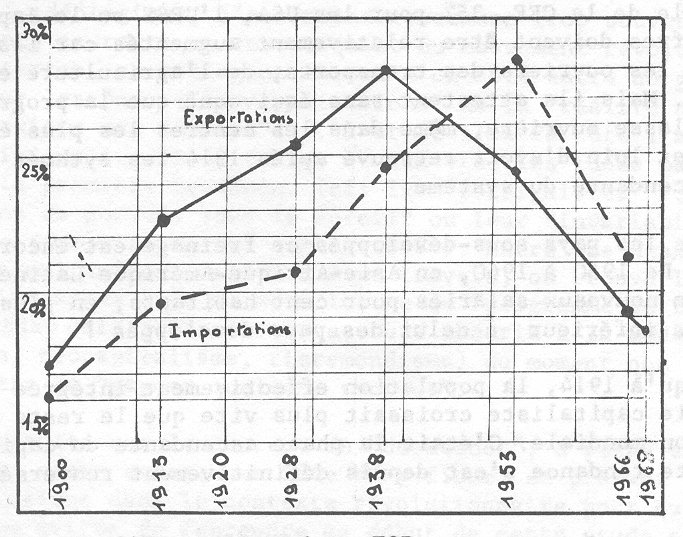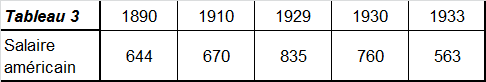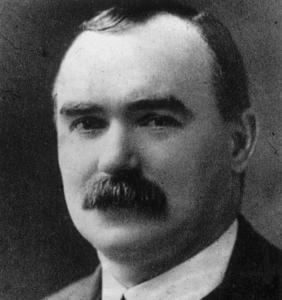Revue Internationale, les années 2010: n°140 - 163
- 4476 lectures
Structure du Site:
Revue Internationale 2010 - n° 140 - 143
- 3209 lectures
Revue Internationale n° 140 - 1er trimestre 2010
- 2605 lectures
Sauver la planète? no, they can't!
"Copenhague se termine sur un échec" (Guardian, Royaume-Uni), "Fiasco à Copenhague", "Résultat grotesque", "Pire qu’inutile" (Financial Times, Royaume-Uni), "Un sommet pour rien" (The Asian Age, Inde), "La douche froide", "Le pire accord de l’histoire" (Libération, France)…La presse internationale est donc presque unanime [1], ce sommet annoncé comme historique s’est révélé catastrophique. Au final, les pays participants à cette grand-messe ont signé un accord en forme de vague promesse lointaine, qui n’engage à rien ni personne : réduire le pic de réchauffement à 2°C en 2050. "L’échec de Copenhague est au-delà de ce que l'on imaginait de pire" selon Herton Escobar, le spécialiste des sciences du quotidien O Estado De São Paulo (Brésil), "Le plus grand événement diplomatique de l'Histoire n’a pas produit le moindre engagement" [2]. Tous ceux qui avaient cru au miracle, la naissance d’un capitalisme vert, ont vu, à l’image de la banquise arctique et de l’Antarctique, leurs illusions fondre d’un coup d’un seul.
Un sommet international pour apaiser les inquiétudes
Le Sommet de Copenhague a été précédé d’une immense campagne publicitaire. Le battage médiatique orchestré à l’échelle internationale fut même assourdissant. Toutes les chaînes de télévisions, les journaux, les magazines ont fait de cet événement un moment historique. Les exemples sont légions.
Dès le 5 juin 2009, le film-documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home, état des lieux dramatique et implacable de l’ampleur de la catastrophe écologique mondiale, a été diffusé simultanément et gratuitement dans 70 pays (à la télévision, sur Internet, dans des cinémas).
Des centaines d’intellectuels et d’associations écologiques ont multiplié les déclarations grandiloquentes pour "réveiller les consciences" et "exercer une pression citoyenne sur les décideurs". En France, la fondation Nicolas Hulot a lancé sous forme d’ultimatum :"L’avenir de la planète et avec lui, le sort d’un milliard d’affamés […] se jouera à Copenhague. Choisir la solidarité ou subir le chaos, l’humanité a rendez-vous avec elle-même". Aux Etats-Unis, le même message d’urgence et de gravité a été délivré : "Les nations du monde se réunissent à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 pour une conférence sur le climat qui est annoncée comme celle de la dernière chance. Ça passe ou ça casse, marche ou crève ou peut-être, littéralement, nage ou coule. De fait, on peut avancer sans se tromper qu’il s’agit de la réunion diplomatique la plus importante de l’histoire du monde." (Bill McKibben, écrivain et militant américain, dans la revue Mother Jones [3]).
Le jour de l’ouverture du sommet, 56 journaux de 45 pays ont pris l’initiative inédite de parler d’une seule voix au travers d’un seul et même éditorial : "A moins que nous nous unissions pour mener une action décisive, le changement climatique va ravager notre planète. […] Le changement climatique […] aura des conséquences indélébiles et nos chances de le dominer se joueront pendant les 14 prochains jours. Nous appelons les représentants des 192 pays réunis à Copenhague à ne pas hésiter, à ne pas sombrer dans les querelles, à ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres[…]. Le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde." [4]
Tous ces discours contiennent une moitié de vérité. Les recherches scientifiques montrent que la planète est en effet bel et bien en train d’être ravagée. Le réchauffement climatique s’aggrave et, avec lui, la désertification, les incendies, les cyclones… La pollution et l’exploitation intensive des ressources entraînent la disparition massive d’espèces. 15 à 37% de la biodiversité devrait disparaître d'ici à 2050. Aujourd'hui, un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70% des plantes sont en danger d’extinction [5]. Selon le Forum humanitaire mondial, le "changement climatique" entraînerait la mort de 300 000 personnes par an (dont la moitié de malnutrition) ! En 2050, il devrait y avoir "250 millions de réfugiés climatiques" [6]. Alors, oui, il y a urgence. Oui, l’humanité est confrontée à un enjeu historique et vital !
Par contre, l’autre moitié du message est un grossier mensonge destiné à bercer d’illusions le prolétariat mondial. Tous en appellent au sens de la responsabilité des gouvernants et à la solidarité internationale face au "danger climatique". Comme si les Etats pouvaient oublier ou dépasser leurs intérêts nationaux propres pour s’unir, coopérer, s’entraider au nom du bien être de l’humanité ! Toutes ces histoires ne sont que des contes à dormir debout inventés pour rassurer une classe ouvrière inquiète de voir la planète peu à peu détruite et des centaines de millions de personnes en souffrir [7]. La catastrophe environnementale montre clairement aux yeux de tous que seule une solution internationale est envisageable. Pour éviter que les ouvriers ne réfléchissent de trop par eux-mêmes à une "solution", la bourgeoisie a voulu prouver qu’elle était capable de mettre de côté ses divisions nationales ou, pour reprendre l’éditorial international des 56 journaux, de "ne pas sombrer dans les querelles", de "ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres" et de comprendre que "le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde."
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objectif est raté et bien raté ! Si Copenhague a bien montré une chose c’est que le capitalisme n’est et ne peut être qu’une "usine à gaz".
Il n’y avait d’ailleurs aucune illusion à se faire, rien de bon ne pouvait sortir de ce sommet. Le capitalisme détruit l’environnement depuis toujours. Déjà, au 19e siècle, Londres était une immense usine crachant sa fumée et déversant ses déchets dans la Tamise. Ce système produit dans l’unique but de faire du profit et accumuler du capital, par tous les moyens. Peu importe si, pour ce faire, il doit raser des forêts, piller les océans, polluer les fleuves, dérégler le climat… Capitalisme et Ecologie sont forcément antagoniques. Toutes les réunions internationales, les comités, les sommets (tel celui de Rio de Janeiro en 1992 ou celui de Kyoto en 1997) n’ont toujours été que des cache-sexes, des cérémonies théâtralisées pour faire croire que les "grands de ce monde" se soucient de l’avenir de la planète. Les Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben et autres Al Gore [8] ont voulu nous faire croire qu’il en serait cette fois-ci autrement, que face à l’urgence de la situation, les hauts-dirigeants allaient se "ressaisir". Pendant que tous ces idéologues brassaient de l’air, ces mêmes "hauts-dirigeants" affûtaient leurs armes éco… nomiques ! Car là est la réalité : le capitalisme est divisé en nations, toutes concurrentes les unes des autres, se livrant sans répit une guerre commerciale et, s’il le faut, parfois militaire.
Un seul exemple. Le pôle Nord est en train de fondre. Les scientifiques y voient une véritable catastrophe écologique : montée des eaux, modifications de la salinité et des courants marins, déstabilisation des infrastructures et érosion des côtes suite à la fonte du pergélisol, libération du CO2 et du méthane de ces sols dégelés, dégradation des écosystèmes arctiques [9]… Les Etats y voient, eux, une "opportunité" d’exploiter des ressources jusqu’ici inaccessibles et d’ouvrir de nouvelles voies maritimes libérées des glaces. La Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Danemark (via le Groenland) se livrent actuellement une guerre diplomatique sans merci, n’hésitant pas à utiliser l’arme de l’intimidation militaire. Ainsi, en août dernier, "Quelque 700 membres des Forces canadiennes, provenant des armées de terre, de mer et de l'air, participent à l'opération pancanadienne NANOOK 09. L'exercice vise à prouver que le Canada est capable d'affirmer sa souveraineté dans l'Arctique, une région convoitée par les États-Unis, le Danemark et, surtout, la Russie, dont certaines récentes tactiques, comme l’envoi d’avion ou de sous-marins, ont irrité Ottawa." [10] Car, effectivement, depuis 2007, l’Etat russe envoie régulièrement ses avions de chasse survoler l’arctique et parfois les eaux canadiennes comme au temps de la Guerre Froide.
Capitalisme et Ecologie sont bel et bien pour toujours antagoniques !
La bourgeoisie ne parvient même plus à sauver les apparences
"L’échec de Copenhague" est donc tout sauf une surprise. Nous l’avions d’ailleurs annoncé dans notre Revue Internationale n°138 dès le 3e trimestre 2009 : "Le capitalisme mondial est totalement incapable de coopérer pour faire face à la menace écologique. En particulier dans la période de décomposition sociale, avec la tendance croissante de chaque nation à jouer sa propre carte sur l'arène internationale, dans la concurrence de tous contre tous, une telle coopération est impossible." Il est plus surprenant, par contre, que tous ces chefs d’Etat n’aient même pas réussi à sauver les apparences. D’habitude, un accord final est signé en grandes pompes, des objectifs bidons sont fixés et tout le monde s’en félicite. Cette fois-ci, il s’agit officiellement d’un "échec historique". Les tensions et les marchandages sont sortis des coulisses et ont été portés au devant de la scène. Même la traditionnelle photo des chefs d’Etats, s’auto-congratulant, bras-dessus, bras-dessous, et affichant de larges sourires d’acteurs de cinéma, n’a pu être réalisée. C’est tout dire !
Ce désaveu est tellement patent, ridicule et honteux que la bourgeoisie a dû faire profil bas. Aux bruyants préparatifs du Sommet de Copenhague a succédé un silence tout aussi assourdissant. Ainsi, au lendemain même de la rencontre internationale, les médias se sont contentés de quelques lignes discrètes pour faire un "bilan" de l’échec (en rejetant d’ailleurs systématiquement la faute sur les autres nations), puis ont évité soigneusement de revenir sur cette sale histoire les jours suivants.
Pourquoi, contrairement aux habitudes, les chefs d’Etats n’ont-ils pas réussi à faire semblant ? La réponse tient en deux mots : crise économique.
Contrairement à ce qui est affirmé partout depuis des mois, la gravité de la récession actuelle ne pousse pas les chefs d’Etat à saisir la "formidable opportunité" de plonger tous ensemble dans "l’aventure de la green economy". Au contraire, la brutalité de la crise attise les tensions et la concurrence internationale. Le sommet de Copenhague a fait la démonstration de la guerre acharnée que sont en train de se livrer les grandes puissances. Il n’est plus l’heure pour eux de faire semblant de bien s’entendre et de proclamer des accords (même bidons). Ils sortent les couteaux, tant pis pour la photo !
Depuis l’été 2007 et le plongeon de l’économie mondiale dans la plus grave récession de l’histoire du capitalisme, il y a une tentation croissante de céder aux sirènes du protectionnisme et une montée du chacun pour soi. Evidemment, de par sa nature même, le capitalisme est divisé depuis toujours en nations qui se livrent une guerre économique sans merci. Mais le krach de 1929 et la crise des années 1930 avaient révélé aux yeux de la bourgeoisie le danger d’une absence totale de règles et de coordinations internationales du commerce mondial. En particulier, après la Seconde Guerre mondiale, les blocs de l’Est et de l’Ouest s’étaient organisés en leur sein et avaient édifié un minimum de lois organisant les relations économiques. Partout, par exemple, le protectionnisme outrancier avait été interdit car identifié comme un facteur nocif pour le commerce mondial et donc, in fine, pour toutes les nations. Ces grands accords (tel que Bretton Woods, 1944) et les institutions chargée de faire respecter ces nouvelles règles (tel que le Fond Monétaire International) ont effectivement participé à amoindrir les effets du ralentissement économique qui frappe le capitalisme depuis 1967.
Mais la gravité de la crise actuelle est venue mettre à mal toutes ces règles de fonctionnement. La bourgeoisie a bien tenté de réagir de façon unie, en organisant les fameux G20 de Pittsburgh et de Londres, mais le chacun pour soi n’a cessé, mois après mois, de gagner du terrain. Les plans de relance sont de moins en moins coordonnés entre les nations et la guerre économique monte en agressivité. Le Sommet de Copenhague est venu confirmer de façon éclatante cette tendance.
Il faut dire que, contrairement aux mensonges sur une prétendue "sortie du tunnel" et sur une reprise de l’économie mondiale, la récession ne cesse de s’aggraver et a même subi une nouvelle accélération en cette fin d’année 2009. "Dubaï, la faillite en ligne d’émir", "La Grèce est au bord de la faillite" (Libération, respectivement des 27 novembre et 9 décembre) [11]. Ces annonces ont été comme des coups de tonnerre. Chaque Etat sent son économie nationale véritablement en danger et est conscient que l’avenir est à une récession de plus en plus profonde. Pour empêcher l’économie capitaliste de s’enfoncer trop rapidement dans la dépression, la bourgeoisie n’a en effet pas eu d’autre choix depuis l’été 2007 que de créer et injecter massivement de la monnaie et de creuser par-là même les déficits publics et budgétaires. Ainsi, comme le pointe un rapport de novembre 2009 publié par la banque Société Générale "Le pire pourrait être devant nous". Selon cette banque, "les récents plans de sauvetage mis en place par les gouvernements mondiaux ont simplement transféré des passifs du secteur privé au secteur public, créant une nouvelle série de problèmes. Premier d’entre eux, le déficit. […] Le niveau de la dette paraît tout à fait insoutenable à long terme. Nous avons pratiquement atteint un point de non-retour en ce qui concerne la dette publique" [12]. L’endettement global est beaucoup trop élevé dans la plupart des économies des pays développés, par rapport à leur PIB. Aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne, la dette publique représentera ainsi 125% du PIB dans deux ans. Au Royaume-Uni, elle s’élèvera à 105% et au Japon, à 270% (toujours d’après le rapport). Et la Société Générale n’est pas la seule à tirer la sonnette d’alarme. En mars 2009, le Crédit Suisse avait établi la liste des dix pays les plus menacés par la faillite, en comparant l’importance des déficits et le PIB. Pour l’instant, cette sorte de "Top 10" a "tapé dans le mille" puisqu’il était constitué, dans l’ordre, de l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Lettonie, la Roumanie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Irlande et la Hongrie [13]. Autre preuve de cette inquiétude, sur les marchés financiers un nouveau sigle est apparu : PIGS. "Aujourd’hui ce sont les PIGS : Portugal, Italie, Grèce, Espagne [Spain en anglais, NDLR] qui font trembler la planète. Après l’Islande et Dubaï, ces quatre pays surendettés de la zone euro sont considérés comme possible bombes à retardement de l’économie mondiale" [14].
En réalité, tous les Etats face à leur déficit abyssal vont devoir réagir et mener une politique d’austérité. Concrètement, cela signifie qu’ils vont :
- développer une très forte pression fiscale (augmenter les impôts) ;
- diminuer encore plus drastiquement les dépenses en supprimant des dizaines ou des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, en réduisant de façon draconienne les allocations retraites, les indemnités chômages, les aides familiales et sociales, les remboursements de soins,…
- et, évidemment, mener une politique de plus en plus agressive, sans foi ni loi, sur le marché du commerce international.
Bref, cette situation économique désastreuse exacerbe la concurrence. Chaque Etat est aujourd’hui peu enclin à accepter la moindre concession ; il livre une bataille acharnée pour la survie de son économie nationale contre les autres bourgeoisies. C’est cette tension, cette guerre économique qui a rejailli à Copenhague.
Les quotas écologiques comme armes économiques
A Copenhague, tous les Etats sont donc venus non pas pour sauver la planète mais pour se défendre bec et ongles. Leur seul but était, pour chacun, d’utiliser "l’écologie" pour faire adopter des règles qui les avantageaient et qui, surtout, handicapaient les autres.
Les Etats-Unis et la Chine sont accusés, par la majorité des autres pays, d’être les principaux responsables de l’échec. Ils ont effectivement refusé tous deux que soit fixé un quelconque objectif chiffré de baisse de production de CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Il faut dire qu’à ce petit jeu, les deux plus gros pollueurs de la planète étaient aussi ceux qui, forcément, avaient le plus à perdre [15]. "Si les objectifs du GIEC [16] sont retenus [c’est à dire une baisse de 40% de CO2 d’ici à 2050, NDLR], en 2050, chaque habitant du monde ne devra plus émettre que 1,7 tonne maximum de CO2 par an. Or, chaque américain en produit en moyenne 20 tonnes !" [17]. Quant à la Chine, son industrie tourne presque exclusivement grâce aux centrales à charbon qui "engendrent 20% des émissions mondiales de ce gaz. C’est plus que tous les transports réunis : voitures, camions, trains, bateaux et avions" [18]. On comprend aussi pourquoi tous les autres pays tenaient tant à "fixer des objectifs chiffrés" de baisse du CO2 !
Mais il ne faut pas croire ici que les Etats-Unis et la Chine ont fait cause commune pour autant. L’Empire du milieu a, au contraire, lui aussi exigé une baisse de 40% d’émission de CO2 d’ici à 2050 pour… les Etats-Unis et l’Europe. Elle devait, par contre, en être naturellement soustraite en tant que "pays émergent". "Les pays émergents, notamment l'Inde et la Chine, réclamaient aux pays riches de forts engagements sur la réduction des gaz à effet de serre mais refusaient d'être soumis à des objectifs contraignants." [19]
L'Inde a utilisé à peu près le même stratagème, une baisse pour les autres mais pas pour elle, en justifiant sa politique par le fait "qu'elle abrite des centaines de millions de pauvres et que le pays ne peut guère se permettre des efforts considérables". Les "pays émergents" ou "en voie de développement", souvent présentés dans la presse comme les premières victimes du fiasco de Copenhague, n’ont ainsi pas hésité à instrumentaliser la misère de leurs populations pour défendre leurs intérêts de bourgeois. Le délégué du Soudan, qui représentait l'Afrique, n’a pas hésité à comparer la situation à celle de l'holocauste. "C'est une solution fondée sur des valeurs qui ont envoyé six millions de personnes dans les fours en Europe." [20] Ces dirigeants, qui affament leur population et qui parfois même les massacrent, osent aujourd’hui, sans vergogne, invoquer leurs "malheurs". Au Soudan, par exemple, ce n’est pas dans l’avenir à cause du climat mais dès aujourd’hui, par les armes, que des millions de personnes se font massacrer !
Et l’Europe, elle qui joue à la dame de bonne vertu, comment a-t-elle défendu "l’avenir de la planète" ? Prenons quelques exemples. Le président français Nicolas Sarkozy a fait une déclaration tonitruante à l’avant-dernier jour du sommet, "Si on continue comme ça, c'est l'échec. […] tous, nous devrons faire des compromis […] L'Europe et les pays riches, nous devons reconnaître que notre responsabilité est plus lourde que les autres. Notre engagement doit être plus fort. […] Qui osera dire que l'Afrique et les pays les plus pauvres n'ont pas besoin de l'argent ? […] Qui osera dire qu'il ne faut pas un organisme pour comparer le respect des engagements de chacun ?" [21] Derrière ces grandes tirades se cache une réalité bien plus sinistre. L’Etat français et Nicolas Sarkozy se sont battus pour une baisse chiffrée des émissions de CO2 et, surtout, pour que… le nucléaire, ressource vitale de l’économie hexagonale, ne soit en rien limité ! Cette énergie pourtant fait aussi peser une lourde menace, telle une épée de Damoclès, au dessus de l’humanité. L’accident de la centrale de Tchernobyl a fait entre 4000 et 200 000 morts selon les estimations (selon que l’on intègre ou non les victimes de cancers liés aux radiations). Avec la crise économique, dans les décennies à venir, les Etats auront de moins en moins les moyens d’entretenir les centrales et les accidents seront de plus en plus probables. Et dés aujourd’hui, le nucléaire pollue massivement. L’Etat français fait croire que ses déchets radioactifs sont traités "proprement" à La Hague alors que, pour faire des économies, il en exporte une grande partie en douce en Russie : "c’est près de 13 % des matières radioactives produites par notre parc nucléaire qui dorment quelque part au fin fond de la Sibérie. Précisément dans le complexe atomique de Tomsk-7, une ville secrète de 30 000 habitants, interdite aux journalistes. Là-bas, chaque année, depuis le milieu des années 1990, 108 tonnes d’uranium appauvri issues des centrales françaises viennent, dans des containers, se ranger sur un grand parking à ciel ouvert." [22] Autre exemple. Les Pays d’Europe du Nord sont réputés pour être à la pointe de l’écologie, de vrais petits modèles. Et pourtant, en ce qui concerne la lutte contre la déforestation,… "la Suède, la Finlande, ou l’Autriche freinent des quatre fers pour que rien ne bouge" [23]. La raison ? Leur production énergétique est extrêmement dépendante du bois et ils sont de grands exportateurs de papier. La Suède, la Finlande et l’Autriche se sont donc retrouvées à Copenhague aux côtés de la Chine qui, elle, en tant que premier producteur mondial de meubles en bois, ne voulait pas non plus entendre parler d’une quelconque limitation de la déforestation.Il ne s’agit pas là d’un détail : "La déforestation est en effet responsable d’un cinquième des émissions mondiales de CO2." [24] et "La destruction des forêts pèse lourd dans la balance climatique […]. Environ 13 millions d'hectares de forêts sont coupés chaque année, soit l'équivalent de la surface de l'Angleterre, et c'est cette déforestation massive qui a fait de l'Indonésie et du Brésil les troisième et quatrième plus gros émetteurs de CO2 de la planète." [25] Ces trois pays européens, officiellement preuves vivantes qu’une économie capitaliste verte est possible (sic !), "se sont vu décerner le prix de Fossil of the Day [26] lors du premier jour des négociations pour leur refus d’endosser leur responsabilité en matière de conversion des terres forestières." [27]
Un pays résume à lui seul tout le cynisme bourgeois qui entoure "l’écologie" : la Russie. Depuis des mois, le pays de Poutine crie haut et fort qu’il est favorable à un accord chiffré sur les émissions de CO2. Cette position peut surprendre quand on connaît l’état de la nature en Russie. La Sibérie est polluée par la radioactivité. Ses armes nucléaires (bombes, sous-marins…) rouillent dans des cimetières. L’Etat russe serait-il pris de remords ? "La Russie se présente comme la nation modèle en matière d’émissions de CO2. Mais ce n’est qu’un tour de passe-passe. Voici pourquoi. En novembre, Dimitri Medvedev [le président russe, NDLR] s’est engagé à réduire les émissions russes de 20% d’ici à 2020 (sur la base de 1990 [28]), soit plus que l’Union européenne. Mais il n’y a là aucune contrainte puisque, en réalité, les émissions russes ont déjà diminué de… 33% depuis 1990 en raison de l’effondrement du PNB russe après la chute de l’Union soviétique. En fait, Moscou cherche à pouvoir émettre plus de CO2 dans les années à venir afin de ne pas brider sa croissance (si celle-ci revient…). Les autres pays ne vont pas accepter cette position facilement.[29]".
Jamais le capitalisme ne sera "vert". Demain, la crise économique va frapper encore plus fort. Le sort de la planète sera alors le dernier des soucis de la bourgeoisie. Elle ne cherchera qu’une seule chose : soutenir son économie nationale, en s’affrontant toujours plus durement aux autres pays, en fermant les usines pas assez rentables, quitte à les laisser pourrir sur place, en réduisant les coûts de production, en coupant dans les budgets sur l’entretien des usines et des centrales énergétiques (nucléaires ou à charbon), ce qui signifiera aussi plus de pollution et d’accidents industriels. Voici l’avenir que nous réserve le capitalisme : une crise économique profonde, une infrastructure pourrissantes et ultra-polluantes et des souffrances croissantes pour l’humanité.
Il est temps de détruire le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et ne décime l’humanité !
Pawel (6 janvier 2010)
1. Seuls les journaux américains et chinois évoquent un "succès", "un pas en avant". Nous expliquerons pourquoi un peu plus loin.
2. www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [3]
3. https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [4]
4. https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [5]
5. https://www.planetoscope.com/biodiversite [6]
6. www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468 [7]
7. Il n’est pas à exclure qu’une grande partie des intellectuels et responsables d’association écologiques croient eux-mêmes aux histoires qu’ils inventent. C’est d’ailleurs même très probablement le cas.
8. Prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le réchauffement climatique avec son film-documentaire "Une vérité qui dérange" !
9. m.futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74
10. ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [8]
11. La liste ne fait ici que s’allonger puisque depuis la fin 2008, début 2009, l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie sont déjà estampillées "Etat en faillite".
12. Rapport [9] rendu public par le Telegraph (journal anglais) du 18 novembre 2009.
13. Source : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir
14. Le nouvel Observateur, magazine français, du 3 au 9 décembre.
15. D’où le cri de victoire de la presse américaine et chinoise (souligné dans notre introduction) pour qui, l’absence d’accord est "un pas en avant".
16. Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
17. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre, numéro spécial Copenhague.
18. Idem.
19. www.nouvelobs.com/rue89 [10]
20. Les Echos du 19 décembre 2009.
21. Le Monde du 17 décembre 2009.
22. "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie", Libération du 12 octobre 2009.
23. Euronews (chaîne de télévision européenne) du 15 décembre 2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)
24. www.rtl.be/info/monde/international/wwf-l-europe-toujours-faible-dans-la-lutte-contre-la-deforestation-143082.aspx [11]
25. La Tribune (quotidien français) du 19 décembre 2009.
26. Ce prix est décerné par un regroupement de 500 ONG liées à l’environnement et "récompense" les individus ou les Etats qui, pour user d’un euphémisme, "traînent des pieds" dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la semaine de Copenhague, presque tous les pays ont eu droit à leur Fossil of the Day.
27. Le Soir (quotidien belge) du 10 décembre 2009.
28. 1990 est l’année de référence pour les émissions de gaz à effet de serre, pour tous les pays, depuis le Protocole de Kyoto.
29. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre.
L'immigration et le mouvement ouvrier
- 5944 lectures
Avec l’aggravation de la crise économique et de la décomposition sociale, partout dans le monde les conditions de vie sont de plus en plus intolérables, en particulier dans les pays du Tiers-Monde. La misère, les catastrophes naturelles, les guerres, le nettoyage ethnique, la famine, la barbarie totale sont la réalité quotidienne pour des millions de gens et leurs effets cumulés poussent à l’émigration de masse. Des millions de personnes fuient vers les grandes métropoles capitalistes ou vers d’autres pays également sous-développés mais qui sont dans une situation un peu moins désespérée.
Les Nations Unies estiment que 200 millions d’immigrés – environ 3% de la population mondiale – vivent hors de leur pays d’origine, le double de 1980. Aux Etats-Unis, 33 millions d'habitants sont nés à l'étranger, environ 11,7 %de la population ; en Allemagne, 10,1 millions, 12,3 % ; en France, 6,4 millions, 10,7 % ; au Royaume Uni, 5,8 millions, 9,7 % ; en Espagne, 4,8 millions, 8,5 % ; en Italie, 2,5 millions, 4,3 % ; en Suisse, 1,7 million, 22,9% et aux Pays-Bas, 1,6 million. 1 Les sources gouvernementales et médiatiques estiment qu’il y a plus de 12 millions d’immigrés clandestins aux Etats-Unis et plus de 8 millions en Union européenne. Dans ce contexte, l’immigration est devenue une question politique brûlante dans toutes les métropoles capitalistes, et même dans le Tiers-Monde, comme les récentes émeutes anti-immigrés en Afrique du Sud l'ont montré.
Bien qu’il existe des variations selon les pays et leurs spécificités, l’attitude de la bourgeoisie face à cette immigration massive suit en général le même schéma en trois volets : 1) encourager l’immigration pour des raisons économiques et politiques 2) simultanément la restreindre et tenter de la contrôler et 3) orchestrer des campagnes idéologiques pour attiser le racisme et la xénophobie contre les immigrés afin de diviser la classe ouvrière.
Encourager l’immigration : La classe dominante compte sur les travailleurs immigrés, légaux ou illégaux, pour occuper des emplois mal payés, peu attractifs pour les ouvriers du pays, et pour servir d’armée de réserve de chômeurs et de main d'œuvre sous-employée, afin de faire baisser les salaires de toute la classe ouvrière et de pallier à la diminution de la main d’œuvre résultant du vieillissement de la population et de la baisse des taux de natalité. Aux Etats-Unis, la classe dominante est tout à fait consciente que des industries entières comme le petit commerce, la construction, le traitement de la viande et de la volaille, les services de nettoyage, les hôtels, la restauration, les services de santé à domicile et de garde d’enfants reposent grandement sur le travail immigré, légal ou illégal. C’est pourquoi les revendications de l’extrême droite de renvoyer 12 millions d’immigrés illégaux et de réduire l’immigration légale ne représentent en aucun cas une alternative politique rationnelle pour les fractions dominantes de la bourgeoisie américaine et ont été rejetées comme irrationnelles, impraticables et nuisibles pour l’économie des Etats-Unis.
Restreindre et contrôler : En même temps, la fraction dominante reconnaît la nécessité de résoudre la question du statut des immigrés sans papier afin de garder un contrôle sur une multitude de problèmes sociaux, économiques et politiques, y compris l'existence et l'attribution de services médicaux, sociaux, éducatifs et d'autres services publics, ainsi que toute une série de questions légales relatives aux enfants d’immigrés nés aux Etats-Unis et à leurs biens. C’était la toile de fond de la réforme sur l’immigration proposée au printemps 2007 aux Etats-Unis qui a été soutenue par l’administration Bush et les Républicains, par les Démocrates (y compris leur aile gauche incarnée par l'ancien sénateur Edward Kennedy), et par les grandes entreprises. Loin d’être en faveur de l’immigration, la loi demandait de restreindre la frontière et de la militariser, la légalisation des immigrés sans papiers déjà présents dans le pays et des mesures de contrôle des futurs immigrés. Tout en proposant des moyens aux immigrés illégaux déjà présents dans le pays de légaliser leur statut, elle ne constituait en aucun cas une "amnistie" et comportait des délais et des amendes énormes.
Les campagnes idéologiques : les campagnes de propagande contre les immigrés varient selon les pays, mais le cœur de leur message est remarquablement similaire ; il vise en premier lieu les "Latinos" aux Etats-Unis et les Musulmans en Europe, sous prétexte que ces derniers immigrés, en particulier les sans-papiers, seraient responsables de l’aggravation de la crise économique et des conditions sociales auxquelles est confrontée la classe ouvrière "du pays", car ils prendraient ses emplois, feraient baisser ses salaires, encombreraient les écoles avec leurs enfants, mettraient à sec les programmes d’assistance sociale, augmenteraient la criminalité et tous les autres malheurs sociaux auxquels on pourrait penser. C’est un exemple classique de la stratégie du capitalisme de diviser pour régner, diviser les ouvriers entre eux de sorte qu’ils s'accusent mutuellement d'être responsables de leurs problèmes, qu’ils se bagarrent pour des miettes, plutôt que de comprendre que c’est le système capitaliste le responsable de leurs souffrances. Cela sert à saper la capacité de la classe ouvrière à reprendre conscience de son identité de classe et de son unité, ce que la bourgeoisie redoute par dessus tout. Le plus typique, c’est que la division du travail au sein de la bourgeoisie assigne à l’aile droite la tâche d’attiser et d'exploiter le sentiment anti-immigrés dans toutes les grandes métropoles capitalistes, avec un succès plus ou moins grand, trouvant un écho dans certains secteurs du prolétariat ; mais nulle part il n’a atteint le niveau de barbarie des émeutes xénophobes contre les immigrés en Afrique du Sud en mai 2008.
L’aggravation des conditions dans les pays sous-développés dans les années à venir, qui comprend non seulement les effets de la décomposition et de la guerre mais, aussi, du changement climatique, signifie que la question de l’immigration prendra probablement encore plus d'importance dans le futur. Il est crucial que le mouvement ouvrier soit clair sur la signification du phénomène de l’immigration, sur la stratégie de la bourgeoisie face à celle-ci, sur sa politique et ses campagnes idéologiques, et sur la perspective du prolétariat sur cette question. Dans cet article nous examinerons le rôle historique de l'immigration de populations dans l’histoire du capitalisme, l’histoire de la question de l’immigration au sein du mouvement ouvrier sur, la politique d’immigration de la bourgeoisie et une orientation pour l’intervention des révolutionnaires sur l’immigration.
L’immigration et le développement capitaliste
Dans sa période ascendante, le capitalisme accordait une importance énorme à la mobilité de la classe ouvrière comme facteur de développement de son mode de production. Sous le féodalisme, la population travailleuse était attachée à la terre, ne se déplaçant quasiment pas au cours de toute sa vie. En expropriant les producteurs agricoles, le capitalisme a contraint de larges populations à quitter la campagne pour la ville, à vendre leur force de travail, fournissant une réserve indispensable de force de travail. Comme l’a noté Révolution Internationale dans son article "La classe ouvrière, une classe d’immigrés",2 "Au début du capitalisme, pendant sa période d’ "accumulation primitive", les liens des premiers travailleurs salariés avec leurs seigneurs féodaux furent rompus et "[les révolutions] dépouillant de grandes masses de leurs moyens de production et d'existence traditionnels, les lancent à l'improviste sur le marché du travail, prolétaires sans feu ni lieu. Mais la base de toute cette évolution, c'est l'expropriation des cultivateurs" 3 ". Comme l’a écrit Lénine, "le capitalisme entraîne inévitablement une mobilité de la population dont les régimes économiques antérieurs n'avaient pas besoin et qui, sous ces régimes, ne pouvait pas exister sur une échelle un tant soit peu importante" 4 (cités dans World Revolution n °300). Avec l’avancée de l’ascendance, la migration massive avait une importance décisive pour le développement du capitalisme dans sa période d’industrialisation. Le mouvement et le déplacement de masses d’ouvriers vers les lieux où le capital en avait besoin; étaient essentiels. De 1848 à 1914, 50 millions de personnes quittèrent l’Europe, la grande majorité alla s’installer aux Etats-Unis. Rien qu’entre 1900 et 1914, 20 millions de personnes émigrèrent d’Europe aux Etats-Unis. En 1900, la population américaine était approximativement de 75 millions; en 1914 d’environ 94 millions - ce qui veut dire qu’en 1914, plus d’un cinquième était composée de nouveaux immigrés – sans compter ceux qui étaient arrivés avant 1900. Si l’on comptabilise les enfants d'immigrés nés aux Etats-Unis, l’impact des immigrés sur la vie sociale est encore plus significatif. Pendant cette période, la bourgeoisie américaine a essentiellement suivi une politique d’ouverture complète à l’immigration (à l’exception de restrictions envers les immigrés d’Asie). Ce qui motivait les ouvriers immigrés à se déraciner, était la promesse d’améliorer leur niveau de vie, la fuite de la pauvreté et de la famine, de l’oppression et du manque de perspectives.
De pair avec sa politique encourageant l’immigration, la bourgeoisie n’hésita pas à mener, en même temps, des campagnes xénophobes et racistes pour diviser la classe ouvrière. On montait ceux qu’on appelait les ouvriers "natifs" ("native" workers, ouvriers "du pays", "de souche"), - et dont certains étaient eux-mêmes de la deuxième ou troisième génération descendant d’immigrés – contre les nouveaux arrivants qu'on dénonçait pour leurs différences linguistiques, culturelles et religieuses. Même parmi les nouveaux arrivants, les antagonismes ethniques étaient utilisés pour alimenter la stratégie de division. Il est important de se rappeler que la peur et la méfiance envers les étrangers ont de profondes racines psychologiques dans cette société, et le capitalisme n’a jamais hésité à exploiter ce phénomène pour ses propres fins sordides. La bourgeoisie, américaine en particulier, a utilisé cette tactique de "diviser pour régner" pour contrecarrer la tendance historique à l’unité de la classe ouvrière et mieux asservir le prolétariat. Dans une lettre à Hermann Schlüter, en 1892, Engels notait : "Votre bourgeoisie sait beaucoup mieux que le gouvernement autrichien lui-même jouer une nationalité contre l'autre : Juifs, Italiens, Bohèmes, etc., contre Allemands et Irlandais, et chacun d'eux contre les autres." C’est une arme idéologique classique de l’ennemi de classe.
Alors que l’immigration dans la période d’ascendance du capitalisme a été en grande partie alimentée pour satisfaire aux besoins de force de travail d’un mode de production historiquement progressiste, en développement et s’étendant rapidement, dans la décadence, avec le ralentissement des taux de croissance exponentiels, les motifs de l’immigration résultèrent de facteurs beaucoup plus négatifs. La nécessité de fuir la persécution, la famine et la pauvreté qui a poussé des millions d’ouvriers pendant la période d’ascendance à émigrer pour trouver un travail et une vie meilleure, s’est accrue inévitablement dans la période de décadence, à un degré d’urgence supérieur. Les nouvelles caractéristiques de la guerre dans la décadence notamment ont donné une nouvelle impulsion à l’émigration de masse et au flot de réfugiés. Dans l’ascendance, les guerres se limitaient avant tout au conflit entre armées professionnelles sur les champs de bataille. Avec le début de la décadence, la nature de la guerre se transforma de façon significative, impliquant toute la population et tout l’appareil économique du capital national. Terroriser et démoraliser la population civile devint un objectif tactique primordial et amena à des migrations massives de réfugiés au 20e et maintenant au 21e siècle. Au cours de la guerre actuelle en Irak par exemple, on estime à deux millions les réfugiés recherchant la sécurité en Jordanie et en Syrie surtout. Les émigrants qui fuient leur pays d’origine sont encore persécutés sur la route par les policiers et les militaires corrompus, la mafia et les criminels qui leur extorquent leurs biens, les brutalisent et les volent au cours de leur voyage désespéré vers ce qu’ils espèrent une vie meilleure. Beaucoup d’entre eux meurent ou disparaissent en cours de route, certains tombent entre les mains de trafiquants d’hommes. Il faut remarquer que les forces de la justice et de l’ordre capitalistes semblent incapables ou ne veuillent pas faire quoi que ce soit pour soulager des maux sociaux qui accompagnent l’immigration massive de la période actuelle.
Aux Etats-Unis, la décadence s’est accompagnée d’un changement abrupt : d’une politique de large ouverture à l’immigration (sauf en ce qui concerne les restrictions de longue date envers les Asiatiques) à des politiques gouvernementales d’immigration extrêmement restrictives. Avec le changement de période économique, il y eut globalement moins besoin d’un afflux continuel et massif de force de travail. Mais ce ne fut pas la seule raison d’une immigration plus contrôlée, des facteurs racistes et « anti-communistes » intervenant également. .Le National Origins Act, loi adoptée en 1924, limita le nombre d’émigrants venant d’Europe à 150 000 personnes par an et fixa le quota pour chaque pays sur la base de la composition ethnique de la population américaine en 1890 – avant la vague massive d’émigration en provenance d’Europe de l’Est et du Sud. Les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient en partie visés sur la base d’un racisme éhonté afin de ralentir l’augmentation d’éléments "indésirables" comme les Italiens, les Grecs, les Européens de l’Est et les Juifs. Pendant la période de "Peur rouge" aux Etats-Unis qui a suivi la Révolution russe, les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient considérés comme incluant probablement un nombre disproportionné de "Bolcheviks" et ceux d’Europe du Sud, d’anarchistes. En plus de restreindre le flot des immigrés, la loi de 1924 créa, pour la première fois aux Etats-Unis, le concept d’ouvrier étranger non immigrant - qui pouvait venir aux Etats-Unis mais n’avait pas le droit d’y rester.
En 1950, le McCarran-Walter Act fut promulgué. Très influencé par le McCarthysme et l’hystérie anti-communiste de la Guerre froide, cette loi imposait de nouvelles limites à l’immigration sous couvert de lutte contre l’impérialisme russe. A la fin des années 1960, avec le début de la crise ouverte du capitalisme mondial, l’immigration américaine se libéralisa, augmentant le flot d’immigrés vers les Etats-Unis, qui venaient non seulement d’Europe, mais aussi d’Asie et d’Amérique latine, reflétant en partie le désir du capitalisme américain d’égaler le succès des puissances européennes en drainant leurs anciens pays coloniaux de travailleurs intellectuels qualifiés et talentueux, comme les scientifiques, les docteurs en médecine, les infirmiers et d’autres professions – ce qu’on appelle "la fuite des cerveaux" des pays sous-développés, et pour fournir des ouvriers agricoles peu payés. La conséquence inattendue des mesures de libéralisation fut l’augmentation spectaculaire de l’immigration, tant légale qu’illégale, en particulier en provenance d’Amérique latine.
En 1986, la politique américaine anti-immigration fut mise à jour avec la promulgation du Simpson-Rodino Immigration and naturalization Control Reform Act qui traitait de l’afflux d’immigrés illégaux venant d’Amérique latine et imposait, pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique, des sanctions (amendes et même emprisonnement) contre les employeurs qui embauchaient en connaissance de cause des ouvriers sans papiers. L’afflux d’immigrés illégaux s’était intensifié avec l’effondrement économique des pays du Tiers-Monde pendant les années 1970, et avait déclenché une vague d'émigration des masses appauvries fuyant le dénuement au Mexique, à Haïti et au Salvador ravagé par la guerre. L'énormité de cette vague hors de contrôle est reflétée par le nombre record de 1,6 million d'arrestations d’immigrés clandestins en 1986 par la police américaine de l’immigration.
Au niveau des campagnes idéologiques, l’utilisation de la stratégie "diviser pour régner" face à l’immigration, déjà utilisée comme outil tactique contre le prolétariat pendant l’ascendance du capitalisme, a atteint de nouveaux sommets pendant la décadence. Les immigrés sont accusés d'envahir les métropoles, de faire baisser les salaires et de les dévaloriser, d’être la cause de l’épidémie de criminalité et de "pollution" culturelle, de remplir les écoles, d'alourdir les programmes sociaux – bref de tous les problèmes sociaux imaginables. Cette tactique ne se limite pas aux Etats-Unis mais est également utilisée en France, en Allemagne et dans toute l’Europe où les immigrés d’Europe de l'Est servent de boucs-émissaires pour les calamités sociales dues à la crise et au capitalisme en décomposition, dans des campagnes idéologiques remarquablement similaires, démontrant ainsi que l'immigration de masse est une manifestation de la crise économique globale et de la décomposition sociale qui s'aggravent dans les pays moins développés. Tout ceci a pour but de créer des obstacles et de bloquer le développement de la conscience de classe dans la classe ouvrière, d'essayer d’embobiner les ouvriers pour qu’ils ne comprennent pas que c’est le capitalisme qui crée les guerres, la crise économique et tous les problèmes sociaux caractéristiques de sa décomposition sociale.
L'impact social de l'aggravation de la décomposition et des crises qui vont avec ainsi que le développement de la crise écologique amèneront sans aucun doute des millions de réfugiés vers les pays développés dans les années à venir. Si ces mouvements massifs et soudains de populations sont traités autrement que l’immigration de routine, ils le sont toujours d’une façon qui reflète l’inhumanité fondamentale de la société capitaliste. Les réfugiés sont souvent parqués dans des camps, séparés de la société qui les entoure et seulement relâchés et intégrés lentement, parfois après de nombreuses années ; ils sont plus traités comme des prisonniers et des indésirables que comme des membres de la communauté humaine. Une telle attitude est en totale opposition avec la solidarité internationaliste qui constitue clairement la perspective prolétarienne.
La position historique du mouvement ouvrier sur l'immigration
Confronté à l’existence de différences ethniques, de race et de langue chez les ouvriers, historiquement, le mouvement ouvrier a été guidé par le principe : "les ouvriers n’ont pas de patrie", un principe qui a influencé à la fois la vie interne du mouvement ouvrier révolutionnaire et l'intervention de ce mouvement dans la lutte de classe. Tout compromis envers ce principe représente une capitulation envers l’idéologie bourgeoise.
Ainsi, par exemple, en 1847, les membres allemands de la Ligue des Communistes exilés à Londres, bien que préoccupés au premier chef par la propagande envers les ouvriers allemands, ont adhéré à la vision internationaliste et ont "maintenu des relations étroites avec les réfugiés politiques de toutes sortes de pays." 5 A Bruxelles, la Ligue a "organisé un banquet internationaliste pour démontrer les sentiments fraternels que les ouvriers avaient pour les ouvriers des autres pays... Cent vingt ouvriers participèrent à ce banquet dont des Belges, des Allemands, des Suisses, des Français, des Polonais, des Italiens et un Russe". 6 Vingt ans plus tard, la même préoccupation a poussé la Première Internationale à intervenir dans les grèves avec deux objectifs centraux : empêcher la bourgeoisie de faire venir des briseurs de grève de l'étranger et apporter un soutien direct aux grévistes comme elle le fit envers les fabricants de tamis, les tailleurs et les vanniers à Londres et envers les fondeurs de bronze à Paris. 7 Lorsque la crise économique de 1866 provoqua une vague de grèves à travers toute l'Europe, le Conseil général de l'Internationale "soutint les ouvriers par ses conseils et son assistance et mobilisa la solidarité internationale du prolétariat en leur faveur. De cette façon, l'Internationale priva la classe capitaliste d'une arme très efficace et les patrons ne purent plus freiner la combativité de leurs ouvriers en important une main d'œuvre étrangère bon marché... Là où elle avait de l'influence, elle cherchait à convaincre les ouvriers que c'était dans leur intérêt de soutenir les luttes salariales de leurs camarades étrangers." 8 De même, en 1871, lorsque le mouvement pour la journée de 9 heures se développa en Grande-Bretagne, organisé par la Nine Hours League et non par les syndicats qui restèrent en dehors de la lutte, la Première Internationale lui apporta son soutien en envoyant des représentants en Belgique et au Danemark pour "empêcher les intermédiaires des patrons de recruter des briseurs de grève dans ces pays, ce qu'ils réussirent avec beaucoup de succès." 9
L'exception la plus marquante à cette position internationaliste eut lieu aux Etats-Unis en 1870-71 où la section américaine de l'Internationale s'opposa à l'immigration d'ouvriers chinois aux Etats-Unis parce que les capitalistes les utilisaient pour faire baisser les salaires des ouvriers blancs. Un délégué de Californie se plaignit du fait que "les Chinois ont fait perdre des milliers d'emplois aux hommes, femmes et enfants blancs". Cette position exprimait une interprétation erronée de la critique portée par Marx au despotisme asiatique en tant que mode de production anachronique dont la domination en Asie devait être renversée pour que le continent asiatique s'intègre dans les rapports de production modernes et pour que se constitue un prolétariat moderne en Asie. Le fait que les travailleurs asiatiques ne soient pas encore prolétarisés et soient donc susceptibles d'être manipulés et surexploités par la bourgeoisie, n'a malheureusement pas constitué une impulsion pour étendre la solidarité à cette main d'œuvre et pour l'intégrer dans la classe ouvrière américaine dans son ensemble, mais a servi à donner une explication rationnelle à l'exclusion raciste.
Quoi qu'il en soit, la lutte pour l'unité de la classe ouvrière internationale se poursuivit dans la Deuxième Internationale. Il y a un peu plus de cent ans, au Congrès de Stuttgart de 1907, l'Internationale rejeta massivement une tentative opportuniste proposant de soutenir la restriction par les gouvernements bourgeois de l'immigration chinoise et japonaise. L'opposition fut si grande que les opportunistes furent en fait contraints de retirer leur résolution. A la place, le Congrès adopta une position anti-exclusion pour le mouvement ouvrier dans tous les pays. Dans le Rapport qu'il fait de ce Congrès, Lénine écrivit : "Sur cette question [de l'immigration] également se fit jour en commission une tentative de soutenir d'étroites conceptions de corporation, d'interdire l'immigration d'ouvriers en provenance des pays arriérés (celle des coolies venus de Chine, etc.). C'est là le reflet de l'esprit "aristocratique" que l'on trouve chez les prolétaires de certains pays "civilisés" qui tirent certains avantages de leur situation privilégiée et qui sont pour cela enclins à oublier les impératifs de la solidarité de classe internationale. Mais au Congrès proprement dit, il ne se trouva pas d'apologistes de cette étroitesse petite-bourgeoise de corporation, et la résolution répond pleinement aux exigences de la social-démocratie révolutionnaire." 10
Aux Etats-Unis, lors des Congrès du Parti socialiste, en 1908, 1910 et 1912, les opportunistes cherchèrent à présenter des résolutions permettant d’échapper à la décision du Congrès de Stuttgart et exprimèrent leur soutien à l'opposition de l'AFL (American Federation of Labor) à l’immigration. Mais ils furent battus à chaque fois par des camarades qui défendaient la solidarité internationale de tous les ouvriers. Un délégué admonesta les opportunistes en disant que pour la classe ouvrière "il n’y a pas d’étrangers". D’autres insistèrent sur le fait que le mouvement ouvrier n’a pas à se joindre aux capitalistes contre des groupes d'ouvriers. En 1915, dans une lettre à la Socialist Propaganda League (le précurseur de l'aile gauche du Parti socialiste qui allait fonder, plus tard, le Communist Party et le Communist Labor Party aux Etats-Unis), Lénine écrivait : "Dans notre lutte pour le véritable internationalisme et contre le "jingo-socialisme", notre presse dénonce constamment les chefs opportunistes du S.P. d'Amérique, qui sont partisans de limiter l'immigration des ouvriers chinois et japonais (surtout depuis le congrès de Stuttgart de 1907, et à l'encontre de ses décisions). Nous pensons qu'on ne peut pas, à la fois, être internationaliste et se prononcer en faveur de telles restrictions." 11
Historiquement, les immigrés ont toujours joué un rôle important dans le mouvement ouvrier aux Etats-Unis. Les premiers marxistes révolutionnaires émigrèrent aux Etats-Unis après l’échec de la révolution de 1848 en Allemagne et établirent des liens vitaux avec le centre de la Première Internationale en Europe. Engels introduisit certaines conceptions problématiques dans le mouvement socialiste aux Etats-Unis, concernant les immigrés ; certains aspects étaient justes, mais d’autres étaient erronés et eurent finalement un impact négatif sur les activités organisationnelles du mouvement révolutionnaire américain. Friedrich Engels était préoccupé de la lenteur avec laquelle le mouvement ouvrier commençait à se développer aux Etats-Unis. Il pensait que cela venait de certaines spécificités de la situation en Amérique, notamment de l'absence de tradition féodale avec son fort système de classes, et de l’existence de la Frontier qui servait de soupape de sécurité à la bourgeoisie et permettait aux ouvriers mécontents de fuir leur existence de prolétaires pour devenir fermiers ou colons à l’Ouest. Un autre aspect était le gouffre qui séparait les ouvriers natifs des Etats-Unis et les ouvriers immigrés sur le plan des possibilités économiques ainsi que l’incapacité des ouvriers immigrés de communiquer avec les ouvriers du pays. Par exemple, pour critiquer les immigrés socialistes allemands de ne pas apprendre l’anglais, Engels écrivit : "Ils devront retirer tous les vestiges de leur costume d’étranger. Ils doivent devenir complètement des Américains. Ils ne peuvent attendre que les Américains viennent vers eux ; ce sont eux, la minorité et les immigrés, qui doivent aller vers les Américains qui constituent la vaste majorité de la population et sont nés là. Pour faire cela, ils doivent commencer par apprendre l’anglais." 12 Il est vrai qu’il existait chez les révolutionnaires immigrés allemands dans les années 1880 une tendance à se limiter au travail théorique et à laisser de côté le travail envers les masses des ouvriers du pays, ceux de langue anglaise, ce qui suscita les commentaires d’Engels. Il est également vrai que le mouvement révolutionnaire mené par les immigrants devait s’ouvrir aux ouvriers américains parlant anglais, mais l’insistance sur l’américanisation du mouvement qui était implicite dans les remarques d’Engels s’avéra désastreuse pour le mouvement ouvrier car elle eut pour conséquence de laisser les ouvriers les plus formés et expérimentés dans des rôles secondaires et d'en remettre la direction entre les mains de militants peu formés, dont la qualité première était d’être nés dans le pays et de parler anglais. Après la Révolution russe, l’Internationale communiste poursuivit la même politique et ses conséquences furent encore plus désastreuses pour le jeune Parti communiste. L’insistance de Moscou pour que les militants nés aux Etats-Unis soient nommés à la direction catapulta les opportunistes et les carriéristes comme William Z. Foster à des postes clé, rejeta les révolutionnaires d’Europe de l’Est qui avaient des penchants pour le communisme de gauche à la périphérie du Parti et accéléra le triomphe du stalinisme dans le Parti aux Etats-Unis.
De même, une autre remarque d’Engels était aussi problématique: "Il me semble que le grand obstacle aux Etats-Unis réside dans la position exceptionnelle des ouvriers du pays… (La classe ouvrière du pays) a développé et s’est aussi, dans une grande mesure, organisée elle-même en syndicats. Mais elle garde toujours une attitude aristocratique et quand c’est possible, laisse les emplois ordinaires et mal payés aux immigrants dont seulement une petite partie adhère aux syndicats aristocratiques." 13. Même si elle décrivait de façon tout à fait juste la façon dont les ouvriers du pays et les immigrés étaient effectivement divisés entre eux, elle sous-entendait de façon erronée que c’étaient les ouvriers américains et pas la bourgeoisie qui étaient responsables du gouffre entre les différentes parties de la classe ouvrière. Alors que ces commentaires parlaient des divisions dans la classe ouvrière immigrée blanche, les nouveaux gauchistes les interprétèrent, au cours des années 1960, dans le sens de donner une base à la "théorie" du "privilège de la peau blanche". 14
De toutes façons, l’histoire même de la lutte de classe aux Etats-Unis a réfuté la vision d’Engels selon laquelle l’américanisation des immigrés constituait une pré-condition à la constitution d’un mouvement socialiste fort aux Etats-Unis. La solidarité et l’unité de classe au delà des aspects ethniques et linguistiques furent une caractéristique centrale du mouvement ouvrier au tournant du 20e siècle. Les partis socialistes américains avaient une presse de langue étrangère et publiaient des dizaines de journaux, quotidiens et hebdomadaires, en plusieurs langues. En 1912, le Socialist Party publiait aux Etats-Unis 5 quotidiens en anglais et 8 dans d’autres langues, 262 hebdomadaires en anglais et 36 dans d’autres langues, 10 mensuels d’actualité en anglais et 2 dans d’autres langues, et ceci n’inclut pas les publications du Socialist Labor Party. A l'intérieur du Socialist Party, il existait 31 fédérations de langue étrangère : arménienne, bohémienne, bulgare, croate, tchèque, danoise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hispanique, hongroise, irlandaise, italienne, japonaise, juive, lettonne, lithuanienne, norvégienne, polonaise, roumaine, russe, scandinave, serbe, slovaque, slovène, slave du sud, espagnole, suédoise, ukrainienne, yougoslave. Ces fédérations constituaient la majorité de l’organisation. La majorité des membres du Communist Party et du Communist Labor Party, fondés en 1919, étaient des immigrés. De même le développement des Industrial Workers of the World (IWW) dans la période qui a précédé la Première Guerre mondiale provenait essentiellement de l’adhésion des immigrés, et même les IWW à l’Ouest qui comptaient beaucoup d’Américains "de naissance", comportaient des milliers de Slaves, de Chicanos et de Scandinaves dans leurs rangs.
La lutte la plus fameuse des IWW, la grève dans le textile à Lawrence en 1912, montra la capacité de solidarité entre les ouvriers immigrés et non immigrés. Lawrence était une ville industrielle du Massachusetts où les conditions de travail étaient déplorables. La moitié des ouvriers étaient des adolescentes entre 14 et 18 ans. Les ouvriers qualifiés étaient en général des gens qui parlaient anglais de descendance anglaise, irlandaise ou allemande. Les ouvriers non qualifiés étaient des Canadiens français, des Italiens, des Slaves, des Hongrois, des Portugais, des Syriens et des Polonais. Une baisse des salaires dans l’une des usines suscita une grève chez les femmes tisserandes polonaises qui s’étendit rapidement à 20 000 ouvriers. Un comité de grève organisé avec les IWW comprenait deux représentants de chaque groupe ethnique et réclamait 15 % d’augmentation de salaire et pas de représailles contre les grévistes. Les réunions pendant la grève étaient traduites en vingt-cinq langues. Lorsque les autorités répondirent par la répression violente, le comité de grève lança une campagne en envoyant plusieurs centaines d’enfants de grévistes chez des sympathisants de la classe à New York. Quand le second convoi de 100 enfants partit pour se rendre chez des sympathisants dans le New Jersey, les autorités s’en prirent aux mères et aux enfants, les arrêtèrent et les molestèrent devant la presse nationale ; cela eut pour résultat un déploiement national de solidarité. Les IWW utilisèrent la même tactique, lors d’une grève dans le secteur de la soie à Paterson, dans le New Jersey, en 1913, en envoyant les enfants d’ouvriers immigrés grévistes chez des "mères de grèves" dans d'autres villes ; à cette occasion encore, les ouvriers démontrèrent leur solidarité de classe par delà les barrières ethniques.
Au cours de la guerre, le rôle des émigrés et immigrants de l’aile gauche du mouvement socialiste fut particulièrement important. Par exemple, Trotsky participa à une réunion, le 14 janvier 1917 à Brooklyn, chez Ludwig Lore, immigrant d’Allemagne, pour planifier un "programme d’action" des forces de gauche du mouvement socialiste américain ; il venait d’arriver la veille à New York ; participèrent aussi Boukharine qui résidait déjà aux Etats-Unis et travaillait comme éditeur de Novy Mir, l’organe de la Fédération socialiste de Russie ; plusieurs autres immigrés russes ; S.J. Rutgers, révolutionnaire hollandais, compagnon de lutte de Pannekoek ; et Sen Katayama, émigré japonais. Selon des témoins visuels, les Russes dominèrent la discussion ; Boukharine défendait la scission immédiate de la gauche avec le Socialist Party, et Trotsky que la gauche devait rester dans le Parti pour le moment, mais devait développer sa critique en publiant tous les quinze jours une publication indépendante ; c’est cette dernière position qui fut adoptée par la réunion. S’il n’était pas rentré en Russie après la révolution de février, Trotsky aurait probablement été à la tête de l’aile gauche du mouvement américain. 15 La coexistence de plusieurs langues ne constituait pas un obstacle au mouvement ; au contraire, c’était un reflet de sa force. Lors d’une manifestation massive en 1917, Trotsky s’adressa à la foule en russe et d’autres en allemand, finnois, anglais, letton, yiddish et lithuanien. 16
La théorisation bourgeoise de l’idéologie anti-immigrés
Les idéologues bourgeois défendent l’idée que les caractéristiques de l’émigration massive actuelle vers l’Europe et les Etats-Unis sont totalement différentes de celles de l'émigration dans des périodes précédentes de l’histoire. Il y a derrière cela l’idée que, aujourd'hui, les immigrés affaiblissent, détruisent même les sociétés qui les accueillent, refusent de s’intégrer dans leur nouvelle société et en rejettent les institutions politiques et la culture. En Europe, le livre de Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, publié en 2007, défend l’idée que l’immigration musulmane est responsable du déclin européen.
Le professeur de sciences politiques bourgeois, Samuel P. Huntington de l’Université de Harvard, dans son livre publié en 2004, Who Are We: The Challenges to America's National Identity défend le point de vue que les immigrés d’Amérique latine, les Mexicains en particulier, qui sont arrivés aux Etats-Unis au cours des trois dernières décennies parleront probablement moins l’anglais que les précédentes générations d’immigrés venant d’Europe parce qu’ils parlent tous la même langue, qu’ils sont concentrés dans les mêmes régions et sont confinés dans des enclaves où l’on parle espagnol, qu’ils sont moins intéressés à s’assimiler d’un point de vue linguistique et culturel et sont encouragés à ne pas apprendre l’anglais par les gauchistes qui fomentent des politiques identitaires. Huntington déclare en plus que la "bifurcation", la division de la société américaine selon des lignes de division raciale noirs/blancs qui a existé pendant des générations, est aujourd’hui menacée d’être déplacée/remplacée par une "bifurcation" culturelle entre les immigrés de langue espagnole et les américains de souche qui parlent anglais, ce qui met en jeu l’identité et la culture nationales américaines.
Laqueur comme Huntington s'enorgueillissent de leur éminente carrière d'idéologues de la Guerre froide au service de la bourgeoisie. Laqueur est un érudit juif conservateur, survivant de l’Holocauste, farouchement pro-sioniste, anti-arabe, et consultant du Centre d’Etudes internationales et stratégiques (CSIS) de Washington qui a servi de "groupe de réflexion" pendant la Guerre froide en étroit lien avec le Pentagone à partir de 1962. L'ancien Secrétaire d'Etat de Bush à la Défense, Rumsfeld, a régulièrement consulté le CSIS. Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard, a été conseiller de Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam et, en 1968, a recommandé une politique de grand bombardement des campagnes vietnamiennes afin de saper le soutien des paysans au Viêt-Cong et les forcer à aller dans les villes. Plus tard, il a travaillé avec la Commission trilatérale dans les années 1970, est l’auteur du rapport sur la Governibility of Democracies (La crise de la démocratie : Rapport sur La gouvernabilité des démocraties à la Commission trilatérale) en 1976. A la fin des années 1970, sous l’administration Carter, il a servi comme coordonnateur politique du Conseil national de Sécurité. En 1993, il a écrit un article dans Foreign Affairs qui est devenu un livre par la suite, intitulé Le choc des civilisations (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), dans lequel il développe la thèse selon laquelle, après l’effondrement de l’URSS, ce serait la culture et non plus l’idéologie qui deviendrait la base la plus importante des conflits dans le monde. Il prévoyait qu’un choc de civilisations imminent entre l’Islam et l’Occident constituerait le conflit international central dans le futur. Bien que le point de vue de Huntington sur l’immigration en 2004 ait été en grande partie écarté par les intellectuels spécialisés dans l’étude des populations et les questions de l’immigration et de l’assimilation, ses vues ont été largement répandues par les médias et les experts en politique autour de Washington.
Les protestations d'Huntington sur le fait que les immigrés de langue étrangère refuseraient d’apprendre l’anglais, résisteraient à l’assimilation et contribueraient à la pollution culturelle, n’ont rien de nouveau aux Etats-Unis. A la fin des années 1700, Benjamin Franklin avait peur que la Pennsylvanie ne soit submergée par la "nuée" des immigrés d’Allemagne. "Pourquoi la Pennsylvanie", demandait Franklin, "fondée par les Anglais, devrait-elle devenir une colonie d’étrangers qui seront bientôt si nombreux qu’ils nous germaniseront plutôt que nous les anglicisions ?". En 1896, le président Francis Walker de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), économiste influent, mettait en garde contre le fait que la citoyenneté américaine pourrait être dégradée par "l’accès tumultueux de multitudes de paysans ignorants et brutalisés des pays d’Europe de l’Est et du Sud". Le président Théodore Roosevelt était si contrarié par l’afflux d’immigrés de langue étrangère qu’il proposa : "Il faut exiger de tous les immigrés qui viennent ici qu'ils apprennent l’anglais dans les cinq ans ou qu'ils quittent le pays". L’historien de Harvard, Arthur Schlesinger Senior, a déploré de la même façon "l’infériorité" sociale, culturelle et intellectuelle des immigrés d’Europe du Sud et de l’Est. Toutes ces plaintes et ces peurs d’hier sont remarquablement similaires à celles de Huntington aujourd’hui.
La réalité historique n'a jamais donné raison à ces peurs xénophobes. Même s’il a toujours existé, dans chaque groupe d’immigrés, une certaine partie qui cherchait à apprendre l’anglais à tout prix, à s’assimiler rapidement et à réussir économiquement, habituellement, l’assimilation s'est développée de façon graduelle – en général sur une période de trois générations. Les immigrants adultes conservaient en général leur langue maternelle et leurs traditions culturelles aux Etats-Unis. Ils vivaient dans des quartiers d’immigrés où ils parlaient leur langue dans la communauté, dans les magasins, dans les réunions religieuses, etc. Ils lisaient des livres et des journaux dans leur langue natale. Leurs enfants, immigrés quand ils étaient très jeunes ou nés aux Etats-Unis, étaient en général bilingues. Ils apprenaient l’anglais à l’école et, au 20e siècle, étaient entourés par l’anglais dans la culture de masse, mais parlaient aussi la langue de leurs parents à la maison et se mariaient en général au sein de leur communauté ethnique. A la troisième génération, les petits-enfants des immigrés perdaient en général l’habitude de parler la langue de leurs grands parents et tendaient à ne parler que l’anglais. Leur assimilation culturelle était marquée par une tendance croissante à se marier en dehors de la communauté ethnique d’origine. Malgré l'importance de l'immigration hispanique au cours des dernières années, les mêmes tendances à l'assimilation semblent perdurer de la même façon dans la période actuelle aux Etats-Unis, selon de récentes études du Pew Hispanic Center et de l'Université de Princeton. 17
Cependant, même si la vague actuelle d’immigration était qualitativement différente des précédentes, quelle importance cela aurait-il ? Si les ouvriers n’ont pas de patrie, pourquoi serions-nous concernés par la question de l’assimilation ? Engels a défendu l'américanisation dans les années 1880 non comme une fin en soi, comme une sorte de principe intemporel du mouvement ouvrier, mais comme un moyen de construire un mouvement socialiste de masse. Mais, comme nous l’avons vu, l'idée que l’américanisation constituerait une pré-condition nécessaire pour développer l’unité de la classe ouvrière a été réfutée par la pratique du mouvement ouvrier lui-même au début du 20e siècle, qui a démontré, sans équivoque possible, que le mouvement ouvrier peut embrasser la diversité et le caractère international du prolétariat et construire un mouvement uni contre la classe dominante.
Alors que les récentes émeutes dans les bidonvilles d’Afrique du Sud constituent un signal d’alerte par rapport au fait que les campagnes anti-immigrés de la bourgeoisie mènent à la barbarie dans la vie sociale, il est évident que la propagande capitaliste exagère la colère anti-immigrés dans la classe ouvrière des métropoles. Aux Etats-unis par exemple, malgré les grands efforts des médias bourgeois et la propagande d'extrême-droite pour attiser la haine contre les immigrés sur les questions de langue et de culture, l’attitude dominante dans la population en général, y compris chez les ouvriers, est de considérer que les immigrés sont des travailleurs qui cherchent à gagner leur vie pour soutenir leurs familles, qu’ils font un travail trop pénible et trop mal payé pour les ouvriers "du pays" et qu’il serait insensé de les renvoyer. 18 Dans la lutte de classe elle-même, il y a de plus en plus de manifestations de solidarité entre ouvriers immigrés et ouvriers "de souche", qui rappellent l'unité internationaliste à Lawrence en 1912. Par exemple, il y a eu les luttes de 2008 comme le soulèvement en Grèce où les ouvriers immigrés ont rejoint la lutte, ou la grève de la raffinerie de Lindsey en Grande-Bretagne en 2009 où les immigrés ont clairement exprimé leur solidarité, ou encore, aux Etats-Unis, lors de l'occupation par les ouvriers immigrés hispaniques de l'usine Window and Door Republic devant laquelle les ouvriers "natifs" se sont rassemblés pour montrer leur soutien en apportant notamment de quoi manger.
L'intervention des révolutionnaires sur la question de l'immigration
D’après ce que rapportent les médias, 80 % des Britanniques pensent que le Royaume Uni fait face à une crise de population du fait de l’immigration ; plus de 50 % ont peur que la culture britannique ne disparaisse ; 60 % que la Grande-Bretagne est plus dangereuse du fait de l’immigration ; et 85 % veulent que l’on diminue ou mette un terme à l’immigration. 19 Le fait qu’il existe une réceptivité à la peur irrationnelle exprimée dans le racisme et la xénophobie propagée par l'idéologie bourgeoise chez certains éléments de la classe ouvrière ne nous surprend pas dans la mesure où l'idéologie de la classe dominante, dans une société de classe, exerce une immense influence sur la classe ouvrière jusqu'à ce que se développe une situation ouvertement révolutionnaire. Cependant, quel que soit le succès de l'intrusion idéologique de la bourgeoisie dans la classe ouvrière, pour le mouvement révolutionnaire, le principe selon lequel la classe ouvrière mondiale est une unité, les ouvriers n’ont pas de patrie, est un principe de base de la solidarité prolétarienne internationale et de la conscience de la classe ouvrière. Tout ce qui insiste sur les particularismes nationaux, aggrave, manipule ou contribue à la "désunion" de la classe ouvrière est contraire à la nature internationaliste du prolétariat comme classe, et est une manifestation de l’idéologie bourgeoise que les révolutionnaires combattent. Notre responsabilité est de défendre la vérité historique : les ouvriers n’ont pas de patrie.
Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, les accusations de l’idéologie bourgeoise contre les immigrés sont plus un mythe qu’une réalité. Il y a bien plus de probabilités que les immigrés soient victimes de criminels qu'ils ne soient des criminels eux-mêmes. De façon générale, les immigrés sont honnêtes, des ouvriers qui travaillent dur, surexploités au-delà de toute limite, pour gagner de quoi vivre et envoyer de l’argent à leur famille restée "au pays". Ils sont souvent floués par des patrons peu scrupuleux qui les paient moins que le salaire minimum et refusent de payer leurs heures supplémentaires, par des propriétaires tout aussi peu scrupuleux qui leur font payer des loyers exorbitants pour de vrais taudis, et par toutes sortes de voleurs et d’agresseurs – qui tous comptent sur la peur des immigrés envers les autorités qui les empêche de porter plainte. Les statistiques montrent que la criminalité a tendance à augmenter chez les seconde et troisième générations dans les familles d’immigrés ; pas parce qu’ils proviennent de l’immigration mais du fait de leur pauvreté continuellement oppressante, de la discrimination et du manque de perspectives en tant que pauvres.20
Il est essentiel d’être clair sur la différence existant aujourd’hui entre la position de la Gauche communiste et celle de tous les défenseurs d'une idéologie anti-raciste (y compris ceux qui se prétendent révolutionnaires). Malgré la dénonciation du caractère raciste de l'idéologie anti-immigrés, les actions qu'ils préconisent restent sur le même terrain. Au lieu de souligner l’unité fondamentale de la classe ouvrière, ils mettent en avant ses divisions. Dans une version mise à jour de la vieille théorie du "privilège de la peau blanche", on blâme, avec des arguments moralistes, les ouvriers qui se méfient des immigrés, et pas le capitalisme pour son racisme anti-immigrés ; et on poursuit même en glorifiant les ouvriers immigrés comme des héros plus purs que les ouvriers de souche. Les "anti-racistes" soutiennent les immigrés contre les non-immigrés au lieu de mettre en avant l’unité de la classe ouvrière. L’idéologie multiculturelle qu'ils propagent dévoie la conscience de classe des ouvriers sur le terrain de la "politique d’identité" pour laquelle c’est "l’identité" nationale, linguistique, ethnique qui est déterminante, et pas l’appartenance à la même classe. Cette idéologie empoisonnée dit que les ouvriers mexicains ont plus en commun avec les éléments mexicains bourgeois qu’avec les autres ouvriers. Face au mécontentement des ouvriers immigrés confrontés aux persécutions qu’ils subissent, l'anti-racisme les enchaîne à l’Etat. La solution qui est proposée aux problèmes des immigrés est invariablement d’avoir recours à la légalité bourgeoise, que ce soit en recrutant les ouvriers pour les syndicats, ou pour la réforme de la loi sur l’immigration, ou en enrôlant les immigrés dans la politique électorale ou la reconnaissance formelle de "droits" légaux. Tout sauf la lutte de classe unie du prolétariat.
La dénonciation par la Gauche communiste de la xénophobie et du racisme contre les immigrés se distingue radicalement de cette idéologie anti-raciste. Notre position est en continuité directe avec celle qu’a défendue le mouvement révolutionnaire depuis la Ligue des communistes et le Manifeste communiste, la Première Internationale, la gauche de la Deuxième Internationale, les IWW et les Partis communistes à leurs débuts. Notre intervention insiste sur l’unité fondamentale du prolétariat, dénonce les tentatives de la bourgeoisie de diviser les ouvriers entre eux, s’oppose au légalisme bourgeois, aux politiques identitaires et à l’interclassisme. Par exemple, le CCI a défendu cette position internationaliste aux Etats-Unis en dénonçant la manipulation capitaliste visant à ce que les manifestations de 2006 (en faveur de la légalisation des immigrés) aient été composées principalement d’immigrés hispaniques. Comme nous l’avons écrit dans Internationalism 21, ces manifestations étaient "dans une grande mesure une manipulation bourgeoise", "totalement sur le terrain de la bourgeoisie qui a provoqué les manifestations, les a manipulées, contrôlées et ouvertement dirigées", et étaient infestées de nationalisme, "que ce soit le nationalisme latino qui à surgi au début des manifestations ou la ruée écœurante pour affirmer son récent américanisme " qui "avait pour but de court-circuiter totalement toute possibilité pour les immigrés et les ouvriers de souche américaine de reconnaître leur unité essentielle."
Par dessus tout, nous devons défendre l’unité internationale de la classe ouvrière. Comme internationalistes prolétariens, nous rejetons l’idéologie bourgeoise et ses constructions sur "la pollution culturelle", la "pollution linguistique", "l’identité nationale", "la méfiance envers les étrangers" ou "la défense de la communauté ou du quartier". Au contraire, notre intervention doit défendre les acquis historiques du mouvement ouvrier : les ouvriers n’ont pas de patrie ; la défense de la culture nationale, de la langue ou de l’identité n’est pas une tâche ni une préoccupation du prolétariat ; nous devons rejeter les tentatives de tous ceux qui cherchent à utiliser les conceptions bourgeoises pour exacerber les différences au sein de la classe ouvrière, pour saper son unité. Quelles que soient les intrusions d'une idéologie de classe étrangère qui ont pu historiquement avoir lieu, le fil rouge qui traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier est la solidarité et l'unité de classe internationaliste. Le prolétariat vient de beaucoup de pays, parle beaucoup de langues mais est une seule classe mondiale dont la responsabilité historique est d'affronter le système d'exploitation et d'oppression capitaliste. Nous considérons la diversité ethnique, culturelle, linguistique de notre classe avant tout comme une force et nous soutenons la solidarité internationale prolétarienne face aux tentatives de nous diviser entre nous. Nous devons transformer le principe "les ouvriers n'ont pas de patrie" en une réalité vivante qui contient la possibilité de créer une communauté humaine authentique dans une société communiste. Toute autre perspective constitue un abandon du principe révolutionnaire.
Jerry Grevin
1 Rainer Muenz : "Europe : Population and Migration in 2005 [12]"
2 Révolution internationale n° 253, février 1996.
3 Marx, Le Capital, Vol.I, chapitre 26, "L'accumulation primitive" (Ed. La Pléiade)
4 Le développement du capitalisme en Russie " VI. "La mission" historique du capitalisme [13]".
5 Franz Mehring, Karl Marx, traduit de l'anglais par nous.
6 Ibid.
7 GM Stekloff, History of the First International, Angleterre 1928, traduit de l'anglais par nous.
8 Franz Mehring, op.cit.
9 Ibid.
10 "Le Congrès socialiste internationale de Stuttgart", publié le 20 octobre 1907 dans le n°17 de Prolétari, Oeuvres complètes, Tome 13, p. 79, Editions sociales. Nous laissons de côté la discussion de la question de l' "aristocratie ouvrière", implicite dans le texte de Lénine.
11 Lettre au secrétaire de la SPL [14], 9 novembre 1915.
12 Lettre aux Américains, traduit de l'anglais par nous.
13 Lettre à Schlüter, op.cit
14 La "White Skin Privilege Theory" ou "théorie du privilège de la peau blanche" a été concoctée par les nouveaux gauchistes des années 1960 qui prétendaient que la classe dominante et la classe ouvrière blanche avaient un deal pour accorder aux ouvriers blancs un niveau de vie supérieur, aux dépens des ouvriers noirs qui subissaient le racisme et la discrimination.
15 Cf. Theodore Draper, The Roots of American Communism
16 Ibid.
17 Voir "2003-2004 Pew hispanic Center.the Kaiser Family Foundation Survey of Latinos: Education" et Rambaut, reuben G., Massey, Douglas, S. and Bean, Frank D. "Linguistic Life Expectancies: Immigrant Language Retention in Southern California. Population and Development", 32 (3): 47-460, septembre 2006
18 "Problems and Priorities", PollingReport.com.
19 Sunday Express, 6 avril 2008
20 States News Service, Immigration Fact Check : Responding to Key Myths, 22 juin 2007.
21 Internationalism, n° 139, été 2006 : « Immigrant demonstrations : Yes to the unity with the working class ! No to the unity with the exploiters [15]!”
Récent et en cours:
- Immigration [16]
Rubrique:
L'automne chaud 1969 en Italie, un moment de la reprise historique de la lutte de classe (I)
- 7093 lectures
Ce qu'il reste généralement en mémoire de "l’Automne chaud italien" 1, qui est intervenu il y a juste 40 ans, c'est un ensemble de luttes qui ont secoué l’Italie du Piémont à la Sicile et qui ont changé de façon durable le cadre social et politique de ce pays. Mais il ne s’agissait pas d’une spécificité italienne puisque, à la fin des années 1960, on a pu assister, particulièrement en Europe mais pas seulement, au développement d’une série de luttes et de moments de prise de conscience dans le prolétariat, qui montraient, dans leur ensemble, que quelque chose avait changé : la classe ouvrière revenait sur la scène sociale. Elle reprenait sa lutte historique contre la bourgeoisie, après la longue nuit des années de contre-révolution où l’avaient plongée la défaite des années 1920, la Seconde Guerre mondiale et l’action contre-révolutionnaire du stalinisme. Le "Mai français" de 1968 2, les grèves en Pologne de 1970 3 et les luttes en Argentine 4 de 1969-73 constituent, avec l’Automne chaud en Italie, les moments les plus importants de cette nouvelle dynamique qui affecte tous les pays du monde, ouvrant une nouvelle période d’affrontements sociaux qui, avec des hauts et des bas, perdure jusqu’à maintenant.
Comment en est-on arrivé à l’Automne chaud ?
Instruite par l'expérience de Mai 68, la bourgeoisie italienne ne se laisse pas surprendre par l'explosion de luttes en 1969, comme cela était arrivé à la bourgeoisie française l'année précédente. Cela ne l'empêchera pas toutefois de se trouver parfois débordée face aux évènements. Ceux-ci ne sont pas apparus comme un éclair dans un ciel bleu. En réalité, de multiples facteurs, tant au niveau national qu’au niveau international, concourent alors à créer une atmosphère nouvelle dans la classe ouvrière italienne et particulièrement chez les jeunes.
Le climat international
Au niveau international, une frange importante de la jeunesse est sensibilisée par un ensemble de situations, notamment :
- La guerre du Vietnam 5, qui apparaît comme le combat entre David-Vietnam et Goliath-USA. Indignés par les atroces massacres au napalm et autres violences infligées par l’armée américaine aux populations locales, beaucoup ont été portés à s’identifier à la résistance Viêt-Cong et à prendre parti pour le "pauvre petit" Vietnam contre le puissant "impérialisme" américain 6 ;
- L’épopée de Che Guevara 7, avec son auréole de héros se battant pour la libération de l’humanité, et d’autant plus vénéré par des générations successives qu’il a été assassiné par l’armée bolivienne et les forces spéciales de la CIA en octobre 1967 ;
- Les menées des guérilleros palestiniens 8, en particulier celles du FPLP de George Habache, qui se développent dans le contexte des réactions hostiles au résultat de la Guerre des six jours, menée et gagnée en juin 1967 par Israël contre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie ;
- L’écho international du "communisme chinois" présenté comme la véritable expression d’instauration du communisme, par opposition au "communisme soviétique" bureaucratisé. En particulier, la "révolution culturelle" 9 déclenchée par Mao Zedong dans la période 1966-1969, se définit comme une lutte pour revenir à l’application orthodoxe de la pensée marxiste-léniniste.
Aucun de ces faits n’est lié de près ou de loin à la lutte de classe du prolétariat en vue du renversement du capitalisme : les horreurs subies par la population vietnamienne dans la guerre sont le fait des antagonismes impérialistes entre les deux blocs rivaux qui se partagent alors le monde ; la résistance incarnée par les guérilleros, qu’ils soient palestiniens ou guevaristes, n’est autre qu’un moment de la lutte à mort entre ces deux blocs pour la domination sur d’autres régions du monde ; quant au "communisme" en Chine, il est tout aussi capitaliste que celui existant en URSS et la dite "révolution culturelle" n’est en fait qu’une lutte pour le pouvoir entre la faction de Mao et celle de Deng Xiaoping et Liu Shaoqi.
Néanmoins, tous ces événements témoignent d’une profonde souffrance de l’humanité inspirant à beaucoup d’éléments un dégoût profond pour les violences de la guerre et un sentiment de solidarité vis-à-vis des populations qui en sont victimes. Quant au maoïsme, s’il ne représente en rien une solution face aux maux de l’humanité, mais bien une mystification et une entrave supplémentaires en travers du chemin de son émancipation, il alimente une contestation internationale concernant la nature réelle du "communisme" en Russie.
Dans ce contexte, l’explosion des luttes étudiantes et ouvrières du Mai français a un écho international tel qu’elle représente un point de référence et un facteur d’encouragement pour les jeunes et les prolétaires du monde entier. Mai 68 est en fait la démonstration du fait que non seulement on peut lutter mais aussi gagner. Ce même Mai, cependant, au moins dans sa composante des luttes étudiantes, a été préparé par d’autres mouvements, comme ceux qui s’étaient produits en Allemagne avec l’expérience de la Kritische Universität 10 et la formation du SDS (Socialistischer Deutscher Stundentenbund), ou en Hollande avec celle des Provos, ou encore aux États-Unis avec le parti des Black Panthers. Nous sommes en quelque sorte dans une époque où tout ce qui se passe dans le monde a un grand écho dans tous les autres pays du fait de la réceptivité importante qui existe, surtout parmi la jeune génération de prolétaires et d’étudiants qui sera un protagoniste essentiel de l’Automne chaud. L’angoisse et la réflexion ambiantes inspireront des personnages charismatiques du monde du spectacle, comme Bob Dylan, Joan Baez, Jimmy Hendrix et d’autres dont les chansons évoquent tantôt les revendications des peuples et des couches sociales historiquement réprimées et exploitées (comme les noirs d’Amérique), tantôt les atrocités de la guerre (comme celle du Vietnam) et exaltent la volonté de s’émanciper.
Politisation sur le plan national
En Italie aussi, comme en France auparavant, l’affaiblissement de la chape de plomb qu’avait constitué le stalinisme pendant toutes les années de contre-révolution permet le développement d’un phénomène de maturation politique constituant le terrain favorable à l’émergence de diverses minorités qui reprendront un travail de recherche et de clarification. Par ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle génération de prolétaires se traduit par une plus grande combativité débouchant sur des caractéristiques nouvelles de la lutte et des expériences d’affrontements de rue qui marqueront la classe ouvrière.
L’expérience des Quaderni Rossi (QR, Cahiers Rouges)
Au début des années 1960, alors que nous nous trouvions encore en pleine contre-révolution, de petits groupes d’éléments – critiques vis-à-vis du stalinisme – ont cherché, autant que cela leur était possible à « repartir de zéro ». De fait, à cette époque, le PCI (Parti communiste italien) passé à la contre-révolution et stalinisé lui aussi comme les autres PC dans le monde, dispose d'une base importante de membres et de sympathisants, en partie grâce à l’auréole héritée du vieux parti révolutionnaire fondé par Bordiga en 1921. La longue vingtaine d’années du fascisme en Italie et la disparition des partis "démocrates" ont évité au PCI, plus qu’aux autres PC, d’être identifié comme véritable ennemi de classe par la grande masse des ouvriers. Cependant, déjà dans les années 1950, et encore plus dans les années 60, ont commencé à apparaître, au sein même du PCI, des minorités cherchant à revenir aux vraies positions de classe. On revient surtout à Marx alors que Lénine est moins lu pendant cette période. On redécouvre aussi Rosa Luxembourg.
Une des expériences qui fait référence pendant cette période est celle des Quaderni Rossi, groupe à l’intérieur du PCI, né autour de la personne de Raniero Panzieri et qui, au cours de son existence (1961-1966), n’a publié que 6 numéros d’une revue qui va cependant avoir un poids énorme dans l’histoire de la réflexion théorique de la gauche en Italie. C’est à cette revue que l’on peut faire remonter l’origine du courant qui prendra le nom de "operaismo" dont nous parlerons ensuite. Les deux principaux groupes de l’opéraïsme italien, Potere Operaio et Lotta Continua, viennent de cette même matrice. Le travail des Quaderni Rossi se partage entre la relecture du Capital, la "découverte" des Grundrisse de Marx et les recherches sur la nouvelle composition de la classe ouvrière. "(…) Quaderni Rossi, la revue de Raniero Panzieri, Vittorio Foa, Mario Tronti et Alberto Asor Rosa, entre 1961 et 1966 s’est trouvée en avance sur l’intuition qui sera au centre de la ligne politique de Lotta Continua : la révolution ne sortira pas des urnes ou des partis (…) ; il s’agit de libérer l'expression de l'antagonisme entre les ouvriers et l'exploitation, antagonisme qui ne doit pas être canalisée dans les accords d'entreprise et les réformes, mais plutôt soustraite à la tutelle des syndicalistes et des ingénieurs et axée sur la perspective du contrôle de la production et d’un changement global du système" 11.
Panzieri a pour projet de rassembler des tendances et des points de vue plutôt variés et éloignés, alors que la période, encore fortement marquée par la contre-révolution, n’autorise pas une entreprise de cet ordre. Ainsi, "au début de 1962, alors que s’ouvrait à peine le débat sur le premier numéro de la revue, le groupe des syndicalistes se retire ; en juillet de la même année, après les événements de la Place Statuto, il y a un premier départ des interventionnistes (qui vont produire le journal "Gatto selvaggio" (Chat sauvage)" 12.
Parallèlement à l’expérience des QR, a lieu dans la région de Venise une autre expérience, de moindre ampleur politique cependant, Progresso Veneto. Celui qui sera le trait d’union entre les deux expériences est un personnage qui deviendra très célèbre par la suite et qui commence sa carrière politique comme conseiller municipal de la commune de Padoue : il s’agit de Toni Negri. Le Progresso Veneto, actif entre décembre 1961 et mars 1962, est le lieu où commence à se forger l’opéraisme vénitien, avec une référence particulière à la région industrielle de Porto Marghera. QR et Progresso Veneto travaillent en symbiose pendant un certain temps jusqu’à ce que le groupe du Veneto (Vénétie) subisse, en juin 1963, une scission entre opéraïstes et socialistes plus fidèles au parti d’appartenance.
Mais la scission la plus importante est celle qui se produit en 1964 au sein de QR. Du groupe d’origine vont sortir Mario Tronti, Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari, Rita Di Leo et d’autres pour fonder Classe Operaia (Classe ouvrière). Tandis que Panzieri reste fixé sur une recherche de type sociologique, sans impact significatif sur la réalité, Classe Operaia se propose d’avoir une présence et une influence immédiate dans la classe ouvrière, jugeant que les temps sont mûrs pour cela : "A nos yeux, leur travail semblait une sophistication intellectuelle, par rapport à ce que nous considérions comme étant une exigence pressante, c'est-à-dire faire comprendre au syndicat comment il devait faire son métier de syndicaliste et au parti comment il devait faire la révolution" 13.
Classe Operaia sera rejoint par une partie des opéraïstes de Progresso Veneto, et va être dirigé par Mario Tronti. Au début au moins, Negri, Cacciari et Ferrari Bravo y participent. Mais la nouvelle revue connaît elle-même une vie difficile : la rédaction vénitienne de Classe Operaia commence à prendre lentement ses distances avec celle de Rome. De fait, alors que les romains se rapprochent de la maison mère PCI, les vénitiens donnent naissance à Potere Operaio qui sort au début comme supplément à Classe Operaia sous forme d’une revue-tract. Classe Operaia commence à agoniser en 1965, mais le dernier fascicule est de mars 1967. Ce même mois naît Potere Operaio, en tant que journal politique des ouvriers de Porto Marghera 14.
En dehors de Quaderni Rossi et de ses différents épigones, il y a en Italie un réseau dense d’autres initiatives éditoriales, parfois nées dans des domaines culturels spécifiques comme le cinéma ou la littérature, qui acquièrent progressivement plus d’ampleur politique et un certain caractère militant. Des publications comme Giovane Critica, Quaderni Piacentini, Nuovo Impegno, Quindici, Lavoro Politico, sont aussi des expressions et des composantes de cette maturation qui conduira aux événements des deux années 68-69.
On voit donc qu’il existe un long travail politique articulé à l’aube de l’Automne chaud qui permet, au moins au niveau des minorités, le développement d’une pensée politique et la récupération, encore que très partielle, du patrimoine des classiques du marxisme. Mais il faut encore souligner que celles qui vont devenir les formations opéraistes les plus significatives des années 1970 sont profondément enracinées dans la culture politique du vieux PCI et qu’elles se développent à une époque bien antérieure à celle de la grande explosion des luttes de 1969 et de celles des étudiants de 1968. Avoir le parti stalinien comme point de départ et de référence, même si c’est en négatif à travers sa critique, constitue, comme nous le verrons, la limite la plus forte à l’expérience des groupes opéraistes et pour le mouvement de l’époque lui-même.
La "nouvelle" classe ouvrière
Au niveau social, le facteur probablement déterminant du développement de la situation fut la forte croissance de la classe ouvrière dans les années du miracle économique, aux dépens surtout des populations de la campagne et des zones périphériques du sud. "En résumé, nous nous trouvons devant une élite d’ouvriers professionnels qui sont entourés d’une grande majorité d’ouvriers sans qualification qui travaillent sur des cycles extrêmement brefs, quelquefois quelques secondes, soumis à un contrôle rigide du temps qu’ils mettent dans le travail à la pièce et sans aucune perspective de carrière professionnelle" 15. Cette nouvelle génération de prolétaires qui vient du sud ne connaît pas encore le travail en usine et ne s’est pas encore soumise à ses contraintes ; par ailleurs, étant jeunes et occupant souvent leur premier emploi, ces prolétaires ne connaissent pas le syndicat et, surtout, ne subissent pas le poids des défaites des décennies passées, de la guerre, du fascisme, de la répression, mais seulement le bouillonnement de ceux qui découvrent un monde nouveau et veulent le modeler à leur gré. Cette "nouvelle" classe ouvrière, jeune, non politisée ni syndiquée, sans ce poids de l'histoire sur elle, fera, en grande partie, l’histoire de l’Automne chaud.
Les mouvements de juillet 1960 et les affrontements de Piazza Statuto de juillet 1962.
Les luttes ouvrières de l’Automne chaud ont un prélude significatif au début des années 60, lors de deux épisodes de lutte importants : les mouvements de rue de juillet 60 et les affrontements de Piazza Statuto en juillet 62 à Turin.
Ces deux épisodes, bien qu’éloignés dans le temps de l’époque 68-69, en représentent d’une certaine façon, des prémices importantes. De fait, la classe ouvrière s’est trouvée en situation de faire l'expérience des attentions de l’État à son égard.
Les mouvements de juillet 1960 démarrent à partir de la protestation contre la tenue du congrès du parti néo-fasciste à Gènes, qui est l’occasion de déclencher dans toute l’Italie une série de manifestations qui sont férocement réprimées : "A San Ferdinando di Puglia, les ouvriers étaient en grève pour le contenu des accords d'entreprise, comme dans toute l’Italie. La police les attaque, arme au poing : trois ouvriers sont gravement blessés. A Licata, dans la région d’Agrigente, se déroule une grève générale contre les conditions de travail. Le 5, la police et les carabiniers chargent et tirent sur le cortège mené par le maire DC [Démocrate Chrétien], Castelli : le commerçant Vicenzo Napoli, 25 ans, est tué d’un coup de fusil. (…) Le jour suivant, un cortège qui se dirigeait vers le sanctuaire de Porta San Paolo – le dernier bastion de la défense de Rome contre les Nazis – est chargé et violemment bastonné. (…) Une nouvelle grève générale éclate. Se produit alors une nouvelle et furieuse réaction du gouvernement qui ordonne de tirer à vue : cinq morts et vingt deux blessés par arme à feu à Reggio Emilia le 7.(…) Le premier à tomber est Lauro Ferioli, ouvrier de 22 ans. A côté de lui, un instant après, tombe aussi Mario Serri, 40 ans, ex-partisan : les tueurs sont deux agents postés au milieu d’arbres. (…) Une rafale de mitraillette fauchera plus tard Emilio Reverberi, 30 ans. Enfin, alors qu’est enregistrée la voix furieuse d’un commissaire qui crie "tirez dans le tas", c’est au tour de Afro Tondelli, 35 ans, de tomber. Comme on peut le voir sur un document photographique, il a été assassiné froidement par un policier qui s’est agenouillé pour mieux viser…" 16.
Les forces de l’ordre, comme on le voit, n’ont jamais d’égards pour les pauvres, pour les prolétaires qui revendiquent. Deux ans après, les mêmes violences policières se répètent lors des affrontements de Piazza Statuto à Turin déclenchés sur un terrain strictement ouvrier. L’UIL et la SIDA, deux syndicats qui avaient déjà démontré clairement à l’époque de quel côté ils se situaient, signent séparément avec la direction de Fiat et en toute hâte, des accords d'entreprise complètement défavorables aux travailleurs : "6 à 7000 personnes, exaspérées d’apprendre cela, se réunirent dans l’après-midi sur la Piazza Statuto, face au siège de l’UIL. Pendant deux jours, la place va être le théâtre d’une série d’affrontements extraordinaires entre les manifestants et la police : les premiers, armés de frondes, de bâtons et de chaînes, cassaient les vitrines et les fenêtres, érigeaient des barricades rudimentaires, chargeaient de façon répétée les cordons de police ; celle-ci ripostait en chargeant les foules en jeep, en asphyxiant la place avec des gaz lacrymogènes, et en frappant les manifestants à coups de crosse de fusil. Les affrontements se prolongèrent tard le soir, aussi bien le samedi 7 que le lundi 9 juillet 1962. Les dirigeants du PCI et de la CDIL, parmi lesquels Pajetta et Garavini, cherchaient à convaincre les manifestants de se disperser, sans succès. Mille manifestants furent arrêtés et plusieurs, dénoncés. La plus grande partie était composée de jeunes ouvriers, en majorité du sud." 17.
On doit à Dario Lanzardo 18 un compte-rendu lucide de ces journées, incluant des témoignages officiels concernant toutes les violences gratuites exercées par la police et les carabiniers, non seulement sur les manifestants mais aussi sur n’importe quelle personne circulant par malheur dans les parages de Piazza Statuto. Si on considère tous les massacres effectués par les forces de l’ordre, depuis la fin de la guerre jusqu'à l’Automne chaud lors de manifestations de prolétaires en lutte, alors on comprend vraiment la différence entre la période noire de la contre-révolution – pendant laquelle la bourgeoisie avait complètement les mains libres pour faire ce qu’elle voulait contre la classe ouvrière – et la phase de reprise des luttes pendant laquelle il est préférable pour elle de s’en remettre d’abord à l’arme de la mystification idéologique et au travail de sabotage des syndicats. En réalité, ce qui changera avec l’Automne chaud, considéré comme une manifestation de la reprise de la lutte de classe au niveau national et international, c’est justement le rapport de forces entre les classes, au niveau national et international. C’est cela la clef pour comprendre la nouvelle phase historique qui s’ouvre à la fin des années 1960, et pas une prétendue démocratisation des institutions. De ce point de vue, la position prise par le PCI sur les affrontements illustre parfaitement le positionnement politique bourgeois qui est le sien depuis quatre décennies : "… l’Unità du 9 juillet définira la révolte comme "des tentatives provocatrices de hooligans" et les manifestants comme "des éléments incontrôlés et exaspérés", "des petits groupes d’irresponsables", des "jeunes voyous", des "anarchistes, internationalistes" 19.
De l’automne étudiant à l’Automne chaud
Parler d’Automne chaud est plutôt restrictif quand on aborde un épisode historique qui, comme on a pu le voir, plonge ses racines dans une dynamique au niveau local et international qui remonte à plusieurs années en arrière. D’ailleurs, le mouvement n’a pas duré une seule saison, comme cela a été le cas pour le Mai français, mais il se maintiendra à un haut niveau pendant au moins deux ans, de 1968 à 1969, avec un retentissement qui s'étendra jusqu’à la fin de 1973.
Le mouvement prolétarien durant ces deux années et même les suivantes est profondément marqué par l’explosion des luttes étudiantes, le 68 italien. C’est pourquoi il est important de revenir sur chaque épisode pour y suivre le développement, progressif et impressionnant, de la maturation de la lutte de classe opérant son retour sur la scène historique en Italie.
Le 68 étudiant
Les écoles et surtout les universités perçoivent fortement les signaux du changement de la phase historique. Le boom économique qui s’était produit, en Italie comme dans le reste du monde, après la fin de la guerre, avait permis aux familles ouvrières de bénéficier d'un niveau de vie moins misérable et aux entreprises de compter sur un accroissement massif de leur main d’œuvre. Les jeunes générations des classes sociales les moins favorisées peuvent désormais accéder aux études universitaires pour se former à un métier, acquérir une culture plus large, avec à la clé l'accession à une position sociale plus satisfaisante que celle de leurs parents. Cependant, l’entrée massive de ces couches sociales moins favorisées à l’université ne conduisit pas seulement à un changement de la composition sociale de la population étudiante mais il en a aussi résulté une certaine dépréciation de l'image des diplômés. Désormais ils ne sont plus, comme auparavant, formés pour remplir un rôle de direction, mais pour s’intégrer dans l'organisation de la production – industrielle ou commerciale – où l’initiative individuelle est de plus en plus limitée. Ce cadre socioculturel explique, au moins en partie, les raisons du mouvement de la jeunesse durant ces années : contestation du savoir dogmatique dont la détention est le privilège d’une caste de mandarins universitaires aux méthodes moyenâgeuses, de la méritocratie, de la sectorisation, d’une société perçue comme vieillissante et repliée sur elle-même. Les manifestations étudiantes avaient déjà commencé en février 1967 avec l’occupation du Palais Campana à Turin, mouvement qui s'était progressivement étendu à toutes les autres universités, depuis Normale de Pise, la faculté de sociologie de Trente, jusqu’à la faculté catholique de Milan et ainsi de suite en allant vers le sud et pendant des mois et des mois jusqu’à l’explosion finale de 1968. Pendant cette période, les groupes politiques à large audience que nous connaîtrons dans les années 1970 n’existent pas encore, mais c’est la période durant laquelle naissent les différentes cultures politiques qui seront à la base de ces groupes. Parmi les expériences qui marqueront le plus profondément la suite, il y a certainement celle de Pise, où était présent un groupe important d’éléments qui publiait déjà un journal, Il Potere Operaio, (appelé "pisan" pour ne pas le confondre avec l’autre, issu de Classe Operaia). Il Potere Operaio est déjà en réalité un journal ouvrier dans la mesure où il est publié comme journal d’usine d’Olivetti d'Ivrea. En effet, le groupe pisan, dans lequel on retrouve les noms des leaders les plus connus de ces années, avait dès le début comporté comme trait distinctif la référence à la classe ouvrière et l'intervention en son sein. Plus généralement, il existe au sein de tout le mouvement étudiant de l’époque la tendance à se tourner vers la classe ouvrière et à en faire la principale référence et le partenaire idéal, même si c’est de manière plus ou moins explicite. La plupart des villes sont gagnées par la contestation étudiante, et il arrive que des délégations d’étudiants se rendent régulièrement devant les usines pour distribuer des tracts et, plus généralement, pour établir une alliance avec le monde ouvrier, qui est de plus en plus ressenti comme celui auquel ils appartiennent. Cette identification de l’étudiant comme partie de la classe ouvrière sera même théorisée par quelques composantes de la mouvance plus opéraïste.
Le développement des luttes ouvrières
Comme nous l’avons dit, 1968 en Italie marque aussi le début d’importantes luttes ouvrières : "Au printemps 68, il se produit dans toute l’Italie une série de luttes dans les usines qui ont comme objectif des augmentations de salaire égales pour tous qui soient en mesure de compenser les "maigres" accords de 1966. Parmi les premières usines à se mobiliser, il y a la Fiat où les ouvriers mènent le plus grand conflit depuis plus de 14 ans, et à Milan où partent en grève Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Philips, Sit SIEMENS, Innocenti, Autelco, Triplex, Brollo, Raimondi, Mezzera, Rhodex, Siae Microelettronica, Seci, Ferrotubli, Elettrocondutture, Autobianchi, AMF, Fachini, Tagliaferri, Termokimik, Minerva, Amsco et une autre vingtaine de petites entreprises. (…) Au début, la lutte est dirigée par les vieux activistes et par le syndicat extérieur à l’usine, et donc dirigée de façon plutôt autoritaire, mais après un mois, de jeunes ouvriers s’imposent, qui "critiquent vivement les syndicalistes et les membres du CI 20 sur la façon de lutter et sur les étapes de la lutte", et qui modifient qualitativement les formes de la mobilisation, avec des piquets très durs et des cortèges à l’intérieur pour obliger les employés à faire grève. Une fois, ces ouvriers ont prolongé spontanément une grève de quelques heures, obligeant les syndicats à les appuyer. Ce souffle de la jeunesse provoque une participation massive à la lutte, les heures de grève se multiplient, des manifestations se produisent à travers les rues de Sesto San Giovanni, parviennent à défoncer le portail du bâtiment qui héberge la direction de l’entreprise. Les grèves continuent, bien que l’Assolombarda pose comme condition de l’ouverture de négociations l’arrêt de celles-ci : la participation est totale chez les ouvriers et presque nulle au contraire chez les employés". 21
A partir de là, tout va crescendo : "Le bilan de 69 à la Fiat est un bulletin de guerre : 20 millions d’heures de grève, 277.000 véhicules perdus, boom (37%) des ventes de voitures étrangères" 22.
Ce qui change profondément avec les luttes de l’Automne chaud, c’est le rapport de forces dans l’usine. L’ouvrier exploité et humilié par les rythmes de travail, les contrôles, les punitions continuelles, entre en conflit quotidien avec le patron. L’initiative ouvrière ne concerne plus tant les heures de grève mais comment mener ces grèves. Il se développe rapidement une logique de refus du travail qui équivaut à une attitude de refus de collaborer à la stratégie de l’entreprise, en restant fermement ancrée dans la défense des conditions de vie ouvrière. Il s’ensuit une nouvelle logique quant aux modalités de la grève qui vise à ce qu'un minimum d’efforts de la part des ouvriers cause le maximum de dommages pour les patrons. C’est la grève sauvage dans laquelle ne fait grève qu’un nombre réduit d’ouvriers dont dépend cependant le cycle complet de production. En changeant à tour de rôle le groupe qui entre en grève, on réussit ainsi à bloquer autant de fois l’usine avec le minimum de "frais" pour les ouvriers.
Une autre expression du changement du rapport de forces entre classe ouvrière et patronat, c’est l’expérience des cortèges à l’intérieur des usines. Au début, ces manifestations se produisent dans les longs couloirs et allées des établissements Fiat et d’autres industries importantes et sont des expressions de protestation. Elles deviennent ensuite la pratique adoptée par les ouvriers pour convaincre les hésitants, les employés en particulier, de se joindre à la grève : "Les cortèges à l’intérieur partaient toujours de la carrosserie, souvent de l’atelier de vernissage. On entendait dire qu’un atelier quelconque avait repris le travail, ou alors qu’ils avaient concentrés les non grévistes dans le bureau 16, celui des femmes. Alors, nous passions et nous ramassions tout le monde. Nous faisions la pêche au chalut. Mirafiori est tout en couloirs et dans les endroits étroits, personne ne pouvait s’échapper. Bientôt, ce ne fut plus nécessaire : dès qu’on nous voyait, les gens ralentissaient la chaîne et nous suivaient." 23
En ce qui concerne la représentativité ouvrière, ce qui est caractéristique de cette période, c’est le slogan : "nous sommes tous délégués", ce qui signifie le refus de toute médiation syndicale et qu’on impose au patronat un rapport de forces direct au moyen de la lutte des ouvriers. Il est important de revenir sur ce mot d’ordre qui se propagera tout au long des luttes, imprégnera longtemps la lutte de classe durant ces années. Cette expérience est précieuse en particulier face aux doutes qu’ont parfois aujourd’hui les minorités prolétariennes qui voudraient engager une lutte en dehors des syndicats mais qui ne voient pas comment faire en n’étant pas elles-mêmes reconnues par l’État.
Ce n'est pas le problème des ouvriers à l'époque de l’Automne chaud : quand il le faut, ils luttent, font grève, en dehors des syndicats et contre leurs consignes ; mais ils ne poursuivent pas toujours un but immédiat : dans cette phase, la lutte des ouvriers est l’expression d’une énorme combativité, d’une volonté longtemps refoulée de répondre aux intimidations du patronat ; elle n’a pas nécessairement besoin de motifs et d’objectifs immédiats pour s’exprimer, elle est son propre stimulant, crée un rapport de forces, change progressivement l'état d'esprit de la classe ouvrière. Le syndicat n’a dans tout cela qu’une présence éphémère. En réalité, le syndicat, comme la bourgeoisie pendant ces années, reste à l'écart, du fait de la force de la lutte de la classe ouvrière. Il fait la seule chose qu’il puisse faire : chercher à se maintenir la tête hors de l'eau, suivre le mouvement et ne pas trop se faire dépasser par lui. Par ailleurs, une réaction aussi forte au sein de la classe est aussi l’expression du manque d’un véritable enracinement des syndicats dans le prolétariat et donc de leur capacité à prévenir ou à bloquer la combativité comme cela arrive au contraire aujourd’hui. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il existe alors une profonde conscience antisyndicale dans la classe ouvrière. En fait, les ouvriers bougent malgré les syndicats, pas contre eux, même si il y a des avancées significatives de la conscience, comme l'illustre le cas des Comités Unitaires de Base (CUB) dans le milanais : "les syndicats sont des "professionnels de la négociation" qui ont choisi avec les soi-disant partis des travailleurs la voie de la réforme, c’est-à-dire la voie de l’accord global et définitif avec les patrons".24
Les années 1968-69 sont un rouleau compresseur de luttes et de manifestations, avec des moments de forte tension comme dans les luttes dans la région de Syracuse, qui aboutissent aux affrontements d’Avola 25, ou celles de Battipaglia qui engendrent des affrontements très violents 26. Mais les affrontements de Corso Traiano à Turin en juillet 1969 représentent certainement une étape historique dans cette dynamique. En cette occasion, le mouvement de classe en Italie réalise une étape importante : la confluence entre le mouvement ouvrier et celui des avant-gardes étudiantes. Les étudiants, ayant plus de temps disponible et étant plus mobiles, réussissent à apporter une contribution importante à la classe ouvrière en lutte, qui en retour, à travers la jeunesse qui s’éveille, prend conscience de son aliénation, et exprime sa volonté d’en finir avec l’esclavage de l’usine. Le lien entre ces deux mondes donnera une forte impulsion aux luttes qui se produiront en 1969 et, en particulier, à celle de Corso Traiano. Nous citons ici un long extrait d’un tract de l’assemblée ouvrière de Turin, rédigé le 5 juillet, parce qu’il représente non seulement un excellent compte-rendu de ce qui s’est passé, mais aussi un document qui a une très grande qualité politique :
"La journée du 3 juillet n’est pas un épisode isolé ou une explosion incontrôlée de révolte. Elle arrive après cinquante journées de luttes qui ont rassemblé un nombre énorme d’ouvriers, bloqué complètement le cycle de production, représenté le point le plus élevé d’autonomie politique et organisationnelle qu’aient atteint les luttes ouvrières jusqu’à maintenant en détruisant toute capacité de contrôle du syndicat.
Complètement expulsés de la lutte ouvrière, les syndicats ont tenté de la faire sortir des usines vers l’extérieur et d’en reconquérir le contrôle en appelant à une grève générale de 24 heures pour bloquer les loyers. Mais encore une fois l’initiative ouvrière a eu le dessus. Les grèves symboliques qui se transforment en congés, avec quelques défilés çà et là, ne servent que les bureaucrates. Dans les mains des ouvriers, la grève générale devient l’occasion de s’unir, pour généraliser la lutte menée dans l’usine. La presse de tout bord se refuse à parler de ce qui se passe à Fiat ou dit des mensonges à son propos. C’est le moment de briser cette conjuration du silence, de sortir de l’isolement, de communiquer à tous, avec la réalité des faits, l’expérience des ouvriers de Mirafiori.
Des centaines d’ouvriers et d’étudiants décident en assemblée de convoquer pour le jour de la grève un grand cortège qui, partant de Mirafiori, ira dans les quartiers populaires, afin d’unir les ouvriers des différentes usines. (…)
C’en est trop pour les patrons. Avant même que le cortège ne se forme, une armée de gros bras et de policiers se jette sans aucun avertissement sur la foule, matraquant, arrêtant, lançant des grenades lacrymogènes (…) En peu de temps, ce ne sont pas seulement les avant-gardes ouvrières et étudiantes qui font face mais toute la population prolétarienne du quartier. Des barricades s’érigent, on répond aux charges de la police par des charges. Pendant des heures et des heures, la bataille continue et la police est obligée de battre en retraite. (…)
Dans ce processus, le contrôle et la médiation des syndicats ont été jetés par-dessus bord : au-delà des objectifs partiels, la lutte a signifié :
- le refus de l’organisation capitaliste du travail,
- le refus du salaire lié aux exigences du patron pour la production,
- le refus de l’exploitation dans et en dehors de l’usine.
Les grèves, les cortèges, les assemblées internes, ont fait sauter la division entre les ouvriers et ont fait mûrir l’organisation autonome de classe en donnant les objectifs :
- toujours garder l’initiative dans l’usine contre le syndicat,
- 100 lires d’augmentation du salaire de base égale pour tous,
- seconde catégorie pour tous,
- réelles réductions du temps de travail.
(…) La lutte des ouvriers de la Fiat a de fait reproduit à un niveau massif les objectifs déjà formulés au cours des années 68-69 par les luttes des plus grandes concentrations ouvrières en Italie, de Milan à Porto Marghera, d’Ivrea à Valdagno. Ces objectifs sont :
- forte augmentation du salaire de base égale pour tous,
- abolition des catégories,
- réduction immédiate et drastique des horaires de travail sans diminution de salaire,
- égalité immédiate et complète entre ouvriers et employés." 27
Comme on l’a déjà dit, toute une série de points forts de l’Automne chaud peuvent être perçus dans ce tract. D’abord l’idée de l’égalité, c'est-à-dire que les augmentations doivent être égales pour tous, indépendamment de la catégorie d’origine, et non assujetties à la rentabilité du travail. Ensuite, la récupération de temps libre pour les ouvriers, pour pouvoir avoir une vie, pour pouvoir faire de la politique, etc. De là, la revendication de réduction des horaires de travail et le refus affirmé du travail à la tâche.
Dans ce même tract, il est rapporté que, sur la base de ces éléments, les ouvriers turinois réunis en assemblée après les affrontements du 3 juillet proposent à tous les ouvriers italiens d’entamer une nouvelle phase de lutte de classe plus radicale, qui fasse avancer, sur les objectifs mis en avant par les ouvriers eux-mêmes, l’unification politique de toutes les expériences autonomes de luttes faites jusque là.
A cette fin, un rassemblement national des comités et des avant-gardes ouvrières est convoqué à Turin :
1. pour confronter et unifier les différentes expériences de lutte sur la base de ce qu’a signifié la lutte à Fiat,
2. pour mettre au point les objectifs de la nouvelle phase de confrontation de classe qui, partant des conditions matérielles dans lesquelles se trouvent les ouvriers, devra investir toute l’organisation sociale capitaliste.
Ce qui se tiendra les 26/27 juillet au Palasport de Turin sera un "rassemblement national des avant-gardes ouvrières". Des ouvriers de toute l’Italie, qui rendent compte des grèves et des manifestations, parlent et avancent des revendications comme l’abolition des catégories, la réduction de l’horaire de travail à 40 heures, des augmentations de salaires égales pour tous en absolu et pas en pourcentage et la reconnaissance de la parité avec les employés. "Toute l’industrie italienne est représentée : par ordre d’intervention, après Mirafiori, la Pétrochimie de Marghera, la Dalmine et Il Nuovo Pignone de Massa, Solvay de Rossignano, Muggiano de La Spezzia, Piaggio de Pontedera, l’Italsider de Piombino, Saint Gobain de Pise, la Fatme, l’Autovox, Sacet et Voxon de Rome, la SNAM, Farmitalia, Sit Siemens, Alfa Romeo et Ercole Marelli de Milan, Ducati et Weber de Bologne, Fiat de Marina di Pisa, Montedison de Ferrare, Ignis de Varese, Necchi de Pavie, la Sir de Porto Torres, les techniciens de la Rai de Milan, Galileo Oti de Florence, les comités unitaires de base de Pirelli, l’arsenal de la Spezzia" 28. Quelque chose qu’on n’avait jamais vu, une assemblée nationale des avant-gardes ouvrières de toute l’Italie, un moment où la classe ouvrière s’affirme et auquel il n’est possible d’assister que dans un moment de forte montée de la combativité ouvrière, comme l’était justement l’Automne chaud.
Les mois qui suivent, ceux qui sont restés dans la mémoire historique comme "l’Automne chaud", se déroulent selon la même ligne. Les nombreux épisodes de lutte, dont une intéressante documentation photographique peut être trouvée sur le site de La Repubblica 29, s’enchaînent les uns aux autres à une cadence infernale. En voici une sélection non exhaustive :
2/09 : grève des ouvriers et des employés à Pirelli pour la prime à la production et les droits syndicaux. A Fiat, les ouvriers des départements 32 et 33 de Mirafiori se mettent à lutter, contrevenant aux directives syndicales, contre la discrimination de l’entreprise sur les changements de catégorie ;
4/09 : Agnelli, patron de Fiat, met à pied 30 000 travailleurs ;
5/09 : la tentative des directions syndicales d’isoler les ouvriers d’avant-garde de Fiat échoue, Agnelli est obligé de retirer les mises à pied ;
6/09 : plus de deux millions de métallos, d’employés du bâtiment et de la chimie partent en lutte pour le renouvellement du contrat salarial ;
11/09 : à la suite de la rupture des négociations concernant le renouvellement du contrat des métallos le 8 septembre, un million de métallurgistes fait grève dans toute l’Italie. À Turin, 100 000 ouvriers bloquent la Fiat ;
12/09 : grève nationale des ouvriers du bâtiment, tous les chantiers du pays sont fermés. Manifestations des métallurgistes à Turin, Milan et Tarente ;
16-17/09 : grève nationale de 48 heures des ouvriers de la chimie, grève nationale dans les cimenteries et nouvelle journée de lutte des ouvriers du bâtiment ;
22/09 : manifestation de 6000 ouvriers d’Alfa Roméo à Milan. Journée de lutte des métallurgistes à Turin, Venise, Modène et Cagliari ;
23-24/09 : nouvelle grève générale de 48 heures des ouvriers des cimenteries ;
25/09 : lock-out à Pirelli, suspension pour un temps indéterminé de 12.000 ouvriers. Réaction immédiate des ouvriers qui bloquent tous les établissements du groupe ;
26/09 : manifestation des métallurgistes à Turin où un cortège de 50 000 ouvriers part de Fiat. Grève générale à Milan et manifestations de centaines de milliers d'ouvriers qui imposent ainsi à Pirelli la fin du lock-out. Cortèges de dizaines de milliers de travailleurs à Florence et Bari ;
29/09 : manifestations des métallurgistes, ouvriers de la chimie et du bâtiment à Porto Marghera, Brescia et Gènes ;
30/09 : grève des ouvriers du bâtiment à Rome, manifestations de 15 000 métallurgistes à Livourne ;
7/10 : grève des métallurgistes dans la province de Milan, 100 000 ouvriers provenant de 9 cortèges se rejoignent sur la Place du Dôme ;
8/10 : grève générale nationale des employés de la chimie. Grève dans la région de Terni. Manifestations des métallurgistes à Rome, Sestri, Piombino, Marina di Pisa et L’Aquila ;
9/10 : 60 000 métallurgistes font grève à Gènes. Grève générale dans le Frioul et la Vénétie Julienne ;
10/10 : pour la première fois, se tient une assemblée à l’intérieur des ateliers de Fiat-Mirafiori. Des assemblées et des défilés ont également lieu à l’intérieur des autres usines du groupe. La police charge à l’extérieur des établissements. Grève à Italsider de Bagnoli contre la suspension de 5 ouvriers ;
16/10 : les hospitaliers, les cheminots, les postiers, les travailleurs des administrations locales et les ouvriers journaliers partent en lutte pour le renouvellement de leurs contrats. Des grèves générales ont lieu dans les provinces de Palerme et Matera ;
22/10 : 40 usines de Milan gagnent le droit de faire des assemblées ;
8/11 : le contrat des ouvriers du bâtiment est signé : il prévoit l’augmentation de 13% sur les plus basses rétributions, la réduction graduelle du temps de travail à 40 heures, le droit de faire des assemblées sur les chantiers ;
13/11 : affrontements très durs entre les ouvriers et la police à Turin ;
25/11 : grève générale dans la chimie ;
28/11 : des centaines de milliers de métallurgistes animent, à Rome, une des plus grandes et des plus combatives manifestations qui ait jamais eu lieu en Italie pour soutenir leurs revendications ;
3/12 : grève totale des ouvriers des carrosseries à Fiat, manifestation des employés des administrations locales ;
7/12 : un accord est trouvé pour le contrat dans la chimie : il prévoit des augmentations de salaire de 19.000 lires par mois, un horaire hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours, et trois semaines de congés payés ;
8/12 : accord sur le contrat dans les entreprises de la métallurgie dans lesquelles l’État a une participation : le contrat prévoit l’augmentation de 65 lires par heure, augmentation égale pour tous, la parité légale entre ouvriers et employés, le droit de faire des assemblées dans l’entreprise pendant les heures de travail à raison de 10 heures par an, payées, et 40 heures de travail hebdomadaire ;
10/12 : grève générale des ouvriers agricoles pour le pacte national, des centaines de milliers manifestent dans toute l’Italie. Début de la grève de 4 jours des employés des sociétés pétrolières privées pour le renouvellement du contrat ;
19/12 : grève nationale des travailleurs de l’industrie pour soutenir le conflit des métallurgistes. Nouvelle grève nationale des ouvriers agricoles ;
23/12 : signature de l’accord pour le nouveau contrat des métallurgistes : il prévoit des augmentations salariales de 65 lires par heure pour les ouvriers et de 13.500 lires par mois pour les employés, le treizième mois, le droit de faire des assemblées dans l’usine, la reconnaissance des représentants syndicaux d’entreprise et la réduction de l’horaire de travail à 40 heures par semaine ;
24/12 : le pacte national pour les ouvriers agricoles est signé après 4 mois de lutte, il prévoit la réduction progressive de l’horaire de travail à 42 heures par semaine et 20 jours de congés 30.
Cet enchaînement impressionnant de luttes n'est pas seulement le produit d'une forte poussée ouvrière mais porte aussi la marque des manœuvres des syndicats qui dispersent les luttes en autant de foyers distincts allumés à l'occasion du renouvellement des contrats collectifs venant à échéance dans différents secteurs et entreprises. C'est le moyen par lequel la bourgeoisie parvient à faire en sorte que le mécontentement social profond qui se fait jour ne débouche sur un embrasement généralisé.
Ce développement énorme de la combativité, accompagné de moments de clarification significatifs dans la classe ouvrière, rencontrera également d'autres obstacles importants dans la période qui va suivre. La bourgeoisie italienne, comme celle des autres pays qui ont dû faire face au réveil de la classe ouvrière, n’est pas restée les mains dans les poches et, à côté des interventions frontales effectuées par les corps de police, elle a cherché graduellement à contourner l’obstacle en utilisant d’autres moyens. Ce que nous verrons dans la deuxième partie de l’article, c’est que la capacité qu’a la bourgeoisie de reprendre le contrôle de la situation se fonde principalement sur les faiblesses d’un mouvement prolétarien qui, malgré son énorme combativité, manquait encore d’une conscience de classe claire et dont même les avant-gardes n’avaient pas la maturité et la clarté nécessaires pour jouer leur rôle.
1/11/09 Ezechiele
1 Du mois de juillet 1969 et pendant plusieurs mois.
2 Voir : Revue internationale n°133 [17] et 134 [18], Mai 68 et la perspective révolutionnaire (I et II), 2008.
3 Voir : Lutte de classe en Europe de l’Est [19] (1970-1980), Revue Internationale n°100.
4 Dans les années 73-74, le Cordobazo, la grève de Mendoza et la vague de luttes qui a submergé le pays, ont alors représenté la clef de l’évolution sociale. Sans revêtir un caractère insurrectionnel, ces luttes ont néanmoins constitué le signal d’un réveil du prolétariat en Amérique du sud. Voir : Révoltes populaires en Argentine : seule l’affirmation du prolétariat sur son terrain peut faire reculer la bourgeoisie [20]. Revue internationale n°109, 2002.
5 Voir : Notes sur l’histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale [21], 2ème partie. Revue Internationale n°114.
6 "C’est ainsi qu’est né le slogan : ‘l’Université est notre Vietnam’ ; les guérilleros vietnamiens combattent contre l’impérialisme américain, les étudiants font leur révolution contre le pouvoir et l’autoritarisme académique". Alessandro Silj, Malpaese, criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima Republica 1943-1994, Donzelli Ed., Rome 1994, p. 92 ;
7 Voir : Che Guevara : mythe et réalité (à propos de courriers d’un lecteur) [22], dans Révolution Internationale n°384 ; Quelques commentaires sur une apologie d’Ernesto"Che" Guevara (à propos d’un livre de Besancenot) [23], in Révolution Internationale n°388.
8 Voir : Le conflit Juifs/Arabes : la position des internationalistes dans les années 30 : Bilan n° 30 et 31 [24], in Revue Internationale n°110 ; Notes sur l’histoire des conflits impérialistes au Moyen-Orient (1ère partie, 2ème partie et 3ème partie) in Revue Internationale N°115 [25], 117 [26] et 118 [27] ; Affrontements Hamas/Fatah : la bourgeoisie palestinienne est aussi sanguinaire que les autres [28], in Révolution Internationale n°381.
9 Voir : Le maoïsme :un pur produit de la contre-révolution [29], in Révolution Internationale n°371 ; Chine 1928-1949 :maillon de la guerre impérialiste, I [30] et II [31], in Revue Internationale n°81 [30] et 84 [31] ; Cina : il capitalismo di stato, dalle origini alla Rivoluzione Culturale (I et II) in Rivoluzione Internazionale n°5 et 6.
10 Voir : Silvia Castillo, Controcultura e politica nel Sessantotto italiano.
11 Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling et Kupfer Eds., p. 13.
12 Luca Barbieri, Il caso 7 aprile. Cap. III, www.indicius.it [32]
13 Interview de Rita Di Leo in L’operaismo degli anni sessanta. Dai ‘Quaderni rossi’ a ‘classe operaia’. Giuseppe Trotta et Fabio Milana, Edition DeriveApprodi. www.deriveapprodi.com [33]
14 Voir : Luca Barbieri, Il caso 7 aprile. Cap. III, www.indicius.it [32]
15 Emiliano Mentasti, La guardia rossa racconta. Storia del Comitato operaio della Magneti Marelli. p. 25, Editions Colibri.
16 Giorgio Frasca Polara, Tambroni e il luglio "caldo” del 60, www.libertaegiustizia.it/primopiano/pp_leggi_articolo.php?id=2803&id_tit... [34]
17 La rivolta operaia di piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
18 Dario Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, Torino, Luglio 1962, Feltrinelli.
19 La rivolta operaia di piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
20 CI est l’abréviation pour Commissions Internes, officiellement des structures représentant les travailleurs dans les conflits dans l’entreprise, en fait une expression du contrôle du syndicat sur les travailleurs. Elles ont fonctionné jusqu’à l’Automne chaud et ont été ensuite remplacées par les Conseils d’usine (CdF).
21 Emilio Mentasti, La guardia rossa racconta. Storia del Comitato operaio della Magneti Marelli. p. 37, Edition Colibri.
22 Aldo Cazzulo, I raggazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. Pp. 75-76. Sperling et Kupfer Eds.
23 Aldo Cazzulo, I raggazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. Pp. 60. Sperling et Kupfer Eds.
24 Document du CUB de Pirelli (Bicocca), "Ibm e Sit Siemens", cité dans Alessandro Silj, Mai piu senza fucile, Vallecchi, Florence 1977, pp. 82-84
25 "La lutte entreprise par les travailleurs agricoles de la province de Syracuse le 24 novembre, à laquelle participaient les ouvriers agricoles d’Avola, revendiquait l’augmentation du salaire journalier, l’élimination des différences de salaire et d’horaire entre les deux zones dans lesquelles la province était divisée, l’introduction d’une loi visant à garantir le respect des contrats, la mise en place des commissions paritaires de contrôle, obtenues dans la lutte en 1966 mais qui n’avaient jamais fonctionné. (…) Les ouvriers agricoles firent des blocages de routes et furent chargés par la police. Le 2 décembre, Avola participa en masse à la grève générale. Les journaliers mirent en place à partir de la nuit des blocages de route sur la Nationale pour Noto, et les ouvriers étaient à leurs côtés. Dans la matinée, les femmes et les enfants arrivèrent. Vers 14 heures, le Vicequesteur (sous-préfet de police) de Syracuse, Samperisi, donna l’ordre à la compagnie de Celere, rejointe par celle de Catania, d’attaquer.(…) Ce jour là, la brigade de Celere sonna trois fois la charge, tirant sur la foule qui pensait qu’il s’agissait de tirs à blanc. Les ouvriers agricoles cherchèrent un abri ; certains lancèrent des pierres. Ce scénario de guerre dura à peu près une demie heure. A la fin, Piscitello, député communiste, ramassa sur le goudron plus de deux kilos d’obus. Le bilan fut de deux journaliers morts, Angelo Sigona et Giuseppe Scibilia, et de 48 blessés, dont 5 graves. (www.attac-italia.org [35]).
26 "Nous descendions dans la rue avec la générosité habituelle des jeunes aux côtés des travailleurs et des travailleuses qui faisaient grève contre la fermeture des manufactures de tabac et de sucre. La fermeture de ces entreprises, mais aussi des sous-traitants, mettait en crise toute la ville, compte-tenu du fait qu’à peu près la moitié de la population en tirait l’unique source de revenu. La grève générale fut l’unique issue possible et fut ressentie comme telle et menée par toute la ville, et même nous, les étudiants ; beaucoup d’entre nous, bien qu’ils ne fussent pas de Battipaglia, ressentirent la nécessité de participer dans la mesure où nous comprenions l’importance de ces deux manufactures pour l’économie de la ville. On ressentait aussi un autre motif pour la grève générale : c’était l’occasion d’apporter la solidarité à ceux de la manufacture de tabac qui occupaient l’établissement de Santa Lucia, depuis bientôt une dizaine de jours. Le spectre d’une crise pesait sur la ville, crise qui avait déjà frappé avec la fermeture de quelques conserveries et qui se profilait comme étant dramatique pour des milliers de travailleurs qui allaient inévitablement perdre leur travail. (…) Très rapidement, il y eut des moments de tension et, comme cela arrive souvent, ils se transformèrent en véritables mouvements. Battipaglia devint le théâtre d’affrontements violents, des barricades s’érigèrent, toutes les issues par route furent bloquées et la gare fut occupée. La police chargea, et ce qui devait être une grande journée de solidarité vis-à-vis de ceux qui voulaient garder leur poste de travail se transformé en une insurrection populaire. Le bilan : deux morts, des centaines de blessés, des dizaines de véhicules brûlés (ceux de la police et de privés) et des dégâts incalculables. (…) Pour avoir raison d’une ville blessée et en colère, il fallut aux forces de l’ordre, environ une vingtaine d’heures". (Témoignage rapporté dans le blog : massimo.delmese.net/marx1-mini [36]).
27 www.nelvento.net/archivio/68/operai/traiano02.htm [37]
28 Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. p. 67, Sperling etKupfer Editeurs.
29 https://static.repubblica.it/milano/autunnocaldo/ [38]
30 du site : www.pmli.it/storiaautunnocaldo.htm [39]
Géographique:
- Italie [40]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [41]
Qu'est ce que les conseils ouvriers ? (I) : pourquoi les conseils ouvriers surgissent-ils en 1905 ?
- 5088 lectures
Le 2 mars 1919, lors de la session inaugurale du Premier Congrès de l’Internationale communiste, Lénine affirmait que le "système des soviets" (conseils ouvriers en langue russe), après avoir été "du latin" pour les grandes masses ouvrières était devenu très populaire et, surtout, était devenu une pratique de plus en plus généralisée ; et il citait comme exemple un télégramme qui venait d’arriver d’Angleterre qui disait : "Le gouvernement de la Grande-Bretagne avait reçu le Conseil des députés ouvriers constitué à Birmingham et promis de reconnaître les Soviets comme des organes économiques." 1.
Aujourd’hui, 90 ans plus tard, des camarades de différents pays nous écrivent pour nous demander : "que sont les Conseils ouvriers ?", en reconnaissant que c’est un sujet dont ils ne savent pratiquement rien et sur lequel ils voudraient pouvoir se faire une idée.
Le poids de la plus terrible contre-révolution de l’histoire, les difficultés qui, depuis 1968, entravent la politisation des luttes de la classe ouvrière ; la falsification, voire le silence complet que les moyens de communications et de culture imposent sur les expériences historiques du prolétariat, font que les mots tels que soviet ou conseil ouvrier, qui étaient pourtant si familiers pour les générations ouvrières des années 1917-23, sont aujourd’hui quelque chose d’étrange ou interprété avec un sens radicalement différent de celui qu'ils avaient à l’origine. 2
Ce sera donc là l’objectif de cet article : contribuer à répondre très simplement à ces questions : que sont les Conseils ouvriers ? Pourquoi ont-ils surgi ? À quelles nécessités historiques répondaient-ils ? Sont-ils sont toujours d’actualité à l’époque présente ?
Pour répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur l’expérience historique de notre classe, une expérience constituée tout autant par les révolutions de 1905 et 1917 que par les débats et les écrits des militants révolutionnaires : Trotsky, Rosa Luxemburg, Lénine, Pannekoek …
Les conditions historiques dans lesquelles naissent les Conseils ouvriers
Pourquoi les Conseils ouvriers surgissent-ils en 1905 et non pas en 1871 lors de la Commune révolutionnaire de Paris ? 3
On ne peut comprendre le surgissement des Conseils ouvriers lors de la révolution russe de 1905 qu’en analysant l’ensemble des facteurs suivants : les conditions historiques de la période, les expériences de lutte que le prolétariat avait faites et l’intervention des organisations révolutionnaires.
Concernant le premier facteur, le capitalisme se trouvait au sommet de son évolution, mais il montrait des signes de plus en plus évidents du début de son déclin, particulièrement sur le terrain impérialiste. Trotsky, dans ses ouvrages 1905 et Bilan et perspectives, sur lesquels nous allons nous appuyer, met en avant que "En liant tous les pays entre eux par son mode de production et son commerce, le capitalisme a fait du monde entier un seul organisme économique et politique", et plus précisément, "Cela donne immédiatement aux événements qui se déroulent actuellement un caractère international, et ouvre un large horizon. L'émancipation politique de la Russie sous la direction de la classe ouvrière élèvera cette classe à des sommets historiques inconnus jusqu'à ce jour et en fera l'initiatrice de la liquidation du capitalisme mondial, dont l'histoire a réalisé toutes les prémisses objectives 4." Produits de cette nouvelle période, des mouvements massifs et des grèves générales avaient déjà fait irruption de par le monde avant 1905 : grève générale en Espagne en 1902 et en Belgique en 1903 et jusqu’en Russie même à différents moments.
Nous en arrivons au deuxième facteur. Les conseils ouvriers ne surgissent pas du néant comme un éclair dans un ciel bleu. Dans les années qui précèdent, de nombreuses grèves éclatent en Russie à partir de 1896 : la grève générale des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en 1896 et 1897 ; les grandes grèves qui, en 1903 et 1904, ébranlèrent tout le sud de la Russie ; etc. Elles constituent autant d'expériences où se manifestent des tendances à la mobilisation spontanée, où se créent des organes de luttes qui ne correspondent plus typiquement aux formes syndicales de lutte, préparant ainsi le terrain pour les luttes de 1905 : "On ne manquera pas de faire remonter l'histoire de la période présente des luttes de masse aux grèves générales de Saint-Pétersbourg. Celles-ci sont importantes pour le problème de la grève de masse parce qu'elles contiennent déjà en germe tous les éléments principaux des grèves de masse qui suivirent" (Rosa Luxemburg ; Grève de masse, parti et syndicats).
Par ailleurs, et concernant le troisième facteur, les partis prolétariens (les bolcheviks et autres tendances) n'avaient évidemment pas fait une propagande préalable sur le thème des conseils ouvriers puisque leur surgissement les a surpris ; ils n'avaient pas non plus mis en place des structures d'organisation intermédiaires pour les préparer. Et, cependant, leur travail politique incessant de propagande a grandement contribué à leur surgissement. C'est ce que met en évidence Rosa Luxemburg à propos des mouvements spontanés comme celui de la grève des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en 1896 et 1897 : "Tout d'abord l'occasion qui déclencha le mouvement fut fortuite et même accessoire, l'explosion en fut spontanée. Mais dans la manière dont le mouvement fut mis en branle se manifestèrent les fruits de la propagande menée pendant plusieurs années par la social-démocratie" (Grève de masse, parti et syndicats). A ce propos, elle clarifie de façon rigoureuse quel est le rôle des révolutionnaires : "Il est hors du pouvoir de la social-démocratie de déterminer à l'avance l'occasion et le moment où se déclencheront les grèves de masse en Allemagne, parce qu'il est hors de son pouvoir de faire naître des situations historiques au moyen de simples résolutions de congrès. Mais ce qui est en son pouvoir et ce qui est de son devoir, c'est de préciser l’orientation politique de ces luttes lorsqu'elles se produisent et de la traduire par une tactique résolue et conséquente" (Ibid).
Cette analyse permet de comprendre la nature du grand mouvement qui secoue la Russie au cours de l’année 1905 et qui connaît son étape décisive dans les trois derniers mois de cette année-là, d’octobre à décembre, pendant lesquels va se généraliser le développement des conseils ouvriers.
Le mouvement révolutionnaire de 1905 a son origine immédiate dans le mémorable "Dimanche sanglant", le 22 janvier 1905 5. Ce mouvement connaît un premier reflux en mars 1905 pour ressurgir, par différents chemins, en mai et juillet 6. Pendant cette période, cependant, il prend la forme d’une série d’explosions spontanées manifestant un faible niveau d’organisation. Par contre, à partir du mois de septembre, la question de l’organisation générale de la classe ouvrière occupe le premier plan : on entre dans une phase de politisation croissante des masses, au sein desquelles apparaissent les limites de la lutte immédiate revendicative mais aussi l’exaspération causée aussi bien par la brutalité du tsarisme que par les hésitations de la bourgeoisie libérale 7.
Le débat de masse
Nous venons de rappeler le terreau historique sur lequel naissent les premiers soviets. Mais quelle est leur origine concrète ? Est-ce qu’ils sont le résultat de l’action délibérée d’une minorité audacieuse ? Ou, au contraire, ont-ils surgi mécaniquement des conditions objectives ?
Si la propagande révolutionnaire menée depuis des années a, comme on l'a dit, contribué au surgissement des soviets, et si Trotsky a joué un rôle de premier plan au sein du Soviet de Saint-Pétersbourg, le surgissement des soviets ne fut le résultat direct ni de l’agitation ni des propositions organisationnelles des partis marxistes (divisés à ce moment-là entre bolcheviks et mencheviks) ni non plus de l'initiative de groupes anarchistes comme le présente Voline dans son livre La Révolution inconnue. 8 Voline 9 situe l’origine de ce premier soviet entre la moitié et la fin de février de 1905. Sans mettre en doute la vraisemblance de ces faits, il est important de signaler que cette réunion – que Voline lui-même qualifie de "privée" - a pu être un élément supplémentaire contribuant au processus vers le surgissement des soviets, mais elle n'en constitua pas leur acte de naissance.
Il est d'usage de considérer le soviet d’Ivanovo-Vosnesensk comme le premier ou l'un des premiers. 10 Au total, 40 à 50 soviets ont été identifiés ainsi que quelques soviets de soldats et de paysans. Anweiler insiste sur leur origines disparates : "Leur naissance se fit ou bien sous forme médiatisée, dans le cadre d’organismes de type ancien – comités de grève ou assemblées de députés, par exemple – ou bien sous forme immédiate, à l’initiative des organisations locales du Parti social-démocrate, appelées en ce cas à exercer une influence décisive sur le soviet. Les limites entre le comité de grève pur et simple et le conseil des députés ouvriers vraiment digne de ce nom étaient souvent des plus floues, et ce ne fut que dans les principaux centres de la révolution et de la classe laborieuse tels que (Saint-Pétersbourg mis à part) Moscou, Odessa, Novorossiisk et le bassin du Donetz, que les conseils revêtirent une forme d’organisation nettement tranchée." 11
Ainsi, la paternité des soviets ne peut être attribuée à tel ou tel personnage ou telle minorité, mais ils ne sont pas nés du néant, par génération spontanée. Fondamentalement, ils ont été l’œuvre collective de la classe : des initiatives multiples, des discussions, des propositions surgies ici ou là, tout cela tissé avec le fil de l’évolution des événements, et avec l’intervention active des révolutionnaires, a abouti à la naissance des soviets. En regardant de plus près ce processus, nous pouvons identifier deux facteurs déterminants : le débat de masse et la radicalisation croissante des luttes.
La maturation de la conscience des masses qu’on observe depuis septembre 1905 s’est concrétisée dans le développement d’une formidable volonté de débattre. Le bouillonnement de discussions animées dans les usines, les universités, les quartiers, apparaît comme un phénomène "nouveau" qui surgit significativement pendant le mois de septembre. Trotsky cite quelques témoignages : "Des assemblées populaires absolument libres dans les murs des universités, alors que, dans la rue, c'est le règne illimité de Trepov12, voilà un des paradoxes les plus étonnants du développement politique et révolutionnaire pendant l'automne de 1905". Ces réunions sont de plus en plus massivement fréquentées par les ouvriers, "'Le peuple' emplissait les corridors, les amphithéâtres et les salles. Les ouvriers allaient tout droit à l'université en sortant de l'usine", dit Trotsky, qui ajoute à la suite : "L'agence télégraphique dépeint avec horreur le public qui s'était amassé dans la salle des fêtes de l'université de Saint-Vladimir. D'après les télégrammes, on voyait dans cette foule, outre les étudiants, une multitude de personnes des deux sexes venues du dehors, des élèves de l'enseignement secondaire, des adolescents des écoles privées, des ouvriers, un ramassis de gens de toute espèce et de va-nu-pieds" 13
Mais il ne s’agit pas du tout d’un "ramassis de gens" comme l’affirme avec mépris l’agence d’information, mais d’un collectif qui discute et réfléchit avec ordre et méthode, en se tenant à une discipline élevée et avec une maturité reconnue même par un chroniqueur du journal bourgeois Rouss (La Russie), cité par Trotsky : "Savez-vous ce qui m'a le plus frappé au meeting de l'université. C'est l'ordre merveilleux, exemplaire, qui régnait. On avait annoncé une suspension dans la salle des séances et j'allai rôder dans le corridor. Le corridor de l'université, c'est maintenant la rue tout entière. Tous les amphithéâtres qui donnaient sur le corridor étaient pleins de monde ; on y tenait des meetings particuliers, par fractions. Le couloir lui-même était bondé, la foule allait et venait (…). On aurait cru assister à un "raout", mais l'assemblée était plus nombreuse et plus sérieuse que dans les réceptions habituelles. Et cependant, c'était là le peuple, le vrai peuple, le peuple aux mains rouges et toutes crevassées par le travail, au visage terreux comme l'ont les gens qui passent leur vie dans des locaux fermés et malsains" 14.
C’est le même état d’esprit qu’on peut observer depuis le mois de mai dans la ville industrielle citée précédemment, Ivanovo-Vosnesensk : Les assemblées plénières se déroulent tous les matins à partir de neuf heures. Une fois la séance [du Soviet] terminée, l’assemblée générale des ouvriers commençait et elle examinait toutes les questions en rapport avec la grève. On rendait compte de son déroulement, des négociations avec les patrons et les autorités. Après la discussion on soumettait à l’assemblée les propositions préparées par le Soviet. Ensuite, les militants des partis faisaient des discours d’agitation sur la situation de la classe ouvrière et la réunion continuait jusqu’à ce que le public soit gagné par la fatigue. À ce moment-la, la foule se mettait à chanter des hymnes révolutionnaires et on mettait fin à l’assemblée. Et ainsi tous les jours" 15
La radicalisation des luttes
Une petite grève dans l’imprimerie Sitin de Moscou qui avait éclaté le 19 septembre allait allumer la mèche de la grève générale massive d’octobre durant laquelle les soviets se généraliseront. La solidarité avec les imprimeurs de Sitin avait porté la grève à plus de 50 imprimeries moscovites ce qui déboucha, le 26 septembre, sur une réunion générale de typographes qui prit le nom de Conseil. La grève s’étend à d’autres secteurs : aux boulangeries, aux industries métallurgiques et textiles. L’agitation gagne, d’un coté, les chemins de fer et, de l’autre, les imprimeurs de Saint-Pétersbourg qui se solidarisent avec leurs camarades de Moscou.
Un autre front organisé surgit de façon inattendue : une Conférence des représentants des cheminots à propos des Caisses de retraite débute à Saint-Pétersbourg le 20 septembre. La Conférence lance un appel à tous les secteurs ouvriers, en ne se limitant pas à cette question-là mais mettant en avant la nécessité de faire des réunions d’ouvriers de différentes branches et de proposer des revendications économiques et politiques. Encouragée par les télégrammes de soutien qui arrivent de tout le pays, la Conférence convoque une nouvelle réunion pour le 9 octobre.
Peu de temps après, le 3 octobre, "L'assemblée des députés ouvriers des corporations de l'imprimerie, de la mécanique, de la menuiserie, du tabac et d'autres, adopte la résolution de constituer un conseil (soviet) général des ouvriers de Moscou" 16.
La grève des cheminots qui avait surgi spontanément sur quelques lignes du réseau ferré devient grève générale à partir du 7 octobre. Dans ce contexte, la réunion convoquée pour le 9 se transforme en "congrès des délégués cheminots à Saint-Pétersbourg, on formule et on expédie immédiatement par télégraphe sur toutes les lignes les mots d'ordre de la grève des chemins de fer : la journée de huit heures, les libertés civiques, l'amnistie, l'Assemblée constituante" 17.
Les réunions massives à l’université avaient été parcourues par un débat de grande intensité sur la situation, les expériences vécues, les alternatives d’avenir, mais en octobre la situation change : ces débats ne s’éteignent pas mais, au contraire, mûrissent pour devenir lutte ouverte, une lutte qui, à son tour, commence à se doter d’une organisation générale, laquelle non seulement dirige la lutte mais intègre et démultiplie ce débat massif. La nécessité de se regrouper et de se réunir, d’unifier les différents foyers de grève avait été posée de manière particulièrement aiguë par les ouvriers de Moscou. Se donner un programme avec des revendications économiques et politiques adaptées à la situation et en accord avec les possibilités réelles de la classe ouvrière, voilà ce que le congrès des cheminots avait pu apporter. Débat, organisation unifiée, programme de lutte : voilà les trois piliers sur lesquels vont se bâtir les Soviets. C’est bien donc la convergence d’initiatives et de propositions des différents secteurs de la classe ouvrière qui sont à l’origine des Soviets et absolument pas le "plan" d’une quelconque minorité. Dans les soviets se concrétise ce qui, 60 ans plus tôt, dans le Manifeste communiste, paraissait une formulation utopique : "Tous les mouvements ont été jusqu’à maintenant réalisés par des minorités pour des minorités. Le mouvement prolétarien est un mouvement indépendant de l’immense majorité au profit de l’immense majorité".
Les Soviets, organes de lutte révolutionnaire
"Le 13 au soir, dans les bâtiments de l'Institut technologique, eut lieu la première séance du futur soviet. Il n'y avait pas plus de trente à quarante délégués. On décida d'appeler immédiatement le prolétariat de la capitale à la grève politique générale et à l'élection des délégués" 18.
Ce Soviet lançait l’appel suivant : "La classe ouvrière, disait l'appel rédigé à la première séance, a dû recourir à l'ultime mesure dont dispose le mouvement ouvrier mondial et qui fait sa puissance : à la grève générale... Dans quelques jours, des événements décisifs doivent s'accomplir en Russie. Ils détermineront pour de nombreuses années le sort de la classe ouvrière ; nous devons donc aller au-devant des faits avec toutes nos forces disponibles, unifiées sous l'égide de notre commun soviet... " 19
Ce passage montre la vision globale, la large perspective que possède l’organe qui vient de naître de la lutte. D’une manière simple, il exprime une vision clairement politique et en cohérence avec l’être profond de la classe ouvrière, en se reliant avec le mouvement ouvrier mondial. Cette conscience est à la fois expression et facteur actif de l’extension de la grève à tous les secteurs et à tout le pays, une grève pratiquement généralisée à partir du 12 octobre. La grève paralyse l’économie et la vie sociale, mais le Soviet veille à ce que cela n’entraîne pas une paralysie de la lutte ouvrière elle-même. Comme le montre Trotsky, "Elle [la grève] ouvre une imprimerie quand elle a besoin de publier les bulletins de la révolution, elle se sert du télégraphe pour envoyer ses instructions, elle laisse passer les trains qui conduisent les délégués des grévistes" 20. La grève "ne consiste pas simplement dans une interruption du travail pour attendre les événements, n'est pas une passive protestation des bras croisés. Elle se défend, et, de la défensive, passe à l'offensive. Dans plusieurs villes du Midi, elle élève des barricades, fait main basse sur les magasins des armuriers, s'arme et fournit une résistance sinon victorieuse, du moins héroïque "21.
Le Soviet est la scène active où se déroule un débat autour de trois axes :
-
Quel rapport avoir avec les paysans ? Etant des alliés indispensables, comment et dans quelles conditions peuvent-ils être intégrés dans la lutte ?
-
Quel est le rôle de l’armée ? Est-ce que les soldats vont déserter de l’engrenage répressif du régime ?
-
Comment s’armer pour assumer l’affrontement décisif avec l’État tsariste qui devient de plus en plus inévitable ?
Dans les conditions de 1905, ces questions pouvaient être posées, mais elles ne pouvaient pas être résolues. Ce sera la Révolution de 1917 qui leur donnera la réponse. Ceci dit, toutes les capacités qui se sont développées en 1917 n’auraient pas pu être envisagées sans les grands combats de 1905.
On imagine la plupart du temps que des questions comme celles posées ci-dessus ne peuvent être que l’apanage de petits cénacles composés "de stratèges de la révolution". N’empêche que dans le cadre des soviets, elles ont été l’objet d’un débat massif avec la participation et les apports de milliers d’ouvriers. Ces pédants qui considèrent les ouvriers incapables de s’occuper de telles affaires, auraient pu vérifier que ceux-ci en parlaient avec le plus grand naturel, devenaient des experts passionnés et engagés, et versaient dans le creuset de l’organisation collective leurs intuitions, leurs sentiments, leurs connaissances remâchées pendant des années. Comme l’évoque de façon imagée Rosa Luxemburg : "Dans les conditions de la grève de masse, l’honnête père de famille devient un révolutionnaire romantique".
Si le 13, il y avait à peine 40 délégués à la réunion du Soviet, par la suite, le nombre se multiplie jour après jour. La première décision de toute usine qui se déclare en grève est d’élire un délégué auquel on donne un mandat consciencieusement adopté par l’assemblée. Il y a des secteurs qui hésitent : les travailleurs du textile de Saint-Pétersbourg, contrairement à leurs collègues moscovites, ne rejoindront la lutte que le 16. Le 15, "Afin d'amener les abstentionnistes à la grève, le soviet mit au point toute une série de moyens de pression gradués, depuis les exhortations jusqu'à l'emploi de la violence. On ne fut pas obligé, toutefois, d'en arriver à cette extrémité. Lorsque les appels imprimés restaient sans effet, il suffisait de l'apparition d'une foule de grévistes, parfois même de quelques hommes, pour que le travail cessât. 22".
Les réunions du soviet étaient aux antipodes de ce qu’est un parlement bourgeois ou une controverse académique entre universitaires. "Aucune trace de verbosité, cette plaie des institutions représentatives ! Les questions sur lesquelles on délibérait – l'extension de la grève et les exigences à présenter à la douma étaient de caractère purement pratique et les débats se poursuivaient sans phrases inutiles, en termes brefs, énergiques. On sentait que chaque seconde valait un siècle. La moindre velléité de rhétorique se heurtait à une protestation résolue du président, appuyée par toutes les sympathies de l'austère assemblée." 23
Ce débat vif et pratique, à la fois profond et concret, révélait une transformation de la conscience et de la psychologie sociale des ouvriers et, en même temps, constituait un puissant facteur de développement de celles-ci. Conscience : compréhension collective de la situation sociale et de ses perspectives, de la force concrète des masses en action et des objectifs qu’elles doivent se donner, identification des amis et des ennemis, ébauche d’une vision du monde et de son avenir. Mais en même temps psychologie sociale : facteur à la fois distinct mais concomitant avec la conscience, facteur qui s’exprime dans l’attitude morale et vitale des ouvriers, dans leur solidarité contagieuse, dans leur empathie vis-à-vis des autres, dans leur capacité d’ouverture et d’apprentissage, de dévouement désintéressé à la cause commune.
Cette transformation mentale peut apparaître utopique et impossible à ceux qui ne voient les ouvriers que sous le prisme de la normalité quotidienne où ils peuvent apparaître comme des robots atomisés, sans la moindre initiative ni sentiment collectif, détruits par le poids de la concurrence et de la rivalité. Et c’est l’expérience de la lutte massive et, dans son déroulement, la formation des Conseils ouvriers qui montrent comment ceux-ci sont le moteur d’une telle transformation, tel que Trotsky l’exprime : "Le socialisme n'a pas pour but de créer une psychologie socialiste comme prémisse du socialisme, mais de créer des conditions de vie socialiste comme prémisses d'une psychologie socialiste." 24
Les Assemblées générales et les Conseils élus par elles et responsables devant elles deviennent autant le cerveau que le cœur de la lutte. Cerveau pour que des milliers d’êtres humains puissent penser à haute voix et puissent prendre des décisions à la suite d’une période de réflexion. Cœur pour que ces êtres cessent de se percevoir comme des gouttes perdues dans un océan de personnes inconnues les unes des autres et potentiellement hostiles pour devenir une partie active d’une large communauté qui les intègre tous et fait que tous se sentent solides et soutenus.
En se construisant sur ces solides fondations, le Soviet érige le prolétariat en pouvoir alternatif face à l’État bourgeois. Il devient une autorité de plus en plus reconnue socialement. "Au fur et à mesure du développement de la grève d'octobre, le soviet devenait tout naturellement le centre qui attirait l'attention générale des hommes politiques. Son importance croissait littéralement d'heure en heure. Le prolétariat industriel avait été le premier à serrer les rangs autour de lui. L'Union des syndicats, qui avait adhéré à la grève dès le 14 octobre, dut presque immédiatement reconnaître son protectorat. De nombreux comités de grève (…) réglaient leurs actes sur ses décisions." 25
Beaucoup d’auteurs anarchistes et conseillistes ont présenté les soviets comme les porte-drapeaux d’une idéologie fédéraliste bâtie sur l’autonomie locale et corporatiste qui serait opposée au centralisme supposé "autoritaire et castrateur" propre au marxisme. Une réflexion de Trotsky répond à ces objections : "Le rôle de Saint-Pétersbourg dans la révolution russe ne peut entrer en comparaison avec celui de Paris dans la révolution qui achève le XVIIIe siècle. Les conditions générales de l'économie toute primitive de la France, l'état rudimentaire de ses moyens de communication, d'une part et, de l'autre, sa centralisation administrative permettaient à Paris de localiser en fait la révolution dans ses murailles. Il en fut tout autrement chez nous. Le développement capitaliste suscita en Russie autant de foyers révolutionnaires séparés qu'il y avait de centres industriels ; et ceux-ci, tout en gardant l'indépendance et la spontanéité de leurs mouvements, restaient étroitement reliés entre eux" 26.
Nous voyons là, dans la pratique, ce qui signifie centralisation prolétarienne, laquelle se trouve aux antipodes du centralisme bureaucratique et castrateur qui est le propre de l’État et, en général, des classes exploiteuses qui ont existé dans l’histoire. La centralisation prolétarienne ne se fonde pas sur la négation de l’initiative et la spontanéité de ses différentes composantes, mais, au contraire, elle contribue avec tous ses moyens à leur développement. Comme le remarque Trotsky "Le chemin de fer et le télégraphe décentralisaient la révolution, malgré le caractère centralisé de l'Etat ; et en même temps ces moyens de communication donnaient de l'unité à toutes les manifestations locales de la force révolutionnaire. Si, en fin de compte, on peut admettre que la voix de Saint-Pétersbourg eut une influence prépondérante, cela ne veut pas dire que toute la révolution se soit rassemblée sur la perspective Nevski ou devant le Palais d'Hiver ; il faut entendre seulement que les mots d'ordre et les méthodes de lutte que préconisait Saint-Pétersbourg trouvèrent un puissant écho révolutionnaire dans tout le pays." 27.
Le Soviet était la colonne vertébrale de cette centralisation massive : "…nous devons accorder la plus haute place au conseil, ou soviet, des députés ouvriers -poursuit Trotsky. C'est en effet la plus importante organisation ouvrière que la Russie ait connue jusqu'à ce jour. De plus, le soviet de Saint-Pétersbourg fut un exemple et un modèle pour Moscou, Odessa et plusieurs autres villes. Mais il faut dire surtout que cette organisation, qui était vraiment l'émanation de la classe des prolétaires, fut l'organisation type de la révolution. Tous les événements pivotèrent autour du soviet, tous les fils se rattachèrent à lui, tous les appels vinrent de lui" 28.
Le rôle des soviets à la fin du mouvement
Vers la fin octobre 1905, on s’aperçoit clairement que le mouvement est placé devant une alternative : ou c’est l’insurrection ou c’est l’écrasement.
L’objectif de cet article n’est pas d’analyser les facteurs qui amenèrent à la seconde issue 29 : le mouvement déboucha en effet sur une défaite et le régime tsariste – à nouveau maître de la situation - déploya une répression brutale. Cependant, la manière dont le prolétariat livra une bataille acharnée et héroïque mais pleinement consciente, réussit à préparer l’avenir. La douloureuse défaite de décembre 1905 prépara l’avenir révolutionnaire de 1917.
Le Soviet de Saint-Pétersbourg a eu un rôle décisif dans ce dénouement : il a fait tout ce qui était possible pour préparer dans les meilleures conditions un affrontement inévitable. Il constitua des patrouilles ouvrières à caractère initialement défensif (contre les expéditions punitives des Cents Noirs organisés par le Tsar et composés par la lie de la société), aménagea des dépôts d’armes et organisa et entraîna des milices.
Mais, en même temps, et en tirant des enseignements des insurrections ouvrières du 19e siècle 30, le Soviet de Saint-Pétersbourg mit en avant que la clé de la situation était l’attitude des troupes, et c’est pour cela que le gros de ses efforts s’est concentré sur comment gagner les soldats à sa cause.
Et, en fait, les appels et les tracts adressés aux armées, les invitations faites aux troupes pour assister aux séances du Soviet ne tombaient pas dans le vide. Elles faisaient écho à un certain degré de maturation du mécontentement parmi les soldats qui avait abouti à la mutinerie du cuirassé Potemkine (immortalisée par le fameux film) ou au soulèvement de la garnison de Kronstadt en octobre.
En novembre 1905, le Soviet appelle à une grève suivie massivement et dont les objectifs étaient directement politiques : le retrait de la loi martiale en Pologne et l’abolition du Tribunal militaire spécial chargé de juger les marins et les soldats de Kronstadt. Cette grève, qui a réussi à intégrer des secteurs ouvriers n'ayant jamais lutté jusque là, a été reçue avec une énorme sympathie de la part des soldats. Cependant, la grève montra également l’épuisement des forces ouvrières et l’attitude majoritairement passive chez les soldats et les paysans, surtout en province, ce qui précipita l’échec de la grève.
Une autre contribution du Soviet à la préparation de l’affrontement, ce sont les deux mesures apparemment paradoxales qui ont été prises en octobre et novembre. Dès qu’il a compris que la grève d’octobre retombait, le Soviet proposa aux assemblées ouvrières que tous les ouvriers reprennent le travail à la même heure. Ce fait fut une démonstration de force qui mettait en évidence la détermination et la discipline consciente des ouvriers. L’opération a été reprise avant l'affaiblissement du mouvement en novembre. C’était un moyen de préserver les énergies pour l’affrontement général, en montrant à l’ennemi la fermeté et l’unité inébranlables des combattants.
La bourgeoisie libérale russe, dès qu’elle prit conscience de la menace prolétarienne, serra ses rangs autour du régime tsariste. Ce régime s’est alors senti renforcé et a entrepris une chasse systématique aux soviets. On s’est rapidement rendu compte que le mouvement ouvrier en province était en train de refluer. Malgré cela, le prolétariat de Moscou lança l’insurrection qui n’a été écrasée qu’au bout de 14 jours de combats acharnés.
Cet écrasement de l’insurrection de Moscou fut le dernier acte des trois cents jours de liberté, de fraternité, d’organisation et de communauté, vécus par les "simples ouvriers" comme se plaisaient à les appeler les intellectuels libéraux. Durant les deux derniers mois, ces "simples ouvriers" avaient construit un édifice simple, d’un fonctionnement alerte et rapide, qui avait atteint en peu de temps un pouvoir immense, les soviets. Mais, avec la fin de la révolution, ils semblèrent avoir disparu sans laisser de trace, enterrés pour toujours… En dehors des minorités révolutionnaires et des groupes d’ouvriers avancés, personne n'en parlait plus. Et pourtant, en 1917, ils sont revenus sur la scène sociale avec une vocation universelle et une force irrésistible. Nous verrons tout cela dans notre prochain article.
C.Mir, 5-11-09
1 Les 4 premiers congrès de l’Internationale communiste (Editions Librairie du Travail, Page 6 )
2 Le mot "soviet" est aujourd’hui relié au régime barbare de capitalisme d’État qui a régné dans l’ancienne URSS et le mot "soviétique" apparaît aujourd’hui comme synonyme de l’impérialisme russe pendant la longue période de la Guerre froide (1945-89).
3 Malgré le fait que Marx reconnaisse dans la Commune "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" et qu’elle contienne de remarquables signes avant-coureurs de ce que seront plus tard les Soviets, la Commune de Paris est plutôt reliée aux formes organisationnelles de démocratie radicale propres aux masses urbaines durant la Révolution française : « Ce fut le Comité central de la Garde nationale, placé à la tête d’un système de conseils de délégués des soldats qui s’était institué dans les unités de l’armée, qui prit l’initiative de proclamer la Commune. Les clubs de bataillon, organismes de base, avaient élu des conseils de légion, dont chacun envoya trois représentants siéger parmi les 60 membres du Comité central. Il était prévu qu’une assemblée générale des délégués de compagnie, révocables à tout instant, se tiendrait chaque mois" (Les Soviets en Russie, d’Oskar Anweiler, traduction française de Serge Bricianer, page 12)
4 Citation reprise par Trotsky de sa préface à la traduction russe de l'Adresse au jury, de F. Lassalle, dans Bilan et perspectives, ch. 8 "Un gouvernement ouvrier en Russie et le socialisme [42]".
5 Nous ne pouvons pas ici développer une chronique de ces événements. Voir "Il y a 100 ans : La Révolution de 1905 en Russie (I) [43]".
6 Le livre de Rosa Luxemburg Grève de masse, parti et syndicats décrit et analyse avec beaucoup de clarté la dynamique du mouvement avec ses hauts et ses bas, avec ses moments ascendants et ses moments de reflux soudains.
7 La Russie, dans la situation mondiale d’apogée et du début de déclin du système capitaliste, était prisonnière de la contradiction entre le frein que le tsarisme féodal signifiait pour le développement capitaliste et la nécessité pour la bourgeoisie libérale de s’appuyer sur ce système non seulement en tant qu’appareil bureaucratique pour son développement, mais aussi en tant que forteresse répressive contre l’émergence impétueuse du prolétariat. Lire le livre de Trotsky cité ci-dessus.
8 "…un soir où, comme d'habitude, il y avait chez moi plusieurs ouvriers - et que Nossar était des nôtres [Nossar fut le premier président du Soviet de Saint-Pétersbourg en octobre 1905] - l'idée surgit parmi nous de créer un organisme ouvrier permanent : une sorte de comité ou plutôt de conseil qui veillerait sur la suite des événements, servirait de lien entre tous les ouvriers, les renseignerait sur la situation et pourrait, le cas échéant, rallier autour de lui les forces ouvrières révolutionnaires." kropot.free.fr/Voline-revinco.htm [44]
9 Voline fut un militant anarchiste qui est resté toujours fidèle au prolétariat dénonçant la Deuxième Guerre mondiale à partir d’une position internationaliste.
10 Il est né le 13 mai 1905 dans la ville industrielle d’Ivanovo-Vosnesensk au centre de la Russie. Pour plus de détails, lire l’article de la Revue internationale nº 122 sur 1905 (2ª partie)
11 Oskar Anweiler, Les Soviets en Russie (1905-1921) aux Editions Gallimard, 1972.
12 NDLR : Fiodor Fiodorovitch Trepov, militaire de formation, fut chef de la police tsariste à Varsovie entre 1860 et 1861 puis entre 1863 et 1866. Il exerça ces mêmes fonctions à Petersbourg dans les années 1874-1880. Il était connu pour la brutalité de ses méthodes de répression, se signalant en particulier par l’écrasement des émeutes estudiantines comme à l'Institut Technologique en janvier 1874 et celle de la manifestation de la cathédrale de Kazan en 1876 (source Wikipedia).
13 Trotsky, 1905 [45], "La grève d’octobre"
14 Idem.
15 Andres Nin, Los Soviets en Rusia, p. 17, (traduit de l’espagnol par nous).
16 Trotsky, 1905 [45], "La grève d’octobre, II".
17 Idem, III.
18 Idem, "Formation du soviet des députés ouvriers"
19 Idem (citation de Trotsky)
20 Idem, "La grève d’octobre", III.
21 Idem, VI.
22 Idem, "Formation du soviet des députés ouvriers"
23 Ibidem.
24 Léon Trotsky, Bilan et Perspectives, [42] Chap. "7 “Les prémisses du socialisme
25 Trotsky, 1905 [45] "Formation du Soviet des députés ouvriers".
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem
29 Consulter particulièrement l’article de la Revue internationale nº 123 sur 1905 et le rôle des soviets (2ª Partie) [46].
30 Surtout des combats de barricade dont Engels avait pu comprendre l’épuisement dans son "Introduction" à La Lutte de classe en France de Marx. Cette "Introduction", écrite en 1895, est devenue très connue parce que la critique portée par Engels aux combats de barricade fut utilisée par les opportunistes de la Social-démocratie pour cautionner le rejet de la violence et l’emploi exclusif des méthodes parlementaires et syndicalistes.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La science et le mouvement marxiste : le legs de Freud
- 4931 lectures
Le CCI a publié récemment, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, plusieurs articles à propos de ce grand scientifique et de sa théorie sur l'évolution des espèces. 1 Ces articles s'inscrivaient dans ce qui a toujours été présent dans le mouvement ouvrier, l'intérêt pour les questions scientifiques, et qui s'exprime au plus haut niveau dans la théorie révolutionnaire du prolétariat, le marxisme. Celui-ci a développé une critique des visions religieuses et idéalistes de la société humaine et de l'histoire qui avaient cours dans les sociétés féodale et capitaliste mais qui imprégnaient aussi les théories socialistes qui ont marqué les premiers pas du mouvement ouvrier, au début du 19e siècle. A l'encontre de ces dernières, il s'est donné comme un de ses objectifs de fonder la perspective de la future société qui délivrera l'être humain de l'exploitation, de l'oppression et de l'ensemble des maux qui l'accablent depuis des millénaires non pas sur une "réalisation des principes d'égalité et de justice" mais d'une nécessité matérielle découlant de l'évolution même de l'histoire humaine, et de la nature dont elle fait partie, elle-même mue, en dernier ressort, par des forces matérielles et non par des forces spirituelles. C'est pour cela que le mouvement ouvrier, à commencer par Marx et Engels eux-mêmes, à toujours porté une attention toute particulière à la science.
La science a précédé de beaucoup l'apparition du mouvement ouvrier et même de la classe ouvrière. On peut même dire que cette dernière n'a pu se développer à large échelle qu'avec le progrès des sciences qui constituèrent une des conditions de l'essor du capitalisme, mode de production basé sur l'exploitation du prolétariat. En ce sens, la bourgeoisie est la première classe de l'histoire qui ait eu besoin, de façon inéluctable, de la science pour son propre développement et l'affirmation de son pouvoir sur la société. C'est en faisant appel à la science qu'elle a combattu l'emprise de la religion qui constituait l'instrument idéologique fondamental de défense et de justification de la société féodale. Mais plus encore, la science a constitué le soubassement de la maîtrise des technologies de la production et des transports, condition de l'épanouissement du capitalisme. Lorsque celui-ci a atteint son apogée, permettant de ce fait le surgissement sur la scène sociale de ce que le Manifeste Communiste appelle son "fossoyeur", le prolétariat moderne, la bourgeoisie s'est empressée de renouer avec la religion et les visions mystiques de la société qui ont le grand mérite de justifier le maintien d'un ordre social basé sur l'exploitation et l'oppression. Ce faisant, si elle a continué à promouvoir et à financer, toutes les recherches qui lui étaient indispensables pour garantir ses profits, pour accroitre la productivité de la force de travail et l'efficacité de ses forces militaires, elle s'est détournée de l'approche scientifique pour ce qui relève de la connaissance de la société humaine.
Il revient au prolétariat, dans sa lutte contre le capitalisme et pour le renversement de ce dernier, de reprendre le flambeau sur des terrains de la connaissance scientifique abandonnés par la bourgeoisie. C'est ce qu'il a fait dès le milieu du 19e siècle en opposant à l'apologétique dans laquelle s'était convertie l'étude de l'économie, c'est-à-dire du "squelette de la société", une vision critique et révolutionnaire de cette étude, une vision nécessairement scientifique telle qu'elle s'exprime, par exemple, dans Le capital de Karl Marx. C'est pourquoi les organisations révolutionnaires du prolétariat ont la responsabilité d'encourager l'intérêt pour les connaissances et recherches scientifiques, notamment dans les domaines qui se rapportent à la société humaine, à l'être humain et son psychisme, domaines par excellence où la classe dominante a intérêt à cultiver l'obscurantisme. Cela ne signifie pas que pour faire partie d'une organisation communiste, il soit nécessaire d'avoir fait des études scientifiques, d'être en mesure de défendre la théorie de Darwin ou de résoudre une équation du second degré. Les bases d'adhésion à notre organisation sont consignées dans notre plate-forme avec laquelle tout militant doit être en accord et qu'il a pour responsabilité de défendre. De même, sur toute une série de questions, comme par exemple l'analyse que nous faisons de tel ou tel aspect de la situation internationale, l'organisation se doit d'avoir une position laquelle est consignée, en général, dans les résolutions adoptées par chacun de nos congrès ou par les réunions plénières de notre organe central. Dans ces cas-là, il n'est pas obligatoire que chaque militant partage une telle prise de position. Le simple fait que ces résolutions soient adoptées suite à une discussion et un vote indique qu'il peut parfaitement exister des points de vue différents lesquels, s'ils se maintiennent et lorsqu'ils sont suffisamment élaborés, s'expriment publiquement dans notre presse comme on peut le constater avec le débat sur la dynamique économique du boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
Concernant les articles abordant des questions culturelles (critique de livre ou de film, par exemple) ou scientifiques, non seulement ils n'ont pas vocation à rencontrer l'adhésion de chaque militant (comme c'est le cas avec la plate-forme), mais ils ne sauraient, en général, être considérés comme représentant la position de l'organisation comme c'est le cas pour les résolutions adoptées par les congrès. Ainsi, tout comme les articles que nous avons publiés sur Darwin, l'article qui suit, rédigé à l'occasion des 70 ans de la disparition de Sigmund Freud, n'engage pas le CCI comme tel. Il doit être considéré comme une contribution à une discussion ouverte non seulement aux militants du CCI qui ne partagent pas son contenu, mais également à l'extérieur de notre organisation. Il s'inscrit dans une rubrique de la Revue Internationale, que le CCI tient à rendre la plus vivante possible, et qui a pour vocation de rendre compte des réflexions et discussions touchant aux questions culturelles et scientifiques. En ce sens, il constitue un appel aux contributions pouvant défendre un point de vue différent que celui qui y est exprimé.
CCI
Le legs de Freud
Le 23 septembre 1939, Sigmund Freud mourait à Hampstead, dans ce qui est aujourd’hui le Musée Freud à Londres. Quelques semaines auparavant avait débuté la Seconde Guerre mondiale. Il y a une histoire qui raconte que Freud, écoutant la radio ou parlant à son petit-fils (les versions varient), et répondant à la question brûlante : "est-ce que ce sera la dernière guerre ?", aurait laconiquement répondu : "En tous cas, ce sera ma dernière guerre".
Freud s’était exilé de sa maison et de son cabinet de Vienne peu après que les nervis nazis eurent pénétré dans son appartement et arrêté sa fille, Anna Freud, relâchée peu après. Freud faisait face à la persécution du pouvoir nazi mis en place après l’Anschluss entre l’Allemagne et l’Autriche, non seulement parce qu’il était juif, mais aussi parce qu’il était la figure fondatrice de la psychanalyse, discipline condamnée par le régime comme un exemple de la "pensée juive dégénérée" : les travaux de Freud, au même titre que ceux de Marx, d’Einstein, de Kafka, de Thomas Mann et d’autres, ont eu l’honneur d’être parmi les premiers livrés aux flammes des autodafés en 1933.
Mais les Nazis n’étaient pas les seuls à haïr Freud. Leurs homologues staliniens avaient également décidé que les théories de Freud devaient être dénoncées du haut des chaires de l'État. Tout comme il mit un terme à toute expérimentation dans l’art, l’éducation et dans d'autres sphères de la vie sociale, le stalinisme triomphant mena une chasse aux sorcières contre les tenants de la psychanalyse en Union soviétique et, en particulier, contre ceux qui estimaient que les travaux de Freud étaient compatibles avec le marxisme. Le pouvoir des soviets avait eu, au départ, une tout autre attitude. Bien que les bolcheviks n'aient nullement adopté une démarche homogène vis-à-vis de cette question, nombre de bolcheviks connus comme Lounatcharski, Boukharine et Trotsky lui-même avaient des sympathies pour les buts et les méthodes de la psychanalyse ; de ce fait, la branche russe de l’Association internationale de Psychanalyse avait été la première au monde à obtenir le soutien, y compris financier, d’un État. Au cours de cette période, l’un des buts fondamentaux de cette branche a été de créer une "école pour les orphelins" qui devait élever et soigner les enfants traumatisés par la perte de leurs parents au cours de la guerre civile. Freud lui-même portait un grand intérêt à ces expériences : il était particulièrement curieux de savoir jusqu’à quel point les différents efforts pour élever les enfants de façon collective, et non sur la base confinée et tyrannique du noyau familial, joueraient sur le complexe d’Œdipe qu’il avait identifié comme une question centrale dans l’histoire psychologique de l'individu. En même temps, des bolcheviks comme Lev Vygotsky, Alexander Luria, Tatiana Rosenthal et M.A. Reisner apportaient des contributions à la théorie psychanalytique et exploraient ses relations avec le matérialisme historique. 2
Tout cela prit fin lorsque la bureaucratie stalinienne eut assuré son emprise sur l’État. Les idées de Freud furent de plus en plus dénoncées comme petite-bourgeoises, décadentes et avant tout idéalistes, alors que la démarche plus mécaniste de Pavlov et sa théorie du "réflexe conditionné" étaient promues comme exemple de la psychologie matérialiste. À la fin des années 1920, il y eut une formidable inflation de textes rédigés par les porte-parole du régime s’opposant à Freud de façon pernicieuse, une série de "défections" de ses anciens adeptes comme Aron Zalkind, et même des attaques hystériques contre une "morale relâchée" crapuleusement associée aux idées de Freud dans ce qui fut plus généralement le "Thermidor de la famille" (selon l'expression de Trotsky).
La victoire finale du stalinisme contre le "Freudisme" fut entérinée au Congrès sur le Comportement humain de 1930, en particulier à travers le discours de Zalkind qui ridiculisa l'ensemble de la démarche freudienne et avança que sa vision du comportement humain était totalement incompatible avec "la construction du socialisme" : "Comment pouvons-nous utiliser la conception freudienne de l’homme dans la construction socialiste ? Nous avons besoin d’un homme socialement "ouvert", qui soit facile à collectiviser, à transformer rapidement et en profondeur dans son comportement – un homme qui sache se montrer solide, conscient et indépendant, bien formé politiquement et idéologiquement…" (cité dans Miller, Freud and the Bolsheviks, Yale, 1998, p. 102, traduit par nous). Nous savons très bien ce que cette "formation" et cette "transformation" signifiaient réellement : briser la personnalité humaine et la résistance des travailleurs au service du capitalisme d’État et de son impitoyable Plan quinquennal. Dans cette vision, il n’y avait évidemment pas de place pour les subtilités et la complexité de la psychanalyse, qui pouvait être utilisée pour montrer que le "socialisme" stalinien n'avait guéri aucune des maladies de l'humanité. Et, bien entendu, le fait que la psychanalyse avait joui d'un certain degré de soutien de la part de Trotsky, à présent exilé, était monté en épingle dans l’offensive idéologique contre les théories de Freud.
Et dans le monde "démocratique" ?
Mais qu’en est-il des représentants du camp démocratique du capitalisme ? L’Amérique de Roosevelt n’a-t-elle pas fait pression pour que Freud et sa famille proche puissent quitter Vienne. Et la Grande-Bretagne n’a-t-elle pas attribué une confortable demeure à l’éminent Professeur et Docteur Freud ? La psychanalyse n’est-elle pas devenue en Occident, notamment aux États-Unis, une sorte de nouvelle église orthodoxe de psychologie, certainement rentable pour beaucoup de ses praticiens ?
En fait, la réaction des intellectuels et des scientifiques aux théories de Freud dans les démocraties a toujours été très mélangée, faite de vénération, de fascination et de respect, combinés à l'indignation, la résistance et le mépris.
Mais au cours des années qui ont suivi la mort de Freud, on a vu deux tendances majeures dans la réception de la théorie psychanalytique : d’un côté, une tendance parmi ses propres porte-parole et praticiens à diluer certaines de ses implications les plus subversives (comme l’idée que la civilisation actuelle est nécessairement fondée sur la répression des instincts humains les plus profonds) au profit d’une démarche plus pragmatique et révisionniste, plus apte à se faire accepter socialement et politiquement par cette même civilisation ; et, d’un autre côté, chez un certain nombre de philosophes, de psychologues appartenant à des écoles rivales et d'auteurs ayant plus ou moins de réussite commerciale, une tendance à rejeter de plus en plus l'ensemble du corpus des idées freudiennes parce qu'elles auraient été subjectives, invérifiables et fondamentalement non-scientifiques. Les tendances dominantes de la psychologie moderne (il y a des exceptions, comme dans la "neuro-psychanalyse" qui réexamine le modèle freudien de la psyché en fonction de ce que nous connaissons aujourd’hui de la structure du cerveau) ont abandonné le voyage de Freud sur la "route royale vers l’inconscient", son effort pour explorer la signification des rêves, des mots d'esprit, des lapsus et autres manifestations immatérielles, au profit de l’étude de phénomènes plus observables et mesurables : les manifestations physiologiques, externes des états mentaux, et les formes concrètes de comportement chez les êtres humains, les rats et d'autres animaux observés dans des conditions de laboratoire. En matière de psychothérapie, l’État-providence, très intéressé à réduire les coûts potentiellement énormes induits par le traitement de l’épidémie grandissante de stress, de névroses et de maladies mentales classiques engendrée par le système social actuel, favorise les solutions rapides telles que les "thérapies cognitives et comportementales" plutôt que les efforts de la psychanalyse pour pénétrer aux racines profondes des névroses 3. Surtout, et c’est particulièrement vrai pour les deux dernières décennies, on a vu un véritable torrent de livres et d’articles tenter de faire passer Freud pour un charlatan, un fraudeur ayant fabriqué ses preuves, un tyran vis-à-vis de ses disciples, un hypocrite et (pourquoi pas ?) un pervers. Cette offensive a beaucoup de traits en commun avec la campagne anti-Marx lancée au lendemain de l’effondrement du prétendu "communisme" à la fin des années 80 et, tout comme cette dernière campagne avait donné naissance au Livre noir du communisme, on nous a servi maintenant un Livre noir de la psychanalyse 4 qui consacre pas moins de 830 pages à traîner Freud et tout le mouvement psychanalytique dans la boue.
Le marxisme et l'inconscient
L’hostilité à la psychanalyse n’a pas surpris Freud : elle a confirmé qu’il avait visé juste. Après tout, pourquoi aurait-il été populaire en développant l'idée que la civilisation (au moins la civilisation actuelle) est antithétique aux instincts humains et en infligeant une blessure, en portant un nouveau coup à "l'amour-propre naïf" de l’homme – selon son expression ?
"C'est en attribuant une importance pareille à l'inconscient dans la vie psychique que nous avons dressé contre la psychanalyse les plus méchants esprits de la critique. Ne vous en étonnez pas et ne croyez pas que la résistance qu'on nous oppose tienne à la difficulté de concevoir l'inconscient ou à l'inaccessibilité des expériences qui s'y rapportent. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours, à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique." (Introduction à la psychanalyse, Troisième partie, Conférence 18, "Rattachement à une action traumatique – l’inconscient", 1917 5)
Pour les marxistes, cependant, il n'y a rien de choquant dans l'idée que la vie consciente de l’homme soit – ou ait été jusqu’ici – dominée par des motifs inconscients. Le concept marxiste d’idéologie (qui englobe toutes les formes de conscience sociale avant l'émergence de la conscience de classe du prolétariat) est ancré exactement sur cette notion.
"Chaque idéologie, une fois constituée, se développe sur la base des éléments de représentation donnés et continue à les élaborer ; sinon elle ne serait pas une idéologie, c'est-à-dire le fait de s'occuper d'idées prises comme entités autonomes, se développant d'une façon indépendante et uniquement soumises à leurs propres lois. Que les conditions d'existence matérielles des hommes, dans le cerveau desquels se poursuit ce processus mental, en déterminent en fin de compte le cours, cela reste chez eux nécessairement inconscient, sinon c'en serait fini de toute idéologie." (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique, 1888, IV "Le matérialisme dialectique" 6)
Le marxisme reconnaît donc que, jusqu’à aujourd’hui, la conscience que l’homme a de sa position réelle dans le monde a été inhibée et déformée par des facteurs dont il n’est pas conscient, que la vie sociale telle qu'elle a été constituée jusqu’ici a créé des blocages fondamentaux dans les processus mentaux de l'homme. Un clair exemple en est l’incapacité historique de la bourgeoisie d’envisager une forme de société supérieure, autre que le capitalisme, du fait que cela impliquerait sa propre disparition. C’est ce que Lukács appelait un "inconscient conditionné de classe" (Histoire et conscience de classe). Et on peut aussi envisager la question du point de vue de la théorie de Marx sur l'aliénation : l’homme aliéné est séparé de son semblable, de la nature et de lui-même, tandis que le communisme dépassera cette dichotomie et que l’homme y sera pleinement conscient de lui-même.
Trotsky défend la psychanalyse
Parmi tous les marxistes du 20e siècle, c’est probablement Trotsky qui a contribué le plus à l'ouverture d'un dialogue avec les théories de Freud, qu’il avait rencontrées au cours de son séjour à Vienne en 1908. Alors qu’il était toujours impliqué dans l’État soviétique mais de plus en plus marginalisé, Trotsky insistait sur le fait que la démarche de Freud envers la psychologie était fondamentalement matérialiste. Il s’opposait à ce qu’une école particulière de psychologie devienne la ligne "officielle" de l’État ou du parti, mais au contraire appelait à un débat large et ouvert. Dans Culture et socialisme, écrit en 1925/26, Trotsky évalue les démarches différentes des écoles freudienne et pavlovienne, et esquisse ce qu'il pense que devrait être l’attitude du parti vis-à-vis de ces questions :
"La critique marxiste de la science doit être non seulement vigilante mais également prudente, sinon elle pourrait dégénérer en un véritable sycophantisme, en une famousovtchina. Prenons par exemple la psychologie. L'étude des réflexes de Pavlov se situe entièrement sur la voie du matérialisme dialectique. Elle renverse définitivement le mur qui existait entre la physiologie et la psychologie. Le plus simple réflexe est physiologique, mais le système des réflexes donnera la "conscience". L'accumulation de la quantité physiologique donne une nouvelle qualité, la qualité "psychologique". La méthode de l'école de Pavlov est expérimentale et minutieuse. La généralisation se conquiert pas à pas depuis la salive du chien jusqu'à la poésie (c'est-à-dire jusqu'à la mécanique psychique de celle-ci et non sa teneur sociale), bien que les voies vers la poésie ne soient pas encore en vue.
C'est d'une manière différente que l'école du psychanalyste viennois Freud aborde la question. Elle part, tout d'abord, de la considération que les forces motrices des processus psychiques les plus complexes et les plus délicats s'avèrent être des nécessités physiologiques. Dans ce sens général, cette école est matérialiste, si l'on écarte la question de savoir si elle ne donne pas une place trop importante au facteur sexuel au détriment des autres facteurs (mais c'est déjà là un débat qui s'inscrit dans le cadre du matérialisme). Pourtant, le psychanalyste n'aborde pas expérimentalement le problème de la conscience, depuis les phénomènes primaires jusqu'aux phénomènes les plus élevés, depuis le simple réflexe jusqu'au réflexe le plus complexe; il s'évertue à franchir d'un seul bond tous les échelons intermédiaires, de haut en bas, du mythe religieux, de la poésie lyrique ou du rêve, directement aux bases physiologiques de l'âme.
Les idéalistes enseignent que l'âme est autonome, que la 'pensée' est un puits sans fond. Pavlov et Freud, par contre, considèrent que le fond de la 'pensée' est constitué par la physiologie. Mais tandis que Pavlov, comme un scaphandrier, descend jusqu'au fond et explore minutieusement le puits, de bas en haut, Freud se tient au-dessus du puits et d'un regard perçant, s'évertue, au travers de la masse toujours fluctuante de l'eau trouble, de discerner ou de deviner la configuration du fond. La méthode de Pavlov, c'est l'expérimentation. La méthode de Freud, la conjecture, parfois fantastique. La tentative de déclarer la psychanalyse 'incompatible' avec le marxisme et de tourner le dos sans cérémonie au freudisme est trop simpliste, ou plutôt trop 'simplette'. En aucun cas nous ne sommes tenus d'adopter le freudisme. C'est une hypothèse de travail qui peut donner — et qui incontestablement donne — des hypothèses et des conclusions qui s'inscrivent dans la ligne de la psychologie matérialiste. La voie expérimentale amène, en son temps, la preuve. Mais nous n'avons ni motif ni droit d'élever un interdit à une autre voie, quand bien même elle serait moins sûre, qui s'efforce d'anticiper des conclusions auxquelles la voie expérimentale ne mène que bien plus lentement." 7
En fait, Trotsky a très rapidement mis en question la démarche quelque peu mécaniste de Pavlov, qui tendait à réduire l’activité consciente au fameux "réflexe conditionné". Dans un discours prononcé peu après la publication du texte cité plus haut, Trotsky se demandait si on pourrait vraiment parvenir à une connaissance des sources de la poésie humaine à travers l’étude de la salivation canine (voir Notebooks de Trotsky, 1933/35, Writings on Lenin, Dialectics and Evolutionism, traduits en anglais et introduits par Philip Pomper, New York, 1998, p. 49). Et dans les réflexions ultérieures sur la psychanalyse contenues dans ces "carnets philosophiques", composés en exil, il insiste bien plus sur la nécessité de comprendre le fait que reconnaître une certaine autonomie de la vie psychique, si elle est conflictuelle avec une version mécaniste du matérialisme, est en réalité parfaitement compatible avec une vision plus dialectique du matérialisme :
"Il est bien connu qu’il existe toute une école de psychiatrie (la psychanalyse, Freud) qui en pratique ne tient aucun compte de la physiologie, se basant sur le déterminisme interne des phénomènes psychiques tels qu'ils sont. Certaines critiques accusent donc l’école freudienne d’idéalisme. […] Mais en elle-même la méthode de la psychanalyse, qui prend comme point de départ 'l’autonomie' des phénomènes psychologiques, ne contredit nullement le matérialisme. Tout au contraire, c’est précisément le matérialisme dialectique qui nous amène à l’idée que la psyché ne pourrait même pas se former si elle ne jouait pas, dans certaines limites il est vrai, un rôle autonome et indépendant dans la vie de l’individu et de l’espèce.
Tout de même, nous approchons ici une question en quelque sorte cruciale, une rupture dans le gradualisme, une transition de la quantité en qualité : la psyché, qui émerge de la matière, est 'libérée' du déterminisme de la matière et peut de façon indépendante, par ses propres lois, influencer la matière."
(Carnets de Trotsky, op.cit., p. 106, notre traduction)
Trotsky affirme ici qu’il existe une véritable convergence entre le marxisme et la psychanalyse. Pour les deux, la conscience, ou plutôt l’ensemble de la vie psychique, est un produit matériel du mouvement réel de la nature et non une force existant en-dehors du monde ; elle est le produit de processus inconscients qui la précèdent et la déterminent. Mais elle devient à son tour un facteur actif qui, dans une certaine mesure, développe sa dynamique propre et qui, plus important, est capable d’agir et de transformer l’inconscient. C’est là la seule base d’une démarche qui fait de l’homme plus qu’une créature des circonstances objectives, et qui le rend capable de changer le monde autour de lui.
Et nous en arrivons ici à ce qui est, peut-être, la plus importante conclusion que tire Trotsky de son investigation dans les théories de Freud. Freud, rappelons-le, avait affirmé que la principale blessure infligée par la psychanalyse au "narcissisme naïf" de l’homme, était la confirmation que l’ego n’est pas maître dans sa propre maison, que dans une large mesure sa vision et son approche du monde sont conditionnées par des forces instinctives qui ont été refoulées dans l’inconscient. Freud lui-même, à une ou deux occasions, a été jusqu’à envisager une société qui aurait dépassé la lutte sans fin contre les privations matérielles et ainsi n’aurait plus à imposer cette répression à ses membres 8. Mais dans l’ensemble, son point de vue restait prudemment pessimiste du fait qu'il ne voyait pas de voie pouvant mener à une telle société. Trotsky, en tant que révolutionnaire, était tenu de soulever la possibilité d’une humanité pleinement consciente qui deviendrait ainsi maîtresse dans sa propre maison. En fait, pour Trotsky, la libération de l’humanité de la domination de l’inconscient devient le projet central de la société communiste : "Enfin, l'homme commencera sérieusement à harmoniser son propre être. Il visera à obtenir une précision, un discernement, une économie plus grands, et par suite, de la beauté dans les mouvements de son propre corps, au travail, dans la marche, au jeu. Il voudra maîtriser les processus semi-conscients et inconscients de son propre organisme : la respiration, la circulation du sang, la digestion, la reproduction. Et, dans les limites inévitables, il cherchera à les subordonner au contrôle de la raison et de la volonté. L'homo sapiens, maintenant figé, se traitera lui-même comme objet des méthodes les plus complexes de la sélection artificielle et des exercices psycho-physiques.
Ces perspectives découlent de toute l'évolution de l'homme. Il a commencé par chasser les ténèbres de la production et de l'idéologie, par briser, au moyen de la technologie, la routine barbare de son travail, et par triompher de la religion au moyen de la science. Il a expulsé l'inconscient de la politique en renversant les monarchies auxquelles il a substitué les démocraties et parlementarismes rationalistes, puis la dictature sans ambiguïté des soviets. Au moyen de l'organisation socialiste, il élimine la spontanéité aveugle, élémentaire des rapports économiques. Ce qui permet de reconstruire sur de tout autres bases la traditionnelle vie de famille. Finalement, si la nature de l'homme se trouve tapie dans les recoins les plus obscurs de l'inconscient, ne va-t-il pas de soi que, dans ce sens, doivent se diriger les plus grands efforts de la pensée qui cherche et qui crée ?" (Littérature et révolution, 1924, Ed. La Passion)
Évidemment, dans ce passage, Trotsky regarde vers un futur communiste très lointain. La priorité de l'humanité dans les premières phases du communisme portera sûrement sur les couches de l'inconscient où les origines des névroses et des souffrances mentales peuvent être dépistées, tandis que la perspective de contrôler des processus physiologiques encore plus fondamentaux soulève d'autres questions qui vont au delà de cet article et qui, de toutes façons, ne seront probablement posées que dans une culture communiste d'un niveau plus avancé.
Les communistes aujourd’hui peuvent être d’accord ou pas avec beaucoup d’idées de Freud. Mais il est sûr que nous devons exprimer la plus grande méfiance vis-à-vis des campagnes actuelles contre Freud et conserver une démarche la plus ouverte possible, comme le défendait Trotsky. Et, au minimum, nous devons admettre que tant que nous vivrons dans un monde où les "mauvaises passions" de l’humanité peuvent exploser avec une force terrifiante, où les relations sexuelles entre les êtres humains, qu'elles soient emprisonnées dans des idéologies médiévales, ou dévaluées et prostituées sur le marché, continuent à être une source de misère humaine indicible, où, pour la grande majorité des hommes, les forces créatrices de l’esprit restent largement étouffées et inaccessibles, les problèmes abordés par Sigmund Freud restent non seulement aussi pertinents aujourd’hui que lorsqu'ils furent soulevés pour la première fois, mais aussi que leur résolution sera certainement un élément irremplaçable dans la construction d’une société réellement humaine.
Amos
1 Voir "Darwinisme et marxisme" d'Anton Pannekoek dans les numéros 137 [49] et 138 [50] de la Revue Internationale, de même que les articles "Darwin et le mouvement ouvrier [51]", "A propos du livre L'effet Darwin : une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation [52]" et "Le 'darwinisme social', une idéologie réactionnaire du capitalisme [53]", respectivement dans les numéros 399, 400 et 404 de Révolution Internationale.
2 Les paroles suivantes de Lénine, rapportées par Clara Zetkin, montrent que les bolcheviks n'avaient pas une démarche unilatérale envers les théories de Freud –même si on peut aussi penser que les critiques de Lénine portaient plus sur les défenseurs de ces théories que sur les théories elles-mêmes : "La situation en Allemagne même exige la concentration extrême de toutes les forces révolutionnaires, prolétariennes, pour la lutte contre la réaction de plus en plus insolente ! Mais les militantes discutent de la question sexuelle, et des formes du mariage dans le passé, le présent et le futur. Elles considèrent que leur tâche la plus importante est d'éclairer les travailleuses sur ce point. L'écrit le plus répandu en ce moment est la brochure d'une jeune camarade de Vienne sur la question sexuelle. C'est de la foutaise ! Ce qu'il y a là-dedans, les ouvriers l'ont lu depuis longtemps dans Bebel. Cela n'est pas exprimé d'une façon aussi ennuyeuse, comme dans cette brochure, mais avec un caractère d'agitation, d'attaque contre la société bourgeoise. La discussion sur les hypothèses de Freud vous donne un air 'cultivé' et même scientifique, mais ce n'est au fond qu'un vulgaire travail d'écolier. La théorie de Freud est également une 'folie' à la mode. Je me méfie des théories sexuelles et de toute cette littérature spéciale qui croît abondamment sur le fumier de la société bourgeoise. Je me méfie de ceux qui ne voient que la question sexuelle, comme le prêtre hindou ne voit que son nuage. Je considère cette surabondance de théories sexuelles, qui sont pour la plupart des hypothèses, et souvent des hypothèses arbitraires, comme provenant d'un besoin personnel de justifier devant la morale bourgeoise sa propre vie anormale ou hypertrophique, ou du moins l'excuser. Ce respect déguisé de la morale bourgeoise m'est aussi antipathique que cette importance accordée aux questions sexuelles. Cela peut paraître aussi révolutionnaire que cela voudra, c'est, au fond, profondément bourgeois. C'est surtout une mode d'intellectuels. Il n'y a pas de place pour cela dans le parti, dans le prolétariat conscient." ("Souvenirs sur Lénine [54]", Clara Zetkin, Janvier 1924).
3 Nous voulons cependant préciser que cet article n'a pas pour objet de juger de l'efficacité thérapeutique de la démarche de Freud. Nous ne sommes pas qualifiés pour cela et, de toutes façons, il n'y a pas de lien mécanique entre l'application pratique de la théorie freudienne et la théorie de l'esprit qui la sous-tend – encore plus du fait que "soigner" les névroses dans une société qui les engendrent en permanence, est un problème qui se pose en fin de compte sur un plan social et non individuel. Ce sont les fondements de la théorie de l'esprit de Freud que nous envisageons ici, et c'est avant tout ces fondements que nous considérons comme un vrai héritage pour le mouvement ouvrier.
4 Le livre noir de la psychanalyse, Catherine Meyer, Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux et Jacques Van Rillaer, Les Arènes, Paris, France, 2005
5 classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/intro_a_la_psychanalyse/intro_psychanalyse_2.rtf [55]
6 www.marxists.org/francais/engels/works/1888/02/fe_18880221_4.htm [56]
7 https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/culture.htm [57]
8 Contrairement au cliché si souvent répété selon lequel Freud "réduirait tout au sexe", il a clairement affirmé que "la base sur laquelle repose la société humaine est, en dernière analyse, de nature économique : ne possédant pas assez de moyens de subsistance pour permettre à ses membres de vivre sans travailler, la société est obligée de limiter le nombre de ses membres et de détourner leur énergie de l'activité sexuelle vers le travail. Nous sommes là en présence de l'éternel besoin vital qui, né en même temps que l'homme, persiste jusqu'à nos jours." (Introduction à la psychanalyse [55], Conférence 20, La vie sexuelle de l’homme).
En d’autres termes : la répression est le produit d’organisations sociales des hommes dominées par la pénurie matérielle. Dans un autre passage, dans L’avenir d’une illusion (1927), Freud a montré une compréhension de la nature de classe de la société "civilisée" et s'est même permis au passage d’en envisager le stade ultérieur : "Mais lorsqu’une culture n'est pas parvenue à dépasser l’état où la satisfaction d’un certain nombre de participants présuppose l'oppression de certains autres, de la majorité peut-être - et c’est le cas de toutes les cultures actuelles -, il est alors compréhensible que ces opprimés développent une hostilité intense à l’encontre de la culture même qu’ils rendent possible par leur travail, mais aux biens de laquelle ils n’ont qu’une part trop minime. […] L’hostilité à la culture manifestée par ces classes est si patente qu’en raison d’elle on n’a pas vu l’hostilité plutôt latente des couches sociales mieux partagées. Il va sans dire qu'une culture qui laisse insatisfaits un si grand nombre de participants et les pousse à la révolte n'a aucune chance de se maintenir durablement et ne le mérite pas non plus. » (L’avenir d’une illusion, chapitre 2 p. 12, Quadrige/PUF, 1995). Ainsi l’ordre actuel non seulement n’a "aucune perspective d’existence durable", mais il pourrait peut-être y avoir une culture qui aurait "dépassé l'état" à partir duquel toute division de classe (et, par conséquent, les mécanismes de répression mentale existant jusqu’ici) deviendrait superflue.
Personnages:
- Freud [58]
Récent et en cours:
- Marxisme et science [59]
Revue Internationale n° 141 - 2e trimestre 2010
- 2457 lectures
Face à la faillite de plus en plus évidente du capitalisme ... un seul avenir, la lutte de classe !
Jamais la faillite du système capitaliste n'aura été aussi évidente. Jamais, non plus, autant d’attaques aussi massives contre la classe ouvrière n'avaient été planifiées. Quels développements de la lutte de classe peut-on attendre dans cette situation ?
La gravité de la crise ne permet plus à la bourgeoisie d'en cacher la réalité
La crise des subprimes en 2008 a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale impliquant une chute de l'activité économique sans équivalent depuis 1929 :
- en quelques mois, de très nombreux établissements financiers ont été renversés comme une chaîne de dominos ;
- les fermetures d'usines se sont multipliées avec des centaines de milliers de licenciements partout dans le monde.
Les moyens mis en œuvre par la bourgeoisie pour éviter que l'effondrement ne soit encore plus brutal et profond n'ont pas été différents des politiques successives appliquées depuis le début des années 1970, à travers le recours au crédit. C'est ainsi qu'une nouvelle étape dans l'endettement mondial a été franchie, accompagnée d'un accroissement inégalé de la dette mondiale. Mais aujourd'hui, le montant de la dette mondiale est tel qu'il est devenu commun de parler de "crise de l'endettement" pour caractériser la phase actuelle de la crise économique.
La bourgeoisie a évité le pire, pour l'instant. Ceci dit, non seulement il n'y a pas eu de reprise, mais un certain nombre de pays présentent des risques sérieux d'insolvabilité, avec des taux d'endettement supérieurs à 100% du PIB. Parmi ceux-ci, non seulement la Grèce est en première ligne mais également le Portugal, l'Espagne (5e économie du l'UE), l'Irlande et l’Italie. La Grande-Bretagne, bien qu'elle n'ait pas atteint ces niveaux d'endettement, présente des signes que les spécialistes qualifient de très inquiétants.
Face au niveau de gravité atteint par la crise de surproduction, la bourgeoisie ne dispose que d'un seul recours : l’Etat. Mais celui–ci dévoile à son tour sa fragilité. La bourgeoisie ne fait que repousser les échéances tandis que tous les acteurs économiques n'ont d'autre issue que la fuite en avant qui devient de plus en plus difficilement praticable et risquée : s'endetter toujours davantage. Les fondements historiques de la crise tendent ainsi à devenir plus évidents. Contrairement au passé, la bourgeoisie ne peut plus camoufler la réalité de la crise et montre à visage découvert qu’il n’y a pas de solution possible au sein de son système.
Dans un tel contexte, l'insolvabilité d'un pays1 désormais incapable de rembourser les échéances de sa dette, peut provoquer une réaction en chaîne conduisant à l'insolvabilité de nombreux acteurs économiques (banques, entreprises, autres pays). Bien sûr, la bourgeoisie essaie encore de brouiller les pistes en polarisant l’attention sur la spéculation et les spéculateurs. Le phénomène de spéculation est réel mais ce mécanisme imprègne tout le système et pas seulement quelques "profiteurs" ou "patrons voyous". La finance folle, c'est-à-dire l'endettement sans limite et la spéculation à tout va, a été favorisée par le capitalisme comme un tout, comme un moyen de repousser les échéances de la récession. Tel est le mode de vie même du capitalisme aujourd'hui. Aussi c'est dans le capitalisme lui-même , incapable de survivre sans des injections nouvelles de crédits, de plus en plus massives, que réside le cœur du problème.
Quels remèdes la bourgeoisie concocte-t-elle à présent face à la crise de l'endettement ? La bourgeoisie est en train de tenter de faire passer un terrible plan d’austérité en Grèce. Un autre également est en préparation en Espagne. En France, de nouvelles attaques sur les pensions de retraites sont planifiées.
Les plans d'austérité peuvent-ils contribuer à relâcher l'étreinte de la crise ?
Les plans d'austérité constituent-ils un moyen pour une nouvelle reprise ? Permettront-ils de réhausser, au moins partiellement, le niveau de vie durement attaqué des prolétaires au cours de ces deux dernières années de crise ?
Certainement pas ! La bourgeoisie mondiale ne peut pas se permettre de laisser "couler" un pays comme la Grèce (malgré les déclarations tonitruantes et démagogiques d’Angela Merkel), sans courir le risque de conséquences analogues pour certains de ses créditeurs, mais la seule aide qu'elle puisse lui apporter, c'est de nouveaux crédits à un taux "acceptable" (cependant les prêts à 6% récemment imposés par l’UE à la Grèce sont déjà particulièrement élevés). En retour, des garanties de rigueur budgétaire sont exigées. L'assisté doit faire la preuve qu'il ne va pas constituer un puits sans fond engouffrant "l'aide internationale". Il est donc demandé à la Grèce de "réduire son train de vie" pour réduire le rythme de la croissance de ses déficits et de son endettement. Ainsi, à la condition que soient durement attaquées les conditions de vie de la classe ouvrière, le marché mondial des capitaux fera à nouveau confiance à la Grèce qui pourra attirer à elle les prêts et les investissements étrangers.
Ce n'est pas le moindre paradoxe de constater que la confiance à accorder à la Grèce dépend de sa capacité à réduire le rythme de l'accroissement de sa dette, et non pas de le stopper, ce qui serait d'ailleurs impossible. C'est-à-dire que la solvabilité de ce pays vis-à-vis du marché mondial des capitaux est suspendue à une augmentation de sa dette qui ne soit "pas trop importante". En d'autres termes, un pays déclaré insolvable à cause de son endettement peut devenir solvable même si cet endettement continue de croître. D’ailleurs, la Grèce elle-même a tout intérêt à faire planer la menace de son "insolvabilité" pour tenter de fléchir les taux d’intérêt de ses créanciers qui, s’ils n’étaient pas du tout remboursés, enregistreraient une perte sèche du montant de leurs créances et se trouveraient à leur tour rapidement "dans le rouge". Dans le monde actuel surendetté, la solvabilité est essentiellement basée non sur une réalité objective mais sur une confiance … pas réellement fondée.
Les capitalistes sont obligés d'adhérer à cette croyance, sinon ils doivent cesser de croire à la pérennité de leur système d'exploitation. Mais si les capitalistes sont obligés d'y croire, ce n'est pas le cas pour les ouvriers ! Les plans d’austérité permettent somme toute à la bourgeoisie de se rassurer mais ne résolvent en rien les contradictions du capitalisme et ne peuvent même pas enrayer la croissance de la dette.
Les plans d'austérité exigent une réduction drastique du coût de la force de travail, ce qui va être appliqué dans tous les pays puisque tous, à des degrés divers, sont confrontés à des problèmes énormes d'endettement et de déficit. Une telle politique qui, dans le cadre du capitalisme, ne connaît pas de réelle alternative, peut éviter un vent de panique, voire provoquer une mini-relance bâtie sur du sable, mais certainement pas assainir le système financier. Elle peut encore moins résoudre les contradictions du capitalisme qui le poussent à s'endetter toujours davantage sous peine d'être secoué par des dépressions de plus en plus brutales. Mais il faut aussi faire accepter ces plans d'austérité à la classe ouvrière. C'est pour la bourgeoisie un enjeu de taille et elle a aussi les yeux braqués sur la réponse des prolétaires à ces attaques.
Avec quel état d'esprit la classe ouvrière aborde-t-elle cette nouvelle vague d'attaques ?
Déjà, depuis le début des années 2000, le discours de la bourgeoisie "acceptez de vous serrer la ceinture pour que cela aille mieux demain" ne parvient généralement plus à illusionner la classe ouvrière, même s'il existe sur ce plan des différences d'un pays à l'autre. La récente aggravation de la crise ne s'est pas traduite jusqu'à présent par une amplification des mobilisations de la classe ouvrière au cours de ces deux ou trois dernières années. La tendance serait même plutôt inverse pour ce qui concerne l'année 2009. Les caractéristiques de certaines des attaques portées, notamment les licenciements massifs, ont en effet rendu la riposte de la classe ouvrière plus difficile puisque, face à ceux-ci :
- les patrons et les gouvernements se replient derrière un argument péremptoire : "Nous n’y sommes pour rien si le chômage augmente ou si vous êtes licenciés : c’est la faute de la crise."
- en cas de fermeture d’entreprise ou d’usine, l’arme de la grève devient inopérante, ce qui accentue le sentiment d’impuissance et le désarroi des travailleurs.
Néanmoins, même si ces difficultés pèsent encore lourdement sur la classe ouvrière, la situation n'est pas bloquée. C'est ce qu'illustre un changement d'état d'esprit au sein de la classe exploitée et se traduit par un frémissement de la lutte de classe.
L'exaspération et la colère des travailleurs sont nourries par une indignation profonde face à une situation de plus en plus scandaleuse et intolérable : la survie même du capitalisme a, entre autres, pour effet de faire apparaître plus crûment que jamais deux "mondes différents" au sein de la même société. Dans le premier, on trouve l'immense majorité de la population qui subit toutes les injustices et la misère et qui doit payer pour le second, le monde de la classe dominante, où il est fait un étalage indécent et arrogant de la puissance et de la richesse.
En lien plus direct avec la crise actuelle, l'idée répandue selon laquelle "ce sont les banques qui nous ont mis dans une mouise dont on ne peut pas sortir" (alors qu'on voit les Etats eux-mêmes approcher de la cessation de paiement) trompe de moins en moins et catalyse la colère contre le système. On voit ici les limites du discours de la bourgeoisie qui désignait les banques comme responsables de la crise actuelle pour tenter d'épargner son système comme un tout. Le "scandale des banques" éclabousse l'ensemble du capitalisme.
Même si la classe ouvrière à l’échelle internationale reste encore sonnée et désemparée face à l’avalanche des coups que lui portent tous les gouvernements de gauche comme de droite, elle n’est pas pour autant résignée ; elle n'est pas restée sans réaction au cours de ces derniers mois. En effet, les caractéristiques fondamentales de la lutte de classe qui avaient marqué certaines mobilisations ouvrières depuis 2003, refont leur apparition sous une forme plus explicite. C'est le cas, en particulier, de la solidarité ouvrière qui tend à nouveau à s'imposer comme un besoin fondamental de la lutte, après avoir été tant dénaturée et dépréciée dans les années 1990. A présent, elle se manifeste sous la forme d'initiatives, certes encore très minoritaires, mais porteuses d'avenir.
En Turquie, aux mois de décembre et janvier derniers, la lutte des ouvriers de Tekel a constitué un phare pour la lutte de classe. Elle a uni dans le même combat des ouvriers turcs et kurdes (alors qu'un conflit nationaliste divise ces populations depuis des années) comme elle a fait preuve d'une volonté farouche d'étendre la lutte à d'autres secteurs et s'est opposée de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Au cœur même du capitalisme, alors que l'encadrement syndical, plus puissant et sophistiqué que dans les pays périphériques, permet encore d'empêcher l'explosion de luttes aussi importantes, on assiste aussi à un regain de la combativité de la classe ouvrière. Ainsi, les mêmes caractéristiques se sont vérifiées début février en Espagne, à Vigo. Là, les chômeurs sont allés trouver les travailleurs actifs des chantiers navals et ils ont manifesté ensemble, en rassemblant d’autres travailleurs jusqu’à obtenir l’arrêt du travail dans tout le secteur naval. Ce qui fut le plus remarquable dans cette action, c'est le fait que l'initiative avait été prise par les travailleurs licenciés des chantiers navals, lesquels avaient été remplacés par des travailleurs immigrés "qui dorment dans des parkings et qui mangent tout juste un sandwich par jour". Loin de susciter des réactions xénophobes de la part des ouvriers avec qui ils avaient été mis en concurrence par la bourgeoisie, ces derniers se sont solidarisés contre les conditions d'exploitation inhumaines réservées aux travailleurs immigrés. Ces manifestations de solidarité ouvrière s'étaient déjà produite également en Grande-Bretagne à la raffinerie de Lindsey de la part d'ouvriers du bâtiment en janvier et en juin 2009 de même qu'en Espagne dans les chantiers navals de Sestao en avril 2009 2.
Dans ces luttes, même si c'est de façon encore limitée et embryonnaire, la classe ouvrière a démontré non seulement sa combativité mais aussi sa capacité à contrer les campagnes idéologiques de la classe dominante pour la diviser, en exprimant sa solidarité prolétarienne, en unissant dans un même combat des ouvriers de différentes corporations, secteurs, ethnies ou nationalités. De même, la révolte des jeunes prolétaires, organisés en assemblées générales et qui avait attiré le soutien de la population, en décembre 2008 en Grèce, avait fait craindre à la classe dominante, la "contagion" de l’exemple grec aux autres pays européens, en particulier chez les jeunes générations scolarisées. Aujourd'hui, ce n’est pas un hasard si les yeux de la bourgeoisie sont à nouveau tournés vers les réactions des prolétaires en Grèce face au plan d’austérité imposé par le gouvernement et les autres Etats de l’Union européenne. Ces réactions ont valeur de test pour les autres Etats menacés par la faillite de leur économie nationale. D’ailleurs, l’annonce quasiment simultanée de plans similaires a également précipité dans la rue des dizaines de milliers de prolétaires qui ont manifesté en Espagne ou au Portugal. Ainsi, malgré les difficultés qui pèsent encore sur la lutte de classe, un changement d’état d’esprit est néanmoins en train de s’opérer dans la classe ouvrière. Partout dans le monde, l’exaspération et la colère s’approfondissent et se généralisent dans les rangs ouvriers.
Les réactions aux plans d’austérité et aux attaques
En Grèce...
En Grèce, le gouvernement a annoncé le 3 mars un nouveau plan d'austérité, le troisième en trois mois, impliquant une hausse des taxes à la consommation, la réduction de 30% du 13e mois et de 60% du 14e mois de salaire, primes touchées par les fonctionnaires (soit une diminution de 12% à 30% en moyenne de leur salaire) ainsi que le gel des pensions de retraites des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Mais ce plan passe très mal dans la population, notamment chez les ouvriers et les retraités.
En novembre-décembre 2008, le pays avait été secoué pendant plus d’un mois par une explosion sociale, menée principalement par la jeunesse prolétarienne, à la suite de l'assassinat d'un jeune par la police. Cette année, les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement socialiste menaçaient de déclencher une explosion non seulement parmi les étudiants et les chômeurs mais aussi parmi les bataillons principaux de la classe ouvrière.
Un mouvement de grève générale le 24 février 2010 contre le plan d’austérité a été largement suivi et une mobilisation des fonctionnaires du gouvernement a rassemblé autour de 40 000 manifestants. Un grand nombre de retraités et de fonctionnaires ont également manifesté le 3 mars dans le centre d'Athènes.
Les événements qui ont suivi ont montré encore plus clairement que le prolétariat était mobilisé : "Quelques heures seulement après l'annonce des nouvelles mesures, des travailleurs licenciés de l'Olympic Airways ont attaqué les brigades de la police anti-émeute gardant le siège de la compagnie et ont occupé le bâtiment, dans ce qu'ils appellent une occupation à durée indéterminée. L'action a conduit à la fermeture de la principale rue commerçante d'Athènes, pour de longues heures." (blog sur libcom.org)
Dans les jours précédant la grève générale du 11 mars, une série de grèves et d’occupations ont eu lieu : les travailleurs licenciés d’Olympic Airways ont occupé pendant 8 jours le siège de la Cour des Comptes tandis que les salariés de la compagnie d’électricité occupaient les agences pour l’emploi au nom du "droit des futurs chômeurs que nous sommes", selon l’un d’eux. Les ouvriers de l'Imprimerie nationale ont occupé leur lieu de travail et refusé d'imprimer les textes légaux des mesures d'économie en misant sur le fait que tant que la loi n'est pas imprimée, elle n'est pas valide... Les agents du fisc ont arrêté le travail pendant 48h, les salariés des auto-écoles dans le Nord du pays ont fait 3 jours de grève ; même les juges et autres officiers de justice ont stoppé toute activité pendant 4 heures chaque jour. Aucune poubelle n'a été vidée pendant plusieurs jours à Athènes, à Patras et à Thessalonique, les éboueurs ayant bloqué les grands dépôts de ces villes. Dans la ville de Komitini, les ouvriers de l’entreprise textile ENKLO ont mené une lutte avec marches de protestation et grèves : deux banques ont été occupées par les travailleurs.
Mais si la classe ouvrière en Grèce se trouve plus largement mobilisée qu'au cours des luttes de novembre-décembre 2008, les appareils d’encadrement de la bourgeoisie ont été mieux préparés et efficaces pour saboter la riposte ouvrière.
En effet, la bourgeoisie a pris les devants pour détourner la colère et la combativité des travailleurs vers des impasses politiques et idéologiques. Celles-ci sont parvenues à évacuer toutes les potentialités de prise en mains de la lutte et de la solidarité prolétariennes qui avaient commencé à prendre forme à travers le combat des jeunes générations ouvrières fin 2008.
L’exaltation du patriotisme et du nationalisme est largement utilisée pour diviser les ouvriers et les isoler de leurs frères de classe dans les autres pays : en Grèce, l’élément le plus mis en avant est le fait que la bourgeoisie allemande refuse d’aider l'économie grecque et le gouvernement du PASOK ne se prive pas d'exploiter les sentiments anti-allemands qui survivent encore de l'occupation nazie.
Le contrôle par les partis et les syndicats a permis d’isoler les ouvriers les uns des autres. Ainsi les salariés d’Olympic Airways n'ont permis à aucun étranger à la compagnie de pénétrer dans le bâtiment public qu’ils occupaient et les dirigeants syndicaux l'ont fait évacuer sans la moindre décision d’une AG. Quand d’autres ouvriers ont voulu se rendre dans les locaux du Trésor public, occupés par ceux de l’Imprimerie Nationale, ils furent sèchement refoulés sous prétexte "qu’ils n’appartenaient pas au ministère" !
La profonde colère des ouvriers en Grèce s’est exprimée contre le PASOK et les dirigeants syndicaux qui lui sont inféodés. Le 5 mars, le leader de la GSEE, centrale syndicale du secteur privé, a été malmené et frappé alors qu’il tentait de prendre la parole devant la foule et a dû être secouru par la police anti-émeute et se réfugier dans le bâtiment du Parlement, sous les huées de la foule l’invitant ironiquement à aller où il est à sa place : dans le nid des voleurs, des assassins et des menteurs.
Mais le PC grec (KKE) et son officine syndicale, le PAME, se présentent comme des alternatives "radicales" au PASOK alors qu'ils entretiennent une campagne pour focaliser la responsabilité de la crise sur les banquiers ou sur "les méfaits du libéralisme".
En novembre-décembre 2008, le mouvement avait été largement spontané et avaient tenu des assemblées générales ouvertes dans les écoles occupées et les universités. Le siège du Parti communiste (KKE), comme le siège de sa confédération syndicale du PAME, avait été lui-même occupé, ce qui était le signe d'une claire méfiance envers les appareils syndicaux et les staliniens, lesquels avaient dénoncé les jeunes manifestants à la fois comme des lumpen-prolétaires et des enfants gâtés de la bourgeoisie.
Mais cette fois-ci, le PC grec s'est ostensiblement mis à l’avant-garde des grèves, manifestations et occupations les plus radicales : "Le matin du 5 mars, les travailleurs du PAME syndicat affilié au Parti communiste occupait le ministère des finances (…) ainsi que la mairie du district de Trikala. Plus tard, le PAME a fait également occuper 4 émetteurs de TV dans la ville de Patras, et la station de télévision d’Etat de Thessalonique, obligeant les journalistes d'information à lire une déclaration contre les mesures gouvernementales" 3. Beaucoup de grèves ont également été déclenchées à l’initiative du PC qui avait appelé dès le 3 mars à une "grève générale" et à une manifestation pour le 5, et dès le 4 dans différentes villes. Le PAME a intensifié les actions spectaculaires, occupant tantôt le ministère des finances, tantôt investissant les locaux de la Bourse.
Le 11 mars, toute la Grèce a été paralysée à 90% pendant 24 heures par le mouvement de colère de la population suite au second appel en moins d’un mois des deux principaux syndicats à la grève générale. Au total, plus de 3 millions de personnes (sur une population totale de 11 millions) y ont pris part. La manifestation du 11 mars a été la plus massivement suivie à Athènes depuis 15 ans et elle a montré la détermination de la classe ouvrière à riposter à l’offensive capitaliste.
... et ailleurs
Dans toutes lés régions du monde, en Algérie, en Russie, au sein de la main-d’œuvre immigrée des Emirats, surexploitée et privée de toute protection sociale, chez les prolétaires anglais et parmi les étudiants réduits à une situation précaire dans l’ex-plus riche Etat de l’Amérique, la Californie, la situation actuelle témoigne d’une tendance de fond vers la reprise de la lutte de classe à l’échelle internationale.
La bourgeoisie est confrontée à une situation où, en plus des licenciements dans les entreprises en difficulté, les Etats doivent assumer frontalement les attaques contre la classe ouvrière pour lui faire supporter le coût de la dette. Le responsable direct des attaques, l'Etat en l'occurrence, est cette fois beaucoup plus facilement identifiable que dans le cas des licenciements face auxquels il peut même se présenter comme le "protecteur", même peu puissant, des salariés. Le fait que l'Etat apparaisse clairement pour ce qu'il est, le premier défenseur des intérêts de toute la classe capitaliste contre l'ensemble de la classe ouvrière, est un facteur qui favorise le développement de la lutte de classe, de son unité et de sa politisation.
Tous les éléments qui se développent dans la situation actuelle constituent les ingrédients pour l'explosion de luttes massives. Mais ce qui sera le détonateur de celles-ci est très certainement l'accumulation de l'exaspération, du ras le bol et de l'indignation. L'application par la bourgeoisie des différents plans d'austérité planifiés dans différents pays, va constituer autant d'occasions d'expériences de lutte et de leçons pour la classe ouvrière.
Les luttes massives, une étape future importante pour le développement de la lutte de classe … mais pas la dernière
L'effondrement du stalinisme et, surtout, son exploitation idéologique par la bourgeoisie fondée sur le plus grand mensonge du siècle identifiant les régimes staliniens au socialisme, ont laissé des traces présentes encore aujourd'hui dans la classe ouvrière.
Face aux "évidences" assénées par la bourgeoisie : "le communisme, ça ne marche pas ; la preuve, c’est qu’il a été abandonné au bénéfice du capitalisme par les populations concernées", les ouvriers ne pouvaient que se détourner du projet d’une société alternative au capitalisme.
La situation qui en a résulté est, de ce point de vue, très différente de celle qu'on a connue à la fin des années 1960. A cette époque, le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec la grève de mai 1968 en France et "l’automne chaud" italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société. L’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables, contrairement à aujourd'hui.
La difficulté à entrer massivement en lutte manifestée par le prolétariat depuis les années 1990 résulte d'un manque de confiance en lui-même, qui n'a pas été dissipé par le renouveau de la lutte de classe de l'année 2003.
Ce n'est que le développement des luttes massives qui permettra au prolétariat de récupérer la confiance en ses propres forces et de mettre à nouveau en avant sa perspective propre. C'est donc une étape fondamentale dans laquelle les révolutionnaires doivent favoriser la capacité de la classe ouvrière à comprendre les enjeux de ses combats dans leur dimension historique, à reconnaître ses ennemis et à prendre en main elle-même ses luttes.
Pour importante que soit cette étape future de la lutte de classe, elle ne signifiera pas pour autant la fin des hésitations du prolétariat à s'engager résolument dans la voie qui mène à la révolution.
Déjà en 1852, Marx, mettait en évidence le cours difficile et tortueux de la révolution prolétarienne, contrairement à celui des révolutions bourgeoises qui, "comme celles du 18e siècle, se précipitent rapidement de succès en succès" 4.
Cette différence, entre prolétariat et bourgeoisie, lorsqu'ils agissent comme classes révolutionnaires, résulte des différences existant entre les conditions de la révolution bourgeoise et celles de la révolution prolétarienne.
La prise du pouvoir politique par la classe capitaliste avait constitué le point d'arrivée de tout un processus de transformation économique au sein de la société féodale. Au cours de celui-ci, les anciens rapports de production féodaux, ont progressivement été supplantés par les rapports de production capitalistes. C'est sur ces nouveaux rapports économiques que la bourgeoisie s'est appuyée pour conquérir le pouvoir politique.
Tout différent est le processus de la révolution prolétarienne. Les rapports de production communistes, qui ne sont pas des rapports marchands, ne peuvent se développer au sein de la société capitaliste. Du fait qu'elle est la classe exploitée dans le capitalisme, privée par définition de la propriété des moyens de production, la classe ouvrière ne dispose pas, et ne peut disposer, de points d'appui économiques pour la conquête du pouvoir politique. Ses points d'appui sont sa conscience et son organisation dans la lutte. Contrairement à la bourgeoisie révolutionnaire, le premier acte de la transformation communiste des rapports sociaux doit consister en un acte conscient et délibéré : la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale par l'ensemble du prolétariat organisé en conseils ouvriers.
L'immensité de cette tâche est évidemment de nature à faire hésiter la classe ouvrière, à la faire douter de sa propre force. Mais c'est le seul chemin pour la survie de l'humanité : l'abolition du capitalisme, de l'exploitation et la création d'une nouvelle société.
FW (31 mars)
1. Bien entendu, la faillite d’un Etat n’a pas du tout les mêmes caractéristiques que celle d’une entreprise : s’il devenait incapable de rembourser ses dettes, il n’est pas question qu’un Etat mette la "clef sous la porte", puisse licencier tous ses fonctionnaires et dissoudre ses propres structures (police, armée, corps enseignant ou administratif…) même si, dans certains pays (notamment en Russie ou certains pays d’Afrique), les fonctionnaires ont pu, du fait de la crise, ne pas être payés pendant des mois…
2. Lire les articles suivants : "Grèves en Angleterre : Les ouvriers du bâtiment au centre de la lutte [61]" ; Sur la Turquie : "Solidarité avec la résistance des ouvriers de Tekel contre le gouvernement et les syndicats ! [62]" ; Sur l’Espagne : "A Vigo, l’action conjointe des chômeurs et des ouvriers des chantiers navals [63]"
3. D’après libcom.org [64]
4. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte.
Hommage à notre camarade Jerry Grevin
- 1868 lectures
Notre camarade Jerry Grevin, militant de longue date de la section américaine du CCI, est mort subitement d'une crise cardiaque le 11 février 2010. Sa mort prématurée est une perte énorme pour notre organisation et tous ceux qui le connaissaient : sa famille a perdu un mari, un père et un grand-père tendre et affectueux ; ses compagnons de travail à l'université où il enseignait ont perdu un collègue estimé ; les militants du CCI, dans sa section et dans le monde entier, ont perdu un camarade très aimé et totalement dévoué.
Jerry Grevin est né en 1946 à Brooklyn, dans une famille ouvrière de la deuxième génération d'immigrants juifs. Ses parents avaient un esprit critique qui les mena à entrer au Parti communiste des Etats-Unis, puis à le quitter. Le père de Jerry avait été profondément choqué par la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki à laquelle il avait assisté en tant que membre des forces américaines d'occupation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait jamais parlé de cette expérience et que son fils ne l'ait connue que bien plus tard, Jerry était convaincu qu'elle avait exacerbé l'état d'esprit anti-patriotique et anti-guerre qu'il avait hérité de ses parents.
L'une des grandes qualités de Jerry, et qui ne s'est jamais démentie, était son indignation brûlante et inébranlable contre toute forme d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Dès sa jeunesse; il a énergiquement pris part aux grandes causes sociales de l'époque. Il participa aux grandes manifestations contre la ségrégation et l'inégalité raciale organisées par le Congress of Racial Equality (CORE) dans le Sud des Etats-Unis. Cela nécessitait un courage certain puisque des militants et des manifestants subissaient quotidiennement de mauvais traitements, des bastonnades et étaient même assassinés ; et Jerry étant juif, non seulement il combattait les préjugés racistes, il en était lui-même l'objet. 1
Pour sa génération, aux Etats-Unis en particulier, l'autre question cruciale de l'époque était l'opposition à la Guerre du Vietnam. Exilé à Montréal au Canada, il fut l'animateur d'un des comités qui faisait partie du "Second Underground Railroad" 2 pour aider les déserteurs de l'armée américaine à fuir les Etats-Unis et à commencer une nouvelle vie à l'étranger. Il s'engagea dans cette activité non comme pacifiste mais avec la conviction que la résistance à l'ordre militaire pouvait et devait faire partie d'une lutte de classe plus large, contre le capitalisme, et il participa à la publication militante, de courte durée, Worker and Soldier. Plusieurs années après, Jerry eut la possibilité de consulter une partie –largement censurée- de son dossier au FBI: son épaisseur et les détails qu'il comportait –le dossier était régulièrement mis à jour dans la période où il militait dans le CCI- lui procurèrent une certaine satisfaction de constater que ses activités inquiétaient les défenseurs de l'ordre bourgeois et induisirent de sa part quelques commentaires caustiques envers ceux qui pensent que la police et les services de renseignements "ne s'occupent pas" des petits groupes insignifiants de militants aujourd'hui.
A son retour aux Etats-Unis dans les années 1970, Jerry travailla comme technicien des téléphones dans une des principales compagnies téléphoniques. C'était une période de bouillonnement de la lutte de classe avec la crise qui commençait à frapper et Jerry participa aux luttes à son travail, aux petites comme aux grandes, en même temps qu'il participait à un journal appelé Wildcat, prônant l'action directe et publié par un petit groupe du même nom. Bien qu'il ait été déçu par l'immédiatisme et l'absence d'une perspective plus large – c'est la recherche d'une telle perspective qui l'amena à rejoindre le CCI –cette expérience directe, à la base, couplée à ses grandes capacités d'observation et à une attitude humaine envers les travers et les préjugés de ses collègues de travail, lui apporta une vision profonde de la façon dont se développe concrètement la conscience dans la classe ouvrière. Comme militant du CCI, il illustrait souvent ses arguments politiques d'images vivantes tirées de son expérience.
Une de celles-ci décrivait un incident dans le Sud des États-Unis où son groupe de techniciens du téléphone de New York avait été envoyé travailler. Un ouvrier du groupe, un noir, était persécuté par la direction pour une prétendue faute , en fait totalement mineure; les New-Yorkais prirent sa défense, à la grande surprise de leurs collègues du Sud : "Pourquoi s'en faire ?" demandèrent-ils "ce n'est qu'un nègre". Ce à quoi un des New-Yorkais répondit vigoureusement que la couleur de la peau n'avait aucune importance, que les ouvriers étaient tous ouvriers ensemble et devaient se défendre mutuellement contre les patrons. "Mais le plus remarquable concluait Jerry, c'est que le type qui avait pris le plus fort la défense de l'ouvrier noir était connu du groupe pour être lui-même raciste et avoir déménagé à Long Island pour ne pas habiter dans un quartier noir. Et cela montre comment la lutte et la solidarité de classe constituent le seul véritable antidote au racisme".
Une autre histoire qu'il aimait raconter, concernait sa première rencontre avec le CCI. Pour citer l'hommage personnel d'un camarade : "Comme je l'ai entendu raconter un million de fois, c'est quand il rencontra pour la première fois un militant du CCI à une époque où il était, comme il le décrivait lui-même, "un jeune individualiste immédiatiste", écrivant et diffusant ses articles seul, qu'il se rendit compte que la passion révolutionnaire sans organisation ne pouvait qu'être une flamme passagère de jeunesse. C'est quand le militant du CCI lui dit: "OK, tu écris et tu es marxiste, mais que fais-tu pour la révolution?". Jerry racontait souvent cette histoire à la suite de quoi il ne dormit pas de toute la nuit. Mais ce fut une nuit blanche qui porta prodigieusement ses fruits". Beaucoup auraient pu se décourager face au commentaire abrupt du CCI, mais pas Jerry. Au contraire, cette histoire (qu'il racontait en s'amusant de son état d'esprit de l'époque) révèle une autre facette de Jerry: sa capacité à accepter la force d'un argument et à changer de point de vue s'il était convaincu par d'autres idées – une qualité précieuse dans le débat politique qui est l'âme d'une véritable organisation prolétarienne.
La contribution de Jerry au CCI est inestimable. Sa connaissance du mouvement ouvrier aux Etats-Unis était encyclopédique; sa plume alerte et son écriture colorée ont fait vivre cette histoire pour nos lecteurs dans les nombreux articles qu'il a écrits pour notre presse aux Etats-Unis (Internationalism) et pour la Revue internationale. Il avait aussi une maîtrise remarquable de la vie politique et de la lutte de classe aux Etats-Unis aujourd'hui et ses articles sur l'actualité, tant pour notre presse que pour nos bulletins internes, ont été des apports importants pour notre compréhension de la politique de la première puissance impérialiste mondiale.
Sa contribution à la vie interne et à l'intégrité organisationnelle du CCI a également été importante. Pendant des années, il a été un pilier de notre section américaine, un camarade sur qui on pouvait toujours compter pour être aux avant-postes quand des difficultés se présentaient. Pendant les difficiles années 1990, quand le monde entier –mais particulièrement peut-être les Etats-Unis- était inondé par la propagande sur "la victoire du capitalisme", Jerry ne perdit jamais la conviction de la nécessité et de la possibilité d'une révolution communiste, il ne cessa jamais de communiquer avec ceux qui l'entouraient et avec les rares nouveaux contacts de la section. Sa loyauté à l'organisation et à ses camarades était inébranlable, d'autant plus que, comme il le disait lui-même, c'était sa participation à la vie internationale du CCI qui lui donnait du courage et lui permettait de "recharger ses batteries".
Sur un plan plus personnel, Jerry était aussi extraordinairement drôle et doué pour raconter des histoires. Il pouvait –et cela arrivait souvent – faire rire pendant des heures une audience d'amis ou de camarades avec des histoires le plus souvent tirées de ses observations de la vie. Alors que ses histoires déployaient parfois des piques aux dépens des patrons ou de la classe dominante, elles n'étaient jamais cruelles ou méchantes. Au contraire, elles révélaient son affection et sa sympathie pour ses semblables, de même qu'une capacité bien trop rare à se moquer de ses propres faiblesses. Cette ouverture aux autres est sans doute ce qui a fait de Jerry un professeur efficace (et apprécié) – profession qu'il a embrassée tard, quand il était déjà dans la quarantaine.
Notre hommage à Jerry serait incomplet si nous ne mentionnions pas sa passion pour la musique Zydeco (un style de musique ayant pour origine les créoles de Louisiane et qui y est toujours jouée). Le danseur de Brooklyn était connu dans les festivals de Zydeco de l'arrière-pays de Louisiane, et Jerry était fier de pouvoir aider de jeunes groupes de Zydeco inconnus à trouver des lieux et une audience pour jouer à New York. C'était tout Jerry : enthousiaste et énergique dans tout ce qu'il entreprenait, ouvert et chaleureux avec les autres.
Nous ressentons d'autant plus vivement la perte de Jerry que ses dernières années ont été parmi les plus heureuses. Il était ravi de devenir le grand-père d'un petit-fils adoré. Politiquement, il y avait le développement d'une nouvelle génération de contacts autour de la section américaine du CCI et il s'était lancé dans le travail de correspondance et de discussion avec toute son énergie coutumière. Son dévouement avait porté ses fruits dans les Journées de Discussion tenues à New York quelques semaines seulement avant sa mort, qui avaient rassemblé de jeunes camarades de différentes parties des Etats-Unis, dont beaucoup se rencontraient pour la première fois. A la fin de la réunion, Jerry était ravi et il voyait celle-ci, et tout l'avenir qu'elle incarnait, comme l'un des couronnements de son activité militante. Il nous paraît donc juste de donner, pour terminer, la parole à deux jeunes camarades qui ont participé aux Journées de Discussion. Pour JK : "Jerry était un camarade de confiance et un ami chaleureux...Sa connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier aux Etats-Unis ; la profondeur de son expérience personnelle dans les luttes des années 1970 et 1980 et son engagement à maintenir la flamme de la Gauche communiste aux Etats-Unis pendant la difficile période qui a suivi la prétendue "mort du communisme" étaient incomparables". Pour J : "Jerry a été une sorte de guide politique pour moi au cours des 18 derniers mois. Il était aussi un ami très cher (...) Il voulait toujours discuter et aider les camarades plus jeunes à apprendre comment intervenir et à comprendre les leçons historiques du mouvement ouvrier. Sa mémoire vivra dans chacun de nous, dans le CCI et à travers toute la lutte de classe."
CCI
1. En 1964, il y eut une affaire tristement célèbre où trois jeunes militants des droits civiques (James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner) furent assassinés par des officiers de police et des membres du Ku Klux Klan. Deux d'entre eux étaient des Juifs de New York.
2. Le nom "Underground Railroad" était une référence à un réseau, créé au 19e siècle avant la Guerre civile, de cachettes et de militants anti-esclavagistes qui aidaient les esclaves en fuite à gagner le Nord des États-Unis et le Canada.
Personnages:
- Jerry Grevin [65]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? (II) : de février à juillet 1917 : resurgissement et crise
- 3827 lectures
Le but de cette série est de répondre à une question que se posent beaucoup de camarades (lecteurs et sympathisants), surtout parmi les plus jeunes : que sont les conseils ouvriers ? Dans le premier article de cette série 1, nous avons vu comment ils apparurent pour la première fois de l’histoire à la chaleur de la Révolution de 1905 en Russie et comment la défaite de cette dernière entraîna leur disparition. Dans ce deuxième article, nous allons voir comment ils réapparurent lors de la Révolution de Février 1917 et de quelle manière, sous la domination des anciens partis révolutionnaires mencheviques et socialistes-révolutionnaires (SR) qui avaient trahi la classe ouvrière, ils s’éloignèrent de la volonté et de la conscience croissante des masses ouvrières jusqu’à devenir, en juillet 1917, un point d’appui de la contre-révolution 2.
Pourquoi les soviets disparaissent-ils entre 1905 et 1917 ?
Oskar Anweiler, dans son ouvrage Les Soviets en Russie (3), souligne comment de nombreuses tentatives eurent lieu pour faire revivre les soviets à la suite de la défaite de la révolution en décembre 1905. Un Conseil de chômeurs vit ainsi le jour au printemps 1906 à Saint-Pétersbourg, qui envoya des délégués aux usines pour pousser à la renaissance du soviet. Une réunion qui regroupa 300 délégués en été 1906 ne donna rien à cause des difficultés à reprendre la lutte. Ce Conseil se décomposa peu à peu avec l’affaiblissement de la mobilisation, et disparut définitivement au printemps 1907. A Moscou, Kharkov, Kiev, Poltava, Ekaterinbourg, Bakou, Batoum, Rostoum et Kronstadt apparurent aussi des conseils de chômeurs plus ou moins éphémères tout au long de 1906.
Des soviets apparurent aussi sporadiquement en 1906-1907 dans certaines villes industrielles de l’Oural. C’est cependant à Moscou qu’eut lieu la tentative la plus sérieuse de constituer un soviet. Une grève éclata en juillet et s’étendit rapidement à de nombreuses concentrations ouvrières. Celles-ci mandatèrent rapidement quelques 150 délégués qui parvinrent à se réunir et à constituer un Comité exécutif, lançant des appels à l’extension de la lutte et à la formation de soviets de quartier. Les conditions n’étaient cependant pas celles de 1905 et le gouvernement, constatant le peu d’écho suscité par la mobilisation à Moscou, déchaîna une violente répression qui vint à bout de la grève et du tout nouveau soviet.
Puis les soviets disparurent de la scène sociale jusqu'en 1917. Cette disparition étonne bien des camarades qui se demandent comment il est possible que les mêmes ouvriers, qui avaient participé avec tant d’enthousiasme aux soviets en 1905, les aient condamnés à l’oubli ? Comment comprendre que la forme "conseil", qui avait démontré son efficacité et sa force en 1905, puisse disparaître comme par enchantement pendant une bonne douzaine d'années ?
Pour répondre à cette question, on ne peut partir du point de vue de la démocratie bourgeoise qui considère la société comme une somme d'individus, "libres et souverains", aussi "libres" de constituer des conseils que de participer à des élections. Si c'était le cas, comment comprendre alors que les millions de citoyens qui "avaient décidé" de se constituer en soviets en 1905 "choisirent" ensuite de délaisser cette forme d'organisation durant de longues années ?
Un tel point de vue ne peut parvenir à comprendre que la classe ouvrière n’est pas une somme d’individus "libres et autodéterminés", mais une classe qui ne parvient à s’exprimer, agir et s’organiser que lorsqu'elle s'affirme à travers son action collective dans la lutte. Cette dernière n’est pas alors la résultante de "décisions individuelles" mais bien le produit dynamique de la conjonction d’un ensemble de facteurs objectifs (la dégradation des conditions d’existence et l’évolution générale de la société), et de facteurs subjectifs (l'indignation, l’inquiétude sur l’avenir qui en découle, l'expérience de la lutte et le développement de la conscience de classe animés par l’intervention des révolutionnaires). L’action et l’organisation de la classe ouvrière sont un processus social, collectif et historique qui traduit une évolution du rapport de force entre les classes.
De plus, cette dynamique de la lutte de classe doit à son tour être replacée dans le contexte historique qui permet la naissance des soviets. Pendant la période historique d’ascendance du système capitaliste – et en particulier durant "l’âge d’or" entre 1873 et 1914 – le prolétariat avait pu constituer de grandes organisations permanentes de masse (en particulier, les syndicats) dont l’existence était une des conditions premières pour mener des luttes victorieuses. Dans la période historique qui s’ouvre au début du 20e siècle, celle de la décadence du capitalisme, marquée par l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l’organisation générale de la classe ouvrière se construit dans et par la lutte, disparaissant avec elle si celle-ci ne peut aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au combat révolutionnaire pour détruire l’État bourgeois.
Dans de telles conditions, les acquis des luttes ne peuvent plus s’évaluer de façon comptable, en une somme de gains sonnants et trébuchants pouvant se consolider d’année en année, ni par une organisation de masse permanente. Ces acquis se concrétisent par des gains "abstraits" (évolution de la conscience, enrichissement du programme historique grâce aux leçons des luttes, perspectives pour l’avenir…) conquis dans les grands moments d’agitation puis qui disparaissent de l'appréhension immédiate des larges masses pour se replier dans le petit univers de minorités, donnant ainsi l’illusion de n’avoir jamais existé.
Février 1917 : les soviets surgissent dans le feu de la lutte
Entre 1905 et 1917, les soviets furent ainsi réduits à n’être plus qu’une "idée" orientant la réflexion mais aussi la lutte politique d’une poignée de militants. La méthode pragmatique qui n’accorde d’importance qu’à ce qui peut se voir et se toucher, ne permet pas de comprendre que l’idée même des soviets contenait une immense puissance matérielle. En 1917, Trotski écrivait : "il est hors de doute que le prochain, le nouvel assaut de la révolution sera suivi partout de l’institution de conseils ouvriers" 4. Les grands acteurs de la Révolution de Février furent effectivement les soviets.
Les minorités révolutionnaires, et plus particulièrement les bolcheviks après 1905, avaient défendu et propagé l’idée de constituer des soviets pour pousser la lutte en avant. Ces minorités gardèrent vivante dans la mémoire collective de la classe ouvrière la flamme des conseils ouvriers. C’est pour cela que, lors de l’éclatement des grèves de février qui prirent rapidement une grande ampleur, il y eut de nombreuses initiatives et appels pour la constitution de soviets. Anweiler souligne que "cette pensée surgit autant dans les usines paralysées que dans les cercles intellectuels révolutionnaires. Des témoignages directs affirmaient que dans certaines usines, dès le 24 février, on élisait des personnes de confiance pour un Soviet qui était en train de se construire" (traduit de l’édition en espagnol, p. 110). Autrement dit, l’idée des soviets qui, pendant longtemps, était restée cantonnée à quelques minorités, fut largement prise en charge par les masses en lutte.
En deuxième lieu, le Parti bolchevique contribua significativement au surgissement des soviets. Et il y contribua non pas en se basant sur un schéma organisationnel préalable ou en imposant une chaîne d’organisations intermédiaires qui au bout conduiraient à la formation des soviets, mais sa contribution fut quelque chose de bien différent, comme on va le voir, en lien avec un dur combat politique.
Pendant l’hiver de l’année 1915, lorsque quelques grèves ont commencé à surgir, surtout à Petersburg, la bourgeoisie libérale avait imaginé un plan pour embrigader les ouvriers dans la production de guerre, proposant que, dans les entreprises, soit élu un Groupe ouvrier au sein des Comités des industries de guerre. Les mencheviks se présentèrent et, ayant obtenu une large majorité, tentèrent d’utiliser le Groupe ouvrier pour présenter des revendications. Ils proposaient, de fait, à l’image des syndicats dans les autres pays européens, d’utiliser une "organisation ouvrière" vendue à l’effort de guerre.
Les bolcheviks s’opposèrent à cette proposition en octobre 1915 par la bouche de Lénine : "Nous sommes contre la participation aux Comités des industries de guerre, qui aident à mener la guerre impérialiste réactionnaire" 5. Les bolcheviks appelèrent à l’élection de comités de grève et le Comité du parti de Petersburg proposa que "les délégués des fabriques et ateliers, élus à la représentation proportionnelle, devront former le Soviet panrusse des députés ouvriers" 6.
Dans un premier temps, les mencheviks, avec leur politique électorale en faveur du Groupe ouvrier, contrôlèrent la situation d’une main de fer. Les grèves de l’hiver 1915 et celles, bien plus nombreuses, de la seconde moitié de 1916 restèrent sous la tutelle du Groupe ouvrier menchevique malgré que, ici où là, apparurent des comités de grève. Ce n'est qu'en février que le grain commença à germer.
La première tentative de constituer un soviet eut lieu lors d’une réunion improvisée qui se déroula au Palais de Tauride le 27 février. Ceux qui y participèrent n’étaient pas représentatifs ; il y avait des éléments du Parti menchevique et du Groupe ouvrier avec quelques représentants bolcheviques et d'autres éléments indépendants. Et là surgit un débat très significatif qui mit sur la table deux options totalement opposées : les mencheviks prétendaient que la réunion devait s’autoproclamer Comité provisoire du Soviet; le bolchevik Chliapnikov "s’[y] opposa, arguant que cela ne pouvait se faire en l’absence de représentants élus par les ouvriers. Il demanda leur convocation urgente et l’assemblée lui donna raison. Il fut décidé de finir la session et de lancer les convocations aux principales concentrations ouvrières et aux régiments insurgés" 7.
La proposition eut des effets foudroyants. La nuit même du 27, elle commença à se répandre dans de nombreux quartiers, les usines et les casernes. Des ouvriers et des soldats veillaient à suivre de près le développement des événements. Le lendemain, il y eut de nombreuses assemblées dans les usines et les casernes et, les unes après les autres, prirent la même décision : constituer un soviet et élire un délégué. Dans l’après-midi, le palais de Tauride était rempli de fond en comble de délégués d’ouvriers et de soldats. Sukhanov, dans ses Mémoires 8, décrit la réunion qui allait prendre la décision historique de constituer le soviet : "au moment de l’ouverture de la séance il y avait quelques 250 députés, mais de nouveaux groupes entraient sans cesse dans la salle" 9. Il raconte comment, au moment de voter l’ordre du jour, la session fut interrompue par des délégués de soldats qui voulaient transmettre les messages de leurs assemblées de régiment respectives. Et l’un d’eux fit le résumé suivant : "Les officiers ont disparu. Nous ne voulons plus servir contre le peuple, nous nous associerons avec nos frères ouvriers, tous unis pour défendre la cause du peuple. Nous donnerons nos vies pour cette cause. Notre assemblée générale nous a demandé de vous saluer". Sukhanov ajoute : "Et avec une voix étouffée par l’émotion, au milieu des ovations de l’assemblée frémissante, le délégué ajouta : Vive la Révolution !" 10.La réunion, constamment interrompue par l’arrivée de nouveaux délégués qui voulaient transmettre la position de ceux qu’ils représentaient, aborda au fur et à mesure les différentes questions : formation de milices dans les usines, protection contre les pillages et les agissements des forces tsaristes. Un délégué proposa la création d’une "commission littéraire" pour rédiger un appel adressé à tous le pays, ce qui fut approuvé à l'unanimité 11. L’arrivée d’un délégué du régiment Semionovski – réputé pour sa fidélité au Tsar et son rôle répressif en 1905 - entraîna une nouvelle interruption. Le délégué proclama : "Camarades et frères, je vous apporte les salutations de tous les hommes du régiment Semionovski. Tous jusqu’au dernier, nous avons décidé de nous joindre au peuple". Ceci provoqua "un courant d’enthousiasme qui parcourut toute l’assemblée" (Sukhanov). L’assemblée organisa un "état-major de l’insurrection" occupant tous les points stratégiques de Petersburg.
L’assemblée du Soviet n’avait pas lieu dans le vide. Les masses étaient mobilisées. Sukhanov souligne l’ambiance qui entourait la séance : "La foule était très compacte, des dizaines de milliers d’hommes s’y étaient rendus pour saluer la révolution. Les salons du palais ne pouvaient plus contenir autant de gens et, devant les portes, les cordons de la Commission militaire arrivaient tout juste à contenir une foule de plus en plus nombreuse" (idem, p. 56).
Mars 1917 : un gigantesque réseau de soviets s'étend sur toute la Russie
En 24 heures, le Soviet se rendit maître de la situation. Le triomphe de l’insurrection de Petersburg provoqua l’extension de la révolution à tout le pays. "Couvrant tout le territoire russe, le réseau des conseils locaux de députés ouvriers et soldats constituait en quelque sorte la charpente osseuse de la révolution" 12.
Comment a pu se produire une telle ramification gigantesque qui, en si peu de temps, s’est étendue sur tout le territoire russe ? Il y a des différences entre la formation des soviets en 1905 et en 1917. En 1905, la grève s’est déclenchée en janvier et les vagues successives de grève ne débouchèrent sur aucune organisation massive sauf quelques exceptions. Les soviets commencèrent à se constituer vraiment en octobre. Par contre, en 1917, c’est dès le début de la lutte que sont créés les soviets. Les appels du Soviet de Petersburg le 28 février tombèrent sur un sol fertile. La célérité impressionnante avec laquelle ce Soviet s’est constitué est, par elle-même, significative de la volonté de le faire surgir qui animait de larges couches d’ouvriers et de soldats.
Les assemblées étaient quotidiennes. Elles ne se limitaient pas à élire le délégué au Soviet. Il arrivait souvent que celui-ci soit massivement accompagné jusqu’au lieu de l’assemblée générale. Par ailleurs et parallèlement, des soviets de quartier se constituaient. Le Soviet lui-même avait fait un appel en ce sens et, le jour même, les ouvriers du quartier combatif de Vyborg, une agglomération prolétarienne de la banlieue de Petersburg, avaient pris les devants en constituant un Soviet de District et en lançant un appel très combatif pour que de tels soviets soient formés dans tout le pays. Les ouvriers de bien d’autres quartiers populaires suivirent leur exemple les jours suivants.
Et c’est de la même manière que les assemblées d’usine constituèrent des conseils d’usine. Ceux-ci, bien qu'étant nés pour répondre à des besoins revendicatifs et d’organisation interne du travail, ne se limitaient pas à cet aspect et devenaient de plus en plus politisés. Anweiler reconnaît que "Avec le temps, les Conseils d’Usine ont acquis une organisation solide à Petersburg, représentant, dans une certaine mesure, une concurrence par rapport au Conseil des Députés Ouvriers. Ils se sont associés aux conseils de rayon (quartier), et leurs représentants élisaient un conseil central avec, à sa tête, un comité exécutif. Etant donné qu’ils encadraient les travailleurs directement dans leur lieux de travail, leur rôle révolutionnaire a pris de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le Soviet [de Petersburg] devenait une institution durable et commençait à perdre le contact étroit avec les masses" (p. 133, idem).
Ainsi, la formation de soviets s’est répandue dans toute la Russie, telle une traînée de poudre. A Moscou "le 1er mars eurent lieu les élections des délégués des usines et le Soviet tint sa première séance en élisant un Comité Exécutif de 30 membres. Le lendemain s’est constitué définitivement le Conseil ; on fixa des normes de représentativité, on élut les délégués pour le Soviet de Petersburg et on approuva la formation du nouveau gouvernement provisoire (…) La marche triomphale de la révolution qui depuis Petersburg s’est propagée à toute la Russie était accompagnée d’une vague révolutionnaire d’activité organisationnelle dans toutes les couches sociales qui a eu sa plus forte concrétisation dans la formation de soviets dans toutes les villes de l’Empire, depuis la Finlande jusqu’à l’océan Pacifique" 13
Même si les soviets s’occupaient d’affaires locales, leur préoccupation principale concernait les problèmes généraux : la guerre mondiale, le chaos économique, l’extension de la révolution à d’autres pays et ils prirent des mesures pour concrétiser ces préoccupations. Il est à souligner que l’effort pour centraliser les soviets est venu "d’en bas" et non d’en haut. Comme c'est dit ci-dessus, le Soviet de Moscou avait décidé d’envoyer des délégués au Soviet de Petersburg, le considérant tout naturellement comme le centre de tout le mouvement. Anweiler souligne que "les conseils d’ouvriers et de soldats des autres villes envoyaient leurs délégués à Petersburg ou gardaient des observateurs en permanence auprès du Soviet" (p. 129). Dès la mi-mars, des initiatives pour des congrès régionaux de soviets ont commencé à se faire jour. À Moscou une Conférence de cette nature eut lieu les 25-27 mars avec la participation de 70 conseils ouvriers et de 38 conseils de soldats. Dans le bassin du Donetz, il y eut une Conférence ayant les mêmes caractéristiques où se réunirent 48 soviets. Tout cet effort a culminé dans la tenue d’un Premier Congrès des soviets de toute la Russie qui eut lieu du 29 mars au 3 avril et regroupa des délégués de 480 soviets.
Le "virus organisationnel" se répandit aux soldats qui, écœurés par la guerre, désertaient les champs de bataille, se mutinaient, expulsaient les officiers et décidaient de rentrer chez eux. Contrairement à 1905 où ils n’existèrent pratiquement pas, les conseils de soldats se mirent à foisonner et à proliférer dans les régiments, les cuirassés, les bases navales, les arsenaux… L'armée regroupait un conglomérat de classes sociales, essentiellement des paysans, les ouvriers étant une minorité. Malgré cette hétérogénéité, la majorité de ces soviets s’unirent au prolétariat. Comme le signale l’historien et économiste bourgeois Tugan Baranovski, "ce n’est pas l’armée qui a déclenché l’insurrection, ce sont les ouvriers. Ce ne sont pas des généraux, mais des soldats qui se sont rendus à la Douma d’Empire 14. Et les soldats ont soutenu les ouvriers non point pour obtempérer docilement à des injonctions de leurs officiers, mais… parce qu’ils se sentaient apparentés par le sang aux ouvriers, en tant que classe de travailleurs, comme eux-mêmes" 15.
L’organisation soviétique gagna progressivement du terrain jusqu’à s’élargir fortement à partir de mai 1917, quand la formation de conseils de paysans commença à agiter des masses habituées depuis des siècles à être traitées comme du bétail. C’était là aussi une différence fondamentale avec 1905, qui n’avait connu que relativement peu de soulèvements paysans, totalement désorganisés.
Que toute la Russie se couvre d’un gigantesque réseau de conseils est un fait historique d’une immense portée. Comme le signale Trotski, "dans toutes les révolutions précédentes, sur les barricades se battaient des ouvriers, de petits artisans, un certain nombre d’étudiants ; des soldats prenaient leur parti ; ensuite, la bourgeoisie cossue, qui avait prudemment observé les combats des barricades par la fenêtre, recueillait le pouvoir" (16), mais il n’en fut pas ainsi cette fois. Les masses cessèrent de se battre "pour d’autres" et se préparèrent à se battre pour elles-mêmes à travers les conseils. Elles s’occupaient de toutes les affaires de la vie économique, politique, sociale et culturelle.
Les masses ouvrières étaient mobilisées. L’expression de cette mobilisation était les soviets et, autour d’eux, tout un gigantesque réseau d’organisations de type soviétique (conseils de quartier et conseils d’usine), réseau qui se nourrissait, et, à son tour, impulsait une quantité impressionnante d’assemblées, de réunions, de débats, d’activités culturelles qui se démultipliaient… Des ouvriers, des soldats, des femmes, des jeunes s’adonnaient à une activité fébrile. Ils vivaient dans une sorte d’assemblée permanente. On arrêtait le travail pour assister à l’assemblée de l’usine, au soviet de la ville ou du quartier, aux rassemblements, aux meetings, aux manifestations. Il est significatif qu’après la grève de février, il n’y ait eu pratiquement pas de grèves, excepté à des moments particuliers et dans des situations ponctuelles ou locales. Contrairement à une vision restrictive de la lutte, limitant celle-ci à la grève, l’absence de grèves ne voulait pas dire démobilisation. Les ouvriers étaient en lutte permanente, mais la lutte de classe, comme le disait Engels, constitue une unité formée par la lutte économique, la lutte politique et la lutte idéologique. Et les masses ouvrières étaient en train d'assumer simultanément ces trois dimensions de leur combat. Des actions massives, des manifestations, des rassemblements, des débats, la circulation de livres et de journaux…, les masses ouvrières russes, avaient pris leur propre destin en main et trouvaient en leur sein des réserves inépuisables de pensée, d’initiatives, de recherche, tout était abordé sans relâche dans des forums intensément collectifs.
Avril 1917 : le combat pour "tout le pouvoir aux soviets"
"Le soviet prit possession de tous les bureaux de postes et de télégraphes, de la radio, de toutes les gares, des imprimeries, de sorte que sans son autorisation il était impossible d’envoyer un télégramme, de sortir de Petersburg ou de publier un manifeste", reconnaît dans ses Mémoires un député du Parti Cadet 17. Et cependant, comme le signale Trotski, il existait un terrible paradoxe depuis février : le pouvoir des soviets avait été confié par la majorité (menchevique et socialiste-révolutionnaire) à la bourgeoisie, l’obligeant pratiquement à créer le Gouvernement provisoire 18, présidé par un prince tsariste et composé de riches industriels, de cadets et, pour faire bien, du "socialiste" Kérenski 19.
Le Gouvernement provisoire, à l’abri derrière les soviets, poursuivait sa politique guerrière et se souciait peu de trouver des solutions aux graves problèmes qui se posaient aux ouvriers et aux paysans. Cela menait les soviets à l’inefficacité et donc à la disparition, comme on peut le dégager de ces déclarations de dirigeants socialistes-révolutionnaires : "Les soviets n’aspirent nullement à rassembler l’Assemblée constituante où siègent les députés de toute la Russie […] Pas plus qu’ils ne sont un pouvoir parallèle à l’Assemblée nationale, pas plus, ils ne s’alignent sur le Gouvernement provisoire. Conseillers du peuple qui luttent pour ses intérêts […], ils ont conscience de ne représenter qu’une partie du pays et de ne jouir de la confiance que des seules masses populaires dans l’intérêt desquelles ils combattent. C’est pourquoi les soviets se sont toujours refusés à prendre en mains le pouvoir et à former un gouvernement" 20.
Au début du mois de mars, un secteur de la classe ouvrière commença cependant à prendre conscience du fait que les soviets tendaient à servir de paravent et d'instrument à la politique de la bourgeoisie. Il y eut alors des débats très animés dans quelques soviets, comités d’usine et conseils de quartiers sur la "question du pouvoir". L’avant-garde bolchevique était alors à la traîne, son Comité central 21 ayant précisément adopté une résolution de soutien critique au Gouvernement provisoire, malgré de fortes oppositions dans différentes sections du parti 22.
Le débat redoubla d’intensité en mars. "Le Comité de Vyborg rassembla dans un meeting des milliers d’ouvriers et de soldats qui, presqu’unanimement, adoptèrent une résolution sur la nécessité de la prise de pouvoir par le Soviet […] La résolution de Vyborg, en raison de son succès, fut imprimée et placardée au moyen d'affiches. Mais le Comité de Petrograd jeta son interdit formel sur cette résolution…" 23.
L’arrivée de Lénine en avril transforma radicalement la situation. Lénine, qui suivait avec inquiétude, depuis son exil en Suisse, les quelques informations qui arrivaient jusqu’à lui sur l’attitude honteuse du Comité central du Parti bolchevique, était parvenu aux mêmes conclusions que le Comité de Vyborg. Dans ses Thèses d’Avril, il le formula clairement : "Ce qu’il y a d’original dans l’actualité russe, c’est la transition de la première étape de la révolution, qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d’organisation du prolétariat, à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie" 24.
Beaucoup d’auteurs ne voient pas dans cette intervention décisive de Lénine une expression du rôle d’avant-garde du parti révolutionnaire et de ses militants les plus remarquables mais, au contraire, la considèrent comme un acte d’opportunisme politique. Selon eux, Lénine aurait saisi au vol l’opportunité d’utiliser les soviets comme plate-forme pour conquérir le "pouvoir absolu", délaissant son habit de "jacobin rigoureux" pour prendre celui d’un anarchiste partisan du "pouvoir direct des masses". De fait, un ancien membre du parti décocha que : "Pendant de nombreuses années, la place de Bakounine dans la révolution russe est restée inoccupée ; maintenant, elle est prise par Lénine" 25.(Traduit pas nous)
Cette légende est radicalement fausse. La confiance de Lénine envers les soviets venait en fait de très loin, des leçons qu’il avait tirées de la Révolution de 1905. Dans un projet de résolution qu’il proposa en 1906 au IVe Congrès du Parti, il disait que "ces soviets étant des embryons du pouvoir révolutionnaire, leur force et leur importance dépendent entièrement de la force et du succès de l’insurrection", pour ajouter que "de telles institutions, si elles ne s’appuient pas sur une armée révolutionnaire et ne renversent pas les autorités gouvernementales (c’est-à-dire si elles ne se transforment pas en gouvernement révolutionnaire), seront inévitablement vouées à leur perte" 26. En 1915, il revint sur cette même idée : "Les conseils des députés ouvriers et autres institutions analogues doivent être considérés comme des organes insurrectionnels, des organes du pouvoir révolutionnaire. C’est seulement en liaison avec le développement de la grève de masse et avec l’insurrection […] que ces institutions peuvent être réellement utiles" 27.
Juin-juillet 1917 : la crise des soviets
Lénine était cependant conscient que le combat ne faisait que commencer : "Ce n’est qu’en luttant contre cette inconscience confiante des masses (lutte qui ne peut et ne doit se livrer qu’avec les armes idéologiques au moyen de la persuasion amicale, en se référant à l’expérience vivante) que nous pourrons vraiment nous débarrasser du déchaînement actuel de phrases révolutionnaires et réellement impulser tant la conscience du prolétariat que celle des masses, l’initiative locale, l' audace et la résolution". 28. (Traduit de l'espagnol pas nous)
Cela se vérifia amèrement lors du Premier Congrès des soviets de toutes les Russies. Convoqué pour unifier et centraliser le réseau des différents types de soviets éparpillés sur tout le territoire, ses résolutions allaient non seulement à l’encontre de la révolution mais débouchaient sur la destruction des soviets. Aux mois de juin et juillet est apparu au grand jour un problème politique grave : la crise des soviets, leur éloignement de la révolution et des masses.
La situation générale était marquée par un désordre total : hausse générale du chômage, paralysie des transports, perte des récoltes dans les campagnes, rationnement général. Les désertions se multipliaient dans l’armée ainsi que les tentatives de fraternisation avec l’ennemi sur le front. Le camp impérialiste de l’Entente (France, Grande-Bretagne et depuis peu États-Unis) faisait pression sur le Gouvernement provisoire pour qu’il lance une offensive générale contre le front allemand. Les délégués mencheviques et SR, complaisants face à cette demande, firent adopter une résolution au Congrès des soviets pour soutenir l’offensive militaire alors qu’une importante minorité, qui ne regroupait pas que les bolcheviks, était contre. Pour comble, le Congrès rejeta une proposition de limiter la journée de travail à huit heures et se désintéressa du problème agraire. De porte-voix des masses, il devint le porte-voix de ce qu’elles haïssaient par-dessus tout, la continuation de la guerre impérialiste.
La mise en circulation des résolutions du Congrès – et, en particulier, celles qui soutenaient l’offensive militaire – provoqua une profonde déception dans les masses. Celles-ci se rendirent compte que leur organisation leur glissait entre les doigts et commencèrent à réagir. Les soviets de quartier de Petersburg, le Soviet de la ville voisine de Kronstadt et divers conseils d’usine et les comités de plusieurs régiments proposèrent une grande manifestation le 10 juin dont l’objectif serait de faire pression sur le Congrès pour qu’il change de politique et s’oriente vers la prise de pouvoir, expulsant les ministres capitalistes.
La réponse du Congrès fut d’interdire temporairement les manifestations sous prétexte du "danger" d’un "complot monarchiste". Les délégués du Congrès furent mobilisés pour se déplacer dans les usines et les régiments pour "convaincre" les ouvriers et les soldats. Le témoignage d’un délégué menchevique est éloquent : "Toute la nuit durant, la majorité du Congrès, plus de cinq cents de ses membres, sans fermer l’œil, par équipes de dix, parcoururent les fabriques, les usines et les casernes de Petrograd, exhortant les hommes à s’abstenir de la manifestation. Le Congrès, dans un bon nombre de fabriques et d’usines et aussi dans une certaine partie de la garnison, ne jouissait d’aucune autorité… Les membres du Congrès furent accueillis très souvent d’une manière fort inamicale, parfois avec hostilité et, fréquemment, furent éconduits avec colère" 29.
Le front de la bourgeoisie avait compris la nécessité de sauver son principal atout – la séquestration des soviets – contre la première tentative sérieuse des masses pour les récupérer. Elle le fit avec son machiavélisme congénital, en utilisant les bolcheviks comme têtes de turcs, lançant une furieuse campagne contre eux. Au Congrès des cosaques qui se tenait en même temps que le Congrès des soviets, Milioukov proclama que "les bolcheviks étaient les pires ennemis de la Révolution russe… Il est temps d’en finir avec ces messieurs" 30. Le Congrès cosaque décida "de soutenir les soviets menacés. Nous autres, cosaques, ne nous querellerons jamais avec les soviets" 31. Comme le souligne Trotski, "contre les bolcheviks, les réactionnaires étaient prêts à marcher même avec le soviet pour l’étouffer d’autant plus tranquillement ensuite" 32. Le menchevik Liber montra clairement l’objectif en déclarant au Congrès des soviets : "Si vous voulez avoir pour vous la masse qui se dirige vers les bolcheviks, rompez avec le bolchevisme".
La violente contre-offensive bourgeoise contre les masses se faisait dans une situation où, dans leur ensemble, elles étaient encore politiquement faibles. Les bolcheviks le comprirent et proposèrent l’annulation de la manifestation du 10 juin, ce qui ne fut accepté qu'à contrecœur par quelques régiments et les usines les plus combatives.
Lorsque parvint cette nouvelle au Congrès des soviets, un délégué proposa que soit convoquée une manifestation "véritablement soviétique", le 18 juin. Milioukov analyse ainsi cette initiative : "Suite à des discours au ton libéral au Congrès des soviets, après avoir réussi à empêcher la manifestation armée du 10 juin… les ministres socialistes sentirent qu’ils étaient allés trop loin dans leur rapprochement avec nous, que le terrain fuyait sous leurs pieds. Effarés, ils se retournèrent brusquement vers les bolcheviks". Trotski le corrige avec justesse : "Il ne s'agissait pas, bien entendu, d'un virage vers les bolcheviks, mais de quelque chose de bien différent, une tentative de se tourner vers les masses, contre les bolcheviks" 33. (Traduit de l'espagnol par nous)
Ce fut un cuisant échec pour le Congrès des soviets dominé par la bourgeoisie. Les ouvriers et les soldats participèrent massivement à la manifestation du 18 juin, brandissant des banderoles réclamant tout le pouvoir aux soviets, la destitution des ministres capitalistes, la fin de la guerre, appelant à la solidarité internationale… Les manifestations reprenaient les orientations bolcheviques et exigeaient le contraire de ce que demandait le Congrès.
La situation empirait. Pressée par ses alliés de l’Entente, la bourgeoisie russe était dans une impasse. La fameuse offensive militaire s’était soldée par un fiasco, les ouvriers et les soldats voulaient un changement radical de politique des soviets. Mais la situation n’était pas si claire dans les provinces et dans les campagnes où, malgré une certaine radicalisation, la grande majorité restait fidèle aux SR et favorable au Gouvernement provisoire.
Le moment était venu pour la bourgeoisie de tendre une embuscade aux masses à Petersburg en provoquant un affrontement prématuré qui devait lui permettre d’asséner un rude coup à l’avant-garde du mouvement et d’ouvrir ainsi les portes à la contre-révolution.
Les forces de la bourgeoisie se réorganisaient. Des "soviets d’officiers" s’étaient constitués, dont la tâche était d’organiser des forces d’élite pour écraser militairement la révolution. Encouragées par les démocraties occidentales, les bandes noires tsaristes relevaient la tête. Selon les propres termes de Lénine, la vieille Douma fonctionnait comme un bureau contre-révolutionnaire sans que les leaders social-traîtres des soviets lui opposent le moindre obstacle.
Une série de provocations subtiles fut programmée pour pousser les ouvriers de Petersburg dans le piège d’une insurrection prématurée. Le Parti Cadet retira tout d’abord ses ministres du Gouvernement provisoire pour que celui-ci ne soit plus composé que de "socialistes". C’était une sorte d’invitation à ce que les ouvriers réclament la prise immédiate du pouvoir et se lancent à l’insurrection. L’Entente lança ensuite un véritable ultimatum au Gouvernement provisoire : il fallait choisir entre les soviets ou un gouvernement constitutionnel. Enfin, la plus violente provocation fut la menace de déplacer les régiments les plus combatifs de la capitale vers les régions frontalières.
Des masses importantes de travailleurs et de soldats de Petersburg mordirent à l’hameçon. A partir de nombreux soviets de quartiers, d'usines et de régiments, une manifestation armée fut appelée pour le 4 juillet. Son mot d'ordre était la prise du pouvoir par les soviets. Cette initiative montrait que les ouvriers avaient compris qu'il n'y avait pas d'issue en dehors de la révolution. Mais, en même temps, ils réclamaient que le pouvoir soit assumé par les soviets tels qu'ils étaient alors constitués, c'est-à-dire avec la majorité aux mains des mencheviks et des socialistes révolutionnaires dont la préoccupation était d'inféoder les soviets à la bourgeoisie. Cette scène, désormais célèbre, où un ouvrier s'adresse à un membre menchevique du Soviet, "pourquoi ne prends-tu pas le pouvoir une bonne fois pour toutes ?", est significative des illusions persistantes au sein de la classe ouvrière. C'était demander que le loup entre dans la bergerie ! Les bolcheviks mirent en garde contre le piège qui était tendu. Ils ne le firent pas avec suffisance, hissés sur un piédestal et disant aux masses à quel point elles se trompaient. Ils se mirent à la tête de la manifestation, coude à coude avec les ouvriers et les soldats, pour contribuer de toutes leurs forces à ce que la riposte soit massive mais ne dérape pas vers un affrontement décisif dont la défaite était écrite d’avance 34.
La manifestation s’acheva dans l’ordre et ne se lança pas à l’assaut révolutionnaire. Le massacre fut évité, ce qui fut une victoire des masses pour l’avenir. Mais la bourgeoisie ne pouvait pas reculer, elle devait poursuivre son offensive. Le Gouvernement provisoire, entièrement constitué de ministres "ouvriers", déchaîna alors une répression brutale particulièrement orientée contre les bolcheviks. Le Parti fut déclaré hors-la-loi, de nombreux militants furent emprisonnés, l’ensemble de la presse interdite, Lénine dut passer à la clandestinité.
Par un effort difficile mais héroïque, le Parti bolchevique avait contribué de façon décisive à éviter la défaite des masses, leur dispersion et la débandade qui les menaçait à travers leur désorganisation. Le Soviet de Petersburg, par contre, soutenu par le Comité exécutif élu lors du récent Congrès des soviets, touchait le fond de l’ignominie en avalisant le déchaînement d'une répression brutale et la réaction.
Comment la bourgeoisie a-t-elle pu dévoyer les soviets ?
L’organisation des masses en conseils ouvriers, dès février 1917, a signifié pour celles-ci la possibilité de développer leur force, leur organisation et leur conscience en vue de l’assaut final contre le pouvoir de la bourgeoisie. La période qui s’ensuivit, dite période de dualité de pouvoir entre prolétariat et bourgeoisie, a constitué une phase critique pour les deux classes antagoniques, pouvant aboutir, pour l’une et l‘autre, à une victoire politique et militaire sur la classe ennemie.
Pendant toute cette période, le niveau de conscience des masses, encore faible relativement aux nécessités d’une révolution prolétarienne, constituait une brèche au sein de laquelle la bourgeoisie devait tenter de s’engouffrer pour faire avorter le processus révolutionnaire en gestation. Elle disposait pour cela d’une arme d’autant plus dangereuse que pernicieuse, le sabotage de l'intérieur exercé par des forces bourgeoises agissant sous un masque "ouvrier" et "radical". Ce cheval de Troie de la contre-révolution fut constitué à l'époque, en Russie, par les partis "socialistes", mencheviks et SR.
Au début, beaucoup d'ouvriers entretenaient des illusions sur le Gouvernement provisoire et le voyaient comme une émanation des soviets, alors qu'en réalité il était leur pire ennemi. Quand aux mencheviks et socialistes-révolutionnaires, ils jouissaient d’une confiance importante parmi les grandes masses ouvrières qu’ils parvenaient à illusionner avec leurs discours radicaux, leur phraséologie révolutionnaire, ce qui leur permit de dominer politiquement la très grande majorité des soviets. C’est à partir de cette position de force qu’ils s’efforcèrent effectivement de vider ces organes de leur substance révolutionnaire pour les mettre au service de la bourgeoisie. S’ils n’y parvinrent finalement pas, c’est parce que les masses mobilisées en permanence, faisaient leur propre expérience les conduisant, avec l'appui du Parti bolchevique, à démasquer les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires à mesure que ceux-ci étaient amenés à assumer l’orientation du Gouvernement provisoire sur des questions aussi fondamentales que celles de la guerre et des conditions de vie.
Nous verrons dans un prochain article comment, dès la fin août 1917, les soviets parvinrent à se régénérer et à devenir réellement des plates-formes pour la prise du pouvoir, qui culmina dans la victoire de la Révolution d’Octobre.
C. Mir, 8 mars 2010
1 Cf. la Revue internationale no 140 [66].
2 Nous disposons aujourd’hui de beaucoup de matériel pour connaître en détails comment se développa la Révolution russe mais aussi pour voir le rôle décisif que joua le Parti bolchevique. En particulier l’Histoire de la Révolution russe de Trotski, Dix jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, nos brochures sur la Révolution russe ainsi que de nombreux articles de notre Revue internationale, cf. les nos 71-72, 89 à 91 [67].
3 Cet auteur très antibolchevique narre cependant les faits de façon très fidèle et reconnaît avec impartialité les apports des bolcheviks, ce qui contraste d’ailleurs avec les jugements sectaires et dogmatiques qu’il assène de temps en temps.
4 Cité par Oskar Anweiler, op. cité.
5 Ídem
6 Ídem.
7 Gerald Walter, Vision d’ensemble de la Révolution russe.
8 Publiées en 1922 en 7 volumes, elles apportent le point de vue d’un socialiste indépendant, collaborateur de Gorki et des mencheviks internationalistes de Martov. Même s’il était en désaccord avec les bolcheviks, il soutint la Révolution d’Octobre. Cette citation et les suivantes sont extraites et traduites d’un résumé de ses Mémoires, publié en espagnol.
9 D’après Anweiler, il y avait autour de 1000 délégués à la fin de la session et, lors des suivantes, il y a eu jusqu’à 3000.
10 Œuvre citée, p. 54
11 Cette commission proposera l’édition permanente d’un journal du Soviet: Izvestia (Les Nouvelles) qui paraîtra régulièrement à partir de ce moment-là.
12 Anweiler, op. cité.
13 Anweiler, œuvre citée p. 121
14 Chambre des députés.
15 Cité par Trotski dans son Histoire de la Révolution russe, T. I.
16 Idem.
17 Parti constitutionnel démocratique (KD), de la grande bourgeoisie, formé précipitamment en 1905. Son dirigeant était Milioukov, éminence grise de la bourgeoisie russe de l’époque.
18 Trotski raconte comment la bourgeoisie était paralysée et comment les chefs mencheviques se servirent de leur influence dans les soviets pour lui remettre le pouvoir sans conditions, de sorte que Milioukov "ne se gênait pas pour afficher sa satisfaction et son agréable surprise » (Mémoires de Soukhanov, menchevik qui vécut de près les événements au sein du Gouvernement provisoire).
19 Cet avocat, très populaire dans les cercles ouvriers avant la révolution, finit par être nommé chef du Gouvernement provisoire et dirigea alors les différentes tentatives d’en finir avec les ouvriers. Ses intentions sont révélées par les mémoires de l’ambassadeur anglais de l’époque : "Kerenski m’exhorta à la patience en m’assurant que les soviets finiraient par mourir de mort naturelle. Ils céderaient bientôt leurs fonctions à des organes démocratiques d’administration autonome ».
20 Cité par Anweiler, op. cité.
21 En faisaient partie Staline, Kamenev et Molotov. Lénine était exilé en Suisse et n’avait pratiquement pas de moyens de contacter le parti.
22 Lors d’une réunion du Comité du Parti de Petrograd, célébrée le 5 mars, fut rejeté le projet de résolution présenté par Chliapnikov qui disait : "L’impératif de l’heure réside dans la formation d’un gouvernement révolutionnaire provisoire issu de l’unification des conseils locaux des députés ouvriers, paysans et soldats. Avant de passer à la conquête intégrale du pouvoir central, il est indispensable […] de consolider le pouvoir des conseils des députés ouvriers et soldats" (cité par Anweiler, op. cité).
23 Trotski, op. cité.
24 Nous ne pouvons aborder dans cet article le contenu de ces Thèses, extrêmement intéressantes au demeurant. Cf. la Revue internationale no 89, "Les Thèses d’avril, phare de la révolution prolétarienne [68]».
25 Cité par Trotski, op. cit.
26 Cité par Anweiler, op. cit.
27 Idem.
28 Lénine, Oeuvres choisies. Lenin Obras Escogidas tomo II página 50 edición española
29 Cité par Trotski, op. cité.
30 Que le chef de la bourgeoisie en Russie se permette de parler au nom de la Révolution russe révèle bien tout le cynisme typique de cette classe !
31 Régiments caractérisés par leur obéissance au tsar et à l’ordre établi. Ils furent les derniers à passer du côté de la révolution.
32 Trotski, op. cité.
33 Toutes ces citations sont extraites de Trotski, op. cité.
34 Voir notre article sur "Les journées de juillet et le rôle indispensable du parti [69]", Revue internationale no 90. Nous renvoyons nos lecteurs à cet article pour une analyse plus détaillée de cet événement.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VI) : La théorie du déclin du capitalisme et la lutte contre le révisionnisme
- 4310 lectures
Engels entrevoit l'arrivée de la crise historique du capitalisme
D'après un certain courant intellectuel, composé de marxologues, de conseillistes et d'anarchistes, la théorie marxiste est devenue stérile après la mort de Marx en 1883 ; selon eux, les partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale auraient été dominés par la pensée d'Engels. Ce dernier ainsi que ses partisans auraient transformé la méthode d'investigation de Marx en un système de pensée à demi mécaniste qui assimilerait, à tort, la critique sociale radicale à la démarche des sciences de la nature. Ils accusent également la "pensée d'Engels" de revenir de façon quasi mystique aux dogmes hégéliens, en particulier lorsqu'il tente d'élaborer une "dialectique de la nature". Dans la conception de ce courant, ce qui est naturel n'est pas social, et ce qui est social n'est pas naturel. Si la dialectique existe, elle ne peut s'appliquer qu'à la sphère sociale.
Cette rupture dans la continuité entre Marx et Engels (qui, sous sa forme la plus extrême, rejette quasiment l'ensemble de la Deuxième Internationale considérée comme un instrument de l'intégration du mouvement ouvrier au service des besoins du capital) est souvent utilisée pour rejeter toute notion de continuité dans l'histoire politique de la classe ouvrière. De Marx - que peu de nos "anti-Engels" rejettent (au contraire, ils sont fréquemment devenus des "experts" de tous les détails du problème de la transformation de la valeur en prix ou d'autres aspects partiels de la critique faite par Marx à l'économie politique), on nous convie à sauter à pieds joints par dessus Engels, Kautsky, Lénine et par dessus les Deuxième et Troisième Internationales. Et tout en reconnaissant, à contre-cœur, que certaines parties de la Gauche communiste ont réalisé certains développements théoriques malgré leur parenté douteuse, on considère qu'après Marx, ce sont quelques intellectuels clairsemés... qui assurent la continuité véritable de sa théorie. Seuls ces brillants individus auraient vraiment compris Marx au cours des dernières décennies – il ne s'agit, en fait, personne d'autre que les partisans de la thèse "anti-Engels".
Nous ne pouvons ici répondre à l'ensemble de cette idéologie. Comme tous les mythes, elle se base sur certains éléments de la réalité qui sont distordus et amplifiés hors de toute proportion. Au cours de la période de la Deuxième Internationale, période au cours de laquelle le prolétariat se constituait comme classe en une force organisée au sein de la société capitaliste, il y a eu en effet une tendance à schématiser le marxisme et à en faire une sorte de déterminisme, en même temps que les idées réformistes exerçaient un poids réel sur le mouvement ouvrier ; et même les meilleurs marxistes, y compris Engels, n'y échappèrent pas 1. Mais même si Engels a commis des erreurs importantes au cours de cette période, écarter platement les travaux d'Engels après la mort de Marx en tant que négation et détournement de la pensée réelle de Marx est absurde étant donnée la coopération très étroite que les deux hommes ont entretenue du début à la fin de leurs relations. C'est Engels qui a assuré l'énorme tâche d'éditer et de publier Le Capital de Marx, dont les Volumes II et III cités par ceux qui dressent un mur entre Marx et Engels. Pense-t-on que cela aurait été possible si Engels avait été réellement été porteur des incompréhensions qui lui sont prêtées ?
L'un des tenants principaux de la ligne de pensée "anti-Engels" est le groupe Aufheben en Grande Bretagne, dont la série "Décadence : Théorie du déclin ou déclin de la théorie" 2, semble considérée par certains comme ayant porté le coup fatal à la notion moribonde de décadence du capitalisme, vu le nombre de fois où cette série est citée par tous ceux qui sont hostiles à cette notion. A son point de vue, la décadence du capitalisme est fondamentalement une invention de la Deuxième Internationale : "La théorie de la décadence du capitalisme est apparue pour la première fois dans la Deuxième Internationale. Le programme d'Erfurt soutenu par Engels établissait que la théorie du déclin et de l'effondrement du capitalisme était un point central du programme du parti" (Aufheben n°2, traduit par nous). Et ils citent les passages suivants :
"Ainsi la propriété privée des moyens de production change sa nature originelle en son contraire. (...) Jadis ce mode de propriété accélérait la marche de l'évolution sociale. La propriété privée est aujourd'hui la cause de la corruption, de la banqueroute de la société. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si l’on veut ou non maintenir la propriété privée des moyens de production. Sa disparition est certaine. La question qui se pose est la suivante : la propriété privée des moyens de production doit-elle entraîner dans sa chute la société tout entière ; la société doit-elle, au contraire, se débarrasser du fardeau néfaste qui l'écrase, pour, devenue libre et en possession de nouvelles forces, continuer à suivre la voie que lui prescrivent les lois de l'évolution ? (p.110-111) Les forces productives qui se sont développées au sein de la société capitaliste ne sont plus compatibles avec le mode de propriété qui forme sa base. Vouloir maintenir cette forme de propriété, c'est rendre à l'avenir son progrès social impossible, c'est condamner la société à la stagnation et au déclin (...) (p.112) La société capitaliste est parvenue au terme de son chemin. Sa dissolution n'est plus qu'une affaire de temps. L'irrésistible évolution économique conduit nécessairement à la banqueroute du mode de production capitaliste. La constitution d'une nouvelle société, destinée à remplacer celle qui existe, n'est plus seulement souhaitable, elle est devenue inévitable. (p.141) En l'état actuel des choses, la civilisation capitaliste ne peut se maintenir. Il nous faut soit aller vers lesocialisme, soit retomber dans la barbarie. (p.142)"
Dans le résumé qui présente l'article suivant de la série, dans Aufheben n°3, l'argument selon lequel le concept de décadence trouve ses racines dans "le marxisme de la Deuxième Internationale" est encore plus explicite :
"Dans la première partie, nous avons examiné comment cette notion de déclin ou de décadence du capitalisme a ses racines dans le marxisme de la Deuxième Internationale et a été maintenue par deux courants qui se réclament être les vrais continuateurs de la "tradition marxiste classique" – le trostkysme-léninisme et le communisme de gauche ou de conseils." (notre traduction)
Bien que la citation qu'Aufheben présente comme faisant partie du Programme d'Erfurt, semble provenir plutôt des commentaires de Kautsky sur le Programme (Le programme socialiste 1892 3), le préambule au Programme contient effectivement une référence à la notion de déclin du capitalisme et affirme même que cette période est déjà ouverte :
"L'abîme qui sépare les possédants et les non-possédants est encore élargi par les crises qui ont leur principe dans l'essence du mode de production capitaliste, crises qui deviennent toujours plus étendues et plus dévastatrices, qui font de l'insécurité générale l'état normal de la société et fournissent la preuve que les forces productives de la société actuelle ont trop grandi pour cette société, que la propriété privée des moyens de production est devenue inconciliable avec un sage emploi et avec le plein développement de ces moyens de production." 4
En réalité, et bien que du point de vue d'Aufheben, le Programme d'Erfurt soit très dépendant de la théorie de la décadence, une lecture rapide de celui-ci donne plutôt l'impression qu'il n'y a aucun lien entre l'évaluation globale du système mentionnée plus haut et les revendications mises en avant dans le Programme, qui sont toutes des revendications minimales pour lesquelles il faut se battre au sein de la société capitaliste ; et même les nombreuses critiques détaillées portées par Engels et d'autres marxistes à ces revendications ne font quasiment aucune référence au contexte historique dans lequel celles-ci sont posées. 5
Ceci dit, il est vrai que dans les travaux d'Engels et d'autres marxistes de la fin du 19e siècle, on trouve de plus en plus de références à la notion d'entrée du capitalisme dans une crise de sénilité, une période de déclin.
Mais alors que pour Aufheben, cette notion s'éloignerait de Marx – qui, affirment-ils, a seulement dit que le capitalisme était un système "transitoire" et n'a jamais mis en avant l'idée d'un processus objectif de déclin ou d'effondrement du capitalisme comme fondement pour les luttes révolutionnaires du prolétariat contre le système – nous avons pour notre part cherché à montrer dans les précédents articles de cette série que le concept de décadence du capitalisme (comme des précédentes sociétés de classes) faisait partie intégrante de la pensée de Marx.
Il est vrai aussi que les écrits de Marx sur l'économie politique ont été produits au cours de la phase encore ascendante d'un capitalisme triomphant. Ses crises périodiques étaient des crises de jeunesse qui permettaient de propulser la marche impériale de ce mode de production dynamique sur toute la surface du globe. Mais Marx avait également vu, dans ces convulsions, les signes avant-coureurs de la chute finale du système et déjà commencé à entrevoir des manifestations de l'achèvement de la mission historique du capitalisme avec la conquête des régions les plus reculées de la planète, tandis que, dans le sillage des événements de la Commune de Paris, il affirmait que la phase des héroïques guerres nationales avait touché à sa fin dans "la vieille Europe".
De plus, au cours de la période qui a suivi la mort de Marx, les signes avant-coureurs d'une crise aux proportions historiques et pas seulement une répétition des anciennes crises cycliques, se manifestaient de plus en plus clairement.
Ainsi, par exemple, Engels a réfléchi sur la signification de la fin apparente du "cycle décennal" de crises et sur le début de ce qu'il appela une dépression chronique affectant la première nation capitaliste, la Grande-Bretagne. Et tandis que de nouvelles puissances capitalistes se frayaient leur chemin sur le marché mondial, l'Allemagne et les Etats-Unis avant tout, Engels vit que cela aboutirait inévitablement à une crise de surproduction encore plus profonde :
"L'Amérique va casser le monopole industriel de l'Angleterre – ou ce qui en reste – mais l'Amérique ne peut succéder à ce monopole. Et à moins qu'un pays ait le monopole des marchés mondiaux, au moins dans les branches décisives du commerce, les conditions – relativement favorables – qui existaient ici en Angleterre de 1848 à 1870 ne peuvent se reproduire nulle part, et même en Amérique, la condition de la classe ouvrière doit sombrer de plus en plus. Car s'il y a trois pays (disons l'Angleterre, l'Amérique et l'Allemagne) qui sont en concurrence sur un pied d'égalité pour la possession du Weltmarkt (marché mondial, en allemand dans le texte), il n'y a pas d'autre possibilité qu'une surproduction chronique, chacun des trois étant capable de produire la totalité de ce qui est requis." (Engels à Florence Kelley Wischnewetsky, 3 février 1886, traduit de l'anglais par nous)
En même temps, Engels voyait la tendance du capitalisme à engendrer sa propre ruine avec la conquête accélérée des régions non capitalistes qui entouraient les métropoles capitalistes :
"Car c'est l'un des corollaires nécessaires de la grande industrie qu'elle détruise son propre marché interne par le processus même par lequel elle le crée. Elle le crée en détruisant la base de l'industrie intérieure de la paysannerie. Mais sans industrie intérieure, les paysans ne peuvent vivre. Ils sont ruinés en tant que paysans ; leur pouvoir d'achat est réduit au minimum : et jusqu'à ce qu'en tant que prolétaires, ils se soient installés dans de nouvelles conditions d'existence, ils ne fourniront qu'un très pauvre marché aux nouvelles usines créées.
La production capitaliste étant une phase économique transitoire est pleine de contradictions internes qui se développent et deviennent évidentes en proportion de son développement. Cette tendance à détruire son propre marché interne en même temps qu'elle le crée, est l'une de ces contradictions. Une autre est la situation insoluble à laquelle cela mène et qui se développe plus vite dans un pays qui n'a pas de marché extérieur, comme la Russie, que dans les pays qui sont plus ou moins aptes à entrer en concurrence sur le marché mondial ouvert. Cette situation sans issue apparente trouve une sortie, pour ces derniers pays, dans des convulsions commerciales, dans l'ouverture violente de nouveaux marchés. Mais même alors, le cul de sac vous éclate à la figure. Regardez l'Angleterre. Le dernier nouveau marché qui pourrait apporter un renouveau de prospérité temporaire en s'ouvrant au commerce anglais est la Chine. Aussi le capital anglais insiste pour construire des chemins de fer chinois. Mais des chemins de fer en Chine signifient la destruction de la base de toute la petite agriculture chinoise et de l'industrie intérieure, et comme il n'existera même pas le contrepoids de la grande industrie chinoise, des centaines de millions de gens se trouveront dans l'impossibilité de vivre. La conséquence en sera une émigration énorme telle que le monde n'en a pas encore connue, l'Amérique, l'Asie, l'Europe submergées par les chinois qui sont haïs, une concurrence pour le travail avec les ouvriers d'Amérique, d'Australie et d'Europe sur la base du niveau de vie chinois, le plus bas de tous – et si le système de production n'a pas changé en Europe d'ici là, il devra alors changer.
La production capitaliste travaille à sa propre ruine et vous pouvez être sûr qu'elle le fera aussi en Russie." (Lettre à Nikolai Danielson, 22 septembre 1892, traduite de l'anglais par nous)
La croissance du militarisme et de l'impérialisme, visant avant tout à achever la conquête des aires non capitalistes de la planète, ont également permis à Engels de voir avec une extrême lucidité les dangers que cette évolution ferait courir en retour au centre du système – en Europe, menaçant d'entraîner la civilisation dans la barbarie tout en accélérant en même temps la maturation de la révolution.
"Aucune guerre n'est plus possible pour l'Allemagne prussienne sauf une guerre mondiale et une guerre mondiale d'une étendue et d'une violence inimaginables jusqu'ici. Huit à dix millions de soldats se massacreront et ce faisant dévoreront toute l'Europe jusqu'à la laisser plus anéantie qu'aucun nuage de sauterelles ne l'a jamais fait. La dévastation de la Guerre de Trente ans condensée en trois, quatre années et répandue sur le continent tout entier : la famine, les fléaux, la chute généralisée dans la barbarie, celle des armées comme celle des masses des populations ; une confusion sans espoir de notre système artificiel de commerce, d'industrie et de crédit aboutissant dans la banqueroute générale, l'effondrement des anciens Etats et de leur sagesse traditionnelle d'élite à un point tel que les couronnes vont tomber par douzaines et il n'y aura personne pour les ramasser ; l'impossibilité absolue de prévoir comment cela finira et qui sortira vainqueur ; un seul résultat est absolument certain : l'épuisement général et la création des conditions pour la victoire finale de la classe ouvrière." (15 décembre 1887, traduit de l'anglais par nous)
Au demeurant cependant, Engels ne voyait pas cette guerre comme un facteur de rapprochement inévitable de la perspective socialiste : il avait peur avec raison que le prolétariat ne soit aussi affecté par l'épuisement général et que cela le rende incapable d'accomplir sa révolution (d'où, pourrait-on ajouter, une certaine attraction pour des schémas quelque peu utopiques qui pourraient retarder la guerre, comme le remplacement des armées permanentes pas des milices populaires). Mais Engels avait des raisons d'espérer que la révolution éclaterait avant une guerre pan-européenne. Une lettre à Bebel (24-26 octobre 1891) exprime ce point de vue "optimiste" :
"... Selon les rapports, vous avez dit que j'avais prévu l'effondrement de la société bourgeoise en 1898. Il y a une légère erreur quelque part. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous pourrions peut-être prendre le pouvoir d'ici 1898. Si cela n'arrive pas, la vieille société bourgeoise pourrait encore végéter un moment, pourvu qu'une poussée de l'extérieur ne fasse pas s'effondrer toute la vieille bâtisse pourrie. Un vieil emballage moisi comme ça peut survivre à sa mort intérieure fondamentale encore quelques décennies si l'atmosphère n'est pas troublée." (traduit de l'anglais par nous)
Dans ce passage, on trouve à la fois les illusions du mouvement de l'époque et sa force théorique sous-jacente. Les acquis durables du parti social-démocrate, surtout dans le domaine électoral et en Allemagne, donnèrent naissance à des espoirs excessifs sur la possibilité d'une progression inexorable vers la révolution (et la révolution elle-même allait jusqu'à être considérée en termes semi-parlementaires, malgré les mises en garde répétées contre le crétinisme parlementaire qui constituait un aspect central du bourgeonnement rapide de l'idéologie réformiste). En même temps, les conséquences de l'incapacité du prolétariat à prendre le pouvoir sont clairement établies : la survie du capitalisme pendant plusieurs décennies comme un "vieil emballage moisi" – bien qu'Engels comme la plupart des révolutionnaires de l'époque n'avait sûrement jamais imaginé que le système pourrait survivre dans sa phase de déclin encore un siècle ou plus. Mais le soubassement théorique permettant d'anticiper une telle situation est clairement établi dans ce passage.
Luxemburg mène la bataille contre le révisionnisme.
Pourtant, précisément parce que l'expansion impérialiste des dernières décennies du 19e siècle a permis au capitalisme de connaître des taux de croissance énormes, on se rappelle cette période comme celle d'une prospérité et d'un progrès sans précédent, d'une augmentation constante du niveau de vie de la classe ouvrière, non seulement grâce aux conditions objectives favorables mais aussi du fait de l'influence croissante du mouvement ouvrier organisé en syndicats et dans les partis sociaux-démocrates. C'était le cas, en particulier, en Allemagne et c'est dans ce pays que le mouvement ouvrier fut confronté à un défi majeur : la montée du révisionnisme.
Précédés par les écrits d'Edouard Bernstein à la fin des années 1890, les révisionnistes défendaient que la social-démocratie devait reconnaître que l'évolution du capitalisme avait invalidé certains éléments fondamentaux de l'analyse de Marx – surtout la prévision de crises toujours plus grandes et l'appauvrissement du prolétariat qui devait s'ensuivre. Le capitalisme avait montré qu'en utilisant le mécanisme du crédit et en s'organisant en trusts et en cartels gigantesques, il pouvait surmonter sa tendance à l'anarchie et à la crise et, sous l'impulsion d'un mouvement ouvrier bien organisé, faire des concessions de plus en plus grandes à la classe ouvrière. Le but "ultime", la révolution, incarné dans le programme du parti social-démocrate, devenait donc superflu et le parti devait se reconnaître pour ce qu'il était vraiment : un parti social-démocrate réformiste, avançant vers une transformation graduelle et pacifique, la transformation du capitalisme en socialisme.
Un certain nombre de figures de la gauche de la social-démocratie répliquèrent à ces arguments. En Russie, Lénine polémiqua contre les économistes qui voulaient réduire le mouvement ouvrier à une question de pain ; en Hollande, Gorter et Pannekoek menèrent la polémique contre l'influence croissante du réformisme dans les domaines syndical et parlementaire. Aux Etats-Unis, Louis Boudin rédigea un livre important, The Theoretical System of Karl Marx (1907), en réponse aux arguments des révisionnistes – nous y reviendrons plus loin. Mais c'est surtout Rosa Luxemburg en Allemagne qui est associée à la lutte contre le révisionnisme dont le cœur était la réaffirmation de la notion marxiste de déclin et d'effondrement catastrophique du capitalisme.
Quand on lit la polémique de Luxemburg contre Bernstein, Réforme sociale ou Révolution, on est frappé du point auquel les arguments mis en avant par ce dernier ont été répétés depuis, quasiment à chaque fois que le capitalisme a donné l'impression –quoique superficielle – de surmonter ses crises.
"D’après Bernstein, un effondrement total du capitalisme est de plus en plus improbable parce que, d’une part, le système capitaliste fait preuve d’une capacité d’adaptation de plus en plus grande et que, d’autre part, la production est de plus en plus différenciée. D’après Bernstein, la capacité d’adaptation du capitalisme se manifeste dans le fait qu’il n’y a plus de crise générale ; ceci, on le doit au développement du crédit, des organisations patronales, des communications, et des services d’information ; dans la survie tenace des classes moyennes, résultat de la différenciation croissante des branches de la production et de l’élévation de larges couches du prolétariat au niveau des classes moyennes ; enfin, dans l’amélioration de la situation économique et politique du prolétariat, grâce à l’action syndicale." (chapitre 1, "La méthode opportuniste") 6
Combien de fois en effet n'avons pas entendu que les crises appartiennent au passé et cela, pas seulement de la part des idéologues officiels de la bourgeoisie mais aussi de ceux qui proclament défendre une idéologie bien plus radicale, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme est organisé à l'échelle nationale ou même internationale, parce qu'il a la possibilité infinie de recourir au crédit et à d'autres manipulations financières ; combien de fois nous a-t-on dit que la classe ouvrière avait cessé d'être une force révolutionnaire parce qu'elle n'était plus dans la misère absolue que décrit Engels dans son livre sur les conditions de la classe ouvrière à Manchester en 1844, ou parce qu'elle se distinguerait de moins en moins des classes moyennes ? C'était notamment le grand refrain des sociologues des années 1950 et 1960, auquel les adeptes de Marcuse et de Castoriadis ont apporté un vernis radical ; et on a ressorti la rengaine du placard une nouvelle fois dans les années 1990, après l'effondrement du bloc de l'Est et avec le boom financé par le crédit dont le vernis factice ne s'est révélé que très récemment.
Contre ces arguments, Luxemburg a souligné que l' "organisation" du capital en cartels et au moyen du crédit était une réponse aux contradictions du système et tendait à exacerber ces contradictions à un degré supérieur et plus dévastateur.
Luxemburg considérait le crédit essentiellement comme un moyen de faciliter l'extension du marché tout en concentrant le capital dans un nombre de mains de plus en plus limité. A ce moment de l'histoire, c'était certainement le cas – il existait une véritable possibilité pour le capitalisme de s'étendre et le crédit accélérait cette expansion. Mais, en même temps, Rosa Luxemburg saisissait l'aspect destructeur du crédit du fait que cette expansion du marché constituait aussi la prémisse du futur conflit avec la masse des forces productives mises en mouvement :
"Ainsi le crédit, loin de contribuer à abolir ou même à atténuer les crises, en est au contraire un agent puissant. Il ne peut d’ailleurs en être autrement. La fonction spécifique du crédit consiste - très généralement parlant - à corriger tout ce que le système capitaliste peut avoir de rigidité en y introduisant toute l’élasticité possible, à rendre toutes les forces capitalistes extensibles, relatives et sensibles. Il ne fait évidemment ainsi que faciliter et qu’exaspérer les crises, celles-ci étant définies comme le heurt périodique entre les forces contradictoires de l’économie capitaliste." (chapitre 2, "L'adaptation du capitalisme", ibid.)
Le crédit n'était pas encore ce qu'il est en grande partie devenu aujourd'hui – pas tant un moyen d'accélérer l'expansion du marché réel, mais un marché artificiel en lui-même, dont le capitalisme est de plus en plus dépendant. Mais sa fonction comme remède qui aggrave le mal est devenue ainsi plus évidente à notre époque, et avant tout depuis ce qui est appelé le "credit crunch" en 2008.
De même, Luxemburg considérait la tendance du capitalisme et des capitalistes à s'organiser au niveau national et même international non comme une solution aux antagonismes du système mais comme une force potentielle qui les exacerbe à un niveau supérieur et plus destructeur :
" (...) ils aggravent la contradiction entre le caractère international de l’économie capitaliste mondiale et le caractère national de l’Etat capitaliste, parce qu’ils s’accompagnent toujours d’une guerre douanière générale ; ils exaspèrent ainsi les antagonismes entre les différents Etats capitalistes. À cela il faut ajouter l’influence révolutionnaire exercée par les cartels sur la concentration de la production, son perfectionnement technique, etc.
Ainsi, quant à l’action exercée sur l’économie capitaliste, les cartels et les trusts n’apparaissent pas comme un "facteur d’adaptation" propre à en atténuer les contradictions, mais bien plutôt comme l’un des moyens qu’elle invente elle-même pour aggraver sa propre anarchie, développer ses contradictions internes, accélérer sa propre ruine." (idem)
Ces prévisions, surtout quand l'organisation du capital est passée de la phase des cartels à celle des "trusts d'Etat national" qui s'affrontaient pour le contrôle du marché mondial en 1914 –allaient se trouver pleinement validées au cours du 20e siècle.
Luxemburg répondit aussi aux arguments de Bernstein selon lesquels le prolétariat n'avait pas besoin de faire la révolution puisqu'il jouissait d'une augmentation de son niveau de vie grâce à son organisation efficace en syndicats et à l'activité de ses représentants au parlement. Elle montrait que les activités syndicales comportaient des limites internes, les décrivant comme un "travail de Sisyphe", nécessaire mais constamment limité dans ses efforts d'accroître la part des ouvriers dans les produits de leur travail du fait de l'accroissement inévitable du taux d'exploitation apporté par le développement de la productivité. L'évolution ultérieure du syndicalisme dans la vie du capitalisme allait mettre encore mieux en évidence ses limites historiques, mais même à une époque où l'activité syndicale (ainsi que dans les domaines d'action parallèles du parlement et des coopératives) avait encore une validité pour la classe ouvrière, les révisionnistes altéraient déjà la réalité en défendant l'idée que ces activités pouvaient assurer à la classe ouvrière une amélioration constante et infinie de ses conditions de vie.
Et alors que Bernstein voyait une tendance à l'atténuation des rapports de classe à travers la prolifération d'entreprises à petite échelle et donc la croissance de la classe moyenne, Luxemburg affirmait l'existence de la tendance qui allait devenir prédominante dans le siècle suivant : l'évolution du capitalisme vers des formes de concentration et de centralisation gigantesques, tant au niveau des entreprises "privées" que de l'Etat et des alliances impérialistes. D'autres membres de la gauche révolutionnaire comme Boudin répondaient à l'idée selon laquelle la classe ouvrière allait devenir une classe moyenne en défendant que beaucoup de "cols blancs" et de techniciens qui étaient supposés engloutir le prolétariat étaient eux-mêmes, en réalité, un produit du processus de prolétarisation – là encore une tendance qui allait être très marquées au cours des dernières décennies. Les paroles de Boudin en 1907 retentissent de façon très moderne de même que les arguments spécieux qu'elles combattent :
"Une très grande proportion de ce qu'on appelle la nouvelle classe moyenne et qui apparaît comme telle dans les statistiques sur les revenus, constitue en réalité une partie du prolétariat ordinaire, et la nouvelle classe moyenne, quelle qu'elle soit, est bien plus petite que ce qui apparaît dans les tableaux des revenus. Cette confusion provient, d'une part, du vieux préjugé profondément ancré selon lequel Marx aurait attribué uniquement au travail manuel la propriété de créer de la valeur et, d'autre part, de la séparation de la fonction de gérant d'avec celle de propriétaire – effectuée par les corporations, comme on l'a noté auparavant. Dans ces circonstances, de larges parties du prolétariat sont comptées comme faisant partie de la classe moyenne, c'est-à-dire la couche inférieure de la classe capitaliste. C'est le cas pour ces activités, nombreuses et croissantes, dont la rémunération est appelée "salary" au lieu de "wage". Toutes ces personnes salariées, quel que soit leur salaire, qui constituent la majeure partie, et certainement une grande portion, de la "nouvelle" classe moyenne, font tout autant partie du prolétariat que le simple ouvrier journalier." (The Theoretical System of Karl Marx, 1907, traduit de l'anglais par nous)
En route vers la débâcle de la civilisation bourgeoise
La crise économique ouverte d'aujourd'hui a lieu dans un stade très avancé du déclin du capitalisme. Luxemburg répondait à Bernstein dans une période qu'elle caractérisait, avec une remarquable lucidité une fois encore, comme une période qui n'était pas encore celle du déclin mais dont l'approche devenait de plus en plus évidente. Ce passage est écrit en réponse à la question empirique (et empiriste) de Bernstein : pourquoi n'avons-nous pas assisté à l'ancien cycle décennal depuis le début des années 1870 ? Luxemburg insiste dans sa réponse sur le fait que ce cycle est en réalité l'expression de la phase de jeunesse du capitalisme ; maintenant le marché mondial se trouvait dans une "période de transition" entre sa période de croissance maximum et l'ouverture d'une époque de déclin :
"Le marché mondial se développe toujours. L'Allemagne et l'Autriche ne sont entrées dans la phase de véritable production industrielle à grande échelle que dans les années 1870 ; la Russie seulement dans les années 1880 ; la France est encore en grande partie à un stade de petite production ; les Etats balkaniques, pour la plus grande partie, ne se sont pas encore débarrassés des chaînes de l'économie naturelle ; et ce n'est que dans les années 1880 que l'Amérique, l'Australie et l'Afrique sont entrés dans un commerce étendu et régulier de biens avec l'Europe. Aussi, d'une part, nous avons maintenant derrière nous une ouverture soudaine et vaste de nouvelles aires d'économie capitaliste comme c'est arrivé périodiquement jusqu'aux années 1870 ; et nous avons derrière nous, pour ainsi dire, des crises de jeunesse qui ont suivi ces développements périodiques. D'autre part, nous ne sommes pas encore arrivés au degré de développement et d'épuisement du marché mondial qui produira la collision périodique, fatale entre les forces productives et les limites du marché, qui constitue la véritable crise de vieillesse du capitalisme. Nous sommes dans une phase où les crises n'accompagnent plus la montée du capitalisme et pas encore son déclin." (chapitre 2, traduit de l'anglais par nous)
Il est intéressant de noter que dans la deuxième édition de sa brochure, publiée en 1908, Luxemburg a omis ce passage et le paragraphe suivant, et mentionne la crise de 1907-1908, qui avait précisément pour centre les nations industrielles les plus puissantes : évidemment, pour Luxemburg, "la période de transition" touchait déjà à sa fin.
De plus elle fait aussi allusion au fait que l'attente précédente d'une nouvelle période qui s'ouvrirait pas "une grande crise commerciale" pourrait s'avérer une erreur – déjà dans Réforme sociale ou Révolution, elle souligne la croissance du militarisme, une évolution qui allait la préoccuper de plus en plus. C'est sûrement la possibilité que l'ouverture de la nouvelle période soit marquée par la guerre et non par une crise économique ouverte qui se trouve probablement derrière l'observation suivante :
"Dans la thèse socialiste affirmant que le point de départ de la révolution socialiste serait une crise générale et catastrophique, il faut à notre avis distinguer deux choses : l’idée fondamentale qu’elle contient et sa forme extérieure.
L’idée est celle-ci : on suppose que le régime capitaliste fera naître de lui-même, à partir de ses propres contradictions internes, le moment où son équilibre sera rompu et où il deviendra proprement impossible. Que l’on ait imaginé ce moment sous la forme d’une crise commerciale générale et catastrophique, on avait de bonnes raisons de le faire, mais c’est finalement un détail accessoire pour l’idée fondamentale elle-même." (Ch.1)
Mais quelle que soit la forme prise par "la crise de sénilité" du capitalisme, Rosa Luxemburg insistait sur le fait que sans cette vision de la chute catastrophique du capitalisme, le socialisme devenait une simple utopie :
"Pour le socialisme scientifique la nécessité historique de la révolution socialiste est surtout démontrée par l’anarchie croissante du système capitaliste qui enferme celui-ci dans une impasse. Mais si l’on admet l’hypothèse de Bernstein : l’évolution du capitalisme ne s’oriente pas dans le sens de l’effondrement - alors le socialisme cesse d’être une nécessité objective. (...) La théorie révisionniste est confrontée à une alternative : ou bien la transformation socialiste de la société est la conséquence, comme auparavant, des contradictions internes du système capitaliste, et alors l’évolution du système inclut aussi le développement de ses contradictions, aboutissant nécessairement un jour ou l’autre à un effondrement sous une forme ou sous une autre ; en ce cas, même les "facteurs d’adaptation" sont inefficaces, et la théorie de la catastrophe est juste. Ou bien les " facteurs d’adaptation " sont capables de prévenir réellement l’effondrement du système capitaliste et d’en assurer la survie, donc d’abolir ces contradictions, en ce cas, le socialisme cesse d’être une nécessité historique ; il est alors tout ce que l’on veut sauf le résultat du développement matériel de la société. Ce dilemme en engendre un autre : ou bien le révisionnisme a raison quant au sens de l’évolution du capitalisme - en ce cas la transformation socialiste de la société est une utopie ; ou bien le socialisme n’est pas une utopie, et en ce cas la théorie des " facteurs d’adaptation" ne tient pas. That is the question : c’est là toute la question." (idem)
Dans ce passage, Luxemburg fait ressortir avec totale clarté le rapport intime entre le point de vue révisionniste et le rejet de la vision marxiste du déclin du capitalisme et, inversement, la nécessité de cette théorie comme pierre de touche d'une conception cohérente de la révolution.
Dans le prochain article de cette série nous examinerons comment Luxemburg et d'autres ont cherché à situer les origines de la crise qui s'approchait dans le processus sous-jacent de l'accumulation capitaliste.
Gerrard
1 Voir par exemple l'article : "1895-1905 : la perspective révolutionnaire obscurcie par les illusions parlementaires [71]", Revue internationale n°88
2 Aufheben n° 2 et 3 https://libcom.org/article/aufheben [72]
3 Edition française Les bons caractères, 2004.
4 https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [73]
5 https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/00/18910000.htm [74]
6 https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1898/r_ou_r1_1.html [75]
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Rubrique:
La surproduction chronique, une entrave incontournable à l’accumulation capitaliste (débat interne au CCI (V))
- 5444 lectures
La dette mondiale atteint des sommets faramineux ne permettant plus comme avant de "relancer l’économie", au moyen d’un nouvel accroissement de l'endettement, sans mettre à mal la crédibilité financière des Etats et la valeur des monnaies. Face à cette situation, il est de la responsabilité des révolutionnaires d'analyser en profondeur les moyens par lesquels le capitalisme est parvenu jusqu'à présent à prolonger artificiellement la vie de son système à travers tout un ensemble de "tricheries" vis-à-vis de ses propres lois. C'est la seule méthode fournissant la clé d'une évaluation pertinente de l'impasse à laquelle se trouve actuellement confrontée la bourgeoisie mondiale.
L'étude de la période dite des Trente Glorieuses, tant louée et regrettée par la bourgeoisie, ne doit pas faire exception à cette attention de la part des révolutionnaires à qui il revient, bien sûr, de prendre en charge la nécessaire réfutation des interprétations qu’en donnent les défenseurs du capitalisme, en particulier lorsqu’ils veulent nous convaincre qu’il peut être réformé 1, mais également de participer à la confrontation fraternelle des différentes points de vue existant sur ce sujet au sein du camp prolétarien. C'est l'objet du débat que notre organisation a ouvert il y a maintenant bientôt deux ans dans les colonnes de la Revue internationale 2.
La vision développée par notre brochure La décadence du capitalisme selon laquelle les destructions opérées durant la Seconde Guerre mondiale auraient été, à travers le marché de la reconstruction, à l'origine du boom des années 1950 et 1960, a fait l’objet d'une critique dans le CCI, notamment de la part de la thèse que nous défendons dite des marchés extra-capitalistes et de l'endettement. Comme son nom l'indique, cette thèse considère que c'est la vente aux marchés extra-capitalistes et la vente à crédit qui ont été, durant les années 1950 et 1960, le moteur de l'accumulation capitaliste et non pas les mesures keynésiennes, comme le soutien une autre thèse dite du keynésiano-fordisme 3. Dans la Revue internationale n° 138 est parue une contribution signée Salome et Ferdinand défendant ce dernier point de vue et qui, en avançant un ensemble d'arguments non encore discutés publiquement, est venue ainsi relancer le débat. Tout en répondant aux arguments de ces deux camarades, cet article se fixe les objectifs suivants : rappeler les fondements de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement ; présenter des éléments statistiques qui, selon nous, illustrent sa validité ; examiner ses implications sur le cadre global d’analyse du CCI de la période de décadence du capitalisme 4.
Les principaux arguments théoriques en présence
L'analyse défendue dans la Décadence du capitalisme prêtait une certaine rationalité économique à la guerre (la guerre vue comme ayant des retombées économiques positives). En ce sens, elle était contradictoire avec de textes plus anciens de notre organisation qui mettaient quant à eux en évidence que "toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales (…), contrairement à celles du siècle dernier, (…) n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués)." 5
L’erreur de notre brochure résulte, selon nous, d’une application hâtive et erronée du passage suivant du Manifeste communiste : "Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens." En effet, le sens de ces lignes n'est pas d’attribuer à la destruction des moyens de production la vertu d’ouvrir un nouveau marché solvable à même de relancer la machine économique. En conformité avec l’ensemble des écrits économiques de Marx, il convient d’interpréter les effets de la destruction de capital (ou plutôt de la dévalorisation de celui-ci) comme participant à désengorger le marché et à freiner la tendance à la baisse du taux de profit 6.
La thèse dite du Capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste offre une interprétation de la "prospérité" des années 1950 et 1960 différente à la fois de celle défendue par la Décadence du capitalisme et de celle défendue par la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement : "L’accroissement assuré des profits, des dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels, ont pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l’accumulation capitaliste" 7. Face à cette idée, les deux arguments suivants ont déjà été avancés :
a) Augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation. De plus, s'il est vrai que l’augmentation de la consommation ouvrière (au moyen d'augmentations de salaires) et des dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue, cela a pour conséquence une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital.8
b) Parmi les ventes effectuées par le capitalisme, la partie qui peut être dédiée à l'accumulation du capital, et qui participe ainsi à l'enrichissement réel de celui-ci, correspond aux ventes réalisées dans le commerce avec des marchés extra-capitalistes (intérieurs ou externes). C'est effectivement le seul moyen permettant au capitalisme de ne pas se trouver dans cette situation décrite par Marx où "des capitalistes s'échangent entre eux et consomment leur production", ce qui "ne permet en rien une valorisation du capital" 9.
Dans leur article de la Revue internationale n° 138, les camarades Salome et Ferdinand reviennent sur le sujet. A cette occasion, ils précisent, de façon tout à fait appropriée à notre avis, ce qu'ils considèrent être le cadre de ce débat : "Il peut être répondu (…) qu'un tel accroissement du marché est insuffisant pour réaliser toute la partie de la plus-value nécessaire à l'accumulation. Cela est vrai d'un point de vue général et à long terme. Nous, défenseurs de la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste, ne pensons pas avoir trouvé une solution aux contradictions inhérentes du capitalisme, une solution qui puisse se répéter à volonté."
Ils illustrent au moyen d’un schéma (basé sur ceux que Marx utilise dans le second volume du Capital, pour présenter le problème de la reproduction élargie) comment l’accumulation peut se poursuivre malgré le fait qu’une partie de la plus-value soit délibérément reversée aux ouvriers sous forme d'augmentations de salaire. De leur point de vue, la même logique sous-jacente explique également le caractère non indispensable d'un marché extra-capitaliste au développement du capitalisme : "Si les conditions sont celles que les schémas présupposent et si nous en acceptons les conséquences (conditions et conséquences qui peuvent être analysées séparément), par exemple un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser de telle sorte que l'accumulation fonctionne selon le schéma ."
Pour les camarades, le bilan pour le capitalisme de cette redistribution de plus-value, bien qu’elle ralentisse l'accumulation, est néanmoins positif, en permettant un élargissement du marché intérieur : "Si ce profit est suffisamment élevé, les capitalistes peuvent augmenter les salaires sans perdre tout l'accroissement de la plus-value extraite" (…) "Une augmentation générale des salaires signifie également un accroissement de ces marchés" (…) "Le seul effet "nuisible" de ce "gaspillage de plus-value" réside dans le fait que l'augmentation de la composition organique du capital est plus lente que le rythme frénétique qu'elle aurait sinon".
Nous sommes d’accord avec le constat que font les camarades concernant les effets de ce "gaspillage de plus-value". Mais, à propos de celui-ci, ils disent également : "on ne peut pas affirmer que ce "gaspillage de plus-value" ne prenne en aucune manière part au processus d'accumulation. Au contraire, cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité participe pleinement de l'accumulation". Il est clair, comme les camarades le reconnaissent eux-mêmes, que le gaspillage en question ne participe pas au processus de l’accumulation à travers l’injection de capital dans le procès de production. En effet, il détourne, de sa finalité capitaliste que représente l’accumulation, du capital pouvant être accumulé. Qu’il ait une utilité momentanée pour la bourgeoisie, sans aucun doute, puisqu’il permet de maintenir artificiellement, voire d’augmenter, un certain niveau d’activité économique. Il diffère ainsi dans le temps les problèmes d’insuffisance de débouchés pour la production capitaliste. C’est bien là le propre des mesures keynésiennes mais, encore une fois, cela n’est pas participer au processus d’accumulation. C’est participer au processus productif dans les conditions de la décadence du capitalisme où ce système, de plus en plus entravé dans son fonctionnement "normal", doit multiplier les dépenses improductives pour maintenir l'activité économique. En effet, ce gaspillage s’ajoute à celui déjà énorme constitué par les dépenses militaires ou d’encadrement de la société, etc. Motivé par la nécessité de créer un marché intérieur artificiel, il est une dépense tout aussi irrationnelle et improductive que ces dépenses là.
Si les mesures keynésiennes ont favorisé la croissance très importante des PIB (Produits Intérieurs Bruts) des principaux pays industrialisés dans les années 1950-60, donnant ainsi l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme, la richesse réellement créée durant cette période s’est accrue à un rythme nécessairement beaucoup plus modeste puisqu’une partie significative de l’accroissement du PIB était faite de dépenses improductives 10.
Pour en terminer avec cette partie, nous examinerons une autre implication du raisonnement des camarades qui permettrait que, "À ce niveau, il n'y a aucune nécessité de marchés extra-capitalistes". Contrairement à ce que les camarades annoncent, nous n'avons pas trouvé le moindre argument nouveau qui mette en question la nécessité d’un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes. Le schéma qu’ils proposent met effectivement en évidence que "un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser" de telle sorte que soit réalisé l’élargissement de la production (par l’augmentation tant des moyens de production que celle des moyens de consommation), sans recourir à un acheteur extérieur et en versant aux ouvriers plus que ce qui est nécessaire au coût social de la reproduction de leur force de travail. Très bien, mais ceci ne représente pas l’accumulation élargie telle qu'elle est pratiquée sous le capitalisme. Plus précisément, l’accumulation élargie ne pourrait pas être pratiquée de la sorte sous le capitalisme quel que soit le niveau de contrôle de l’Etat sur la société, et cela qu’un sursalaire soit versé ou non aux ouvriers.
L’explication que donne Rosa Luxemburg de cette impossibilité lorsqu’elle décrit la boucle sans fin des schémas de l’accumulation élargie (élaborés par Marx dans le livre II du Capital) se réfère aux conditions concrètes de la production capitaliste : "D'après le schéma de Marx, le mouvement [de l'accumulation] part de la section I, de la production des moyens de production. Qui a besoin de ces moyens de production accrus ? A cela, le schéma répond : c'est la section II qui en a besoin, pour pouvoir fabriquer plus de moyens de consommation. Mais qui a besoin de ces moyens de consommation accrus ? Le schéma répond : précisément la section I, parce qu'elle occupe maintenant plus d'ouvriers. Nous tournons manifestement dans un cercle. Produire plus de moyens de consommation, pour pouvoir entretenir plus d'ouvriers, et produire plus de moyens de production, pour pouvoir occuper ce surplus d'ouvriers, est du point de vue capitaliste une absurdité" (L'accumulation du Capital ; paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx);
Il est, à ce stade de la réflexion, tout à fait opportun d'examiner une remarque des camarades : "S'il n'y avait pas de crédit et s'il était nécessaire de réaliser en argent toute la production annuelle d’un seul coup sur le marché, alors, oui, il devrait exister un acheteur externe à la production capitaliste. Mais ce n'est pas le cas." Nous sommes d’accord avec les camarades pour dire qu’il n'est pas nécessaire qu'à chaque cycle de la production intervienne un acheteur externe, d’autant plus qu'il existe le crédit. Ceci dit, cela n'élimine pas le problème mais ne fait simplement que l'étaler et le différer dans le temps, en permettant qu'il se pose moins souvent mais à chaque fois de façon plus importante 11. Dés lors qu’un acheteur extérieur est présent au bout, par exemple, de 10 cycles d'accumulation ayant impliqué la coopération des secteurs I et II, et qu'il achète alors autant de moyens de production ou de consommation qu'il en est nécessaire pour rembourser les dettes contractées au cours de ces 10 cycles d'accumulation, alors tout va bien pour le capitalisme. Mais s’il n’y a pas au bout du compte un acheteur extérieur, les dettes accumulées ne peuvent jamais être remboursées ou alors seulement au moyen de nouveaux emprunts. La dette enfle alors inévitablement et démesurément jusqu’à l’éclatement d’une crise qui n'a pour effet que d'impulser un nouvel endettement. C’est exactement ce processus que nous voyons se répéter sous nos yeux, de façon de plus en plus grave, depuis la fin des années 1960.
Redistribuer une partie de la plus-value extraite sous forme d’augmentations de salaire ne revient, en fin de compte, qu'à augmenter le coût de la force de travail. Mais cela n’élimine en rien le problème de "la boucle sans fin" mise en évidence par Rosa Luxemburg. Dans un monde constitué uniquement de capitalistes et d'ouvriers, il n’existe pas de réponse à la question que Marx ne cesse de se poser dans le Capital (Livre II) "mais d'où vient l'argent nécessaire au financement de l’augmentation tant des moyens de production que de consommation" ? Dans un autre passage de L'accumulation du Capital Rosa Luxemburg reprend à con compte cette problématique en l’explicitant très simplement : "Une partie de la plus-value, la classe capitaliste la consomme elle-même sous forme de moyens de consommation et conserve dans sa poche l'argent échangé contre eux. Mais qui lui achète les produits où est incorporée l'autre partie, la partie capitalisée, de la plus-value ? Le schéma répond : en partie les capitalistes eux-mêmes, en fabriquant de nouveaux moyens de production, au moyen de l'élargissement de la production ; en partie de nouveaux ouvriers, qui sont nécessaires pour utiliser ces nouveaux moyens de production. Mais pour pouvoir faire travailler de nouveaux ouvriers avec de nouveaux moyens de production, il faut - du point de vue capitaliste - avoir auparavant un but pour l'élargissement de la production, une nouvelle demande de produits à fabriquer (…) D'où vient l'argent pour la réalisation de la plus-value dans les conditions de l'accumulation, c'est-à-dire de la non consommation, de la capitalisation d'une partie de la plus-value ?" (Paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx) En fait, Marx lui-même fournira une réponse à cette question en désignant les "marchés étrangers" 12.
Faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes résout, selon Rosa Luxemburg, le problème de la possibilité de l’accumulation. Cela résout également cette autre contradiction des schémas de Marx résultant du rythme différent de l'évolution de la composition organique du Capital dans les deux sections (celle des moyens de production et celle des moyens de consommation) 13. Les deux camarades reviennent dans leur texte sur cette contradiction mise en évidence par Rosa Luxemburg : "cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité" (…) "atténue précisément le problème identifié par R. Luxemburg dans le chapitre 25 de L’accumulation du capital, où elle fait valoir fermement qu'avec la tendance vers une composition organique du capital toujours plus grande, un échange entre les deux secteurs principaux de la production capitaliste (production de moyens de production d'une part, de moyens de consommation de l'autre) est impossible à long terme". A ce propos les camarades font le commentaire suivant : "F. Sternberg considère ce point de réflexion de R. Luxemburg comme le plus important de "tous ceux qui ont soigneusement été évités par ceux qui critiquent Rosa Luxemburg" (Fritz Sternberg, El imperialismo ; Siglo XXI editores, p 70)." Sur ce point également nous ne partageons pas la position des camarades ni celle de Sternberg, laquelle ne correspond pas réellement à la manière dont Rosa Luxemburg a posé le problème.
En effet, pour Rosa Luxemburg elle-même, cette "contradiction" se résout dans la société par le placement d' "une portion toujours plus grande de la plus-value accumulable dans la section des moyens de production au lieu de la section des moyens de consommation. Comme les deux sections de la production ne sont que deux branches de la même production sociale totale ou si l'on veut deux succursales appartenant au même "capitaliste total", on ne peut rien objecter à l'hypothèse d'un transfert constant d'une partie de la plus-value accumulée d'une section à l'autre, selon les besoins techniques ; cette hypothèse correspond en fait à la pratique courante du capital. Cependant cette supposition n'est valable que tant que nous envisageons la plus-value capitalisable en termes de valeur." (L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie - souligné par nous). Cette dernière supposition impliquant l'existence "d’acheteurs extérieurs" intervenant régulièrement dans la succession des cycles d'accumulation.
En fait, si une telle "contradiction" présente le risque d'aboutir à l’impossibilité de l’échange entre les deux sections de la production, c’est essentiellement dans le monde abstrait des schémas de la reproduction élargie dés lors qu’on ne fait pas intervenir un "acheteur extérieur". En effet, "le progrès technique doit se traduire, d'après Marx lui-même, par l'accroissement relatif du capital constant par rapport au capital variable ; par conséquent il y a nécessairement une modification constante dans la répartition de la plus-value capitaliste entre c et v". Or "Les capitalistes du schéma ne sont pas en mesure d'effectuer à leur gré cette modification car la capitalisation dépend a priori de la forme matérielle de leur plus-value [Ndlr : moyens de production ou moyens de consommation]. Puisque d'après l'hypothèse de Marx, l'élargissement de la production ne peut se faire qu'avec les moyens de production et de consommation produits dans le monde capitaliste" (Rosa Luxemburg ; L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie).
Nous concevons tout à fait que les camarades n'aient jamais été convaincus par les démonstrations de Rosa Luxemburg quant à la nécessité d'un acheteur extérieur pour permettre l'accumulation capitaliste (ou, à défaut, d’un recours au crédit mais qui sera alors "non remboursable"). Par contre, nous n'avons pas identifié en quoi les objections qu'ils formulent en s'appuyant notamment sur Sternberg, dont nous avons de bonnes raisons de penser qu'il n'avait pas réellement assimilé le fond de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg 14, sont à même de remettre en cause des positions cardinales de cette théorie.
Comme nous l’avons déjà souligné dans des contributions antérieures, le fait que les sursalaires versés aux ouvriers ne servent à augmenter ni le capital constant ni le capital variable est déjà suffisant pour conclure au gaspillage total (du point de vue de la rationalité capitaliste) que représentent ces dépenses. Du point de vue strictement économique, le même effet aurait été produit par l’augmentation des dépenses personnelles des capitalistes. Mais il n’était pas nécessaire, pour parvenir à cette conclusion, de recourir à Rosa Luxemburg 15. Ceci étant dit, si nous avons jugé nécessaire de répondre aux objections faites par ces camarades à la théorie de l'accumulation du capital défendue par Rosa Luxemburg, c'est par ce que nous estimons que le débat sur cette question contribue à donner une assise plus large et profonde à la compréhension non seulement du phénomène des Trente Glorieuses mais également au problème de la surproduction dont on peut difficilement nier qu'il se trouve au cœur des problèmes actuels du capitalisme.
La part des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’accumulation des années 1950 et 1960
Deux facteurs sont à l’origine de l’augmentation des PIB durant cette période :
-
l’augmentation de la richesse réelle de la société à travers le processus d’accumulation du capital ;
-
toute une série de dépenses improductives en augmentation comme conséquence du développement du capitalisme d’Etat et plus particulièrement des politiques keynésiennes alors mises en place.
Nous nous intéressons, dans cette partie, à la manière dont l’accumulation s’est effectuée. C’est l’ouverture et l’exploitation accélérée des marchés extra-capitalistes qui avaient été à l’origine de la phase de très forte expansion du capitalisme débutée au sein de la deuxième moitié du 19e siècle et à laquelle la Guerre de 1914 avait mis un terme. La phase de décadence du capitalisme étant caractérisée globalement par l’insuffisance relative de tels marchés en regard des besoins toujours plus importants d’écoulement des marchandises, doit on en déduire que les marchés extra-capitalistes n’ont plus joué qu’un rôle marginal dans l’accumulation durant cette période de la vie du capitalisme ouverte par la guerre en 1914 ? Si c’est le cas, alors ces marchés ne peuvent pas expliquer, même en partie, l’accumulation réalisée dans les années 1950 et 1960. C’est la réponse que donnent les camarades dans leur contribution : "Pour nous, le mystère des Trente Glorieuses ne peut s’expliquer par des restes de marchés extra-capitalistes, alors que ceux-ci sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". Pour notre part, nous pensons au contraire que les marchés extra-capitalistes ont joué un rôle important dans l’accumulation, en particulier au début des années 1950, lequel a décru ensuite progressivement jusqu’à la fin des années 1960. A mesure qu’ils devenaient insuffisants, c’est l’endettement qui prenait le relais, en jouant le rôle de l’acheteur extérieur au capitalisme, mais évidemment il s’agissait d’un endettement d’une "qualité nouvelle", ayant cette caractéristique de ne plus pouvoir être réduit. En fait, c’est à cette période qu’il faut remonter pour trouver l’origine du phénomène d’explosion de la dette mondiale telle qu’on la connaît aujourd’hui, même si bien évidemment la contribution en valeur des décennies 1950 et 1960 à la dette mondiale actuelle est dérisoire.
Les marchés extra-capitalistes
Statistiquement, c’est en 1953 que culmine la part des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux, évaluée en pourcentage des exportations mondiales (voire figure 1, la courbe des importations des pays coloniaux étant supposée la même que celle des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux). Le taux de 29% alors atteint donne une indication de l’ordre de grandeur de l’importance des exportations en direction des marchés extra-capitalistes des pays coloniaux puisque, à l’époque, les marchés coloniaux sont encore très majoritairement extra-capitalistes. Par la suite, ce pourcentage diminuera pour se situer à 22% des exportations en 1966. Dans la réalité, la décroissance de ce pourcentage, relativement cette fois aux PIB et non plus aux exportations, est plus rapide encore puisque, durant cette période, les PIB augmentent plus rapidement que les exportations.
Figure 1. Importations des marchés coloniaux en pourcentage des importations mondiales (Schéma repris de BNP Guide statistique 1972 ; Sources : P. Bairoch op. cit. – Communiqué OCDE, novembre 1970)
Aux exportations en direction des marchés extra-capitalistes des colonies, il convient d’ajouter les ventes qui sont effectuées, au sein de pays capitalistes comme la France, le Japon, l’Espagne, etc., à des secteurs qui, comme le secteur agricole, ne sont encore que peu intégrés dans les relations de production capitaliste. De même, en Europe orientale il subsiste encore un marché extra capitaliste, alors que l’issue de la Première Guerre mondiale avait condamné l’expansion capitaliste dans ces pays à la stagnation 16.
Ainsi donc, si l’on considère l’ensemble des ventes effectuées par les régions dominées par des relations de production capitaliste en direction de celles produisant encore selon des relations précapitalistes, qu’il s’agisse des marchés extérieurs ou intérieurs, on s’aperçoit que celles-ci ont pu soutenir une partie importante de la croissance réelle des Trente Glorieuses, tout au moins au début des années 1950. Nous reviendrons dans la dernière partie de cet article sur l'appréciation du niveau de saturation des marché au moment de l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, afin d’en faire une caractérisation plus fine.
L’endettement
Au tout début de notre débat interne, les tenants de la thèse du keynésiano-fordisme opposaient à notre hypothèse accordant un rôle à l’endettement dans les années 1950 et 1960 pour soutenir la demande le fait que "la dette totale n’augmente pratiquement pas pendant la période 1945-1980, ce n’est que comme réponse à la crise qu’elle explose. L’endettement ne peut donc expliquer la vigoureuse croissance d’après-guerre". Toute la question est de savoir ce que recouvre ce "pratiquement pas" et si, malgré tout, cela ne serait pas suffisant pour permettre le bouclage de l’accumulation, en complément des marchés extra-capitalistes.
Il est assez difficile de trouver des données statistiques concernant l'évolution de la dette mondiale durant les années 1950-60 pour la plupart des pays, sauf pour les Etats-Unis.
Nous disposons de l’évolution de la dette totale et du PNB américains, année par année, entre 1950 et 1969. L’étude de ces données (Figure 2) doit nous permettre de répondre à la question suivante : est-il possible que, chaque année, l’accroissement de la dette ait été suffisant pour assumer cette partie de l’augmentation du PIB qui ne correspond pas à des ventes effectuées en direction des marchés extra-capitalistes ? Comme on l’a déjà dit, dès lors que ceux-ci font défaut, c’est à l’endettement qu’il revient de jouer le rôle d’acheteur extérieur aux rapports de production capitalistes 17.
|
Année |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
|
GDP |
257 |
285 |
328 |
346 |
365 |
365 |
398 |
419 |
441 |
447 |
484 |
504 |
520 |
560 |
591 |
632 |
685 |
750 |
794 |
866 |
932 |
|
Dette |
446 |
486 |
519 |
550 |
582 |
606 |
666 |
698 |
728 |
770 |
833 |
874 |
930 |
996 |
1071 |
1152 |
1244 |
1341 |
1435 |
1567 |
1699 |
|
%annuel Dette/GDP |
|
171 |
158 |
159 |
160 |
166 |
167 |
167 |
165 |
172 |
172 |
174 |
179 |
178 |
181 |
182 |
182 |
179 |
181 |
181 |
182 |
|
%sur la période ΔDette /ΔGDP |
185% |
||||||||||||||||||||
|
Δannuel GDP |
|
28 |
44 |
17 |
19 |
0 |
33 |
21 |
22 |
6 |
36 |
20 |
16 |
40 |
30 |
42 |
53 |
65 |
44 |
72 |
67 |
|
Δannuel Dette |
|
40 |
33 |
31 |
31 |
24 |
60 |
33 |
30 |
41 |
63 |
41 |
56 |
66 |
75 |
81 |
93 |
97 |
94 |
132 |
132 |
|
(Δannuel Dette- |
|
12 |
-11 |
14 |
12 |
24 |
27 |
11 |
8 |
35 |
27 |
21 |
40 |
26 |
45 |
39 |
40 |
32 |
50 |
60 |
65 |
Figure 2. Evolution comparée du PIB (GDP) et de la dette aux Etats-Unis entre 1950 et 1960 18
Source (GDP et Dette): Federal Reserve Archival System for Economic research
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870 [78]
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870/1615/download/6... [79]
|
Année |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
|
%annuel Dette/GDP |
22 |
39 |
47 |
67 |
75 |
Figure 3.Evolution de la dette en RDA entre 1950 et 1970. Sources : Survey of Current Business (07/1975) - Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6)
L’augmentation de la valeur de la dette en pourcentage de l’augmentation de la valeur du PIB est, sur la période concernée, de 185%. En d'autres termes, l'augmentation en valeur de la dette est presque le double, en 20 ans, de l'augmentation du PIB. En fait, ce résultat démontre que l'évolution de l'endettement aux Etats-Unis est tel qu'il aurait largement pu, globalement durant la période considérée, assurer à lui seul la croissance du PIB de ce pays (et même participer à celle de certains autres d'autres pays) sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours à la vente aux marchés extra-capitalistes. Par ailleurs, on observe que chaque année, à l’exception de 1951, l’augmentation de la dette est supérieure à celle du PIB (c’est seulement en 1951 que la différence entre l’augmentation de la dette et l’augmentation du PIB est négative). Ce qui signifie que, pour chacune de ces années sauf une, c’est l’endettement qui aurait pu avoir assumé l’augmentation du PIB, ce qui est plus que nécessaire étant donné la contribution des marchés extra-capitalistes à la même époque.
La conclusion de cette réflexion concernant les Etats-Unis est la suivante : l’analyse théorique selon laquelle le recours au crédit avait pris le relais de la vente aux marchés extra-capitalistes pour permettre l’accumulation n’est pas démentie par la réalité même de l'évolution de l’endettement dans ce pays. Et, si une telle conclusion ne peut pas être généralisée de façon automatique à l'ensemble des pays industrialisés, le fait qu'elle concerne le plus grosse puissance économique mondiale, lui confère une certaine universalité que confirme par ailleurs le cas de la RDA. En effet, concernant ce pays, nous disposons de statistiques relatives à l’évolution de la dette en fonction du GNP (Figure 3) qui illustrent la même tendance.
Quelles implications pour notre analyse de la décadence ?
Quel niveau de saturation des marchés en 1914 ?
La Première Guerre mondiale éclate au faîte de la prospérité de l'économie capitaliste mondiale. Elle n'est précédée d'aucune crise se manifestant ouvertement sur le plan économique mais, néanmoins, c'est bien l'inadéquation croissante entre le développement des forces productives et les rapports de production qui se trouve à l'origine du conflit mondial et, avec lui, de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Le développement de ce système étant conditionné par la conquête de marchés extra-capitalistes, la fin de la conquête coloniale et économique du monde par les métropoles capitalistes conduit celles-ci à s'affronter entre elles pour se disputer leurs marchés respectifs.
Contrairement à l'interprétation des camarades Salome et Ferdinand, une telle situation ne signifie pas que "les marchés extra-capitalistes (…) sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". En effet, si tel avait été le cas, la crise se serait manifestée au niveau purement économique avant 1914.
Ce sont ces caractéristiques de la période (rivalités impérialistes autour des territoires non capitalistes encore libres) que traduit précisément la citation suivante de Rosa Luxemburg : "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe." (L'accumulation du capital - Le protectionnisme et l'accumulation ; souligné par nous). A plusieurs reprise Rosa Luxemburg reviendra sur la description de l'état du monde à cette époque : "A côté des vieux pays capitalistes il existe, même en Europe, des pays où la production paysanne et artisanale domine encore aujourd'hui de loin l'économie, par exemple la Russie, les pays balkaniques, la Scandinavie, l'Espagne. Enfin, à côté de l'Europe capitaliste et de l'Amérique du Nord, il existe d'immenses continents où la production capitaliste ne s'est installée qu'en certains points peu nombreux et isolés, tandis que par ailleurs les territoires de ces continents présentent toutes les structures économiques possibles, depuis le communisme primitif jusqu'à la société féodale, paysanne et artisanale." (La critique des critiques. Souligné par nous)"
En fait, "la guerre mondiale, tout en étant un produit en dernière instance des contradictions économiques du système, a éclaté avant que ces contradictions aient pu se manifester au niveau "purement" économique. La crise de 1929 a donc été la première crise économique mondiale de la période de décadence." (Résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI)
Si 1929 constitue la première manifestation significative, pendant la décadence, de l'insuffisance des marchés extra-capitalistes, cela signifie-t-il que, après cette date, il n'est pas possible que ces derniers aient joué un rôle significatif dans la prospérité capitaliste ?
Les vastes zones précapitalistes présentes de par le monde en 1914 n'ont pas pu "être asséchées" durant les 10 ans qui ont précédé 1929, période qui n'a pas été marquée par une intense activité économique mondiale. De même, durant les années 1930 et une bonne partie des années 1940, l’économie fonctionne au ralenti. C'est la raison pour laquelle, la crise de 1929, si elle illustre les limites des marchés extra-capitalistes atteintes à cette époque, ne marque pas pour autant la fin de toute possibilité que ceux-ci jouent un rôle significatif dans l’accumulation du capital.
L'exploitation d'un marché extra-capitaliste vierge, ou la meilleure exploitation d'un ancien marché extra-capitaliste, dépend en grande partie de facteurs tels que la productivité du travail dans les métropoles capitalistes dont résulte la compétitivité des marchandises produites ; les moyens de transport dont dispose le capital pour assurer la circulation des marchandises. Ces facteurs ont constitué le moteur de l'expansion du capitalisme à travers le monde, comme le mettait déjà en évidence Le Manifeste communiste 19. De plus, le mouvement de décolonisation a pu, en soulageant les échanges du poids considérable de l'entretien de l'appareil de domination coloniale, favoriser la rentabilité de certains marchés extra-capitalistes.
Le cycle "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise" en question
Le CCI avait très tôt corrigé une interprétation fausse de la réalité selon laquelle la Première Guerre mondiale aurait été la conséquence d’une crise économique ouverte. Comme nous l’avons vu à propos de cette période, la relation de cause à effet "crise – guerre" n’acquiert un sens universel (excluant toutefois le facteur lutte de classe) dés lors seulement que le terme crise est considéré au sens large, en tant que crise des rapports de production.
Quant à la séquence "guerre – reconstruction – nouvelle crise", nous avons également vu qu’elle ne permettait pas de rendre compte de la prospérité des années 1950 et 60 qui, en aucune manière, ne peut être mise sur le compte de la reconstruction consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Il en va d’ailleurs de même concernant la reprise consécutive à la Première Guerre mondiale, durant laquelle le capitalisme renoue avec la dynamique antérieure à la guerre, basée sur l’exploitation des marchés extra-capitalistes, mais selon un rythme bien moindre qui porte la marque de l’état de guerre et des destructions occasionnées par celle-ci. Il y a effectivement eu reconstruction mais, loin de favoriser l’accumulation, celle-ci a plutôt signifié des faux frais nécessaires au redémarrage de l’économie.
Et depuis 1967, date à laquelle le capitalisme entre à nouveau dans une période de turbulences économiques, les crises se sont succédées, le capitalisme a ravagé la planète en multipliant les conflits impérialistes sans pour autant créer les conditions d’une reconstruction synonyme de retour même momentané et limité à la prospérité.
Ainsi que le CCI l’a toujours mis en évidence, l’entrée en décadence n’a pas signifié la fin de l’accumulation comme le traduit la poursuite de la croissance après 1914 et jusqu’à nos jours, quoique globalement à un rythme inférieur à celui de la période faste de l’ascendance du capitalisme (la majeure partie de la seconde moitié du 19e siècle jusqu’à 1914). Celle-ci s’est poursuivie sur la base de l’exploitation des marchés extra-capitalistes jusqu’au moment où ils furent totalement épuisés. C’est alors l’endettement non remboursable qui a dû prendre le relais en accumulant également des contradictions de plus en plus insurmontables.
Ainsi donc, et contrairement à ce qu'induit la représentation "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise", le mécanisme destruction / reconstruction n’a pas constitué un moyen permettant à la bourgeoisie de prolonger les jours du capitalisme, pas plus suite à la Première Guerre mondiale que suite à la Seconde. Les instruments privilégiés d'une telle entreprise, le keynésianisme et surtout l'endettement, s’ils ont pu avoir des effets immédiats allant dans le sens de repousser l’échéance des conséquences ultimes de la surproduction, n'ont pas été à coup nuls et encore moins miraculeux. L'abandon des mesures keynésiennes dans les années 1980 et surtout l’impasse actuelle de l’endettement généralisé et abyssal en constituent les preuves éclatantes.
Sílvio
1 Face à la crise, il ne manque pas de voix "à gauche" (et même aujourd’hui dans une grande partie de la droite) pour préconiser un retour aux mesures keynésienne comme l’illustre le passage suivant extrait d’un document de travail de Jacques Gouverneur, enseignant à l’Université Catholique de Louvin (Belgique). Comme le lecteur pourra s’en apercevoir, la solution qu’il préconise repose sur la mise à profit de l’augmentation de la productivité pour mettre en place de mesures keynésiennes et des politiques alternatives, … du type de celles qui, face à l’aggravation de la situation économique, ont été mises en avant par la gauche du capital depuis la fin des années 1960 afin de mystifier la classe ouvrière quant à la possibilité de réformer ce système : "Pour sortir de la crise et résoudre le problème du chômage, faut-il réduire – ou faudrait-il au contraire augmenter – les salaires, les prestations de sécurité sociale (allocations de chômage, pensions, remboursements de soins de santé, allocations familiales), les dépenses publiques (enseignement, culture, travaux publics, …) ? En d’autres termes : faut-il continuer à mettre en œuvre des politiques restrictives d’inspiration néolibérale (comme on le fait depuis le début des années 1980) ou faut-il au contraire préconiser un retour à des politiques expansives d’inspiration keynésienne (appliquées pendant la période de croissance 1945-1975) ? (…) En d’autres termes : les entreprises peuvent-elles augmenter simultanément leurs profits et leurs débouchés ? Il faut pour cela que deux conditions soient remplies. La première condition consiste en une augmentation de la productivité générale, en ce sens qu’avec un même nombre de travailleurs (ou d’habitants), l’économie produit un volume plus grand de biens et services. De manière imagée, une augmentation de la productivité sur une période donnée (…) élargit la taille du "gâteau" produit, augmente le nombre de "parts de gâteau" à répartir Dans une période où la productivité augmente, la mise en œuvre de politiques keynésiennes constitue la deuxième condition pour que les entreprises disposent simultanément de profits plus élevés et de débouchés élargis. (…) La perpétuation des politiques néolibérales multiplie les drames sociaux et débouche sur une contradiction économique majeure : elle accentue le divorce entre la croissance des profits globaux et celle des débouchés globaux. Mais elle favorise les entreprises et les groupes dominants : ceux-ci continuent donc à exercer une pression efficace sur les pouvoirs publics (nationaux et supranationaux) en vue de prolonger ces politiques globalement néfastes. Le retour à des politiques keynésiennes supposerait un changement dans le rapport de forces actuellement en vigueur ; il ne suffirait cependant pas pour résoudre les problèmes économiques et sociaux mis en évidence par la crise structurelle du système capitaliste. La solution à ces problèmes passe par la mise en œuvre de politiques alternatives : augmentation des prélèvements publics (essentiellement sur les profits) pour financer des productions socialement utiles, réductions du temps de travail pour développer l’emploi et le temps libre, glissement dans la composition des salaires pour promouvoir la solidarité." www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [80]économiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf (souligné par nous).
2 La présentation du débat ainsi que celle des trois principales positions en présence a été effectuée au sein de l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale, dans la Revue internationale n° 133. Par la suite ont été publiés successivement les articles suivants : Origine, dynamique, et limites du capitalisme d’Etat keynésiano-fordiste (Revue internationale n° 135) ; Les bases de l'accumulation capitaliste et Économie de guerre et capitalisme d’État (Revue internationale n° 136) ; En défense de la thèse ‘Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste’ (Revue internationale n° 138).
3 En défense de la thèse Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste (Réponse à Silvio et à Jens), Revue internationale n° 138.
4 Si la présente contribution ne revient pas sur des réponses de Salome et Ferdinand à la thèse L’économie de guerre et le capitalisme d’Etat, c'est parce que nous avons estimé moins prioritaire (même si nécessaire) la discussion des questions soulevées par cette dernière thèse et sur lesquelles nous aurons l'occasion de nous pencher. En effet, celles-ci ne sont pas déterminées d'abord et avant tout par une conception particulière des ressorts de l'accumulation mais plutôt par les conditions géopolitiques qui influent sur sa réalisation.
5 Cité dans l’article d’ouverture du débat dans le Revue internationale n° 133 : extrait du Rapport sur le Cours historique adopté au 3e congrès du CCI, citant lui-même le Rapport adopté à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France et provenant de l'article Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme publié en 1988, dans la Revue internationale n° 52.
6 Lire à ce sujet l’article de la série La décadence du capitalisme, Les contradictions mortelles de la société bourgeoise (Revue internationale n° 139).
7 Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste (Revue Internationale n° 135)
8 Voir l’article Les bases de l’accumulation capitaliste (Revue internationale n° 136)
9 Voir la thèse Les marchés extra-capitalistes et l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133). La référence à l'œuvre de Marx est la suivante : Le capital, Livre III, section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation.
10 Voir sur cette question la présentation de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133)
11 Il est indéniable que le crédit joue un rôle régulateur et permet d’atténuer l'exigence de marchés extra-capitalistes à chaque cycle tout en la maintenant de façon globale. Mais cela ne change rien au problème de fond qui peut se ramener, comme le fait Rosa Luxemburg, à l'étude d'un cycle abstrait qui est la résultante des cycles élémentaires des divers capitaux : "Un élément de la reproduction élargie du capital social est, tout comme pour la reproduction simple que nous avons supposée plus haut, la reproduction du capital individuel. Car la production, qu'elle soit simple ou élargie, ne se poursuit en fait que sous la forme d'innombrables mouvements de reproduction indépendants de capitaux individuels" (L’accumulation du capital ; souligné par nous). De même, il est évident que seulement certains de ces cycles sont amenés à faire intervenir l’acheteur extérieur.
12 Cette réponse se trouve (entre autres) dans le livre III du capital "Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation" (Section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation)
13 L'élévation de la composition organique (c'est-à-dire la croissance plus rapide du capital constant par rapport au capital variable) dans la section des moyens de production est en moyenne plus rapide que dans celle des moyens de consommation, du fait des caractéristiques techniques propres à l’une et à l’autre de ces deux sections.
14 Malgré les excellentes illustrations et interprétations du développement du capitalisme mondial qu'il a réalisées, en s'appuyant sur la théorie de Rosa Luxemburg, en particulier dans Le conflit du siècle, on peut néanmoins s'interroger sur son assimilation en profondeur de cette théorie. En effet, Sternberg analyse dans ce même ouvrage la crise des années 1930 comme ayant résulté de l'incapacité du capitalisme a avoir su, à cette époque, synchroniser l'augmentation de la production avec celle de la consommation : "Le test qui consistait à synchroniser, sur la base de l'économie de profit capitaliste et sans expansion extérieure majeure, d'une part l'accroissement de la production et de la productivité, et, d'autre part, l'augmentation de la consommation, se solda donc par un échec. La crise fut le résultat de cet échec" (p 344). Laisser entendre qu'une telle synchronisation est possible sous le capitalisme, est le début de l’abandon de la rigueur et de la cohérence de la théorie de Rosa Luxemburg. C’est d’ailleurs ce que confirme l’étude la période post-Seconde Guerre mondiale faite par Sternberg où celui-ci développe sa conception selon laquelle il existe la possibilité d'une transformation de la société notamment à travers les nationalisations prises en charge par l'Etat et l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. La citation suivante en donne un aperçu : " …, la réalisation intégrale du programme travailliste de 1945 aurait constitué un grand pas vers la socialisation complète de l'économie anglaise, palier à partir duquel d'autres étapes sur la même voie auraient sans doute été franchies plus aisément (…) Au cours des premières années d'après-guerre, le gouvernement travailliste s'employa à exécuter le mandat que le peuple lui avait ainsi confié. S'en tenant strictement aux moyens et méthodes de la démocratie traditionnelle, il fit subir des modifications radicales à l'Etat, à la société et à l'économie capitalistes." (Chapitre Le monde d'aujourd'hui ; p 629). Le but n'est pas ici de faire la critique radicale du réformisme de Sternberg. Il s'agit seulement de mettre en évidence en quoi sa démarche réformiste incluait nécessairement une sous-estimation considérable des contradictions économiques qui assaillent la société capitaliste, sous-estimation peu compatible avec la théorie de Rosa Luxemburg telle qu'elle est exposée dans L'accumulation du Capital.
15 Comme l’illustre cette partie de notre critique effectuée dans Les bases de l'accumulation du capital (Revue internationale n° 136) qui s’appuie sur les écrits de Paul Mattick. En effet, pour ce dernier, contrairement à Rosa Luxemburg, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitaliste pour que l’accumulation soit possible.
16 Fritz Sternberg, Le conflit du Siècle. III - La stagnation du capitalisme ; l'arrêt de l'expansion capitaliste ; l'arrêt de l'expansion extérieure du capitalisme ; p. 254.
17 Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la fonction de l’endettement n’est pas limitée à la création d’un marché artificiel.
18 %annuel Dette/GDP = (Dette/GDP)*100 ; %sur la période ΔDette/ΔGDP = ((Dette en 1969 - Dette en 1949) / (GDP en 1969 - GDP en 1949))*100 ; Δ annuel GDP = GDP en (n) - GDP en (n-1) ; Δ annuel Dette de l’année (n) = Dette l’année n - Dette de l’année (n-1) ;
19 "Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers." (souligné par nous).
Questions théoriques:
- L'économie [81]
L'Union Libre des Syndicats Allemands en marche vers le syndicalisme révolutionnaire
- 2918 lectures
Dans la première partie de cet article 1, nous avons rendu compte de la controverse au sein du mouvement syndical allemand et du SPD qui a mené à la création de l'Union Libre des Syndicats Allemands (Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, FVDG), l’organisation qui sera le précurseur du syndicalisme révolutionnaire allemand. Cet aperçu embrassait une période allant des années 1870 à1903. La FVDG, fondée en 1897, se présentait alors explicitement, et ce jusqu’en 1903, comme une partie combative du mouvement syndical social-démocrate. Elle n’avait aucun lien avec le syndicalisme révolutionnaire ou l’anarchisme, qui étaient très présents dans d’autres pays comme la France ou l’Espagne. La FVDG a défendu de façon très conséquente, au niveau théorique, la nécessité que les ouvriers organisés au sein des syndicats s’occupent non seulement des questions économiques mais également des questions politiques.
En raison du contexte d’éparpillement lors de sa naissance sous les lois antisocialistes et des démêlés avec la Confédération générale syndicale, la FVDG n’est toutefois pas parvenue à développer en son sein une coordination suffisante pour mener la lutte collective. L’organisation clairement syndicaliste révolutionnaire qui existe déjà dans les IWW aux États-Unis est, sur la question de la centralisation de l’activité, très en avance sur la FVDG. Le penchant permanent à la dispersion fédéraliste, même si celle-ci n’est pas encore théorisée au sein de la FVDG, demeure une faiblesse constante de cette organisation. Face à la grève de masse qui s’annonce, la répugnance envers la centralisation du combat va constituer de plus en plus clairement une entrave à l'activité politique de la FVDG.
La discussion autour des nouvelles formes de lutte apparues avec la grève de masse de la classe ouvrière au début du 20e siècle constitue pour la FVDG un grand défi et a pour conséquence que cette dernière commence à évoluer vers le syndicalisme révolutionnaire. Une évolution qui ne fait que se renforcer jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, comme nous allons l'illustrer dans cet article.
La grève de masse repousse dans l’ombre le vieil esprit syndicaliste1
Au niveau international, le tournant du 20e siècle voit de plus de plus se faire jour les prémisses de la grève de masse en tant que nouvelle forme de la lutte de classe. Par sa dynamique tendant spontanément à l’extension, propice au dépassement du cadre de la branche professionnelle, et par sa prise en compte de revendications politiques, la grève de masse se différencie des anciens schémas des combats de classe syndicaux du 19e siècle, entièrement organisés par les appareils syndicaux, limités à la corporation et à des revendications économiques. Dans les grèves de masse qui éclosent partout dans le monde se manifeste aussi une vitalité de la classe ouvrière qui tend à rendre caduques les grèves longuement préparées et complètement dépendantes de l’état des caisses de grèves syndicales.
Déjà en 1891avait eu lieu en Belgique une grève de 125 000 ouvriers puis en 1893 une autre de 250 000 travailleurs. En 1896 et 1897 se produisit la grève générale des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en Russie. En 1900 ce fut le tour des mineurs de l’État américain de Pennsylvanie puis, en 1902 et 1903, de ceux d’Autriche et de France. En 1902 une nouvelle grève de masse eut lieu en Belgique pour le suffrage universel et, en 1903, ce fut le tour des cheminots aux Pays-Bas. En septembre 1904 eut lieu un mouvement national de grève en Italie. En 1903 et 1904 de grandes grèves ébranlèrent tout le Sud de la Russie.
L’Allemagne, malgré ses puissants syndicats forts de leurs traditions et sa classe ouvrière concentrée et organisée, n’a pas été à ce moment là l’épicentre de ces nouveaux épisodes de lutte de classes qui s’étendaient tels de violents raz-de-marée. La question de la grève de masse en fut d’autant plus passionnément discutée dans les rangs de la classe ouvrière en Allemagne. Le vieux schéma syndical de la "lutte de classe contrôlée", qui ne devait pas perturber le sacro-saint "ordre public", entrait en conflit avec l’énergie du prolétariat et la solidarité qui se déployait dans les nouvelles luttes de masse. Arnold Roller écrivit ainsi en 1905, au cours d’une lutte des mineurs de la Ruhr à laquelle 200 000 ouvriers prirent part : "On (les syndicats) s’est cantonné à conférer à la grève le caractère d’une sorte de démonstration paisible, attentiste, afin peut-être d’obtenir de la sorte des concessions par reconnaissance de cette "conduite raisonnable". Les mineurs des autres bassins organisés dans un esprit semblable, comme en Saxe, en Bavière, etc. témoignent leur solidarité en soutenant la grève et paradoxalement en faisant des heures supplémentaires pour produire des milliers de tonnes de charbon en plus – qui seront expédiées et utilisées par l’industrie au service du Capital pendant la grève (…) Pendant que les travailleurs dans la Ruhr souffrent de la faim, leurs représentants au Parlement négocient et obtiennent quelques promesses d’améliorations – légales – mais seulement pour après la reprise du travail. Bien entendu, la direction syndicale allemande a refusé l’idée d’exercer une pression réellement forte sur le patronat par l’extension de la grève à l’ensemble du secteur charbonnier. " 2
L’un des éléments déclencheurs les plus importants du célèbre "débat sur la grève de masse" en 1905/1906 au sein du SPD et des syndicats allemands fut sans aucun doute la puissante grève de masse de 1905 en Russie qui dépassait alors par sa dimension et sa dynamique politique tout ce qui s’était vu jusque-là 3.
Pour les syndicats, les grèves de masse signifiaient une remise en cause directe de leur existence et de leur fonction historique. Leur rôle d’organisation de défense économique permanente de la classe ouvrière n’était-il pas dépassé ? La grève de masse de 1905 en Russie, réaction directe à l’effrayante misère engendrée dans la classe ouvrière et la paysannerie par la guerre russo-japonaise, avait précisément montré que les questions politiques comme la guerre et, en fin de compte, la révolution se trouvaient maintenant au centre du combat ouvrier. Ces questions dépassaient de très loin le carcan de la pensée syndicale traditionnelle. Ainsi que l’écrivait très clairement Anton Pannekoek : "Tout ceci concorde fort bien avec le véritable caractère du syndicalisme, dont les revendications ne vont jamais au-delà du capitalisme. Le but du syndicalisme n'est pas de remplacer le système capitaliste par un autre mode de production, mais d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur même du capitalisme. L'essence du syndicalisme n'est pas révolutionnaire mais conservatrice" 4
Reprocher aux dirigeants des syndicats puissamment enracinés en Allemagne leur manque de flexibilité parce qu’ils ne sympathisaient pas avec la forme de lutte de la grève de masse politique ne nous donne pas le fin mot de l’histoire. Leur attitude défensive vis-à-vis de la grève de masse résultait simplement de la nature et de la conception des organisations syndicales qu’ils représentaient, et qui ne pouvaient assumer les nouvelles exigences de la lutte de classe.
Il est évident que les organisations politiques et les partis de la classe ouvrière ont alors été obligés de comprendre la nature du combat engagé par les ouvriers eux-mêmes au moyen de la grève de masse. Cependant, "pour l’écrasante majorité des dirigeants sociaux-démocrates, il n’y avait qu’un axiome : la grève générale, c’est la folie générale!" 5. Ne voulant pas admettre la réalité, ils croyaient voir dans le déclenchement de la grève de masse uniquement et très schématiquement la "grève générale" qui était mise en avant par les anarchistes et les partisans de l’ancien co-fondateur de la social-démocratie hollandaise, Domela Nieuwenhuis. Quelques décennies auparavant, dans son texte Les Bakouninistes à l’œuvre daté de 1873, Engels avait, de façon tout à fait fondée, taxé de complète stupidité la vision d’une grève générale préparée dans les coulisses comme un scénario d’insurrection écrit d’avance. Cette ancienne vision de la "grève générale" consistait en ceci que grâce à un arrêt du travail simultané et général mené par les syndicats, le pouvoir de la classe dominante serait affaibli et mis à bas en quelques heures. En ce sens, les directions du SPD et des syndicats justifiaient leurs réticences et utilisaient les mots d’Engels comme une sentence pour rejeter en bloc et ignorer toute amorce de débat sur les grèves de masse réclamé par la Gauche autour de Rosa Luxemburg au sein du SPD.
L’examen plus précis de la fausse opposition entre "la grève générale anarchiste" et "le solide travail syndical" montre cependant clairement que le vieux rêve anarchiste de la grandiose grève générale économique et la conception des grandes centrales syndicales sont en fait très proches. Pour ces deux conceptions, ce qui comptait était exclusivement le nombre de combattants et elles balayaient la nécessité de prendre en charge les questions politiques désormais contenues, au moins potentiellement, dans les luttes massives.
La FVDG qui, jusqu’ici, avait toujours mis en avant l’activité politique des ouvriers était-elle en mesure d’apporter une réponse ?
La position de la FVDG sur la grève de masse
Motivé par les expériences de mouvements massifs en Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le débat sur la grève de masse s’est ouvert au sein de la FVDG en 1904 en vue du Congrès socialiste d’Amsterdam, congrès qui approchait et où cette question était à l’ordre du jour. Dans les rangs de la FVDG où l’on cherchait d’abord à comprendre le phénomène de la grève de masse, ce débat se heurtait à une certaine conception du travail syndical. Dans sa conception générale d’un travail syndical bien mené, la FVDG ne se distinguait sur le fond aucunement des grandes centrales syndicales sociales-démocrates. Cependant, sa faible influence ne la mettant pas en situation de pouvoir contrôler la lutte de classe, la question de la grève de masse y était bien plus ouverte que dans les grandes organisations syndicales.
Gustav Kessler, co-fondateur du courant "Localiste" et autorité politique au sein de la FVDG, est mort en juin 1904. C'est lui qui, au sein de la direction de la FVDG, avait représenté le plus fortement l’orientation vers la Social-démocratie. Le caractère très hétérogène de la FVDG, union des fédérations de métiers, a toujours laissé se constituer des tendances anarchistes minoritaires, comme celle autour d’Andreas Kleinlein Platz. La mort de Kessler et l’élection de Fritz Kater à la tête de la commission exécutive de la FVDG à l’été 1904 ouvrirent précisément une période de plus grande ouverture vis-à-vis des idées syndicalistes révolutionnaires.
C’était avant tout le syndicalisme révolutionnaire français de la CGT, avec son concept de "grève générale", qui semblait pouvoir apporter une réponse à une partie de la FVDG. Sous l’influence de Kessler, la FVDG avait, jusqu’au début de 1904, refusé de faire officiellement de la propagande en faveur de la grève générale. De façon agacée, la FVDG se posa alors la question de savoir si les différentes expressions récentes de la grève de masse de par le monde étaient ou non une confirmation historique de l'ancienne et théâtrale vision de la grève générale.
Deux documents expriment la meilleure compréhension de la grève de masse par la FVDG : la brochure éditée par Raphael Friedeberg en 1904, Parlementarisme et grève générale, ainsi qu’une résolution votée en août de la même année par la FVDG. Le point de vue de Friedeberg (il est resté membre du SPD jusqu’en 1907) a été très influant au sein du syndicat et a nourri ensuite toute sa réflexion. 6.
La brochure de Friedeberg se consacre essentiellement à une critique correcte et finement formulée de l’influence destructrice et abrutissante du parlementarisme tel qu’il était alors pratiqué par la direction social-démocrate : "La tactique parlementaire, la surestimation du parlementarisme, sont trop enracinées dans les masses du prolétariat allemand. Elles sont également trop confortables ; tout doit résulter de la législation, tous les changements dans les rapports sociaux ; tout ce qu'il suffit de faire à chacun, c’est de déposer tous les deux ans son bulletin socialiste dans l’urne. (…) Voilà un bien mauvais moyen d’éducation du prolétariat. (…) Je veux bien concéder que le parlementarisme a eu une tâche historique à remplir dans le développement historique du prolétariat, et qu’il l’aura encore." Comme on le voit, cet anti-parlementarisme n’avait pas le caractère d’un refus de principe, mais correspondait à un stade historique alors atteint au sein duquel ce moyen de propagande pour le prolétariat était devenu totalement inefficace.
De la même façon que Rosa Luxemburg, il a souligné le caractère émancipateur du grand mouvement de grève de masse pour le prolétariat : "À travers la grève, les ouvriers s’éduquent. Elle leur donne une force morale, leur apporte un sentiment de solidarité, une façon de penser et une sensibilité prolétariennes. L’idée de la grève générale offre aux syndicats un horizon tout aussi large que le lui a donné jusqu’ici l’idée du pouvoir politique du mouvement." Il a également écrit sur l’aspect éthique du combat de la classe ouvrière : "Si les ouvriers veulent renverser l’État de classe, s’ils veulent ériger un nouvel ordre mondial, ils doivent être meilleurs que les couches qu’ils combattent, celles qu’ils veulent écarter. C’est pourquoi ils doivent apprendre à repousser tout ce qui est bas et vil en elles, tout ce qui n’est pas éthique. C’est là le caractère principal de l’idée de grève générale, d’être un moyen de lutte éthique."
Ce qui est caractéristique du texte de Friedeberg, c’est l’utilisation du terme "grève générale" même lorsqu’il parle de la grève de masse politique concrète de l’année écoulée.
Même si le ressort de la brochure de Friedeberg est une réelle indignation contre l’esprit conservateur qui règne dans les grandes centrales syndicales, indignation qu’il partage avec Luxemburg, il en arrive à de tout autres conclusions :
- Il rejette clairement la tendance qui existait dans la FVDG à s’intéresser à des questions politiques : "nous ne menons aucun combat politique et, par conséquent, nous n’avons besoin d’aucune forme de combat politique. Notre combat est économique et psychologique." C’est là une nette rupture avec la position qu’avait auparavant la FVDG. En traçant, de façon superficielle, un trait d'égalité entre "parlementarisme" et "combat politique", il rejette la dynamique politique que la grève de masse avait exprimée.
- De plus, Friedeberg élabore une vision (certes très minoritaire au sein même de la FVDG) non matérialiste du combat de classe, basée sur une conception psychologique et sur la stratégie du "refus de la personnalité" - qu’il appelait "psychisme historique". On voit précisément ici qu’il suit certaines conceptions clairement anarchistes selon lesquelles c’est l’esprit de rébellion individuelle qui est l’élément moteur de la lutte de classe et pas le développement collectif de la conscience de classe.
- Bien que Friedeberg ait très correctement cloué au pilori l’idée réformiste social-démocrate de la prise graduelle du pouvoir d’État par le prolétariat, il tendait à adopter une conception gradualiste du même type, mais avec une touche syndicaliste : "Rien que ces dernières années, les syndicats ont accru leurs effectifs de 21% et sont parvenus à dépasser le million d’adhérents. Étant donné que de telles choses se conforment en quelque sorte à des lois, nous pouvons affirmer que, dans trois ou quatre ans nous aurons deux millions de syndiqués, et dans dix ans entre trois et quatre millions. Et lorsque l’idée de la grève générale aura pénétré plus profondément dans le prolétariat […] elle poussera entre quatre et cinq millions d’ouvriers à cesser le travail et ainsi à éliminer l’État de classe." En réalité, l’enrôlement toujours plus important de la classe ouvrière dans les syndicats n’offrait aucunement de meilleures conditions pour la révolution prolétarienne mais, au contraire, constituait un obstacle pour celle-ci.
Derrière la propagande autour d’un "moyen de lutte sans violence pure", on voit aussi chez Friedeberg une énorme sous-estimation de la classe dominante et de la brutale répression qu’elle sait déchaîner dans une situation révolutionnaire : "la caractéristique principale de l’idée de grève générale, c’est d’être un moyen de lutte éthique. […] Ce qui se produira après, lorsque nos adversaires voudront nous réprimer, lorsque nous serons en état de légitime défense, on ne peut pas aujourd’hui le déterminer."
Pour l’essentiel, Friedeberg a vu dans la grève de masse la confirmation de la vieille idée anarchiste de la grève générale. Sa plus grande faiblesse résidait dans le fait de ne pas avoir reconnu que la grève de masse qui venait ne pouvait se développer qu’en tant qu’acte politique de la classe ouvrière. En rupture avec la tradition de la FVDG, qui jusqu’alors avait constamment mis en garde contre toute lutte purement économique, il réduisait la perspective de la grève de masse à ce seul aspect. La base de la FVDG n'était pas unie derrière la conception de Friedeberg qui était le représentant d’une aile minoritaire évoluant vers l’anarchisme et entraînant la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Cependant les positions de Friedeberg furent pour une courte période l’étendard de la FVDG. Friedeberg lui-même se retira de la FVDG en 1907 pour retourner dans une communauté anarchiste à Ascona.
La FVDG ne pouvait pas comprendre la grève de masse en suivant les théories de Friedeberg. L’esprit révolutionnaire qui se développait et qui se manifestait dans cette nouvelle forme de combat de la classe ouvrière posait la question de la fusion entre les questions politiques et économiques. La question de la grève générale qui se retrouvait maintenant sur le devant de la scène à la FVDG, représentait par rapport à la grève de masse un pas en arrière, une fuite vis-à-vis des questions politiques.
Cependant, malgré toutes ces confusions qui remontaient ainsi à la surface à travers les écrits de Friedeberg, le débat au sein de la FVDG a permis de remuer le mouvement ouvrier allemand. Il lui revient le mérite, bien avant la rédaction de brochures lumineuses et célèbres sur la grève de masse de 1905 (comme celles de Luxemburg ou de Trotsky) d’avoir soulevé cette question au sein du SPD.
Il n’est guère étonnant que la conception de la révolution de la FVDG (qui était elle-même l’union de différents syndicats) à cette époque ait continué à mettre en avant les syndicats en tant qu’organes révolutionnaires. Un pas en avant de la part de la FVDG aurait été qu’elle mette elle-même en question sa propre forme d’organisation. D’un autre côté, même Rosa Luxemburg comptait encore beaucoup sur les syndicats qu’elle décrivait dans beaucoup de pays comme un produit direct et en droite ligne de la grève de masse (par exemple en Russie). Il fallut attendre encore presque cinq ans avant que le livre de Trotsky, 1905, qui racontait l’expérience des conseils ouvriers en tant qu’organes révolutionnaires en lieu et place des syndicats, ne soit publié 7. Ce qui resta constant dans la FVDG et les organisations qui lui ont succédé, ce fut leur cécité vis-à-vis des conseils ouvriers et leur attachement viscéral au syndicat en tant qu’organe de la révolution. Une faiblesse qui devait s'avérer fatale lors du soulèvement révolutionnaire après la guerre en Allemagne.
Négociations secrètes pour contrecarrer la grève de masse et le débat à Mannheim en 1906
Au sein du SPD, un combat en règle s’engagea sur la question de savoir s’il fallait discuter de la grève de masse au Congrès du Parti en 1906. La direction du Parti chercha fébrilement à estampiller les manifestations les plus importantes de la lutte de classe comme dépourvues d’intérêt pour la discussion. Le Congrès du SPD de 1905 à Iéna ne s’était prononcé que pour la forme, dans une résolution qui proclamait que la grève de masse était "éventuellement une mesure à propager". La grève de masse était réduite à n'être qu'un ultime moyen de défense contre un éventuel retrait du droit de vote. Les leçons tirées de la grève de masse en Russie par Rosa Luxemburg furent caractérisées de "romantisme révolutionnaire" par la majorité de la direction du SPD et elles furent déclarées n'avoir aucune application possible à l’Allemagne.
Il n’est pas surprenant que juste après le Congrès d’Iéna, en février 1906, la direction du SPD et la commission générale des principaux syndicats se soient mis d’accord dans des pourparlers secrets pour œuvrer ensemble à empêcher des grèves de masse. Cet arrangement fut quand même démasqué. La FVDG publia dans son journal Die Einigkeit (L’Unité) des parties du procès-verbal de cette réunion qui lui était tombé dans les mains. Entre autres, on y lisait : "Le comité directeur du Parti n’a pas l’intention de propager la grève générale politique, mais cherchera, dans la mesure de son possible, à l’empêcher". Cette publication souleva au sein de la direction du SPD, "l’indignation de ceux qui étaient pris la main dans le sac" et rendit bon gré mal gré indispensable la remise à l’ordre du jour du débat sur la grève de masse au Congrès du Parti des 22 et 23 septembre 1906.
Les premiers mots de Bebel, dans son discours inaugural au Congrès de Mannheim, reflétaient la lâcheté et l'ignorance de la direction du Parti, qui se voyait fort incommodée par l’obligation de se confronter à une question qu’elle avait dans les faits espéré éviter : "Lorsque nous nous sommes séparés l’an dernier après le Congrès d’Iéna, personne n’a pressenti que nous aurions à nouveau cette année à discuter de la grève de masse. […] Du fait de la grosse indiscrétion de l’Einigkeit à Berlin, nous voilà face à un grand débat." 8. Afin de se sortir de l’embarras des discussions secrètes, mises en lumière par l’Einigkeit, Bebel tourna purement et simplement en dérision la FVDG et la contribution de Friedeberg : "Comment, en présence d’un tel développement et de la puissance de la classe des patrons vis-à-vis de la classe ouvrière, il est possible d’obtenir quelque chose avec des syndicats organisés localement, comprenne qui le pourra. De toute façon, la direction du Parti et le Parti lui-même dans sa grande majorité pensent que ces syndicats locaux sont totalement impuissants à assumer les devoirs de la classe ouvrière 9." Qui fut, huit ans plus tard, face au vote des crédits de guerre, "totalement impuissant à assumer les devoirs de la classe ouvrière" ? Précisément cette même direction du SPD ! La FVDG au contraire fut, en 1914, face à la question de la guerre, capable de prendre une position prolétarienne.
Au cours des très indigents débats sur la grève de masse qui eurent lieu lors du Congrès, au lieu d’arguments politiques, on s’échangea surtout des récriminations et justifications bureaucratiques, comme si les militants du Parti devaient s’en tenir à la résolution sur la grève de masse prise l’année précédente au Congrès d’Iéna, ou à celle du Congrès des syndicats de mai 1906, laquelle avait clairement rejeté la grève de masse. Le débat tourna pour l’essentiel autour de la proposition de Bebel et Legien de lancer un ultimatum aux membres du Parti organisés au sein de la FVDG afin qu’ils retournent dans la grande centrale syndicale, sous peine de se faire exclure immédiatement du Parti en cas de refus.
Au lieu de se pencher sur les leçons politiques à tirer des grèves de masse victorieuses, ou d’aborder les conclusions de la brochure de Rosa Luxemburg parue une semaine auparavant, le débat était réduit à une lamentable querelle juridico-politicienne !
Alors que le délégué invité de la FVDG, rédacteur de l’Einigkeit de Berlin, était tourné en ridicule, Rosa Luxemburg s’éleva de façon véhémente contre la machination destinée à mettre sous le boisseau le débat politique central sur la grève de masse à l’aide de moyens formels et purement disciplinaires : "En outre je trouve irresponsable que le Parti soit de quelque manière utilisé comme férule contre un groupe de syndicalistes déterminé, et que nous devions endosser la querelle et la discorde au sein du Parti. Il ne fait quand même aucun doute, que dans les organisations localistes se trouvent vraiment beaucoup de bons camarades, et il serait irresponsable si, pour servir directement les syndicats dans cette question, nous introduisions la brouille dans nos rangs. Nous respectons l'avis que les localistes ne doivent pas pousser le litige dans les syndicats au point d’entraver l'organisation syndicale ; mais au nom de la sacro-sainte égalité des droits, on doit reconnaître quand même au moins la même chose pour ce qui concerne le Parti. Si nous excluons directement les anarcho-socialistes du Parti, comme le comité directeur du Parti le propose, nous donnerons un bien triste exemple : nous ne serons capables de détermination et d’énergie que dès lors qu’il s’agit de délimiter notre Parti sur sa gauche, alors que nous laisserons avant comme après les portes très largement ouvertes sur sa droite.
Von Elm nous a rapporté, en illustration de ce qu’il appelle l’absurdité anarchiste, que dans l’Einigkeit ou dans une conférence des organisations locales, il se serait dit : "La grève générale est le seul moyen de lutte de classe réellement révolutionnaire à prendre en compte". Bien entendu, c’est une absurdité et rien d’autre. Cependant, chers amis, cela n’est pas plus éloigné de la tactique sociale-démocrate et de nos principes que les propos de David nous expliquant que le seul moyen de lutte de la social-démocratie est la tactique légale parlementaire. On nous dit que les localistes, les anarcho-socialistes, sapent peu à peu les principes sociaux-démocrates par leur agitation. Mais lorsqu’un membre des comités centraux comme Bringmann se prononce par principe contre la lutte de classe comme il l’a fait lors de votre conférence en février, c’est tout autant un travail de sape des principes de base de la social-démocratie." 10
Comme lors du Congrès du Parti de 1900, lors du débat sur les syndicats à Hambourg, Luxemburg s’oppose à la tentative d’utiliser les faiblesses de la FVDG comme un prétexte facile pour étouffer les questions centrales. Elle voyait que le grand péril ne provenait pas d’une minorité syndicale comme la FVDG, évoluant vers le syndicalisme révolutionnaire et dont les militants au sein du SPD se situaient souvent du côté de son aile gauche, mais bien plutôt du centre et de la droite du Parti.
La scission de la FVDG et la rupture définitive avec le SPD en 1908
La FVDG n'a nullement représenté pour la direction réformiste du SPD et la confédération syndicale centrale le même danger que l'aile révolutionnaire de la social-démocratie autour de Liebknecht et de Luxemburg. Cependant, l'aile révolutionnaire ne pouvait pas ne pas tenir compte de la FVDG uniquement en raison du fait que cette dernière constituait une petite minorité et qu’elle ne reconnaissait pas vraiment les enseignements des grèves de masse. L'émergence internationale de mouvements syndicalistes révolutionnaires puissants à partir de 1905, comme les IWW aux États-Unis, faisait des tendances syndicalistes révolutionnaires un danger potentiel pour le réformisme.
La stratégie, inaugurée en 1906 au Congrès du Parti à Mannheim, de faire pression sur les membres de la FVDG pour qu’ils entrent dans les syndicats centraux, s'est poursuivie pendant des mois. D'une part, on a offert à des membres connus et combatifs des syndicats locaux des postes rémunérateurs dans les bureaucraties des syndicats sociaux-démocrates. D'autre part, pour le Congrès du SPD à Nuremberg qui devait avoir lieu en 1908, est parue à nouveau une motion sur l'incompatibilité de la double affiliation SPD et FVDG.
Mais la FVDG échoua surtout à cause de ses ambiguïtés et des différences d’orientations au sein de ses associations professionnelles. À l’époque où il s’agissait de comprendre la grève de masse politique et l'émergence des conseils ouvriers, elle se déchira dans un affrontement interne sur la question de rejoindre les centrales syndicales ou de s’engager dans une voie syndicaliste révolutionnaire subordonnant les questions politiques aux questions économiques. À son Congrès extraordinaire de janvier 1908, la FVDG examina une motion des syndicats de maçons demandant de dissoudre la FVDG pour adhérer aux syndicats centraux. Bien que cette motion ait été rejetée, cela signifiait la scission de la FVDG et donc la fin de la longue histoire d'une immense opposition syndicale qui s'était appuyée sur la tradition prolétarienne de la social-démocratie. Plus d’un tiers de ses membres quitta immédiatement la FVDG pour rejoindre les grands syndicats. Le nombre d’adhérents tomba de 20 000 à moins de 7000 en 1910.
Il était alors facile à la direction de la social-démocratie de sceller, en septembre 1908, la scission avec la FVDG au Congrès du Parti par l'interdiction définitive de la double affiliation FVDG et SPD. Dès lors, les vestiges de la FVDG ne constituaient plus un danger sérieux pour les Legien et consorts.
Dans l'histoire de la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, l'année 1908 marque ainsi le début d'une nouvelle étape, celle d’un revirement d’orientation déclaré en faveur du syndicalisme révolutionnaire, et cela de la part d'un peu moins de la moitié des membres de la FVDG.
Vers le syndicalisme révolutionnaire
Vu que la FVDG dans sa genèse était apparue comme mouvement d'opposition syndicale solidement lié à la social-démocratie, donc à une organisation politique du mouvement ouvrier, elle ne s'était jamais caractérisée, avant 1908, comme syndicaliste révolutionnaire. En effet, le syndicalisme révolutionnaire ne signifie pas seulement un engagement tout feu tout flamme exclusivement dans les activités syndicales, mais aussi l’adoption d’une conception qui considère le syndicat comme la seule et unique forme d'organisation pour le dépassement du capitalisme - un rôle que celui-ci, de par sa nature d’organe de lutte pour des réformes, n’a jamais pu et ne pourra jamais jouer.
Le nouveau programme de 1911, "Que veulent les Localistes ? Programme, buts et moyens de la FVDG", significatif de la voie qu’elle empruntait, exprimait désormais ce point de vue de la façon suivante : "La lutte émancipatrice des travailleurs est principalement une lutte économique que le syndicat, conformément à sa nature en tant qu'organisation des producteurs, doit conduire sur tous les plans. (…) Le syndicat (et non le parti politique) est seul en mesure de permettre de façon requise l’épanouissement du pouvoir économique des travailleurs…" 11
Les années précédentes, les grandes grèves de masse avaient témoigné de la dynamique spontanée de la lutte des classes et avaient vu l’abandon par les Bolcheviks en 1903 du concept de "parti de masse", clarifiant dans le même temps la nécessité des organisations de minorités politiques révolutionnaires. Toutefois, le nouveau programme de la FVDG, certes avec bonne volonté et tout en combattant le vieux "dualisme", partait sur des conclusions fausses : "C’est pourquoi nous rejetons le dualisme nuisible (bipartition), tel qu’il est pratiqué par la social-démocratie et les syndicats centraux qui s’y rattachent. Nous entendons par là la division absurde des organisations ouvrières entre une branche politique et une branche syndicale. (…) Puisque nous rejetons la lutte parlementaire et l’avons remplacée par la lutte politique directe par des moyens syndicaux et non pas pour le pouvoir politique, mais pour l’émancipation sociale, tout parti politique ouvrier tel que la social-démocratie perd toute raison d’être." 12
Ce nouveau programme exprimait une complète cécité par rapport à l'émergence historique et au caractère révolutionnaire des conseils ouvriers et se réfugiait dans la théorisation pleine d'espoir d'un nouveau type de syndicat :
- alternative au parti de masse (de fait) périmé,
- alternative aux grands syndicats bureaucratisés,
- organe de la révolution,
- et, finalement, architecte de la nouvelle société.
Quelle tâche considérable !
À la façon caractéristique du syndicalisme révolutionnaire, la FVDG défendait à cette époque un clair rejet de l'État bourgeois et du parlementarisme débridé. Elle soulignait correctement la nécessité de la lutte de la classe ouvrière contre la guerre et le militarisme.
Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, la FVDG ne s'est pas rapprochée de l’anarchisme. Les théories de Friedeberg l'ayant mené de la social-démocratie vers l’anarchisme dans les années 1904-07, bien qu'elles aient servi d'emblème, n'ont pas pour autant signifié un basculement de l’ensemble de l'organisation dans l’anarchisme. Au contraire, les forces fortement orientées vers le syndicalisme révolutionnaire réunies autour de Fritz Kater craignaient également une "tutelle" de la part des anarchistes, du type de celle exercée par le SPD sur les syndicats. Dans l’Einigkeit d'août 1912, Kater caractérisait encore l'anarchisme comme "tout aussi superflu que tout autre parti politique" 13. Il serait faux de partir du principe que ce serait la présence en son sein d'anarchistes avérés qui aurait conduit la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. L’hostilité envers les partis politiques, née des dures controverses avec le SPD, s’étendait dans les années d’avant-guerre également aux organisations anarchistes. Ce n'est en aucune manière non plus l'influence du charismatique anarchiste Rudolf Rocker à partir de 1919 qui aurait introduit cette hostilité envers les partis politiques dans l'organisation qui a succédé à la FVDG, la FAUD. Une telle évolution avait en effet déjà clairement eu lieu avant. R. Rocker ne fit que théoriser, dans les années 1920, beaucoup plus nettement que cela n’avait été le cas avant la guerre, cette hostilité du syndicalisme révolutionnaire allemand envers les partis politiques.
Les années précédant l’éclatement de la guerre en 1914 ont été marquées pour la FVDG par un repli sur elle-même. Les grands débats avec les organisations mères étaient terminés. La scission avec la Confédération syndicale centrale avait eu lieu en 1897. La rupture avec le SPD dix bonnes années plus tard, en 1908.
Il se produisit alors une situation curieuse révélant le paradoxe qui ressurgit constamment avec le syndicalisme révolutionnaire : se définissant en tant que syndicat voulant s’ancrer parmi un maximum de travailleurs, la FVDG a toutefois été réduite à un minimum de membres. Parmi ses 7000 adhérents environ, seule une faible partie était vraiment active. Elle n'était plus un syndicat ! Les vestiges de la FVDG formaient plutôt des cercles de propagande en faveur des idées syndicalistes révolutionnaires, et avaient plutôt un caractère de groupe politique. Mais ils ne voulaient pas être une organisation politique !
Les vestiges de la FVDG sont restés - et c'est pour la classe ouvrière une question absolument centrale - sur un terrain internationaliste et se sont opposés, malgré toutes leurs faiblesses, aux efforts de la bourgeoisie en faveur du militarisme et de la guerre. La FVDG et sa presse ont été interdites en août 1914, immédiatement après la déclaration de la guerre, et beaucoup de ses membres encore actifs ont été emprisonnés.
Dans un prochain article, nous examinerons le rôle des syndicalistes révolutionnaires en Allemagne jusqu’en 1923, période qui couvre la Première Guerre mondiale, la révolution allemande et la vague révolutionnaire mondiale.
Mario, 6.11.2009
1 "La naissance du syndicalisme révolutionnaire dans le mouvement ouvrier allemand [82]", Revue Internationale n° 137
2. Arnold Roller (Siegfried Nacht) : Die direkte Aktion ("L’action directe"), 1912. (notre traduction) Roller incarnait au sein de la FVDG l’aile anarchiste jusque-là très minoritaire.
3. Voir les Revue Internationale n° 120 [43], 122 [83], 123 [46], 125 [84] en anglais, espagnol et français.
4. Anton Pannekoek, Le Syndicalisme, International Council Correspondance, n° 2 - Janvier1936., Rédigé en anglais sous le pseudonyme de John Harper. (Notre traduction)
5. Paul Frölich, Rosa Luxemburg, sa vie et son œuvre, chapitre : "La grève politique de masse". Ed. L’Harmattan, p.168
6. Friedeberg lui-même ne venait pas de l’anarchisme mais était élu local du SPD et membre de la direction berlinoise du Parti social-démocrate.
7. Trotsky écrivit d’abord en 1907 Notre révolution. Quelques chapitres servirent de base à 1905, lequel fut écrit en 1908/1909.
8 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mannheim, 23. bis 29. September 1906 (Procès-verbal des débats du Congrès du Parti Social-démocrate allemand, Mannheim, 1906), page 227.(Notre traduction)
9. Ibidem, page 295. .(Notre traduction)
10. Ibidem, , page 315 (ou dans les Œuvres complètes de Rosa Luxemburg, Tome 2 page 174).
11. Notre traduction
12. Notre traduction
13. Voir Dirk H. Müller, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, p.191-198.
Courants politiques:
Revue Internationale n° 142 - 3e trimestre 2010
- 2867 lectures
Le capitalisme est dans une impasse, les cures d'austérité ou les plans de relance n'y changeront rien
"Le G20 à la recherche d'une nouvelle façon de gouverner le monde". C'est là une bien grande ambition que prêtaient certains médias 1 à ce nouveau sommet des "grands" de ce monde, mais, une ambition à la hauteur de l'état catastrophique de la planète !
Qu'il existe l'attente d'une amélioration est une évidence alors que, de par le monde et depuis plus de deux ans, c'est à un rythme accéléré que s'abattent les attaques contre la classe ouvrière. L'économie mondiale, malgré les annonces quotidiennes d'une reprise imminente ou déjà à l'œuvre, est installée dans la stagnation et son futur apparaît de plus en plus sombre. Face à cela, la réunion des personnalités qui ont en charge la gestion de cette économie mondiale et donc, entre leurs mains, le sort des habitants de la planète, paraissait devoir décider de moyens réels permettant une amélioration.
La réunion des pays du G8 (préparatoire du G20) devait ainsi décider de la politique à suivre pour permettre à l'économie mondiale de sortir de la crise : poursuite des plans de relance comme le recommandent et le font les États-Unis, ou bien mise en œuvre de plans d'austérité afin d'écarter les menaces de faillite qui concernent un nombre croissant d'États, comme les recommandent et les appliquent déjà les pays les plus importants de l'Union européenne. Le G20 devait, quant à lui décider, d'une part, la taxation des banques en vue de constituer un "fond de résolution" des crises financières, celle qui a débuté en 2007 n'étant de fait pas résolue même si ses effet les plus dévastateurs en ont momentanément été contenus ; il devait, d'autre part, s'atteler à la "régulation du système financier" avec pour objectif d'éviter des actions spéculatives "particulièrement déstabilisatrices" et d'orienter les capacités financières ainsi "libérées" vers les progrès de la production. Qu'est-il sorti de ce sommet ? Rien. La montagne n'a pas accouché d'une souris, elle n'a accouché de rien du tout. Aucune décision n'a été prise sur quelque problème que ce soit ; comme nous le verrons plus en détail dans la suite de cet article, les participants n'ont pu que constater leur désaccord complet : "Sur les sujets qui devaient constituer le gros de ce G20 il y a encore peu, les participants au sommet de Toronto ont jugé qu'il était urgent d'attendre. Les divergences restent trop importantes, l'impréparation aussi." 2 Il fallait bien le sens de l'à propos du président français Sarkozy pour tenter de relativiser ce constat d'échec et d'impuissance de la bourgeoisie mondiale en commentant "on ne peut pas prendre des décisions historiques à chaque sommet" !
Les précédents G20 avaient promis de mettre en œuvre des réformes s'appuyant sur les leçons de l'affaire des "subprimes" et de la crise financière qui s'en est suivie. Cette fois-ci, il n'y a même pas de promesses. Pourquoi les grands gestionnaires du capitalisme mondial se montrent-ils incapables de prendre la moindre décision ? Le fond du problème c'est qu'il n'y a pas de solution à la crise du capitalisme autre que le renversement de ce mode de production historiquement sénile. Il existe également une autre explication possible, plus circonstancielle : les chefs d'État et de gouvernement ayant en général conscience que l'économie mondiale s'enfonce toujours plus dans un gouffre sans fond, ils ont la sagesse d'éviter de se trouver, dans quelques mois, dans l'obligation de prononcer la fameuse phrase de l'ancien président de la Côte d'Ivoire F. Houphouët Boigny : "Nous étions au bord du gouffre, nous avons fait un grand pas en avant" 3 car, cette fois-ci, les termes étant de circonstance, cela ne ferait rire personne.
La fin des plans de relance et le retour de la dépression
L’éclatement de la crise financière, en 2008, avait entraîné dans son sillage une chute de la production de l'essentiel des pays du monde (un simple ralentissement pour la Chine et l’Inde). Pour tenter d'endiguer le phénomène, la bourgeoisie dans la plupart des pays, avait été amenée à mettre en place des plans de relance, ceux de la Chine et des États-Unis étant de loin les plus importants. Si ces plans ont permis un rattrapage partiel de l’activité économique mondiale et une stabilisation de celle des pays développés, leurs effets sur la demande, la production et les échanges sont néanmoins en train de s’épuiser.
Malgré toute la propagande sur la reprise dans laquelle nous serions engagés, la bourgeoisie est désormais obligée d’admettre que la situation n’évolue pas dans cette direction. Aux États-Unis, la croissance qui était prévue à 3,5% pour 2010 a été révisée en baisse à 2,7% ; le nombre de chômeurs s’accroît de nouveau de semaine en semaine et l’économie américaine a recommencé à détruire des emplois 4 ; de manière générale, les nombreux indicateurs créés pour mesurer l’activité économique des États-Unis montrent une croissance qui a tendance à faiblir. Dans la zone euro, la croissance n’a été que de 0,1% au premier trimestre et la Banque Centrale Européenne prévoit qu’elle atteindra 1% pour toute l’année 2010. Les mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver : la croissance de la production manufacturière est de moins en moins forte et le chômage a recommencé à augmenter, sauf pour l'Allemagne. Il est prévu que le PIB de l’Espagne continuera de diminuer en 2010 (- 0,3%). Il est significatif que, tant aux États-Unis qu’en Europe, l’investissement continue à diminuer, ce qui veut dire que les entreprises ne prévoient pas une réelle croissance de la production.
Par-dessus tout, l’Asie, la région du monde qui devait devenir le nouveau centre de gravité de l’économie mondiale, est en train de voir son activité décélérer. En Chine, l’indice du Conference Board qui était prévu en hausse de 1,7% pour le mois d’avril n’augmente finalement que de 0,3% ; ce chiffre est corroboré par tous ceux qui ont été publiés dernièrement. Si les chiffres mensuels concernant un pays ne sont pas nécessairement significatifs d’une tendance générale, le fait que, dans les grands pays de la région, l’activité ait pris la même direction au même moment, est significatif d'une tendance sérieuse : ainsi l’indice de l’activité économique en Inde traduit lui aussi un ralentissement et, au Japon, les chiffres du mois de mai pour la production industrielle et la consommation des ménages sont en baisse.
Enfin, confirmant cette inflexion qui dément les fanfaronnades des médias sur la reprise économique, l’indice "Baltic Dry Index" qui mesure l’évolution du commerce international est, lui aussi, orienté à la baisse.
La faillite des États
Tandis que l'évolution des différents indices économiques témoigne d'une rechute dans la dépression, des États éprouvent des difficultés croissantes à assumer le remboursement de leur dette. Cela n'est pas sans rappeler la crise des "subprimes" qui avait vu l'incapacité de nombreux ménages américains à rembourser les prêts qui leur avaient été consentis. Il y a quelques mois, c'était au tour de l'État grec de se retrouver sur la sellette alors qu'était suspectée une situation de l'état de ses finances bien plus grave que celle annoncée initialement. Dans le même temps, la solvabilité de plusieurs autres États européens (affublés gracieusement du qualificatif de PIIGs construit à partir de leur initiales et évocateur du terme "pig" – cochon en anglais), le Portugal, l’Irlande, l’Italie, l'Espagne en plus de la Grèce, était mise en doute par les agences de notation financière. Il est certain que la spéculation à leur encontre a aggravé leurs difficultés et que le rôle joué par les fameuses agences de notation (qui ont été créées par de grandes banques) est loin d’être clair. Il n'en demeure pas moins que ce qui est fondamentalement en cause dans cette crise de confiance affectant ces pays est l'ampleur de leurs déficits budgétaires (à des niveaux inégalés depuis la Deuxième Guerre mondiale) et de leur dette publique, la politique de relance menée, peu ou prou, par les différents États n'étant pas pour rien dans cette situation. Il en a résulté un affaiblissement des réserves monétaires des différents Trésors publics et, en conséquence, des difficultés toujours plus importantes des États concernés pour rembourser les intérêts des prêts qui leur avaient été accordés. Or, le paiement du service de la dette, au minimum, est la condition indispensable pour que les grands organismes bancaires mondiaux continuent à prêter. Mais les PIIGs ne sont pas les seuls à connaître une très forte augmentation des déficits publics et, en conséquence, de la dette publique. Ainsi, les agences de notation ont menacé explicitement la Grande-Bretagne d’abaisser sa note et de lui faire rejoindre les rangs peu honorables des PIIGs, si elle ne faisait pas un gros effort pour diminuer ses déficits publics. Ajoutons, pour faire bonne mesure, que le Japon (qui, dans les années 1990, a été pronostiqué comme devant supplanter les États-Unis au niveau du leadership économique mondial) a atteint un endettement public qui correspond au double de son PIB 5. En fait, une telle liste que l’on pourrait encore allonger nous amène à la conclusion que la tendance au défaut de paiement de la dette souveraine des États est une tendance mondiale parce que tous les États ont été touchés par l’aggravation de la crise de l'endettement à partir de 2007 et que tous ont subi des déséquilibres semblables à ceux de la Grèce et du Portugal.
Mais il n'y a pas que les États dont la situation financière s’approche de l’insolvabilité. Le système bancaire, lui aussi, se trouve dans une situation de plus en plus grave, pour les raisons suivantes :
- tous les spécialistes savent et disent que les comptes des banques n’ont pas été apurés des "produits toxiques" qui ont présidé à la faillite de nombreuses institutions financières, survenue à la fin 2008 ;
- les banques, confrontées à ces difficultés, n’ont pas cessé pour autant de spéculer sur le marché financier mondial par l’achat de produits très risqués. Tout au contraire, elles ont dû continuer à jouer sur ce registre pour tenter de faire face aux pertes massives qu’elles venaient de subir ;
- l’aggravation de la crise depuis la fin 2007 a provoqué de nombreuses faillites d’entreprises, si bien que beaucoup de ménages, se retrouvant sans emploi, ne purent plus, contrairement aux années précédentes, rembourser les différents prêts qu’ils avaient contractés.
Une illustration de cette situation a été fournie récemment, le 22 mai, lorsqu’une caisse d’épargne en Espagne nommée Caja Sur a été mise sous tutelle de l’État. Mais cet événement n’était qu’une petite partie (la face émergée de l'iceberg) de ce que représentent les difficultés éprouvées par les banques ces derniers mois. D’autres banques en Europe ont été dégradées par les agences de notation (Caja Madrid en Espagne, BNP en France) mais, surtout, la BCE a informé le monde financier que les banques européennes allaient devoir déprécier leurs actifs de 195 milliards d’euros dans les deux prochaines années et que leurs besoins de capitaux, jusqu’en 2012, se montaient à 800 milliards d’euros. Un événement survenu récemment constitue, sur un autre plan, une vérification éclatante de la fragilité actuelle du système bancaire : l’entreprise allemande Siemens a décidé de créer sa propre banque, une institution qui serait ainsi à son service et à celui de ses clients. La raison en est simple : ayant déjà perdu la bagatelle de 140 Millions d’euros lors de la faillite de Lehman Brothers, cette entreprise a peur que le même phénomène se reproduise avec les liquidités qu'elle sera amenée à déposer aux guichets de banques "classiques". On a d’ailleurs appris, à cette occasion, que Siemens n’avait rien inventé puisque l’entreprise Veolia, alliée à British American Tobacco et d’autres entreprises de moindre importance, avait fait la même chose en janvier 2010 6. Il est clair que, si des entreprises dont la solidité n’est pour le moment pas en cause, ne déposent plus leur trésorerie aux guichets des grandes banques, la situation de ces dernières ne va pas s’arranger !
Mais ce qu’il est particulièrement important de souligner, c’est que les problèmes d’insolvabilité des États et des banques ne peuvent que se cumuler : c’est déjà le cas, mais ce phénomène ne peut que prendre de l'ampleur dans les semaines et les mois à venir ; en clair, la "faillite" d’un État, s’il n’était pas "secouru" par les autres comme cela a été fait pour la Grèce, provoquerait la faillite des banques qui lui ont prêté massivement. Les créances des banques allemandes et françaises à l’égard des États regroupés sous le terme de PIIGs se montant à environ 1000 milliards d’euros, il apparaît clairement que le défaut de paiement de ces pays aurait des conséquences incalculables sur l'Allemagne et la France et, par ricochet, sur l’économie mondiale.
Aujourd’hui c'est l’Espagne qui est dans l’œil du cyclone de la crise financière. La BCE a annoncé que les banques espagnoles, pas assez crédibles pour emprunter sur le marché, se sont refinancées auprès d'elle du montant exorbitant de 85,6 milliards d’euros, pour le seul mois de mai. De plus, il se dit, dans les salles de marché, que l’État espagnol devrait s’acquitter, fin juillet ou début août, d'une somme considérable 7. C’est donc dans un délai particulièrement court que de telles sommes doivent être trouvées et c’est bien parce que la situation est dramatique que le directeur du FMI, D. Strauss-Kahn, et le Secrétaire d’État adjoint au Trésor des États-Unis, C. Collins, se sont succédés à Madrid. Un plan de sauvetage de la dette souveraine espagnole d’un montant de 200 ou 250 milliards d’euros serait à l'étude.
Si autant de monde se presse autour de l’Espagne, c’est que les problèmes posés par sa situation financière peuvent être très lourds de conséquences :
- si, n’étant pas secouru, l’État espagnol faisait faillite, cela provoquerait une défiance générale à l’égard de l’Euro et de tout paiement libellé dans cette monnaie ; en d’autres termes, la zone euro se trouverait considérablement mise à mal ;
- la France et l’Allemagne, c’est-à-dire les économies les plus fortes de la zone euro, ne peuvent pas prendre en charge les engagements auxquels l’Espagne ne peut faire face sous peine d’une déstabilisation grave de leurs propres finances et, finalement, de l' ensemble de leur économie (analyse développée par l’économiste P. Artus 8).
Cela signifie que l'aide à l’État espagnol permettant à celui-ci d’éviter le défaut de paiement sur sa dette souveraine ne peut être le fruit que d’une entente de l’ensemble des pays occidentaux, et que le prix à payer en sera nécessairement la fragilisation de leur propre situation financière. Et, dans la mesure où, comme nous l’avons vu, la plupart des États sont dans une situation s'approchant de celle de l’Espagne, cela exige de leur part la mise en place d'une politique visant à éviter des impossibilités de remboursement en cascade de leur dette souveraine.
De tout ce qui précède, il ressort que le capitalisme n’a plus les moyens de renverser le cours de l’aggravation de la crise telle qu'elle se manifeste depuis 2007.
Les divergences des États sur la politique à mener
"Rigueur ou relance : le désaccord persistant des dirigeants du G8" titrait le journal Le Monde dans son édition des 27 et 28 juin. Malgré le langage diplomatique employé, il ressort clairement que le désaccord entre les différents pays est complet. La rigueur est voulue par la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui entraîne avec elle la zone euro ; la relance est souhaitée par les États-Unis et, à un degré moindre, par la Chine. Quels sont le contenu et les raisons d’un tel désaccord ?
Le constat de la gravité des implications, pour l’Europe et le monde, de la faillite de l’État grec a amené l’Europe et le FMI à finalement organiser le sauvetage de la dette souveraine de la Grèce et ce, malgré les divergences qui s'étaient manifestées entre les États devant participer à ce sauvetage. Mais cet événement a provoqué un infléchissement important de la politique de l'ensemble des pays de la zone euro :
- Tout d’abord, tous se sont finalement accordés sur la nécessité de prendre les moyens de secourir les États ayant besoin de l’être, car des défauts de paiement de leur part ébranleraient tout le système financier européen, avec le risque qu'il s'effondre. C’est pour cela qu’a été créé un fonds de soutien de 750 milliards d’euros, approvisionné pour deux tiers par les pays membres de la zone euro et pour un tiers par le FMI, qui est censé permettre aux États qui se retrouveraient en défaut de paiement de faire face à leurs engagements. Dans le même sens, au vu de la situation des banques de la zone euro, la Banque Centrale Européenne accepte de prendre en charge les créances plus ou moins douteuses qui lui sont présentées par celles-ci ; c’est ce qui vient de se produire, comme on l'a vu, avec les banques espagnoles.
- Ensuite, pour diminuer le risque de défaut de paiement, les États ont décidé d’assainir leurs propres finances publiques et leur propre système bancaire. Pour cela, ils ont lancé des plans d’austérité qui vont signifier une baisse du niveau de vie de la classe ouvrière, d'une importance comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930. Le nombre des attaques est tellement important que leur énumération dépasserait de loin la taille de cet article. Prenons des exemples significatifs. En Espagne, le salaire des fonctionnaires a été diminué de 5% et 13 000 postes ont été supprimés. En France, en plus de la réforme des retraites qui vise à retarder d’au moins deux ans le départ en retraite et à ne remplacer qu’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, il a été décidé de supprimer 100 000 postes de la fonction publique sur la période 2011-2013 ; il est mis fin aux mesures de relance décidées en 2009 ; la hausse des sommes collectées au titre des impôts devra être de 5 milliards d’euros. En Grande-Bretagne, le plan Osborne prévoit une diminution des dépenses des ministères de 25% en cinq ans ("les ministères sanctuarisés" comme la santé ne sont cependant pas touchés par cette mesure) ; toute une série d’allocations sociales dont bénéficient les plus faibles sont gelées ; la TVA passe de 17,5% à 20% ; il a été calculé que le plan Osborne allait aboutir à la suppression de 1,3 million d’emplois. En Allemagne, 14 000 emplois de fonctionnaires seront supprimés d’ici 2014 et l’indemnisation des chômeurs de longue durée sera diminuée. Dans tous les pays les investissements publics sont diminués.
La logique proclamée de ces mesures est la suivante : tout en sauvant le système financier par le soutien aux banques en difficulté et aux États risquant de se trouver en défaut de paiement, il s’agit d’assainir les finances publiques pour pouvoir à nouveau emprunter par la suite, afin de permettre un redémarrage futur de la croissance. En fait, derrière cet objectif affiché, il y a d’abord la volonté de la bourgeoisie allemande de préserver ses intérêts économiques : pour ce capital national qui a misé sur sa capacité à vendre ses marchandises – en particulier ses machines-outils et sa chimie - au reste du monde, il est hors de question de faire supporter par une hausse de ses coûts de production les frais d’une relance ou d'un soutien (au-delà d’un certain niveau) à d'autres pays européens en difficulté. Il en résulterait en effet une perte de compétitivité de ses marchandises. Et comme ce pays est le seul à pouvoir soutenir les autres pays européens, il impose à tous une politique d’austérité, même si cela ne correspond pas à leurs intérêts.
Le fait que le Royaume-Uni, qui ne subit pas les contraintes de la zone euro, mette en œuvre la même politique est significatif de la profondeur de la crise. Pour cet État, l'heure n'est plus à la relance alors que son déficit budgétaire pour l’année 2010 atteint 11,5% du PIB. Il en résulterait de trop grands risques de défaut de paiement sur la dette souveraine et, ce faisant, d’effondrement de la Livre sterling. Il faut également noter que le Japon – compte tenu de l'ampleur de sa dette publique - a adopté la même politique d’austérité. De plus en plus de pays pensent désormais que leurs déficits et leur dette publique sont devenus trop dangereux, le défaut de paiement sur la dette souveraine signifiant en effet un affaiblissement considérable du capital national. Ils optent ainsi pour une politique d’austérité qui ne peut mener qu’à la déflation 9.
Or, c’est bien l’entrée dans une dynamique déflationniste qui fait peur aux États-Unis. Ils accusent les européens de s’engager dans un "épisode Hoover" (du nom du Président des États-Unis en fonction en 1930), ce qui revient à accuser les États européens d’engager le monde dans une dépression et une déflation comme celles des années 1929-1932. D’après eux, même s’il est légitime de vouloir diminuer les déficits publics, il faudra le faire plus tard, lorsque "la reprise" sera vraiment engagée. En défendant une telle politique, les États-Unis défendent leurs propres intérêts car, étant émetteurs de la monnaie de réserve mondiale, créer de la monnaie supplémentaire pour alimenter la reprise ne leur coûte que des écritures de compte. Ceci dit, cela n'empêche pas que leur crainte est bien réelle de voir l’économie mondiale s’engager dans la déflation.
Au fond, quelle que soit l’option souhaitée ou adoptée, les changements de politique effectués ces derniers temps de même que les craintes exprimées par différentes fractions de la bourgeoisie mondiale sont révélatrices du désarroi qui existe en son sein : il n'existe plus de bonne solution !
Quelles perspectives ?
L’effet des politiques de relance est terminé et c'est une rechute dans la dépression qui s'amorce. Une telle dynamique implique pour les entreprises des difficultés croissantes à dégager des profits suffisants, ne serait-ce que pour ne pas disparaître. La politique d'austérité que vont mettre en place un grand nombre de pays ne va qu'aggraver la chute dans la dépression et engendrer la déflation dont certaines manifestations commencent à apparaître.
Il ne fait pas de doute que l'espoir selon lequel une politique d'austérité assainira les finances publiques et permettra un endettement futur est une pure illusion. En effet, selon les calculs du FMI, la conséquence du plan d'austérité grec implique, pour ce pays, une perte de 8% de son PIB. De même, une baisse du PIB espagnol est déjà prévue. De plus, les plans d'austérité ne peuvent que provoquer une baisse des rentrées fiscales et participer ainsi à creuser les déficits que, justement, les mesures d’austérité draconiennes essaient de réduire ! Il faut s'attendre à une chute de la production de la plupart des pays du monde et du commerce mondial pour la fin 2010 et pour le début 2011 avec toutes les conséquences que cela aura pour le développement de la misère d'une partie toujours plus grande de la classe ouvrière et une dégradation des conditions de vie de tous les ouvriers.
Il n'est pas impossible que, au vu de la chute accélérée dans la dépression qui va résulter des politiques d'austérité, intervienne au bout de quelques mois un changement de politique et que soit adoptée celle prônée par les États-Unis. En effet, les six derniers mois nous montrent que la bourgeoisie, n'ayant plus guère de marge de manœuvre, est maintenant incapable de prévoir au delà du très court terme : on faisait une politique de relance il y a seulement un an ! Si une nouvelle politique de relance était adoptée, elle signifierait une forte émission monétaire (certains disent que les États-Unis s’apprêteraient à la mettre en œuvre). Mais alors, il faudrait s’attendre à la chute générale de la valeur des monnaies, c'est-à-dire une explosion de l'inflation, en d'autres termes de nouvelles attaques dramatiques contre le niveau de vie des travailleurs.
Vitaz (03/07/2010)
1 Ce n'était rien de moins que le titre de première page du journal Le Monde du 26 juin 2010
2 Le Monde, 29 juin 2010
3 https://www.dicocitations.com/citations/citation-7496.php [87]
4 Après 5 mois consécutifs de créations d'emplois, ce sont 125 000 qui ont été détruits au mois de juin, ce qui est plus que ne le redoutaient les analystes. Voir l'article "Après cinq mois de créations d'emplois, les États-Unis se remettent à en détruire [88]".
5 C'est, entre autre, le fait qu'il possède actuellement les deuxièmes réserves de change du monde qui permet au Japon de n'être pas noté par les agences de notation aussi sévèrement que le sont nombre de pays beaucoup moins endettés que lui.
6 www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/29/siemens-cree-sa-banque-afin-de-s-affranchir-des-etablissements-traditionnels_1380459_3234.html [89]
7 Il s'agirait de 280 Milliards d’euros. Bien sûr, de par leur origine (les salles de marché), de tels chiffres sont officieux et ont évidemment été démentis par les autorités car, dans ce cas, même le silence serait interprété comme une confirmation et engendrerait une panique indescriptible.
8 Journal Le Monde, 16 avril 2010,
9 Baisse des prix durable, provoquée dans ce cas par l'insuffisance de la demande, elle-même conséquence des programmes d'austérité.
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (III) : la révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir
- 4434 lectures
La série Que sont les conseils ouvriers ? se propose de répondre à la question en analysant l'expérience historique du prolétariat. Il ne s'agit pas d'élever les soviets au niveau d'un modèle infaillible qu’il s’agirait simplement de .copier ; nous cherchons à les comprendre tant dans leurs erreurs que dans leurs succès, pour armer les générations actuelles et futures à la lumière de cette compréhension.
Dans le premier article, nous avons vu comment ils naquirent avec la Révolution de 1905 en Russie 1, dans le deuxième comment ils furent la pièce maîtresse de la Révolution de Février 1917 et comment ils entrèrent dans une crise profonde en juin-juillet 1917 jusqu'à être pris en otage par la contre-révolution bourgeoise 2.
Dans ce troisième article, nous verrons comment ils furent reconquis par la masse des travailleurs et des soldats qui purent ainsi prendre le pouvoir en octobre 1917.
Après la défaite de juillet, la bourgeoisie se propose de détruire les soviets
Dans les processus naturels comme dans les processus sociaux, l'évolution ne se fait jamais linéairement mais bien à travers des contradictions, des convulsions, des contretemps dramatiques, des pas en arrière et des bonds en avant. Tout ceci est encore plus évident avec le prolétariat, classe qui, par définition est privée de la propriété des moyens de production et ne dispose d'aucun pouvoir économique. Sa lutte suit un processus convulsif et contradictoire, fait de reculs, de perte apparente de ce qui est qui paraissait acquis à jamais, de longs moments d’apathie et de découragement.
Après la Révolution de Février, les travailleurs et les soldats semblaient voler de succès en succès, le bolchevisme augmentait sans cesse son influence, les masses – surtout celles de la région de Petrograd – allaient vers la révolution. Celle-ci paraissait mûrir comme un fruit.
Toutefois, juillet mit en évidence ces moments de crise et d’hésitation typiques de la lutte prolétarienne. "Une défaite directe fut essuyée par les ouvriers et les soldats de Petrograd qui, dans leur élan en avant, s'étaient heurtés, d'un côté, au manque de clarté et aux contradictions de leurs propres desseins, d'autre part, à l'état arriéré de la province et du front" 3.
La bourgeoisie en profita pour engager une furieuse offensive : les bolcheviks furent calomniés comme agents de l'Allemagne" 4 et arrêtés en masse ; des bandes paramilitaires furent organisées qui les brutalisaient dans la rue, organisaient le boycott de leurs meetings, assaillaient leurs locaux et leurs imprimeries. Les redoutables Cent Noir tsaristes, les cercles monarchiques, les associations officielles reprirent le haut du pavé. La bourgeoisie – avec l’aval des diplomaties anglaise et française – aspirait à détruire les soviets et à implanter une dictature féroce 5.
La révolution entamée en février parvenait à un point où le spectre de la défaite devenait on ne peut plus présent : "Bien des gens crurent que la révolution était en somme arrivée à son point mort. En réalité, c'était la Révolution de Février qui avait tout donné d'elle jusqu'au fond. Cette crise intérieure de la conscience des masses, combinée avec la répression et la calomnie, mena à la perturbation et à des reculades, à des paniques en certains cas. Les adversaires s'enhardirent. Dans la masse elle-même monta à la surface tout ce qu'il y avait d'arriéré, d'inerte, de mécontent, à cause des commotions et des privations" 6.
Les bolcheviks impulsent la riposte des masses
Toutefois, en ce moment difficile, les bolcheviks surent être un bastion essentiel des forces prolétariennes. Poursuivis, calomniés, secoués par de violents débats dans leurs propres rangs et par la démission de bon nombre de militants, ils ne cédèrent pas ni ne tombèrent dans la débandade. Leurs efforts se concentrèrent à tirer les leçons de la défaite et en particulier la leçon essentielle : comment les soviets avaient-ils pu être pris en otage par la bourgeoisie et menacer de disparaître ?
De février à juillet s’était maintenue une situation de double pouvoir : les soviets d'une part et, de l’autre, le pouvoir de l'État bourgeois, qui n'avait pas été détruit et avait encore suffisamment d’atouts pour pouvoir se reconstituer pleinement. Les événements de juillet avaient fait exploser un équilibre impossible entre soviets et pouvoir d'État : "L'état-major général et le commandement supérieur de l'armée, consciemment ou à demi-consciemment, secondés par Kerenski que les socialistes-révolutionnaires, même les plus en vue, traitent maintenant de Cavaignac 7, se sont pratiquement emparés du pouvoir d'État et ont déclenché la répression contre les unités révolutionnaires du front. Ils ont commencé à désarmer les troupes et les ouvriers révolutionnaires de Petrograd et de Moscou, à étouffer et à mater le mouvement de Nijni Novgorod, à arrêter les bolcheviks et à fermer leurs journaux, non seulement sans décision des tribunaux, mais encore sans décret du gouvernement. (…) l'objet véritable de la dictature militaire qui règne aujourd'hui sur la Russie avec l'appui des cadets et des monarchistes : préparer la dissolution des Soviets" 8.
Lénine démontrait également comment les mencheviks et les SR "ont définitivement trahi la cause de la révolution en la livrant aux contre-révolutionnaires et en transformant leurs propres personnes, leurs partis et les Soviets en feuilles de vigne de la contre-révolution". (idem.).
Dans de telles conditions, "Tous les espoirs fondés sur le développement pacifique de la révolution russe se sont à jamais évanouis. La situation objective se présente ainsi : ou la victoire complète de la dictature militaire ou la victoire de l'insurrection armée des ouvriers (…) Le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux Soviets" fut celui du développement pacifique de la révolution qui était possible en avril, mai, juin et jusqu'aux journées du 5 au 9 juillet" (idem).
Dans son livre Les Soviets en Russie, Anweiler 9 utilise ces analyses pour essayer de démontrer que "Ainsi se trouvait pour la première fois érigée en but, sous une forme à peine voilée, la dévolution exclusive du pouvoir aux bolcheviks, but jusqu'alors camouflé sous le mot d'ordre 'tout le pouvoir aux soviets'" 10.
Ici apparaît l'accusation désormais célèbre et maintes fois réitérée selon laquelle Lénine aurait "utilisé les soviets de façons tactique pour conquérir le pouvoir absolu". Une analyse de l'article que Lénine a écrit par la suite démontre toutefois que ses préoccupations étaient radicalement différentes de celles que lui attribue Anweiler : il cherchait comment sortir les soviets de la crise dans laquelle ils se débattaient, comment les tirer du mauvais pas qui conduisait à leur disparition.
Dans l'article "À propos des mots d’ordre", Lénine s’est prononcé sans équivoque : "Après l'expérience de juillet 1917, c'est précisément le prolétariat révolutionnaire qui doit prendre lui-même le pouvoir : hors de là, pas de victoire possible pour la révolution (…) Les Soviets pourront et devront faire leur apparition dans cette nouvelle révolution ; pas les Soviets d'aujourd'hui, pas ces organes d'entente avec la bourgeoisie, mais des organes de lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie. Nous resterons, alors aussi, partisans d'un État bâti sur le type des Soviets, c'est certain. Il ne s'agit pas de disserter sur les Soviets en général, mais de combattre la contre-révolution actuelle et la trahison des Soviets actuels" 11. Plus précisément, il affirme : "Un nouveau cycle commence, où entrent les classes, les partis, les Soviets, non pas anciens, mais rénovés au feu des combats, aguerris, instruits, régénérés à travers la lutte" (idem).
Ces écrits de Lénine s’inscrivaient dans un débat orageux qui traversa les rangs du Parti bolchevique, et se cristallisa lors du VIe Congrès du Parti, qui se tint du 26 juillet au 3 août dans la clandestinité la plus rigoureuse et en l’absence de Lénine et de Trotsky, particulièrement recherchés par la police. Dans ce Congrès, trois positions s’exprimèrent : la première, désorientée par la défaite de juillet et par la dérive des soviets, préconisait ouvertement de "les négliger" (Staline, Molotov, Sokolnikov) ; la seconde plaidait pour maintenir tel quel l'ancien mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" ; la troisième préconisait de s’appuyer sur les organisations "de base" (conseils d'usines, soviets locaux, soviets de quartiers) pour reconstituer le pouvoir collectif des travailleurs.
A la mi-juillet, les masses commencent à récupérer
Cette dernière position tapait dans le mille. Dès la mi-juillet, les organisations soviétiques "de base" avaient entamé un combat pour la rénovation des soviets.
Dans le deuxième article de cette série, nous avons vu qu'autour des soviets, les masses s’étaient organisées dans un gigantesque réseau d'organisations soviétiques de tout type, qui exprimaient leur unité et leur force 12. Le sommet du réseau soviétique – les soviets des villes – ne flottait pas sur un océan de passivité des masses ; celles-ci, bien au contraire, exprimaient une intense vie collective concrétisée par des milliers d'assemblées, de conseils d’usines, de soviets de quartiers, d’assemblées interdistricts, de conférences, rencontres, meetings… Dans ses Mémoires, Soukhanov 13 nous donne une idée de l'atmosphère qui régnait lors de la Conférence des Conseils d’usine de Petrograd : " Le 30 mai s'ouvrit dans la salle Blanche une conférence des comités de fabrique et d'usine de la capitale et des environs. Cette conférence avait été préparée "à la base" ; son plan avait été mis au point dans les usines sans aucune participation des organismes officiels chargés des questions du travail, ni même des organes du Soviet. (…). La conférence était réellement représentative : des ouvriers venus de leurs établis participèrent en grand nombre et activement à ses travaux. Pendant deux jours, ce Parlement ouvrier discuta de la crise économique et de la débâcle dans le pays" 14
Même aux pires moments qui succédèrent aux journées de juillet, les masses purent conserver ces organisations, qui furent moins touchées par la crise que "les grands organes soviétiques" : le Soviet de Petrograd, le Congrès des soviets et son Comité exécutif, le CEC (Comité exécutif central).
Deux raisons concomitantes expliquent cette différence : d'abord, les organisations soviétiques "d’en bas" étaient directement convoquées sous la pression des masses qui, ressentant des problèmes ou des dangers, appelaient à la tenue d'une assemblée et parvenaient à la tenir en quelques heures. La situation des organes soviétiques "d’en haut" était très différente : "Mais ce qu'il [le Soviet] gagnait en matière de bon fonctionnement, il le perdait sur le plan du contact direct avec une partie considérable des masses. Quasi quotidiennes pendant ses premières semaines d'existence, les séances plénières du Soviet allaient s'espaçant et n'attiraient souvent qu'un nombre restreint de députés. L'Exécutif du soviet s'affranchissait à vue d'œil de la surveillance que les députés étaient censés exercer sur lui." 15
Deuxièmement, mencheviks et SR se concentrèrent dans le noyau bureaucratique des grands organes soviétiques. Soukhanov, décrit l'atmosphère d’intrigues et de manipulations qui émanait du Soviet de Pétrograd : "Le Présidium du Soviet, qui avait été à l'origine un organe de procédure intérieure, tendit à se substituer au Comité exécutif dans ses fonctions, et à le supplanter. En outre, il se renforça d'un organisme permanent et quelque peu occulte qui reçut le nom de "Chambre des Etoiles". On y retrouvait les membres du Présidium et une sorte de camarilla composée d'amis dévoués à Tchkhéidzé et à Tseretelli. Ce dernier, avec tout le déshonneur et toute l'indignité que cela comportait, devint l'un des responsables du dictatorialisme au sein du Soviet." 16
Par contre, les bolcheviks menaient une intervention active et quotidienne dans les organes soviétiques de base. Leur présence était très dynamique, ils étaient souvent les premiers à proposer des assemblées et des débats, l'adoption de résolutions capables de donner une expression à la volonté et à l'avancée des masses.
Le 15 juillet, une manifestation d’ouvriers des grandes usines de Petrograd se concentra devant le bâtiment du Soviet, dénonçant les calomnies contre les bolcheviks et exigeant la libération des prisonniers. Le 20 juillet, l'assemblée de l'usine d'armements de Sestroretsk demandait le règlement des salaires qui avaient été retenus aux ouvriers pour leur participation aux journées de juillet ; ils consacrèrent l’argent récupéré à financer la presse contre la guerre. Trotsky raconte comment, le 24 juillet, "une assemblée des ouvriers de vingt-sept entreprises du district de Peterhof vota une résolution protestant contre le gouvernement irresponsable et sa politique contre-révolutionnaire" 17
Trotsky souligne aussi que le 21 juillet arrivèrent à Petrograd des délégations de soldats du front. Ils étaient las des souffrances qu'ils y avaient vécues et de la répression que les officiers déchaînaient contre les éléments les plus en vue. Ils s’adressèrent au Comité exécutif du Soviet qui n’en fit pas le moindre cas. Plusieurs militants bolcheviques leur conseillèrent alors de prendre contact avec les usines et les régiments de soldats et de marins. L'accueil y fut radicalement différent : ils furent reçus comme des frères, écoutés, nourris et logés. "Dans une conférence que personne d'en haut n'avait convoquée, qui avait surgi d'en bas, il y eut, comme participants, des délégués de vingt-neuf régiments du front, de quatre-vingt-dix usines de Petrograd, de matelots de Kronstadt et des garnisons de la banlieue.
Au centre de la conférence se trouvaient des délégués venus des tranchées; parmi eux, il y avait aussi quelques jeunes officiers. Les ouvriers de Petrograd écoutaient les hommes du front avec avidité, tâchant de ne pas perdre un mot de ce qu'ils disaient. Ceux-ci racontaient comment l'offensive et ses conséquences dévoraient la révolution. D'obscurs soldats, qui n'étaient pas du tout des agitateurs, décrivaient dans des causeries simplistes le traintrain journalier de la vie du front. Ces détails étaient bouleversants, car ils montraient clairement la remontée de tout ce qui était le plus détesté dans le vieux régime", indique Trotsky qui ajoute ensuite : "Bien que, parmi les délégués du front, les socialistes-révolutionnaires fussent vraisemblablement en majorité, une violente résolution bolcheviste fut adoptée presque à l'unanimité : il n'y eut que quatre abstentions. La résolution adoptée ne restera pas lettre morte : une fois séparés, les délégués raconteront la vérité, diront comment ils ont été repoussés par les leaders conciliateurs et comment ils ont été reçus par les ouvriers" (idem).
Le soviet de Kronstadt – un des postes d'avant-garde de la révolution – se fit aussi entendre : "Le 20 juillet, un meeting sur la place de l'Ancre exige la remise du pouvoir aux soviets, l'envoi au front des Cosaques ainsi que des gendarmes et des sergents de ville, l'abolition de la peine de mort, l'admission à Tsarskoié-Sélo de délégués de Kronstadt pour vérifier si Nicolas II, dans sa détention, est suffisamment et rigoureusement surveillé, la dislocation des "Bataillons de la mort", la confiscation des journaux bourgeois, etc." (idem). À Moscou, les conseils d'usine avaient décidé de tenir des sessions communes avec les comités de régiment et, fin juillet, une Conférence de conseils d’usines à laquelle furent invités des délégués des soldats adopta une résolution de dénonciation du gouvernement et la revendication de "nouveaux soviets pour remplacer le gouvernement". Lors des élections, le premier août, six des dix conseils de quartier de Moscou avaient une majorité bolchevique.
Face aux augmentations de prix décidées par le Gouvernement et aux fermetures d'usines organisées par les patrons, grèves et manifestations massives commencèrent à proliférer. Y prenaient part des secteurs de la classe ouvrière jusqu'alors considérés comme "attardés" (papier, tanneries, caoutchouc, concierges, etc.).
Dans la section ouvrière du Soviet de Petrograd, Soukhanov rapporte un fait significatif : "La section ouvrière du Soviet créa un Présidium, qu'elle ne possédait pas auparavant, et ce Présidium se trouva composé de bolcheviks" 18.
En août se tint à Moscou une Conférence nationale dont l'objectif était, comme le dénonce Soukhanov, "d'étouffer l'opinion de "toute la démocratie" à l'aide de l'opinion de "tout le pays", libérant ainsi le gouvernement de "toute la nation" de la tutelle de toutes sortes d'organisations ouvrières, paysannes, zimmerwaldiennes, semi-allemandes, semi-juives, et autres groupes de voyous" 19.
Les travailleurs perçurent le danger et de nombreuses assemblées votèrent des motions proposant la grève générale. Le Soviet de Moscou les rejeta toutefois, par 364 votes contre 304, mais les soviets de quartier protestèrent contre cette décision, "les usines réclamèrent immédiatement de nouvelles élections au soviet de Moscou, qui s'était non seulement laissé distancer par les masses, mais était tombé dans un grave antagonisme avec elles. Dans le soviet de rayon de Zamoskvorietchie (faubourg de Moscou au sud de la Moscova), en accord avec les comités d'usine, on exigea que les députés qui avaient marché 'contre la volonté de la classe ouvrière' fussent remplacés, et cela par cent soixante-quinze voix contre quatre, devant dix-neuf abstentions !" 20 plus de 400 000 travailleurs entrèrent en grève, laquelle s’étendit à d'autres villes comme Kiev, Kostrava et Tsatarin.
La mobilisation et l’auto-organisation des masses fait échouer le coup de Kornilov
Ce que nous venons de rapporter ne constitue qu'un petit nombre de faits significatifs, pointe de l'iceberg d'un processus très vaste qui montre le tournant marqué par rapport aux attitudes qui avaient prédominé de février à juin, plus passives, encore marquée de beaucoup d'illusions et à la mobilisation qui était restée plus restreinte aux lieux de travail, aux quartiers ou à la ville :
– les assemblées unitaires de travailleurs et de soldats, ouvertes à des délégués paysans, prolifèrent. Les conférences de soviets de quartiers et d'usines invitent à leurs travaux des délégués des soldats et des marins ;
– la confiance croissante envers les bolcheviks : calomniés en juillet, l'indignation vis-à-3vis de la persécution dont ils furent victimes, alimente la reconnaissance toujours plus vaste de la validité de leurs analyses et de leurs mots d’ordre ;
– la multiplication de revendications exigeant la rénovation des soviets et la prise du pouvoir.
La bourgeoisie ressent que les succès obtenus en juillet risquent de partir en fumée. L'échec de la Conférence nationale de Moscou a été un coup dur. Les ambassades anglaise et française poussent à prendre des mesures "décisives". C’est dans ce contexte qu’apparaît le "plan" de coup militaire du général Kornilov 21. Soukhanov souligne que "Milioukov, Rodzianko et Kornilov, eux, comprirent ! Frappés de stupeur, ces vaillants héros de la révolution se mirent à préparer d'urgence, mais en secret, leur action. Pour donner le change, ils ameutèrent l'opinion contre une entreprise prochaine des bolcheviks" 22.
Nous ne pouvons pas ici faire une analyse de tous les détails de l'opération 23. L’important est que la mobilisation gigantesque des masses d’ouvriers et de soldats parvint à paralyser la machine militaire déchaînée. Et ce qui est remarquable, c’est que cette réponse eut lieu en développant un effort d'organisation qui donnera le coup de pouce définitif à la régénération des soviets et à leur marche vers la prise du pouvoir.
Dans la nuit du 27 août, le Soviet de Pétrograd proposa la formation d'un Comité militaire révolutionnaire pour organiser la défense de la capitale. La minorité bolchevique accepta la proposition mais ajouta qu'un tel organe "devait s'appuyer sur les masses des ouvriers et des soldats" 24. Au cours de la session suivante, les bolcheviks firent une nouvelle proposition, acceptée à contrecœur par la majorité menchevique, "le partage des armes dans les usines et les quartiers ouvriers" (idem.) chose qui, dès qu'elle fut annoncée, donna lieu à ce que "Dans les quartiers, d'après la presse ouvrière, se formèrent aussitôt "des files impressionnantes d'hommes désireux de faire partie de la Garde rouge". Des cours s'ouvrirent pour le maniement du fusil et le tir. En qualité de moniteurs, on fit venir des soldats expérimentés. Dès le 29, des compagnies (droujiny) se formèrent dans presque tous les quartiers. La Garde rouge se déclara prête à faire avancer immédiatement un effectif comptant quarante mille fusils (…) L'entreprise géante de Poutilov devient le centre de la résistance dans le district de Peterhof. On crée en hâte des droujiny de combat. Le travail dans l'usine marche et jour et nuit : on s'occupe du montage de nouveaux canons pour former des divisions prolétariennes d'artillerie". 25.
A Petrograd, "… les soviets de quartier se resserrèrent entre eux et décidèrent de déclarer la conférence interdistricts ouverte en permanence ; d'introduire leurs représentants dans l'état-major formé par le Comité exécutif ; de créer une milice ouvrière ; d'établir le contrôle des soviets de quartiers sur les commissaires du gouvernement ; d'organiser des équipes volantes pour l'arrestation des agitateurs contre-révolutionnaires" (idem.). Ces mesures "représentaient l'appropriation d'importantes fonctions, non seulement du gouvernement mais même du Soviet de Pétrograd (…) L'entrée des quartiers de Pétrograd dans l'arène de la lutte modifia du coup la direction et l’ampleur de celle-ci. De nouveau se découvrit, par l'expérience, l’inépuisable vitalité de l'organisation soviétique : paralysée d'en haut par la direction des conciliateurs, elle se ranimait, au moment critique, en bas, sous l'impulsion des masses" (idem. souligné par nous)
Cette généralisation de l'auto-l'organisation des masses s’étendit à tout le pays. Trotsky cite le cas de Helsingfors, où "l'assemblée générale de toutes les organisations soviétiques créa un Comité révolutionnaire qui délégua à la maison du général-gouverneur, à la Kommandantur, au contre-espionnage et à d'autres très importantes institutions ses commissaires. Dès lors, sans la signature de ces derniers, pas un ordre n'est valable. Les télégraphes et les téléphones sont pris sous contrôle" (idem), et il se passa un événement très significatif : "Le lendemain, au Comité, se présentent des Cosaques du rang, ils déclarent que tout le régiment est contre Kornilov. Des représentants des Cosaques sont pour la première fois introduits dans le Soviet" (idem).
Septembre 1917 : la rénovation totale des soviets
L’écrasement du coup de Kornilov provoqua une inversion spectaculaire du rapport de forces entre les classes : le Gouvernement provisoire de Kerenski avait été en-dessous de tout. Les masses furent les seuls protagonistes de ces événements, par dessus tout, à travers le renforcement et la revitalisation générale de leurs organes collectifs. La réponse à Kornilov fut "le départ d'une transformation radicale de toute la conjoncture, une revanche sur les Journées de Juillet. Le Soviet pouvait renaître !" 26
Le journal du parti cadet 27, Retch, ne se trompait pas quand il indiquait : "Dans les rues sont déjà présents des multitudes de travailleurs armés qui terrorisent les habitants pacifiques. Dans les soviets, les bolcheviks exigent énergiquement la liberté de leurs camarades emprisonnés. Tout le monde est convaincu qu'une fois terminé le mouvement du général Kornilov, les bolcheviks, rejetés par la majorité du Soviet, emploieront toute leur énergie à l’obliger à suivre, ne serait-ce que partiellement, leur programme". Retch se trompait toutefois sur une chose : ce ne furent pas les bolcheviks qui obligèrent le soviet à suivre leur programme, ce furent les masses qui obligèrent les soviets à adopter le programme bolchevique.
Les ouvriers avaient acquis une énorme confiance en eux-mêmes et ils voulaient l'appliquer à la rénovation totale des soviets. Ville après ville, soviet après soviet, dans un processus vertigineux, les vieilles majorités social-traîtres furent écartées et de nouveaux soviets à majorité bolchevique et autres groupements révolutionnaires (socialistes-révolutionnaires de gauche, mencheviks internationalistes, anarchistes) émergeaient après des débats et des votes massifs.
Soukhanov décrit ainsi l'état d'esprit des travailleurs et des soldats : "Poussés par l'instinct de classe et, dans une certaine mesure, la conscience de classe ; par l'influence idéologique organisée des bolcheviks ; las de la guerre et des charges qui en découlaient ; déçus par la stérilité de la révolution qui ne leur avait encore rien donné ; irrités contre les maîtres et les gouvernants qui jouissaient, eux, de toutes leurs aises ; désireux enfin d'user du pouvoir conquis, ils souhaitaient livrer une bataille décisive" 28.
Les épisodes de cette reconquête et de la rénovation des soviets sont légion. "Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, toujours sous la présidence du même Tchkhéidzé, le Soviet vota pour le pouvoir des ouvriers et des paysans. Les membres de la base des factions conciliatrices soutinrent presque tous la résolution des bolcheviks. La motion concurrente de Tsérételli recueillit une quinzaine de voix. Le présidium conciliateur n'en croyait pas ses yeux. De droite, l'on exigea un vote nominal qui dura jusqu'à trois heures du matin. Pour ne point voter ouvertement contre leurs partis, bien des délégués sortirent. Et pourtant, malgré tous les moyens de pression, la résolution des bolcheviks obtint, après pointage, 279 voix contre 115. C'était un fait de grande importance. C'était le commencement de la fin. Le présidium, abasourdi, déclara qu'il déposait ses pouvoirs" 29.
Le 2 septembre, une Conférence de tous les soviets de Finlande adopte une résolution pour la remise du pouvoir aux soviets, par 700 voix pour, 13 contre et 36 abstentions. La Conférence régionale des soviets de toute la Sibérie approuve une résolution dans le même sens. Le Soviet de Moscou va également dans le même sens le 5 septembre, lors d’une session dramatique, où est approuvée une motion de défiance envers le Gouvernement provisoire et le Comité exécutif. "Le 8, la résolution des bolcheviks est adoptée au Soviet des députés ouvriers de Kiev par une majorité de 130 voix contre 66, bien que la fraction bolcheviste officielle ne comptât que 95 membres" (idem). Pour la première fois, le Soviet de députés paysans de la province de Petrograd choisit un bolchevik comme délégué.
Le moment culminant de ce processus a été la session historique du Soviet de Petrograd, le 9 septembre. D’innombrables réunions dans des usines, les quartiers et les régiments l'avaient préparée. Environ 1000 délégués allèrent à une réunion où le Bureau proposa d’annuler le vote du 31 août. Le vote exprima un résultat qui signifiait le rejet définitif de la politique des social-traîtres : 519 votes contre l’annulation et pour la prise du pouvoir par les soviets, 414 votes pour le présidium et 67 abstentions.
On pourrait penser, en regardant les choses de manière superficielle, que la rénovation des soviets n’a été qu’un simple changement de majorité, celle-ci passant des social-traîtres aux bolcheviks.
Il est certain – et nous le traiterons plus longuement dans le prochain article de cette série – que dans la classe ouvrière et, par conséquent, dans ses partis, pesait encore fortement une vision contaminée par le parlementarisme, selon laquelle la classe choisissait "des représentants qui agissaient en son nom", mais il est important de comprendre que là n’était pas l’essentiel de la rénovation des soviets.
1) La rénovation se construit sur l'énorme réseau de réunions des soviets de base (conseils d'usine, de quartiers, comités de régiment, réunions conjointes). Après le coup de Kornilov, ces réunions se multiplièrent à l'infini. Chaque session de soviet unifiait et donnait une expression décisive à une infinité de réunions préparatoires.
2) Cette auto-organisation des masses fut propulsée de manière consciente et active par les soviets renouvelés. Tandis que les soviets précédents s’autonomisaient et ne convoquaient que de rares sessions massives, les nouveaux convoquaient quotidiennement des sessions ouvertes. Alors que les anciens soviets craignaient et désapprouvaient même les assemblées dans les usines et les quartiers, les nouveaux les convoquaient continuellement. Autour de chaque débat significatif ou important, le soviet appelait à tenir des réunions "à la base" pour adopter une position. Face à la 4e coalition du Gouvernement provisoire (25 septembre) : "Outre la résolution du Soviet de Saint-Pétersbourg refusant de soutenir la nouvelle coalition, une vague de meetings déferla à travers les deux capitales et la province. Des centaines de milliers d'ouvriers et de soldats, protestant contre la formation du nouveau gouvernement bourgeois, s'engagèrent à mener contre lui une lutte résolue et exigèrent le pouvoir les Soviets." 30
3) La multiplication de congrès régionaux de soviets – qui parcourent comme une traînée de poudre tous les territoires russes depuis le milieu de septembre – s'avère spectaculaire. "Durant ces semaines se tiennent de nombreux congrès de soviets locaux et régionaux, dont la composition et le développement reflétaient l'atmosphère politique des masses. Le déroulement du Congrès de Conseils députés ouvriers, soldats et paysans à Moscou dans les premiers jours d'octobre fut significatif de la bolchevisation rapide. Alors qu'au début de la réunion la résolution présentée par les SR, qui s’opposait à la cession du pouvoir aux soviets, recueillait 159 votes contre 132, la fraction bolchevique obtenait trois jours plus tard, lors d’un autre vote, 116 votes contre 97. Dans d'autres congrès de conseils furent aussi acceptées les résolutions bolcheviques, qui exigeaient la prise du pouvoir par les soviets et la destitution du Gouvernement provisoire. A Ekaterinbourg, 120 délégués de 56 Conseils de l'Oural se réunirent le 13 octobre, 95 parmi eux étaient bolcheviks. A Saratov, le Congrès territorial de la région de la Volga rejeta une résolution menchevique-SR et adopta la résolution bolchevique" 31.
Mais il est important de préciser deux éléments qui nous paraissent fondamentaux.
Le premier est le fait que les résolutions bolcheviques obtiennent la majorité signifiait beaucoup plus qu'une simple délégation de vote à un parti. Le Parti bolchevique était le seul parti clairement partisan non seulement de la prise du pouvoir mais mettant en avant une façon concrète de le faire : une insurrection consciemment préparée qui renverserait le Gouvernement provisoire et démonterait le pouvoir de l'État. Tandis que les partis social-traîtres annonçaient qu'ils voulaient obliger les soviets à se faire hara-kiri, tandis que d'autres partis révolutionnaires faisaient des propositions irréalistes ou vagues, seuls les bolcheviks étaient convaincus que "… le Soviet de députés ouvriers et soldats ne peut être qu'un organisme insurrectionnel, qu'un organe du pouvoir révolutionnaire. Sinon les Soviets ne sont que de vains hochets qui conduisent infailliblement à l'apathie, à l'indifférence, au découragement des masses légitimement écoeurées par la répétition perpétuelle de résolutions et de protestations" 32
Il était donc naturel que les masses ouvrières accordent leur confiance aux bolcheviks, non pour leur donner un chèque en blanc, mais comme instrument de leur propre combat qui arrivait à son point culminant : l'insurrection et la prise du pouvoir.
"Le camp de la bourgeoisie s'alarma enfin avec raison. La crise était claire pour chacun. Le mouvement des masses, visiblement, débordait ; l'effervescence dans les quartiers ouvriers de Saint-Pétersburg était manifeste. On n'écoutait que les bolcheviks. Devant le fameux Cirque Moderne, où venaient parler Trotsky, Volodarski, Lounatcharski, on voyait des queues sans fin et des foules que le vaste bâtiment ne pouvait plus contenir. Les agitateurs invitaient à passer des discours aux actes et promettaient le pouvoir au Soviet pour le plus proche avenir." ; c'est ainsi que Soukhanov, pourtant adversaire des bolcheviks, décrivait l'atmosphère régnant à la mi-octobre 33.
Deuxièmement, les faits qui s'accumulent en septembre et octobre révèlent un changement important dans la mentalité des masses. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent de la série, le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux soviets", énoncé timidement en mars, argumenté théoriquement par Lénine en avril, massivement proclamé lors des manifestations de juin et juillet, avait été jusqu'alors davantage une aspiration qu'un programme d'action consciemment assumé.
Une des raisons de l'échec du mouvement de juillet était que la majorité réclamait que les Soviets "obligent" le Gouvernement provisoire à nommer des "ministres socialistes".
Cette division entre Soviet et Gouvernement révélait une incompréhension évidente de la tâche de la révolution prolétarienne, qui n'est certainement pas de "choisir son gouvernement" et de conserver par conséquent la structure du vieil État, mais bien de détruire l’appareil d'État et d’exercer le pouvoir directement. Dans la conscience des masses, bien que, comme nous le verrons dans un prochain article, la multitude de problèmes nouveaux et les confusions ait été considérable, se faisait jour une compréhension beaucoup plus concrète et précise du mot d’ordre "Tout le pouvoir aux soviets".
Trotsky montre comment, ayant perdu le contrôle du Soviet de Petrograd, les social-traîtres emportèrent tous les moyens à leur disposition, les concentrant dans leur dernier bastion : le CEC : "Le Comité exécutif central supprima en temps voulu au Soviet de Pétrograd les deux journaux qu'il avait créés, tous les services de direction, toutes les ressources financières et techniques, y compris les machines à écrire et les encriers. De nombreuses automobiles qui, depuis les Journées de Février, avaient été mises à la disposition du Soviet, se trouvèrent sans exception livrées à l'Olympe conciliateur. Les nouveaux dirigeants n'avaient ni caisse, ni journal, ni appareils de bureaux, ni moyen de transport, ni porte-plume, ni crayons. Rien que des murs dépouillés et l'ardente confiance des ouvriers et des soldats. Cela se trouva parfaitement suffisant" 34.
Le Comité militaire révolutionnaire, organe soviétique de l'insurrection
Début octobre, une marée de résolutions provenant de soviets du pays tout entier réclame la tenue du Congrès des soviets, reportée constamment par les social-traîtres, dans le but de matérialiser la prise du pouvoir.
Cette orientation constitue une réponse tant à la situation en Russie qu’à la situation internationale. En Russie, les révoltes de paysans se répandent dans presque toutes les régions, la prise des terres est généralisée ; dans les casernes, les soldats désertent et retournent dans leurs villages, manifestant une fatigue croissante face à une situation de guerre inextricable ; dans les usines, les travailleurs doivent faire face au sabotage de la production par une partie des chefs d'entreprise et des cadres supérieurs ; l’ensemble de la société est menacée par la famine, due au désapprovisionnement total et à la pénurie, au coût de la vie qui ne cesse de croître. Sur le front international se multipliaient les désertions, l'insubordination de troupes, les fraternisations entre soldats des deux bords, ;une vague de grèves balaye l’Allemagne, une grève générale explose en août 1917 en Espagne. Le prolétariat russe doit prendre le pouvoir non seulement pour répondre aux problèmes insolubles du pays mais, surtout, pour ouvrir une brèche par laquelle puisse se développer la révolution mondiale contre les souffrances terribles causées par trois années de guerre.
La bourgeoisie utilise ses armes contre la montée révolutionnaire des masses. En septembre, elle tente de tenir une conférence démocratique qui échoue à nouveau, comme celle de Moscou. De leur côté, les social-traîtres font tout leur possible pour retarder le Congrès des soviets, dans le but de maintenir dispersés et désorganisés les soviets de tout le pays et d'éviter ainsi leur unification pour la prise du pouvoir.
Mais l'arme la plus redoutable et qui se précise toujours plus est la tentative de saboter la défense de Petrograd pour que l'armée allemande écrase le bastion le plus avancé de la révolution. Kornilov, le "patriote", avait déjà tenté ce coup en août, quand il abandonna la Riga 35 révolutionnaire à l'invasion des troupes allemandes qui y "rétablirent l'ordre" dans le sang. La bourgeoisie, qui fait de la défense nationale son credo, l’utilise comme pire poison contre le prolétariat, n'hésite pas une seconde à s’allier avec ses pires rivaux impérialistes quand elle voit son pouvoir menacé par l'ennemi de classe.
C'est à partir de cette question de la défense de Petrograd, que les discussions du Soviet aboutirent à la formation d'un Comité militaire révolutionnaire, composé de délégués élus du Soviet de Petrograd, de la Section de soldats de ce Soviet, du Soviet de délégués du Carré baltique, de la Garde rouge, du Comité régional des soviets de la Finlande, de la Conférence des conseils d'usine, du Syndicat ferroviaire et de l'Organisation militaire du Parti bolchevique. À la tête de ce Comité fut nommé Lasimir, un jeune et combatif membre des SR de Gauche. Les objectifs de ce comité concernaient tant la défense de Petrograd que la préparation du soulèvement armé, deux objectifs qui "s'excluaient jusqu'alors l'un l'autre, se rapprochaient maintenant en fait : ayant pris en main le pouvoir, le Soviet devra se charger aussi de la défense militaire de Petrograd" 36.
Le lendemain même fut convoquée une Conférence permanente de toute la garnison de Petrograd et de la région. Avec ces deux organismes, le prolétariat se dotait des moyens pour l'insurrection, moyens nécessaire et indispensable pour la prise du pouvoir.
Dans un précédent article de la Revue internationale, nous avons mis en évidence comment – à l’encontre des légendes tissées par la bourgeoisie qui présente Octobre comme "un coup d'État bolchevique" – l'insurrection a été l’œuvre des soviets et plus concrètement de celui de Pétrograd 37. Les organes qui ont préparé méticuleusement, pas à pas, la défaite armée du Gouvernement provisoire, dernier rempart de l'État bourgeois, furent le Comité militaire révolutionnaire et la Conférence permanente des garnisons. Le CMR obligea le Quartier général de l'armée à soumettre à son aval tout ordre et toute décision, aussi insignifiants soient-ils, le paralysant ainsi totalement. Le 22 octobre, lors d’une assemblée dramatique, le dernier régiment récalcitrant – celui de la forteresse Pierre et Paul- accepta de se soumettre au CMR. Le 23 octobre, lors d’une journée émouvante, des milliers d'assemblées de travailleurs et de soldats s’impliquaient définitivement dans la prise du pouvoir. L’échec et mat exécuté par l'insurrection du 25 octobre, qui occupa le Quartier général et le siège du Gouvernement provisoire, défit les derniers bataillons restés fidèles à celui-ci, arrêta des ministres et des généraux, occupa les centres de communications, et posa ainsi les conditions pour que le lendemain, le Congrès des Soviets de toute les Russies assume la prise du pouvoir 38.
Dans le prochain article de cette série, nous verrons les problèmes gigantesques auxquels les soviets durent faire face après la prise du pouvoir.
C.Mir 6-6-10
1 Revue internationale [66] n [66]o [66] 140 [66]
2 Revue internationale [90] n [90]o [90] 141 [90]
3. Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 2, "Les masses exposées aux coups [91]".
4. Voir la réfutation très documentée de cette thèses dans le chapitre "Le mois de la grande calomnie [92]",dans Histoire de la Révolution russe de Trotsky, Tome 2.
5. Le General Knox, chef de la mission anglaise, disait: "Je ne m'intéresse pas au gouvernement de Kerensky, il est trop faible ; il faut une dictature militaire, il faut des Cosaques, ce peuple a besoin du knout ! La dictature est exactement ce qu'il faut." Ainsi s’exprimait le représentant du gouvernement de la plus ancienne démocratie", cité par Trotsky dans "Le soulèvement de Kornilov [93]", Tome 2.
6. Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 2, "Les masses exposées aux coups [91]".
7. Cavaignac : général français (1802-1857), sabre-peuple, bourreau de l’insurrection des ouvriers parisiens en 1848.
8. Lénine, "La situation politique (Quatre thèses) [94]", 23 (10) juillet 1917.
9. Cf. références dans le précédent article de cette série.
10. Les soviets en Russie, Le bolchevisme et les conseils de 1917; Expériences tactiques p 214
11. Lénine, "A propos des mots d’ordre [95]", mi-juillet 1917.
12. Voir l’article précédent de cette série [90], le sous-titre "Mars 1917 : un gigantesque réseau de soviets s'étend sur toute la Russie", Revue internationale no 141.
13. Soukhanov, menchevik internationaliste, scission de gauche du menchevisme dans laquelle militait Martov. Il a publié des Mémoires en 7 tomes. Un abrégé La révolution russe a été publié, d'où nous tirons les citations en français, Editions Stock, 1965.
14. Soukhanov, La révolution russe ; Le Triomphe de la réaction ; Autour de la coalition p. 210.
15. Anweiler, op. cit. Les soviets de 1917 ; Le conseil de Petrograd, p. 134
16. Soukhanov, La révolution russe ; Le Triomphe de la réaction ; Dans les profondeurs p. 223.
17. "Les masses exposées aux coups [91]", Trotsky, op. cit.
18. Soukhanov, La révolution russe ; Contre-révolution et désagrégation de la démocratie ; Après le juillet : deuxième et troisième coalitions, page 306.
19. Soukhanov. La honte de Moscou, page 310
20. "Kérensky et Kornilov [96]", Trotsky, Histoire de la révolution russe, Tome 2.
21. Kornilov : militaire assez incompétent qui se fit remarquer par ses constantes défaites sur le front, puis fut encensé par les partis bourgeois et considéré comme un "héros de la Patrie" après les journées de Juillet.
22. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 312.
23. Voir Trotsky, Histoire de la révolution russe, Tome 2. On peut consulter les chapitres "La contre-révolution relève la tête", "Kérensky et Kornilov", "Le complot de Kérensky" et "Le soulèvement de Kornilov".
24. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 317
25. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "La bourgeoisie se mesure avec la démocratie [97]".
26. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 314
27. Le parti cadet : Parti constitutionnel démocrate, principal parti bourgeois de l’époque.
28. Soukhanov, La désagrégation de la démocratie après le soulèvement de Kornilov, page 330
29. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "Marée montante [98]".
30. Soukhanov, La préparation de l’artillerie, page 351
31. Anweiler, op. cit. Le bolchevisme et les conseils de 1917; Bolchevisation des soviets et préparatifs insurrectionnels, p. 228. Dans les pages suivantes, il fait une liste des nombreux congrès régionaux qui couvrirent pratiquement tout l’empire et décidaient dans leur majorité la prise de pouvoir.
32. Lénine. Thèses pour le rapport à la conférence du 8 octobre de l'organisation de Pétersburg. Sur le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets". 8 octobre 1917.
33. Soukhanov, La préparation de l’artillerie, page 364.
34. La révolution russe, Tome 2, "Marée montante [98]".
35. Capitale de l’Estonie, qui faisait alors partie de l’Empire russe.
36. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "Le Comité militaire révolutionnaire [99]"
37. Voir notre article "La révolution d'Octobre 1917 : œuvre collective du prolétariat", 2e partie, "La prise du pouvoir par les soviets [100]", Revue internationale n° 72, 1er trimestre 1993.
38. Dans notre article "1917, la révolution russe : l'insurrection d'Octobre, une victoire des masses ouvrières [101]", Revue internationale n°91, 4e trimestre 1997, nous développons une analyse détaillée sur la façon dont l'insurrection du prolétariat n'a rien à voir avec une révolte ou une conspiration, quelles sont ses règles et le rôle indispensable que joue en son sein le parti du prolétariat.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VII) : Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme
- 4932 lectures
Comme nous l'avons vu dans le précédent article [103] de la série, l'attaque des révisionnistes contre le marxisme s'est centrée sur la théorie de l'inévitabilité du déclin du capitalisme, selon laquelle les contradictions insolubles existant dans les rapports de production capitalistes constitueront une entrave insurmontable au développement des forces productives. Le révisionnisme d'Edouard Bernstein, que Rosa Luxemburg réfuta de façon si lucide dans sa brochure Réforme sociale ou Révolution, se basait en grande partie sur des observations empiriques qui découlaient de la période d'expansion et de prospérité sans précédent que les nations capitalistes les plus puissantes avaient connue au cours des dernières décennies du 19e siècle. Il ne prétendait guère fonder la critique de la vision "catastrophique" de Marx sur une investigation théorique approfondie des théories économiques de ce dernier. Sous bien des aspects, les arguments de Bernstein étaient similaires à ceux qu'ont développé plus tard beaucoup d'experts bourgeois, au cours du boom économique d'après-guerre et, à nouveau, pendant la phase de "croissance" bien plus précaire des premières années du 21e siècle. C'était en gros : le capitalisme fonctionne, donc il fonctionnera toujours.
Mais d'autres économistes de l'époque, qui n'étaient pas encore complètement déconnectés du mouvement ouvrier, cherchèrent à fonder leur stratégie réformiste sur une démarche "marxiste". Tel fut le cas du Russe Tougan-Baranowsky qui publia, en 1901, un livre intitulé Studies in the Theory and History of Commercial Crises in England. A la suite des travaux de Struve et de Boulgakov quelques années auparavant, Tougan-Baranowski faisait partie de ce qu'on appelait "les marxistes légaux" et son étude s'inscrivait dans la réponse de ceux-ci au courant des populistes russes qui voulaient démontrer que le capitalisme serait confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir en Russie ; l'une de ces difficultés consistant en l'insuffisance de marchés pour écouler sa production. Comme Boulgakov, Tougan tenta d'utiliser les schémas de la reproduction élargie de Marx, dans le Volume II du Capital, pour prouver qu'il n'existait pas de problème fondamental de réalisation de la plus-value dans le système capitaliste, qu'il était possible à ce dernier, comme "système clos", d'accumuler indéfiniment et de manière harmonieuse. Rosa Luxemburg résuma ainsi cette tentative : "Sans aucun doute, les marxistes russes «légaux» ont triomphé de leurs adversaires, les "populistes", mais ils ont trop triomphé. Tous les trois, Struve, Boulgakov, Tougan-Baranowsky ont, dans l'ardeur du combat, prouvé plus qu'il ne fallait. Il s'agissait de savoir si le capitalisme en général et le capitalisme russe en particulier était susceptible de se développer et les trois marxistes cités ont si bien démontré cette capacité qu'ils ont même prouvé par leurs théories la possibilité de la durée éternelle du capitalisme."1
La thèse de Tougan suscita une réponse rapide de la part de ceux qui défendaient toujours la théorie marxiste des crises, en particulier du porte-parole de "l'orthodoxie marxiste", Karl Kautsky qui, reprenant les conclusions de Marx, mit notamment en avant le fait que ni les capitalistes, ni les ouvriers ne pouvant consommer l'ensemble de la plus-value produite par le système, ce dernier était alors sans cesse poussé à conquérir de nouveaux marchés en dehors de lui-même :
"Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché pour les moyens de consommation produits par l'industrie, marché qui s'agrandit avec l'accroissement de la richesse des premiers et le nombre des seconds, moins vite cependant que l'accumulation du capital et que la productivité du travail, et qui ne suffit pas à lui seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. L'industrie doit chercher des débouchés supplémentaires à l'extérieur de sa sphère dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. Elle les trouve et les élargit sans cesse, mais trop lentement. Car ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension de la production capitaliste.
Depuis le moment où la production capitaliste s'est développée en grande industrie, comme c'était déjà le cas en Angleterre au 19e siècle, elle possède la faculté d'avancer par grands bonds, si bien qu'elle dépasse en peu de temps l'extension du marché. Ainsi chaque période de prospérité qui suit une extension brusque du marché est condamnée à une vie brève, la crise y met un terme inévitable. Telle est en quelques mots la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les «marxistes orthodoxes» et fondée par Marx." Kautsky (Neue Zeit n°5, 1902) cité par RL dans la Critique des critiques 2
A peu près à la même époque, en publiant the Theoretical System of Karl Marx 3, un membre de l'aile gauche de l'American Socialist Party, Louis Boudin, a participé au débat avec une analyse similaire et même plus développée, et publiait.
Tandis que Kautsky, comme le souligne Rosa Luxemburg dans L'Accumulation du capital et dans la Critique des critiques (1915), avait posé le problème de la crise en termes de "sous-consommation", et dans le cadre plutôt imprécis de la vitesse relative de l'accumulation et de l'expansion du marché 4, Boudin la situait de façon plus exacte dans le caractère unique du mode de production capitaliste et dans ses contradictions qui l'amenaient au phénomène de surproduction :
"Dans les anciens systèmes esclavagiste et féodal, un problème comme la surproduction n'a jamais existé du fait que la production ayant pour but la consommation familiale, la seule question qui se soit jamais présentée était : quelle part de la production sera attribuée à l'esclave ou au serf et combien ira au propriétaire d'esclave ou au seigneur féodal. Une fois que les parts respectives des deux classes étaient déterminées, chacune procédait à la consommation de sa part sans rencontrer de nouveau problème. En d'autres termes, la question portait toujours sur la façon de diviser les produits et la question de la surproduction ne se posait pas du fait que les produits ne devaient pas être vendus sur le marché mais être consommés par les personnes directement concernées par leur production, en tant que maître ou en tant qu'esclave... Il n'en va pas de même pour notre industrie capitaliste moderne. Il est vrai que toute la production à l'exception de la portion qui va aux ouvriers, va comme par le passé au maître, aujourd'hui au capitaliste. Mais le problème ne se termine pas là du fait que le capitaliste ne produit pas pour lui-même mais pour le marché. Il ne veut pas s'accaparer les biens que produisent les ouvriers mais il veut les vendre et, s'il ne les vend pas, ils n'ont absolument aucune valeur pour lui. Entre les mains du capitaliste, les marchandises vendables sont sa fortune, son capital, mais lorsqu'elles deviennent invendables, toute la fortune contenue dans ses entrepôts de marchandises, fond dès que celles-ci ne sont pas monnayables.
Alors qui va acheter les marchandises à nos capitalistes qui ont introduit de nouvelles machines dans leur production et, de ce fait, grandement augmenté leur production ? Evidemment, d'autres capitalistes peuvent vouloir ces produits mais, quand on considère la production de la société dans son ensemble, que va faire la classe capitaliste de la production accrue que les ouvriers ne peuvent consommer ? Les capitalistes ne peuvent l'utiliser en gardant chacun sa propre production, ni en se l'achetant entre eux. Et cela pour une raison très simple, du fait que la classe capitaliste ne peut utiliser elle-même tout le surproduit que les ouvriers produisent et qu'elle s'approprie en tant que profits de production. C'est déjà exclu par les prémisses mêmes de la production capitaliste à grande échelle et l'accumulation du capital. La production capitaliste à grande échelle implique l'existence de vastes quantités de travail cristallisé sous la forme de chemins de fer, de bateaux à vapeur, d'usines, de machines et d'autres produits manufacturés qui n'ont pas été consommés par les capitalistes et qui représentent leur part ou profit de la production des années précédentes. Comme on l'a déjà établi précédemment, toutes les grandes fortunes de nos rois, princes et barons capitalistes modernes et autres grands dignitaires de l'industrie, avec ou sans titres, consistent en outils sous une forme ou une autre, c'est-à-dire sous une forme non consommable. C'est cette part des profits capitalistes que les capitalistes ont "économisée" et donc non consommée. Si les capitalistes consommaient tout leur profit, il n'y aurait pas de capitalistes dans le sens moderne du mot, il n'y aurait pas d'accumulation de capital. Pour que le capital puisse accumuler, les capitalistes ne doivent en aucune circonstance consommer tout leur profit. Le capitaliste qui le fait, cesse d'être un capitaliste et succombe dans la concurrence avec ses pairs capitalistes. En d'autres termes, le capitalisme moderne présuppose l'habitude d'économiser des capitalistes, c'est à dire que cette part des profits des capitalistes individuels ne doit pas être consommée mais mise de côté pour accroître le capital existant... Il ne peut donc consommer toute sa part du produit manufacturé. Il est donc évident que ni l'ouvrier, ni le capitaliste ne peut consommer l'ensemble du produit accru de la manufacture. Qui donc va l'acheter ?" (traduit de l'anglais par nous)
Boudin essaie ensuite d'expliquer la façon dont le capitalisme traite ce problème. Luxemburg en cite un long passage dans une note de L'Accumulation du capital et le présente comme "une critique brillante" du livre de Tougan 5:
"Le surproduit créé dans les pays capitalistes n'a pas entravé - à quelques exceptions près que nous mentionnerons plus tard - le cours de la production parce que la production a été répartie de façon plus habile dans les différentes sphères ou bien parce que la production de cotonnades a cédé la place à une production de machines mais parce que, à cause du fait que quelques pays se sont transformés plus tôt que d'autres en pays capitalistes, et qu'aujourd'hui encore il reste quelques pays sous-développés du point de vue capitaliste, les pays capitalistes ont à leur disposition un monde véritablement extérieur où ils ont pu exporter les produits qui ne peuvent être consommés par eux-mêmes, que ces produits soient des cotonnades ou des produits sidérurgiques. Ce qui ne veut absolument pas dire que le remplacement des cotonnades par les produits de l'industrie sidérurgique en tant que produits essentiels des pays capitalistes les plus importants serait dénué de signification. Au contraire il est de la plus grande importance, mais sa signification est tout autre que celle que lui prête Tougan-Baranowsky. Elle annonce le début de la fin du capitalisme. Aussi longtemps que les pays capitalistes ont exporté des marchandises pour la consommation, il y avait encore de l'espoir pour le capitalisme de ces pays. Il n'était pas encore question de savoir quelle était la capacité d'absorption du monde extérieur non capitaliste pour les marchandises produites dans les pays capitalistes et combien de temps elle persisterait encore. L'accroissement de la fabrication de machines dans l'exportation des principaux pays capitalistes aux dépens des biens de consommation indique que les territoires qui, autrefois, se trouvaient à l'écart du capitalisme et, pour cette raison, servaient de lieu de décharge pour ses surproduits, sont aujourd'hui entraînés dans l'engrenage du capitalisme et montre encore que leur propre capitalisme se développe et qu'ils produisent eux-mêmes leurs biens de consommation. Aujourd'hui, au stade initial de leur développement capitaliste, ils ont encore besoin de machines produites d'après le mode capitaliste. Mais plus tôt qu'on ne le pense, ils n'en auront plus besoin. Ils produiront eux-mêmes leurs produits sidérurgiques, de même qu'ils produisent dès maintenant leurs cotonnades et leurs principaux biens de consommation. Alors ils cesseront non seulement d'être un lieu d'absorption pour le surproduit des pays capitalistes proprement dits, mais encore ils auront eux-mêmes un surproduit qu'à leur tour ils ne pourront placer que difficilement". (Die Neue Zeit, 25e année, 1e vol., Mathematische Formeln gegen Kart Marx, cité par Luxemburg dans une note du chapitre 23 de L'Accumulation du capital) 6
Boudin va donc plus loin que Kautsky et insiste sur le fait que l'achèvement proche de la conquête du globe par le capitalisme signifie aussi "le début de la fin du capitalisme".
Rosa Luxemburg examine le problème de l'accumulation
A l'époque où ce débat avait lieu, Rosa Luxemburg enseignait à l'école du Parti à Berlin. Y exposant à grands traits l'évolution historique du capitalisme comme système mondial, elle fut amenée à revenir de façon plus approfondie sur les travaux de Marx, à la fois du fait de son intégrité comme professeur et comme militante (elle avait horreur de rabâcher des idées connues en les présentant seulement sous une nouvelle forme mais considérait que c'était la tâche de tout marxiste de développer et d'enrichir la théorie marxiste), et du fait de la nécessité de plus en plus urgente de comprendre les perspectives auxquelles le capitalisme mondial faisait face. En re-examinant Marx, elle avait trouvé beaucoup d'éléments pour soutenir son point de vue selon lequel le problème de la surproduction par rapport au marché constitue une clé pour comprendre la nature transitoire du mode de production capitaliste (voir "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise" dans la Revue n°139). Rosa avait parfaitement conscience que les schémas de la reproduction élargie de Marx dans le Volume II du Capital étaient conçus par leur auteur comme un modèle théorique purement abstrait, utilisé pour étudier la question de l'accumulation, qui, pour la clarté de l'argumentation, prenait comme hypothèse une société uniquement composée de capitalistes et d'ouvriers. Il lui semblait néanmoins qu'il en résultait l'idée que le capitalisme pouvait accumuler de façon harmonieuse dans un système clos, disposant de la totalité de la plus-value produite à travers l'interaction mutuelle des deux branches principales de la production (le secteur des biens de production et celui des biens de consommation). Il apparut à Rosa Luxemburg que c'était en contradiction avec d'autres passages de Marx (dans le Volume III du Capital par exemple) qui insistent sur la nécessité d'une expansion constante du marché et, en même temps, établissent une limite inhérente à cette expansion. Si le capitalisme pouvait s'autoréguler, il pouvait y avoir des déséquilibres temporaires entre les branches de la production mais il ne devait pas y avoir de tendance inexorable à produire une masse de marchandises inabsorbables, de crise de surproduction insoluble ; si la tendance du capitalisme à l'accumulation simplement par elle-même générait constamment l'augmentation de la demande nécessaire pour réaliser l'ensemble de la plus-value, alors comment les marxistes pouvaient-ils argumenter, contre les révisionnistes, que le capitalisme était destiné à entrer dans une phase de crise catastrophique qui fournirait les bases objectives de la révolution socialiste ?
A cette question, Luxemburg répondit qu'il était nécessaire de replacer l'ascendance du capitalisme dans son véritable contexte historique. On ne pouvait saisir l'ensemble de l'histoire de l'accumulation capitaliste que comme un processus constant d'interaction avec les économies non capitalistes qui l'entouraient. Les communautés les plus primitives qui vivaient de chasse et de cueillette et n'avaient pas encore produit de surplus social commercialisable n'avaient aucune utilité pour le capitalisme et devaient être balayées à travers des politiques de destruction directe et de génocide (même les ressources humaines de ces communautés tendaient à être inutilisables pour du travail d'esclave). Mais les économies qui avaient développé un surplus commercialisable et où la production de marchandises en particulier était déjà développée en leur sein (comme dans les grandes civilisations d'Inde et de Chine), fournissaient non seulement des matières premières mais d'énormes débouchés pour la production des métropoles capitalistes, permettant au capitalisme des pays centraux de surmonter l'engorgement périodique de marchandises (ce processus est décrit de façon éloquente dans Le Manifeste communiste). Mais comme le souligne aussi Le Manifeste, même quand les puissances capitalistes établies tentèrent de restreindre le développement capitaliste de leurs colonies, ces régions du monde devinrent inéluctablement parties intégrantes du monde bourgeois, ruinant les économies pré-capitalistes et les convertissant aux délices du travail salarié –déplaçant ainsi le problème de la demande additionnelle requise pour l'accumulation à un autre niveau. Ainsi, comme Marx lui-même l'avait annoncé, plus le capitalisme tendait à devenir universel, plus il était destiné à s'effondrer : "L'universalité vers quoi tend sans cesse le capital rencontre des limites immanentes à sa nature, lesquelles, à un certain stade de son développement, le font apparaître comme le plus grand obstacle à cette tendance et le poussent à son autodestruction." (Grundrisse) 7
Cette démarche permit à Rosa Luxemburg de comprendre le problème de l'impérialisme. Le Capital n'avait fait que commencer à traiter la question de l'impérialisme et de ses fondements économiques, question qui, à l'époque où le livre avait été écrit, n'était pas encore devenue le centre des préoccupations des marxistes. Maintenant, ceux-ci étaient confrontés à l'impérialisme non seulement comme une poussée pour la conquête du monde non capitaliste mais, aussi, comme un aiguisement des rivalités inter-impérialistes entre les principales nations capitalistes pour la domination du marché mondial. L'impérialisme était-il une option, une commodité pour le capital mondial, comme l'entendaient beaucoup de ses critiques libéraux et réformistes, ou était-il une nécessité inhérente à l'accumulation capitaliste à un certain stade de sa maturité ? Là encore, les implications étaient vastes car si l'impérialisme n'était qu'une option supplémentaire pour le capital, on pouvait alors argumenter en faveur de politiques plus raisonnables et pacifiques. Luxemburg conclut cependant que l'impérialisme était une nécessité pour le capital – un moyen de prolonger son règne qui l'entraînait aussi inexorablement vers sa ruine.
"L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes ; il faut tenir compte en effet de la masse énorme du capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler son surproduit et pour capitaliser sa plus-value, et, en outre, de la rapidité avec laquelle les pays pré-capitalistes se transforment en pays capitalistes. Sur la scène internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non capitalistes, plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes." 8
La conclusion essentielle de L'Accumulation du capital était donc que le capitalisme entrait dans "une période de catastrophes". Il est important de noter qu'elle ne considérait pas – comme cela a souvent été dit de façon erronée – que le capitalisme était sur le point de succomber. Elle établit très clairement que le milieu non capitaliste "représente [géographiquement] aujourd'hui encore la plus grande partie du globe" et que des économies non capitalistes existaient non seulement dans les colonies mais dans de grandes parties de l'Europe elle-même 9. Il est certain que l'échelle de ces zones économiques en terme de valeur allait en diminuant relativement à la capacité croissante du capital à générer de nouvelles valeurs. Mais le monde avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir un système de capitalisme pur comme imaginé dans les schémas de la reproduction de Marx :
"Si on le comprend bien, le schéma marxiste de l'accumulation est par son insolubilité même le pronostic exact de l'effondrement économique inévitable du capitalisme, résultat final du processus d'expansion impérialiste, l'expansion se donnant pour but particulier de réaliser ce qui était l'hypothèse de départ de Marx : la domination exclusive et générale du capital.
Ce terme final peut-il être jamais atteint dans la réalité ? Il s'agit à vrai dire d'une fiction théorique, pour la raison précise que l'accumulation du capital n'est pas seulement un processus économique mais un processus politique." 10
Pour Rosa Luxemburg, un monde uniquement constitué de capitalistes et d'ouvriers était "une fiction théorique" mais plus on s'approcherait de ce point, plus le processus d'accumulation deviendrait difficile et désastreux, déchaînant des calamités qui ne seraient pas "simplement" économiques, mais également militaires et politiques. La guerre mondiale qui éclata peu de temps après la publication de L'Accumulation, constituait une confirmation éclatante de ce pronostic. Pour Rosa Luxemburg, il n'y a pas un effondrement purement économique du capitalisme et encore moins un lien automatique, garanti, entre l'effondrement capitaliste et la révolution socialiste. Ce qu'elle annonçait dans son travail théorique était précisément ce qu'allait confirmer l'histoire catastrophique du siècle suivant : la manifestation croissante du déclin du capitalisme comme mode de production, mettant l'humanité face à l'alternative socialisme ou barbarie, et appelant spécifiquement la classe ouvrière à développer l'organisation et la conscience nécessaires au renversement du système et à son remplacement par un ordre social supérieur.
Une tempête de critiques
Rosa Luxemburg pensait que sa thèse n'était pas tellement sujette à controverse, précisément parce qu'elle l'avait fermement basée sur les écrits de Marx et des partisans de sa méthode. Pourtant, elle fut accueillie par un déluge de critiques – non seulement de la part des révisionnistes et des réformistes mais, également, de la part de révolutionnaires comme Pannekoek et Lénine qui, dans ce débat, se trouva non seulement aux côtés des marxistes légaux de Russie mais également des austro-marxistes qui faisaient partie du camp semi-réformiste dans la social-démocratie:
"J'ai lu le nouveau livre de Rosa L'Accumulation du capital. Elle s'embrouille de façon choquante. Elle a distordu Marx. Je suis très content que Pannekoek et Eckstein et O. Bauer l'aient tous condamnée d'un commun accord et exprimé contre elle ce que j'avais dit en 1899 contre les Narodinikis." 11
Le consensus se fit sur l'idée que Luxemburg avait tout simplement mal lu Marx et inventé un problème qui n'existait pas : les schémas de la reproduction élargie montrent que le capitalisme peut en fait accumuler sans aucune limite inhérente dans un monde purement composé d'ouvriers et de capitalistes. Les calculs de Marx sont justes après tout, ça doit donc être vrai. Bauer était un peu plus nuancé : il reconnaissait que l'accumulation ne pouvait avoir lieu que si elle était alimentée par une demande effective croissante, mais il apportait une réponse simple : la population s'accroît, donc il y a plus d'ouvriers, et donc une augmentation de la demande – solution qui revenait au point de départ du problème puisque ces nouveaux ouvriers ne pouvaient toujours consommer que le capital variable qui leur était transféré par les capitalistes. La question essentielle – que maintiennent quasiment tous les critiques de Luxemburg jusqu'à nos jours – est que les schémas de la reproduction montrent en fait qu'il n'existe pas de problème insoluble de réalisation pour le capitalisme.
Luxemburg était très consciente du fait que les arguments développés par Kautsky (ou par Boudin, mais celui-ci était évidemment une figure bien moins connue du mouvement ouvrier) pour défendre au fond la même thèse n'avaient pas provoqué la même indignation :
"Il reste que Kautsky a réfuté en 1902, dans l'ouvrage de Tougan-Baranowsky, exactement les mêmes arguments que ceux que les «experts» opposent aujourd'hui à ma théorie de l'accumulation, et que les «experts» officiels du marxisme attaquent dans mon livre comme une déviation de la foi orthodoxe ce qui n'est que le développement exact, appliqué au problème de l'accumulation, des thèses soutenues par Kautsky il y a quatorze ans contre le révisionniste Tougan-Baranowsky et qu'il appelle "la théorie des crises généralement adoptée par les marxistes orthodoxes"." 12
Pourquoi une telle indignation ? Elle est facile à comprendre venant des réformistes et des révisionnistes qui se préoccupaient avant tout de rejeter la possibilité d'un effondrement du système capitaliste. De la part de révolutionnaires, elle est plus difficile à saisir. Nous pouvons certainement signaler le fait – et il est très significatif du caractère hystérique des réactions- que Kautsky n'avait pas cherché à faire le lien entre ses arguments et les schémas de la reproduction 13 et n'apparut pas, de ce fait, comme un "critique" de Marx. Peut-être ce conservatisme est-il au coeur de beaucoup des critiques portées à Rosa Luxemburg : la vision selon laquelle Le Capital est une sorte de bible qui fournit toutes les réponses pour comprendre l'ascendance et le déclin du mode de production capitaliste – un système fermé en fait ! Luxemburg en revanche défendait avec vigueur que les marxistes devaient considérer Le Capital pour ce qu'il était – une oeuvre de génie mais inachevée, en particulier ses Volumes II et III ; et qui, de toute façon, ne pouvait inclure tous les développements ultérieurs de l'évolution du système capitaliste.
Au milieu de toutes ces réponses scandalisées, il y eut cependant au moins une défense très claire de Luxemburg, écrite au moment des soulèvements de la guerre et de la révolution : "Rosa Luxemburg, marxiste", par le Hongrois Georg Lukàcs, qui était, à ce moment là, un représentant de l'aile gauche du mouvement communiste. L'article de Lukàcs, publié dans le livre Histoire et conscience de classe (1922), commence par souligner la principale considération méthodologique dans la discussion de la théorie de Luxemburg. Il défend l'idée que ce qui distingue fondamentalement la vision prolétarienne de la vision bourgeoise du monde est le fait que, tandis que la bourgeoisie est condamnée par sa position sociale à examiner la société du point de vue d'une unité atomisée, en concurrence, seul le prolétariat peut développer une vision de la réalité comme totalité :
"Ce n'est pas la prédominance des motifs économiques dans l'explication de l'histoire qui distingue de façon décisive le marxisme de la science bourgeoise, c'est le point de vue de la totalité. La domination, déterminante et dans tous les domaines, du tout sur les parties, constitue l'essence de la méthode que Marx a empruntée à Hegel et qu'il a transformée de manière originale pour en faire le fondement d'une science entièrement nouvelle. La séparation capitaliste entre le producteur et le processus d'ensemble de la production, le morcellement du processus du travail en parties qui laissent de côté le caractère humain du travailleur, l'atomisation de la société en individus qui produisent droit devant eux sans plan, sans se concerter, etc., tout cela devait nécessairement avoir aussi une influence profonde sur la pensée, la science et la philosophie du capitalisme. Et ce qu'il y a de fondamentalement révolutionnaire dans la science prolétarienne, ce n'est pas seulement qu'elle oppose à la société bourgeoise des contenus révolutionnaires, mais c'est, au tout premier chef, l'essence révolutionnaire de la méthode même. Le règne de la catégorie de la totalité est le porteur du principe révolutionnaire dans la science."
Il poursuit en montrant que l'absence de cette méthode prolétarienne avait empêché les critiques de Luxemburg de saisir le problème qu'elle avait soulevé dans L'Accumulation du capital :
"... la justesse ou la fausseté de la solution que Rosa Luxemburg proposait au problème de l'accumulation du capital n'était pas le centre du débat conduit par Bauer, Eckstein, etc. On discutait au contraire pour savoir s'il y avait seulement là un problème et l'on contestait avec la dernière énergie l'existence d'un véritable problème. Ce qui peut parfaitement se comprendre, et est même nécessaire du point de vue méthodologique des économistes vulgaires. Car si la question de l'accumulation est d'une part traitée comme un problème particulier de l'économie politique, d'autre part considérée du point de vue du capitaliste individuel, il n'y a là effectivement aucun problème.
Ce refus du problème entier a un lien étroit avec le fait que les critiques de Rosa Luxemburg sont passés distraitement à côté de la partie décisive du livre ("Les conditions historiques de l'accumulation") et, logiques avec eux-mêmes, ont posé la question sous la forme suivante : les formules de Marx qui reposent sur le principe isolant, admis par souci méthodologique, d'une société composée exclusivement de capitalistes et de prolétaires sont-elles justes et quelle en est la meilleure interprétation ? Ce n'était chez Marx qu'une hypothèse méthodologique à partir de laquelle on devait progresser pour poser les questions de façon plus large, pour poser la question quant à la totalité de la société, et c'est ce qui a complètement échappé aux critiques. Il leur a échappé que Marx lui-même a franchi ce pas dans le premier Volume du Capital à propos de ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Ils ont lu – consciemment ou inconsciemment – le fait que justement par rapport à cette question tout Le Capital n'est qu'un fragment interrompu juste à l'endroit où ce problème doit être soulevé, qu'en conséquence Rosa Luxemburg n'a rien fait d'autre que de mener jusqu'au bout, dans le même sens, ce fragment, le complétant conformément à l'esprit de Marx.
Ils ont cependant agi en toute conséquence. Car du point de vue du capitaliste individuel, du point de vue de l'économie vulgaire, ce problème ne doit en effet pas être posé. Du point de vue du capitaliste individuel, la réalité économique apparaît comme un monde gouverné par les lois éternelles de la nature auxquelles il doit adapter son activité. La réalisation de la plus-value et l'accumulation s'accomplissent pour lui sous la forme d'un échange avec les autres capitalistes individuels (à vrai dire, même ici, ce n'est pas toujours le cas, c'est seulement le cas le plus fréquent). Et tout le problème de l'accumulation aussi n'est que le problème d'une des formes des multiples transformations que subissent les formules Argent-Marchandise-Argent et Marchandise-Argent-Marchandise au cours de la production, de la circulation, etc. Ainsi la question de l'accumulation devient pour l'économie vulgaire une question de détail dans une science particulière, et elle n'a pratiquement aucun lien avec le destin du capitalisme dans son ensemble ; sa solution garantit suffisamment l'exactitude des "formules" marxistes qui doivent tout au plus être améliorées –comme chez Otto Bauer – pour être "adaptées à l'époque". Pas plus qu'en leur temps les élèves de Ricardo n'avaient compris la problématique marxiste, Otto Bauer et ses collègues n'ont compris qu'avec ces formules la réalité économique ne peut, par principe, jamais être embrassée puisque ces formules présupposent une abstraction (société considérée comme se composant uniquement de capitalistes et de prolétaires) à partir de la réalité d'ensemble ; ces formules donc ne peuvent servir qu'à dégager le problème, ne sont qu'un tremplin pour poser le vrai problème." 14
Un passage des Grundrisse que Lukàcs ne connaissait pas encore, confirme cette démarche : l'idée que la classe ouvrière constitue un marché suffisant pour les capitalistes est une illusion typique de la vision étroite de la bourgeoisie :
"Nous n'avons pas encore à considérer ici le rapport d'un capitaliste donné aux ouvriers des autres capitalistes. Ce rapport ne fait que révéler l'illusion de chaque capitaliste, mais ne change rien au rapport fondamental capital-travail. Sachant qu'il ne se trouve pas vis-à-vis de son ouvrier dans la situation du producteur face au consommateur, chaque capitaliste cherche à en limiter au maximum la consommation, autrement dit la capacité d'échange, le salaire. Il souhaite, naturellement, que les ouvriers des autres capitalistes consomment au maximum sa propre marchandise ; mais le rapport de chaque capitaliste à ses ouvriers est le rapport général du capital au travail. C'est de là précisément que naît l'illusion que, ses propres ouvriers exceptés, toute la classe ouvrière se compose pour lui de consommateurs et de clients, non d'ouvriers, mais de dépenseurs d'argent. On oublie que, selon Malthus, "l'existence même d'un profit sur n'importe quelle marchandise présuppose une demande extérieure à celle de l'ouvrier qui l'a produite", et que par conséquent "la demande de l'ouvrier lui-même ne peut jamais être une demande adéquate". Etant donné qu'une production en met en mouvement une autre et qu'elle se crée ainsi des consommateurs chez les ouvriers d'un tiers capital, chaque capital a l'impression que la demande de la classe ouvrière, telle qu'elle est posée par la production elle-même, est une "demande adéquate". Cette demande posée par la production elle-même l'incite et doit l'inciter à dépasser les limites proportionnelles où elle devrait produire par rapport aux ouvriers ; d'autre part, si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate." 15
En mettant en question la lettre de Marx, Luxemburg a montré plus que tout autre qu'elle était fidèle à son esprit ; mais il y a bien d'autres écrits de Marx qui pourraient être cités pour défendre l'importance centrale du problème qu'elle souleva.
Dans les prochains articles, nous examinerons comment le mouvement révolutionnaire a cherché à comprendre le processus de déclin du capitalisme tel qu'il s'est déroulé sous ses yeux au cours des décennies tumultueuses de 1914 à 1945.
Gerrard
1 L'Accumulation du capital, chapitre 24 [104].
2 Critique des critiques [105]
3 Parue pour la première fois sous forme de livre publié par Charles Kerr (Chicago) en 1915, cette étude se base sur une série d'articles publiés, de mai 1905 à octobre 1906, dans la revue International Socialist Review.
4. Citation de Rosa Luxemburg : "Ne tenons pas compte de l'ambiguïté des termes de Kautsky, qui appelle cette théorie une explication des crises "par la sous-consommation" ; or une telle explication fait l'objet des railleries de Marx dans le deuxième livre du Capital. Faisons abstraction également du fait que Kautsky ne s'intéresse qu'au problème des crises sans voir, semble-t-il, que l'accumulation capitaliste, en dehors même des variations de la conjoncture, constitue à elle seule un problème. Enfin n'insistons pas sur le caractère vague des affirmations de Kautsky - la consommation des capitalistes et des ouvriers ne croît "pas assez vite" pour l'accumulation, celle-ci a donc besoin d'un "marché supplémentaire" - qui ne cherche pas à saisir avec plus de précision le mécanisme de l'accumulation." (Critique des critiques [105]).
Il est intéressant de noter que tant de critiques de Rosa Luxemburg – y compris ceux qui étaient "marxistes" – l'accusent de sous-consommationisme, alors qu'elle rejette cette notion si explicitement ! Il est évidemment tout à fait exact que Marx argumente à plusieurs occasions que "la raison ultime de toutes les crises réelles est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses" (Le Capital, Volume III, chapitre 30, Ed. La Pléiade, Tome 2, chapitre XVII, page 1206), mais Marx prend soin de préciser qu'il ne se réfère pas "au pouvoir de consommation absolu", mais au "pouvoir de consommation, qui a pour base des conditions de répartition antagoniques qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites. Il est, en outre, restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue." (Le Capital, Volume III, chapitre 15, Ed. La Pléiade, Tome 2, chapitre X, page 1024-25) En d'autres termes, les crises ne résultent pas de la réticence de la société à consommer autant qu'il est physiquement possible, ni du fait que les salaires seraient trop "bas" – ce qu'il faut préciser du fait des nombreuses mystifications à ce sujet qui émanent en particulier de l'aile gauche du capital. Si c'était le cas, on pourrait alors éliminer les crises en augmentant les salaires et c'est précisément ce que Marx ridiculise dans le Volume II du Capital. Le problème réside plutôt dans l'existence de "conditions de répartition antagoniques", c'est à dire dans le rapport du travail salarié lui-même qui doit toujours permettre une "plus-value" en plus de ce que le capitaliste paie aux ouvriers.
5 La principale critique de Luxemburg à Boudin portait sur l'idée apparemment visionnaire selon laquelle les dépenses d'armement constituaient une forme de gaspillage ou de dépenses inconsidérées ; ce point de vue allait à l'encontre de celui de Luxemburg sur "le militarisme, champ d'action du capital", élaboré dans un chapitre du même nom dans L'Accumulation du capital. Mais le militarisme ne pouvait être champ d'accumulation du capital qu'à une époque où existaient des possibilités réelles que la guerre – les conquêtes coloniales pour être exact – ouvrent de nouveaux marchés substantiels pour l'expansion capitaliste. Avec le rétrécissement de ces débouchés, le militarisme devient vraiment un pur gaspillage pour le capitalisme global : même si l'économie de guerre semble fournir une "solution" à la crise de surproduction en faisant tourner l'appareil économique (de façon la plus évidente dans l'Allemagne de Hitler par exemple et pendant la Seconde Guerre mondiale), elle constitue en réalité une immense destruction de valeur.
6 https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_23.htm [106]
7 Editions La Pléiade, Oeuvres, Tome 2, publié sous le nom de Principes d'une critique de l'économie politique, partie II : "Le capital", "Marché mondial et système de besoins", pages 260-61
8 L'Accumulation du capital, III, 31: "Le protectionnisme et l'accumulation [107]".
9 "En réalité dans tous les pays capitalistes, et même dans ceux où la grande industrie est très développée, il existe, à côté des entreprises capitalistes, de nombreuses entreprises industrielles et agricoles de caractère artisanal et paysan, où règne une économie marchande simple. A côté des vieux pays capitalistes il existe, même en Europe, des pays où la production paysanne et artisanale domine encore aujourd'hui de loin l'économie, par exemple la Russie, les pays balkaniques, la Scandinavie, l'Espagne. Enfin, à côté de l'Europe capitaliste et de l'Amérique du Nord, il existe d'immenses continents où la production capitaliste ne s'est installée qu'en certains points peu nombreux et isolés, tandis que par ailleurs les territoires de ces continents présentent toutes les structures économiques possibles, depuis le communisme primitif jusqu'à la société féodale, paysanne et artisanale." (Critique des critiques, I [105]).
Voir l'article "La surproduction chronique, une entrave incontournable de l'accumulation capitaliste [108]" pour une contribution à la compréhension du rôle joué par les marchés extra-capitalistes dans la période de décadence capitaliste.
10 Critique des critiques, [109] II, V [109].
11. Dans La Genèse du Capital chez Marx (The making of Marx's Capital, Pluto Press, 1977), Roman Rosdolsky fait une excellente critique de l'erreur commise par Lénine en se mettant aux côtés des légalistes russes et des réformistes autrichiens contre Luxemburg (p. 472 édition en anglais). Bien qu'il ait lui aussi des critiques à porter à Luxemburg, il insiste sur le fait que le marxisme est nécessairement une théorie "de l'effondrement" et souligne la tendance à la surproduction identifiée par Marx comme étant la question clé pour la comprendre. En fait, ses critiques à Luxemburg sont assez difficiles à déchiffrer. Il insiste sur le fait que la principale erreur de Luxemburg résidait dans le fait qu'elle ne comprenait pas que les schémas de la reproduction étaient simplement un "dispositif heuristique" et, pourtant, toute l'argumentation de Luxemburg contre ses critiques porte précisément sur le fait que ce schéma ne peut qu'être utilisé comme un dispositif heuristique et non comme une description réelle de l'évolution historique du capital, ni comme une preuve mathématique de la possibilité d'une accumulation illimitée. (p.490, édition anglaise)
12 Critique des critiques, I [105].
13. Plus tard, Kautsky s'aligna lui-même sur la position des austro-marxistes : "Dans son oeuvre majeure, il critique fortement "l'hypothèse" de Luxemburg selon laquelle le capitalisme doit s'effondrer pour des raisons économiques ; il affirme que Luxemburg "est en contradiction avec Marx qui a démontré le contraire dans le deuxième Volume du Capital, c'est-à-dire dans les schémas de la reproduction"." (Rosdolsky, op cit., citant Kautsky dans La conception matérialiste de l'histoire, traduit de l'anglais par nous.)
14 In Histoire et conscience de classe, Les Editions de Minuit, pages 47 et 51-52
15. Grundrisse ou Principes d'une critique de l'économie politique; Ed. La Pléiade, Tome II, "II. Le Capital", p.267-268. Marx explique aussi ailleurs que l'idée selon laquelle les capitalistes eux-mêmes peuvent constituer le marché pour la reproduction élargie, est basée sur une incompréhension de la nature du capitalisme : "Le capital poursuit, en effet, non la satisfaction des besoins, mais l'obtention d'un profit, et sa méthode consiste à régler la masse des produits d'après l'échelle de la production et non celle-ci d'après les produits qui devraient être obtenus ; il y a donc conflit perpétuel entre la consommation comprimée et la production tendant à franchir la limite assignée à cette dernière, et comme le capital consiste en marchandises, sa surproduction se ramène à une surproduction de marchandises. Un phénomène bizarre c'est que les mêmes économistes qui nient la possibilité d'une surproduction de marchandises admettent que le capital puisse exister en excès. Cependant quand ils disent qu'il n'y a pas de surproduction universelle, mais simplement une disproportion entre les diverses branches de production, ils affirment qu'en régime capitaliste la proportionnalité des diverses branches de production résulte continuellement de leur disproportion ; car pour eux la cohésion de la production tout entière s'impose aux producteurs comme une loi aveugle, qu'ils ne peuvent vouloir, ni contrôler. Ce raisonnement implique, en outre, que les pays où le régime capitaliste n'est pas développé consomment et produisent dans la même mesure que les nations capitalistes. Dire que la surproduction est seulement relative est parfaitement exact. Mais tout le système capitaliste de production n'est qu'un système relatif, dont les limites ne sont absolues que pour autant que l'on considère le système en lui-même. Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation. En résumé toutes les objections que l'on oppose aux phénomènes si tangibles cependant de la surproduction (phénomènes qui se déroulent malgré ces objections), reviennent à dire que les limites que l'on attribue à la production capitaliste n'étant pas des limites inhérentes à la production en général, ne sont pas non plus des limites de cette production spécifique que l'on appelle capitaliste. En raisonnant ainsi on oublie que la contradiction qui caractérise le mode capitaliste de production, réside surtout dans sa tendance à développer d'une manière absolue les forces productives, sans se préoccuper des conditions de production au milieu desquelles se meut et peut se mouvoir le capital."
Le Capital, Volume III, chapitre 15 : "le développement des contradictions immanentes de la loi [110]", 3e partie.- souligné par nous.
Questions théoriques:
- L'économie [81]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (1e partie)
- 2618 lectures
Nous publions ci-après le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (PCR, parti bolchevique) et dont un des leaders les plus en vue fut Miasnikov (cf. note 1 en fin d'article), d'où l'appellation fréquente de "Groupe de Miasnikov". Ce groupe fait partie de ce qu'on appelle la Gauche communiste 1, au même titre que d'autres groupes en Russie même et dans d'autres parties du monde, en Europe en particulier. Les différentes expressions de ce courant trouvent leur origine dans la réaction à la dégénérescence opportuniste des partis de la Troisième Internationale et du pouvoir des soviets en Russie. Il s'agit là une réponse prolétarienne sous la forme de courants de gauche, comme il en avait existé auparavant face au développement de l’opportunisme de la Seconde Internationale.
Notre présentation
En Russie même, dés 1918, apparaissent au sein du parti bolchevique des fractions de gauche 2 expressions de différents désaccords avec la politique de celui-ci 3. C'est en soi une preuve du caractère prolétarien du bolchevisme. Parce qu'il était une expression vivante de la classe ouvrière, la seule classe qui peut faire une critique radicale et continuelle de sa propre pratique, le parti bolchevique a engendré sans cesse des fractions révolutionnaires. A chaque étape de sa dégénérescence, se sont élevées à l'intérieur même du parti des voix qui protestaient, se sont formés des groupes à l'intérieur du parti ou qui s'en séparaient pour dénoncer l'abandon du programme initial du bolchevisme. Ce n'est que quand le parti a finalement été enterré par ses fossoyeurs staliniens qu'il n'a plus secrété de telles fractions. Les communistes de gauche russes étaient tous des bolcheviks. C'étaient eux qui défendaient une continuité avec le bolchevisme des années héroïques de la révolution, alors que ceux qui les ont calomniés, persécutés et exécutés, aussi célèbres qu'ils aient été, rompaient avec l'essence du bolchevisme.
Le retrait de Lénine de la vie politique fut l'un des facteurs qui précipita l'éclatement d'une crise ouverte dans le parti bolchevique. D'un côté, la fraction bureaucratique, un bloc instable constitué initialement par le "triumvirat" Staline, Zinoviev et Kamenev dont le principal ciment était la volonté d'isoler Trotski, parvenait à consolider son emprise sur le parti. Pendant ce temps, Trotski, malgré de considérables hésitations, était contraint d'évoluer vers une position ouvertement oppositionnelle au sein du parti.
En même temps, le régime bolchevique était confronté à de nouvelles difficultés sur le plan économique et social. Pendant l'été 1923, la première crise de "l'économie de marché" instaurée par la NEP menaçait l'équilibre de toute 1’économie. Tout comme la NEP avait été introduite pour contrer l'excessive centralisation par l'Etat du Communisme de guerre qui avait résulté dans la crise de 1921, il devenait évident que la libéralisation de l'économie exposait la Russie à certaines des difficultés les plus classiques de la production capitaliste. Ces difficultés économiques et, par dessus tout, la réponse qu'y apportait le gouvernement – une politique de coupes dans les emplois et les salaires comme dans n'importe quel Etat capitaliste "normal" – aggravaient à leur tour la condition de la classe ouvrière qui se trouvait déjà à la limite de la misère. En août-septembre 1923, des grèves spontanées avaient commencé à s'étendre aux principaux centres industriels.
Le triumvirat qui était avant tout intéressé à la préservation du statu quo, avait commencé à considérer la NEP comme la voie royale au socialisme en Russie ; ce point de vue était théorisé en particulier par Boukharine qui était passé de 1'extrême-gauche du parti à l'extrême-droite et qui a précédé Staline dans la théorie du socialisme en un seul pays quoiqu'à "un rythme d'escargot", à cause du développement d'une économie de marché "socialiste". Trotski, d'un autre côté, avait déjà commencé à demander plus de centralisation et de planification étatique pour répondre aux difficultés économiques du pays. Mais la première prise de position claire de l'opposition émanant de l'intérieur des cercles dirigeants du parti a été la Plate-forme des 46, soumise au Bureau politique en octobre 1923. Les 46 étaient composés à la fois de proches de Trotski comme Piatakov et Préobrajensky, et d'éléments du groupe Centralisme démocratique comme Sapranov, V.Smirnov et Ossinski. Il n'est pas insignifiant que le document ne porte pas la signature de Trotski : la crainte d'être considéré comme faisant partie d'une fraction (alors que les fractions avaient été interdites en 1921) a certainement influencé son attitude. Néanmoins, sa lettre ouverte au Comité central, publiée dans la Pravda de décembre 1923 et sa brochure Cours nouveau exprimaient des préoccupations très similaires à celles de l'opposition et le plaçaient définitivement dans les rangs de celle-ci.
A l'origine, la Plate-forme des 46 était une réponse aux problèmes économiques dans lesquels se trouvait le régime. Elle prenait fait et cause pour une plus grande planification étatique contre le pragmatisme de l'appareil dominant et sa tendance à élever la NEP au rang de principe immuable. Ce devait être un thème constant de l'opposition de gauche autour de Trotski et, comme nous le verrons, pas l'une de ses forces. Plus important était l'avertissement lancé concernant l'étouffement de la vie interne du parti 4.
En même temps, la Plate-forme prenait ses distances avec ce qu'elle appelait des groupes d'opposition "malsains", même si elle considérait ces derniers comme des expressions de la crise du parti. Cela faisait sans aucun doute référence à des courants comme Le Groupe ouvrier autour de Miasnikov et La Vérité ouvrière autour de Bogdanov qui avaient surgi à la même époque. Peu après, Trotski adoptait un point de vue similaire : le rejet de leurs analyses comme trop extrêmes, tout en les considérant en même temps comme des manifestations de la mauvaise santé du parti. Trotski ne voulait pas non plus collaborer avec les méthodes de répression qui avaient pour but d'éliminer ces groupes.
En fait, ces groupes ne peuvent absolument pas être écartés comme des phénomènes "malsains". Il est vrai que La Vérité ouvrière exprimait une certaine tendance au défaitisme et même au menchevisme ; comme la plupart des courants de la Gauche allemande et hollandaise, son analyse de la montée du capitalisme d'Etat en Russie était affaiblie par la tendance à mettre en question la révolution d'Octobre elle-même et à la considérer comme une révolution bourgeoise plus ou moins progressive 5.
Ce n'était pas du tout le cas du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique), dirigé par des ouvriers bolcheviques de longue date comme Miasnikov, Kuznetsov et Moiseev. Le groupe se fit d'abord connaître en avril-mai 1923 par la distribution de son Manifeste, juste après le 13e Congrès du parti bolchevique. L'examen de ce texte confirme le sérieux du groupe, sa profondeur et sa perspicacité politiques.
Le texte n'est pas dépourvu de faiblesses. En particulier, il est entraîné dans la "théorie de l'offensive", qui ne voit pas le reflux de la révolution internationale et la nécessité qui en découle de luttes défensives de la classe ouvrière. C'était l'autre face de la médaille par rapport à l'analyse de l'Internationale communiste qui voyait le recul de 1921 mais en tirait des conclusions largement opportunistes. De la même façon, le Manifeste adopte un point de vue erroné sur le fait qu'à l'époque de la révolution prolétarienne, les luttes pour de plus hauts salaires n'auraient plus de rôle positif.
Malgré cela, les forces de ce document pèsent bien plus que ses faiblesses :
- son internationalisme résolu. Contrairement au groupe L'Opposition ouvrière de Kollontaï, il n’y a pas trace de localisme russe dans son analyse. Toute la partie introductive du Manifeste traite de la situation internationale, situant clairement les difficultés de la révolution russe dans le retard de la révolution mondiale, et insistant sur le fait que le seul salut pour la première résidait dans le renouveau de la seconde : "Le travailleur russe (...) a appris à se considérer comme soldat de l'armée mondiale du prolétariat international et à voir dans ses organisations de classe les troupes de cette armée. Chaque fois donc qu'est soulevée la question inquiétante du destin des conquêtes de la révolution d'Octobre, il tourne son regard là-bas, au-delà des frontières où sont réunies les conditions pour une révolution, mais d'où, néanmoins, la révolution ne vient pas."
- sa critique aiguisée de la politique opportuniste du Front unique et du slogan du Gouvernement ouvrier ; la priorité accordée à cette question constitue une confirmation supplémentaire de l'internationalisme du groupe puisqu'il s'agissait avant tout d'une critique de la politique de l'Internationale communiste. Sa position n’était pas non plus teintée de sectarisme : il affirmait la nécessité de l'unité révolutionnaire entre les différentes organisations communistes (comme le KPD et le KAPD en Allemagne) mais rejetait complètement l'appel de l'Internationale à faire bloc avec les traîtres de la social-démocratie et son dernier argument fallacieux selon lequel la révolution russe avait précisément réussi parce que les bolcheviks auraient utilisé de façon intelligente la tactique du front unique : "... la tactique qui devait conduire le prolétariat insurgé à la victoire ne pouvait être celle du front unique socialiste mais celle du combat sanglant, sans ménagement, contre les fractions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse. Seul ce combat pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a vaincu non en s'alliant aux socialistes-révolutionnaires, aux populistes et aux mencheviks, mais en luttant contre eux. (…) Il est nécessaire d'abandonner la tactique du "Front unique socialiste" et d'avertir le prolétariat que "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste ambiguë" – à l'époque actuelle tous les partis de la Deuxième internationale – marcheront au moment décisif les armes à la main pour la défense du système capitaliste."
- son interprétation des dangers qu'affrontait l'Etat soviétique – la menace du "remplacement de la dictature du prolétariat par une oligarchie capitaliste ". Le Manifeste retrace la montée d'une élite bureaucratique et la perte des droits politiques de la classe ouvrière, et réclame la restauration des comités d'usine et par dessus tout que les soviets prennent la direction de l'économie et de l'Etat. (6)
Pour le Groupe ouvrier, le renouveau de la démocratie ouvrière constituait le seul moyen de contrer la montée de la bureaucratie, et il rejetait explicitement l'idée de Lénine qui voyait dans l'établissement d'une Inspection ouvrière un moyen d'aller de l'avant, alors que ce n’était qu’une tentative de contrôler la bureaucratie par des moyens bureaucratiques.
- son profond sens des responsabilités. Contrairement aux notes critiques ajoutées par le KAPD quand il publia le Manifeste en Allemagne (Berlin, 1924) et qui exprimaient la sentence prématurée de mort de la révolution russe et de l'Internationale communiste de la part de la Gauche allemande, le Groupe ouvrier est très prudent avant de proclamer le triomphe définitif de la contre-révolution en Russie ou la mort de l'Internationale. Pendant la "crise de Curzon" de 1923, au moment où il semblait que la Grande-Bretagne allait déclarer la guerre à la Russie, les membres du Groupe ouvrier s'engagèrent à défendre la république soviétique en cas de guerre et, surtout, il n'y a pas la moindre trace de répudiation de la révolution d'Octobre et de l'expérience bolchevique. En fait, 1'attitude adoptée par le groupe sur son propre rôle correspond très précisément à la notion de fraction de gauche telle qu'elle a été élaborée plus tard par la Gauche italienne en exil. Il reconnaissait la nécessité de s'organiser indépendamment et même clandestinement, mais le nom du groupe (Groupe ouvrier du Parti communiste russe – bolchevique) tout comme le contenu de son Manifeste démontrent qu'il se considérait en totale continuité avec le programme et les statuts du parti bolchevique. Il appelait donc tous les éléments sains au sein du parti, de la direction comme des différents groupements d'opposition comme La Vérité ouvrière, l'Opposition ouvrière et le Centralisme démocratique à se regrouper et à mener une lutte décidée pour régénérer le parti et la révolution. Et sous bien des aspects, c'était une politique bien plus réaliste que l'espoir qu'avaient les "46" de faire abolir le régime de factions dans le parti "en premier lieu" par la faction dominante elle-même.
En somme, il n'y avait rien de malsain dans le projet du Groupe ouvrier, et il n'était pas une simple secte sans influence dans la classe. Des estimations évaluent à environ 200 le nombre de ses membres à Moscou, et il était totalement cohérent quand il disait se trouver aux côtés du prolétariat dans sa lutte contre la bureaucratie. Il chercha donc à mener une intervention politique active dans les grèves sauvages de l'été et de l'automne 1923. En fait, c'est pour cette raison même et à cause de l'influence croissante du groupe au sein du parti que 1'appareil déchaîna sa répression contre lui. Comme il l'avait prévu, Miasnikov subit même une tentative d’assassinat "lors d'une tentative d'évasion". Miasnikov survécut et quoique emprisonné puis forcé à l'exil après s'être échappé, il poursuivit son activité révolutionnaire à l'étranger deux décennies durant. Le groupe en Russie fut plus ou moins disloqué par des arrestations de masse, bien qu'il soit clair dans L'énigme russe, le précieux rapport d'A. Ciliga sur les groupes d'opposition en prison à la fin des années 1920, qu’il ne disparut pas complètement et continua d'influencer "l'extrême-gauche" du mouvement d'opposition. Néanmoins, cette première répression ne présageait vraiment rien de bon : c'était la première fois qu'un groupe ouvertement communiste souffrait directement de la violence de l'Etat sous le régime bolchevique.
Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe
En guise de préface
Tout ouvrier conscient que ne laissent indifférent ni les souffrances et les tourments de sa classe, ni la lutte titanique qu’elle mène, a certainement réfléchi plus d’une fois au destin de notre révolution à tous les stades de son développement. Chacun comprend que son sort est lié de façon très étroite à celui du mouvement du prolétariat mondial.
On lit encore dans le vieux programme social-démocrate que "le développement du commerce crée une liaison étroite entre les pays du monde civilisé" et que "le mouvement du prolétariat devait devenir international, et qu’il est déjà devenu tel".
Le travailleur russe, lui aussi, a appris à se considérer comme soldat de l’armée mondiale du prolétariat international et à voir dans ses organisations de classe les troupes de cette armée. Chaque fois donc qu’est soulevée la question inquiétante du destin des conquêtes de la révolution d’Octobre, il tourne son regard là-bas, au-delà des frontières où sont réunies les conditions pour une révolution mais d’où, néanmoins, la révolution ne vient pas.
Mais le prolétaire ne doit pas se plaindre ni baisser la tête parce que la révolution ne se présente pas à un moment déterminé. Il doit au contraire se poser la question : que faut-il faire pour que la révolution arrive ?
Quand le travailleur russe tourne ses regards vers son propre pays, il voit la classe ouvrière, qui a accompli la révolution socialiste, assumer les plus dures épreuves de la NEP (Nouvelle économie politique) et, face à elle, les héros de la NEP toujours plus gras. Comparant leur situation à la sienne, il se demande avec inquiétude : où allons-nous exactement ?
Il lui vient alors les pensées les plus amères. Il a supporté, lui, le travailleur, la totalité du poids de la guerre impérialiste et de la guerre civile ; il est fêté, dans les journaux russes, comme le héros qui a versé son sang dans cette lutte. Mais il mène une vie misérable, au pain et à l’eau. Par contre, ceux qui se rassasient du tourment et de la misère des autres, de ces travailleurs qui ont déposé leurs armes, ceux-là vivent dans le luxe et la magnificence. Où allons-nous donc ? Qu’adviendra-t-il après ? Est-il vraiment possible que la NEP, de "Nouvelle économie politique", se transforme en Nouvelle exploitation du prolétariat ? Que faut-il faire pour détourner de nous ce péril ?
Quand ces questions se posent à l’improviste au travailleur, il regarde machinalement en arrière afin d’établir un lien entre le présent et le passé, comprendre comment on a pu arriver à une telle situation. Aussi amères et instructives que soient ces expériences, le travailleur ne peut s’y retrouver dans le réseau inextricable des événements historiques qui se sont déroulés sous ses yeux.
Nous voulons l’aider, dans la mesure de nos forces, à comprendre les faits et si possible lui montrer le chemin de la victoire. Nous ne prétendons pas au rôle de magiciens ou de prophètes dont la parole serait sacrée et infaillible ; au contraire nous voulons qu’on soumette tout ce que nous avons dit à la critique la plus aiguë et aux corrections nécessaires.
Aux camarades communistes de tous les pays !
L’état actuel des forces productives dans les pays avancés et particulièrement dans ceux où le capitalisme est hautement développé donne au mouvement prolétarien de ces pays le caractère d’une lutte pour la révolution communiste, pour le pouvoir des mains calleuses, pour la dictature du prolétariat. Ou l’humanité sombrera dans la barbarie en se noyant dans son propre sang en d’incessantes guerres nationales et bourgeoises, ou le prolétariat accomplira sa mission historique : conquérir le pouvoir et mettre fin une fois pour toutes à l’exploitation de l’homme par l’homme, à la guerre entre les classes, les peuples, les nations ; planter le drapeau de la paix, du travail et de la fraternité.
La course aux armements, le renforcement accéléré des flottes aériennes d’Angleterre, de France, d’Amérique, du Japon, etc., nous menacent d’une guerre inconnue jusqu’ici dans laquelle des millions d’hommes périront et les richesses des villes, des usines, des entreprises, tout ce que les ouvriers et les paysans ont créé par un travail épuisant, sera détruit.
Partout, c’est la tâche du prolétariat de renverser sa propre bourgeoisie. Plus vite il le fera dans chaque pays, plus vite le prolétariat mondial réalisera sa mission historique.
Pour en finir avec l’exploitation, l’oppression et les guerres, le prolétariat ne doit pas lutter pour une augmentation de salaire ou une réduction de son temps de travail. Ce fut nécessaire autrefois, mais il faut aujourd’hui lutter pour le pouvoir.
La bourgeoisie et les oppresseurs de toute sorte et de toute nuance sont très satisfaits des socialistes de tous les pays, précisément parce qu’ils détournent le prolétariat de sa tâche essentielle, la lutte contre la bourgeoisie et contre son régime d’exploitation : ils proposent continuellement de petites revendications mesquines sans manifester la moindre résistance à l’assujettissement et à la violence. De cette façon, ils deviennent, à un certain moment, les seuls sauveteurs de la bourgeoisie face à la révolution prolétarienne. La grande masse ouvrière accueille en effet avec méfiance ce que ses oppresseurs lui proposent directement ; mais si la même chose lui est présentée comme conforme à ses intérêts et enrobée de phrases socialistes, alors la classe ouvrière, troublée par ce discours, fait confiance aux traîtres et gaspille ses forces en un combat inutile. La bourgeoisie n’a donc pas et n’aura jamais de meilleurs avocats que les socialistes.
L’avant-garde communiste doit avant tout chasser de la tête de ses camarades de classe toute crasse idéologique bourgeoise et conquérir la conscience des prolétaires pour les conduire à la lutte victorieuse. Mais pour brûler ce bric-à-brac bourgeois, il faut être un des leurs, des prolétaires, partager tous leurs maux et peines. Quand ces prolétaires qui ont jusqu’ici suivi les commis de la bourgeoisie, commencent à lutter, à faire des grèves, il ne faut pas les écarter en les blâmant avec mépris – il faut, au contraire, rester avec eux dans leur lutte en expliquant sans relâche que cette lutte ne sert qu’à la bourgeoisie. De même, pour leur dire un mot de vérité, on est parfois forcé de monter sur un tas de merde (se présenter aux élections) en souillant ses honnêtes souliers révolutionnaires.
Certes, tout dépend du rapport de forces dans chaque pays. Et il se pourrait qu’il ne soit nécessaire ni de se présenter aux élections, ni de participer aux grèves, mais de livrer directement une bataille. On ne peut pas mettre tous les pays dans le même sac. On doit naturellement chercher de toutes les façons à conquérir la sympathie du prolétariat ; mais pas au prix de concessions, d’oublis ou de renoncements aux solutions fondamentales. Celui-là doit être combattu qui, par souci de succès immédiat, abandonne ces solutions, ne guide pas, ne cherche pas à conduire les masses mais les imite, ne les conquiert pas mais se met à leur remorque.
On ne doit jamais attendre l’autre, rester immobile parce que la révolution n’éclate pas simultanément dans tous les pays. On ne doit pas excuser sa propre indécision en invoquant l’immaturité du mouvement prolétarien et encore moins tenir le langage suivant : "Nous sommes prêts pour la révolution et même assez forts ; mais les autres ne le sont pas encore ; et si nous renversons notre bourgeoisie sans que les autres en fassent autant, qu’arrivera-t-il alors ?".
Supposons que le prolétariat allemand chasse la bourgeoisie de son pays et tous ceux qui la servent. Que se produira-t-il ? La bourgeoisie et les social-traîtres fuiront loin de la colère prolétarienne, se tourneront vers la France et la Belgique, supplieront Poincaré et Cie de régler son compte au prolétariat allemand. Ils iront jusqu’à promettre aux Français de respecter le traité de Versailles, leur offrant peut-être en sus la Rhénanie et la Ruhr. C’est-à-dire qu’ils agiront comme le firent et le font encore la bourgeoisie russe et ses alliés sociaux-démocrates. Naturellement, Poincaré se réjouira d’une si bonne affaire : sauver l’Allemagne de son prolétariat, comme le firent les larrons du monde entier pour la Russie soviétique. Malheureusement pour Poincaré et Cie, à peine les ouvriers et les paysans qui composent leur armée auront-ils compris qu’il s’agit d’aider la bourgeoisie allemande et ses alliés contre le prolétariat allemand, qu’ils retourneront leurs armes contre leurs propres maîtres, contre Poincaré lui-même. Pour sauver sa propre peau et celle des bourgeois français, celui-ci rappellera ses troupes, abandonnera à son sort la pauvre bourgeoisie allemande avec ses alliés socialistes, et cela même si le prolétariat allemand a déchiré le traité de Versailles. Poincaré chassé du Rhin et de la Ruhr, on proclamera une paix sans annexion ni indemnité sur le principe de l’autodétermination des peuples. Il ne sera pas difficile pour Poincaré de s’entendre avec Cuno et les fascistes ; mais l’Allemagne des conseils leur brisera les reins. Quand on dispose de la force, il faut s’en servir et non tourner en rond.
Un autre danger menace la révolution allemande, c’est l’éparpillement de ses forces. Dans l’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale, le prolétariat révolutionnaire tout entier doit unir ses efforts. Si la victoire du prolétariat est impensable sans rupture décisive et sans combat sans merci contre les ennemis de la classe ouvrière (les social-traîtres de la Deuxième Internationale qui répriment les armes à la main le mouvement révolutionnaire prolétarien dans leur pays – soi-disant libre), cette victoire est impensable sans l’union de toutes les forces qui ont pour but la révolution communiste et la dictature du prolétariat. C’est pourquoi nous, Groupe ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique), qui nous comptons, organisationnellement et idéologiquement, parmi les partis adhérant à la IIIe Internationale, nous nous tournons vers tous les prolétaires révolutionnaires communistes honnêtes en les appelant à unir leurs forces pour la dernière et décisive bataille. Nous nous adressons à tous les partis de la IIIe Internationale comme à ceux de la IVe Internationale communiste ouvrière 7, ainsi qu’aux organisations particulières qui n’appartiennent à aucune de ces internationales mais poursuivent notre but commun, pour les appeler à constituer un front uni pour le combat et la victoire.
La phase initiale s’est achevée. Le prolétariat russe, en se fondant sur les règles de l’art révolutionnaire prolétarien et communiste, a abattu la bourgeoisie et ses laquais de toute espèce et de toute nuance (socialistes-révolutionnaires, mencheviks, etc.) qui la défendaient avec tant de zèle. Et bien que beaucoup plus faible que le prolétariat allemand, il a comme vous le voyez repoussé toutes les attaques que la bourgeoisie mondiale dirigeait contre lui à l’incitation des bourgeois, des propriétaires fonciers et des socialistes de Russie.
C’est maintenant au prolétariat occidental qu’il incombe d’agir, de réunir ses propres forces et de commencer la lutte pour le pouvoir. Ce serait évidemment dangereux de fermer les yeux devant les dangers qui menacent la révolution d’Octobre et la révolution mondiale au sein même de la Russie soviétique. L’Union Soviétique traverse actuellement ses moments les plus difficiles : elle affronte tant de déficiences, et d’une telle gravité, qu’elles pourraient devenir fatales au prolétariat russe et au prolétariat du monde entier. Ces déficiences dérivent de la faiblesse de la classe ouvrière russe et de celles du mouvement ouvrier mondial. Le prolétariat russe n’est pas encore en mesure de s’opposer aux tendances qui d’un côté conduisent à la dégénérescence bureaucratique de la NEP et, de l’autre, mettent en grand péril les conquêtes de la révolution prolétarienne russe, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le prolétariat du monde entier est directement et immédiatement intéressé à ce que les conquêtes de la révolution d’Octobre soient défendues contre toute menace. L’existence d’un pays comme la Russie en tant que base de la révolution communiste mondiale est déjà une garantie de victoire et, en conséquence, l’avant-garde de l’armée prolétarienne internationale – les communistes de tous les pays – doit exprimer fermement l’opinion encore muette du prolétariat sur les déficiences et sur les maux dont souffrent la Russie soviétique et son armée de prolétaires communistes, le PCR (bolchevique).
Le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), qui est le mieux informé sur la situation russe, entend commencer l’œuvre.
Nous ne pensons pas qu’en tant que prolétaires communistes, nous ne puissions pas parler de nos défauts sous prétexte qu’il y a, de par le monde, des social-traîtres et des gredins qui pourraient utiliser ce que nous disons contre la Russie soviétique et le communisme. Toutes ces craintes sont sans fondement. Que nos ennemis soient ouverts ou cachés est tout à fait indifférent : ils demeurent ces artisans de malheur qui ne peuvent vivre sans nous nuire, nous, prolétaires et communistes qui voulons nous libérer du joug capitaliste. Que s’ensuit-il ? Devons-nous à cause de cela passer sous silence nos maladies et nos défauts, ne pas en discuter ni prendre des mesures pour les extirper ? Qu’adviendra-t-il si nous nous laissons terroriser par les social-traîtres et si nous nous taisons ? Dans ce cas les choses peuvent aller si loin qu’il ne restera plus que le souvenir des conquêtes de la révolution d’Octobre. Ce serait d’une grande utilité pour les social-traîtres et un coup mortel pour le mouvement communiste prolétarien international. C’est justement dans l’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale et de la classe ouvrière que nous, Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), commençons sans trembler à poser dans sa totalité la question décisive du mouvement prolétarien international et russe, face à l’opinion des social-traîtres. Nous avons déjà observé que ses défauts peuvent s’expliquer par la faiblesse du mouvement international et russe. La meilleure aide que le prolétariat des autres pays puisse apporter au prolétariat russe, c’est une révolution dans son propre pays ou, au moins, dans un ou deux pays de capitalisme avancé. Même si à l’heure actuelle les forces n’étaient pas suffisantes pour réaliser un tel but, elles seraient dans tous les cas en mesure d’aider la classe ouvrière russe à conserver les positions conquises lors de la révolution d’Octobre, jusqu’à ce que les prolétaires des autres pays se soulèvent et vainquent l’ennemi.
La classe ouvrière russe, affaiblie par la guerre impérialiste mondiale, la guerre civile et la famine, n’est pas puissante, mais devant les périls qui la menacent actuellement, elle peut se préparer à la lutte précisément parce qu’elle a déjà connu ces dangers ; elle fera tous les efforts possibles pour les surmonter et elle y réussira grâce à l’aide des prolétaires des autres pays.
Le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique) a donné l’alarme et son appel trouve un large écho dans toute la grande Russie soviétique. Tout ce qui, dans le PCR, pense de façon prolétarienne et honnête se réunit et commence la lutte. Nous réussirons certainement à éveiller dans la tête de tous les prolétaires conscients la préoccupation du sort qui guette les conquêtes de la révolution d’Octobre, mais la lutte est difficile ; on nous a contraints à une activité clandestine, nous opérons dans l’illégalité. Notre Manifeste ne peut être publié en Russie : nous l’avons écrit à la machine et diffusé illégalement. Les camarades qui sont soupçonnés d’adhérer à notre Groupe sont exclus du parti et des syndicats, arrêtés, déportés, liquidés.
A la Douzième Conférence du PCR (bolchevique), le camarade Zinoviev a annoncé, avec l’approbation du parti et des bureaucrates soviétiques, une nouvelle formule pour opprimer toute critique de la part de la classe ouvrière, en disant : "Toute critique à l’égard de la direction du PCR, qu’elle soit de droite ou de gauche, est du menchevisme" (cf. son discours à la XIIe Conférence). Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si les lignes fondamentales de la direction n’apparaissent pas justes à un ouvrier communiste quelconque et que, dans sa simplicité prolétarienne, il commence à les critiquer, on l’exclura du parti et du syndicat, on le livrera à la Guépéou (Tcheka). Le centre du PCR ne veut tolérer aucune critique car il se considère aussi infaillible que le pape de Rome. Nos soucis, les soucis des travailleurs russes au sujet du destin des conquêtes de la révolution d’Octobre, tout cela est déclaré contre-révolutionnaire. Nous, le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), devant le prolétariat du monde entier, déclarons que l’Union soviétique est une des plus grandes conquêtes du mouvement prolétarien international. C’est justement à cause de cela que nous lançons le cri d’alarme, parce que le pouvoir des soviets, le pouvoir du prolétariat, la victoire d’Octobre de la classe ouvrière russe menacent de se transformer en une oligarchie capitaliste. Nous déclarons que nous empêcherons de toutes nos forces la tentative de renverser le pouvoir des soviets. Nous le ferons, bien qu’on nous persécute et nous emprisonne au nom de ce pouvoir des soviets. Si le groupe dirigeant du PCR déclare que nos soucis au sujet de la révolution d’Octobre sont illégaux et contre-révolutionnaires, vous pouvez, prolétaires révolutionnaires de tous les pays et, avant tout, vous qui adhérez à la IIIe Internationale, exprimer votre opinion décisive sur la base de la lecture de notre Manifeste. Camarades, les regards de tous les prolétaires de Russie inquiets à cause des dangers qui menacent le grand Octobre sont dirigés sur vous. Nous voulons qu’à vos réunions vous discutiez de notre Manifeste et que vous insistiez pour que les délégués de vos pays au Ve Congrès de la IIIe Internationale soulèvent la question des fractions à l’intérieur des partis et de la politique du PCR vis-à-vis des soviets. Camarades, discutez de notre Manifeste et faites des résolutions. Sachez, camarades, que vous aiderez ainsi la classe ouvrière de Russie, épuisée et martyrisée, à sauver les conquêtes de la révolution d’Octobre. Notre révolution d’Octobre est une partie de la révolution mondiale !
Au travail camarades !
Vivent les conquêtes de la révolution d’Octobre du prolétariat russe !
Vive la révolution mondiale !
Les deux premières parties du Manifeste s'intitulent Le caractère de la lutte de classe du prolétariat" et "Dialectique de la lutte de classe". Nous avons pris le parti de ne pas les publier ici (bien qu'elles figurent évidemment dans notre livre) dans la mesure où ce sont des rappels de la vision de la marche de l'histoire et du rôle de la lutte de classe au sein de celle-ci telle qu'elle est exposée par Marx, notamment dans le Manifeste communiste de 1848. Il nous est apparu préférable d'entrer directement dans la partie du document qui exprime l'analyse élaborée par le Groupe ouvrier de la période historique à laquelle se confrontait le prolétariat mondial à ce moment-là.
Les Saül et les Paul dans la révolution russe
Tout ouvrier conscient qui a appris les leçons de la révolution, voyait lui-même comment les classes différentes se sont « miraculeusement » transformées de Saül en Paul, de propagandistes de la paix en propagandistes de la guerre civile et vice-versa. Si on se souvient des événements des quinze-vingt dernières années, on se représentera assez clairement ces transformations.
Regardez la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres, les socialistes révolutionnaires et les mencheviks. Qui parmi les prêtres et propriétaires fonciers a prôné la guerre civile avant 1917 ? Personne. Mieux, tout en prônant la paix universelle et l’état de grâce, ils ont jeté les gens en prison, les ont fusillés et pendus pour avoir osé faire une telle propagande. Et après Octobre ? Qui prônait et prône jusqu’ici la guerre civile avec tant de passion ? Ces mêmes enfants fidèles du christianisme : les prêtres, les propriétaires fonciers et les officiers.
Et est-ce que la bourgeoisie, représentée par les démocrates constitutionnels, ne fut point jadis partisane de la guerre civile contre l’autocratie ? Souvenez-vous de la révolte à Vyborg. Milioukov ne dit-il pas, du haut de la tribune du gouvernement provisoire : « Nous tenons le drapeau rouge dans nos mains, et on ne pourra nous l’arracher qu’en passant sur nos cadavres ? » A vrai dire, il prononça aussi des paroles bien différentes devant la Douma d’Etat : « Cette loque rouge qui nous blesse les yeux à tous ». Mais on peut dire avec certitude qu’avant 1905, la bourgeoisie était favorable à la guerre civile. Et en 1917, sous le Gouvernement provisoire qui a proclamé avec le plus de virulence « la paix, la paix civile, l’union entre toutes les classes de la société : voilà le salut de la nation ! »? C’étaient eux, la bourgeoisie, les Cadets. Mais après Octobre ? Et qui continue aujourd’hui à crier comme des enragés : « à bas les soviets, à bas les bolcheviks, la guerre, la guerre civile : voilà le salut de la nation ! »? Ce sont eux, les mêmes bons maîtres et « révolutionnaires » pleurnicheurs, qui ont à présent l’air de tigres.
Et les socialistes-révolutionnaires ? N’ont-ils pas en leur temps assassiné Plehve, le grand-duc Serge Alexandrovitch, Bogdanovitch et autres piliers de l’ancien régime ? Et ces révolutionnaires violents n’ont-ils pas appelé à l’union et à la paix civile en 1917, sous le même Gouvernement provisoire ? Oui, ils y ont appelé, et comment ! Et après Octobre ? Sont-ils restés aussi épris de paix ? Que non ! Ils se transformèrent de nouveau en violents... mais r-r-réactionnaires cette fois, et tirèrent sur Lénine. Ils prônent la guerre civile.
Et les mencheviks ? Ils furent partisans d’une insurrection armée avant 1908, d’une journée du travail de 8 heures, d’une réquisition des propriétés foncières, d’une république démocratique et, de 1908 à 1917, se rallièrent à une sorte de « collaboration de classes », pour la liberté des coalitions et les formes légales de lutte contre l’autocratie. Ils ne s’opposèrent pourtant pas au renversement de cette dernière mais certes, non pendant la guerre, car ils sont patriotes, voire « internationalistes » ; avant Octobre 1917, ils prônent la paix civile et, après Octobre, la guerre civile, comme les monarchistes, les Cadets et les socialistes-révolutionnaires.
Est-ce que ce phénomène est propre à nous, les Russes ? Non. Avant le renversement du féodalisme, les bourgeoisies anglaise, française, allemande, etc., prônaient et menaient la guerre civile. Après que le féodalisme fut tombé en poussière et que la bourgeoisie eut pris le pouvoir, elle devint propagatrice de la paix civile, surtout au vu de l’apparition d’un nouveau prétendant au pouvoir, la classe ouvrière qui la combattait à outrance.
Cherchez maintenant où la bourgeoisie est favorable à la guerre civile. Nulle part ! Partout, excepté dans la Russie soviétique, elle prône la paix et l’amour. Et quelle sera son attitude quand le prolétariat aura pris le pouvoir ? Restera-t-elle propagatrice de la paix civile ? Appellera-t-elle à l’union et la paix ? Non, elle se transformera en propagatrice violente de la guerre civile et mènera cette guerre à outrance, jusqu’au bout.
Et nous, prolétaires russes, est-ce que nous faisons exception à cette règle ?
Pas du tout.
Si on prend la même année 1917, nos conseils de députés ouvriers sont-ils devenus des organes de guerre civile ? Oui. Ils prennent d’ailleurs le pouvoir. Voulaient-ils que la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres et autres personnes maltraitées par les conseils se révoltent contre eux ? Ne voulaient-ils pas que la bourgeoisie et tous ses grands et petits alliés se soumettent sans résistance ? Oui, ils le voulaient. Le prolétariat était donc pour la guerre civile avant la prise du pouvoir, et contre après sa victoire, pour la paix civile.
Il est vrai que dans toutes ces transformations, il y a beaucoup d’inertie historique. Même à l’époque où tous (des monarchistes aux mencheviks, y inclus les socialistes-révolutionnaires) ont mené la guerre civile contre le pouvoir soviétique, c’était sous le mot d’ordre de « paix civile ». En réalité le prolétariat a voulu la paix, mais a dû appeler encore à la guerre. Même en 1921, dans une des circulaires du Comité central du PCR, s’entrevoit cette incompréhension de la situation : le mot d’ordre de la guerre civile était considéré même en 1921 comme l’indice d’un fort esprit révolutionnaire. Mais on ne peut voir là qu’un cas historique qui n’ébranle pas du tout notre point de vue.
Si actuellement en Russie, en consolidant le pouvoir prolétarien conquis par la révolution d’Octobre, nous prônons la paix civile, tous les éléments prolétariens honnêtes devront cependant s’unir fermement sous le mot d’ordre de guerre civile, sanglante et violente, contre la bourgeoisie du monde entier.
La classe ouvrière voit actuellement avec quelle hystérie les couches exploiteuses de la population des pays bourgeois prônent la paix civile et universelle, l’état de grâce. Il faut donc comprendre dès à présent que si demain, le prolétariat de ces pays bourgeois prend le pouvoir, tous les pacifistes d’aujourd’hui, des propriétaires fonciers jusqu’aux Internationales II et II½, mèneront la guerre civile contre le prolétariat.
Avec toute la force et l’énergie dont nous sommes capables, nous devons appeler le prolétariat de tous les pays à la guerre civile, sanglante et impitoyable ; nous sèmerons le vent, car nous voulons la tempête. Mais avec encore plus de force nous ferons la propagande de la paix civile et universelle, l’état de grâce, partout où le prolétariat aura triomphé et pris le pouvoir.
Les propriétaires fonciers, les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires de tous les pays prôneront quant à eux la paix civile dans tous les pays où règne l’oppression capitaliste, et la guerre civile encore plus cruelle et sanglante partout où le prolétariat aura pris le pouvoir.
Les tâches principales d’aujourd’hui
Le développement des forces productives dans tous les pays a fait en sorte que la phase qui fait du capitalisme lui-même un facteur de destruction de ces mêmes forces touche à sa fin. La guerre mondiale et les événements qui s’ensuivirent, la paix de Versailles, la question des dommages de guerre, Gênes, La Haye, Lausanne, Paris et enfin l’occupation de la Ruhr par la France, auxquels s’ajoutent le chômage immense et la vague des grèves sans fin, montrent explicitement que la dernière heure de l’exploitation capitaliste est déjà arrivée et que les expropriateurs doivent être eux-mêmes expropriés.
La mission historique du prolétariat consiste à sauver l’humanité de la barbarie où l’a plongée le capitalisme. Et il est impossible de l’accomplir par la lutte pour des sous, pour la journée de travail de 8 heures, pour les concessions partielles que le capitalisme peut lui accorder. Non, le prolétariat doit s’organiser fermement en vue de la lutte décisive pour le pouvoir.
Il est des moments où toute propagande en faveur de grèves pour l’amélioration des conditions matérielles du prolétariat dans les pays capitalistes avancés est une propagande nuisible qui entretient le prolétariat dans les illusions, dans l’espoir d’une amélioration réelle de son niveau de vie dans le cadre de la société capitaliste.
Les ouvriers avancés doivent prendre part aux grèves et, si les circonstances le permettent, les diriger. Ils doivent proposer des revendications pratiques pour le cas où la masse prolétarienne espèrerait encore pouvoir améliorer ses conditions en suivant cette voie ; une pareille attitude augmentera leur ascendant sur le prolétariat. Mais ils doivent stipuler fermement que ce n’est pas une voie vers le salut, vers l’amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. S’il était possible d’organiser le prolétariat en vue de la lutte décisive en le soutenant décidément dans tous ses conflits avec le capital, il ne faudrait pas s’en priver. Il vaut mieux se mettre à la tête de ce mouvement et proposer des revendications audacieuses et catégoriques, pratiques et compréhensibles au prolétariat, tout en lui expliquant que s’il ne prend pas le pouvoir, il ne sera pas à même de changer ses conditions d’existence. Ainsi, pour le prolétariat, chaque grève, chaque conflit sera une leçon qui prouvera la nécessité d’une conquête du pouvoir politique et d’une expropriation des expropriateurs.
Ici les communistes de tous les pays doivent adopter la même attitude qu’aux parlements – ils n’y vont pas pour faire un travail positif de législation, mais en vue de la propagande, de la destruction de ces parlements par le prolétariat organisé.
De même, lorsqu’il y a la nécessité de faire la grève pour un sou, pour une heure, il faut y participer, mais pas pour entretenir l’espoir d’améliorer réellement la condition économique ouvrière. Au contraire, il faut dissiper ces illusions, utiliser chaque conflit pour organiser les forces du prolétariat tout en préparant sa conscience à la lutte finale. Jadis, la revendication d’une journée de travail de huit heures avait été révolutionnaire, elle a aujourd’hui cessé de l’être dans tous les pays où la révolution sociale est à l’ordre du jour. Nous abordons ici directement le problème du front uni.
A suivre ….
La suite du Manifeste qui sera publié dans les numéros suivants de la Revue internationale comporte les têtes de chapitre suivantes :
- Le front unique socialiste
- La question du front uni dans le pays où le prolétariat est au pouvoir (démocratie ouvrière)
- La question nationale
- La Nouvelle politique économique (NEP)
- La NEP et la campagne
- La NEP et la politique tout simplement
- La NEP et la gestion de l’industrie
Note de fin de document
1. Gabriel Miasnikov, un ouvrier de l'Oural, s'était distingué dans le parti bolchevique en 1921 quand, tout de suite après le crucial 10e Congrès, il avait réclamé "la liberté de la presse, des monarchistes aux anarchistes inclus", (cité par Carr, The Interregnum). Malgré les efforts de Lénine pour le dissuader de mener un débat sur cette question, il refusa de reculer et fut expulsé du parti au début de 1922. En mars 1923, il se regroupa avec d'autres militants pour fonder le "Groupe Ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique)" et celui-ci publia et distribua son Manifeste au XIIe Congrès du PCR. Le groupe commença à faire du travail illégal parmi les ouvriers, appartenant ou non au parti, et semble avoir été présent de façon significative dans la vague de grèves de l'été 1923, en appelant à des manifestations de masses et essayant de politiser un mouvement de classe essentiellement défensif. Son activité dans ces grèves a suffi pour convaincre la Guépéou qu'il représentait une véritable menace et une vague d'arrestations de certains dirigeants porta un coup sévère au groupe. Cependant, il poursuivit son travail clandestin jusqu'au début des années 1930 bien qu'à une échelle réduite. L'histoire ultérieure de Miasnikov est la suivante : de 1923 à 1927, il passe la plupart de son temps en exil ou en prison à cause de ses activités clandestines ; évadé de Russie en 1927, il fuit en Perse et en Turquie (où il connaîtra également la prison) et s'installe définitivement en France en 1930. Durant cette période, il essaie toujours d'organiser son groupe en Russie. A la fin de la guerre, il demande à Staline la permission de retourner en URSS. Staline envoya un avion le chercher. À partir du jour où il retourna dans son pays, on n’a plus eu de nouvelles de lui. Et pour cause ! Il fut, après un jugement secret par un tribunal militaire, fusillé dans une prison de Moscou, le 16 novembre 1945.
1 Lire notre article La gauche communiste et la continuité du marxisme [112].
2 Le CCI a déjà publié en anglais et en russe une brochure La gauche communiste russe dédiée à l'étude des différentes expressions de la Gauche communiste en Russie. Une version est également en préparation en français. La version anglaise incluait le Manifeste du Groupe ouvrier mais, depuis sa publication, une nouvelle version plus complète de ce Manifeste a été exhumée en Russie. C'est cette dernière version (inédite en français) que nous publions aujourd'hui et qui sera intégrée dans la future édition en français.
3.. Lire notre article La Gauche communiste en Russie dans les Revue internationale n°8 [113] et 9 [114].
4.. "Les membres du parti qui ne sont pas satisfaits de telle ou telle décision du comité central, qui ont à l'esprit tel ou tel doute, qui relèvent en privé telle ou telle erreur, telle ou telle irrégularité ou telle ou telle confusion, ont peur d'en parler dans les réunions du parti et ont même peur d'en parler dans une conversation. (...) Aujourd'hui, ce n'est pas le parti, pas ses larges masses, qui promeut et choisit les membres des comités provinciaux et du comité central du Parti communiste de Russie. Au contraire, c’est de plus en plus la hiérarchie du secrétariat du parti qui recrute les membres des conférences et des congrès qui deviennent à leur tour de plus en plus les assemblées exécutives de cette hiérarchie. (...) La position qui s'est créée s'explique par le fait que le régime est la dictature d'une faction au sein du parti. (...) Le régime factionnel doit être aboli et ce doit être fait, en premier lieu, par ceux qui l'ont créé ; il doit être remplacé par un régime d'unité fraternelle et de démocratie interne du parti."
5.. Lire dans la Revue internationale n°8 et 9 l'article La Gauche communiste en Russie, déjà cité.
6.. Cependant, le Manifeste semble aussi défendre que les syndicats doivent devenir des organes de la centralisation de la direction économique – vieille position de l'Opposition ouvrière que Miasnikov avait critiquée en 1921.
7. Il s'agit de la KAI (Internationale des ouvriers communistes, 1921-22) fondée à l'initiative du KAPD, à ne pas confondre avec la IVe Internationale trotskiste.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
La gauche du Parti communiste de Turquie
- 4163 lectures
Le but de cet article est d'introduire la nouvelle édition en anglais de notre brochure sur la gauche du Parti communiste turc (Türkiye Komünist Partisi, TKP) qui sera publiée intégralement dans les prochains numéros de la Revue internationale. La première édition a été publiée en 2008 par le groupe turc Enternasyonalist Komünist Sol (Gauche communiste internationaliste, EKS) qui, à l'époque, avait déjà adopté les positions de base du CCI comme principes et avait commencé à discuter la plateforme du CCI. En 2009, EKS a rejoint le CCI pour former la section de notre organisation en Turquie, publiant Dünya Devrimi (Révolution mondiale).
La nouvelle édition de la traduction en anglais fait suite à la publication d'une nouvelle édition en turc dans laquelle certains aspects de la brochure originale ont été clarifiés par de plus nombreuses références au matériel turc d'origine. Elle comprend également un appendice (publié pour la première fois en turc moderne et en anglais) : la déclaration de fondation du TKP à Ankara en 1920.
Le corps de la brochure présente toujours une certaine difficulté pour le lecteur non turc du fait qu'il fait référence à des événements historiques, bien connus de n'importe quel écolier turc mais très peu sinon pas du tout en dehors de la Turquie. Plutôt que d'alourdir le corps du texte avec des explications qui ne sont pas nécessaires pour le lecteur turc, nous avons choisi d'ajouter quelques notes explicatives dans la version anglaise et de présenter, dans cet article, un bref survol du contexte historique global qui, nous l'espérons, facilitera la lecture sur cette période complexe. 1
Ce survol historique sera lui-même divisé en deux parties : dans la première, nous nous centrerons sur les événements qui ont mené à la création de l'Etat turc et à la formation du TKP ; dans la seconde, nous examinerons les débats qui ont eu lieu autour des fondements théoriques de la politique de l'Internationale communiste envers les mouvements nationaux à l'Est, en particulier tels qu'ils s'expriment dans l'adoption des "Thèses sur la question nationale" au Deuxième Congrès de l'Internationale.
La chute de l'Empire ottoman
La République turque fondée par Mustapha Kemal Atatürk dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale est née sur les ruines de l'Empire ottoman. 2 L'Empire (également connu sous le nom de La Sublime Porte) n'était pas un Etat national mais le résultat d'une série de conquêtes dynastiques qui – au moment de sa plus grande extension au début du 17e siècle – s'étendait jusqu'à Alger sur la côte nord-africaine, comprenait l'Irak, la Syrie, la Jordanie, Israël et le Liban actuels et la plus grande partie de la côte de l'Arabie saoudite, y inclus les villes saintes de La Mecque et de Médine ; sur le continent européen, les Ottomans conquirent la Grèce, les Balkans et la plus grande partie de la Hongrie. Depuis le règne de Selim Le Magnifique au début du 16e siècle, le sultan avait toujours endossé le titre de calife, c'est-à-dire de chef de tout l'Ummah – la communauté islamique. Pour autant qu'une analogie puisse être faite avec l'histoire européenne, les sultans ottomans combinaient donc les attributs temporels et spirituels de l'empereur romain et du pape.
Mais au début du 19e siècle, l'Empire ottoman fut soumis à la pression croissante de l'expansionnisme des Etats capitalistes européens modernes, menant à sa désintégration graduelle. L'Egypte s'en sépara de facto après son invasion par Napoléon en 1798 qui en fut chassé par une alliance des troupes britanniques avec les forces locales ; elle devint un protectorat britannique en 1882. Les troupes françaises conquirent l'Algérie au cours d'une série de conflits sanglants entre 1830 et 1872, tandis que la Tunisie devenait en 1881 un protectorat français. La Grèce gagna son indépendance en 1830 après une guerre menée avec l'aide de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. Ce processus de désintégration se poursuivit jusqu'au début du 20e siècle. En 1908, la Bulgarie déclara son indépendance et l'Autriche-Hongrie officialisa l'annexion de la Bosnie ; en 1911, l'Italie envahit la Libye tandis qu'en 1912, l'armée ottomane était sérieusement bousculée par la Bulgarie, la Serbie et la Grèce au cours de la Première Guerre des Balkans. En réalité, la survie de la Sublime Porte était due, en partie, aux rivalités des puissances européennes dont aucune ne voulait permettre à ses rivaux de profiter de l'effondrement de l'Empire ottoman à ses dépens. Aussi la France et la Grande-Bretagne qui, comme on l'a vu, étaient parfaitement capables de dépouiller l'Empire dans leur intérêt propre, s'unirent pour le protéger des avancées de la Russie au cours de la Guerre de Crimée de 1853-56.
Sur le plan interne, l'Empire ottoman était une mosaïque d'unités ethniques dont la seule cohésion provenait du Sultanat et de l'Etat ottoman lui-même. Le Califat s'appliquait de façon limitée puisque l'Empire comprenait d'importantes populations juives et chrétiennes, sans mentionner toute une variété de sectes musulmanes. Même en Anatolie – la région qui correspond en gros à la Turquie moderne – il n'y avait pas d'unité nationale ou ethnique. La majorité de la population turque, en grande partie composée de paysans travaillant dans des conditions extrêmement arriérées, vivait côte-à-côte avec des Arméniens, des Kurdes, des Azéris, des Grecs et des Juifs. De plus, même si une sorte de capital turc existait, la vaste majorité de la bourgeoisie industrielle et commerçante montante n'était pas turque mais arménienne, juive et grecque, et les autres principaux acteurs économiques relevaient du capital étranger, français ou allemand. La situation en Turquie était ainsi comparable à celle de l'Empire tsariste où un appareil d'Etat despotique et dépassé chapeautait une société civile qui, malgré tous ses aspects arriérés, était néanmoins intégrée dans l'ensemble du capitalisme mondial. Mais, à la différence de la Russie, l'appareil d'Etat ottoman n'était pas basé sur une bourgeoisie nationale dominante économiquement.
Bien que le Sultanat ait fait quelques tentatives de réformes, les expériences de démocratie parlementaire limitée furent de courte durée. Des résultats plus concrets provinrent de la collaboration avec l'Allemagne pour la construction de lignes de chemin de fer reliant l'Anatolie à Bagdad et Al-Hejaz (La Mecque et Médine) ; celles-ci avaient une importance particulière aux yeux de la Grande-Bretagne au cours des années qui précédaient la guerre puisqu'elles pouvaient permettre à l'Empire ottoman et à l'Allemagne de constituer une menace pour les champs de pétrole perses (critiques pour l'approvisionnement de la flotte britannique) d'une part et, de l'autre, envers l'Egypte et le canal de Suez (l’artère du commerce avec l'Inde). La Grande-Bretagne n'était pas non plus enthousiaste face à la demande du Sultan que des officiers allemands entraînent l'armée ottomane à la stratégie et à la tactique modernes.
Pour la jeune génération de révolutionnaires nationalistes qui allaient former le mouvement des "Jeunes Turcs", il était évident que le Sultanat était incapable de répondre à la pression imposée par les puissances impérialistes étrangères, et de construire un Etat moderne et industriel. Cependant le statut minoritaire (à la fois national et religieux) des classes industrielles et marchandes signifiait que le mouvement révolutionnaire national Jeune Turc qui fonda le "Comité d'Union et de Progrès" (CUP, en turc Ýttihat ve Terakki Cemiyeti) en 1906, était en grande partie composé non d'une classe industrielle montante mais d'officiers de l'armée et de fonctionnaires de l'Etat turc frustrés. Au cours de ses premières années, le CUP reçut aussi un soutien considérable de la part des minorités nationales (y compris du parti arménien Dashnak et de la population de Salonique qui se trouve aujourd'hui en Grèce) et, au début du moins, de la Fédération socialiste ouvrière de Avraam Benaroya. Bien que le CUP s'inspirât des idées de la Révolution française et de l'efficacité de l'organisation militaire allemande, il ne pouvait à proprement parler être considéré comme nationaliste puisque son but était de transformer et de renforcer l'Empire ottoman multiethnique. Ce faisant il entra inévitablement en conflit avec les mouvements nationalistes émergents dans les Etats des Balkans et avec la Grèce en particulier.
Le soutien au CUP grandit rapidement dans l'armée, au point que ses membres décidèrent, en 1908, de mener un putsch militaire qui réussit et força le Sultan Abdulhamit à faire appel à un parlement et à accepter des ministres du CUP dans son gouvernement qu'ils dominèrent rapidement. La base populaire du CUP était cependant si limitée qu'il fut rapidement éjecté du pouvoir et ne put rétablir son autorité qu'en occupant militairement la capitale Istanbul. Le Sultan Abdulhamit fut contraint d'abdiquer et fut remplacé par son jeune frère, Mehmet V. L'Empire ottoman, au moins en théorie, était devenu une monarchie constitutionnelle que les Jeunes Turcs espéraient convertir en un Etat capitalisme moderne. Mais le fiasco de la Guerre des Balkans (1912-1913) allait démontrer on ne peut plus clairement l'arriération de l'Empire ottoman par rapport aux puissances plus modernes.
La "révolution Jeune Turque", nom sous lequel on la connaît, établit donc le schéma pour la création de la république turque et aussi pour les Etats qui allaient émerger plus tard de l'effondrement des empires coloniaux : un Etat capitaliste mis en place par l'armée en tant que seule force de la société ayant une cohésion suffisante pour empêcher le pays d'exploser.
Ce serait fastidieux de rendre compte des mésaventures de l'Empire ottoman qui ont suivi son entrée dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. 3 Il suffit de dire qu'en 1919, l'Empire était vaincu et démantelé : ses possession arabes avaient été réparties entre la Grande-Bretagne et la France tandis que la capitale elle-même était occupée par les troupes alliées. La classe dominante grecque qui avait participé à la guerre aux côtés des Alliés, voyait maintenant une opportunité de réaliser la Megali Idea : une "Grande Grèce" qui incorporerait à l'Etat grec les parties de l'Anatolie qui avaient été grecques du temps d'Alexandre – essentiellement la côte de la mer Egée incluant le grand port d'Izmir et la partie côtière de la mer Noire connue sous le nom de Pontus. 4 Comme ces régions étaient largement peuplées par des Turcs, une telle politique ne pouvait être mise en oeuvre qu'au moyen de pogroms et de nettoyage ethnique. En mai 1919, avec le soutien tacite de la Grande-Bretagne, l'armée grecque occupa Izmir. Le gouvernement ottoman affaibli, entièrement dépendant de la bonne volonté, peu fiable et intéressée, de la Grande-Bretagne et de la France, fut incapable de résister. La résistance allait venir, non du Sultanat discrédité d'Istanbul, mais du plateau central d'Anatolie. C'est là que le "Kémalisme" entra dans l'histoire.
Pratiquement au moment où la Grèce occupait Izmir, Mustapha Kemal Pasha – connu dans l'histoire sous le nom de Kemal Atatürk – quitta Istanbul pour Samsun sur la côte de la Mer Noire ; en tant qu'inspecteur de la 9e armée, ses tâches officielles étaient de maintenir l'ordre et de superviser le démantèlement des armées ottomanes selon l'accord de cessez-le-feu établi avec les alliés. Son but véritable était de galvaniser la résistance nationale contre les puissances d'occupation et, dans les années qui suivirent, Mustapha Kemal allait devenir la figure dirigeante au sein du premier mouvement turc véritablement national qui mena à l'abolition du Sultanat et à la liquidation de l'Empire ottoman, à l'expulsion des armées grecques de l'Anatolie occidentale et à la création de la République turque actuelle en 1922.
La première Assemblée nationale turque se tint à Ankara en 1920. La même année, les événements en Russie commencèrent une nouvelle fois à jouer un rôle important dans l'histoire de la Turquie et réciproquement.
Les deux années qui avaient suivi la révolution d'Octobre avaient été tragiques pour le nouveau pouvoir révolutionnaire : l'Armée rouge avait dû repousser l'intervention directe des puissances capitalistes et mener une guerre civile sanglante contre les armées blanches de Koltchak en Sibérie, de Denikine sur le Don (la région nord-est de la mer Noire) et de Wrangel en Crimée. En 1920, la situation commençait à se stabiliser : des "républiques soviétiques" avaient été créées ou étaient sur le point de l'être à Tachkent, Bokhara, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie. Les troupes britanniques avaient été forcées de quitter Bakou (au cœur de l'industrie pétrolière de la mer Caspienne et le seul centre réellement prolétarien de la région), mais constituaient une menace toujours présente en Perse en en Inde. Dans ces circonstances, la question nationale était d'une importance pressante et immédiate pour le pouvoir soviétique et pour le mouvement ouvrier dont la plus haute expression politique était l'Internationale communiste : les mouvements nationaux constituaient-ils une force de la réaction ou une aide potentielle pour le pouvoir révolutionnaire comme l'avaient été les paysans en Russie ? Comment le mouvement ouvrier devait-il se comporter dans des régions où les ouvriers étaient toujours une minorité ? Que pouvait-on attendre de mouvements comme la Grande Assemblée nationale à Ankara qui semblait au moins avoir en commun avec la Fédération socialiste russe des Républiques soviétiques le même ennemi sous la forme de l'impérialisme britannique et français ?
Le débat sur la question nationale
En 1920, ces questions furent au cœur des débats du Deuxième Congrès de l'IC qui adopta les "Thèses sur la question nationale" et au Premier Congrès des Peuples de l'Orient, connu sous le nom de Congrès de Bakou. Ces événements constituèrent, pour ainsi dire, le contexte théorique des événements en Turquie et c'est d'eux que nous nous occuperons maintenant.
En présentant les "Thèses sur la question nationale", Lénine déclara : "En premier lieu, quelle est l'idée essentielle, fondamentale de nos thèses ? La distinction entre les peuples opprimés et les peuples oppresseurs. (...) A l'époque de l'impérialisme, il est particulièrement important pour le prolétariat et l'Internationale communiste de constater les faits économiques concrets et, dans la solution de toutes les questions coloniales et nationales, de partir non de notions abstraites, mais des réalités concrètes." 5
L'insistance de Lénine sur le fait que la question nationale ne pouvait être comprise que dans le contexte de "l'époque de l'impérialisme " (ce que nous appellerions l'époque de la décadence du capitalisme) était partagée par tous les participants au débat qui suivit. Beaucoup ne partageaient pas, cependant, les conclusions de Lénine et tendaient à poser la question en termes similaires à ceux qu'avait utilisés Rosa Luxemburg 6: "A une époque d'impérialisme sans frein, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne servent que comme moyens de tromperie, à mettre les masses au service de leur ennemi mortel, l'impérialisme.(...) Aucune nation opprimée ne peut gagner sa liberté et son indépendance des mains des Etats impérialistes. (...) Les petites nations dont les classes dominantes sont des appendices de leurs frères de classe des grandes puissances, ne sont que des pions dans le jeu impérialiste des grandes puissances et sont maltraitées pendant la guerre exactement comme les masses ouvrières, dans le seul but d'être sacrifiées sur l'autel des intérêts capitalistes après la guerre." 7
Quand nous étudions les débats sur la question nationale, nous voyons émerger trois positions.
La position de Lénine et les "Thèses sur la question nationale"
La position de Lénine était profondément influencée par la situation de la Russie soviétique sur l'arène mondiale : "...dans la situation internationale d'aujourd'hui, après la guerre impérialiste, les relations réciproques des peuples et tout le système politique mondial sont déterminés par la lutte d'un petit groupe de nations impérialistes contre le mouvement soviétique et les Etats soviétiques, à la tête desquels se trouve la Russie des Soviets. (...) Ce n'est qu'en partant de là que les questions politiques peuvent être posées et résolues d'une façon juste par les partis communistes, aussi bien des pays civilisés que des pays arriérés." 8
Parfois cette position allait jusqu'à rendre la révolution prolétarienne dangereusement dépendante de la révolution nationale en Orient : "La révolution socialiste ne se fera pas simplement, ni principalement, par la lutte du prolétariat de chaque pays contre sa propre bourgeoisie – non, ce sera la lutte de toutes les colonies et de tous les pays opprimés par l'impérialisme, de tous les pays dépendants, contre l'impérialisme." (Traduit de l'anglais par nous) 9
Le danger d'une telle position est précisément qu'elle tend à faire dépendre le mouvement ouvrier de n'importe quel pays et l'attitude de l'IC envers celui-ci non des intérêts de la classe ouvrière internationale et des rapports entre eux des ouvriers des différents pays, mais des intérêts étatique de la Russie soviétique.10 La question de savoir que faire quand les deux types d'intérêts entrent en conflit reste sans réponse. Pour prendre un exemple très concret, que devait être l'attitude des ouvriers et des communistes turcs dans la guerre entre le mouvement nationaliste de Mustapha Kemal et les forces d'occupation grecques ? Le défaitisme révolutionnaire adopté par l'aile gauche des partis communistes turc et grec, ou le soutien à la diplomatie et au militarisme de la Russie soviétique à l'Etat turc naissant avec le point de vue de vaincre la Grèce du fait qu'elle était une arme entre les mains de l'impérialisme britannique ?
La position de Manabendra Nath Roy
Au cours du Deuxième Congrès de l'IC, M.N. Roy 11 présenta des "Thèses complémentaires sur la question nationale" qui furent débattues en commission et présentées avec celles de Lénine pour adoption par le Congrès. Pour Roy, la poursuite de la survie du capitalisme dépendait des "superprofits" venant des colonies. "L'une des sources majeures dont le capitalisme européen tire sa force principale se trouve dans les possessions et dépendance coloniales. Sans le contrôle des marchés étendus et du vaste champ d'exploitation qui se trouvent dans les colonies, les puissances capitalistes d'Europe ne pourraient maintenir leur existence même pendant un temps très court. (...) Le surprofit obtenu par l'exploitation des colonies est le soutien principal du capitalisme contemporain, et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas été privé de cette source de surprofit, ce ne sera pas facile à la classe ouvrière européenne de renverser l'ordre capitaliste." 12
Ceci amenait Roy à considérer que la révolution mondiale dépendait de la révolution des masses travailleuses d'Asie. "L'Orient s'éveille ; et qui sait si la formidable marée, celle qui balaiera la structure capitaliste d'Europe occidentale, ne viendra pas de là. Ce n'est pas une lubie fantaisiste, ni un rêve sentimental. Que le succès final de la révolution sociale en Europe dépende largement sinon totalement, d'un soulèvement simultané des masses laborieuses d'Orient est un fait qui peut être scientifiquement prouvé." 13. Cependant, du point de vue de Roy, la révolution en Asie ne dépendait pas d'une alliance du prolétariat avec la paysannerie. Il la considérait comme incompatible avec le soutien au mouvement nationaliste démocratique : "... le fait d'aider à renverser la domination étrangère dans les colonies ne signifie pas qu'on donne adhésion aux aspirations nationalistes de la bourgeoisie indigène ; il s'agit uniquement d'ouvrir la voie au prolétariat qui y est étouffé. (...) On peut constater l'existence dans les pays dépendants de deux mouvements qui chaque jour se séparent de plus en plus. Le premier est le mouvement nationaliste bourgeois-démocratique, qui a un programme d'indépendance politique sous un ordre bourgeois ; l'autre est celui de l'action de masse des paysans et des ouvriers pauvres et ignorants luttant pour leur émancipation de toute espèce d'exploitation". 14 Les objections de Roy amenèrent à retirer du projet de Thèses de Lénine l'idée de soutien aux mouvements "démocratiques bourgeois" et à la remplacer pas le soutien aux mouvements "nationaux révolutionnaires". Le problème réside cependant en ce que la distinction entre les deux restait extrêmement confuse dans la pratique. Qu'est-ce qu'était exactement un mouvement "national révolutionnaire" qui n'était pas également "démocratique bourgeois" ? De quelle façon était-il "révolutionnaire" et comment les caractéristiques d'un tel mouvement "national" pouvaient-elles se réconcilier avec la revendication d'une révolution prolétarienne internationale ? Ces questions ne furent jamais clarifiées par l'IC et leurs contradictions inhérentes ne furent pas résolues.
La position de Sultanzade
Il existait une troisième position, à gauche, dont l'un des porte-parole le plus clair était certainement Sultanzade 15, délégué du Parti communiste perse nouvellement créé. Sultanzade rejetait l'idée selon laquelle des révolutions nationales pouvaient se libérer de leur dépendance vis-à-vis de l'impérialisme ainsi que celle selon laquelle la révolution mondiale dépendait des événements en Orient : "... le destin du communisme à travers le monde dépend-il du succès de la révolution sociale en Orient, comme le camarade Roy vous l'assure ? Certainement pas. Beaucoup de camarades au Turkestan commettent cette erreur. (...) Supposons que la révolution communiste ait commencé en Inde. Les ouvriers de ce pays seraient-ils capables de résister à l'attaque de la bourgeoisie du monde entier sans l'aide d'un grand mouvement révolutionnaire en Angleterre et en Europe ? Evidemment non. L'extinction de la révolution en Chine et en Perse est un clair exemple de cela. (...) Si quelqu'un essayait de procéder selon les Thèses dans des pays qui ont déjà dix ans d'expérience ou plus (...) cela voudrait dire jeter les masses dans les bras de la contre-révolution. Notre tâche est de créer et maintenir un mouvement purement communiste en opposition au mouvement démocratique-bourgeois. Tout autre évaluation des faits pourrait mener à des résultats déplorables." 16
La voix de Sultanzade n'était pas isolée et des points de vue similaires étaient défendus ailleurs. Dans son rapport au Congrès de Bakou, Pavlovitch (qui, selon certaines sources 17, avait travaillé avec Sultanzade sur ce rapport) déclara que si "les séparatistes irlandais atteignaient leur but et réalisaient leur idéal d'un peuple irlandais indépendant, (...) le lendemain, l'Irlande indépendante tomberait sous le joug du capital américain ou de la Bourse française et, peut-être, d'ici un ou deux ans, l'Irlande combattrait la Grande-Bretagne ou un autre Etat en s'étant alliée avec l'un des prédateurs de ce monde à la poursuite de marchés, de mines de charbon, de parts de territoires en Afrique et, une nouvelle fois, des centaines de milliers d'ouvriers britanniques, irlandais, américains et autres mourraient dans cette guerre. (...) L'exemple (...) de la Pologne bourgeoise qui se conduit maintenant comme le bourreau des minorités nationales vivant sur son territoire et sert de gendarme au capitalisme international dans sa lutte contre les ouvriers et les paysans russes ; ou l'exemple des Etats des Balkans - la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, la Grèce – qui se disputent les dépouilles des nations qui étaient hier encore sous le joug turc et veulent chacun les annexer ; et beaucoup d'autres faits du même genre montrent que la formation des Etats nationaux en Orient où le pouvoir est passé des mains de la domination étrangère qui a été chassée à celles des capitalistes et des propriétaires locaux ne constitue pas en elle-même un grand pas en avant pour ce qui est de l'amélioration de la position des masses du peuple. Dans le cadre du système capitaliste, tout Etat nouvellement formé qui n'exprime pas les intérêts des masses travailleurs mais sert les intérêts de la bourgeoisie constitue un nouvel instrument d'oppression et de coercition, un nouveau facteur de guerre et de violence. (... ) Si la lutte en Perse, en Inde et en Turquie devait mener simplement à la venue au pouvoir des capitalistes et des propriétaires terriens de ces pays avec leurs parlements et leurs sénats nationaux, les masses du peuple n'y auront rien gagné. Tout Etat nouvellement formé serait rapidement entraîné, par le cours même des événements et la logique inéluctable des lois de l'économie capitaliste, dans le cercle vicieux du militarisme et de la politique impérialiste et, après quelques décennies, il y aurait une nouvelle guerre mondiale (...) dans l'intérêt des banquiers et des patrons français, allemands, britanniques, indiens, chinois, perses et turcs (...) Seule la dictature du prolétariat et, de façon générale, des masses ouvrières, libérées de l'oppression étrangère et ayant renversé complètement le capital, apportera aux pays arriérés une garantie que des pays ne deviendront pas – comme c'est le cas des Etats qui se sont formés à partir des fragments de l'Empire austro-hongrois et de la Russie tsariste : la Pologne, la Hongrie blanche, la Tchécoslovaquie, la Géorgie, l'Arménie, ou de ceux formés des fragments de la Turquie, la Grèce de Venizelos et le reste – un nouvel instrument de guerre, de pillage et de coercition." Grigori Safarov (qui allait jouer un rôle important dans le développement du Parti communiste turc) posa le problème plus clairement dans son Problemy Vostoka : "(...) il faut souligner que seul le développement de la révolution en Europe rend la victoire de la révolution agraire paysanne en Orient possible. (...) le système impérialiste des Etats n'offre pas de place à des républiques paysannes. Un nombre insignifiant de cadres de prolétaires et semi-prolétaires ruraux locaux peut entraîner avec eux de larges masses paysannes dans la bataille contre l'impérialisme et les éléments féodaux, mais ceci requiert une situation révolutionnaire internationale qui leur permette de s'allier au prolétariat des pays avancés." 18
Il est sûr que le rapport de Pavlovitch que nous venons de citer n'est pas un modèle de clarté et contient un nombre d'idées contradictoires 19. A un autre endroit du rapport par exemple, il se réfère à "la Turquie révolutionnaire" ("L'occupation de la Thrace et d'Adrianople a pour but d'isoler la Turquie révolutionnaire et la Russie des Balkans révolutionnaires."). Il va même jusqu'à reprendre une suggestion des "camarades turcs" (probablement le groupe autour de Mustafa Suphi) selon qui "la question des Dardanelles doit être décidée par les Etats qui bordent la mer Noire, sans la participation de Wrangel 20, ni de l'Entente", et continue en disant : "Nous saluons chaleureusement cette idée dont la réalisation constituerait une première étape décisive vers une fédération de tous les peuples et de tous les pays qui bordent la mer Noire." (op. cité) Cela montre que les révolutionnaires de l'époque étaient confrontés, dans la pratique et dans des conditions extrêmement difficiles, à des problèmes nouveaux qui n'avaient pas de solution facile. Dans une telle situation, une certaine confusion était probablement inévitable.
Remarquons au passage cependant, que ces positions "de gauche" n'étaient pas mises en avant par des intellectuels occidentaux ni des révolutionnaires en chambre mais, précisément, par ceux qui devaient mettre en pratique la politique de l'IC.
La question nationale dans la pratique
Il faut souligner que les positions que nous avons fait ressortir ici de façon plutôt schématique n'existaient pas comme un seul bloc. L'IC était confrontée à des questions et à des problèmes qui étaient entièrement nouveaux : le capitalisme dans son ensemble était encore à un tournant, un moment charnière entre sa période d'ascendance triomphale et "l'époque des guerres et des révolutions" (pour utiliser l'expression de l'IC) ; l'opposition entre la bourgeoisie et le prolétariat trouvait son expression dans une opposition entre le pouvoir soviétique et les Etats capitalistes ; et les communistes d'Orient devaient "s'adapter à des conditions spécifiques que n'avaient pas connues les pays européens." 21
Il faut dire que face à ces nouvelles questions, les dirigeants de l'IC faisaient parfois preuve d'une naïveté surprenante. Voici ce que déclare Zinoviev au Congrès de Bakou : "Nous pouvons soutenir une politique démocratique telle qu'elle prend forme actuellement en Turquie et qui fera peut-être son apparition demain dans d'autres pays. Nous soutenons et nous soutiendrons les mouvements nationaux comme celui de Turquie, de Perse, d'Inde et de Chine (...), la tâche de ce mouvement (national actuel) est d'aider l'Orient à se libérer de l'impérialisme britannique. Mais nous avons notre propre tâche à mener, non moins grande – aider les travailleurs d'Orient dans leur lutte contre les riches et les aider, ici et maintenant, à construire leurs propres organisations communistes, (...) à les préparer à une réelle révolution du travail." 22 Zinoviev ne faisait rien d'autre que reprendre le Rapport de Lénine sur la question nationale au 2e Congrès de l'IC : "en tant que communistes, nous ne soutiendrons les mouvements bourgeois de libération dans les pays coloniaux que si ces mouvements sont vraiment révolutionnaires et si leurs représentants ne s'opposent pas à l'entraînement et l'organisation de la paysannerie d'une façon révolutionnaire." (op. cité)
En effet, la politique défendue par Zinoviev – et qu'au début, le pouvoir soviétique allait chercher à mettre en pratique – s'appuyait sur l'idée que les mouvements nationaux accepteraient le pouvoir soviétique comme allié tout en permettant que les communistes aient les mains libres pour les renverser. Mais les dirigeants nationalistes comme Mustapha Kemal n'étaient ni idiots ni aveugles vis-àvis de leurs intérêts propres. Kemal – pour prendre l'exemple turc – était prêt à laisser les communistes s'organiser tant qu'il avait besoin du soutien de la Russie soviétique contre la Grèce et la Grande-Bretagne. La détermination de Kemal à maintenir sous contrôle l'enthousiasme populaire pour le communisme – qui existait certainement et gagnait du terrain, même si c'était de façon confuse – amena même à la création bizarre d'un parti communiste "officiel" dont le comité central comprenait les généraux dirigeants de l'armée ! Ce PC était parfaitement clair (en fait bien plus clair que l'IC) sur la totale incompatibilité du nationalisme et du communisme. Comme l'écrivait l'organe du PC officiel", Anadoluda Yeni Gün : "Actuellement, le programme des idées communistes est non seulement nocif, mais il est même ruineux pour notre pays. Quand un ouvrier réalise qu'il ne doit pas y avoir de patrie, il n'ira pas la défendre ; en entendant qu'il ne doit pas y avoir de haine entre nations, il n'ira pas combattre les Grecs." 23 L'idéologue du Parti, Mahmud Esat Bozkurt, déclare sans ambiguïté : "Le communisme n'est pas un idéal, mais un moyen pour les Turcs. L'idéal pour les Turcs, c'est l'unité de la nation turque." 24
Bref, le pouvoir soviétique était un allié acceptable pour les nationalistes dans la mesure où il agissait non comme expression de l'internationalisme prolétarien, mais comme celle des intérêts nationaux russes.
Les conséquences de la politique de l'IC vis-à-vis de la Turquie ont été clairement exprimées dans les Mémoires d'Agis Stinas publiés en 1976 : "Le gouvernement russe et l'Internationale communiste avaient caractérisé la guerre menée par Kemal comme une guerre de libération nationale et l'avaient "en conséquence" jugée progressiste et, pour cette raison, soutenue politiquement, diplomatiquement et en lui envoyant des conseillers, des armes et de l'argent. Si l'on considère que Kemal combattait une invasion étrangère pour en libérer le sol turc, sa lutte avait un caractère de libération nationale. Mais était-elle pour autant progressiste ? Nous le croyions et le soutenions alors. Mais comment pourrions-nous aujourd'hui défendre la même thèse ? N'est progressiste à notre époque et ne peut être considéré comme progressiste que ce qui contribue à élever la conscience de classe des masses ouvrières, à développer leur capacité à lutter pour leur propre émancipation. En quoi la création de l'Etat turc moderne y a-t-il contribué ? Kemal (...) jeta les communistes turcs dans les geôles ou les pendit, puis tourna finalement le dos à la Russie, établissant des relations cordiales avec les impérialistes et se chargeant de protéger leurs intérêts. La politique juste, en accord avec les intérêts de la révolution prolétarienne, aurait été d'appeler les soldats grecs et turcs à fraterniser, et les masse populaires à lutter ensemble, sans se laisser arrêter par les différences nationales, raciales et religieuses, pour la république des conseils ouvriers et paysans en Asie mineure. Indépendamment de la politique de la Russie et des objectifs de Kemal, le devoir des communistes grecs était bien sûr la lutte intransigeante contre la guerre." 25 (nous soulignons).
L'importance de l'expérience de la gauche en Turquie ne réside pas dans son héritage théorique mais dans le fait que la lutte entre le nationalisme et le communisme à l'Est alla jusqu'au bout, non dans le débat mais sur le terrain, dans la lutte de classe. 26 Le combat de la gauche en Turquie contre l'opportunisme au sein du Parti et contre la répression de l'Etat kémaliste qui plongea les mains dans le sang des ouvriers dès sa naissance, met à nu de façon implacable les erreurs et les ambiguïtés des Thèses de l'IC sur la question nationale. La lutte de Manatov, Haçioglu et de leurs camarades appartient à l'héritage internationaliste du mouvement ouvrier.
Jens
1. Pour ce faire, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la récente biographie de Kemal Atatürk par Andrew Mango, et sur l'Histoire de la révolution russe de EH Carr, en particulier le chapitre sur "L'auto-détermination dans la pratique" dans le volume intitulé La révolution bolchevique. Le lecteur de langue française peut consulter le long article critique publié dans Programme communiste [116] n°100 [116] (décembre 2009) qui, malgré l'inévitable aveuglement des bordiguistes sur la question nationale, contient des données historiques utiles.
2. Le fait que la Turquie n'existait pas en tant que telle durant la plus grande partie de la période traitée dans la brochure permet d'une certaine façon d'expliquer que la Préface originale de l'EKS décrive la Turquie comme "un obscur pays du Moyen-Orient" ; pour le reste, l'ignorance indubitable des affaires turques par la grande majorité du monde de langue anglaise justifie l'expression. Il est amusant de voir que Programme Communiste préfère l'attribuer aux "préjugés du citoyen d’une des «grandes puissances» qui dominent le monde" sur la base de la supposition absolument non fondée que cette Préface aurait été écrite par le CCI. Devons-nous en conclure que les propres préjugés du PCI le rendent incapable d'imaginer qu'une position internationaliste sans compromis puisse être adoptée par un membre de ce qu'il aime appeler "les peuples olivâtres" ?
3. Parmi tous les crimes perpétrés au cours de la Première Guerre mondiale, le massacre des Arméniens mérite une mention spéciale. De peur que la population arménienne chrétienne ne collabore avec la Russie, le gouvernement CUP et son Ministre de la Guerre, Enver Pasha, entreprit un programme de déportation massive et de massacres menant à l'extermination de centaines de milliers de civils.
4. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Megali_Idea [117]
5. "Rapport de la commission nationale et coloniale [118]", 2e Congrès de l'IC, 26 juillet 1920.
6. Dans la critique qu'il fait à la brochure d'EKS, Programme communiste cherche à opposer Lénine à Luxemburg et va jusqu'à dire que Luxemburg, sous le nom de "Junius", "avance... un programme national de défense de la patrie!". Il est vrai que Luxemburg comme la plupart de ses contemporains n'était pas toujours libérée d'ambiguïtés et de références démodées à la question nationale telle qu'elle avait été traitée au 19e siècle par Marx et Engels, et plus généralement par la Social-démocratie. Nous avons déjà signalé ces ambiguïtés dans la Revue internationale n°12 (1978) où nous avons défendu la critique que Lénine en avait faite dans son article sur la Brochure de Junius. Il est également juste qu'une analyse économique correcte ne mène pas automatiquement à une position politique correcte (pas plus qu'une analyse économique incorrecte n'invalide des positions politiques de principe correctes). Cependant, Programme communiste n'est malheureusement pas à la hauteur de Lénine quand il cite en les tronquant honteusement les textes de Rosa Luxemburg pour éviter que ses lecteurs puissent lire en quoi consistait le prétendu "programme national" de celle-ci : "Oui, les sociaux-démocrates doivent défendre leur pays lors des grandes crises historiques. Et la lourde faute du groupe social-démocrate du Reichstag est d'avoir solennellement proclamé dans sa déclaration du 4 août 1914 : « A l'heure du danger, nous ne laisserons pas notre patrie sans défense », et d'avoir, dans le même temps, renié ses paroles. Il a laissé la patrie sans défense à l'heure du plus grand danger. Car son premier devoir envers la patrie était à ce moment de lui montrer les dessous véritables de cette guerre impérialiste, de rompre le réseau de mensonges patriotiques et diplomatiques qui camouflait cet attentat contre la patrie ; de déclarer haut et clair que, dans cette guerre, la victoire et la défaite étaient également funestes pour le peuple allemand ; de résister jusqu'à la dernière extrémité à l'étranglement de la patrie au moyen de l'état de siège ; de proclamer la nécessité d'armer immédiatement le peuple et de le laisser décider lui-même la question de la guerre ou de la paix ; d'exiger avec la dernière énergie que la représentation populaire siège en permanence pendant toute la durée de la guerre pour assurer le contrôle vigilant de la représentation populaire sur le gouvernement et du peuple sur la représentation populaire ; d'exiger l'abolition immédiate de toutes les limitations des droits politiques, car seul un peuple libre peut défendre avec succès son pays ; d'opposer, enfin, au programme impérialiste de guerre - qui tend à la conservation de l'Autriche et de la Turquie, c'est-à-dire de la réaction en Europe et en Allemagne -, le vieux programme véritablement national des patriotes et des démocrates de 1848, le programme de Marx, Engels et Lassalle." (nous soulignons). https://www.marxists.org/francais/luxembur/junius/rljgf.html [119]
7. Article "Ou – ou", 16 avril 1916, traduit de l'anglais par nous. Cela ne veut pas dire que les délégués qui faisaient écho à certaines positions de Luxemburg se soient considérés comme "luxemburgistes" car il n'est pas du tout évident qu'ils aient même connu les écrits de cette dernière.
8. ibid. note 6
9. Rapport de Lénine au Second Congrès des organisations communistes des peuples d'Orient, Novembre 1918, cité dans Le marxisme et l'Asie, Carrère d'Encausse et Schram.
10. Un exemple frappant de la domination des intérêts de l'Etat russe se rencontre dans l'attitude du pouvoir soviétique face au mouvement dans le Guilan (Perse). L'étude de ce mouvement dépasse le cadre de cet article mais les lecteurs intéressés peuvent trouver certaines informations dans l'étude de Vladimir Genis Les Bolcheviks au Guilan, publiée dans Les Cahiers du Monde russe, juillet – septembre 1999.
11. Manabendra Nath Roy (1887 – 1954). Né sous le nom de Narenra Nath Bhattacharya et connu sous celui de M. N. Roy, il était un révolutionnaire indien bengali, connu internationalement comme militant et théoricien politique. Il fonda le Parti communiste en Inde et au Mexique. Il commença son activité politique dans l'aile extrémiste du nationalisme indien mais évolua vers des positions communistes pendant un séjour à New York au cours de la Première Guerre mondiale. Il s'envola pour Mexico pour échapper à la surveillance des services secrets britanniques et y participa à la fondation du Parti communiste. Il fut invité à assister au Deuxième Congrès de l'IC et collabora avec Lénine dans la formulation des "Thèses sur la question nationale".
12. M.N. Roy, Discours au 2 [120]e [120] Congrès de l'IC [120], juillet 1920.
13. Traduit de l'anglais par nous. M.N. Roy, The awakening of the East [121].
14. ibid. note 12
15. Sultanzade était en fait d'origine arménienne ; son vrai nom était Avetis Mikailian. Il est né en 1890 dans une famille de paysans pauvres de Marageh (au Nord-Ouest de la Perse). Il rejoignit les Bolcheviks en 1912, probablement à Saint Petersburg. Il travailla pour l'IC à Bakou et au Turkestan, et fut l'un des principaux organisateurs du Premier Congrès du Parti communiste perse à Anzali en juin 1920. Il assista au Deuxième Congrès de l'IC en tant que délégué du Parti perse. Il resta à gauche de l'Internationale et s'opposa aux "dirigeants nationalistes" de l'Est (tels que Kemal) ; il critiqua également très sévèrement les prétendus "experts" de l'IC sur l'Orient et la Perse. Il mourut dans les purges staliniennes entre 1936 et 1938. Voir l'étude de Cosroe Chaqeri sur Sultanzade dans Iranian Studies, printemps – été 1984.
16. Traduit de l'anglais par nous, The Second Congress of the Communist International, Vol.1 New Park
17. Voir Cosroe Chaqeri, op. cit. Dans les Cahiers du monde russe, 40/3, juillet-septembre 1999, Vladimir Genis mentionne un rapport rédigé par Pavlovitch et Sultanzade, à la demande de Lénine à la suite du 2e Congrès de l'IC, sur "Les objectifs du parti communiste en Perse". Le Rapport propose de mener une propagande massive "en vue de la liquidation complète de la propriété privée et du transfert des terres aux paysans" car "la classe des propriétaires ne peut être le support de la révolution, que ce soit dans le combat contre le shah ou, même, contre les Anglais."
18. Cité dans Le marxisme et l'Asie, Carrère d'Encausse et Schram
19. Mais il est significatif que Pavlovitch pose les questions en ces termes.
20. Wrangel était l'un des généraux des armées blanches dont les campagnes contre la révolution étaient financées par les grandes puissances – dans le cas de Wrangel, par la France en particulier.
21. Traduit de l'anglais par nous, Lénine cité dans Le marxisme et l'Asie, op. cit.
22. Traduit de l'anglais par nous.
23. Traduit de l'anglais par nous, cité par George S. Harris dans The origins of Communism in Turkey.
24. Ibid.
25. Mémoires, Editions La Brèche-PEC, 1990, chapitre 2 "Le réveil des masses populaires", page 42. Pour un résumé de la vie de Stinas, voir la Revue internationale [122] n°72 [122].
26. Comme l'écrit la brochure, "l'aile gauche du Parti communiste turc était formée autour de l'opposition au mouvement de libération nationale pour des raisons pratiques, du fait de ses terribles conséquences pour les ouvriers, ne leur apportant que des souffrances et la mort". Quand le groupe EKS a écrit la brochure, il était bien conscient – comme le CCI - que la gauche turque n'occupe pas la même place dans le développement théorique et organisationnel de la Gauche communiste que la Gauche italienne par exemple. C'est pourquoi la brochure s'intitule The left wing of the TKP ("l'aile gauche du PCT") et non The Turkish Communist Left ("la gauche communiste turque"). Apparemment, cette distinction n'est pas claire pour Programme communiste. Mais alors Programme communiste tend à traiter la Gauche communiste comme sa propriété personnelle et défend l'idée que seule la Gauche italienne "se situait, elle, sur la base du marxisme orthodoxe" (l'expression "marxisme orthodoxe" est elle-même une notion grotesque qui est totalement – osons le dire – non marxiste ). Programme communiste continue par de longs développements sur tous les différents courants, de droite et de gauche, dans "le jeune mouvement communiste" et nous informe savamment qu'ils pouvaient être "de droite" ou "de gauche" selon les changements de la politique de l'IC, citant la caractérisation de Bordiga par Zinoviev en 1924. Mais pourquoi ne mentionne-t-il pas la brochure de Lénine écrite contre "les communistes de gauche", spécifiquement en Italie, Allemagne, Hollande et Grande-Bretagne ? Contrairement à Programme communiste, Lénine n'avait aucune difficulté à voir qu'il y avait quelque chose de commun entre "les communistes de gauche" – même si nous ne partageons évidemment pas sa description du communisme de gauche comme une "maladie infantile".
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
Revue Internationale n° 143 - 4e trimestre 2010
- 2217 lectures
Débâcle économique, catastrophes "naturelles", chaos impérialiste, ....
Le capitalisme est un système en faillite qu'il faut abattre
Depuis la crise du système financier en 2008, plus rien ne semble pouvoir camoufler la profondeur de la crise historique que traverse le capitalisme. Alors que les attaques contre la classe ouvrière pleuvent, que la misère se répand, les tensions impérialistes s'aiguisent, la faim continue de frapper plusieurs centaines de millions de personnes, les catastrophes naturelles se font toujours plus meurtrières. La bourgeoisie elle-même ne peut nier l'ampleur des difficultés ni dessiner l'horizon chimérique d'un avenir meilleur sous sa domination. C’est ainsi que, jusque dans ses organes de propagande, elle concède que la crise actuelle est la plus grave qu’ait connu le capitalisme depuis celle des années 1930, que le développement de la misère est un mal avec lequel il nous faudra "apprendre à vivre." Mais la bourgeoisie est une classe disposant de nombreuses capacités d'adaptation : s'il lui faut admettre, un peu contrainte par l'évidence de la situation, beaucoup par calcul politique, que les choses vont mal et qu’elles ne sont pas prêtes de s’améliorer, elle sait, dans le même temps, présenter les problèmes de manière suffisamment fallacieuse pour épargner le système capitaliste comme un tout. Les banques font faillite, entraînant dans leur sillage l'économie mondiale ? La faute aux traders ! L'endettement de certains États est tel qu'ils se déclarent en cessation de paiement ? La faute aux gouvernements corrompus ! La guerre ravage une partie de la planète ? Un manque de volonté politique ! Les catastrophes environnementales se multiplient causant toujours plus de victimes ? La faute à la nature ! Si des divergences existent dans les multiples analyses que propose la bourgeoisie, elles se rejoignent toutes sur un point essentiel qui consiste à dénoncer telle ou telle forme de gouvernance mais pas le capitalisme comme mode de production. En réalité, l'ensemble des calamités qui s’abattent sur la classe ouvrière est le résultat des contradictions qui, tous les jours un peu plus fortement, étranglent la société quel qu'en soit le mode de gouvernement, dérégulé ou étatique, démocratique ou dictatorial. Pour mieux camoufler la faillite de son système, la bourgeoisie prétend également que la crise économique débutée en 2008 reflue légèrement. Cette dernière est non seulement loin d'être terminée mais, de plus en plus explicitement, elle exprime l’approfondissement de la crise historique du capitalisme.
Le capitalisme s'enfonce dans la crise
La bourgeoisie se félicite parfois des perspectives positives qu’annoncent les indicateurs économiques, en particulier les chiffres de la croissance qui commencent timidement à repartir à la hausse. Mais derrière ces "bonnes nouvelles", la réalité est bien différente. Dès 2008, afin d'éviter le scénario catastrophe de la crise des années 30, la bourgeoisie a dépensé des milliards pour soutenir les banques en grandes difficultés et mis en place des mesures keynésiennes. Ces mesures consistent, notamment, à diminuer les taux directeurs des banques centrales, qui déterminent le prix du crédit, et, pour l’État, à engager des dépenses de relance économique, souvent financées par l’endettement. Une telle politique est censée avoir pour effet bénéfique le développement d'une forte croissance. Or, aujourd'hui, ce qui frappe d'emblée, c’est l’extrême mollesse de la croissance mondiale au regard des astronomiques dépenses de relance et de l’agressivité des politiques inflationnistes. Les États-Unis se trouvent ainsi dans une situation que les économistes bourgeois, faute de pouvoir s’appuyer sur l’analyse marxiste, ne comprennent pas : l’État américain s’est endetté de plusieurs centaines de milliards de dollars et le taux directeur de la FED est proche de zéro ; pourtant, la croissance devrait s’élever à seulement 1,6% en 2010, contre les 3,7% espérés. Comme l’illustre le cas américain, si, depuis 2008, la bourgeoisie a momentanément évité le pire en s‘endettant massivement, la reprise n’est pas vraiment là. Incapables de comprendre que le système capitaliste est un mode de production transitoire, prisonniers de schémas sclérosés, les économiste bourgeois ne voient pas l’évidence : le keynésianisme a fait la preuve de son échec historique depuis les années 1970 parce que les contradictions du capitalisme sont désormais insolubles, y compris par la tricherie de l’endettement avec les lois fondamentales du capitalisme.
L’économie capitaliste se maintient péniblement depuis de nombreuses décennies par le gonflement prodigieux de la dette de tous les pays du monde afin de créer artificiellement un marché destiné à absorber une partie de la surproduction chronique. Mais la relation du capitalisme à l’endettement s’apparente à de l’opiomanie : plus il consomme, moins la dose est suffisante. En d'autres termes, la bourgeoisie a maintenu la tête hors de l’eau en s’agrippant à une planche de salut pourrie qui a fini par craquer en 2008. C’est ainsi qu’à l’inefficacité patente des déficits budgétaires s’ajoute le risque d'insolvabilité de nombreux pays, en particulier la Grèce, l’Italie, l'Irlande ou l'Espagne. Dans ce contexte, les gouvernements de tous les pays sont réduits à naviguer au jour le jour, modifiant leurs politiques économiques, de la relance à la rigueur en fonction des événements, sans que rien ne puisse durablement améliorer la situation. L’État, ultime recours contre la crise historique qui étrangle le capitalisme, n’est définitivement plus en mesure de camoufler son impuissance.
Partout dans le monde, des attaques sans précédent contre la classe ouvrière continuent de s’abattre aussi rapidement que les taux de chômage augmentent. Les gouvernements, de droite comme de gauche, imposent aux prolétaires des réformes et des coupes budgétaires d'une brutalité peu commune, comme en Espagne où, entre autres choses, les fonctionnaires ont vu leur salaire diminuer de 5% cette année par le gouvernement socialiste de Zapatero qui promet déjà leur gel en 2011. En Grèce, c’est notamment l'âge moyen de départ à la retraite qui a augmenté de 14 ans tandis que les pensions sont gelées jusqu‘en 2012. En Irlande, pays que la bourgeoisie vantait encore récemment pour son dynamisme, le taux officiel de chômage s’élève à 14%, tandis que les salaires des fonctionnaires ont également été allégés de 5 à 15% tout comme les indemnités des chômeurs ou les allocations familiales. D'après l’Organisation Internationale du Travail, le nombre de chômeurs dans le monde est passé de 30 millions, en 2007, à 210 millions, aujourd'hui1. On pourrait multiplier les exemples car, sur tous les continents, la bourgeoisie fait payer à la classe ouvrière le prix fort de la crise. Mais derrière les plans d'austérité hypocritement appelés réformes, derrière les licenciements et les fermetures d‘usine, des familles entières sombrent dans la pauvreté. Aux États-Unis, près de 44 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté d'après un rapport du Census Bureau, soit une augmentation de 6,3 millions de pauvres en deux ans, qui viennent s’ajouter aux trois précédentes années qui avaient déjà connu un fort développement de la pauvreté. La décennie a d'ailleurs été marquée aux États-Unis par une forte diminution de la valeur des bas revenus.
Il n’y a pas qu’au sein des "pays riches" que la crise se paie par la misère. Récemment, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (plus connue sous le sigle : FAO.) se félicitait d'observer en 2010 un recul de la sous-alimentation qui touche particulièrement l’Asie (578 millions de personnes) et l’Afrique (239 millions), pour un total de 925 millions de personnes dans le monde. Ce que les statistiques ne révèlent pas immédiatement, c’est que ce chiffre reste largement supérieur à celui publié en 2008, avant que les effets de l’inflation spéculative des prix de l’alimentation ne se fassent sentir jusqu’à provoquer une série d'émeutes dans de nombreux pays. Le recul significatif des prix agricoles a, certes, fait modestement "reculer la faim dans le monde" mais la tendance sur plusieurs années, c’est-à-dire indépendamment de la conjoncture économique immédiate, est indéniablement à la hausse. D'ailleurs, les canicules de l’été en Russie, en Europe de l’Est et, récemment, en Amérique latine ont très sensiblement diminué le rendement des récoltes mondiales, ce qui, dans un contexte d'augmentation des prix, va inévitablement faire croître la malnutrition l’an prochain. Ainsi, il n’y a pas qu’au niveau économique que la faillite du capitalisme s‘exprime. Les dérèglements climatiques et la gestion bourgeoise des catastrophes environnementales constituent une cause croissante de mortalité et de dénuement.
Le capitalisme détruit la planète
Cet été, de violentes catastrophes se sont abattues sur les populations partout dans le monde : les flammes ont embrasé la Russie, le Portugal et de nombreux autres pays ; des moussons dévastatrices ont noyé le Pakistan, l’Inde, le Népal et la Chine sous la boue. Au printemps, le Golfe du Mexique connaissait la pire catastrophe écologique de l’histoire après l’explosion d'une plate-forme pétrolière. La liste des catastrophes de l’année 2010 est encore longue. La multiplication de ces phénomènes et leur gravité croissante ne sont pas le fruit du hasard car de l’origine des catastrophes jusqu'à à leur gestion, le capitalisme en porte une très lourde responsabilité.
Récemment, la rupture du réservoir mal entretenu d'une usine de production d'aluminium a engendré une catastrophe industrielle et écologique en Hongrie : plus d'un million de mètres cubes de "boue rouge" toxique s'est répandu autour de l'usine, causant plusieurs morts et de nombreux blessés. Les dégâts environnementaux et sanitaires sont très importants. Or, pour "minimiser les impacts" de ces déchets, les industriels retraitent la boue rouge de la manière suivante : soit ils la rejettent dans la mer par milliers de tonnes, soit ils l'entreposent dans d'immense bassin de rétention, à l'image de celui qui a cédé en Hongrie, alors que des technologies existent depuis longtemps pour recycler de pareils déchets, en particulier dans le bâtiment et l'horticulture.
La destruction de la planète par la bourgeoisie ne se limite cependant pas aux innombrables catastrophes industrielles qui frappent chaque année de nombreuses régions. Selon l’avis de nombreux scientifiques, le réchauffement de la planète joue un rôle majeur dans la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes : "Ce sont des événements qui sont appelés à se reproduire et à s’intensifier dans un climat perturbé par la pollution des gaz à effet de serre" selon le vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Et pour cause, de 1997 à 2006, alors que la température de la planète ne cessait d'augmenter, le nombre de catastrophes, de plus en plus dévastatrices, a augmenté de 60 % par rapport à la décennie précédente, entraînant dans leur sillage de plus en plus de victimes. D'ici 2015, le nombre de victimes de catastrophes météorologiques devrait augmenter de plus de 50%.
Les scientifiques des compagnies pétrolières peuvent s’agiter en déclarant que le réchauffement planétaire n’est pas le résultat d'une pollution massive de l’atmosphère, l’ensemble des recherches scientifiques sérieuses démontre une corrélation évidente entre le rejet des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et la multiplication des catastrophes naturelles. Cependant, les scientifiques se trompent lorsqu’ils affirment qu’un peu de volonté politique des gouvernements est en mesure de changer les choses. Le capitalisme est incapable de limiter les rejets de gaz à effet de serre car il devrait alors aller à l'encontre de ses propres lois, celles du profit, de la production à moindre frais et de la concurrence. C’est la nécessaire soumission à ces lois qui fait que la bourgeoisie pollue avec, entre autres exemples, son industrie lourde, ou qu’elle fait inutilement parcourir à ses marchandises des milliers de kilomètres.
La responsabilité du capitalisme dans l’ampleur de ces catastrophes ne se limite d'ailleurs pas à la pollution atmosphérique et au dérèglement climatique. La destruction méthodique des écosystèmes, à travers, par exemple, la déforestation massive, le stockage des déchets dans les zones naturelles de drainage, ou l’urbanisation anarchique, parfois jusque dans le lit des rivières asséchées et au cœur de secteurs notablement inflammables, ont fortement aggravé l’intensité des catastrophes.
La série d'incendies qui a frappé la Russie au cœur de l’été, en particulier une large région autour de Moscou, est significative de l’incurie de la bourgeoisie et de son impuissance à maîtriser ces phénomènes. Les flammes ont embrasé des centaines de milliers d'hectares causant un nombre indéterminé de victimes. Pendant plusieurs jours, une épaisse fumée, dont les conséquences sur la santé ont été catastrophiques au point de doubler le taux quotidien de mortalité, a envahi la capitale. Et pour faire bonne mesure, des risques nucléaires et chimiques importants menacent encore les populations bien au-delà des frontières russes à cause, notamment, des incendies sur des terres contaminées par l’explosion de la centrale de Tchernobyl et des entrepôts d'armes et de produits chimiques plus ou moins oubliés dans la nature.
Un élément essentiel pour comprendre le rôle de la bourgeoisie dans l’envergure des incendies est l’état stupéfiant d'abandon des forêts. La Russie est un pays immense doté d'un parc forestier très important et dense, nécessitant un soin particulier pour circonscrire rapidement les débuts d'incendies afin d'éviter qu’ils ne se répandent jusqu’à devenir incontrôlables. Or, beaucoup de massifs forestiers russes ne sont même pas dotés de voies d'accès, si bien que les camions de pompiers sont incapables d'atteindre le cœur de la plupart des incendies. La Russie compte d'ailleurs seulement 22 000 pompiers, soit moins qu’un petit pays comme la France, pour lutter contre les flammes, et les gouverneurs régionaux, notablement corrompus, préfèrent employer les maigres moyens dont ils disposent pour la gestion des forêts à l'achat de voitures de luxe, comme l'ont révélé plusieurs scandales.
Le même cynisme vaut pour les fameux feux de tourbière, zones dont le sol est constitué de matière organique en décomposition particulièrement inflammable : en plus de laisser les tourbières à l’abandon, la bourgeoisie russe a favorisé la construction d'habitations sur ces zones alors que des incendies avaient déjà fortement sévi en 1972. Le calcul est bien simple : sur ces secteurs dangereux, les promoteurs immobiliers ont pu acheter des terrains, déclarés constructibles par la loi, à un prix dérisoire.
C’est de cette manière que le capitalisme transforme des phénomènes naturels humainement maîtrisables en véritables catastrophes. Mais, en matière d'horreur, la bourgeoisie ne s’arrête devant rien. C’est ainsi qu’autour des dévastatrices inondations qui ont frappé le Pakistan, s’est jouée une lutte impérialiste des plus crapuleuses.
Durant plusieurs semaines, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Pakistan, occasionnant des inondations majeures, des glissements de terrain, des milliers de victimes, plus de 20 millions de sinistrés et des dégâts matériels considérables. La famine et la propagation de maladies, notamment le choléra, sont venues empirer une situation déjà désespérée. Pendant plus d'un mois, au milieu de cet horrible tableau, la bourgeoisie pakistanaise et son armée n’ont fait qu’étaler une incompétence et un cynisme hallucinants, accusant l’implacabilité de la nature, alors que, comme en Russie, entre urbanisation anarchique et services de secours impuissants, les lois du capitalisme apparaissent comme l’élément essentiel pour comprendre l’ampleur de la catastrophe.
Mais un aspect particulièrement écœurant de cette tragédie est la manière dont les puissances impérialistes essayent encore de tirer profit de la situation, au détriment des victimes, en utilisant les opérations humanitaires comme alibi. En effet, les États-Unis soutiennent, dans le cadre de la guerre avec l’Afghanistan voisin, le gouvernement très contesté de Youssouf Raza Gilani, et ont très rapidement profité des événements pour déployer un important contingent "humanitaire" constitué de porte-hélicoptères, de navires d'assaut amphibies, etc. Sous le prétexte d'empêcher un soulèvement des terroristes d'Al-Qaida, que favoriseraient les inondations, les États-Unis freinent, autant que faire se peut, l’arrivée de "l’aide internationale" venant d'autres pays, "aide humanitaire" elle aussi constituée de militaires, de diplomates et d'investisseurs sans scrupules.
Comme pour chaque catastrophe d'ampleur, tous les moyens sont mis en œuvre par tous les États pour faire valoir leurs intérêts impérialistes. Parmi ces moyens, la promesse de dons est devenue une opération systématique : tous les gouvernements annoncent officiellement une manne financière substantielle qui n’est officieusement accordée qu’en échange de la satisfaction des ambitions des donateurs. Par exemple, à ce jour, 10 % seulement de l’aide internationale promise en janvier 2010 après le tremblement de terre à Haïti a été effectivement versée à la bourgeoisie haïtienne. Et le Pakistan ne fera bien sûr pas exception à la règle ; les millions promis ne seront versés qu’à titre de commission d'État contre services rendus.
Les fondements du capitalisme, la recherche du profit, la concurrence, etc., sont donc, à tous les niveaux, au cœur de la problématique environnementale. Mais les luttes autour du Pakistan illustrent également les tensions impérialistes croissantes qui ravagent une partie de la planète.
Le capitalisme sème le chaos et la guerre
L’élection de Barack Obama à la tête de la première puissance mondiale a suscité beaucoup d'illusions sur la possibilité de pacifier les rapports internationaux. En réalité, la nouvelle administration américaine n’a fait que confirmer la dynamique impérialiste ouverte avec l’effondrement du bloc de l’Est. L'ensemble de nos analyses selon lesquelles "la discipline rigide des blocs impérialistes" devait, suite à l'effondrement du bloc de l'Est, céder la place à l’indiscipline et à un chaos rampant, à une lutte généralisée de tous contre tous et à une multiplication incontrôlable des conflits militaires locaux s’est pleinement vérifiée. La période ouverte par la crise et l’aggravation considérable de la situation économique n’a fait qu’aiguiser les tensions impérialistes entre les nations. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, pas moins de 1 531 milliards de dollars auraient été dépensés dans les budgets militaires de tous les pays en 2009, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2008 et de 49% par rapport à 2000. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte les transactions illégales d'armement. Même si la bourgeoisie de certains États se trouve contrainte, crise oblige, de rogner sur ses dépenses militaires, fondamentalement la militarisation croissante de la planète est le reflet du seul futur qu'elle réserve à l'humanité : la multiplication des conflits impérialistes.
Les États-Unis, avec leurs 661 milliards de dépenses militaires en 2009, bénéficient d'une supériorité militaire absolument incontestable. Pourtant, depuis l’effondrement du bloc de l’Est, le pays est de moins en moins en mesure de mobiliser d'autres nations derrière lui, comme en avait témoigné la guerre d'Irak débutée en 2003 où, en dépit du retrait annoncé récemment, les troupes américaines comptent encore plusieurs dizaines de milliers de soldats. Non seulement les États-Unis n’ont pas été en mesure de fédérer beaucoup d'autres puissances sous leur bannière, notamment la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine mais, en plus, d‘autres se sont petit à petit désengagées du conflit, en particulier le Royaume-Uni et l'Espagne. Surtout, la bourgeoisie américaine semble de moins en moins capable d'assurer la stabilité d'un pays conquis (les bourbiers afghan et irakien sont symptomatiques de cette impuissance) ou d'une région, comme l'illustre la manière dont l'Iran défie les Etats-Unis sans crainte de représailles. L’impérialisme américain est ainsi nettement sur le déclin et cherche à reconquérir son leadership perdu depuis plusieurs années à travers des guerres qui, finalement, l’affaiblissent considérablement.
Face aux États-Unis, la Chine tente de faire prévaloir ses ambitions impérialistes à travers l'effort d'armement (100 milliards de dollars de dépenses militaires en 2009, avec des augmentations annuelles à deux chiffres depuis les années 90) et sur le terrain. Au Soudan, par exemple, comme dans beaucoup d'autres pays, elle s’implante économiquement et militairement. Le régime soudanais et ses milices, armés par la Chine, poursuivent le massacre des populations accusées de soutenir les rebelles du Darfour, eux-mêmes armés par la France, par l’intermédiaire du Tchad, et les États-Unis, ancien adversaire de la France dans la région. Toutes ces manœuvres écœurantes ont engendré la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement de plusieurs millions d'autres.
Les États-Unis et la Chine sont loin de porter à eux seuls la responsabilité du chaos guerrier sur la planète. En Afrique, par exemple, la France, directement ou par milices interposées, essaye de sauver ce qu’elle peut de son influence, notamment au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc. Les cliques palestiniennes et israéliennes, soutenus par leurs parrains respectifs, poursuivent une guerre interminable. La décision israélienne de ne pas prolonger le moratoire sur la construction dans les territoires occupés, alors que "négociations de paix" organisées par les États-Unis se poursuivent, montre d'ailleurs l'impasse de la politique Obama qui voulait se distinguer de celle de Bush par plus de diplomatie. La Russie, à travers la guerre en Géorgie ou l’occupation de la Tchétchénie, essaye de recréer une sphère d'influence autour d'elle. La litanie des conflits impérialistes est trop longue pour que nous puissions l’exposer ici de manière exhaustive. Néanmoins, ce que la multiplication des conflits révèle, c'est que toutes les fractions nationales de la bourgeoisie, puissantes ou pas, n'ont d'autre alternative à proposer que répandre le sang en défense de leurs intérêts impérialistes.
La classe ouvrière reprend le chemin de la lutte
Face à la profondeur de la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme, la combativité ouvrière n’est manifestement pas à la hauteur des enjeux, le poids des défaites du prolétariat pèse encore lourdement sur la conscience de notre classe. Mais les armes de la révolution se forgent au cœur des luttes que la crise commence à développer significativement. Depuis plusieurs années de nombreuses luttes ouvertes ont éclaté, parfois simultanément au niveau international. La combativité ouvrière s’exprime ainsi simultanément au sein des pays "riches" - en Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, en Grèce, en Irlande, en France, au Japon, etc. - et des pays "pauvres." Si la bourgeoisie des pays riches diffuse l’idée crapuleuse et mensongère que les travailleurs des pays pauvres s’approprient les emplois de ceux des pays riches, elle prend bien soin d'imposer un quasi black-out sur les luttes de ces ouvriers qui feraient apparaître qu'eux aussi sont victimes des mêmes attaques que le capitalisme en crise impose dans tous les pays.
En Chine, dans un pays où la part des salaires dans le PIB est passée de 56% en 1983 à 36% en 2005, les ouvriers de plusieurs usines ont cherché à s’émanciper des syndicats, malgré de fortes illusions sur la possibilité d'un syndicat libre. Surtout, les ouvriers chinois ont réussi à coordonner eux-mêmes leur action et à élargir leur lutte au-delà de l’usine. Au Panama, une grève a éclaté le 1er juillet dans les bananeraies de la province de Bocas de Toro pour réclamer le paiement des salaires et s‘opposer à une réforme antigrève. Là aussi, malgré une vive répression policière et les multiples sabotages syndicaux, les travailleurs ont immédiatement cherché, et avec succès, à étendre leur mouvement. La même solidarité et la même volonté de se battre collectivement ont animé un mouvement de grève sauvage au Bangladesh, violemment réprimé par les forces de l'ordre.
Dans les pays centraux, la réaction ouvrière en Grèce s'est poursuivie à travers de nombreuses luttes, en particulier en Espagne où les grèves se multiplient contre les mesures draconiennes d'austérité. La grève organisée par les travailleurs du métro de Madrid est significative de la volonté des ouvriers d'étendre leur lutte et de s'organiser collectivement à travers des assemblées générales. C'est pour cela qu'elle a été le cible d'une campagne de dénigrement orchestrée par le gouvernement socialiste de Zapatero et ses médias. En France, si les syndicats parviennent à encadrer les grèves et les manifestations, la réforme visant à allonger l'âge de départ à la retraite provoque la mobilisation d'une large frange de la classe ouvrière et donne lieu à des expressions, certes très minoritaires mais également très significatives, d'une volonté de s'organiser en dehors des syndicats à travers des assemblées générales souveraines et d'étendre les luttes.
Evidemment, la conscience du prolétariat mondial est encore insuffisante et ces luttes, quoique simultanées, ne sont pas immédiatement en mesure de créer les conditions d'un même combat au niveau international. Néanmoins, la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme, les cures d'austérité et la misère croissante vont inévitablement produire une multiplication de luttes toujours plus massives à travers lesquelles les ouvriers développeront petit à petit leur identité de classe, leur unité, leur solidarité, leur volonté de se battre collectivement. Ce terrain est le terreau d'une politisation consciente du combat ouvrier pour son émancipation. Le chemin vers la révolution est encore long mais, comme l’écrivaient Marx et Engels dans le Manifeste communiste : "La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort ; elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires."
V. (08/10/10)
1. Ces statistiques mettent en évidence une augmentation générale officielle du chômage que les tricheries de la bourgeoisie ne peuvent plus dissimuler. Il faut cependant être conscient que ces chiffres sont loin de refléter l'ampleur du phénomène puisque, dans tous les pays, y compris ceux où la bourgeoisie a dû aller le plus loin dans la mise en place d'un dispositif d'amortisseurs sociaux, le fait de ne pas retrouver de travail a pour conséquence qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus considéré comme chômeur.
L'automne chaud 1969 en Italie, un moment de la reprise historique de la lutte de classe (II)
- 4091 lectures
Dans l’article précédent nous avons évoqué la grande lutte menée par la classe ouvrière en Italie à la fin des années 60, passée à l’histoire sous le nom "d’automne chaud", dénomination qui, comme nous l’avons rappelé dans cet article, est trop étroite pour désigner une phase de lutte qui a impliqué les prolétaires en Italie au moins pendant les années 1968-1969 et qui a laissé des traces profondes au cours des années suivantes. Nous avions également mis en lumière comment cette lutte en Italie n’a pas été qu’un des nombreux épisodes au sein d’un processus de reprise internationale de la lutte de classe après la longue période de contre-révolution subie par le monde entier après la défaite de la vague révolutionnaire des années 20. La conclusion de ce premier article rappelait que ce développement énorme de combativité, accompagné de moments importants de clarification dans la classe ouvrière, allait rencontrer cependant, dans la période qui allait suivre, des obstacles importants. La bourgeoisie italienne, comme celle des autres pays qui avaient dû faire front au réveil de la classe ouvrière, n’est pas restée longtemps les bras croisés et, à côté des interventions directes des corps de police, elle a cherché progressivement à contourner l’obstacle par des moyens divers. Comme nous allons le voir dans cet article, la capacité de récupération de la bourgeoisie se base largement sur les faiblesses d’un mouvement prolétarien qui, malgré une énorme combativité, était encore privé d’une conscience de classe claire et dont les avant-gardes elles-mêmes n’avaient pas la maturité ni la clarté nécessaires pour jouer leur rôle.
Les faiblesses de la classe ouvrière pendant l’Automne chaud
Les faiblesses de la classe ouvrière au moment de l’automne chaud sont principalement liées à la rupture organique profonde qui s’était produite dans le mouvement ouvrier après la défaite de la vague révolutionnaire des années 20 et à la domination étouffante du stalinisme. Cela avait joué de façon doublement négative sur la conscience de la classe ouvrière. D’un côté, tout le patrimoine politique de classe avait été effacé, la perspective du communisme étant confondue avec les programmes interclassistes de nationalisations et la lutte de classe elle-même toujours plus confondue avec la lutte pour la "défense de la patrie" ! 1 De l’autre côté, la continuité apparente dans le passage de la vague révolutionnaire des années 20 à la phase la plus atroce de la contre-révolution, avec les purges staliniennes et les millions de prolétaires massacrés au nom du "communisme", a imprimé dans la tête des gens, grâce aussi à la propagande perverse de la bourgeoisie sur les communistes qui seraient des gens toujours prêts à opprimer et exercer la violence contre les hommes, l’idée qu’effectivement le marxisme et le léninisme devaient être rejetés ou, pour le moins, profondément révisés. Ainsi, quand la classe ouvrière se réveille, au niveau italien et international, elle n’est épaulée par aucune organisation révolutionnaire aux bases théoriques solides qui puisse soutenir son effort de reprise. De fait, presque tous les nouveaux groupes qui se reconstituent sur la lancée de la reprise de la lutte de classe à la fin des années 60, bien que reprenant en main les classiques, le font avec un certain a priori critique qui ne les aidera pas à retrouver ce dont ils ont besoin. Par ailleurs, même les formations de la Gauche communiste qui avaient survécu pendant les longues années de la contre-révolution, n’étaient pas restées politiquement indemnes. Les conseillistes, témoignage presque effacé de l’expérience héroïque de la gauche germano-hollandaise des années 20, encore terrorisés par le rôle néfaste que pourrait assumer dans le futur un parti dégénéré qui, comme le parti stalinien, établirait sa domination sur l’Etat et sur le prolétariat, se retranchaient de plus en plus dans une posture de "participants aux luttes" sans jouer de rôle quelconque d’avant-garde et en gardant pour eux tout l’héritage des leçons du passé. Il en a été de même, d'une certaine façon, de la part des bordiguistes et de la gauche italienne d’après 1943 (Programme Communiste et Battaglia Comunista), qui eux, au contraire, revendiquent avec force un rôle pour le parti. Paradoxalement, du fait de leur incapacité à comprendre la phase dans laquelle ils se trouvaient et d’une sorte d’adulation pour le parti, conjuguée à une certaine sous-estimation des luttes ouvrières lorsqu'elles sont menées en l'absence d'organisations révolutionnaires, ils se sont refusé à reconnaître, dans l’automne chaud et dans les luttes de la fin des années 60, la reprise historique de la classe au niveau international. De ce fait, leur présence à l’époque a été pratiquement nulle. 2 C’est pourquoi les nouveaux groupes politiques qui s’étaient formés pendant les années 60, soit du fait de la méfiance issue de la confrontation avec les expériences politiques précédentes, soit du fait de l’absence de références politiques déjà présentes, ont été poussés à réinventer des positions et un programme d’action. Le problème, toutefois, c’est qu’ils avaient comme point de départ l’expérience vécue au sein du vieux parti stalinien décrépi. D’où cette génération nombreuse de militants qui s’affichent en opposition à de tels partis et aux syndicats, rompant les ponts avec les partis de gauche, mais aussi partiellement avec la tradition marxiste, allant à la recherche d’une voie révolutionnaire dans la "nouveauté" qu’ils pensent trouver dans la rue, développant grandement le spontanéisme et le volontarisme, parce que, ce qui se présente encore sous l’habit officiel, c’est ou le stalinisme ancienne manière (URSS et PCI) ou la forme nouvelle des "chinois".
L’idéologie dominante de l’Automne chaud : l’opéraïsme
C’est dans ce contexte que se développe l’opéraïsme, l’idéologie dominante de l’automne chaud. La réaction justifiée des prolétaires qui reprirent la lutte de classe contre les structures bureaucratisées et asphyxiantes du PCI 3 et des syndicats, les conduisit à retirer toute confiance à ces structures et à mettre toute cette confiance dans la classe ouvrière elle-même. Ce sentiment s’exprime bien dans l’intervention d’un ouvrier de l’Om de Milan au Palasport de Turin à l’occasion d’une assemblée de la toute nouvelle Lotta Continua en janvier 1970 :
"A la différence du Parti communiste, nous ne sommes pas dirigés par 4 bourgeois. (…) Nous, nous ne ferons pas comme le PCI, parce que ce sont les ouvriers qui seront les guides de cette organisation". 4
Le jugement porté sur les syndicats est de fait particulièrement sévère :
"Nous ne pensons ni qu’on peut changer le syndicat "de l’intérieur", ni qu’on doive en construire un nouveau plus "rouge", plus "révolutionnaire", plus "ouvrier", sans bureaucrates. Nous, nous pensons que le syndicat est un rouage du système des patrons… et qu’il doit donc être combattu comme les patrons". 5
Nous chercherons donc dans cet article à présenter les principaux aspects de l’opéraïsme, en particulier dans sa version défendue par Toni Negri – qui reste jusqu’à aujourd’hui un des représentants les plus reconnus de ce courant politique – de façon à pouvoir dégager ce qui a fait sa force mais ce qui a été aussi la cause de son échec par la suite. Pour ce faire, nous nous réfèrerons à l’œuvre de Toni Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo. 6 Commençons par une définition de l’opéraïsme :
"Ce qu’on a appelé "opéraïsme" naît et se forme en tant que tentative de réponse politique à la crise du mouvement ouvrier des années 50, crise déterminée fondamentalement par les événements historiques dans le mouvement autour du 20e Congrès". 7
Déjà, dans ce passage, il est visible que malgré la rupture profonde avec les forces officielles de gauche, la définition de celles-ci – et en particulier du PCI – est complètement inadéquate et ne s’enracine pas dans une compréhension théorique profonde. Le point de départ est la prétendue "crise du mouvement ouvrier des années 50" alors que, au contraire, ce qui est défini comme "mouvement ouvrier" à l’époque, ce n’est que l’internationale de la contre-révolution stalinienne, dans la mesure où la vague révolutionnaire avait déjà été défaite dans les années 20 et la grande partie des cadres politiques ouvriers anéantie parce que dispersée et massacrée. Cette ambiguïté vis-à-vis du PCI s’exprimera au travers d’un rapport "amour-haine" vis-à-vis du parti d’origine et expliquera comment, avec le temps, tant d’éléments n’ont rien trouvé de mal à revenir au bercail. 8
L’opéraïsme se base à l’origine sur ce qui a été défini comme ouvrier-masse, c’est-à-dire la nouvelle génération de prolétaires qui, venant en grande partie du sud dans une phase d’expansion et de modernisation de l’industrie qui dure de la seconde moitié des années 50 aux premières années 60, va remplacer l’ancienne image de l’ouvrier professionnel ; cette nouvelle génération était en général astreinte à un travail non qualifié et répétitif. Le fait que cette composante du prolétariat, jeune et sans histoire, ait été bien moins sensible aux sirènes du stalinisme et du syndicalisme et beaucoup plus prête à se lancer dans la lutte, a amené les opéraïstes de l’époque à se laisser aller à une analyse sociologique selon laquelle le PCI aurait été l’expression de couches d’ouvriers professionnels, d’une aristocratie ouvrière. 9 Nous verrons plus loin où a conduit cette sorte de purisme social au niveau des choix politiques.
De la conception partidiste à la dissolution du mouvement
Le contexte des années 60, la force énorme et la durée du mouvement de classe en Italie à cette période, le manque d’une expérience qui aurait pu être transmise directement par des organisations prolétariennes préexistantes, ont fait croire à la génération de jeunes militants de l’époque qu’on était arrivé dans une situation révolutionnaire 10 et qu’il fallait établir, face à la bourgeoisie, un rapport de conflit permanent, une sorte de dualité de pouvoir. Il incombait donc aux groupes qui défendaient cette idée (principalement Potere Operaio) d’assumer un rôle dirigeant dans les débats du mouvement ("agir comme un parti") et de développer une action continue et systématique contre l’Etat. Voila comment s’exprimait Toni Negri à ce propos :
"L’activité politique de Potere Operaio sera donc celle de rassembler systématiquement le mouvement de classe, les différentes situations, les différents secteurs de la classe ouvrière et du prolétariat et de les amener vers des échéances, à des moments d’affrontement de masse qui puissent causer des dommages à cette réalité de l’Etat telle qu’elle se présente. L’exercice d’un contre-pouvoir, comme contre-pouvoir lié à des expériences particulières mais qui vise toujours plus à se garantir et à s’exercer contre le pouvoir de l’Etat : cela est aussi un sujet fondamental de l’analyse et une fonction de l’organisation" 11.
Malheureusement, l’absence de critiques des pratiques du stalinisme a conduit les groupes, opéraïstes ou non, à se retrancher derrière des logiques relevant de celles du stalinisme. Parmi celles-ci, l’idée de "l’action exemplaire", capable de pousser les masses à adopter un certain comportement, s’est révélée particulièrement pesante :
"Je n’avais pas des positions pacifistes" dit Negarville, un des chefs du service d’ordre qui avait cherché, et trouvé, l’affrontement avec les policiers sur le Corso Traiano (3 juillet 1969 : 70 policiers blessés, 160 manifestants arrêtés). "L’idée de l’action exemplaire qui provoque la réaction de la police fait partie de la théorie et de la praxis de Lotta Continua depuis le début, les affrontements dans la rue sont comme les batailles ouvrières pour le salaire, fonctionnels au début du mouvement", dit Negarville ; il n’y a rien de pire qu’une manifestation pacifique ou qu’un bon contrat ; ce qui compte, ce n’est pas d’atteindre un objectif mais la lutte, la lutte continue justement. 12
Cette logique est la même que celle qui poussera, plus tard, les différentes formations terroristes à défier l’Etat, sur le dos de la classe ouvrière, en comptant sur le fait que plus on porte l’attaque au cœur de l’Etat, plus les prolétaires auront du courage. L’expérience nous a démontré au contraire que chaque fois que des bandes terroristes ont volé l’initiative à la classe ouvrière, en la mettant dans une situation de chantage objectif, la conséquence a été systématiquement une paralysie de la classe ouvrière. 13
Cette recherche de l’affrontement continu produisit cependant, à la longue, autant un épuisement des énergies qu’une difficulté, pour ces formations opéraïstes, à trouver un espace pour une réflexion politique sérieuse et nécessaire :
"En fait, la vie organisationnelle de Potere Operaio est continuellement interrompue par la nécessité de répondre à des échéances qui, souvent et de plus en plus, dépassent la capacité d’y répondre massivement ; par ailleurs, l’enracinement au niveau de la masse est souvent faible, ce qui exclut la capacité de tenir des échéances." 14
Par ailleurs, le mouvement de lutte de la classe, après avoir manifesté un grand élan avec le développement de luttes encore importantes au début des années 70, commençait cependant à décliner, ce qui a provoqué la fin de l’expérience de Potere Operaio avec la dissolution du groupe en 1973 :
"… dès que nous avons compris que le problème que nous posions était, dans la situation et le rapport de force donnés, insoluble, nous nous sommes dissous. Si nous n’arrivions pas avec nos forces à résoudre ce problème, à ce moment là, c’était la force du mouvement de masse qui devait le résoudre d'une façon ou d'une autre ou, tout au moins, proposer une nouvelle façon de poser le problème." 15
L’hypothèse de départ, selon laquelle on était en présence d’une attaque ouvrière contre le capital, permanente et croissant de manière linéaire, et donc devant les conditions matérielles de la construction "d’un nouveau parti révolutionnaire", s’est révélée bien vite non fondée et ne correspondant pas à la réalité négative du "reflux".
Mais plutôt que d’en prendre acte, les opéraïstes se sont fait prendre par un subjectivisme croissant, en imaginant avoir mis le système économique en crise par ses luttes et en perdant petit à petit tout support matérialiste dans leurs analyses, rejoignant parfois des points de vue définitivement interclassistes.
De l’opéraïsme à l’autonomie ouvrière
Les thèmes politiques qui ont caractérisé l’opéraïsme ne sont pas toujours les mêmes ni toujours mis en avant avec la même vigueur. Néanmoins, toutes les positions de Potere Operaio (et de l’opéraïsme en général) sont marqués par cette exigence d’opposition frontale continuelle à l’Etat, une opposition ostentatoire en continu en tant que signal d’action politique, d’expression de vitalité. Ce qui va changer graduellement, par contre, c’est la référence à la classe ouvrière ou mieux, à l’image de l’ouvrier à laquelle on fait référence qui, après avoir été celle de l’ouvrier-masse, s’est diluée progressivement dans celle d’un soi-disant "ouvrier social" quand il y a eu moins de luttes. C’est cette modification de la référence sociale qui explique d’une certaine manière toute l’évolution, ou plus exactement, l’involution politique de l’opéraïsme.
Pour tenter d’expliquer cette évolution des positions de l’opéraïsme, on invoque un dessein du capital qui tend à défaire la combativité ouvrière, auparavant concentrée dans l’usine, en dispersant la classe sur le territoire.
"… la restructuration capitaliste commençait à s’identifier à une opération colossale sur la composition de la classe ouvrière, opération de dissolution de la forme dans laquelle la classe s’était constituée et déterminée dans les années 70. Dans ces années prévalait l’ouvrier-masse en tant que figure charnière de la production capitaliste et de la production sociale de valeur concentrée sur l’usine. La restructuration capitaliste était obligée, du fait de cette rigidité politique interne entre production et reproduction, de jouer sur l’isolement de l’ouvrier-masse dans l’usine par rapport au processus de socialisation de la production et à l’image de l’ouvrier qui devenait plus diffuse socialement. Par ailleurs, dans la mesure où le processus de production s’étendait socialement, la loi de la valeur commençait à ne jouer que formellement, c'est-à-dire qu’elle ne jouait plus sur le rapport direct entre travail individuel, déterminé, et la plus-value extorquée, mais sur l’ensemble du travail social." 16
L’image de l’ouvrier de référence devient ainsi celle d’un "ouvrier social" fantomatique, image d’autant plus fumeuse que, malgré les précisions de Negri 17, le mouvement de l’époque y a vu un peu de tout.
En réalité, avec la transition de l’ouvrier-masse à l’ouvrier social, l’opéraïsme lui-même se dissout (Potere Operaio) ou dégénère dans le parlementarisme (Lotta Continua) ; un nouveau phénomène apparaît : celui de l’autonomie ouvrière 18 qui se veut la continuation, en forme de mouvement, de l’expérience opéraïste.
L’Autonomie Ouvrière naît en fait en 1973 au Congrès de Bologne, dans une période où toute une partie de la jeunesse se reconnaît dans la figure de l’ouvrier social inventée par Toni Negri. Pour ce "jeune prolétariat", la libération ne passe plus par la conquête du pouvoir, mais par le développement "d’une aire sociale capable d’incarner l’utopie d’une communauté qui se réveille et qui s’organise en dehors du modèle économique, du travail et du salariat" 19 et donc par la mise en action d’un "communisme immédiat". La politique devient "luxurieuse", dictée et soumise au désir et aux besoins. Construit autour de centres sociaux, où se rencontrent les jeunes des quartiers populaires, ce "communisme immédiat" se traduit dans la pratique par la multiplication d’actions directes, parmi lesquelles principalement "les expropriations prolétariennes", imaginées comme sources de "salaire social", "les auto-réductions, les occupations de sites d’hébergement", publics et privés, et une expérience confuse d’autogestion et de vie alternative. De plus, l’attitude volontariste, qui prend ses désirs pour des réalités, se renforce, jusqu’à imaginer une situation dans laquelle la bourgeoisie subit l’assaut de l’ouvrier social :
"… maintenant désormais, la situation italienne est dominée par un contre-pouvoir irréductible, radical, qui n’a plus rien à faire, simplement, avec l’ouvrier des usines, avec la situation établie par le 'Statut des travailleurs' ou par des constructions institutionnelles post-soixante-huitardes déterminées. Nous nous trouvons au contraire dans une situation dans laquelle, au sein de tout le processus de reproduction – et ce doit être souligné – l’auto-organisation ouvrière est acquise en termes désormais définitifs" 20.
Cette analyse ne s’est pas limitée à la situation italienne, mais a été étendue au niveau international, surtout aux pays où l’économie est la plus développée, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. La conviction que le mouvement ouvrier est dans une position de force est tellement puissante qu’elle fait croire à Toni Negri (et aux autonomes de l’époque) que désormais les Etats ont décidé de mettre la main au portefeuille pour tenter d’endiguer l’offensive prolétarienne en distribuant une plus grande partie du revenu :
"… ce sont des phénomènes que nous connaissons parfaitement dans les économies plus avancées que la nôtre, des phénomènes qui se sont réalisés complètement pendant toutes les années 60, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où la possibilité de bloquer le mouvement était vraiment recherchée, d’un côté à travers la destruction des avant-gardes subjectives du mouvement, de l’autre, de manière importante, à travers la capacité de contrôle, qui se fondait sur une disponibilité énorme de cash, sur une articulation énorme de la distribution du revenu." 21
Ainsi donc, dans une situation dans laquelle "tout le processus de la valeur n’existe plus", les patrons auraient été même disposés à ne plus rien gagner si ce n’est "restaurer les règles de l’accumulation" et "socialiser de façon complète les instruments de contrôle et de commande". 22 En d’autres termes, on s’imagine avoir déstabilisé l’Etat avec sa lutte, l’avoir mis en crise sans même se rendre compte que, de plus en plus, il ne restait dans la rue qu' une jeunesse qui avait de moins en moins à voir avec le monde de l’usine et du travail et qui, par conséquent, avait de moins en moins la capacité d’imposer un rapport de force à la bourgeoisie.
Ce qui est caractéristique de cette période, c’est le concept d’ "autovalorisation ouvrière" qui, au-delà des aspects liés aux conquêtes matérielles, se référait "à des moments de contre pouvoir", c'est-à-dire "à des moments politiques d’autodétermination, de séparation de la réalité de classe de celle qui est globalement la réalité de la production capitaliste" 23. Dans ce contexte, "la conquête prolétarienne du revenu" aurait été capable de "détruire parfois l’équation de la loi de la valeur". 24 Ici, on confond la capacité de la classe d’obtenir de plus hauts salaires et donc de réduire la part de plus value extorquée par les capitalistes avec une prétendue "destruction" de la loi de la valeur. La loi de la valeur par contre, comme l’a démontré toute l’histoire du capitalisme, tient bien la route et a survécu jusque dans les pays du soi-disant "socialisme réel" (les pays de l’Est qu’on appelait à l’époque, insidieusement, communistes).
Nous pouvons voir, d’après tout cet ensemble, qu’il existait, au sein du milieu de l’autonomie ouvrière, la grande illusion que le prolétariat pourrait, au sein de la société bourgeoise, créer et jouir de positions de contre pouvoir relativement "stables", alors que le rapport de double pouvoir est une condition particulièrement précaire, typique des périodes révolutionnaires qui, soit évoluent en une offensive victorieuse de la révolution prolétarienne, avec l’affirmation du pouvoir exclusif de la classe ouvrière et l’anéantissement du pouvoir bourgeois, soit dégénèrent en défaite de la classe.
C’est cette déconnexion importante d’avec la réalité matérielle, les bases économiques de la lutte, qui a amené au développement fantaisiste et estudiantin des positions politiques de l’autonomie.
Parmi les positions particulièrement en vogue chez les militants de l’autonomie ouvrière, il y avait le refus du travail en rapport étroit avec celle sur la théorie des besoins. A l’observation pertinente que l’ouvrier doit tendre à ne pas rester englué dans la logique des intérêts patronaux et à réclamer la satisfaction de ses besoins fondamentaux, les théoriciens de l’autonomie superposent une théorie qui va plus loin, identifiant l’autovalorisation ouvrière au sabotage de la machine patronale, jusqu’à prétendre qu’il y a un plaisir dans cette action de sabotage. C’est ce qui ressort de la description satisfaite que fait Toni Negri quand il parle de la liberté qu’ont pris les ouvriers d’Alfa Romeo quand ils se mettent à fumer sur les chaînes sans s’occuper des dégâts causés à la production. Il ne fait aucun doute que, à certains moments, on éprouve une profonde satisfaction à faire quelque chose qui est inutilement défendu, à faire de toute façon quelque chose qu’on te refuse avec l’arrogance de la force. C’est une satisfaction psychologique et même physique. Mais qu’est ce que cela a à voir avec les conclusions qu’en tire Toni Negri pour qui ce fait de fumer aurait été "une chose super-importante (…) importante, du point de vue théorique, presque autant que la découverte que c’est la classe ouvrière qui détermine le développement du capital" ??? Selon Negri, "la sphère des besoins" n’est plus celle des besoins matériels, objectifs, naturels, mais quelque chose qui crée petit à petit, "qui passait à travers, et réussissait à dominer, toutes les occasions qu’offrait la contre culture".
D’une certaine manière, le juste refus de rester aliéné, non seulement matériellement, mais aussi mentalement, à son poste de travail, ce qui s’exprime dans les entorses à la discipline d’usine, est présenté comme "un fait qualitatif formidable ; un fait qui se rapporte exactement à la dimension de l’expansion des besoins. Que signifie en fait jouir du refus du travail, quoi d’autre cela pourrait-il signifier sinon avoir construit en son sein même une série de capacités matérielles de jouissance qui sont complètement alternatives au rythme travail-famille-bar, et utiles à la rupture de ce monde fermé, en découvrant dans l’expérience de la révolte, des capacités et un pouvoir alternatif radical". 25
En réalité, c’est en se perdant derrière ces chimères vides et privées de toute perspective que l’opéraïsme, dans sa version ouvrier social, dégénère complètement en se dispersant dans nombre d’initiatives séparées, visant chaque fois à revendiquer la satisfaction des besoins de telle ou telle catégorie, à mille lieues de l’expression de cette solidarité de classe qui s’était exprimée pendant l’automne chaud et qui ne reviendra que plus tard quand la parole reviendra à la classe ouvrière.
Réactions de l’Etat et épilogue de l’Automne chaud
Comme nous l’avons dit au début de cet article, la capacité de récupération de la bourgeoisie s’est en grande partie fondée sur les faiblesses du mouvement prolétarien que nous avons évoquées. Il faut cependant dire que la bourgeoisie, après s'être révélée complètement surprise dans un premier temps, a été ensuite capable de lancer une attaque sans précédent contre le mouvement ouvrier, autant de façon directe sur le plan de la répression, que sur le plan de manœuvres de toutes sortes.
Au niveau de la répression
C’est l’arme classique de la bourgeoisie contre son ennemi de classe, même si ce n’est pas l’arme décisive qui lui permet de créer vraiment un rapport de force contre le prolétariat. Entre octobre 1969 et janvier 1970, il y a plus de trois mille mises en accusation d’ouvriers et d’étudiants.
"Les étudiants et les ouvriers, plus de trois mille entre octobre 69 et janvier 70, ont été poursuivis. Les articles du code fasciste, qui punissent ‘la propagande subversive’ et ‘l’instigation à la haine entre les classes’ ont été exhumés. La police et les carabiniers confisquaient les oeuvres de Marx, Lénine et Che Guevara". 26
Au niveau du jeu fascisme/antifascisme
C’est l’arme classique contre le mouvement étudiant, moins dans les conflits avec la classe ouvrière, qui consiste à dévoyer le mouvement dans des affrontements de rue stériles entre bandes rivales, avec le recours obligé, à un certain niveau, aux composantes "démocratiques et antifascistes" de la bourgeoisie. En bref, c’est une façon de faire rentrer les moutons à la bergerie.
Au niveau de la stratégie de la tension
C’est sûrement le chef d’œuvre de la bourgeoisie italienne dans ces années, qui a réussi à changer profondément le climat politique. Tout le monde se souvient du massacre de la Banque de l’Agriculture, Place Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, qui a fait 16 morts et 88 blessés. Mais tout le monde ne sait pas, ou ne se souvient pas, qu’à partir du 25 avril 69, l’Italie a souffert d’une série ininterrompue d’attentats :
"Le 25 avril, deux bombes explosent à Milan, une à la Gare centrale et l’autre, qui fait une vingtaine de blessés, au stand Fiat de la Foire. Le 12 mai, trois engins explosifs, deux à Rome et un à Turin, n’explosent pas par pur hasard. En juillet, l’hebdomadaire ‘Panorama’ se fait l’écho de rumeurs d’un coup d’Etat de droite. Des groupes néofascistes lancent un appel à la mobilisation, le PCI met ses sections en état d’alerte. Le 24 juillet, un engin explosif similaire à ceux découverts à Rome et à Turin est trouvé, non explosé, au Palais de Justice de Milan. Le 8 et le 9 août, huit attentats contre les chemins de fer provoquent des dégâts importants et font quelques blessés. Le 4 octobre, à Trieste, un explosif déposé dans une école élémentaire et programmé pour exploser à l’heure de sortie des enfants, n’explose pas du fait d’un défaut technique ; on accuse un militant d’Avanguardia Nazionale (un groupe d'extrême droite, ndt). A Pise, le 27 octobre, le bilan d’une journée d’affrontements entre la police et des manifestants qui réagissent à une manifestation de fascistes italiens et grecs, est d’un mort et cent vingt cinq blessés. (…) Le 12 décembre, quatre engins explosifs explosent à Rome et Milan. Les trois de Rome ne font pas de victime, mais celui de Milan, place Fontana en face de la Banque de l’Agriculture, fait 16 morts et 88 blessés. Un cinquième engin explosif, à Milan toujours, est retrouvé intact. Ainsi commence, pour l’Italie, ce qui a été défini effectivement comme la longue nuit de la République". 27
En ce qui concerne la période suivante, le rythme ne s’est que légèrement abaissé, mais n’a jamais cessé. De 1969 à 1980, on a enregistré 12 690 attentats et autres moments de violence pour des raisons politique, qui ont fait 362 morts et 4490 blessés. Parmi eux, le nombre de morts et de blessés par attentats se monte respectivement à 150 et 551, au total onze attentats, le premier en décembre 69, Piazza Fontana à Milan, le plus grave (85 morts et 200 blessés) à la gare de Bologne en août 1980. 28
"… l’État violent se révéla au-delà de toute attente : il organisait les attentats, déjouait les enquêtes, arrêtait des innocents, en tuait un, Pinelli, avec en plus la bénédiction de quelques journaux et de la TV. Le 12 décembre a représenté la découverte d’une dimension imprévue de la lutte politique et même la révélation de l’ampleur du front contre lequel nous devions nous battre (…). Avec la Piazza Fontana, on découvrit donc un nouvel ennemi : l’État. Avant, les adversaires étaient le professeur, le chef d’équipe, le patron. Les références étaient transnationales, de différentes régions du monde : le Vietnam, le Mai français, les Black Panthers, la Chine. La révélation de l’Etat terroriste ouvrait un nouvel horizon aux luttes : celui des complots, de l’instrumentalisation des néofascistes" 29
Le but évident de cette stratégie était d’intimider et désorienter le plus possible la classe ouvrière, répandre la peur des bombes et de l’insécurité, ce en quoi elle a partiellement réussi. Cela a eu aussi un autre effet, certainement plus néfaste. Dans la mesure où, avec la Piazza Fontana, on découvrait, au moins, au niveau de minorités, que c’était l’État le véritable ennemi, celui avec lequel il fallait régler les comptes, une série de composantes prolétariennes et étudiantes allaient virer vers le terrorisme en tant que méthode de lutte.
La dynamique terroriste encouragée
La pratique du terrorisme est devenue ainsi la façon dont beaucoup de camarades courageux, mais aventureux, ont détruit leur vie et leur engagement politique dans une pratique n'ayant rien à voir avec la lutte de classe. Cette pratique a de plus conduit aux pires résultats, en provoquant un recul de toute la classe ouvrière devant la double menace de la répression de l’État d’une part et du chantage du monde "brigadiste" et terroriste d’autre part.
Les syndicats récupèrent via les Conseils d'Usine
Le dernier élément, mais sûrement pas en terme d’importance, sur lequel la bourgeoisie s’est appuyée a été le syndicat. Ne pouvant compter sur la répression pour tenir le prolétariat à distance, le patronat qui, pendant toutes les années d'après-guerre jusqu’à la veille de l’automne chaud, avait été fortement hostile au syndicat, se redécouvrait démocratique et amoureux des bonnes relations dans les entreprises. La tromperie, évidemment, c’est que ce qu’on n'arrive pas à obtenir avec de mauvaises relations, on cherche à l’avoir avec les bonnes, en recherchant le dialogue avec les syndicats considérés comme uniques interlocuteurs en mesure de contrôler les luttes et les revendications ouvrières. Ce plus grand champ démocratique offert aux syndicats, qui se traduira par l’établissement et le développement des Conseils d’Usine, forme de syndicalisme de base dans lesquels il n’est pas nécessaire d’avoir une carte pour participer, a donné aux travailleurs l’illusion d’avoir conquis cela eux-mêmes et qu’ils pouvaient faire confiance à ces nouvelles structures pour continuer leur lutte. En fait, la lutte des ouvriers, bien que souvent très critique dans les rapports avec les syndicats, n’a pas réussi à en faire une critique radicale, se bornant à en dénoncer les inconséquences.
Pour conclure …
Dans ces deux articles, nous avons cherché à montrer, d’un côté, la force et les potentialités de la classe ouvrière, de l’autre, l’importance que son action soit soutenue par une conscience claire de la route à parcourir. Le fait que les prolétaires qui s'étaient réveillés à la fin des années 60 à la lutte de classe, en Italie et dans le monde entier, n’aient pas disposé de la mémoire des expériences du passé et qu’ils aient dû s’appuyer seulement sur des acquis empiriques qu’ils pouvaient accumuler petit à petit, a constitué l’élément majeur de la faiblesse du mouvement.
Aujourd’hui, dans les différentes évocations de 68 en France et de l’automne chaud italien, nombreux sont ceux qui se laissent aller à des soupirs de nostalgie en pensant que cette époque est bien lointaine et que des luttes semblables ne peuvent plus resurgir. Nous pensons que c’est vraiment le contraire. De fait, l’automne chaud, le Mai français et l’ensemble des luttes qui ont secoué la société mondiale à la fin des années 60, n’ont été que le début de la reprise de la lutte de classe, mais les années qui ont suivi ont vu un développement et une maturation de la situation. Aujourd’hui, en particulier, il existe, au niveau mondial, une présence plus significative des avant-gardes politiques internationalistes (bien qu'encore encore ultra minoritaires), qui, contrairement aux groupes sclérosés du passé, sont capables de débattre entre elles, de travailler et d’intervenir ensemble, leur objectif commun à toutes étant le développement de la lutte de classe. 30 De plus, il n’y a pas aujourd'hui dans la classe seulement une combativité de base permettant l'éclosion de luttes un peu partout dans le monde 31. Il y a aussi le sentiment diffus que désormais cette société dans laquelle nous vivons n’a plus rien à offrir à qui que ce soit, sur le plan économique comme sur celui de la sécurité vis-à-vis des catastrophes environnementales ou des guerres, etc. Et un tel sentiment tend à se répandre, à tel point qu’il arrive quelquefois d’entendre parler de la nécessité de la révolution par des personnes qui n’ont aucune expérience politique. En même temps, la plupart de ces personnes considèrent que la révolution n'est pas possible, que les exploités n'auront pas la force de renverser le système capitaliste :
"On peut résumer cette situation de la façon suivante : à la fin des années 1960, l’idée que la révolution était possible pouvait être relativement répandue mais celle qu’elle était indispensable ne pouvait pas s’imposer. Aujourd’hui, au contraire, l’idée que la révolution soit nécessaire peut trouver un écho non négligeable mais celle qu’elle soit possible est extrêmement peu répandue.
Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives. L’énorme attaque qu’elle subit dès à présent à l’échelle internationale devrait constituer la base objective pour de telles luttes. Cependant, la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. En général, (…) les moments de forte montée du chômage ne sont pas le théâtre des luttes les plus importantes. Le chômage, les licenciements massifs, ont tendance à provoquer une certaine paralysie momentanée de la classe. (…) C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus." (Résolution sur la situation internationale du 18e congrès du CCI, 2009, Revue internationale n° 138)
Ce sentiment d'impuissance a pesé et pèse encore sur la génération actuelle de prolétaires et explique par moments les hésitations, les retards, le manque de réactions face aux attaques de la bourgeoisie. Mais nous devons voir notre classe avec la confiance qui nous vient de la connaissance de son histoire et de ses luttes passées ; nous devons travailler pour relier les luttes du passé avec celles du présent ; nous devons participer aux luttes et donner en leur sein courage et confiance dans l’avenir, accompagnant et stimulant la reconquête par le prolétariat dans sa prise de conscience que le futur de l'humanité repose sur ses épaules, et qu'il a la capacité d'accomplir cette tâche immense.
Ezechiele (23/08/10)
1. Voir en particulier le rôle néfaste de la "résistance au fascisme» qui, au nom d’une prétendue "lutte pour la liberté", conduira les prolétaires à se faire massacrer pour une fraction de la bourgeoisie contre une autre d’abord dans la guerre d’Espagne (1936-1939) et ensuite dans la Seconde Guerre mondiale.
2. "Ayant formé le Parti en 1945, alors que la classe était encore soumise à la contre-révolution et n'ayant pas ensuite fait la critique de cette formation prématurée, ces groupes (qui continuaient à s'appeler "parti") n'ont plus été capables de faire la différence entre la contre-révolution et la sortie de la contre-révolution. Dans le mouvement de mai 1968 comme dans l'automne chaud italien de 1969, ils ne voyaient rien de fondamental pour la classe ouvrière et attribuaient ces événements à l'agitation des étudiants. Conscients par contre du changement du rapport de forces entre les classes, nos camarades de Internacionalismo (et notamment MC, ancien militant de la Fraction et de la GCF) ont compris la nécessité d'engager tout un travail de discussion et de regroupement avec les groupes que le changement de cours historique faisait surgir. A plusieurs reprises, ces camarades ont demandé au PCInt de lancer un appel à l'ouverture d'une discussion entre ces groupes et à la convocation d'une conférence internationale dans la mesure où cette organisation avait une importance sans commune mesure avec notre petit noyau au Venezuela. A chaque fois, le PCInt a rejeté la proposition arguant qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Finalement, un premier cycle de conférences a pu se tenir à partir de 1973 à la suite de l'appel lancé par Internationalism, le groupe des États-Unis qui s'était rapproché des positions de Internacionalismo et de Révolution Internationale, fondée en France en 1968. C'est en grand partie grâce à la tenue de ces conférences, qui avaient permis une décantation sérieuse parmi toute une série de groupes et d'éléments venus à la politique à la suite de mai 68, qu'a pu se constituer le CCI en janvier 1975". (Tiré de "Les trente ans du CCI : s’approprier le passé pour construire l’avenir [124]")
3. Sur le PCI, voir les deux articles "Breve Storia del PCI ad uso dei proletari che non vogliono credere piu a niente ad occhi chiusi" I (1921-1936) et II (1936-1947) (Rivoluzione Internazionale n° 63 et 64). ("Brève histoire du PCI à l'usage des prolétaires qui ne veulent plus croire les yeux fermés"). Le roman d’Ermanno Rea, Mistero napoletano, (Ed. Einaudi) est particulièrement intéressant, pour comprendre la pesanteur des rapports au sein du PCI de ces années)
4. Aldo Cazzulo, "I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua" Sperling et Kupfer, Eds, p. 8.
5. "Tra servi e padroni", in Lotta Continua du 6 décembre 1969, cité aussi dans Aldo Cazzullo, op.cit.p. 89.
6. Antonio Negri, "De l'ouvrier-masse à l'ouvrier social. Entretien sur l'opéraïsme". En italien, édition Ombre Corte.
7. Antonio Negri, op.cit, p. 36-37.
8. On ne peut qu’être impressionné par la quantité d’éléments dans le monde d’aujourd’hui, qui sont des personnages publics, politiques, journalistes, écrivains, avec des positions politiques de centre gauche ou même de droite, qui sont passés hier par des groupes de la gauche extra-parlementaire et, en particulier, par l’opéraïsme. N’en citons que quelques uns : Massimo Cacciari, député PD (Margherita avant) et deux fois maire de Venise ; Alberto Asor Rosa, écrivain et critique littéraire ; Adriano Sofri, journaliste modéré à La Repubblica et Il Foglio ; Mario Tronti, revenu au PCI au niveau du comité central et élu sénateur ; Paolo Liguori, journaliste avec des responsabilités directoriales dans différents journaux télévisés et autres entreprises éditoriales de Berlusconi... Et la liste pourrait se poursuivre avec des dizaines et des dizaines d’autres noms.
9. Nous ne partageons pas l’analyse de Lénine sur l’existence d’une aristocratie ouvrière au sein de la classe ouvrière. Voir notre article : "L’aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière [125]" (Revue Internationale n° 25).
10. Idée largement répandue aussi au niveau international.
11. Antonio Negri, op. cit., p. 105
12. Aldo Cazzullo, op. cit., p. XII
13. Voir à ce propos "Terreur, terrorisme et violence de classe [126]" (Revue Internationale n° 14) ; "Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière [127]" (ICC on line, 2008) ; "Débat sur la violence (II) : il est nécessaire de dépasser le faux dilemme : pacifisme social-démocrate ou violence minoritaire [128]". (ICC on line, 2009)
14. Antonio Negri, op. cit., p. 105
15. Antonio Negri, op. cit. p. 108
16. Antonio Negri, op. cit., p. 113
17. "Quand on dit ‘ouvrier social’, on dit vraiment, avec une précision extrême, que de la plus-value est extraite de ce sujet. Quand nous parlons ‘d’ouvrier social’, nous parlons d’un sujet qui est productif et quand nous disons qu’il est productif, nous disons qu’il est producteur de plus-value, à terme ou immédiatement". Antonio Negri, op. cit. p.18
18. Sur cette question, voir nos articles: "L’Area della Autonomia: la confusione contro la classe operaia (1)" (Rivoluzione Internazionale n°8) et (2) (Rivoluzione Internazionale n° 10)
19. N. Balestrini, P. Moroni, "L’orda d’oro", Milano, SugarCo Edizioni, 1988, p. 334
20. Antonio Negri, op.cit.,p. 138
21. Antonio Negri, op.cit.,p. 116-117
22. Antonio Negri, op.cit.,p. 118
23. Antonio Negri, op.cit.,p. 142
24. Antonio Negri, op.cit.,p. 142
25. Antonio Negri, op.cit.,p. 130-132
26. Alessandro Silj, "Malpaese, Criminalità, corruzione et politica nell’Italia della prima Repubblica 1943-1994", Donzelle Editeur, p. 100-101
27. Alessandro Silj, op. cit., p. 95-96
28. Alessandro Silj, op. cit., p. 113
29. Témoignage de Marco Revelli, à l’époque militant de Lotta Continua. In : Aldo Cazzullo, op. cit., p. 91
30. Il n’est pas possible de reporter ici la liste des différents articles relatifs à cette nouvelle génération d’internationalistes, nous invitons donc les lecteurs à visiter notre site sur lequel ils pourront trouver un grand nombre d’informations.
31. Sur le développement actuel de la lutte de classe, nous renvoyons aussi à notre site web, en attirant en particulier l’attention sur la lecture des articles à propos de Vigo (Espagne), la Grèce et Tekel (Turquie).
Géographique:
- Italie [40]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (IV) : 1917-21 : les soviets tentent d'exercer le pouvoir
- 4933 lectures
Dans les articles précédents de cette série, nous avons suivi l’apparition des conseils ouvriers (soviets en russe) au cours de la Révolution de 1905, leur disparition puis leur resurgissement au cours de la Révolution de 1917, leur crise et leur reprise en mains par les ouvriers, qui les amena à la prise de pouvoir en octobre 1917 1. Nous aborderons dans cet article la tentative d'exercice du pouvoir par les soviets, moment fondamental dans l'histoire de l’humanité : "car pour la première fois ce n'est pas une minorité, ce ne sont pas uniquement les riches, uniquement les couches instruites, c'est la masse véritable, l'immense majorité des travailleurs qui édifient eux-mêmes une vie nouvelle, tranchent en se fondant sur leur expérience, les problèmes si ardus de l'organisation socialiste" 2.
Octobre 1917- avril 1918 : l’ascension des soviets
Animées par un extraordinaire enthousiasme, les masses d’ouvriers s’attelèrent à la tâche de consolider et poursuivre ce qu’elles avaient commencé avant la Révolution. L’anarchiste Paul Avrich décrit l'atmosphère de ces premiers mois en soulignant qu'il existait "un degré de liberté et un sentiment de puissance qui furent uniques dans toute son histoire [celle de la classe ouvrière russe]" 3.
Le mode de fonctionnement que tenta de mettre en place le pouvoir soviétique était radicalement différent de celui de l’Etat bourgeois où l’Exécutif – le Gouvernement – jouit de pouvoirs pratiquement absolus tandis que le Législatif – le Parlement – et le Judiciaire qui, théoriquement, doivent le contrebalancer, lui sont en réalité fortement subordonnés. En tout état de cause, les trois pouvoirs sont totalement séparés de la grande majorité de la population dont le rôle est limité à déposer régulièrement le bulletin de vote dans l’urne 4. Le pouvoir soviétique se basait quant à lui sur deux prémisses complètement nouvelles :
– la participation active et massive des ouvriers ;
– ce sont eux – c’est-à-dire la masse de travailleurs – qui débattent, décident et exécutent.
Comme le dit Lénine au IIe Congrès des Soviets : "La force se manifeste, de l'avis de la bourgeoisie, quand les masses vont aveuglément à l'abattoir [...] La bourgeoisie ne reconnaît comme fort un gouvernement que s'il peut, usant de toute la puissance du mécanisme gouvernemental, jeter les masses où elle l'entend. Notre conception de la force est différente. A notre avis, un gouvernement est fort de la conscience des masses. Il est fort quand ces masses savent tout, jugent de tout, acceptent tout consciemment." 5.
Dès qu’ils eurent pris le pouvoir, les soviets se heurtèrent cependant à un obstacle : l'Assemblée constituante ; celle-ci représentait la négation même de toutes ces prémisses et le retour au passé : la délégation de pouvoir et son exercice par une caste bureaucratique de politiciens.
Face au tsarisme, le mouvement ouvrier en Russie avait revendiqué l'Assemblée constituante comme pas en avant vers une République bourgeoise, mais la Révolution de 1917 avait largement dépassé ce vieux mot d’ordre. Le poids du passé se révéla dans l’influence qu’il continuait à avoir, y compris après la proclamation du pouvoir soviétique, non seulement auprès de vastes masses d’ouvriers mais également auprès de nombreux militants du Parti bolchevique qui considéraient cette Assemblée constituante compatible avec le pouvoir des soviets.
"L'une des fautes les plus graves et les plus lourdes de conséquences que la coalition bourgeoise socialiste commit, ce fut d'ajourner, sous des prétextes essentiellement juridiques, les élections [à l'Assemblée constituante]" 6. Les gouvernements qui se succédèrent entre février et octobre 1917 l'avaient ajournée maintes et maintes fois, trahissant de fait ce qu'eux-mêmes présentaient comme leur aspiration ultime. Les bolcheviks – non sans divisions et contradictions en leur sein – avaient durant cette période été ses principaux défenseurs, tout en sachant son incohérence avec le mot d’ordre de "Tout le pouvoir aux soviets !".
Ainsi se fit jour un paradoxe : trois semaines après la prise du pouvoir par les soviets, ceux-ci accomplirent la promesse de convoquer des élections pour l'Assemblée constituante. Ces élections donnèrent la majorité aux socialistes-révolutionnaires de droite (299 sièges), suivis de loin par les bolcheviks (168), puis par les socialistes-révolutionnaires de gauche (39) et autres groupes de moindre importance.
Comment est-il possible que le résultat électoral donne la victoire aux perdants d'Octobre ?
Plusieurs facteurs l’expliquent, mais le plus évident en Russie à ce moment précis est que le vote met sur un pied d'égalité des "citoyens" dont la condition est radicalement antagonique : ouvriers, patrons, bureaucrates, paysans, etc., ce qui favorise toujours la minorité exploiteuse et la conservation du statu quo. Plus généralement, il existe un autre facteur qui affecte la classe révolutionnaire : le vote est un acte où l'individu atomisé se laisse porter par de multiples considérations, influences et intérêts particuliers, donnés par l’illusion d’être un "citoyen" hypothétiquement libre et n’exprimant donc en rien la force active d'un collectif. L’ouvrier "citoyen individuel" qui vote dans l’isoloir et l’ouvrier qui participe à une assemblée sont comme deux personnes différentes.
L'Assemblée constituante fut toutefois complètement inopérante. Elle se discrédita elle-même. Elle prit quelques décisions grandiloquentes qui restèrent sans effet, ses réunions se limitant à n’être qu’une succession de discours ennuyeux. L'agitation bolchevique, appuyée par des anarchistes et des socialistes-révolutionnaires de gauche, posa clairement le dilemme Soviets ou Assemblée constituante et participa ainsi à la clarification des consciences. Après de multiples avatars, l'Assemblée constituante fut tranquillement dissoute en janvier 1918 par les matelots chargés d'en monter la garde pour assurer sa sécurité.
Le pouvoir exclusif passa aux mains des soviets au travers desquels les masses ouvrières réaffirmèrent leur existence politique. Pendant les premiers mois de la révolution et au moins jusqu'à l'été 1918, l'auto-activité permanente des masses, que nous avions déjà vu se manifester dès février 1917, non seulement se poursuivit mais s’amplifia et se renforça. Les travailleurs, les femmes, les jeunes, vivaient dans une dynamique d'assemblées, de conseils d'usine, de quartier, de soviets locaux, de conférences, de meetings, etc. "La première phase du régime soviétique fut celle de l'autonomie presque illimitée de ses institutions locales. Animés d'une vie intense et de plus en plus nombreux, les Soviets, à la base, se montrèrent jaloux de leur autorité" 7. Les soviets locaux discutaient prioritairement d'affaires concernant toute la Russie mais aussi de la situation internationale, en particulier du développement des tentatives révolutionnaires 8.
Le Conseil des commissaires du peuple, créé par le IIe Congrès des Soviets, n'était pas conçu comme un gouvernement de fait, c'est-à-dire comme un pouvoir indépendant monopolisant toutes les affaires mais, au contraire, comme l'animateur et le moteur de l'action massive. Anweiler cite la campagne d'agitation dirigée par Lénine en ce sens: "Le 18 novembre, Lénine appela les travailleurs à prendre en main propre toutes les affaires publiques : vos soviets sont à partir de maintenant des organes de gouvernement tout-puissants, qui décident de tout" 9. Ce n'était pas de la rhétorique. Le Conseil des commissaires du peuple ne disposait pas, comme les gouvernements bourgeois, d’une constellation impressionnante de conseillers, fonctionnaires de carrière, gardes du corps, collaborateurs, etc. Comme le raconte Victor Serge 10, cet organe comptait un chef de service et deux collaborateurs. Ses sessions consistaient à examiner chaque affaire avec des délégations ouvrières, des membres du Comité exécutif des Soviets ou du Soviet de Petrograd et de Moscou. "Le secret des délibérations du Conseil des ministres" avait été aboli.
En 1918, se tinrent quatre congrès généraux des soviets de toute les Russies : le IIIe en janvier, le IVe en mars, le Ve en juillet et le VIe en novembre. Ceci montre la vitalité et la vision globale qui animaient les soviets. Ces congrès généraux, qui requéraient un immense effort de mobilisation – les transports étaient paralysés et la guerre civile rendait très compliqué le déplacement des délégués – exprimaient l'unité globale des soviets et concrétisaient leurs décisions.
Les congrès étaient animés par de vifs débats où participaient non seulement les bolcheviks, mais aussi les mencheviks internationalistes, les socialistes-révolutionnaires de gauche, les anarchistes, etc. Les bolcheviks y exprimaient même leurs propres divergences. L’atmosphère était celle d’un profond esprit critique, ce qui fit dire à Victor Serge : "pour être honnêtement servie, [la révolution] doit sans cesse être mise en garde contre ses propres abus, ses propres excès, ses propres crimes, ses propres éléments de réaction. Elle a donc un besoin vital de la critique, de l'opposition, du courage civique de ceux qui l'accomplissent" 11.
Aux IIIe et IVe Congrès, il y eut un débat orageux sur la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne – Brest-Litovsk 12 – centré sur deux questions : comment pouvait se maintenir le pouvoir soviétique en attendant la révolution internationale ? Comment pouvait-il contribuer réellement à celle-ci ? Le IVe Congrès fut le théâtre d'une confrontation aiguë entre bolcheviks et socialistes-révolutionnaires de gauche. Le VIe congrès se centra sur la révolution en Allemagne et adopta des mesures pour la soutenir, entre autres l'envoi de trains contenant d’énormes quantités de blé, ce qui exprimait l’énorme solidarité et le dévouement des travailleurs russes qui étaient à ce moment-là rationnés : 50 grammes de pain quotidien à peine !
Les initiatives des masses traversaient tous les aspects de la vie sociale. Nous ne pouvons ici en effectuer une analyse détaillée. Nous nous contenterons de mettre en avant la création de tribunaux de justice dans les quartiers ouvriers, conçus comme d’authentiques assemblées où se discutaient les causes des délits ; les sentences qui y étaient adoptées visaient à modifier la conduite des malfaiteurs et non à punir ou se venger. "Du public, raconte la femme de Lénine, plusieurs ouvriers ainsi que des ouvrières prirent la parole et leurs interventions eurent quelquefois des accents enflammés. 'L'avocat' ne cessait pas, dans son embarras, d'éponger son front en sueur, après quoi l'accusé, le visage baigné de larmes, promit de ne plus battre son fils. A vrai dire, il ne s'agissait pas tellement d'un tribunal que d'une réunion populaire exerçant un contrôle sur la conduite des citoyens. Sous nos yeux, l'éthique prolétarienne était en train de prendre corps." 13
D'avril à décembre 1918 : crise et déclin du pouvoir soviétique
Toutefois, ce puissant élan allait déclinant et les soviets s’altéraient, s'éloignant de la majorité des ouvriers. En mai 1918, parmi la classe ouvrière à Moscou et à Petrograd, circulaient déjà des critiques croissantes sur la politique des soviets dans ces deux villes. Comme cela avait le cas en juillet-septembre 1917, il y eut une série de tentatives de rénovation des soviets 14 ; dans les deux villes en question se tinrent des conférences indépendantes qui, bien qu'elles fussent fondées sur des revendications économiques, se donnaient comme principal objectif la rénovation des organes soviétiques. Les mencheviks y obtinrent la majorité. Ceci poussa les bolcheviks à rejeter ces conférences et à les taxer de contre-révolutionnaires. Les syndicats furent mobilisés pour les démanteler et elles disparurent rapidement.
Cette mesure contribua à saper les bases de l'existence même des soviets. Dans l'article précédent de cette série, nous avons montré que les soviets ne flottaient pas dans le vide mais qu’ils étaient la figure de proue du grand vaisseau prolétarien formé par d’innombrables organisations soviétiques, les comités d’usine, les conseils de quartier, les conférences et assemblées de masses, etc. Dès le milieu de 1918, ces organismes commencèrent à décliner et disparurent progressivement. Les comités d'usine (dont nous reparlerons) disparurent les premiers, puis les soviets de quartier entrèrent à leur tour dans une agonie qui dura de l'été 1918 à leur totale disparition, fin 1919.
Les deux ingrédients vitaux des soviets sont le réseau massif d'organisations soviétiques de base et leur rénovation permanente. La disparition des premières s’est accompagnée de l'élimination progressive de la seconde. Les soviets tendaient à montrer toujours les mêmes visages, évoluant peu à peu vers une bureaucratie inamovible.
Le Parti bolchevique contribua involontairement à ce processus. Pour combattre l'agitation contre-révolutionnaire que les mencheviks et autres partis développaient dans des soviets, ils eurent recours à des mesures administratives d'exclusion, ce qui contribua à créer une lourde atmosphère de passivité, de crainte du débat, de soumission progressive aux diktats du Parti 15.
Cette démarche répressive fut épisodique à ses débuts mais finit par se généraliser dès les premiers mois de 1919, quand les organes centraux du Parti réclamèrent ouvertement aux soviets leur subordination complète à leurs propres comités locaux et l'exclusion des autres partis.
Le manque de vie et de débat, la bureaucratisation, la subordination au Parti, etc., se font de plus en plus lourds. Au VIIe Congrès des soviets, Kamenev reconnaît que "Les assemblées plénières des soviets, en tant qu'institutions politiques, pâtissent souvent de cet état de choses ; on ne s'y occupe que de questions purement techniques (...). Il est rare que les soviets tiennent des assemblées générales et, quand les députés se rassemblent enfin, c'est uniquement pour approuver un rapport, écouter un discours, etc." 16. Ce Congrès, tenu en décembre 1919, eut comme thème central de discussion la renaissance des soviets et il y eut des contributions non seulement de la part des bolcheviks, qui se présentèrent pour la dernière fois en exprimant des positions différentes entre eux , mais également des mencheviks internationalistes – Martov, leur leader, y participa très activement.
Il y eut un effort pour mettre en pratique les résolutions du Congrès. En janvier 1920 se tinrent des élections cherchant la rénovation soviétique, dans des conditions de liberté totale. "Martov, reconnut au début de l'année 1920, que, sauf à Petrograd où des élections "à la Zinoviev" continuaient à être organisées, le retour à des méthodes plus démocratiques était général et favorisait souvent les candidats de son parti" 17.
De nombreux soviets réapparurent et le Parti bolchevique tenta de corriger les erreurs de concentration bureaucratique auxquelles il avait progressivement participé. "Le gouvernement soviétique annonça son intention d'abdiquer une partie des prérogatives qu’il s’était arrogées et de rétablir dans ses droits le Comité exécutif [des Soviets, élu par le Congrès] chargé, d'après la Constitution de 1918, de contrôler l'activité des Commissaires du peuple". 18
Ces espoirs s’évanouirent rapidement toutefois. L’intensification de la guerre civile, avec l'offensive de Wrangel et l'invasion polonaise, l'aggravation de la famine, la catastrophe économique, les révoltes de paysans, fauchèrent ces intentions à la racine, "l'état de délabrement de l'économie, la démoralisation des populations, l'isolement croissant d'un pays ruiné et d'une nation exsangue, la base même et les conditions d'une renaissance soviétique s'étaient évanouies." 19
L'insurrection de Kronstadt en mars 1921, avec sa revendication de soviets totalement renouvelés et qui exerceraient effectivement le pouvoir, fut le dernier râle d’agonie ; son écrasement par le Parti bolchevique signa le décès pratiquement définitif des soviets comme organes ouvriers 20.
La guerre civile et la création de l'Armée rouge
Pourquoi les soviets furent-ils entraînés, contrairement à septembre 1917, sur une pente qu’ils ne pourront pas remonter ? Si le manque d'oxygène auquel seul le développement de la révolution mondiale aurait pu apporter une solution, a été le facteur fondamental, nous allons cependant analyser les autres facteurs, "internes". Nous pouvons les résumer à deux facteurs essentiels, fortement reliés entre eux : la guerre civile et la famine d’une part et, de l’autre, le chaos économique.
Commençons par la guerre civile 21. C’était une guerre organisée par les principales puissances impérialistes : la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis, le Japon, etc., qui unirent leurs troupes à toute une masse hétéroclite de forces armées, "les Blancs", appartenant à la bourgeoisie russe défaite. Cette guerre dévasta le pays jusqu'en 1921 et provoqua plus de 6 millions de morts et un nombre incalculable de destructions. Les Blancs effectuaient des représailles d’un sadisme et d'une barbarie inouïs. "La terreur blanche en fut partiellement responsable [de l'effondrement du pouvoir des soviets], les victoires de la contre-révolution s'accompagnant le plus souvent non seulement du massacre d'un grand nombre de communistes mais de l'extermination des militants les plus actifs des Soviets et, en tout cas, de la suppression de ceux-ci." 22
Nous voyons ici la première des causes de l'affaiblissement des soviets. L'armée blanche supprima les soviets et assassina indistinctement tous leurs membres.
Mais des causes plus complexes s’ajoutèrent à ces massacres. Pour répondre à la guerre, le Conseil des commissaires du peuple adopta en avril-mai 1918 deux décisions importantes : la formation de l'Armée rouge et la constitution de la Tcheka, organisme chargé de démanteler les complots contre-révolutionnaires. C'était la première fois que ce Conseil adoptait une décision sans débat préalable avec les soviets ou, du moins, avec le Comité exécutif.
La constitution d'une Tcheka comme organe policier était inévitable au lendemain de la révolution. Les complots contre-révolutionnaires se succédaient, tant de la part des socialistes-révolutionnaires de droite, des mencheviks, des Cadets, que des centuries monarchistes, des cosaques, encouragés par les agents anglais et français. L’organisation d'une Armée rouge fut aussi une nécessité impérieuse dès que commença la guerre.
Ces deux structures – la Tcheka et l’Armée rouge –, ne sont pas de simples instruments que l’on peut utiliser à sa convenance, ce sont des organes étatiques et, en tant que tels, ils sont du point de vue du prolétariat des armes à double tranchant ; la classe ouvrière est obligée de s’en servir tant que le prolétariat n’a pas triomphé définitivement au niveau mondial, mais leur utilisation comporte de graves dangers car ceux-ci tendent à s'autonomiser vis-à-vis du pouvoir prolétarien.
Pour quelle raison fut donc créée une armée, alors que le prolétariat disposait d’un organe soviétique militaire qui avait dirigé l’insurrection, le Comité militaire révolutionnaire 23 ?
A partir de septembre 1917, l’armée russe était entrée dans une franche décomposition. Dès que la paix fut déclarée, les conseils de soldats se démobilisèrent rapidement. La seule aspiration de la majorité des soldats était de retourner dans leurs villages. Pour paradoxal que cela puisse paraître, les conseils de soldats – mais aussi dans une moindre mesure de matelots – qui s’étaient généralisés après la prise de pouvoir par les soviets, s’attachaient essentiellement à organiser la dissolution de l’armée, en évitant la fuite des appelés dans le désordre et en réprimant les bandes de soldats qui se servaient de leurs armes pour piller et terroriser la population. Début janvier 1918, l’armée n’existait plus. La Russie était à la merci de l’armée allemande. La paix de Brest-Litovsk obtint cependant une trêve qui permit de réorganiser une armée pour défendre efficacement la révolution.
A ses débuts, l’Armée rouge était une armée de volontaires. Les jeunes des classes moyennes et les paysans évitaient de s’engager, et ce furent les ouvriers des usines et des grandes villes qui formèrent son contingent initial. Il en résulta une véritable saignée dans les rangs de la classe ouvrière, qui dut sacrifier ses meilleurs éléments dans une guerre sanglante et cruelle. "Comme on le sait, les meilleurs ouvriers ont dû, par suite de la guerre, quitter les villes en masse, ce qui a eu maintes fois pour effet de rendre difficiles la formation d'un soviet dans tel ou tel chef-lieu de gouvernement ou de cercle, et la création des conditions nécessaires à son fonctionnement régulier" 24.
Nous abordons ici la seconde cause de la crise des soviets : ses meilleurs éléments furent absorbés par l’Armée rouge. Pour s’en faire une idée réelle, Petrograd en avril 1918 mobilisa 25 000 volontaires, dans leur grande majorité des ouvriers militants, et Moscou 15 000, alors que l’ensemble du pays comptait 106 000 volontaires au total.
Quant à la troisième cause de cette crise, elle ne fut autre que l’Armée rouge elle-même qui considérait les soviets comme un obstacle. Elle tendait à éviter leur contrôle et demandait au gouvernement central qu’il les empêche de s’immiscer dans ses affaires. Elle rejetait aussi les propositions de soutien de la part des unités militaires propres des soviets (Gardes rouge, guérilléros). Le Conseil des commissaires du peuple se plia à toutes les exigences de l’armée.
Pourquoi un organe créé pour défendre les soviets se retourne-t-il contre eux ? L’armée est un organe étatique dont l'existence et le fonctionnement ont nécessairement des conséquences sociales, vu qu'il exige une discipline aveugle, une hiérarchie rigide dans son état-major, avec un corps d’officiers qui n’obéissent qu’à l’autorité gouvernementale. C’est pour pallier à cette tendance que fut créé un réseau de commissaires politiques formé d’ouvriers de confiance, destiné à contrôler les officiers. Les effets de cette mesure furent malheureusement très limités et même contreproductifs, puisque ce réseau devint à son tour une structure bureaucratique supplémentaire.
Non seulement l’Armée rouge échappa toujours plus au contrôle des soviets, mais elle imposa en outre ses méthodes de militarisation à la société entière, contraignant encore plus, si c’était possible, la vie de ses membres. Dans son livre l’ABC du communisme, Preobrajensky parle même de dictature militaire du prolétariat !
Les impératifs de la guerre et la soumission aveugle aux exigences de l’Armée rouge amenèrent le gouvernement à former, durant l’été 1918, un Comité militaire révolutionnaire qui n’avait rien de commun avec celui qui dirigea la Révolution d’Octobre, comme le démontre le fait que sa première décision fut de nommer des Comités révolutionnaires locaux qui imposèrent leur autorité aux soviets. "Une décision du Conseil des commissaires du Peuple obligeait les Soviets à se plier inconditionnellement aux instructions de ces comités." 25
L’Armée rouge, comme la Tcheka, cessèrent progressivement d’être ce pourquoi elles avaient été conçues, des armes de défense du pouvoir des soviets, et s’en dégagèrent, s’autonomisèrent, pour finalement se retourner contre lui. Si dans un premier temps les organes de la Tcheka rendaient compte de leurs activités aux soviets locaux et tentaient d’organiser un travail commun, les méthodes expéditives qui les caractérisaient prévalurent rapidement et s'imposèrent à la société soviétique. "Le 28 août 1918, l'autorité centrale de la Tcheka donnait en effet pour instruction à ses commissions locales de récuser toute autorité des Soviets. C'étaient ces commissions, au contraire, qui devaient imposer leur volonté aux instances soviétiques. Elles y réussirent sans peine dans les nombreuses régions affectées par les opérations militaires" 26.
La Tcheka rongeait tellement le pouvoir des soviets qu’en novembre 1918, une enquête révélait que 96 soviets exigeaient la dissolution des sections de la Tcheka, 119 demandaient leur subordination aux institutions légales soviétiques et 19 seulement approuvaient ses agissements. Cette enquête fut parfaitement inutile d’ailleurs puisque la Tcheka continua d’accumuler de nouveaux pouvoirs. " 'Tout le pouvoir aux Soviets' a cessé d'être le principe sur lequel se fonde le régime, affirmait par ailleurs un membre du commissariat du Peuple à l'Intérieur; il est remplacé par une nouvelle règle : 'Tout le pouvoir à la Tcheka' " 27
Famine et chaos économique
La guerre mondiale léguait un terrible héritage. L’appareil productif de la majorité des pays d’Europe était exsangue, la circulation des biens de consommation et de la nourriture était profondément perturbée quand elle n’était pas totalement paralysée. "La consommation des vivres avait diminué de trente à cinquante pour cent. La situation des Alliés était meilleure, grâce à l'appui de l'Amérique. L'hiver 1917-1918, marqué en France et en Angleterre par les rationnements les plus rigoureux et par la crise des combustibles, avait cependant été très dur" 28.
La Russie avait cruellement souffert de cette situation. La Révolution d’Octobre n’avait pu s’y attaquer, d’autant qu’elle se heurta à un puissant galvaniseur du chaos : le sabotage systématique pratiqué tant par les chefs d’entreprise qui préféraient la politique de la terre brûlée plutôt que de livrer les instruments de production au prolétariat que par toute la couche des techniciens, dirigeants et même de travailleurs hautement spécialisés qui étaient hostiles au pouvoir soviétique. Les soviets se heurtèrent dès leur prise de pouvoir à une grève massive de fonctionnaires, de travailleurs des télégraphes et des chemins de fer, manipulés par les syndicats dirigés par les mencheviks. Cette grève était fomentée et dirigée à travers la courroie de transmission syndicale par "un gouvernement occulte [qui] fonctionnait, présidé par M. Prokopovitch qui avait officiellement pris la succession de Kerenski, "démissionnaire". Ce ministère clandestin dirigeait la grève des fonctionnaires, de concert avec un comité de grève. Les grandes firmes de l'industrie, du commerce et de la banque, telles que la Banque agricole de Toula, la Banque populaire de Moscou, la Banque du Caucase continuaient à payer leurs fonctionnaires en grève. L'ancien Exécutif panrusse des Soviets (mencheviks et socialistes-révolutionnaires) faisait de ses fonds, dérobés à la classe ouvrière, le même usage." 29
Ce sabotage vint s’ajouter au chaos économique généralisé rapidement aggravé par la guerre civile. Comment s’attaquer à la famine qui ravage les villes ? Comment garantir ne serait-ce qu’un approvisionnement minimum ?
Ici se concrétisent les effets désastreux d’un phénomène qui caractérise 1918 : la coalition sociale qui avait renversé le gouvernement bourgeois en Octobre 1917 s’était volatilisée. Le pouvoir soviétique avait été une "coalition", pratiquement sur un pied d’égalité, entre les soviets d’ouvriers, de paysans et de soldats. Ces derniers s’étaient à quelque exception près volatilisés dès la fin de 1917, laissant le pouvoir soviétique privé d’armée. Mais que firent les soviets de paysans qui possédaient pourtant la clé pour assurer l’approvisionnement des villes ?
Le décret sur la répartition des terres adopté par le IIe Congrès des soviets s’appliqua dans la plus grande confusion, ce qui favorisa un nombre incalculable d’abus et même si beaucoup de paysans pauvres purent accéder à une parcelle, les grandes gagnantes furent la riche et la moyenne paysannerie qui augmenta considérablement son patrimoine, ce qui se concrétisa par leur domination quasi-généralisée dans les soviets de paysans. L’égoïsme caractéristique des propriétaires privés s’en trouvait encouragé. "Le paysan, recevant en échange de son blé des roubles-papier avec lesquels il ne pouvait acheter qu'à grand peine une quantité de plus en plus restreinte d'articles manufacturés, recourait au troc : vivres contre objets. Une tourbe de petits spéculateurs s'interposaient entre lui et la ville" 30. Ces paysans ne vendaient leur production qu’aux spéculateurs qui se l'accaparaient, aggravant ainsi la pénurie et faisant exploser les prix 31.
En juin 1918, un décret du gouvernement soviétique met en place des comités de paysans pauvres pour combattre cette situation. Leur objectif était de créer une force pour tenter de ramener les soviets de paysans vers le prolétariat en organisant la lutte de classe dans les campagnes, mais aussi de tenter de mettre en place des brigades de choc afin d’obtenir les céréales et les aliments qui soulageraient la terrible famine dans les villes.
Ces comités se dédièrent surtout, "de concert avec des détachements d'ouvriers en armes, [à] confisquer le blé et [à] réquisitionner le bétail et le matériel des paysans riches pour les répartir entre les miséreux, voire [à] redémembrer les terres" 32. Le bilan de cette expérience fut globalement négatif. Ils ne parvinrent ni à garantir l’approvisionnement des villes affamées, ni à rénover les conseils de paysans. Et le comble, c’est qu’en 1919 les bolcheviks changèrent de politique pour tenter de gagner à eux la paysannerie moyenne et ils ont dissous par la force les comités de paysans pauvres.
La production moderne capitaliste fait dépendre l'approvisionnement des produits agricoles de l'existence d'un vaste système de transports hautement industrialisés et fortement liés à toute une série d'industries de base. Sur ce terrain, l'approvisionnement de la population affamée se heurta à l’effondrement généralisé de l'appareil productif industriel dû à la guerre et accentué par le sabotage économique et l’éclatement de la guerre civile à partir d'avril 1918.
Les conseils d’usine auraient pu avoir un rôle déterminant. Comme nous l’avons vu dans l’article précédent de cette série, ils jouaient un rôle très important d’avant-garde du système soviétique. Ils auraient aussi pu contribuer à combattre le sabotage des capitalistes et éviter la pénurie et la paralysie.
Ils tentèrent d’ailleurs de se coordonner pour monter un organisme central de contrôle de la production et de lutte contre le sabotage et la paralysie des transports 33, mais la politique bolchevique s’opposa à cette orientation. Celle-ci concentra la direction des entreprises en un corps de fonctionnaires dépendants du pouvoir exécutif, ce qui s’accompagna, dans un premier temps, de mesures de restauration du travail à la pièce puis s’acheva par une militarisation brutale qui atteignit ses niveaux les plus élevés en 1919-20. Par ailleurs, elle renforça les syndicats. Ce corps de fonctionnaires, farouche adversaire des conseils d’usine, mena une intense campagne qui s’acheva par la disparition de ces derniers fin 1918 34.
La politique bolchevique tentait de combattre la tendance de certains conseils d’usine, particulièrement en province, à se considérer comme les nouveaux propriétaires et à se concevoir comme des unités autonomes et indépendantes. Cette tendance avait en partie ses origines dans "la difficulté d'établir des circuits réguliers de distribution et d'échange, ce qui provoqua l'isolement de nombreuses usines et centres de production. Ainsi apparurent des usines fort semblables à des "communes anarchistes" vivant repliées sur elles-mêmes." 35
Tendance à la décomposition de la classe ouvrière russe
Il est évident que ces tendances favorisaient la division de la classe ouvrière. Mais il ne s’agissait pas de tendances générales et elles auraient pu être combattues au moyen du débat au sein des conseils d’usine eux-mêmes dans lesquels, nous l’avons vu, cette vision globale était présente. La méthode choisie, s’appuyer sur les syndicats, contribua à détruire ces organismes qui étaient la pierre angulaire du pouvoir prolétarien et globalement favorisa l’aggravation d’un problème politique fondamental des premières années du pouvoir soviétique, qui avait été occulté par l’enthousiasme des premiers mois : "L'affaiblissement progressif de la classe ouvrière russe, une perte de vigueur et de substance qui finira par provoquer son déclassement presque total et, en quelque sorte, sa provisoire disparition" 36.
En avril 1918, 265 des 799 principales entreprises industrielles de Petrograd ont disparu, la moitié des travailleurs de cette ville n’a pas de travail ; sa population en juin 1918 compte un million et demi de personnes, alors qu'elle était de deux millions et demi un an auparavant. Moscou a perdu un demi-million d'habitants au cours de cette courte période.
La classe ouvrière souffre de la faim et des maladies les plus terrifiantes. Jacques Sadoul, observateur partisan des bolcheviks, décrit ainsi la situation à Moscou au printemps 1918 : "Dans les faubourgs, c'est la misère affreuse. Épidémies : typhus, variole, maladies infantiles. Les bébés meurent en masse. Ceux qu'on rencontre sont défaillants, décharnés, pitoyables. Dans les quartiers ouvriers, on croise trop souvent de pauvres mamans pâles, maigres, portant tristement entre leurs bras, dans le petit cercueil de bois argenté, qui semble un berceau, le petit corps inanimé qu'un peu de pain ou de lait eût conservé en vie" 37.
Beaucoup d’ouvriers s’enfuirent vers la campagne pour se consacrer à des activités agricoles précaires. La pression terrifiante de la famine, des maladies, des rationnements et des files d’attente fait que les ouvriers sont obligés de consacrer la journée entière à tenter de survivre. Comme en témoigne un ouvrier de Petrograd en avril 1918, "Voici encore une foule d'ouvriers qui ont été renvoyés. Bien que nous soyons des milliers, on n'entend pas un mot qui ait trait à la politique ; personne ne parle de la révolution, de l'impérialisme allemand ou de tout autre problème d'actualité. Pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui peuvent à peine se tenir debout, toutes ces questions paraissent terriblement lointaines." 38
Le processus de crise de la classe ouvrière russe est si alarmant qu’en octobre 1921, Lénine justifie la NEP 39 en disant que "Les capitalistes vont bénéficier de notre politique, et ils vont créer un prolétariat industriel qui, chez nous, en raison de la guerre, de la ruine et des destructions terribles, est déclassé, c'est-à-dire qu'il a été détourné de son chemin de classe et a cessé d'exister en tant que prolétariat" 40.
Nous avons présenté tout un ensemble de conditions générales qui, s’ajoutant aux inévitables erreurs, affaiblirent les soviets jusqu’à les conduire à leur disparition comme organes ouvriers. Dans le prochain article de cette série, nous aborderons les problèmes politiques qui participèrent d'aggraver l'effet de cette situation.
C.Mir (01-9-10)
1. Voir les Revue internationale nos 140 [66], 141 [90] et 142 [129].
2. Lénine, Lettre aux ouvriers américains, 22 août 1918. Œuvres, Editions Sociales, Tome 28.
3. Cité par Marcel Liebman, Le Léninisme sous Lénine, tome II, page 190. C’est un ouvrage très intéressant et documenté, émanant d’un auteur non communiste.
4. Il a existé une phase de la vie du capitalisme, alors qu'il était encore un système progressiste, pendant laquelle le Parlement était le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s’unissaient ou s’affrontaient pour gouverner la société. Le prolétariat se devait d’y participer pour tenter d’infléchir l'action de la bourgeoisie dans le sens de la défense de ses intérêts et ceci malgré les dangers de mystification qu’une telle politique pouvait lui faire encourir. Cependant, même à cette époque, les trois pouvoirs ont toujours été séparés de la grande majorité de la population.
5. Cité par Victor Serge, militant anarchiste convaincu au bolchevisme, dans L’An I de la Révolution russe, page 84, Chapitre III. "Les grands décrets".
6. Oskar Anweiler, les Soviets en Russie, p. 261 chapitre V, Première partie, "Assemblée constituante ou République soviétique ?"
7. Marcel Liebman, op. cit., page 31.
8. Le suivi de la situation en Allemagne, les nouvelles de grèves et de mutineries occupaient une grande part des discussions.
9. Oskar Anweiler, op. cit., page 275, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
10. Victor Serge, op. cit., page 99. Chapitre III, "L’initiative des masses".
11. Marcel Liebman, op. cit., page 94.
12. Ce Traité fut signé entre le pouvoir soviétique et l’Etat allemand en mars 1918. Au prix d’importantes concessions, il permit au pouvoir soviétique d’obtenir une trêve qui lui permit de se maintenir et il démontra clairement au prolétariat international sa volonté d’en finir avec la guerre. Voir nos articles : "Octobre 17, début de la révolution prolétarienne (2e partie) [130]", Revue internationale no 13, 1978, et "Le communisme n’est pas un bel idéal " (8 [131]e [131] partie) : "La compréhension de la défaite de la Révolution russe [131]", Revue internationale no 99, 1999.
13. Marcel Liebman, op. cit., page 176.
14. Voir dans cette série, la Revue internationale no 142, "La Révolution de 1917…", partie "Septembre 1917, la rénovation totale des soviets [129]".
15. Il faut préciser que ces mesures ne furent pas accompagnées de restrictions quant à la liberté de la presse. Dans son livre cité plus haut, Victor Serge affirme que "La dictature du prolétariat hésita longtemps à supprimer la presse ennemie. (…) ce n'est qu'en juillet 1918 que les derniers organes de la bourgeoisie et de la petite- bourgeoisie furent supprimés. La presse légale des mencheviks n'a disparu qu'en 1919 ; celle des anarchistes hostiles au régime et des maximalistes a paru jusqu'en 1920 ; celle des socialistes-révolutionnaires de gauche, plus tard encore." (Note en bas de page 109, Chapitre III. "Réalisme prolétarien et rhétorique révolutionnaire".
16. Oskar Anweiler, op. cit., page 299, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
17. Marcel Liebman, op. cit., page 35. Zinoviev, militant bolchevik, avait de grandes qualités et fut un grand animateur aux origines de l’Internationale communiste, mais il se distingua cependant par sa roublardise et ses manœuvres.
18. Íbidem.
19. Íbidem.
20. Nous ne pouvons ici analyser en détails les événements de Kronstadt, leur sens et les leçons qu’ils apportèrent. Voir à ce sujet "https://fr.internationalism.org/rinte3/kronstadt.htm [132]", Revue internationale no 3, 1975, et "Comprendre Kronstadt [133]", Revue internationale no 104, 2001.
21. Cf. Victor Serge, op. cit., pour un récit de la guerre civile en 1918.
22. Marcel Liebman, op. cit., page 32.
23. Cf. dans cette série, Revue internationale no 142, "La révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir [129]", sous-titre "Le Comité militaire révolutionnaire, organe soviétique de l'insurrection".
24. Intervention de Kamenev citée par Oskar Anweiler. op. cit., p. 299.
25. Marcel Liebman, op. cit., page 33.
26. Idem, page 32.
27. Idem, page 164.
28. Victor Serge, op. cit., page 162. Chapitre V, “Le problème en janvier1918”.
29. Victor Serge, op. cit., page 99. Chapitre III, “Le sabotage”.
30. Idem, page 227. Chapitre VI, " Le problème".
31. Idem. Victor Serge souligne qu’une des politiques des syndicats consistait en la création de commerces coopératifs qui se consacraient à spéculer sur la nourriture au grand profit de leurs membres.
32. Oskar Anweiler, op. cit., page 301, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
33. Oskar Anweiler, op. cit., page 279, rapporte que "Quelques semaines après Octobre, certains conseils centraux des comités de fabrique, tels qu'il en existait dans beaucoup de villes, se consultèrent dans le dessein avoué de s'organiser de manière indépendante à l'échelon national, ce qui aurait eu comme effet d'instaurer leur dictature économique."
34. Ibidem. Anweiler rapporte que "Ne se bornant plus à empêcher la tenue d'un congrès panrusse des comités de fabrique, les syndicats réussirent à se les annexer et à en faire leur organe au plus bas échelon." p. 279.
35. Marcel Liebman, op. cit. page 189.
36. Idem, page 23.
37. Idem, page 24.
38. Idem, page 23.
39. NEP: Nouvelle politique économique, appliquée en mars 1921 après les événements de Kronstadt, qui faisait de larges concessions à la paysannerie et au capital national et étranger. Voir la Revue internationale no 101, dans la série "Le communisme n’est pas un bel idéal", l’article "1922-23 : les fractions communistes contre la montée de la contre-révolution [134]".
40. Lénine, La Nouvelle politique économique et les tâches des services d'éducation politique, 17 octobre 1921. Œuvres, tome 33, Editions Sociales.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VIII) : l'âge des catastrophes
- 2779 lectures
Même si les révolutionnaires actuels sont loin de tous partager l'analyse de l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas le cas de ceux qui ont dû réagir face à cette guerre et ont participé aux soulèvements révolutionnaires ayant suivi. Au contraire, comme le montre le présent article, la majorité des marxistes partageaient ce point de vue. De même, pour eux, la compréhension qu'on était entré dans une nouvelle période historique était indispensable pour revigorer le programme communiste et les tactiques qui en découlaient.
Dans le précédent article de cette série, nous avons vu que Rosa Luxemburg, par son analyse des processus fondamentaux sous-tendant l'expansion impérialiste, prévoyait que les calamités que subissaient les régions pré-capitalistes du globe, allaient revenir au cœur même du système, dans l'Europe bourgeoise. Et comme elle le soulignait dans sa Brochure de Junius (dont le titre original est La crise de la social-démocratie allemande), rédigée en prison en 1915, l'éclatement de la guerre mondiale en 1914 n'était pas seulement une catastrophe du fait de la destruction et de la misère qu'elle faisait pleuvoir sur la classe ouvrière des deux camps belligérants, mais aussi parce qu'elle avait été rendue possible par le plus grand acte de trahison de l'histoire du mouvement ouvrier : la décision de la majorité des partis sociaux-démocrates, jusqu'alors phares de l'internationalisme, éduqués dans la vision marxiste du monde, de soutenir l'effort de guerre des classes dominantes de leurs pays respectifs, d'entériner le massacre mutuel du prolétariat européen, malgré les retentissantes déclarations d'opposition à la guerre qu'ils avaient adoptées lors des nombreuses réunions de la Deuxième Internationale et de ses partis constitutifs au cours des années qui avaient précédé.
Ce fut la mort de l'Internationale ; elle avait maintenant éclaté en différents partis nationaux dont de grandes parties, le plus souvent leurs organes dirigeants, agirent comme agents recruteurs dans l'intérêt de leur propre bourgeoisie : on les désigna comme les "social-chauvins" ou les "social-patriotes" ; ils entraînèrent avec eux également la majorité des syndicats. Dans cette terrible débâcle, une autre partie importante de la social-démocratie, "les centristes", se vautra dans toutes sortes de confusions, incapable de rompre définitivement avec les social-patriotes, s'accrochant à d'absurdes illusions sur la possibilité d'accords de paix et, comme dans le cas de Kautsky, l'ancien "pape du marxisme", tournant fréquemment le dos à la lutte de classe au nom du fait que l'Internationale ne pouvait qu'être un instrument de paix, pas de guerre. Au cours de cette époque traumatisante, seule une minorité maintint fermement les principes que toute l'Internationale avait adoptés sur le papier à la veille de la guerre – avant tout le refus d'arrêter la lutte de classe du fait qu'elle mettrait en danger l'effort de guerre de sa propre bourgeoisie et, par extension, la volonté d'utiliser la crise sociale apportée par la guerre comme moyen de hâter la chute du système capitaliste. Mais, face à l'état d'esprit d'hystérie nationaliste qui dominait au début de la guerre, "l'atmosphère de pogrom" dont parle Luxemburg dans sa brochure, même les meilleurs militants de la gauche révolutionnaire se trouvèrent en butte aux doutes et aux difficultés. Quand Lénine prit connaissance de l'édition du Vorwärts, journal du SPD, qui annonçait que le parti avait voté les crédits de guerre au Reichstag, il pensa que c'était un faux, concocté par la police politique. Au parlement allemand, l'anti-militariste Liebknecht vota au début les crédits de guerre par discipline de parti. L'extrait suivant d'une lettre de Rosa Luxemburg montre à quel point elle ressentait que l'opposition de gauche dans la social-démocratie avait été réduite à une petite collection d'individus :
"Je voudrais entreprendre l'action la plus énergique contre ce qui se passe au groupe parlementaire. Malheureusement, je trouve peu de gens disposés à m'aider.[...] On ne peut jamais joindre Karl (Liebknecht), car il court de tous les côtés comme un nuage dans le ciel ; Franz (Mehring) montre peu de compréhension pour une action autre que littéraire, la réaction de ta mère (Clara Zetkin) est hystérique et absolument désespérée. Mais en dépit de tout cela, j'ai l'intention d'essayer de voir ce que l'on peut faire." (Lettre à Konstantin Zetkin, fin 1914) 1
Chez les anarchistes c'était aussi la confusion ou la trahison ouverte. Le vénérable anarchiste Kropotkine appela à la défense de la civilisation française contre le militarisme allemand (ceux qui suivirent son exemple furent appelés "les anarchistes des tranchées"), et le leurre du patriotisme s'avéra particulièrement fort dans la CGT en France. Mais l'anarchisme, précisément du fait de son caractère hétérogène, ne fut pas ébranlé jusqu'en ses fondements de la même façon que le fut le "parti marxiste". De nombreux groupes et militants anarchistes continuèrent à défendre les mêmes positions internationalistes qu'auparavant. 2
L'impérialisme : le capitalisme en déclin
Evidemment, les groupes de l'ancienne gauche de la social-démocratie devaient s'atteler à la tâche de réorganisation et de regroupement afin de mener le travail fondamental de propagande et d'agitation malgré la frénésie nationaliste et la répression étatique. Mais ce qu'il fallait, surtout, c'était une révision théorique, un effort rigoureux pour comprendre comment la guerre avait pu balayer des principes défendus depuis si longtemps par le mouvement. D'autant plus qu'il était nécessaire de déchirer le voile "socialiste" dont les traîtres déguisaient leur patriotisme, en utilisant les paroles de Marx et Engels, les sélectionnant soigneusement et, surtout, en les sortant de leur contexte historique, pour justifier leur position de défense nationale – surtout en Allemagne où avait existé une longue tradition du courant marxiste qui soutenait les mouvements nationaux contre la menace réactionnaire posée par le tsarisme russe.
La nécessité d'une recherche théorique complète a été symbolisée par Lénine qui passa calmement son temps, au début de la guerre, à lire Hegel à la bibliothèque. Dans un article récemment publié dans The Commune, Kevin Anderson du Marxist Humanist Comittee (Comité marxiste humaniste) américain défend l'idée que l'étude de Hegel conduisit Lénine à la conclusion que la majorité de la Deuxième Internationale, y compris son mentor Plekhanov (et par extension lui-même), n'avaient pas rompu avec le matérialisme vulgaire, et que leur ignorance de Hegel les avait amenés à avoir peu de maîtrise de la véritable dialectique de l'histoire.3 Et, évidemment, l'un des principes dialectiques sous-jacents de Hegel est que ce qui est rationnel à une époque, devient irrationnel à une autre. Il est certain que c'est la méthode que Lénine utilisa pour répondre aux social-chauvins – Plekhanov en particulier – qui cherchaient à justifier la guerre en se référant aux écrits de Marx et Engels :
"Les social-chauvins russes (Plekhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870 ; les social-chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies... Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes... Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois." (Le socialisme et la guerre, 1915) 4
Là résidait la clé de la question : le capitalisme était devenu un système réactionnaire comme Marx l'avait prévu. La guerre le prouvait et cela impliquait une réévaluation complète de toutes les anciennes tactiques du mouvement, une compréhension claire des caractéristiques du capitalisme dans sa crise de sénilité et donc des nouvelles conditions auxquelles la lutte de classe était confrontée. Chez les fractions de gauche, cette analyse fondamentale de l'évolution du capitalisme était universelle. Rosa Luxemburg, dans la Brochure de Junius, sur la base d'une réinvestigation approfondie du phénomène de l'impérialisme au cours de la période qui avait mené à la guerre, reprit ce qu'Engels avait annoncé : l'humanité serait confrontée au choix socialisme ou barbarie ; et elle déclarait que ce n'était plus une perspective mais une réalité immédiate : "cette guerre est la barbarie". Dans le même document, Luxemburg défendait qu'à l'époque de la guerre impérialiste débridée, l'ancienne stratégie de soutien à certains mouvements de libération nationale avait perdu tout contenu progressiste : "A l'époque de cet impérialisme déchaîné il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l'impérialisme."5
Trotsky, qui écrivait dans Nashe Slovo, évoluait dans une direction parallèle, défendant que la guerre était le signe que l'Etat national lui-même était devenu une entrave à tout progrès humain ultérieur : "L'Etat national est dépassé – comme cadre pour le développement des forces productives, comme base pour la lutte de classe et, en particulier, comme forme étatique de la dictature du prolétariat. " (Nashe Slovo, 4 février 1916, traduit de l'anglais par nous.)
Dans une oeuvre plus connue, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Lénine – comme Luxemburg – reconnaissait que le conflit sanglant entre les grandes puissances mondiales exprimait le fait que ces puissances s'étaient désormais partagé toute la planète et que, de ce fait, le gâteau impérialiste ne pouvait qu'être re-réparti à travers de violents règlements de comptes entre ogres capitalistes : "...le trait caractéristique de la période envisagée, c'est le partage définitif du globe, définitif non en ce sens qu'un nouveau partage est impossible, - de nouveaux partages étant au contraire possibles et inévitables, - mais en ce sens que la politique coloniale des pays capitalistes en a terminé avec la conquête des territoires inoccupés de notre planète. Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître." 6
Dans le même livre, Lénine caractérise "le stade suprême" du capitalisme comme celui du "parasitisme et du déclin" ou du "capitalisme moribond". Parasitaire parce que – en particulier dans le cas de la Grande-Bretagne - il voyait une tendance à ce que la contribution des nations industrialisées à la production de la richesse globale soit remplacée par une dépendance croissante vis à vis du capital financier et des superprofits extraits des colonies (un point de vue qu'on peut certainement critiquer mais qui contenait un élément d’intuition, comme en témoigne aujourd'hui l'essor de la spéculation financière et l'avancement de la désindustrialisation de certaines des nations les plus puissantes). Le déclin (qui ne signifiait pas pour Lénine une stagnation absolue de la croissance) du fait de la tendance du capitalisme à abolir la libre concurrence au profit du monopole signifiait le besoin croissant que la société bourgeoise cède la place à un mode de production supérieur.
L'impérialisme de Lénine souffre d'un certain nombre de faiblesses. Sa définition de l'impérialisme est plus une description de certaines de ses manifestations les plus visibles ("les cinq caractéristiques " si souvent citées par les gauchistes pour prouver que telle ou telle nation, ou bloc de nations, n'est pas impérialiste) qu'une analyse des racines du phénomène dans le processus de l'accumulation comme l'avait fait Luxemburg. Sa vision d'un centre capitaliste avancé vivant de façon parasitaire des superprofits tirés des colonies (et corrompant ainsi une frange de la classe ouvrière, "l'aristocratie ouvrière", amenant cette dernière à soutenir les projets impérialistes de la bourgeoisie) ouvrait une brèche pour la pénétration de l'idéologie nationaliste sous la forme du soutien aux mouvements de "libération nationale" dans les colonies. De plus, la phase monopolistique (dans le sens de cartels privés gigantesques) avait déjà, au cours de la guerre, cédé la place à une expression "supérieure" du déclin capitaliste : l'énorme croissance du capitalisme d'Etat.
Sur cette dernière question, la contribution la plus importante est certainement celle de Boukharine qui fut l'un des premiers à montrer qu'à l'époque de "l'Etat impérialiste", la totalité de la vie politique, économique et sociale a été absorbée par l'appareil d'Etat, par dessus tout dans le but de mener la guerre avec les impérialismes rivaux :
"Contrairement à ce qu'était l'Etat dans la période du capitalisme industriel, l'Etat impérialiste se caractérise par un accroissement extraordinaire de la complexité de ses fonctions et par une brusque incursion dans la vie économique de la société. Il révèle une tendance à prendre en charge l'ensemble de la sphère productive et l'ensemble de la sphère de la circulation des marchandises. Les types intermédiaires d'entreprises mixtes seront remplacés par une pure régulation par l'Etat car, de cette façon, le processus de centralisation peut se développer. Tous les membres des classes dominantes (ou, plus exactement de la classe dominante car le capitalisme financier élimine graduellement les différents sous-groupes des classes dominantes, les unissant en une seule clique de capitalisme financier) deviennent actionnaires ou partenaires d'une gigantesque entreprise d'Etat. Assurant auparavant la préservation et la défense de l'exploitation, l'Etat se transforme en une organisation exploiteuse unique centralisée qui est confrontée directement au prolétariat, objet de cette exploitation. De même que les prix du marché sont déterminés par l'Etat, ce dernier assure aux ouvriers une ration suffisante pour la préservation de leur force de travail. Une bureaucratie hiérarchique remplit les fonctions organisatrices en plein accord avec les autorités militaires dont la signification et la puissance s'accroissent sans interruption. L'économie nationale est absorbée par l'Etat qui est construit de façon militaire et dispose d'une armée et d'une marine immenses et disciplinées. Dans leur lutte, les ouvriers doivent s'affronter à toute la puissance de ce monstrueux appareil, car toute avancée de leur lutte s'affrontera directement à l'Etat : la lutte économique et la lutte politique cesseront d'être deux catégories et la révolte contre l'exploitation signifiera une révolte directe contre l'organisation étatique de la bourgeoisie." ("Vers une théorie de l'Etat impérialiste", 1915, traduit de l'anglais par nous).
Le capitalisme d'Etat totalitaire et l'économie de guerre allaient s'avérer les caractéristiques fondamentales du siècle à venir. Etant donné l'omniprésence de ce monstre capitaliste, Boukharine concluait à juste raison que, désormais, toute lutte ouvrière significative n'avait d'autre choix que de se confronter à l'Etat et que la seule voie pour que le prolétariat aille de l'avant était de "faire exploser" l'ensemble de l'appareil – de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer par ses propres organes de pouvoir. Ceci signifiait le rejet définitif de toutes les hypothèses sur la possibilité de conquérir pacifiquement l'Etat existant, ce que Marx et Engels n'avaient pas entièrement rejeté, même après l'expérience de la Commune, et qui était devenu de plus en plus la position orthodoxe de la Deuxième Internationale. Pannekoek avait déjà développé cette position en 1912 et, lorsque Boukharine la reprit, Lénine au début l'accusa vivement de tomber dans l'anarchisme. Mais pendant qu'il élaborait sa réponse, et stimulé par la nécessité de comprendre la révolution qui se déroulait en Russie, Lénine fut une nouvelle fois saisi par la dialectique toujours en évolution et arriva à la conclusion que Pannekoek et Boukharine avaient eu raison – une conclusion formulée dans L'Etat et la révolution, rédigé à la veille de l'insurrection d'Octobre.
Dans le livre de Boukharine L'impérialisme et l'économie mondiale (1917), il y a aussi une tentative pour situer le cours vers l'expansion impérialiste dans les contradictions économiques identifiées par Marx ; il souligne la pression exercée par la baisse du taux de profit mais reconnaît également la nécessité d'une extension constante du marché. Comme Luxemburg et Lénine, le but de Boukharine est de démontrer que précisément du fait que le processus de "mondialisation" impérialiste avait créé une économie mondiale unifiée, le capitalisme avait rempli sa mission historique et ne pouvait désormais qu'entrer en déclin. C'était tout à fait cohérent avec la perspective soulignée par Marx quand il écrivait que "la tâche propre de la société bourgeoise, c'est l'établissement du marché mondial, du moins dans ses grandes lignes et d'une production fondée sur cette base." (Lettre de Marx à Engels, 8 octobre 1858, ES, Tome V)
Ainsi, contre les social-chauvins et les centristes qui voulaient revenir au statu quo d'avant guerre, qui dénaturaient le marxisme pour justifier leur soutien à l'un ou l'autre des camps belligérants, les marxistes authentiques affirmèrent de façon unanime qu'il n'y avait plus de capitalisme progressiste et que son renversement révolutionnaire était désormais historiquement à l'ordre du jour.
L'époque de la révolution prolétarienne
Ce fut la même question fondamentale de la période historique qui se posa à nouveau en Russie 1917, point culminant d'une vague internationale montante de résistance du prolétariat à la guerre. Comme la classe ouvrière russe, organisée en soviets, se rendait de plus en plus compte que le fait de s'être débarrassée du tsarisme, n'avait résolu aucun de ses problèmes fondamentaux, les fractions de droite et les centristes de la social-démocratie firent campagne, de toutes leurs forces, contre l'appel des Bolcheviks à la révolution prolétarienne et pour que les soviets règlent leur compte non seulement aux anciens éléments tsaristes mais aussi à toute la bourgeoisie russe qui considérait la révolution de Février comme sa propre révolution. La bourgeoisie russe était soutenue en ce sens par les Mencheviks qui reprenaient les écrits de Marx pour montrer que le socialisme ne pouvait être construit que sur la base d'un système capitaliste pleinement développé : comme la Russie était bien trop arriérée, elle ne pouvait évidemment aller plus loin que la phase d'une révolution bourgeoise démocratique et les Bolcheviks n'étaient qu'une bande d'aventuriers qui cherchaient à jouer à saute-mouton avec l'histoire. La réponse apportée par Lénine dans les Thèses d'avril était une nouvelle fois cohérente avec sa lecture de Hegel qui avait déjà souligné la nécessité de considérer le mouvement de l'histoire comme un tout. Elle reflétait en même temps son profond engagement internationaliste. C'est évidemment absolument juste que les conditions de la révolution doivent mûrir historiquement, mais l'avènement d'une nouvelle époque historique ne se juge pas à l'aune de tel ou tel pays pris séparément. Le capitalisme, comme le montrait la théorie de l'impérialisme, était un système global et donc son déclin et la nécessité de son renversement mûrissaient également à une échelle globale : l'éclatement de la guerre impérialiste mondiale le prouvait amplement. Il n'y avait pas une révolution russe isolée : l'insurrection prolétarienne en Russie ne pouvait qu'être le premier pas vers une révolution internationale ou, comme l'exprima Lénine dans son discours qui fit l'effet d'une bombe, adressé aux ouvriers et aux soldats qui étaient venus l'accueillir à son retour d'exil à la Gare de Finlande à Petrograd : "Chers camarades, soldats, matelots et ouvriers, je suis heureux de saluer en vous la révolution russe victorieuse, de vous saluer comme l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale... L'heure n'est pas loin où, à l'appel de notre camarade Karl Liebknecht, les peuples retourneront leurs armes contre les capitalistes exploiteurs... La révolution russe accomplie par vous a ouvert une nouvelle époque. Vive la révolution socialiste mondiale !..."
Cette compréhension que le capitalisme tout à la fois avait rempli les conditions nécessaires à l'avènement du socialisme et était entré dans sa crise historique de sénilité – puisque ce sont les deux faces de la même pièce – est également contenue dans la phrase bien connue de la Plateforme de l'Internationale communiste rédigée à son Premier Congrès en mars 1919 : "Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat." 7
Lorsque la gauche révolutionnaire internationaliste se réunit au Premier Congrès de l'IC, l'agitation révolutionnaire déclenchée par la révolution d'Octobre était à son point le plus haut. Bien que le soulèvement "spartakiste" à Berlin en janvier ait été écrasé et que Luxemburg et Liebknecht aient été sauvagement assassinés, la république des soviets venait de se former en Hongrie, l'Europe et des parties des Etats-Unis et d'Amérique du Sud connaissaient des grèves de masse. L'enthousiasme révolutionnaire de l'époque est exprimé dans les textes fondamentaux adoptés par le Congrès. En accord avec le discours de Rosa Luxemburg au Congrès de fondation du KPD, l'aube d'une nouvelle époque signifiait que l'ancienne distinction entre le programme minimum et le programme maximum n'était plus valable, par conséquent la tâche de s'organiser au sein du capitalisme au moyen de l'activité syndicale et de la participation au parlement en vue de gagner des réformes significatives avait historiquement perdu sa raison d'être. La crise historique du système capitaliste mondial, exprimée non seulement par la guerre impérialiste mondiale mais aussi par le chaos économique et social qu'elle avait laissé dans son sillage, signifiait que la lutte directe pour le pouvoir organisé en soviets était maintenant à l'ordre du jour d'une façon réaliste et urgente, et ce programme était valable dans tous les pays, y compris dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. De plus, l'adoption de ce nouveau programme maximum ne pouvait être mis en oeuvre que par une rupture complète avec les organisations qui avaient représenté la classe ouvrière au cours de l'époque précédente mais avaient trahi ses intérêts dès qu'elles avaient dû passer le test de l'histoire – le test de la guerre et de la révolution, en 1914 et en 1917. Les réformistes de la social-démocratie, la bureaucratie syndicale étaient désormais définis comme les laquais du capital, pas comme l'aile droite du mouvement ouvrier. Le débat au Premier Congrès montre que la jeune Internationale était ouverte aux conclusions les plus audacieuses tirées de l'expérience directe du combat révolutionnaire. Bien que l'expérience russe ait suivi un chemin en quelque sorte différent, les Bolcheviks écoutaient sérieusement le témoignage des délégués d'Allemagne, de Suisse, de Finlande, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'ailleurs, qui argumentaient que les syndicats n'étaient plus seulement inutiles mais étaient devenus un obstacle contre-révolutionnaire direct – des rouages de l'appareil d'Etat, et que les ouvriers s'organisaient de plus en plus en dehors et contre eux à travers la forme d'organisation des conseils dans les usines et dans les rues. Et comme la lutte de classe se centrait précisément sur les lieux de travail et dans les rues, ces centres vivants de la lutte de classe et de la conscience de classe, apparaissaient, dans les documents officiels de l'IC, en contraste frappant avec la coquille vide du parlement, instrument qui, lui aussi, était non seulement inadéquat pour la lutte pour la révolution prolétarienne mais aussi un instrument direct de la classe dominante, utilisé pour saboter les conseils ouvriers, comme l'avaient clairement démontré à la fois la Russie en 1917 et l'Allemagne en 1918. De même, le Manifeste de l'IC était très proche de la position que Luxemburg avait développée selon laquelle les luttes nationales étaient dépassées et les nouvelles nations montantes étaient devenues de simples pions des intérêts impérialistes rivaux. A ce stade, ces conclusions révolutionnaires "extrêmes" semblaient à la majorité découler logiquement de l'ouverture de la nouvelle période.8
Les débats au Troisième Congrès
Lorsque l'histoire s'accélère, comme ce fut le cas à partir de 1914, les changements les plus dramatiques peuvent avoir lieu en l'espace d'une année ou deux. Au moment où l'IC se réunissait pour son Troisième Congrès, en juin/juillet 1921, l'espoir d'une extension immédiate de la révolution, si fort lors du Premier Congrès, avait subi les coups les plus sévères. La Russie avait traversé trois ans de guerre civile épuisante et, bien que les Rouges aient vaincu militairement les Blancs, le prix en fut politiquement mortel : de larges parties des ouvriers les plus avancés avaient été décimées, l'Etat "révolutionnaire" s'était bureaucratisé au point que les soviets en avaient perdu le contrôle. Les rigueurs du "Communisme de guerre" et les excès destructeurs de la terreur rouge avaient fini par susciter une révolte ouverte dans la classe ouvrière : en mars, des grèves massives éclatèrent à Petrograd, suivies par le soulèvement armé des marins et des ouvriers de Cronstadt qui appelaient à la renaissance des soviets et à la fin de la militarisation du travail et des actions de répression de la Tcheka. Mais la direction bolchevique, enchaînée dans l'Etat, ne vit dans ce mouvement qu'une expression de la contre-révolution blanche et le supprima de façon impitoyable et sanglante. Tout cela était l'expression de l'isolement croissant du bastion russe. La défaite faisait suite à celle des républiques soviétiques de Hongrie et de Bavière, à la défaite des grèves générales de Winnipeg, Seattle, Red Clydeside, à celle des occupations d'usine en Italie, du soulèvement de la Ruhr en Allemagne et de beaucoup d'autres mouvements de masse.
De plus en plus conscients de leur isolement, le parti agrippé au pouvoir en Russie et d'autres partis communistes ailleurs commencèrent à avoir recours à des mesures désespérées pour étendre la révolution, comme la marche de l'Armée rouge sur la Pologne et l'Action de Mars en Allemagne en mars 1921 – deux tentatives ratées de forcer le cours de la révolution sans développement massif de la conscience de classe et de l'organisation nécessaires à une véritable prise du pouvoir par la classe ouvrière. Pendant ce temps, le système capitaliste, quoique saigné à blanc par la guerre et manifestant toujours des symptômes d'une profonde crise économique, parvint à se stabiliser sur les plans économique et social, en partie grâce au nouveau rôle joué par les Etats-Unis comme force motrice industrielle et banquier du monde.
Au sein de l'Internationale communiste, le Deuxième Congrès de 1920 avait déjà ressenti l'impact des précédentes défaites. Ce fut symbolisé par la publication par Lénine de la brochure La maladie infantile du communisme qui fut distribuée au Congrès 9. Au lieu de s'ouvrir à l'expérience vivante du prolétariat mondial, l'expérience bolchevique – ou une version particulière de celle-ci - était maintenant présentée comme un modèle universel. Les Bolcheviks avaient eu un certain succès à la Douma après 1905, la tactique du "parlementarisme révolutionnaire" était donc présentée comme ayant une validité universelle ; les syndicats s'étaient formés récemment en Russie et n'avaient pas perdu tout signe de vie prolétarienne... les communistes de tous les pays devaient donc faire tout ce qu'ils pouvaient pour rester dans les syndicats réactionnaires et chercher à les conquérir en éliminant les bureaucrates corrompus. A côté de cette codification des tactiques syndicale et parlementaire, en totale opposition vis-à-vis des courants communistes de gauche qui les rejetaient, vint l'appel à construire des partis communistes de masse, en incorporant en grande partie les organisations comme l'USPD en Allemagne et le Parti socialiste en Italie (PSI).
L’année 1921 montra d'autres manifestations du glissement vers l'opportunisme, du sacrifice des principes et des buts à long terme au profit de succès à court terme et de la croissance numérique. Au lieu d'une claire dénonciation des partis sociaux-démocrates comme agents de la bourgeoisie, on avait maintenant le sophisme de la "lettre ouverte" à ces partis, ayant pour but de "forcer les dirigeants à se battre" ou, s'ils ne le faisaient pas, à se démasquer face à leurs membres ouvriers. Bref, l'adoption d'une politique de manœuvres dans laquelle les masses doivent en quelque sorte être dupées pour développer leur conscience. Ces tactiques allaient être rapidement suivies par la proclamation de celle du "front unique" et par le slogan encore plus sans principes de "Gouvernement ouvrier", sorte de coalition parlementaire entre les sociaux-démocrates et les communistes. Derrière toute cette course à l'influence à tout prix se trouve le besoin de l'Etat "soviétique" de faire face à un monde capitaliste hostile, de trouver un modus vivendi avec le capitalisme mondial, au prix d'un retour à la pratique de la diplomatie secrète qui avait été très clairement condamnée par le pouvoir soviétique en 1917 (en 1922, l'Etat "soviétique" signait un accord secret avec l'Allemagne, lui fournissant même des armes qui allaient servir à abattre les ouvriers communistes un an après). Tout cela indiquait l'accélération de la trajectoire qui s'éloignait de la lutte pour la révolution et s'orientait vers l'incorporation dans le statu quo capitaliste – pas encore définitive mais indiquant le chemin de la dégénérescence qui allait culminer dans la victoire de la contre-révolution stalinienne.
Cela ne voulait pas dire que toute clarté ou tout débat sérieux sur la période historique ait disparu. Au contraire, les "communistes de gauche", réagissant à ce cours opportuniste, allaient baser encore plus solidement leurs arguments sur le point de vue que le capitalisme était entré dans une nouvelle période : le programme du KAPD de 1920 commençait donc par la proclamation que le capitalisme était dans sa crise historique et qu'il mettait le prolétariat face au choix "socialisme ou barbarie" 10 ; la même année, les arguments de la gauche italienne contre le parlementarisme partent des prémisses selon lesquelles les campagnes pour les élections parlementaires avaient eu leur validité dans la période passée mais que l'avènement d'une nouvelle époque invalidait cette ancienne pratique. Mais même parmi les voix "officielles" de l'Internationale existait toujours une tentative authentique de comprendre les caractéristiques et les conséquences de la nouvelle période.
Le Rapport et les Thèses sur la situation mondiale présentées par Trotsky au Troisième Congrès en juin/juillet 1921 offraient une analyse très lucide des mécanismes auxquels avait recours un capitalisme profondément mal en point pour assurer sa survie dans la nouvelle période – notamment la fuite dans le crédit et le capital fictif. Analysant les premiers signes d'une reprise d'après-guerre, le rapport de Trotsky sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l'Internationale communiste posait ainsi les questions : "Comment s'est fait le relèvement lui-même, comment peut-il être expliqué ? En premier lieu, par des causes économiques : les relations internationales ont été renouées, quoique dans des proportions restreintes, et partout nous observons une demande des marchandises les plus variées ; il s'explique ensuite par des causes politiques et financières : les gouvernements européens avaient eu peur de la crise qui devait se produire après la guerre et avaient pris leurs mesures pour faire durer ce relèvement artificiel qui avait été provoqué par la guerre. Les gouvernements ont continué à mettre en circulation du papier-monnaie en grande quantité, ils ont lancé de nouveaux emprunts, taxé les bénéfices, les salaires et le prix du pain, ils couvraient ainsi une part des salaires des ouvriers démobilisés en puisant dans les fonds nationaux, et créaient une activité économique artificielle dans le pays. De cette façon, pendant tout ce temps, le capital fictif continuait à croître, surtout dans les pays où l'industrie baissait."11
Toute la vie du capitalisme depuis cette époque n'a fait que confirmer ce diagnostic d'un système qui ne pouvait se maintenir à flot qu'en violant ses propres lois économiques. Ces textes cherchaient aussi à approfondir la compréhension selon laquelle, sans une révolution prolétarienne, le capitalisme déchaînerait certainement de nouvelles guerres encore plus destructrices (même si les déductions sur une confrontation imminente entre l'ancienne puissance britannique et la puissance américaine montante étaient loin du compte bien que non sans fondement). Mais la clarification la plus importante contenue dans ce document et d'autres était la conclusion que l'avènement de la nouvelle période ne signifiait pas que le déclin, la crise économique ouverte et la révolution seraient simultanés – une ambiguïté qu'on peut trouver dans la formulation d'origine de l'IC en 1919, "Une nouvelle époque est née", qui pouvait être interprétée comme signifiant que le capitalisme était entré simultanément dans une crise économique "finale", une phase ininterrompue de conflits révolutionnaires. Cette avancée dans la compréhension est peut-être plus clairement exprimée dans le texte de Trotsky "Les enseignements du Troisième Congrès de l'IC", rédigé en juillet 1921. Il commençait ainsi : "Les classes ont leur origine dans le processus de production. Elles sont capables de vivre tant qu'elles jouent le rôle nécessaire dans l'organisation commune du travail. Les classes perdent pied si leurs conditions d'existence sont en contradiction avec le développement de la production, c'est-à-dire le développement de l'économie. C'est dans une telle situation que se trouve actuellement la bourgeoisie. Cela ne signifie pas du tout que la classe qui a perdu ses racines et qui est devenue parasitaire doive périr immédiatement. Quoique les fondements de la domination de classe reposent sur l'économie, les classes se maintiennent grâce aux appareils et organes de l'Etat politique : armée, police, parti, tribunaux, presse, etc. A l'aide de ces organes, la classe dominante peut conserver le pouvoir des années et des dizaines d'années même quand elle est devenue un obstacle direct au développement social. Si cet état de choses se prolonge trop longtemps, la classe dominante peut entraîner dans sa chute le pays et la nation qu'elle domine... La représentation purement mécanique de la révolution prolétarienne, qui a uniquement pour point de départ la ruine constante de la société capitaliste, poussait quelques groupes de camarades à la théorie fausse de l'initiative des minorités qui font écrouler par leur hardiesse "les murs de la passivité commune du prolétariat" et des attaques incessantes de l'avant-garde du prolétariat comme nouvelle méthode de combat dans les luttes et de l'emploi des méthodes de révoltes armées. Inutile de dire que cette sorte de théorie de la tactique n'a rien à faire avec le marxisme." 12
Ainsi, l'ouverture du déclin n'excluait pas des reprises au niveau économique, ni des reculs du prolétariat. Evidemment, personne ne pouvait voir à quel point déjà les défaites de 1919-21 avaient été décisives, mais il existait un besoin brûlant de clarifier que faire maintenant, dans une nouvelle époque mais pas dans un moment immédiat de révolution. Un texte séparé, les Thèses sur la tactique, adopté par le Congrès, mettait très justement en avant la nécessité que les partis communistes prennent part aux luttes défensives afin de développer la confiance et la conscience de la classe ouvrière, et ceci, de pair avec la reconnaissance que le déclin et la révolution n'étaient en aucun cas synonymes, constituait un rejet nécessaire de "la théorie de l'offensive" qui avait largement justifié la démarche semi-putschiste de l'Action de mars. Cette théorie – selon laquelle les conditions objectives étant mûres, le parti communiste devait mener une offensive insurrectionnelle plus ou moins permanente pour pousser les masses à l'action – était défendue principalement par la gauche du parti communiste allemand, par Bela Kun et d'autres et non, comme c'est souvent dit de façon erronée, par la Gauche communiste à proprement parler même si le KAPD et des éléments proches de lui n'étaient pas toujours clairs sur cette question. 13
A ce sujet, les interventions des délégations du KAPD au Troisième Congrès sont extrêmement instructives. Contredisant l'étiquette de "sectaire" qui lui était accolée dans les Thèses sur la tactique, l'attitude du KAPD au Congrès fut un modèle de la façon responsable dont une minorité doit se conduire dans une organisation prolétarienne. Bien qu'il ait disposé d'un temps extrêmement restreint pour ses interventions et dû supporter les interruptions et les sarcasmes des supporters de la ligne officielle, le KAPD se considérait comme participant pleinement au déroulement du Congrès et ses délégués étaient très disposés à souligner les points d'accord quand ils en avaient ; ils n'étaient pas du tout intéressés à mettre en avant leurs divergences pour elles-mêmes, ce qui constitue l'essence de l'attitude sectaire. 14 Par exemple, dans la discussion sur la situation mondiale, un certain nombre de délégués du KAPD partageaient beaucoup de points de l'analyse de Trotsky, notamment la notion selon laquelle le capitalisme était en train de se reconstruire au plan économique et de reprendre le contrôle sur le plan social : ainsi Seeman souligna la capacité de la bourgeoisie internationale de mettre temporairement de côté ses rivalités inter-impérialistes afin de faire face au danger prolétarien, en Allemagne en particulier.
L'implication de ceci – en particulier du fait que le rapport de Trotsky et les Thèses sur la situation mondiale étaient en grande partie orientées pour rejeter la "théorie de l'offensive" et ses partisans – c'est que le KAPD ne défendait pas qu'il ne pourrait pas y avoir de stabilisation du capital ni que la lutte devait être offensive à tout moment.Et il exprima explicitement ce point de vue dans nombre d'interventions.
Sachs, dans sa réponse à la présentation de Trotsky sur la situation économique mondiale, dit ainsi que : "Nous avons vu certes hier en détail comment le camarade Trotsky – et tous ceux qui sont ici seront, je pense, d' accord avec lui - se représente les rapports entre d'un côté les petites crises et les petites périodes d'essors cycliques et momentanés et, de l'autre côté, le problème de l'essor et du déclin du capitalisme, envisagé sur de grandes périodes historiques. Nous serons tous d'accord que la grande courbe qui allait vers le haut va maintenant irrésistiblement vers le bas, et qu'à l'intérieur de cette grande courbe, aussi bien lorsqu'elle montait que maintenant qu'elle descend, se produisent des oscillations." (La gauche allemande, p.21) 15
Ainsi, quelles que soient les ambiguïtés ayant existé dans la vision du KAPD sur "la crise mortelle", il ne considérait pas que l'ouverture de la décadence signifiait un effondrement soudain et définitif de la vie économique du capitalisme.
De même, l'intervention de Hempel sur la tactique de l'Internationale montre clairement que l'accusation de "sectaire" portée au KAPD pour son supposé refus des luttes défensives et son prétendu appel à l'offensive à tout moment était fausse : "Maintenant la question des actions partielles. Nous disons que nous ne repoussons aucune action partielle. Nous disons : chaque action, chaque combat, car c'est une action, doit être mis au point, poussé en avant. On ne peut pas dire : nous repoussons ce combat-ci, nous repoussons ce combat-là. Le combat qui naît des nécessités économiques de la classe ouvrière, ce combat doit par tous les moyens être poussé en avant. Justement dans un pays tel que l'Allemagne, l'Angleterre et tous les autres pays de démocratie bourgeoise qui ont subi pendant 40 ou 50 ans une démocratie bourgeoise et ses effets, la classe ouvrière doit être d'abord habituée aux luttes. Les mots d'ordre doivent correspondre aux actions partielles. Prenons un exemple : dans une entreprise, dans différentes entreprises, une grève éclate, elle englobe un petit domaine. Là le mot d'ordre ne saurait être : lutte pour la dictature du prolétariat. Ce serait une absurdité. Les mots d'ordre doivent aussi être adaptés aux rapports de force, à ce que l'on peut attendre en un lieu donné." (ibid. p.40)
Mais derrière beaucoup de ces interventions, il y avait l'insistance du KAPD sur le fait que l'IC n'allait pas assez loin dans sa compréhension qu'une nouvelle période de la vie du capitalisme et donc de la lutte de classe s'était ouverte. Sachs, par exemple, ayant exprimé son accord avec Trotsky sur la possibilité de reprises temporaires, défendit que : "ce qui n'a pas été exprimé dans ces Thèses, ...c'est justement le caractère fondamentalement différent de cette époque de déclin vis-à-vis de l'époque antérieure d'essor du capitalisme considéré dans sa totalité" (ibid., p.21) et que cela avait des implications sur la façon dont le capitalisme survivrait désormais : "le capital reconstruit son pouvoir en détruisant l'économie". (ibid. p.22), un point de vue visionnaire sur la façon dont le capitalisme allait continuer comme système dans le siècle qui allait suivre. Hempel, dans la discussion sur la tactique, tire les implications de la nouvelle période concernant les positions politiques que les communistes doivent défendre, en particulier sur les questions syndicale et parlementaire dans la tactique. Contrairement aux anarchistes auxquels le KAPD a souvent été assimilé, Hempel insiste sur le fait que l'utilisation du parlement et des syndicats avait été juste dans la période précédente : "...si l'on se remet en mémoire les tâches qu'avait le vieux mouvement ouvrier, ou mieux, le mouvement ouvrier précédent l'époque de cette irruption de la révolution directe, il avait pour tâche, d'un côté, grâce aux organisations politiques de la classe ouvrière, les partis, d'envoyer des délégués au parlement et dans les institutions que la bourgeoisie et la bureaucratie avaient laissées ouvertes à la représentation de la classe ouvrière. C'était l'une des tâches. Cela fut mis à profit et à l'époque c'était juste. Les organisations économiques de la classe ouvrière avaient de leur côté la tâche de se préoccuper d'améliorer la situation du prolétariat au sein du capitalisme, de pousser à la lutte et de négocier lorsque la lutte s'arrêtait...telles étaient les tâches des organisations ouvrières avant la guerre. Mais la révolution arriva ; d'autres tâches se firent jour. Les organisations ouvrières ne pouvaient pas se conformer à la lutte pour les augmentations de salaires et s'en satisfaire ; elles ne purent plus poser – comme leur but principal – celui d'être représentées au parlement et d'extorquer des améliorations pour la classe ouvrière " (ibid. p.33) et de plus "en permanence nous faisons l'expérience que toutes les organisations de travailleurs qui prennent ce chemin, en dépit de tous leurs discours révolutionnaires, se dérobent dans les luttes décisives" (ibid. p.34), et c'est pourquoi la classe ouvrière avait besoin de créer de nouvelles organisations capables d'exprimer la nécessité de l'auto-organisation du prolétariat et de la confrontation directe avec l'Etat et le capital ; ceci était valable tant pour les petites luttes défensives que pour les luttes massives plus vastes. Ailleurs Bergmann définit les syndicats comme les rouages de l'Etat et montre qu'il est donc illusoire de vouloir les conquérir : "Nous sommes fondamentalement de l'avis qu'il faut se dégager des vieux syndicats. Non parce que nous aurions une soif de destruction, mais parce que nous voyons que ces organisations sont devenues réellement, dans le pire sens du terme, des organes de l'Etat capitaliste pour réprimer la révolution." (ibid., p. 56) Dans la même veine, Sachs critiqua la régression vers la notion de parti de masse et la tactique de la lettre ouverte aux partis sociaux-démocrates – c'étaient des régressions soit vers des pratiques sociales-démocrates et des formes d'organisation dépassées ou, pire, vers les partis sociaux-démocrates eux-mêmes qui étaient passés à l'ennemi.
* * *
En général, l'Histoire est écrite par les vainqueurs ou, du moins, par ceux qui apparaissent comme tels. Dans les années qui suivirent le Troisième Congrès, les partis communistes officiels restèrent des organisations capables d'inspirer la loyauté de millions d'ouvriers, le KAPD éclata rapidement en plusieurs composantes dont peu maintinrent la clarté exprimée par ses représentants à Moscou en 1921. Désormais, les erreurs vraiment sectaires apparurent au premier plan, en particulier dans la décision hâtive de la tendance d'Essen du KAPD, autour de Gorter, de fonder une "quatrième internationale" (la KAI ou Internationale communiste ouvrière) alors que ce qui était nécessaire dans une phase de recul de la révolution était le développement d'une fraction internationale qui combatte la dégénérescence de la Troisième Internationale. Cet enterrement prématuré de l'Internationale communiste s'accompagna logiquement d'un tournant dans l'analyse de la révolution d'Octobre, de plus en plus considérée comme une révolution bourgeoise. Le point de vue de la tendance Schröder dans la KAI qui considérait qu'à l'époque de la "crise mortelle", les luttes pour les salaires étaient opportunistes, était également sectaire ; d'autres courants commencèrent à mettre en question la possibilité même d'un parti politique du prolétariat, donnant naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de "conseillisme". Mais ces manifestations d'un affaiblissement et d'une fragmentation plus générale de l'avant-garde révolutionnaire étaient le produit de la défaite et de la contre-révolution qui s'aggravaient ; en même temps, le maintien, au cours de cette période, des partis communistes en tant qu'organisations de masse influentes était aussi le produit de la contre-révolution bourgeoise, mais avec cette terrible particularité que ces partis s'étaient mis à l'avant-garde de cette contre-révolution, à côté des bouchers fascistes et démocratiques. D'un autre côté, les positions les plus claires du KAPD et de la gauche italienne, produits des plus hauts moments de la révolution et solidement ancrées dans la théorie du déclin du capitalisme, ne disparurent pas, en grande partie grâce au travail patient de petits groupes de révolutionnaires, souvent extrêmement isolés ; quand les brumes de la contre-révolution commencèrent à se dissiper, ces positions trouvèrent une nouvelle vie avec l'émergence d'une nouvelle génération de révolutionnaires et elles restent des acquis fondamentaux sur lesquels le futur parti de la révolution devra se construire.
Gerrard
1. Citée dans J.P. Nettl, "La vie et l'œuvre de Rosa Luxemburg", Ed. Maspero, Tome II, p.593
2. Ce serait intéressant cependant de faire plus de recherches sur les tentatives actuelles au sein du mouvement anarchiste d'analyser la signification de la guerre.
3. "Lenin's Encounter with Hegel after Eighty Years: A Critical Assessment [136]"
4. www.marxists.org/francais/lenin/works/1915/08/vil19150800.htm [137]
5. chapitre annexe "Thèses sur les tâches de la social-démocratie [138]".
6. "Le partage du monde entre les grandes puissances [139]".
7 www.marxists.org/francais/inter_com/1919/ic1_19190300d.htm [140]
8. Pour plus d'éléments sur les discussions lors du Premier Congrès de l'Internationale, voir l'article de la Revue internationale n°123 "La théorie de la décadence au cœur du matérialisme historique – De Marx à la Gauche communiste (2) [141]".
9 Signalons que cette lettre n'est pas restée sans réponse ni critiques, notamment celle de Gorter au camarade Lénine [142].
10. "La crise économique mondiale, née de la guerre mondiale, avec ses effets économiques et sociaux monstrueux, et dont l’image d’ensemble produit l’impression foudroyante d’un unique champ de ruines aux dimensions colossales, ne signifie qu’une seule chose : le crépuscule des dieux de l’ordre mondial bourgeois-capitaliste est entamé. Aujourd’hui il ne s’agit pas d’une des crises économiques périodiques, propres au mode de production capitaliste ; c’est la crise du capitalisme lui-même ; secousses convulsives de l’ensemble de l’organisme social, éclatement formidable d’antagonismes de classes d’une acuité jamais vue, misère générale pour de larges couches populaires, tout cela est un avertissement fatidique à la société bourgeoise. Il apparaît de plus en plus clairement que l’opposition entre exploiteurs et exploités qui s’accroît encore de jour en jour, que la contradiction entre capital et travail, dont prennent de plus conscience même les couches jusque là indifférentes du prolétariat, ne peut être résolue. Le capitalisme a fait l’expérience de son fiasco définitif ; il s’est lui-même historiquement réduit à néant dans la guerre de brigandage impérialiste, il a créé un chaos, dont la prolongation insupportable place le prolétariat devant l’alternative historique : rechute dans la barbarie ou construction d’un monde socialiste." www.left-dis.nl/f/kapd1920f.htm [143]
11 www.trotsky-oeuvre.org/21/07/210725_NE1.html [144].
12 www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1921/07/lt19210712.htm [145]
13. Par exemple le paragraphe introductif du programme du KAPD, cité dans la note, peut facilement être interprété comme décrivant une crise finale et définitive du capitalisme et, par rapport au danger de putschisme, certaines activités du KAPD pendant l'Action de Mars sont certainement tombées dans cette tendance, comme par exemple l'alliance avec le VKPD dans l'utilisation de ses membres chômeurs pour tenter d'entraîner littéralement par la force les ouvriers à rejoindre la grève générale, et dans ses rapports ambigus avec les forces armées "indépendantes" menées par Max Hoelz et d'autres (Voir également l'intervention de Hempel au Troisième Congrès (La gauche allemande, p. 41) qui reconnaît que l'Action de Mars n'aurait pas pu renverser le capitalisme mais insiste aussi sur la nécessité de lancer le slogan de renversement du gouvernement – une position qui semble manquer de cohérence puisque, pour le KAPD, il n'était pas question de défendre aucune sorte de Gouvernement "ouvrier" sans la dictature du prolétariat.
14 L'attitude de Hempel envers les anarchistes et les syndicalistes-révolutionnaires était également exempte d'esprit sectaire, et soulignait la nécessité de travailler avec toutes les expressions authentiquement révolutionnaires de ce courant (voir La gauche allemande, pp. 44-45)
15 Edité par Invariance, La vieille taupe, La vecchia talpa, 1973.
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (2e partie)
- 2374 lectures
Nous avons publié la première partie du Manifeste dans le numéro précédent de la Revue internationale. Pour rappel, le Groupe ouvrier du Parti communiste russe, dont ce Manifeste est l’émanation, fait partie de ce qu’on appelle la Gauche communiste, constituée de courants de gauche ayant surgi en réponse à la dégénérescence opportuniste des partis de la Troisième Internationale et du pouvoir des soviets en Russie.
Les deux chapitres suivants de ce document que nous publions ci-dessous constituent une critique aiguisée de la politique opportuniste du front unique et du slogan de Gouvernement ouvrier. En replaçant cette critique dans son contexte historique, c’est réellement à une tentative d’appréhender les implications du changement de période historique que se livre le Manifeste. Pour lui, la nouvelle période rend caduque toute politique d’alliance avec des fractions de la bourgeoisie, vu que celles-ci sont désormais toutes également réactionnaires. De même, passer des alliances avec des organisations comme la social-démocratie, qui ont déjà fait la preuve de leur trahison, ne peut que conduire à un affaiblissement du prolétariat. De plus, le Manifeste est parfaitement clair sur ce fait que, dans la nouvelle période, ce n’est plus la lutte pour des réformes qui est à l’ordre du jour, mais bien celle pour la prise du pouvoir. Cependant, la rapidité avec laquelle des changements historiques considérables sont intervenus n’a pas permis, même aux révolutionnaires les plus clairs, de prendre le recul nécessaire pour en comprendre en profondeur les implications précises. Cela arrive aussi au Groupe ouvrier qui ne fait pas la différence entre lutte pour des réformes et lutte économique de résistance du prolétariat, face aux empiètements permanents du capital. Tout en ne refusant pas de participer à ces dernières, par solidarité, il juge cependant que seule la prise du pouvoir est de nature à libérer le prolétariat de ses chaînes, sans prendre en compte le fait que la lutte économique et politique forment un tout.
Enfin, face à la limitation de la liberté de parole imposée au prolétariat, y compris après la fin de la guerre civile, le Manifeste réagit très fermement et lucidement en s’adressant aux dirigeants : "comment voulez-vous résoudre la grande tâche de l’organisation de l’économie sociale sans le prolétariat ?"
Le front uni socialiste
Avant d’examiner le contenu de cette question, il est nécessaire de nous remettre en mémoire les conditions dans lesquelles les thèses du camarade Zinoviev au sujet du front unique furent débattues et acceptées en Russie. Du 19 au 21 décembre 1921 eut lieu la Douzième Conférence du PCR (bolchevik), au cours de laquelle fut posée la question du front unique. Jusqu’alors, rien n’avait été écrit dans la presse ni discuté à ce sujet dans les réunions du parti. Cependant, à la Conférence, le camarade Zinoviev se laissa aller à livrer de rudes attaques et la Conférence fut si surprise qu’elle céda tout de suite et approuva les thèses à mains levées. Nous rappelons cette circonstance non pour offenser qui que ce soit, mais pour attirer avant tout l’attention sur le fait que, d’une part, la tactique du front unique fut discutée de façon très hâtive, quasi "militairement", et que, d’autre part, en Russie même, elle est réalisée de façon tout à fait particulière.
Le PCR (bolchevik) fut le promoteur de cette tactique au sein du Komintern (IC) 1. Il convainquit les camarades étrangers que nous, révolutionnaires russes, avions vaincu justement grâce à cette tactique du front unique et qu’elle avait été édifiée en Russie sur base de l’expérience de toute l’époque pré-révolutionnaire et particulièrement à partir de l’expérience de la lutte des bolcheviks contre les mencheviks.
Tout ce que les camarades venus de différents pays connaissaient, c’est que le prolétariat russe avait vaincu, et ils voulaient de même vaincre leur bourgeoisie. On leur expliquait à présent que le prolétariat russe avait vaincu grâce à la tactique du front unique. Comment leur aurait-il été alors possible de ne pas approuver cette tactique ? Ils croyaient sur parole que la victoire de la classe ouvrière russe était le résultat de la tactique du front unique. Ils ne pouvaient pas faire autrement, puisqu’ils ne connaissaient pas l’histoire de la Révolution russe. Le camarade Lénine a condamné un jour très durement celui qui se fie simplement aux mots, mais il ne voulait vraisemblablement pas dire qu’on ne devait pas le croire lui sur parole.
Quelle leçon pouvons-nous alors tirer de l’expérience de la Révolution russe ?
A une époque, les bolcheviks soutenaient un mouvement progressiste contre l’autocratie :
a) "la social-démocratie doit soutenir la bourgeoisie tant que cette dernière est révolutionnaire ou opposée au tsarisme" ;
b) "c’est pourquoi la social-démocratie doit être favorable au réveil d’une conscience politique de la bourgeoisie russe mais, d’un autre côté, elle est obligée de dénoncer le caractère limité et l’insuffisance du mouvement d’émancipation de la bourgeoisie partout où ils s’expriment" (Résolution du IIe Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, "De l’attitude envers les libéraux", août 1903).
La résolution du IIIe Congrès, qui s’est tenu en avril 1905, reproduit ces deux points en recommandant aux camarades :
1) d’expliquer aux ouvriers la nature contre-révolutionnaire et anti-prolétarienne du courant bourgeois-démocrate quelles que soient ses nuances, des libéraux modérés représentés par les vastes couches des propriétaires fonciers et des fabricants jusqu’au courant le plus radical comprenant "l’Union de l’émancipation" et les groupes variés des gens des professions libérales ;
2) de lutter ainsi énergiquement contre toute tentative de la part de la démocratie bourgeoise de récupérer le mouvement ouvrier et de parler au nom du prolétariat et de ses groupes divers.Dés 1898 la social-démocratie était favorable à un "front uni" (comme on dit actuellement) avec la bourgeoisie. Mais ce front uni a connu 3 phases :
1) en 1901, la social-démocratie soutient tout "mouvement progressiste" opposé au régime existant ;
2) en 1903, elle se rend bien compte de la nécessité de dépasser "les bornes du mouvement de la bourgeoisie";
3) en 1905, en avril, elle fait des pas concrets "en conseillant vivement aux camarades de dénoncer la nature contre-révolutionnaire et anti-prolétarienne du courant bourgeois-démocrate, toutes nuances comprises", en lui disputant énergiquement l’influence sur le prolétariat.
Mais quelles que furent les formes de soutien à la bourgeoisie, il est hors de doute que pendant une certaine période, avant 1905, les bolcheviks formèrent un front uni avec la bourgeoisie.
Et que penserions-nous d’un "révolutionnaire" qui, en fonction de l’expérience russe, aurait proposé un front uni avec la bourgeoisie aujourd’hui ?
Au mois de septembre 1905, la Conférence convoquée spécialement pour débattre la question de la "Douma de Boulyguine" a défini l’attitude de cette dernière envers la bourgeoisie de la façon suivante : "Par cette illusion d’une représentation du peuple, l’autocratie aspire à s’attacher une grande partie de la bourgeoisie lasse du mouvement ouvrier et désirant de l’ordre ; en s’assurant de ses intérêt et de son soutien, l’autocratie vise à écraser le mouvement révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie."
La résolution des bolcheviks proposée au Congrès d’unification du POSDR (avril 1906) révèle le secret du changement de politique des bolcheviks, de son soutien passé à la bourgeoisie à la lutte contre elle : "Quant à la classe des grands capitalistes et des propriétaires fonciers, on voit leur passage très rapide de l’opposition à un arrangement avec l’autocratie pour écraser ensemble la révolution". Comme "la tâche principale de la classe ouvrière au moment actuel de la révolution démocratique est l’achèvement de cette révolution", il faut former "un front uni" avec des partis qui le veulent aussi. Pour cette raison, les bolcheviks ont renoncé à tout accord avec les partis à la droite des Cadets et ont conclu des pactes avec les partis à leur gauche, à savoir les socialistes-révolutionnaires (SR), les socialistes populaires (NS) et les travaillistes, ont donc construit "un front uni socialiste" dans la lutte pour la marche conséquente de la révolution démocratique.
Est-ce que la tactique des bolcheviks était juste à cette époque ? Nous ne croyons pas que parmi les combattants actifs de la Révolution d’octobre se trouvent des gens contestant la justesse de cette tactique. Nous constatons donc que de 1906 à 1917 inclus, les bolcheviks ont prôné "un front uni socialiste" dans la lutte pour une marche conséquente de la révolution démocratique s’achevant par la formation d’un Gouvernement révolutionnaire provisoire qui aurait dû convoquer une Assemblée constituante.
Personne n’a jamais considéré et n’a pu considérer cette révolution comme étant prolétarienne, socialiste ; tous ont bien compris qu’elle était bourgeoise-démocratique ; et néanmoins, les bolcheviks ont proposé et ont eux-mêmes suivi la tactique d’un "front uni socialiste" en s’unissant en pratique avec les SR, les mencheviks, les NS et les travaillistes.
Quelle fut la tactique des bolcheviks quand se posa la question de savoir si on devait lutter pour la révolution démocratique ou pour la révolution socialiste ? La lutte pour le pouvoir des conseils réclame-t-elle aussi le "front uni socialiste" ?
Les révolutionnaires marxistes considèrent toujours le parti des socialistes-révolutionnaires comme étant une "fraction démocratique-bourgeoise" à la "phraséologie socialiste ambiguë" ; ce qui a été confirmé, dans une grande mesure, par son activité durant toute la révolution jusqu’à l’heure actuelle. En tant que fraction démocratique-bourgeoise, ce parti ne pouvait pas se proposer la tâche pratique d’une lutte pour la révolution socialiste, pour le socialisme ; mais il chercha, en utilisant une terminologie "socialiste ambiguë", à empêcher à tout prix cette lutte. S’il en est ainsi (et il en est ainsi), la tactique qui devait conduire le prolétariat insurgé à la victoire ne pouvait être celle du front uni socialiste, mais celle du combat sanglant, sans ménagement, contre les fractions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse. Seul ce combat pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a vaincu non en s’alliant aux socialistes-révolutionnaires, aux populistes et aux mencheviks, mais en luttant contre eux.
Il est vrai que vers octobre, les bolcheviks ont réussi à faire scissionner les partis SR 2 et mencheviks 3 en libérant les masses ouvrières de la captivité d’une terminologie socialiste obscure, et ont pu agir avec ces scissions [de gauche], mais ça ne peut guère être considéré comme un front uni avec les fractions bourgeoises.
Qu’est-ce que l’expérience russe nous enseigne ?
1) Dans certains moments historiques, il faut former un "front uni" avec la bourgeoisie dans les pays où la situation est plus ou moins semblable à celle qui existait en Russie avant 1905.
2) Dans les pays où la situation est à peu près semblable à celle de la Russie entre 1906 et 1917, il faut renoncer à la tactique d’un "front uni" avec la bourgeoisie et suivre la tactique d’un "front uni socialiste".
Dans les pays où il s’agit d’une lutte directe pour le pouvoir du prolétariat, il est nécessaire d’abandonner la tactique du "front uni socialiste" et d’avertir le prolétariat que "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste ambiguë" – à l’époque actuelle tous les partis de la Seconde Internationale – marcheront au moment décisif les armes à la main pour la défense du système capitaliste.
Il est nécessaire, pour l’unification de tous les éléments révolutionnaires qui ont pour but le renversement de l’exploitation capitaliste mondiale, qu’ils s’alignent avec le Parti communiste ouvrier d’Allemagne (KAPD), le Parti communiste ouvrier de Hollande et les autres partis qui adhèrent à la IVe Internationale 4. Il est nécessaire que tous les éléments révolutionnaires prolétariens authentiques se détachent de ce qui les emprisonne : les partis de la Seconde Internationale, de l’Internationale deux et demi 5 et de leur "phraséologie socialiste ambiguë". La victoire de la révolution mondiale est impossible sans une rupture principielle et une lutte sans quartier contre les caricatures bourgeoises du socialisme. Les opportunistes et les social-chauvins, en tant que serviteurs de la bourgeoisie et par là ennemis directs de la classe prolétarienne, deviennent, plus spécialement aujourd’hui, liés comme ils le sont aux capitalistes, des oppresseurs armés dans leurs propres pays et dans les pays étrangers (cf. Programme du PCR bolchevik). Telle est donc la vérité sur la tactique du front unique socialiste qui, comme le soutiennent les thèses de l’Exécutif de l’IC, serait fondée sur l’expérience de la Révolution russe, alors qu’elle n’est en réalité qu’une tactique opportuniste. Une telle tactique de collaboration avec les ennemis déclarés de la classe ouvrière, qui oppriment les armes à la main le mouvement révolutionnaire du prolétariat dans tous les pays, est en contradiction ouverte avec l’expérience de la Révolution russe. Pour rester sous le signe de la révolution sociale, il est nécessaire de réaliser un "front uni" contre la bourgeoisie et ses serviteurs socialistes de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi.
Comme on le dit ci-dessus, la tactique du "front uni socialiste" garde toute sa valeur révolutionnaire dans les pays où le prolétariat lutte contre l’autocratie, soutenue par la bourgeoisie, et pour la révolution bourgeoise-démocratique.
Et là où le prolétariat combat encore l’autocratie à laquelle s’oppose aussi la bourgeoisie, il faut suivre la tactique du "front uni" avec la bourgeoisie.
Quand le Komintern exige des partis communistes de tous les pays qu’ils suivent coûte que coûte la tactique du front uni socialiste, c’est une exigence dogmatique qui entrave la résolution des tâches concrètes conformément aux conditions de chaque pays et nuit incontestablement à tout le mouvement révolutionnaire du prolétariat.
A propos des thèses de l’Exécutif de l’Internationale communiste
Les thèses qui en leur temps furent publiées dans la Pravda montrent clairement de quelle façon les "théoriciens" de l’idée du "front unique socialiste" comprennent cette tactique. Deux mots seulement sur l’expression "front unique". Chacun sait à quel point étaient "populaires" en Russie en 1917 les social-traîtres de tous les pays et en particulier Scheidemann, Noske et Cie. Les bolcheviks, les éléments de base du parti qui avaient peu d’expérience, criaient à chaque coin de rue : "Vous, traîtres perfides de la classe ouvrière, nous vous pendrons à des poteaux télégraphiques ! Vous portez la responsabilité du bain de sang international dans lequel vous avez noyé les travailleurs de tous les pays. Vous avez assassiné Rosa Luxemburg et Liebknecht. Les rues de Berlin, grâce à votre action violente, furent rouges du sang des travailleurs qui s’étaient soulevés contre l’exploitation et l’oppression capitalistes. Vous êtes les auteurs de la paix de Versailles ; vous avez porté d’innombrables blessures au mouvement prolétarien international, parce que vous le trahissez à chaque instant."
Il faut également ajouter qu’on n’a pas décidé de proposer aux ouvriers communistes le "front unique socialiste", c’est-à-dire un front unique avec Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting et Cie. Un tel front unique doit être d’une façon ou d’une autre masqué et c’est ainsi qu’il fut procédé. Les thèses ne sont pas simplement intitulées "le front unique socialiste", mais "thèses sur le front unique du prolétariat et sur l’attitude vis-à-vis des ouvriers appartenant à la Deuxième Internationale, à l’Internationale Deux et demi et celle d’Amsterdam, de même que vis-à-vis des ouvriers adhérant aux organisations anarchistes et syndicalistes". Pourquoi une sauce si longue ? Voyez-vous, le camarade Zinoviev lui-même qui, naguère encore, invitait à collaborer à l’enterrement de la Deuxième Internationale, invite maintenant à des noces avec elle. De là le titre à rallonge. En réalité, on a parlé d’accord non avec les ouvriers, mais avec les partis de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi. Tout ouvrier sait, même s’il n’a jamais vécu dans l’émigration, que les partis sont représentés par leur Comité central, là où siègent les Vandervelde, les Branting, les Scheidemann, les Noske et Cie. Ainsi, c’est avec eux également que s’établira l’accord. Qui est allé à Berlin à la Conférence des trois Internationales ? A qui l’Internationale communiste s’est-elle fiée corps et âme ? A Wels, à Vandervelde, etc.
Mais a-t-on cherché à obtenir une entente avec le KAPD, étant donné que le camarade Zinoviev soutient que là se trouvent les éléments prolétariens les plus précieux ? Non. Et pourtant le KAPD se bat pour organiser la conquête du pouvoir par le prolétariat.
Il est vrai que le camarade Zinoviev a affirmé dans les thèses qu’on ne vise pas à une fusion de l’Internationale communiste avec la Deuxième Internationale, à l’égard de laquelle il a rappelé la nécessité de l’autonomie organisationnelle : "L’autonomie absolue et l’indépendance totale d’exposer ses positions pour chaque parti communiste qui conclut tel ou tel accord avec les partis de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi". Les communistes s’imposent la discipline dans l’action mais ils doivent conserver le droit et la possibilité – non seulement avant et après mais si c’est nécessaire aussi durant l’action – de se prononcer sur la politique des organisations ouvrières sans exception. En soutenant le mot d’ordre "de l’unité maximale de toutes les organisations ouvrières dans toute action pratique contre le front capitaliste, les communistes ne peuvent pas renoncer à exposer leurs positions" (cf. les thèses du CC du Komintern pour la conférence du PCR de 1921).
Avant 1906, dans le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, il y eut deux fractions qui avaient autant d’autonomie que le prévoient les thèses du Komintern citées ci-dessus.
Discipline dans les pourparlers et autonomie de jugement sont formellement reconnues par les statuts du PCR (bolchevik) dans la vie interne du parti. On doit faire ce que la majorité a décidé et on peut seulement exercer le droit à la critique. Fais ce qu’on te commande, mais si tu es vraiment trop scandalisé et convaincu qu’on est en train de nuire à la révolution mondiale, tu peux, avant, pendant et après l’action, exprimer librement ta rage. Cela revient à renoncer aux actions autonomes (tout comme Vandervelde a signé le traité de Versailles et s’est compromis).
Dans ces mêmes thèses, l’Exécutif proposa le mot d’ordre de gouvernement ouvrier qui doit se substituer à la formule de la dictature du prolétariat. Qu’est-ce exactement qu’un gouvernement ouvrier ? C’est un gouvernement constitué par le Comité central réduit du parti ; la réalisation idéale de ces thèses se rencontre en Allemagne où le président Ebert est socialiste et où se forment des gouvernements avec son agrément. Même si cette formule n’est pas acceptée, les communistes devront appuyer par leur vote les premiers ministres et les présidents socialistes comme Branting en Suède et Ebert en Allemagne.
Voila comment nous nous représentons l’autonomie de critique : le président du Komintern, le camarade Zinoviev, entre au CC du Parti social-démocrate et, en y voyant Ebert, Noske, Scheidemann, se jette sur eux le poing levé en criant : "Perfides, traîtres de la classe ouvrière !" Ils lui sourient aimablement et s’inclinent bas devant lui. "Vous avez assassiné Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, les chefs du prolétariat allemand, nous vous pendrons à la potence !" Ils lui sourient encore plus aimablement et s’inclinent encore plus bas. Le camarade Zinoviev leur offre le front unique et propose de former un gouvernement ouvrier avec participation communiste. Ainsi, il troque le gibet contre le fauteuil ministériel et la colère contre la sympathie. Noske, Ebert, Scheidemann et Cie iront dans les assemblées ouvrières et raconteront que l’IC leur a consenti une amnistie et offert des postes ministériels à la place de la potence. Ceci pourtant à une condition, que les communistes reçoivent un ministère […] 6. Ils diront à toute la classe ouvrière que les communistes ont reconnu la possibilité de réaliser le socialisme en s’unissant avec eux et non contre eux. Et ils ajouteront : regardez un peu ces gens ! Ils nous pendaient et enterraient d’avance ; finalement ils sont venus à nous. Et bon, nous leur pardonnerons comme ils nous ont évidemment pardonné. Une amnistie mutuelle.
L’Internationale communiste a donné à la Deuxième Internationale une preuve de sa sincérité politique et elle a reçu une preuve de misérabilisme politique. Qu’y a-t-il en réalité à l’origine de ce changement ? Comment se fait-il que le camarade Zinoviev offre à Ebert, à Scheidemann et à Noske des fauteuils ministériels au lieu du gibet ? Il y a peu de temps il chantait l’oraison funèbre de la Deuxième Internationale et, à présent, il en ressuscite l’esprit. Pourquoi chante-t-il désormais ses louanges ? Verrons-nous vraiment sa résurrection et la réclamerons-nous réellement ?
Les thèses du camarade Zinoviev répondent effectivement à cette question : "la crise économique mondiale devient plus aiguë, le chômage s’accroît, le capital passe à l’offensive et manœuvre avec adresse ; le niveau de vie du prolétariat est compromis" Ainsi une guerre est inévitable. Il en découle que la classe ouvrière se dirige plus à gauche. Les illusions réformistes se détruisent. La large base ouvrière commence maintenant à apprécier le courage de l’avant-garde communiste... et de ce fait... on doit constituer le front unique avec Scheidemann. Et vraiment, c’est partir de très haut pour arriver bien bas.
Nous ne serions pas objectifs si nous ne rapportions pas encore quelques considérations fondamentales que le camarade Zinoviev avance pour défendre le front unique dans sa thèse. Le camarade Zinoviev fait une merveilleuse découverte : "On sait que la classe ouvrière lutte pour l’unité. Et comment y arriver sinon à travers un front unique avec Scheidemann ?". Tout ouvrier conscient qui, sensible aux intérêts de sa classe et de la révolution mondiale, peut se demander : la classe ouvrière a-t-elle commencé à lutter pour l’unité juste au moment où on affirme la nécessité du "front unique" ? Quiconque a vécu parmi les travailleurs, depuis que la classe ouvrière est entrée dans le champ de la lutte politique, connaît les doutes qui assaillent tout ouvrier : pourquoi les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires, les bolcheviks, les trudoviki (populistes) luttent-ils donc entre eux ? Tous désirent le bien du peuple. Et pour quels motifs se combattent-ils ? Tout ouvrier connaît ces doutes, mais quelle conclusion doit-on en tirer ? La classe ouvrière doit s’organiser en classe indépendante et s’opposer à toutes les autres. Nos préjugés petit-bourgeois doivent être surmontés ! Telle était alors la vérité et telle elle le reste aujourd’hui.
Dans tous les pays capitalistes où se présente une situation favorable à la révolution socialiste, nous devons préparer la classe ouvrière à la lutte contre le menchevisme international et les socialistes-révolutionnaires. Les expériences de la Révolution russe devront être prises en considération. La classe ouvrière mondiale doit s’enfoncer cette idée dans la tête, à savoir que les socialistes de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi sont et seront à la tête de la contre-révolution. La propagande du front unique avec les social-traîtres de toutes les nuances tend à faire croire qu’eux aussi combattent en définitive la bourgeoisie, pour le socialisme et non contre. Mais seule la propagande ouverte, courageuse, en faveur de la guerre civile et de la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière peut intéresser le prolétariat à la révolution.
L’époque où la classe ouvrière pouvait améliorer sa propre condition matérielle et juridique à travers les grèves et l’entrée au parlement est définitivement passée. On doit le dire ouvertement. La lutte pour les objectifs les plus immédiats est une lutte pour le pouvoir. Nous devons démontrer à travers notre propagande que, bien que nous ayons souvent appelé à la grève, nous n’avons pas réellement amélioré notre condition d’ouvriers, mais vous, travailleurs, vous n’avez pas encore dépassé la vieille illusion réformiste et menez une lutte qui vous affaiblit vous-mêmes. Nous pourrons bien être solidaires de vous dans les grèves, mais nous reviendrons toujours vous dire que ces mouvements ne vous libéreront pas de l’esclavage, de l’exploitation et de la morsure du besoin inassouvi. L’unique voie qui vous conduira à la victoire est la prise du pouvoir par vos mains calleuses.
Mais ce n’est pas tout. Le camarade Zinoviev a décidé de motiver solidement la tactique d’un front uni : nous sommes habitués à comprendre la notion relative à "l’époque de la révolution sociale" comme le moment actuel, ce qui veut dire que la révolution sociale est à l’ordre du jour ; mais en pratique il se révèle que "l’époque de la révolution sociale est un processus révolutionnaire à long terme". Zinoviev conseille de retomber sur terre et d’attirer les masses ouvrières. Mais nous avions déjà attiré les masses en nous unissant de différentes façons avec les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires (SR) depuis 1903 jusqu’en 1917 et, comme on le voit, nous avons fini par triompher, c’est pourquoi, pour vaincre Ebert, Scheidemann et Cie, il nous faut... (mais non, pas les combattre…) nous unir à eux.
Nous ne discuterons pas si l’époque de la révolution sociale est un processus de longue durée ou non, et si oui, combien de temps prendra-t-il, car cela ressemblerait à une dispute de moines sur le sexe des anges ou à une discussion visant à trouver à partir de quel cheveu perdu commence la calvitie. Nous voulons définir la notion même de "l’époque de la révolution sociale" Qu’est-ce que c’est ? С’est d’abord l’état des forces productives matérielles qui commencent à être antinomiques à la forme de propriété. Est-ce qu’il y a des conditions matérielles nécessaires pour que la révolution sociale soit inévitable ? Oui. Est-ce qu’il manque quelque chose ? Il manque des conditions subjectives, personnelles : que la classe ouvrière des pays capitalistes avancés se rende compte de la nécessite de cette révolution, non dans un avenir lointain, mais dès aujourd’hui, dès demain. Et pour cela, que doivent faire les ouvriers avancés, l’avant-garde qui s’en rend déjà compte ? Sonner le tocsin, appeler à la bataille en utilisant dans leur propagande en faveur de la guerre civile ouverte toute sorte de choses (les lock-out, les grèves, l’imminence de la guerre, l’abaissement du niveau de vie) et en préparant, en organisant la classe ouvrière pour une lutte immédiate.
Dit-on que le prolétariat russe a triomphé parce qu’il s’était uni avec les mencheviks et les SR ? C’est une baliverne. Le prolétariat russe a vaincu la bourgeoisie et les propriétaires fonciers grâce à sa lutte acharnée contre les mencheviks et les SR.
Dans un de ses discours sur la nécessité d’une tactique de front uni, le camarade Trotski dit que nous avons triomphé, mais qu’il faut analyser comment nous nous sommes battus. Il prétend que nous avons marché en front uni avec les mencheviks et les SR parce que nous, les mencheviks et les SR avons siégé dans les mêmes conseils. Si la tactique du front uni consiste à siéger dans une même institution, alors le chef des travaux forcés et les bagnards font eux aussi un front uni : les uns et les autres sont au bagne.
Nos partis communistes siègent dans les parlements – est-ce que ça veut dire qu’ils font un front uni avec tous les députés ? Les camarades Trotski et Zinoviev devraient raconter aux communistes du monde entier que les bolcheviks eurent raison de ne pas participer au "pré-parlement" convoqué par le socialiste-révolutionnaire Kerenski en août 1917, non plus qu’au Gouvernement provisoire dirigé par les socialistes (ce qui fut une leçon utile), au lieu de dire des choses plutôt douteuses sur un soi-disant front uni des bolcheviks, des mencheviks et des SR.
Nous avons déjà évoqué l’époque où les bolcheviks avaient fait un front uni avec la bourgeoisie. Mais quelle était cette époque ? Avant 1905. Oui, les bolcheviks ont prôné le front uni avec tous les socialistes – mais quand ? Avant 1917. Et en 1917, lorsqu’il s’agissait de lutter pour le pouvoir de la classe ouvrière, les bolcheviks se sont unis avec tous les éléments révolutionnaires, des SR de gauche aux anarchistes de toute espèce pour combattre à main armée les mencheviks et les SR qui, eux, faisaient un front uni avec la soi-disant "démocratie", c’est-à-dire avec la bourgeoisie et les propriétaires fonciers. En 1917, le prolétariat russe se plaça à la pointe de "l’époque de la révolution sociale" dans laquelle vit déjà le prolétariat des pays capitalistes avancés. Et dans laquelle il faut utiliser la tactique victorieuse du prolétariat russe de 1917 tout en tenant compte des leçons des années qui s’ensuivirent : la résistance acharnée de la part de la bourgeoisie, des SR et des mencheviks face à la classe ouvrière russe qui a pris le pouvoir. Ce sera cette tactique qui unira la classe ouvrière des pays capitalistes avancés, car cette classe est en train de "se débarrasser des illusions réformistes" ; ce ne sera pas le front uni avec la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi qui lui apportera la victoire, mais la guerre contre elles. Voilà le mot d’ordre de la révolution sociale mondiale future.
La question du front uni dans le pays où le prolétariat est au pouvoir (démocratie ouvrière)
Tous les pays où l’assaut socialiste a déjà eu lieu, où le prolétariat est la classe dirigeante, exigent une approche chaque fois différente. À noter qu’on ne peut pas élaborer une tactique valable pour toutes les étapes du processus révolutionnaire dans chaque pays différent, ainsi qu’une même politique pour tous les pays au même stade du processus révolutionnaire.
Si on se souvient de notre propre histoire (pour ne pas aller loin), celle de notre lutte, on verra qu’en combattant nos ennemis, nous avons utilisé des procédés bien différents.
En 1906 et les années suivantes, c’étaient les "trois piliers" : la journée de travail de 8 heures, la réquisition des terres et la république démocratique. Ces trois piliers comprenaient la liberté de parole et de presse, d’association, de grève et de syndicat, etc.
En février 1917 ? "À bas l’autocratie, vive l’Assemblée constituante !". C’est le cri des bolcheviks.
Pourtant, en avril-mai, tout s’oriente dans un autre sens : il y a la liberté d’association, de presse et de parole, mais la terre n’est pas réquisitionnée, les ouvriers ne sont pas au pouvoir ; on lance alors le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux conseils !"
A cette époque, toute tentative de la bourgeoisie de nous coudre la bouche provoquait une résistance acharnée : "Vive la liberté de parole, de presse, d’association, de grève, de syndicat, de conscience ! Empare-toi de la terre ! Contrôle ouvrier de la production ! De la paix ! Du pain ! Et de la liberté ! Vive la guerre civile !"
Mais voilà Octobre et la victoire. Le pouvoir est à la classe ouvrière. L’ancien mécanisme étatique de l’oppression est complètement détruit, le nouveau mécanisme de l’émancipation est structuré en conseils de députés ouvriers, de soldats, etc.
Est-ce qu’à cette époque le prolétariat a dû proclamer le mot d’ordre de la liberté de presse, de parole, d’association, de coalition ? A-t-il pu permettre à tous ces messieurs, des monarchistes aux mencheviks et SR, de prôner la guerre civile ? Plus que ça, a-t-il pu, en tant que classe dirigeante, accorder la liberté de parole et de presse à quelques-uns de son milieu qui auraient aussi prôné la guerre civile ? Non et encore non !
Toute propagande pour la guerre civile contre le pouvoir prolétarien qui venait d’être organisé aurait été un acte contre-révolutionnaire en faveur des exploiteurs, des oppresseurs. Plus "socialiste" aurait été cette propagande, plus de mal aurait-elle pu faire. Et pour cette raison, il était nécessaire de procéder à "l’élimination la plus sévère, impitoyable de ces propagandistes de la famille prolétarienne même".
Mais voilà le prolétariat capable de supprimer la résistance des exploiteurs, de s’organiser en tant que pouvoir unique dans le pays, de se construire en autorité nationale reconnue même par tous les gouvernements capitalistes. Une nouvelle tâche s’impose à lui : organiser l’économie du pays, créer les biens matériels autant que possible. Et cette tâche est aussi immense que la conquête du pouvoir et la suppression de la résistance des exploiteurs. Plus que ça, la conquête du pouvoir et la suppression de la résistance des exploiteurs ne sont pas des objectifs en soi, mais des moyens pour aboutir au socialisme, à plus de bien-être et de liberté que sous le capitalisme, sous la domination d’une classe et l’oppression de l’autre.
Pour résoudre ce problème, la forme d’organisation et les moyens d’action utilisés pour supprimer les oppresseurs ne marchent plus, de nouvelles approches sont nécessaires.
Vu nos faibles ressources, vu les ravages horribles faits par les guerres impérialiste et civile, s’impose la tâche de créer des valeurs matérielles pour montrer en pratique à la classe ouvrière et aux groupes alliés parmi la population la force attractive de cette société socialiste créée par le prolétariat : montrer qu’elle est bonne non seulement parce qu’il n’y a plus de bourgeois, de gendarmes et autres parasites, mais parce que le prolétariat s’y sent maître, libre et sûr que toutes les valeurs, tous les biens, chaque coup de marteau sert à améliorer la vie, la vie des indigents, des opprimés, des humiliés sous le capitalisme, que ce n’est pas le royaume de la faim, mais celui de l’abondance jamais vue nulle part ailleurs. Voilà une tâche qui reste à faire par le prolétariat russe, tâche qui surpasse celles qui la précèdent.
Oui, elle les surpasse, car les deux premières tâches, la conquête du pouvoir et l’éradication de la résistance des oppresseurs (compte tenu de la haine acharnée du prolétariat et de la paysannerie envers les propriétaires fonciers et les bourgeois), sont certainement grandes, mais moins importantes que le troisième but. Et aujourd’hui tout ouvrier pourrait se demander : pourquoi a-t-on fait tout ça ? Fallait-il en faire tant ? Fallait-il verser le sang ? Fallait-il subir des souffrances sans fin ? Qui résoudra ce problème ? Qui sera l’artisan de notre fortune ? Quelle organisation le fera ?
Il n’est pas de sauveur suprême,
Ni dieu, ni césar, ni tribun ;
Producteurs,
sauvons-nous nous-mêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour résoudre ce problème, il faut une organisation qui représente une volonté unie de tout le prolétariat. Il faut des conseils de députés ouvriers en tant qu’organisations industrielles présentes dans toutes les entreprises reprises à la bourgeoisie (nationalisées) qui devront soumettre à leur influence les couches immenses des compagnons de route.
Mais que sont actuellement nos conseils ? Ressemblent-ils même un tout petit peu aux conseils de députés ouvriers, c’est-à-dire aux "noyaux de base du pouvoir d’Etat dans les fabriques et les usines" ? Ressemblent-ils aux conseils du prolétariat qui représentent sa volonté unie de vaincre ? Ils sont vidés de leur sens, d’une base industrielle.
La longue guerre civile qui mobilisait l’attention de tout le prolétariat vers les objectifs de destruction, de résistance aux oppresseurs, a ajourné, effacé toutes les autres tâches et – sans que le prolétariat s’en aperçoive – a modifié son organisation, les conseils. Les conseils de députés ouvriers dans les usines sont morts. Vive les conseils de députés ouvriers !
Et n’est-ce pas la même chose avec la démocratie prolétarienne en général ? Est-ce que nous devons avoir une attitude similaire envers la liberté de parole et de presse pour le prolétariat qu’à l’époque de la guerre civile acharnée, de la révolte des esclavagistes ? Est-ce que le prolétariat, qui a pris le pouvoir, qui a su se défendre de mille ennemis terribles, ne peut pas se permettre d’exprimer ses pensées maintenant, en s’organisant pour surmonter des difficultés immenses dans la production, en dirigeant cette production et le pays entier ?
Que les bourgeois soient réduits au silence, certes, mais qui osera disputer le droit de libre parole d’un prolétaire qui a défendu son pouvoir sans ménager son sang ?
Qu’est-ce pour nous que la liberté de parole et de presse, est-ce un dieu, un fétiche ?
Nous ne nous faisons d’idole
Ni sur la terre, ni dans les cieux
Et ne nous prosternons
devant personne !
Pour nous, il n’existe aucune véritable démocratie, aucune liberté absolue en tant que fétiche ou idole, et même aucune véritable démocratie prolétarienne.
La démocratie n’était et ne sera jamais qu’un fétiche pour la contre-révolution, la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres, les SR, les mencheviks de tous les pays du monde. Pour eux, elle n’est qu’un moyen d’obtenir leurs buts de classe.
Avant 1917, la liberté de parole et de presse pour tous les citoyens fut notre revendication de programme. En 1917, nous avons conquis ces libertés et les avons utilisées pour la propagande et l’organisation du prolétariat et de ses compagnons de route, dont des intellectuels et des paysans. Après avoir organisé une force capable de vaincre la bourgeoisie, nous, les prolétaires, nous nous sommes mis au combat et avons pris le pouvoir. En vue d’empêcher la bourgeoisie d’utiliser la parole et la presse pour mener la guerre civile contre nous, nous avons refusé la liberté de parole et de presse non seulement aux classes ennemies, mais aussi à une partie du prolétariat et de ses compagnons de route – jusqu’au moment où la résistance de la bourgeoisie sera brisée en Russie.
Mais avec l’appui de la majorité des travailleurs, nous en avons fini avec la résistance de la bourgeoisie ; pouvons-nous maintenant nous permettre de nous parler entre nous, les prolétaires ?
La liberté de parole et de presse avant 1917, c’est une chose, en 1917 une autre, en 1918-20 une troisième et en 1921-22, un quatrième type d’attitude de notre parti envers cette question.
Mais se peut-il que les ennemis du pouvoir soviétique utilisent ces libertés pour le renverser ?
Peut-être ces libertés seraient-elles utiles et nécessaires en Allemagne, en France, en Angleterre, etc., si ces pays étaient dans la même phase du processus révolutionnaire, car il y a là-bas une classe ouvrière nombreuse et il n’y a pas de paysannerie immense. Mais chez nous, ce mince prolétariat qui a survécu aux guerres et au désastre économique est usé, affamé, a froid, est saigné à blanc, exténué ; est-il difficile de le pousser à sa perte, à la voie menant au renversement du pouvoir soviétique ? Outre le prolétariat, il existe aussi en Russie une grande partie de la paysannerie qui est loin de l’opulence, qui vit péniblement. Qui garantit que la liberté de parole ne sera pas utilisée pour former une force contre-révolutionnaire avec cette paysannerie ? Non, quand nous aurons nourri un peu l’ouvrier, donné quelque chose au paysan, alors on verra ; mais maintenant il ne faut pas y songer. Tels sont à peu près les raisonnements des communistes bien-pensants.
Qu’il nous soit permis de poser une question : comment voulez-vous résoudre la grande tâche de l’organisation de l’économie sociale sans le prolétariat ? Ou bien voulez-vous la résoudre avec un prolétariat qui dise oui et amen chaque fois que le veulent ses bons pasteurs ? En avez-vous besoin ?
"Toi ouvrier, et toi paysan, restez tranquilles, ne protestez pas, ne raisonnez pas parce que nous avons de braves types, qui sont aussi des ouvriers et des paysans à qui nous avons confié le pouvoir et qui l’utilisent de façon telle que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes soudainement arrivés dans le paradis socialiste". Parler ainsi signifie avoir foi dans les individus, dans les héros, non pas dans la classe, parce que cette masse grise aux idéaux médiocres (du moins le pensent ainsi les chefs) n’est rien de plus qu’un matériau avec lequel nos héros, les fonctionnaires communistes, construiront le paradis communiste. Nous ne croyons pas aux héros et faisons appel à tous les prolétaires afin qu’ils n’y croient pas. La libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Oui, nous, prolétaires, sommes épuisés, affamés, nous avons froid et nous sommes las. Mais les problèmes que nous avons devant nous, aucune classe, aucun groupe du peuple ne peut les résoudre pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Si vous pouvez nous démontrer que les tâches qui nous attendent, à nous ouvriers, peuvent être accomplies par une "intelligence", même si c’est une intelligence communiste, alors nous serons d’accord pour lui confier notre destin de prolétaires. Mais personne ne peut nous démontrer cela. Pour cette raison, il n’est pas du tout juste de soutenir que le prolétariat est fatigué et n’a pas besoin de savoir ni de décider quoi que ce soit.
Si la situation en Russie est différente des années 1918-20, différente doit être aussi notre attitude sur cette question.
Quand vous, camarades communistes bien-pensants, vous voulez casser la gueule à la bourgeoisie, c’est bien ; mais le problème, c’est que vous levez la main sur la bourgeoisie et que c’est nous, les prolétaires, qui avons les côtes cassés et la bouche pleine de sang.
En Russie, la classe ouvrière communiste n’existe pas. Il existe simplement une classe ouvrière dans laquelle nous pouvons trouver des bolcheviks, des anarchistes, des socialistes-révolutionnaires et d’autres (qui n’appartiennent pas à ces partis mais tirent d’eux leurs orientations). Comment doit-on entrer en rapport avec elle ? Avec les "cadets" démocrates constitutionnels bourgeois, professeurs, avocats, docteurs, aucune négociation ; pour eux, un seul remède : le bâton. Mais avec la classe ouvrière c’est une toute autre chose. Nous ne devons pas l’intimider, mais l’influencer et la guider intellectuellement. Pour cela aucune violence, mais la clarification de notre ligne de conduite, de notre loi.
Oui, la loi est la loi, mais pas pour tous. À la dernière Conférence du parti, lors de la discussion sur la lutte contre l’idéologie bourgeoise, il apparut qu’à Moscou et à Petrograd, on compte jusqu’à 180 maisons d’édition bourgeoises et on entend les combattre à 90 %, selon les déclarations de Zinoviev, non avec des mesures répressives mais à l’aide d’une influence ouvertement idéologique. Mais en ce qui nous concerne comment veut-on nous "influencer" ? Zinoviev sait comment on a cherché à influencer certains d’entre nous. Si on nous concédait au moins la dixième partie de la liberté dont jouit la bourgeoisie !
Qu’en pensez-vous, camarades ouvriers ? Ce ne serait pas mal du tout, n’est ce pas ? Donc de 1906 à 1917 on a eu une tactique, en 1917 avant octobre une autre, depuis octobre 1917 jusqu’à fin 1920 une troisième et, depuis le commencement de 1921, une quatrième. […]
(À suivre)
1. NDLR :Komintern, nom russe de la Troisième Internationale ou Internationale communiste (IC).
2 NDLR : Les socialiste-révolutionnaires de gauche ("SR de gauche"), favorables aux soviets, se séparent du parti socialiste-révolutionnaire en septembre 1917.
3 NDLR : Lors du Congrès des Soviets du 25 octobre 1917, les 110 délégués mencheviques, minoritaires (sur 673 délégués), quittèrent la salle au moment de la ratification de la révolution d'Octobre, pour dénoncer un "coup d'État bolchevique".
4. NDLR : il s'agit, rappelons-le, de la KAI (Internationale communiste ouvrière, 1922-24) fondée à l’initiative du KAPD, à ne pas confondre avec la IVe Internationale trotskiste.
5 NDLR : L’Union internationale des partis socialistes, qu’on appelait l’Internationale Deux et demi, "parce qu'elle se situait entre la deuxième et la troisième". Lire à ce propos la critique faite à ce regroupement dans Moscou sous Lénine d’Alfred Rosmer, dans le chapitre "Les délégués des trois internationales à Berlin [146]".
6 NDLR Ici, comme à un autre endroit du texte, les symboles […] signifient qu'un un court passage que nous ne sommes pas parvenus à interpréter a été supprimé.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
Revue Internationale 2011 - n° 144 - 147
- 3213 lectures
Revue Internationale n° 144 - 1er trimestre 2011
- 1938 lectures
Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie.
L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe
Les grèves et les manifestations de septembre, octobre et novembre en France qui se sont déroulées à l’occasion de la réforme des retraites ont témoigné d’une forte combativité dans les rangs des prolétaires, même si elles n’ont pas réussi à faire reculer la bourgeoisie.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique internationale de notre classe qui retrouve progressivement le chemin de la lutte, chemin jalonné en 2009 et 2010 par la révolte des jeunes générations de prolétaires contre la misère en Grèce et par la volonté d'étendre leur lutte des ouvriers de Tekel en Turquie en s'opposant de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Ainsi, les étudiants se sont largement mobilisés contre le chômage et la précarité que leur réserve le monde capitaliste comme en Grande-Bretagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Aux États-Unis, bien que restant enfermées dans le carcan syndical, plusieurs grèves d'envergure se sont succédées en divers points du pays depuis le printemps 2010 pour résister aux attaques : dans le secteur de l'éducation en Californie, infirmiers à Philadelphie et Minneapolis-Saint-Louis, ouvriers du bâtiment à Chicago, secteur agro-alimentaire dans l'État de New York, enseignants dans l'Illinois, ouvriers de Boeing et d'une usine Coca-Cola à Bellevue (État de Washington), dockers dans le New Jersey et à Philadelphie.
A l'heure où nous mettons sous presse, au Maghreb, en particulier en Tunisie, la colère ouvrière accumulée depuis des décennies s'est propagée comme une traînée de poudre après l'immolation publique, le 17 décembre, d'un jeune chômeur diplômé qui s'était vu confisquer par la police municipale de Sidi Bouzid, au centre du pays, son étal de fruits et légumes, son unique gagne-pain. Des manifestations spontanées de solidarité se sont propagées à travers tout le pays face à l'ampleur du chômage et à la hausse brutale des produits alimentaires de première nécessité. La répression brutale et féroce de ce mouvement social a fait plusieurs dizaines de morts, la police tirant à balles réelles sur les manifestants désarmés. Cela n'a fait que renforcer l'indignation et la détermination des prolétaires pour réclamer d'abord du travail, du pain et un peu de dignité, puis le départ de Ben Ali. "On n'a plus peur", scandaient les manifestants en Tunisie. Les enfants de prolétaires en tête ont utilisé les réseaux d'Internet ou leur téléphone portable comme armes de combat, pour montrer et dénoncer la répression, et comme moyens de communication et d'échange assurant ainsi un lien entre eux mais aussi avec leurs famille ou amis en dehors du pays, notamment en Europe, brisant ainsi partiellement la conspiration du silence de toutes les bourgeoisies et de leurs médias. Partout, nos exploiteurs se sont efforcés de masquer la nature de classe de ce mouvement social, cherchant à le dénaturer tantôt en le présentant comme des émeutes comme celles de 2005 en France ou comme l'œuvre de casseurs et de pillards, tantôt en le faisant passer pour une "lutte héroïque et patriotique du peuple tunisien" pour la "démocratie" animée par des intellectuels diplômés et les "classes moyennes".
La crise économique et la bourgeoisie portent leurs coups de boutoir partout dans le monde. En Algérie, en Jordanie, en Chine, d'autres mouvements sociaux similaires face à l'enfoncement dans la misère ont été durement réprimés. Cette situation doit pousser les prolétaires des pays centraux, plus expérimentés, à prendre conscience de l'impasse et de la faillite dans laquelle le système capitaliste entraîne partout l'humanité et à apporter leur solidarité à leurs frères de classe en développant leurs luttes. D'ailleurs les travailleurs commencent peu à peu à réagir et à refuser l’austérité, la paupérisation et les "sacrifices" imposés.
Pour l’instant, cette riposte est nettement en deçà des attaques que nous subissons. C’est incontestable. Mais une dynamique est enclenchée, la réflexion ouvrière et la combativité vont continuer de se développer. Pour preuve, ce fait nouveau : des minorités cherchent aujourd’hui à s’auto-organiser, à contribuer activement au développement de luttes massives et à se dégager de l’emprise syndicale.
La mobilisation contre la réforme des retraites en France
Le mouvement social de l'automne dernier en France est pleinement révélateur de cette dynamique enclenchée par le précédent mouvement contre le CPE 1.
C’est par millions que les ouvriers et employés de tous les secteurs sont descendus régulièrement dans la rue en France. Parallèlement, depuis la rentrée de septembre, des mouvements de grève plus ou moins radicaux sont apparus ici et là, exprimant un mécontentement profond et grandissant. Cette mobilisation constitue le premier combat d’envergure en France depuis la crise qui a secoué le système financier mondial en 2007-2008. Elle n’est pas seulement une réponse à la réforme des retraites elle-même mais, par son ampleur et sa profondeur, elle est une réponse claire à la violence des attaques subies ces dernières années. Derrière cette réforme et les autres attaques simultanées ou en préparation, se manifeste le refus grandissant d'un enfoncement aggravé de tous les prolétaires et d‘autres couches de la population dans la pauvreté, la précarité et la misère la plus sombre. Et avec l’approfondissement inexorable de la crise économique, ces attaques ne sont pas près de s’arrêter. Il est clair que cette lutte en annonce d’autres et qu’elle s’inscrit en droite ligne de celles qui se sont développées en Grèce et en Espagne face aux mesures drastiques d’austérité.
Cependant, malgré la massivité de la riposte, le gouvernement en France n’a pas cédé. Au contraire, il est resté intraitable, affirmant sans relâche et malgré la pression de la rue sa ferme détermination à faire passer son attaque sur les retraites, se permettant de surcroît de répéter avec cynisme qu’elle était "nécessaire", au nom de la "solidarité" entre les générations.
Pourquoi cette mesure qui frappe au cœur toutes nos conditions de vie et de travail, et alors que l’ensemble de la population a exprimé amplement et puissamment son indignation et son opposition, est-elle passée malgré tout ? Pourquoi cette mobilisation massive n’a-t-elle pas réussi à faire reculer le gouvernement ? Parce que le gouvernement avait la certitude du contrôle de la situation par les syndicats, lesquels ont toujours accepté, comme également les partis de gauche, le principe d’une "réforme nécessaire" des retraites ! On peut faire la comparaison avec le mouvement de 2006 contre le CPE. Ce mouvement, que les médias avaient traité au début avec le plus grand mépris comme une "révolte étudiante" sans lendemain, a fini par faire reculer le gouvernement qui n’a eu d’autre recours que de retirer le CPE.
Où est la différence ? Elle réside d’abord en ceci que les étudiants s’étaient organisés en assemblées générales ouvertes à tous, sans distinction de catégories ou de secteurs, du public ou du privé, au travail ou au chômage, travailleurs précaires, etc. Cet élan de confiance dans les capacités de la classe ouvrière et dans sa force, de profonde solidarité dans la lutte, avait créé une dynamique d’extension du mouvement imprimant à celui-ci une massivité impliquant toutes les générations. Car, tandis que, d’un côté, les assemblées générales voyaient se dérouler des débats et des discussions les plus larges, ne restant pas cantonnées au seul problème des étudiants, de l’autre côté, on voyait au fil des manifestations les travailleurs eux-mêmes se mobiliser de plus en plus avec les étudiants et de nombreux lycéens.
Mais c’est aussi parce que la détermination et l’esprit d’ouverture des étudiants, tout en entraînant des fractions de la classe ouvrière vers la lutte ouverte, n’arrivaient pas à être battus en brèche par les manœuvres des syndicats. Au contraire, alors que ces derniers, notamment la CGT, s’efforçaient de se placer en tête des manifestations pour en prendre le contrôle, c’est à plusieurs reprises que les étudiants et les lycéens ont débordé les banderoles syndicales pour affirmer clairement qu’ils ne voulaient pas se voir ravaler en arrière-plan d’un mouvement dont ils étaient à l’initiative. Mais surtout ils affirmaient leur volonté de garder le contrôle eux-mêmes de la lutte, avec la classe ouvrière, et de ne pas se laisser avoir par les centrales syndicales.
En fait, un des aspects qui inquiétait le plus la bourgeoisie, c’est que les formes d’organisation que s’étaient données les étudiants en lutte, ces assemblées générales souveraines, élisant leurs comités de coordination et ouvertes à tous, dans lesquelles les syndicats étudiants faisaient souvent profil bas, ne fassent tâche d’huile parmi les salariés si ces derniers entraient en grève. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au cours de ce mouvement, Thibault 2 a affirmé à plusieurs reprises que les salariés n’avaient pas de leçons à recevoir des étudiants sur comment s’organiser. D'après lui, si ces derniers avaient leurs assemblées générales et leurs coordinations, les salariés avaient leurs syndicats en qui ils avaient confiance. Dans un tel contexte de détermination chaque fois réaffirmée et de danger d’un débordement des syndicats, il fallait que l'État français lâche du lest car c’est le dernier rempart de protection de la bourgeoisie contre l’explosion de luttes massives qui risquait d’être battu en brèche.
Avec le mouvement contre la réforme des retraites, les syndicats, soutenus activement par la police et les médias, ont fait les efforts nécessaires pour tenir le haut du pavé, en sentant venir le vent et s’organiser en conséquence.
D'ailleurs le mot d'ordre des syndicats n'était pas "retrait de l'attaque sur les retraites" mais "aménagement de la réforme". Ils appelaient à se battre pour une meilleure négociation État-Syndicats et pour une réforme plus "juste", plus "humaine". On les a vus jouer dès le début la division malgré l'apparente unité de l'intersyndicale clairement constituée pour faire barrage aux "risques" de débordements ; le syndicat FO 3 organisait au début ses manifestations dans son coin, tandis que l’intersyndicale qui organisait la journée d’action du 23 mars préparait le "ficelage" de la réforme, après tractations avec le gouvernement, en programmant deux autres journées d’action le 26 mai, et surtout le 24 juin, à la veille des vacances d’été. On sait qu’habituellement une journée d’action, à cette époque de l’année, signe le coup de grâce pour la classe ouvrière lorsqu’il s’agit de faire passer une attaque majeure. Pourtant, cette dernière journée d’action a montré une mobilisation inattendue, avec plus du double d’ouvriers, de chômeurs, de précaires, etc., dans les rues. Et, alors qu’une morosité, largement soulignée par la presse, avait marqué les deux premières journées d’action, la colère et le ras-le-bol étaient au rendez-vous du 24 juin où le succès de la mobilisation a regonflé le moral du prolétariat. L'idée qu'une lutte d'ampleur est possible gagne du terrain. Les syndicats sentent évidemment eux aussi le vent tourner, ils savent que la question "Comment lutter ?" trotte dans les têtes. Ils décident donc d'occuper immédiatement le terrain et les esprits, il n'est pas question pour eux que les prolétaires se mettent à penser et à agir par eux-mêmes, en dehors de leur contrôle. Ils décident donc d'appeler à une nouvelle journée d'action pour le 7 septembre, dès le retour des congés d'été. Et pour être bien sûrs d'endiguer le mouvement de réflexion, ils vont jusqu'à faire passer en pleines vacances d'été des avions au-dessus des plages tirant des banderoles publicitaires appelant à la manifestation du 7 !
Pour leur part, les partis de gauche, qui étaient pourtant bien d’accord eux aussi sur l’impérieuse nécessité d’attaquer la classe ouvrière sur la question des retraites, sont venus se greffer à la mobilisation afin de ne pas se discréditer totalement.
Mais un autre événement, un fait divers, vient durant l'été alimenter la colère ouvrière : "l’affaire Woerth" (il s'agit d'une connivence entre les hommes politiques actuellement au pouvoir et la plus riche héritière du capital français, Madame Bettencourt, patronne du groupe L'Oréal, sur fond de fraudes fiscales et arrangements illégaux en tous genres). Or, Éric Woerth n'est autre que le ministre chargé de la réforme des retraites. Le sentiment d'injustice est total : la classe ouvrière doit se serrer la ceinture pendant que les riches et les puissants mènent "leurs petites affaires". C’est donc sous la pression de ce mécontentement ouvert et de la prise de conscience grandissante des implications de cette réforme sur nos conditions de vie que se présente la journée d’action du 7 septembre, obligeant cette fois-ci les syndicats à entonner le credo de l’unité d'action. Depuis, pas un syndicat n’a manqué à l’appel des journées d’action qui ont regroupé dans les manifestations environ trois millions de travailleurs à plusieurs reprises. La réforme des retraites devient le symbole de la dégradation brutale des conditions de vie.
Mais cette unité de "l’intersyndicale" a constitué un leurre pour la classe ouvrière. Elle visait en fait à lui faire croire que les syndicats étaient déterminés à organiser une offensive d’ampleur contre la réforme et qu’ils s’en donnaient les moyens avec des journées d’action à répétition dans lesquelles on pouvait voir et entendre à satiété leurs leaders, bras dessus, bras dessous, égrener leurs discours sur la "poursuite" du mouvement et autres mensonges. Ce qu’ils redoutaient par-dessus tout, c’est que les travailleurs sortent du carcan syndical et qu’ils s’organisent par eux-mêmes. C’est ce que disait Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui faisait "passer un message" au gouvernement dans une interview au journal le Monde du 10 septembre : "On peut aller vers un blocage, vers une crise sociale d’ampleur. C’est possible. Mais ce n’est pas nous qui avons pris ce risque", donnant l’exemple suivant pour mieux affirmer où se trouvait l’enjeu auquel étaient confrontés les syndicats : "On a même trouvé une PME sans syndicat où 40 salariés sur 44 ont fait grève. C’est un signe. Plus l’intransigeance dominera, plus l’idée de grèves reconductibles gagnera les esprits."
En clair, si les syndicats ne sont pas là, les ouvriers s’organisent eux-mêmes et non seulement décident réellement de ce qu’ils veulent faire mais risquent de le faire massivement. Et c’est contre quoi les centrales syndicales, et particulièrement la CGT et SUD 4, se sont attelées avec un zèle exemplaire : occuper le terrain sur la scène sociale et dans les médias, tout en empêchant avec la même résolution sur le terrain toute réelle expression de solidarité ouvrière. En bref, un battage à tout crin d’une part, et de l’autre une activité visant à stériliser et entraîner le mouvement dans de fausses alternatives, afin de créer la division, la confusion, et mieux le mener à la défaite.
Le blocage des raffineries de pétrole en est un exemple des plus évidents. Alors que les ouvriers de ce secteur, dont la combativité était déjà très vive, avaient la volonté grandissante de manifester leur solidarité envers l’ensemble de la classe ouvrière contre la réforme des retraites, ouvriers par ailleurs particulièrement confrontés à des mesures drastiques de réductions de personnels, la CGT a fait en sorte de transformer cet élan de solidarité en grève-repoussoir. Ainsi, le blocage des raffineries n’a jamais été décidé dans de véritables assemblées générales, où les travailleurs pouvaient exprimer réellement leur point de vue, mais il a été décidé suite à des manœuvres dont les leaders syndicaux sont spécialistes et qui ont fait adopter, en pourrissant la discussion, des actions stérilisantes. Cependant, malgré cet enfermement verrouillé par les syndicats, certains ouvriers de ce secteur ont cherché à créer des contacts et des liens avec des ouvriers d’autres secteurs. Mais, globalement pris dans l’engrenage du "blocage jusqu’au bout", la plupart des ouvriers des raffineries se sont vu piégés dans une logique syndicale d’enfermement dans l’usine, véritable poison utilisé contre l’élargissement du combat. En effet, bien que les ouvriers des raffineries avaient pour objectif de renforcer le mouvement, d’en être un des bras armés, afin de faire reculer le gouvernement, le blocage des dépôts, tel qu’il s’est déroulé sous la houlette syndicale, s’est surtout révélé être une arme de la bourgeoisie et de ses syndicats contre les ouvriers. Non seulement pour isoler ceux des raffineries, mais pour rendre leur grève impopulaire, en créant un vent de panique et en agitant la menace d’une pénurie de carburant généralisée ; la presse a abondamment déversé son fiel contre ces "preneurs d’otages empêchant les gens de se rendre à leur travail ou de partir en congés". Mais c’est aussi physiquement que les travailleurs de ce secteur se sont trouvés isolés ; alors même qu’ils voulaient contribuer par la lutte solidaire à la construction d’un rapport de forces favorable au retrait de la réforme, ce blocage particulier s’est en fait retourné contre eux et contre l’objectif qu’ils s’étaient donné initialement.
Il y a eu de nombreuses actions syndicales similaires, dans certains secteurs comme les transports, et de préférence dans des régions peu ouvrières, car il fallait à tout prix pour les syndicats prendre le moins de risques possibles d’extension et de mise en œuvre active de la solidarité. Il leur fallait faire semblant, pour la galerie, d’orchestrer les luttes les plus radicales et de jouer la partition de l’unité syndicale dans les manifestations, tout en pourrissant en réalité la situation.
Partout, on a donc vu les syndicats, réunis dans une "intersyndicale" pour mieux promouvoir le simulacre de l’unité, mettre en œuvre des semblants d’assemblées générales, sans véritable débat, enfermées dans les préoccupations les plus corporatistes, tout en affichant publiquement la prétendue volonté de se battre "pour tous" et "tous ensemble"… mais organisées chacun dans son coin, derrière son petit chef syndicaliste, en faisant tout pour empêcher la mise en œuvre de délégations massives en recherche de solidarité vers les entreprises les plus proches géographiquement.
Les syndicats n’ont d’ailleurs pas été les seuls à entraver la possibilité d’une telle mobilisation, car la police de Sarkozy, réputée pour sa prétendue débilité et son esprit anti-gauche, a su se faire l’auxiliaire indispensable des syndicats à plusieurs reprises par ses provocations. Exemple : les incidents de la place Bellecour à Lyon, où la présence d’une poignée de "casseurs" (probablement manipulés par les flics) a servi de prétexte à une violente répression policière contre des centaines de jeunes lycéens dont la plupart ne cherchaient qu’à venir discuter à la fin d’une manifestation avec les travailleurs.
Un mouvement riche de perspectives
En revanche, il n’a pas du tout été question dans les médias des nombreux Comités ou Assemblées générales interprofessionnels (AG interpros), qui se sont formés durant cette période, comités et AG dont le but affiché était et reste de s’organiser en-dehors des syndicats et de développer des discussions réellement ouvertes à tous les prolétaires, ainsi que des actions dans lesquelles c’est toute la classe ouvrière qui pourrait, non seulement se reconnaître, mais aussi et surtout s’impliquer massivement.
On voit ici ce que la bourgeoisie a craint particulièrement : que des contacts se nouent et se multiplient le plus largement possible dans les rangs de la classe ouvrière, jeunes, vieux, au travail ou au chômage.
Il faut tirer les leçons de l'échec du mouvement.
Le premier constat après l'échec du mouvement est que ce sont les appareils syndicaux qui ont permis de faire passer l’attaque auprès des prolétaires et qu’il ne s’agit nullement de quelque chose de conjoncturel. C’est qu’ils ont fait leur sale boulot, pour lequel tous les spécialistes et autres sociologues, ainsi que le gouvernement et Sarkozy en personne, les saluent pour leur "sens des responsabilités". Oui, sans hésitation, la bourgeoisie peut se féliciter d’avoir des "responsables" syndicaux capables de briser un mouvement d’une telle ampleur en faisant en même temps croire qu’ils ont pourtant fait tout leur possible pour lui permettre de se développer. Ce sont encore ces mêmes appareils syndicaux qui sont parvenus à étouffer et marginaliser les véritables expressions de lutte autonome de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.
Cependant, cet échec est porteur de nombreux fruits car tous les efforts déployés par l’ensemble des forces de la bourgeoisie n’ont pas réussi à entraîner le mouvement dans une défaite cuisante de tout un secteur, comme ce fut le cas en 2003 avec la lutte contre la réforme des retraites du secteur public qui avait donné lieu à un cinglant recul parmi les travailleurs de l’Éducation nationale après plusieurs semaines de grève.
Ensuite, ce mouvement a permis le surgissement convergent en plusieurs endroits de minorités exprimant une vision claire des besoins réels de la lutte pour l'ensemble du prolétariat : la nécessité d'une prise en mains de la lutte pour pouvoir l'étendre et la développer, traduisant un réel mûrissement de la réflexion, tout en exprimant l'idée que le développement de la lutte n'en est qu'à son début et manifestant une volonté de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de rester mobilisées pour l'avenir.
Comme le dit un tract de "l’AG interpro" parisienne de la Gare de l’Est daté du 6 novembre : "Il aurait fallu, dès le départ, s’appuyer sur les secteurs en grève, ne pas limiter le mouvement à la seule revendication sur les retraites alors que les licenciements, les suppressions de postes, la casse des services publics, les bas salaires continuent dans le même temps. C'est cela qui aurait pu permettre d’entraîner d’autres travailleurs dans la lutte et d’étendre le mouvement gréviste et de l’unifier. Seule une grève de masse qui s'organise à l'échelle locale et se coordonne nationalement, au travers de comités de grève, d'assemblées générales interprofessionnelles, de comités de lutte, pour que nous décidions nous-mêmes des revendications et des moyens d'action tout en contrôlant le mouvement, peut avoir une chance de gagner."
"La force des travailleurs n'est pas seulement de bloquer, ici ou là, un dépôt pétrolier ou même une usine. La force des travailleurs, c'est de se réunir sur leurs lieux de travail, par-delà les professions, les sites, les entreprises, les catégories et de décider ensemble" Car "l'attaque ne fait que commencer. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. C'est la guerre de classe que la bourgeoisie nous déclare et nous avons encore les moyens de la mener" (tract intitulé "Personne ne peut lutter, décider et gagner à notre place", signé par des travailleurs et précaires de "l’AG interpro" de la Gare de l’Est et d’Île-de-France, déjà cité plus haut). Nous n’avons pas d’autre choix pour nous défendre que d’étendre et de développer massivement nos luttes et pour cela de les prendre dans nos propres mains.
Cette volonté s'est donc clairement affirmée à travers en particulier :
- des véritables AG interpros qui ont émergé, même de façon très minoritaire, dans le développement de la lutte en affichant leur détermination à rester mobilisées en vue de préparer de futurs combats ;
- la tenue ou les tentatives de former des assemblées de rues ou des assemblées populaires en fin de manifestations s'est également affirmée, en particulier à Toulouse.
Cette volonté de s'auto-organiser exprimée par des minorités révèle que l'ensemble de la classe commence à se poser des questions sur la stratégie syndicale, sans oser tirer encore toutes les conséquences de ses doutes et questionnements. Dans toutes les AG (syndicales ou non), la plupart des débats sous diverses formes ont tourné autour de questions essentielles sur "comment lutter ?", "comment aider les autres travailleurs ?", "comment exprimer notre solidarité ?", "quelle autre AG interpro pouvons-nous rencontrer ?", "comment briser l'isolement et toucher le maximum d'ouvriers pour discuter avec eux des moyens de lutter ?"… Et dans les faits, quelques dizaines de travailleurs de tous secteurs, de chômeurs, de précaires, de retraités se sont rendues effectivement chaque jour devant les portes des 12 raffineries paralysées, pour "faire nombre" face aux CRS, apporter des paniers-repas aux grévistes, un peu de chaleur morale.
Cet élan de solidarité est un élément important, il révèle une nouvelle fois la nature profonde de la classe ouvrière.
"Prendre confiance en nos propres forces" devra être le mot d’ordre de demain.
Cette lutte est en apparence une défaite, le gouvernement n'a pas reculé. Mais en fait, elle constitue un pas en avant supplémentaire pour notre classe. Les minorités qui ont émergé et qui ont essayé de se regrouper, de discuter en AG interpro ou en assemblée populaire de rue, ces minorités qui ont essayé de prendre en main leurs luttes en se méfiant comme de la peste des syndicats, révèlent le questionnement qui mûrit en profondeur dans toutes les têtes ouvrières. Cette réflexion va continuer de faire son chemin et elle portera, à terme, ses fruits. Il ne s'agit pas là d'un appel à attendre, les bras croisés, que le fruit mûr tombe de l'arbre. Tous ceux qui ont conscience que l'avenir va être fait d'attaques ignobles du capital, d'une paupérisation croissante et de luttes nécessaires, doivent œuvrer à préparer les futurs combats. Nous devons continuer à débattre, à discuter, à tirer les leçons de ce mouvement et à les diffuser le plus largement possible. Ceux qui ont commencé à tisser des liens de confiance et de fraternité dans ce mouvement, au sein des cortèges et des AG, doivent essayer de continuer de se voir (en Cercles de discussion, Comités de lutte, Assemblées populaires ou "lieux de parole") car des questions restent entières, telles que :
- Quelle est la place du "blocage économique" dans la lutte de classe ?
- Quelle est la différence entre la violence de l'État et celle des travailleurs en lutte ?
- Comment faire face à la répression ?
- Comment prendre en main nos luttes ? Comment nous organiser ?
- Quelles différences entre une AG syndicale et une AG souveraine ? etc.
Ce mouvement est déjà riche en enseignements pour le prolétariat mondial. Sous une forme différente, les mobilisations étudiantes en Grande-Bretagne sont également porteuses de promesses pour le développement des luttes à venir.
Grande-Bretagne : la jeune génération renoue avec la lutte
Le premier samedi après l’annonce du plan de rigueur gouvernemental de réduction drastique des dépenses publiques, le 23 octobre, se sont déroulées de nombreuses manifestations contre les coupes budgétaires, partout dans le pays, appelées par divers syndicats. Le nombre de participants, très variable (allant jusqu'à 15 000 à Belfast ou 25 000 à Edimbourg) révèle la profondeur de la colère. Une autre démonstration de ce ras-le-bol généralisé est la rébellion des étudiants contre la hausse de 300 % des frais d’inscription dans les universités.
Déjà ces frais les contraignaient à s’endetter lourdement pour rembourser après leurs études des sommes astronomiques (pouvant aller jusqu’à 95 000 euros !). Ces nouvelles hausses ont donc provoqué toute une série de manifestations du Nord au Sud du pays (5 mobilisations en moins d’un mois : les 10, 24 et 30 novembre, les 4 et 9 décembre). Cette hausse a tout de même été définitivement votée à la chambre des Communes le 8 décembre.
Les foyers de lutte se sont multipliés : dans la formation continue, dans les écoles supérieures et les lycées, occupations d’une longue liste d’universités, de nombreuses réunions sur les campus ou dans la rue pour discuter de la voie à suivre... les étudiants ont reçu le soutien et la solidarité de la part de nombreux enseignants, notamment en fermant les yeux devant les absences des grévistes en classe (l’assiduité au cours est ici strictement réglementée) ou en allant rendre visite aux étudiants et en discutant avec eux. Les grèves, manifestations et occupations ont été tout sauf ces sages événements que les syndicats et les "officiels" de la gauche ont habituellement pour mission d’organiser. Cet élan de résistance à peine contrôlé a inquiété les gouvernants. Un signe clair de cette inquiétude est le niveau de la répression policière utilisée contre les manifestations. La plupart des rassemblements se sont terminés par des affrontements violents avec la police anti-émeutes pratiquant une stratégie d’encerclement, n’hésitant pas à matraquer les manifestants, ce qui s’est traduit par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, surtout à Londres, alors que des occupations se déroulaient dans une quinzaine d’universités avec le soutien d’enseignants. Le 10 novembre, les étudiants avaient envahi le siège du Parti conservateur et le 8 décembre, ils ont tenté de pénétrer dans le ministère des finances et à la Cour suprême, tandis que des manifestants s’en sont pris à la Rolls-Royce transportant le prince Charles et son épouse Camilla. Les étudiants et ceux qui les soutiennent étaient venus aux manifestations de bonne humeur, fabriquant leurs propres bannières et leurs propres slogans, certains d’entre eux rejoignant pour la première fois un mouvement de protestation. Les débrayages spontanés, l’investissement du QG du Parti conservateur à Millbank, le défi face aux barrages de police, ou leur contournement inventif, l’occupation des mairies et autres lieux publics, ne sont que quelques expressions de cette attitude ouvertement rebelle. Les étudiants ont été écœurés et révoltés par l'attitude de Porter Aaron, le président du NUS (le syndicat national des étudiants) qui avait condamné l'occupation du siège du Parti conservateur, l'attribuant à la violence pratiquée par une infime minorité. Le 24 novembre à Londres, des milliers de manifestants ont été encerclés par la police quelques minutes après leur départ de Trafalgar Square, et malgré quelques tentatives réussies pour percer les lignes de police, les forces de l’ordre ont bloqué des milliers d’entre eux pendant des heures dans le froid. A un moment, la police montée est passée directement à travers la foule. A Manchester, à Lewisham Town Hall et ailleurs, mêmes scènes de déploiement de la force brutale. Après l’irruption au siège du parti conservateur à Millbank, les journaux ont tenu leur partition habituelle en affichant des photos de présumés "casseurs", faisant courir des histoires effrayantes sur les groupes révolutionnaires qui prennent pour cible les jeunes de la nation avec leur propagande maléfique. Tout cela montre la vraie nature de la "démocratie" sous laquelle nous vivons.
La révolte étudiante au Royaume-Uni est la meilleure réponse à l’idée que la classe ouvrière dans ce pays reste passive devant le torrent d’attaques lancées par le gouvernement sur tous les aspects de notre niveau de vie : emplois, salaires, santé, chômage, prestations d’invalidité ainsi que l’éducation. Toute une nouvelle génération de la classe exploitée n’accepte pas la logique de sacrifices et d’austérité qu'imposent la bourgeoisie et ses syndicats. Ce n'est qu'en prenant en main ses luttes, en développant sa solidarité et son unité internationales que la classe ouvrière, notamment dans les pays "démocratiques" les plus industrialisés, pourra offrir une perspective d'avenir à la société. Ce n'est qu'en refusant de faire les frais de la faillite du capitalisme partout dans le monde, que la classe exploitée pourra mettre un terme à la misère et à la terreur de la classe exploiteuse en renversant le capitalisme et en construisant une autre société basée sur la satisfaction des besoins de toute l'humanité et non sur le profit et l'exploitation.
W. (14 janvier)
1. Lire notre article de la Revue internationale n° 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [148]".
2. Secrétaire général de la CGT, principale centrale syndicale du pays et proche du Parti "communiste".
3 FO : "Force ouvrière". Syndicat issu d'une scission de la CGT en 1947, au début de la Guerre froide, appuyée et financée par l'AFL-CIO des États-Unis. Jusqu'aux années 1990, cette centrale se distingue par sa "modération" mais, depuis, elle a "radicalisé" ses postures en essayant de "tourner" la CGT sur sa gauche.
4 SUD : "Solidaires Unitaires Démocratiques". Syndicat minoritaire se situant à l'extrême gauche de l'éventail des forces d'encadrement de la classe ouvrière et animé principalement par des groupes gauchistes.
Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie
- 2993 lectures
Économies nationales surendettées, les plus faibles devant être secourues pour leur éviter la banqueroute et celle de leurs créanciers ; plans de rigueur pour tenter de contenir l'endettement qui ne fait qu'accroître les risques de récession et, ce faisant, les risques de faillites en série ; tentatives de relance au moyen de la planche à billets… qui relancent l'inflation. C'est l'impasse au niveau économique et la bourgeoisie s'avère dans l'incapacité totale de proposer des politiques économiques un tant soit peu cohérentes.
Le "sauvetage" d'États en Europe
Au moment même où l'Irlande négociait son plan de "sauvetage", les autorités du FMI admettaient que la Grèce ne pourrait pas rembourser le plan qu'elles-mêmes et l'Union Européenne avaient mis en place en avril 2010 et que, de fait, la dette de ce dernier pays devait être restructurée, même si le mot n'a pas été employé par les autorités financières. D'après D. Strauss Khan, le chef du FMI, il devrait être permis à la Grèce de finir de rembourser la dette résultant de son plan de sauvetage, non pas en 2015 mais en 2024 ; c'est-à-dire, au train où va la crise des États en Europe, dans une éternité. C'est là un véritable symbole de la fragilité d'un certain nombre de pays européens minés par la dette, pour ne pas dire la plupart d'entre eux.
Bien sûr, ce nouveau "cadeau" à la Grèce doit s'accompagner de mesures d'austérité supplémentaires. Après le plan d'austérité d'avril 2010 qui s'était soldé par la suppression du paiement de deux mois de retraites, de la baisse des indemnités dans le secteur public, d'une augmentation des prix, elle-même conséquence d'une augmentation des taxes sur l'électricité, les carburants, les alcools, le tabac, etc., des décisions sont en cours de préparation pour supprimer des emplois publics.
C'est un scénario analogue qui se déroule en Irlande où les ouvriers subissent leur quatrième plan d'austérité : en 2009, les salaires des fonctionnaires avaient subi une baisse comprise entre 5 et 15%, des allocations sociales avaient été supprimées et les départs à la retraite n'étaient plus remplacés. Le nouveau plan d'austérité négocié en échange du plan de "sauvetage" du pays contient la baisse du salaire minimum de 11,5%, la diminution des allocations sociales et familiales, la suppression de 24 750 postes de fonctionnaire et l'augmentation de la TVA de 21% à 23%. Et, comme pour la Grèce, il est évident qu'un pays de 4,5 millions d'habitants, dont le PIB était en 2009 de 164 milliards d'euros, ne parviendra pas à rembourser un prêt de 85 milliards d'euros. Pour ces deux pays, il ne fait pas de doute non plus que ces plans d'austérité particulièrement violents appellent l'adoption de futures mesures enfonçant la classe ouvrière et la majeure partie de la population dans une misère telle que, faire face aux fins de mois, va devenir impossible.
L'incapacité de nouveaux pays (Portugal, Espagne, etc.) à faire face à leur dette est déjà annoncée alors que, pour éviter une telle issue, ces pays avaient déjà adopté des mesures d'austérité particulièrement draconiennes qui, comme en Grèce et en Irlande, en annoncent d'autres.
Que cherchent à sauver les différents plans d'austérité ?
La question est d'autant plus légitime que la réponse ne s'impose pas d'elle-même. Une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas pour objet de sauver de la misère les millions de personnes qui sont les premières à en subir les conséquences. Une indication concernant la réponse recherchée est fournie par l'angoisse qui étreint les autorités politiques et financières devant le risque que de nouveaux pays soient à leur tour exposés à un défaut de paiement sur leur dette publique. C'est en fait plus qu'un risque dans la mesure où l’on ne voit guère comment ce scénario ne se produirait pas.
A l'origine de la faillite de la l'État grec se trouve un déficit budgétaire considérable dû à une masse exorbitante de dépenses publiques (en particulier d'armements) que les ressources fiscales du pays, affaiblies par l'aggravation de la crise en 2008, ne permettent pas de financer. Quant à l'État irlandais, son système bancaire avait accumulé une quantité de créances de 1 432 milliards d'euros (à comparer avec le montant du PIB de 164 milliards d'euros - déjà mentionné précédemment - pour mesurer l'absurdité de la situation économique présente !) que l'aggravation de la crise a rendu impossible à recouvrir. En conséquence de quoi, le système bancaire en question a dû être en grande partie nationalisé, les créances étant ainsi transférées à l'État. Après avoir payé une partie, pourtant relativement faible, des dettes du système bancaire, l'État irlandais s'est retrouvé en 2010 avec un déficit public correspondant à 32% du PIB ! Au-delà du caractère délirant de tels chiffres, il faut souligner que, même si les déboires de ces deux économies nationales ont des histoires différentes, le résultat est le même. En effet, dans un cas comme dans l'autre, face à l'endettement démentiel de l'État ou des institution privées, c'est l'État qui doit assumer la fiabilité du capital national en montrant sa capacité à rembourser la dette et payer les intérêts de celle-ci.
La gravité de ce qu'impliquerait une incapacité des économies grecque et irlandaise à assumer leur dette déborde largement le périmètre des frontières de ces deux pays. C'est d'ailleurs bien ce dernier aspect qui explique la panique qui, à cette occasion, s'est emparée des hautes instances de la bourgeoisie mondiale. De la même manière que les banques irlandaises possédaient des créances considérables sur toute une série d'États du monde, les banques des grands pays développés possèdent des créances colossales sur les États grec et irlandais. Concernant le montant des créances des grandes banques mondiales sur l'État irlandais, les différentes sources ne concordent pas. Parmi celles-ci, retenons, à titre indicatif, des évaluations qui apparaissent "moyennes" : "Selon le quotidien économique les Échos de lundi, les banques françaises seraient exposées à hauteur de 21,1 milliards en Irlande, derrière les banques allemande (46 milliards), britanniques (42,3) et américaines (24,6)" 1. Et concernant l'engagement des banques à l'égard de la Grèce : "Les établissements français sont les plus exposés, avec 75 milliards de dollars (55 milliards d'euros) d'encours. Les établissements suisses ont investi 63 milliards de dollars (46 milliards d'euros), les Allemands 43 milliards (31 milliards d'euros)" 2. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait mis dans une situation très difficile les banques créditrices, et donc les États dont elles dépendent. C'est tout particulièrement le cas pour des pays dont la situation financière est très critique (Portugal, Espagne), qui sont, eux aussi, engagés en Grèce et en Irlande, et pour qui une telle situation aurait été fatale.
Ce n'est pas tout. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait signifié que les autorités financières de l'UE et du FMI ne garantissaient pas les finances des pays en difficulté, qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, etc. Il en aurait résulté un véritable sauve-qui-peut des créanciers de ces États, la faillite garantie des plus faibles parmi ces derniers, l'effondrement de l'euro et une tempête financière, en comparaison de laquelle les conséquences de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008 auraient fait figure de légère brise de mer. En d'autres termes, en venant au secours de la Grèce et de l'Irlande, les autorités financières de l'UE et du FMI n'ont pas eu comme préoccupation de sauver ces deux États, encore moins les populations de ces deux pays, mais bien d'éviter la déroute du système financier mondial.
Dans la réalité, ce ne sont pas que la Grèce, l'Irlande et quelques autres pays du sud de l'Europe dont la situation financière est fortement détériorée, comme le traduisent les chiffres suivants : "On obtient les statistiques suivantes (janvier 2010) [montant de la dette totale en pourcentage du PIB] : 470% pour le Royaume-Uni et le Japon, médailles d’or de l’endettement total ; 360% pour l’Espagne ; 320% pour la France, l’Italie et la Suisse ; 300% pour les États-Unis et 280% pour l’Allemagne" 3. En fait, l'ensemble des pays, qu'ils soient situés dans la zone euro ou hors de celle-ci, ont un endettement considérable qui, de manière évidente, ne permet pas qu'il puisse être remboursé. Néanmoins, les pays de la zone euro ont sur ce plan à faire face à une difficulté supplémentaire dans la mesure où un État qui s'endette n'a pas la possibilité de créer lui-même les moyens monétaires pour "financer" ses déficits puisqu’une telle possibilité est exclusivement du ressort d'une institution qui lui est extérieure, à savoir la Banque Centrale Européenne. D'autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, également très endettés, n'ont pas ce problème puisqu'ils ont toute autorité pour créer leur propre monnaie.
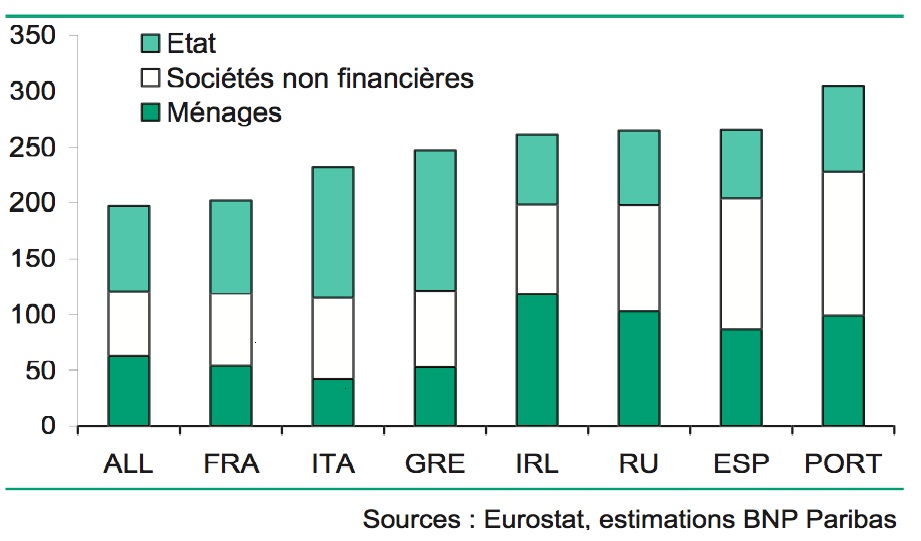
Endettement public et privé (en % du PIB) hors institutions financières, en 2009
Quoi qu'il en soit, les niveaux d'endettement de tous ces États montre que leurs engagements dépassent leurs possibilités de remboursement, et ce jusqu'à l'absurde. Des calculs ont été faits qui montrent que la Grèce devrait – au bas mot - parvenir à un excédent budgétaire de 16 ou 17% pour stabiliser sa dette publique. En fait, ce sont tous les pays du monde qui se sont endettés à un point tel que leur production nationale ne permet pas le remboursement de leur dette. En d'autres termes, cela signifie que des États et institutions privées possèdent des créances qui ne pourront jamais être honorées 4. Le tableau ci-dessous, qui indique l'endettement de chaque pays européen (hors institutions financières, contrairement aux chiffres mentionnés plus haut), permet de se faire une bonne idée de l'immensité des dettes contractées de même que de la fragilité des pays les plus endettés.
Les plans de sauvetage n'ayant aucune chance d'aboutir, leur existence a-t-elle une autre signification ?
Le capitalisme ne peut survivre que grâce à des plans de soutien économique permanents
Le plan de "sauvetage" de la Grèce a coûté 110 milliards d'euros et celui de l'Irlande 85 milliards. Ces masses financières apportées par le FMI, la zone euro et le Royaume-Uni (pour 8,5 milliards d'euros alors que le gouvernement Cameron a par ailleurs mis en œuvre son propre plan d'austérité visant à diminuer les dépenses publiques de 25% en 2015 5) ne sont autres que de la monnaie émise sur la base de la richesse des différents États.
En d'autres termes, l'argent dépensé dans le plan de sauvetage n'est pas basé sur de nouvelles richesses créées mais il est bel et bien le produit de la planche à billets, ce qui en fait de la "monnaie de singe".
Un tel soutien au secteur financier, lequel finance l'économie réelle, est en fait un soutien à l'activité économique réelle. Ainsi, alors que d'un côté se mettent en place des plans d'austérité draconiens, qui annoncent d'autres plans d'austérité encore plus draconiens, on voit les États être obligés, sous peine d'effondrement du système financier et de blocage de l'économie mondiale, d'adopter ce qu'il faut bien appeler des plans de soutien – dont le contenu est très proche de ce qui s'appelle des "plans de relance".
En fait, ce sont les États-Unis qui sont allés le plus loin dans cette direction : le Quantitative Easing n° 2 de 900 milliards de dollars 6 n'a pas d'autre sens que de tenter de sauver un système financier américain dont les livres de compte demeurent remplis de mauvaises créances, et de soutenir la croissance économique des États-Unis dont le caractère poussif montre qu'elle ne peut pas se passer d'un déficit budgétaire important.
Les États-Unis, bénéficiant toujours de l'avantage que leur confère le statut du dollar comme monnaie d'échange mondiale, ne subissent pas les même contraintes que la Grèce, l'Irlande ou d'autres pays européens et, de ce fait, il n'est pas exclu, comme beaucoup le pensent, que devra être adopté un Quantitative Easing n° 3.
Ainsi, le soutien de l'activité économique par les mesures budgétaires est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il ne l'est dans les pays européens. Mais cela n'empêche pas les États-Unis de chercher aussi à diminuer de manière drastique le déficit budgétaire, comme l'illustre le fait que B. Obama lui-même a proposé de bloquer le salaire des fonctionnaires fédéraux. En fait, c'est dans tous les pays du monde que l'on trouve de telles contradictions dans les politiques mises en œuvre
La bourgeoisie a dépassé les limites de l'endettement que le capitalisme peut supporter
Nous avons donc des plans d'austérité et des plans de relance menés en même temps ! Quelle est la raison de telles contradictions ?
Comme l'avait montré Marx, le capitalisme souffre par nature d'un manque de débouchés car l'exploitation de la force de travail de la classe ouvrière aboutit forcément à la création d'une valeur plus grande que la somme des salaires versés, vu que la classe ouvrière consomme beaucoup moins que ce qu'elle a produit. Pendant toute une période qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie a pu réellement faire face à ce problème par la colonisation de territoires qui n'étaient pas capitalistes, territoires sur lesquels elle forçait, par de multiples moyens, la population à acheter les marchandises produites par son capital. Les crises et les guerres du XXe siècle ont illustré que cette manière de faire face au problème de la surproduction, inhérent à l'exploitation capitaliste des forces productives, atteignait ses limites. En d'autres termes, les territoires non capitalistes de la planète n'étaient plus suffisants pour permettre à la bourgeoisie d'écouler ce surplus de marchandises qui permet l'accumulation élargie et résulte de l'exploitation de la classe ouvrière. Le dérèglement de l'économie qui s'est produit à la fin des années 1960 et qui s'est manifesté par des crises monétaires et par des récessions signait la quasi absence des marchés extra-capitalistes comme moyen d'absorber le surproduit de la production capitaliste. La seule solution qui se soit alors imposée a été la création d'un marché artificiel alimenté par la dette. Il permettait à la bourgeoisie de vendre à des États, des ménages ou des entreprises des marchandises sans que ces derniers disposent des moyens réels pour les acheter.
Nous avons souvent abordé ce problème en soulignant que le capitalisme avait utilisé l'endettement comme un palliatif à la crise de surproduction dans laquelle il est enfoncé depuis la fin des années 1960. Mais il ne faut pas confondre endettement et miracle. En effet, la dette doit être progressivement remboursée et ses intérêts payés systématiquement sinon le créancier, non seulement n'y trouve pas son intérêt, mais encore il risque lui-même de faire faillite.
Or, la situation d'un nombre croissant de pays européens montre qu'ils ne peuvent plus s'acquitter de la partie de leur dette exigée par leurs créanciers. En d'autres termes, ces pays se retrouvent devant l'exigence de devoir diminuer leur dette, notamment en réduisant leurs dépenses, alors que quarante années de crise ont montré que l'augmentation de celle-ci était une condition absolument nécessaire à ce que l'économie mondiale n'entre pas en récession. C'est là une même contradiction insoluble à laquelle sont confrontés, de façon plus ou moins aigüe, tous les États.
Les secousses financières qui se manifestent en ce moment en Europe sont ainsi le produit des contradictions fondamentales du capitalisme et illustrent l'impasse absolue de ce mode de production. D'autres caractéristiques de la situation actuelle, que nous n'avons pas encore évoquées dans cet article, entrent également en jeu.
L'inflation se développe
Au moment même où beaucoup de pays du monde mettent en place des politiques d'austérité plus ou moins violentes, ayant pour effet de réduire la demande intérieure, y inclus les produits de première nécessité, le prix des matières premières agricoles connait de très fortes augmentations : plus de 100 % pour le coton en un an 7, plus de 20% pour le blé et le maïs entre juillet 2009 et juillet 2010 8 et 16% pour le riz entre la période avril-juin 2010 et fin octobre 2010 9 ; une tendance analogue concerne les métaux et le pétrole. Bien sûr, les facteurs climatiques ont un rôle dans l'évolution du prix des produits alimentaires, mais l’augmentation est tellement généralisée qu'elle a nécessairement des causes qui sont autres. Plus généralement, l'ensemble des États sont préoccupés par le niveau de l'inflation qui affecte de plus en plus leur économie. Quelques exemples concernant les pays "émergents" :
- Officiellement l'inflation en Chine atteignait, au mois de novembre 2010, le rythme annuel de 5,1% (en fait tous les spécialistes s'accordent à dire que les chiffres réels de l'inflation dans ce pays se situent entre 8 et 10%) ;
- En Inde, l'inflation était de 8,6% au mois d'octobre ;
- En Russie, où l'inflation a été de 8,5% en 2010 10.
Le développement de l’inflation n'est pas un phénomène exotique réservé aux pays émergents puisque les pays développés sont aussi de plus en plus concernés : les 3,3% en novembre au Royaume-Uni ont été qualifiés de dérapage par le gouvernement ; le 1,9% dans la vertueuse Allemagne est qualifié de préoccupant parce qu'il s'insère au sein d'une croissance rapide.
Quelle est donc la cause de ce retour de l'inflation ?
L'inflation n'a pas toujours pour cause une demande excédentaire par rapport à l'offre permettant aux vendeurs d'augmenter les prix sans craindre de ne pas vendre toutes leurs marchandises. Un autre facteur tout à fait différent peut être à l'origine de ce phénomène : il s'agit de l'augmentation de la masse monétaire qui se produit effectivement depuis trois décennies. En effet, l'utilisation de la planche à billets, c'est-à-dire l'émission de nouvelle monnaie sans que la richesse nationale lui correspondant augmente dans les mêmes proportions, aboutit inévitablement à une dépréciation de la valeur de la monnaie en service, ce qui se traduit par une hausse des prix. Or, toutes les données communiquées par les organismes officiels font apparaître, depuis 2008, de fortes augmentations de la masse monétaire dans les grandes zones économiques de la planète.
Ces augmentations encouragent le développement de la spéculation, avec des conséquences désastreuses pour la vie de la classe ouvrière. La demande étant trop faible, notamment du fait de la stagnation ou de la baisse des salaires, les entreprises ne peuvent pas augmenter le prix des marchandises sur le marché sous peine de ne pouvoir les écouler et d'enregistrer des pertes. Ces mêmes entreprises, ou les investisseurs, se détournent ainsi de l'activité productive, trop peu rentable et donc trop risquée, et orientent les quantités de monnaie créées par les banques centrales vers la spéculation : concrètement, cela signifie achat de produits financiers, de matières premières ou de monnaies avec l'espoir qu'ils pourront être revendus avec un profit substantiel. Ce faisant, ces "produits de consommation" vont se trouver transformés en actifs. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces produits, en particulier les matières premières agricoles, sont aussi des marchandises qui entrent dans la consommation du plus grand nombre d'ouvriers, de paysans, de chômeurs, etc. Finalement, en plus de la baisse de ses revenus, une grande partie de la population mondiale va aussi se trouver aux prises avec l'augmentation du prix du riz, du pain, des vêtements, etc.
Ainsi, la crise qui oblige la bourgeoisie à sauver ses banques au moyen de la création de monnaie aboutit à ce que les ouvriers subissent deux attaques :
-
la baisse du niveau de leur salaire,
l'augmentation du prix des produits de première nécessité.
C'est pour ces raisons que l'on a connu une augmentation du prix des produits de première nécessité depuis le début des années 2000 et les mêmes causes ont, aujourd'hui, les mêmes effets. En 2007-2008 (juste avant la crise financière), de grandes masses de la population mondiale se retrouvant dans une situation de disette avaient été à l'origine d'émeutes de la faim. Les conséquences de l'actuelle flambée des prix ne se sont pas fait attendre comme l'illustrent les révoltes actuelles en Tunisie et en Algérie.
Le niveau actuel de l'inflation ne cesse de s'élever. D’après le Cercle Finance du 7 décembre, le taux des T bonds 11 à 10 ans est passé de 2,94% à 3,17% et le taux des T bonds à trente ans est passé 4,25% à 4,425%. Cela signifie clairement que les capitalistes anticipent une perte de valeur de l'argent qu’ils placent en exigeant un taux plus élevé pour leurs placements.
Les tensions entre capitaux nationaux
Lors de la crise des années 1930, le protectionnisme, moyen de la guerre commerciale, s’était développé massivement à tel point qu’on avait pu alors parler de "régionalisation" des échanges : chacun des grands pays impérialistes se réservant une zone planétaire qu’il dominait et qui lui permettait de trouver un minimum de débouchés. Contrairement aux pieuses intentions publiées par le récent G20 de Séoul, et selon lesquelles les différents pays participant ont déclaré vouloir bannir le protectionnisme, la réalité n'est pas celle-là. Des tendances protectionnistes sont clairement à l’œuvre actuellement et on préfère chastement parler, à leur propos, de "patriotisme économique". La liste des mesures protectionnistes adoptées par les différents pays serait trop fastidieuse pour être rapportée. Mentionnons simplement le fait que les États-Unis en étaient, en septembre 2010, à 245 mesures anti-dumping ; que le Mexique avait pris, dès mars 2009, 89 mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis et que la Chine a récemment décidé la limitation drastique de l’exportation de ses "terres rares" qui rentrent dans la production d’une grande partie des produits de haute technologie.
Mais, dans la période actuelle, c'est la guerre des monnaies qui se trouve constituer la manifestation majeure de la guerre commerciale. Nous avons vu plus haut que le Quantitative Easing n° 2 était une nécessité pour le capital américain, mais en même temps, dans la mesure où la création de monnaie qui l'accompagne ne peut que se traduire par la baisse de la valeur de celle-ci, et donc aussi du prix des produits "made in USA" sur le marché mondial (relativement aux produits des autres pays), il constitue une mesure protectionniste particulièrement agressive. De même, la sous-évaluation du yuan chinois poursuit des objectifs similaires.
Et pourtant, malgré la guerre économique, les différents États ont été obligés de s’entendre pour permettre à la Grèce et à l’Irlande de ne pas faire défaut sur leur dette. Cela signifie que dans ce domaine aussi, la bourgeoisie ne peut pas faire autrement que de prendre des mesures très contradictoires, dictées par l’impasse totale dans laquelle se trouve son système.
La bourgeoisie a-t-elle des solutions à proposer ?
Pourquoi, dans le contexte de la situation catastrophique actuelle de l'économie mondiale, voit-on apparaître des articles comme ceux de La Tribune ou du Monde titrant respectivement "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous" 12 et "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique" 13 ? De tels titres, qui ne relèvent que de la propagande, visent à nous endormir et, surtout, à nous faire croire que les autorités économiques et politiques de la bourgeoisie ont encore une certaine maîtrise de la situation. En fait, la bourgeoisie n’a le choix qu’entre deux politiques qui sont comme la peste et le choléra :
- Soit elle procède comme elle l’a fait pour la Grèce et l’Irlande à de la création de monnaie, car tant les fonds de l'UE que ceux du FMI proviennent de la planche à billets des divers États membres ; mais alors on se dirige vers une dévalorisation des monnaies et une tendance inflationniste qui ne peut que devenir de plus en plus galopante ;
- Soit elle pratique une politique d'austérité particulièrement draconienne visant à une stabilisation de la dette. C'est la solution qui est préconisée par l'Allemagne pour la zone euro, les particularités de cette zone faisant que, en fin de compte, c'est le capital allemand qui supporte le plus gros du coût du soutien aux pays en difficulté. L'aboutissement d'une telle politique ne peut être que la chute vertigineuse dans la dépression, à l’image de la chute de la production que l’on a vu en 2010 en Grèce, en Irlande et en Espagne suite aux plans "de rigueur" qui ont été adoptés.
Un certains nombre d'économistes dans toute une série d'ouvrages publiés récemment proposent tous leur solution à l'impasse actuelle, mais toutes procèdent soit de la méthode Coué, soit de la plus pure propagande pour faire croire que cette société a, malgré tout, un avenir. Pour ne prendre qu'un exemple, selon le professeur M. Aglietta 14, les plans d’austérité adoptés en Europe vont coûter un pour cent de croissance dans l’Union Européenne ramenant celle-ci à un niveau d'environ 1% en 2011. Sa solution alternative est révélatrice du fait que les plus grands économistes n'ont plus rien de réaliste à proposer : il n’a pas peur d’affirmer qu’une nouvelle "régulation" basée sur "l’économie verte" serait la solution. Il "oublie" seulement une chose : une telle "régulation" impliquerait des dépenses considérables et donc une création monétaire bien plus gigantesque que l'actuelle, et ce alors que l’inflation redémarre de façon particulièrement préoccupante pour la bourgeoisie.
La seule vraie solution à l'impasse capitaliste est celle qui se dégagera des luttes, de plus en plus nombreuses, massives et conscientes que la classe ouvrière est contrainte de mener de par le monde, pour résister aux attaques économiques de la bourgeoisie. Elle passe naturellement par le renversement de ce système dont la principale contradiction est celle de produire pour le profit et l'accumulation et non pour la satisfaction des besoins humains.
Vitaz - 2 janvier 2011
1. lexpansion.lexpress.fr/entreprises/que-risquent-les-banques-francaises_1341874.html [149]
2. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395-grece-ce-que-risquent-les-banques-.php [150]
3. Bernard Marois, professeur émérite à HEC : www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_des_dettes_totales_des_pays-456 [151]
4. J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise", Marianne, 31 décembre 2010
5. Mais il est révélateur que M. Cameron commence à avoir peur de l'effet dépressif sur l'économie anglaise du plan qu'il a concocté.
6. Le QE n° 2 a été fixé à 600 milliards de dollars, mais il faut ajouter le droit qu'a la FED depuis cet été de renouveler l'achat de créances arrivées à échéance pour 35 milliards de dollars par mois.
7. blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton (les chiffres rapportés sur ce site datent de début novembre ; aujourd'hui ces chiffres sont largement dépassés).
8. C. Chevré, MoneyWeek, 17 novembre 2010
9. Observatoire du riz de Madagascar ; iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf
10. Le Figaro du 16 décembre 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-russie-l-inflation-a-85-en-2010.php [152]
11. Bons du Trésor américains.
12. La Tribune, 17 décembre 2010
13. Le Monde, 30 décembre 2010
14. M. Aglietta dans l'émission "L'esprit public" sur la chaine radio "France Culture", 26 décembre 2010.
Récent et en cours:
- Crise économique [153]
La crise en Grande-Bretagne
- 4620 lectures
Le texte ci-dessous est, à quelques modifications mineures près, la partie économique du rapport sur la situation en Grande-Bretagne réalisé pour le 19e congrès de World Revolution (section du CCI en Grande-Bretagne). Nous avons jugé utile sa publication à l'extérieur de notre organisation dans la mesure où ce document fournit un ensemble de données et analyses permettant de saisir la manière dont la crise économique mondiale se manifeste dans la plus ancienne puissance économique du capitalisme.
Le contexte international
En 2010, la bourgeoisie a annoncé la fin de la récession et prédit que l'économie mondiale repartira dans les deux années à venir grâce aux économies émergentes. Cependant, il existe de grandes incertitudes sur la situation globale qui se reflètent dans des projections de croissance contradictoires. Le FMI, dans sa World Outlook Update de juillet 2010, prévoit une croissance globale de 4,5% pour l'année en cours et de 4,25% pour l'année suivante. Le rapport sur les Global Economic Prospects de la Banque mondiale de l'été 2010 envisage une croissance de 3,3% pour 2010 et 2011, et de 3,5% pour 2012, si les choses vont bien. Si elles ne vont pas bien, 3,1% pour 2010, 2,9% l'année suivante et 3,2% en 2012. Leurs préoccupations concernent particulièrement l'Europe pour laquelle la Banque mondiale fait dépendre son estimation la moins pessimiste d'hypothèses qui sont loin d'être réalisées : "les mesures prises empêchent le marché, du fait de sa nervosité actuelle, de ralentir les prêts des banques" et "on parvient à éviter un défaut de paiement ou une restructuration de la dette souveraine européenne". 1 Si ces conditions ne sont pas réalisées, alors l'Europe connaîtra un taux de croissance inférieur, estimé à 2,1, 1,9 et 2,2 pour cent respectivement entre 2010 et 2012.
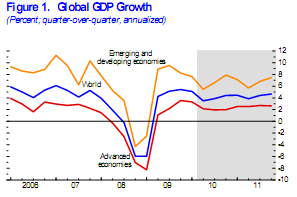
Légende : Orange : Economies émergentes ou en développement ; Rouge : Economies développées ; Bleu : Economie mondiale
Croissance globale du PIB
(Source: FMI, World Economic Outlook Update, Juillet 2010)
La situation reste fragile du fait du haut niveau de dettes et du bas niveau de prêts bancaires, et de la possibilité de nouveaux chocs financiers comme celui qu'on a connu en mai de cette année (2010) où les marchés boursiers ont globalement perdu entre 8 et 17% de leur valeur. L'échelle du renflouage est en elle-même l'une des causes des préoccupations : "La dimension du plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI (près de 1 trillion de dollars) ; l'ampleur de la réaction initiale du marché à la possibilité de défaut de paiement de la Grèce et au danger de contagion ; et la poursuite de la volatilité sont des indicateurs de la fragilité de la situation financière... un nouvel épisode d'incertitude du marché pourrait avoir des conséquences sérieuses pour la croissance à la fois sur les pays de haut revenu et sur les pays en développement." 2 Comme on pouvait s'y attendre, le FMI prescrit une réduction des dépenses étatiques, avec le résultat inévitable d'imposer l'austérité à la classe ouvrière : "Les pays à haut revenu devront faire des coupes dans les dépenses gouvernementales (ou augmenter leur revenu) de 8,8% du PIB pendant une période de 20 ans afin de ramener le niveau de la dette à 60% du PIB d'ici 2030."
Malgré leur objectivité apparente et la sobriété de leurs analyses, les rapports du FMI et de la Banque mondiale laissent à penser qu'il existe une profonde incertitude et une grande peur au sein de la classe dominante concernant sa capacité à surmonter la crise. Il est prévisible que d'autres pays suivront l'Irlande dans sa chute dans la récession.
L'évolution de la situation économique en Grande-Bretagne
Cette partie, basée sur des données officielles, est destinée à donner une vue d'ensemble du cours de la récession. Cependant, il est important de rappeler que la crise a commencé dans le secteur financier, à la suite de la crise du marché immobilier aux Etats-Unis, et qu'elle a affecté les grandes banques et les instituts financiers impliqués dans des prêts à risques sur toute la planète. Elle a été la plus forte sur le marché des subprimes aux Etats-Unis et s'est répandue à travers le système financier du fait que le commerce est basé sur des produits financiers dérivés de ces prêts. Cependant d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont trouvé le moyen de développer leur propre bulle immobilière ce qui a contribué, de pair avec une augmentation massive de l'endettement non sécurisé des particuliers, à créer un niveau de dette tel qu'en fin de compte, en Grande-Bretagne, il a dépassé le PIB annuel du pays. La crise qui se développait submergeait l'économie "réelle" et préparait la récession. Cette situation a suscité une réponse très forte de la classe dominante britannique qui a injecté des sommes d'argent sans précédent dans le système financier et a baissé les taux d'intérêt à un niveau jamais vu.
Les chiffres officiels montrent que la Grande-Bretagne est entrée en récession au cours du 2e trimestre 2008 et en est sortie au 4e trimestre 2009 avec un pic de recul du PIB de 6,4%. 3 Ce chiffre qui vient d'être révisé à la baisse, fait de cette récession la pire depuis la Seconde Guerre mondiale (les récessions du début des années 1990 et des années 1980 ont respectivement été accompagnées de taux négatifs de croissance de 2,5% et de 5,9%). La croissance du 2e trimestre 2010 a été de 1,2%, une augmentation significative par rapport au 0,4% du 4e trimestre 2009 et au 0,3% du premier trimestre 2010. Cependant, elle est toujours en dessous des 4,7% de la période précédant la récession.
Le secteur manufacturier a été le plus affecté par la récession, enregistrant une chute maximale de 13,8% entre le 4e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009. Depuis, ce secteur a enregistré une croissance de 1,1% au dernier trimestre 2009 et de 1,4% et 1,6% au cours des deux trimestres suivants.
L'industrie du bâtiment a connu un fort rebond de croissance, de 6,6%, au cours du 2e trimestre 2010 et contribué de 0,4% au taux de croissance global de ce trimestre. Mais ceci fait suite à un déclin très substantiel tant dans la construction (tombée de 37,2% entre 2007 et 2009) que dans l'activité industrielle et commerciale (tombé de 33,9% entre 2008 et 2009).
Le secteur des services a enregistré une chute de 4,6%, les services financiers et d'affaires chutant de 7,6% "bien plus que lors des précédents reculs et contribuant le plus à la chute". 4 Au cours du dernier trimestre de 2009, ce secteur a retrouvé une croissance de 0,5% mais au cours du premier trimestre 2010, celle-ci est tombée à 0,3%. Bien que le déclin de ce secteur soit moindre que celui des autres, sa position dominante dans l'économie signifie que c'est lui qui a le plus contribué au déclin global du PIB au cours de cette récession. Au cours de celle-ci, le déclin du secteur des services a été également supérieur à ce qu'il avait été dans les récessions du début des années 1980 et du début des années 1990 où les chutes ont été respectivement de 2,4% et de 1%. Plus récemment, le secteur de la finance et des affaires a connu une plus forte croissance et a contribué de 0,4 point au chiffre du PIB global.
Comme on pouvait s'y attendre, les exportations comme les importations ont diminué au cours de la récession. Cela a été le plus marqué dans le commerce de marchandises (bien que la balance se soit légèrement améliorée dernièrement) : "En 2009, le déficit est passé de 11,2 milliards de £ à 81,9 milliards. Il y a eu une chute des exportations de 9,7% - de 252,1 milliards de £ à 227,5 milliards. Cependant cela s'est accompagné d'une chute des importations de 10,4%, la plus grande chute annuelle depuis 1952, qui a eu un impact bien plus grand puisque le total des importations est significativement supérieur à celui des exportations. Les importations sont tombées de 345,2 milliards de £ en 2008 à 309,4 milliards de £ en 2009. Ces chutes importantes, tant dans les exportations que dans les importations, sont le résultat d'une contraction générale du commerce en plus de la crise financière mondiale qui a commencé fin 2008". 5
Le déclin dans les services a été plus réduit, les importations chutant de 5,4% et les exportations de 6,9%, la balance commerciale restant toutefois positive de 55,4 milliards de £ en 2008 et 49,9 milliards de £ en 2009. Le total du commerce dans les services était en 2009 de 159,1 milliards de £ d'exportations et de 109,2 milliards d'importations, ce qui est significativement moins que celui du commerce de marchandises.
Entre 2008-09 et 2009-10, le déficit des comptes courants a doublé, de 3,5% du PIB à 7,08%. Les demandes d'emprunt du secteur public qui incluent l'emprunt pour des dépenses en investissements sont passées de 2,35% du PIB en 2007- 08, à 6,04% en 2008 - 09 et 10,25% en 2009 - 10. En 2008, elles se montaient à 61,3 milliards de £ et en 2009 à 140,5 milliards. Il était prévu que la dette nette totale du gouvernement se monte à 926,9 milliards de £ en juillet de cette année soit 56,1% du PIB, alors qu'elle avait été de 865,5 milliards en 2009 et de 634,4 milliards en 2007. En mai 2009, Standard and Poor’s (organisme de notation) a soulevé la question de rétrograder la notation de la dette britannique en dessous du niveau AAA (le plus élevé). Une telle baisse aurait renchéri de façon significative le coût des emprunts.
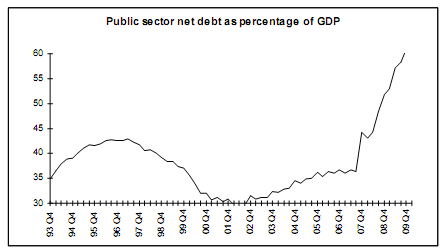
Dette nette du secteur public en pourcentage du PIB
Le nombre de faillites a augmenté pendant la récession, de 12 507 en 2007 (ce qui était un des chiffres les plus bas de la décennie) à 15 535 en 2008 et 19 077 en 2009. Le nombre de rachats et de fusions a augmenté au cours de la deuxième moitié de la décennie pour atteindre 869 en 2007 avant de tomber au cours des deux années suivantes respectivement à 558 et 286. Les chiffres du premier trimestre 2010 n'indiquent pas une quelconque augmentation. Ceci semble signifier que l'insolvabilité des entreprises et la destruction de capital n'ont pas engendré le processus général de consolidation qui intervient en général en sortie d'une crise, ce qui, en soi, peut indiquer que la vraie crise est toujours là.
Pendant la crise, la livre sterling a beaucoup chuté par rapport aux autres devises, perdant plus d'un quart de sa valeur entre 2007 et début 2009, ce qui a suscité le commentaire suivant de la banque d'Angleterre : "Cette chute de plus de 25% est la plus forte sur une période comparable depuis la fin des Accords de Bretton Woods au début des années 1970." 6 Il y a eu une reprise depuis mais la livre reste environ 20% en dessous de son taux de change de 2007.
Le prix du logement a beaucoup chuté après l'éclatement de la bulle immobilière et bien que les prix recommencent à augmenter cette année, ils sont nettement en-dessous de leur maximum et ont à nouveau chuté de 3,6% en septembre dernier. Le nombre de ventes reste à un niveau historiquement bas.
La Bourse a connu de fortes chutes depuis mi-2007 et bien qu'elle ait remonté depuis, l'incertitude existe toujours. Les préoccupations liées à la dette de la Grèce et d'autres pays avant l'intervention de l'Union européenne et du FMI ont provoqué une chute significative en mai cette année comme le montre le graphique ci-après.
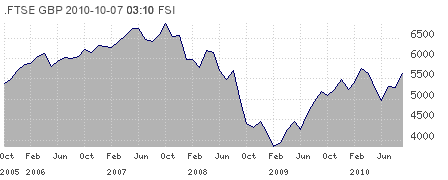
Evolution des valeurs boursières
L'inflation a atteint presque 5% en septembre 2008 avant de retomber à 2% l'année suivante. Elle est depuis passée à plus de 3% en 2010, au-dessus de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre.
L'augmentation du chômage est estimée à 900 000 pendant la récession, ce qui est bien plus bas qu'au cours des précédentes récessions. En juillet 2010, les chiffres officiels étaient de 7,8% de la force de travail, un total d'environ 2,47 millions de personnes.
L'intervention de l'Etat
Le gouvernement britannique est intervenu avec force pour limiter la crise, mettant en oeuvre une série de mesures qui ont également été prises dans beaucoup d'autres pays. Gordon Brown a eu son heure de gloire pendant quelques mois ; son lapsus au cours d'un débat à la Chambre des Communes comme quoi il avait sauvé le monde, est célèbre. L'intervention de l'Etat a comporté plusieurs volets :
- des baisses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Entre 2007 et mars 2009, le taux a été progressivement abaissé de 5,5% à 0,5%, l'amenant au niveau le plus bas jamais enregistré et au-dessous du taux d'inflation ;
- une intervention de soutien direct aux banques, conduisant à des nationalisations totales ou partielles, à commencer par Northern Rock en février 2008, suivie ensuite par Bradford and Bingley. En septembre, le gouvernement négociait le rachat de HBOS par la Lloyds TSB. En octobre, 50 milliards de livres étaient mises à la disposition des banques pour leur recapitalisation. En novembre 2009, une nouvelle injection de 73 nouveaux milliards de livres a abouti à la nationalisation de fait de RBS/NatWest et à la nationalisation partielle de Lloyds TSB/HBOS ;
- une politique de détente du crédit par l'augmentation de la masse monétaire et par l'octroi de subventions au secteur bancaire, connue sous le nom de l'Asset purchase facility. En mars 2009, un plan d'injection de 75 milliards de livres sur trois mois a été annoncé. Le montant s'est élevé jusqu'à atteindre aujourd'hui un total de 200 milliards. La Banque d'Angleterre explique que le but de la détente du crédit est d'injecter plus d'argent dans l'économie sans pour autant devoir réduire le taux de base de 0,5%, déjà au plancher, en vue de maintenir l'objectif d'une inflation à 2%. Cela se fait par l'achat d'avoirs par la Banque d'Angleterre (principalement des gilts 7) aux institutions du secteur privé, ce qui procure des liquidités aux vendeurs. C'est simple en apparence mais, selon le Financial Times, "Personne ne sait très bien si la politique de détente du crédit ou d'autres politiques monétaires non orthodoxes marchent, ni comment elles marchent." 8
- un encouragement à la consommation. En janvier 2009, la TVA a été abaissée de 17,5% à 15% et, en mai 2009, un système de rabais sur les ventes d'automobiles a été introduit. L'augmentation des garanties sur les dépôts de banque à 50 000 £ en octobre 2008 peut être vue comme un élément de cette politique puisque son but est de rassurer les consommateurs sur le fait que leur argent ne disparaîtra pas purement et simplement en cas d'effondrement de la banque.
Cette politique a permis de contenir la crise dans l'immédiat et d'éviter de nouveaux effondrements bancaires. Le prix en a été une augmentation substantielle de la dette comme on l'a indiqué plus haut. Les chiffres officiels donnent le coût de l'intervention du gouvernement, de 99,8 milliards de £ en 2007, 121,5 milliards de £ en 2009 et 113,2 en juillet cette année. Ces chiffres n'incluent ni les coûts de la détente du crédit (ce qui ajouterait environ 250 milliards de £ au total) ni le coût de l'achat d'avoirs comme la participation dans les banques sous le prétexte que ces avoirs ne seront détenus que provisoirement par le gouvernement avant d'être revendus. Cela reste à voir, même si Lloyds TSB a déjà remboursé une partie des sommes reçues. Selon certains commentateurs, l'action du gouvernement a par ailleurs contribué au fait que l'augmentation du chômage a été plus faible que prévu, pendant la récession. Nous y reviendrons plus en détail plus loin.
Cependant, les prospectives à long terme semblent plus contestables :
- les interventions pour prévenir l'inflation et, en théorie, encourager les dépenses n'ont pas permis d'atteindre leur but bien qu'il semble que les tendances de fond soient meilleures que ce qui était prévu. Cependant, le coût des aliments augmente globalement ce qui ne pourra que pousser l'inflation à la hausse et les ventes à la baisse ;
- les tentatives d'injecter des liquidités dans le système en réduisant le coût de l'emprunt et en augmentant l'argent disponible n'ont pas eu la conséquence attendue, amenant les politiciens à réitérer leurs appels pour que "les banques en fassent plus" ;
- l'impact de la baisse de la TVA et du système de rabais sur les automobiles a contribué à un début de reprise fin 2009, mais à présent cette mesure n'est plus en vigueur. Il y a eu une légère baisse des ventes d'automobiles au premier trimestre 2010 alors que le système de rabais existait encore. En fin de compte, il y a eu des réductions concernant la plupart des domaines de consommation des ménages, mais cela s'est traduit par le ralentissement de l'endettement individuel et l'augmentation du taux d'épargne. Etant donné le rôle central joué par la consommation des ménages, basée sur l'endettement, au sein du boom économique, il est clair que sa baisse a des implications négatives, dans cette reprise comme dans toute reprise.
Les prévisions pour la croissance du PIB en 2010 et 2011 en Grande-Bretagne se montent respectivement à 1,5% et 2%. C'est au dessus des 0,9% et 1,7% prévus dans la zone euro, mais en dessous des 1,9% et 2,5% prévus pour l'ensemble de l'OCDE 9 et en dessous des prévisions du FMI pour l'Europe citées au début de ce rapport.
Cependant, pour saisir la signification réelle de la crise, il est nécessaire d'aller au-delà de la surface des phénomènes et d'examiner des aspects de la structure et du fonctionnement de l'économie britannique.
Les questions économiques et structurelles
Changement dans la composition de l'économie britannique : de la production aux services
Pour comprendre la situation du capitalisme britannique et la signification de la récession, il est nécessaire d'examiner les principaux changements structurels intervenus dans l'économie au cours des récentes décennies. Un article publié par Bilan en 1934/1935 (numéros 13 et 14) notait qu'en 1851, 24% des hommes étaient employés dans l'agriculture alors qu'ils n'étaient plus que 7% en 1931, et qu'au cours de la même période, la proportion d'hommes employés dans l'industrie a décliné de 51% à 42%. Aujourd'hui, on est clairement bien en deçà. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne avait encore un empire, même sur le déclin, sur lequel elle pouvait s'appuyer. C'est fini depuis la Seconde Guerre mondiale. La tendance historique s'est modifiée passant du secteur de la production vers celui des services et, au sein de ce dernier, vers la finance en particulier comme le montrent les deux tableaux ci-dessous.
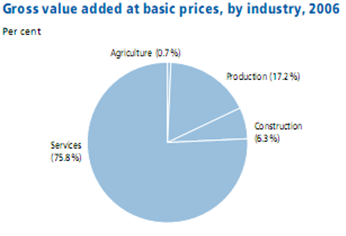
Valeur ajoutée brute totale par secteur en 2006, aux prix de base
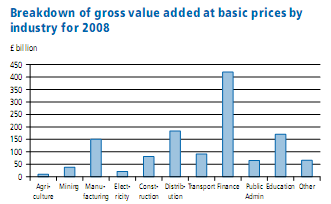
Répartition de la valeur ajoutée brute totale par secteur en 2008,
aux prix de base
Ces deux tableaux proviennent du Blue Book de 2010 qui établit les comptes de la nation. Il fait le commentaire suivant : "En 2006, dernière année de référence, un peu plus de 75% de la valeur ajoutée brute totale provenait du secteur des services, alors que celle issue de la production était de 17%. La partie restante venait majoritairement du secteur de la construction". 10 En 1985, le secteur des services ne constituait que 58% de la valeur ajoutée brute. "Une analyse des 11 grands secteurs industriels montre qu'en 2008, l'intermédiation financière et autres secteurs des services fournissaient la plus grande contribution à la valeur ajoutée brute aux prix de base courants, à 420 milliards de livres sur un total de 1 295,7 milliards (32,4%). Les secteurs de la distribution et de l'hôtellerie ont contribué à hauteur de 14,2% ; ceux de l'éducation, de la santé et du social se montaient à 13,1% ; et celui de la manufacture à 11,6%." 11 Il faut noter qu'en l'espace de deux ans (de 2006 à 2008, le secteur manufacturier a chuté d'environ un tiers (de 17% à 11,6%).
Le tableau ci-dessous intitulé "Changements structurels dans les services au Royaume-Uni" donne une idée de cette évolution au cours des trente dernières années en cherchant à quantifier le développement des différents secteurs qui constituent le secteur des services. "Le rendement total des services a plus que doublé au cours de cette période alors que, dans le secteur des affaires et de la finance, il a été multiplié quasiment par cinq." 12 En comparaison, le même tableau concernant la manufacture montre que ce secteur n'a augmenté que de 18,1% au cours de la même période avec de grandes variations selon les industries.
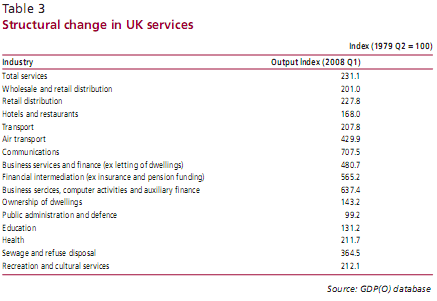
Changements structuraux dans les services au Royaume-Uni.
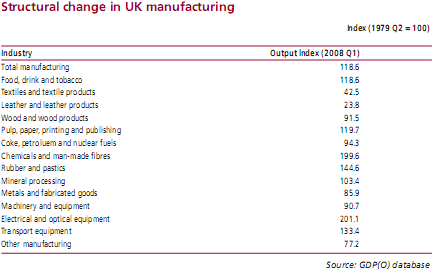
Changements structuraux dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni
Le secteur des services dans son ensemble est plus rentable que celui de la manufacture comme le montre le tableau ci-dessous. Au cours du premier trimestre 2010, le taux net de rendement dans la manufacture était de 6,4% et dans les services de 14,4%. Cependant, ce sont les taux de rendement les plus bas respectivement depuis 1991 et 1995.
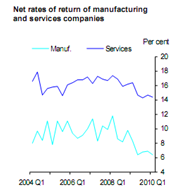
Taux net de rendement dans le secteur manufacturier et dans les services
La montée du secteur financier
Les chiffres publiés sur la profitabilité du secteur des services cités plus haut concernent les compagnies privées non financières et une caractéristique particulière de la situation en Grande-Bretagne est l'importance du secteur de la finance. Celui-ci nécessite donc un examen plus détaillé. Cinq des dix premières banques en tête par capitalisation en Europe en 2004, dont les deux premières, étaient basées en Grande-Bretagne. Globalement, les quatre plus grandes banques britanniques sont dans les sept premières mondiales (les banques américaines Citicorp et UBS sont les deux premières). Selon le directeur de la Stabilité financière à la Banque d'Angleterre : "La part du secteur financier du Royaume uni dans la production total a augmenté de 9% au dernier trimestre 2008. L'excédent brut d'exploitation des entreprises financières (la valeur ajoutée brute moins la compensation pour les employés et d'autres taxes sur la production) a augmenté de 5 milliards de livres à 20 milliards, ce qui est aussi la plus grande augmentation jamais enregistrée". 13 Ceci reflète la tendance en Grande-Bretagne depuis un siècle et demi : "Au cours des 160 dernières années, la croissance de l'intermédiation financière a dépassé l'ensemble de la croissance économique de plus de 2 points de pourcentage par an. Ou, dit autrement, la croissance de la valeur ajoutée du secteur financier a été plus du double de celle de l'ensemble de l'économie nationale au cours de la même période." 14 Alors qu'il représentait environ 1,5% des profits de l'économie entre 1948 et 1970, le secteur représente maintenant 15%. C'est un phénomène global avec des profits avant impôts sur les 1000 principales banques mondiales atteignant 800 milliards de livres en 2007-08, une augmentation de 150% depuis 2000-01. De façon cruciale, le rendement du capital dans le secteur bancaire a largement dépassé celui du reste de l'économie comme le montre le tableau ci-dessous.
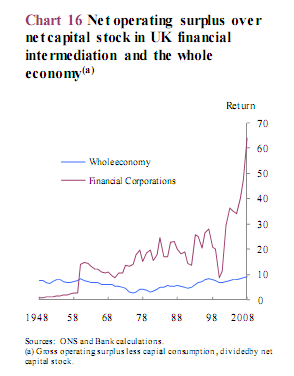
Le ratio de l'excédent net d'exploitation par rapport au capital net dans le secteur d'intermédiation financière et pour l'économie dans son ensemble au Royaume-Uni
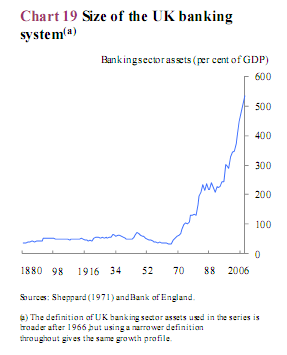
Taille du système bancaire au Royaume-Uni
Le poids du secteur bancaire au sein de l'économie peut se mesurer en comparant ses avoirs par rapport à l'ensemble du PIB du pays. On peut le voir dans le tableau ci-dessus. En 2006, les avoirs de la banque d'Angleterre dépassaient 500% du PIB. Aux Etats-Unis au cours de la même période, les avoirs sont passés de 20% à 100% du PIB, le poids du secteur bancaire en Grande-Bretagne est donc bien supérieur. Cependant son ratio de capital (c'est-à-dire le capital détenu par la banque relativement à celui qui est prêté) ne s'est pas maintenu, tombant de 15-25% au début du 20e siècle à 5% à la fin de celui-ci. Ceci s'est considérablement amplifié au cours de la dernière décennie. Juste avant le krach, le taux de couverture des principales banques était environ de 1 pour 50. Ceci souligne que l'économie globale s'est construite sur une tour de capital fictif au cours des dernières décennies. La crise de 2007 a menacé de faire basculer l'ensemble de l'édifice et cela aurait été catastrophique pour la Grande-Bretagne vu sa dépendance envers ce secteur. C'est pourquoi la bourgeoisie britannique a dû répondre comme elle l'a fait.
La nature du secteur des services
Cela vaut aussi la peine d'examiner de plus près le secteur des services. Il est réparti de différentes façons dans les publications officielles qui fournissent des informations plus ou moins détaillées. Ici, nous nous référerons à la liste des services qui sont cités dans le tableau présenté plus haut ("Changement structurel dans les services au Royaume-Uni"). Il faut toutefois noter à ce sujet que, parfois, la construction qui est une activité productive est incluse dans le secteur des services. La bourgeoisie enregistre la valeur que chaque industrie est supposée ajouter à l'économie, mais ça ne nous dit pas si elles produisent vraiment de la plus-value ou si, tout en remplissant une fonction nécessaire, elles n'ajoutent pas de valeur.
Certains de ces secteurs sont ce que Marx décrivait comme "les frais de circulation". 15 Il y distingue ceux qui sont liés à la transformation de la marchandise d'une forme en une autre, c'est-à-dire de la forme marchandise en monnaie ou vice-versa, et ceux qui sont la continuation du processus de production.
Les changements de forme de la marchandise, bien qu'ils fassent partie du processus global de la production n'ajoutent pas de valeur et constituent un coût sur la plus-value extraite. Dans la liste que nous examinons, sont inclus la distribution de détail et de gros (quand elle ne comprend pas le transport des marchandises – voir plus loin), les hôtels et les restaurants (dans la mesure où ils sont le point de vente de marchandises finies – la préparation des repas peut être considérée comme un processus productif produisant de la plus-value), une grande partie des télécommunications (quand elles sont concernées par l'achat de matières premières ou la vente de produits finis), les ordinateurs et services d’affaires (quand ils sont concernés par des activités telles que la commande et le contrôle des stocks et la stratégie de marché). Toute l'industrie du marketing et de la publicité, qui n'est pas signalée de façon distincte ici, tombe dans cette catégorie puisque son rôle est de maximaliser les ventes.
Marx défend que ces activités qui sont la continuation du processus productif incluent des activités comme le transport qui achemine la marchandise à son point de consommation, ou comme le stockage qui préserve la valeur de la marchandise. Ces activités tendent à augmenter le coût de la marchandise sans ajouter à sa valeur d'usage ; ce sont des coûts improductifs pour la société mais elles peuvent produire de la plus-value pour les capitalistes individuels. Dans notre liste, cette catégorie inclut le transport, la distribution de détail et en gros quand elles impliquent le transport ou le stockage des marchandises.
Un troisième domaine concerne les activités liées à l'appropriation d'une part de la plus-value grâce aux intérêts ou à la rente. Une grande part des activités dans les services d’affaires, la finance, l'intermédiation et les services financiers d’affaires, l'informatique (…) sont des aspects de l'administration de la Bourse et des banques où des honoraires et des commissions sont perçus ainsi que des intérêts. Les organismes financiers investissent aussi de l'argent et spéculent pour leur compte. La propriété des logements est probablement reliée à la location d'où l'enregistrement de plus-value sous forme de rente.
Un quatrième domaine est l'activité de l'Etat qui couvre la plus grande part des cinq derniers éléments de notre liste. Puisqu'ils se fondent sur la plus-value issue de la taxation de l'industrie, aucun ne produit de plus-value, bien que les commandes de l'Etat puissent produire des profits pour les entreprises individuelles. Dans la Revue internationale n° 114, nous soulignions que la façon dont "la bourgeoisie produit ses comptes nationaux [tend] à surestimer le PIB parce que la comptabilité nationale prend partiellement en compte deux fois la même chose. En effet, le prix de vente des produits marchands incorpore les impôts dont le montant sert à payer les dépenses de l'Etat, à savoir le coût des services non marchands (enseignement, sécurité sociale, personnel des services publics). L'économie bourgeoise évalue la valeur de ces services non marchands comme étant égale à la somme des salaires versés au personnel qui est chargé de les produire. Or, dans la comptabilité nationale, cette somme est rajoutée à la valeur ajoutée produite dans le secteur marchand (le seul secteur productif) alors qu'elle est déjà incluse dans le prix de vente des produits marchands (répercussion des impôts et des cotisations sociales dans le prix des produits)." 16
Si on prend l'ensemble du secteur des services, il est clair qu'il n'apporte pas à l'économie la valeur qu'on prétend. Certains services participent à réduire le total de plus-value produite, et les autres, ceux de la finance et des affaires en particulier, prennent leur part de la plus-value produite, y compris lorsqu'elle est produite dans d'autres pays.
Quelles sont les raisons du changement de structure de l'économie britannique ? D'abord, une augmentation de la productivité signifie qu'une masse croissante de marchandises est produite par un nombre de plus en plus faible d'ouvriers. C'est la réalité que montrent les chiffres de Bilan cités plus haut. Deuxièmement, l'augmentation de la composition organique et la chute du taux de profit ont pour résultat que la production se déplace vers des régions où les coûts du travail et du capital constant sont plus bas. 17 Troisièmement, les mêmes facteurs poussent le capital à orienter ses activités là où les rendements sont plus forts, notamment le secteur financier et bancaire dans lequel la domination de longue date de la Grande-Bretagne (Bilan parlait de la Grande-Bretagne comme du "banquier mondial") lui permettait d'extraire plus de plus-value. La dérégulation de ce secteur dans les années 1980 n'a pas réduit les coûts mais a renforcé la domination des principales banques et des compagnies financières, et la dépendance de la bourgeoisie vis-à-vis des profits qu'elles produisent. Quatrièmement, avec l'augmentation de la masse de marchandises, augmente aussi la contradiction entre l'échelle de la production et la capacité des marchés, ce qui mobilise davantage de ressources pour transformer le capital de sa forme de marchandise en sa forme d'argent. Cinquièmement, la complexité croissante de l'économie et des contraintes sociales a pour conséquence le développement de l'Etat qui doit gérer l'ensemble de la société dans l'intérêt du capital national. Ceci inclut les forces de contrôle direct, mais aussi les secteurs de l'Etat qui ont pour tâche de produire des ouvriers qualifiés, de les maintenir à peu près en bonne santé et de gérer les différents problèmes sociaux qui surgissent dans une société d'exploitation.
Conclusion
Deux conclusions quelque peu contradictoires peuvent être tirées de cette partie du rapport. La première et la plus importante est que l'évolution du capitalisme britannique l'a exposé de plein fouet à la crise lorsqu'elle a éclaté et il y a eu un vrai danger que l'effondrement du secteur financier paralyse l'économie. La perspective était à une accélération aiguë du déclin du capitalisme britannique avec toutes ses conséquences au niveau économique, impérialiste et social. Dire que la bourgeoisie britannique était au bord de l'abîme en 2007 et 2008 n'est pas une exagération. La réponse que la classe dominante a apportée confirme qu'elle est toujours capable et déterminée ; elle a uni toutes ses forces pour faire face au danger immédiat ; pour les conséquences à plus long terme c'est autre chose.
La seconde conclusion est que ce serait une erreur de négliger les secteurs manufacturiers et de penser que la Grande-Bretagne n'a quasiment plus d'industrie. Deux raisons à cela. D'abord, le secteur industriel participe toujours de façon importante à l'économie dans son ensemble, même si le taux de profit y est plus bas. La contribution de 17% ou même 11,6% à l'économie totale n'est pas insignifiante (et est en réalité probablement plus grande une fois que les composantes non productives des services sont prises en compte). De plus, même si dans ce secteur la balance commerciale est négative depuis des décennies, la production constitue une composante importante des exportations de la Grande-Bretagne. Deuxièmement, la crise actuelle met à nu le danger de ne s'appuyer que sur une partie de l'économie. Cela explique pourquoi le gouvernement de Cameron met en avant le rôle que la manufacture peut jouer dans une reprise économique et pourquoi la promotion du commerce britannique est devenue récemment une priorité de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Que celle-ci soit réaliste est une autre question car elle requiert une attaque sur les coûts de production plus importante que tout ce qui a été fait par Thatcher et ira contre les tendances historique et immédiate de l'économie globale. La Grande-Bretagne ne peut entrer directement en compétition avec la Chine et ses semblables, aussi devra-t-elle trouver des créneaux particuliers.
Tout cela nous amène à la question : "quel espoir de reprise économique ?"
IV. Quel espoir de reprise économique ?
Le contexte global
"... des données récentes indiquent que la reprise globale ralentit après une reprise initiale relativement rapide. La production occidentale est toujours bien en dessous des tendances d'avant 2008. Le chômage obstinément haut aux Etats-Unis gâche des vies et aigrit la politique. L'Europe a frôlé la déroute d'une seconde crise mondiale en mai lorsque ses principales économies ont accepté de renflouer la Grèce et d'autres pays très endettés risquant le défaut de leur dette souveraine. Le Japon est intervenu sur le marché des monnaies pour la première fois en six ans pour arrêter une montée du yen mettant en péril ses exportations." Cette citation du Financial Times 18 à la veille de la réunion biannuelle du FMI et de la Banque mondiale début octobre reflète les préoccupations de la bourgeoisie.
On peut constater que les plans de reprise en Europe ont jusqu'à présent échoué à produire de forts taux de croissance et on doit souligner avant tout l'augmentation de la dette publique qui, dans certains pays, a amené à mettre en question la capacité de l'Etat à rembourser ses dettes. La Grèce est aux avant-postes de ce groupe de pays, mais la Grande-Bretagne fait aussi partie de ceux dont le niveau d'endettement présente un risque. Le graphique ci-dessous, malgré son intitulé rassurant, montre qu'aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, le niveau d'endettement présente un risque. La Grande-Bretagne n'a peut-être pas un niveau de dette aussi considérable que d'autres (axe horizontal), mais son déficit courant est le plus élevé (axe vertical), indiquant à quelle rapidité elle a récemment accumulé de la dette.
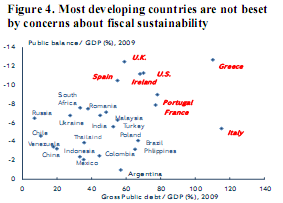
La plupart des pays en voie de développement n'ont pas de problème de viabilité fiscale
Deux stratégies distinctes ont été adoptées pour faire face à la récession : celle qui a les faveurs des Etats-Unis et consiste à poursuivre l'endettement et celle qui est de plus en plus adoptée en Europe consistant à diminuer les déficits en imposant des programmes d'austérité. Les Etats-Unis sont en position de mener cette politique parce que le dollar continue à être la monnaie de référence, ce qui leur permet de financer leur déficit en imprimant des billets, une option à laquelle leurs rivaux ne peuvent recourir. Les autres pays sont plus contraints par leur dette et ce fait en lui-même apporte des éléments de réponse à la question qui se pose concernant les limites de l'endettement. Une évolution récente au niveau international a été l'augmentation des efforts pour utiliser les taux de change afin d'être plus compétitif, ce qui est crucial pour utiliser les exportations en vue de restaurer la situation économique d'un pays. Une deuxième cause est la lutte qui oppose les pays excédentaires aux pays déficitaires sur la question des taux de change. Elle s'exerce entre la Chine et les Etats-Unis où la dévaluation du dollar par rapport au yuan non seulement réduirait la compétitivité des marchandises chinoises mais dévaluerait également ses énormes avoirs en dollars américains (c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine a utilisé une partie de ses réserves pour acheter des avoirs dans différents pays, y compris en GB). La politique d'assouplissement monétaire ("quantitative easing", QE) joue un rôle dans la dévaluation des monnaies puisqu'elle participe d'augmenter la création de monnaie, ce qui donne un nouvel éclairage à l'annonce récente par le Japon d'un nouveau round sur le QE. Les Etats-Unis et la GB envisagent la même chose. Ce que cela implique, c'est une perte de l'unité qu'on a connue en pleine crise et son remplacement par l'attitude du chacun pour soi. Un journaliste du Financial Times commentant ces événements écrivait récemment : "Comme dans les années 1930, tout le monde cherche à sortir de la crise grâce aux exportations ce que, par définition, tous ne peuvent faire. Aussi des déséquilibres globaux se développent à nouveau, comme le risque de protectionnisme." 19 Les pressions grandissent mais nous ne pouvons pas encore dire si la bourgeoisie y succombera.
Ce que cela signifie, c'est que toutes les options sont porteuses de véritables dangers et qu'il n'existe pas de sortie évidente de la crise. Le manque de demande solvable va renouveler la pression qui a mené à l'escalade de l'endettement et va réanimer les réflexes protectionnistes qui avaient été depuis longtemps contenus, tandis que les politiques d'austérité risquent de réduire encore la demande et de provoquer une nouvelle récession, un plus grand protectionnisme et de renforcer la pression pour un retour à l'utilisation de l'endettement. Dans cette perspective, le recours à de nouvelles dettes semble le plus évident dans l’immédiat puisque ce sera la poursuite des politiques des dernières décennies mais cela pose la question des limites de l'endettement et, si de telles limites existent, ce qu’elles sont et si nous les avons atteintes. Pour ce rapport, nous pouvons conclure des récents développements et de la crise qui a éclaté en Grèce qu'il existe des limites à l'endettement – ou, plutôt, un point où les conséquences d'une dette accrue se mettent à saper son efficacité et déstabiliser l'économie mondiale. Si la Grèce s'avérait incapable de rembourser, il y aurait non seulement une dépression sérieuse dans le pays, mais il y aurait également des perturbations sérieuses de tout le système financier international. La chute de la Bourse avant le renflouage de l'Europe et du FMI a montré la sensibilité de la bourgeoisie à cette question.
Les options du capitalisme britannique
La bourgeoisie britannique est aux avant-postes de celles qui ont choisi l'austérité avec son plan pour éliminer le déficit en quatre ans, ce qui requiert une coupe d'environ ¼ des dépenses de l'Etat. Au-delà du secteur étatique, son plan de suppression des allocations pour rendre le travail plus attractif a clairement pour objectif de baisser le coût du travail dans toute l'économie afin d'augmenter la compétitivité et la profitabilité du capitalisme britannique. Elle présente cela sous le drapeau de l'intérêt national et cherche à suggérer que la crise est la faute du gouvernement travailliste et pas du capitalisme.
Nous avons analysé, dans des rapports antérieurs, que le capitalisme britannique avait récemment produit de la plus-value en augmentant le taux d'exploitation absolue de la classe ouvrière et avait réalisé cela au moyen d'une augmentation de la dette, en particulier de la dette privée alimentée par le boom immobilier et l'explosion des prêts non sécurisés. Sur cette base, le rapport du dernier congrès de la section en Grande-Bretagne soulignait l'importance du secteur des services et le présent rapport le confirme tout en précisant que ce n'est pas l'ensemble du secteur qui est concerné mais celui des finances. Dans ce cadre, cela vaut la peine d'examiner comment les trois éléments de réponse à la crise – l'endettement, l'austérité et les exportations – se présentent dans la situation rencontrée par la Grande-Bretagne.
Avant la crise, l'endettement des ménages a été à la base de la croissance économique pendant plusieurs années, à la fois directement à travers la dette accumulée par les ménages britanniques et indirectement à travers le rôle des institutions financières dans le marché global de la dette. Avec l'éclatement de la crise, l'Etat s'est endetté pour protéger les institutions financières et, dans une bien moindre mesure, pour protéger les ménages (l'augmentation de la protection de l'épargne jusqu'à 50 000 £), tandis que la croissance de l'endettement des ménages déclinait et que certaines personnes se trouvaient insolvables. A présent, le niveau de l'endettement privé diminue légèrement tandis que l'épargne augmente et que le gouvernement a annoncé qu'il était déterminé à diminuer le déficit de moitié. A moins qu'il n'y ait un renversement, il semble peu probable que l'endettement puisse contribuer en quoi que ce soit à la reprise. L'austérité qui se profile peut avoir deux effets sur la classe ouvrière. D'une part, elle peut amener beaucoup de travailleurs à limiter leurs dépenses et à chercher à rembourser leurs dettes afin de se protéger. D'autre part, elle peut en amener d'autres à s'endetter pour boucler les fins de mois. Cependant, ce dernier cas de figure serait certainement limité par la réticence des banques à prêter. Le secteur financier était dépendant du développement de la dette globale pour la plus grande part de sa croissance avant le krach et, à présent, il y a des tentatives de trouver des alternatives, qui se concrétisent par exemple par l'activité accrue dans le marché alimentaire. Cependant ce type d'activités continue à dépendre en dernière instance de la présence d'une demande solvable, ce qui nous ramène au point de départ. Si les Etats-Unis continuent sur le chemin d'une augmentation de l'endettement, le capital britannique pourrait en bénéficier étant donné sa position au sein du système financier global, ce qui semble indiquer que, malgré toute la rhétorique d'un Vince Cable 20 et ses semblables, aucune action ne sera entreprise pour freiner les banquiers et que la stratégie de dérégulation initiée sous Thatcher continuera.
L'austérité semble être actuellement la stratégie principale. Le but avoué est de réduire le déficit, avec la promesse implicite qu'après, les choses reviendront à la normale. Mais pour avoir un quelconque impact durable sur la compétitivité du capital britannique, des changements durables devront avoir lieu. Les espoirs peuvent être placés dans une grande augmentation de la productivité mais cela ne s'est pas concrétisé depuis des décennies. Cela n'arrivera probablement pas, à moins qu'il y ait un investissement substantiel dans les domaines liés à une productivité croissante, comme la recherche et le développement, l'éducation et l'infrastructure. Ce qui est déjà évident, c'est qu'il y a des coupes dans ces domaines, aussi l'effort le plus probable sera de réduire en permanence la proportion de plus-value engrangée par l'Etat et la proportion de la valeur totale assignée à la classe ouvrière. Bref, une réduction de la taille de l'Etat et des salaires plus bas. Cependant, pour être efficace, les attaques contre la classe ouvrière devront être massives et la réduction de la taille de l'Etat va à l'encontre de la tendance que nous avons connu au cours de la période de décadence au sein de laquelle l'Etat doit accroître sa domination sur la société afin de défendre ses intérêts économiques et impérialistes et d'empêcher les contradictions au cœur de la société bourgeoisie de la faire éclater.
Les exportations ne peuvent jouer un rôle que si la bourgeoisie réussit à rendre le capital britannique plus compétitif. Tous ses rivaux font de même. Le secteur des services en Grande-Bretagne rapporte et il serait possible d'augmenter son niveau relativement bas d'exportations. Mais l'ennui c'est que les parties les plus rentables de ce secteur semblent être celles qui sont liées au système financier ce qui rend son développement dépendant d'une reprise globale.
Pour résumer, il n'y a pas de voie facile pour le capitalisme britannique. La direction la plus probable semble être de continuer à s'appuyer sur sa position au sein du système financier global en même temps qu'un programme d'austérité pour soutenir les profits. A long terme cependant, il ne peut que se trouver face à une détérioration continue de sa position.
V. Les conséquences de la crise sur la classe ouvrière
L'impact de la crise sur la classe ouvrière fournit la base objective pour notre analyse de la lutte de classe. Cette partie se concentrera sur la situation matérielle de la classe ouvrière. Les questions de l'offensive idéologique de la classe dominante et du développement de la conscience de classe seront traitées dans d'autres parties du rapport (...)
L'un des impacts immédiats de la crise sur la classe ouvrière a été une augmentation du chômage. Le taux a augmenté sans interruption durant la plus grande partie de 2008 et 2009, augmentant de 842 000 et atteignant 2,46 millions ou 7,8% de la population active. Cependant, c'est en-dessous des augmentations connues au cours des récessions des années 1980 et 90, quand les taux ont augmenté respectivement jusqu'à 8,9% (une augmentation de 932 000) et 9,2% (une augmentation de 622 000), ceci en dépit du fait que la chute du PIB ait été supérieure dans la récession actuelle à celle des précédentes.
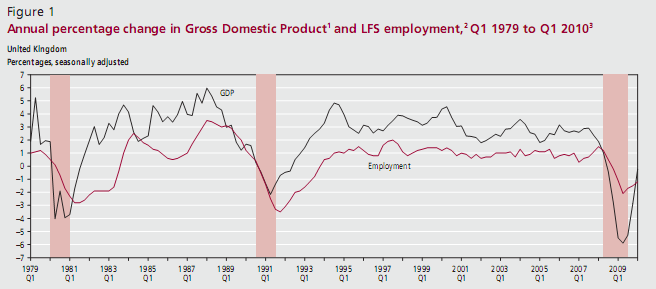
Variation annuelle du PIB et de l'emploi (chiffres 'Labour Force Survey') du premier trimestre 1979 au premier trimestre 2010
Une étude récente indique que la chute du PIB pendant cette récession aurait pu donner lieu à une augmentation supplémentaire du chômage de l’ordre d’un million 21 ; on peut se demander pourquoi cela n'est pas arrivé. L'étude citée avance que c'est dû au fait de "la forte position financière des entreprises au début de la récession et du resserrement financier plus modéré sur les entreprises au cours de cette récession" ce qui à son tour est dû à trois facteurs : "Premièrement, les politiques d'assistance du système bancaire, la baisse des taux d'intérêt et le grand déficit gouvernemental, créant un fort stimulant. Deuxièmement, la flexibilité des ouvriers qui a permis une véritable diminution des coûts salariaux pour les entreprises, accompagnée par des taux d'intérêt bas qui ont soutenu la croissance du salaire réel des consommateurs. Enfin, le fait que les entreprises se sont abstenues de licencier la main d'œuvre qualifiée tout en faisant face à la pression sur les profits et à la sévérité de la crise financière."
La baisse des coûts salariaux est attestée par les faits et elle a été réalisée grâce à la réduction des heures travaillées (et donc payées) et à une augmentation des salaires inférieure à l'inflation. Le travail à temps partiel a augmenté depuis la fin des années 1970 où il constituait un peu plus de 16% de la force de travail, et a atteint 22% en 1995. Au cours de cette récession il s'est encore accru et la majorité des travailleurs à temps partiel le sont parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. 22 Le nombre de personnes sous-employées dépasse le million. Il y a eu une légère chute de la moyenne des heures de travail par semaine, de 32,2 à 31,7 mais sur l'ensemble de la force de travail, cela équivaut à 450 000 emplois basés chacun sur la moyenne de la durée du travail dans le pays.
La réduction des salaires réels provient à la fois d'accords sur les salaires défavorables aux salariés et de la montée de l'inflation. Le résultat est que les entreprises ont économisé 1% des coûts salariaux réels.
Mais ce n'est pas tout. Alors qu'on a vu dans les dernières années des efforts pour radier les gens du système d'allocations, cette tendance ne s'est pas accentuée au cours de la récession. En fait, l'utilisation de l'allocation d'incapacité ou autre continue à permettre de masquer le chômage comme le montre le graphique ci-dessous.
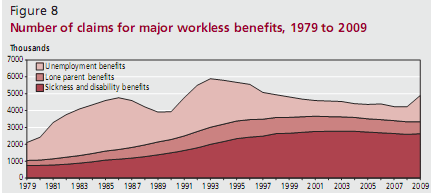
Evolution du nombre de demandes des principales allocations chômage
De plus, au cours des deux dernières récessions, le chômage a continué à augmenter longtemps après que, formellement, la récession fut terminée. Dans les années 1980, il a fallu 8 ans pour que les niveaux de chômage retrouvent ceux qui avaient précédé la récession, et dans les années 1990, presque 9. Alors que le taux d'augmentation du chômage dans la présente récession pourrait se stabiliser plus rapidement que dans les deux précédentes, il y a de bonnes raisons de penser que ce ne pourrait être qu’un interlude temporaire. En effet, non seulement les mesures d'austérité prévoient le licenciement de centaines de milliers de fonctionnaires, mais aussi la récession en W (double plongée) que ces mesures pourraient provoquer, en plus de l'incertitude de la situation générale, signifie que le chômage pourrait bien recommencer à augmenter. On considère qu'il faudrait des taux de croissance annuels de 2% pour que l'emploi augmente et de 2,5% en cas d'une modeste augmentation de la population. Or de tels taux ne font pas partie des projections pour le futur.
Ceux qui se retrouvent au chômage y restent plus longtemps puisque le nombre d'emplois vacants est substantiellement inférieur au nombre de ceux qui cherchent du travail. Plus la période de chômage dure, plus la probabilité est grande qu'un chômeur qui a trouvé du travail connaîtra de nouveau le chômage dans le futur. Début 2010, 700 000 personnes étaient dans la catégorie chômeur de longue durée, n'ayant pas travaillé depuis 12 mois ou plus. Il vaut la peine de souligner ici l'impact du chômage sur la population : "Une indication des coûts réels de cette flexibilité a été fournie par une étude récente de l'impact de la récession sur la santé mentale. Elle montrait que 71% des personnes ayant perdu leur emploi l'an dernier ont connu des symptômes de dépression, les plus affectés ayant entre 18 et 30 ans. La moitié d'entre eux dit avoir connu le stress et l'anxiété." 23
Un aspect de la réduction des salaires et de l'aggravation générale des conditions de vie est une chute de la consommation. Bien que certaines des études citées avancent que celle-ci s’est réduite faiblement, d'autres affirment qu'il y a eu une chute de 5% au cours de 2008 et 2009. Evidemment, pour la plupart des gens, ce n'est pas une question de choix mais la simple conséquence de la perte d’emploi, d'une diminution des heures de travail ou d'une baisse directe du salaire.
Les chiffres officiels montrent une chute de la pauvreté chez les enfants et les retraités au cours de la période du gouvernement travailliste, le niveau de vie moyen augmentant par ailleurs de 2% par an. Cependant, il y a eu un ralentissement ces dernières années. En même temps l'inégalité a augmenté et la pauvreté chez les adultes en âge de travailler est à son plus haut niveau depuis 1961. 24 Globalement, la pauvreté relative s'est accrue entre 1% et 1,8% (ce qui représente entre 0,9 et 1,4 million de personnes) pour atteindre 18,1% ou 22,3% (la différence des estimations résulte de l'inclusion ou non des coûts du logement).
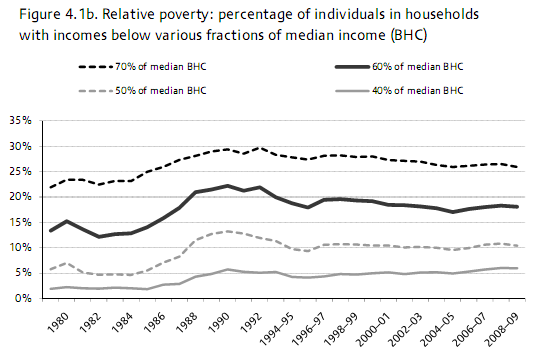
La pauvreté relative: pourcentage d'individus dans des ménages dont le revenu se situe en-deça de diverses fractions du revenu médian
Bien qu'il y ait eu récemment un léger déclin du niveau d'endettement personnel (au rythme de 19 pence par jour), en juillet de cette année le taux de croissance annuel était toujours de 8% et le total de la dette de 1 456 milliards de livres 25, ce qui, comme nous l'avons souligné auparavant, est supérieur à la production annuelle totale du pays. Cette somme inclut 1 239 milliards de livres de prêts sécurisés pour le logement et 217 milliards de crédit à la consommation. On estime qu'une famille moyenne doit dépenser 15% de son revenu net à rembourser ses dettes.
Ceci a eu pour résultat l'augmentation des banqueroutes personnelles et des Arrangements Volontaires Individuels (IVA). Ces derniers sont passés, de façon significative, de 67 000 en 2005, à 106 000 en 2006 et 107 000 en 2008 avant de monter à nouveau pour atteindre 134 000 en 2009. Le premier trimestre de cette année a vu 36 500 IVA supplémentaires, ce qui, si cela devait continuer ainsi, signifierait une nouvelle augmentation. 26 Cette augmentation est très substantiellement supérieure à celle que nous avons vue au cours des précédentes récessions, bien que les changements légaux rendent difficiles les comparaisons directes. 27
A côté de la diminution de la croissance de la dette personnelle, l'ONS rapporte une évolution du taux d'épargne des ménages, passant de – 0,9% début 2008 à + 8,5% à la fin 2009. 28 Il semble que beaucoup d'ouvriers cherchent à se préparer pour les jours difficiles à venir.
Perspectives
Bien que l'impact de la crise sur la classe ouvrière soit plus important que les publications de la bourgeoisie tendent à la présenter, il a néanmoins été relativement contenu à la fois au niveau de l'emploi et du revenu. C'est dû en partie aux circonstances, en partie à la stratégie adoptée par la bourgeoisie - y compris à travers l'utilisation de l'endettement - et, en partie, à la réponse de la classe ouvrière qui semble s'être plus focalisée sur la façon de survivre à la récession que sur la nécessité de la combattre. Mais il est peu probable que cette situation continue. Premièrement, la situation économique globale va rester très difficile puisque la bourgeoisie est incapable de résoudre les contradictions fondamentales qui minent les fondements de son économie. Deuxièmement, la stratégie de la classe dominante britannique a maintenant évolué vers l'instauration de l'austérité, du fait, en partie, de la situation globale. Elle pourrait revenir à l'utilisation de la dette à court terme mais cela ne ferait qu'empirer les problèmes à plus long terme. Troisièmement, l'impact sur la classe ouvrière va s'accroitre dans la période à venir et contribuera à développer les conditions objectives pour l'essor de la lutte de classe.
10/10/2010
1 World Bank, Global Economic Prospects, été 2010, Key Messages.
2 Ibid.
3 La plupart des données de cette partie sont tirées de la Economic and Labour Market Review d'août 2010, publiée par le Bureau national des Statistiques (Office for National Statistics, ONS). D'autres chiffres proviennent du Blue Book qui traite des comptes nationaux de la Grande-bretagne, du Pink Book qui traite de la balance des paiements et de Financial Statistics ; tous sont publiés par L'ONS.
4 Economic and Labour Market Review, août 2010.
5 ONS, Pink Book, Edition 2010
6 Banque d’Angleterre, Inflation Report, février 2009.
7 "Les gilts, abréviation de gilt-edged securities, soit littéralement "valeurs mobilières dorées sur tranche", sont les emprunts d'État émis par le Royaume-Uni." (Wikipedia)
8 Financial Times, "That elusive spark" ("Cette étincelle insaisissable"), 06/10/2010
9 Ces chiffres sont tirés du Economic and Labour Market Review, septembre 2010. La revue reprend les prévisions pour la zone euro et l'OCDE de l'Economic Outlook de l'OCDE de novembre 2009.
10 Blue Book 2010
11 Ibid.
12 Economic and Labour Market Review, août 2010
13 Andrew Haldane, "The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage", Banque d'Angleterre, juillet 2010.
14 Ibid.
15 Voir Le Capital, livre II, chapitre IV, "Les frais de circulation"
16 Revue internationale n° 114, "Crise économique : Les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise".
17 On attribue au développement de la production en Chine et à d'autres producteurs à bas coût le maintien de la stabilité relative du taux de l'inflation globale au cours des dernières décennies ainsi que la réduction des coûts du travail dans le monde entier, y compris dans les pays développés, puisque le nombre d'ouvriers s'est massivement accru (il a été indiqué que l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale a doublé la main d'œuvre à disposition). Par conséquent, non seulement le taux de profit peut être plus élevé dans les pays à bas coût eux-mêmes, mais on peut également faire baisser le coût du travail et remonter le taux de profit dans les pays développés, ce qui résulte dans l'augmentation du taux de profit moyen que nous avons noté dans plusieurs numéros de la Revue internationale. Mais que cela suffise à créer la masse nécessaire de profit est une autre question.
18 "That elusive spark", 06/10/2010
19 John Plender, "Currency demands make a common ground elusive", 06/10/2010
20 Membre du Parti Libéral-Démocrate et actuellement secrétaire d'Etat pour l'Entreprise et l'Innovation ("Secretary of State for Business, Innovation and Skills") au sein du gouvernement de coalition Cameron-Clegg.
21 "Employment in the 2008-2009 recession", Economic and Labour Market Review, août 2010
22 Voir Economic and Labour Market Review, septembre 2010
23 Rapport original dans The Guardian, 01/04/2010
24 Institute for Fiscal Studies, Poverty and Inequality in UK, 2010.
25 Les chiffres de ce paragraphe proviennent de Debt Facts and Figures de septembre 2010 compilés par Credit Action.
26 Source : ONS, Financial Statistics, août 2010
27 Economic and Labour Market Review, août 2010. Entre 1979 et 1984, la hausse a été de 3 500 à 8 229, et entre 1989 et 1993, de 9 365 à 36 703.
28 Ibid.
Géographique:
- Grande-Bretagne [154]
Récent et en cours:
- Crise économique [153]
La révolution hongroise de 1919 : l'exemple de la Russie inspire des ouvriers hongrois (II)
- 5146 lectures
Dans ce second article nous verrons comment cette manœuvre échoua, et comment la situation révolutionnaire continuant de mûrir, le Parti social-démocrate lança une autre manœuvre aussi risquée mais qui finalement fut un succès pour le capitalisme : fusionner avec le Parti communiste, "prendre le pouvoir" et organiser "la dictature du prolétariat", ce qui bloqua le processus ascendant de lutte et d’organisation du prolétariat et le conduisit dans une impasse qui permit sa défaite totale.
Mars 1919 : crise de la République bourgeoise
La vérité sur l’affaire de l’assaut du journal finit bientôt par éclater. Les ouvriers se sentirent trompés et leur indignation grandit quand ils apprirent les tortures infligées aux communistes. La crédibilité du Parti social-démocrate en prit un sérieux coup. Tout ceci favorisait la popularité des communistes. Les luttes revendicatives se multipliaient depuis fin février, les paysans prenaient les terres sans attendre la sempiternelle promesse de "réforme agraire"2, l’affluence aux réunions du Conseil ouvrier de Budapest grandissait et des discussions tumultueuses portaient des critiques acerbes aux dirigeants sociaux-démocrates et syndicaux. La République bourgeoise, qui avait suscité tant d’illusions en octobre 1918, décevait à présent. Les 25 000 soldats rapatriés des champs de bataille étaient enfermés dans leurs casernes et organisés en conseils ; la première semaine de mars, non seulement les assemblées de casernes renouvelaient leurs représentants – avec une augmentation significative de délégués communistes – mais, en outre, votaient des motions par lesquelles il était affirmé qu’"il ne sera obéi aux ordres du gouvernement que s’ils ont préalablement été ratifiés par le Conseil de soldats de Budapest".
Le 7 mars, une session extraordinaire du Conseil ouvrier de Budapest adopta une résolution qui "exigeait la socialisation de tous les moyens de production et le passage de leur direction aux conseils". Même si la socialisation sans destruction de l’appareil d’État bourgeois ne peut être qu'une mesure boiteuse, cet accord exprimait cependant la grande confiance en soi des conseils et était une réponse à deux questions pressantes : 1) le sabotage effectué par le patronat sur une production totalement désorganisée par l’effort de guerre ; 2) la terrible pénurie de vivres et de produits de première nécessité.
Les événements se radicalisent. Le Conseil ouvrier des métallos lance un ultimatum au gouvernement : il lui accorde cinq jours pour céder le pouvoir aux partis du prolétariat 3. Le 19 mars se déroule la plus grande manifestation ayant eu lieu jusqu’alors, convoquée par le Conseil ouvrier de Budapest ; les chômeurs revendiquent une allocation et une carte de ravitaillement, ainsi que la suppression des loyers. Le 20, les typographes partent en grève, et celle-ci se généralise dès le lendemain avec deux revendications : libération des dirigeants communistes et "gouvernement ouvrier".
Si ces faits démontrent la maturation d’une situation révolutionnaire, ils mettent aussi en évidence que celle-ci était encore loin du niveau politique qui permet au prolétariat de se lancer à l’assaut du pouvoir. Pour le prendre et le conserver, le prolétariat doit compter sur deux forces indispensables : les conseils ouvriers et le parti communiste. En mars 1919, les conseils ouvriers en Hongrie n'en étaient qu'à leurs premiers pas, ils commençaient à peine à sentir leur force et leur autonomie et ils en étaient encore à tenter de se libérer de la tutelle étouffante de la social-démocratie et des syndicats. Leurs deux principales faiblesses étaient :
– leurs illusions sur la possibilité d’un "gouvernement ouvrier" qui unirait les sociaux-démocrates et les communistes, ce qui, comme nous le verrons, sera le tombeau du développement révolutionnaire ;
– leur organisation était encore celle des secteurs économiques : conseils de métallos, de typographes, d’ouvriers du textile, etc. En Russie, depuis 1905, l’organisation des conseils était totalement horizontale, organisant les ouvriers comme un tout par-dessus les divisions par secteur, région, nationalité, etc. ; en Hongrie coexistent les conseils sectoriels et les conseils horizontaux par villes, avec les dangers que cela représente au niveau du corporatisme et de la dispersion.
Nous soulignions dans le premier article de cette série que le Parti communiste était encore très faible et hétérogène, que le débat commençait à peine à se développer en son sein. Il souffrait de l’absence d’une structure internationale solide pour le guider – l’Internationale communiste célébrait à peine son Premier Congrès. Pour ces raisons, comme nous allons le voir, il manifesta une énorme faiblesse et une absence de clarté qui fera de lui une victime facile du piège que lui tendra la social-démocratie.
La fusion avec le Parti social-démocrate et la proclamation de la République soviétique
Le colonel Vix, représentant l’Entente4, remet un ultimatum dans lequel il est stipulé la création d’une zone démilitarisée dans le territoire hongrois directement gouvernée par le commandement allié, d’une profondeur de 200 kilomètres, ce qui revient à occuper la moitié du pays.
La bourgeoisie n’affronte jamais le prolétariat à visage découvert ; l’histoire nous enseigne qu’elle tente de le prendre entre deux feux, la gauche et la droite. Nous voyons là comment la droite ouvre le feu avec la menace de l’occupation militaire, qui se concrétisera par l’invasion en bonne et due forme dès le mois d’avril. De son côté, la gauche entre en action dès le lendemain à partir d’une déclaration pathétique du Président Karolyi : "La patrie est en danger. L'heure la plus grave de notre histoire a sonné. (…) Le moment est venu où la classe ouvrière hongroise, avec sa force, la seule force organisée du pays, et avec ses relations internationales, doit sauver la patrie de l'anarchie et de la mutilation. Je vous propose donc un gouvernement social-démocrate homogène qui fera face aux impérialistes. Il s'agira d'une lutte dont l'enjeu est le sort de notre pays. Pour mener à bien cette lutte, il est indispensable que la classe ouvrière retrouve son unité, et que l'agitation et le désordre provoqués par les extrémistes cessent. A cette fin les sociaux-démocrates doivent trouver un terrain d'entente avec les communistes" 5.
Le feu croisé contre la lutte de classe de la droite, avec l’occupation militaire, et de la gauche, avec la défense nationale, convergent vers le même objectif : sauver la domination capitaliste. L’occupation militaire – le pire affront que puisse souffrir un État national – a comme objectif réel l’écrasement des tendances révolutionnaires du prolétariat hongrois. En outre, elle offre la possibilité à la gauche d’encadrer les ouvriers vers la défense de la patrie. C’est un piège qui s’était déjà présenté en octobre 1917 en Russie quand, confrontée à son incapacité à écraser le prolétariat, la bourgeoisie russe avait préféré que les troupes allemandes occupent Petrograd. La classe ouvrière déjoua alors habilement cette manœuvre en s'engageant dans la prise de pouvoir. Dans le sillage du comte Karolyi, le social-démocrate de droite Garami expose la stratégie à suivre : "confier le gouvernement aux communistes, attendre leur faillite totale et alors, alors seulement, dans une situation libérée de ces déchets de la société, nous pourrons former un gouvernement homogène" 6. L’aile centriste du Parti 7 précisait cette politique : "Constatant en effet que la Hongrie se trouve être sacrifiée par l'Entente, qui manifestement a décidé de liquider la Révolution, il en résulte que les seuls atouts dont celle-ci dispose sont la Russie soviétique et l'Armée rouge. Pour obtenir l'appui de ces dernières, il faut que la classe ouvrière hongroise soit effectivement maîtresse du pouvoir et que la Hongrie soit une véritable république populaire et soviétique." Et elle ajoutait "pour éviter que les communistes n'abusent du pouvoir, il vaut mieux le prendre avec eux !" 8.
L’aile gauche du Parti social-démocrate défend une position prolétarienne et tend à converger vers les communistes. Face à elle, les droitiers de Garami et les centristes de Garbai manœuvrent avec habileté. Garami démissionne de toutes ses responsabilités. L’aile droite se sacrifie en faveur de l’aile centriste qui "se déclarant favorable au programme communiste" parvient à séduire la gauche 9.
Après ce virage, la nouvelle direction centriste propose la fusion immédiate avec le Parti communiste et rien de moins que la prise de pouvoir ! Une délégation du Parti social-démocrate se rend à la prison erncontrer Bela Kun et lui propose la fusion des deux partis, la formation d’un "parti ouvrier", l’exclusion de tous les "partis bourgeois" et l’alliance avec la Russie. Les conversations durent à peine une journée au terme de laquelle Bela Kun rédige un protocole en six points parmi lesquels sont soulignés "Les comités directeurs du Parti social-démocrate Hongrois et du Parti Communiste Hongrois ont décidé l'unification totale et immédiate de leurs organisation respectives. Le nom de la nouvelle organisation sera Parti Socialiste Unifié de Hongrie (PSUH). (…) Le P.S.U.H. prend immédiatement le pouvoir au nom de la dictature du prolétariat. Cette dictature est exercée par les conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. Il n'y aura plus d'Assemblée Nationale (…) Une alliance militaire et politique la plus complète possible sera conclue avec la Russie" 10.
Le Président Karolyi, qui suit de près les négociations, présente sa démission et fait une déclaration adressée "au prolétariat du monde pour obtenir aide et justice. Je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat du peuple de Hongrie" 11.
Lors de la manifestation du 22 mars, "l’ex-homo-regius, le ci-devant archiduc François-Joseph, tel Philippe Egalité, lui aussi viendra se ranger aux côtés des ouvriers, au cours de la manifestation" 12. Le nouveau gouvernement, formé dès le lendemain, avec Bela Kun et d'autres dirigeants communistes récemment libérés, est présidé par le social-démocrate centriste Garbai 13. Il dispose d’une majorité centriste avec deux postes réservés à l’aile gauche et deux autres aux communistes, parmi lesquels Bela Kun. Alors commence une opération à haut risque qui consiste à prendre les communistes en otages de la politique social-démocrate et à saboter les conseils ouvriers à peine naissants avec le cadeau empoisonné de la "prise de pouvoir". Les sociaux-démocrates laisseront le rôle principal à Bela Kun qui – totalement pris au piège – deviendra le porte-voix et la caution de toute une série de mesures qui ne feront que le décrédibiliser 14.
"L’unité" crée la division des forces révolutionnaires
La proclamation du parti "unifié" parvint en premier lieu à stopper le rapprochement des sociaux-démocrates de gauche et des communistes, habilement séduits par la radicalisation des centristes. Mais le pire fut l’ouverture d’une boîte de Pandore parmi les communistes qui se divisèrent en plusieurs tendances. La majorité, autour de Bela Kun, se transforma en otage des sociaux-démocrates ; une autre tendance se forma autour de Szamuelly, demeurant dans le parti mais tentant de mener une politique indépendante ; la majorité des anarchistes se séparèrent, formant l’Union anarchiste qui soutiendra cependant le gouvernement avec une posture d’opposition 15.
Le Parti, formé quelques mois auparavant et qui commençait à peine à développer une organisation et une intervention, se volatilisa complètement. Le débat devint impossible et une confrontation permanente opposait ses anciens membres. Celle-ci ne se basait pas sur des principes ou une analyse indépendante de la situation, mais était toujours à la remorque de l’évolution des événements et des subtiles manœuvres auxquelles se livraient les centristes sociaux-démocrates.
La désorientation sur la réalité de la situation en Hongrie affecta même un militant aussi expérimenté et lucide que Lénine. Dans ses œuvres complètes apparaît la transcription des discussions avec Bela Kun des 22 et 23 mars 1919 (16). Lénine demande à Bela Kun : "Ayez la bonté de communiquer quelles garanties réelles avez-vous pour que le nouveau Gouvernement hongrois soit effectivement communiste et non pas seulement socialiste, c’est-à-dire social-traître. Les communistes ont-ils la majorité dans le Gouvernement ? Quand se tiendra le Congrès des conseils ? En quoi consiste réellement la reconnaissance de la dictature du prolétariat par les socialistes ?". Lénine pose les questions élémentaires correctes. Cependant, comme tout repose sur des contacts personnels et non sur un débat collectif international, Lénine conclut : "Les réponses de Bela Kun furent pleinement satisfaisantes et dissipèrent nos doutes. Il en ressortait que les socialistes de gauche avaient rendu visite à Bela Kun en prison et eux seuls, sympathisants des communistes, ainsi que des personnes du centre, furent ceux qui formèrent le nouveau gouvernement, pensant que les socialistes de droite, les sociaux-traîtres pour ainsi dire, incorrigibles et intransigeants, abandonnèrent le parti sans être suivis par aucun ouvrier". On voit ici que Lénine était pour le moins mal informé ou n’évaluait pas correctement la situation, car le centre de la social-démocratie était majoritaire au gouvernement et les sociaux-démocrates de gauche étaient entre les mains de leurs "amis" du centre.
Emporté par un optimisme démobilisateur, Lénine conclut : "La propre bourgeoisie a donné le pouvoir aux communistes de Hongrie. La bourgeoisie a démontré au monde entier que lorsque survient une crise grave, quand la nation est en danger, elle est incapable de gouverner. Et le seul pouvoir réellement souhaité par le peuple est le pouvoir des Conseils de députés ouvriers, soldats et paysans".
Hissés au "pouvoir", les conseils ouvriers sont sabotés
Ce pouvoir n’existait réellement que sur le papier. En premier lieu, c’est le Parti socialiste unifié qui prend le pouvoir sans que le Conseil de Budapest ou aucun autre conseil du pays n’y participe en aucune façon (17). Même si le Gouvernement se déclare formellement "subordonné" au Conseil ouvrier de Budapest, dans la pratique, c’est lui qui présente les décrets, ordres et décisions de toutes sortes comme des faits avérés, par rapport auxquels le Conseil ne dispose que d’un relatif droit de veto. Les conseils ouvriers sont pris dans le corset faisandé de la pratique parlementaire. "Les affaires du prolétariat continuèrent à être administrées – ou pour mieux dire sabotées – par l’ancienne bureaucratie et non par les conseils ouvriers eux-mêmes, qui ne parvinrent donc jamais à devenir des organismes actifs" 18.
Le coup le plus violent porté aux conseils est la convocation par le Gouvernement à des élections afin de constituer une "Assemblée nationale des Conseils ouvriers". Le système d’élections qu’impose alors le Gouvernement consiste à concentrer les élections sur deux dates (7 et 14 avril 1919), "suivant les modalités de la démocratie formelle (vote au scrutin de listes, avec isoloirs, etc.)" 19. C’est là la reproduction du mécanisme typique des élections bourgeoises, qui ne fait que saboter l’essence même des conseils ouvriers. Alors que dans la démocratie bourgeoise les organes élus sont le résultat d’un vote effectué par une somme d’individus atomisés et totalement séparés entre eux, les Conseils ouvriers supposent un concept radicalement nouveau et différent de l’action politique : les décisions, les actions à mener, sont pensées et discutées lors de débats auxquels participent d’énormes masses organisées, et celles-ci ne se contentent pas de prendre des décisions mais les mettent elles-mêmes en pratique.
Le triomphe de la manœuvre électorale n’est pas que le produit de l’habileté manœuvrière des sociaux-démocrates ; ceux-ci ne font qu’exploiter les confusions existantes non seulement parmi les masses mais aussi dans la propre majorité des militants communistes et particulièrement dans le groupe de Bela Kun. Des années de participation à des élections et au Parlement – activité nécessaire pour les progrès du prolétariat durant la période ascendante du capitalisme – avaient provoqué des habitudes et des visions liées à un passé définitivement révolu qui entravaient une riposte claire face à la nouvelle situation, laquelle exigeait la rupture complète avec le parlementarisme et l’électoralisme.
Le mécanisme électoral et la discipline du parti "unifié" font que "dans la présentation des candidats aux élections des conseils, les communistes durent défendre la cause des sociaux-démocrates et même ainsi, plusieurs ne furent pas élus", constate Szantó, qui ajoute que ceci permettait aux sociaux-démocrates de se livrer "au verbalisme révolutionnaire et communiste, afin d’apparaître plus révolutionnaires que les communistes !" 20.
Ces politiques provoquèrent une vive résistance. Les élections d’avril furent contestées dans le 8e district de Budapest, Szamuelly parvenant à faire annuler la liste officielle de son propre parti (!) et à imposer des élections se basant sur les débats lors d’assemblées massives, lesquelles donnèrent la victoire à une coalition de dissidents du propre PSUH et à des anarchistes, regroupés autour de Szamuelly.
D’autres tentatives de donner vie à d’authentiques conseils ouvriers eurent lieu à la mi-avril. Un mouvement de conseils de quartiers parvint à tenir une Conférence de ces derniers à Budapest qui critiqua sévèrement le "gouvernement soviétique" et avança toute une série de propositions quant à l’approvisionnement, la répression des contre-révolutionnaires, les rapports avec la paysannerie, la poursuite de la guerre et proposa – à peine un mois après les élections ! – une nouvelle élection des Conseils. Otage des sociaux-démocrates, Bela Kun apparût lors de la dernière session de la Conférence dans le rôle du pompier de service, son discours frisant la démagogie : "Nous sommes déjà tellement à gauche qu’il est impossible d’aller plus loin. Un tournant encore plus à gauche ne pourrait être qu'une contre-révolution" 21.
La réorganisation économique s’appuie sur les syndicats contre les conseils
La tentative révolutionnaire se heurtait au chaos économique, à la pénurie et au sabotage patronal. S’il est vrai que le centre de gravité de toute révolution prolétarienne est le pouvoir politique des conseils, ceci ne veut pas pour autant dire qu’ils doivent négliger le contrôle de la production. Même s’il est impossible de commencer une transformation révolutionnaire de la production vers le communisme tant que la révolution n'est pas victorieuse au niveau mondial, il ne faut pas en déduire que le prolétariat n’ait pas à mener une politique économique dès le début de la révolution. Celle-ci doit en particulier aborder deux questions prioritaires : la première est d’adopter toutes les mesures possibles en vue de diminuer l’exploitation des travailleurs et de garantir qu’ils disposent du maximum de temps libre pour pouvoir consacrer leur énergie à la participation active dans les conseils ouvriers. Sur ce plan, et sous la pression du Conseil ouvrier de Budapest, le Gouvernement adopta des mesures telles que la suppression du travail à la tâche et la réduction de la journée de travail, avec comme objectif de "permettre aux ouvriers de participer à la vie politique et culturelle de la révolution" 22. La seconde est la lutte pour l’approvisionnement et contre le sabotage, de sorte que la faim et le chaos économique inévitables ne sonnent le glas de la révolution. Confrontés à ce problème, les ouvriers créèrent dès janvier 1919 des conseils d’usine, des conseils sectoriaux et, comme nous l’avons vu dans le premier article de cette série, le Conseil de Budapest adopta un plan audacieux de contrôle de l’approvisionnement des produits de première nécessité. Mais le Gouvernement, qui devait s’appuyer sur eux, mena une politique systématique pour leur enlever le contrôle de la production et de l’approvisionnement, le confiant de plus en plus aux syndicats. Bela Kun commit alors de graves erreurs. Il déclara ainsi en mai 1919 : "L'appareil de notre industrie repose sur les syndicats. Ces derniers doivent s'émanciper davantage et se transformer en puissantes entreprises qui comprendront la majorité, puis l'ensemble des individus d'une même branche industrielle. Les syndicats prenant part à la direction technique, leur effort, tend à saisir lentement tout le travail de direction. Ainsi ils garantissent que les organes économiques centraux du régime et la population laborieuse travaillent en accord et que les ouvriers s'habituent à la conduite de la vie économique." 23. Roland Bardy commente cette analyse de façon critique : "Prisonnier d’un schéma abstrait, Bela Kun ne pouvait se rendre compte que la logique de sa position conduisait à redonner aux socialistes un pouvoir dont ils avaient été progressivement dépossédés (…) Durant toute une période, les syndicats seront le bastion de la social-démocratie réformiste et se trouveront constamment en concurrence directe avec les soviets" 24.
Le Gouvernement parvint à imposer que seuls les ouvriers et les paysans syndiqués auraient accès aux coopératives et aux économats de consommation. Ceci donnait aux syndicats un levier essentiel de contrôle. Bela Kun le théorisa : "le régime communiste est celui de la société organisée. Celui qui veut vivre et réussir doit adhérer à une organisation, aussi les syndicats ne doivent-ils pas faire des difficultés aux admissions" 25. Comme Bardy le signale : "Ouvrir le syndicat à tous était le meilleur moyen pour liquider la prépondérance du prolétariat en son sein et à long terme permettre le rétablissement "démocratique" de la société de classe" ; de fait, "les anciens patrons, rentier et, leurs grands valets ne participaient pas dans la production active (industrie et agriculture,) mais dans les services administratifs ou juridiques. Le gonflement de ce secteur permit à l’ancienne bourgeoisie de survivre en tant que classe parasite, et d’avoir accès à la répartition des produits, sans être intégrée cependant dans le processus productif, actif" 26. Ce système favorisa la spéculation et le marché noir, sans jamais parvenir à résoudre les problèmes de famine et de pénurie qui torturaient les ouvriers des grandes villes.
Le Gouvernement impulsa la formation de grandes exploitations agricoles régies par un système de "collectivisation". Ce fut une grande escroquerie. Des "Commissaires de production" furent placés à la tête des fermes collectives et ceux-là, quand ils n’étaient pas d’arrogants bureaucrates, étaient… les anciens propriétaires terriens ! Ces derniers occupaient d’ailleurs toujours leurs demeures et exigeaient des paysans qu’ils continuent à les appeler "maître".
Les Fermes collectives étaient supposées étendre la révolution dans les campagnes et garantir l’approvisionnement, mais elles ne firent ni l’un ni l’autre. Les travailleurs journaliers et les paysans pauvres, profondément déçus par la réalité des Fermes collectives, s’éloignaient de plus en plus du régime ; par ailleurs, leurs dirigeants exigèrent un troc que le gouvernement était incapable de tenir : fournir des produits agricoles en échange d’engrais, de tracteurs et de machines. Ils vendaient donc à des spéculateurs et à des accapareurs, ce qui eut pour conséquence que la faim et la pénurie parvinrent à de tels niveaux que le Conseil ouvrier de Budapest organisa désespérément la transformation des parcs et jardins en zones de culture agraires.
L’évolution de la lutte révolutionnaire mondiale et la situation en Hongrie
La seule possibilité permettant au prolétariat hongrois de briser le piège dans lequel il était tombé résidait dans l’avancée de la lutte du prolétariat mondial. La période qui va de mars à juin 1919 était porteuse de grands espoirs malgré le coup de massue qu’avait provoqué l’écrasement de l’insurrection de Berlin en janvier 27. En mars 1919 se constitue l’Internationale communiste, en avril est proclamée la République des conseils de Bavière qui finit tragiquement écrasée par le gouvernement social-démocrate. L’agitation révolutionnaire en Autriche, où se consolidaient les conseils ouvriers, fut aussi avortée par la manœuvre d’un provocateur, Bettenheim, qui incita le jeune parti communiste à une insurrection prématurée qui fut facilement écrasée (mai 1919). En Grande-Bretagne éclata la grande grève des chantiers navals de la Clyde, au cours de laquelle apparurent des conseils ouvriers et qui provoqua des mutineries dans l’armée. Des mouvements de grève apparurent en Hollande, Norvège, Suède, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, Italie et même aux États-Unis. Mais ces mouvements étaient encore trop embryonnaires. Cette situation conférait ainsi une marge de manœuvre importante aux armées de France et de Grande-Bretagne qui étaient restées mobilisées après la fin de la guerre mondiale et se chargeaient maintenant de la sale besogne de gendarmes et écrasaient les foyers révolutionnaires. Leur intervention se concentra sur la Russie (1918-20) et la Hongrie (dès avril 1919). Quand éclatèrent les premières mutineries dans l’armée et, confrontées aux campagnes qui se faisaient jour contre la guerre livrée à la Russie révolutionnaire, les troupes d’appelés furent rapidement remplacées par des troupes coloniales, bien plus résistantes face au prolétariat.
Contre la Hongrie, le commandement français tira les leçons du refus des soldats de réprimer l’insurrection de Szeged. La France resta au second plan et attisa les États voisins contre la Hongrie : la Roumanie et la Tchécoslovaquie seront le fer de lance de ces opérations. Ces États combinaient le travail de gendarme avec la conquête de territoires au détriment de l’État hongrois.
La Russie soviétique, assiégée, ne put accorder le moindre soutien militaire. La tentative de l’Armée rouge et des guérilléros de Nestor Makhno de lancer en juin 1919 une offensive par l’ouest afin d’ouvrir une voie de communication vers la Hongrie, fut réduite à néant par la violente contre-attaque du général Denikine.
Mais le problème central était que le prolétariat avait son ennemi dans sa propre maison 28. Le 30 mars, le Gouvernement de la "dictature du prolétariat" créait pompeusement l’Armée rouge. C’était la même vieille armée rebaptisée. Tous ses postes de commandement restaient aux mains des anciens généraux, supervisés par un corps de commissaires politiques dominé par les sociaux-démocrates, dont les communistes étaient exclus.
Le gouvernement rejeta une proposition des communistes de dissoudre les forces policières. Les ouvriers, cependant, désarmèrent par eux-mêmes les gardes et plusieurs usines de Budapest adoptèrent des résolutions sur ce sujet qui furent immédiatement appliquées : "Alors seulement les sociaux-démocrates donnèrent la permission. Mais ils n’autorisèrent pas que s’effectuent leur désarmement, ce n’est qu’après une longue résistance qu’ils consentirent à approuver le licenciement de la police, de la gendarmerie et de la garde de sécurité" 29. La formation de l’Armée rouge fut décrétée, intégrant dans ses rangs les policiers licenciés !
L’Armée et la police, colonne vertébrale de l’État bourgeois, restèrent donc intactes grâce à ces tours de passe-passe. Il n’est donc pas surprenant que l’Armée rouge se décomposât si facilement lors de l’offensive d’avril lancée par les troupes roumaines et tchèques. Plusieurs régiments passèrent même à l’ennemi.
Contre les troupes d’envahisseurs aux portes de Budapest, le 30 avril, la mobilisation ouvrière parvint à retourner la situation. Les anarchistes et le groupe de Szamuelly menèrent une forte agitation. La manifestation du Premier Mai connut un succès massif, les slogans demandant "l’armement du peuple" furent lancés et le groupe de Szamuelly réclama "tout le pouvoir aux conseils ouvriers". Le 2 mai se tint un meeting gigantesque qui demanda la mobilisation volontaire des travailleurs. En quelques jours, rien qu’à Budapest, 40 000 d’entre eux s’engagent dans l’Armée rouge.
L’Armée rouge, renforcée par l’incorporation massive des ouvriers et par l’arrivée de Brigades internationales de volontaires français et russes, lança alors une grande offensive qui obtint toute une série de victoires sur les troupes roumaines, serbes et particulièrement sur les tchèques qui subirent une grande défaite et dont les soldats désertèrent massivement. En Slovaquie, l’action des ouvriers et des soldats rebelles conduisit à la formation d’un Conseil ouvrier qui, appuyé par l’Armée rouge, proclama la République slovaque des Conseils (16 juin). Le Conseil conclut une alliance avec la République hongroise et lança un manifeste dirigé à tous les ouvriers tchèques.
Ce succès alerta la bourgeoisie mondiale : "La Conférence de la Paix à Paris, alarmée par les succès de l’Armée rouge, lança le 8 juin un nouvel ultimatum à Budapest, dans lequel elle exigeait que l’Armée rouge interrompe son avancée, invitant le gouvernement hongrois à Paris pour "discuter des frontières de la Hongrie". Il y eut ensuite un second ultimatum, dans lequel l’usage de la force était évoqué si l’ultimatum n’était pas respecté" 30.
Le social-démocrate Bohm, soutenu par Bela Kun, ouvrit "à n’importe quel prix" des négociations avec l’État français, qui exigea comme premier pas l’abandon de la République des Conseils de Slovaquie, ce qui fut accepté le 24 juin. Cette République fut alors écrasée le 28 du même mois et tous ses militants connus pendus dès le lendemain.
L’Entente opèra alors un changement de tactique. Les exactions des troupes roumaines et leurs prétentions territoriales avaient été à l’origine d’un resserrement des rangs autour de l’Armée rouge, ce qui avait en mai favorisé ses victoires. Un Gouvernement provisoire hongrois fut formé à la hâte autour de deux frères de l’ancien Président Karolyi, qui s’installa dans la zone occupée par les roumains mais dut cependant se retirer en maugréant pour donner l’apparence d’un "gouvernement indépendant". L’aile droite de la social-démocratie réapparut alors, soutenant ouvertement ce gouvernement.
Le 24 janvier eut lieu une tentative de soulèvement à Budapest, organisé par la social-démocratie de droite. Le Gouvernement négocia avec les insurgés et cèda à sa revendication d’interdire les Gars de Lénine, les Brigades internationales et les régiments contrôlés par les anarchistes. Cette répression précipita la décomposition de l’Armée rouge : de violents affrontements éclatèrent en son sein, les désertions et les mutineries se multiplièrent.
La défaite finale et la répression brutale
La démoralisation atteint son comble parmi la population ouvrière de Budapest. Beaucoup d’ouvriers et leur famille fuient la ville. Les révoltes paysannes contre le Gouvernement se multiplient dans les campagnes. La Roumanie reprend son offensive militaire. Dès la mi-juin, retrouvant leur unité, les sociaux-démocrates réclament la démission de Bela Kun et la formation d’un nouveau gouvernement sans la présence des communistes. Le 20 juillet, Bela Kun lance une offensive militaire désespérée contre les troupes roumaines avec ce qui reste de l’Armée rouge, qui se rend le 23. Le 31 juillet, finalement, Bela Kun démissionne et un nouveau gouvernement avec les sociaux-démocrates et les syndicats est formé, qui déchaîne une violente répression contre les communistes, les anarchistes et tout militant ouvrier qui n’a pu prendre la fuite. Szamuelly est assassiné le 2 août.
Le 6 août, ce gouvernement est à son tour renversé par une poignée de militaires qui ne rencontrent aucune résistance. Les troupes roumaines entrent à Budapest. Les prisonniers sont soumis à des tortures moyenâgeuses avant d’être assassinés. Les soldats blessés ou malades sont arrachés des hôpitaux et traînés dans les rues où ils sont soumis à tout type d’humiliations avant d’être tués. Dans les villages, les troupes obligent les paysans à organiser des procès contre leurs propres voisins considérés comme suspects, à les torturer pour ensuite les assassiner. Les refus sont châtiés par l’incendie des maisons avec leurs occupants à l’intérieur.
Alors que 129 contre-révolutionnaires furent exécutés pendant les 133 jours que dura la République soviétique, plus de 5 000 personnes furent assassinées entre le 15 et le 31 août. Il y eut 75 000 arrestations. Les procès de masse commencèrent en octobre.15 000 ouvriers furent jugés par les tribunaux militaires qui infligeaient les peines de mort et les travaux forcés.
Entre 1920 et 1944, la féroce dictature de l’amiral Horty bénéficia du soutien des démocraties occidentales malgré ses sympathies pour le fascisme, en remerciement de ses services rendus contre le prolétariat.
C. Mir, 4-9-2010
1 Cf. Revue internationale no 139, https://fr.internationalism.org/rint139/1914_23_dix_annees_qui_ebranlerent_le_monde_la_revolution_hongroise_de_1929.html [155]
2 Par une action coordonnée, les comités de paysans prirent les terres du principal aristocrate du pays, le comte Esterhazy.
3 Ceci révèle la politisation croissante des ouvriers mais aussi les insuffisances de leur prise de conscience, puisqu’ils demandent un gouvernement où seraient ensemble les traîtres sociaux-démocrates et les communistes, qui avaient été incarcérés au moyen des manœuvres de premiers.
4 Pendant la Première Guerre mondiale, l’Entente regroupait le camp impérialiste formé par la Grande-Bretagne, la France et la Russie, du moins jusqu’à la Révolution d’Octobre.
5 Roland Bardy, 1919, la Commune de Budapest, p. 83. La majeure partie des informations utilisées dans cet article est extraite de l’édition française de cet ouvrage, qui contient une abondante documentation.
6 Ibidem.
7 L’aile centriste du parti hongrois était formée par des cadres aussi réactionnaires que ceux de l’aile droite, mais beaucoup plus rusés et capables de s’adapter à la situation.
8 Roland Bardy, op. cit., p. 84.
9 Bela Szanto, dans son livre la Révolution hongroise de 1919, page 88 de l’édition espagnole, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?", cite un social-démocrate, Buchinger, qui reconnaît que "l’union avec les communistes sur la base de leur programme intégral fut réalisée sans la moindre conviction".
10 Roland Bardy, op. cit., p. 85.
11 Idem, p. 86.
12 Idem, p. 99.
13 Cet individu avait crié, en février 1919 : "les communistes doivent être mis face aux canons des fusils", et il déclarera en juillet 1919 : "je suis incapable de m’intégrer à l’univers mental sur lequel se base la dictature du prolétariat" (Szanto, op. cit., p. 99).
14 Bela Szanto, op. cit., p. 82 de l’édition espagnole, rapporte que dès le lendemain, Bela Kun confessa à ses camarades du Parti : "Les choses vont trop bien. Je n’ai pu dormir, je n’ai cessé de penser toute la nuit où nous avons pu nous tromper", chapitre "Au pas de charge vers la dictature du prolétariat".
15 Au sein de l’Union anarchiste se distingue une tendance organisée de façon autonome, qui se fait appeler Les Gars de Lénine et qui proclame "la défense du pouvoir des conseils ouvriers". Elle jouera un rôle significatif au cours des actions militaires en défense de la révolution.
16 Tome 38 de l’édition espagnole, pages 228, 229 et 246. Les documents s’intitulent "Salut par radio au gouvernement de la République des conseils hongroise", radiogramme envoyé à Bela Kun, et "Communiqué sur les conversations radio avec Bela Kun".
17 Le Conseil ouvrier de Szeged – ville de la zone "démilitarisée" mais occupée en réalité par 16 000 soldats français – agit de façon révolutionnaire. Le 21 mars, le Conseil organisa l’insurrection, occupant tous les points stratégiques. Les soldats français refusèrent de les combattre et le commandement décida alors la retraite. Le 23, le Conseil élit un Conseil de gouvernement formé par un ouvrier du verre, un autre du bâtiment et un avocat. Il prend contact dès le 24 avec le nouveau Gouvernement de Budapest.
18 Szantó, op. cit., p. 106, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
19 Roland Bardy, op. cit., p. 101.
20 Bela Szanto, op. cit., page 91, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?".
21 Roland Bardy, op. cit., p. 105.
22 Idem, p. 117.
23 Idem, p. 111.
24 Idem, p. 112.
25 Idem, p. 127.
26 Idem, p. 126
27 Cf. le quatrième chapitre [156] de notre série sur la Révolution en Allemagne, Revue internationale, no 136.
28 Bela Szanto, op. cit., page 146 : "La contre-révolution se sentit si forte qu’elle pouvait dans ses brochures et opuscules présenter comme siens des hommes qui étaient à la tête du mouvement ouvrier ou qui occupaient des postes importants dans la dictature des Conseils."
29 Idem, p. 104, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
30 Alan Woods, La République soviétique hongroise de 1919, la révolution oubliée. En espagnol : https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [157].; en anglais : https://marxist.com/hungarian-soviet-republic-1919.htm [158]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (3e partie)
- 1820 lectures
Nous avons vu dans la partie précédente [159] du Manifeste (publiée dans la Revue internationale n° 143) comment celui-ci s'opposait violemment à tout front unique avec les sociaux-démocrates. En contrepartie, il appelait à un front unique de tous les éléments véritablement révolutionnaires, parmi lesquels il incluait les partis de la Troisième Internationale au même titre que les partis communistes ouvriers (KAPD en Allemagne). Face à la question nationale qui se pose dans les républiques soviétiques, traitée dans la troisième publication que nous faisons de ce document, celui-ci préconise la réalisation du Front unique avec les PC des ces républiques qui, dans l'IC, "auraient les mêmes droits que le parti bolchevique".
Toutefois, le point le plus important abordé dans cette avant-dernière partie du Manifeste est celui consacré à la NEP.
La position du Manifeste sur cette question est la suivante : "La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays (…) Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie." En fait, ce point de vue n'est pas très éloigné de celui de Lénine pour qui la NEP était une forme de capitalisme d'État. En 1918, Lénine défendait déjà que le capitalisme d'État constituait un pas en avant, un pas vers le socialisme pour l'économie arriérée de la Russie. Dans le discours au Congrès du parti bolchevique de 1922, il reprend ce thème, en insistant sur la différence fondamentale à faire entre le capitalisme d'État sous la direction de la bourgeoisie réactionnaire, et le capitalisme d'État administré par l'État prolétarien. Le Manifeste énonce une série de suggestions pour "l'amélioration" de la NEP, dont l'indépendance vis-à-vis des capitaux étrangers.
Là où le Manifeste diverge de Lénine et de la position officielle du parti bolchevique c'est lorsqu'il souligne que "Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement". Les mesures qu'il préconise sont la régénérescence du système des soviets : "Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens."
La question nationale
La réalisation de la tactique du front uni fut surtout difficile à cause de la variété nationale et culturelle des peuples en URSS.
L’influence pernicieuse de la politique du groupe dirigeant du PCR (bolchevique) se révéla en particulier sur la question nationale. À toute critique et à toute protestation, des proscriptions sans fin ("division méthodique du parti ouvrier") ; des nominations qui parfois ont un caractère autocratique (personnes impopulaires qui n’ont pas la confiance des camarades locaux du parti) ; des ordres donnés aux républiques (aux mêmes populations demeurées pendant des décennies et des siècles sous le joug ininterrompu des Romanov personnifiant la domination de la nation grand-russe), qui peuvent finir par donner une nouvelle vigueur aux tendances chauvines dans les larges masses travailleuses, pénétrant même les organisations nationales du parti communiste.
La Révolution russe, dans ces républiques soviétiques, fut indubitablement accomplie par les forces locales, par le prolétariat local avec l’appui actif des paysans. Et si tel ou tel parti communiste national développa un travail nécessaire et important, celui-ci consista essentiellement à appuyer les organisations locales du prolétariat contre la bourgeoisie locale et ses soutiens. Mais une fois accomplie la révolution, la praxis du parti, du groupe dirigeant du PCR (bolchevique), inspirée par la défiance vis-à-vis des revendications locales, ignore les expériences locales et impose aux partis communistes nationaux divers contrôleurs, souvent de nationalité différente, ce qui exaspère les tendances chauvines et donne aux masses ouvrières l’impression que ces territoires sont soumis à un régime d’occupation. La réalisation des principes de la démocratie prolétarienne, avec l’institution des organisations locales étatiques et de parti, éliminera dans toutes les nationalités les racines de la différence entre ouvriers et paysans. Réaliser ce "front unique" dans les républiques qui ont accompli la révolution socialiste, réaliser la démocratie prolétarienne, signifie instituer l’organisation nationale avec des partis communistes ayant dans l’Internationale les mêmes droits que le PCR (bolchevique) et constituant une section particulière de l’Internationale. Mais puisque toutes les républiques socialistes ont certaines tâches communes et que le parti communiste développe dans toutes un rôle dirigeant, on doit convoquer – pour les discussions et les décisions sur les problèmes communs à toutes les nationalités de l’Union des républiques socialistes soviétiques – des congrès généraux de parti qui élisent, en vue d’une activité stable, un exécutif des partis communistes de l’URSS. Une telle structure organisationnelle des partis communistes de l’URSS peut déraciner et déracinera indubitablement la méfiance au sein du prolétariat et elle présentera en outre une énorme importance pour l’agitation du mouvement communiste dans tous les pays.
La NEP (Nouvelle Politique économique)
La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays.
Et vraiment, supposons que notre pays soit couvert d’une épaisse forêt de tuyaux d’usine, la terre cultivée par des tracteurs et non par des charrues, que le blé soit moissonné à l’aide de moissonneuses et non d’une faucille et d’une faux, battu par une batteuse et non par un fléau, vanné par un tarare et non par une pelle aux quatre vents ; de plus toutes ces machines mises en marche par un tracteur – est-ce que dans ces conditions nous aurions besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Pas du tout.
Et imaginez-vous maintenant que l’année dernière, en Allemagne, en France et en Angleterre il y ait eut une révolution sociale et que chez nous, en Russie, la massue et l’araire n’aient pas pris leur retraite, remplacés par la reine machine, mais règnent sans rivaux. Tout comme ils règnent aujourd’hui (surtout l’araire, et le manque de bêtes oblige l’homme à s’y atteler lui-même avec ses enfants, sa femme suivant l’araire). Aurait-on alors besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Oui.
Et pour quoi ? Pour la même chose, pour s’appuyer sur une culture familiale paysanne avec son araire et, par là, pour passer de l’araire au tracteur, donc pour changer la base matérielle d’une économie petite-bourgeoise de la campagne en vue d’élargir la base économique de la révolution sociale.
Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie.
Mais comment accomplir cette tâche ? En décrétant, en criant : "eh vous, petit-bourgeois, disparaissez !" ? On pourrait prendre de pareils décrets réprimandant un élément petit-bourgeois autant qu’on voudrait, la petite-bourgeoisie vivrait quand même comme un coq en pâte. Et qu’est-ce que les purs prolétaires feraient sans elle dans un pays comme la Russie ? Ils mourraient de faim ! Pourrait-on rassembler tous les petit-bourgeois dans une commune collective ? Impossible. Ce ne sera donc pas par décrets que l’on combattra l’élément petit-bourgeois, mais en le soumettant aux nécessités d’une économie rationnelle, mécanisée, homogène. Par la lutte libre des économies basées sur l’utilisation des machines et des nouveaux perfectionnements techniques contre tous les autres modes de production archaïques qui dominent encore dans une petite économie artisanale. On ne peut pas construire le communisme avec un araire.
Mais imaginez que la révolution socialiste ait eu lieu en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu’une Nouvelle Politique économique y serait possible à un quelconque moment du processus révolutionnaire ?
Ça dépend totalement de l’importance et de l’échelle de la production petite-bourgeoise. Si son rôle dans la vie du pays est insignifiant, on pourra se passer de Nouvelle Politique économique et, en accélérant l’activité législative de la dictature prolétarienne, introduire de nouvelles méthodes de travail.
Donc là où la production petite-bourgeoise exerce une influence considérable sur la vie économique du pays et où l’industrie de la ville et de la campagne ne peut pas s’en passer, la Nouvelle Politique économique aura lieu. Plus la grande industrie dépendra de la petite production, plus l’échelle de la NEP sera grande et sa durée conditionnée à la vitesse de la marche triomphante d’une industrie socialiste nationale.
En Russie, la Nouvelle Politique économique durera longtemps – non parce que quelqu’un le veut, mais parce que personne ne peut agir autrement. Jusqu’au moment où notre industrie socialiste cessera de dépendre de la production et de la propriété petites-bourgeoises, il n’y sera pas question de suspendre la NEP.
La NEP et la campagne
La question du changement de politique économique, de la suspension de la NEP, sera posée à l’ordre du jour après la disparition de la domination petite-bourgeoise dans l’agriculture.
Actuellement, la force et la puissance de la révolution socialiste sont totalement conditionnées par la lutte pour l’industrialisation, du tracteur contre l’araire. Si le tracteur arrache la terre russe à l’araire, alors le socialisme vaincra, mais si l’araire chasse le tracteur, le capitalisme l’emportera. La Nouvelle Politique économique ne disparaîtra qu’avec l’araire.
Mais avant que le soleil ne se lève, la rosée peut crever les yeux 1 ; et pour que nos yeux, ceux de la révolution socialiste, restent sains et saufs, il nous faut suivre une ligne juste envers le prolétariat et la paysannerie.
Notre pays est agraire. Nous ne devons pas oublier que le paysan y est le plus fort, il faut l’attirer de notre côté. Nous ne pouvons pas l’abandonner à une idéologie bourgeoise, car ce serait la mort de la Russie soviétique et la paralysie pour longtemps de la révolution mondiale. La question des formes d’une organisation de paysans est une question de vie et de mort pour la Révolution russe et internationale.
La Russie est entrée dans la voie de la révolution socialiste alors que 80 % de sa population vivait encore dans des exploitations individuelles. Nous avons poussé le paysan à exproprier les expropriateurs, à s’emparer des terres. Mais lui ne comprenait pas cette expropriation comme l’ouvrier industriel la comprend. Son être à la campagne déterminait sa conscience. Chaque paysan, ayant son exploitation individuelle, rêvait de l’accroître. Les propriétés foncières n’avaient pas la même organisation interne que les entreprises industrielles des villes, c’est pourquoi il fallut "socialiser la terre" bien que ce fût une régression, un recul des forces productives, un pas en arrière. En expropriant peu ou prou les expropriateurs, nous n’avons pas pu penser à changer tout de suite un mode de production avec les forces productives existantes, le paysan ayant son exploitation individuelle. Il ne faut jamais oublier que la forme de l’économie est entièrement déterminée par le degré de développement des forces productives, et notre charrue araire ne peut en rien prédisposer au mode de production socialiste.
Il n’y a pas lieu de penser que nous puissions influencer un propriétaire par notre propagande communiste et qu'il se retrouve dans une commune ou une collectivité.
Pendant trois ans, prolétariat et bourgeoisie se sont affrontés pour récupérer la paysannerie. Celui qui gagna l’ascendant sur cette dernière gagna la lutte. Nous avons vaincu parce que nous étions les plus forts, les plus puissants. Il faut affermir cette puissance, mais en même temps réaliser une chose : elle ne sera pas consolidée par la qualité ou la quantité de discours de nos bavards, mais au fur et à mesure de la croissance des forces productives, au fur et à mesure que triomphera le tarare sur la pelle, la faucheuse sur la faux, la moissonneuse sur la faucille, le tracteur sur la charrue. Au fur et à mesure que triomphera l’économie socialisée de la production et de la propriété petite-bourgeoise.
Qui peut prouver que le paysan soit opposé aux faucheuses, aux tarares, aux moissonneuses, aux lieuses et aux tracteurs ? Personne. Personne ne peut donc prouver que le paysan n’arrivera jamais aux formes socialisées de l’économie, mais nous savons qu’il y arrivera en tracteur et non en s’attelant lui-même à l’araire.
G.V. Plekhanov raconte qu’une tribu africaine sauvage en voulait aux Européens et considérait abominable tout ce qu’ils faisaient. L’imitation des mœurs, des coutumes et des façons européennes de travailler était considérée comme péché capital. Mais les mêmes sauvages, qui utilisaient des haches de pierre, ayant vu les Européens manier les haches d’acier, ont bientôt commencé à se procurer ces dernières, quoiqu'en récitant des formules magiques et en se cachant.
Certes, pour le paysan, tout ce que les communistes font et qui sent la commune est abominable. Mais il faut le forcer à substituer le tracteur à la charrue, tout comme les sauvages ont substitué la hache d’acier à celle de pierre. C’est beaucoup plus facile à faire pour nous que pour les Européens en Afrique.
Si on veut développer l’influence du prolétariat en milieu paysan, il ne faut pas rappeler trop souvent au cultivateur que c’est la classe ouvrière qui lui a donné la terre, car il peut bien répondre : "Merci, mon brave, et maintenant, pourquoi es-tu venu ? Pour prélever un impôt en nature ? Cet impôt, tu l’auras, mais ne dis surtout pas qu’hier tu étais très bien, dis si aujourd’hui tu veux faire du bien. Sinon, mon colon, va te faire voir !"
Tous les partis contre-révolutionnaires, des mencheviks aux SR et aux monarchistes inclus, basent leurs théories pseudo-scientifiques de l’avènement inévitable d’un paradis bourgeois sur la thèse qu’en Russie le capitalisme n’a pas encore épuisé tout son potentiel, qu’il y reste de grandes possibilités de développement et de prospérité, qu’il va embrasser peu à peu toute l’agriculture en y introduisant des méthodes industrielles de travail. C’est pourquoi, concluent-ils, si les bolcheviks ont fait un coup d’État, s’ils ont pris le pouvoir pour construire le socialisme sans attendre les conditions matérielles nécessaires, ils devront soit se transformer eux-mêmes en vraie démocratie bourgeoise, soit les forces développées à l’intérieur exploseront politiquement, renverseront les communistes résistant aux lois économiques et mettront à leur place une coalition des Martov, Tchernov, Milioukov, dont le régime donnera libre champ au développement des forces productives du pays.
Certes, chacun sait que la Russie est un pays plus arriéré que l’Angleterre, les États-Unis, l’Allemagne, la France etc. Mais tous doivent comprendre : si le prolétariat dans ce pays a eu assez de force pour prendre le pouvoir, pour exproprier les expropriateurs, supprimer la résistance acharnée des oppresseurs soutenue par la bourgeoisie du monde entier, ce prolétariat aura d’avantage encore de force pour suppléer le processus anarchique de mécanisation de l’agriculture du capitalisme par une mécanisation conséquente et planifiée grâce à l’industrie et au pouvoir prolétarien, soutenue par les aspirations conscientes des paysans à voir facilité leur travail.
Qui dit que c’est facile à faire ? Personne. Surtout après les ravages immenses que les SR, les mencheviks, la bourgeoisie et les propriétaires fonciers ont fait en déclenchant la guerre civile. C’est difficile à faire mais ce sera fait, même si les mencheviks et les SR, alliés aux Cadets et aux monarchistes, feront flèche de tout bois en vociférant en faveur du retour de la bourgeoisie.
Il nous faut poser cette question dans un cadre pratique. Il n’y a pas longtemps, le camarade Lénine a écrit une lettre aux camarades émigrés américains en les remerciant de l’aide technique qu’ils nous prêtent en organisant des sovkhozes et des kolkhozes exemplaires, où sont utilisés des tracteurs américains pour le labour et la moisson. Ainsi, la Pravda a publié un rapport du travail d’une telle commune à Pierm.
Comme tout communiste, nous sommes ravis que les prolétaires d’Amérique viennent à notre secours, là où on le nécessite le plus. Mais notre attention fut involontairement attirée par un fragment de ce rapport disant que les tracteurs avaient chômé pendant longtemps parce que : 1) l’essence s’était révélée impure ; 2) on avait été obligé de l’importer de loin, avec retard ; 3) les chauffeurs du village avaient mis beaucoup de temps à étudier le maniement des tracteurs ; 4) les routes et surtout les ponts n’étaient pas bons pour les tracteurs.
Si la mécanisation de l’agriculture détermine le sort de notre révolution et n’est de ce fait pas étrangère au prolétariat du monde entier, il faut la développer sur une base plus solide. Sans renoncer à une aide d’une telle ampleur (que nous accordent les camarades d’outre-mer) ni diminuer son importance, nous avons pourtant à penser les résultats qu’elle nous permettra d’obtenir.
Il nous faut avant tout attirer l’attention sur le fait que ces tracteurs ne sont pas produits dans nos usines. Peut-être n’a-t-on pas besoin de les produire en Russie, mais si cette aide prend de l’envergure, notre agriculture sera liée à l’industrie des États-Unis.
Maintenant il faut déterminer quel type de tracteur, quel moteur est applicable aux conditions russes. 1) il doit utiliser le pétrole comme combustible et ne pas faire de caprices à cause de la mauvaise qualité de l’essence ; 2) il doit être simple d’utilisation pour que non seulement les chauffeurs professionnels sachent le conduire, mais pour qu’on puisse former ces chauffeurs facilement et autant qu’il en faudra ; 3) il faut avoir des niveaux de force : 100, 80, 60, 40, 30, 25, selon le type de terre : à labourer, vierge ou déjà cultivée ; 4) il faut que ce soit un moteur universel pour le labour, le battage, le fauchage, le transport du blé ; 5) il faut qu’on le fabrique dans les usines russes et non qu’on aille le chercher quelque part outre-mer ; sinon, au lieu de l’alliance de la ville et de la campagne, ce serait l’alliance de la campagne et des négociants étrangers ; 6) il doit utiliser un combustible local.
Après les horreurs de la guerre et de la famine, notre pays promet à la machine dans l’agriculture un triomphe plus grand et plus proche que jamais dans le monde. Car actuellement, même la simple charrue araire, l’instrument principal de travail dans notre campagne, commence à manquer et lorsqu’il y en a, on n’a pas de bêtes à y atteler. Les machines pourraient faire des choses impossibles à imaginer.
Nos spécialistes estiment que l’imitation aveugle des États-Unis serait nuisible à notre économie ; ils pensent aussi que malgré tout, la production en série des moteurs indispensables à notre agriculture est possible avec nos moyens techniques. Cette tâche est d’autant plus facile à résoudre que notre industrie métallurgique se plaint toujours de l’absence de commandes, que les usines fonctionnent à la moitié de leur potentiel, donc à perte ; on leur passerait des commandes.
La production en série d’une machine universelle agricole simple, que des mécaniciens préparés rapidement pourraient conduire, qui fonctionnerait au pétrole et ne ferait donc pas de caprices à cause d’une essence de qualité médiocre, doit être organisée dans les régions de Russie où il est facile de transporter le pétrole soit par train, soit par bateau. On pourra utiliser le moteur à pétrole au sud de la Russie, en Ukraine, au centre de la Russie, dans les régions de la Volga et de la Kama ; ça ne marcherait pas en Sibérie, car le transport du pétrole y reviendrait très cher. L’immense espace de la Sibérie est un problème pour notre industrie. Mais il y a d’autres types de combustible en Sibérie, notamment du bois ; c’est pourquoi les moteurs à vapeur pourront y occuper une place importante. Si nous réussissons à résoudre le problème de la distillation du bois, de l’extraction de l’esprit de bois en Sibérie, on pourra utiliser des moteurs à bois. Lequel des deux moteurs sera le plus rentable, les spécialistes techniques devront le décider d’après les résultats pratiques.
Le 10 novembre 1920, la Pravda, sous le titre "Entreprise gigantesque", rapportait la nouvelle de la constitution de la Société internationale de secours pour la renaissance de l’industrie dans l’Oural. De très importants trusts d’État et le Secours ouvrier international contrôlent cette société qui dispose d’ores et déjà d’un capital de deux millions de roubles-or et est entrée en rapport d’affaires avec l’entreprise américaine Keith en acquérant une grande quantité de tracteurs, affaire jugée évidemment avantageuse.
La participation du capital étranger est nécessaire, mais dans quel domaine ? Nous voulons, ici, soumettre à tous les questions suivantes : si le Secours ouvrier international peut nous aider grâce à ses rapports avec l’entreprise Keith, pourquoi ne pourrait-il pas, avec une quelconque autre entreprise, organiser chez nous, en Russie, la production des machines nécessaires à l’agriculture ? Ne serait-il pas préférable d’employer les deux millions de roubles-or que la société possède dans la production de tracteurs, ici, chez nous ? A-t-on justement envisagé toutes les possibilités ? Est-il réellement nécessaire d’enrichir de notre or l’entreprise Keith et de lier à elle le sort de notre économie agricole ?
Dans un livre technique, nous avons lu qu’en voulant soumettre les régions agricoles des pays occupés à leur domination économique certaine, les firmes allemandes étaient venues avec leurs tracteurs, avaient labouré les terres et puis avaient vendu les machines aux laboureurs pour un sou. Il va de soi que par la suite, ces firmes ont demandé un haut prix, mais les tracteurs se vendaient déjà. C’était la conquête sans verser une goutte de sang.
La volonté de la firme Keith de nous aider et de nous accorder un crédit semble être du même genre et il faut y être très prudent.
Certes, il est relativement douteux que la firme Keith puisse nous fournir des tracteurs adaptés aux conditions russes, mais même les tracteurs qui y sont peu accommodés remporteront un succès assuré au vu des conditions lamentables de notre agriculture, car n’importe quoi aurait du succès dans une pareille situation. Si la production des moteurs nécessaires et adaptés aux conditions russes est possible de toute façon, pourquoi a-t-on besoin de la firme Keith ? Car, autant qu’on sache, il n’est pas définitif que nous ne puissions pas organiser nous-mêmes la production des machines nécessaires.
Si les idées et les calculs des ingénieurs de Petrograd sont réellement justes, les deux millions de roubles-or accordés par cette Société seraient un investissement bien plus solide pour un redressement de l’économie dans l’Oural que l’aide de la firme Keith.
En tout cas, il faut discuter sérieusement cette question, parce qu’elle a une portée non seulement économique, mais aussi politique, non seulement pour la Russie soviétique mais pour toute la révolution mondiale. Et on ne peut pas la résoudre d’un seul coup. Il faut savoir ce que nous pourrions faire de cet or, et réfléchir : si les personnes compétentes et les autorités décident que ça ne vaut même pas la peine d’essayer et qu’il vaut mieux s’adresser directement outre-mer, soit.
Nous avons peur d’avoir l’esprit d’escalier : d’abord nous donnerons de l’or à monsieur Keith, puis nous ferons publiquement notre mea-culpa, tout en nous vantant de ne pas avoir peur de reconnaître nos fautes.
Si on mécanise l’agriculture en Russie, par la production des machines nécessaires par nos usines et non par l’achat à la bonne firme d’outre-mer Keith, la ville et la campagne seront indissolublement liées par la croissance des forces productives, rapprochées l’une de l’autre ; il faudra alors consolider ce rapprochement idéologique en organisant "des syndicats de type particulier" (d’après le programme du PCR). Ce sont des conditions indispensables pour l’abolition paisible des rapports capitalistes, l’élargissement d’une base de la révolution socialiste à l’aide d’une nouvelle politique économique 2.
Notre révolution socialiste détruira la production et la propriété petite-bourgeoise non en décrétant la socialisation, la municipalisation, la nationalisation, mais par la lutte consciente et conséquente des modes modernes de production au détriment des modes dépassés, désavantageux, par l’instauration évolutive du socialisme. C’est exactement l’essence du saut de la nécessité capitaliste à la liberté socialiste.
La Nouvelle Politique économique et la politique tout simplement
Et quoi qu’en disent les gens "bien-pensants", c’est en premier lieu la classe ouvrière active et en second la paysannerie (et non les fonctionnaires communistes, même les meilleurs et les plus intelligents) qui sont en mesure de mener cette politique.
La Nouvelle Politique économique déterminée par l’état des forces productives de notre pays cache en elle des dangers pour le prolétariat. Nous ne devons pas seulement montrer que la révolution sait affronter un examen pratique sur le plan de l’économie et que les formes économiques socialistes sont en fait meilleures que les capitalistes, mais nous devons aussi affirmer notre position socialiste sans engendrer pour autant une caste oligarchique qui détienne le pouvoir économique et politique, qui finisse par craindre par-dessus tout la classe ouvrière. Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens.
Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement. Les membres de l’administration de certains trusts, par exemple celui du sucre, reçoivent un salaire mensuel de 200 roubles-or, jouissent gratuitement ou pour un prix modique d’un bel appartement, possèdent une automobile pour leurs déplacements et ont bien d’autres avantages pour satisfaire leurs besoins à prix moindre que celui payé par les ouvriers adonnés à la culture de la betterave à sucre, alors même que ces ouvriers, bien qu’ils soient communistes, ne reçoivent (outre les modestes rations alimentaires qui leurs sont accordées par l’État), que 4 ou 5 roubles par mois en moyenne (et avec ce salaire ils doivent également payer le loyer et l’éclairage) ; il est bien évident qu’on entretient vraiment une différence profonde dans le mode de vie des uns et des autres. Si cet état de chose ne change pas au plus vite mais se maintient encore dix ou vingt ans, la condition économique des uns comme des autres déterminera leur conscience et ils se heurteront en deux camps opposés. Nous devons considérer que les postes dirigeants, souvent renouvelés, sont occupés par des personnes de très basse extraction sociale mais qu’il s’agit toujours d’éléments non prolétariens. Ils forment une très mince couche sociale. Déterminés par leur condition, ils se considèrent comme étant les seuls aptes à certaines tâches réservées, les seuls capables de transformer l’économie du pays, de satisfaire le programme revendicatif de la dictature du prolétariat, des conseils d’usine, des délégués ouvriers, à l’aide du verset : "Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal".
Ils considèrent en réalité ces revendications comme les expressions de l’influence d’éléments petits-bourgeois contre-révolutionnaires. Il y a donc ici sans le moindre doute un danger qui couve sur les conquêtes du prolétariat, qui vient du côté où l’on pouvait le moins s’y attendre. Pour nous, le danger est que le pouvoir prolétarien dégénère en hégémonie d’un groupe puissant décidé à tenir dans ses propres mains le pouvoir politique et économique, sous le voile de très nobles intentions, naturellement, "dans l’intérêt du prolétariat, de la révolution mondiale et autres idéaux très élevés". Oui, le danger existe vraiment d’une dégénérescence oligarchique.
Mais dans le pays où la production petite-bourgeoise exerce une influence décisive, où de plus la politique économique permet d’accélérer, de renforcer au maximum les vues individualistes d’un petit propriétaire, il faut exercer une pression permanente sur la base même de l’élément petit-bourgeois. Et qui l’exercera ? Seront-ce les mêmes fonctionnaires, ces sauveurs de l’humanité affligée ? Qu’ils aient tous la sagesse de Salomon – ou de Lénine – ils ne pourront quand même pas le faire. Seule la classe ouvrière en est capable, dirigée par le parti qui vit sa vie, souffre de ses souffrances, de ses maladies, un parti qui n’ait pas peur de la participation active du prolétariat à la vie du pays.
Il ne faut pas, il est nuisible et contre-révolutionnaire de raconter des fables au prolétariat pour endormir sa conscience. Mais qu’est-ce qu’on nous dit ? "Tiens-toi coi, va aux manifestations lorsqu’on t’y invite, chante l’Internationale quand il le faut, le reste sera fait sans toi par de braves garçons, presque des ouvriers comme toi, mais qui sont plus intelligents que toi et connaissent tout sur le communisme, reste donc tranquille et tu entreras bientôt au royaume socialiste". C’est du pur socialisme-révolutionnaire. Ce sont eux qui défendent que des individus brillants, pleins de dynamisme et armés de talents variés, issus de toutes les classes de la société (et ce semble être le cas) font de cette masse de couleur grise (la classe ouvrière) un royaume élevé et parfait où il n’y aura ni maladies, ni peines, ni soupirs, mais la vie éternelle. C’est tout à fait le style des "saints pères" socialistes-révolutionnaires.
Il faut substituer à la pratique existante une pratique nouvelle qui se baserait sur l’activité autonome de la classe ouvrière et non sur l’intimidation du parti.
En 1917, on avait besoin d’une démocratie développée et en 1918, 1919 et 1920, il fallut réduire tous les appareils dirigeants en les suppléant partout par le pouvoir autocratique de fonctionnaires nommés par en haut qui décrétaient tout ; en 1922, face aux tâches bien différentes qu’auparavant, il est hors de doute qu’on ait besoin d’autres formes d’organisation et méthodes de travail. Dans les fabriques et les usines (nationales) il faut organiser des conseils de députés ouvriers servant de noyaux principaux du pouvoir d’État ; il faut mettre en pratique le point du programme du PCR qui dit : "L’État soviétique rapproche l’appareil étatique et les masses, y compris par le fait que l’unité de production (l’usine, la fabrique) devient le noyau principal de l’État au lieu du district" (cf. le Programme du PCR, division politique, point 5). C’est ce noyau principal du pouvoir d’État aux fabriques et usines qu’il faut restaurer en Conseils de députés ouvriers qui prendront la place de nos sages camarades qui dirigent actuellement l’économie et le pays.
Peut-être certains lecteurs lucides vont-ils nous accuser de faction (article 102 du Code pénal), d’ébranler les bases sacrées du pouvoir prolétarien. Il n’y a rien à dire à de pareils lecteurs.
Mais d’autres diront : "Montrez-nous un pays où les ouvriers jouissent de mêmes droits et libertés qu’en Russie". Ceci dit, ils penseront mériter l’ordre du Drapeau rouge pour avoir écrasé une faction, sans peine et sans verser le sang qui plus est. Et à ceux-là, on peut dire quelque chose. Montrez donc, chers amis, encore un pays où le pouvoir appartient à la classe ouvrière ? Un tel pays n’existe pas, donc la question est absurde. Le problème, ce n’est pas d’être plus libéral, plus démocratique qu’une puissance impérialiste (d’ailleurs ce ne serait pas un grand mérite) ; le problème consiste à résoudre les tâches qui se posent au seul pays au monde qui ait fait le coup d’État d’Octobre, faire en sorte que la NEP (Nouvelle Politique économique) ne devienne une "NEP" (Nouvelle exploitation du prolétariat) et que, dans dix ans, ce prolétariat ne soit pas, Gros-Jean comme devant, forcé de recommencer sa lutte, peut-être sanglante, pour renverser l’oligarchie et garantir ses conquêtes principales. Le prolétariat peut le garantir en participant directement à la résolution de ces tâches, en instaurant une démocratie ouvrière, en mettant en pratique un des points principaux du programme du PCR qui dit : "La démocratie bourgeoise s’est bornée à proclamer formellement les droits et libertés politiques", à savoir les libertés d’association, de presse, égales pour tous les citoyens. Mais en réalité, la pratique administrative et surtout l’esclavage économique des travailleurs ne permettent pas à ces derniers de jouir pleinement de ces droits et libertés.
Au lieu de les proclamer formellement, la démocratie prolétarienne les accorde en pratique avant tout aux classes de la population opprimées jadis par le capitalisme, c’est-à-dire au prolétariat et à la paysannerie. Pour cela, le pouvoir soviétique exproprie les locaux, les imprimeries, les dépôts de papier de la bourgeoisie en les mettant à la disposition des travailleurs et de leurs organisations.
La tâche du PCR (bolchevique) consiste à permettre aux grandes masses de la population laborieuse de jouir des droits et libertés démocratiques sur une base matérielle de plus en plus développée (cf. le Programme du PCR, division politique, point 3).
Il aurait été absurde et contre-révolutionnaire de revendiquer la réalisation de ces thèses programmatiques en 1918, 1919 ou 1920 ; mais il est encore plus absurde et contre-révolutionnaire de se prononcer contre leur réalisation en 1922.
Veut-on améliorer la position de la Russie soviétique dans le monde, ou restaurer notre industrie, ou élargir la base matérielle de notre révolution socialiste en mécanisant l’agriculture, ou faire face aux effets dangereux d’une Nouvelle Politique économique, on en revient inévitablement à la classe ouvrière qui seule est capable de faire tout ça. Moins elle est forte, plus fermement doit-elle s’organiser.
Et les bons garçons qui occupent les bureaux ne peuvent résoudre de pareilles tâches grandioses, n’est-ce pas ?
Malheureusement, la majorité des chefs du PCR ne pense pas de la même façon. À toutes les questions sur la démocratie ouvrière, Lénine, dans un discours prononcé au IXe congrès panrusse des soviets, répondit ainsi : "A tout syndicat qui pose, en général, la question de savoir si les syndicats doivent participer à la production, je dirai : mais cessez donc de bavarder (applaudissements), répondez-moi plutôt pratiquement et dites-moi (si vous occupez un poste responsable, si vous avez de l’autorité, si vous êtes un militant du Parti communiste ou d’un syndicat) : où avez-vous bien organisé la production, en combien d’années, combien de personnes vous sont subordonnées, un millier ou une dizaine de milliers ? Donnez-moi la liste de ceux à qui vous confiez un travail économique que vous avez mené à bonne fin, au lieu de vous attaquer à vingt affaires à la fois pour ne faire aboutir aucune d’elles, faute de temps. Chez nous, avec nos mœurs soviétiques, il est rare qu’on mène une affaire à terme, qu’on puisse parler d’un succès durant quelques années ; on craint de s’instruire auprès du marchand qui empoche 100 % de bénéfices et plus encore, on préfère écrire une belle résolution sur les matières premières et se targuer du titre de représentants du Parti communiste, d’un syndicat, du prolétariat. Je vous demande bien pardon. Qu’est-ce qu’on appelle prolétariat ? C’est la classe qui travaille dans la grande industrie. Mais où est-elle, la grande industrie ? Quel est donc ce prolétariat ? Où est votre grande industrie ? Pourquoi est-elle paralysée ? Parce qu’il n’y a plus de matières premières ? Est-ce que vous avez su vous en procurer ? Non. Vous écrirez une résolution ordonnant de les collecter, et vous serez dans le pétrin ; et les gens diront que c’est absurde ; vous ressemblez à ces oies dont les ancêtres ont sauvé Rome", et qui, pour continuer le discours de Lénine (selon la morale de la fable bien connue de Krylov) doivent être guidées avec une longue baguette au marché pour y être vendues.
Supposons que le point de vue de l’ancienne Opposition ouvrière sur le rôle et les tâches des syndicats soit erroné. Que ce ne soit pas la position de la classe ouvrière au pouvoir, mais celle d’un ministère professionnel. Ces camarades veulent récupérer la gestion de l’économie en l’arrachant des mains des fonctionnaires soviétiques, sans pour autant impliquer la classe ouvrière dans cette gestion, à travers la démocratie prolétarienne et l’organisation des Conseils de députés ouvriers des entreprises conçus comme noyaux principaux du pouvoir étatique, à travers la prolétarisation de ces nids bureaucratiques. Et ils ont tort.
On ne peut pas parler à la façon de Lénine de la démocratie prolétarienne et de la participation du prolétariat à l’économie populaire ! La très grande découverte faite par le camarade Lénine est que nous n’avons plus de prolétariat. Nous nous réjouissons avec toi, camarade Lénine ! Tu es donc le chef d’un prolétariat qui n’existe même pas ! Tu es le chef du gouvernement d’une dictature prolétarienne sans prolétariat ! Tu es le chef du Parti communiste mais non du prolétariat !
à l’inverse du camarade Lénine, son collègue du Comité central et du Bureau politique Kamenev voit le prolétariat partout. Il dit : "1) Le bilan de la conquête d’Octobre consiste en ce que la classe ouvrière organisée en bloc dispose des richesses immenses de toute l’industrie nationale, du transport, du bois, des mines, sans parler du pouvoir politique. 2) L’industrie socialisée est le bien principal du prolétariat", etc., etc. On peut citer beaucoup d’autres exemples. Kamenev voit le prolétariat chez tous les fonctionnaires qui, depuis Moscou, se sont installés par voie bureaucratique et lui-même est, selon ses propres dires, encore plus prolétaire que n’importe quel ouvrier. Il ne dit pas, en parlant du prolétariat : "LUI, le prolétariat..." mais "NOUS, le prolétariat...". Trop de prolétaires du type de Kamenev participent à la gestion de l’économie populaire ; c’est pourquoi il arrive que de semblables prolétaires tiennent d’étranges discours sur la démocratie prolétarienne et sur la participation du prolétariat à la gestion économique ! "S’il vous plaît, dit Kamenev, de quoi parlez-vous ? Ne sommes-nous pas le prolétariat, un prolétariat organisé en tant qu’unité compacte, en tant que classe ?".
Le camarade Lénine considère tout discours sur la participation du prolétariat à la gestion de l’économie populaire comme un bavardage inutile parce qu’il n’y a pas de prolétariat ; Kamenev est du même avis, mais parce que le prolétariat "en tant qu’unité compacte, en tant que classe" gouverne déjà le pays et l’économie, dans la mesure où tous les bureaucrates sont considérés par lui comme prolétaires. Eux, naturellement, se mettent d’accord et s’entendent particulièrement bien, déjà sur quelques points, parce que depuis la Révolution d’octobre Kamenev a pris l’engagement de ne pas prendre position contre le camarade Lénine, de ne pas le contredire. Ils se mettront d’accord sur le fait que le prolétariat existe – naturellement pas seulement celui de Kamenev – mais aussi sur le fait que son bas niveau de préparation, sa condition matérielle, son ignorance politique imposent que "les oies soient tenues loin de l’économie avec une longue baguette". C’est ainsi que cela se passe en réalité !
Le camarade Lénine a appliqué ici la fable de façon plutôt impropre. Les oies de Krylov crient que leurs ancêtres sauvèrent Rome (leurs ancêtres, camarade Lénine) tandis que la classe ouvrière ne parle pas de ses ancêtres, mais d’elle-même, parce qu’elle (la classe ouvrière, camarade Lénine) a accompli la révolution sociale et de ce fait veut diriger elle-même le pays et son économie ! Mais le camarade Lénine a pris la classe ouvrière pour les oies de Krylov et, la poussant avec sa baguette, lui dit : "Laissez vos aïeux en paix ! Vous, qu’avez-vous fait ?". Que peut répondre le prolétariat au camarade Lénine ?
On peut nous menacer avec une baguette et cependant nous déclarerons à haute voix que la réalisation cohérente et sans hésitation de la démocratie prolétarienne est aujourd’hui une nécessité que la classe prolétarienne russe ressent jusqu’à la moelle ; car elle est une force. Advienne que pourra, mais le diable ne sera pas toujours à la porte du pauvre ouvrier. (A suivre)
1. Proverbe russe.
2. Il va de soi que dans la période transitoire les formes existantes d’organisation de la paysannerie sont historiquement inévitables.
Géographique:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
Revue Internationale n° 145 - 2e trimestre 2011
- 1701 lectures
Révoltes sociales au Maghreb et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye
Seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre capitaliste
Les derniers mois ont été riches en événements historiques. Si les révoltes au Maghreb et au Moyen-Orient n’ont aucun lien avec le tsunami qui a ravagé le Japon et la crise nucléaire consécutive, tous ces évènements font néanmoins ressortir avec acuité l’alternative qui s’offre plus que jamais à l’humanité : socialisme ou barbarie. Tandis que l’écho des soulèvements résonne encore dans de nombreux pays, la société capitaliste croupit lamentablement au coin de son petit feu nucléaire. Inversement, l’héroïsme des ouvriers nippons qui sacrifient leur vie aux abords de la centrale de Fukushima tranche avec l’écœurante hypocrisie des puissances impérialistes en Libye.
La mobilisation des masses fait chuter les gouvernements
Depuis plusieurs mois, des mouvements de protestation, inédits de par leur ampleur géographique 1, secouent plusieurs pays. Les premières révoltes du Maghreb ont ainsi rapidement produit des émules puisque des manifestations touchaient, quelques semaines plus tard, la Jordanie, le Yémen, Bahreïn, l’Iran, l’Afrique sub-saharienne, etc. Il est impossible d’établir une stricte identité entre tous ces mouvements, tant en termes de contenu de classe que de riposte de la bourgeoisie, mais la crise économique qui plonge les populations dans une misère de plus en plus intenable depuis 2008 rend assurément insupportables les régimes corrompus et répressifs de la région.
La classe ouvrière ne s’y est jusque-là jamais présentée comme une force autonome en mesure d’assumer la direction des luttes qui ont souvent pris la forme d’une révolte de l’ensemble des classes non-exploiteuses, de la paysannerie ruinée aux couches moyennes en voie de prolétarisation. Mais, d’une part, l’influence ouvrière sur les consciences était sensible à la fois dans les mots d’ordre et les formes d’organisation des mouvements. Une tendance à l’auto-organisation s’est, par exemple, manifestée au travers des comités de protection des quartiers, apparus en Egypte et en Tunisie pour faire face à la répression policière et aux bandes de voyous opportunément libérés des prisons pour semer le chaos. Surtout, beaucoup de ces révoltes ont ouvertement cherché à amplifier le mouvement à travers des manifestations de masse, des assemblées et des tentatives pour coordonner et centraliser les prises de décisions. D’autre part, la classe ouvrière a parfois eu un rôle décisif dans le déroulement des événements. C’est en Egypte, où la classe ouvrière est la plus concentrée et la plus expérimentée de la région, que les grèves ont été les plus massives. L’extension rapide et le rejet de l’encadrement syndical ont largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser Hosni Moubarak du pouvoir.
Alors que les mobilisations sont encore nombreuses et que le vent de la révolte souffle à nouveau dans d’autres pays, la bourgeoisie semble avoir toutes les peines du monde pour éteindre l’incendie. Surtout en Egypte et en Tunisie, où le "printemps des peuples" est censé avoir triomphé, les grèves et les affrontements avec "l’Etat démocratique" se poursuivent. L’ensemble de ces révoltes constitue une formidable expérience sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire. Néanmoins, si cette vague de révoltes, pour la première fois depuis longtemps, a explicitement lié les problèmes économiques aux enjeux politiques, la réponse à cette question s’est heurtée aux illusions qui pèsent encore sur la classe ouvrière, en particulier les mirages démocratique et nationaliste. Ces faiblesses ont souvent permis aux pseudo-oppositions démocratiques de se présenter comme une alternative aux cliques corrompues en place. En fait, ces "nouveaux" gouvernements sont essentiellement constitués du sérail des vieux régimes au point que la situation frise parfois la bouffonnerie. En Tunisie, la population a même contraint une partie du gouvernement à démissionner tant il apparaissait comme une redite exacte du régime Ben Ali. En Egypte, l’armée, soutien historique de Moubarak, tient l’ensemble des leviers de l’Etat et manœuvre déjà pour assurer sa position. En Libye, le "conseil national de transition" est dirigé par… l’ancien ministre de l’intérieur de Kadhafi, Abdel Fattah Younes, et une bande d’anciens hauts-fonctionnaires qui, après avoir organisé la répression et bénéficié de la générosité pécuniaire de leur maitre, se sont piqués d’un goût soudain pour les droits de l’homme et la démocratie.
En Libye, la guerre impérialiste fait rage sur les ruines de la révolte populaire
Sur la base de ces faiblesses, la situation en Libye a évolué d’une manière particulière dans la mesure où ce qui est très justement apparu au départ comme un soulèvement de la population contre le régime de Kadhafi s’est transformé en guerre entre plusieurs fractions bourgeoises sur laquelle sont venues se greffer les grandes puissances impérialistes dans une cacophonie surréaliste et sanglante. Le déplacement du terrain de la lutte vers la poursuite d’intérêts bourgeois, celui du contrôle de l’Etat libyen par l’une ou l’autre des fractions en présence, fut d’autant plus aisé que la classe ouvrière en Libye est très faible. L’industrie locale est notablement arriérée et presque réduite à la production de pétrole, directement pilotée par la clique de Kadhafi qui n’a jamais été en mesure de mettre un tant soit peu l’intérêt national au-dessus de ses intérêts particuliers. La classe ouvrière en Libye est, à ce titre, une main d’œuvre souvent étrangère qui, en débrayant dès le début des événements, a fini par fuir les massacres, notamment à cause de la difficulté de se reconnaitre dans une "révolution" aux accents nationalistes. C'est a contrario que la Libye illustre tragiquement la nécessité que la classe ouvrière occupe une place centrale au sein des révoltes populaires ; son effacement explique en grande partie l’évolution de la situation.
Depuis le 19 mars, après plusieurs semaines de massacres, sous le prétexte d’une intervention humanitaire pour "sauver le peuple libyen martyrisé", une coalition un peu trouble, constituée du Canada, des Etats-Unis, de l’Italie, de la France, du Royaume-Uni, etc. a directement engagé ses forces militaires afin de soutenir le Conseil national de transition. Chaque jour, des missiles sont tirés et des avions décollent pour larguer des tapis de bombes sur toutes les régions abritant des forces armées fidèles au régime de Kadhafi. En langage clair, c’est la guerre. Ce qui, d’emblée, est frappant, c’est l’incroyable hypocrisie des grandes puissances impérialistes qui, d’un côté, brandissent le drapeau déjà mité de l’humanitarisme et, dans le même temps, cautionnent le massacre des masses qui se révoltent à Bahreïn, au Yémen, en Syrie, etc. Où était cette même coalition quand Kadhafi a fait massacrer 1000 détenus dans la prison Abu Salim de Tripoli en 1996 ? En réalité, c’est depuis quarante ans que ce régime enferme, torture, terrorise, fait disparaître, exécute… en toute impunité. Où était hier cette même coalition quand Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Egypte ou Bouteflika en Algérie faisaient tirer sur la foule lors des soulèvements de janvier et février ? Derrière cette infâme rhétorique, les morts continuent à s’entasser dans les morgues. Et déjà, l’OTAN prévoit de prolonger les opérations pendant plusieurs semaines afin d’assurer le triomphe de la paix et de la démocratie.
En réalité, chaque puissance intervient en Libye pour ses intérêts particuliers. La cacophonie de la coalition, incapable de seulement établir une chaîne de commandement, illustre à quel point ces pays partent dans cette aventure guerrière en ordre dispersé afin de renforcer leur propre place dans la région, tels des vautours sur un cadavre. Du point de vue des Etats-Unis, la Libye ne représente pas un intérêt stratégique majeur dans la mesure où ils disposent déjà d’alliés de poids sur place, notamment l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Ceci explique leur perplexité initiale lors des négociations à l’ONU. Néanmoins, les Etats-Unis, soutien historique d’Israël, ont une image catastrophique dans le monde arabe, que les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan ne sont pas venues améliorer. Or, les révoltes commencent à faire émerger des gouvernements plus sensibles à l’opinion anti-américaine et, si les Etats-Unis veulent assurer leur avenir dans la région, il est impératif de redorer leur blason vis-à-vis des nouvelles équipes. Surtout, le gouvernement américain ne pouvait pas laisser les mains libres au Royaume-Uni et à la France sur le terrain. Ces derniers ont également, d’une manière ou d’une autre, une image à améliorer, notamment la Grande-Bretagne suite à ses interventions en Irak et en Afghanistan. Le gouvernement français, malgré ses multiples maladresses, jouit encore d'une certaine popularité dans les pays arabes acquise sous De Gaulle et renforcée par son refus de participer à la guerre d’Irak en 2003. Une intervention contre un Kadhafi beaucoup trop incontrôlable et imprévisible au goût de ses voisins ne pouvait être qu'appréciée par ceux-ci et permettre de renforcer l'influence de la France. Derrière les belles paroles et les faux sourires, chaque fraction bourgeoise intervient donc pour ses propres intérêts, et participe, avec Kadhafi, à cette macabre danse de la mort.
Au Japon comme ailleurs, la nature produit des phénomènes, le capitalisme des catastrophes
A plusieurs milliers de kilomètres de la Libye, sur les terres de la troisième puissance économique mondiale, le capitalisme sème également la mort et démontre que nulle part, même au cœur des pays industrialisés, l’humanité n’est à l’abri de l’irresponsabilité et de l’incurie de la bourgeoisie. Les médias aux ordres ont, comme toujours, présenté le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagé le Japon comme une fatalité contre laquelle personne ne peut rien. Il est bien sûr impossible d’empêcher la nature de se déchaîner, mais l’installation de populations sur des zones à risque dans des maisons en bois n’est pas une "fatalité", tout comme l’exploitation de centrales nucléaires hors d’âge au milieu de ce triste tableau.
La bourgeoisie est, en effet, directement responsable de l’ampleur meurtrière de la catastrophe. Pour les besoins de la production, le capitalisme a concentré les populations et les industries de manière délirante. Le Japon est une caricature de ce phénomène historique : des dizaines de millions de personnes sont massées sur les rivages d’une petite bande de terre particulièrement sujette aux séismes et donc aux tsunamis. Evidemment, les structures résistantes antisismiques ont été bâties pour les plus riches et les immeubles de bureaux ; du simple béton suffisant à se prémunir des raz-de-marée, la classe ouvrière a néanmoins dû se contenter de cages à lapins en bois sur des territoires dont tout le monde sait qu’ils sont hautement dangereux. En toute logique, la population pourrait au moins être installée plus loin des côtes mais le Japon est un pays exportateur et, pour maximiser le profit, il vaut mieux construire les usines près des ports. Certaines usines ont d’ailleurs été balayées par les eaux, surajoutant à la catastrophe nucléaire une catastrophe industrielle à peine imaginable. Dans ce contexte, une crise humanitaire menace un des centres du capitalisme mondial, et devrait encore alourdir l’hécatombe. Tandis que de nombreux équipements et infrastructures sont hors d’usage, des dizaines de milliers de personnes sont abandonnées à leur sort, sans nourriture et sans eau.
Mais la bourgeoisie ne pouvait manifestement s’arrêter là dans l’irresponsabilité et l’impunité ; il lui fallait bâtir 17 centrales nucléaires à l’entretient douteux. La situation autour de la centrale de Fukushima, victime d’avaries sévères, est encore incertaine, mais la communication confuse des autorités laisse présager le pire. Il semble déjà acquis qu’une catastrophe nucléaire digne de l’explosion, en 1986, de la centrale de Tchernobyl se déroule sous les yeux d’un gouvernement impuissant, réduit à bricoler ses installations en sacrifiant de nombreux ouvriers. La fatalité et la nature n’ont encore rien à voir avec la catastrophe. La construction de centrales sur des rivages sensibles ne paraît pas être la plus brillante des idées, en particulier lorsqu’elles ont souvent plusieurs décennies de service et qu’elles bénéficient d’un entretien réduit au minimum. A titre d’exemple stupéfiant, en 10 ans, la centrale de Fukushima a été victime de plusieurs centaines d’incidents liés à une maintenance laborieuse qui a réussi à pousser à la démission des cadres scandalisés.
La nature n’a rien à voir dans ces catastrophes ; les lois, devenues absurdes, de la société capitaliste en sont responsables de bout en bout, dans les pays les plus pauvres comme au sein des plus puissants. La situation en Libye et les évènements au Japon illustrent à quel point le seul avenir que nous réserve la bourgeoisie est un chaos croissant et permanent. A ce titre, les révoltes dans les pays arabes, malgré toutes leurs faiblesses, nous montrent le chemin, celui de la lutte des exploités contre l’Etat capitaliste, seule à même d’éviter la catastrophe généralisée qui menace l’humanité.
V. (27-03-2011)
1 En fait, jamais depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Lire à ce propos l'article suivant de cette revues, "Que se passe-t-il au Moyen Orient ?"
Révoltes sociales au Maghreb et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye : seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre capitaliste
- 1987 lectures
Les derniers mois ont été riches en événements historiques. Si les révoltes au Maghreb et au Moyen-Orient n’ont aucun lien avec le tsunami qui a ravagé le Japon et la crise nucléaire consécutive, tous ces évènements font néanmoins ressortir avec acuité l’alternative qui s’offre plus que jamais à l’humanité : socialisme ou barbarie. Tandis que l’écho des soulèvements résonne encore dans de nombreux pays, la société capitaliste croupit lamentablement au coin de son petit feu nucléaire. Inversement, l’héroïsme des ouvriers nippons qui sacrifient leur vie aux abords de la centrale de Fukushima tranche avec l’écœurante hypocrisie des puissances impérialistes en Libye.
La mobilisation des masses fait chuter les gouvernements
Depuis plusieurs mois, des mouvements de protestation, inédits de par leur ampleur géographique 1, secouent plusieurs pays. Les premières révoltes du Maghreb ont ainsi rapidement produit des émules puisque des manifestations touchaient, quelques semaines plus tard, la Jordanie, le Yémen, Bahreïn, l’Iran, l’Afrique sub-saharienne, etc. Il est impossible d’établir une stricte identité entre tous ces mouvements, tant en termes de contenu de classe que de riposte de la bourgeoisie, mais la crise économique qui plonge les populations dans une misère de plus en plus intenable depuis 2008 rend assurément insupportables les régimes corrompus et répressifs de la région.
La classe ouvrière ne s’y est jusque-là jamais présentée comme une force autonome en mesure d’assumer la direction des luttes qui ont souvent pris la forme d’une révolte de l’ensemble des classes non-exploiteuses, de la paysannerie ruinée aux couches moyennes en voie de prolétarisation. Mais, d’une part, l’influence ouvrière sur les consciences était sensible à la fois dans les mots d’ordre et les formes d’organisation des mouvements. Une tendance à l’auto-organisation s’est, par exemple, manifestée au travers des comités de protection des quartiers, apparus en Egypte et en Tunisie pour faire face à la répression policière et aux bandes de voyous opportunément libérés des prisons pour semer le chaos. Surtout, beaucoup de ces révoltes ont ouvertement cherché à amplifier le mouvement à travers des manifestations de masse, des assemblées et des tentatives pour coordonner et centraliser les prises de décisions. D’autre part, la classe ouvrière a parfois eu un rôle décisif dans le déroulement des événements. C’est en Egypte, où la classe ouvrière est la plus concentrée et la plus expérimentée de la région, que les grèves ont été les plus massives. L’extension rapide et le rejet de l’encadrement syndical ont largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser Hosni Moubarak du pouvoir.
Alors que les mobilisations sont encore nombreuses et que le vent de la révolte souffle à nouveau dans d’autres pays, la bourgeoisie semble avoir toutes les peines du monde pour éteindre l’incendie. Surtout en Egypte et en Tunisie, où le "printemps des peuples" est censé avoir triomphé, les grèves et les affrontements avec "l’Etat démocratique" se poursuivent. L’ensemble de ces révoltes constitue une formidable expérience sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire. Néanmoins, si cette vague de révoltes, pour la première fois depuis longtemps, a explicitement lié les problèmes économiques aux enjeux politiques, la réponse à cette question s’est heurtée aux illusions qui pèsent encore sur la classe ouvrière, en particulier les mirages démocratique et nationaliste. Ces faiblesses ont souvent permis aux pseudo-oppositions démocratiques de se présenter comme une alternative aux cliques corrompues en place. En fait, ces "nouveaux" gouvernements sont essentiellement constitués du sérail des vieux régimes au point que la situation frise parfois la bouffonnerie. En Tunisie, la population a même contraint une partie du gouvernement à démissionner tant il apparaissait comme une redite exacte du régime Ben Ali. En Egypte, l’armée, soutien historique de Moubarak, tient l’ensemble des leviers de l’Etat et manœuvre déjà pour assurer sa position. En Libye, le "conseil national de transition" est dirigé par… l’ancien ministre de l’intérieur de Kadhafi, Abdel Fattah Younes, et une bande d’anciens hauts-fonctionnaires qui, après avoir organisé la répression et bénéficié de la générosité pécuniaire de leur maitre, se sont piqués d’un goût soudain pour les droits de l’homme et la démocratie.
En Libye, la guerre impérialiste fait rage sur les ruines de la révolte populaire
Sur la base de ces faiblesses, la situation en Libye a évolué d’une manière particulière dans la mesure où ce qui est très justement apparu au départ comme un soulèvement de la population contre le régime de Kadhafi s’est transformé en guerre entre plusieurs fractions bourgeoises sur laquelle sont venues se greffer les grandes puissances impérialistes dans une cacophonie surréaliste et sanglante. Le déplacement du terrain de la lutte vers la poursuite d’intérêts bourgeois, celui du contrôle de l’Etat libyen par l’une ou l’autre des fractions en présence, fut d’autant plus aisé que la classe ouvrière en Libye est très faible. L’industrie locale est notablement arriérée et presque réduite à la production de pétrole, directement pilotée par la clique de Kadhafi qui n’a jamais été en mesure de mettre un tant soit peu l’intérêt national au-dessus de ses intérêts particuliers. La classe ouvrière en Libye est, à ce titre, une main d’œuvre souvent étrangère qui, en débrayant dès le début des événements, a fini par fuir les massacres, notamment à cause de la difficulté de se reconnaitre dans une "révolution" aux accents nationalistes. C'est a contrario que la Libye illustre tragiquement la nécessité que la classe ouvrière occupe une place centrale au sein des révoltes populaires ; son effacement explique en grande partie l’évolution de la situation.
Depuis le 19 mars, après plusieurs semaines de massacres, sous le prétexte d’une intervention humanitaire pour "sauver le peuple libyen martyrisé", une coalition un peu trouble, constituée du Canada, des Etats-Unis, de l’Italie, de la France, du Royaume-Uni, etc. a directement engagé ses forces militaires afin de soutenir le Conseil national de transition. Chaque jour, des missiles sont tirés et des avions décollent pour larguer des tapis de bombes sur toutes les régions abritant des forces armées fidèles au régime de Kadhafi. En langage clair, c’est la guerre. Ce qui, d’emblée, est frappant, c’est l’incroyable hypocrisie des grandes puissances impérialistes qui, d’un côté, brandissent le drapeau déjà mité de l’humanitarisme et, dans le même temps, cautionnent le massacre des masses qui se révoltent à Bahreïn, au Yémen, en Syrie, etc. Où était cette même coalition quand Kadhafi a fait massacrer 1000 détenus dans la prison Abu Salim de Tripoli en 1996 ? En réalité, c’est depuis quarante ans que ce régime enferme, torture, terrorise, fait disparaître, exécute… en toute impunité. Où était hier cette même coalition quand Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Egypte ou Bouteflika en Algérie faisaient tirer sur la foule lors des soulèvements de janvier et février ? Derrière cette infâme rhétorique, les morts continuent à s’entasser dans les morgues. Et déjà, l’OTAN prévoit de prolonger les opérations pendant plusieurs semaines afin d’assurer le triomphe de la paix et de la démocratie.
En réalité, chaque puissance intervient en Libye pour ses intérêts particuliers. La cacophonie de la coalition, incapable de seulement établir une chaîne de commandement, illustre à quel point ces pays partent dans cette aventure guerrière en ordre dispersé afin de renforcer leur propre place dans la région, tels des vautours sur un cadavre. Du point de vue des Etats-Unis, la Libye ne représente pas un intérêt stratégique majeur dans la mesure où ils disposent déjà d’alliés de poids sur place, notamment l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Ceci explique leur perplexité initiale lors des négociations à l’ONU. Néanmoins, les Etats-Unis, soutien historique d’Israël, ont une image catastrophique dans le monde arabe, que les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan ne sont pas venues améliorer. Or, les révoltes commencent à faire émerger des gouvernements plus sensibles à l’opinion anti-américaine et, si les Etats-Unis veulent assurer leur avenir dans la région, il est impératif de redorer leur blason vis-à-vis des nouvelles équipes. Surtout, le gouvernement américain ne pouvait pas laisser les mains libres au Royaume-Uni et à la France sur le terrain. Ces derniers ont également, d’une manière ou d’une autre, une image à améliorer, notamment la Grande-Bretagne suite à ses interventions en Irak et en Afghanistan. Le gouvernement français, malgré ses multiples maladresses, jouit encore d'une certaine popularité dans les pays arabes acquise sous De Gaulle et renforcée par son refus de participer à la guerre d’Irak en 2003. Une intervention contre un Kadhafi beaucoup trop incontrôlable et imprévisible au goût de ses voisins ne pouvait être qu'appréciée par ceux-ci et permettre de renforcer l'influence de la France. Derrière les belles paroles et les faux sourires, chaque fraction bourgeoise intervient donc pour ses propres intérêts, et participe, avec Kadhafi, à cette macabre danse de la mort.
Au Japon comme ailleurs, la nature produit des phénomènes, le capitalisme des catastrophes
A plusieurs milliers de kilomètres de la Libye, sur les terres de la troisième puissance économique mondiale, le capitalisme sème également la mort et démontre que nulle part, même au cœur des pays industrialisés, l’humanité n’est à l’abri de l’irresponsabilité et de l’incurie de la bourgeoisie. Les médias aux ordres ont, comme toujours, présenté le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagé le Japon comme une fatalité contre laquelle personne ne peut rien. Il est bien sûr impossible d’empêcher la nature de se déchaîner, mais l’installation de populations sur des zones à risque dans des maisons en bois n’est pas une "fatalité", tout comme l’exploitation de centrales nucléaires hors d’âge au milieu de ce triste tableau.
La bourgeoisie est, en effet, directement responsable de l’ampleur meurtrière de la catastrophe. Pour les besoins de la production, le capitalisme a concentré les populations et les industries de manière délirante. Le Japon est une caricature de ce phénomène historique : des dizaines de millions de personnes sont massées sur les rivages d’une petite bande de terre particulièrement sujette aux séismes et donc aux tsunamis. Evidemment, les structures résistantes antisismiques ont été bâties pour les plus riches et les immeubles de bureaux ; du simple béton suffisant à se prémunir des raz-de-marée, la classe ouvrière a néanmoins dû se contenter de cages à lapins en bois sur des territoires dont tout le monde sait qu’ils sont hautement dangereux. En toute logique, la population pourrait au moins être installée plus loin des côtes mais le Japon est un pays exportateur et, pour maximiser le profit, il vaut mieux construire les usines près des ports. Certaines usines ont d’ailleurs été balayées par les eaux, surajoutant à la catastrophe nucléaire une catastrophe industrielle à peine imaginable. Dans ce contexte, une crise humanitaire menace un des centres du capitalisme mondial, et devrait encore alourdir l’hécatombe. Tandis que de nombreux équipements et infrastructures sont hors d’usage, des dizaines de milliers de personnes sont abandonnées à leur sort, sans nourriture et sans eau.
Mais la bourgeoisie ne pouvait manifestement s’arrêter là dans l’irresponsabilité et l’impunité ; il lui fallait bâtir 17 centrales nucléaires à l’entretient douteux. La situation autour de la centrale de Fukushima, victime d’avaries sévères, est encore incertaine, mais la communication confuse des autorités laisse présager le pire. Il semble déjà acquis qu’une catastrophe nucléaire digne de l’explosion, en 1986, de la centrale de Tchernobyl se déroule sous les yeux d’un gouvernement impuissant, réduit à bricoler ses installations en sacrifiant de nombreux ouvriers. La fatalité et la nature n’ont encore rien à voir avec la catastrophe. La construction de centrales sur des rivages sensibles ne paraît pas être la plus brillante des idées, en particulier lorsqu’elles ont souvent plusieurs décennies de service et qu’elles bénéficient d’un entretien réduit au minimum. A titre d’exemple stupéfiant, en 10 ans, la centrale de Fukushima a été victime de plusieurs centaines d’incidents liés à une maintenance laborieuse qui a réussi à pousser à la démission des cadres scandalisés.
La nature n’a rien à voir dans ces catastrophes ; les lois, devenues absurdes, de la société capitaliste en sont responsables de bout en bout, dans les pays les plus pauvres comme au sein des plus puissants. La situation en Libye et les évènements au Japon illustrent à quel point le seul avenir que nous réserve la bourgeoisie est un chaos croissant et permanent. A ce titre, les révoltes dans les pays arabes, malgré toutes leurs faiblesses, nous montrent le chemin, celui de la lutte des exploités contre l’Etat capitaliste, seule à même d’éviter la catastrophe généralisée qui menace l’humanité.
V. (27-03-2011)
1 En fait, jamais depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Lire à ce propos l'article suivant de cette revues, "Que se passe-t-il au Moyen Orient ?"
Géographique:
Récent et en cours:
- Catastrophes [165]
- Guerre [166]
Que se passe-t-il au Moyen-Orient ?
- 2712 lectures
Les événements actuels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont d'une importance historique majeure, dont les conséquences sont encore difficiles à cerner. Néanmoins, il est important de développer à leur propos un cadre d'analyse cohérent. Les remarques qui suivent ne constituent pas ce cadre lui-même et encore moins une description détaillée des événements, mais simplement quelques points de référence de base visant à stimuler la réflexion sur cette question.1
1. Jamais, depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Bien que l'épicentre du mouvement ait été en Afrique du Nord (Tunisie, Egypte et Libye, mais aussi Algérie et Maroc), les protestations contre les régimes existants ont aussi éclaté dans la Bande de Gaza, en Jordanie, en Irak, en Iran, au Yémen, à Bahreïn et en Arabie, tandis qu'un certain nombre d'Etats répressifs d'autres pays arabes, notamment la Syrie, sont en état d'alerte. Il en est de même pour le régime stalinien de la Chine. Il y a aussi de clairs échos de protestations dans le reste de l'Afrique : Soudan, Tanzanie, Zimbabwe, Swaziland... Nous pouvons aussi voir l'impact direct de la révolte dans les manifestations contre la corruption gouvernementale et les effets de la crise économique en Croatie, dans les banderoles et les slogans des manifestations d'étudiants au Royaume-Uni, dans les luttes ouvrières dans le Wisconsin et sans doute dans beaucoup d'autres pays. Cela ne veut pas dire que tous ces mouvements dans le monde arabe soient identiques, que ce soit dans leur contenu de classe, leurs revendications, ou dans la riposte de la classe dirigeante, mais il y a évidemment un certain nombre de caractéristiques communes qui permettent de parler d'un phénomène global.
2. Le contexte historique dans lequel ces événements se déroulent est le suivant :
- Une crise économique profonde, la plus grave de l'histoire du capitalisme, qui a frappé les économies les plus faibles du monde arabe avec une force particulière et qui a déjà plongé des millions d'êtres humains dans une pauvreté indécente, avec pour perspective des conditions de vie encore pires. Contrairement à beaucoup de pays centraux qui connaissent le 'vieillissement', les jeunes, qui constituent un très grand pourcentage de la population totale, sont particulièrement touchés par le chômage, avec un avenir totalement bouché, qu'ils soient instruits ou non. Dans tous les cas, ce sont les jeunes qui sont à la pointe de ces mouvements.
- Une nature corrompue et répressive de tous les régimes de la région qui est devenu insupportable. Alors que pendant longtemps l'activité impitoyable de la police secrète ou des forces armées a maintenu la population dans un état d'atomisation et de peur, ces armes mêmes de l'Etat ont servi à généraliser la volonté de se réunir et de résister. Cela a été très clair en Egypte, par exemple, lorsque Moubarak a envoyé son armée de voyous et de policiers en civil pour terroriser les masses qui occupaient la place Tahrir : ces provocations ont seulement renforcé la détermination des manifestants à se défendre et en ont attiré des milliers d'autres. De même, la corruption scandaleuse et la cupidité des cliques dirigeantes, qui avaient amassé d'immenses fortunes privées, alors que la grande majorité avait du mal à survivre au jour le jour, ont attisé les flammes de la rébellion, une fois que les populations ont commencé à surmonter leurs craintes.
- Cette soudaine disparition de la peur, évoquée par de nombreux participants, est non seulement le produit de changements au niveau local et régional, mais aussi d'un climat de mécontentement croissant et d'une manifestation de la lutte des classes au niveau international. Partout, face à la crise économique, les exploités et les opprimés sont de plus en plus réticents à faire les sacrifices qu'on leur demande. Là encore, le rôle joué par la nouvelle génération est essentiel, et, en ce sens, la rébellion de la jeunesse en Grèce il y a deux ans, les luttes des étudiants au Royaume-Uni et en Italie, la lutte contre la réforme des retraites en France ont aussi eu leur impact dans le monde 'arabe', en particulier à l'ère de Facebook et Twitter, où il est beaucoup plus difficile pour la bourgeoisie de maintenir un black-out cohérent des luttes contre le statu quo.
3. La nature de classe de ces mouvements n'est pas uniforme et varie d'un pays à l'autre et selon les différentes phases. On peut, cependant, dans l'ensemble les caractériser comme des mouvements des classes non-exploiteuses, comme des révoltes sociales contre l'Etat. En général, la classe ouvrière n'a pas été à la tête de ces rébellions, mais elle a certainement eu une présence et une influence considérables qui peuvent être perçues tant dans les méthodes et les formes d'organisation adoptées par le mouvement que, dans certains cas, par le développement spécifique des luttes ouvrières, comme les grèves en Algérie et surtout la grande vague de grèves en Egypte qui a été un facteur clé dans la décision de se débarrasser de Moubarak (sur laquelle nous reviendrons plus loin). Dans la majorité de ces pays, le prolétariat n'est pas la seule classe opprimée. La paysannerie et d'autres couches provenant de modes de production encore plus anciens, bien que largement éclatées et ruinées par des décennies de déclin du capitalisme, ont encore un poids dans les zones rurales, tandis que dans les villes, où les révoltes ont toujours été concentrées, la classe ouvrière coexiste avec une vaste classe moyenne qui est en voie de prolétarisation, mais qui a gardé ses traits spécifiques et une masse d'habitants de taudis qui sont constitués, d'une part, de prolétaires et d'autre part de petits commerçants et d'éléments 'lumpenisés'. Même en Egypte, où se trouve la classe ouvrière la plus concentrée et la plus expérimentée, des témoins oculaires sur la place Tahrir ont souligné que les protestations avaient mobilisé toutes les classes, à l'exception des échelons supérieurs du régime. Dans d'autres pays, le poids des couches non prolétariennes a été beaucoup plus fort qu'il ne l'a été dans la majorité des luttes des pays centraux.
4. Lorsqu'on essaie de comprendre la nature de classe de ces rébellions, nous devons donc éviter deux erreurs symétriques : d'une part, une identification générale de toutes les masses en lutte avec le prolétariat (la position la plus caractéristique de cette vision est celle du Groupe Communiste Internationaliste), et d'autre part, un rejet de ce qui peut être positif dans des révoltes qui ne sont pas explicitement celles de la classe ouvrière. La question posée ici nous ramène à des événements antérieurs, comme ceux de l'Iran à la fin des années 1970, où, là encore, nous avons vu une révolte populaire au cours de laquelle, pendant un certain temps, la classe ouvrière a été en mesure d'assumer un rôle de premier plan, bien que finalement ce dernier n'ait pas été suffisant pour empêcher la récupération du mouvement par les islamistes. À un niveau plus historique, le problème de la classe ouvrière, qui émerge d'un mouvement de révoltes englobant toutes les classes sociales non-exploiteuses, mais qui, face à elles, a besoin de maintenir son autonomie de classe, rappelle aussi le problème de l'Etat dans la période de transition entre le capitalisme et le communisme.
5. Dans la révolution russe, la forme d'organisation en soviet a été engendrée par la classe ouvrière, mais elle a également fourni un modèle d'organisation pour tous les opprimés. Sans perdre le sens des proportions - parce qu'il y a encore un long chemin avant d'arriver à une situation révolutionnaire dans laquelle la classe ouvrière serait capable d'apporter une direction politique claire aux autres couches sociales - nous pouvons voir que les méthodes de lutte de la classe ouvrière ont eu un impact sur les révoltes sociales dans le monde arabe :
- Dans les tendances à l'auto-organisation, qui sont apparues plus clairement dans les comités de protection des quartiers, qui ont émergé comme une réponse à la tactique du régime égyptien qui lâchait des bandes de criminels contre la population, dans la structure du 'délégué' de certaines des assemblées massives sur la place Tahrir, dans l'ensemble du processus de discussion et de prises de décisions collectives ;
- Dans l'occupation d'espaces normalement contrôlés par l'Etat pour se donner un lieu central afin de se rassembler et de s'organiser à une échelle massive ;
- Dans la prévision consciente de la nécessité de se défendre contre les voyous et la police envoyés par les régimes, mais en même temps dans le rejet de la violence gratuite, de la destruction et du pillage, dans leur propre intérêt ;
- Dans des efforts délibérés pour surmonter les divisions sectaires et autres qui ont été cyniquement manipulées par les régimes : divisions entre chrétiens et musulmans, chiites et sunnites, religieux et laïcs, hommes et femmes ;
- Dans les nombreuses tentatives pour fraterniser avec les soldats du rang.
Ce n'est pas un hasard si ces tendances se sont le plus fortement développées en Egypte, là où la classe ouvrière a une longue tradition de luttes et où, à une étape cruciale du mouvement, elle a émergé comme une force distincte, pour se livrer à une vague de luttes qui, comme celles de 2006-2007, peuvent être considérées comme des 'germes' de la grève de masse à venir, contenant un certain nombre de ses caractéristiques parmi les plus importantes : l'extension spontanée des grèves et des exigences d'un secteur à l'autre, le rejet intransigeant des syndicats d'Etat, certaines tendances à l'auto-organisation, le développement de revendications à la fois économiques et politiques. Ici, nous voyons, dans ses grandes lignes, la capacité de la classe ouvrière à se présenter comme le porte-parole de tous les opprimés et exploités et la seule classe qui offre la perspective d'une société nouvelle.
6. Toutes ces expériences sont de vrais tremplins pour le développement d'une conscience véritablement révolutionnaire. Mais la route dans cette direction est encore longue, elle est parsemée de nombreuses et indéniables illusions et faiblesses idéologiques :
- Des illusions, surtout dans la démocratie, qui sont extrêmement fortes dans les pays qui ont été régis par une combinaison de tyrannie militaire et de monarchies corrompues, où la police secrète est omniprésente et où l'arrestation, la torture et l'exécution des dissidents sont monnaie courante. Ces illusions ouvrent une porte pour que 'l'opposition' démocratique se présente comme une équipe alternative pour la gestion de l'Etat : El Baradei et les Frères Musulmans en Egypte, le Gouvernement de Transition en Tunisie, le Conseil National en Libye ... En Egypte, les illusions dans l'armée comme étant celle du 'peuple' sont particulièrement fortes, même si les récentes actions de répression de l'armée contre les manifestants sur la place Tahrir, conduiront certainement une minorité vers la réflexion. Un aspect important du mythe démocratique en Egypte est la demande de syndicats indépendants, dans laquelle se sont sans doute impliqués de nombreux travailleurs parmi les plus combatifs qui ont, avec raison, appelé à la dissolution des syndicats officiels discrédités ;
- Des illusions par rapport au nationalisme et au patriotisme, avec l'exhibition largement répandue du drapeau national comme le symbole de la 'révolution' en Egypte et en Tunisie, ou, comme en Libye, du vieux drapeau monarchique, comme emblème de tous ceux qui s'opposent au règne de Kadhafi. Une fois encore, l'image de marque de Moubarak comme un agent du sionisme sur un certain nombre de bannières en Egypte montre que la question du conflit Israël/Palestine reste comme un levier potentiel pour détourner les conflits de classe vers un conflit impérialiste. Cela dit, il y avait peu d'intérêt à soulever la question palestinienne, compte tenu du fait que la classe dirigeante a si longtemps utilisé les souffrances des Palestiniens comme un moyen de détourner l'attention des souffrances qu'elle a imposées à sa propre population, et il y avait sûrement quelque chose d'internationaliste dans le fait de brandir des drapeaux d'autres pays, comme expression de solidarité avec leurs rébellions. L'ampleur même de la révolte à travers le monde 'arabe' et au-delà est une démonstration de la réalité matérielle de l'internationalisme, mais l'idéologie patriotique a des capacités très fortes d'adaptation et, dans ces événements, nous voyons comment elle peut se transformer en des formes plus populistes et plus démocratiques ;
- Des illusions sur la religion, avec l'utilisation fréquente de la prière publique et l'utilisation de la mosquée en tant que centre d'organisation de la rébellion. En Libye, il est prouvé que ce sont plus spécifiquement les groupes islamistes (du terroir plutôt que liés à Al-Qaïda, comme le prétend Kadhafi) qui ont joué, dès le début, un rôle important dans la révolte. Ceci, ainsi que le rôle des loyautés tribales, est un reflet de la faiblesse relative de la classe ouvrière libyenne et du retard du pays et de ses structures étatiques. Toutefois, dans la mesure où l'islamisme radical du type Ben Laden s'est présenté comme la réponse à la misère des masses 'en terre musulmane', les révoltes en Tunisie et en Egypte, et même en Libye et dans les Etats du Golfe comme le Yémen et le Bahreïn, ont montré que les groupes jihadistes, avec leur pratique de petites cellules terroristes et leurs idéologies nocives et sectaires, ont été presque entièrement marginalisés par le caractère massif des mouvements et par les efforts véritables de ces dernières pour surmonter les divisions sectaires.
7. La situation actuelle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est toujours sous pression. Au moment où nous écrivons, il faut s'attendre à des manifestations à Riyad, alors même que le régime saoudien a déjà décrété que toutes les manifestations sont contraires à la charia. En Egypte et en Tunisie, où la 'révolution' est censée avoir déjà triomphé, il y a des affrontements permanents entre les manifestants et l'Etat, maintenant 'démocratique', qui est administré par des forces qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui ont mené la danse avant le départ des 'dictateurs'. La vague de grèves en Egypte, qui a rapidement conquis bon nombre de ses revendications, semble avoir diminué. Mais, ni la lutte ouvrière, ni le mouvement social plus large, n'ont subi de contrecoup et de défaite dans ces pays, et il y a, certainement en Egypte, des signes d'un large débat et d'une réflexion en cours. Cependant, les événements en Libye ont pris une tournure très différente. Ce qui semble avoir commencé comme une véritable révolte de « ceux d'en bas », avec des civils, sans armes, partant courageusement à l'assaut des casernes des militaires et incendiant les QG des soi-disant 'Comités du Peuple', en particulier dans l'est du pays, a été rapidement transformé en une totale et très sanglante 'guerre civile' entre des fractions de la bourgeoisie, avec les puissances impérialistes rôdant à l'affut comme des vautours au-dessus du carnage. En termes marxistes, il s'agit en fait, d'un exemple de la transformation d'une guerre civile naissante - dans son sens véritable d'une confrontation directe et violente entre les classes - en une guerre impérialiste. L'exemple historique de l'Espagne en 1936 - en dépit des différences considérables dans l'équilibre global des forces entre les classes, et dans le fait que la révolte initiale contre le coup d'Etat de Franco ait été, sans équivoque, de nature prolétarienne - montre comment la bourgeoisie nationale et internationale peut vraiment intervenir dans de telles situations à la fois en poursuivant ses rivalités de factions, nationales et impérialistes et en écrasant toute possibilité de révolte sociale.
8. Le contexte de cette tournure des événements en Libye est lié au retard extrême du capitalisme libyen, qui a été gouverné pendant plus de 40 ans par la clique de Kadhafi, principalement à travers un appareil de terreur, directement sous son commandement. Cette organisation a freiné le développement d'une armée en tant que force capable de mettre l'intérêt national au-dessus de l'intérêt d'un chef particulier ou d'une faction, comme cela a a été le cas en Tunisie et en Egypte. Dans le même temps, le pays est déchiré par les divisions régionales et tribales et celles-ci ont joué un rôle clé par rapport au soutien ou à l'opposition à Kadhafi. Une forme 'nationale' d'islamisme semble avoir également joué, dès le début, un rôle dans la révolte, bien que la rébellion ait été à l'origine plus générale et sociale que simplement tribale ou islamique. La principale industrie de la Libye est le pétrole et les turbulences qu'il a subies ont un effet très sévère sur les prix mondiaux du pétrole. Mais une grande partie de la population active occupée dans l'industrie pétrolière est constituée d'immigrants venant d'Europe, du reste du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, et même s'il y a eu très tôt des compte-rendus de grèves dans ce secteur, l'exode massif des travailleurs 'étrangers' fuyant les massacres est un signe clair qu'ils se reconnaissaient peu dans une 'révolution' qui hisse le drapeau national. En fait, il y a eu des compte-rendus sur la persécution de travailleurs noirs entre les mains des forces 'rebelles', car il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles certains mercenaires avaient été recrutés par le régime pour écraser les manifestations dans des Etats africains, ce qui jetait la suspicion sur tous les immigrants noirs. La faiblesse de la classe ouvrière en Libye est donc un élément crucial dans l'évolution négative de la situation dans ce pays.
9. Une preuve manifeste que la 'rébellion' est devenue une guerre entre camps bourgeois est fournie par la désertion très hâtive du régime de Kadhafi par de nombreux hauts fonctionnaires, y compris des ambassadeurs étrangers, des officiers de l'armée et de la police et des hauts fonctionnaires. Les commandants militaires ont, notamment, mis en avant la 'régularisation' des forces armées anti-Kadhafi. Mais peut-être le signe le plus frappant de ce changement est-il la décision de la majeure partie de la 'communauté internationale' de s'aligner à côté des 'rebelles'. Le Conseil National de Transition, basé à Benghazi, a déjà été reconnu par la France comme la voix de la nouvelle Libye., Et une petite intervention militaire sur le terrain a déjà pris forme par l'envoi de 'conseillers' pour aider les forces anti-Kadhafi. Etant déjà intervenus diplomatiquement pour accélérer le départ de Ben Ali et de Moubarak, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres puissances ont été encouragées par le vacillement, au début, du régime de Kadhafi : William Hague, par exemple, a prématurément annoncé que Kadhafi était en route vers le Venezuela. Alors que les forces de Kadhafi commençaient à reprendre le dessus, les voix pour imposer une zone d'exclusion aérienne ou pour utiliser d'autres formes d'intervention militaire directe devenaient plus fortes. Cependant, au moment où nous écrivons, il semble y avoir de profondes divisions au sein de l'UE et de l'OTAN, avec la Grande-Bretagne et la France plus fortement favorables à une action militaire et les Etats-Unis et l'Allemagne plus réticents. L'administration Obama n'est bien sûr pas opposée, sur le principe, à une intervention militaire, mais elle n'a nullement envie de s'exposer au danger d'être entraînée dans un autre bourbier insoluble, dans le monde arabe. Il se peut également que certaines parties de la bourgeoisie mondiale se demandent si la terreur de masse employée par Kadhafi ne serait pas un 'remède' pour décourager de nouveaux troubles dans la région. Une chose est certaine cependant : les événements libyens, et même tout le développement de la situation dans la région, ont révélé l'hypocrisie grotesque de la bourgeoisie mondiale. Après avoir, pendant des années, vilipendé la Libye de Kadhafi comme un foyer du terrorisme international (ce qu'elle était, bien sûr), les dirigeants de pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui avaient du mal à justifier leur position sur les présumées armes de destruction massive de Saddam Hussein, ont eu leur coeur réchauffé par la décision de Kadhafi, en 2006, de larguer ses propres armes de destruction massive. Tony Blair, en particulier, avait montré une hâte indécente en embrassant l'ex- 'leader terroriste fou'. Seulement quelques années plus tard, Kadhafi est à nouveau un 'leader terroriste fou'' et ceux qui l'ont soutenu doivent se hâter de prendre leurs distances par rapport à lui. Et ce n'est là qu'une version de la même histoire: presque tous les 'dictateurs arabes', d'hier ou d'aujourd'hui, ont bénéficié de l'appui fidèle des Etats-Unis et d'autres puissances, qui ont jusqu'à présent manifesté très peu d'intérêt pour les aspirations démocratiques de la population de Tunisie, d'Egypte, de Bahreïn ou d'Arabie. La flambée de manifestations de rue, provoquée par la hausse des prix et les pénuries de biens de première nécessité et, dans certains cas, violemment réprimées, contre le gouvernement de l'Irak, imposé par les États-Unis, y compris les dirigeants actuels du Kurdistan irakien, révèle encore plus la vacuité des promesses fabriquées par 'l'Occident démocratique'.
10. Certains anarchistes internationalistes de Croatie (du moins avant qu'ils ne commencent à prendre part aux manifestations en cours à Zagreb et ailleurs) sont intervenus sur libcom.org pour faire valoir que les événements dans le monde arabe se sont présentés à leurs yeux comme une répétition des événements en Europe de l'Est en 1989, au cours desquels toutes les aspirations de changement ont été dévoyées vers la voie de garage qui porte le nom de 'démocratie', et qui n'apporte absolument rien pour la classe ouvrière. C'est une préoccupation très légitime, étant donné la force évidente des mystifications démocratiques au sein de ce nouveau mouvement, mais il manque la différence essentielle entre les deux moments historiques, surtout au niveau de la configuration des forces de classes à l'échelle mondiale. Au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, la classe ouvrière des pays de l'Ouest atteignait les limites d'une période de luttes qui n'avaient pas été en mesure de se développer sur le plan politique. L'effondrement du bloc de l'Est, avec ses campagnes sur la "mort du communisme" et la "fin de la lutte de classes", et avec l'incapacité de la classe ouvrière de l'Est de riposter sur son propre terrain de classe, a contribué à plonger la classe ouvrière internationale dans une longue période de recul. Dans le même temps, bien que les régimes staliniens aient été en réalité les victimes de la crise économique mondiale, à l'époque, c'était loin de paraître évident et il y avait encore assez de marge de manœuvre dans les économies occidentales pour alimenter l'illusion qu'une ère nouvelle s'ouvrait pour le capitalisme mondial. La situation est aujourd'hui très différente. La nature mondiale de la crise capitaliste n'a jamais été aussi évidente, ce qui rend beaucoup plus facile pour les prolétaires du monde entier de comprendre que, pour l'essentiel, ils sont tous confrontés aux mêmes problèmes : le chômage, la hausse des prix, l'absence de tout avenir dans le système. Et au cours des sept ou huit dernières années, nous avons pu voir une reprise lente, mais réelle, des luttes ouvrières à travers le monde, des luttes généralement dirigées par une nouvelle génération de prolétaires qui est moins marquée par les échecs des années 80 et 90 et qui donne naissance à une minorité croissante d'éléments politisés, encore une fois à l'échelle mondiale. Compte tenu de ces différences profondes, il y a une réelle possibilité que les événements dans le monde arabe, loin d'avoir un impact négatif sur la lutte de classes dans les pays centraux, soient intégrés à son développement futur :
- En réaffirmant la puissance de l'action massive et illégale dans les rues, sa capacité à ébranler la sérénité des souverains de la terre ;
- En annihilant la propagande bourgeoise sur 'les Arabes' considérés comme une masse uniforme de fanatiques sans cervelle et en démontrant la capacité des masses, dans ces régions, de discuter, de réfléchir et de s'organiser ;
- En renforçant la perte de crédibilité des dirigeants des pays centraux dont la vénalité et le manque de scrupules ont été mis en évidence par leurs attitudes de girouettes à l'égard des régimes dictatoriaux du monde arabe.
Ces éléments et d'autres seront tout d'abord beaucoup plus évidents pour la minorité politisée que pour la majorité des travailleurs des pays centraux, mais, sur le long terme, ils contribueront à une véritable unification de la lutte de classe, par delà les frontières nationales et continentales. Rien de tout cela, cependant, ne diminue la responsabilité de la classe ouvrière des pays avancés, qui a expérimenté, pendant des années, les délices de la 'démocratie' et d'un 'syndicalisme indépendant', une classe dont les traditions politiques et historiques sont profondément ancrées, même si elles ne sont pas encore très répandues, et qui est concentrée au coeur du système impérialiste mondial. La capacité de la classe ouvrière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient d'en finir avec les illusions démocratiques et d'offrir une véritable perspective aux masses déshéritées de la population est toujours fondamentalement conditionnée par la capacité des travailleurs des pays centraux de leur fournir un exemple clair de lutte prolétarienne auto-organisée et politisée.
CCI (11 Mars)
1 Ce document a été rédigé le 11 mars, c'est-à-dire plus d'une semaine avant le début de l'intervention de la "coalitions" en Libye. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas référence à cette intervention, tout en la laissant pressentir.
Géographique:
- Moyen Orient [167]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique
- 3331 lectures
Pendant plusieurs générations, l’Afrique a été synonyme de catastrophes, de guerres et de massacres permanents, de famine, de maladies incurables, de gouvernements corrompus, bref de misère absolue sans issue. Tout au plus, quand on évoque son histoire (en dehors des aspects "exotiques" ou "folkloriques"), on désigne ses "braves" tirailleurs sénégalais ou maghrébins, les célèbres supplétifs de l’armée coloniale française lors des deux guerres mondiales et du maintien de l’ordre dans les anciennes colonies. Mais jamais on ne prononce les mots "classe ouvrière" et moins encore on évoque ses luttes, tout simplement parce que cela n’est jamais entré véritablement dans l’imaginaire des masses au niveau mondial comme au niveau africain.
Pourtant, le prolétariat mondial est bien présent en Afrique et a déjà montré par ses luttes qu’il fait partie de la classe ouvrière porteuse d’une mission historique. Cependant, son histoire a été délibérément occultée par l’ancienne bourgeoisie coloniale, puis étouffée par la nouvelle bourgeoisie africaine après la "décolonisation".
Par conséquent, le but principal de cette contribution est de fournir des éléments attestant la réalité bien vivante de l’histoire du mouvement ouvrier africain à travers ses combats contre la classe exploiteuse. Certes, il s’agit de l’histoire d’une classe ouvrière à la dimension d’un contient historiquement sous développé.
Mais, comment et pourquoi cette occultation de l'histoire du prolétariat en Afrique ?
"L’Afrique a-t-elle une histoire ? Il n’y a pas si longtemps, l’on répondait encore à cette question négativement. Dans un passage devenu célèbre, l’historien anglais Hugh Trevor-Roper comparait en 1965 l’histoire de l’Europe et elle de l’Afrique, et en concluait qu’au fond la seconde n’existait pas. Le passé africain, écrivait-il ne présentait aucun intérêt hormis "les tribulations de tribus barbares dans des endroits du globe pittoresques certes, mais sans la moindre importance". Trevor-Roper peut certes être qualifié de conservateur, mais il se trouve que le marxiste hongrois Endre Sik défendait plus ou moins le même point de vue en 1966 : "Avant d’entrer en contact avec les Européens, la plupart des Africains menaient encore une existence primitive et barbare, et nombre d’entre eux n’avaient même pas dépassé le stade de la barbarie la plus primitive. (…) Aussi est-t-il irréalise de parler de leur "histoire" - dans la conception scientifique du terme - avant l’arrivée des envahisseurs européens ?
Ce sont là des propos particulièrement musclés, mais la majorité des historiens de l’époque y souscrivait jusqu’à un certain point".1
Voilà comment, par le mépris raciste, les penseurs de la bourgeoisie coloniale européenne décrétèrent la non existence de l’histoire du continent noir. Et, en conséquence, pourquoi la classe ouvrière, elle non plus, n’a, aux yeux du monde, aucune histoire.
Mais surtout, ce qui frappe encore à la lecture de ces propos, c’est de voir unis dans leurs préjugés a-historiques sur l’Afrique, les "bon penseurs" des deux ex-blocs impérialistes de l’époque, à savoir le "bloc démocratique" de l’Ouest et le bloc "socialiste" de l’Est. En effet, celui qui est qualifié de "marxiste", Endre Sik, n’est rien d’autre qu’un stalinien de bon teint dont l’argumentaire n’est pas moins fallacieux que celui de son rival (ou compagnon) anglais Trevor- Roper. Par leur déni de l’histoire de l’Afrique (et de ses luttes de classes), ces messieurs, représentants de la classe dominante, expriment une vision de l’histoire encore plus barbare que la "barbarie des tribulations des tribus africaines". En réalité, ces auteurs font partie des "savants" qui avaient donné leur "bénédiction scientifique" aux thèses ouvertement racistes des pays colonisateurs. Ce qui n’est pas le cas de l’auteur qui a relevé leurs propos, Henri Wesseling, car il se démarque de ses collègues "historiens" en ces termes :
"(…) La vérité est tout autre. Un certain nombre d’Africains, tels que le khédive d’Egypte, le sultan du Maroc, le roi zoulou Cetwayo, le roi des Matabélés Lobengula, l’almami Samori et le Makoko des Batékés, ont considérablement influencé le cours des choses".
Certes, par sa réaction, Henri Wesseling s’honore assurément en rétablissant la vérité historique dans le cas d’espèce face aux falsificateurs bien intentionnés. Reste que d’autres "scientifiques" qui, après avoir admis la réalité de l’histoire de l’Afrique et celle de la classe ouvrière, persistent eux aussi dans la vision très idéologique de l’histoire, en particulier de la lutte des classes. En effet, ils excluent ni plus ni moins la possibilité d’une révolution prolétarienne sur le continent noir avec des arguments pas moins aussi douteux que ceux employés par les historiens racistes 2:
"(…) Rebelles, les travailleurs africains le sont aussi à la prolétarisation : le témoignage de leur résistance permanente au salariat intégral (…) rend fragile la théorie importée d’une classe ouvrière porteuse d’une mission historique. L’Afrique n’est pas une terre de révolutions prolétariennes, et les quelques copies catastrophiques de ce modèle ont toutes eu, peu ou prou, à affronter violemment la dimension sociale vivante du "prolétariat"".
Précisons tout de suite que les auteurs de cette citation sont des sociologues universitaires composés de chercheurs anglophones et francophones. Par ailleurs, le titre de leur ouvrage, Classes ouvrières d’Afrique noire, en dit long sur leurs préoccupations de fond. D’autre part, si c’est clair qu’ils ne nient pas, eux, la réalité de l’histoire du continent africain comme le font leurs homologues historiens, en revanche, comme eux, leur démarche procède de la même idéologie qui consiste à prendre son point de vue pour "vérité scientifique" sans l’avoir confronté à l’histoire réelle. Déjà, en parlant de "quelques copies catastrophiques de ce modèle", ils confondent (involontairement ?) la révolution prolétarienne, comme celle de 1917 en Russie, avec les coups de force de type stalinien ou des luttes de "libération nationale" qui ont surgi partout dans le monde au lendemain de la seconde boucherie impérialiste mondiale, sous le vocable "socialiste" ou "progressiste". Ce sont bien ces modèles-là qui ont eu à affronter violemment le prolétariat qui leur résistait. Que cela soit en Chine, à Cuba, dans les anciens pays du bloc soviétique ou dans le "Tiers monde" en général et en Afrique en particulier. Mais surtout, ces sociologues virent carrément à la contre-révolution quand ils mettent en garde contre la "théorie importée d’une classe ouvrière porteuse d’une mission historique", d’où logiquement leur conclusion suivant laquelle l’Afrique n’est pas une terre de révolutions prolétariennes. De fait, ce groupe de "savants", en niant la possibilité de toute lutte révolutionnaires sur le continent noir, semble exclure de fait l’extension de toute autre révolution ("exportée") à Afrique. Du coup, ils ferment la porte à toute perspective de sortie de la barbarie capitaliste dont sont victimes les classes exploitées et les populations africaines en général. Finalement, ils n’apportent aucun éclairage par rapport à l’histoire véritable de la classe ouvrière.
Pour ce qui nous concerne, n’en déplaise à "nos" sociologues, la classe ouvrière reste encore la seule classe porteuse d'une mission historique face à la faillite du capitalisme qui s’accélère de jour en jour, y compris en Afrique comme l’atteste l’historien. Iba Der Thiam 3 , lorsqu'il fait le bilan des luttes ouvrières du début 19e au début des années 1930 :
"Dans le domaine syndical, la période 1790-1929 fut, nous l’avons vu, une étape décisive. Période de réveil, d’éveil, et puis d’affirmation, elle fut pour la classe ouvrière l’occasion souvent renouvelée de donner la preuve de sa détermination et de son esprit de lutte et d’abnégation.
De l’apparition d’une conscience présyndicale, jusqu’à la veille de la crise économique mondiale, nous avons suivi toutes les phases, d’une prise de conscience dont la rapidité du processus comparée au long cheminement de la classe ouvrière française, dans le même domaine, paraît tout à fait exceptionnelle.
L’idée de grève, c'est-à-dire d’un moyen de lutte, d’une forme d’expression consistant à se croiser les bras, et à interrompre provisoirement le déroulement normal de la vie économique pour faire valoir des droits, contraindre un patronat à se pencher sur des revendications salariales par exemple, ou accepter de négocier avec les grévistes ou leurs représentants, fit, en moins de quinze années, des progrès considérables, acquit même droit de cité, nonobstant les dispositions d’une législation restrictive, et fut reconnue comme une pratique sinon légale, du moins légitime.
(…) La résistance patronale, mises à part quelques exceptions, ne fit que rarement preuve d’une rigidité extrême. D’un réalisme lucide, les propriétaires des moyens de production ne mettaient en général, non seulement aucune réticence à préconiser et à rechercher le dialogue avec les grévistes, mais il leur arrivait même de pousser le Gouverneur à diligenter ses procédures d’intervention, et ne se gênaient pas, lorsque leurs intérêts étaient gravement menacés, à prendre fait et cause pour les travailleurs, dans les conflits qui les opposaient au chemin de fer par exemple, où il est vrai, la part de l’Etat dans les capitaux, était considérable".
Non seulement cet exposé suffit amplement pour caractériser une classe ouvrière porteuse d’espoir, mais celle qui a une histoire en Afrique qu’elle partage de surcroît avec la bourgeoisie à travers des confrontations historiques de classes, comme cela s’est passé souvent dans le monde depuis que le prolétariat s’est constitué en classe sous le régime capitaliste.
Avant de poursuivre sur l’histoire du mouvement ouvrier africain, nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que nous allons nous heurter aux difficultés liées au déni de l’histoire de l’Afrique par les historiens et les autres penseurs des anciennes puissances coloniales. En effet, cela s’est traduit, par exemple, chez les administrateurs coloniaux par une politique de censure systématique des faits et gestes les plus importants de la classe ouvrière, notamment ceux qui mettaient en relief la force de la classe ouvrière. De ce fait, nous sommes réduits ici à nous appuyer sur des sources rares d’auteurs plus ou moins connus mais dont la rigueur des travaux nous semble globalement prouvée et convaincante. D’autre part, si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations.
Quelques éléments du contexte
Le Sénégal fut la plus ancienne des colonies françaises en Afrique, la France s’y installa officiellement de 1659 à 1960.
Un historien situe le début de l’histoire du mouvement ouvrier africain à la fin du 18e siècle, d’où le titre de son ouvrage "Histoire du Mouvement syndical africain 1790- 1929".
Les premiers ouvriers professionnels (artisans charpentiers, menuisiers, maçons, etc.) furent des européens installés à Saint- Louis du Sénégal (ancienne capitale des colonies africaines).
Avant la seconde guerre mondiale, la population ouvrière de la colonie francophone d'Afrique Occidentale Française (AOF) se trouvait essentiellement au Sénégal, entre Saint-Louis et Dakar qui furent respectivement capitale de l’AOF et capitale de la fédération qui regroupait l'AOF, l'Afrique Equatoriale Française (AEF), le Cameroun et le Togo. Surtout à Dakar qui était le "poumon économique" de la colonie AOF, avec le port, le chemin de fer, et évidemment le gros des fonctionnaires et des employés des services.
Au plan numérique, la classe ouvrière a toujours été historiquement faible en Afrique en général, cela étant dû évidemment au faible développement économique du continent, lequel s’explique à son tour par le faible investissement sur place des pays colonisateurs. De ce fait, la population ouvrière était estimée en 1927, par le Gouverneur de la colonie, à 60 000 personnes. Certes, certains disent que la moitié des ouvriers était exclue de ce chiffre, à savoir les éternels "journaliers" et autres apprentis.
Depuis ses premiers combats jusqu’aux années 1960, le prolétariat s’est toujours confronté systématiquement à la bourgeoisie française qui détenait les moyens de production à côté de l’administration coloniale. Cela signifie que la bourgeoisie sénégalaise naquit et évolua à l’ombre de sa "grande sœur française" (au moins jusqu’aux années 1960).
Luttes de classes au Sénégal
"L’histoire du mouvement syndical africain n’a, jusqu’à ce jour, jamais été globalement écrite. (…) La raison fondamentale de cette carence nous paraît résider, d’une part, dans l’indigence des recherches consacrées aux différents segments de la classe ouvrière africaine dans une perspective qui soit à la fois synchronique et diachronique ; d’autre part, dans l’absence d’une étude systématique des différents conflits sociaux qui ont été enregistrés, conflits sociaux dont chacun referme des gisements d’informations sur les préoccupations des travailleurs, leurs formes d’expression, les réactions de l’administration coloniale et du patronat, celles de la classe politique, les conséquence de tous ordres que ces épreuves ont eues sur l’histoire intérieure des colonies au quadruple plan économique, social, politique et culturel (…)".(Thiam. ibid.)
Comme vient de le souligner Iba Der Thiam, plusieurs facteurs expliquent les difficultés d’écrire l’histoire du mouvement ouvrier en Afrique. Reste que l’obstacle majeur sur lequel les chercheurs ont buté est sans conteste lié au fait que les véritables détenteurs des informations sur la classe ouvrière, à savoir les autorités coloniales françaises, elles, se gardèrent longtemps de leur ouvrir les archives de l’Etat. Et pour cause : elles avaient intérêt à cacher des choses .
En effet, avec la levée partielle des archives coloniales en AOF (au lendemain de la chute du mur de Berlin), on apprend que, non seulement la classe ouvrière existait en Afrique depuis le 19e siècle mais, très naturellement, elle a pu mener des combats souvent victorieux contre son ennemi de classe. 1855 marqua la première expression d’une organisation ouvrière où, à Saint Louis du Sénégal, un groupe de 140 ouvriers africains (charpentiers, maçons,) décida de se battre contre les vexations des maîtres européens qui leur imposaient des conditions de travail inacceptables. De même, on peut lire dans les archives l’existence d’un syndicat (clandestin) des "Charpentiers du Haut-Fleuve" en 1885. Surtout un nombre important de grèves et d’affrontements très durs eurent lieu entre la classe ouvrière et la bourgeoisie coloniale française, à l’instar de la grève générale avec émeute en 1914 à Dakar où, durant 5 jours, la vie économique et sociale fut totalement paralysée et où le Gouverneur fédéral de l’AOF William Ponti, lui-même, reconnut (dans ses notes secrètes) que "La grève était parfaitement organisée et eut un plein succès". Il y eut aussi de nombreuses autres grèves victorieuses, notamment celle d’avril 1919 et celle de 1938 menées par les cheminots (européens et africains unis) mais aussi où l’Etat dut recourir à la répression policière avant d’être contraint de satisfaire les revendications des grévistes. Ajoutons l’exemple de la grève générale de 6 mois (entre octobre 1947 et mars 1948) des cheminots de toute l’AOF, où les grévistes durent subir les balles du gouvernement PS (SFIO) avant de sortir victorieux du combat.
Enfin, il y a aussi ce fameux "Mai 68" mondial qui fit tache d’huile en Afrique et au Sénégal, venant rompre brutalement le "consensus national" ou patriotique qui régnait jusqu’alors depuis "l’indépendance" des années 1960. Et où, de par leur lutte sur un terrain de classe prolétarien, les ouvriers et les jeunes scolarisés ont dû affronter violemment le régime profrançais de Senghor en réclamant une amélioration de leurs conditions de vie et d’études. Ce faisant, le mouvement ouvrier a repris le chemin de la lutte qu’il connaissait depuis le début du 20e siècle mais qui fut obstrué par la perspective trompeuse de "l’indépendance nationale".
Ce sont là quelques exemples pour illustrer l’existence réelle d’une classe ouvrière, combative et souvent consciente de ses intérêts de classe ayant, certes, rencontré d’immenses difficultés de toutes sortes depuis sa naissance.
Naissance du prolétariat africain
Il convient de préciser d’emblée qu’il s’agit du prolétariat émergeant sous le régime du capitalisme colonial, étant entendu que, faute d’avoir accompli sa propre révolution contre le féodalisme, la bourgeoisie africaine doit son existence, elle aussi, à la présence du colonialisme européen sur son sol.
En d’autres termes, il s’agit de la naissance du prolétariat, moteur du développement des forces productives sous le règne du capitalisme triomphant du régime féodal, l’ancien système dominant, dont les résidus sont encore bien visibles aujourd’hui à maints endroits sur le continent noir.
"Au cours des siècles ayant précédé l’arrivée des colonisateurs, dans leur continent, les sociétés africaines, comme toutes les autres sociétés humaines, connaissaient le travail et utilisaient une main-d’œuvre, dans des conditions qui leur étaient particulières. (…)
L’économie était essentiellement agricole ; une agriculture d’ailleurs à prédominance vivrière, parce qu’utilisant des techniques rudimentaires, ne parvenait que rarement à dégager des surplus importants ; une économie fondée également sur des activités de chasse, de pêche, et de cueillette, auxquelles, pouvaient, dans certains cas, s’ajouter soit l’exploitation de quelques mines, soit un artisanat local de faible rentabilité, enfin des activités d’échanges, d’ampleur relative, qui se déroulaient à cause de la modicité et l’indigence des moyens de communication, à l’intérieur du groupe, de la région, et plus rarement du royaume, dans des marchés à périodicité régulière.
Dans un tel contexte, les modes de production étaient souvent lignagers et secrétaient rarement des antagonismes suffisamment vigoureux et assez conflictuels pour déterminer l’existence de classes sociales véritables au sens marxiste du terme.
(…) Autant la notion de biens dans les sociétés sénégambiennes précoloniales y était différente de sa notion européenne moderne, autant celle de travail et de service l’était plus encore. En effet, si dans les sociétés modernes fondées sur le développement industriel et le travail salarié, le travail est négocié comme bien économique, et comme tel, soumis forcément aux mécanismes inéluctables des lois du marché, où les rapports entre l’offre et la demande détermine les prix des services, dans les sociétés précoloniales négro-africaines, sénégambiennes, le travail ne nous paraît pas avoir eu une fonction autonome, indépendante de la personne. Il est une sorte d’activité communautaire découlant logiquement des normes de vie collective, une activité imposée par le statut social et les nécessités économiques (…).
La conquête coloniale essentiellement fondée sur l’esprit de puissance, la recherche de l’accumulation du profit par l’exploitation des ressources humaines, matérielles et minières, eut largement recours à la main-d’œuvre indigène, et n’hésitait pas à faire appel aux moyens que mettait à sa disposition, l’exercice du pouvoir étatique pour utiliser d’abord gratuitement le travail des populations locales, avant d’introduire le salariat, créant ainsi des conditions et des rapports nouveaux aussi bien pour le travail que pour le travailleur" (Thiam. ibid.).
Dans l’ensemble, l’exposé de l’auteur est suffisamment clair et pertinent dans son approche théorique et dans sa description du contexte historique de la naissance du prolétariat en Afrique. Effectivement, il est convaincant dans son argumentation visant à démontrer que le travail dans les sociétés négro-africaines ou sénégambiennes pré coloniales n’avait pas la même signification que dans les sociétés modernes de type occidental. De même, par rapport à son propos sur le salariat, nous pouvons affirmer effectivement que la notion de travail salarié fut sans doute introduite au Sénégal par l’appareil colonial français, le jour où celui-ci décida de "salarier" les hommes qu’il exploitait pour s’assurer du profit et étendre sa domination sur le territoire conquis. C’est ainsi que s’ouvrirent les premiers chantiers agricoles, industriels, miniers, des chemins de fer, des voies navigables, des routes, des usines, des imprimeries, etc. Autrement dit, voilà comment le capitalisme colonial français put introduire de nouveaux rapports de production dans sa première colonie africaine en créant en conséquence les conditions de la naissance de la classe ouvrière. Mais, ce fut d’abord sous le régime du travail obligatoire (le monstrueux "système de la corvée") que les premiers travailleurs se faisaient exploiter. Ce qui veut dire qu’à cette époque ils ne purent même pas négocier la vente de leur force de travail, comme l’atteste cette citation :
"Au titre des travaux civils, Blanchot par exemple exigea du maire des corvées de travailleurs chargés d’assurer les travaux de construction des quais à partir du 1e janvier 1790, puis du débarcadère de Saint- Louis. Le personnel demandé se composait originellement de "20 personnes avec gourmet et un habitant qui sera chargé de les rassembler, de les conduire au travail et de les y contenir". Il s’agissait d’abord d’une réquisition obligatoire, à laquelle nul ne pouvait se dérober, une fois désigné, sous peine de sanction. Il s’agissait, ensuite, d’un travail presque gratuit. Les travailleurs étaient choisis, convoqués, employés, surveillés, sans aucune condition de prix, de salaires, sans disposer, le moins du monde, du droit de discuter les modalités de leur utilisation, voire même de contester les circonstances du choix dont ils avaient été l’objet. Cette dépendance du travailleur vis-à-vis de son employeur était attestée par le fait que l’ordre n° 1 du 18 décembre 1789 instituant la corvée affectée à la construction des quais et du débarcadère ne stipulait aucune durée et pouvait, par conséquent, s’appliquer tant que durerait la nécessité qui lui avait donné naissance. Tout au plus y était-il fait allusion à une "gratification" de deux bouteilles d’eau de vie, et, pour bien montrer qu’il ne s’agissait point d’un salaire attaché à la rémunération ou simplement à la compensation du travail fourni, le texte faisait nettement comprendre qu’il s’agissait d’une simple faveur, due au bon vouloir des autorités, à l’exclusion de toute obligation de droit, ou de morale et dont la dite corvée "pouvait être privée lorsque les travaux seront retardés par négligence" ". (Thiam. ibid.)
Réquisition obligatoire sans aucune négociation, ni sur le prix, ni sur les conditions de travail, bref une dépendance totale de l’employé vis-à-vis de l’employeur, qui, tout au plus, était à peine incité à offrir à son exploité, comme seule "nourriture", une gratification sous forme d’eau de vie. Tel fut le statut et les conditions dans lesquelles le prolétariat, futur salarié, émergea sous le capitalisme colonial français au Sénégal.
Quatre ans plus tard, en 1794, le même Blanchot (commandant d’alors du Sénégal) décida une nouvelle "gratification" en donnant l’ordre de fournir aux travailleurs réquisitionnés "le couscous et le sanglès". Certes, on peut noter une "légère amélioration" de la gratification, car on passait de deux bouteilles d’eau de vie à un couscous, mais il n‘était toujours pas question de "compensation" et moins encore de salaire proprement parler. Il fallut attendre jusqu’en 1804 pour qu'existe officiellement la rémunération comme contrepartie du travail fourni, l’année où l’économie de la colonie connaissait une forte crise due à l’effort de guerre soutenu alors par l’appareil colonial pour la conquête de l’empire du Fouta (région voisine de Saint- Louis). En effet, la guerre se traduisit par l’arrêt provisoire du commerce sur le fleuve, d'où s'ensuivirent la rareté des produits et la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité, ce qui provoqua le renchérissement du coût de la vie et, avec lui, de fortes tensions sociales.
1804 : l’instauration du salariat et première expression d’antagonisme de classes
Pour faire face à la dégradation du climat social, le Commandant de la ville de Saint- Louis dut intervenir en lançant l’ordre suivant :
"(…) qu’en conséquence de l’arrêt du conseil de la colonie sur les plaintes relatives à la cherté des ouvriers qui ont successivement porté leurs journées de travail à des prix exorbitants, et intolérables, plus longtemps...(…) Les maîtres, ouvriers, charpentiers ou maçons devaient désormais être payés au salaire d’une barre de fer par jour ou 4 francs 16 sols ; les compagnons trois quarts de barre ou 3 francs 12 sols, les manœuvres un quart de barre ou 1 franc, 4 sols".
"Dans cet arrêt, qui était l’un des plus anciens documents écrits que nous possédons sur le travail salarié, nous apprenons que la ville de Saint- Louis comptait dès ce moment- là, c'est-à-dire en 1804, "des ouvriers, charpentiers, calfats et maçons" employés par des particuliers, selon des normes et dans des circonstances qui ne nous sont pas malheureusement indiquées, mis à part le montant des salaires appliqués à ces personnels". (Thiam, ibid.)
Par détour d’arbitrage du conflit entre employeurs et employés, l’Etat décida de réglementer leurs rapports en fixant lui-même le montant des salaires selon les catégories et les niveaux de qualification. Notons par ailleurs que cette intervention de l’Etat colonial était d’abord orientée contre les employés car elle répondait aux doléances déposées auprès du Chef de la colonie par les employeurs qui se plaignaient des "prix exorbitants" des journées de travail des ouvriers.
En effet, pour faire face aux effets de la crise, les ouvriers durent décider de majorer le prix de leur travail afin de préserver leur pouvoir d’achat détérioré par l’augmentation du coût de la vie. Et avant cette date, l’établissement des conditions de travail était encore une affaire purement privée, se trouvant exclusivement entre les mains des négociateurs socioéconomiques, c'est-à-dire, sans aucune législation formelle de l’Etat.
Reste que cette intervention ouverte de l’autorité étatique fut la première du genre dans un conflit opposant les ouvriers aux employeurs. Plus généralement, cette période (1804) atteste la réalité de la première expression ouverte dans la colonie d’un antagonisme entre les deux principales classes sociales historiques qui s’affrontent sous le capitalisme, à savoir la bourgeoisie et le prolétariat. Cette date marque aussi l’histoire du travail au Sénégal, où fut actée officiellement l’instauration du salariat, permettant enfin aux ouvriers de vendre "normalement" leur force de travail et d’être rémunérés le cas échéant.
Pour ce qui concerne la "composition ethnique" des ouvriers (qualifiés), ces derniers étaient très majoritairement d’origine européenne, de même, les employeurs étaient quasi exclusivement venus de la métropole. Parmi ces derniers figuraient les Potin, Valantin, Pellegrin, Morel, D’Erneville, Dubois, Prévost, etc. Ce furent ceux-là qu’on appela les premiers la "crème de la bourgeoisie commerçante" de la colonie. Enfin, soulignons au passage l’extrême faiblesse numérique de la classe ouvrière (quelques milliers), comme conséquence du bas niveau du développement économique du pays, et ceci un siècle et demi après l’arrivée des premiers colons dans cette zone. De plus, il s’agissait d’une "économie de comptoir" (ou de traite), basée essentiellement sur le commerce des matières premières et du bois d’ébène 4.
L’économie de comptoir en crise de main-d’œuvre
"Tant que le Sénégal demeura un comptoir d’importance secondaire dont l’activité principale portait sur le commerce du bois d’ébène, et sur l’exploitation des produits tels que la gomme, l’or, l’ivoire, la cire jaune, les cuirs tirés par les commerçants saint-louisiens et goréens du commerce sur le fleuve ou le long de la côte occidentale d’Afrique, cette question [de la main d'oeuvre] ne connut jamais une dimension inquiétante. Pour faire face aux rares travaux d’équipement et d’infrastructures sommaires, le Gouverneur pouvait faire appel accessoirement au concours de la population civile ou militaire des deux comptoirs et, dans les travaux n’exigeant pas une main-d’œuvre spécialisée, à celui beaucoup plus fréquent des travailleurs de condition servile, sur la base des normes laissées le plus souvent, si ce n’était toujours, à sa seule discrétion.
Mais la suppression de l’esclavage avait profondément modifié les données de la situation. La principale ressource économique de la colonie étant désormais menacée de tarissement, la France ayant de plus perdu certaines de ses colonies agricoles, l’expérience de la colonisation européenne tentée dans le Cap-Vert ayant échoué, le Gouvernement de la Restauration pensa qu’il était désormais nécessaire d’amorcer la mise en valeur agricole du Sénégal par la culture d’un certain nombre de produits coloniaux susceptibles d’alimenter l’industrie française, de reconvertir les activités commerciales de la colonie, de fournir du travail à la main-d’œuvre indigène libérée". (Thiam, ibid.)
Il faut souligner d’emblée que la suppression de l’esclavage répondait d’abord et avant toute considération humanitaire à un besoin économique. En fait, la bourgeoisie coloniale manquait de force de travail du fait qu’une grande partie des hommes et des femmes en âge de travailler était constituée d’esclaves entre les mains de leurs maîtres locaux, étant entendu par ailleurs que la suppression de l’esclavage se fit en deux étapes.
Dans un premier temps, une loi datant d’avril 1818 interdisait seulement le commerce maritime du bois d’ébène et son transport vers l’Amérique, mais pas à l’intérieur des terres, c'est-à-dire, le marché restant libre pour les commerçants coloniaux. Cependant, on se rendit compte très vite que cela restait insuffisant pour remédier à la situation de pénurie de main-d’œuvre. Dès lors, le chef de la colonie décida d’y apporter sa contribution personnelle en demandant au chef du premier bataillon de lui fournir "des hommes de corvée sur les demandes qui lui seraient faites pour les diverses parties du service". Grâce à ces mesures, les autorités coloniales et les commerçants purent ainsi combler momentanément le manque de main-d’œuvre. De leur côté, les travailleurs disponibles prenaient conscience du profit qu’ils pouvaient tirer de la rareté de la main-d’œuvre en devenant de plus en plus exigeants vis-à-vis des employeurs. Et cela provoqua une nouvelle confrontation sur les prix de la main d'œuvre avec ces derniers, d’où une nouvelle intervention de l’autorité coloniale qui procéda à la "régulation" du marché en faveur des commerçants.
Dans un deuxième temps, en février 1821, le Ministère de la Marine et des colonies, tout en envisageant de recourir à une politique d’immigration active de la population d’origine européenne, ordonna la fin de l’esclavage sous "toutes ses formes".
En fait, une fois encore, pour les autorités coloniales, il s’agissait de trouver les bras nécessaires au développement de l’économie agricole :
"Il s’agissait(…) du rachat par le Gouverneur ou les particuliers d’individus maintenus en esclavage dans des contrées proches des possessions de l’Ouest-africain ; de leur affranchissement, par un acte authentique, à la condition qu’ils travaillent pour l’engagiste pendant un certain laps de temps. Ce serait (…) une sorte d’apprentissage à la liberté, familiarisant l’autochtone avec la civilisation européenne, lui donnant le goût des nouvelles cultures industrielles, tout en faisant diminuer le nombre des captifs. On obtient ainsi, (…) de la main-d’œuvre, tout en restant dans les vues humanitaires des abolitionnistes". (Thiam,. ibid)
Autrement dit, il s’agissait avant tout de "civiliser" pour mieux exploiter les "affranchis" et non point de les libérer au nom d’une vision humanitaire. D’ailleurs, comme cela ne suffisait pas, l’administration coloniale instaura, deux ans plus tard, en 1823, un "régime des engagés à temps", c'est-à-dire une sorte de contrat liant l’employé à l’employeur pour une longue durée.
"Les engagés à temps étaient utilisés pour une période pouvant aller jusqu’à quatorze ans dans les ateliers publics, dans l’administration, dans les plantations agricoles (ils étaient 300 sur 1500 utilisés par le baron Roger), dans les hôpitaux où ils servaient comme garçons de salle, infirmiers ou comme personnel domestique, dans la sécurité municipale, et dans l’armée ; rien que dans le Régiment d’Infanterie de Marine, on en dénombrait 72 en 1828, 115, quatre années après, 180 en 1842, tandis que le relevé des rachats en comptabilisait 1629 en 1835, 1768 en 1828, 2545, en 1839. A cette date la seule ville de Saint- Louis comptait environ 1600 engagés à temps". (Thiam, ibid.)
A ce propos, soulignons d’entrée l’existence formelle de contrats de travail de longue durée (14 ans) assimilable à un CDI (contrat à durée indéterminée) d’aujourd’hui. On voit là le besoin permanent de main-d’œuvre ouvrière correspondant au rythme du développement économique de la colonie. De même, le régime des engagés à temps avait été conçu dans le but d’accélérer la colonisation agricole et cette politique se traduisit réellement par un début de développement conséquent des forces productives et plus généralement de l’économie locale. Mais le bilan fut cependant très contrasté car, s’il permit un essor réel du mouvement commercial (import/export) qui passa de 2 millions de francs en 1818 à 14 millions en 1844, en revanche, la politique de l’industrialisation agricole fut un échec. En effet, le projet de développement de l’agriculture initié par le baron Roger fut abandonné (3 ans après son lancement) par les successeurs du baron en raison de divergences d’orientation économique au sein de l’Etat. Un autre facteur ayant pesé sur la décision d’annuler le projet de développement de l’agriculture fut le refus d’un grand nombre d’anciens cultivateurs, devenus employés salariés, de retourner à la terre. Cependant les deux volets de cette politique, à savoir, le rachat d’esclaves et le "régime des engagés", furent maintenus jusqu’en 1848, date du décret de leur suppression totale.
"Telle était la situation vers le milieu du XIXe siècle, une situation caractérisée par l’existence, désormais avérée, du travail salarié, apanage d’un prolétariat sans défense, et presque sans droit, qui, s’il connaît des formes primaires de concertation et de coalition, s’il avait donc une conscience pré-syndicale, n’avait jamais encore osé soutenir un conflit avec ses employeurs, servis par un gouvernement autoritaire". (Thiam. Ibid)
Voilà donc constituées les bases d'un prolétariat salarié, évoluant sous le régime du capitalisme moderne, précurseur de la classe ouvrière africaine et qui, désormais, va faire l’apprentissage de la lutte de classe au début de la deuxième moitié du 19e siècle.
Les premières formes embryonnaires de lutte de classe en 1855
L'émergence de la classe ouvrière
Selon les sources disponibles (Mar Fall, L’Etat et la Question Syndicale au Sénégal) 5,, il fallut attendre 1855 pour voir l’apparition d’une première organisation professionnelle en vue de la défense des intérêts spécifiques du prolétariat. Sa constitution fut consécutive à mouvement lancé par un charpentier autochtone (habitant Saint- Louis) qui se mit à la tête de 140 ouvriers pour rédiger une pétition contre les maîtres menuisiers européens qui leur imposaient des conditions de travail inacceptables. En effet :
"Les premiers artisans qui avaient entrepris les grands travaux coloniaux étaient des européens ou des militaires du génie auxquels on avait adjoint des auxiliaires et de la main-d’œuvre indigène. C’étaient des charpentiers, menuisiers, des maçons, des forgerons, des cordonniers. Constituant alors le personnel techniquement plus qualifié, bénéficiant, dans un certain nombre de cas, d’une instruction plus ou moins élémentaire, ils régnaient sur les corporations existantes dont ils constituaient l’élite dirigeante ; c’étaient eux, sans doute, qui décidaient des marchés, fixaient les prix, répartissaient la tâche, choisissaient les ouvriers qu’ils embauchaient et payaient à un tarif largement inférieur à celui qu’ils réclamaient aux employeurs".(Thiam.ibid)
Dans cette lutte, ce qui frappe d’abord, c’est de voir que la première expression de "lutte de classe" dans la colonie opposait deux fractions de la même classe (ouvrière) et non directement bourgeoisie et prolétariat. Autrement dit, une fraction ouvrière dite de base (dominée) en lutte contre une autre fraction ouvrière dite "élite dirigeante" (dominante). Un autre trait caractéristique de ce contexte est le fait que la classe exploiteuse était issue exclusivement de la bourgeoisie coloniale, faute de "bourgeoisie autochtone". Bref, on avait là une classe ouvrière en constitution sous un capitalisme colonial en développement. Dès lors on peut comprendre pourquoi la première expression de lutte ouvrière ne put éviter d’être marquée par une triple connotation "corporatiste", "ethnique" et "hiérarchique". C’est ce qu’illustre le cas du leader de ce groupe d’ouvriers indigènes, lui-même maître charpentier, à ce titre formateur de nombreux jeunes ouvriers en apprentissage auprès de lui, alors que dans le même temps il exerçait sous la dépendance tutélaire des maîtres-menuisiers européens qui décidaient de tout (cf. citation précédente).
Dans ce contexte, la décision du leader autochtone de se regrouper avec les ouvriers africains de base (moins qualifiés que lui) pour faire face à l’attitude arrogante des maîtres artisans occidentaux est compréhensible et peut être interprétée comme une réaction saine de défense d’intérêts prolétariens.
Par ailleurs, selon des sources (archives), ce même maître ouvrier indigène fut impliqué plus tard dans la constitution en 1885 du premier syndicat africain alors même que la loi de Jules Ferry de 1884, autorisant la création de syndicats, avait exclu son instauration dans les colonies. D’ailleurs, c’est pour cette raison que le syndicat des ouvriers indigènes dut exister et fonctionner clandestinement, d’où le peu d’information sur son histoire, comme l’indique le passage suivant :
"La série K 30 des Archives de la République du Sénégal renferme un document manuscrit, inédit, qui n’avait auparavant été cité dans aucune source, classé dans une chemise sur laquelle on a écrit : syndicat des charpentiers du Haut-Fleuve. Malheureusement cette pièce d’archives d’une importance capitale, pour l’histoire du mouvement syndical au Sénégal n’est accompagnée d’aucun autre document susceptible d’en éclairer la compréhension". (Thiam, ibid)
Donc, malgré l’interdiction de toutes formes d’organe d’expression prolétarienne et en dépit de la pratique systématique de la censure visant la vraie histoire du mouvement ouvrier dans les colonies, le constat a pu être fait de l’existence des premières organisations embryonnaires de lutte de classe, de type syndical. Certes, ce fut un "syndicat corporatiste", des charpentiers, mais de toute façon l’Etat capitaliste à cette époque interdisait tout regroupement interprofessionnel.
Voilà ce que les investigations dans les écrits relatifs à ce thème et cette période permettent de connaître aujourd’hui sur le mode d'expressions de lutte de la classe ouvrière sur cette période allant de 1855 à 1885.
Les luttes des immigrés sénégalais au Congo belge en 1890/1892
"Rappelons tout d’abord que lorsqu’intervint en 1848 la suppression du régime des engagés à temps, ce système, loin d’avoir complètement disparu, avait essayé de s’adapter à la nouvelle situation en se transformant progressivement. Mais cette solution ne parvint nullement à résoudre l’épineux problème de la main-d’œuvre.
Les milieux économiques coloniaux ne pouvant donc plus acheter des esclaves qu’ils feraient travailler servilement, et les plantations risquant d’être abandonnées faute de bras, poussèrent les dirigeants administratifs et les autorités politiques, à autoriser l’immigration des travailleurs africains récemment libérés vers des contrées où leurs services étaient appréciés, moyennant un salaire et des conditions discutés d’un commun accord avec les patrons. Pour donner suite à cette requête, le Gouverneur avait fait proclamer le décret du 27 mars 1852 réorganisant l’émigration des travailleurs dans les colonies ; c’est ainsi que le 3 juillet 1854, un navire dénommé "Les cinq frères" affrété pour assurer le transport de 3000 ouvriers destinés aux plantations de la Guyane avait jeté l’ancre à Dakar et pris des contacts en vue de l’embauche de 300 sénégalais. Les conditions fixées seraient les suivantes : "une expatriation de six ans contre un cadeau d’une valeur de 30 à 50 f, un salaire de 15 f par mois, le logement, la nourriture, les soins médicaux, la jouissance d’un petit jardin et le rapatriement gratuit à l’issue de leur séjour américain" ". (Thiam.ibid)
On voit là, avec le cas des 300 sénégalais destinés aux plantations d’Amérique (en Guyane), que la classe ouvrière existait réellement, au point de constituer une "main-d’œuvre de réserve", dans laquelle puisa la bourgeoisie pour en exporter une partie.
En effet, ayant fait preuve de compétence et d’efficacité par exemple en parvenant à achever (en 1885) les durs travaux du chemin de fer Dakar- Saint- Louis, les ouvriers de cette colonie française suscitèrent particulièrement l'intérêt des milieux économiques coloniaux, soit en tant que main-d’œuvre exploitable sur place, soit en qualité de force de travail exportables vers les concurrents extérieurs.
C’est dans ce même cadre et dans des conditions analogues que fut recruté et envoyé au Congo belge un grand nombre de travailleurs sénégalais pour exercer sur divers chantiers, notamment sur le chemin de fer congolais de Matadi.
Mais, dès leur arrivée sur place, les ouvriers immigrés se heurtèrent aux dures conditions de travail et d’existence, en constatant tout de suite que les autorités coloniales belges n’avaient aucune intention de respecter leur contrat. En effet, comme ils le signalaient, eux-mêmes, dans un courrier de protestation à l’adresse du Gouverneur du Sénégal, les ouvriers se disaient "mal nourris, mal logés, mal payés, malades mal soignés", ils mourraient comme des mouches et ils avaient l’impression que le choléra les frappait car "on enterrait 4 ou 5 personnes par jour". D’où la pétition de février 1892 adressée aux autorités coloniales franco-belges exigeant fermement leur rapatriement collectif au Sénégal, et conclue de la sorte : "Maintenant personne entre nous ne veux plus rester à Matadi".
Les ouvriers furent ainsi victimes d’une exploitation particulièrement odieuse de la part du capitalisme colonial qui leur imposa des conditions d’autant plus barbares que, pendant ce temps-là, les deux Etats coloniaux se renvoyaient la balle, ou fermaient carrément les yeux sur le sort des travailleurs immigrés :
"C’est ainsi qu’encouragées par l’impunité, les autorités belges ne firent rien pour améliorer le sort des malheureux protestataires. La distance qui séparait le Congo belge du Sénégal, la querelle de préséance qui empêchait le représentant du Gouvernement français dans la région d’intercéder en leur faveur, les complicités dont bénéficiait la compagnie de chemin de fer du Bas Congo au niveau de la rue Oudinot (cf. Ministère des colonies), le cynisme de certains milieux coloniaux que les malheurs des pauvres sénégalais amusaient, exposèrent les ouvriers sénégalais à un abandon presque total, et en faisaient une main-d’œuvre à demi-désarmée, sans véritable moyen de défense, taillable et corvéable, dès lors, à merci".(Thiam, ibid)
Toujours est-il que, par leur combativité, en refusant de travailler dans les conditions que l’on sait et en exigeant fermement leur évacuation du Congo, les immigrés de la colonie française obtinrent satisfaction. Aussi, dès leur retour au pays, ils purent compter sur le soutien de la population et de leurs camarades ouvriers, en obligeant ainsi le Gouverneur à engager des nouvelles réformes en vue de la protection des travailleurs, à commencer par l’instauration d’une nouvelle réglementation de l’émigration. En effet, le drame subi au Congo par les immigrés avait suscité débats et prise de conscience par rapport à la condition ouvrière. Ce fut dans ce cadre, entre 1892 et 1912, que toute une série de mesures furent prises en faveur des salariés, par exemple, le repos hebdomadaire, les retraites ouvrières, l’assistance médicale, bref de vraies réformes.
Par ailleurs, en s’appuyant sur leur "expérience congolaise", les anciens immigrés se firent particulièrement remarquer lors d’une nouvelle opération de recrutement pour de nouveaux chantiers du chemin de fer du Sénégal en se montrant très exigeants sur les conditions de travail. Dans ce sens, ils décidèrent de créer, en 1907, une association professionnelle dénommée "Association des ouvriers de Kayes" en vue de mieux défendre leurs conditions de travail et de vie face à l’appétit des charognards capitalistes. Et l’autorité coloniale, tenant compte du rapport de force d’alors qui était en train de lui échapper, accepta de légaliser l’association des cheminots.
En fait, la naissance de ce regroupement au sein des cheminots n’étonne guère quand on sait que, depuis l’ouverture du réseau (1885), ce secteur était devenu l’un des complexes industriels parmi les plus importants de la colonie, à la fois par son chiffre d’affaires et le nombre de ses employés. De même, on verra plus loin que les ouvriers du chemin de fer seront de tous les combats de la classe ouvrière de l’AOF.
Plus généralement, la période qui suit le retour des immigrés au pays (entre 1892 et 1913) fut marquée par une forte agitation sociale, notamment dans la fonction publique où les commis et les travailleurs des PTT protestaient contre la dégradation de leurs conditions de travail et les bas salaires. Dans ce cadre, les fonctionnaires et assimilés décidèrent de créer leurs propres associations pour se défendre par "tous les moyens à leur disposition", suivis aussitôt par les employés de commerce qui en profitèrent pour demander l’application dans leur secteur de la loi sur le repos hebdomadaire. Bref, on assistait à un bouillonnement de combativité chez les salariés du privé comme du public d’où l’inquiétude grandissante des autorités coloniales. En effet, non seulement, les problèmes sociaux brûlants ne purent être réglés à la fin de 1913, mais culminèrent avec le contexte de crise résultant de la Première Guerre mondiale.
Lassou (à suivre)
1 Henri Wesseling, Le partage de l’Afrique, 1991, Editions Denoel, 1996, pour la traduction française.
2 M. Agier, J. Copans et A. Morice, Classes ouvrières d’Afrique noire, Karthala- ORSTOM, 1987
3 Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Editions L’Harmattan, 1991
4 Euphémisme utilisé par les négriers pour désigner les esclaves noirs déportés aux Amériques. Source Wikipédia.
5 L'Harmattan, Paris, 1989
Géographique:
- Afrique [162]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (V) : 1917-21 : les soviets face à la question de l'Etat
- 2235 lectures
Dans l’article précédent [168] de cette série (Revue internationale n° 143), nous avons vu comment les soviets, qui avaient pris le pouvoir en Octobre 1917, le perdirent progressivement au point de ne plus être qu’une façade, maintenue en vie artificiellement pour occulter le triomphe de la contre-révolution capitaliste qui s’était instaurée en Russie. Le but de cet article est de comprendre les causes de ce processus et de tirer les leçons qui sont indispensables aux futures tentatives révolutionnaires.
La nature de l’État qui naît de la révolution
Marx et Engels, analysant la Commune de Paris de 1871, tirèrent quelques leçons sur la question de l’État que nous pouvons brièvement résumer : 1) Il est nécessaire de détruire l’appareil d’État bourgeois de fond en comble ; 2) au lendemain de la révolution, l’État se reconstitue, pour deux raisons principales : a) la bourgeoisie n’a pas encore été complètement défaite et éradiquée ; b) dans la société de transition subsistent encore des classes non exploiteuses (petite bourgeoisie, paysannerie, marginaux urbains…), dont les intérêts ne coïncident pas avec ceux du prolétariat.
Cet article n’a pas pour but d’analyser la nature de ce nouvel État (1), néanmoins, pour éclairer le sujet que nous traitons, nous devons mettre en évidence que si ce nouvel État n’est pas identique à ceux qui l’ont précédé dans l’histoire, il garde cependant des caractéristiques qui constituent un obstacle pour le développement de la révolution ; c’est bien pour cela que, comme Engels l’avait déjà signalé et comme insistait Lénine dans l’État et la Révolution, le prolétariat doit commencer un processus d’extinction du nouvel État le jour même de la révolution.
Après la prise du pouvoir, le principal obstacle sur lequel trébuchèrent les soviets en Russie fut l’État qui en était issu. Celui-ci "malgré l'apparence de sa plus grande puissance matérielle, (…) est mille fois plus vulnérable à l'ennemi que les autres organismes ouvriers. En effet, l'État doit sa plus grande puissance matérielle à des facteurs objectifs qui correspondent parfaitement aux intérêts des classes exploiteuses mais ne peuvent avoir aucun rapport avec la fonction révolutionnaire du prolétariat" (2), "La menace redoutable d’un retour au capitalisme se trouvera essentiellement dans le secteur étatisé. Cela d’autant plus que le capitalisme se trouve ici sous sa forme impersonnelle pour ainsi dire éthérée. L’étatisation peut servir à camoufler longtemps un processus opposé au socialisme" (3).
Dans l’article précédent, nous avons décrit les faits qui favorisèrent l’affaiblissement des soviets: la guerre civile, la famine, le chaos général de l’économie dans son ensemble, l’épuisement et la décomposition progressive de la clase ouvrière, etc. La "conspiration silencieuse" de l’État soviétique, qui participa aussi de l'affaiblissement des soviets, est intervenue selon trois axes : 1) le poids croissant que prenaient les institutions par excellence étatiques : l’armée, la Tcheka (la police politique) et les syndicats ; 2) "l’interclassisme" des soviets et la bureaucratisation accélérée qui en résultait ; 3) l’absorption progressive du Parti bolchevique par l'État. Nous avons abordé le premier point dans l’article précédent, cet article est consacré aux deux derniers.
L’irrésistible renforcement de l’État
L’État des soviets excluait la bourgeoisie mais n’était pas l’État exclusif du prolétariat. Il comprenait des classes sociales non exploiteuses comme la paysannerie, la petite-bourgeoisie, les diverses couches moyennes. Ces classes tendent à préserver leurs petits intérêts et posent inévitablement des obstacles à la marche vers le communisme. Cet "interclassisme" inévitable pousse le nouvel État, comme le dénonça l’Opposition ouvrière 4 en 1921, à ce que "la politique soviétique pousse dans plusieurs directions et que sa configuration par rapport à la classe soit défigurée",et à ce que se constitue le terreau de la bureaucratie étatique.
Peu de temps après Octobre, les anciens fonctionnaires tsaristes commençaient à occuper des postes dans les institutions soviétiques, en particulier lorsqu'il fallait prendre des décisions improvisées face aux problèmes qui se présentaient. Ainsi, par exemple, face à l’impossibilité d’organiser l’approvisionnement de produits de première nécessité en février 1918, le Commissariat du peuple dut recourir à l’aide des commissions qui avaient été mises en place par l’ancien Gouvernement provisoire. Leurs membres acceptèrent à condition de ne dépendre d’aucun bolchevik, ce que ces derniers acceptèrent. De façon similaire, la réorganisation du système éducatif en 1918-19 dut se faire en recourant à d’anciens fonctionnaires tsaristes qui finirent par altérer progressivement les programmes d’enseignement proposés.
En outre, les meilleurs éléments prolétariens se convertissaient progressivement en bureaucrates éloignés des masses. Les impératifs de la guerre absorbèrent de nombreux cadres ouvriers aux tâches de commissaires politiques, inspecteurs ou chefs militaires. Les ouvriers les plus capables devinrent des cadres de l’administration économique. Les anciens bureaucrates impériaux et les nouveaux-venus d’origine prolétarienne formèrent une couche bureaucratique qui s’identifiait à l’État. Mais cet organe a sa propre logique, et ses chants de sirène parvinrent à séduire des révolutionnaires aussi expérimentés que Lénine et Trotski.
Les anciens fonctionnaires provenant des élites bourgeoises étaient les porteurs de cette logique, et ils pénétrèrent dans la forteresse soviétique par la porte que leur ouvrait le nouvel État : "des milliers d’individus, plus ou moins intimement liés à la bourgeoisie expropriée, par des liens routiniers et culturels, recommencèrent à jouer un rôle (…) fusionnés avec la nouvelle élite politico-administrative, dont le noyau était le Parti lui-même, les secteurs les plus "ouverts" et les plus capables techniquement de la classe expropriée, ne tardèrent pas à revenir à des positions dominantes" (5). Ces individus, comme le signale l'historien soviétique Kritsman, "dans leur travail administratif, faisaient preuve de désinvolture et d'hostilité envers le public" 6
Mais le danger principal venait de l’engrenage étatique lui-même, avec le poids croissant mais imperceptible de son inertie. Comme conséquence de cela, même les fonctionnaires les plus dévoués tendaient à se séparer des masses, à se méfier d’elles, adoptant des méthodes expéditives, imposant sans écouter, expédiant les affaires qui concernaient des milliers de personnes comme de simples questions administratives, gouvernant à coups de décrets. "En laissant de côté ses tâches de destruction pour celles d’administration, le Parti découvre les vertus de la loi, de l’ordre et de la soumission à la juste autorité du pouvoir révolutionnaire" (7).
La logique bureaucratique de l’État va comme un gant à la bourgeoisie, qui est une clase exploiteuse et peut tranquillement déléguer l’exercice du pouvoir à un corps spécialisé de politiciens et de fonctionnaires professionnels. Mais elle est fatale au prolétariat qui ne peut à aucun moment l’abandonner à de tels spécialistes, qui doit apprendre par lui-même, commettre des erreurs et les corriger, qui non seulement prend des décisions et les applique mais en outre, ce faisant, se transforme lui-même. La logique du pouvoir du prolétariat n’est pas dans la délégation de ce pouvoir mais dans la participation directe à la prise en charge de celui-ci.
La révolution en Russie se trouva face à un dilemme en avril 1918 : la révolution mondiale n’avançait pas et l’invasion impérialiste menaçait d’écraser le bastion soviétique. Le pays entier sombrait dans le chaos, "l’organisation administrative et économique déclinait dans des proportions alarmantes. Le danger ne venait pas tant de la résistance organisée que de l’effondrement de toute autorité. L’appel à détruire l’organisation étatique bourgeoise de l’État et la Révolution devenait singulièrement anachronique maintenant que cette partie du programme révolutionnaire avait triomphé au-delà des espérances" (8).
L’État soviétique se confrontait à des questions dramatiques : mettre sur pieds l’Armée rouge dans la précipitation, organiser les transports, relancer la production, assurer l’approvisionnement alimentaire des villes affamées, organiser la vie sociale. Tout ceci devait se résoudre malgré le sabotage total des entrepreneurs et des managers, ce qui poussa à la confiscation généralisée d’industries, de banques, de commerces, etc. C’était un défi supplémentaire lancé au pouvoir soviétique. Un débat passionné anima alors le Parti et les soviets. Tout le monde était d’accord pour résister militairement et économiquement jusqu’à l’explosion de la révolution prolétarienne dans d’autres pays et principalement en Allemagne. La divergence portait sur la façon d’organiser la résistance : à partir de l’État en renforçant ses mécanismes ou en développant l’organisation et les capacités des masses ouvrières ? Lénine prit la tête de ceux qui défendaient la première solution alors que certaines tendances de gauche du Parti bolchevique incarnaient la seconde.
Dans la brochure Les tâches immédiates du pouvoir soviétique, Lénine "défend que la première tâche à laquelle la révolution devait faire face (…) était celle de (…) reconstruire une économie ruinée, d'imposer une discipline du travail et de développer la productivité, d'assurer un rapport et un contrôle strict du processus de production et de distribution, d'éliminer la corruption et le gaspillage et, peut-être plus que tout, de lutter contre la mentalité petite-bourgeoise (…) Il n'hésite pas à utiliser ce qu'il traitait lui-même de méthodes bourgeoises, y compris l'utilisation de spécialistes techniques bourgeois (…), le recours au travail aux pièces ; l'adoption du "système de Taylor" (…) Il a donc appelé à la 'direction d'un seul homme'" (9).
Pourquoi Lénine défendit-il cette orientation ? La première raison était l’inexpérience : le pouvoir soviétique s’affrontait en effet à des tâches gigantesques et urgentes sans recours possible à une quelconque expérience et sans qu'une réflexion théorique préalable ait pu être menée sur ces questions. La seconde raison était la situation désespérée et insoutenable que nous avons décrite. Mais nous devons aussi considérer que Lénine était à son tour victime de la logique étatique et bureaucratique, se convertissant peu à peu en son interprète. Cette logique le poussait à faire confiance aux vieux techniciens, administrateurs et fonctionnaires formés dans le capitalisme et, par ailleurs, aux syndicats chargés de discipliner les ouvriers, de réprimer leurs initiatives et leur mobilisation indépendante, les liant à la division capitaliste du travail et à la mentalité corporatiste et étroite qu’elle suppose.
Les adversaires de gauche dénonçaient cette conception selon laquelle "La forme du contrôle de l'État sur les entreprises doit se développer dans la direction de la centralisation bureaucratique, de la domination de différents commissaires, de la privation d'indépendance des soviets locaux et du rejet dans la pratique du type d’"État-Commune" dirigé par en bas (...) L'introduction de la discipline du travail en lien avec la restauration de la direction capitaliste dans la production ne peut pas accroître fondamentalement la productivité du travail, mais elle affaiblira l'autonomie de classe, l'activité et le degré d'organisation du prolétariat" (10).
L’Opposition ouvrière dénonçait : "au vu de l’état catastrophique de notre économie, qui repose encore sur le système capitaliste (salaire payé avec de l’argent, tarifs, catégories de travail, etc.), les élites de notre Parti, se méfiant de la capacité créatrice des travailleurs, cherchent le salut au chaos économique dans les héritiers du capitaliste bourgeois passé, à travers des hommes d’affaires et des techniciens dont la capacité créatrice est corrompue sur le terrain de l’économie par la routine, les habitudes et les méthodes de production et de direction du mode capitaliste" (11).
Loin d’avancer sur la voie de son extinction, l’État se renforçait de façon alarmante : "Un professeur "blanc" qui arriva à Omsk venant de Moscou en automne 1919 racontait qu’à la tête de plusieurs centres et des glavski se trouvaient les anciens patrons, fonctionnaires et directeurs. Quiconque connaît personnellement le vieux monde des affaires sera surpris, en visitant les centres, de retrouver dans les Glavkoh les anciens propriétaires des grandes industries de la peau et, dans les organisations centrales du textile, les grands fabricants." (12) En mars 1919, pendant le débat du Soviet de Petrograd, Lénine reconnût : "Nous avons chassé les anciens bureaucrates, mais ils sont revenus avec la fausse étiquette de communistes ; ils arborent un ruban rouge à la boutonnière et cherchent une sinécure" (13).
La croissance de la bureaucratie soviétique finit par écraser les soviets. Elle comptait 114 259 employés en juin 1918, 529 841 un an plus tard, et 5 820 000 en décembre 1920 ! La raison d’État s’imposait implacablement à la raison du combat révolutionnaire pour le communisme, "les considérations étatiques de caractère général commencèrent à sourdre face aux intérêts de classe des travailleurs" (14).
L’absorption du Parti bolchevique par l’État
Le renforcement de l’État entraîna l’absorption du Parti bolchevique. Celui-ci a priori n'envisageait pas de se convertir en parti étatique. Selon les chiffres de février 1918, le Comité central des bolcheviks ne comptait que six employés administratifs contre 65 pour le Conseil des Commissaires, les soviets de Petrograd et de Moscou en comptant plus de 200. "Les organisations bolcheviques dépendaient financièrement de l'aide que leur apportaient les institutions soviétiques locales et, dans l'ensemble, leur dépendance était compète. Il arriva même que des bolcheviks en vue – comme ce fut le cas de Preobrajensky – suggérassent devant le nouvel état des choses, que le parti acceptât de se dissoudre complètement pour se fondre dans l'appareil soviétique". L’anarchiste Leonard Schapiro reconnaît que "les meilleurs cadres du parti s'étaient intégrés dans l'appareil, central et local, des soviets". Beaucoup de bolcheviks considéraient que "les comités locaux du parti bolchevique n'étaient rien de plus que les sections de propagande des soviets locaux" (15). Les bolcheviks eurent même des doutes sur leur compétence pour exercer le pouvoir à la tête des soviets. "Au lendemain de l'insurrection d'octobre, quand le personnel du gouvernement soviétique s'est formé, Lénine a eu une hésitation avant d'accepter le poste de président du soviet des commissaires du peuple. Son intuition politique lui disait que cela freinerait sa capacité à agir comme avant-garde de l'avant-garde, à être à la gauche du parti révolutionnaire comme il l'avait si clairement été entre avril et octobre 1917" (16). Lénine craignait, non sans raisons, que si le parti et ses membres les plus avancés se mobilisent au jour le jour dans le gouvernement soviétique, ils ne finissent attrapés dans ses engrenages et perdent de vue les objectifs globaux du mouvement prolétarien qui ne peuvent être liés aux contingences quotidiennes de la gestion étatique (17).
Les bolcheviks ne recherchaient pas non plus le monopole du pouvoir, partageant le premier Conseil des Commissaires du peuple avec les Socialistes-révolutionnaires de gauche. Certaines délibérations de ce Conseil furent même ouvertes à des délégués mencheviques internationalistes et à des anarchistes.
Le gouvernement ne devient définitivement bolchevique qu’à partir de juillet 1918, date du soulèvement des socialistes-révolutionnaires de gauche opposés à la création de Comités de paysans pauvres : "Le 6 juillet, deux jeunes tchékistes membres du Parti s.r. de gauche et pièces maîtresses de la conspiration, A. Andreiev et Ia. G. Blumkine, se présentaient à l'ambassade d'Allemagne munis de documents officiels attestant de leur qualité et de leur mission. Admis dans le bureau de l'ambassadeur, le comte von Mirbach, ils l'abattirent et prirent la fuite. Dans la foulée, un détachement de tchékistes commandés par un s.r. de gauche, Popov, procéda par surprise à plusieurs arrestations, dont celles des dirigeants de la Tcheka, Dzejinski et Latsis, du président du soviet de Moscou, Smidovitch, et du commissaire du peuple aux Postes, Podbielsky. Il s'empara aussi des locaux centraux de la Tcheka et du bâtiment central des Postes" (18).
Comme conséquence de ceci, le Parti se voit alors envahi par toute sorte d’opportunistes et d’arrivistes, d’anciens fonctionnaires tsaristes ou de dirigeants mencheviques reconvertis. Noguine, un vieux bolchevik, "avait exprimé l'horreur que lui inspiraient l'ivrognerie, la débauche, la corruption, les cas de vol et le comportement irresponsable que l'on rencontrait parmi beaucoup de permanents du parti. Vraiment, ajoutait-il, les cheveux se dressent sur la tête" (19). En mars 1918, devant le Congrès du Parti, Zinoviev raconta l’anecdote de ce militant qui, recevant un nouvel adhérent, lui dit de revenir le lendemain retirer sa carte de membre ; celui-ci lui répondit que "non, camarade, j’en ai besoin de suite pour obtenir une place au bureau".
Comme le signale Marcel Liebman, "Si tant d'hommes qui n'avaient de communiste que le nom tentaient de pénétrer les rangs du parti, c'est que celui-ci était devenu le centre du pouvoir, l'institution la plus influente de la vie sociale et politique, celle qui réunissait la nouvelle élite, sélectionnait les cadres et les dirigeants et constituait l'instrument et le canal de l'ascension sociale et de la réussite" ; et il ajoute que "les privilèges des cadres moyens et subalternes soulevaient des protestations dans les rangs du parti" (20), alors que tout ceci est normal et courant dans un parti bourgeois.
Le Parti tenta alors de combattre cette vague en réalisant de nombreuses campagnes d’épuration. Mais ce ne pouvait être que des mesures impuissantes puisqu’elles ne s’attaquaient pas à la racine du problème dans la mesure où la fusion du Parti et de l’État se renforçait inexorablement. Ce danger en contenait un autre, parallèle, l’identification du Parti avec la nation russe. En effet, le Parti prolétarien est international et sa section dans un ou plusieurs pays où le prolétariat occupe un bastion avancé ne peut en aucun cas s’identifier avec la nation, mais uniquement et exclusivement avec la révolution mondiale.
La transformation du bolchevisme en un parti-État finit par être théorisée par la thèse selon laquelle le Parti exerce le pouvoir au nom de la classe, la dictature du prolétariat étant la dictature du parti (21), ce qui le désarma théoriquement et politiquement, achevant de le précipiter dans les bras de l’État. Dans une de ses résolutions, le 8e Congrès du Parti (mars 1919) accorde que le Parti doit "s’assurer la domination politique complète au sein des soviets et le contrôle pratique de toutes leurs activités" (22). Cette résolution se concrétise les mois suivants par la formation de cellules du Parti dans tous les soviets pour les contrôler. Kamenev proclama que "le Parti communiste est le gouvernement de Russie. Ce sont ses 600 000 membres qui gouvernent le pays" (23). La cerise sur le gâteau fut apportée par Zinoviev au cours du 2e Congrès de l’Internationale communiste (1920) qui déclara que "tout ouvrier conscient doit comprendre que la dictature de la classe ouvrière ne peut être réalisée que par la dictature de son avant-garde, c’est-à-dire par le Parti communiste" 24 et par Trotski au Xe Congrès du Parti (1921), qui affirma, en réponse à l’Opposition ouvrière : "Comme si le parti n'avait pas le droit d'affirmer sa dictature même si celle-ci heurte momentanément l'humeur velléitaire de la Démocratie ouvrière ! Le parti a le droit de maintenir sa dictature sans tenir compte des vacillations passagères de la classe ouvrière. La dictature n'est pas fondée à chaque instant sur le principe formel de la démocratie ouvrière" (25).
Le parti bolchevique fut perdu en tant qu’avant-garde du prolétariat. Ce n’était plus lui qui utilisait l’État au bénéfice du prolétariat, mais l’État qui fit du parti son bélier contre le prolétariat. Comme le dénonça la Plate-forme des Quinze, groupe d’opposition qui surgit au sein du Parti bolchevique au début de 1920, "La bureaucratisation du parti, la dégénérescence de ses éléments dirigeants, la fusion de l'appareil du parti avec l'appareil bureaucratique du gouvernement, la perte d'influence de la partie prolétarienne du parti, l'introduction de l'appareil gouvernemental dans les luttes intérieures du parti -tout cela montre que le comité central a déjà dépassé dans sa politique les limites du bâillonnement du parti et commence la liquidation- et la transformation de ce dernier en un appareil auxiliaire de l'État. L'exécution de cette liquidation du parti signifierait la fin de la dictature prolétarienne dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le parti est l'avant-garde et l'arme essentielle dans la lutte de la classe prolétarienne. Sans cela, ni sa victoire, ni le maintien de la dictature prolétarienne ne sont possibles." 26.
La nécessité de l’organisation autonome du prolétariat face à l’État transitoire
Comment le prolétariat pouvait-il en Russie renverser le rapport de forces, revitaliser les soviets, mettre un frein à l’État surgi après la révolution, ouvrir la voie à son extinction effective et avancer dans le processus révolutionnaire mondial vers le communisme ?
Cette question ne pouvait se résoudre que par le développement de la révolution mondiale. "En Russie, le problème ne pouvait être que posé" (27). "Il était évident qu'il est bien plus difficile de commencer la révolution en Europe et bien plus facile de la commencer chez nous, mais qu'ici il sera plus difficile de la continuer" (28).
Dans le cadre de la lutte pour la révolution mondiale, il y avait en Russie deux tâches concrètes : récupérer le parti pour le prolétariat en l’arrachant aux griffes de l’État et s’organiser en conseils ouvriers capables de redresser les soviets. Nous ne traiterons ici que ce dernier point.
Le prolétariat doit s’organiser indépendamment de l’État transitoire et exercer sur lui sa dictature. Ceci peut passer pour une stupidité pour ceux qui s’en tiennent aux formules faciles et propres du syllogisme selon lesquelles le prolétariat est la classe dominante et l’État ne peut être que son organe le plus fidèle. Dans l’État et la Révolution, revenant sur la Critique du Programme de Gotha faite par Marx en 1875, Lénine écrit :
"Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu'est le maintien de l''horizon borné du droit bourgeois', en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un État bourgeois, car le droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes.
Il s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l'État bourgeois – sans bourgeoisie !" (29).
L’État de la période de transition au communisme (30) est un "État bourgeois sans bourgeoisie" (31) ou, pour parler plus précisément, est un État qui conserve des traits profonds de la société de classes et de l’exploitation : subsistent encore le droit bourgeois (32), la loi de la valeur, l’influence spirituelle et morale du capitalisme, etc. La société de transition rappelle encore par beaucoup d’aspects la vieille société, mais elle a subi un changement fondamental qui est précisément ce qu’il faut conserver à tout prix car c’est la seule chose qui puisse amener au communisme : l’activité massive, consciente et organisée de la grande majorité de la classe ouvrière, son organisation en classe politiquement dominante, la dictature du prolétariat.
L'expérience tragique de la Révolution russe montre que l’organisation du prolétariat en classe dominante ne peut être réalisée à travers l’État transitoire (l'État des soviets), "la classe ouvrière elle-même en tant que classe, considérée unitairement et non comme unité sociale diffuse, avec des nécessités de classe unitaires et semblables, avec des tâches et des intérêts univoques et une politique semblable, conséquente, formulée de façon claire et nette, joue un rôle politique de moins en moins important dans la République des soviets" (33).
Les soviets étaient l’État-Commune dont parlait Engels comme association politique des classes populaires. Cet État-Commune joue un rôle indispensable dans la répression de la bourgeoisie, dans la guerre défensive contre l’impérialisme et dans le maintien d’un minimum de cohésion sociale, mais n’a pas et ne peut avoir comme horizon la lutte pour le communisme. Marx l’avait déjà entrevu. Dans son ébauche de la Guerre civile en France, il argumentait : "...la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe..." (34). De plus, L'histoire de la Commune de Paris de Lissagaray en particulier "contient beaucoup de critiques des hésitations, confusions et, dans certains cas, des positions creuses de certains délégués au Conseil de la Commune dont beaucoup incarnaient, en fait, un radicalisme petit-bourgeois obsolète qui était fréquemment mis en question par les assemblées des quartiers plus prolétariens. Un des clubs révolutionnaires locaux au moins déclara qu'il fallait dissoudre la Commune parce qu'elle n'était pas assez révolutionnaire !" 35
"l'État est entre nos mains ; eh bien sur le plan de la Nouvelle Politique économique, a-t-il fonctionné comme nous l'entendions ? Non. Nous ne voulons pas l'avouer : l'État n'a pas fonctionné comme nous l'entendions. Et comment a-t-il fonctionné ? La voiture n'obéit pas : un homme est bien au volant, qui semble la diriger, mais la voiture ne roule pas dans la direction voulue ; elle va où la pousse une autre force, -force illégale, force illicite …" (36).
Pour résoudre ce problème, le Parti bolchevique appliqua une série de mesures. D’un côté, la Constitution soviétique adoptée en 1918 estima que "Le Congrès panrusse des Soviets est formé de représentants des Soviets locaux, les villes étant représentées par 1 député pour chaque 25 000 habitants et les campagnes par 1 député pour chaque 125 000. Cet article consacre l'hégémonie du prolétariat sur les ruraux" (37), et d’un autre, le Programme du Parti bolchevique, adopté en 1919, préconisait que "1) Chaque membre du soviet doit assumer un travail administratif ; 2) Il doit y avoir une rotation continue des postes, chaque membre du soviet doit acquérir de l'expérience dans les différentes branches de l'administration. Progressivement, l'ensemble de la classe ouvrière doit être incité à participer dans les services administratifs". 38
Ces mesures étaient inspirées des leçons de la Commune de Paris. Elles étaient destinées à limiter les privilèges et prérogatives des fonctionnaires étatiques mais, pour qu'elles soient effectives et efficaces, seul le prolétariat organisé de façon autonome en conseils ouvriers indépendants de l’État (39) était qualifié pour les faire appliquer .
Le marxisme est une théorie vivante, qui a besoin de réaliser, à partir des faits historiques, des rectifications et de nouveaux approfondissements. Tirant les leçons léguées par Marx et Engels sur la Commune de Paris de 1871, les bolcheviks comprirent que l’État-Commune, qui devait aller vers l'extinction, est l’expression des soviets. Mais ils l’avaient en même temps identifié de façon erronée comme un État prolétarien (40), croyant que son extinction pourrait se réaliser de l’intérieur (41). L’expérience de la Révolution russe démontre l’impossibilité pour l’État de s'éteindre de lui-même et rend nécessaire de distinguer les conseils ouvriers et les soviets, les premiers étant le siège de l’authentique organisation autonome du prolétariat qui doit exercer sa dictature de classe sur l’État-Commune transitoire représenté par les seconds.
Après la prise du pouvoir par les soviets, le prolétariat devait conserver et développer ses propres organisations qui agissaient de façon indépendante dans les soviets : la Garde rouge, les conseils d’usine, les conseils de quartier, les sections ouvrières des soviets, les assemblées générales.
Les conseils d’usine, cœur de l'organisation de la classe ouvrière
Nous avons déjà vu que les conseils d'usine avaient joué un rôle décisif lors de la crise des soviets en juillet (42), et comment ils les avaient délivrés de la mainmise de la bourgeoisie, leur permettant d'assumer leur rôle d'organes de l’insurrection d’Octobre (43). En mai 1917, la Conférence des Conseils d’usine de Jarkov (Ukraine) avait réclamé que ceux-ci "se convertissent en organes de la révolution dédiés à consolider ses victoires" (44). Entre le 7 et le 12 octobre, une Conférence des Conseils d’usine de Petrograd décida de créer un Conseil central des Conseils d’usine qui prit le nom de Section ouvrière du Soviet de Petrograd, coordonna immédiatement toutes les organisations soviétiques de base et intervint activement dans la politique du Soviet, la radicalisant progressivement. Dans son ouvrage les Syndicats soviétiques, Deutscher reconnaît que "les instruments les plus puissants et redoutables de subversion étaient les conseils d’usine et non les syndicats" (45).
Avec les autres organisations de base émanant directement et organiquement de la classe ouvrière, les conseils d’usine exprimaient beaucoup plus naturellement et authentiquement que les soviets les pensées, les tendances, les avancées de la classe ouvrière, maintenant avec elle une profonde symbiose.
Durant la période de transition au communisme, le prolétariat n'acquiert en rien un statut de classe dominante sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle, contrairement à la bourgeoisie sous le capitalisme, il ne peut déléguer le pouvoir à une structure institutionnelle, en l'occurrence à un État. De plus, celui-ci, malgré ses particularités d'État-commune, ne présente néanmoins pas les intérêts spécifiques de la classe ouvrière, déterminés par la transformation révolutionnaire du monde, mais celui de l'ensemble des couches non exploiteuses. Enfin, l'inéluctable tendance bureaucratique de l'État tend à autonomiser cet organe par rapport aux masses et à leur imposer sa domination. C'est pourquoi, la dictature du prolétariat ne peut venir d’un organe étatique mais d’une force de combat, de débats et de mobilisation permanente, d'un organe qui, à la fois, assure l'autonomie de classe du prolétariat, reflète les besoins des masses ouvrières et permet leur transformation dans l'action et la discussion.
Nous avons montré dans le quatrième article de cette série comment, après la prise de pouvoir, les organisations soviétiques de base et instruments de lutte de la classe ouvrière disparurent progressivement. Ce fut un épisode tragique qui affaiblit le prolétariat et accéléra le processus de décomposition sociale dont il souffrait.
La Garde rouge, venue au monde de façon éphémère en 1905, ressurgit en février sous l’impulsion et le contrôle des conseils d’usine, parvenant à mobiliser quelques 100 000 membres. Elle se maintint active jusque vers le milieu de 1918, mais la guerre civile la plongea dans une grave crise. La puissance énormément supérieure des armées impérialistes mit en évidence l’incapacité de la Garde rouge à faire front. Les unités du sud de la Russie, commandées par Antonov Ovseenko, opposèrent une résistance héroïque mais furent balayées et défaites. Victimes de la peur de la centralisation, les unités qui tentèrent de rester opérationnelles manquaient des fournitures les plus élémentaires, des cartouches par exemple. C’était surtout une milice urbaine, avec une instruction et un armement limités, sans expérience d’organisation, qui pouvait tout au plus fonctionner comme unités d’urgence ou comme auxiliaire d’une armée organisée, mais incapable de livrer une guerre en bonne et due forme. Les nécessités du moment rendirent nécessaire la constitution en toute urgence d’une Armée rouge avec toute la rigide structure militaire requise (46). Celle-ci absorba de nombreuses unités de la Garde rouge qui se sont dissoutes en tant que telles. Il y eut des tentatives de reconstituer la Garde rouge jusqu’en 1919, certains soviets offrirent la collaboration de leurs unités avec l’Armée rouge mais celle-ci les rejeta systématiquement quand elle ne les dissolvait pas par la force.
La disparition de la Garde rouge rendit à l’État soviétique une des prérogatives classiques de l’État, le monopole des armes, ce qui ôta au prolétariat une grande partie des moyens de sa défense puisqu’il ne disposait plus de force militaire qui lui soit propre.
Les conseils de quartier disparurent fin 1919. Ils intégraient dans l’organisation prolétarienne les travailleurs des petites entreprises et des commerces, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les familles qui faisaient partie de la classe ouvrière comme un tout. C’était aussi un moyen essentiel pour œuvrer progressivement à diffuser la pensée et l’action prolétarienne au sein des couches de marginaux urbains, aux artisans, aux petits paysans, etc.
La disparition des conseils d’usine fut un coup décisif. Comme nous l’avons vu dans le quatrième article de la série, elle fut rapide et ils avaient cessé d’exister fin 1918. Les syndicats eurent un rôle décisif dans leur destruction.
Le conflit se déclara clairement lors d’une tumultueuse Conférence panrusse des conseils d’usine, célébrée la veille de la Révolution d’Octobre. Pendant les débats s’affirma l'idée selon laquelle "lorsque se sont formés les conseils de fabrique, les syndicats ont cessé d'exister et les conseils ont rempli le vide". Un délégué anarchiste déclara que: "les syndicats veulent absorber les conseils de fabrique, mais les gens ne sont pas mécontents de ceux-ci alors qu'ils le sont des syndicats. Pour l'ouvrier, le syndicat est une forme d'organisation imposée de l'extérieur alors que le conseil de fabrique est très proche de lui". L’une des résolutions adoptées par la Conférence disait: "le contrôle ouvrier n'est possible que dans un régime où la classe ouvrière détient le pouvoir politique et économique (…) où sont déconseillées les activités isolées et désorganisées (…) et le fait que les ouvriers confisquent les fabriques au profit même de ceux qui y travaillent est incompatible avec les objectifs du prolétariat" (47).
Les bolcheviks continuèrent à défendre comme un dogme la thèse suivant laquelle "les syndicats sont les organes économiques du prolétariat", et ils prirent partie en leur faveur dans le conflit qui les opposait aux conseils d’usine. Lors de cette même Conférence, un délégué bolchevique défendit que : "les conseils de fabrique devaient exercer leurs fonctions de contrôle au bénéfice des syndicats et, de plus, devaient dépendre financièrement d'eux" (48).
Le 3 novembre 1917, le Conseil des Commissaires du peuple soumit un projet de décret sur le contrôle ouvrier qui stipulait que les décisions des conseils d’usine "pouvaient être annulées par les syndicats ou par les congrès syndicaux" 49. Cette décision provoqua de vives protestations parmi les Conseils d’usine et des membres du Parti. Le projet fut finalement modifié : sur les 21 délégués qui constituaient le Conseil du Contrôle ouvrier, 10 représentaient les syndicats et 5 seulement les conseils d’usine ! Ce déséquilibre non seulement mit ces derniers dans une position de faiblesse, mais les enferma en outre dans la logique de la gestion de la production, ce qui les rendait encore plus vulnérables aux syndicats.
Bien que le Soviet des Conseils d’usine se soit maintenu actif pendant quelques mois, tentant même d’organiser un Congrès général (voir le 4e article de notre série), les syndicats parvinrent finalement à dissoudre les conseils d'usine. Le IIe Congrès syndical, célébré du 25 au 27 janvier 1919, réclama que soit donné un "un statut officiel aux prérogatives des syndicats dans la mesure où leurs fonctions sont chaque fois plus étendues et se confondent avec celles de l'appareil gouvernemental d'administration et de contrôle étatiques" (50).
Avec la disparition des conseils d’usine, "dans la Russie soviétique de 1920, les ouvriers étaient de nouveau soumis à l'autorité de la direction, à la discipline du travail, aux stimulants financiers, au management scientifique, à toutes les formes traditionnelles de l'organisation industrielle, aux anciens directeurs bourgeois, la seule différence étant que le propriétaire était à présent l'État" (51), les ouvriers se retrouvaient complètement atomisés, n’avaient plus la moindre organisation propre qui les réunisse et la participation au soviet s’assimila à l’électoralisme classique de la démocratie bourgeoise et les soviets devinrent de simples chambres parlementaires.
Après la révolution, l'abondance n'existe pas encore et la classe ouvrière continue de subir les conditions du règne de la nécessité, y inclus l'exploitation pendant toute la période pendant laquelle la bourgeoisie mondiale n'est pas vaincue. Après celle-ci et tant que l'intégration des autres couches de la société au travail associé n'est pas achevée, c'est sur le prolétariat que repose l'effort essentiel de production des richesses pour toute la société. La marche vers le communisme inclut donc, pendant tout un temps, une lutte sans trêve pour diminuer l’exploitation jusqu’à la faire disparaître (52). "Afin de maintenir sa domination politique collective, la classe ouvrière a besoin d'assurer au moins les besoins matériels fondamentaux de la vie et, en particulier, d'avoir le temps et l'énergie de s'engager dans la vie politique" (53). Marx disait que "si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande envergure" (54). Si le prolétariat, après avoir pris le pouvoir, acceptait l’augmentation croissante de son exploitation, il se rendrait incapable de continuer le combat pour le communisme.
C’est ce qui se passa dans la Russie révolutionnaire. L’exploitation de la clase ouvrière augmenta jusqu’à atteindre des limites extrêmes, au rythme de sa désorganisation en tant que classe autonome. Ce processus devint irréversible quand il s’avéra que l’extension internationale de la révolution avait échouée. Le groupe Vérité ouvrière (55) exprima clairement la situation : "La révolution a abouti à une défaite de la classe ouvrière. La bureaucratie et les hommes de la NEP sont devenus une nouvelle bourgeoisie qui vit de l’exploitation des ouvriers et profite de leur désorganisation. Avec les syndicats aux mains de la bureaucratie, les ouvriers sont plus désemparés que jamais. Après s’être converti en parti dirigeant, en parti de dirigeants et organisateurs de l’appareil d’État et de l’activité économique de type capitaliste, le Parti communiste a irrévocablement perdu tout type de lien et de parenté avec le prolétariat".
C. Mir, 28-12-10
1 Voir les articles publiés sur le thème : "La Période de transition [169]", Revue internationale no 1 ; "L’État et la dictature du prolétariat [170]", Revue internationale no 11. Voir aussi les articles de notre série sur le communisme : Revue internationale nos 77 [171]-78 [172], 91 [173], 95 [174]-96 [175], 99 [131], 127 [176]-130 [177], 132 [178], 134 [179] et 135 [180].
2 Bilan, no 18, organe de la Fraction de la Gauche communiste d’Italie, p. 612. Bilan poursuivit les travaux de Marx, Engels et Lénine sur la question de l’État et plus particulièrement sur son rôle dans la période de transition du capitalisme au communisme qu’il considéra, reprenant la formulation d’Engels, comme "fléau dont hérite le prolétariat, nous garderons à son égard, une méfiance presque instinctive" (Bilan n° 26 p 874 .
3 Internationalisme, no 10, organe de la Gauche communiste de France (GCF), 1945-1953. La Gauche communiste de France poursuivit l’œuvre de Bilan et fut l’ancêtre de notre organisation.
4 Tendance de gauche qui surgit au sein du Parti bolchevique en 1920-21. Le but de cet article n’est pas d’analyser les différentes fractions de gauche qui surgirent du Parti bolchevique en réaction à sa dégénérescence. Nous renvoyons le lecteur aux nombreux articles que nous avons déjà publiés sur cette question.
Citons entre autres "La Gauche communiste en Russie", Revue internationale nos 8 [113]-9 [114] ; "Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe", Revue internationale nos 142 [181],143 [159], 144 [182] et 145. La citation, traduite par nous, est reprise de l’ouvrage Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, chapitre "Qu’est-ce que l’opposition ouvrière", page 179 de l’édition espagnole. Il faut souligner que si l’Opposition ouvrière eut le mérite et la lucidité de constater les problèmes que connaissait la révolution, la solution qu’elle proposait ne faisait qu’empirer les choses. Elle pensait que les syndicats devaient avoir toujours plus de pouvoir. Partant de l’idée juste que "l’appareil des soviets est un composé de différentes couches sociales" (p. 177 op. cit.), elle conclut par le besoin que "les rênes de la dictature du prolétariat dans le domaine de la construction économique doivent être les organes qui, de par leur composition, sont des organes de classe, unis par les liens vitaux avec la production de façon immédiate, c’est-à-dire les syndicats" (idem). Elle restreint d’un côté l’activité du prolétariat au domaine étroit de la "construction économique" et, de l’autre, donne à des organes bureaucratiques et annihilateurs des capacités du prolétariat, les syndicats, la mission utopique de développer l’activité autonome des masses.
5 Cf. M. Brinton, Les Bolcheviks et le Contrôle ouvrier, "Introduction", page 17 de l’édition espagnole, traduit par nous.
6 Citation du livre de Marcel Liebman Le léninisme sous Lénine, p 167.
7 E. H. Carr, la Révolution bolchevique, Chap. VIII, "L’ascension du parti", p. 203 de l'édition espagnole.
8 Idem, note A, "La théorie de Lénine sur l’État", page 264 de l’édition espagnole.
9 Cf. Revue internationale, no 99, "Comprendre la défaite de la Révolution russe [131]" (1re partie).
10 Idem. Citation de Ossinski, membre d’une des premières tendances de gauche dans le Parti.
11 Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, op. cit., p. 181 de l’édition espagnole, traduit par nous.
12 Brinton, op. cit., note 7, p. 121 de l’édition espagnole, traduit par nous. Les Glavki étaient les organes étatiques de gestion étatique économique.
13 Lénine, mars 1919, Intervention au Soviet de Petrograd.
14 Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, op. cit., p. 213 de l’édition espagnole, traduit par nous.
15 Citations empruntées à l’ouvrage de Marcel Liebman, le Léninisme sous Lénine, p. 109.
16 Revue internationale, no 99, op. cit.
17 Cette préoccupation fut reprise par les communistes de gauche qui "exprimèrent, en 1919, le désir d'accentuer la distinction entre Etat et parti. Il leur semblait que celui-ci avait plus que celui-là une préoccupation internationaliste qui répondait à leur propre inclination. Le parti eût dû, en quelque sorte, jouer le rôle de conscience du gouvernement et de l'Etat" (Marcel Liebman, P. 112). Bilan insiste sur ce risque que le Parti soit absorbé par l’État, faisant perdre à la classe ouvrière, son avant-garde, et aux organes soviétiques, leurs principaux animateurs : "La confusion ente ces deux notions de parti et d'Etat est d'autant plus préjudiciable qu'il n'existe aucune possibilité de concilier ces deux organes, alors qu'une opposition inconciliable existe entre la nature, la fonction et les objectifs de l'Etat et du parti. L'adjectif de prolétarien ne change pas la nature de l'Etat qui reste un organe de contrainte économique et politique, alors que le parti est l'organe dont le rôle est, par excellence, celui d'arriver non pas par la contrainte, mais par l'éducation politique à l'émancipation des travailleurs" (Bilan n° 26, p. 871)
18 Pierre Broué, Trotski, p. 255. L’auteur rapporte le récit de l’auteur anarchiste Léonard Schapiro.
19 Marcel Liebman, op. cit., p. 149.
20 Idem, p. 151.
21 Cette théorisation s’enracinait dans les confusions que traînaient tous les révolutionnaires par rapport au parti, ses rapports avec la classe et la question du pouvoir, comme nous le signalons dans un article de notre série sur le communisme, Revue internationale no 91 : "les révolutionnaires de l'époque, malgré leur engagement envers le système de délégation des soviets qui avait rendu obsolète le vieux système de représentation parlementaire, étaient encore tirés en arrière par l'idéologie parlementaire au point qu'ils considéraient que c'était le parti ayant la majorité dans les soviets centraux, qui devait former le gouvernement et administrer l’État". En réalité, les vieilles confusions se virent renforcées et poussées à l’extrême par la théorisation de la réalité toujours plus évidente de la transformation du parti bolchevique en Parti-État.
22 Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
23 Idem, p. 110.
24 Idem, p. 110
25 Cité dans la brochure de Brinton, p. 138, note 7, traduit par nous. Trotski a raison de dire que la classe peut passer par des moments de confusion et d’hésitation et que le Parti, au contraire, armé par un rigoureux cadre théorique et programmatique, est porteur des intérêts historiques de la classe et doit les lui transmettre. Mais cela, il ne peut le faire au moyen d’une dictature sur le prolétariat, laquelle ne fait qu’affaiblir celui-ci, augmentant encore plus ses hésitations.
26 La plateforme du "Groupe des quinze” fut initialement publiée hors de Russie par la branche de la Gauche italienne qui publiait le journal Réveil communiste à la fin des années 1920. Elle parut en allemand et en français sous le titre A la veille de Thermidor, révolution et contre-révolution dans la Russie des soviets -Plate-forme de l'Opposition de gauche dans le parti bolchevique (Sapranov, Smirnov, Obhorin, Kalin, etc.) au début de 1928
27 Rosa Luxemburg, la Révolution russe.
28 Lénine, "Rapport sur la guerre et la paix” au VIIe Congrès du Parti. 7 Mars 1918.
29 Chapitre V, "La phase supérieure de la société communiste, p. 375.
30 Comme Marx, Lénine utilise de façon impropre le terme "phase inférieure du communisme", quand en réalité, une fois détruit l’État bourgeois, nous sommes encore sous "un capitalisme avec une bourgeoisie défaite", ce qui nous fait considérer plus exact de parler de "période de transition du capitalisme au communisme".
31 Dans la Révolution trahie, Trotski reprend la même idée lorsqu’il parle du caractère "double" de l’Etat, "socialiste" d’un côté mais aussi "bourgeois sans bourgeoisie" de l’autre. Voir notre article [183] de la série sur le communisme, Revue internationale no 105.
32 Comme le disait Marx dans la Critique au Programme de Gotha, le principe dominant "à travail égal, salaire égal" n’a rien de socialiste.
33 Alexandra Kollontai, dans une intervention au Xe Congrès du parti, Op cit page 171 de l'édition espagnole, traduit par nous. Anton Ciliga, dans son livre Au pays du grand mensonge, va dans le même sens : "Ce qui séparait cette Opposition du trotskisme, ce n'était pas seulement la façon de juger le régime et de comprendre les problèmes actuels. C'était avant tout la façon de comprendre le rôle du prolétariat dans la révolution. Pour les trotskistes, c'était le parti, pour les groupes d'extrême gauche, c'était la classe ouvrière qui était le moteur de la révolution. La lutte entre Staline et Trotsky concernait la politique du parti, le personnel dirigeant du parti; pour l'un comme pour l'autre le prolétariat n'était qu'un objet passif. Les groupes de l'extrême gauche communiste au contraire s'intéressaient avant tout à la situation et au rôle de la classe ouvrière, à ce qu'elle était en fait dans la société soviétique et à ce qu'elle devait être dans une société qui se donnerait sincèrement pour tâche d'édifier le socialisme". (traduit par nous)
34 Revue internationale no 77, "1871 : la première révolution prolétarienne – Le communisme, une société sans État".
35 Idem
36 Lénine, "Rapport politique du Comité central au XIe Congrès". 27 mars 1922.
37 Víctor Serge, l’An I de la Révolution russe, Tome II, La constitution soviétique.
38 Lénine. Brouillon du projet du programme du parti communiste bolchevique. "Les thèses fondamentales de la dictature du prolétariat en Russie". Point 9. Traduit par nous à partir de la version espagnole des œuvres complètes, Tome 38.
39 Dans sa lettre à la République des Conseils ouvriers de Bavière – qui ne vécut que trois semaines car écrasée par les troupes du gouvernement social-démocrate en mai 1919 – Lénine semble orienter vers l’organisation indépendante des conseils ouvriers : "L'application la plus urgente et la plus large de ces mesures, ainsi que d'autres semblables, faite en s'appuyant sur l'initiative des soviets d'ouvriers, de journaliers, et, séparément, de petits paysans, doit renforcer votre position" (27 avril 1919)
40 Sur cette question, Lénine exprima cependant des doutes, puisqu’en maintes occasions il signala avec raison qu’il s’agissait "d’un État ouvrier et paysan avec des déformations bureaucratiques” et, par ailleurs, lors du débat sur les syndicats (1921), il argumenta que le prolétariat devait être organisé en syndicats et avoir le droit de grève pour se défendre de "son" État : "[Trotsky] prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotski parle d'un "État ouvrier". Mais c'est une abstraction ! Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, c'était normal; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : "Pourquoi défendre la classe ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier", on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une des principales erreurs du camarade Trotski. Des principes généraux, nous sommes passés aujourd'hui à la discussion pratique et aux décrets, et l'on veut nous détourner de ce travail pratique et concret pour nous tirer en arrière. C'est inadmissible. En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. De nombreuses conséquences en découlent. (Boukharine [184] : "Comment ? Ouvrier-paysan ?"). Et bien que le camarade Boukharine, crie derrière : "Comment ? Ouvrier-paysan ?", je ne vais pas me mettre à lui répondre sur ce point. Que ceux qui en ont le désir se souviennent du Congrès des Soviets qui vient de s'achever ; il a donné la réponse.
Mais ce n'est pas tout. Le programme de notre Parti, document que l'auteur de l'"ABC du communisme [185]" connaît on ne peut mieux, ce programme montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique. Il nous reporte dans le domaine de l'abstraction ou de l'idéal que nous atteindrons d'ici quinze ou vingt ans, et encore, je ne suis pas sûr que nous y parvenions dans ce délai. Nous sommes en face d'une réalité que nous connaissons bien, si toutefois nous ne nous grisons pas, nous ne nous laissons pas entraîner par des discours d'intellectuels ou des raisonnements abstraits, ou encore, par ce qui semble parfois être une "théorie", mais n'est en fait qu'une erreur, une fausse appréciation des particularités de la période de transition. Notre État est tel aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État et pour que les ouvriers défendent notre État." (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/12/vil19201230.htm [186])
41 Lénine impulsa une Inspection ouvrière et paysanne (1922) qui échoua rapidement dans sa mission de contrôle et se convertit en une structure bureaucratique supplémentaire.
42 Cf. Revue internationale no 141, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? (II) : de février à juillet 1917 : resurgissement et crise [90]".
43 Cf. Revue internationale no 142, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers (III) : la révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir [129]".
44 Brinton, op. cit., voir note 10 p. 32 de l’édition espagnole, traduit par nous.
45 Idem, p. 47 de l’édition espagnole, traduit par nous.
46 Sans entrer dans une discussion sur la nécessité ou non d’une Armée rouge pendant cette partie de la période de transition, que nous pouvons appeler période de guerre civile mondiale (c’est-à-dire tant que le prolétariat n’a pas pris le pouvoir dans le monde entier), quelque chose apparaît comme évident dans l’expérience russe : la formation de l’Armée rouge, sa rapide bureaucratisation et affirmation comme organe étatique, la totale absence de contrepoids prolétariens en son sein, tout ceci reflète un rapport de forces avec la bourgeoisie très défavorable au prolétariat au niveau mondial. Comme nous le remarquions dans l’article de la série sur le communisme publié dans la Revue internationale no 96, "plus la révolution s’étend mondialement, plus elle sera directement dirigée par les conseils ouvriers et leurs milices, plus les aspects politiques de la lutte prédomineront sur le militaire, moins il y aura besoin d’une 'Armée rouge' pour mener la lutte".
47 Cité par Brinton, op. cit., p. 48 de l’édition espagnole, traduit par nous. Enthousiasmé par les résultats de la Conférence, Lénine déclara : "nous devons transférer le centre de gravité vers les conseils de fabrique. Ils doivent devenir les organes de l'insurrection. Il nous faut changer de mot d'ordre et, au lieu de dire, "tout le pouvoir aux soviets", nous devons dire "tout le pouvoir aux conseils de fabrique".
48 Idem, p. 35 de l’édition espagnole.
49 Cité par Brinton, op. cit., p. 50 de l’édition espagnole, traduit par nous
50 L’expérience russe montre de façon concluante la nature réactionnaire des syndicats, leur tendance indéfectible à se convertir en structures étatiques et leur antagonisme radical aux nouvelles formes organisationnelles que, depuis 1905, le prolétariat avait développées en dans le contexte des nouvelles conditions du capitalisme décadent et face à la nécessité de la révolution.
51 R.V. Daniels, cité par Brinton, op. cit., p. 120 de l’édition espagnole, traduit par nous.
52 "Une politique de gestion prolétarienne (…) aura un contenu socialiste seulement si le cours économique reçoit une orientation diamétralement opposée à celle du capitalisme, si donc il se dirige vers une élévation progressive et constante des conditions de vie des masses et non vers leur abaissement" (Bilan, no 28, "Les problèmes de la période de transition", cité dans la Revue internationale no 128).
53 Cf. Revue internationale no 95, "1919 – Le programme de la dictature du prolétariat [174]".
54 K. Marx, Salaire, prix et profits.
55 Né en 1922, il fut une des dernières fractions de gauche sécrétées par le Parti bolchevique dans le combat pour sa régénération et sa récupération par la classe.
11
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Heritage de la Gauche Communiste:
Décadence du capitalisme (IX) : le Comintern et le virus du "Luxemburgisme" en 1924
- 2603 lectures
Dans le précédent article de la série, nous avons montré la rapidité avec laquelle les espoirs en une victoire révolutionnaire immédiate suscités par les soulèvements de 1917-1919 avaient, en deux ans à peine, dès 1921, cédé la place chez les révolutionnaires à une réflexion plus réaliste sur le cours de la crise historique du capitalisme. Au Troisième Congrès de l’IC, l’une des questions centrales qui se posait était : il est certain que le système capitaliste est entré dans une époque de déclin, mais que va-t-il se passer si le prolétariat ne répond pas immédiatement à la nouvelle période en renversant le système ? Et quelle est la tâche des organisations communistes dans une phase où la lutte de classe et la compréhension subjective de la situation par le prolétariat refluent, alors que les conditions historiques objectives de la révolution existent toujours ?
Cette accélération de l’histoire, qui donna lieu à différentes réponses souvent conflictuelles de la part des organisations révolutionnaires, se poursuivit au cours des années suivantes, avec la dégénérescence de la révolution en Russie due à son isolement croissant qui ouvrit la porte au triomphe d’une forme sans précédent de contre-révolution. L’année 1921 constitua un tournant fatidique : confrontés à un mécontentement largement répandu dans le prolétariat de Petrograd et de Kronstadt ainsi qu’à une vague de révoltes paysannes, les Bolcheviks prirent la décision catastrophique de réprimer massivement la classe ouvrière et, simultanément, d’interdire les fractions au sein du parti. La Nouvelle Politique Economique (NEP), introduite immédiatement après la révolte de Kronstadt, faisait certaines concessions sur le plan économique, mais aucune au niveau politique : l’appareil du parti-Etat ne devait permettre aucun assouplissement de sa domination sur les soviets. Et pourtant, un an après, Lénine protestait contre le fait que l’Etat échappait au contrôle du parti prolétarien, l’entraînant dans une voie qu’il ne pouvait prévoir. La même année, à Rapallo, l’Etat "soviétique" concluait un accord secret avec l’impérialisme allemand à un moment où existait encore en Allemagne une fermentation sociale : c’était un symptôme évident du fait que l’Etat russe commençait à mettre ses intérêts nationaux au-dessus de ceux de la lutte de classe internationale. En 1923, en Russie, de nouvelles grèves ouvrières eurent lieu et des groupements de communistes de gauche se formèrent illégalement, comme le Groupe ouvrier de Miasnikov, en même temps que se créait une opposition de gauche "légale", regroupant non seulement d’anciens dissidents comme Ossinski mais également Trotsky lui-même.
Lénine mourut en janvier 1924 et en décembre Staline tenta de lancer le slogan du "socialisme dans un seul pays". En 1925-1926, c’était devenu la politique officielle du parti russe. Cette nouvelle orientation était le symbole d’une rupture décisive avec l’internationalisme.
La bolchevisation contre le "luxemburgisme"
Tous les communistes qui s’étaient regroupés en 1919 pour former la nouvelle Internationale partageaient l’idée que le capitalisme était devenu historiquement un système en déclin, même s’ils n’étaient pas d’accord sur les implications politiques de la nouvelle période ni sur les moyens dont avait besoin la lutte révolutionnaire pour se développer – par exemple, sur la possibilité d’utiliser les parlements comme une "tribune" pour la propagande révolutionnaire, ou la nécessité de les boycotter en faveur d’actions de rue et sur les lieux de travail. Concernant les fondements théoriques de la nouvelle époque, ils avaient disposé de peu de temps pour en discuter de façon soutenue. La seule analyse vraiment cohérente de "l’économie en décadence" avait été fournie par Rosa Luxemburg juste avant l’éclatement de la Guerre mondiale. Comme nous l’avons vu précédemment 1, la théorie de Luxemburg sur l’effondrement du capitalisme avait provoqué beaucoup de critiques de la part des réformistes ainsi que des révolutionnaires, mais ces critiques étaient pour la plus grande part négatives – il existait peu d’élaboration d’un cadre alternatif pour comprendre les contradictions fondamentales qui propulsaient le capitalisme dans sa phase de déclin. Quoi qu’il en soit, les désaccords sur cette question n’étaient pas considérés, à juste raison, comme fondamentaux. La question essentielle était d’accepter l’idée que le système était entré dans une phase où la révolution était devenue à la fois possible et nécessaire.
En 1924, cependant, au sein de l’Internationale communiste, la controverse autour de l’analyse économique de Luxemburg se raviva. Le point de vue de Luxemburg avait toujours eu une influence considérable dans le mouvement communiste allemand, tant dans le Parti communiste officiel (KPD) que dans le parti communiste de gauche (Parti communiste ouvrier d’Allemagne, KAPD). Mais maintenant, du fait de la pression grandissante pour que les partis communistes en dehors de la Russie soient plus fermement rattachés aux besoins de l’Etat russe, un processus de "bolchevisation" fut lancé dans toute l’IC, avec le but de se débarrasser de toutes les divergences indésirables en termes de théorie et de tactique. Il arriva un moment de la campagne de "bolchevisation" où la persistance du "luxemburgisme" dans le parti allemand fut considérée comme la source d’une multitude de déviations – en particulier ses "erreurs" sur la question nationale et coloniale et une démarche spontanéiste vis-à-vis du rôle du parti. Sur un plan plus "théorique" et abstrait, cette orientation contre le "luxemburgisme" donna lieu à l’écriture par Boukharine du livre L’impérialisme et l’accumulation du Capital, en 1924. 2
La dernière fois que nous avons parlé de Boukharine, c’était un porte-parole de la gauche du Parti bolchevique pendant la guerre – son analyse quasi-prophétique du capitalisme d’Etat et le fait qu’il défendait la nécessité de détruire l’Etat capitaliste et de revenir à Marx le mettaient vraiment à l’avant-garde du mouvement international ; il était également très proche de la position de Luxemburg par son rejet du slogan de "l’auto-détermination nationale", au grand mécontentement de Lénine. En Russie en 1918, il avait été l’un des instigateurs du Groupe communiste de gauche qui s’était opposé au Traité de Brest-Litovsk et, de façon plus significative, il s’était opposé à la bureaucratisation précoce de l’Etat soviétique 3. Mais une fois que la controverse sur la question de la paix se fût dissipée, l’admiration de Boukharine pour les méthodes du Communisme de guerre l’emporta sur ses facultés critiques et il se mit à théoriser ces méthodes comme l’expression d’une forme authentique de transition vers le communisme 4. Au cours du débat sur les syndicats en 1921, Boukharine partageait la position de Trotsky qui réclamait la subordination des syndicats à l’appareil d’Etat. Mais avec l’introduction de la NEP, Boukharine changea à nouveau de position. Il rejeta les méthodes extrêmes de coercition favorisées par le Communisme de guerre, en particulier à l’égard de la paysannerie, et commença à considérer la NEP comme le modèle "normal" de la transition vers le communisme, avec son mélange de propriété individuelle et de propriété d’Etat ainsi que sa politique consistant à s’appuyer sur les forces du marché plutôt que sur les décrets de l’Etat. Mais tout comme il s’était emballé pour le Communisme de guerre, Boukharine considérait de plus en plus cette phase de transition en termes nationaux, contrairement à ce qu’il avait défendu pendant la guerre, quand il avait souligné la nature globalement interdépendante de l’économie mondiale. En fait, on peut en un sens considérer Boukharine comme l’instigateur de la thèse du socialisme dans un seul pays reprise par Staline et utilisée par ce dernier pour se débarrasser finalement de Boukharine, politiquement d’abord, puis physiquement.5
L’impérialisme et l'accumulation du capital de Boukharine se donnait clairement pour but de justifier théoriquement la dénonciation des "faiblesses" du KPD sur les questions nationale, coloniale et paysanne – il l’affirme hardiment à la fin du livre, bien qu’il ne fasse aucun lien entre les attaques contre la vision économique de Luxemburg et ses prétendues conséquences politiques. Pourtant, certains révolutionnaires ont considéré l’assaut tous azimuts contre Luxemburg sur la question de l’accumulation capitaliste comme si la question était indépendante des buts douteux du livre.
Nous pensons que c’est une erreur pour plusieurs raisons. On ne peut séparer le ton agressif et le contenu théorique du livre de Boukharine de son but politique.
Le ton du texte indique de façon certaine que son but est une entreprise de démolissage de Luxemburg afin de la discréditer. Comme le souligne Rosdolsky : "Le lecteur d’aujourd’hui peut trouver le ton agressif et souvent frivole de Boukharine plutôt déplaisant si on se rappelle que Rosa Luxemburg avait été victime de meurtriers fascistes à peine quelques années auparavant. L’explication est que ce ton était dicté par des intérêts politiques plus que par un intérêt scientifique. Boukharine considérait que sa tâche était d’anéantir l’influence encore très grande du "luxemburgisme" dans le Parti communiste allemand (KPD), et par tous le moyens."6. Il faut s’enfiler des pages de sarcasmes et d’apartés condescendants avant que Boukharine admette à contrecœur, tout à la fin du livre, que Rosa avait fourni une excellente vue d’ensemble de la façon dont le capitalisme avait traité les autres systèmes sociaux qui constituent son milieu. Il n’y a aucun effort dans cette "polémique" de commencer par se référer aux véritables questions que Rosa Luxemburg avait abordées dans son livre – l’abandon par les révisionnistes de la perspective de la faillite du capitalisme et la nécessité de comprendre la tendance à l’effondrement inhérente au processus d’accumulation capitaliste. Au contraire, un bon nombre d’arguments de Boukharine donnent l’impression qu’il s’en prend à tout ce qui lui tombe sous la main, même si cela signifie la distorsion totale de la thèse de Luxemburg.
Par exemple, que faire de l’accusation selon laquelle Luxemburg nous proposerait une théorie dans laquelle l’impérialisme vivrait en harmonie avec le monde pré-capitaliste à travers un échange pacifique d’équivalents, ce qui, dans la formulation de Boukharine, s’écrit : "Les deux parties sont très satisfaites. Les loups ont mangé, les moutons sont saufs" ? Nous venons de mentionner que Boukharine lui-même admet ailleurs qu’une qualité majeure du livre de Luxemburg est la manière dont il rend compte de la façon dont le capitalisme "intègre" le milieu non-capitaliste – par le pillage, l’exploitation et la destruction – et le dénonce. C’est tout le contraire de moutons et de loups vivant en harmonie. Soit les moutons sont mangés, soit grâce à leur propre croissance économique, ils se transforment en loups capitalistes et leur entrée dans la compétition restreint l’apport de nourriture...
Tout aussi grossier est l’argument selon lequel, selon la définition de l’impérialisme par Luxemburg, seules les luttes pour certains marchés non capitalistes constitueraient des conflits impérialistes et "une lutte pour des territoires qui sont déjà devenus capitalistes ne serait pas de l’impérialisme, ce qui est totalement faux". En réalité, l’argument de Luxemburg selon lequel "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde" 7 a pour but de décrire l’ensemble d’une période, un contexte général dans lequel se déroulent les conflits impérialistes. Le retour du conflit impérialiste au cœur du système, l’évolution vers des rivalités militaires directes entre les puissances capitalistes développées est déjà indiqué dans L’Accumulation et est considérablement développé dans La brochure de Junius.
Toujours au sujet de l’impérialisme, Boukharine met en avant l’argument selon lequel, puisqu’il existe encore beaucoup d’aires de production non capitalistes dans le monde, le capitalisme aurait un brillant avenir : "C’est un fait que l’impérialisme signifie catastrophe, que nous sommes entrés dans la période de l’effondrement du capitalisme, rien de moins. Mais c’est aussi un fait que la majorité écrasante de la population mondiale appartient à "la troisième personne"... ce ne sont pas les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture qui composent la majorité de la population mondiale actuelle... Même si la théorie de Rosa Luxemburg était ne serait-ce qu’approximativement correcte, la cause de la révolution serait en très mauvaise posture."
Paul Frölich (l’un des "luxemburgistes" qui est resté dans le KPD après l’exclusion de ceux qui allaient fonder le KAPD) répond très bien à cet argument dans sa biographie de Luxemburg, publiée en 1939 pour la première fois :
"Divers critiques, et Boukharine en particulier, croyaient jouer un atout contre Rosa Luxemburg lorsqu’ils soulignaient les immenses possibilités de l’expansion capitaliste dans des zones non capitalistes. Mais l’auteur de la théorie de l’accumulation avait déjà ôté à cet argument son dard en soulignant de façon répétée que l’agonie du capitalisme aurait lieu bien avant que sa tendance inhérente à étendre ses marchés ait atteint ses limites objectives. Les possibilités expansionnistes ne résident pas dans une conception géographique : ce n’est pas le nombre de km2 qui est décisif. Ni non plus dans une conception démographique : ce n’est pas une comparaison statistique des populations capitalistes et non-capitalistes qui indique la maturité du processus historique. Il s’agit d’un problème socio-économique et tout un ensemble complexe d’intérêts, de forces et de phénomènes contradictoires doit être pris en compte." 8 En somme, Boukharine a confondu de façon patente la géographie et la démographie avec la capacité réelle des systèmes non capitalistes restants de générer de la valeur d’échange et donc de constituer un marché effectif pour la production capitaliste.
Les contradictions capitalistes
Si nous examinons maintenant la façon dont Boukharine traite la question centrale de la théorie de Luxemburg - le problème soulevé par les schémas de la reproduction de Marx - nous voyons de nouveau que la démarche de Boukharine est loin d’être déconnectée de sa vision politique. Dans un article en deux parties publié en 1982 dans les Revue internationale n° 29 et 30, "Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme, c’est l’élimination du salariat (A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine)"9, il est argumenté à juste titre que les critiques portées par Boukharine à Luxemburg révèlent de profondes divergences sur le contenu du communisme.
Au centre de la théorie de Luxemburg se trouve l’argument selon lequel les schémas de la reproduction élargie, dans le Volume II du Capital, qui, pour les besoins de l’argument, supposent une société exclusivement composée de capitalistes et d’ouvriers, doivent précisément être considérés comme un schéma abstrait et non comme une démonstration de la possibilité réelle d’une accumulation harmonieuse du capital dans un système fermé. Dans la vie réelle, le capitalisme a été constamment amené à s’étendre au-delà des frontières de ses propres rapports sociaux. Pour Luxemburg, à la suite de l’argumentation de Marx dans d’autres parties du Capital, le problème de la réalisation se pose au capital dans son ensemble même si pour les ouvriers et les capitalistes individuels, d’autres ouvriers et d’autres capitalistes peuvent parfaitement constituer un marché pour toute leur plus-value. Boukharine accepte évidemment que pour que la reproduction élargie ait lieu, il faut une source constante de demande additionnelle. Mais il dit que cette demande additionnelle est fournie par les ouvriers ; peut-être pas les ouvriers qui absorbent le capital variable avancé par les capitalistes au début du cycle de l’accumulation, mais par les ouvriers supplémentaires : "L’emploi d’ouvriers supplémentaires produit une demande additionnelle ce qui réalise précisément la partie de la plus-value qui doit être accumulée, pour être exact, la partie qui doit nécessairement être convertie en capital variable additionnel de fonctionnement." Ce à quoi notre article répond : "Appliquer l’analyse de Boukharine à la réalité mène à ceci : que doivent faire les capitalistes pour éviter de licencier les ouvriers quand leurs entreprises ne trouvent plus de débouchés ? C’est simple ! Embaucher des "ouvriers supplémentaires" ! Il fallait y penser. Le problème, c’est que le capitaliste qui suivra ce conseil, fera rapidement faillite." 10
Cet argument est du même niveau que celui d’Otto Bauer en réponse à Luxemburg, argument qu’elle met en pièces dans l’Anticritique : pour Bauer, la simple croissance de la population constitue les nouveaux marchés nécessaires à l’accumulation. Le capitalisme serait certainement florissant aujourd’hui si l’augmentation de la population résolvait le problème de la réalisation de la plus-value. Mais de façon étrange, au cours des dernières décennies, l’augmentation de la population a été constante tandis que la crise du système a également augmenté à des niveaux vertigineux. Comme le soulignait Frölich, le problème de la réalisation de la plus-value n’est pas une question démographique mais de demande effective, demande soutenue par la capacité à payer. Et puisque la demande des ouvriers ne peut pas absorber plus que le capital variable avancé au départ par les capitalistes, embaucher de nouveaux ouvriers se révèle une non-solution dès qu’on considère le capitalisme comme une totalité.
- Il y a cependant un autre aspect dans l’argument de Boukharine puisqu’il dit également que les capitalistes eux-mêmes constituent le marché additionnel pour l’accumulation à venir en investissant dans la production des moyens de production. "Les capitalistes eux-mêmes achètent les moyens additionnels de production, les ouvriers supplémentaires, qui reçoivent de l’argent des capitalistes, achètent les moyens de consommation additionnels."
Cet aspect de l’argument a les faveurs de ceux qui considèrent, comme Boukharine, que Luxemburg a soulevé un problème qui n’existe pas : produire et vendre des moyens de production additionnels résout le problème de l’accumulation. Luxemburg avait déjà répondu à l’essentiel de cet argument dans la critique de Tougan-Baranovski qui cherchait à prouver que le capitalisme ne se confrontait pas à des barrières insurmontables au cours du processus d’accumulation ; elle soutenait son argument en se référant à Marx lui-même : "En outre, comme nous l’avons vu au livre II, section III 11, une circulation continuelle se fait entre capital constant et capital variable (même si l’on ne tient pas compte de l’accumulation accélérée) ; cette circulation est d’abord indépendante de la consommation individuelle dans la mesure où elle n’y entre pas ; néanmoins, elle est définitivement limitée par cette dernière parce que la production de capital constant ne se fait jamais pour elle-même, mais uniquement parce qu’il s’en utilise davantage dans les sphères de production qui produisent pour la consommation individuelle." 12
Pour Luxemburg, une interprétation littérale des schémas de la reproduction comme le fait Tougan-Baranovski aurait pour résultat "[non] pas une accumulation de capital, mais une production croissante de moyens de production sans aucun but". 13
Boukharine est conscient que la production de biens de production ne constitue pas une solution au problème car il fait intervenir des "ouvriers supplémentaires" pour acheter les masses de marchandises produites par les moyens de production additionnels. En fait, il prend Tougan-Baranovski à partie pour ne pas comprendre que "la chaîne de la production doit toujours finir par la production de moyens de consommation...qui entrent dans le processus de la consommation personnelle" 14. Mais il n’utilise cet argument que pour accuser Luxemburg de confondre Tougan et Marx. Et pour finir, il répond à Luxemburg, comme tant d’autres le feront après lui, en citant Marx d’une façon erronée qui semble impliquer que le capitalisme pourrait être parfaitement satisfait en basant son expansion sur une production infinie de biens d’équipement :
- "Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise." 15
C’est une citation de Marx en effet, mais la référence qu’y fait Boukharine est trompeuse. Le langage utilisé ici par Marx est polémique et non exact : il est vrai que le capital est basé sur l’accumulation pour elle-même, c’est-à-dire sur l’accumulation de richesses sous sa forme historiquement dominante de valeur ; mais il ne peut réaliser cela en produisant simplement pour lui-même. Ceci parce qu’il ne produit que des marchandises et qu’une marchandise ne réalise aucun profit pour les capitalistes si elle n’est pas vendue. Il ne produit pas pour remplir simplement ses entrepôts ou jeter ce qu’il a produit (même si cela est souvent le résultat malheureux de son incapacité à trouver un marché pour ses produits).
Les solutions capitalistes d’Etat de Boukharine
Stephen Cohen, biographe de Boukharine qui a cité les commentaires de Boukharine sur Tougan, note une autre contradiction fondamentale dans la démarche de Boukharine.
- "A première vue, sa démarche inflexible vis-à-vis des arguments de Tougan-Baranovsky semble curieuse. Boukharine lui-même, après tout, avait souvent souligné le pouvoir régulateur des systèmes capitalistes d’Etat, théorisant même plus tard que sous un "pur" capitalisme d’Etat (sans libre marché), la production pourrait se poursuivre sans crise alors que la consommation serait à la traîne." 16
Cohen met le doigt sur un élément crucial de l’analyse de Boukharine. Il se réfère au passage suivant de L’impérialisme et l’Accumulation du Capital.
- "Imaginons trois formations socio-économiques : l’ordre social collectif capitaliste (le capitalisme d’Etat) dans lequel la classe capitaliste est unie en un trust unifié et nous nous trouvons dans une économie organisée bien qu’en même temps, du point de vue des classes, antagoniste ; puis la société capitaliste "classique" qu’analyse Marx ; et, finalement, la société socialiste. Suivons (1) le développement de la reproduction élargie ; donc les facteurs qui rendent une "accumulation" possible (nous mettons le mot "accumulation" entre guillemets parce que ce terme, "accumulation", suppose par sa nature même des rapports capitalistes seulement) ; (2) comment, où et quand les crises peuvent surgir.
1. Le capitalisme d’Etat. Une accumulation y est-elle possible ? Evidemment. Le capital constant s’accroît parce que la consommation des capitalistes s’accroît. De nouvelles branches de la production correspondant à de nouveaux besoins émergent continuellement. Même si elle connaît certaines limites, la consommation des travailleurs augmente. En dépit de cette sous-consommation des masses, aucune crise ne peut surgir car la demande mutuelle de toutes les branches de la production comme la demande des consommateurs, celle des capitalistes comme celle des ouvriers, sont données au départ. Au lieu de "l’anarchie de la production", on a un plan qui est rationnel du point de vue du Capital. S’il y a de "mauvais calculs" dans les moyens de production, le surplus est stocké, et une correction sera apportée dans la période suivante de production. Si, d’un autre côté, il y a eu de mauvais calculs concernant les moyens de consommation pour les ouvriers, cet excédent est utilisé comme "fourrage" en le distribuant aux ouvriers, ou la portion correspondante du produit sera détruite. Même dans le cas de mauvais calculs dans la production d’articles de luxe, la "voie de sortie" est claire. Ainsi, aucune crise de surproduction ne peut avoir lieu ici. La consommation des capitalistes constitue une incitation pour la production et le plan de production. De ce fait, il n’y a pas de développement particulièrement rapide de la production (petit nombre de capitalistes)."
Frölich comme Cohen souligne ce passage et fait le commentaire suivant :
- "La solution (de Boukharine) s’avère une confirmation de sa thèse centrale... Et cette solution est étonnante. On nous présente un "capitalisme" qui n’est pas une anarchie économique mais une économie planifiée dans laquelle il n’y a pas de compétition mais qui est plutôt un trust mondial global et dans laquelle les capitalistes n’ont pas à se soucier de la réalisation de leur plus-value..."
Notre article aussi est cinglant vis à vis de cette idée de se débarrasser de la surproduction :
- "Boukharine prétend résoudre théoriquement le problème en l’éliminant. Le problème des crises de surproduction du capitalisme, c’est la difficulté à vendre. Boukharine nous dit : on n’a qu’à procéder à "une distribution gratuite" ! Si le capitalisme avait la possibilité de distribuer gratuitement ce qu’il produit, il ne connaîtrait effectivement jamais de crise majeure. Sa principale contradiction étant de ce fait résolue. Mais un tel capitalisme ne peut exister que dans la tête d’un Boukharine en mal d’arguments. La distribution "gratuite" de la production, c’est-à-dire l’organisation de la société de sorte que les hommes produisent directement pour eux-mêmes, cela constitue effectivement la seule solution pour l’humanité. Seulement, cette solution, ce n’est pas un capitalisme "organisé" mais le communisme."
Lorsqu’il revient sur la société capitaliste "classique" dans le paragraphe qui suit, Boukharine accepte que des crises de surproduction puissent avoir lieu – mais elles sont simplement le produit d’un déséquilibre temporaire entre les branches de la production (un point de vue précédemment exprimé par les économistes "classiques" et critiqué par Marx comme nous l’avons montré dans un article précédent 17), Boukharine dédie ensuite quelques maigres lignes au socialisme en tant que tel et nous sert l’évidence selon laquelle une société qui ne produit que pour la satisfaction des besoins humains ne subirait pas de crise de surproduction. Mais ce qui semble intéresser Boukharine avant tout, c’est le capitalisme hyper-planifié où l’Etat aplanit tous les problèmes de disproportion ou de mauvais calculs. En d’autres termes, la sorte de société qu’en URSS au milieu des années 1920, il décrivait déjà comme du socialisme... Il est vrai que le capitalisme d’Etat de science-fiction de Boukharine est devenu un trust mondial, un colosse qui n’est plus entouré d’aucun vestige pré-capitaliste et ne connaît aucun conflit entre capitaux nationaux. Mais sa vision du socialisme en Union soviétique était une utopie cauchemardesque du même genre, un trust quasiment autosuffisant ne connaissant aucune concurrence interne et seulement une paysannerie docile, partiellement et temporairement en dehors de sa juridiction économique.
Ainsi, comme nous l’avions dit plus haut, l’article de la Revue internationale n° 29 conclut à juste titre que l’attaque de Boukharine contre la théorie économique de Rosa Luxemburg révèle deux visions fondamentalement opposées du socialisme. Pour Luxemburg, la contradiction fondamentale de l’accumulation capitaliste découle de la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, inhérente à la marchandise – et par dessus tout à la force de travail, marchandise qui a la caractéristique unique d’engendrer une valeur additionnelle source du profit capitaliste mais aussi source de son problème d’insuffisance de marchés pour réaliser son profit. Par conséquent, cette contradiction, et toutes les convulsions qui en résultent, ne peut être surmontée que par l’abolition du travail salarié et de la production de marchandises – prérequis essentiels du mode de production communiste.
D’un autre côté, Boukharine critique Luxemburg pour s’être facilité les choses et "avoir choisi une contradiction" alors qu’il y en a beaucoup : la contradiction entre les branches de la production, entre l’industrie et l’agriculture, l’anarchie du marché et la concurrence 18. Tout cela est vrai mais la solution capitaliste d’Etat de Boukharine montre que pour lui, il existe un problème fondamental dans le capitalisme : son absence de planification. Si l’Etat pouvait prendre en charge la production et la distribution, on aurait alors une accumulation sans crise.
Quelles qu’aient été les confusions au sein du mouvement ouvrier avant la Révolution russe sur la transition au communisme, ses éléments les plus clairs avaient toujours défendu que le communisme/socialisme ne pourrait être créé qu’à l’échelle mondiale parce que chaque pays, chaque nation capitaliste est inévitablement dominée par le marché mondial ; et la libération des forces productives mises en mouvement par la révolution prolétarienne ne pourra devenir effective que lorsque la tyrannie du capital global aura été renversée dans tous les principaux centres. Contrairement à cette vision, la vision stalinienne du socialisme dans un seul pays pose l’accumulation dans un système clos – quelque chose qui avait été impossible pour le capitalisme classique et n’était pas davantage possible pour un Etat totalement régulé, même si la vaste taille (et l’énorme secteur agricole) de la Russie a permis temporairement un développement autarcique. Mais si, comme insistait Luxemburg, le capitalisme en tant qu’ordre mondial ne peut opérer dans le cadre d’un système fermé, c’est encore moins le cas des capitaux nationaux et l’autarcie stalinienne des années 1930 – basée sur le développement frénétique d’une économie de guerre – fut essentiellement une préparation à son expansion impérialiste militaire inévitable qui s’est réalisée dans le deuxième holocauste impérialiste et les conquêtes qui l’ont suivi.
Entre 1924, moment où Boukharine écrivit son livre et 1929, année du grand krach, le capitalisme connut une phase de stabilité relative et, dans certaines régions, de croissance spectaculaire – avant tout aux Etats-Unis. Mais c’était simplement le calme avant la tempête de la plus grande crise économique que le capitalisme ait jamais connu jusqu’alors.
Dans le prochain article de cette série, nous examinerons certaines des tentatives des révolutionnaires pour comprendre les origines et les implications de cette crise et, surtout, sa signification en tant qu’expression du déclin du mode de production capitaliste.
Gerrard
1 Revue internationale n° 142 [187].
2 Toutes les citations du livre Imperialism and the Accumulation of Capital dans cet article sont traduites de l’anglais par nous.
3 Même si la plupart des positionnements de Boukharine que nous venons d'énoncer l'avaient placé à l'avant-garde marxiste à cette époque, ce n'était pas le cas de son attitude face au traité de Brest-Litovsk. Lire à ce sujet au sein de notre série Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, l'article "La révolution critique ses erreurs [131]" dans la Revue internationale n° 99.
4 Voir l’article "1920 : Boukharine et la période de transition [175]" dans la Revue internationale n° 96.
5 Dans sa biographie de Boukharine, Bukharin and the Bolshevik Revolution, London 1974, Stephen Cohen fait remonter la version initiale de la théorie à la date précoce de 1922.
6 Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, Pluto Press 1989 edition, vol 2 p 458. Traduit de l’anglais par nous.
Comme nous l’avons noté dans un article précédent ("Rosa Luxemburg et les limites de l’expansion du capitalisme", Revue internationale n° 142), Rosdolsky porte aussi des critiques à Luxemburg, mais il n’écarte pas les problèmes qu’elle soulève ; par rapport à la façon dont Boukharine traite les schémas de la reproduction, il défend que si Rosa Luxemburg a fait des erreurs mathématiques, Boukharine également et, de plus, que ce dernier a pris la formulation par Marx du problème de la reproduction élargie pour sa solution : "Boukharine a complètement oublié que la reproduction élargie du capital social global ne mène pas seulement à l’augmentation de c et de v mais également de a, c’est-à-dire l’augmentation de la consommation individuelle des capitalistes. Néanmoins, cette erreur élémentaire est passée inaperçue pendant presque deux décennies, et Boukharine a été généralement considéré comme la plus grande autorité en défense de l’ "orthodoxie" marxiste contre Rosa Luxemburg et ses attaques envers "ces parties de l’analyse de Marx que le maître incomparable nous a transmises comme produit achevé de son génie" (L’impérialisme, p.58, London edition 1972). Néanmoins, la formule générale par Boukharine de l’équilibre est très utile, même si lui aussi (comme beaucoup des critiques de Rosa Luxemburg) a pris la simple formulation du problème pour sa solution". (The Making of Marx’s Capital, p 450) – Traduit de l’anglais par nous.
7 L’Accumulation du Capital. Chapitre Le protectionnisme et l'accumulation.
8 Traduit de l’anglais par nous.
9 https://fr.internationalism.org/rinte29/crise.htm [188]
10 International review n°29. Ce passage a malencontreusement sauté des deux articles mentionnés de la Revue internationale en Français.
11 Trad. Éditions Sociales, tome 5, pp. 73-76.
12 Le Capital, I. I, I° partie, p. 289. Trad. Éditions Sociales, tome 6, p. 314, cité par Luxemburg, L’Accumulation, chapitre XXV.
https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_25.htm [189]
13 Ibid.
14 Traduit de l’anglais par nous. L’Impérialisme, cité par S. Cohen.
15 Le Capital, Livre I, 7e section, chapitre XXIV, III, https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_25.htm [189]
16 Cohen utilise le terme "à première vue" parce qu’il poursuit en disant que ce que Boukharine avait vraiment en tête, était moins l’ancienne controverse avec Tougan que la nouvelle controverse dans le parti russe, entre les "super-industrialistes" (au départ Préobrajensky et l’opposition de gauche, plus tard Staline) qui se centraient sur l’accumulation forcée de moyens de production dans le secteur étatique et son propre point de vue qui (ironiquement, en considérant son rejet de l’importance accordée par Luxemburg à la demande non capitaliste) soulignait continuellement la nécessité de fonder l’expansion de l’industrie étatique sur le développement graduel du marché paysan plutôt que sur une exploitation directe des paysans et le pillage de leurs biens, comme les super-industrialistes le préconisaient de façon choquante.
17 Revue internationale n° 139, "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise [190]".
18 Cela vaut la peine de noter que Grossman critique aussi Boukharine pour ne parler que vaguement des contradictions, sans situer la contradiction essentielle qui mène à l’effondrement du système. Voir Grossman, The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System, London 1992, p 48-9.
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (4e partie)
- 1868 lectures
Nous publions la quatrième et dernière partie du Manifeste (les trois premières parties sont publiées dans les trois numéros précédents de la Revue internationale). Dans celle-ci, il traite deux questions en particulier : d'une part, l'organisation des ouvriers en conseils pour la prise du pouvoir et la transformation de la société ; d'autre part, la nature de la politique oppositionnelle au parti bolchevique menée par d'autres groupes constitués en réaction à la dégénérescence de celui-ci.
Le Manifeste opère clairement la distinction entre le prolétariat organisé en conseils, et les autres couches non exploiteuses de la société qu'il entraine derrière lui : "Où les conseils sont-ils nés ? Dans les usines et dans les fabriques. (…) Les conseils ouvriers se présentent en 1917 comme guides de la révolution, non seulement dans leur substance mais aussi formellement : soldats, paysans, cosaques se subordonnent à la forme organisationnelle du prolétariat". Une fois achevée la guerre civile contre la réaction blanche internationale, c'est encore au prolétariat organisé sur ses bases propres que le Manifeste attribue le rôle de transformation de la société. Dans ce cadre, il accorde une importance de premier ordre à l'organisation autonome de la classe ouvrière qui a été considérablement affaiblie par les années de guerre civile à tel point que : "On ne doit pas parler d'une amélioration des soviets, mais de leur reconstitution. Il faut reconstituer les conseils dans toutes les fabriques et usines nationalisées pour résoudre une nouvelle tâche immense".
Le Manifeste est très critique par rapport à l'activité d'autres groupes d'opposition à la politique du parti bolchevique, en particulier la Vérité Ouvrière et un autre qui n'a pu être identifié autrement que par ses écrits qui sont cités. Le Manifeste dénonce le radicalisme de façade des critiques portées par ces groupes (qu'il qualifie de "libéraux") au Parti bolchevique, à tel point que, selon lui, ce dernier pourrait reprendre à son compte de telles critiques, en plus radical, pour les utiliser comme paravent à sa politique d'étouffement de la liberté de parole du prolétariat. 1
Enfin, l'article rappelle comment se positionne Le Manifeste par rapport au parti bolchevique dont les déficiences menacent de le transformer "en une minorité de détenteurs du pouvoir et des ressources économiques du pays, qui s'entendra pour s'ériger en une caste bureaucratique" : "exercer une influence décisive sur la tactique du PCR, en conquérant la sympathie de larges masses prolétariennes, de façon telle qu'elle contraigne le parti à abandonner sa ligne directrice".
La Nouvelle Politique économique
En fait la Nouvelle Politique économique a partagé l'industrie entre, d'un côté, l'État (les trusts, les syndicats, etc.) et, de l'autre, le capital privé et les coopératives. Notre industrie nationalisée a pris le caractère et les aspects de l'industrie capitaliste privée, dans le sens où elle fonctionne sur la base des besoins du marché.
Depuis le IXe congrès du PCR (bolchevique), l'organisation de la gestion de l'économie est réalisée sans participation directe de la classe ouvrière, à l'aide de nominations purement bureaucratiques. Les trusts sont constitués suivant le même système adopté pour la gestion de l'économie et la fusion des entreprises. La classe ouvrière ne sait pas pourquoi tel ou tel directeur a été nommé, ni pour quel motif une usine appartient à ce trust plutôt qu'à un autre. A cause de la politique du groupe dirigeant du PCR, elle ne prend aucune part à ces décisions.
Il va de soi que l'ouvrier regarde avec inquiétude ce qui se passe. Il se demande souvent comment il a pu en arriver là. Il se souvient fréquemment du moment où est apparu et s'est développé le Conseil des députés ouvriers dans son usine. Il se pose la question : comment a-t-il pu se faire que son soviet, le soviet qu'il avait lui-même institué et auquel ni Marx, ni Engels, ni Lénine ni aucun autre n'avait pensé, comment se fait-il que ce soviet soit mort ? Et d'inquiètes pensées le hantent... Tous les ouvriers se souviennent de la façon dont furent organisés les conseils des députés ouvriers.
En 1905, quand personne encore dans le pays ne parlait de conseils ouvriers et que, dans les livres, il était seulement question de partis, d'associations, de ligues, la classe ouvrière russe réalisa les soviets dans les usines.
Comment ces conseils furent-ils organisés ? Au moment de l'apogée de la montée révolutionnaire, chaque atelier de l'usine élut un député pour présenter ses revendications à l'administration et au gouvernement. Pour coordonner les revendications, ces députés des ateliers se rassemblèrent en conseils et constituèrent ainsi le Conseil des députés.
Où les conseils sont-ils nés ? Dans les usines et dans les fabriques. Les ouvriers des fabriques et des usines, de tout sexe, religion, ethnie, conviction ou métier s'unissent en une organisation où se forme une volonté commune. Le Conseil des députés ouvriers est donc l'organisation des ouvriers des entreprises de production.
C'est de la même manière que sont réapparus les conseils en 1917. Ils sont décrits ainsi dans le programme du PCR(b) : "L'arrondissement électoral et noyau principal de l'État est l'unité de production (la fabrique, l'usine) et non plus le district". Même après la prise du pouvoir, les conseils ont gardé le principe selon lequel leur base est le lieu de production, et c'était leur trait distinctif par rapport à toute autre forme du pouvoir étatique, leur avantage, car une pareille organisation de l'État rapproche l'appareil étatique des masses prolétariennes.
Les conseils des députés ouvriers de toutes les fabriques et usines se réunissent en assemblées générales et forment des conseils de députés ouvriers des villes dirigés par leur Comité exécutif (CE). Les congrès des conseils des provinces et des régions forment des comités exécutifs des conseils provinciaux et régionaux. Enfin, tous les conseils de députés des usines élisent leurs mandataires au Congrès panrusse des conseils en formant une organisation panrusse des conseils de députés ouvriers, son organe permanent étant le Comité exécutif panrusse des conseils de députés ouvriers.
Dès les premiers jours de la Révolution de février, les besoins de la guerre civile ont exigé l'engagement dans le mouvement révolutionnaire de la force armée, par l'organisation de conseils de députés des soldats. Les besoins révolutionnaires du moment leur ont dicté de s'unir, ce qui fut fait. Ainsi se sont formés les conseils de députés ouvriers et de soldats.
Dès que les conseils prirent le pouvoir, ils attirèrent à leurs côtés la paysannerie représentée par les conseils de députés paysans et ensuite des cosaques. Ainsi s'organisa le Comité exécutif central panrusse (CECP) des conseils de députés ouvriers, paysans, de soldats et des cosaques.
Les conseils ouvriers se présentent en 1917 comme guides de la révolution, non seulement dans leur substance mais aussi formellement : soldats, paysans, cosaques se subordonnent à la forme organisationnelle du prolétariat.
Lors de la prise du pouvoir par les conseils, il s'est tout d'un coup révélé que ces conseils, surtout ceux de députés ouvriers, seraient obligés de s'occuper presque entièrement d'une lutte politique contre les anciens esclavagistes qui s'étaient soulevés, fortement appuyés par "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste obscure". Et jusqu'à la fin de 1920, les conseils se sont occupés de l'écrasement de la résistance des exploiteurs.
Au cours de cette période, les conseils perdirent leur caractère lié à la production et déjà, en 1920, le IXe congrès du PCR(b) décréta la direction par un seul des fabriques et des usines. Pour Lénine, cette décision était motivée par le fait que la seule chose qu'on ait bien faite était l'Armée rouge avec une direction unique.
Et où sont-ils maintenant les conseils de députés ouvriers des fabriques et des usines ? Ils n'existent plus et sont complètement oubliés (même si on continue à parler du pouvoir des conseils). Non, il n'y en a plus et nos conseils ressemblent aujourd'hui beaucoup aux maisons communes ou aux zemstvos 2 (avec une inscription au-dessus de la porte : "C'est un lion, pas un chien").
Tout ouvrier sait que les conseils de députés ouvriers avaient organisé une lutte politique pour la conquête du pouvoir. Après avoir pris le pouvoir, ils ont écrasé la résistance des exploiteurs. La guerre civile que les exploiteurs entreprirent contre le prolétariat au pouvoir, avec les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, prit un caractère si intense et si âpre qu'elle engagea à fond la classe ouvrière toute entière ; c'est pourquoi les ouvriers furent éloignés tant des problèmes du pouvoir des soviets que des problèmes de la production pour lesquels ils s'étaient battus jusqu'alors. Ils pensaient : nous gérerons plus tard la production. Pour reconquérir la production, il faut tout d'abord l'arracher aux exploiteurs rebelles. Et ils avaient raison.
Mais fin 1920, la résistance des exploiteurs est anéantie. Le prolétariat, couvert de blessures, usé, souffrant de faim et de froid, va jouir des fruits de ses victoires. Il a repris la production. Et devant lui s'impose la nouvelle tâche immense, à savoir l'organisation de cette production, celle de l'économie du pays. Il faut produire le maximum de biens matériels pour démontrer l'avantage de ce monde prolétarien.
Le sort de toutes les conquêtes du prolétariat est étroitement lié au fait de réussir à s'emparer de la production et de l'organiser.
"La production est l'objectif de la société et c'est pourquoi ceux qui dirigent la production ont gouverné et gouverneront toujours la société".
Si le prolétariat ne réussit pas à se mettre à la tête de la production et à mettre sous son influence toute la masse petite-bourgeoise des paysans, des artisans et des intellectuels corporatistes, tout sera à nouveau perdu. Les fleuves de larmes et de sang, les monceaux de cadavres, les souffrances indicibles du prolétariat pendant la révolution ne serviront que d'engrais au terrain où le capitalisme se restaurera, où s'élèvera le monde d'exploitation, d'oppression d'un homme par son semblable si le prolétariat ne récupère pas la production, ne s'impose pas à l'élément petit-bourgeois personnifié par le paysan et l'artisan, ne change pas la base matérielle de la production.
Les conseils des députés ouvriers, qui forgeaient auparavant la volonté du prolétariat dans la lutte pour le pouvoir, ont triomphé sur le front de la guerre civile, sur le front politique, mais leur triomphe même les a affaiblis au point qu'on ne doit pas parler d'une amélioration des soviets, mais de leur reconstitution.
Il faut reconstituer les conseils dans toutes les fabriques et usines nationalisées pour résoudre une nouvelle tâche immense, pour créer ce monde de bonheur pour lequel tant de sang a coulé.
Le prolétariat est affaibli. La base de sa force (la grande industrie) est dans un état lamentable ; mais plus faibles sont les forces du prolétariat, plus ce dernier doit avoir d'unité, de cohésion, d'organisation. Le Conseil des députés ouvriers est une forme d'organisation qui a montré sa force miraculeuse et a surmonté non seulement les ennemis et les adversaires du prolétariat en Russie, mais a ébranlé aussi la domination des oppresseurs dans le monde entier, la révolution socialiste menaçant toute la société d'oppression capitaliste.
Ces nouveaux soviets, s'ils se portent au sommet dirigeant de la production, de la gestion des usines, seront non seulement capables d'appeler les masses les plus vastes de prolétaires ou semi-prolétaires à la résolution des problèmes qui se posent à elles, mais ils emploieront aussi directement dans la production tout l'appareil étatique, non en paroles mais en actes. Quand, ensuite, le prolétariat aura organisé, pour la gestion des entreprises et des industries, les soviets comme cellules fondamentales du pouvoir étatique, il ne pourra y rester inactif : il passera à l'organisation des trusts, des syndicats et des organes directeurs centraux, y compris les fameux soviets suprêmes pour l'économie populaire, et donnera un nouveau contenu au travail du Comité exécutif central panrusse. Les soviets désigneront comme membres du Comité central panrusse des soviets ceux qui combattirent sur les fronts de la guerre civile, sur le front de l'économie au travail. Naturellement tous les bureaucrates, tous les économistes qui se considèrent les sauveurs du prolétariat (dont ils craignent par-dessus tout la parole et le jugement) de même que tous les gens qui occupent des postes douillets dans les divers organismes, pousseront de hauts cris. Ils soutiendront que cela signifie l'écroulement de la production, la banqueroute de la révolution sociale, parce que beaucoup savent qu'ils doivent leur poste non à leurs capacités, mais à la protection, aux connaissances, aux "bonnes relations", en aucun cas à la confiance du prolétariat, au nom duquel ils administrent. Du reste, ils ont plus peur du prolétariat que des spécialistes, des nouveaux dirigeants d'entreprise et des Slastchovs.
La comédie panrusse avec ses directeurs rouges est orchestrée de façon à pousser le prolétariat à sanctifier la gestion bureaucratique de l'économie et à bénir la bureaucratie ; c'est une comédie également parce que les noms des directeurs de trusts, fortement protégés, n'apparaissent jamais dans la presse en dépit de leur ardent désir de publicité. Toutes nos tentatives pour démasquer un provocateur qui, il n'y a pas si longtemps, recevait de la police tsariste 80 roubles – le salaire le plus élevé pour ce genre d'activité – et qui se trouve maintenant à la tête du trust du caoutchouc, ont rencontré une résistance insurmontable. Nous voulons parler du provocateur tsariste Lechava-Murat (le frère du Commissaire du peuple pour le commerce intérieur, NDLR). Ceci éclaire suffisamment la nature du groupe qui avait imaginé la campagne pour les directeurs rouges.
Le Comité exécutif central panrusse des soviets, qui est élu pour un an et se réunit pour des conférences périodiques, constitue le ferment de la pourriture parlementaire. Et on dit : camarades, si on vient, par exemple, à une réunion où les camarades Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine parlent deux heures sur la situation économique, que peut-on faire d'autre, sinon s'abstenir ou approuver rapidement la résolution proposée par le rapporteur ? Étant donné que le Comité central panrusse ne s'occupe pas d'économie, il écoute de temps en temps quelques exposés sur ce sujet pour se dissoudre ensuite et chacun s'en va de son côté. Il est même arrivé le fait curieux qu'un projet présenté par les commissaires du peuple fût approuvé sans qu'il ait été lu au préalable. Dans quel but faut-il le lire avant de l'approuver ? On ne peut pas être, certes, plus instruit que le camarade Kurski (commissaire à la justice). On a transformé le Comité exécutif panrusse en une simple chambre d'enregistrement des décisions. Et son président ? Il est, avec votre permission, l'organe suprême ; mais eu égard aux tâches qui s'imposent au prolétariat, il est occupé à des broutilles. Il nous semble au contraire que le Comité exécutif central panrusse des soviets devrait plus que tout autre être lié aux masses, et cet organe législatif suprême devrait décider sur les questions les plus importantes de notre économie.
Notre Conseil des commissaires du peuple est, selon l'avis même de son chef, le camarade Lénine, un véritable appareil bureaucratique. Mais il voit les racines du mal dans le fait que les gens qui participent à l'Inspection ouvrière et paysanne sont corrompus et il propose simplement de changer les hommes qui occupent les postes dirigeants ; après ça tout ira mieux. Nous avons ici sous les yeux l'article du camarade Lénine paru dans la Pravda du 15 janvier 1923 : c'est un bel exemple de "politicaillerie". Les meilleurs parmi les camarades dirigeants affrontent en réalité cette question en tant que bureaucrates puisqu'ils voient le mal dans le fait que ce soit Tsiurupa (Rinz) et non Soltz (Kunz) qui préside l'Inspection ouvrière et paysanne. Il nous vient à l'esprit le dicton d'une fable : "Ce n'est pas en vous y obligeant que vous deviendrez musiciens". Ils se sont corrompus sous l'influence du milieu ; le milieu les a rendus bureaucrates. Que l'on change le milieu et ces gens travailleront bien.
Le Conseil des commissaires du peuple est organisé à l'image d'un conseil des ministres de tout pays bourgeois et a tous ses défauts. Il faut cesser de réparer les mesures douteuses qu'il prend ou de le liquider en gardant seulement le Présidium du CECP avec ses différents départements, tout comme on fait dans les provinces, districts et communes. Et transformer le CECP en organe permanent avec des commissions permanentes qui s'occuperaient des questions diverses. Mais pour qu'il ne devienne pas une institution bureaucratique, il faut changer le contenu de son travail et ce ne sera possible qu'au moment où sa base ("le noyau principal du pouvoir d'État"), les conseils des députés ouvriers seront rétablis à toutes les fabriques et usines, où les trusts, les syndicats, les directions des fabriques seront réorganisés sur base d'une démocratie prolétarienne, par les congrès des conseils, du district jusqu'au CECP. Alors on n'aura plus besoin du bavardage sur la lutte contre le bureaucratisme et la chicane. Car on sait bien que ce sont les pires bureaucrates qui critiquent le plus le bureaucratisme.
En réorganisant ainsi les organes dirigeants, en y introduisant les éléments réellement étrangers au bureaucratisme (et cela ira de soi), nous résoudrons effectivement la question qui nous préoccupe dans les conditions de la Nouvelle Politique économique. Alors, ce sera la classe ouvrière qui dirigera l'économie et le pays et non un groupe de bureaucrates qui menace de se transformer en oligarchie.
Quant à l'Inspection ouvrière et paysanne (la Rabkrine) 3, il vaut mieux la liquider que d'essayer d'améliorer son fonctionnement par le changement de ses fonctionnaires. Les syndicats (à travers leurs comités) devront se charger d'un contrôle de toute la production. Nous (l'État prolétarien) n'avons pas à craindre un contrôle prolétarien et ici il n'y a de place pour aucune objection réelle, si ce n'est la crainte même que le prolétariat inspire aux bureaucrates de toute sorte.
Donc il faut comprendre enfin que le contrôle doit être indépendant de celui qui y est soumis ; et pour l'obtenir, les syndicats ont à jouer le rôle de notre Rabkrine ou de l'ancien Contrôle d'État.
Ainsi les noyaux syndicaux locaux dans les usines et fabriques d'État se transformeraient en organes de contrôle.
Les comités des provinces réunis en conseils des syndicats des provinces deviendraient organes du contrôle dans les provinces et de même le Conseil central panrusse des syndicats aurait une telle fonction au centre.
Les conseils dirigent, les syndicats contrôlent, voici l'essence des rapports entre ces deux organisations dans l'État prolétarien.
Dans les entreprises privées (gérées à travers un bail ou une concession), les comités syndicaux jouent le rôle du contrôle étatique, veillant au respect des lois du travail, à l'acquittement des engagements pris par le gérant, le concessionnaire, etc. envers l'État prolétarien.
Quelques mots sur deux groupes
Deux documents que nous avons devant nous, [l'un] signé par un groupe clandestin Le groupe central la Vérité Ouvrière, l'autre ne portant aucune signature, sont une expression frappante de nos errements politiques.
Même les divertissements littéraires innocents que se permettait toujours une partie libérale du PCR (le soi-disant "Centralisme Démocratique"), ne peuvent absolument pas paraître dans notre presse. De tels documents, dénués de fondements théoriques et pratiques, du genre liquidateur comme l'appel du groupe "La Vérité Ouvrière", n'auraient aucune portée en milieu ouvrier s'ils étaient publiés légalement, mais, dans le cas contraire, ils peuvent attirer les sympathies non seulement du prolétariat, mais aussi des communistes.
Le document non signé, réalisé sans doute par les libéraux du PCR, constate justement :
1) Le bureaucratisme de l'appareil des conseils et du parti.
2) La dégénérescence des effectifs du parti.
3) La rupture entre les élites et les masses, la classe ouvrière, les militants de base du parti.
4) La différenciation matérielle entre les membres du parti.
5) L'existence du népotisme.
Comment combattre tout cela ? Il faut, voyez-vous :
1) Réfléchir sur des problèmes théoriques dans un cadre strictement prolétarien et communiste.
2) Assurer, dans le même cadre, une unité idéologique et une éducation de classe aux éléments sains et avancés du parti.
3) Lutter au sein du parti comme condition principale de son assainissement intérieur, l'abolition de la dictature et la mise en pratique de la liberté de discussion.
4) Lutter au sein du parti en faveur de telles conditions du développement des conseils et du parti, ce qui faciliterait l'élimination des forces et d'une influence petite-bourgeoises et affermirait davantage la force et l'influence d'un noyau communiste.
Voilà les idées principales de ces libéraux.
Mais, dites donc, qui du groupe dirigeant du parti s'opposerait à ces propositions ? Personne. Mieux encore, il n'a pas d'égal pour une démagogie de ce genre.
Les libéraux ont toujours servi au groupe dirigeant du parti justement en jouant le rôle des opposants "radicaux" et en dupant ainsi la classe ouvrière et beaucoup de communistes qui ont vraiment de bonnes raisons d'être mécontents. Et leur mécontentement est si grand que, pour le canaliser, les bureaucrates du parti et des conseils ont besoin d'inventer une opposition. Mais ils n'ont pas à se fatiguer, car les libéraux les aident chaque fois avec la grandiloquence qui leur est propre, en répondant à des questions concrètes par des phrases générales.
Qui, parmi le personnel actuel du Comité Central, ira protester contre le point le plus radical ? : "Lutter au sein du parti en faveur de telles conditions du développement des conseils et du parti, ce qui faciliterait l'élimination des forces et de l'influence petite-bourgeoises et affermirait davantage la force et l'influence d'un noyau communiste".
Non seulement ils ne protesteront pas, mais ils formuleront ces propos avec beaucoup plus de vigueur. Regardez le dernier article de Lénine et vous verrez qu'il dit "des choses très radicales" (du point de vue des libéraux) : à l'exception du Commissariat des affaires étrangères, notre appareil d'État est par excellence une survivance du passé qui n'a subi aucune modification sérieuse. Puis il tend la main aux libéraux, promet de les faire entrer aux CC et Commission centrale de Contrôle (CCC) élargis – et ils ne demanderaient pas mieux. Et cela va de soi, dès qu'ils entreront au CC, la paix universelle s'instaurera partout. En pérorant à propos de la libre discussion dans le parti, ils oublient un petit détail – le prolétariat. Car sans la liberté de parole accordée au prolétariat, aucune liberté dans le parti n'était et ne sera possible. Ce serait étrange d'avoir une liberté d'opinion dans le parti et en même temps en priver la classe dont ce parti représente les intérêts. Au lieu de proclamer la nécessité de réaliser les bases de la démocratie prolétarienne selon le programme du parti, ils jasent sur la liberté pour les communistes les plus avancés. Et il ne fait aucun doute que les plus avancés soient Sapronov, Maximovski et Co et si Zinoviev, Kamenev, Staline, Lénine se considèrent les plus avancés, alors ils s'entendront sur le fait qu'ils sont tous "les meilleurs", augmenteront les effectifs du CC et de la CCC et tout ira pour le mieux.
Nos libéraux sont incroyablement… libéraux, et ils demandent tout au plus la liberté d'association. Mais pour quoi faire ? Que veulent-ils nous dire, nous expliquer ? Seulement ce que vous avez écrit en deux petites pages ? Donc à la bonne heure ! Mais si vous feignez d'être un innocent opprimé, un persécuté politique, alors vous duperez ceux qu'il faut duper.
La conclusion de ces thèses est tout à fait "radicale", même "révolutionnaire" : voyez-vous, leurs auteurs voudraient bien que le XIIe congrès du parti fasse sortir du CC un ou deux (quelle audace !) fonctionnaires qui ont le plus contribué à la dégénérescence des effectifs du parti, au développement de la bureaucratie tout en cachant leurs desseins derrière de belles phrases (Zinoviev, Staline, Kamenev).
C'est chic ! Dès qu'au CC Staline, Zinoviev, Kamenev céderont la place à Maximovski, Sapronov, Obolenski, tout ira bien, même très bien. Nous répétons que vous n'avez rien à craindre, camarades libéraux ; au XIIème congrès vous entrerez au CC et, ce qui sera essentiel pour vous, ni Kamenev, ni Zinoviev, ni Staline ne vous en empêcheront. Bonne chance !
Selon ses dires, le groupe La Vérité Ouvrière est composé de communistes.
Comme tous les prolétaires auxquels ils s'adressent, nous les croirions volontiers, mais le problème est que ce sont des communistes d'un type particulier. D'après eux, la signification positive de la révolution russe d'Octobre consiste en ceci qu'elle a ouvert à la Russie des perspectives grandioses d'une transformation rapide en un pays de capitalisme avancé. Comme le prétend ce groupe, c'est sans aucun doute une conquête immense de la révolution d'Octobre.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un appel à revenir en arrière, au capitalisme, en renonçant aux mots d'ordre socialistes de la révolution d'Octobre. Ne pas consolider les positions du socialisme, du prolétariat en tant que classe dirigeante, mais les affaiblir en ne laissant à la classe ouvrière que la lutte pour un sou.
En conséquence, le groupe prétend que les rapports capitalistes classiques sont déjà restaurés. Il conseille donc à la classe ouvrière de se débarrasser "des illusions communistes" et l'invite à combattre le "monopole" du droit de vote par les travailleurs, ce qui veut dire que ceux-ci doivent y renoncer. Mais, messieurs les communistes, permettez-nous de demander en faveur de qui ?
Mais ces messieurs-là ne sont pas des imbéciles au point de dire ouvertement que c'est en faveur de la bourgeoisie. Quelle confiance des prolétaires auraient-ils alors en eux ? Les ouvriers comprendraient tout de suite qu'il s'agit de la même ancienne rengaine des mencheviks, SR et KD 4, ce qui n'entre pas dans les vues du groupe. Pourtant il n'a pas laissé échapper son secret. Car il prétend être attaché à la lutte contre "l'arbitraire administratif", mais "avec réserve": "Autant que c'est possible en l'absence d'institutions législatives élues". Le fait que les travailleurs russes élisent leurs conseils et CE, ce n'est pas une élection, figurez-vous, car une vraie élection doit être effectuée avec la participation de la bourgeoisie et des communistes de La Vérité Ouvrière, et pas celle des travailleurs. Comme tout cela est "communiste" et "révolutionnaire" ! Pourquoi, chers "communistes", vous arrêtez-vous à mi-chemin et n'expliquez-vous pas qu'il faudrait le droit de vote général, égal, direct et secret, celui qui est propre aux rapports capitalistes normaux ? Que ce serait une véritable démocratie bourgeoise ? Voulez-vous pêcher en eau trouble ?
Messieurs les communistes, espérez-vous dissimuler vos desseins réactionnaires et contre-révolutionnaires en répétant sans cesse le mot "révolution" ? Au cours des six dernières années, la classe ouvrière de Russie a vu suffisamment d'ultra-révolutionnaires pour comprendre votre intention de la duper. La seule chose qui pourrait vous faire obtenir gain de cause, c'est l'absence d'une démocratie prolétarienne, le silence imposé à la classe ouvrière.
Nous laissons de côté d'autres propos démagogiques de ce groupe, en notant seulement que le mode de pensée de cette "Vérité Ouvrière" est emprunté à A. Bogdanov.
Le Parti
Il ne fait aucun doute que, même maintenant, le PCR(b) est le seul parti qui représente les intérêts du prolétariat et de la population laborieuse russe qui se range de se son côté. Il n'y en a pas d'autre. Le programme et les statuts du parti sont l'ultime expression d'une pensée communiste. À partir du moment où le PCR organisa le prolétariat en vue de l'insurrection et de la prise du pouvoir, à partir de ce moment-là, il devint un parti de gouvernement et fut, durant la rude guerre civile, la seule force capable d'affronter les vestiges du régime absolutiste et agraire, les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks. Durant ces trois années de lutte, les organes dirigeants du parti ont assimilé des méthodes de travail adaptées à une guerre civile terrible mais qu'ils étendent maintenant à une phase toute nouvelle de la révolution sociale et dans laquelle le prolétariat avance des revendications tout-à-fait différentes.
De cette contradiction fondamentale découlent toutes les déficiences du parti et du mécanisme des soviets. Ces déficiences sont si graves qu'elles menacent d'annuler tout ce que le travail du PCR a produit de bon et d'utile. Mais plus encore, elles risquent d'anéantir ce parti en tant que parti d'avant-garde de l'armée prolétarienne internationale ; elles menacent – à cause des rapports actuels avec la N.E.P. – de transformer le parti en une minorité de détenteurs du pouvoir et des ressources économiques du pays, qui s'entendra pour s'ériger en une caste bureaucratique.
Ce n'est que le prolétariat lui-même qui peut réparer ces défauts de son parti. Il a beau être faible et ses conditions de vie ont beau être difficiles, il aura cependant assez de force pour réparer son bateau naufragé (son parti) et atteindre enfin la Terre promise.
On ne peut plus soutenir aujourd'hui qu'il soit vraiment nécessaire que le régime interne du parti continue à appliquer la méthode valable au temps de la guerre civile. C'est pourquoi, pour défendre les buts du parti, il faut s'efforcer – même si c'est à contrecœur – d'utiliser des méthodes qui ne sont pas celles du parti.
Dans la situation actuelle, il est objectivement indispensable de constituer un Groupe Ouvrier Communiste, qui ne soit pas lié organiquement au PCR, mais qui en reconnaisse pleinement le programme et les statuts. Un tel groupe est en train de se développer malgré l'opposition obstinée du parti dominant, de la bureaucratie des soviets et des syndicats. La tâche de ce groupe consistera à exercer une influence décisive sur la tactique du PCR, en conquérant la sympathie de larges masses prolétariennes, de façon telle qu'elle contraigne le parti à abandonner sa ligne directrice.
Conclusion
1. Le mouvement du prolétariat de tous les pays, surtout de ceux du capitalisme avancé, a atteint la phase de la lutte pour abolir l'exploitation et l'oppression, la lutte de classe pour le socialisme.
Le capitalisme menace de plonger toute l'humanité dans la barbarie. La classe ouvrière se doit de remplir sa mission historique et de sauver le genre humain.
2. L'histoire de la lutte des classes montre explicitement que, dans des situations historiques différentes, les mêmes classes prêchèrent soit la guerre civile, soit la paix civile. La propagande de la guerre civile et de la paix civile par la même classe, fut soit révolutionnaire et humaine, soit contre-révolutionnaire et strictement égoïste, défendant les intérêts d'une classe concrète à l'encontre des intérêts de la société, de la nation, de l'humanité.
Seul le prolétariat est toujours révolutionnaire et humain, qu'il prône la guerre ou la paix civiles.
3. La révolution russe donne des exemples frappants sur comment les différentes classes se transformèrent de partisanes de la guerre civile en partisanes de la paix civile et vice versa.
L'histoire de la lutte des classes en général et celle des 20 dernières années en Russie en particulier nous enseignent que les classes dirigeantes actuelles qui prônent la paix civile prôneront la guerre civile, impitoyable et sanglante, dès que le prolétariat prendra le pouvoir ; on peut dire la même chose des "fractions bourgeoises ayant une phraséologie socialiste obscure", des partis de la IIe Internationale et de ceux de l'Internationale II ½.
Dans tous les pays du capitalisme avancé, le parti du prolétariat doit, avec toute sa force et sa vigueur, prôner la guerre civile contre la bourgeoisie et ses complices – et la paix civile partout où le prolétariat triomphe.
4. Dans les conditions actuelles, la lutte pour un sou et pour une diminution de la journée de travail à travers les grèves, le Parlement etc. a perdu son ancienne portée révolutionnaire et ne fait qu'affaiblir le prolétariat, le détourner de sa tâche principale, ranimer les illusions sur une possibilité d'améliorer ses conditions au sein de la société capitaliste. Il faut soutenir les grévistes, aller au Parlement, non pour prôner une lutte pour un sou, mais pour organiser des forces prolétariennes en vue d'un combat décisif et final contre le monde de l'oppression.
5. La discussion de la question d'un "front unique" à la façon militaire (comme on en discute tous les aspects en Russie) et la conclusion singulière qui lui a été donnée n'ont pas permis, jusqu'ici, d'aborder sérieusement ce problème, car [dans le contexte actuel] il est tout à fait impossible de critiquer quoi que ce soit.
La référence à l'expérience de la révolution russe ne vaut que pour les ignorants et n'est confirmée d'aucune façon par cette même expérience tant que celle-ci demeure fixée dans les documents historiques (les résolutions des congrès, des conférences etc.).
La vision marxiste et dialectique des problèmes de la lutte de classe y est substituée par une vision dogmatique.
L'expérience d'une époque concrète avec ses buts et tâches est automatiquement transportée à une autre qui a des traits particuliers qui lui sont propres, ce qui conduit inévitablement à imposer, aux partis communistes du monde entier, une tactique opportuniste du "front unique". La tactique du "front unique" avec la IIe Internationale et l'Internationale II ½ contredit totalement l'expérience de la révolution russe et le programme du PCR(b). C'est une tactique d'entente avec des ennemis ouverts de la classe ouvrière.
Il faut former un front unique avec toutes les organisations révolutionnaires de la classe ouvrière qui sont prêtes (aujourd'hui et non "un jour ou l'autre") à lutter pour la dictature du prolétariat, contre la bourgeoisie et ses fractions.
6. Les thèses du CC de l'Internationale Communiste sont un déguisement classique de la tactique opportuniste par des phrases révolutionnaires.
7. Ni les thèses, ni les discussions menées dans les congrès de l'Internationale Communiste n'ont abordé la question du front unique dans les pays qui ont accompli la révolution socialiste et dans lesquels la classe ouvrière exerce la dictature. Cela est dû au rôle que le parti communiste russe assume dans l'Internationale et dans la politique interne de la Russie. La particularité de la question du "front unique" dans de tels pays tient au fait qu'elle est résolue de façons diverses au cours des différentes phases du processus révolutionnaire : dans la période de répression de la résistance des exploiteurs et de leurs complices, une certaine solution est valable, une autre s'impose au contraire quand les exploiteurs sont déjà battus et que le prolétariat a progressé dans la construction de l'ordre socialiste, même avec l'aide de la N.E.P. et les armes à la main.
8. La question nationale. Les nominations arbitraires multiples, la négligence d'une expérience locale, l'imposition des tuteurs et les exils ("les permutations planifiées"), tout ce comportement du groupe dirigeant du PCR(b) envers les partis nationaux des pays adhérents à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a aggravé, dans les masses laborieuses de la plupart des petites ethnies, des tendances chauvines qui pénètrent les partis communistes.
Pour se débarrasser une fois pour toutes de ces tendances, il faut réaliser les principes de la démocratie prolétarienne dans le domaine de l'organisation des partis communistes nationaux, chacun dirigé par son CC, adhérant à la IIIe Internationale Communiste, au même titre que le PCR(b) et en y formant une section autonome. Pour résoudre des tâches communes, les partis communistes des pays de l'URSS doivent convoquer leur congrès périodique qui élit un comité exécutif permanent des partis communistes de l'URSS.
9. La N.E.P est une conséquence directe de l'état des forces productives de notre pays. Il faut l'utiliser pour maintenir les positions du prolétariat conquises en Octobre.
Même dans le cas d'une révolution dans un des pays capitalistes avancés, la N.E.P serait une phase de la révolution socialiste dont il est impossible de se passer. Si la révolution avait éclaté dans un des pays du capitalisme avancé, cela aurait eu une influence sur la durée et le développement de la N.E.P.
Mais dans tous les pays du capitalisme avancé, la nécessité d'une Nouvelle Politique économique, à un certain stade de la révolution prolétarienne, dépendra du degré d'influence du mode petit-bourgeois de production par rapport à celle de l'industrie socialisée.
10. L'extinction de la N.E.P. en Russie est liée à la mécanisation rapide du pays, à la victoire des tracteurs sur les charrues en bois. Sur ces bases de développement des forces productives s'institue un nouveau rapport réciproque entre les villes et les campagnes. Compter sur l'importation de machines étrangères pour les besoins de l'économie agricole n'est pas juste. Ceci est politiquement et économiquement nocif dans la mesure où cela lie notre économie agricole au capital étranger et affaiblit l'industrie russe.
La production des machines nécessaires en Russie est possible, cela renforcera l'industrie et soudera la ville et la campagne d'une façon organique, fera disparaître l'écart matériel et idéologique entre elles et formera bientôt des conditions qui permettront de renoncer à la N.E.P.
11. La Nouvelle Politique économique contient des menaces terribles pour le prolétariat. Hormis le fait que, à travers elle, la révolution socialiste subit un examen pratique de son économie, en dehors du fait que nous devons démontrer en pratique les avantages des formes socialistes de la vie économique par rapport aux formes capitalistes – à part tout cela, il faut se tenir aux positions socialistes sans devenir une caste oligarchique qui s'emparerait de tout le pouvoir économique et politique et aurait peur de la classe ouvrière plus que de toute autre chose.
Pour empêcher de transformer la Nouvelle Politique économique en "Nouvelle Exploitation du Prolétariat", il faut que le prolétariat participe directement à la résolution des tâches immenses qui se posent à lui en ce moment, sur base des principes d'une démocratie prolétarienne ; ce qui donnera à la classe ouvrière la possibilité de mettre ses conquêtes d'Octobre à l'abri de tous les dangers, d'où qu'ils viennent, et de modifier radicalement le régime intérieur du parti et ses rapports avec celui-ci.
12. La réalisation du principe de la démocratie prolétarienne doit correspondre aux tâches fondamentales du moment.
Après la résolution des tâches politico-militaires (prise du pouvoir et répression de la résistance des exploiteurs), le prolétariat est amené à résoudre la tâche la plus difficile et importante : la question économique de la transformation des vieux rapports capitalistes en nouveaux rapports socialistes. C'est seulement après l'accomplissement d'une telle tâche qu'un prolétariat peut se considérer vainqueur, sinon tout aura été vain encore une fois, et le sang et les morts serviront seulement de fumier à la terre sur laquelle continuera à s'élever l'édifice de l'exploitation et de l'oppression, la domination bourgeoise.
Pour accomplir cette tâche, il est absolument nécessaire que le prolétariat participe réellement à la gestion de l'économie. "Qui se trouve au sommet de la production se trouve également au sommet de la ‘société' et de l'l'État'".
Il est donc nécessaire :
que dans toutes les fabriques et les entreprises se constituent les conseils des délégués ouvriers ;
que les congrès des conseils élisent les dirigeants des trusts, des syndicats et les autorités centrales ;
que l'Exécutif panrusse soit transformé en un organe qui gère l'agriculture et l'industrie. Les tâches qui s'imposent au prolétariat doivent être abordées avec en vue l'actualité de la démocratie prolétarienne. Celle-ci doit s'exprimer dans un organe qui travaille de façon assidue et institue en son sein des sections et des commissions permanentes prêtes à affronter tous les problèmes. Mais le Conseil des commissaires du peuple qui est la copie d'un quelconque conseil des ministres bourgeois doit être aboli et son travail confié au Comité exécutif panrusse des soviets.
Il est nécessaire, en outre, que l'influence du prolétariat soit renforcée sur d'autres plans. Les syndicats, qui doivent être une véritable organisation prolétarienne de classe, doivent en tant que tels se constituer en organes de contrôle ayant le droit et les moyens pour effectuer l'inspection ouvrière et paysanne. Les comités d'usine et d'entreprise doivent remplir une fonction de contrôle dans les usines et les entreprises. Les sections dirigeantes des syndicats qui sont unies dans l'Union dirigeante centrale doivent contrôler les directions tandis que les directions des syndicats réunies dans une Union centrale panrusse, doivent être les organes de contrôle au centre.
Mais les syndicats accomplissent aujourd'hui une fonction qui ne leur revient pas dans l'État prolétarien, ce qui fait obstacle à leur influence et contraste avec le sens de leurs positions au sein du mouvement international.
Celui qui a peur devant un tel rôle des syndicats témoigne de sa peur devant le prolétariat et perd tout lien avec lui.
13. Sur le terrain de l'insatisfaction profonde de la classe ouvrière, divers groupes se forment qui se proposent d'organiser le prolétariat. Deux courants : la plate-forme des libéraux du Centralisme Démocratique et celle de Vérité Ouvrière témoignent, d'un côté, d'un manque de clarté politique, de l'autre, de l'effort de se relier à la classe ouvrière. La classe ouvrière cherche une forme d'expression à son insatisfaction.
L'un et l'autre groupes, auxquels appartiennent très probablement des éléments prolétariens honnêtes, jugeant insatisfaisante la situation actuelle, se dirigent vers des conclusions erronées (de type menchevique).
14. Il persiste dans le parti un régime qui est nocif aux rapports du parti avec la classe prolétarienne et qui, pour le moment, ne permet pas de soulever des questions qui soient, d'une quelconque façon, gênantes pour le groupe dirigeant le PCR (b). De là provient la nécessité de constituer le Groupe ouvrier du PCR (b) sur la base du programme et des statuts du PCR, afin d'exercer une pression décisive sur le groupe dirigeant du parti lui-même.
Nous faisons appel à tous les éléments prolétariens authentiques (également à ceux du Centralisme démocratique et de Vérité Ouvrière, d'Opposition ouvrière) et à ceux qui se trouvent à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur du parti, afin qu'ils s'unissent sur la base du Manifeste du Groupe ouvrier du PCR(b).
Plus vite ils reconnaîtront la nécessité de s'organiser, moindres seront les difficultés que tous nous devrons surmonter.
En avant, camarades !
L'émancipation des ouvriers est l'œuvre des ouvriers eux-mêmes !
Moscou, février 1923.
Le Bureau central provisoire d'organisation du Groupe ouvrier du PCR (b).
1 Nous conseillons au lecteur de replacer cette question de l'activité des groupes critiqués par Le Manifeste dans le contexte plus large que nous lui donnons dans l'article "La gauche communiste en Russie" des Revues internationales n° 8 (lire en particulier ce qui concerne le groupe Centralisme démocratique) et n° 9 (lire en particulier ce qui concerne le groupe Vérité Ouvrière)
2 Assemblée provinciale de la Russie impériale représentant, avant leur abolition par le pouvoir soviétique, la noblesse locale et les riches artisans et commerçants (source Wikipédia). NDLR
3 Organisme qui avait en principe pour responsabilité de contrôler le bon fonctionnement de l'État et de lutter contre sa bureaucratisation mais qui était devenu à son tour une caricature de bureaucratie.
4 SR : Socialistes révolutionnaires. KD : Constitutionnels démocrates. NDLR
Géographique:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
Revue Internationale n° 146 - 3e trimestre 2011
- 3104 lectures
La mobilisation des indignés en Espagne et ses répercussions dans le monde : un mouvement porteur d'avenir
- 76 lectures
Le Mouvement "15M" en Espagne – dont le nom correspond à la date de sa création, le 15 mai – est un événement de grande importance aux caractéristiques inédites. Nous voulons dans cet article en raconter les épisodes marquants et, à chaque fois, tirer les leçons et tracer les perspectives pour le futur.
Rendre compte de ce qui s’est réellement passé est une contribution nécessaire à la compréhension de la dynamique que prend la lutte de classes internationale vers des mouvements massifs de la classe ouvrière, qui l’aideront à reprendre confiance en elle et lui donneront les moyens de présenter une alternative à cette société moribonde 1.
Le "No Future" du capitalisme, toile de fond du Mouvement 15M
Le mot "crise" contient une connotation dramatique pour des millions de personnes, frappées par une avalanche de misère qui va de détérioration croissante des conditions de vie, en passant par le chômage à durée indéterminée et la précarité qui rendent impossible la moindre stabilité quotidienne, jusqu’aux situations les plus extrêmes qui renvoient directement à la grande pauvreté et à la faim 2.
Mais ce qui est le plus angoissant est l’absence de futur. Comme le dénonçait l’Assemblée des Emprisonnés de Madrid 3 dans un communiqué qui, comme nous allons le voir, fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres du mouvement : "nous nous trouvons face à un horizon privé du moindre espoir et sans un futur qui nous permette de vivre tranquilles et de pouvoir nous consacrer à ce qui nous plaît" 4. Lorsque l’OCDE nous déclare qu’il faudra 15 ans pour que l’Espagne retrouve le niveau d’emploi qu’elle avait en 2007 – presque une génération entière privée de travail ! –, lorsque des chiffres similaires peuvent être extrapolés pour les États-Unis ou la Grande-Bretagne, on peut réaliser à quel point cette société est précipitée dans un tourbillon sans fin de misère, de chômage et de barbarie.
Le mouvement s’est, à première vue, polarisé contre le système politique bipartite dominant en Espagne (deux partis, à droite le Parti Populaire et à gauche le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui représentent 86 % des élus) 5. Ce facteur a joué un rôle, en rapport précisément avec cette absence d’avenir, puisque dans un pays où la droite jouit de la réputation méritée d’être d’autoritaire, arrogante et anti-ouvrière, d’amples secteurs de la population ont vu avec inquiétude comment, avec les attaques gouvernementales portées par les faux-amis – le PSOE –, les ennemis déclarés – le PP – menaçaient de s’installer au pouvoir pour de longues années, sans alternative aucune au sein du jeu électoral, reflétant ainsi le blocage général de la société.
Ce sentiment a été renforcé par l’attitude des syndicats qui commencèrent par convoquer une "grève générale" le 29 septembre, qui ne fut qu’une gesticulation démobilisatrice, puis signèrent avec le gouvernement un Pacte social en janvier 2011 qui acceptait la brutale réforme des retraites et fermait la porte à toute possibilité de mobilisations massives sous leur direction.
A ces facteurs s'est joint un profond sentiment d’indignation. Une des conséquences de la crise, comme cela fut dit dans l’assemblée de Valence, c’est que "les rares qui possèdent beaucoup sont encore plus rares et possèdent beaucoup plus, alors que le grand nombre qui possède peu est beaucoup plus nombreux et possède beaucoup moins". Les capitalistes et leur personnel politique se font de plus en plus arrogants, voraces et corrompus. Ils n’hésitent pas à accumuler d’immenses richesses, alors qu’autour d’eux se répandent la misère et la désolation. Tout cela fait comprendre, bien plus aisément qu'une démonstration, que les classes sociales existent et que nous ne sommes pas des "citoyens égaux".
Dès la fin de 2010, face à cette situation, des collectifs ont surgi, affirmant qu’il fallait s’unir dans la rue, agir en marge des partis et des syndicats, s’organiser en assemblées… La vieille taupe évoquée par Marx préparait dans les entrailles de la société une maturation souterraine qui éclata en plein jour au mois de mai ! La mobilisation de "Jeunes Sans Avenir" au mois d’avril regroupa 5 000 jeunes à Madrid. Par ailleurs, le succès de manifestations de jeunes au Portugal – Geração à Rasca (génération à la dérive) – qui rassemblèrent plus de 200 000 personnes, et l’exemple très populaire de la place Tahrir en Égypte ont fait partie des stimulateurs du mouvement.
Les assemblées : un premier regard vers l’avenir
Le 15 mai, un cartel de plus de 100 organisations – baptisé Democracia Real Ya (DRY) 6 – convoqua des manifestations dans les grandes villes de province "contre les politiciens", réclamant une "véritable démocratie".
De petits groupes de jeunes (chômeurs, précaires et étudiants), en désaccord avec le rôle de soupape du mécontentement social que les organisateurs voulaient faire jouer au mouvement, tentèrent de mettre en place un campement sur la place centrale à Madrid, à Grenade et autres villes afin de poursuivre le mouvement. DRY les désavoua et laissa les troupes policières se livrer à une brutale répression, perpétrée en particulier dans les commissariats. Cependant, ceux qui en ont été victimes se constituèrent en Assemblée des Emprisonnés de Madrid et produisirent rapidement un communiqué dénonçant clairement les traitements dégradants infligés par la police. Celui-ci fit forte impression et encouragea de nombreux jeunes à se joindre aux campements.
Le mardi 17 mai, alors que DRY tentait d’enfermer les campements dans un rôle symbolique de protestation, l’énorme masse qui affluait vers eux imposa la tenue d’assemblées. Le mercredi et le jeudi, les assemblées massives se répandaient dans plus de 73 villes. Il s’y exprimait des réflexions intéressantes, des propositions judicieuses, traitant de tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Rien de ce qui est humain n’était étranger à cette immense agora improvisée !
Une manifestante madrilène disait : "ce qu’il y a de mieux c’est les assemblées, la parole se libère, les gens se comprennent, on peut penser à haute voix, des milliers d’inconnus peuvent parvenir à être d’accord. N’est-ce pas merveilleux ?". Les assemblées étaient un tout autre monde, à l’opposé de l’ambiance sombre qui règne dans les bureaux de vote et à cent lieues de l’enthousiasme de marketing des périodes électorales : "Accolades fraternelles, cris d'enthousiasme et de ravissement, chants de liberté, rires joyeux, gaieté et transports de joie : c'était tout un concert qu'on entendait dans cette foule de milliers de personnes allant et venant à travers la ville du matin au soir. Il régnait une atmosphère d'euphorie ; on pouvait presque croire qu'une vie nouvelle et meilleure commençait sur la terre. Spectacle profondément émouvant et en même temps idyllique et touchant" 7. Des milliers de personnes discutaient passionnément dans une ambiance de profond respect, d’ordre admirable, d’écoute attentive. Elles étaient unies par l’indignation et l’inquiétude face au futur mais, surtout, par la volonté de comprendre ses causes ; de là cet effort pour le débat, pour l’analyse d’une foule de questions, les centaines de réunions et la création de bibliothèques de rue… Un effort apparemment sans résultat concret, mais qui a bouleversé tous les esprits et a semé des graines de conscience dans les champs de l’avenir.
Subjectivement, la lutte de classe repose sur deux piliers : d’une part la conscience, de l’autre, la confiance et la solidarité. Sur ce dernier aspect, les assemblées ont aussi été porteuses pour l’avenir : les liens humains qui se tissaient, le courant d’empathie qui animait les places, la solidarité et l’unité qui fleurissaient avaient au moins autant d’importance que le fait de prendre des décisions ou de converger sur une revendication. Les politiciens et la presse enrageaient, eux qui réclamaient, avec l’immédiatisme et l’utilitarisme caractéristiques de l’idéologie bourgeoise, que le mouvement condense ses revendications dans un "protocole", ce que DRY tentait de convertir en "décalogue" regroupant toutes les mesures démocratiques ridicules et poussives telles que les listes des candidats ouvertes, les initiatives législatives populaires et la réforme de la loi électorale.
La résistance acharnée à laquelle se heurtèrent ces mesures précipitées est venue illustrer en quoi le mouvement exprimait le devenir de la lutte de classes. A Madrid, les gens criaient : "Nous n’allons pas lentement, c’est que nous allons très loin !". Dans une Lettre ouverte aux assemblées, un groupe de Madrid disait : "Le plus difficile est de synthétiser ce que veulent nos manifestations. Nous sommes convaincus que ce n’est pas à la légère, comme le veulent de façon intéressée les politiciens et tous ceux qui veulent que rien ne change ou, pour mieux dire, ceux qui veulent changer quelques détails pour que tout reste identique. Que ce ne sera pas en proposant soudain un "Grenelle de revendications" que nous parviendrons à synthétiser ce pourquoi nous luttons, ce n’est pas en créant un petit tas de revendications que notre révolte s’exprimera et se renforcera" 8.
L’effort pour comprendre les causes d’une situation dramatique et d’un futur incertain, et trouver la façon de lutter en conséquence, a constitué l’axe des assemblées. D'où leur caractère délibératif qui a désorienté tous ceux qui espéraient une lutte centrée sur des revendications précises. L’effort de réflexion sur des thèmes éthiques, culturels, artistiques et littéraires (il y eut des interventions sous forme de chansons ou de poèmes) a créé le sentiment trompeur d’un mouvement petit-bourgeois "d’indignés". Nous devons ici séparer le bon grain de l’ivraie. Cette dernière est bien sûr présente dans la coquille démocratique et citoyenne qui a souvent enveloppé ces préoccupations. Mais celles-ci sont du bon grain, car la transformation révolutionnaire du monde s’appuie, et à la fois le stimule, sur un gigantesque changement culturel et éthique ; "changer le monde et changer la vie en nous transformant nous-mêmes", telle est la devise révolutionnaire que Marx et Engels formulèrent dans l’Idéologie allemande voilà plus d’un siècle et demi : "... Une transformation massive des hommes s'avère nécessaire pour la création en masse de cette conscience communiste, comme aussi pour mener la chose elle-même à bien ; or, une telle transformation ne peut s'opérer que par un mouvement pratique, par une révolution ; cette révolution n'est donc pas seulement rendue nécessaire parce qu'elle est le seul moyen de renverser la classe dominante, elle l'est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l'autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles" 9.
Les assemblées massives ont été une première tentative de réponse à un problème général de la société que nous avons mis en évidence il y a plus de 20 ans : la décomposition sociale du capitalisme. Dans les "Thèses sur la décomposition" que nous avions alors écrites 10, nous signalons la tendance à la décomposition de l'idéologie et des superstructures de la société capitaliste et, allant de pair avec celle-ci, la dislocation croissante des relations sociales qui affecte aussi bien la bourgeoisie que la petite bourgeoisie. La classe ouvrière n'y échappe pas du fait, entre autres, qu'elle côtoie la petite bourgeoisie. Nous mettions en garde dans ce document contre les effets de ce processus : "1) 'l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le 'chacun pour soi', la 'débrouille individuelle' ; 2) le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société ; 3) la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le 'no future' ; 4) la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque."
Cependant, ce que montrent les assemblées massives en Espagne – de même que ce qu'ont mis en évidence celles qui sont apparues durant le mouvement des étudiants en France en 2006 11 - c'est que les secteurs les plus vulnérables aux effets de la décomposition – les jeunes, les chômeurs, du fait en particulier du peu d'expérience du travail qu'il ont acquis – se sont retrouvés à l'avant-garde des assemblées et de l'effort de prise de conscience d'une part, de solidarité et d'empathie d'autre part.
Pour toutes ces raisons, les assemblées massives ont constitué une première anticipation de ce qui est devant nous. Cela peut paraître très peu à ceux qui attendent que le prolétariat, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, se manifeste clairement et sans ambages comme la classe révolutionnaire de la société. Cependant, d’un point de vue historique et en prenant en compte les difficultés énormes qu’il rencontre pour atteindre cet objectif, il s’agit là d’un bon début, puisqu’il a commencé à préparer rigoureusement le terrain subjectif.
Paradoxalement, ces caractéristiques ont aussi été le talon d’Achille du mouvement "15M" tel qu'il s'est exprimé dans une première étape de son développement. N’ayant pas surgi avec un objectif concret, la fatigue, la difficulté pour aller au-delà de premières approximations des graves problèmes qui se posent, l’absence de conditions pour que le prolétariat entre en lutte depuis les lieux de travail, ont plongé le mouvement dans une sorte de vide et de terrain vague qui ne pouvait se maintenir longtemps en l'état, et que DRY a tenté d'investir avec ses objectifs de "réforme démocratique" soi-disant "faciles" et "réalisables" mais qui ne sont qu’utopiques et réactionnaires.
Les pièges que le mouvement a dû affronter
Pendant presque deux décennies, le prolétariat mondial a réalisé une traversée du désert caractérisée par l’absence de luttes massives et, surtout, par une perte de confiance en lui-même et une perte de sa propre identité de classe 12. Même si cette atmosphère est allée en se diluant progressivement depuis 2003, avec l’apparition de luttes significatives dans bon nombre de pays et d’une nouvelle génération de minorités révolutionnaires, l’image stéréotypée d’une classe ouvrière "qui ne bouge pas", "complètement absente", continuait de dominer.
L’irruption soudaine de grandes masses dans l’arène sociale devait être entravée par ce poids du passé, difficulté accrue par la présence dans le mouvement de couches sociales en voie de prolétarisation, plus vulnérables aux pièges démocratique et citoyen. À cela s'est ajouté le fait que le mouvement n'ayant pas surgi à partir de la lutte contre une mesure concrète, il en a résulté un paradoxe, qui n’est pas nouveau dans l’histoire 13, à savoir que les deux grandes classes de la société – le prolétariat et la bourgeoisie – ont semblé esquiver le corps à corps ouvert, donnant ainsi l’impression d’un mouvement pacifique, jouissant de "l’approbation de tous" 14.
Mais en réalité, la confrontation entre les classes était présente dès les premiers jours. Le gouvernement PSOE ne répliqua-t-il pas d’emblée par la répression brutale contre une poignée de jeunes ? N’est-ce pas la réponse rapide et passionnée de l’Assemblée des Emprisonnés de Madrid qui déchaîna le mouvement ? N’est-ce pas cette dénonciation qui ouvrit les yeux à bien des jeunes qui, dès lors, scandèrent "ils l'appellent démocratie mais ce n’en est pas une !", mot d’ordre ambigu qui fut transformé par une minorité en "ils la nomment dictature et c’en est une !" ?
Pour tous ceux qui pensent que la lutte de classes est une succession "d’émotions fortes", l’aspect "paisible" que revêtaient les assemblées les a poussés à croire que celles-ci n’étaient rien de plus que l’exercice d’un "inoffensif droit constitutionnel", peut-être même beaucoup de participants croyaient-ils que leur mouvement se limitait à cela.
Cependant, les assemblées massives sur la place publique, le mot d’ordre "Prends la place !", expriment un défi en règle à l’ordre démocratique. Ce que déterminent les rapports sociaux et que sanctifient les lois, c’est que la majorité exploitée s’occupe de "ses affaires" et, si elle veut "participer" aux affaires publiques, elle utilise le vote et la protestation syndicale qui l’atomisent et l’individualisent davantage encore. S’unir, vivre la solidarité, discuter collectivement, commencer à agir en tant que corps social indépendant, sont de fait une violence irrésistible contre l’ordre bourgeois.
La bourgeoisie a fait l’impossible pour en finir avec les assemblées. Pour la vitrine, avec l’écœurante hypocrisie qui la caractérise, ce n’étaient que louanges et clins d’œil complices vers les Indignés, mais les faits – qui sont ce qui compte réellement – démentaient cette apparente complaisance.
A cause de la proximité de la journée électorale – le dimanche 22 mai –, l’Assemblée électorale centrale décida d’interdire les assemblées dans tout le pays le samedi 21, considéré comme un "jour de réflexion". Dès samedi à 0 heure, un énorme déploiement policier encercle le campement de la Puerta del Sol, mais il est à son tour encerclé par une foule gigantesque, qui oblige le ministre de l’Intérieur lui-même à ordonner le repli. Plus de 20 000 personnes occupent alors la place dans une grande explosion de joie. Nous voyons là un autre épisode de confrontation de classe, même si la violence explicite s’est réduite à quelques algarades.
DRY propose de maintenir les campements tout en gardant le silence afin de respecter la "journée de réflexion", donc de ne pas tenir d’assemblées. Mais personne ne l’écoute, et les assemblées du samedi 21, formellement illégales, enregistrent les plus hauts niveaux d’assistance. Dans l’assemblée de Barcelone, des panneaux, des slogans repris en chœur et des pancartes proclament ironiquement en réponse à l’Assemblée électorale : "Nous réfléchissons !".
Le dimanche 22, jour d’élections, a lieu une nouvelle tentative d’en finir avec les assemblées. DRY proclame que "les objectifs sont atteints" et que le mouvement doit s’achever. La riposte est unanime : "Nous ne sommes pas ici pour les élections !". Lundi 23 et mardi 24, tant en nombre de participants que par la richesse des débats, les assemblées atteignent leur point culminant. Les interventions, les mots d’ordre, les pancartes prolifèrent qui démontrent une profonde réflexion : "Où se trouve la gauche ? Au fond à droite !", "Les urnes ne peuvent contenir nos rêves !", "600 euros par mois, ça c’est de la violence !", "Si vous ne nous laissez pas rêver, nous vous empêcheront de dormir !", "Sans travail, sans logement, sans peur !", "Ils ont trompé nos grands-parents, ils ont trompé nos enfants, qu’ils ne trompent pas nos petits-enfants !". Ils démontrent aussi une conscience des perspectives : "Nous sommes le futur, le capitalisme c’est le passé !", "Tout le pouvoir aux assemblées !", "Il n’y a pas d’évolution sans révolution !", "Le futur commence maintenant !", "Tu crois encore que c’est une utopie ?"…
A partir de ce sommet, les assemblées commencent à décliner. En partie à cause de la fatigue, mais aussi au bombardement incessant de DRY pour faire adopter son "Décalogue démocratique". Les points du décalogue sont loin d’être neutres, ils sont dirigés directement contre les assemblées. La revendication la plus "radicale", l’"Initiative législative populaire" 15, outre qu’elle implique d’interminables démarches parlementaires qui décourageraient les plus tenaces, remplace surtout le débat massif, où tous peuvent se sentir partie prenante d’un corps collectif, par des actes individuels, purement citoyens, de protestation enfermée entre les quatre murs du Moi 16.
Le sabotage de l’intérieur s’est conjugué avec les attaques répressives de l’extérieur, démontrant par-là à quel point la bourgeoisie est hypocrite lorsqu'elle prétend que les assemblées constituent "un droit constitutionnel de réunion". Le vendredi 27, le Gouvernement catalan – en coordination avec le gouvernement central – tente un coup de force : les "mossos de esquadra" (forces de police régionale) envahissent la Place de Catalogne à Barcelone et répriment sauvagement, provoquant de nombreux blessés et de multiples arrestations. L’Assemblée de Barcelone – jusqu’alors la plus orientée vers des positionnements de classe – est prise au piège des revendications démocratiques classiques : pétitions pour exiger la démission du conseiller de l’Intérieur, rejet de la répression "disproportionnée" 17, revendication d’un "contrôle démocratique de la police". Sa volte-face est d'autant plus évidente qu’elle cède au poison nationaliste et inclut dans ses revendications le "droit à l’autodétermination".
Les scènes de répression se multiplient dans la semaine du 5 au 12 juin : Valence, Saint-Jacques-de-Compostelle, Salamanque… Le coup le plus brutal est cependant porté du 14 au 15 à Barcelone. Le Parlement catalan discutait une loi dite Omnibus qui prévoyait de violentes coupes sociales en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé (entre autres 15 000 licenciements dans ce dernier). DRY, en dehors de toute dynamique de discussion en assemblées de travailleurs, convoqua une "manifestation pacifique" qui consistait à encercler le Parlement pour "empêcher les députés de voter une loi injuste". Il s’agit là d'une action purement symbolique typique qui, au lieu de combattre une loi et les institutions dont elle émane, s’adresse à la "conscience" des députés. Aux manifestants ainsi piégés, il ne reste plus que le faux choix : ou bien le terrain démocratique et les pleurnicheries impuissantes et passives de la majorité, ou bien son pendant, la violence "radicale" d’une minorité.
Les insultes et bousculades de quelques députés sont l'occasion d'une campagne hystérique qui criminalise les "violents" (mettant dans ce sac ceux qui défendent des positions de classe) et appelle à "défendre les institutions démocratiques menacées". Pour que la boucle soit bouclée, DRY arbore son pacifisme pour demander aux manifestants d’exercer la violence sur les éléments "violents" 18, et va encore plus loin : elle demande ouvertement que les "violents" soient livrés à la police et que les manifestants applaudissent cette dernière pour ses "bons et loyaux services" !
Les manifestations du 19 juin et l’extension à la classe ouvrière
Dès le début, le mouvement a eu deux âmes : une âme démocratique très large, alimentée par les confusions et les doutes, résultant de son caractère socialement hétérogène et sa tendance à fuir la confrontation directe. Mais il y avait aussi une âme prolétarienne, qui se matérialisait par les assemblées 19 et par une tendance toujours présente à "aller vers la classe ouvrière".
À l’Assemblée de Barcelone, des travailleurs des télécommunications et de la santé, des pompiers, des étudiants de l’université, mobilisés contre les coupes sociales, participent activement. Ils créent une Commission d’extension et de grève générale, dont les débats sont très animés et organisent un réseau des Travailleurs indignés de Barcelone qui convoque une assemblée d’entreprises en lutte pour le samedi 11 juin, puis une Rencontre le samedi 3 juillet. Vendredi 3 juin, chômeurs et actifs manifestent autour de la place de Catalogne derrière une banderole qui affiche : "A bas la bureaucratie syndicale ! Grève générale !". A Valence, l’Assemblée soutient une manifestation des travailleurs des transports publics et aussi une manifestation de quartier protestant contre les coupes dans l’enseignement. A Saragosse, les travailleurs des transports publics se joignent à l’assemblée avec enthousiasme 20. Les assemblées décident de former des assemblées de quartier 21.
La manifestation du 19 juin voit une nouvelle poussée de "l’âme prolétarienne". Cette manifestation a été convoquée par les Assemblées de Barcelone, Valence et Malaga et est orientée contre les coupes sociales. DRY tente de la dénaturer en proposant uniquement des mots d’ordre démocratiques. Cela provoque une réaction qui se concrétise, à Madrid, par l’initiative spontanée d’aller au Congrès manifester contre les coupes sociales, manifestation qui regroupe plus de 5 000 personnes. Par ailleurs, une Coordination des assemblées de quartier du sud de Madrid, née à la suite du fiasco de la grève du 29 septembre et ayant une orientation très similaire à celle des Assemblées générales interprofessionnelles créées en France à la chaleur des événements de l'automne 2010, lance un appel : "Depuis les populations et les quartiers de travailleurs de Madrid, allons au Congrès où se décident sans nous consulter les coupes sociales, pour dire : basta ! (…) Cette initiative provient d’une conception assembléiste de base de la lutte ouvrière, contre ceux qui prennent des décisions dans le dos des travailleurs sans les soumettre à leur approbation. Parce que la lutte est longue, nous t’encourageons à t’organiser dans les assemblées de quartier ou locales, comme dans les lieux de travail ou d’études".
Les manifestations du 19 juin connaissent un réel succès, l’assistance est massive dans plus de 60 villes, mais leur contenu est encore plus important. Il répond à la brutale campagne contre "les violents". Exprimant une maturation née des nombreux débats dans les milieux les plus actifs 22, le mot d’ordre le plus repris, par exemple à Bilbao, est "La violence, c’est de ne pas boucler les fins de mois !" et à Valladolid : "La violence, c’est aussi le chômage et les expulsions !".
Cependant, c'est surtout la manifestation à Madrid qui exprime le virage du 19 juin vers la perspective du futur. Elle est convoquée par un organisme directement lié à la classe ouvrière et né de ses minorités les plus actives 23. Le thème de ce rassemblement est "Marchons ensemble contre la crise et contre le capital". Les revendications sont : "Non aux réductions de salaires et des pensions ; pour lutter contre le chômage : la lutte ouvrière, contre l’augmentation des prix, pour l’augmentation des salaires, pour l’augmentation des impôts de ceux qui gagnent le plus, en défense des services publics, contre les privatisations de la santé, de l’éducation... Vive l’unité de la classe ouvrière !" 24.
Un collectif d’Alicante adopte le même Manifeste. À Valence, un "Bloc autonome et anticapitaliste" de plusieurs collectifs très actifs dans les assemblées diffuse un Manifeste qui dit : "Nous voulons une réponse au chômage. Que les chômeurs, les précaires, ceux qui connaissent le travail au noir, se réunissent en assemblées, qu’ils décident collectivement de leurs revendications et que celles-ci soient satisfaites. Nous demandons le retrait de la loi de réforme du Code du travail et de celle qui autorise des plans sociaux sans contrôle et avec une indemnisation de 20 jours. Nous demandons le retrait de la loi sur la réforme des pensions de retraites car, après une vie de privations et de misère, nous ne voulons pas sombrer dans encore plus de misère et d’incertitude. Nous demandons que cessent les expulsions. Le besoin humain d’avoir un logement est supérieur aux lois aveugles du commerce et de la recherche du profit. Nous disons NON aux réductions qui touchent la santé et l’éducation, NON aux licenciements à venir que préparent les gouvernements régionaux et les mairies suite aux dernières élections". 25
La marche de Madrid s’est organisée en plusieurs colonnes qui partent de sept banlieues ou quartiers de la périphérie différents ; au fur et à mesure que ces colonnes avancent, elles sont rejointes par une foule toujours plus dense. Ces foules reprennent la tradition ouvrière des grèves de 1972-76 en Espagne (mais aussi la tradition de 1968 en France) où, à partir d’une concentration ouvrière ou d’une usine "phare", comme à l’époque la Standard de Madrid, les manifestations voyaient des masses croissantes d’ouvriers, d’habitants, de chômeurs, de jeunes les rejoindre, et toute cette masse convergeait vers le centre de la ville. Cette tradition était d’ailleurs déjà réapparue dans les luttes de Vigo de 2006 et 2009 26.
A Madrid, le Manifeste lu pendant le rassemblement appelle à tenir des "Assemblées afin de préparer une grève générale", ce qui est accueilli par des cris massifs de "Vive la classe ouvrière !".
La nécessité d’un enthousiasme réfléchi
Les manifestations du 19 juin provoquent un sentiment d’enthousiasme ; une manifestante à Madrid déclare : "L’ambiance était celle d’une fête authentique. On marchait ensemble, des gens très variés et de tous les âges : des jeunes autour de 20 ans, des retraités, des familles avec leurs enfants, d’autres personnes encore différentes... et cela, alors que des gens se mettaient à leur balcon pour nous applaudir. Je suis rentrée à la maison épuisée, mais avec un sourire rayonnant. Non seulement j’avais la sensation d’avoir contribué à une cause juste, mais en plus, j’ai passé un moment vraiment extra". Un autre dit : "C’est vraiment important de voir tous ces gens rassemblés sur une place, parlant politique ou luttant pour leurs droits. N’avez-vous pas la sensation que nous sommes en train de récupérer la rue ?".
Après les premières explosions caractérisées par des assemblées "en recherche", le mouvement commence à présent à chercher la lutte ouverte, commence à entrevoir que la solidarité, l’union, la construction d’une force collective peuvent être menées à bien 27. L’idée commence à se répandre que "Nous pouvons être forts face au capital et à son État !", et que la clé de cette force sera donnée par l’entrée en lutte de la classe ouvrière. Dans les assemblées de quartier de Madrid, un débat a eu pour thème la convocation d’une grève générale en octobre pour "rejeter les coupes sociales". Les syndicats CCOO et UGT poussèrent des hauts cris en disant que cette convocation serait "illégale" et qu’eux seuls étaient autorisés à la faire, ce à quoi beaucoup de secteurs ripostèrent haut et fort : "seules les assemblées massives peuvent la convoquer".
Nous ne devons cependant pas nous laisser aller à l’euphorie, l’entrée en lutte de la classe ouvrière ne sera pas un processus facile. Les illusions et confusions sur la démocratie, le point de vue citoyen, les "réformes", pèsent lourdement, renforcées par la pression de DRY, des politiciens, des médias, qui exploitent les doutes et l’immédiatisme poussant à chercher des "résultats rapides et palpables", mais aussi la peur face à l’ampleur des questions qui se posent. Il importe surtout de comprendre que la mobilisation des ouvriers sur leur lieu de travail est aujourd’hui réellement très difficile, à cause du risque élevé de perdre son emploi, de se retrouver sans ressources, ce qui pour beaucoup ferait franchir la frontière entre une vie misérable mais supportable et une vie misérable et d’extrême pauvreté.
Les critères démocratiques et syndicaux voient la lutte comme une addition de décisions individuelles. N’êtes-vous pas mécontents ? Ne vous sentez-vous pas piétinés ? Si, vous l'êtes ! Alors pourquoi ne vous révoltez-vous pas ? Ce serait si simple s’il s’agissait pour l’ouvrier de choisir entre être "courageux" ou "lâche", seul avec sa conscience, comme dans un bureau de vote ! La lutte de classe ne suit pas ce genre de schéma idéaliste et falsificateur, elle est le résultat d’une force et d’une conscience collectives qui proviennent non seulement du malaise que provoque une situation insoutenable, mais aussi de la perception qu’il est possible de lutter ensemble et qu’il existe un minimum de solidarité et de détermination le permettant.
Une telle situation est le produit d’un processus souterrain qui repose sur trois piliers : l’organisation en assemblées ouvertes qui permettent de prendre conscience des forces dont on dispose et de la marche à suivre pour les accroître ; la conscience pour définir ce que nous voulons et comment le conquérir ; la combativité face au travail de sape des syndicats et de tous les organes de mystification.
Ce processus est en marche, mais il reste difficile de savoir quand et comment il aboutira. Une comparaison peut éventuellement nous y aider. Lors de la grande grève massive de Mai 68 28, il y eut le 13 mai une manifestation gigantesque à Paris en soutien aux étudiants brutalement réprimés. Le sentiment de force qu’elle dégagea se traduisit, dès le lendemain, par l'éclatement d'une série de grèves spontanées, comme celle de Renault à Cléon puis Paris. Ceci ne s’est pas produit après les grandes manifestations du 19 juin en Espagne. Pourquoi ?
La bourgeoisie, en mai 1968, était peu préparée politiquement pour affronter la classe ouvrière, la répression ne fit que jeter de l’huile sur le feu ; aujourd’hui, elle peut s'appuyer dans un grand nombre de pays sur un appareil super-sophistiqué de syndicats, de partis, et peut déployer des campagnes idéologiques basées précisément sur la démocratie, et qui de plus permettent un usage politique très efficace de la répression sélective. De nos jours, le surgissement d’une lutte requiert un effort bien supérieur de conscience et de solidarité que ce n'était le cas dans le passé.
En mai 1968, la crise n'en était qu'à ses prémices, elle plonge aujourd’hui clairement le capitalisme dans une impasse. Cette situation est intimidante, elle rend difficile l’entrée en grève ne serait-ce que pour une raison aussi "simple" que l’augmentation des salaires. La gravité de la situation fait qu’éclatent des grèves parce que "la coupe est pleine", mais alors doit pouvoir s'ensuivre la conclusion que "le prolétariat n'a que ses chaînes à perdre et un monde à gagner".
Ce mouvement n’a pas de frontières
Si la route semble donc plus longue et douloureuse qu’en mai 1968, les bases qui se forgent sont cependant beaucoup plus solides. L’une d’entre elles, déterminante, c’est de se concevoir comme partie d’un mouvement international. Après toute une période "d’essais" avec quelques mouvements massifs (le mouvement des étudiants en France en 2006 et la révolte de la jeunesse en Grèce en 2008 29), cela fait à présent neuf mois que se succèdent des mouvements bien plus larges et laissant entrevoir la possibilité de paralyser la main barbare du capitalisme : France à l'automne 2010, Grande-Bretagne en novembre et décembre 2010, Égypte, Tunisie, Espagne et Grèce en 2011.
La conscience que le mouvement "15M" fait partie de cette chaîne internationale commence à se développer de façon embryonnaire. Le slogan "Ce mouvement n’a pas de frontières" fut repris par une manifestation à Valence. Des manifestations "pour une Révolution européenne" furent organisées par plusieurs campements, il y eut le 15 juin des manifestations en soutien à la lutte en Grèce, et elles se répétèrent le 29. Le 19, les slogans internationalistes commencèrent à apparaître minoritairement : une pancarte disait : "Heureuse union mondiale !", et une autre affichait en anglais : "World Revolution".
Pendant des années, ce qu’elle nommait "globalisation de l’économie" servit de prétexte à la bourgeoisie de gauche pour susciter des réactions nationalistes, son discours consistant à revendiquer la "souveraineté nationale" face aux "marchés apatrides". Elle proposait aux ouvriers rien de moins que d’être plus nationalistes que la bourgeoisie ! Avec le développement de la crise, mais aussi grâce à la popularisation d’Internet, aux réseaux sociaux, etc., la jeunesse ouvrière commence à retourner ces campagnes contre leurs promoteurs. L’idée fait son chemin selon laquelle, "face à la globalisation de l’économie il faut riposter par la globalisation internationale des luttes", que face à la misère mondiale l’unique riposte possible est la lutte mondiale.
Le "15M" a eu une ample répercussion au niveau international. Les mobilisations en Grèce depuis deux semaines suivent le même "modèle" d’assemblées massives sur les places principales ; elles se sont inspirées consciemment des événements en Espagne 30. Selon Kaosenlared du 19 juin, "c’est le quatrième dimanche consécutif que des milliers de personnes, de tous âges, manifestent place Syntagma devant le Parlement grec, à l'appel du mouvement paneuropéen des 'Indignés', pour protester contre les mesures d’austérité".
En France, en Belgique, au Mexique, au Portugal ont lieu des assemblées régulières très minoritaires où se font jour la solidarité avec les Indignés et la tentative d’impulser le débat et la riposte. Au Portugal, "Quelque 300 personnes, jeunes dans leur majorité, marchèrent dimanche après-midi au centre de Lisbonne à l’appel de Democracia Real Ya, inspirés par les Indignés espagnols. Les manifestants portugais marchèrent dans le calme derrière une banderole où l’on pouvait lire : "Espagne, Grèce, Irlande, Portugal : notre lutte est internationale !" 31.
Le rôle des minorités actives dans la préparation de nouvelles luttes
La crise mondiale de la dette illustre la réalité de la crise sans issue du capitalisme. En Espagne comme dans les autres pays, pleuvent les attaques frontales et l’on ne peut apercevoir le moindre répit, sinon de nouveaux et pires coups-bas contre nos conditions de vie. La classe ouvrière doit riposter et, pour cela, elle doit s’appuyer sur l’impulsion donnée par les assemblées de mai et les manifestations du 19 juin.
Pour préparer ces ripostes, la classe ouvrière secrète en son sein des minorités actives, des camarades qui tentent de comprendre ce qui se passe, se politisent, animent les débats, actions, réunions, assemblées, tentent de convaincre ceux qui doutent encore, apportent des arguments à ceux qui cherchent. Comme nous l’avons vu au début, ces minorités contribuèrent au surgissement du "15M".
Avec ses modestes forces, le CCI a participé au mouvement, tentant de donner des orientations. "Lors d'une épreuve de force entre les classes, on assiste à des fluctuations importantes et rapides face auxquelles il faut savoir s'orienter, guidé par les principes et les analyses sans se noyer. Il faut être dans le flot du mouvement, sachant comment concrétiser des 'buts généraux' pour répondre aux préoccupations réelles d'une lutte, pour pouvoir appuyer et stimuler les tendances positives qui se font jour" 32. Nous avons écrit de nombreux articles tentant de comprendre les diverses phases par lesquelles est passé le mouvement tout en faisant des propositions concrètes et réalisables : l’émergence des assemblées et leur vitalité, l’offensive de DRY contre elles, le piège de la répression, le tournant que représentent les manifestations du 19 juin 33.
Une autre des nécessités du mouvement étant le débat, nous avons ouvert une rubrique sur notre page web en Espagnol "Debates del 15 M" où ont pu s’exprimer des camarades avec différentes analyses et positions.
Travailler avec d’autres collectifs et minorités actives a été une autre de nos priorités. Nous nous sommes coordonnés et avons participé à des initiatives communes avec le Círculo obrero de debate de Barcelona, avec la Red de Solidaridad de Alicante et divers collectifs assembléistes de Valence.
Dans les assemblées, nos militants sont intervenus sur des points concrets : défense des assemblées, orienter la lutte vers la classe ouvrière, impulsion des assemblées massives dans les centres de travail et d’études, rejet des revendications démocratiques pour les remplacer par la lutte contre les coupes sociales, l’impossibilité de réformer ou de démocratiser le capitalisme, la seule possibilité réaliste étant sa destruction 34. Dans la mesure de nos possibilités, nous avons aussi participé activement à des assemblées de quartier.
Suite au "15M", la minorité favorable à une orientation de classe s’est élargie et s’est rendue plus dynamique et influente. Elle doit à présent se maintenir unie, articuler un débat, se coordonner au niveau national et international. Face à l’ensemble de la classe ouvrière, il doit s’affirmer une position qui recueille ses besoins et aspirations les plus profonds : contre le mensonge démocratique, montrer ce qui se profile derrière le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux assemblées !" ; contre les revendications de réformes démocratiques, montrer la lutte conséquente contre les coupes sociales ; contre d’illusoires "réformes" du capitalisme, montrer la lutte tenace et persévérante dans la perspective de la destruction du capitalisme.
L’important est que se développent dans ce milieu un débat et un combat. Un débat sur les nombreuses questions qui se sont posées ces derniers mois : Réforme ou révolution ? Démocratie ou assemblées ? Mouvement citoyen ou mouvement de classe ? Revendications démocratiques ou revendications contre les attaques sociales ? Grève générale ou grève de masse ? Syndicats ou assemblées ? etc. Un combat pour impulser l’auto-organisation et la lutte indépendante mais surtout pour savoir déjouer et dépasser les multiples pièges qui ne vont pas manquer de nous être tendus.
C. Mir
1 Lire, dans la Revue internationale no 144, "Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie – L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe [192]".
2 Un responsable de Cáritas en Espagne, ONG ecclésiastique qui se consacre à la pauvreté, signalait que "nous parlons à présent de 8 millions de personnes en cours d’exclusion et de 10 millions sous le seuil de pauvreté". Cf. https://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/230828-tenemo... [193]. 18 millions de personnes, c’est un tiers de la population de l’Espagne ! Ceci n’est évidemment en rien une particularité espagnole, le niveau de vie des Grecs a baissé en un an de 8 %.
3 Nous reviendrons sur celle-ci plus en détail au paragraphe suivant.
4 Nous avons publié ce communiqué [194] en plusieurs langues (dont le français [195]).
5 Deux slogans étaient très repris "PSOE-PP, c’est la même merde !" et "Avec des roses ou des mouettes, ils nous prennent pour des crêpes !", sachant que la rose est le symbole du PSOE et la mouette celle du PP.
6 Pour se faire une idée de ce mouvement et de ses méthodes, voir notre article "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya !" : une dictature sur les assemblées massives [196]", traduit en plusieurs langues.
7 Cette citation de Rosa Luxemburg, extraite de Grève de masse, parti et syndicats [197] et qui fait référence à la grande grève du sud de la Russie en 1903, va comme un gant à l’ambiance exaltée des assemblées, un siècle plus tard.
8 Voir "Carta abierta a las Asambleas [198]".
9 Cf. première partie [199], "Feuerbach – Opposition de la conception matérialiste et idéaliste", B, "La base réelle de l'idéologie".
10 Voir la Revue internationale no 62, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [200]".
11 "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [148]" dans la Revue internationale n° 125.
12 A notre avis, la cause fondamentale de ces difficultés se trouve dans les événements de 1989 qui balayèrent les régimes étatiques identifiés faussement comme "socialistes" et qui permirent à la bourgeoisie de développer une campagne écrasante sur la "fin du communisme", "la fin de la lutte des classes", "l’échec du communisme", etc., qui affectèrent brutalement plusieurs générations ouvrières. Cf. Revue internationale n° 60, "Des difficultés accrues pour le prolétariat [201]".
13 Rappelons comment, entre février et juin 1848 en France, eut également lieu ce type de "grande fête de toutes les classes sociales" qui s’achèvera avec les journées de juin où le prolétariat parisien s'affronta, les armes à la main, au Gouvernement Provisoire. Au cours de la Révolution russe de 1917 régna aussi entre février et avril cette même ambiance d’union générale sous l’égide de la "démocratie révolutionnaire".
14 À l’exception de l’extrême-droite qui, portée par sa haine irrépressible contre la classe ouvrière, exprimait à haute voix ce que les autres fractions de la bourgeoisie se limitaient à dire dans l’intimité de ses salons.
15 Possibilité pour les citoyens de recueillir un certain nombre de signatures afin de proposer et faire voter des lois et des réformes au Parlement.
16 La démocratie se base sur la passivité et l’atomisation de l’immense majorité réduite à une somme d’individus d’autant plus sans défense et vulnérables qu’ils pensent que leur Moi peut être souverain. Par contre, les assemblées partent du point de vue opposé : les individus sont forts parce qu’ils s’appuient sur la "richesse de leurs rapports sociaux" (Marx) en s’intégrant et étant partie prenante d’un vaste corps collectif.
17 Comme s’il pouvait exister une répression "proportionnée" !
18 DRY demande que les manifestants encerclent et critiquent publiquement le comportement de tout élément "violent", ou "suspect d’être violent" (sic).
19 Ses origines plus lointaines sont les réunions de districts pendant la Commune de Paris, mais c’est avec le mouvement révolutionnaire de Russie en 1905 qu’elles s’affirment et, depuis lors, tout grand mouvement de la classe les verra surgir sous différentes formes et appellations : Russie 1917, Allemagne 1918, Hongrie 1919 et 1956, Pologne 1980… Il y eut en 1972 à Vigo en Espagne une Assemblée générale de ville qui se répéta à Pampelune en 1973 et à Vitoria en 1976, puis de nouveau à Vigo en 2006. Nous avons écrit de nombreux articles sur l’origine de ces assemblées ouvrières. Voir en particulier la série "Que sont les conseils ouvriers", à partir de la Revue internationale no 140.
20 A Cadix, l’Assemblée générale organise un débat sur la précarité qui attire une forte assistance. A Caceres est dénoncée l’absence d’information sur le mouvement en Grèce et à Almeria est organisée le 15 juin une réunion sur "la situation du mouvement ouvrier".
21 Ce sont en fait des armes à double tranchant : elles contiennent des aspects positifs, par exemple l’extension du débat massif vers des couches plus profondes de la population travailleuse et la possibilité – comme ce fut le cas – d’impulser des assemblées contre le chômage et la précarité, brisant l’atomisation et le sentiment de honte qui accable beaucoup de travailleurs au chômage, rompant aussi la situation de totale vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs précaires des petits commerces. Le point négatif est qu’elles sont aussi utilisées pour disperser le mouvement, lui faire perdre ses préoccupations plus globales, pour l’enfermer dans des dynamiques "citoyennes" favorisées par le fait que le quartier – entité qui mélange les ouvriers avec la petite bourgeoisie, des patrons, etc. – se prête plus à ce genre de préoccupations.
22 Voir entre autres "un protocole anti-violence".
23 Dans la Coordination des Assemblées de quartiers et de banlieues du sud de Madrid, on trouve fondamentalement des Assemblées de travailleurs de différents secteurs même si y participent également des petits syndicats radicaux. Voir https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [202]
24 La privatisation des services publics et des Caisses d'épargne est une réponse du capitalisme à l'aggravation de la crise et, plus concrètement, au fait que l'État, de plus en plus endetté, est contraint de réduire ses dépenses, quitte pour cela à dégrader de façon insupportable la manière dont des services essentiels sont assumés. Cependant, il est important de comprendre que l'alternative aux privatisations n'est pas la lutte pour le maintien de ces services dans le giron de l'État. En premier lieu, parce que les services "privatisés" continuent souvent d'être contrôlés organiquement par des institutions étatiques qui sous-traitent le travail à des entreprises privées. Et en deuxième lieu, parce que l'État et la propriété étatique n'ont rien de "social" ni à voir avec un quelconque "bien-être citoyen". L'État est un organe exclusivement au service de la classe dominante et la propriété étatique est basée sur l'exploitation salariée. Cette problématique a commencé à être posée dans certains milieux ouvriers, notamment dans une assemblée à Valence contre le chômage et la précarité. www.kaosenlared.net/noticia/cronica-libre-reunion-contra-paro-precariedad [203].
25 Voir https://infopunt-vlc.blogspot.com/2011/06/19-j-bloc-autonom-i-anticapitalista.html [204]
26 Voir "Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : une avancée dans la lutte prolétarienne [205]" et aussi "A Vigo, en Espagne : les méthodes syndicales mènent tout droit à la défaite [206]".
27 Ce qui n’implique pas la sous-estimation des obstacles que la nature intrinsèque du capitalisme, basé sur la concurrence à mort et la méfiance des uns par rapport aux autres, oppose à ce processus d’unification. Celui-ci ne pourra se réaliser qu’au terme d’énormes et complexes efforts se basant sur la lutte unitaire et massive de la classe ouvrière, une classe qui produit collectivement et au moyen du travail associé les principales richesses sociales et qui, pour cela, contient en elle la reconstruction de l’être social de l’humanité.
28 Voir la série "Mai 68 et la perspective révolutionnaire", à partir de la Revue internationale no 133.
29 Voir la Revue internationale no 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [148]", et la Revue internationale no 136, "Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe [207]".
30 La censure sur les événements en Grèce et les mouvements massifs qui s'y déroulent est totale, ce qui nous empêche de les intégrer dans notre analyse.
31 Repris de Kaosenlared.
32 Revue internationale no 20, "Sur l'intervention des révolutionnaires : réponse à nos censeurs [208]".
33 Voir les différents articles qui ponctuent chacun de ces moments dans notre presse.
34 Ce n’était pas une insistance spécifique du CCI, un mot d’ordre assez populaire disait : "Être réaliste, c’est être anticapitaliste !", une banderole proclamait : "Le système est inhumain, soyons antisystème".
A propos du 140e anniversaire de la Commune de Paris
- 1388 lectures
La Commune de Paris, qui s'est déroulée de mars à juin 1871, constitue le premier exemple dans l'histoire de prise du pouvoir politique par la classe ouvrière. La Commune a démantelé l'ancien État bourgeois et formé un pouvoir directement contrôlé d'en bas : les délégués de la Commune, élus par les assemblées populaires des quartiers de Paris, étaient révocables à tout moment et leur salaire ne dépassait pas la moyenne de celui des ouvriers. La Commune appela à suivre son exemple dans toute la France, détruisit la Colonne Vendôme, symbole du chauvinisme national français et déclara que son drapeau rouge était le drapeau de la République universelle. Évidemment, ce crime contre "l'ordre naturel" devait être puni sans merci. Le journal libéral britannique The Guardian publia à l'époque un rapport très critique de la revanche sanglante prise par la classe dominante française :
"Le gouvernement civil est temporairement suspendu à Paris. La ville est divisée en quatre districts militaires, sous le commandement des généraux Ladmirault, Cissky, Douay et Vinoy. Tout le pouvoir des autorités civiles dans le maintien de l'ordre est transféré aux militaires. Les exécutions sommaires se poursuivent, et les déserteurs de l'armée, les incendiaires et les membres de la Commune sont tués sans merci. On rapporte que le Marquis De Galliffet a suscité un léger mécontentement en faisant abattre des personnes innocentes près de l'Arc de triomphe. Il faut rappeler que le Marquis (qui était avec Bazaine au Mexique) a ordonné que 80 personnes, extraites d'un grand convoi de prisonniers, soient exécutées près de l'Arc. On dit maintenant que certaines d'entre elles étaient innocentes. Si on le lui demandait, le Marquis exprimerait probablement un regret poli qu'une telle circonstance fâcheuse se soit produite et qu'est-ce qu'un "véritable ami de l'ordre" demanderait de plus ?" (Manchester, jeudi 1er juin 1871. Résumé des nouvelles. Étranger.)
En à peine huit jours, 30 000 communards ont été massacrés. Et ceux qui ont infligé ce supplice ne sont pas seulement les Galliffet ni leurs supérieurs français. Les prussiens, dont la guerre avec la France a provoqué le soulèvement à Paris, ont mis de côté leurs intérêts divergents de ceux de la bourgeoisie française pour permettre à cette dernière d'écraser la Commune : c'est clairement la première indication du fait que, aussi féroces que soient les rivalités nationales qui opposent les unes aux autres les différentes fractions de la classe dominante, celles-ci se serrent les coudes quand elles sont confrontées à la menace prolétarienne.
La Commune fut totalement vaincue, mais elle a constitué une source inestimable de leçons politiques pour le mouvement ouvrier. Marx et Engels ont revu leur vision de la révolution prolétarienne à la suite de celle-ci et en ont déduit que la classe ouvrière ne pouvait pas prendre le contrôle de l'ancien appareil d'État bourgeois mais devait le détruire et le remplacer par une nouvelle forme de pouvoir politique. Les Bolcheviks et les Spartakistes des révolutions russe et allemande de 1917-19 se sont inspirés de la Commune et ont considéré que les conseils ouvriers, ou soviets, qui étaient nés de ces révolutions constituaient une continuation et un développement des principes de la Commune. La Gauche communiste des années 1930 et 1940, qui cherchait à comprendre les raisons de la défaite de la révolution en Russie, est revenue sur l'expérience de la Commune et a examiné ses apports concernant le problème de l'État dans la période de transition. Dans la lignée de cette tradition, notre Courant a publié un certain nombre d'articles sur la Commune. Le premier volume de notre série Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle, qui se penche sur l'évolution du programme communiste dans le mouvement ouvrier au XIXe siècle, consacre un chapitre à la Commune et examine comment cette expérience a clarifié l'attitude que la classe ouvrière doit adopter à la fois envers l'État bourgeois et l'État post-révolutionnaire, envers les autres couches non exploiteuses de la société, envers les mesures politiques et économiques nécessaires pour avancer dans la direction d'une société sans classe et sans État. On peut lire cet article ("1871 : la première révolution prolétarienne [171]") dans la Revue internationale n° 77 (1994, 8e partie).
Nous republions également dans notre presse territoriale un article [209] écrit pour le 120e anniversaire de la Commune, en 1991. Cet article dénonce les tentatives du moment de récupérer la mémoire de la Commune et de travestir son caractère essentiellement internationaliste et révolutionnaire en la présentant comme un moment de la lutte patriotique pour les libertés démocratiques.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Commune de Paris - 1871 [210]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (II) - la période 1914/1928 : premiers véritables affrontements entre les deux classes
- 2301 lectures
On a pu remarquer qu’entre 1855 et 1914, le prolétariat qui émergeait dans la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française) faisait l’apprentissage de la lutte de classe en cherchant à se regrouper et à s’organiser en vue de se défendre face aux exploiteurs capitalistes. En effet, malgré son extrême faiblesse numérique, il a pu démontrer sa volonté de lutter et la prise de conscience de sa force en tant que classe exploitée. Par ailleurs, on a pu noter que, à la veille de la Première Guerre mondiale, le développement des forces productives dans la colonie était suffisant pour donner lieu à un choc frontal entre la bourgeoisie et la classe ouvrière.
Grève générale et émeute à Dakar en 1914
Au début de 1914, le mécontentement et l’inquiétude de la population qui s'accumulaient depuis l’année précédente ne s'exprimèrent pas tout de suite sous forme de grève ou de manifestation. Mais au mois de mai la colère explosa, entraînant celle de la classe ouvrière qui déclencha une grève générale insurrectionnelle.
Cette grève fut avant tout une réponse aux grossières provocations du pouvoir colonial envers la population de Dakar lors des élections législatives de mai cette année-là à l'occasion desquelles le gros commerce 1 et le maire de la commune menaçaient de couper les crédits, l’eau et l’électricité à tous ceux qui voulaient voter pour le candidat autochtone (un certain Blaise Diagne, nous y reviendrons plus loin). Le hasard fit qu’éclata à ce moment-là une épidémie de peste dans la ville et que, sous prétexte d’endiguer son éventuelle extension vers les quartiers résidentiels (où habitaient les européens), le maire de Dakar, Masson (un colon), ordonna purement et simplement la destruction par le feu de toutes les habitations (des populations locales) suspectées d’infection.
Cela mit un autre feu aux poudres : grève générale et émeute contre les procédés criminels des autorités coloniales. Et, pour passer à l‘action, un groupe de jeunes dit "Jeunes Sénégalais" appela au boycott économique et sillonna les rues pour placarder dans tout Dakar le slogan : "affamons les affameurs", en reprenant ainsi le mot d’ordre du candidat et futur député noir.
De son côté, tout en dissimulant mal son inquiétude, le gros commerce lança une violente campagne de dissuasion véhiculée par le journal L’AOF (à sa botte) contre les grévistes dans ces termes :
"Voilà nos arrimeurs, charretiers et manœuvres privés de leurs salaires (…) Avec quoi vont-ils manger ? (…) vos grèves, celles qui atteindraient la vie du port, ne feraient que rendre la gêne bien plus cruelle aux malheureux qu’à ceux qui ont de la fortune : elles paralyseraient le développement de Dakar en décourageant ceux qui peuvent venir s’y fixer". (cité par Iba Der Thiam.)2
Mais rien n’y fit, la grève ne put être empêchée. Au contraire, elle s’étendit en touchant l’ensemble des secteurs, notamment les poumons de l’économie de la colonie à savoir le port et le chemin de fer, ainsi que les services et le commerce, public et privé confondus. La suite nous est racontée dans les mémoires secrets du Gouverneur de la colonie William Ponty :
"La grève (ajoutait le Gouverneur général), par l’abstention fomentée en dessous, était parfaitement organisée et eut un plein succès. C’était (…) la première manifestation de ce genre qu’il m’ait été donné de voir aussi unanime dans ces régions". (Thiam, ibidem)
La grève dura 5 jours (entre le 20 et le 25 mai) et ses auteurs finirent par acculer les autorités coloniales à éteindre l’incendie qu’elles avaient, elles-mêmes, allumé. En effet quelle grève exemplaire ! Voilà une lutte qui marqua un tournant majeur dans la confrontation entre la bourgeoisie et la classe ouvrière de l’AOF. C’était la première fois qu’une grève se généralisait au-delà des catégories professionnelles en réunissant, ensemble, ouvriers et population de Dakar et sa région dans un même combat contre le pouvoir dominant. En clair, ce fut une lutte qui modifia brusquement le rapport de forces en faveur des opprimés, d’où d’ailleurs la décision de ce même Gouverneur (avec l’aval de Paris) de céder aux revendications de la population gréviste, exprimée en ces termes :
"La cessation des incinérations des cases, la restitution des cadavres, la reconstruction en matériaux durs des bâtiments et concessions détruites, la disparition complète dans la ville entière de toutes les baraques en mauvaises planches de caisses ou en paille et leur remplacement par des immeubles en ciment, un type d’habitation à bon marché". (Thiam, ibid.)
Cependant, le même Gouverneur ne dit rien sur le nombre des victimes, brûlées à l’intérieur de leur case ou tombées sous les balles des forces de l’ordre. Tout au plus, les autorités locales de la colonie évoquèrent seulement "la restitution des cadavres" mais, là aussi, sans un mot sur les conditions des tueries, ni sur leur étendue.
Mais, en dépit de la censure sur les actes et les paroles de la classe ouvrière de cette époque, on peut cependant penser que les ouvriers qui voyaient brûler leur propre maison et celles de leurs proches ne restèrent pas inertes et qu'ils durent livrer une bataille acharnée. En clair, bien que très minoritaire, la classe ouvrière fut sans doute un élément décisif dans les affrontements qui firent plier les forces du capital colonial. Mais, surtout, la grève avait un caractère très politique :
"Il s’agissait donc d’une grève économique, certes, mais aussi politique, d’une grève de protestation, d’une grève de sanction, d’une grève de représailles, décidée et appliquée par toute la population du Cap- Vert (…). Leur grève avait donc un caractère nettement politique, la réaction des autorités le fut tout autant (…) L’administration était à la fois surprise et désarmée. Surprise parce qu’elle n’avait jamais eu à faire face à une manifestation de cette nature, désarmée parce qu’elle ne se trouvait nullement en présence d’une organisation syndicale classique avec bureau, statuts, mais d’un mouvement général pris en main par toute une population dont la direction était invisible". (Thiam, ibid.)
En accord avec le point de vue cet auteur, on se doit de conclure qu’il s’était agi d’une grève éminemment politique exprimant un haut degré de conscience prolétarienne. Phénomène d’autant plus remarquable que le contexte était peu favorable à la lutte de classe car dominé, à l’extérieur, par le bruit de bottes et, au plan intérieur, par des luttes de pouvoir et des règlements de comptes au sein de la bourgeoisie à travers justement les élections législatives dont l’enjeu principal était l'élection, pour la première fois de l’histoire, d'un député du continent noir. Voilà le piège mortel que la classe ouvrière sut retourner contre la classe dominante en déclenchant avec la population la grève victorieuse.
1917/1918 : des mouvements de grève qui inquiétèrent sérieusement la bourgeoisie
Comme on le sait, la période de 1914/1916 fut marquée, dans le monde en général et en Afrique en particulier, par un sentiment de terreur et d’abattement consécutif à l'éclatement de la première boucherie mondiale. Certes, juste avant le début de l’embrasement, on avait pu assister au formidable combat de classe à Dakar en 1914, de même à une dure grève de mineurs en Guinée en 1916 3 mais, dans l’ensemble, ce qui dominait était un état général d’impuissance au sein de la classe ouvrière alors même que ses conditions de vie se dégradaient sur tous les plans. En effet, il fallut attendre 1917 (pur hasard ?) pour voir de nouvelles expressions de luttes conséquentes dans la colonie :
"Les effets cumulés de l’inflation galopante, du blocage des salaires et des tracasseries de tous ordres, en même temps qu’ils révèlent au grand jour la nature étroite du lien de dépendance existant entre la colonie et la Métropole et l’imbrication accentuée du Sénégal dans le système capitaliste mondial, avaient provoqué une rupture de l’équilibre social à la faveur de laquelle la conscience des travailleurs et leur volonté de lutte s’étaient nettement affirmées. Dès l’année 1917, les rapports politiques signalaient, que devant la situation de crise, le marasme des affaires, la fiscalité écrasante, la paupérisation accrue des masses, des travailleurs de plus en plus nombreux, incapables de joindre les deux bouts, revendiquaient des augmentations de salaires". (Thiam, ibid.)
Effectivement, des grèves éclatèrent entre décembre 1917 et février 1918 contre la misère et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière, et ce malgré l’instauration de l’état de siège dans toute la colonie, accompagné d’une censure implacable. Néanmoins, même avec le peu de détail sur les tenants et aboutissants des grèves de cette époque, on peut y voir, à travers certaines notes confidentielles, l’existence de véritables affrontements de classes. Ainsi, à propos du mouvement de grève des charbonniers de la société italienne Le Sénégal, on peut lire, dans une note du Gouverneur William Ponty à son ministère, ceci :
"(…) Satisfaction leur ayant été donnée de suite, le travail fut repris le lendemain (…)".
Ou encore : "Une petite grève de deux jours s’est produite également au cours du trimestre dans le chantier des entreprises Bouquereau et Leblanc. La plupart des grévistes ont été remplacés par des Portugais". (Thiam, ibid.)
Mais, sans que l’on puisse savoir ce que fut la nature des réactions des ouvriers remplacés par des "jaunes", le Gouverneur général indiquait quand même que : "Les ouvriers de toutes les professions devaient faire grève générale le 1er janvier". Plus loin, il informa son ministre que des maçons répartis sur une dizaine de chantiers étaient partis en grève le 20 février en revendiquant une augmentation de salaire de 6 à 8 francs par jour, et que "la satisfaction [de la revendication] mit fin à la grève".
Comme on peut le voir clairement, entre 1917 et 1918, la combativité ouvrière fut telle que les affrontements entre la bourgeoisie et le prolétariat débouchèrent souvent sur des victoires de ce dernier, comme en attestent les citations des divers rapports ou propos secrets des autorités coloniales. De même les luttes ouvrières de cette époque ne pouvaient pas être sans rapport avec le contexte historique de la révolution en Russie en particulier et en Europe en général :
"La concentration de travailleurs salariés dans les ports, les chemins de fer, crée les conditions pour l’apparition des premières manifestations du mouvement ouvrier. (…) Enfin, les souffrances de la guerre - effort de guerre, épreuves subies par les combattants - créent le besoin d’une détente, l’espoir d’un changement. Or, les échos de la Révolution russe d’octobre sont parvenus en Afrique ; il y avait des troupes sénégalaises parmi les unités stationnées en Roumanie qui ont refusé de marcher contre les Soviets ; il y avait des marins noirs sur les unités navales mutinées de la Méditerranée ; certains ont assisté aux mutineries de 1917, ont vécu ou suivi l’essor révolutionnaire des années de la fin de la guerre et de l’immédiat après-guerre en France". ( Jean Suret-Canale. Ibid).
Effectivement, la révolution russe d’octobre 1917 eut des échos jusqu’en Afrique, en particulier auprès de la jeunesse dont une grande partie fut enrôlée et expédiée en Europe par l’impérialisme français en vue de la boucherie de 1914-18. Dans ce contexte, on comprend mieux le bien-fondé des inquiétudes d’alors de la bourgeoisie française, d’autant plus que la vague de luttes se poursuivait.
1919 : année de luttes et tentatives de constitution d’organisations ouvrières
1919, année d’intenses luttes ouvrières, fut aussi l’année de l’émergence de multiples structures associatives à caractère professionnel alors que l’autorité coloniale continuait d’interdire en AOF toute organisation syndicale et toute coalition de travailleurs supérieure à vingt personnes. Pourtant, nombreux furent les travailleurs qui prenaient l’initiative de créer des associations professionnelles (des "amicales") susceptibles de prendre en charge la défense de leurs intérêts. Mais l’interdiction étant destinée particulièrement aux travailleurs indigènes, il revint par conséquent à leurs camarades européens, en l’occurrence les cheminots, d'avoir pris l'initiative de créer la première "amicale professionnelle" en 1918, les cheminots ayant déjà été à l’origine de la première tentative (publique) en la matière, en 1907.
Ce sont ces amicales professionnelles qui furent les jalons des premières organisations syndicales reconnues dans la colonie :
"(…) Peu à peu, sortant du cadre étroit de l’entreprise, le processus de coalition des travailleurs était, de proche en proche, émancipé, assez vite d’ailleurs, passant d’abord à l’Union à l’échelon d’une ville comme Saint-Louis ou Dakar, puis au regroupement au niveau de la colonie, de tous ceux que leurs obligations professionnelles associaient aux mêmes servitudes professionnelles. Nous en trouvons des exemples chez les instituteurs, les agents des PTT, les dames dactylographes, les employés de commerce. (…) Par ce moyen, le mouvement syndical naissant renforçait ses positions de classe. Il élargissait le champ et le cadre de son action, et disposait d’une force de frappe dont la mise en œuvre pouvait se révéler particulièrement efficace face au patronat. Ainsi, l’esprit de solidarité entre travailleurs prenait corps peu à peu. Des indices probants prouvaient même que les éléments les plus avancés étaient en train de prendre conscience des limites du corporatisme et de jeter les bases d’une union interprofessionnelle des travailleurs d’un même secteur dans un cadre géographique beaucoup plus vaste". (Thiam, ibid.) 4
En effet, c’est dans ce contexte qu’on apprendra plus tard, dans un rapport de police tiré des archives, l’existence d’une fédération des associations des fonctionnaires coloniaux de l’AOF.
Mais dès qu’il prit connaissance de l’ampleur du danger que constituait à ses yeux le surgissement des groupes ouvriers fédérés, le Gouverneur ordonna une enquête sur les activités des syndicats émergents. Par la suite, il chargea son secrétaire général de briser les organisations et leurs responsables dans les termes suivants (selon Thiam) :
"1) voir s’il est possible de liquider tous les indigènes signalés ;
2) rechercher dans quelles conditions ils ont été engagés ;
3) ne pas donner la note jointe dans les services et la conserver dans votre tiroir, pour me la remettre personnellement avec ma note".
Quel vocabulaire, et quel cynique ce Monsieur le Gouverneur ! C’est donc en toute logique qu’il fit appliquer sa sale "mission" se traduisant effectivement par des révocations massives et par la "chasse à l’ouvrier" et à tout travailleur susceptible d’appartenir à une organisation syndicale ou autre. En clair, l’attitude du Gouverneur fut celle d’un chef d'État policier dans ses œuvres les plus criminelles et, en ce sens, il appliquait également la ségrégation entre ouvriers européens et ouvriers "indigènes", comme le montre ce document d’archive :
"Que les lois civiles métropolitaines soient étendues aux citoyens habitants les colonies, cela se conçoit puisqu’il s’agit de membres d’une société évoluée ou bien d’originaires habitués depuis longtemps à nos mœurs et à notre vie civique ; mais prétendre y assujettir des races sinon encore dans un état voisin de la barbarie, du moins tout à fait étrangères à notre civilisation, c’est souvent une impossibilité, quand ce n’est pas une erreur regrettable". (Thiam, ibid.)
Nous voilà devant un Gouverneur parfaitement méprisant en train de mener sa politique d’apartheid. En effet, non content d’avoir décidé de "liquider" les ouvriers indigènes, il se permit de surcroît de justifier ses actes par des théories ouvertement racistes.
Malgré cette politique criminelle anti-prolétarienne, la classe ouvrière de cette époque (ouvriers européens et africains) refusa de capituler en poursuivant la lutte de plus belle pour la défense de ses intérêts de classe.
Grève des cheminots en avril 1919
1919 fut une année de forte agitation sociale où plusieurs secteurs entrèrent en lutte pour diverses revendications, que ce soit d’ordre salarial ou concernant le droit de constituer des organisations de défense des intérêts des travailleurs.
Mais ce sont les cheminots les premiers qui entrèrent en grève cette année-là, entre le 13 et le 15 avril, en envoyant d’abord un avertissement à l’employeur :
"Le 8 avril 1919, soit sept mois à peine après la fin des hostilités, un mouvement de revendication éclata dans les services du chemin de fer Dakar - Saint-Louis (DSL) à l’initiative des travailleurs européens et indigènes sous la forme d’un télégramme anonyme ainsi libellé, adressé à l’Inspecteur général des travaux publics : "cheminots Dakar - Saint-Louis d’accord unanime présentent revendications suivantes : relèvement de soldes personnel européen et indigène, augmentation régulière et maintien indemnité, amélioration soldes et indemnités congés maladie… cesseront tout travail sous cent vingt heures, à partir ce jour, c'est-à-dire le douze avril, vingt quatre heures si pas réponse favorable sur tous points : signé Cheminots Dakar - Saint-Louis" ". (Thiam, ibid.)
Voilà le ton particulièrement ferme et combatif avec lequel les employés du chemin de fer annoncèrent leur intention de partir en grève, s’ils n'étaient pas entendus par leurs employeurs. De même, on doit noter le caractère unitaire des grévistes. Pour la première fois, de façon consciente, européens et africains décidèrent d’élaborer ensemble leur cahier de revendications. Là, nous sommes en face d’un geste d’internationalisme dont seule la classe ouvrière est authentiquement porteuse. C’est le pas de géant que purent franchir les cheminots en s’efforçant de dépasser sciemment les frontières ethniques que l’ennemi de classe établit régulièrement pour les diviser en vue de mieux les amener à la défaite.
Réaction des autorités face aux revendications des cheminots
À la réception du télégramme des ouvriers, le Gouverneur général convoqua les membres de son administration ainsi que les chefs de l’armée pour décider aussitôt la réquisition totale du personnel et de l’administration de la ligne du Dakar - Saint-Louis, placée sous les ordres de l’autorité militaire. En effet on peut lire ceci dans l’arrêté du Gouverneur :
"La troupe se servirait d’abord de la crosse de ses fusils. A une attaque à armes blanches, elle répondrait par l’usage de la baïonnette (…) Il serait indispensable à la troupe de faire usage des feux pour assurer la sécurité du personnel de l’administration qui serait en danger ainsi que la sienne propre (…)."
Et l’autorité française de conclure que les lois et les règlements régissant l’armée devenaient immédiatement applicables.
Pourtant, ni cette terrible décision à vocation décidément répressive, ni le tapage arrogant accompagnant sa mise en œuvre, ne réussirent à empêcher le déclenchement de la grève :
"A 18h 30, Lachère (chef civil du réseau) câblait au chef de la Fédération que "trains impairs pas partis aujourd’hui ; trains quatre et six partis, le deuxième arrêté à Rufisque (…)" et priait celui-ci de lui indiquer d’urgence la suite qu’il convient de donner aux revendications des travailleurs. En vérité le trafic avait été presque complètement paralysé. Il en était de même à Dakar, à Saint-Louis, à Rufisque. Tout le réseau était en grève, européens, comme africains (…) ; les arrestations opérées ici et là, les tentatives visant à opposer les travailleurs sur des bases raciales n’y firent rien. Ou bien le personnel se rendait dans les gares sans travailler, ou bien il faisait purement et simplement défection. Le 15 avril au matin, la grève fut totale à Rufisque. Aucun agent européen, ni africain n’était présent. En conséquence ordre fut donné de fermer la gare. C’était là que se trouvait le centre du mouvement de grève. Jamais le Sénégal n’avait connu un mouvement d’une telle ampleur. Pour la première fois une grève avait été conduite par des Européens et des Africains et réussie avec éclat, et à l’échelle territoriale. Les milieux économiques s’affolèrent. Giraud, président de la chambre de commerce, entra en contact avec les cheminots et tenta une action de conciliation. La Maison Maurel et Prom alerta sa direction à Bordeaux. La Maison Vieilles adressa à son siège marseillais ce télégramme alarmiste : "Situation intenable, agissez". Giraud revint à la charge, saisit directement le Président du Syndicat de défense des intérêts sénégalais (patronaux) à Bordeaux, stigmatisa la nonchalance des autorités". (Thiam, ibid.)
Panique et tremblement s'emparaient des dirigeants de l’administration coloniale face aux flammes de la lutte ouvrière. En effet, suite aux pressions du milieu économique de la colonie, à la fois sur ses dirigeants métropolitains et sur le gouvernement central, les autorités de Paris durent donner le feu vert en vue de négocier avec les grévistes. Dès lors, le Gouverneur général convoqua les représentants de ces derniers (au deuxième jour de la grève) avec des propositions allant dans le sens des revendications des grévistes. Et lorsque le Gouverneur signifia son désir de rencontrer les délégués des cheminots composés uniquement d’européens, les ouvriers répliquèrent en refusant de se rendre à la concertation sans la présence des délégués africains sur un même pied d’égalité de droits que leurs camarades blancs. En effet, les ouvriers grévistes se méfiaient de leurs interlocuteurs, non sans raison, car après avoir donné satisfaction aux cheminots sur les principaux points de leurs revendications, les autorités poursuivirent leurs manœuvres et tergiversèrent par rapport à certaines revendications des indigènes. Mais cela ne faisait qu’augmenter la combativité des cheminots, qui décidèrent aussitôt de repartir en grève, d’où à nouveau des pressions de la part des représentants de la bourgeoisie française à Dakar sur le gouvernement central de Paris. C'est ce que montrent les télégrammes suivants (Thiam, ibid.) :
"Il est urgent que satisfaction soit donnée de suite au personnel du DSL et décision soit notifiée sans tarder sinon nous risquons avoir nouvelle grève" (le représentant du gros commerce) ;
"Je vous demande instamment (…) donner approbation arbitrage Gouverneur Général transmis mon câble du 16…toute urgence avant le 1er mai, si allons (probablement si voulons) avoir nouvelle cessation de travail cette date" (le directeur du chemin de fer) ;
"Malgré mes conseils, grève va reprendre si compagnie donne pas satisfaction" (le Gouverneur général).
Visiblement, ce fut l’affolement général chez les autorités coloniales à tous les étages. Bref, au bout du compte, le gouvernement français donna son approbation à l’arbitrage de son Gouverneur en validant ainsi les accords négociés avec les grévistes, et le travail reprit le 16 avril. Une fois encore, la classe ouvrière arracha une belle victoire sur les forces du capital grâce notamment à son unité de classe exploitée par le même exploiteur, mais surtout au développement de sa conscience de classe.
Mais, en plus de la satisfaction des revendications des cheminots, ce mouvement eut d’autres retombées positives pour les autres travailleurs, en l’occurrence, la journée de 8 heures fut étendue à la colonie au lendemain de la grève. Cependant, face à la résistance du patronat pour l’accepter et face à la dynamique de lutte créée par les cheminots, des ouvriers d’autres branches durent eux aussi partir en lutte pour se faire entendre.
Grève des postiers
Ainsi, pour obtenir des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail, les agents des PTT de Saint-Louis partirent en grève le 1er mai 1919. Celle-ci dura 12 jours et se solda par une paralysie quasi-totale des services postaux. Devant l’ampleur du mouvement, l’autorité coloniale fit appel, par réquisition, à l’armée afin que celle-ci lui fournisse des forces spécialisées en matière postale pour assurer la continuité du service public. Mais ce corps militaire étant loin de pouvoir jouer efficacement les "jaunes", l’autorité administrative dut par conséquent se résoudre à négocier avec le comité de grève des postiers, auquel fut proposée une majoration des traitements de 100 %. En effet :
"La duplicité des autorités coloniales avait aussitôt relancé le mouvement de grève, qui avait repris avec vigueur renouvelée, tonifié sans aucun doute par les perspectives alléchantes qu’il avait un moment pu entrevoir. Il dura jusqu’au 12 mai et se termina par un succès total". (Thiam, ibid.)
Une fois de plus, voilà une victoire obtenue par les ouvriers des PTT, grâce à la pugnacité de leur combat. Décidément, les ouvriers se montraient de plus en plus conscients de leur force et de leur appartenance de classe.
En fait, toute la fonction publique avait été plus ou moins touchée par le mouvement. De même, de nombreuses catégories professionnelles purent bénéficier amplement des retombées du succès de la lutte déclenchée par les agents des PTT : après que ceux-ci eurent obtenu de fortes hausses de salaires, ce fut ensuite le cas pour des agents des travaux publics, des agents de la culture, des enseignants, des aide- médecins, etc. Mais le succès de ce mouvement ne s’arrêta pas là ; de nouveau les représentants du capital refusèrent d’abdiquer.
Menace d’une nouvelle grève des cheminots et manœuvres politiques de la bourgeoisie
Suite au mouvement des agents des PTT et six mois après la fin victorieuse de leur propre mouvement, les cheminots indigènes décidèrent de repartir en lutte sans leurs camarades européens en adressant aux autorités de nouvelles revendications :
"Dans cette lettre, nous demandons, notaient-ils, une amélioration de traitement et quelques modifications sur le règlement du Personnel indigène. (…) Nous nous permettons de vous dire que nous ne pouvons plus continuer à mener cette vie de galère et nous espérons que vous éviterez d’en arriver à des mesures dont seul vous serez responsable. (…) et nous voulons comme le personnel sédentaire (formé presque uniquement d’européens) être récompensés. Agissez à notre égard, comme vous agissez à leur égard, et tout ira pour le mieux". (Thiam, ibid.)
En fait, les cheminots indigènes voulaient bénéficier d'avantages matériels que certains fonctionnaires avaient acquis suite à la grève des agents PTT. Mais surtout ils réclamaient une égalité de traitement avec les cheminots européens, avec à la clé la menace d’une nouvelle grève.
"L’initiative des agents indigènes du D.S.L. avait, tout naturellement, suscité le plus vif intérêt du côté patronal. L’unité d’action grâce à laquelle le mouvement du 13 au 15 avril avait été couronné de succès ayant désormais vécu, il fallait tout faire, pour que le fossé nouveau qui venait se creuser entre travailleurs européens et africains ne soit jamais comblé. On aurait ainsi le meilleur moyen d’affaiblir le mouvement ouvrier, en le laissant s’épuiser dans des rivalités fratricides qui rendaient inefficace toute entreprise de coalition à venir.
L’administration du réseau s’employa, à partir de cette analyse, à accentuer les disparités pour augmenter la frustration des milieux indigènes dans l’espoir de rendre définitive la rupture amorcée". (Thiam, ibid.)
Par conséquent les responsables coloniaux passèrent cyniquement à l’acte en décidant, non pas d’ajuster les revenus des indigènes par rapport à ceux des européens, mais au contraire d’augmenter tapageusement les rémunérations de ces derniers, tout en tardant à satisfaire les revendications des cheminots autochtones, avec la volonté évidente de creuser l’écart entre les deux groupes pour mieux les dresser les uns contre les autres dans le but de les neutraliser.
Mais heureusement, sentant venir ce gros piège dans lequel les autorités coloniales voulaient les faire tomber, les cheminots indigènes surent éviter de partir en grève dans ces conditions, en décidant d’attendre des jours meilleurs. On constatera plus loin que, s’ils donnèrent l’impression d’avoir oublié l’importance de l’unité de classe dont ils avaient fait preuve précédemment en s’alliant avec leurs camarades européens, les cheminots indigènes purent cependant décider d’élargir leur mouvement à d’autres catégories ouvrières (employés de services publics et privés, européens comme africains). De toute façon, il convient de prendre en compte ici, chez les ouvriers, le caractère balbutiant de l’unité de classe doublé d’une conscience qui se développait lentement et en dents de scie. Rappelons aussi le fait que le pouvoir colonial institutionnalisa les divisions raciales et ethniques dès les premiers contacts entre les populations européennes et africaines. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura plus d’autres tentatives d’unité entre ouvriers européens et africains.
La révolte des marins sénégalais à Santos (Brésil) en 1920 : grève et répression
On apprend dans les souvenirs d’un consul français l’existence d’un mouvement de lutte mené par des marins du Vapeur Provence (immatriculé à Marseille) à Santos courant mai 1920, l’épisode montrant une lutte de solidarité ouvrière suivie d’une féroce répression policière. Voici comment ce diplomate relata l’évènement :
"Des actes d’indiscipline s’étant produits à bord du Vapeur Provence…, je me suis rendu à Santos et, après enquête, j’ai puni les principaux coupables. (…) 4 jours de prison et je les ai fait conduire à la prison de la ville dans l’intérêt de la sécurité du navire. (…) Tous les chauffeurs sénégalais se sont solidarisés avec leurs camarades, ont pris une attitude menaçante et ont voulu quitter le bord malgré ma défense formelle. (…) Et les sénégalais ont essayé de dégager leurs camarades, ont suivi les agents de police en proférant des menaces et des injures et l’autorité locale a dû finalement procéder à leur arrestation". (Thiam, ibid.)
En fait, il s’agissait d’ouvriers marins (chauffeurs, graisseurs, matelots) dont les uns étaient inscrits à Dakar et les autres à Marseille, employés par le gros commerce français pour assurer le transport des marchandises entre les trois continents. Le problème ici est que les notes du diplomate restent muettes sur la cause de la révolte. Il semble cependant que ce mouvement ait pu avoir un lien avec un autre fait précédent s'étant produit en 1919 quand des marins sénégalais, suite à une lutte, furent débarqués et remplacés par des européens (selon des sources policières). Suite à cela, après la grève, beaucoup de syndiqués indigènes décidèrent de quitter la CGT qui avait approuvé cette décision pour adhérer à la CGTU (cette dernière étant dissidente de la première).
En tous cas, cet événement semble avoir inquiété sérieusement les autorités coloniales comme le montre le récit suivant qui en est fait :
"Le consul fulminait de plus belle, demandait avec véhémence que les coupables soient déférés, dès leur arrivée à Dakar, devant les tribunaux compétents et traduisait sa surprise et son indignation en ces termes : "L’attitude de ces individus est telle qu’elle constitue un réel danger pour les navires sur lesquels ils seraient embarqués à l’avenir, et pour la sécurité des états-majors et des équipages. Ils sont animés du plus mauvais esprit, ont perdu, ou n’ont jamais eu, le moindre respect pour la discipline et se croient le droit de donner des ordres au commandant".
Il découvrit, sans doute, pour la première fois, l’état d’esprit des sénégalais après la Première Guerre mondiale et avait manifestement été scandalisé par leur esprit de contestation et leur détermination à ne pas accepter sans réagir ce qu’ils considéraient comme attentatoire à leurs droits et libertés. La classe ouvrière était en train de mûrir politiquement et syndicalement". (Thiam, ibid.)
Effectivement on assiste là à un magnifique combat de classe de la part des ouvriers marins qui, malgré le rapport de force qui leur était très défavorable, purent montrer à l’ennemi leur détermination à se faire respecter en étant solidaires dans la lutte.
1920 : la relance de l’action des cheminots se conclut victorieusement
On a vu que, suite au mouvement victorieux des agents des PTT (en 1919), les cheminots indigènes voulaient s’engouffrer dans cette brèche pour repartir en grève avant de décider finalement d’annuler leur action faute de conditions favorables.
Six mois après cet épisode, ils décidèrent de relancer pour de bon leur action revendicative. Le mouvement d’action des cheminots fut motivé d’abord par la dégradation générale des conditions de vie due aux conséquences désastreuses de la Grande Guerre, ayant accentué le mécontentement prévisible des travailleurs et de la population en général. En effet, le coût de la vie connut dans les principales villes des hausses vertigineuses. Ainsi, le prix du kilo de mil qui était en décembre 1919 de 0,75 F avait été multiplié par trois en l’espace de quatre mois. Et le kilo de viande était passé de 5 à 7 F, de poulet de 6 à 10 F, etc.
Ce fut une note de l’Inspecteur général des Travaux publics le 13 avril, dans laquelle il demandait à ses supérieurs administratifs de ne pas appliquer la loi sur la journée de huit heures dans la colonie, qui fit déborder le vase en ravivant aussitôt le mécontentement latent qui couvait chez les cheminots depuis leur mouvement revendicatif de décembre 1919. Et de fait les ouvriers du rail passèrent à l’action le premier juin 1920 :
"C’était là le premier mouvement de grève mené à l’échelle ethnique par les ouvriers du chemin de fer, ce qui explique la rapidité et l’unanimité avec lesquelles les milieux économiques accueillirent l’événement et résolurent d’y porter remède. (…) Dès le premier juin, ils tenaient les États Généraux du commerce colonial au Sénégal, adressaient au chef de la Fédération leur préoccupation, et l’invitaient à ne pas assister en spectateur à la détérioration en cours du climat social". (Thiam, ibid.)
Les cheminots indigènes décidèrent ainsi de se lancer dans un nouveau bras de fer avec les autorités coloniales afin de faire aboutir les mêmes revendications. Mais, cette fois-ci, les cheminots africains semblèrent avoir tiré les leçons de l’action avortée, en élargissant la base sociale du mouvement, avec plusieurs délégués représentant chaque corps de métier, pleinement investis pour négocier collectivement avec les responsables politiques et économiques. Précisément, dès le deuxième jour de la grève, l’inquiétude grandit chez les principaux responsables coloniaux. Ainsi alerté par les décideurs économiques de Dakar, le ministre des colonies envoya un câble au Gouverneur dont les termes sont les suivants :
"On me signale que par suite grève 35 000 tonnes graines non abritées seraient en souffrance dans différentes stations du Dakar - Saint- Louis".
A partir de là, la pression fut renforcée sur le directeur du réseau ferré pour le pousser à répondre aux revendications des salariés. Et le "chef de gare" de répondre à ses supérieurs comme suit :
"Nous craignons que si une nouvelle augmentation de salaire aussi forte et aussi peu justifiée était accordée, il en résulte une répercussion générale sur les prétentions de tout le personnel et un encouragement à nous présenter de nouvelles demandes".
Dès lors, la Direction du réseau s’efforça d’emblée de briser la grève en jouant les blancs contre les noirs (ce qui lui avait réussi précédemment). Ainsi, au 3e jour du mouvement, elle parvenait même à composer un train de marchandises et de voyageurs grâce au concours d’un mécanicien européen et de chauffeurs de la Marine sous bonne escorte des forces de l’ordre. Mais, quand la Direction voulut jouer à nouveau ce scénario, elle ne trouva aucun salarié pour se prêter à son jeu car, cette fois-ci, les cheminots européens avaient décidé de rester "neutres", à la suite de fortes pressions exercées sur eux par les grévistes indigènes. Et la suite on l’entendra dans un compte-rendu du délégué du Gouverneur du Sénégal 5 : "Les agents de Dakar - Saint-Louis ont déclaré que, si au bout d’un mois, ils n’ont pas satisfaction, ils quitteront Dakar pour aller cultiver des lougans 6 dans l’intérieur de la colonie".
Dès cet instant, le Gouverneur du Sénégal convoqua aussitôt (au 6e jour de la grève) l’ensemble des partenaires sociaux pour leur notifier une série de mesures élaborées par ses propres services en vue de satisfaire les revendications des grévistes et, au bout du compte, les grévistes obtinrent ce qu'ils voulaient. En clair, les ouvriers remportèrent ainsi une nouvelle victoire grâce à leur combativité et à une meilleure organisation de la grève, et c’est bien cela qui leur permit d’imposer un rapport de force aux représentants de la bourgeoisie :
"Ce qui en revanche paraît sûr, c’est que la mentalité ouvrière au fil des épreuves s’affermissait et s’affinait de plus en plus et concevait au regard des enjeux en cause des formes de lutte plus étendues et des tentatives de coordination syndicale dans une sorte de large front de classe, face à un patronat de combat". (Thiam, ibid.)
Mais plus significatif encore dans cette montée du développement du front de classe, ce fut le 1er juin 1920, le jour où les cheminots venaient de déclencher la grève et le fait "que les équipages des remorqueurs cessaient le travail quelques heures plus tard, malgré la promesse qu’ils avaient donnée, notait le Délégué du Gouverneur, d’attendre le résultat des pourparlers qu’avait été chargé de conduire Martin, le chef du service de l’inspection maritime. Nous avons donc là, la première tentative délibérée de coordination volontaire de mouvements de grève simultanés déclenchés par (…) des cheminots et des ouvriers des équipages du port, c'est-à-dire, les personnels des deux secteurs qui constituaient les poumons de la colonie dont la paralysie concertée bloquait toute activité économique, commerciale, à l’entrée comme à la sortie (…). La situation paraissait plus préoccupante encore (pour l’Administration), puisque les boulangers de Dakar avaient eux aussi menacé de se mettre en grève, précisément le 1er juin et auraient sans nul doute tenu parole si des augmentations immédiates de salaires ne leur avaient pas été concédées." (Thiam, ibid.)
De même, au même moment, d’autres mouvements de grève éclatèrent simultanément aux chantiers Han/Thiaroye et aux chantiers de la route de Dakar à Rufisque. Les sources policières qui relatent cet événement ne disent rien sur l’origine de l’éclatement simultané de ces différents mouvements. Cependant, un recoupement de plusieurs éléments d’information de la même police coloniale permet de conclure que l’extension du mouvement de lutte n’était pas sans lien avec la tentative du Gouverneur de briser la grève des transports maritimes. En effet, sans le dire ouvertement, le représentant de l'État colonial fit d’abord appel à la Marine en compagnie de quelques équipages civils européens pour assurer les services de transport entre Dakar et Gorée 7. Et cela semble avoir provoqué des actions de solidarité chez les ouvriers d’autres secteurs :
"Cette intervention de l'État aux côtés du patronat avait-elle suscité la solidarité d’autres branches professionnelles ? Sans pouvoir l’affirmer de manière péremptoire, nous ne pouvons ne pas noter la grève qui éclata presque simultanément aux tentatives visant à briser le mouvement de revendication des équipages, dans les travaux publics". (Thiam, ibid.)
En effet, on sait qu’au bout du 5e jour, le mouvement s’effritait sous le double effet de la répression étatique et des rumeurs faisant état de la décision du patronat de remplacer les grévistes par des "jaunes".
"Les travailleurs, sentant que la durée de leur lutte et l’intervention des militaires pouvaient modifier le rapport des forces et compromettre l’heureux aboutissement de leur action, avaient, au septième jour de leur action de grève assoupli leurs exigences initiales en formulant leur plateforme sur les bases suivantes (…). L’Administration et le patronat firent front pour rejeter ces nouvelles propositions, obligeant ainsi les grévistes à poursuivre désespérément leur mouvement ou bien à l’arrêter aux conditions des autorités locales. Ils optèrent pour cette dernière solution". (Thiam, ibid.).
En clair, les grévistes durent effectivement reprendre le travail avec leur ancien salaire plus la "ration", en constatant la modification du rapport des forces nettement en faveur de la bourgeoisie et tout en mesurant les dangers encourus dans la poursuite de leur mouvement dans l’isolement. On peut dire qu’ici la classe ouvrière a bien subi une défaite mais le fait d'avoir su reculer en bon ordre a permis que celle-ci ne soit pas davantage profonde, ni à même d'effacer dans la conscience ouvrière les victoires plus nombreuses et plus importantes qu'elle avait remportées.
En résumé, cette période allant de 1914 à 1920 fut fortement marquée par d’intenses affrontements de classe entre la bourgeoisie coloniale et la classe ouvrière qui émergeait dans la colonie de l’AOF, cela dans un contexte révolutionnaire à l’échelle mondiale, ce dont le capital français prit pleinement conscience car se sentant fortement bousculé par le prolétariat en lutte exemplaire.
"Les activités du mouvement communiste mondial connurent pendant la même période, un développement ininterrompu marqué notamment par l’entrée en scène du premier africain de formation marxiste 8 ; rompant avec l’approche utopique que ses frères avaient des problèmes coloniaux, il tenta la première explication autochtone connue dans l’état actuel des sources, et la première critique sérieuse et approfondie du colonialisme, en tant que système organisé d’exploitation et de domination". (Thiam, ibid.)
Précisément, parmi les ouvriers qui se portèrent à la tête des mouvements de grève au Sénégal dans la période 1914/1920, certains purent côtoyer d’anciens "jeunes tirailleurs" immobilisés ou rescapés de la Première Guerre mondiale. Par exemple, les mêmes sources font part de l’existence, à l’époque, d’une petite poignée de syndicalistes sénégalais dont un certain Louis Ndiaye (jeune marin de 13 ans) qui fut militant de la CGT dès 1905 et le représentant de cette organisation dans les colonies entre 1914 et 1930. Par ailleurs, comme beaucoup d’autres jeunes "tirailleurs", il fut mobilisé en 1914/18, dans la Marine où il faillit périr. De même, avec un autre jeune sénégalais, en l’occurrence Lamine Senghor (proche du PCF dans les années 1920), ils furent, tous deux, sensiblement influencés par les idées de l’Internationale communiste. En ce sens, en compagnie d’autres figures des années 1920, on les considérait comme ayant joué un rôle majeur et dynamisant dans le processus de politisation et de développement de la conscience de classe dans les rangs ouvriers de la première colonie de l’AOF.
Lassou (à suivre)
1 Ce terme désignait à l'époque le commerce autre que local, essentiellement l'import / export contrôlé par quelques familles.
2 Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Éditions L’Harmattan, 1991.
3 Voir Afrique noire, l'Ère coloniale 1900- 1945. Jean Suret-Canale , Éditions Sociales, Paris 1961.
4 Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations". De manière plus générale, nous soulignons à nouveau ici que si les syndicats ont, dans une première période de la vie du capitalisme, effectivement constitué de véritables organes de la lutte de la classe ouvrière en vue de la défense de ses intérêts immédiats au sein du capitalisme, ils ont par la suite été intégrés à l'Etat capitaliste et ont définitivement perdu toute possibilité d'être utilisés par la classe ouvrière dans son combat contre l'exploitation.
5 Le Gouverneur du Sénégal était le subalterne du Gouverneur général de l'AOF.
6 Champs créés sur brûlis.
7 Île sénégalaise située dans la baie de Dakar.
8 Il s'agissait de Lamine Senghor.
Géographique:
- Afrique [162]
Résolution sur la situation internationale du XIXe congrès du CCI
- 1559 lectures
Crise économique
1) La résolution adoptée par le précédent congrès du CCI mettait d'emblée en évidence le démenti cinglant infligé par la réalité aux prévisions optimistes des dirigeants de la classe bourgeoise au début de la dernière décennie du 20e siècle, particulièrement après l'effondrement de cet "Empire du mal" que constituait le bloc impérialiste dit "socialiste". Elle citait la déclaration désormais fameuse du président George Bush senior de mars 1991 annonçant la naissance d'un "Nouvel Ordre mondial" basé sur le "respect du droit international" et elle soulignait son caractère surréaliste face au chaos croissant dans lequel s'enfonce aujourd'hui la société capitaliste. Vingt ans après ce discours "prophétique", et particulièrement depuis le début de cette nouvelle décennie, jamais, depuis la fin de la seconde guerre mondiale le monde n'a donné une telle image de chaos. A quelques semaines d'intervalle on a assisté à une nouvelle guerre en Libye, venant s'ajouter à la liste de tous les conflits sanglants qui ont touché la planète au cours de la dernière période, à de nouveaux massacres en Côte d'Ivoire et aussi à la tragédie qui a frappé un des pays les plus puissants et modernes du monde, le Japon. Le tremblement de terre qui a ravagé une partie de ce pays a souligné une nouvelle fois qu'il n'existe pas des "catastrophes naturelles" mais des conséquences catastrophiques à des phénomènes naturels. Il a montré que la société dispose aujourd'hui de moyens pour construire des bâtiments qui résistent aux séismes et qui permettraient d'éviter des tragédies comme celle d'Haïti l'an dernier. Mais il a montré aussi toute l'imprévoyance dont même un État aussi avancé que le Japon peut faire preuve : le séisme en lui-même a fait peu de victimes mais le tsunami qui l'a suivi a tué près de 30 000 êtres humains en quelques minutes. Plus encore, en provoquant un nouveau Tchernobyl, il a mis en lumière, non seulement l'imprévoyance de la classe dominante, mais aussi sa démarche d'apprenti sorcier, incapable de maîtriser les forces qu'elle a mises en mouvement. Ce n'est pas l'entreprise Tepco, l'exploitant de la centrale atomique de Fukushima qui est le premier, encore moins l'unique responsable de la catastrophe. C'est le système capitaliste dans son ensemble, basé sur la recherche effrénée du profit ainsi que sur la compétition entre secteurs nationaux et non sur la satisfaction des besoins de l'humanité, qui porte la responsabilité fondamentale des catastrophes présentes et futures subies par l'espèce humaine. En fin de compte, le Tchernobyl japonais constitue une nouvelle illustration de la faillite ultime du mode de production capitaliste, un système dont la survie constitue une menace croissante pour la survie de l'humanité elle-même.
2) C'est évidemment la crise que subit actuellement le capitalisme mondial qui exprime le plus directement la faillite historique de ce mode de production. Il y a deux ans, la bourgeoisie de tous les pays était saisie d'une sainte panique devant la gravité de la situation économique. L'OCDE n'hésitait pas à écrire : "L’économie mondiale est en proie à sa récession la plus profonde et la plus synchronisée depuis des décennies" (Rapport intermédiaire de mars 2009). Quand on sait avec quelle modération cette vénérable institution s'exprime habituellement, on peut se faire une idée de l'effroi que ressentait la classe dominante face à la faillite potentielle du système financier international, la chute brutale du commerce mondial (plus de 13% en 2009), la brutalité de la récession des principales économies, la vague de faillites frappant ou menaçant des entreprises emblématiques de l'industrie telles General Motors ou Chrysler. Cet effroi de la bourgeoisie l'avait conduite à convoquer les sommets du G20 dont celui de mars 2009 à Londres décidant notamment le doublement des réserves du Fonds monétaire international et l'injection massive de liquidités dans l'économie par les États afin de sauver un système bancaire en perdition et de relancer la production. Le spectre de la "Grande Dépression des années 1930" hantait les esprits ce qui conduisait la même OCDE à conjurer de tels démons en écrivant : "Bien qu’on ait parfois qualifié cette sévère récession mondiale de ‘grande récession’, on reste loin d’une nouvelle ‘grande dépression’ comme celle des années 30, grâce à la qualité et à l’intensité des mesures que les gouvernements prennent actuellement" (Ibid.). Mais comme le disait la résolution du 18e congrès, "le propre des discours de la classe dominante aujourd'hui est d’oublier les discours de la veille" et le même rapport intermédiaire de l'OCDE du printemps 2011 exprime un véritable soulagement face à la restauration de la situation du système bancaire et à la reprise économique. La classe dominante ne peut faire autrement. Incapable de se donner une vision lucide, d'ensemble et historique des difficultés que rencontre son système, car une telle vision la conduirait à découvrir l'impasse définitive dans laquelle se trouve ce dernier, elle en est réduite à commenter au jour le jour les fluctuations de la situation immédiate en essayant de trouver dans celle-ci des motifs de consolation. Ce faisant, elle en est amenée à sous-estimer, même si, de temps en temps, les médias adoptent un ton alarmiste à son sujet, la signification du phénomène majeur qui s'est fait jour depuis deux ans : la crise de la dette souveraine d'un certain nombre d'États européens. En fait, cette faillite potentielle d'un nombre croissant d'États constitue une nouvelle étape dans l'enfoncement du capitalisme dans sa crise insurmontable. Elle met en relief les limites des politiques par lesquelles la bourgeoisie a réussi à freiner l'évolution de la crise capitaliste depuis plusieurs décennies.
3) Cela fait maintenant plus de 40 ans que le système capitaliste se confronte à la crise. Mai 68 en France et l'ensemble des luttes prolétariennes qui ont suivi internationalement n'ont connu cette ampleur que parce qu'ils étaient alimentés par une aggravation mondiale des conditions de vie de la classe ouvrière, une aggravation résultant des premières atteintes de la crise capitaliste, notamment la montée du chômage. Cette crise a connu une brutale accélération en 1973-75 avec la première grande récession internationale de l'après guerre. Depuis, de nouvelles récessions, chaque fois plus profondes et étendues, ont frappé l'économie mondiale jusqu'à culminer avec celle de 2008-2009 qui a ramené dans les consciences le spectre des années 1930. Les mesures adoptées par le G20 de mars 2009 pour éviter une nouvelle "Grande Dépression" sont significatives de la politique menée depuis plusieurs décennies par la classe dominante : elles se résument par l'injection dans les économies de masses considérables de crédits. De telles mesures ne sont pas nouvelles. En fait, depuis plus de 35 ans, elles constituent le cœur des politiques menées par la classe dominante pour tenter d'échapper à la contradiction majeure du mode de production capitaliste : son incapacité à trouver des marchés solvables en mesure d'absorber sa production. La récession de 1973-75 avait été surmontée par des crédits massifs aux pays du Tiers-Monde mais, dès le début des années 1980, avec la crise de la dette de ces pays, la bourgeoise des pays les plus développés avait dû renoncer à ce poumon pour son économie. Ce sont alors les États des pays les plus avancés, et au premier lieu celui des États-Unis, qui ont pris la relève en tant que "locomotive" de l'économie mondiale. Les "reaganomics" (politique néolibérale de l'Administration Reagan) du début des années 80, qui avaient permis une relance significative de l'économie de ce pays, étaient basées sur un creusement inédit et considérable des déficits budgétaires alors que Ronald Reagan déclarait au même moment que "L'État n'est pas la solution, c'est le problème". En même temps, les déficits commerciaux également considérables de cette puissance permettaient aux marchandises produites par les autres pays de trouver à s'y écouler. Au cours des années 1990, les "tigres" et les "dragons" asiatiques (Singapour, Taïwan, Corée du Sud, etc.) ont accompagné pour un temps les États-Unis dans ce rôle de "locomotive" : leurs taux de croissance spectaculaires en faisaient une destination importante pour les marchandises des pays les plus industrialisés. Mais cette "success story" s'est construite au prix d'un endettement considérable qui a conduit ces pays à des convulsions majeures en 1997 au même titre que la Russie "nouvelle" et "démocratique" qui s'est retrouvée en cessation de paiements ce qui a déçu cruellement ceux qui avaient misé sur la "fin du communisme" pour relancer durablement l’économie mondiale. Au début des années 2000 l’endettement a connu une nouvelle accélération, notamment grâce au développement faramineux des prêts hypothécaires à la construction dans plusieurs pays, en particulier aux États-Unis. Ce dernier pays a alors accentué son rôle de "locomotive de l’économie mondiale" mais au prix d’une croissance abyssale des dettes, -notamment au sein de la population américaine- basées sur toutes sortes de "produits financiers" censés prévenir les risques de cessation de paiement. En réalité, la dispersion des créances douteuses n’a nullement aboli leur caractère d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’économie américaine et mondiale. Bien au contraire, elle n’a fait qu’accumuler dans le capital des banques les "actifs toxiques" à l’origine de leur effondrement à partir de 2007 et de la brutale récession mondiale de 2008-2009.
4) Ainsi, comme le disait la résolution adoptée au précédent congrès, "ce n’est pas la crise financière qui est à l’origine de la récession actuelle. Bien au contraire, la crise financière ne fait qu’illustrer le fait que la fuite en avant dans l’endettement qui avait permis de surmonter la surproduction ne peut se poursuivre indéfiniment. Tôt ou tard, "l’économie réelle" se venge, c’est-à-dire que ce qui est à la base des contradictions du capitalisme, la surproduction, l’incapacité des marchés à absorber la totalité des marchandises produites, revient au devant de la scène." Et cette même résolution précisait, après le sommet du G20 de mars 2009, que "la fuite en avant dans l’endettement est un des ingrédients de la brutalité de la récession actuelle. La seule ‘solution’ que soit capable de mettre en œuvre la bourgeoisie est… une nouvelle fuite en avant dans l’endettement. Le G20 n’a pu inventer de solution à une crise pour la bonne raison qu’il n’existe pas de solution à celle-ci."
La crise des dettes souveraines qui se propage aujourd'hui, le fait que les États soient incapables d'honorer leurs dettes, constitue une illustration spectaculaire de cette réalité. La faillite potentielle du système bancaire et la récession ont obligé tous les États à injecter des sommes considérables dans leur économie alors même que les recettes étaient en chute libre du fait du recul de la production. De ce fait les déficits publics ont connu, dans la plupart des pays, une augmentation considérable. Pour les plus exposés d'entre eux, comme l'Irlande, la Grèce ou le Portugal, cela a signifié une situation de faillite potentielle, l'incapacité de payer leurs fonctionnaires et de rembourser leurs dettes. Les banques se refusent désormais à leur consentir de nouveaux prêts, sinon à des taux exorbitants, puisqu'elles n'ont aucune garantie de pouvoir être remboursées. Les "plans de sauvetage" dont ils ont bénéficié de la part de la Banque européenne et du Fonds monétaire international constituent de nouvelles dettes dont le remboursement s'ajoute à celui des dettes précédentes. C'est plus qu'un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. La seule "efficacité" de ces plans consiste dans l'attaque sans précédent contre les travailleurs qu'ils représentent, contre les fonctionnaires dont les salaires et les effectifs sont réduits de façon drastique, mais aussi contre l'ensemble de la classe ouvrière à travers les coupes claires dans l'éducation, la santé et les pensions de retraite ainsi que par des augmentations majeures des impôts et taxes. Mais toutes ces attaques anti-ouvrières, en amputant massivement le pouvoir d'achat des travailleurs, ne pourront qu'apporter une contribution supplémentaire à une nouvelle récession.
5) La crise de la dette souveraine des PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne) ne constitue qu'une part infime du séisme qui menace l'économie mondiale. Ce n'est pas parce qu'elles bénéficient encore pour le moment de la note AAA dans l'indice de confiance des agences de notation (les mêmes agences qui, jusqu'à la veille de la débandade des banques en 2008, leur avaient accordé la note maximale) que les grandes puissances industrielles s'en tirent beaucoup mieux. Fin avril 2011, l'agence Standard and Poor's émettait une opinion négative face à la perspective d'un Quantitative Easing n° 3, c'est-à-dire un 3e plan de relance de l'État fédéral américain destiné à soutenir l'économie. En d'autres termes, la première puissance mondiale court le risque de se voir retirer la confiance "officielle" sur sa capacité à rembourser ses dettes, si ce n'est avec un dollar fortement dévalué. En fait, de façon officieuse, cette confiance commence à faire défaut avec la décision de la Chine et du Japon depuis l'automne dernier d'acheter massivement de l'or et des matières premières en lieu et place des bons du Trésor américain ce qui conduit la Banque fédérale américaine à en acheter maintenant de 70% à 90% à leur émission. Et cette perte de confiance se justifie parfaitement quand on constate l'incroyable niveau d'endettement de l'économie américaine : en janvier 2010, l'endettement public (État fédéral, États, municipalités, etc.) représentait déjà près de 100% du PIB ce qui ne constituait qu'une partie de l'endettement total du pays (qui comprend également les dettes des ménages et des entreprises non financières) se montant à 300% du PIB. Et la situation n'était pas meilleure pour les autres grands pays où la dette totale représentait à la même date des montants de 280% du PIB pour l’Allemagne, 320% pour la France, 470% pour le Royaume-Uni et le Japon. Dans ce dernier pays, la dette publique à elle seule atteignait 200% du PIB. Et depuis, pour tous les pays, la situation n'a fait que s'aggraver avec les divers plans de relance.
Ainsi, la faillite des PIIGS ne constitue que la pointe émergée de la faillite d'une économie mondiale qui n'a dû sa survie depuis des décennies qu'à la fuite en avant désespérée dans l'endettement. Les États qui disposent de leur propre monnaie comme le Royaume-Uni, le Japon et évidemment les États-Unis ont pu masquer cette faillite en faisant fonctionner à tout va la planche à billets (au contraire de ceux de la zone Euro, comme la Grèce, l'Irlande ou le Portugal, qui ne disposent pas de cette possibilité). Mais cette tricherie permanente des États qui sont devenus de véritables faux-monnayeurs, avec comme chef de gang l'État américain, ne pourra se poursuivre indéfiniment de la même façon que ne pouvaient pas se poursuivre les tricheries du système financier comme l'a démontré la crise de celui-ci en 2008 qui a failli le faire exploser. Un des signes visibles de cette réalité est l'accélération actuelle de l'inflation mondiale. En basculant de la sphère des banques à celles des États, la crise de l'endettement ne fait que marquer l'entrée du mode de production capitaliste dans une nouvelle phase de sa crise aiguë où vont s'aggraver encore de façon considérable la violence et l'étendue de ses convulsions. Il n'y a pas de "sortie du tunnel" pour le capitalisme. Ce système ne peut qu'entraîner la société dans une barbarie toujours croissante.
Tensions impérialistes
6) La guerre impérialiste constitue la manifestation majeure de la barbarie dans laquelle le capitalisme décadent précipite la société humaine. L'histoire tragique du 20e siècle en constitue la manifestation la plus évidente : face à l'impasse historique dans laquelle se trouve son mode de production, face à l'exacerbation des rivalités commerciales entre États, la classe dominante est conduite à une fuite en avant dans les politiques guerrières, dans les affrontements militaires. Pour la plupart des historiens, y compris ceux qui ne se réclament pas du marxisme, il est clair que la Seconde Guerre mondiale est fille de la Grande Dépression des années 1930. De même, l'aggravation des tensions impérialistes de la fin des années 1970 et du début des années 1980 entre les deux blocs d'alors, l'américain et le russe (invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979, croisade contre "l'Empire du mal" de l'administration Reagan) découlaient pour une grande partie du retour de la crise ouverte de l'économie capitaliste à la fin des années 1960. Cependant, l'histoire a montré que ce lien entre aggravation des affrontements impérialistes et crise économique du capitalisme n'est pas direct ou immédiat. L'intensification de la "guerre froide" s'est finalement soldée par la victoire du bloc occidental et par l'implosion du bloc adverse, laquelle a conduit en retour à la désagrégation du premier. Mais s'il échappait à la menace d'une nouvelle guerre généralisée qui pouvait aboutir à la disparition de l'espèce humaine, le monde n'a pu s'épargner une explosion des tensions et des affrontements militaires : la fin des blocs rivaux a signifié la fin de la discipline qu'ils réussissaient à imposer dans leurs territoires respectifs. Depuis, l'arène impérialiste planétaire est dominée par la tentative de la première puissance mondiale de maintenir son leadership sur le monde, et en premier lieu sur ses anciens alliés. La 1e Guerre du Golfe, en 1991, avait déjà cet objectif mais l'histoire des années 1990, particulièrement la guerre en Yougoslavie, a montré la faillite de cette ambition. La "guerre contre le terrorisme mondial" déclarée par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001 se voulait une nouvelle tentative pour réaffirmer leur leadership, mais leur enlisement en Afghanistan et en Irak a souligné une nouvelle fois l'incapacité de rétablir ce leadership.
7) Ces échecs des États-Unis n'ont pas découragé cette puissance à poursuivre la politique offensive qu'elle mène depuis le début des années 1990 et qui fait d'elle le principal facteur d'instabilité sur la scène mondiale. Comme le disait la résolution du précédent congrès : "Face à cette situation, Obama et son administration ne pourront pas faire autre chose que poursuivre la politique belliciste de leurs prédécesseurs" (…) "si Obama a prévu de retirer les forces américaines d'Irak, c'est pour pouvoir renforcer leur engagement en Afghanistan et au Pakistan". C'est ce qui s'est illustré récemment avec l'exécution de Ben Laden par un commando américain sur le territoire pakistanais. Cette opération "héroïque" avait évidemment une vocation électorale à un an et demi des élections américaines. Elle visait notamment à contrer les critiques des républicains qui reprochaient à Obama sa mollesse dans l'affirmation de la prééminence des États-Unis sur le plan militaire, des critiques qui s'étaient radicalisées lors de l'intervention en Libye où le leadership de l'opération avait été laissé au tandem franco-britannique. Elle signifiait aussi qu'après avoir fait jouer à Ben Laden le rôle du méchant de l'histoire pendant près de 10 ans, il était temps de s'en débarrasser sous peine d'apparaître comme impuissants. Ce faisant, la puissance américaine faisait la preuve qu'elle est la seule à avoir les moyens militaires, technologiques et logistiques de réussir ce genre d'opération, justement au moment où la France et le Royaume-Uni peinent à mener à bien leur opération anti-Kadhafi. Elle signifiait au monde qu'elle n'hésitait pas à violer la "souveraineté nationale" d'un "allié", qu'elle entendait fixer les règles du jeu partout où elle l'estimait nécessaire. Enfin, elle réussissait à obliger la plupart des gouvernements du monde à saluer, souvent à leur cœur défendant, la valeur de cet exploit.
8) Cela-dit, le coup d'éclat réussi par Obama au Pakistan ne saurait en aucune façon lui permettre de stabiliser la situation dans la région, notamment au Pakistan même où ce camouflet subi par sa "fierté nationale" risque d'attiser les conflits anciens entre divers secteurs de la bourgeoisie et de l'appareil d'État. De même, la mort de Ben Laden ne permettra pas aux États-Unis et aux autres pays engagés en Afghanistan de reprendre le contrôle du pays et d'asseoir l'autorité d'un gouvernement Karzaï complètement miné par la corruption et le tribalisme. Plus généralement, elle ne permettra nullement de mettre un frein aux tendances au "chacun pour soi" et à la contestation de l'autorité de la première puissance mondiale telle qu'elle continue à se manifester, comme on l'a vu récemment avec la constitution d'une série d’alliances ponctuelles surprenantes : rapprochement entre la Turquie et l’Iran, alliance entre l’Iran, le Brésil et le Venezuela, (stratégique et anti-USA), entre l’Inde et Israël (militaire et rupture d’isolement), entre la Chine et l’Arabie Saoudite (militaire et stratégique), etc. En particulier, elle ne saurait décourager la Chine de faire prévaloir les ambitions impérialistes que lui permet son statut récent de grande puissance industrielle. Il est clair que ce pays, malgré son importance démographique et économique, n'a absolument pas les moyens militaires ou technologiques, et n'est pas prêt de les avoir, de constituer une nouvelle tête de bloc. Cependant, il a les moyens de perturber encore plus les ambitions américaines – que ce soit en Afrique, en Iran, en Corée du Nord, en Birmanie, et d'apporter sa pierre à l'instabilité croissante qui caractérise les rapports impérialistes. Le "nouvel ordre mondial" prédit il y a 20 ans par George Bush père, et que celui-ci rêvait sous l'égide des États-Unis, ne peut que se présenter toujours plus comme un "chaos mondial", un chaos que les convulsions de l'économie capitaliste ne pourront qu'aggraver encore.
Lutte de classe
9) Face à ce chaos qui affecte la société bourgeoise sur tous les plans - économique, guerrier et aussi environnemental, comme on l'a vu encore récemment au Japon - seul le prolétariat peut apporter une solution, SA solution, la révolution communiste. La crise insoluble de l'économie capitaliste, les convulsions toujours croissantes qu'elle va connaître, constituent les conditions objectives pour celle-ci. D'une part en obligeant la classe ouvrière à développer de façon croissante ses luttes face aux attaques dramatiques qu'elle va subir de la part de la classe exploiteuse. D'autre part en lui permettant de comprendre que ces luttes prennent toute leur signification comme moments de préparation de son affrontement décisif avec un mode de production - le capitalisme - condamné par l'histoire, en vue de son renversement.
Cependant, comme le disait la résolution du précédent congrès international : "Le chemin est encore long et difficile qui conduit aux combats révolutionnaires et au renversement du capitalisme. (…) Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives." De façon beaucoup plus immédiate, la résolution précisait que "la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. (…) C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de 'relance' de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus."
10) Les deux années qui nous séparent du précédent congrès ont amplement confirmé cette prévision. Cette période n'a pas connu de luttes d'ampleur contre les licenciements massifs et la montée du chômage sans précédent subis par la classe ouvrière dans les pays les plus développés. En revanche, c'est à partir des attaques portées directement par les gouvernements en application des plans "d'assainissement des comptes publics" qu'ont commencé à se développer des luttes significatives. Cette réponse est encore très timide, notamment là où ces plans d'austérité ont pris les formes les plus violentes, dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne par exemple où, pourtant, la classe ouvrière avait fait preuve dans un passé récent d'une combativité relativement importante. D'une certaine façon, il semble que la brutalité même des attaques provoque un sentiment d'impuissance dans les rangs ouvriers, d'autant plus qu'elles sont conduites par des gouvernements "de gauche". Paradoxalement, c'est là où ces attaques semblent les moins violentes, en France par exemple, que la combativité ouvrière s'est exprimée le plus massivement avec le mouvement contre la réforme des retraites de l'automne 2010.
11) En même temps, les mouvements les plus massifs qu'on ait connus au cours de la dernière période ne sont pas venus des pays les plus industrialisés mais des pays de la périphérie du capitalisme, notamment dans un certain nombre de pays du monde arabe, particulièrement la Tunisie et l'Égypte où, finalement, après avoir tenté de les museler par une répression féroce, la bourgeoisie a été conduite à licencier les dictateurs en place. Ces mouvements n'étaient pas des luttes ouvrières classiques comme ces pays en avaient déjà connues dans un passé récent (par exemple les luttes à Gafsa en Tunisie en 2008 ou les grèves massives dans l’industrie textile en Égypte, durant l’été 2007, rencontrant la solidarité active de la part de nombreux autres secteurs). Ils ont pris souvent la forme de révoltes sociales où se trouvaient associés toutes sortes de secteurs de la société : travailleurs du public et du privé, chômeurs, mais aussi des petits commerçants, des artisans, les professions libérales, la jeunesse scolarisée, etc. C'est pour cela que le prolétariat, la plupart du temps, n'y est pas apparu directement de façon distincte (comme il est apparu, par exemple, dans les grèves en Égypte vers la fin des révoltes), encore moins en assumant le rôle de force dirigeante. Cependant, à l'origine de ces mouvements (ce qui se reflétait dans beaucoup des revendications mises en avant) on trouve fondamentalement les mêmes causes à l'origine des luttes ouvrières dans les autres pays : l'aggravation considérable de la crise, la misère croissante qu'elle provoque au sein de l'ensemble de la population non exploiteuse. Et si en général le prolétariat n'est pas apparu directement comme classe dans ces mouvements, son empreinte y était présente dans les pays où il a un poids significatif, notamment par la profonde solidarité qui se manifestait dans les révoltes, leur capacité à éviter de se lancer dans des actes de violence aveugle et désespérée malgré la terrible répression qu'ils ont dû affronter. En fin de compte, si la bourgeoisie en Tunisie et en Égypte s'est finalement résolue, sur les bons conseils de la bourgeoisie américaine, à se débarrasser des vieux dictateurs, c'est en grande partie à cause de la présence de la classe ouvrière dans ces mouvements. Une des preuves, en négatif, de cette réalité, c'est l'issue qu'ont connue les mouvements en Libye : non pas le renversement du vieux dictateur Kadhafi mais l'affrontement militaire entre cliques bourgeoises où les exploités ont été enrôlés comme chair à canon. Dans ce pays, une grande partie de la classe ouvrière était constituée de travailleurs immigrés (égyptiens, tunisiens, chinois, subsahariens, bengalis) dont la réaction principale a été de fuir la répression qui s'est déchaînée avec férocité dès les premiers jours.
12) L'issue guerrière du mouvement en Libye, avec l'entrée en lice des pays de l'OTAN, a permis à la bourgeoise de promouvoir des campagnes de mystification en direction des ouvriers des pays avancés dont la réaction spontanée avait été de se sentir solidaires des manifestants de Tunis et du Caire et de saluer leur courage et leur détermination. En particulier, la présence massive des jeunes générations dans le mouvement, notamment de la jeunesse scolarisée dont l'avenir se présente sous les auspices sinistres du chômage et de la misère, faisait écho aux récents mouvements qui ont animé la jeunesse scolarisée dans de nombreux pays européens dans la dernière période : mouvement contre le CPE en France au printemps 2006, révoltes et grèves en Grèce fin 2008, manifestations et grèves des lycéens et étudiants en Grande-Bretagne fin 2010, mouvements étudiants en Italie en 2008 et aux États-Unis en 2010, etc.). Ces campagnes bourgeoises pour dénaturer, aux yeux des travailleurs des autres pays, la signification des révoltes en Tunisie et en Égypte ont évidemment été facilitées par les illusions qui pèsent fortement sur la classe ouvrière de ces pays : les illusions nationalistes, démocratiques et syndicalistes notamment, comme cela avait d'ailleurs été le cas en 1980-81 avec la lutte du prolétariat polonais.
13) Ce mouvement d'il y a 30 ans avait permis au CCI d’élaborer son analyse critique de la théorie des "maillons faibles" développée notamment par Lénine au moment de la révolution en Russie. Le CCI avait à ce moment-là mis en avant, en se basant sur les positions élaborées par Marx et Engels, que c'est des pays centraux du capitalisme, et particulièrement des vieux pays industriels d'Europe de l'Ouest, que viendrait le signal de la révolution prolétarienne mondiale, du fait de la concentration du prolétariat de ces pays, et plus encore de son expérience historique, et qui lui donnent les meilleures armes pour déjouer finalement les pièges idéologiques les plus sophistiqués mis en œuvre depuis longtemps par la bourgeoisie. Ainsi, une des étapes fondamentales du mouvement de la classe ouvrière mondiale dans l'avenir sera constituée non seulement par le développement des luttes massives dans les pays centraux d'Europe occidentale, mais aussi par leur capacité à déjouer les pièges démocratiques et syndicaux, notamment par une prise en main de ces luttes par les travailleurs eux-mêmes. Ces mouvements constitueront un phare pour la classe ouvrière mondiale, y compris pour celle de la principale puissance capitaliste, les États-Unis, dont la plongée dans une misère croissante, une misère qui touche déjà des dizaines de millions de travailleurs, va transformer le "rêve américain" en véritable cauchemar.
CCI (mai 2011)
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
XIXe congrès du CCI : se préparer aux affrontements de classe
- 1977 lectures
Le CCI a tenu son 19e congrès en mai dernier. Le congrès constitue, en général, le moment le plus important de la vie des organisations révolutionnaires et, dans la mesure où celles-ci sont parties intégrantes de la classe ouvrière, il leur appartient de porter à la connaissance de cette dernière les principaux enseignements de leur congrès. C'est le but du présent article. Il faut d'emblée signaler que le congrès lui-même a mis en pratique cette volonté d'ouverture vers l'extérieur de l'organisation puisque, outre les délégations des sections du CCI, étaient présents non seulement des sympathisants de celui-ci ou des membres de cercles de discussion auxquels participent ses militants mais aussi des délégations d'autres groupes avec qui le CCI est en contact et en discussion ; deux groupes de Corée et Opop du Brésil1. D'autres groupes avaient été invités et avaient accepté l'invitation mais il n'ont pu venir du fait des barrages de plus en plus sévères que la bourgeoisie européenne oppose aux ressortissants des pays non européens.
Suivant les statuts de notre organisation :
"Le Congrès international est 1'organe souverain du CCI. Comme tel il a pour tâches :
- d'élaborer les analyses et orientations générales de l'organisation, notamment en ce qui concerne la situation internationale ;
- d'examiner et faire le bilan des activités de l'organisation depuis le précédent congrès ;
- de définir ses perspectives de travail pour le futur."
C'est sur la base de ces éléments qu'on peut tirer le bilan et les enseignements du 19e congrès.
La situation internationale
Le premier point qu'il importe d'aborder est celui de nos analyses et discussions sur la situation internationale. En effet, si l'organisation n'est pas en mesure d'élaborer une compréhension claire de celle-ci, elle se prive de sa capacité à y intervenir de façon appropriée. L'histoire nous a appris combien pouvait être catastrophique une évaluation erronée de la situation internationale de la part des organisations révolutionnaires. On peut citer les cas les plus dramatiques comme la sous-évaluation du danger de guerre par la majorité de la 2e Internationale à la veille de la première boucherie impérialiste mondiale, alors que dans la période précédente, sous l'impulsion de la Gauche de l'Internationale, ses congrès avaient correctement mis en garde et appelé à la mobilisation du prolétariat contre ce danger.
Un autre exemple est celui de l'analyse faite par Trotski au cours des années 1930 lorsqu'il voit dans les grèves ouvrières en France de 1936 ou dans la guerre civile en Espagne les prémices d'une nouvelle vague révolutionnaire internationale. Cette analyse le conduit à fonder en 1938 une "4e Internationale" qui doit, face à la "politique conservatrice des partis communistes et socialistes", prendre leur place à la tête "des masses de millions d'hommes [qui] s'engagent sans cesse sur la voie de la révolution". Cette erreur a fortement contribué au passage des sections de la 4e Internationale dans le camp bourgeois au cours de la Seconde Guerre mondiale : voulant à tout pris "coller aux masses", elles se sont engouffrées dans les politiques de la "Résistance" menées par les partis socialistes et "communistes", c'est-à-dire au soutien du camp impérialiste des Alliés.
Plus près de nous, on a pu voir comment certains groupes qui se réclamaient de la Gauche communiste étaient passés à côté de la grève généralisée de Mai 1968 en France et de l'ensemble du mouvement international de luttes ouvrières qui l'a suivi en considérant que c'était un "mouvement d'étudiants". On a pu aussi constater le cruel destin d'autres groupes qui, en considérant que Mai 68 était une "révolution", ont sombré dans le désespoir et ont finalement disparu lorsque que ce mouvement n'a pas tenu les promesses qu'ils y voyaient.
Aujourd'hui, il est de la plus haute importance pour les révolutionnaires d'élaborer une analyse correcte des enjeux de la situation internationale justement parce que ces enjeux ont acquis, au cours de la dernière période, une importance toute particulière.
Nous publions dans ce numéro de la Revue Internationale la résolution adoptée par le Congrès et il n'est donc pas nécessaire de revenir sur tous les points de celle-ci. Nous voulons seulement en souligner les aspects les plus importants.
Le premier aspect, le plus fondamental, est le pas décisif que vient de franchir la crise du capitalisme avec la crise de la dette souveraine de certains États européens comme la Grèce.
"En fait, cette faillite potentielle d'un nombre croissant d'États constitue une nouvelle étape dans l'enfoncement du capitalisme dans sa crise insurmontable. Elle met en relief les limites des politiques par lesquelles la bourgeoisie a réussi à freiner l'évolution de la crise capitaliste depuis plusieurs décennies. (…) Les mesures adoptées par le G20 de mars 2009 pour éviter une nouvelle 'Grande Dépression' sont significatives de la politique menée depuis plusieurs décennies par la classe dominante : elles se résument par l'injection dans les économies de masses considérables de crédits. De telles mesures ne sont pas nouvelles. En fait, depuis plus de 35 ans, elles constituent le cœur des politiques menées par la classe dominante pour tenter d'échapper à la contradiction majeure du mode de production capitaliste : son incapacité à trouver des marchés solvables en mesure d'absorber sa production. (…) La faillite potentielle du système bancaire et la récession ont obligé tous les États à injecter des sommes considérables dans leur économie alors même que les recettes étaient en chute libre du fait du recul de la production. De ce fait les déficits publics ont connu, dans la plupart des pays, une augmentation considérable. Pour les plus exposés d'entre eux, comme l'Irlande, la Grèce ou le Portugal, cela a signifié une situation de faillite potentielle, l'incapacité de payer leurs fonctionnaires et de rembourser leurs dettes. (…) Les 'plans de sauvetage' dont ils ont bénéficié de la part de la Banque européenne et du Fonds monétaire international constituent de nouvelles dettes dont le remboursement s'ajoute à celui des dettes précédentes. C'est plus qu'un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. (…) La crise de la dette souveraine des PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne) ne constitue qu'une part infime du séisme qui menace l'économie mondiale. Ce n'est pas parce qu'elles bénéficient encore pour le moment de la note AAA dans l'indice de confiance des agences de notation… que les grandes puissances industrielles s'en tirent beaucoup mieux. (…) la première puissance mondiale court le risque de se voir retirer la confiance 'officielle' sur sa capacité à rembourser ses dettes, si ce n'est avec un dollar fortement dévalué. (…) pour tous les pays, la situation n'a fait que s'aggraver avec les divers plans de relance. Ainsi, la faillite des PIIGS ne constitue que la pointe émergée de la faillite d'une économie mondiale qui n'a dû sa survie depuis des décennies qu'à la fuite en avant désespérée dans l'endettement. (…) La crise de l'endettement ne fait que marquer l'entrée du mode de production capitaliste dans une nouvelle phase de sa crise aiguë où vont s'aggraver encore de façon considérable la violence et l'étendue de ses convulsions. Il n'y a pas de 'sortie du tunnel' pour le capitalisme. Ce système ne peut qu'entraîner la société dans une barbarie toujours croissante."
La période qui a suivi le congrès a confirmé cette analyse. D'une part, la crise des dettes souveraines des pays européens, dont il est clair maintenant qu'elle ne concerne pas que les "PIIGS" mais menace toute la zone Euro, est venue occuper l'actualité d'une façon de plus en plus insistante. Et ce n'est pas le prétendu "succès" du sommet européen du 22 juillet sur la Grèce qui y changera grand-chose. Tous les sommets précédents avaient vocation à résoudre durablement les difficultés rencontrées par ce pays et on voit avec quelle efficacité !
D'autre part, au même moment, avec les difficultés rencontrées par Obama pour faire adopter sa politique budgétaire, les médias "découvrent" que les États-Unis également sont confrontés à une dette souveraine colossale, dont le niveau (130% du PIB) n'a rien à envier à celui des PIIGS. Cette confirmation des analyses qui s'étaient dégagées du congrès ne découle d'aucun mérite particulier de notre organisation. Le seul "mérite" dont elle se revendique c'est d'être fidèle aux analyses classiques du mouvement ouvrier qui ont toujours, depuis le développement de la théorie marxiste, mis en avant le fait que le mode de production capitaliste, comme les précédents, n'était que transitoire et qu'il ne pourrait pas, à terme, surmonter ses contradictions économiques. Et c'est dans le cadre de l'analyse marxiste que s'est déroulée la discussion du congrès. Des points de vue différents s'y sont exprimés, notamment sur les causes ultimes des contradictions du capitalisme (qui recoupent en grande partie ceux exprimés dans notre débat sur les Trente Glorieuses 2) ou bien encore sur la possibilité que l'économie mondiale ne soit plongée dans l'hyperinflation du fait de l'utilisation effrénée de la planche à billets par les États, notamment celui des États-unis. Mais une réelle homogénéité s'est dégagée pour souligner toute la gravité de la situation actuelle comme le fait la résolution adoptée à l'unanimité.
Le congrès s'est également penché sur l'évolution des conflits impérialistes comme il apparaît dans la résolution. Sur ce plan, les deux années qui nous séparent du précédent congrès n'ont pas apporté d'élément fondamentalement nouveau sinon une confirmation du fait que, malgré tous ses efforts militaires, la première puissance mondiale se montre incapable de rétablir le "leadership" qui avait été le sien lors de la "Guerre froide" et que ses engagements en Irak et en Afghanistan n'ont pu établir une "Pax américana" sur le monde, bien au contraire :
"Le 'nouvel ordre mondial' prédit il y a 20 ans par George Bush père, et que celui-ci rêvait sous l'égide des États-Unis, ne peut que se présenter toujours plus comme un 'chaos mondial', un chaos que les convulsions de l'économie capitaliste ne pourront qu'aggraver encore." (point 8 de la résolution)
Il importait que le congrès se penche tout particulièrement sur l'évolution présente de la lutte de classe puisque, au-delà de l'importance toute particulière que revêt pour les révolutionnaires cette question, le prolétariat se trouve aujourd'hui confronté dans tous les pays à des attaques sans précédent de ses conditions d'existence. Ces attaques sont particulièrement brutales dans les pays mis sous perfusion par la Banque européenne et le Fonds monétaire international, comme c'est notamment le cas de la Grèce. Mais elles se déchaînent dans tous les pays du fait de l'explosion du chômage et surtout de la nécessité pour tous les gouvernements de réduire les déficits budgétaires.
La résolution adoptée par le précédent congrès avançait que : "la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements [de luttes massives]. (…) C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de 'relance' de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus."
Le 19e congrès a constaté que "Les deux années qui nous séparent du précédent congrès ont amplement confirmé cette prévision. Cette période n'a pas connu de luttes d'ampleur contre les licenciements massifs et la montée du chômage sans précédent subis par la classe ouvrière dans les pays les plus développés. En revanche, c'est à partir des attaques portées directement par les gouvernements en application des plans 'd'assainissement des comptes publics' qu'ont commencé à se développer des luttes significatives." Cependant, le congrès a relevé que : "Cette réponse est encore très timide, notamment là où ces plans d'austérité ont pris les formes les plus violentes, dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne par exemple où, pourtant, la classe ouvrière avait fait preuve dans un passé récent d'une combativité relativement importante. D'une certaine façon, il semble que la brutalité même des attaques provoque un sentiment d'impuissance dans les rangs ouvriers, d'autant plus qu'elles sont conduites par des gouvernements 'de gauche'". Depuis, la classe ouvrière a fait la preuve dans ces mêmes pays qu'elle ne se résignait pas. C'est notamment le cas en Espagne où le mouvement des "Indignés" est devenu pour plusieurs mois une sorte de "phare" pour les autres pays d'Europe ou d'autres continents.
Ce mouvement a débuté au moment même où se tenait le congrès et ce dernier n'a pu, évidemment, en discuter. Cela dit, le congrès a été conduit à se pencher sur les mouvements sociaux qui avaient touché les pays arabes à partir de la fin de l'année dernière. Il n'y pas eu une totale homogénéité dans les discussions sur ce sujet, notamment du fait de leur caractère inédit, mais l'ensemble du congrès s'est rassemblé autour de l'analyse qui se trouve dans la résolution :
"… les mouvements les plus massifs qu'on ait connus au cours de la dernière période ne sont pas venus des pays les plus industrialisés mais des pays de la périphérie du capitalisme, notamment dans un certain nombre de pays du monde arabe, particulièrement la Tunisie et l'Égypte où, finalement, après avoir tenté de les museler par une répression féroce, la bourgeoisie a été conduite à licencier les dictateurs en place. Ces mouvements n'étaient pas des luttes ouvrières classiques comme ces pays en avaient déjà connues dans un passé récent (par exemple les luttes à Gafsa en Tunisie en 2008 ou les grèves massives dans l’industrie textile en Égypte, durant l’été 2007, rencontrant la solidarité active de la part de nombreux autres secteurs). Ils ont pris souvent la forme de révoltes sociales où se trouvaient associés toutes sortes de secteurs de la société : travailleurs du public et du privé, chômeurs, mais aussi des petits commerçants, des artisans, les professions libérales, la jeunesse scolarisée, etc. C'est pour cela que le prolétariat, la plupart du temps, n'y est pas apparu directement de façon distincte (comme il est apparu, par exemple, dans les grèves en Égypte vers la fin des révoltes), encore moins en assumant le rôle de force dirigeante. Cependant, à l'origine de ces mouvements (ce qui se reflétait dans beaucoup des revendications mises en avant) on trouve fondamentalement les mêmes causes à l'origine des luttes ouvrières dans les autres pays : l'aggravation considérable de la crise, la misère croissante qu'elle provoque au sein de l'ensemble de la population non exploiteuse. Et si en général le prolétariat n'est pas apparu directement comme classe dans ces mouvements, son empreinte y était présente dans les pays où il a un poids significatif, notamment par la profonde solidarité qui se manifestait dans les révoltes, leur capacité à éviter de se lancer dans des actes de violence aveugle et désespérée malgré la terrible répression qu'ils ont dû affronter. En fin de compte, si la bourgeoisie en Tunisie et en Égypte s'est finalement résolue, sur les bons conseils de la bourgeoisie américaine, à se débarrasser des vieux dictateurs, c'est en grande partie à cause de la présence de la classe ouvrière dans ces mouvements."
Ce surgissement de la classe ouvrière dans des pays de la périphérie du capitalisme a conduit le congrès à se pencher sur l'analyse élaborée par notre organisation à la suite des grèves de masse de 1980 en Pologne : "Le CCI avait à ce moment-là mis en avant, en se basant sur les positions élaborées par Marx et Engels, que c'est des pays centraux du capitalisme, et particulièrement des vieux pays industriels d'Europe de l'Ouest, que viendrait le signal de la révolution prolétarienne mondiale, du fait de la concentration du prolétariat de ces pays, et plus encore de son expérience historique, et qui lui donnent les meilleures armes pour déjouer finalement les pièges idéologiques les plus sophistiqués mis en œuvre depuis longtemps par la bourgeoisie. Ainsi, une des étapes fondamentales du mouvement de la classe ouvrière mondiale dans l'avenir sera constituée non seulement par le développement des luttes massives dans les pays centraux d'Europe occidentale, mais aussi par leur capacité à déjouer les pièges démocratiques et syndicaux, notamment par une prise en main de ces luttes par les travailleurs eux-mêmes. Ces mouvements constitueront un phare pour la classe ouvrière mondiale, y compris pour celle de la principale puissance capitaliste, les États-Unis, dont la plongée dans une misère croissante, une misère qui touche déjà des dizaines de millions de travailleurs, va transformer le "rêve américain" en véritable cauchemar."
Cette analyse a connu un début de vérification avec le récent mouvement des "Indignés". Alors que les manifestants de Tunis ou du Caire arboraient le drapeau national comme emblème de leur lutte, les drapeaux nationaux étaient absents dans la plupart des grandes villes européennes à la fin du printemps dernier (en Espagne en particulier). Certes le mouvement des "Indignés" est encore fortement imprégné d'illusions démocratiques mais il a le mérite de mettre en évidence que tout État, même le plus "démocratique" et y compris étiqueté "de Gauche", est un ennemi féroce des exploités.
L'intervention du CCI dans le développement des combats de classe
Comme on l'a vu plus haut, la capacité des organisations révolutionnaires à analyser correctement la situation historique dans laquelle elles se trouvent, de même que de savoir remettre en cause éventuellement des analyses qui ont été infirmées par la réalité des faits, conditionne la qualité, dans sa forme comme dans son contenu, de leur intervention au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire, en fin de compte, de leur capacité d'être à la hauteur de la responsabilité pour laquelle cette dernière les a fait surgir.
Le 19e congrès du CCI, sur la base de l'examen de la crise économique, des terribles attaques que celle-ci va entraîner contre la classe ouvrière et sur la base des premières réponses de celle-ci à ces attaques, a considéré que nous entrions dans une période de développement des luttes prolétariennes bien plus intenses et massives que dans la période qui va de 2003 à aujourd'hui. Dans ce domaine, encore plus peut-être que dans celui de l'évolution de la crise qui le détermine grandement, il est difficile de faire des prévisions à court terme. Il serait illusoire d'essayer de chercher où et quand les prochains combats de classe importants vont se déployer. Ce qu'il importe de faire, en revanche, c'est de dégager une tendance générale et d'être particulièrement vigilant face à l'évolution de la situation afin de pouvoir réagir rapidement et de façon appropriée quand celle-ci le requiert tant du point de vue des prises de position que de l'intervention directe dans les luttes.
Le 19e congrès a estimé que le bilan de l'intervention du CCI depuis le précédent congrès était indiscutablement positif. Chaque fois que c'était nécessaire, et souvent de façon très rapide, des prises de position ont été publiées en de nombreuses langues sur notre site Internet et dans notre presse papier territoriale. Dans la mesure de nos très faibles forces, celle-ci a été diffusée largement dans les manifestations qui ont accompagné les mouvements sociaux qu'on a connus dans la période passée, notamment lors du mouvement contre la réforme des retraites à l'automne 2010 en France ou lors des mobilisations de la jeunesse scolarisée contre les attaques ciblant particulièrement les étudiants issus de la classe ouvrière (comme l'augmentation considérable des droits d'inscription dans les universités britanniques à la fin 2010). Parallèlement, le CCI a tenu des réunions publiques dans de nombreux pays et sur plusieurs continents traitant des mouvements sociaux en cours. De même, les militants du CCI sont intervenus, chaque fois que c'était possible, dans les assemblées, comités de lutte, cercles de discussion, forums Internet pour soutenir les positions et analyses de l'organisation et participer au débat international que ces mouvements avaient suscité.
Ce bilan n'est nullement un affichage destiné à consoler les militants ou à bluffer ceux qui liront cet article. Il peut être vérifié, et contesté, par tous ceux qui ont suivi les activités de notre organisation puisqu'il concerne, par définition, des activités publiques.
De même, le congrès a tiré un bilan positif de notre intervention en direction des éléments et groupes qui défendent des positions communistes ou qui s'approchent de ces positions.
En effet, la perspective d'un développement significatif des luttes ouvrières porte avec elle celle du surgissement de minorités révolutionnaires. Avant même que le prolétariat mondial ne se soit engagé dans des luttes massives, on a pu constater (comme cela a déjà été relevé dans la résolution adoptée par le 17e congrès3) qu'un tel surgissement commençait à se dessiner, notamment du fait que, depuis 2003, la classe ouvrière avait commencé à surmonter le recul qu'elle avait subi suite à l'effondrement du bloc dit "socialiste" en 1989 et des formidables campagnes sur "la fin du communisme", voire "la fin de la lutte de classe". Depuis, même si de façon encore timide, cette tendance s'est confirmée ce qui a conduit à l'établissement de contacts et discussions avec des éléments et groupes dans un nombre significatif de pays. "Ce phénomène de développement des contacts concerne aussi bien des pays où le CCI n'a pas de section que d'autres où il est déjà présent. Cependant l'afflux des contacts n'est pas immédiatement palpable au niveau de chaque pays où existe le CCI, loin s'en faut. On peut même dire que ses manifestations les plus franches sont encore réservées à une minorité de sections du CCI." (Présentation au congrès du rapport sur les contacts)
En fait, bien souvent, les nouveaux contacts de notre organisation sont apparus dans des pays où il n'existe pas (ou pas encore) de section de celle-ci. C'est ce qu'on a pu constater par exemple lors de la conférence "panaméricaine" qui s'est tenue en novembre 2010 et où étaient présents, outre Opop et d'autres camarades du Brésil, des camarades du Pérou, de Saint-Domingue et d'Équateur.4 Du fait du développement du milieu de contacts, "notre intervention en direction [de ces derniers] a connu une accélération très importante, nécessitant un investissement militant et financier comme jamais notre organisation n'en avait effectué pour ce type d'activité, permettant ainsi que puissent avoir lieu les rencontres et discussions les plus nombreuses et riches de toute notre existence" (Rapport sur les contacts présenté au congrès).
Ce rapport "met l'accent sur des nouveautés de la situation concernant les contacts, en particulier notre collaboration avec des anarchistes. Nous avons réussi, en certaines occasions, à faire cause commune dans la lutte avec des éléments ou groupes qui se trouvent dans le même camp que nous, celui de l'internationalisme." (Présentation du rapport au congrès) Cette collaboration avec des éléments et groupes se réclamant de l'anarchisme a suscité au sein de notre organisation de nombreuses et riches discussions qui nous ont permis de mieux connaître les différentes facettes de ce courant et en particulier de mieux comprendre toute l'hétérogénéité existant en sont son sein (depuis de purs gauchistes prêts à soutenir toutes sortes de mouvements ou idéologies bourgeoises, tel le nationalisme jusqu'à des éléments clairement prolétarien et d'un internationalisme irréprochable).
"Une autre nouveauté, c'est notre collaboration, à Paris, avec des éléments se réclamant du trotskisme (…) Pour l'essentiel, ces éléments (…) étaient très actifs [lors de la mobilisation contre la réforme des retraites] dans le sens de favoriser la prise en charge par la classe ouvrière de ses propres luttes, en dehors du cadre syndical et que, également, ils favorisaient le développement de la discussion au sein de celle-ci, tout comme le CCI aurait pu le faire. Nous avions, de ce fait toutes les raisons de nous associer à leur effort. Que leur attitude entre en contradiction avec la pratique classique du trotskisme, c'est tant mieux." (Présentation du rapport))
Ainsi, le congrès a pu tirer également un bilan positif de la politique de notre organisation en direction des éléments qui défendent les positions révolutionnaires ou s'en approchent. C'est là une partie très importante de notre intervention en direction de la classe ouvrière, celle qui participe à la future constitution d'un parti révolutionnaire indispensable pour le triomphe de la révolution communiste.5
Les questions organisationnelles
Toute discussion sur les activités d'une organisation révolutionnaire doit se pencher sur le bilan de son fonctionnement. Et c'est dans ce domaine que le congrès, sur base de différents rapports, a constaté les plus grandes faiblesses dans notre organisation. Nous avons déjà traité publiquement, dans notre presse ou même dans des réunions publiques, des difficultés organisationnelles qu'a pu rencontrer le CCI par le passé. Ce n'est nullement de l'exhibitionnisme mais une pratique classique du mouvement ouvrier. Le congrès s'est longuement penché sur ces difficultés et en particulier sur l'état souvent dégradé du tissu organisationnel et du travail collectif qui pèse sur un certain nombre de sections. Nous ne pensons pas que le CCI connaisse aujourd'hui une crise comme cela a été le cas en 1981, 1993 ou 2001. En 1981, nous avions assisté à l'abandon par une partie significative de l'organisation des principes politiques et organisationnels sur lesquels elle avait été fondée, ce qui avait entraîné des convulsions très sérieuses et notamment la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. En 1993 et en 2001, le CCI avait dû affronter des difficultés de type clanique qui avaient entraîné le rejet de la loyauté organisationnelle et de nouveaux départs de militants (notamment des membres de la section de Paris en 1995 et des membres de l'organe central en 2001) 6. Parmi les causes de ces deux dernières crises, le CCI a identifié le poids des conséquences de l'effondrement du bloc "socialiste" qui a provoqué un recul très important de la conscience au sein du prolétariat mondial et, plus généralement, de la décomposition sociale qui affecte aujourd'hui le société capitaliste moribonde. Les causes des difficultés actuelles sont en partie du même ordre mais elles n'entraînent pas de phénomènes de perte de conviction ou de déloyauté. Tous les militants des sections où ces difficultés se manifestent sont fermement convaincus de la validité du combat mené par le CCI, sont totalement loyaux envers celle-ci et continuent à manifester leur dévouement à son égard. Alors que le CCI a dû faire face à la période la plus sombre connue par la classe ouvrière depuis la fin de la contre-révolution marquée avec éclat par le mouvement de Mai 1968 en France, celle d'un recul général de sa conscience et de sa combativité à partir du début des années 1990, ces militants sont restés "fidèles au poste". Bien souvent, ces camarades se connaissent et militent ensemble depuis plus de trente ans. Il existe souvent entre eux, de ce fait, des liens d'amitié et de confiance solides. Mais les petits défauts, les petites faiblesses, les différences de caractère que chacun doit pouvoir accepter chez les autres ont souvent conduit au développement de tensions ou d'une difficulté croissante à travailler ensemble pendant des dizaines d'années au sein de petites sections qui n'ont pas été irriguées par le "sang neuf" de nouveaux militants du fait, justement, du recul général subi par la classe ouvrière. Aujourd'hui, ce "sang neuf" commence à alimenter certaines sections du CCI mais il est clair que les nouveaux membres de celui-ci ne pourront être correctement intégrés en son sein que si son tissu organisationnel s'améliore. Le congrès a discuté avec beaucoup de franchise de ces difficultés ce qui a conduit certains des groupes invités à lui faire part également de leurs propres difficultés organisationnelles. Cependant, il n'a pas apporté de "solution miracle" à ces difficultés qui avaient déjà été constatées lors des précédents congrès. La résolution d'activités qu'il a adoptée rappelle la démarche déjà adoptée par l'organisation et appelle l'ensemble des militants et sections à la prendre en charge de façon plus systématique :
"Depuis 2001, le CCI s'est engagé dans un projet théorique ambitieux qui a été conçu, entre autres choses, pour expliquer et développer ce qu'est le militantisme communiste (et donc l'esprit de parti). Il a fallu faire preuve d'un effort de création pour comprendre au niveau le plus profond :
- les racines de la solidarité et de la confiance prolétariennes,
- la morale et la dimension éthique du marxisme,
- la démocratie et le démocratisme et leur hostilité à l'égard du militantisme communiste,
- la psychologie et l'anthropologie et leur rapport au projet communiste,
- le centralisme et le travail collectif,
- la culture du débat prolétarien,
- le marxisme et la science.
En bref, le CCI s'est engagé dans un effort pour rétablir une meilleure compréhension de la dimension humaine de l'objectif communiste et de l'organisation communiste, pour redécouvrir l'ampleur de la vision du militantisme qui a été presque perdue au cours de la contre-révolution et donc pour se prémunir contre la réapparition des cercles, des clans qui se développent dans une atmosphère d'ignorance ou de déni de ces questions plus générales d'organisation et de militantisme." (Point 10)
"La réalisation des principes unitaires de l'organisation – le travail collectif – requiert le développement de toutes les qualités humaines en lien avec l'effort théorique pour appréhender le militantisme communiste de façon positive auquel nous nous référons dans le point 10. Cela signifie que le respect mutuel, la solidarité, les réflexes de coopération, un esprit chaleureux de compréhension et de sympathie pour les autres, les liens sociaux et la générosité doivent se développer." (Point 15)
La discussion sur "Marxisme et science"
Une des insistances des discussions et de la résolution adoptée par le congrès porte sur la nécessité d'approfondir les aspects théoriques des questions auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour cela que, comme pour les précédents congrès, celui-ci a consacré un point de son ordre du jour à une question théorique : "Marxisme et science" qui va donner lieu, comme nous l'avons fait pour la plupart des autres questions théoriques discutées en notre sein, à la publication d'un ou plusieurs documents. Nous n'allons pas de ce fait rapporter ici les éléments abordés dans la discussion, laquelle faisait suite à de nombreuses discussions qui s'étaient tenues auparavant au sein des sections. Ce qu'il nous faut signaler c'est la grande satisfaction qu'ont retiré les délégations de cette discussion, une satisfaction qui devait beaucoup aux contributions d'un scientifique, Chris Knight 7, que nous avons avions invité à participer à une partie du congrès. Ce n'était pas la première fois que le CCI invitait un scientifique à son congrès. Il y a deux ans, Jean-Louis Dessalles était venu nous présenter ses réflexions sur l'origine du langage, ce qui avait provoqué des discussions très animées et intéressantes. 8 Avant toute chose, nous voulons remercier Chris Knight d'avoir accepté notre invitation et nous tenons à saluer la qualité de ses interventions ainsi que leur caractère très vivant et accessible par des non spécialistes comme le sont la plupart des militants du CCI. Chris Knight est intervenu à trois reprises 9. Il a pris la parole dans le débat général et tous les participants ont été impressionnés non seulement par la qualité de ses arguments mais aussi par la remarquable discipline dont il a fait preuve, respectant strictement le temps de parole et le cadre du débat (discipline qu'on souvent du mal à respecter beaucoup de membres du CCI). Il a ensuite présenté, de façon très imagée, un résumé de sa théorie sur l'origine de la civilisation et du langage humain, évoquant la première des "révolutions" connues par l'humanité, dans laquelle les femmes ont joué un rôle moteur (idée qu'il reprend d'Engels), révolution qui a été suivie de plusieurs autres, permettant à chaque fois à la société de progresser. Il inscrit la révolution communiste comme point culminant de cette série de révolutions et estime que, comme les précédentes, l'humanité dispose des moyens pour la réussir.
La troisième intervention de Chris Knight a consisté en un salut très sympathique qu'il a dressé à notre congrès.
A la suite du congrès, l'ensemble des délégations a estimé que la discussion sur "Marxisme et Science", et la participation de Chris Knight au sein de celle-ci, avaient constitué un des moments les plus intéressants et satisfaisants du congrès, un moment qui encourage l'ensemble des sections à poursuivre et approfondir l'intérêt pour les questions théoriques.
Avant de passer à la conclusion de cet article, nous devons signaler que les participants au 19e congrès du CCI (délégations, groupes et camarades invités), qui s'est tenu 140 ans, presque jour pour jour, après la semaine sanglante qui a mis fin à la Commune de Paris, et à proximité de cet événement, a tenu à saluer la mémoire des combattants de cette première tentative révolutionnaire du prolétariat.10
Nous ne tirons pas un bilan triomphaliste du 19e congrès du CCI, notamment du fait que ce congrès a pu prendre la mesure des difficultés organisationnelles que rencontre notre organisation, des difficultés qu'elle devra surmonter si elle veut continuer à être présente aux rendez-vous que l'histoire donne aux organisations révolutionnaires. C'est donc un combat long et difficile qui attend notre organisation. Mais cette perspective n'est pas faite pour nous décourager. Après tout, le combat de l'ensemble de la classe ouvrière lui aussi est long et difficile, semé d'embûches et de défaites. Ce que cette perspective doit inspirer aux militants, c'est la ferme volonté de mener ce combat. Après tout, une des caractéristiques fondamentales de tout militant communiste c'est d'être un combattant.
CCI (31/07/2011)
1 Opop était déjà présent aux deux précédents congrès du CCI. Pour sa présentation voir les articles consacrés aux 17e et au 18e congrès du CCI dans les numéros 130 et 138 de la Revue Internationale.
2 Voire à ce sujet les Revues internationales n° 133, 135, 136, 138 et 141.
3 "Aujourd'hui, comme en 1968, la reprise des combats de classe s'accompagne d'une réflexion en profondeur dont l'apparition de nouveaux éléments se tournant vers les positions de la Gauche communiste constitue la pointe émergée de l'iceberg" (point 17)
4 Voir à ce sujet notre article "5ª Conferencia Panamericana de la Corriente Comunista Internacional - Un paso importante hacia la unidad de la clase obrera". https://es.internationalism.org/RM120-panamericana [212].
5 Le congrès a discuté et repris à son compte une critique contenue dans le rapport sur les contacts concernant la formulation suivante contenue dans la résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI : "le CCI constitue déjà le squelette du futur parti". En effet, "Il n'est pas possible de définir dès à présent la forme que prendra la participation organisationnelle du CCI à la formation du futur parti puisque cela dépendra de l'état général et de la configuration du nouveau milieu mais aussi de notre propre organisation." Cela dit, le CCI a la responsabilité de maintenir vivant et d'enrichir le patrimoine qu'il a hérité de la Gauche communiste afin d'en faire bénéficier les générations actuelles et futures de révolutionnaires, et donc le futur parti. En d'autres termes, il a la responsabilité de participer à remplir la fonction de pont entre la vague révolutionnaire des années 1917-23 et la future vague révolutionnaire.
6 Ces éléments qui rejettent leur loyauté envers l'organisation sont souvent entraînées dans une démarche que nous avons qualifiée de "parasitaire" : tout en prétendant continuer à défendre les "véritables positions de l'organisation", ils consacrent l'essentiel de leurs efforts à la dénigrer et à essayer de la discréditer. Nous avons consacré un document au phénomène du parasitisme politique (Voir "Construction de l'organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme" dans la Revue Internationale 94). Il faut noter que certains camarades du CCI, tout en constatant ce type de comportements et en revendiquant la nécessité de défendre fermement l'organisation contre eux, ne partagent pas cette analyse du parasitisme, désaccord qui s'est exprimé au congrès.
7 Chris Knight est un universitaire britannique qui a enseigné l'anthropologie jusqu'en 2009 au London East College. Il est l'auteur, notamment, de Blood Relations, Menstruation and the Origins of Culture dont nous avons rendu compte sur notre site Internet en langue anglaise (https://en.internationalism.org/2008/10/Chris-Knight [213]) et qui s'appuie de façon très fidèle sur la théorie de l'évolution de Darwin ainsi que sur les travaux de Marx et surtout Engels (notamment, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État). Il se dit 100% "marxiste" en anthropologie. Par ailleurs, c'est un militant politique animant le groupe Radical Anthropology dont un des principaux modes d'intervention est l'organisation de représentations de théâtre de rue dénonçant et ridiculisant les institutions capitalistes Il a été exclu de l'Université pour avoir organisé des manifestations contre la tenue du G20 à Londres en mars 2009. Il était notamment accusé "d'appel au meurtre" pour avoir pendu en effigie des banquiers et avoir arboré une pancarte disant "Eat the banquers" ("Mangez les banquiers"). Nous ne partageons pas un certain nombre des positions politiques ni des modes d'action de Chris Knight mais, pour avoir discuté avec lui depuis un certain temps, nous tenons à affirmer notre conviction de sa totale sincérité, de son réel dévouement à la cause de l'émancipation du prolétariat et de sa farouche conviction que la science et la connaissance sont des armes fondamentales de celle-ci. Nous voulons, en ce sens, lui apporter notre chaleureuse solidarité face aux mesures de répression dont il a été l'objet (licenciement, arrestation).
8 Voir notre article sur le 18e congrès du CCI dans la Revue Internationale 138.
9 Nous publierons sur notre site Internet des extraits des interventions de Chris Knight.
10 Les participants au 19e congrès du CCI dédient ce congrès à la mémoire des combattants de la Commune de Paris qui sont tombés, il a exactement 140 ans, face à la bourgeoisie déchaînée qui leur a fait payer leur volonté de partir à "l'assaut du ciel".
En mai 1871, pour la première fois de l'Histoire, le prolétariat a fait trembler la classe dominante. C'est cette peur de la bourgeoisie face au fossoyeur du capitalisme qui explique la furie et la barbarie de la répression sanglante des insurgés de la Commune.
L'expérience de la Commune de Paris a apporté des leçons fondamentales aux générations suivantes de la classe ouvrière. Des leçons qui lui ont permis de s'engager dans la révolution russe en 1917.
Les combattants de la Commune de Paris, tombés sous la mitraille du Capital, n'auront pas donné leur sang pour rien si, dans ses combats futurs, la classe ouvrière est capable de s'inspirer de l'exemple de la Commune pour renverser le capitalisme.
"Le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré a jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ses martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ses exterminateurs, l'histoire les a déjà cloués au pilori éternel, et toutes les prières de leurs prêtres n'arriveront pas à les en libérer." (Karl Marx, La guerre civile en France)
Vie du CCI:
Décadence du capitalisme (X) : Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme
- 2284 lectures
Il n'y a pas eu de réelle reprise du capitalisme mondial après la dévastation de la Première Guerre mondiale. La plupart des économies d'Europe stagnaient, incapables de résoudre les problèmes posés par la rupture opérée par la guerre et la révolution, par des usines obsolètes et le chômage massif. La situation difficile de l'économie britannique, qui avait été la plus puissante, est typique de la situation lorsqu'en 1926 elle recourt à des réductions de salaire pour tenter vainement de reconstituer son avantage concurrentiel sur le marché mondial. Il en résulte la grève de dix jours en solidarité avec les mineurs dont les salaires et les conditions de vie étaient la cible centrale de l'attaque. Le seul vrai boom eu lieu aux États-Unis, qui ont bénéficié à la fois des difficultés de leurs anciens rivaux et du développement accéléré de la production en série symbolisée par les chaînes de montage de Détroit qui produisaient la Ford T. Le couronnement de l'Amérique comme première puissance économique mondiale a également permis de sortir l'économie allemande du marasme grâce à l'injection de prêts massifs. Mais tout le vacarme des "rugissantes années 20" [1] aux États-Unis et dans quelques autres endroits ne pouvait cacher le fait que cette relance n'était fondée sur aucune extension substantielle du marché mondial, contrairement à la croissance massive qui avait eu lieu durant les dernières décennies du 19ème siècle. Le boom, déjà en grande partie alimenté par la spéculation et les créances irrécouvrables, préparait le terrain pour la crise de surproduction qui a éclaté en 1929 et rapidement englouti l'économie mondiale, l'ensevelissant dans la dépression la plus profonde jamais connue (voir le premier article de cette série, dans la Revue internationale n° 132).
Ce n'était pas un retour au cycle "expansion – récession" du 19ème siècle, mais une maladie entièrement nouvelle : la première crise économique majeure d'une nouvelle ère de la vie du capitalisme. C'était une confirmation de ce que la grande majorité des révolutionnaires avait conclu en réponse à la guerre de 1914 : le mode de production bourgeois était devenu obsolète, un système décadent. La Grande Dépression des années 1930 a été interprétée par presque toutes les expressions politiques de la classe ouvrière comme une nouvelle confirmation de ce diagnostic. A celle-ci contribua de façon non négligeable le fait que pendant les années précédentes, il était devenu de plus en plus évident qu'il n'y aurait aucune récupération économique spontanée et que la crise poussait de plus en plus le système vers un deuxième partage impérialiste du monde.
Mais cette nouvelle crise n'a pas provoqué une nouvelle vague de luttes révolutionnaires, malgré des mouvements de classe importants qui eurent lieu dans un certain nombre de pays. La classe ouvrière avait souffert une défaite historique suite à l'écrasement des tentatives révolutionnaires en Allemagne, Hongrie, Italie et ailleurs, et à la mort atroce de la révolution en Russie. Avec le triomphe du stalinisme dans les partis communistes, les courants révolutionnaires qui survécurent avaient été réduits à de petites minorités luttant pour clarifier les raisons de cette défaite et incapables d'exercer une influence significative quelconque dans la classe ouvrière. Néanmoins, la compréhension de la trajectoire historique de la crise du capitalisme était un élément crucial qui a guidé ces groupes au cours de cette période sombre.
Les réponses de la part du mouvement politique prolétarien : trotskisme et anarchisme
Le courant d'Opposition de gauche autour de Trotsky, regroupé au sein d'une nouvelle Quatrième Internationale, a édité son programme en 1938, avec le titre L'agonie du capitalisme et les tâches de la 4ème Internationale. En continuité avec la Troisième Internationale, il affirmait que le capitalisme était entré dans une décadence irrémédiable. "La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l’humanité ont cessé de croître (…) Les bavardages de toutes sortes selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore "mûres" pour le socialisme ne sont que le produit de l’ignorance ou d’une tromperie consciente. Les prémisses objectives de la révolution ne sont pas seulement mûre ; elles ont même commencé à pourrir". (Programme de transition. https://www.cps-presse.com/archives/prg-tr/prgtrans.htm [215]). Ce n'est pas le lieu ici d'une critique détaillée du Programme de transition, nom sous lequel ce texte s'est fait connaître. En dépit de son point de départ marxiste, il présente une vision des rapports entre les conditions objectives et subjectives qui tombe à la fois dans le matérialisme vulgaire et l'idéalisme : d'une part, il tend à présenter la décadence du système comme un arrêt absolu du développement des forces productives ; de l'autre, il considère qu'une fois cette impasse objective atteinte, il ne manque qu'une direction politique correcte au prolétariat pour transformer la crise en révolution,. L'introduction du document déclare ainsi que "La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire". D'où la tentative volontariste de former une nouvelle Internationale dans une période de contre-révolution. En effet, pour Trotsky, la défaite du prolétariat constitue précisément ce qui rend nécessaire la proclamation de la nouvelle Internationale : "Des sceptiques demandent : mais le moment est-il venu de créer une nouvelle Internationale ? Il est impossible, disent-ils, de créer une Internationale "artificiellement" ; seuls, de grands événements peuvent la faire surgir, etc. (…) La IVème Internationale est déjà surgie de grands événements : les plus grandes défaites du prolétariat dans l’Histoire". En ratiocinant de la sorte, le niveau réel de la conscience de classe du prolétariat et sa capacité à s'affirmer comme force indépendante sont plus ou moins relégués à un rôle marginal. Cette démarche n'est pas sans lien avec la teneur semi-réformiste et capitaliste d'État de beaucoup des revendications transitoires contenues dans le programme, puisqu'elles ne sont pas tant vues comme de réelles solutions à l'étranglement des forces productives mais, plutôt, comme des moyens sophistiqués pour arracher le prolétariat à la prison de sa direction corrompue du moment, et le guider vers la bonne direction politique. Le programme de transition est ainsi établi sur une séparation totale entre l'analyse de la décadence du capitalisme et ses conséquences programmatiques.
Les anarchistes ont souvent été en désaccord avec les marxistes sur l'insistance de ces derniers pour baser les perspectives de la révolution sur les conditions objectives atteintes par le développement capitaliste. Au 19ème siècle, l'époque du capitalisme ascendant, des anarchistes comme Bakounine défendaient l'idée que le soulèvement des masses était possible à tout moment et accusaient les marxistes de remettre la lutte révolutionnaire à un avenir lointain. En conséquence, pendant la période qui suivit la Première Guerre mondiale, il y eut peu de tentatives de la part des courants anarchistes pour tirer les conséquences de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence puisque, pour bon nombre d'entre eux, rien n'avait réellement changé. Néanmoins, l'ampleur de la crise économique des années 1930 a convaincu certains de ses meilleurs éléments que le capitalisme avait en effet atteint son époque de déclin. L'anarchiste russe exilé Maximoff, dans Mon credo social, édité en 1933, affirme que "ce processus de déclin a commencé immédiatement après la Première Guerre mondiale, et il a pris la forme de crises économiques de plus en plus importantes et aigües qui, durant ces dernières années, ont éclaté simultanément dans les pays vainqueurs et vaincus. Au moment d'écrire ce texte (1933-1934), une véritable crise mondiale du système capitaliste touche presque tous les pays. Sa nature prolongée et sa portée universelle ne peuvent nullement être expliquées par la théorie de crises politiques périodiques" [2]. Il poursuit en montrant comment les efforts du capitalisme pour sortir de la crise par des mesures protectionnistes, des réductions de salaire ou la planification étatique ne font qu'approfondir les contradictions du système : "le capitalisme, qui a donné naissance à un nouveau fléau social, ne peut se débarrasser de sa propre progéniture maléfique sans se tuer lui-même. Le développement logique de cette tendance doit inévitablement aboutir au dilemme suivant : soit une désintégration complète de la société, soit l'abolition du capitalisme et la création d'un nouveau système social plus progressiste. Il n'existe aucune autre alternative. La forme moderne d'organisation sociale a suivi son cours et prouve, aujourd'hui même, qu'elle constitue à la fois un obstacle au progrès de l'humanité et un facteur de délabrement social. Ce système dépassé doit donc être relégué au musée des reliques de l'évolution sociale" (Ibid). Il est vrai que Maximoff sonne très marxiste dans ce texte, de même lorsqu'il avance que l'incapacité du capitalisme à s'étendre empêchera que la crise puisse se résoudre de la même manière qu'autrefois : "Dans le passé, le capitalisme aurait évité la crise mortelle au moyen des marchés coloniaux et de ceux des nations agraires. De nos jours, la plupart des colonies elles-mêmes concurrencent les pays métropolitains sur le marché mondial, alors que les terres agraires sont en cours d'industrialisation intensive" (Ibid). On rencontre la même clarté concernant les caractéristiques de la nouvelle période dans les écrits du groupe britannique Fédération Communiste Anti-Parlementaire (APCF), chez qui l'influence des marxistes de la Gauche communiste germano-hollandaise a été beaucoup plus directe [3].
La Gauche italienne / belge
Ce n'était pas un hasard : c'est la Gauche communiste qui a été la plus rigoureuse dans l'analyse de la signification historique de la dépression économique en tant qu'expression de la décadence du capitalisme et dans les tentatives d'identifier les racines de la crise au moyen de la théorie marxiste de l'accumulation. Les fractions italienne et belge de la Gauche communiste en particulier ont toujours fondé leurs positions programmatiques sur la reconnaissance du fait que la crise du capitalisme était historique et pas seulement cyclique : par exemple le rejet des luttes nationales et des revendications démocratiques, qui a clairement distingué ce courant du trotskisme, se basait non sur un sectarisme abstrait mais sur le fait que le changement des conditions du capitalisme mondial avait rendu obsolètes ces aspects du programme du prolétariat. Cette recherche d'une cohérence a incité les camarades de la Gauche italienne et belge à se lancer dans une étude approfondie de la dynamique interne de la crise capitaliste. Inspirée également par la traduction récente en français de L'accumulation du capital de Rosa Luxemburg, cette étude a donné naissance aux articles signés Mitchell, "Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant", publiés en 1934 dans les numéros 10 et 11 de Bilan (republiés dans les numéros 102 et 103 de la Revue internationale).
Les articles de Mitchell retournent à Marx et examinent la nature de la valeur et de la marchandise, le processus de l'exploitation du travail et les contradictions fondamentales du système capitaliste qui résident dans la production de la plus-value elle-même. Pour Mitchell, il y avait une claire continuité entre Marx et Rosa Luxemburg à travers la reconnaissance de l'impossibilité que l'intégralité de la plus-value soit réalisée au moyen de la consommation des travailleurs et des capitalistes. Concernant les schémas de la reproduction de Marx, qui sont au cœur de la polémique qui éclate avec le livre de Rosa Luxemburg, Mitchell dit ceci :
" … si Marx, dans ses schémas de la reproduction élargie, a émis cette hypothèse d'une société entièrement capitaliste où ne s'opposeraient que des capitalistes et des prolétaires c'est, nous semble-t-il, afin de pouvoir précisément faire la démonstration de l'absurdité d'une production capitaliste s'équilibrant et s'harmonisant un jour avec les besoins de l'humanité. Cela signifierait que la plus-value accumulable, grâce à l'élargissement de la production, pourrait se réaliser directement d'une part par 1'achat de nouveaux moyens de production nécessaires, d'autre part par la demande des ouvriers supplémentaires (où les trouver d'ailleurs ?) et que les capitalistes, de loups se seraient transformés en pacifiques progressistes.
Marx, s'il avait pu poursuivre le développement de ses schémas, aurait abouti à cette conclusion opposée qu'un marché capitaliste qui ne serait plus extensible par l'incorporation de milieux non capitalistes, qu'une production entièrement capitaliste - ce qui historiquement est impossible - signifierait l'arrêt du processus de l'accumulation et la fin du capitalisme lui-même. Par conséquent, présenter les schémas (comme l'ont fait certains "marxistes") comme étant l'image d'une production capitaliste pouvant se dérouler sans déséquilibre, sans surproduction, sans crises, c'est falsifier sciemment la théorie marxiste". (Bilan n° 10)
Mais le texte de Mitchell ne reste pas au niveau abstrait. Il nous présente les phases principales de l'ascendance et du déclin de l'ensemble du système capitaliste, depuis les crises cycliques du 19ème siècle, où il essaye de mettre en évidence l'interaction entre le problème de la réalisation et la tendance à la baisse du taux de profit, le développement de l'impérialisme et du monopole et la fin du cycle des guerres nationales après les années 1870. Tout en mettant l'accent sur le rôle croissant du capital financier, il critique la tendance de Boukharine à voir l'impérialisme comme un produit du capital financier plutôt que comme une réponse du capital à ses contradictions internes. Il analyse la chasse aux colonies et la concurrence croissante entre les principales puissances impérialistes comme étant les facteurs immédiats de la Première Guerre mondiale, qui marque l'entrée du système dans sa crise de sénilité. Il identifie alors certaines des caractéristiques principales du mode de vie du capitalisme dans cette nouvelle période : le recours croissant à la dette et au capital fictif, l'interférence massive de l'État dans la vie économique, dont le fascisme est une expression typique mais qui est significative de la tendance plus générale au divorce croissant entre l'argent et la valeur réelle symbolisé par l'abandon de l'étalon or. La récupération de courte durée effectuée par le capitalisme après la Première Guerre mondiale est expliquée par certains facteurs : la destruction de capital surabondant ; la demande produite par la nécessité de reconstruire les économies ruinées ; la position unique des États-Unis comme nouvelle locomotive de l'économie mondiale ; mais, surtout, la "prospérité fictive" créée par le crédit : cette croissance d'après-guerre n'était pas basée sur une véritable expansion du marché global et était donc très différente des reprises du 19ème siècle. Du même coup, la crise mondiale qui a éclaté en 1929 était différente des crises cycliques du 19ème siècle : pas seulement en ce qui concerne son échelle mais en raison de sa nature insoluble, faisant qu'elle ne serait pas suivie automatiquement ou spontanément par un boom. Le capitalisme survivrait dorénavant en flouant de plus en plus ses propres lois : "En nous référant aux facteurs déterminants de la crise générale du capitalisme, nous pouvons comprendre pourquoi la crise mondiale ne peut être résorbée par 1'action "naturelle" des lois économiques capitalistes, pourquoi, au contraire, celles-ci sont vidées par le pouvoir conjugué du capital financier et de l'État capitaliste, comprimant toutes les manifestations d'intérêts capitalistes particuliers" (Bilan n° 11). Ainsi, si les manipulations de l'État permettaient un accroissement de la production, celui-ci a été consacré en grande partie au secteur militaire et aux préparatifs pour une nouvelle guerre. "De quelque côté qu'il se tourne, quelque moyen qu'il puisse utiliser pour se dégager de l'étreinte de la crise, le capitalisme est poussé irrésistiblement vers son destin, à la guerre. Où et comment elle surgira est impossible à déterminer aujourd'hui. Ce qu'il importe de savoir et d'affirmer, c'est qu'elle explosera en vue du partage de l'Asie et qu'elle sera mondiale" (ibid).
Sans entrer davantage dans l'analyse des forces et de certains points plus faibles de l'analyse de Mitchell [4], ce texte s'avère remarquable à tout point de vue, il constitue une première tentative de la part de la Gauche communiste de fournir une analyse cohérente, unifiée et historique du processus d'ascendance et de décadence du capitalisme.
La Gauche germano-hollandaise
Dans la tradition de la gauche germano-hollandaise, qui avait été sévèrement décimée par la répression contre-révolutionnaire en Allemagne même, l'analyse luxemburgiste constituait encore la référence pour un certain nombre de groupes. Mais il y existait également une tendance importante, orientée dans une autre direction, en particulier dans la Gauche hollandaise et dans le groupe autour de Paul Mattick aux États-Unis. En 1929, Henryk Grossman publiait un travail important sur la théorie des crises : La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste. Le Groep van Internationale Communisten (GIC) en Hollande avait qualifié ce travail de "remarquable" [5] et, en 1934, Paul Mattick publiait un résumé (et un développement) des idées de Grossman, intitulé "La crise permanente – l'interprétation par Henryk Grossman de la théorie de Marx de l'accumulation capitaliste", au sein du n° 2 du volume 1 de International Council Correspondence. Ce texte reconnaissait explicitement la valeur de la contribution de Grossman tout en la développant sur certains points. En dépit du fait que Grossman était sympathisant du KPD et d'autres partis staliniens, et malgré l'appréciation qu'il faisait de Mattick, le considérant comme politiquement sectaire [6], les deux hommes ont maintenu une correspondance pendant quelque temps, en grande partie autour des questions posées par le livre de Grossman.
Le livre de Grossman a donc été publié avant l'éclatement de la crise mondiale, mais il a certainement inspiré un certain nombre de révolutionnaires pour appliquer sa thèse à la réalité concrète de la Grande Dépression. Au cœur de son livre, Grossman insiste sur l'idée selon laquelle la théorie de l'effondrement du capitalisme est absolument centrale dans Le Capital de Marx, même si Marx ne pouvait pas en tirer les conséquences ultimes. Les révisionnistes du marxisme - Bernstein, Kautsky, Tugan Baranowski, Otto Bauer et d'autres - ont tous rejeté la notion d'effondrement du capitalisme, en toute cohérence avec leur politique réformiste. Pour Grossman, il était axiomatique que le socialisme ne surviendrait pas seulement parce que le capitalisme était un système immoral mais parce que son évolution historique elle-même devait le plonger dans des contradictions insurmontables, le transformant en entrave à la croissance des forces productives : "À un certain stade de son développement historique, le capitalisme ne parvient plus à susciter un nouveau développement des forces productives. À partir de ce moment, la chute du capitalisme devient économiquement inévitable. La véritable tâche que se fixait Marx dans Le Capital était de fournir une description précise de ce processus et d'en saisir les causes au moyen d'une analyse scientifique du capitalisme" (La loi de l'accumulation, édition abrégée en anglais - 1992, Pluto Press, p. 36. Notre traduction). D'autre part, "s'il n'existe pas une raison économique faisant que le capitalisme doit nécessairement échouer, alors le socialisme peut remplacer le capitalisme sur des bases qui n'ont rien d'économique mais qui sont purement politiques, psychologiques ou morales. Mais, dans ce cas, nous abandonnons le fondement matérialiste d'un argument scientifique en faveur de la nécessité du socialisme, nous abandonnons la déduction de cette nécessité à partir du mouvement économique" (ibid, p. 56).
Jusque-là, Grossman est en accord avec Luxemburg qui avait ouvert la voie en réaffirmant le rôle central de la notion d'effondrement et, sur ce point, il est à ses côtés contre les révisionnistes. Cependant, Grossman considérait que la théorie de Luxemburg sur la crise comportait de grandes faiblesses car elle était basée sur une mauvaise compréhension de la méthode que Marx avait cherché à développer dans son utilisation du schéma de la reproduction : "au lieu d'examiner le schéma de la reproduction de Marx dans le cadre de son système total et particulièrement de sa théorie de l'accumulation, au lieu de se demander quel rôle celui-ci joue méthodologiquement dans la structure de sa théorie, au lieu d'analyser le schéma de l'accumulation depuis son début jusqu'à sa conclusion finale, Luxemburg a été inconsciemment influencée par eux (les épigones révisionnistes). Elle en est arrivée à croire que les schémas de Marx permettent une accumulation illimitée" (ibid p125). En conséquence, argumentait-il, elle a déplacé le problème de la sphère principale de la production de la plus-value vers la sphère secondaire de la circulation. Grossman a réexaminé le schéma de la reproduction qu'Otto Bauer avait adapté de Marx dans sa critique de L'accumulation du capital [7]. Le but de Bauer était alors de réfuter la thèse de Luxemburg selon laquelle le capitalisme serait confronté à un problème insoluble dans la réalisation de la plus-value une fois qu'il aurait éliminé tous les marchés "extérieurs" à son mode de production. Pour Bauer, la croissance démographique du prolétariat était suffisante pour absorber toute la plus-value requise pour permettre l'accumulation. Il faut souligner que Grossman n'a pas commis l'erreur de considérer le schéma de Bauer comme une description réelle de l'accumulation capitaliste (contrairement à ce que dit Pannekoek, nous y reviendrons plus loin) : "Je montrerai que le schéma de Bauer reflète et ne peut refléter que le côté valeur du processus de reproduction. En ce sens, ce schéma ne peut pas décrire le processus réel de l'accumulation en termes de valeur et valeur d'usage. Deuxièmement, l'erreur de Bauer consiste en ceci qu'il suppose que le schéma de Marx est, d'une certaine manière, une illustration des processus réels dans le capitalisme, et oublie les simplifications qui l'accompagnent. Mais ces points faibles ne réduisent pas la valeur du schéma de Bauer" (ibid p. 69). L'intention de Grossman, lorsqu'il pousse le schéma de Bauer jusqu'à à sa conclusion "mathématique", est de montrer que, même sans problème de réalisation, le capitalisme se heurterait inévitablement à des barrières insurmontables. Prenant en considération l'augmentation de la composition organique du capital et la tendance à la baisse du taux de profit qui en résulte, l'élargissement global du capital aboutirait à un point où la masse absolue du profit serait insuffisante pour permettre davantage d'accumulation, et le système serait confronté à l'effondrement. Dans l'utilisation par Grossman, selon ses hypothèses, du schéma de Bauer, ce point est atteint au bout de 35 ans : à partir dece moment, "toute nouvelle accumulation de capital dans les conditions postulées serait tout à fait sans effet. Le capitaliste gaspillerait ses efforts à gérer un système productif dont les fruits sont entièrement absorbés par la part des travailleurs. Si cet état persistait, cela signifierait une destruction du mécanisme capitaliste, sa fin économique. Pour la classe des entrepreneurs, l'accumulation serait non seulement insignifiante, elle serait objectivement impossible parce que le capital sur-accumulé se trouverait inexploité, ne pourrait pas fonctionner, échouerait à rapporter du profit" (ibid, p. 76).
Ceci a amené certains critiques de Grossman à dire que celui-ci pensait pouvoir prévoir avec une certitude absolue le moment où le capitalisme deviendrait impossible. Cependant, cela n'a jamais été son but. Grossmann essayait simplement de se réapproprier la théorie de Marx de l'effondrement en expliquant pourquoi celui-ci avait considéré la tendance à la baisse du taux de profit comme la contradiction centrale dans le processus d'accumulation. "Cette baisse du taux de profit à l'étape de la suraccumulation est différente de la baisse de ce taux aux étapes précédentes de l'accumulation du capital. Un taux de profit en baisse est un symptôme permanent du progrès de l'accumulation au cours de ses différentes étapes mais, durant les premières étapes de l'accumulation, il va de pair avec une masse croissante de profit et une consommation capitaliste elle aussi en hausse. Au-delà de certaines limites cependant, la baisse du taux de profit s'accompagne d'une chute de la plus-value affectée à la consommation capitaliste et, bientôt, de la plus-value destinée à l'accumulation. "La baisse du taux de profit s'accompagnerait cette fois d'une diminution absolue de la masse du profit" [Marx, Le Capital, livre 3, 3e section, Conclusions, "Les contradictions internes de la loi", Bibliothèque de La Pléiade, tome 2, p. 1034]" (ibid pp. 76-77).
Pour Grossman, la crise ne survient pas, comme le soutenait Rosa Luxemburg, parce que le capitalisme est confronté à "trop" de plus-value, mais parce qu'au final trop peu de plus-value est extraite de l'exploitation des travailleurs pour réaliser davantage d'investissements rentables dans l'accumulation. Les crises de surproduction se produisent effectivement mais elles sont fondamentalement la conséquence de la suraccumulation du capital constant : "La surproduction des marchandises est une conséquence d'une valorisation insuffisante due à la suraccumulation. La crise n'est pas provoquée par une disproportion entre l'expansion de la production et l'insuffisance du pouvoir d'achat, c'est-à-dire par une pénurie de consommateurs. La crise intervient parce qu'aucune utilisation n'est faite du pouvoir d'achat qui existe. C'est parce que cela ne paie pas d'augmenter la production puisque l'échelle de la production ne modifie pas la quantité de plus-value disponible. Ainsi, d'une part, le pouvoir d'achat demeure inemployé, de l'autre, les marchandises produites demeurent invendues" (ibid p. 132).
Le livre de Grossman constitue un réel retour à Marx et il n'hésite pas à critiquer des marxistes éminents comme Lénine et Boukharine pour leur incapacité à analyser les crises ou les menées impérialistes du capitalisme comme des expressions de ses contradictions internes, se concentrant au lieu de cela sur des manifestations extérieures de ces dernières (dans le cas de Lénine, par exemple, l'existence des monopoles vue comme la cause de l'impérialisme). Dans l'introduction à son livre, Grossman explique la prémisse méthodologique qui sous-tend cette critique : "J'ai essayé de montrer comment les tendances empiriquement décelables de l'économie mondiale qui sont considérées comme définissant les caractéristiques de de la dernière étape du capitalisme (monopoles, exportation de capitaux, la lutte pour le partage des sources des matières premières, etc.) ne sont que des manifestations extérieures secondaires qui résultent de l'essence de l'accumulation capitaliste qui en constitue le fondement. A travers ce mécanisme interne, il est possible d'employer un seul principe, la loi marxiste de la valeur, pour expliquer clairement toutes les manifestations du capitalisme sans avoir besoin d'improviser une théorie spécifique, et également de faire la lumière sur son étape ultime - l'impérialisme. Je n'insiste pas sur le fait que c'est la seule manière de démontrer l'immense cohérence du système économique de Marx"
Poursuivant dans la même veine, Grossman se défend alors à l'avance de l'accusation "d'économisme pur" :
"Puisque, dans cette étude, je me limite délibérément à ne décrire que les fondements économiques de l'effondrement du capitalisme, laissez-moi dès à présent dissiper tout soupçon d'économisme. Il est inutile de gâcher du papier à propos du lien entre les sciences économiques et la politique ;il est évident que ce lien existe. Cependant, tandis que les marxistes ont énormément écrit sur la révolution politique, ils ont négligé de traiter théoriquement l'aspect économique de cette question et n'ont pas réussi à prendre en compte le contenu réel de la théorie de Marx de l'effondrement. Mon unique souci ici est de combler cette lacune de la tradition marxiste" (Ibid p. 32-33).
On doit garder cela à l'esprit quand on accuse Grossman de ne décrire la crise finale du système que par l'incapacité de l'appareil économique de continuer à fonctionner plus longtemps. Cependant, si on laisse de côté l'impression créée par plusieurs de ses formulations abstraites au sujet de l'effondrement capitaliste, il y a un problème plus fondamental dans la tentative de Grossman "de faire la lumière sur l'étape ultime (du capitalisme) - l'impérialisme"
À la différence de Mitchell, par exemple, il ne conçoit pas explicitement son travail comme étant destiné à clarifier les conclusions auxquelles la Troisième internationale avait abouti, à savoir que la Première Guerre mondiale avait ouvert l'époque de déclin du capitalisme, l'époque des guerres et des révolutions. Dans certains passages, par exemple, il reproche à Boukharine de considérer la guerre (mondiale) comme la preuve du fait que l'époque de l'effondrement est arrivée, il tend à réduire l'importance de la Guerre Mondiale comme expression indubitable de la sénilité du mode de production capitaliste. Il est vrai qu'il accepte que cela "pourrait très bien être le cas", et que son objection principale à l'argument de Boukharine est l'idée de ce dernier selon laquelle la guerre serait la cause du déclin et non son symptôme ; mais Grossman argumente également que "loin de constituer une menace pour le capitalisme, les guerres sont le moyen de prolonger son existence comme un tout. Les faits montrent précisément qu'après chaque guerre, le capitalisme connaît une nouvelle période de croissance" (ibid pp. 49-50). Ceci représente une sérieuse sous-estimation de la menace que la guerre capitaliste représente pour la survie de l'humanité et semble confirmer que, pour Grossman, la crise finale sera purement économique. En outre, bien que son travail témoigne d'un certain nombre d'efforts pour concrétiser son analyse – en mettant en évidence l'accroissement inévitable des tensions impérialistes provoquée par la tendance vers l'effondrement, son insistance sur l'inévitabilité d'une crise finale qui obligerait la classe ouvrière à renverser le système ne fait pas clairement apparaître si l'époque de la révolution prolétarienne est réellement déjà ouverte.
Mattick et l'époque de la crise permanente
Par rapport à cette question, le texte de Mattick est plus explicite que le livre de Grossman puisqu'il appréhende la crise du capitalisme dans le contexte général du matérialisme historique et, ce faisant, au moyen du concept d'ascendance et de décadence des différents modes de production. Ainsi, le point de départ du document est l'affirmation selon laquelle "le capitalisme en tant que système économique a eu la mission de développer les forces productives de la société à un degré qu'aucun système précédent n'aurait été capable d'atteindre. Le moteur du développement des forces productives dans le capitalisme est la course pour le profit. Et pour cette raison même, ce processus ne peut se poursuivre qu'aussi longtemps qu'il est rentable. De ce point de vue, le capital devient une entrave au développement continu des forces productives dès lors que ce développement entre en conflit avec la nécessité du profit" (notre traduction). Mattick n'a aucun doute sur le fait que l'époque de la décadence capitaliste est arrivée et que nous sommes maintenant dans la phase de la crise permanente comme l'exprime le titre de son texte, quoiqu'il puisse y avoir des booms temporaires provoqués par des mesures destinées à enrayer le déclin, telles que l'augmentation de l'exploitation absolue. Ces booms temporaires "au sein de la crise mortelle", ne sont pas "une expression du développement mais du délabrement".A nouveau, peut-être plus clairement que Grossman, Mattick ne plaide pas pour un effondrement automatique une fois que le taux de profit aura diminué en-deçà d'un certain niveau : il montre la réaction du capitalisme à son impasse historique, consistant à augmenter l'exploitation de la classe ouvrière pour extraire les dernières gouttes de plus-value requises pour l'accumulation, et marchant à la guerre mondiale pour s'approprier les matières premières à meilleur marché, conquérir des marchés et annexer de nouvelles sources de force de travail. En même temps, il considère les guerres, tout comme la crise économique elle-même, comme "de gigantesques dévalorisations du capital constant à travers la destruction violente de valeur et de valeurs d'usage qui forment sa base matérielle". Ces deux facteurs conduisent à une augmentation de l'exploitation et, selon la vision de Mattick, la guerre mondiale provoquera une réaction de la classe ouvrière qui ouvrira la perspective de la révolution prolétarienne. Déjà, la Grande Dépression constitue "la plus grande crise dans l'histoire capitaliste" mais "c'est de l'action des travailleurs que dépend qu'elle soit la dernière pour le capitalisme, aussi bien que pour ceux-ci".
Le travail de Mattick se situe ainsi clairement dans la continuité des tentatives antérieures de l'Internationale communiste et de la Gauche communiste pour comprendre la décadence du système. Et tandis que Grossman avait déjà examiné les limites des contre-tendances à la baisse du taux de profit, Mattick a permis de rendre celles-ci plus concrètes à travers l'analyse du développement réel de la crise capitaliste mondiale pendant la période ouverte par le krach de 1929.
De notre point de vue, en dépit des concrétisations apportées par Mattick à la théorie de Grossman, des aspects de cette démarche générale demeurent abstraits. Nous sommes perplexes face à la vision de Grossman selon laquelle il n'y a "aucune trace chez Marx" d'un problème d'insuffisance du marché (La loi de l'accumulation, p. 128). Le problème de la réalisation ou de la "circulation" ne réside pas en dehors du processus d'accumulation mais en constitue une partie indispensable.De même, Grossman semble écarter le problème de la surproduction comme étant un simple sous-produit de la baisse du taux de profit et ignore les passages de Marx qui l'enracinent clairement au sein des relations fondamentales entre travail salarié et capital [8]. Alors qu' en analysant ces éléments, Luxemburg fournit un cadre cohérent pour comprendre pourquoi le triomphe même du capitalisme en tant que système global devait le propulser dans son ère de déclin, il est plus difficile de saisir à quel moment l'augmentation de la composition organique du capital atteint un niveau tel que les contre-tendances deviennent inefficaces et que le déclin commence. En effet, en incluant le commerce extérieur dans l'ensemble de ces contre-tendances, Mattick lui-même se rapproche un peu de Luxemburg quand il argumente que la transformation des colonies en pays capitalistes enlève cette option essentielle : "En transformant les pays importateurs de capitaux en pays exportateurs de capitaux, en accélérant leur développement industriel par une forte croissance locale, le commerce extérieur cesse de devenir une contre-tendance [à la baisse du taux de profit]. Alors que l'effet des contre-tendances est annulé, la tendance à l'effondrement capitaliste reste dominante. Nous avons alors la crise permanente, ou la crise mortelle du capitalisme. Le seul moyen qu'il reste pour permettre au capitalisme de continuer à exister est alors la paupérisation permanente, absolue et générale du prolétariat". À notre avis, nous avons là une indication du fait que le problème de la réalisation - la nécessité de l'extension permanente du marché global afin de compenser les contradictions internes du capital - ne peut pas être retiré de l'équation aussi facilement [9].
Cependant, le but de ce chapitre n'est pas de fouiller à nouveau dans les arguments en faveur ou contre la théorie de Luxemburg, mais de prouver que l'explication alternative de la crise contenue dans la théorie de Grossman-Mattick s'insère également entièrement dans une compréhension de la décadence du capitalisme. Il n'en est pas de même concernant la principale critique portée à la thèse de Grossman-Mattick au sein de la Gauche communiste pendant les années 1930, "La théorie de l'écroulement du capitalisme" de Pannekoek, texte édité pour la première fois dans Rätekorrespondenz en juin 1934 [10].
La critique par Pannekoek de la théorie de l'effondrement
Pendant les années 1930, Pannekoek travaillait très étroitement avec le Groep van Internationale Communisten et son texte a, sans aucun doute, été écrit en réponse à la popularité croissante des théories de Grossman au sein du courant communiste de conseils : il mentionne le fait que cette théorie avait déjà été intégrée dans le manifeste du Parti Uni des Travailleurs de Mattick. Les paragraphes introductifs du texte expriment une préoccupation qui pouvait être parfaitement justifiée et avait en vue d'éviter les erreurs faites par un certain nombre de communistes allemands à l'heure de la vague révolutionnaire, quand l'idée de la "crise mortelle" était invoquée pour affirmer que le capitalisme avait déjà épuisé toutes les options et qu' une légère poussée seulement était nécessaire pour le renverser complètement, un point de vue qui s'associait souvent à des actions volontaristes et aventuristes. Cependant, comme nous l'avons écrit par ailleurs [11], la faille essentielle dans le raisonnement de ceux qui défendaient la notion de crise mortelle dans l'après-guerre ne résidait pas dans la notion même de crise catastrophique du capitalisme. Cette notion caractérise un processus qui peut durer des décennies et non un krach soudain qui viendrait de nulle part. Cette faille résidait dans l'amalgame de deux phénomènes distincts : la décadence historique du capitalisme comme mode de production et la crise économique conjoncturelle –quelle que soit sa profondeur- que le système peut connaître à un moment donné. Dans sa polémique contre l'idée d'un l'effondrement du capitalisme en tant que phénomène immédiat et ayant lieu à un niveau purement économique, Pannekoek est tombé dans le piège de rejeter complètement la notion de décadence du capitalisme, en cohérence avec d'autres positions auxquelles il adhérait à cette époque, comme la possibilité de révolutions bourgeoises dans les colonies et le "rôle bourgeois du bolchevisme" en Russie.
Pannekoek commence par critiquer la théorie de l'effondrement de Rosa Luxemburg. Il reprend des critiques classiques faites à ses théories selon lesquelles celles-ci sont basées sur un faux problème et que, mathématiquement parlant, les schémas de la reproduction de Marx ne présentent pas de problème de réalisation pour le capitalisme. Cependant, la cible principale du texte de Pannekoek est la théorie de Grossman.
Pannekoek reproche à Grossman deux aspects essentiels : le manque de concordance entre sa théorie des crises et celle de Marx ; la tendance à considérer la crise comme un facteur automatique de l'avènement du socialisme exigeant peu de la classe ouvrière en termes d'action consciente. Un certain nombre des critiques détaillées faites par Pannekoek à l'utilisation par Grossman des tables de Bauer souffre d'un point de départ défectueux, en ce sens qu'il accuse Grossman de prendre telles quelles les tables de Bauer. Nous avons montré que ceci est faux. Plus sérieuse est son accusation selon laquelle Grossman aurait mal compris, voire même consciemment réécrit Marx concernant la relation entre la baisse du taux de profit et l'augmentation de la masse du profit. Pannekoek insiste sur le fait que, puisqu'une augmentation de la masse du profit a toujours accompagné la baisse du taux de profit, Marx n'a jamais envisagé une situation où il y aurait une pénurie absolue de plus-value : "Marx parle d’une suraccumulation qui introduit la crise, d’un trop-plein de plus-value accumulée qui ne trouve pas où s’investir et pèse sur le profit ; l’écroulement de Grossmann provient d’une insuffisance de plus-value accumulée."
(https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [216])
Il est difficile de suivre ces critiques : il n'est pas contradictoire de parler, d'une part, de suraccumulation et, d'autre part, d'une pénurie de plus-value : la "suraccumulation" étant une autre manière de dire qu'il y a un excès de capital constant, ceci signifiera nécessairement que les marchandises produites contiendront moins de plus-value et ainsi moins de profit potentiel pour les capitalistes. Il est vrai que Marx a considéré qu'une baisse du taux de profit serait compensée par une augmentation de la masse du profit : ceci dépend en particulier de la possibilité de vendre une quantité de marchandises toujours plus grande et nous amène ainsi au problème de la réalisation de la plus-value, mais nous n'avons pas l'intention de l'examiner ici.
Le problème majeur que nous voulons aborder ici est la notion basique d'effondrement capitaliste et non pas les explications théoriques spécifiques à celle-ci. L'idée d'un effondrement purement économique (et il est vrai que Grosssman tend dans cette direction avec sa vision de la crise finale en tant que simple grippage des mécanismes économiques du capitalisme) trahit une approche très mécanique du matérialisme historique où l'action humaine ne joue qu'un rôle infime, voire ne joue pas de rôle ; et, pour Pannekoek, Marx a toujours vu la fin du capitalisme comme résultant de l'action consciente de la classe ouvrière. Cette question est centrale dans la critique portée par Pannekoek aux théories de l'effondrement, parce qu'il estimait que de telles théories tendaient à sous-estimer la nécessité pour la classe ouvrière de s'armer dans la lutte, de développer sa conscience et son organisation afin de réaliser l'immense tâche de renverser le capitalisme, qui ne tomberait certainement pas comme un fruit mûr dans les mains du prolétariat. Pannekoek accepte le fait que Grossman ait considéré que l'avènement de la crise finale provoquerait la lutte des classes, mais il critique la vision purement économiste de cette lutte. Pour Pannekoek, "Ce n’est pas parce que le capitalisme s’écroule économiquement et que les hommes –les ouvriers et les autres– sont poussés par la nécessité à créer une nouvelle organisation, que le socialisme apparaît. Au contraire : le capitalisme, tel qu’il vit et croît, devenant toujours plus insupportable pour les ouvriers, les pousse à la lutte, continuellement, jusqu’à ce que se soient formées en eux la volonté et la force de renverser la domination du capitalisme et de construire une nouvelle organisation, et alors le capitalisme s’écroule. Ce n’est pas parce que l’insupportabilité du capitalisme est démontrée de l’extérieur, c’est parce qu’elle est vécue spontanément comme telle, qu’elle pousse à l’action.".
(https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [216])
En fait, un passage de Grossman anticipe déjà plusieurs des critiques de Pannekoek : "L'idée de l'effondrement, nécessaire pour des raisons objectives, ne contredit évidemment pas la lutte des classes. En revanche, l'effondrement, en dépit de sa nécessité objectivement donnée, peut être influencé dans une large mesure par l'action vivante des classes en lutte et laisse une certaine place pour une intervention active de la classe. C'est alors seulement qu'il est possible de comprendre pourquoi, un haut niveau d'accumulation du capital étant atteint, chaque hausse sérieuse des salaires rencontre de plus en plus de difficultés, pourquoi chaque lutte économique majeure devient nécessairement une question d'existence pour le capitalisme, une question de pouvoir politique…. La lutte de la classe ouvrière sur des revendications quotidiennes est ainsi liée à sa lutte pour le but final. Le but final, pour lequel la classe ouvrière lutte, n'est pas un idéal introduit au sein du mouvement ouvrier depuis l'extérieur par des moyens spéculatifs, et dont la réalisation, indépendante des luttes du présent, est réservée à l'avenir lointain. C'est le contraire, comme le montre la loi de l'effondrement du capitalisme présentée ici : [le but final est] un résultat des luttes quotidiennes immédiates et il peut être atteint plus rapidement au moyen de ces luttes" (Kuhn, op. cit. pp. 135-6, citation issue de l'édition allemande complète de La loi de l'accumulation. Notre traduction),
Mais, pour Pannekoek, Grossman était "un économiste bourgeois qui n’a jamais eu d'expérience pratique de la lutte du prolétariat, et par conséquent est dans une situation qui lui interdit de comprendre l’essence du marxisme" (https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_1934... [216]). Et bien que, il faut en convenir, Grossman ait critiqué des aspects du "vieux mouvement ouvrier" (social-démocratie et "communisme de parti"), il n'avait vraiment rien en commun avec ce que les communistes de conseils appelaient le "nouveau mouvement ouvrier", qui était véritablement indépendant du "vieux". Pannekoek insiste ainsi sur le fait que si, pour Grossman, il y a une dimension politique à la lutte des classes, celle-ci relève essentiellement de l'activité d'un parti de type bolchevique. Pour lui, Grossman est resté un avocat de l'économie planifiée, et la transition de la forme traditionnelle et anarchique du capital à la forme gérée par l’État pourrait facilement se passer de toute intervention du prolétariat auto-organisé ; tout ce dont elle a besoin, c'est de la main ferme d'une "avant-garde révolutionnaire" au moment de la crise finale.
Il n'est pas totalement juste d'accuser Grossman de n'être rien qu'un économiste bourgeois sans expérience pratique de la lutte des travailleurs : avant la guerre, il avait été très impliqué dans le mouvement des travailleurs juifs en Pologne et, bien qu'à la suite de la vague révolutionnaire il soit resté un sympathisant des partis staliniens (et des années plus tard, peu avant sa mort, il avait été employé par l'université de Leipzig en Allemagne de l'Est stalinienne), il a toujours maintenu une indépendance d'esprit, si bien que ses théories ne peuvent pas être écartées comme une simple apologie du stalinisme. Comme nous l'avons vu, il n'a pas hésité à critiquer Lénine ; il a maintenu une correspondance avec Mattick et, pendant une brève période au début des années 1930, il avait été attiré par l'opposition trotskiste. Il est clair que, contrairement à Rosa Luxemburg, Mattick, ou lénine, il n'a pas passé la plus grande partie de sa vie en tant que révolutionnaire communiste, mais il est réducteur de considérer la totalité de la théorie de Grossman comme étant le reflet direct de sa politique [12].
Pannekoek résume son argumentation dans "La théorie de l'écroulement du capitalisme" de la manière suivante : "Le mouvement ouvrier n’a pas à attendre une catastrophe finale, mais beaucoup de catastrophes, des catastrophes politiques – comme les guerres – et économiques – comme les crises qui se déclenchent périodiquement, tantôt régulièrement, tantôt irrégulièrement mais qui, dans l’ensemble, avec l’extension croissante du capitalisme, deviennent de plus en plus dévastatrices. Cela ne cessera de provoquer l’écroulement des illusions et des tendances du prolétariat à la tranquillité, et l’éclatement de luttes de classe de plus en plus dures et de plus en plus profondes. Cela apparaît comme une contradiction que la crise actuelle – plus profonde et plus dévastatrice qu’aucune auparavant – ne laisse rien entrevoir de l’éveil d’une révolution prolétarienne. Mais l’élimination des vieilles illusions est sa première grande tâche : en premier lieu de l’illusion de rendre le capitalisme supportable, grâce aux réformes qu’obtiendraient la politique parlementaire et l’action syndicale ; et d’autre part, l’illusion de pouvoir renverser le capitalisme dans un assaut guidé par un parti communiste se donnant des allures révolutionnaires. C’est la classe ouvrière elle-même, comme masse, qui doit mener le combat, et elle a encore à se reconnaître dans les nouvelles formes de lutte, tandis que la bourgeoisie façonne de plus en plus solidement son pouvoir. Des luttes sérieuses ne peuvent pas ne pas venir. La crise présente peut bien se résorber, de nouvelles crises viendront et de nouvelles luttes. Dans ces luttes la classe ouvrière développera sa force de combat, reconnaîtra ses objectifs, se formera, se rendra autonome et apprendra à prendre elle-même en main ses propres destinées, c’est-à-dire la production sociale. C’est dans ce processus que s’accomplit le trépas du capitalisme. L’auto-émancipation du prolétariat est l’écroulement du capitalisme". (https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_1934... [216])
Il y a beaucoup de choses correctes dans cette vision, surtout la nécessité pour la classe dans son ensemble de développer son autonomie vis-à-vis de toutes les forces capitalistes qui se présentent comme son sauveur. Pannekoek, cependant, n'explique pas pourquoi les crises devraient devenir de plus en plus dévastatrices - il invoque seulement la taille du capitalisme comme facteur de cette caractéristique [13]. Mais également, il ne pose pas la question : combien de catastrophes dévastatrices le capitalisme peut-il traverser avant qu'il ne se détruise lui-même et, avec lui, la possibilité d'une nouvelle société ? En d'autres termes, ce qui est absent ici, c'est la compréhension que le capitalisme est un système limité historiquement par ses propres contradictions et qu'il a déjà mis l'humanité face à l'alternative socialisme ou barbarie. Pannekoek avait parfaitement raison d'insister sur le fait que l'effondrement économique ne mènerait nullement automatiquement au socialisme. Mais il a tendu à oublier qu'un système en déclin qui n'a pas été renversé par la classe ouvrière révolutionnaire pourrait se détruire et détruire avec lui toute possibilité pour le socialisme. Les lignes introductrices du Manifeste communiste laissent ouverte la possibilité que les contradictions croissantes du mode de production puissent aboutir simplement à la ruine mutuelle des classes en présence si la classe opprimée ne peut pas réaliser sa transformation de la société. Dans ce sens, le capitalisme est en effet condamné à se détériorer jusqu'à sa "crise finale", et il n'y a aucune garantie que le communisme puisse s'édifier sur le sol de cette débâcle. Cette prise de conscience ne saurait cependant en rien diminuer l'importance de l'action décidée de la classe ouvrière pour imposer sa propre solution à l'effondrement du capitalisme. Au contraire, elle rend d'autant plus urgente et indispensable la lutte consciente du prolétariat et l'activité des minorités révolutionnaires en son sein.
Gerrard
1. Terme anglophone faisant explicitement référence à la période de l'entre-deux-guerres, et plus précisément aux années 1920 comme son nom l'indique, période durant laquelle les activités économiques et culturelles battent leur plein. On désigne par là le plus souvent un phénomène qui s'est déroulé en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Cependant, ce phénomène trouve son pendant en France avec les "années folles". Source Wikipédia.
2. Notre traduction à partir de l'anglais. Il existe également une version en français.
3. Par exemple, Advance (Le Progrès), le journal de l'APCF, a édité en mai 1936 un article de Willie McDougall, intitulé "Le capitalisme doit continuer" qui explique la crise économique en termes de surproduction. L'article conclut de la sorte : "La mission historique [du capitalisme] - le remplacement du féodalisme - a été accomplie. Il a élevé le niveau de la production à des sommets auxquels ne songeaient même pas ses propres pionniers, mais son point le plus haut a été atteint et le déclin a commencé. A chaque fois qu'un système devient une entrave au développement ou au fonctionnement même des forces productives, une révolution est imminente et il est condamné à laisser la place à un successeur. Tout comme le féodalisme devait laisser la place au système plus productif qu'est le capitalisme, ce dernier doit être balayé du chemin du progrès pour laisser la place au socialisme." (Notre traduction à partir de l'anglais).
4. En particulier les paragraphes traitant la destruction de capital et du travail dans la guerre. Voir à ce sujet l'introduction à la discussion sur les facteurs à la base des "Trente glorieuses" [217] dans la Revue internationale n° 133 et, également, la note 2 [218] à la deuxième partie de l'article de Mitchell dans la Revue internationale n° 103.
5. PIC, Persdinst van de Groep van Internationale Communisten no.1, Janvier 1930 ‘Een marwaardog boek’, cité dans la brochure du CCI La Gauche Hollandaise, p 210.
6. Rick Kuhn, Henryk Grossman and the Recovery of Marxism, Chicago 2007, p 184
7. Otto Bauer, "L'accumulation du capital", Die Neue Zeit, 1913
8. Voir l'article précédent de cette série de la Revue internationale n° 139, "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise [190]".
9. Dans un travail postérieur, Crises et théorie des crises (1974), Mattick revient sur ce problème et reconnaît qu'effectivement Marx ne conçoit pas le problème de la surproduction seulement comme une conséquence de la baisse du taux de profit, mais comme une contradiction réelle, résultant en particulier du "pouvoir de consommation limité" de la classe ouvrière. En fait, son honnêteté intellectuelle l'amène à poser une question inconfortable : "Une fois de plus, nous nous trouvons devant le point de savoir si Marx a élaboré deux théories des crises, l'une découlant de la théorie de la valeur, sous la forme de la baisse du taux de profit, l'autre relative à la faiblesse de la consommation ouvrière" (Crises et théorie des crises, chapitre "Les épigones", p. 140, Éditions Champ Libre). La réponse qu'il propose est que les formulations de Marx relatives à la "sous-consommation de la classe ouvrière" doivent être imputées "soit à une erreur de jugement soit à une faute de plume" (Idid., chapitre "La théorie des crises chez Marx", p. 100).
10. Traduction en français : "La théorie de l'écroulement du capitalisme [216]", sur www.marxists.org [219].
11. "L'âge des catastrophes [220]" dans la Revue internationale n° 143.
12. Ce serait là une erreur en quelque sorte similaire à celle que Pannekoek a faite dans Lénine philosophe où il défendait que les influences bourgeoises sur les écrits philosophiques de Lénine démontraient la nature de classe bourgeoise du bolchevisme et de la révolution d'Octobre
13. Voir notre livre sur la Gauche hollandaise, p 211, où une remarque semblable est faite au sujet de la position du GIC dans son ensemble : "tout en rejetant les conceptions quelque peu fatalistes de Grossman et de Mattick, le GIC abandonnait tout l'héritage théorique de la gauche allemande sur les crises. La crise de 1929 n'était pas une crise généralisée exprimant le déclin du système capitaliste mais une crise cyclique. Dans une brochure parue en 1933, le GIC affirmait que la Grande Crise avait un caractère chronique et non pas permanent, même depuis 1914. Le capitalisme était semblable au Phénix de la légende, sans cesse renaissant de ses cendres. Après chaque "régénération" par la crise, le capitalisme apparaît "plus grand et plus puissant que jadis". Mais cette régénération n'était pas éternelle ; puisque "l'incendie menace de mort toujours plus violemment l'ensemble de la vie sociale". Finalement, seul le prolétariat pouvait donner le "coup mortel" au Phénix capitaliste et transformer un cycle de crise en crise finale. Cette théorie était donc contradictoire, puisque, d'un côté, elle reprenait la vision des crises cycliques comme au XIXe siècle, élargissant sans cesse l'extension du capitalisme, en une ascension ininterrompue ; de l'autre, elle définissait un cycle de destructions et de reconstructions de plus en plus fatal à la société." La brochure évoquée dans la citation est De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven.
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Rubrique:
Revue Internationale n° 147 - 4e trimestre 2011
- 2510 lectures
La catastrophe économique mondiale est inévitable
- 2742 lectures
Ces derniers mois sont intervenus, de façon très rapprochée, des évènements d'une grande portée et qui témoignent de la gravité de la situation économique mondiale : incapacité de la Grèce à faire face à ses dettes ; menaces analogues pour l'Espagne et l'Italie ; mise en garde de la France pour son extrême vulnérabilité face à une éventuelle cessation de paiement de la Grèce ou l'Italie ; blocage à la Chambre des Représentants des États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette de l'État ; perte par ce pays de son "triple A" - note maximale qui, jusque-là, caractérisait la garantie de remboursement de sa dette ; rumeurs de plus en plus persistantes sur le risque de faillite de certaines banques, les démentis opposés ne trompant personne, étant donné les suppressions d'emplois massives auxquelles elles ont déjà procédé ; première confirmation de cette rumeur avec la faillite de la banque franco-belge Dexia. Chaque fois, les dirigeants de ce monde courent après les événements mais les brèches qu'ils semblaient avoir colmatées s'ouvrent à nouveau, quelques semaines ou même quelques jours plus tard. Leur impuissance à contenir l'escalade de la crise ne traduit pas tant leur incompétence et leur vue à court terme, que la dynamique actuelle du capitalisme vers des catastrophes qui ne peuvent être évitées : faillites d'établissements financiers, faillites d'États, plongée dans une profonde récession mondiale.
Des conséquences dramatiques pour la classe ouvrière
Les mesures d'austérité prises depuis 2010 sont implacables, plaçant de plus en plus la classe ouvrière - et une grande partie du reste de la population - dans l'incapacité de faire face à leurs besoins vitaux. Énumérer toutes les mesures d'austérité qui ont été mises en place dans la zone euro, ou qui sont en train de l'être, aboutirait à un très long catalogue. Il est malgré tout nécessaire d'en mentionner un certain nombre qui tendent à se généraliser et sont significatives du sort qui est fait à des millions d'exploités. En Grèce, alors qu'en 2010 les impôts sur les biens de consommation avaient été augmentés, l'âge de la retraite repoussé à 67 ans, et les salaires des fonctionnaires réduits brutalement, il a été décidé, au mois de septembre 2011, de mettre au chômage technique 30 000 employés de la fonction publique avec une diminution de 40% de leur salaire, de réduire de 20% le montant des retraites de plus de 1200 euros et d'imposer tous les revenus supérieurs à 5000 euros par an 1. Dans presque tous les pays les impôts augmentent, l'âge de la retraite est relevé et des emplois publics sont supprimés par dizaines de milliers. Il en résulte des dysfonctionnements importants des services publics, y compris ceux revêtant un caractère vital ; ainsi, dans une ville comme Barcelone, les blocs opératoires et les services d'urgence ont réduit leurs heures d'ouverture et des lits d'hôpitaux sont supprimés en masse 2 ; à Madrid, 5000 professeurs non-titulaires ont perdu leur poste 3 et cela a été compensé par l'augmentation de 2 heures de la durée hebdomadaire d'enseignement des professeurs titulaires.
Les chiffres du chômage sont de plus en plus alarmants : 7,9% au Royaume-Uni à la fin août, 10% en zone euro (20% en Espagne) à la fin septembre 4 et 9,1% aux États-Unis à la même période. Durant tout l'été, les plans de licenciements ou de suppression d'emplois se sont succédés : 6500 chez Cisco, 6000 chez Lockheed Martin, 10000 chez HSBC, 30000 chez Bank of America, et la liste n'est pas close. Les revenus des exploités chutent : selon les chiffres officiels, le salaire réel avait diminué de plus de 10% en rythme annuel en Grèce au début 2011, de plus de 4% en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal et en Italie. Aux États-Unis, 45,7 millions de personnes, soit une augmentation de 12% en un an 5, ne survivent que grâce au système des bons d'alimentation de 30 dollars par semaine délivrés par l'Administration.
Et malgré cela, le pire est encore à venir.
Ainsi, c'est toujours avec plus d'acuité que se pose la nécessité du renversement du système capitaliste avant que, dans son effondrement, il n'entraîne la ruine de l'humanité. Les mouvements de protestation en réaction aux attaques et qui ont eu lieu depuis le printemps 2011 dans un certain nombre de pays, quelles que soient les insuffisances ou les faiblesses qu'ils peuvent exprimer, constituent néanmoins les premiers jalons d'une riposte prolétarienne d'ampleur à la crise du capitalisme (voir à ce sujet l'article "De l'indignation à la préparation des combats de classe" dans ce numéro de la Revue internationale).
Depuis 2008 la bourgeoisie n'est pas parvenue à endiguer la tendance à la récession
L'illusion pouvait exister, au début de l'années 2010, que les États étaient parvenus à mettre le capitalisme à l'abri d'une poursuite de la récession qui avait eu lieu en 2008 et début 2009 et s'était traduite par une chute vertigineuse de la production. A cette fin, toutes les grandes banques centrales du monde avaient procédé à des injections massives de monnaie dans l'économie. C'est à cette occasion que Ben Bernanke, le directeur de la FED (à l'origine du lancement de plans de relance considérables), fut surnommé "Helicopter Ben" tant il paraissait arroser les États-Unis de dollars depuis un hélicoptère. Entre 2009 et 2010, d'après les chiffres officiels que l'on sait toujours surévalués, le taux de croissance était passé aux États-Unis de 2,6% à +2,9% et, dans la zone euro, de 4,1% à +1,7%. Dans les pays émergents, les taux de croissance, qui avaient baissé, semblaient retrouver en 2010 les valeurs antérieures à la crise financière : 10,4% en Chine, 9% en Inde. Tous les États et leurs médias avaient alors entonné le couplet de la reprise alors qu'en réalité la production de l'ensemble des pays développés n'est jamais parvenue à retrouver ses niveaux de 2007. En d'autres termes, en fait de reprise, on peut tout juste parler d'un pallier au sein d'un mouvement de chute de la production. Et ce palier n'a duré que quelques trimestres :
- Dans les pays développés, les taux de croissance ont recommencé à chuter à partir de la mi-2010. La croissance prévue aux États-Unis pour l'année 2011 est de 0,8%. Ben Bernanke a annoncé que la reprise américaine était sur le point de "marquer le pas". Par ailleurs, la croissance des grands pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni) est voisine de 0 et si les gouvernements des pays du Sud de l'Europe (Espagne, 0,6% en 2011 après -0,1% en 2010 6 ; Italie, 0,7% en 2011) 7 sont en train de nous répéter sur tous les tons que leur pays "n'est pas en récession", en réalité, compte tenu des plans de rigueur qu'ils ont subi et vont encore subir, la perspective qui les attend n'est certainement n'est pas très éloignée de ce que connaît actuellement la Grèce, pays dont la chute de la production sera supérieure à 5 % en 2011.
- Pour les pays émergents, la situation est loin d'être brillante. S'ils ont connu des taux de croissance importants en 2010 avaient été, l'année 2011 se présente sous un jour beaucoup moins favorable. Le FMI avait prévu qu'ils connaîtraient une croissance de 8,4% l'an pour l'année 2011 8, mais certains indices montrent que l'activité en Chine est en train de ralentir 9. Il est prévu que la croissance du Brésil passe de 7,5% en 2010 à 3,7% en 2011 10 . Et enfin, les capitaux sont en train de fuir la Russie 11. En bref, contrairement à ce que nous ont rabâché les économistes et beaucoup d'hommes politiques depuis des années, les pays émergents ne seront pas la locomotive permettant un retour de la croissance mondiale. Tout au contraire, ceux-ci vont pâtir au premier chef de la dégradation de la situation des pays développés et connaître ainsi une chute de leurs exportations, lesquelles avaient jusqu'alors été le facteur de leur croissance.
Le FMI vient de revoir ses prévisions qui tablaient sur une croissance de 4% au niveau mondial pour les années 2011 et 2012, en signalant, après avoir précédemment constaté que la croissance s'était "considérablement affaiblie", "qu'il ne peut pas exclure" 12 une récession pour l'année 2012. En d'autres termes, la bourgeoisie est en train de prendre conscience à quel point l'activité économique va se contracter. Au vu d'une telle évolution, on ne peut que se poser la question : pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas continué à arroser le monde de monnaie comme elles l'ont fait à la fin de l'année 2008 et en 2009, augmentant ainsi de manière considérable la masse monétaire (elle a été multipliée par 3 aux États-Unis et par 2 dans la zone euro) ? La raison en est que le déversement de "monnaie de singe" sur les économies ne résout pas les contradictions du capitalisme. Il en résulte moins une relance de la production que de l'inflation, cette dernière avoisinant 3% en zone euro, un peu plus aux États-Unis, 4,5% au Royaume-Uni, entre 6% et 9% dans les pays émergents.
L'émission de monnaie papier ou électronique permet que de nouveaux prêts soient consentis… et que l'endettement mondial soit augmenté. Le scénario n'est pas nouveau, c'est comme cela que de grands acteurs économiques du monde se sont endettés à un point tel qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui rembourser leur dette. En d'autres termes, ils sont aujourd'hui insolvables, et parmi eux on compte, rien de moins, que les États européens, l'État américain et l'ensemble du système bancaire.
Le cancer de la dette publique
La zone euro
Les États européens éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer le paiement des intérêts de leur dette.
Si c'est dans la zone euro que se sont manifestés en premier des défauts de paiement de certains États, c'est parce que ceux-ci n'ayant pas, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon, la maîtrise de l'émission de leur propre monnaie, ils n'ont pas eu la possibilité de faire marcher la planche à billets pour honorer, en monnaie de singe, les échéances de leur dette. L'émission d'Euros est du ressort de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est plutôt soumise à la volonté des grands États Européens et, en particulier, de l'Allemagne. Et, comme chacun le sait, multiplier la masse monétaire par deux ou par trois, alors que la production stagne, ne peut que se traduire par le développement de l'inflation. C'est pour éviter cela que la BCE a de plus en plus renâclé à assurer le financement des États qui le nécessitaient afin de ne pas se retrouver elle-même en défaut de paiement.
C'est une des raisons essentielles pour laquelle les pays de la zone euro vivent, depuis un an et demi, sous la menace d'un défaut de paiement de l'État grec. En fait, le problème qui se pose à la zone euro n'a pas de solution car son refus de financer la dette grecque provoquerait la cessation de paiement de la Grèce et sa sortie de la zone euro. Les créanciers de la Grèce, parmi lesquels figurent des États européens et des banques européennes importantes, rencontreraient à leur tour des difficultés pour faire face à leurs propres engagements, et seraient à leur tour menacés de faillite. C'est l'existence même de la zone Euro qui se trouve ainsi mise en question, alors que son existence est essentielle pour les pays exportateurs situés au nord de celle-ci, l'Allemagne en particulier.
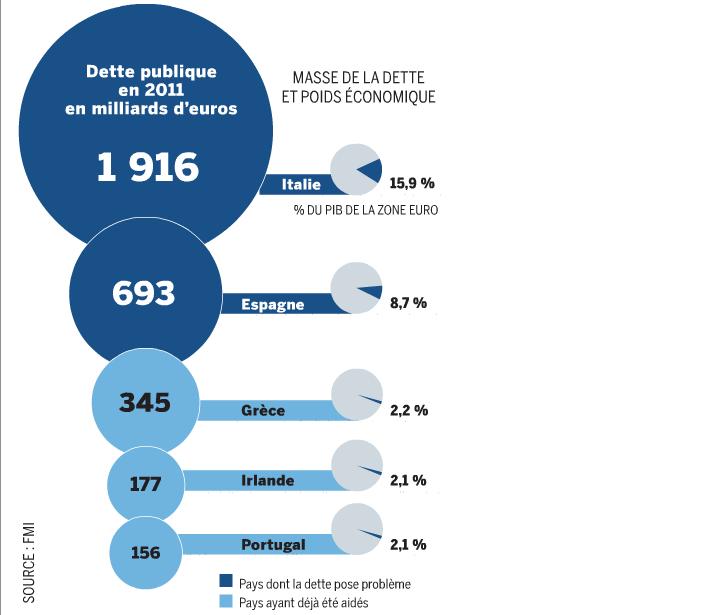
C'est essentiellement la Grèce qui, depuis un an et demi, a polarisé l'attention sur les questions de défaut de paiement. Mais des pays comme l'Espagne et l'Italie vont se trouver dans une situation semblable vu qu'ils n'arriveront jamais à dégager les recettes fiscales nécessaires à l'amortissement d'une partie de leur dette (Cf. Graphique) 13. Un simple regard sur l'ampleur de la dette de l'Italie, dont le défaut de paiement à court terme est très probable, montre que la zone euro ne pourra pas soutenir ce pays pour lui permettre d'assumer ses engagements. Déjà les investisseurs croient de moins en moins en ses capacités de remboursement, et c'est pour cela qu'ils ne consentent à lui prêter de l'argent qu'à des taux très élevés. La situation de l'Espagne est, pour sa part, assez voisine de celle de la Grèce.
Les prises de position des gouvernements et des instances de la zone euro, en particulier du gouvernement allemand, traduisent leur incapacité à faire face à la situation créée par la menace de faillite de certains pays. La majeure partie de la bourgeoisie de la zone euro est consciente du fait que le problème n'est plus de savoir si la Grèce est en défaut de paiement : l'annonce selon laquelle les banques allaient participer au sauvetage de la Grèce pour 21% de sa dette constituait déjà une reconnaissance de cette situation, qui a été confirmée lors du sommet Merkel-Sarkozy du 9 Octobre admettant qu'il y aura défaut de paiement de la Grèce pour 60% de sa dette. Dès lors, le problème qui se pose à la bourgeoisie est de trouver les moyens de faire en sorte que ce défaut de paiement provoque le moins de convulsions possibles au sein de la zone euro, ce qui constitue un exercice particulièrement délicat provocant hésitations et divisions en son sein. Ainsi, les partis politiques au pouvoir en Allemagne sont très divisés sur le fait de savoir s'il faut aider financièrement la Grèce, comment l'aider et s'il faut aussi aider les autres États qui vont à grands pas vers le même défaut de paiement qui touche aujourd'hui ce pays. A titre d'illustration, il est remarquable que le plan décidé le 21 juillet par les autorités de la zone euro pour "sauver" la Grèce et qui prévoit un renforcement de la capacité de prêt du Fonds Européen de Stabilité Financière de 220 à 440 milliards d'euros (avec pour corollaire évident une augmentation de la contribution des différents États), ait été, pendant des semaines, remis en cause par une partie importante des partis au pouvoir en Allemagne. Revirement de situation, il a finalement été massivement voté par le Bundestag le 29 septembre ! De même, jusqu'à début août, le gouvernement allemand refusait que la BCE rachète des titres de la dette souveraine de l'Italie et de l'Espagne. Compte tenu de la dégradation de la situation financière de ces pays, l'État allemand a finalement accepté qu'à partir du 7 août la BCE puisse racheter de telles obligations 14. Si bien que, entre le 7 août le 22 août, la BCE aura racheté pour 22 milliards de dette souveraine de ces deux pays 15 ! En fait, ces contradictions et atermoiements montrent qu'une bourgeoisie aussi importante internationalement que la bourgeoisie allemande ne sait pas quelle politique mener. De manière générale, l'Europe, poussée par l'Allemagne, a plutôt choisi l'austérité. Cela n'exclut pas de permettre de financer a minima les États et les banques par l'instauration du Fonds Européen de Solidarité Financière (ce qui suppose donc aussi l’augmentation des ressources financières de cet organisme), ni d'autoriser la BCE à créer suffisamment de monnaie pour venir en aide à un État ne pouvant plus payer ses dettes, afin que le défaut de paiement n'intervienne pas tout de suite.
Bien sûr le problème n'est pas celui de la bourgeoisie allemande, mais celui de toute la classe dominante car c'est elle dans son ensemble qui, depuis la fin des années 1960, s'est endettée pour éviter la surproduction, et cela à un point tel qu'il est aujourd'hui très difficile de non seulement de rembourser les échéances de la dette mais même d'honorer les intérêts de celle-ci. D'où les économies qu'elle essaie de faire actuellement au moyen de politiques d'austérité draconiennes qui ponctionnent tous les revenus mais, dans le même temps, ne peuvent qu'impliquer une diminution de la demande, accroître la surproduction et accélérer la plongée dans la dépression.
Les États-Unis
Ce pays a été confronté au même type de problème durant l'été 2011.
Le plafond de la dette, qui avait été fixé en 2008 à 14 294 milliards de dollars, a été atteint en mai 2011. Il devait être relevé pour que, de manière analogue aux pays de la zone euro, ils puissent faire face à leurs engagements, y compris intérieurs, c'est-à-dire assurer le fonctionnement de l'État. Même si l'invraisemblable archaïsme et la bêtise du Tea Party ont été un facteur d'aggravation de la crise, ils n'ont pas constitué le fond du problème qui s'est posé au Président et au Congrès des États-Unis. Le vrai problème était bien l'alternative suivante dont il fallait choisir l'un des termes :
- soit poursuivre la politique d'endettement de l'État fédéral, comme le demandaient les démocrates, c'est-à-dire fondamentalement demander à la FED de créer de la monnaie au risque de provoquer une chute incontrôlée de la valeur de cette dernière ;
- soit pratiquer une politique d'austérité drastique comme l'exigeaient les républicains, à travers en particulier la réduction, sur 10 ans, des dépenses publiques de 4000 à 8000 milliards de dollars. A titre de comparaison, le PIB des États-Unis en 2010 était de 14 624 milliards de dollars, ce qui donne une idée de l'ampleur des coupes budgétaires, et donc des suppressions d'emplois publics, impliquées par un tel plan.
En résumé, l'alternative posée cet été aux États-Unis était la suivante : soit prendre le risque d'ouvrir la porte à une inflation pouvant devenir galopante, soit pratiquer une politique d'austérité qui ne pouvait que réduire fortement la demande, provoquer la chute ou même la disparition des profits, avec au bout du compte la fermeture en chaine de toute une série d'entreprises et une chute vertigineuse de la production. Du point de vue des intérêts du capital national, tant le positionnement des Républicains que celui des Démocrates est légitime. Tiraillées par les contradictions qui assaillent l'économie nationale, les autorités américaines de ce pays en furent réduites à des demi-mesures… contradictoires et incohérentes. Le Congrès se trouvera donc à nouveau confronté à la nécessité de réaliser à la fois des milliers de milliards de dollars d'économies budgétaires et un nouveau plan de relance de l'emploi.
L'issue du conflit entre républicains et démocrates montre que, contrairement à l'Europe, les États-Unis ont plutôt choisi l'aggravation de la dette puisque le plafond de la dette fédérale a ainsi été rehaussé de 2100 milliards de dollars jusqu'en 2013 avec, comme contrepartie, des réductions de dépenses budgétaires d'environ 2500 milliards dans les dix ans à venir.
Mais, comme pour l'Europe, cette décision montre que l'État américain ne sait pas quelle politique mener face à l'impasse de son endettement.
L’abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Standard and Poor's et les réactions qu'elle a provoquées sont une illustration du fait que la bourgeoisie sait parfaitement qu'elle est dans une impasse et qu'elle ne voit pas quels moyens se donner pour en sortir. Contrairement à bien d'autres décisions des agences de notation depuis le début de la crise des subprimes, la décision de Standard and Poor's de cet été apparaît cohérente : l'agence montre qu'il n'y pas de recettes suffisantes pour compenser l'augmentation de l'endettement accepté par le Congrès et que, en conséquence, la capacité des États-Unis de rembourser leurs dettes a perdu de sa crédibilité. En d'autres termes, pour cette institution, le compromis qui a évité une grave crise politique aux États-Unis en aggravant l'endettement de ce pays va accroître l'insolvabilité de l'État américain lui-même. La perte de confiance des financiers de la planète envers le dollar qui inévitablement résultera de la sentence de Standard and Poor's va tirer ainsi sa valeur à la baisse. Par ailleurs, si le vote de l'augmentation du plafond de la dette fédérale permet d'éviter la paralysie à l'Administration fédérale, les différents États fédérés et les municipalités en faillite le resteront. Depuis le 4 juillet, l'État du Minnesota est en défaut de paiement et il a dû demander à 22 000 fonctionnaires de rester chez eux 16. Un certain nombre de villes américaines (dont Central Falls et Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie) sont dans la même situation ; situation que l'État de Californie – et il n'est pas le seul - semble ne pas pouvoir éviter dans un avenir proche.
Face à l'aggravation de la crise depuis 2007, aussi bien la politique économique de la zone euro que celle des États-Unis, n'ont pu éviter aux États de devoir prendre en charge les dettes qui avaient été, à l'origine, contractées par le secteur privé. Ces nouvelles dettes du secteur public n'ont fait qu'accroître la dette publique qui, de son côté, ne cessait de se développer depuis des décennies. Il en a résulté un échéancier de remboursements auxquels les États ne peuvent pas faire face. Aux États-Unis comme dans la zone euro, cela se traduit par des licenciements massifs dans le secteur public, par la baisse sans fin des salaires et l'augmentation, également sans fin, des impôts.
La menace d'une grave crise bancaire
En 2008-2009, après l'effondrement de certaines banques comme Bear Stearns et Northern Rock et la faillite pure et simple de Lehman Brothers, les États avaient volé au secours de beaucoup d'autres en les recapitalisant afin de leur éviter le même sort. Où en est-on à présent de la santé des établissements bancaires ? Elle est à nouveau très mauvaise. Tout d'abord, les livres des comptes bancaires sont loin d'avoir évacué toute une série de créances irrécouvrables. Ensuite, beaucoup de banques sont elles-mêmes détentrices d'une partie de la dette d'États aujourd'hui en difficulté de paiement. Le problème pour elles, c'est que la valeur de la dette ainsi achetée a depuis lors considérablement diminué.
La déclaration récente du FMI, se basant sur sa connaissance des difficultés actuelles des banques européennes et stipulant que celles-ci devaient augmenter leurs fonds propres de 200 milliards, a provoqué en retour des réactions agacées et des déclarations de la part de ces institutions selon lesquelles tout allait bien pour elles. Et cela, alors qu'au même moment, tout témoignait du contraire :
- les banques américaines ne veulent plus refinancer en dollars les filiales américaines des banques européennes et rapatrient les fonds qu'elles avaient placés en Europe ;
- les banques européennes se prêtent de moins en moins entre elles parce qu'elles sont de moins en moins sûres d'être remboursées et préfèrent placer, même à des taux très bas, leurs liquidités à la BCE ;
- conséquence de ce manque de confiance se généralisant, les taux des prêts entre banques ne cessent d'augmenter, même s'ils n'ont pas encore atteint les niveaux de fin 2008 17.
Le comble, c'est que quelques semaines après que les banques aient affirmé leur merveilleuse santé, on assistait à la faillite et à la liquidation de la banque franco-belge Dexia sans qu'aucune autre banque ne soit intéressée à se porter à son secours.
Ajoutons que les banques américaines sont bien mal placées pour "rouler des mécaniques" face à leurs consœurs européennes : du fait des difficultés qu'elles rencontrent, Bank of America vient de supprimer 10% de ses postes de travail et Goldman Sachs, la banque qui est devenue le symbole de la spéculation mondiale, vient de licencier 1000 personnes. Et, elles aussi, préfèrent déposer leurs liquidités à la FED plutôt que de prêter à d'autres banques américaines.
La santé des banques est essentielle pour le capitalisme car celui-ci ne peut pas fonctionner sans un système bancaire qui l'approvisionne en monnaie. Or, la tendance à laquelle nous assistons est celle qui mène au "Credit Crunch", à savoir une situation dans laquelle les banques ne veulent plus prêter dès qu'il y a le moindre risque de non-remboursement. Ce que cela contient, à terme, c'est un blocage de la circulation du capital, c'est-à-dire le blocage de l'économie. On comprend mieux, sous cet angle, pourquoi le problème du renforcement des fonds propres des banques est devenu le premier point à l'ordre du jour des multiples réunions au sommet qui ont lieu au niveau international, avant même la situation de la Grèce qui, pourtant, n'est toujours pas réglée. Au fond, le problème des banques montre l’extrême gravité de la situation économique et illustre à lui seul les difficultés inextricables auxquelles le capitalisme doit faire face.
Lors de la perte de la note AAA par les États-Unis, le quotidien économique français Les Echos titrait le 8 août 2011 en première page : "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu". Lorsque le principal média économique de la bourgeoisie française exprime une telle désorientation, une telle angoisse par rapport à l'avenir, il ne fait en cela qu'exprimer la désorientation de la bourgeoisie elle-même. Depuis 1945, le capitalisme occidental (et le capitalisme mondial après l'effondrement de l'URSS) est basé sur le fait que la force du capital américain constitue en dernière instance le gage ultime garantissant l'ensemble des dollars qui assurent, partout dans le monde, la circulation des marchandises, et donc du capital. Or, l'immense accumulation de dettes que la bourgeoisie américaine a contractées pour faire face, depuis la fin des années 1960, au retour de la crise ouverte du capitalisme, a fini par constituer un facteur accélérateur et aggravant de cette même crise. Tous ceux qui détiennent des parcelles de la dette américaine, à commencer par l'État américain lui-même, détiennent en réalité un avoir… qui vaut de moins en moins. La monnaie dans laquelle celle-ci est libellée, ne peut à son tour que s'affaiblir de même que… l'État américain.
La base de la pyramide sur laquelle le monde est construit depuis 1945 se désagrège. En 2007, lors de la crise financière, le système financier mondial a été sauvé par les banques centrales, c'est-à-dire par les États ; maintenant ceux-ci sont au bord de la faillite et il est hors de question que les banques puissent venir les secourir ; de quelque côté que les capitalistes se tournent, il n'existe rien qui puisse permettre une réelle reprise économique. En effet, une croissance même très faible suppose l'émission de nouvelles dettes pour créer une demande permettant d'écouler les marchandises ; or, même les intérêts des dettes déjà contractées ne sont plus remboursables et précipitent banques et États dans la banqueroute.
Comme on l'a vu, des décisions qui étaient affirmées irrévocables sont remises en cause au bout de quelques jours, des certitudes affirmées quant à la santé de l'économie ou des banques sont démenties tout aussi rapidement. Dans un tel contexte, les États sont de plus en plus amenés à naviguer au jour le jour. Il est probable, mais non certain, justement parce que la bourgeoisie est désorientée par une situation inédite, que pour faire face à l'immédiat, pour gagner un peu de temps, elle continue à arroser de monnaie le capital qu'il soit financier, commercial ou industriel, même si cela induit une inflation qui a déjà commencé, qui va s'accroître et qui va devenir de plus en plus incontrôlable. Cela n'empêchera pas la poursuite des licenciements, des baisses de salaires et des hausses d'impôts ; mais, en plus, l'inflation va aggraver la misère de la très grande majorité des exploités. Le jour même où Les Echos titraient "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu", un autre quotidien économique français, La tribune, titrait "Dépassés", à propos des grands décideurs de la planète dont la photo figurait également en "Une". Oui, ceux qui nous ont promis monts et merveille, puis qui nous ont consolés lorsqu'il était devenu évident qu'en fait de merveille c'était le cauchemar qui nous attendait, avouent maintenant qu'ils sont "dépassés". Et s'ils sont "dépassés", c'est parce que leur système, le capitalisme, est définitivement caduc et qu'il est en train d'entraîner la très grande majorité de la population mondiale dans la plus terrible des misères.
Vitaz (10-10-2011)
1 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/09/22/04016-20110922ARTFIG00699-la-colere-gronde-de-plus-en-plus-fort-en-grece.php [222]
2 https://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/espagne-les-enseignants-manif... [223]
3 www.rfi.fr/fr/europe/20110921-manifestations-enseignants-lyceens-espagne [224]
4 Statistique Eurostat
5 Le Monde, 7-8 août 2011
6 finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique
7 globalix.fr/la-dynamique-de-la-dette-italiennela-dynamique-de-la-dette-italienne [225]
8 FMI, perspectives de l'économie mondiale, juillet 2010
9 Le Figaro, 3 octobre 2011
10Les Echos, 9 août 2011
11 www.lecourrierderussie.com/2011/10/12/poutine-la-crise-existe [226]
12https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/10/05/97002-20111005FILWWW00435-fmi-recession-mondiale-pas-exclue.php [227]
13Paru dans le journal Le Monde du 5 août 2011.
14Les Echos, août 2011
15Les Echos, 16 août 2011
16www.rfi.fr/fr/ameriques/20110702-faillite-le-gouvernement-minnesota-cesse-activites [228]
17https://www.gecodia.fr/Le-stress-interbancaire-en-Europe-s-approche-du-pic-post-Lehman_a2348.html [229]
Récent et en cours:
- Crise économique [153]
Rubrique:
Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe
- 5836 lectures
Dans le dernier éditorial de la Revue internationale no 146, nous rendions compte de la lutte qui se développait en Espagne [1]. Depuis, la contagion de son exemple s’est propagée jusqu’en Grèce et en Israël [2]. Dans le présent article, nous voulons tirer les leçons de ces mouvements et voir quelles perspectives s’en dégagent face à une situation de faillite du capitalisme et d’attaques féroces contre le prolétariat et la grande majorité de la population mondiale.
Il est indispensable pour les comprendre de rejeter catégoriquement la méthode immédiatiste et empiriste qui prédomine dans la société actuelle. Celle-ci analyse chaque événement en lui-même, hors de tout contexte historique et en l’isolant dans le pays où il apparaît. Cette méthode photographique est un reflet de la dégénérescence idéologique de la classe capitaliste, car "le seul projet que cette classe puisse proposer à l’ensemble de la société est celui de résister au jour le jour, au coup par coup, et sans espoir de réussite, à l’effondrement irrémédiable du mode de production capitaliste" [3].
Une photographie peut nous montrer un personnage heureux arborant un large sourire, mais cela peut occulter qu’il affichait quelques secondes avant ou après un rictus angoissé. Nous ne pouvons comprendre les mouvements sociaux de cette façon. On ne peut les voir qu’en les situant à la lumière du passé qui les a fait mûrir et du futur qu’ils annoncent ; il est nécessaire de les situer dans le cadre mondial et non dans le réduit national où ils apparaissent ; et, surtout, ils doivent être compris dans leur dynamique, non par ce qu’ils sont à un moment donné mais par ce qu’ils peuvent devenir du fait des tendances, forces et perspectives qu’ils contiennent et qui surgiront tôt ou tard à la surface.
Le prolétariat sera-t-il capable de répondre à la crise du capitalisme ?
Nous avons publié, au début du xxie siècle, une série de deux articles intitulés "A l'aube du xxie siècle, pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme ?" [4]. Nous y rappelions que la révolution communiste n’est pas une fatalité et que son avènement dépend de l'union de deux facteurs, l’objectif et le subjectif. Le facteur objectif est donné par la décadence du capitalisme [5] et par le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production [6] comme le dit l'article. Le facteur subjectif est lié à l’action collective et consciente du prolétariat.
L’article reconnaît que le prolétariat a raté ses rendez-vous avec l’histoire. Lors du premier – la Première Guerre mondiale –, la tentative de riposte par une vague révolutionnaire mondiale en 1917-23 fut défaite ; lors du deuxième – la Grande dépression de 1929 –, il fut absent comme classe autonome ; lors du troisième – la Seconde Guerre mondiale –, non seulement il fut absent mais il crut en outre que la démocratie et l’État-providence, ces mythes manipulés par les vainqueurs, constituaient réellement sa victoire. Par la suite, avec le retour de la crise à la fin des années 1960, il "n'avait pas manqué le rendez-vous (…) mais, en même temps, nous avons pu mesurer la quantité d'obstacles auxquels il s'est affronté depuis et qui ont ralenti d'autant son chemin vers la révolution prolétarienne" [7]. Ces freins se vérifièrent lors d’un nouvel événement de grande envergure – l’effondrement des régimes soi-disant "communistes" en 1989 –, dans lequel non seulement il ne fut pas facteur actif, mais où il fut victime d’une formidable campagne anti-communiste qui le fit reculer tant au niveau de sa conscience que de sa combativité.
Ce que nous pourrions appeler le "cinquième rendez-vous" de l’histoire s’ouvre à partir de 2007. La crise qui se manifeste plus ouvertement démontre l’échec pratiquement définitif des politiques que le capitalisme avait déployées pour accompagner l’émergence de sa crise économique insoluble. L’été 2011 a mis en évidence que les énormes sommes injectées ne peuvent arrêter l’hémorragie et que le capitalisme est entraîné sur la pente de la Grande dépression, d’une gravité bien supérieure à celle de 1929 [8].
Mais, dans un premier temps, et malgré les coups qui pleuvent sur lui, le prolétariat semble également absent. Nous avions envisagé une telle situation lors de notre XVIIIe Congrès international (2009) : "Mais ce seront probablement, dans un premier temps, des combats désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus" [9].
Les mouvements actuels en Espagne, Israël et Grèce montrent que le prolétariat commence à assumer ce "cinquième rendez-vous de l’histoire", à se préparer pour y être présent, à se donner les moyens de vaincre [10].
Dans la série citée plus haut, nous disions que deux des piliers sur lesquels le capitalisme – tout au moins dans les pays centraux – s’est appuyé pour maintenir le prolétariat sous sa coupe étaient la démocratie et ce que l’on nomme "État-providence". Ce que révèlent les trois mouvements actuels c'est que ces piliers commencent à être contestés, bien que confusément encore, contestation qui va se nourrir de l’évolution catastrophique de la crise.
La contestation de la démocratie
La colère contre les politiciens et, en général, contre la démocratie s’est manifestée dans les trois mouvements, comme s’est aussi manifestée l’indignation vis-à-vis du fait que les riches et leur personnel politique soient toujours plus riches et corrompus, que la grande majorité de la population soit traitée comme une marchandise au service des bénéfices scandaleux de la minorité exploiteuse, marchandise jetée à la poubelle quand les "marchés ne vont pas bien" ; les programmes d’austérité drastiques aussi ont été dénoncés, programmes dont personne ne parle jamais lors des campagnes électorales et qui pourtant deviennent la principale occupation de ceux qui sont élus.
Il est évident que ces sentiments et ces attitudes ne sont pas nouveaux : dire du mal des politiciens par exemple a été monnaie courante au cours de ces trente dernières années. Il est clair aussi que ces sentiments peuvent être détournés vers des impasses comme ont tenté de le faire avec persévérance les forces de la bourgeoisie en action dans ces trois mouvements : "vers une démocratie participative", vers un "renouveau de la démocratie", etc.
Mais ce qui est nouveau et revêt une importance significative, c’est que ces thème qui, qu’on le veuille ou non, mettent en question la démocratie, l’État bourgeois et ses appareils de domination, sont l’objet de débats lors d’innombrables assemblées. On ne peut comparer des individus qui ruminent leur dégoût tout seuls, atomisés, passifs et résignés avec ces mêmes individus qui l’expriment collectivement dans des assemblées. Au-delà des erreurs, des confusions, des impasses qui s’y expriment inévitablement et qui doivent être débattues avec la plus grande patience et énergie, l’essentiel se trouve précisément dans le fait que les problèmes soient posés publiquement, ce qui contient en puissance une évidente politisation des grandes masses et, aussi, le principe d’une mise en question de cette démocratie qui a rendu tant de services au capitalisme tout au long du dernier siècle.
La fin du prétendu "État-providence"
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme instaura ce qui fut appelé "l’État-providence" [11]. Celui-ci a constitué un des principaux piliers de la domination capitaliste au cours des 70 dernières années. Il a créé l’illusion que le capitalisme aurait dépassé les aspects les plus brutaux de sa réalité : l’État-providence garantirait une sécurité face au chômage, pour la retraite, la gratuité des soins de santé et d’éducation, des logements sociaux, etc.
Cet "État social", complément de la démocratie politique, a subi des amputations significatives au cours des 25 dernières années et s’achemine à présent vers sa disparition pure et simple. En Grèce, en Espagne ou en Israël (où c'est surtout la pénurie de logements qui a polarisé les jeunes), l’inquiétude créée par cette suppression des minima sociaux était au centre des mobilisations. Il est bien évident que la bourgeoisie a tenté de les dévoyer vers des "réformes" de la Constitution, l'adoption de lois qui "garantissent" ces prestations, etc. Mais la vague d’inquiétude croissante va contribuer à remettre en cause ces digues qui ont vocation de contrôler les travailleurs.
Les mouvements des Indignés, point culminant de huit années de luttes
Le cancer du scepticisme domine l’idéologie actuelle et infecte également le prolétariat et ses minorités révolutionnaires. Comme on l'a dit plus haut, le prolétariat a raté tous les rendez-vous que l’histoire lui avait donnés durant presqu’un siècle de décadence capitaliste et il en résulte un doute angoissant dans ses rangs concernant sa propre identité et ses capacités, à tel point que même lors de manifestations de combativité, certains rejettent jusqu’au terme de "classe ouvrière" [12]. Ce scepticisme est d’autant plus fort qu’il est alimenté par la décomposition du capitalisme [13] : le désespoir, l’absence de projet concret concernant l’avenir favorisent l’incrédulité et la méfiance envers toute perspective d’action collective.
Les mouvements en Espagne, Israël et Grèce – malgré toutes les faiblesses qu’ils contiennent – commencent à fournir un remède efficace contre le cancer du scepticisme, de par leur existence même et par ce qu’ils signifient dans la continuité des luttes et des efforts de prise de conscience que réalise le prolétariat mondial depuis 2003 [14]. Ils ne sont pas un orage qui éclate soudain dans un ciel d’azur, ils sont le fait d’une lente condensation ces huit dernières années de petites nuées, de crachins, d’éclairs timides qui a progressé jusqu’à atteindre une qualité nouvelle.
Le prolétariat commence à récupérer depuis 2003 de la longue période de recul dans sa conscience et dans sa combativité qu’il a subi à partir des événements de 1989. Ce processus suit un rythme lent, contradictoire et très tortueux, se manifestant par :
– une succession de luttes assez isolées dans divers pays tant du centre que de la périphérie, caractérisées par des manifestations "chargées de futur" : recherche de solidarité, tentatives d’auto-organisation, présence des nouvelles générations, réflexions sur l’avenir ;
– un développement de minorités internationalistes qui recherchent une cohérence révolutionnaire, se posent de nombreuses questions et recherchent le contact entre elles, débattent, tracent des perspectives…
En 2006 éclatent deux mouvements – la lutte contre le CPE en France [15] et la grève massive des travailleurs de Vigo en Espagne – qui, malgré la distance, la différence de conditions ou d’âge, présentent des traits similaires : assemblées générales, extension à d’autres secteurs, massivité des manifestations… C’est comme un premier coup de semonce qui, apparemment, n’a pas de suite [16].
Un an plus tard un embryon de grève massive éclate en Égypte à partir d’une grande usine de textile. Début 2008 éclatent de nombreuses luttes isolées les unes des autres mais simultanées dans un grand nombre de pays, de la périphérie au centre du capitalisme. D’autres mouvements se distinguent, comme la prolifération de révoltes de la faim dans 33 pays durant le premier trimestre 2008. En Égypte, elles sont soutenues et en partie prises en charge par le prolétariat. Fin 2008 éclate la révolte de la jeunesse ouvrière en Grèce, appuyée par une partie du prolétariat. Nous remarquons aussi des germes de réactions internationalistes en 2009 à Lindsay (Grande-Bretagne) et une grève généralisée explosive dans le sud de la Chine (en juin).
Après le recul initial du prolétariat face au premier impact de la crise, comme nous l’avons signalé, celui-là commence à lutter de façon bien plus décidée et, en 2010, la France est secouée par des mouvements massifs de protestation contre la réforme des retraites, des mouvements au cours desquels apparaissent des tentatives d’assemblées interprofessionnelles ; la jeunesse britannique se révolte en décembre contre l’augmentation brutale des coûts de scolarité. L’année 2011 voit les grandes révoltes sociales en Égypte et en Tunisie. Le prolétariat semble prendre de l’élan pour un nouveau saut en avant : le mouvement des Indignés en Espagne, puis en Grèce et en Israël.
Ce mouvement appartient-il à la classe ouvrière ?
Ces trois derniers mouvements ne peuvent se comprendre hors du contexte que nous venons d’analyser. Ils sont comme un premier puzzle qui unit tous les éléments apportés tout au long des huit dernières années. Mais le scepticisme est très fort et beaucoup se demandent : peut-on parler de mouvements de la classe ouvrière puisque celle-ci ne se présente pas comme telle et qu’ils ne sont pas renforcés par des grèves ou des assemblées sur les lieux de travail ?
Le mouvement se nomme "Les Indignés", concept très valable pour la classe ouvrière [17] mais qui ne révèle pas immédiatement ce dont il est porteur puisqu'il ne s’identifie pas directement avec sa nature de classe. Deux facteurs lui confèrent essentiellement une apparence de révolte sociale :
La perte de l’identité de classe
Le prolétariat a traversé une longue période de recul qui lui a infligé des dommages significatifs en ce qui concerne sa confiance en lui-même et la conscience de sa propre identité : "Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant 'socialistes', les campagnes assourdissantes sur la 'fin du communisme', voire sur la 'fin de la lutte de classe', ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans (…) D’autre part, [la bourgeoisie] a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes massives" [18]. Ceci explique en partie pourquoi la participation du prolétariat comme classe n’a pas été dominante mais qu’il fut présent à travers la participation des individus ouvriers (salariés, chômeurs, étudiants, retraités…) qui tentent de se clarifier, de s'impliquer selon leur instinct mais à qui manquent la force, la cohésion et la clarté que donne le fait de s’assumer collectivement comme classe.
Il découle de cette perte d’identité que le programme, la théorie, les traditions, les méthodes du prolétariat ne sont pas reconnus somme siens par l’immense majorité des ouvriers. Le langage, les formes d’action, les symboles mêmes qui apparaissent dans le mouvement des Indignés s'abreuvent à d’autres sources. C’est une faiblesse dangereuse qui doit être patiemment combattue pour que se réalise une réappropriation critique de tout le patrimoine théorique, d’expérience, de traditions que le mouvement ouvrier a accumulé au long de ces deux derniers siècles.
La présence de couches sociales non prolétariennes
Parmi les Indignés il y a une forte présence de couches sociales non prolétariennes, en particulier une couche moyenne en voie de prolétarisation. En ce qui concerne Israël, notre article soulignait : "Une autre tactique pour minimiser [ces événements] est de les cataloguer comme représentatifs du mouvement des classes moyennes. Il est vrai que, comme pour tous les autres mouvements, nous assistons à une révolte sociale très large qui peut exprimer le mécontentement de beaucoup de couches différentes de la société, allant des petits entrepreneurs jusqu'aux ouvriers à la chaîne, qui sont toutes touchées par la crise économique mondiale, par l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, et, dans un pays comme Israël par l'aggravation des conditions de vie à cause des exigences insatiables de l'économie de guerre. Mais le terme de 'classe moyenne' est devenu un synonyme de paresseux, un terme 'fourre-tout' pour parler de quelqu'un qui a reçu une certaine éducation ou bénéficie d'un travail et, en Israël comme en Afrique du Nord, en Espagne ou en Grèce, un nombre croissant de jeunes gens instruits sont poussés dans les rangs du prolétariat, travaillant dans des emplois précaires mal rémunérés et peu qualifiés où l'on peut embaucher n'importe qui" [19].
Bien que le mouvement semble vague et mal défini, cela ne peut remettre en cause son caractère de classe, surtout si nous considérons les choses dans leur dynamique, dans la perspective de l’avenir, comme le font les camarades du TPTG à propos des mouvements en Grèce : "Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général" [20].
La présence du prolétariat n’est pas visible en tant que force dirigeante du mouvement ni à travers une mobilisation à partir des centres de travail. Elle réside dans la dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social, de reconnaissance du combat qui se prépare. Là se trouve toute son importance, malgré le fait que ce ne soit qu’un petit pas en avant extrêmement fragile. Sur la Grèce, les camarades du TPTG disent que le mouvement "constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies" [21] et sur Israël, un journaliste signale, avec ses mots : "ce n'a jamais été l'oppression qui a maintenu l'ordre social en Israël, concernant la communauté juive. C'est l'endoctrinement qui s'en est chargé – l'idéologie dominante, pour utiliser le terme préféré des théoriciens critiques. Et c'est cet ordre culturel qui a été ébranlé dans ce tourbillon de protestations. Pour la première fois, une grande partie de la classe moyenne juive – il est trop tôt pour évaluer l'importance que celle-ci représente – a reconnu que son problème n'était pas vis-à-vis d'autres Israéliens, ni avec les Arabes, ni avec tel ou tel politicien mais avec l'ordre social tout entier, avec le système dans son ensemble. En ce sens, c'est un événement inédit dans l'histoire d'Israël" [22].
Les caractéristiques des luttes futures
Dans cette optique, nous pouvons comprendre les traits de ces luttes comme des caractéristiques que les futures luttes pourront reprendre avec un esprit critique et développer à des niveaux supérieurs :
– l’entrée en lutte de nouvelles générations du prolétariat, avec cependant une différence importante avec les mouvements de 1968 : alors que la jeunesse d’alors tendait à repartir de zéro et considérait que les aînés étaient "vaincus et embourgeoisés", nous voyons aujourd’hui une lutte unie des différentes générations de la classe ouvrière ;
– l’action directe des masses : la lutte a gagné la rue, les places ont été occupées. Les exploités s’y sont retrouvés directement, ils ont pu vivre, discuter et agir ensemble ;
– le début de la politisation : au-delà des fausses réponses qui sont et seront données, il est important que les grandes masses commencent à s’impliquer directement et activement dans les grandes questions de la société, c’est le début de leur politisation comme classe ;
– les assemblées : elles sont liées à la tradition prolétarienne des conseils ouvriers de 1905 et 1917 en Russie, qui s’étendirent en Allemagne et à d'autres pays pendant la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elles réapparurent en 1956 en Hongrie et en 1980 en Pologne. Elles sont l’arme de l’unité, du développement de la solidarité, de la capacité de compréhension et de décision des masses ouvrières. Le slogan "Tout le pouvoir aux assemblées !", très populaire en Espagne, exprime la naissance d’une réflexion-clé sur des questions telles que l’État, le double pouvoir, etc. ;
– la culture du débat : la clarté qui inspire la détermination et l’héroïsme des masses prolétariennes ne se décrète pas, pas plus qu’elle n’est le fruit d’un endoctrinement réalisé par une minorité détentrice de "la vérité" : elle est le produit conjugué de l’expérience, de la lutte et particulièrement du débat. La culture du débat a été très présente dans ces trois mouvements : tout a été soumis à la discussion, rien de ce qui est politique, social, économique, humain, n’a échappé à la critique de ces immenses agoras improvisées. Comme nous le disons dans l’introduction à l’article des camarades de Grèce, ce fait a une énorme importance : "l’effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent 'une sphère prolétarienne publique' qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre" [23] ;
– la façon d'envisager la question de la violence : le prolétariat "a été confronté depuis le début à la violence extrême de la classe exploiteuse, la répression lorsqu'il essayait de défendre ses intérêts, la guerre impérialiste mais aussi à la violence quotidienne de l'exploitation. Contrairement aux classes exploiteuses, la classe porteuse du communisme ne porte pas avec elle la violence, et même si elle ne peut s'épargner l'utilisation de celle-ci, ce n'est jamais en s'identifiant avec elle. En particulier, la violence dont elle devra faire preuve pour renverser le capitalisme, et dont elle devra se servir avec détermination, est nécessairement une violence consciente et organisée et doit donc être précédée de tout un processus de développement de sa conscience et de son organisation à travers les différentes luttes contre l'exploitation" [24]. Comme lors du mouvement des étudiants en 2006, la bourgeoisie a tenté plusieurs fois d’entraîner le mouvement des Indignés (particulièrement en Espagne) dans le piège des affrontements violents contre la police dans un contexte de dispersion et de faiblesse, pour ainsi pouvoir discréditer le mouvement et faciliter son isolement. Ces pièges furent évités et une réflexion active sur la question de la violence a commencé à voir le jour [25].
Faiblesses et confusions à combattre
Nous ne voulons pas le moins du monde glorifier ces mouvements. Rien n’est plus étranger à la méthode marxiste que de faire d’une lutte déterminée, pour importante et riche qu’elle soit, un modèle définitif, achevé et monolithique qu’il faudrait suivre à la lettre. Nous comprenons parfaitement ses faiblesses et ses difficultés avec un regard lucide.
La présence d’une "aile démocrate"
Celle-ci pousse à la réalisation d’une "vraie démocratie". Cette démarche est représentée par plusieurs courants, y compris des courants de droite comme en Grèce. Il est évident que les medias et les politiciens s’appuient sur cette aile pour faire en sorte que l’ensemble du mouvement s’identifie à elle.
Les révolutionnaires doivent combattre énergiquement toutes les mystifications, les fausses mesures, les arguments fallacieux de cette tendance. Cependant, pourquoi existe-t-il encore une forte propension à se laisser séduire par les chants de sirène de la démocratie, après tant d’années de tromperies, de mensonges et de déceptions ? Nous pouvons en donner trois raisons. La première se trouve dans le poids des couches sociales non prolétariennes très réceptives aux mystifications démocratiques et à l’interclassisme. La deuxième réside dans la puissance des confusions et des illusions démocratiques très présentes encore dans la classe ouvrière, particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas encore pu développer une expérience politique. La troisième, enfin, se trouve dans la pression de ce que nous nommons la décomposition sociale et idéologique du capitalisme qui favorise la tendance à chercher refuge dans une entité "au dessus des classes et des conflits", c’est-à-dire l’État, qui pourrait prétendument apporter un certain ordre, la justice et la médiation.
Mais il y a une cause plus profonde sur laquelle il est important d’attirer l’attention. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx constate que "Les révolutions prolétariennes (…) reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts" [26]. Aujourd’hui, les événements mettent en évidence la faillite du capitalisme, la nécessité de le détruire et de construire une nouvelle société. Pour un prolétariat qui doute de ses propres capacités, qui n’a pas récupéré son identité, cela crée et continuera encore à créer pendant un certain temps la tendance à se raccrocher à des branches pourries, à de fausses mesures "de réformes" et de "démocratisation", même en ayant des doutes. Tout ceci, indiscutablement, donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie qui lui permet de semer la division et la démoralisation et, en conséquence, de rendre plus difficile encore pour le prolétariat la récupération de cette confiance en soi et de cette identité de classe.
Le poison de l’apolitisme
Il s’agit d’une vieille faiblesse que traîne le prolétariat depuis 1968 et qui trouve son origine dans l’énorme déception et le profond scepticisme provoqués par la contre-révolution stalinienne et social-démocrate, qui induit la tendance à croire que toute option politique, y compris celles qui se réclament du prolétariat, n’est qu’un vil mensonge, contiendrait en son sein le ver de la trahison et de l’oppression. C’est ce dont profitent largement les forces de la bourgeoisie qui, occultant leur propre identité et imposant la fiction d’une intervention "en tant que libres citoyens", opèrent dans le mouvement pour prendre le contrôle des assemblées et les saboter de l’intérieur. Les camarades du TPTG le mettent clairement en évidence : "Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le 'secrétariat de soutien' et celui responsable de la 'communication'. Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des 'individus'" [27].
Le danger du nationalisme
Celui-ci est plus présent en Grèce et en Israël. Comme le dénonçaient les camarades du TPTG, "le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre 'le gouvernement vendu à l’étranger' ou pour 'le salut du pays', 'la souveraineté nationale', la revendication d’une 'nouvelle constitution' apparaît comme une solution magique et unificatrice" [28].
La réflexion des camarades est aussi juste que profonde. La perte de l’identité et de confiance du prolétariat en sa propre force, le lent processus que traverse la lutte dans le reste du monde, favorise la tendance à "s’accrocher à la communauté nationale", refuge utopique face à un monde hostile et plein d’incertitudes.
Ainsi, par exemple, les conséquences des coupes dans la santé et l’éducation, le problème réel créé par l’affaiblissement de ces services, sont utilisés pour enfermer les luttes derrière les barreaux nationalistes de la revendication d’une "bonne éducation" (car celle-ci nous rendrait compétitifs sur le marché mondial), et d’une "santé au service de tous les citoyens".
La peur et la difficulté pour assumer la confrontation de classe
L’angoissante menace du chômage, la précarité massive, la fragmentation croissante des employés – divisés, sur un même lieu de travail, dans un réseau inextricable de sous-traitants et par une incroyable variété de modalités d’embauche - provoquent un puissant effet intimidateur et rendent plus difficile le regroupement des travailleurs pour la lutte. Cette situation ne peut être dépassée par des appels volontaristes à la mobilisation, pas plus qu’en morigénant les travailleurs pour leur supposée "lâcheté" ou "servilité".
De ce fait, le pas vers la mobilisation massive des chômeurs, des précaires, des centres de travail et d’étude, est rendu plus difficile que ce qu’il pourrait sembler à première vue, difficulté provoquant à son tour une hésitation, un doute et une tendance à s’accrocher à des "assemblées" qui deviennent tous les jours plus minoritaires et dont "l’unité" ne favorise que les forces bourgeoises qui agissent en leur sein. Ceci donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie pour préparer ses coups tordus destinés à saboter les assemblées générales de l’intérieur. C’est ce que dénoncent justement les camarades du TPPG : "La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres 'non déclarés' des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre – pas toujours réussi – entre d’un côté un discours général et abstrait sur 'l’autodétermination', la 'démocratie directe', 'l’action collective', 'l’antiracisme', le 'changement social', etc., et de l’autre côté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place" [29].
Regarder le futur avec sérénité
S’il est évident que "pour que vive l’humanité, le capitalisme doit mourir" [30], le prolétariat est encore loin d’avoir atteint la capacité d’exécuter la sentence. Le mouvement des Indignés pose une première pierre.
Dans la série mentionnée plus haut, nous disions : "Une des raisons pour lesquelles les prévisions des révolutionnaires du passé sur l'échéance de la révolution ne se sont pas réalisées est qu'ils ont sous-estimé la force de la classe dirigeante, particulièrement son intelligence politique" [31]. Cette capacité de la bourgeoisie à utiliser son intelligence politique contre les luttes est aujourd’hui plus vive que jamais ! Ainsi, par exemple, les mouvements des Indignés dans les trois pays ont été complètement occultés ailleurs, sauf quand il s’en est donné une version light de "rénovation démocratique". Autre exemple, la bourgeoisie britannique a été capable de profiter du mécontentement pour le canaliser vers une révolte nihiliste qui lui a servi de prétexte pour renforcer la répression et intimider la moindre riposte de classe [32].
Les mouvements des Indignés ont posé une première pierre, dans le sens où ils ont fait les premiers pas pour que le prolétariat récupère sa confiance en lui-même et sa propre identité de classe, mais cet objectif reste encore très lointain car il nécessite le développement de luttes massives sur un terrain directement prolétarien qui mette en évidence que la classe ouvrière est capable d’offrir, face à la débâcle du capitalisme une alternative révolutionnaire aux couches sociales non exploiteuses.
Nous ignorons comment nous parviendrons à cette perspective et nous devons rester vigilants envers les capacités et les initiatives des masses, comme celle du 15 mai en Espagne. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’extension internationale des luttes sera un facteur essentiel dans ce sens.
Les trois mouvements ont planté le germe d’une conscience internationaliste : lors du mouvement des Indignés en Espagne, il se disait que sa source d’inspiration était la place Tahrir en Égypte [33] ; il avait cherché une extension internationale de la lutte, malgré que cela se soit fait dans la plus grande confusion. De leur côté, les mouvements en Israël et en Grèce ont déclaré explicitement qu’ils suivaient l’exemple des Indignés d’Espagne. Les manifestants d’Israël exhibaient des pancartes qui disaient : "Moubarak, Assad, Netanyahou : tous pareils !", ce qui montre non seulement un début de conscience de qui est l’ennemi mais une compréhension au moins embryonnaire du fait que leur lutte se mène avec les exploités de ces pays et non contre eux dans le cadre de la défense nationale [34]. "A Jaffa, des dizaines de manifestants arabes comme juifs portaient des pancartes écrites à la fois en Hébreu et en Arabe où on pouvait lire "Les Arabes et les Juifs veulent un logement au prix abordable" et "Jaffa ne veut pas d'offres de logements réservées aux riches." (…) Il y a eu des manifestations de Juifs et d'Arabes pour protester contre l'expulsion de ces derniers, partant du quartier de Cheikh Jarrah. A Tel-Aviv, des contacts ont été établis avec les résidents de camps de réfugiés dans les territoires occupés, qui ont visité à leur tour les villages de tentes et ont engagé des discussions avec les manifestants" [35]. Les mouvements en Égypte et en Tunisie comme ceux en Israël changent la donne de la situation, dans une partie de la planète qui est probablement le centre principal de confrontation impérialiste du monde. Comme le dit notre article, "L'actuelle vague de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une tout autre solution : la solidarité de tous les exploités face à toutes les divisions religieuses ou nationales ; la lutte de classes dans tous les pays dans le but de faire la révolution dans le monde entier qui sera la négation des frontières nationales et l'abolition des États. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé totalement utopique à la plupart des gens. Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes voit la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du monde capitaliste en train de s'effondrer" [36].
Les trois mouvements ont contribué à la cristallisation d’une aile prolétarienne : tant en Grèce qu'en Espagne, mais aussi en Israël [37], est en train d’émerger une "aile prolétarienne" à la recherche de l’auto-organisation, de la lutte intransigeante à partir de positions de classe et du combat pour la destruction du capitalisme. Les problèmes mais également les potentialités et les perspectives de cette large minorité ne peuvent être abordés dans le cadre de cet article. Ce qui est certain, c’est qu’elle constitue une arme vitale à qui le prolétariat a donné vie pour préparer ses combats futurs.
C. Mir, 23-9-2011
1. Cf. https://fr.internationalism.org/node/4752 [230]. Dans la mesure où cet article analysait en détail cette expérience, nous ne la répéterons pas ici.
2. Cf. les articles sur ces mouvements sur https://fr.internationalism.org/node/4776 [231].
3. Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du IXe Congrès du CCI, 1991.
4. Cf. Revue internationale nos 103 [232] et 104 [232].
5. Pour débattre de ce concept crucial de décadence du capitalisme, voir entre autres la Revue internationale no 146, "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [233]".
6. Revue internationale no 103, "A [232] [232]l'aube [232] [232]du [232] [232]xxi [232]e [232] [232]siècle, [232] [232]pourquoi [232] [232]le [232] [232]prolétariat [232] [232]n'a [232] [232]pas [232] [232]encore [232] [232]renversé [232] [232]le [232] [232]capitalisme ? [232]" : "La deuxième condition de la révolution prolétarienne consiste dans le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production."
7. Revue internationale no 104, "A [234] [234]l'aube [234] [234]du [234] [234]xxi [234]e [234] [234]siècle, [234] [234]pourquoi [234] [234]le [234] [234]prolétariat [234] [234]n'a [234] [234]pas [234] [234]encore [234] [234]renversé [234] [234]le [234] [234]capitalisme ? II [234]".
8. Cf. "Crise [235] [235]économique [235] [235]mondiale : [235] [235]un [235] [235]été [235] [235]meurtrier [235]".
9. Cf. Revue internationale no 138, "Résolution [236] [236]sur [236] [236]la [236] [236]situation [236] [236]internationale [236]".
10. "Puisqu'il est privé de tout point d'appui économique au sein du capitalisme, sa seule véritable force, outre son nombre et son organisation, est sa capacité à prendre clairement conscience de la nature, des buts et des moyens de son combat", Revue internationale no 103, op. cit.
11. Les nationalisations, de même qu'un certain nombre de mesures 'sociales' (comme une plus grande prise en charge par l'État du système de santé) sont des mesures parfaitement capitalistes (…) Les capitalistes ont tout intérêt à disposer d'ouvriers en bonne santé (…) Cependant, ces mesures capitalistes sont présentées comme des 'victoires ouvrières'", Revue internationale no 104, op. cit.
12. Nous ne pouvons développer ici pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire de la société non plus que pourquoi sa lutte représente l’avenir pour toutes les couches sociales non-exploiteuses, question brûlante comme nous le verrons plus loin lors du mouvement des Indignés. Le lecteur pourra trouver des éléments de réponse pour alimenter le débat sur cette question dans la série de deux articles publiés dans les nos 73 et 74 de la Revue internationale, "Qui [237] [237]peut [237] [237]changer [237] [237]le [237] [237]monde ? [237]".
13. Cf. "La [200] [200]décomposition, [200] [200]phase [200] [200]ultime [200] [200]de [200] [200]la [200] [200]décadence [200] [200]du [200] [200]capitalisme [200]", Revue internationale no 62.
14. Cf. les articles d’analyse de la lutte de classe dans notre Revue internationale.
15. Cf. Revue internationale no 125, "Thèses [148] [148]sur [148] [148]le [148] [148]mouvement [148] [148]des [148] [148]étudiants [148] [148]du [148] [148]printemps [148] [148]2006 [148] [148]en [148] [148]France [148]".
16. La bourgeoisie prend bien garde de cacher ces événements : les révoltes nihilistes des banlieues en novembre 2005 en France sont beaucoup plus connues, y compris dans les milieux politisés, que le mouvement conscient des étudiants cinq mois plus tard.
17. L’indignation n’est ni la résignation ni la haine. Contre la dynamique insupportable du capitalisme, la résignation exprime une passivité, une tendance à rejeter sans voir comment affronter. La haine, de son côté, exprime un sentiment actif puisque le rejet se transforme en lutte, mais il s’agit d’un combat aveugle, privé de perspectives et de réflexion pour élaborer un projet alternatif, elle est purement destructive, assemblant une somme de ripostes individuelles mais ne générant rien de collectif. L’indignation exprime la transformation active du rejet accompagnée par la tentative de lutter consciemment, recherchant l’élaboration concomitante d’une alternative, elle est donc collective et constructive. "… L’indignation amenant à la nécessité d’une régénération morale, d’un changement culturel, les propositions faites – même si elles peuvent parfois paraître naïves ou farfelues – expriment un désir, même timide ou confus, de vouloir "vivre autrement"", "De [238] [238]la [238] [238]Place [238] [238]Tahrir [238] [238]à [238] [238]la [238] [238]Puerta [238] [238]del [238] [238]Sol [238]", ICC on-line.
18. Cf. Revue internationale no 130, "Résolution [239] [239]sur [239] [239]la [239] [239]situation [239] [239]internationale [239]".
19. Cf. ICC on-line, "Révoltes [240] [240]sociales [240] [240]en [240] [240]Israël : [240] [240]Moubarak, [240] [240]Assad, [240] [240]Netanyahou : [240] [240]tous [240] [240]pareils ! [240]".
20. ICC on-line, "Une [231] [231]contribution [231] [231]du [231] [231]TPTG [231] [231]sur [231] [231]le [231] [231]mouvement [231] [231]des [231] [231]'Indignés' [231] [231]en [231] [231]Grèce [231]".
21. Idem.
22. "Révoltes sociales en Israël…", op.cit.
23. "Une contribution du TPTG", op. cit.
24. Revue internationale no 125, "Thèses [148] [148]sur [148] [148]le [148] [148]mouvement [148] [148]des [148] [148]étudiants [148] [148]du [148] [148]printemps [148] [148]2006 [148] [148]en [148] [148]France [148]".
25. Cf CCI-on line, “Qu [241]’ [241]y [241] [241]a-t-il [241] [241]derrière [241] [241]la [241] [241]campagne [241] [241]contre [241] [241]les [241] [241]"violents" [241] [241]autour [241] [241]des [241] [241]incidents [241] [241]de [241] [241]Barcelone ? [241]".
26. Karl Marx, Le [242] [242]18 [242] [242]Brumaire [242] [242]de [242] [242]Louis [242] [242]Bonaparte [242].
27. "Une contribution du TPTG…", op. cit. Cf. aussi ICC on-line, "'L'apolitisme' [243] [243]est [243] [243]une [243] [243]mystification [243] [243]dangereuse [243] [243]pour [243] [243]la [243] [243]classe [243] [243]ouvrière [243]".
28. Idem.
29. Idem.
30. Mot d’ordre de la Troisième Internationale.
31. Revue internationale no 104, op. cit.
32. Cf. "Les [244] [244]émeutes [244] [244]en [244] [244]Grande-Bretagne [244] [244]et [244] [244]la [244] [244]perspective [244] [244]sans [244] [244]avenir [244] [244]du [244] [244]capitalisme [244]".
33. La "Plaza de Cataluña" fut rebaptisée par l’Assemblée "Place Tahrir", ce qui non seulement affirme une volonté internationaliste mais en outre constitue un camouflet au nationalisme catalan qui considère que cette place est son plus beau fleuron.
34. Cité dans "Révoltes sociales en Israël", op. cit. : "Un animateur interrogé sur le réseau RT News a demandé si les manifestations avaient été inspirées par les événements dans les pays arabes. Il a répondu 'Ce qui s'est passé sur la place Tahrir a eu beaucoup d'influence. Cela garde beaucoup d'influence, bien sûr. C'est quand les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent commence à dire aux gouvernements ce qu'ils veulent'".
35. Idem.
36. Idem.
37. Dans ce mouvement, "certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer 'l'union nationale' et diviser le mouvement", (idem), ce qui, même encore implicitement, révèle une prise de distance vis-à-vis de l’État israélien d’Union nationale au service de l’économie de guerre et de la guerre.
Récent et en cours:
- Indignés [245]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (III) : les années 1920
- 3546 lectures
Les années 1920 : Face au développement des luttes ouvrières la bourgeoisie française réorganise son dispositif répressif
1923 : "l’accord de Bordeaux" ou le pacte d’une "collaboration de classes"
C’est cette année-là que fut signé "l’accord de Bordeaux", un "pacte d’entente" conclu entre le milieu économique colonial 1 et Blaise Diagne, le premier député africain siégeant à l’Assemblée nationale française. En effet, ayant tiré les leçons de la magnifique grève insurrectionnelle de mai 1914 à Dakar et de ses prolongements les années suivantes 2, la bourgeoisie française se devait de réorganiser son dispositif politique face à la montée inexorable du jeune prolétariat de sa colonie africaine. Ce fut dans ce cadre qu’elle décida de jouer à fond la carte de Blaise Diagne en faisant de lui le "médiateur/pacificateur" des conflits entre les classes, en fait un vrai contre-révolutionnaire. En effet, au lendemain de son élection comme député et en tant que témoin majeur du mouvement insurrectionnel contre le pouvoir colonial dans lequel il avait lui-même été impliqué au départ, Diagne se trouva devant trois possibilités lui permettant de jouer un rôle historique à l’issue de cet événement : 1) profiter de l’affaiblissement politique de la bourgeoisie coloniale au lendemain de la grève générale, dont elle sortit défaite, pour déclencher une "lutte de libération nationale" ; 2) militer pour le programme communiste en portant le drapeau de la lutte prolétarienne dans la colonie, en profitant notamment du succès de la grève ; 3) jouer sa carte politique personnelle en s’alliant avec la bourgeoisie française qui lui tendait la main à ce moment-là.
Finalement Blaise Diagne décida de choisir cette dernière voie, à savoir l’alliance avec la puissance coloniale. En réalité derrière cet acte dit "accord de Bordeaux", la bourgeoisie française ne manifestait pas seulement sa crainte de la classe ouvrière en effervescence dans sa colonie africaine, mais elle était également préoccupée par le contexte révolutionnaire international.
"(…) Devant la tournure que prirent les choses, le gouvernement colonial entreprit de gagner le député noir à sa cause pour mettre sa puissance de persuasion et son courage téméraire au service des intérêts de la colonisation et des maisons de commerce. De cette façon il parviendrait à couper l’herbe sous les pieds à l’effervescence qui s’était emparée des esprits de l’élite africaine à un moment où la révolution d’octobre (1917), le mouvement pan-noir et les menaces du communisme mondial en direction des colonies pourraient exercer une dangereuse séduction sur les consciences des colonisés".
"(…) Tel fut le véritable sens de l’accord de Bordeaux signé le 12 juin 1923. Il marquait la fin du Diagnisme combatif et volontariste et ouvrait une nouvelle ère de collaboration entre colonisateurs et colonisés dont le député sortit dépouillé de tout charisme qui représentait jusque là son atout politique majeur. Un grand élan venait d’être brisé". (Iba Der Thiam) 3
Le premier député noir de la colonie africaine resta fidèle au capital français jusqu’à sa mort
Pour mieux comprendre le sens de cet accord entre la bourgeoisie coloniale et le jeune député, revenons sur la trajectoire de ce dernier. Blaise Diagne fut remarqué très tôt par l’appareil du capital français qui voyait en lui une future carte politique stratégique et le forma d’ailleurs dans ce sens. En effet, Diagne exerçait une forte influence sur la jeunesse urbaine à travers le Parti Jeunes Sénégalais acquis à sa cause. Justement, fort du soutien de la jeunesse, notamment des jeunes instruits et intellectuels, il se lança en avril 1914 dans l’arène électorale et arracha le seul poste de député à pourvoir pour l’ensemble de la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française). Rappelons qu’on était à la veille des tueries impérialistes de masse et que ce fut dans ces circonstances qu’éclata la fameuse grève générale de mai 1914 où, après avoir mobilisé la jeunesse dakaroise en vue du déclenchement du formidable mouvement de révolte, Diagne essaya de l’arrêter sans succès en voulant éviter ainsi de mettre en péril ses intérêts de jeune député petit bourgeois.
En fait, une fois élu, le député fut chargé de veiller à la protection des intérêts des grands groupes commerciaux d’une part et de faire respecter les "lois de la République" d’autre part. Déjà bien avant la signature de l’accord de Bordeaux, Diagne s’illustra en bon agent recruteur de 72 000 "tirailleurs sénégalais" en vue de la boucherie mondiale de 1914/1918. C’est à cette fin qu’il avait été nommé, en janvier 1918, Commissaire de la République par Georges Clemenceau alors Président du Conseil. Effectivement, face aux réticences des jeunes et de leurs parents à se faire enrôler, il sillonna les villages africains de l’AOF pour convaincre les récalcitrants et, à coup de propagande et d'intimidation, parvint à envoyer au massacre des dizaines de milliers d’africains.
De même il fut un ardent défenseur de cet abominable "travail forcé" dans les colonies françaises, comme l’indique son discours à la XIVe session du Bureau International du Travail à Genève 4.
Tout compte fait, le premier député noir de la colonie africaine, ne fut jamais un véritable défenseur de la cause ouvrière, au contraire, il ne fut en définitive qu’un arriviste contre-révolutionnaire. D’ailleurs la classe ouvrière ne tarda pas à en prendre conscience :
"(…) comme si l’accord de Bordeaux avait convaincu les travailleurs que la classe ouvrière paraissait désormais seule en mesure de prendre le relais et de porter haut le flambeau du combat contre l’injustice pour l’égalité économique, sociale et politique, les luttes syndicales connurent, par une sorte de mouvement pendulaire, une exceptionnelle impulsion." (Thiam, ibid.) 5
En clair, Diagne ne put garder longtemps la confiance de la classe ouvrière et resta fidèle à ses parrains coloniaux jusqu’à sa mort en 1934.
1925 : année de forte combativité et de solidarité face à la répression policière
"Rien que dans le chemin de fer, en effet, l’année 1925 avait été secouée par trois grands mouvements sociaux, dont chacun avait eu des conséquences importantes. Il s'agit, d’une part, de la grève des cheminots indigènes et européens du Dakar - Saint-Louis, du 23 au 27 janvier, déclenchée pour des raisons économiques, d’autre part, de la menace de grève générale dans le Thiès-Kayes envisagée autour précisément de mots d’ordre dont le droit syndical, peu de temps après, enfin de la révolte des travailleurs Bambara en service dans les chantiers de construction du chemin de fer à Ginguinéo, révolte que des soldats appelés pour l’écraser refusèrent de mâter". (Thiam, ibid.)
Et pourtant, le moment n’était pas particulièrement propice à la mobilisation pour la lutte car, en prévention de la combativité ouvrière, l’autorité coloniale prenait une série de mesures extrêmement répressives.
"Au cours de l’année 1925, le département des colonies avait édicté, sur les recommandations des Gouverneurs Généraux, singulièrement celui de l’AOF, des mesures draconiennes touchant notamment la répression de la propagande révolutionnaire.
Au Sénégal, des nouvelles instructions, émanant de la Fédération (des 2 colonies françaises, AOF-AEF), avaient provoqué le renforcement des mesures de surveillance, sur l’ensemble du territoire. Et, dans chacune des colonies du groupe, un service spécial avait été institué, en liaison avec les services de la Sûreté Générale, chargé de centraliser à Dakar, et de recouper, tous les indices perçus aux postes d’écoute.
(…) Un nouveau projet fixant le régime de l’émigration, et de l’identification des indigènes, avait été dressé, au Département, dans le courant du mois de décembre 1925. Les étrangers et les suspects avaient désormais chacun leur casier ; la presse étrangère faisait l’objet d’un contrôle sévère, et les saisies de journaux étaient presque devenues la règle. (…) Le courrier était systématiquement violé, les envois de journaux ouverts et souvent détruits". (Thiam, ibid.)
Une fois encore, le pouvoir colonial trembla dès l’annonce d’un nouvel assaut de la classe ouvrière d’où sa décision d’instaurer un régime policier en vue de contrôler sévèrement toute la vie civile et les mouvements sociaux qui se développaient dans la colonie mais aussi et surtout en cherchant à éviter tout contact entre les ouvriers en lutte dans les colonies avec leurs frères de classe dans le monde, d’où les mesures draconiennes contre la "propagande révolutionnaire". Et pourtant, dans ce contexte, d’importantes luttes ouvrières purent éclater avec vigueur, ce malgré tout l’arsenal répressif brandi par l'État colonial.
Une grève des cheminots à caractère très politique
Le 24 janvier 1925, les cheminots européens et africains partirent ensemble en grève, en se dotant d’un comité de grève énonçant les revendications suivantes :
"Les agents du chemin de fer de Dakar - Saint-Louis ont arrêté le 24 janvier le trafic, à l’unanimité. Ce n’est pas sans réflexion, ni sans amertume qu’ils accomplissent ce geste. Depuis 1921, leurs salaires n’ont reçu aucun relèvement, malgré la hausse constante du coût de la vie à la colonie. Les Européens en majorité ne réalisent pas un salaire mensuel de 1000 francs et un indigène un salaire journalier de 5 francs. Ils demandent que leurs traitements soient relevés pour pouvoir vivre honnêtement". (Thiam, ibid.)
En effet, dès le lendemain, tous les agents des divers secteurs du chemin de fer abandonnèrent machines, chantiers et bureaux, bref une paralysie générale du rail. Mais surtout ce mouvement eut un caractère très politique dans la mesure où il intervint au milieu d’une campagne législative, en obligeant ainsi les partis et leurs candidats à se positionner clairement par rapport aux revendications des grévistes. De ce fait, dès cet instant, les notables politiques et les lobbies du commerce interpellèrent l’administration coloniale centrale en l’incitant à œuvrer immédiatement pour la satisfaction des revendications des salariés. Et, aussitôt après, au bout du deuxième jour de grève, les revendications des cheminots furent pleinement satisfaites. Ce fut d’ailleurs avec jubilation que les membres du comité de grève se permirent de retarder leur réponse dans l’attente du résultat de la consultation de leur base. De même que les grévistes avaient tenu à faire porter par leurs délégués l’ordre de reprise, par écrit, par un train spécial passant par toutes les gares.
"Les travailleurs avaient, une nouvelle fois, remporté une importante victoire, dans des conditions de lutte où ils avaient fait preuve d’une grande maturité, ainsi que d’une fermeté, non exempte de souplesse et de réalisme. (…) Ce succès est d’autant plus significatif qu’il était le fait de tous les travailleurs du réseau, européens comme indigènes, qui, après avoir été opposés par des problèmes de couleur et de relations de travail difficiles, avaient eu la sagesse de taire leurs divergences, dès que le danger d’une législation du travail draconienne se profila à l’horizon. (…) Le gouverneur lui-même n’avait pu s’empêcher de noter la maturité et l’esprit de suite et d’à propos, avec lesquels la grève avait été organisée. La préparation, écrit-il, en avait été fort adroitement menée. Le maire de Dakar, lui-même, connu et aimé des indigènes, n’avait pas été prévenu de leur participation. L’époque de la traite était choisie de façon à ce que le commerce, pour la sauvegarde de ses propres intérêts, soutienne les revendications. Les motifs invoqués, et pour certains justifiés, mettaient la campagne en mauvaise posture. En un mot, concluait-il, tout concordait pour lui faire rendre son maximum d’efficacité et lui donner l’appui de l’opinion publique". (Thiam, ibid.)
Voilà une éclatante illustration du haut niveau de combativité et de conscience de classe dont fit preuve la classe ouvrière de la colonie française, où travailleurs européens et africains prirent en main collectivement l’organisation de leur lutte victorieuse. On a là une belle leçon de solidarité de classe venant comme consolidation des acquis de toutes les expériences précédentes de confrontation avec la bourgeoisie. Et cela rend encore plus évident le caractère internationaliste des combats ouvriers de cette époque, et ce malgré l’effort permanent de la bourgeoisie de "diviser pour régner".
En février 1925, la grève des câblistes fit plier les autorités au bout de 24 heures
Le mouvement des cheminots venait à peine de se terminer que les câblistes partirent en grève, en formulant, eux aussi, de nombreuses revendications dont une forte augmentation de salaire et l’amélioration de leur statut. Et ce mouvement fut arrêté au bout de 24 heures et pour cause…
"Grâce au concours combiné des pouvoirs locaux et métropolitains, grâce à l’intervention heureuse des membres des corps élus, tout revint à l’ordre dans les 24 heures, car satisfaction fut donnée en partie aux câblistes, en ce qui rapportait à l’octroi de l’allocation d’attente à tout le personnel". (Thiam, ibid.)
Aussi, revigorés par ce premier succès, les câblistes (européens et indigènes ensemble) remettaient sur le tapis le reste de leurs revendications en menaçant de repartir immédiatement en grève. En fait, ils profitèrent de la place stratégique qu’ils occupaient dans le dispositif administratif et économique en tant qu’agents hautement qualifiés, donc possédant, de fait, une grande capacité de blocage du fonctionnement des réseaux de communication sur le territoire.
Pour leur part, face aux revendications des agents câblistes accompagnées d’une nouvelle menace de grève, les représentants de la bourgeoisie décidèrent de riposter en lançant une campagne d’intimidation et de culpabilisation à l’encontre des grévistes sur le thème :
"Comment les quelques fonctionnaires qui s’agitent pour exiger les augmentations de solde ne voient-ils pas qu’ils creusent eux-mêmes leur propre fosse ?" (Thiam, ibid.)
En fait, le pouvoir politique et du gros commerce mobilisa d’autres gros moyens de pression sur les grévistes allant jusqu’à les accuser de vouloir "détruire délibérément l’économie du pays" tout en s’efforçant par ailleurs de briser l’unité qui existait entre eux. La pression devenant de plus en plus forte, les ouvriers décidèrent alors de reprendre le travail sur la base des revendications satisfaites à l’issue de la grève précédente.
En fait, cet épisode fut aussi un des moments forts où l’unité entre ouvriers européens et africains se réalisa pleinement dans la lutte.
Rébellion sur les chantiers du chemin de fer Thiès-Kayes le 11 décembre 1925
Une rébellion éclata sur cette ligne où un contingent de travailleurs (une centaine) décida d’en découdre avec son chef, capitaine de l’armée coloniale, personnage cynique et autoritaire, accoutumé à être obéi "au doigt et à l’œil", et qui avait l’habitude de faire subir des sévices corporels aux travailleurs qu’il jugeait "paresseux".
"De l’enquête qui avait pourtant été menée par l’Administrateur Aujas, commandant de cercle de Kaolack, il ressortait qu’une rébellion avait éclaté le 11 décembre par suite de "mauvais traitements" infligés à ces travailleurs. Le commandant de cercle ajoutait, que, sans admettre entièrement ces déclarations, monsieur le capitaine Heurtematte a reconnu qu’il lui arrivait quelquefois de frapper d’un coup de cravache un manœuvre paresseux et récalcitrant. [L’incident] s’est envenimé dès le moment où le capitaine fit attacher à un pieu par des cordes, trois bambaras [terme ethnique], qu’il prit pour les meneurs de l’affaire". (Thiam, ibid.)
Et les choses se gâtèrent pour le capitaine quand il se mit à fouetter ces trois travailleurs car leurs camarades du chantier décidèrent d’en finir pour de bon avec leur tortionnaire et celui-ci ne put sauver sa tête que d’extrême justesse par l’arrivée sur place des tirailleurs appelés à son secours.
"Les tirailleurs dont il était question étaient formés de sujets français originaires du Sénégal oriental et de Thiès ; arrivés sur place et ayant appris ce qui s’était passé, ils refusèrent unanimement l’ordre de tirer sur les travailleurs noirs, ordre que le pauvre capitaine assailli de toutes parts, par une meute menaçante et féroce, leur avait intimé, craignant, disait-il, pour sa vie". (Thiam, ibid.)
Voilà un fait singulier car jusque là on était plutôt habitué à voir les "tirailleurs" comme forces aveugles, acceptant par exemple de jouer docilement le rôle de "jaunes" ou carrément de "liquidateurs" de grévistes. Du coup ce geste de fraternisation ne peut que nous rappeler quelques épisodes historiques où des conscrits refusèrent de briser des grèves ou des révolutions. L’exemple le plus célèbre reste évidemment l’épisode de la révolution russe où un grand nombre de militaires refusèrent de tirer sur leurs frères révolutionnaires en désobéissant aux ordres de leur hiérarchie, ce malgré les gros risques encourus.
L’attitude des "tirailleurs" face à leur capitaine fut d’autant plus réjouissante que le contexte était particulièrement alourdi par une forte tendance à la militarisation de la vie sociale et économique de la colonie. D’ailleurs l’affaire prenait une tournure hautement politique car l’administration civile et militaire se trouvait ainsi bien embarrassée de devoir choisir, soit de sanctionner l’attitude d’insoumission des soldats au risque de resserrer leur solidarité avec les travailleurs, soit d’étouffer l’incident. Et finalement l’autorité coloniale choisit cette dernière solution.
"Mais l’affaire ayant fortement défrayé la chronique et menaçant de compliquer les relations interraciales déjà plus que préoccupantes dans un service comme le chemin de fer, les autorités fédérales comme locales avaient finalement conclu à la nécessité d’étouffer l’incident et de le minimiser, maintenant qu’elles s’étaient rendu compte des conséquences désastreuses que la politique dite de collaboration des races inaugurée par Diagne depuis la signature du pacte de Bordeaux était en train de leur coûter cher". (Thiam, ibid.)
En effet, comme les précédents, ce mouvement de lutte illustra remarquablement les limites du "pacte de Bordeaux" par lequel le député Blaise Diagne pensait avoir garanti la "collaboration" entre exploiteurs et exploités. Mais hélas pour la bourgeoisie coloniale, la conscience de classe était passée par là.
La vigoureuse grève des inscrits maritimes en 1926
Comme l’année précédente, 1926 fut marquée par un épisode de lutte très vigoureuse et très riche en termes de combativité et de solidarité de classe, d’autant plus remarquable que le mouvement fut déclenché dans le même contexte de répression des luttes sociales dans lequel, depuis l’année précédente, nombre de chantiers et d'autres secteurs étaient encadrés en permanence par les forces de police et de gendarmerie, au nom de la "sécurisation" de l’environnement économique.
"Alors que les attentats sur la voie ferrée se poursuivaient inexorablement 6 et que l’agitation gagnait des milieux aussi attachés pourtant à l’ordre et à la discipline que les anciens combattants, les travailleurs des Messageries Africaines de Saint-Louis déclenchaient un ordre de grève, qui allait détenir le record de la durée parmi tous les mouvements sociaux jusque-là étudiés dans cette localité.
Tout avait commencé le 29 septembre lorsqu’un télégramme du Lieutenant-Gouverneur informa le Chef de la Fédération que les inscrits maritimes de la Compagnie des Messageries Africaines à Saint-Louis s’étaient mis en grève pour obtenir des améliorations de salaires. Par un bel esprit de solidarité presque spontané, leurs collègues de la Maison Peyrissac, employés sur le Vapeur Cadenel ayant alors jeté l’ancre à Saint-Louis, bien que non concernés par la revendication avancée, avaient cessé eux aussi le travail dès le premier octobre suivant". (Thiam, ibid.)
Sous la poussée de la hausse effrayante du coût de la vie, beaucoup de secteurs avancèrent des revendications salariales en menaçant de partir en lutte et de ce fait un grand nombre d’entreprises avaient accordé des hausses de salaire à leurs employés. Tel n’avait pas été le cas pour les travailleurs des Messageries, d’où le déclenchement de leur mouvement et le soutien reçu de leurs camarades du Vapeur. Cependant, malgré cela, le patronat resta de marbre et refusa toute négociation avec les grévistes jusqu’au cinquième jour de la grève, laissant le mouvement se poursuivre dans l’espoir de son épuisement à court terme.
"Mais le mouvement, ayant conservé sa cohésion et sa solidarité des premiers jours, le 6 octobre, la Direction des Messageries assaillie de toutes parts par les maisons de commerces et encouragée secrètement par l’Administration à faire preuve de plus de souplesse, vu la précarité de la conjoncture, baissa pavillon, subitement. Elle fit aux équipages les propositions suivantes : "augmentation mensuelle de 50 francs (sans distinction de catégorie) et des denrées pour la pitance (41 francs par mois environ)". (…) Mais les travailleurs concernés, voulant payer leurs collègues de la Maison Peyrissac de leur solidarité agissante, demandèrent et obtinrent que les mêmes avantages leur fussent accordés. La Direction de cette maison s’inclina. Le 6 octobre, la grève prit fin. Le mouvement avait duré huit jours pleins, sans que l’unité des travailleurs se soit émoussée un seul instant. C’était là, un événement d’une grande importance". (Thiam, ibid.)
Nous assistons, là encore, à un mouvement formidable, exemplaire et riche d’enseignements sur la vitalité des luttes de cette époque. En d’autres termes, cette séquence de la lutte fut l’occasion d’une véritable expression de "solidarité agissante" (comme le dit l’auteur cité) entre ouvriers de diverses entreprises. Quel meilleur exemple de solidarité de voir tel équipage exiger et obtenir que les mêmes avantages qu’il arracha à l’issue de sa lutte fussent accordés à ses camarades d’une autre entreprise en "remerciement" du soutien reçu de ces derniers !
Que dire aussi de la combativité et de la cohésion dont les ouvriers des messageries firent preuve en imposant un rapport de force sans faille aux forces du capital !
La longue et dure grève des marins de Saint-Louis en juillet/août 1928
L’annonce de cette grève préoccupait beaucoup les autorités coloniales car elle semblait faire écho aux revendications des marins en France qui s’apprêtaient à partir en lutte au même moment que leurs camarades africains.
Au congrès de la Fédération syndicale internationale (de tendance social-démocrate), tenu à Paris en août 1927, fut lancé un appel à la défense des prolétaires des colonies comme le relate (Thiam, ibid.) :
"Un délégué anglais au Congrès de la Fédération syndicale internationale (FSI) à Paris ; saisissant l’occasion, ce délégué nommé Purcell avait particulièrement insisté sur l’existence dans les colonies de millions d’hommes soumis à une exploitation effrénée, devenus des prolétaires au sens plein du terme, qu’il fallait, désormais, organiser et engager dans des actions revendicatives de type syndical, en recourant notamment à l’arme de la protestation et de la grève. Lui faisant écho, Koyaté (syndicaliste africain) lui-même déclarait que "le droit syndical est à arracher en Afrique noire française par des grèves de masse, dans l’illégalité" ". En France depuis le mois de juin 1928, une agitation se développait chez les ouvriers marins qui réclamaient des augmentations de salaire et on s’attendait donc à une grève le 14 juillet. Or, à la date fixée, ce furent les marins indigènes des compagnies maritimes de Saint-Louis qui entrèrent massivement en grève sur les mêmes revendications que leurs camarades en métropole. Dès lors la réaction des autorités coloniales fut de crier au "complot international" en désignant, entre autres, deux leaders syndicalistes indigènes comme "meneurs" du mouvement. Et pour y faire face, l’Administration de la colonie fit front avec le patronat en combinant manœuvres politiques et mesures répressives pour briser la grève.
"(…) Commencèrent alors d’âpres et longs marchandages. Alors que les marins acceptaient, tout au plus, de réduire leurs demandes de 25 francs seulement, le patronat déclara qu’il était impossible d’attribuer plus de 100 francs par mois aux grévistes. Les travailleurs (qui en réclamaient 250) ayant considéré cette offre insuffisante le mouvement de grève continua de plus belle". (Thiam, ibid.)
En effet, les grévistes de la région de Saint-Louis purent bénéficier spontanément du soutien actif d’autres ouvriers marins (Thiam, ibid) :
"(Archives d'État) Le chef du service de l’Inscription nous apprend, en effet, que le 19, dans l’après midi, le "Cayor" remorqueur venant de Dakar, est arrivé avec le Chaland "Forez". A peine le navire stoppé, l’équipage a fait cause commune avec les grévistes à l’exclusion d’un vieux maître d’équipage et d’un autre marin. Mais nous dit-il, dans la matinée du lendemain 20 juillet, les grévistes ont fait irruption à bord du "Cayor" et ont traîné à terre, de force les deux marins demeurés à leur poste. Une courte manifestation aux abords de la mairie a été dispersée par la police".
La grève se prolongea pendant plus d’un mois avant d’être brisée militairement par le Gouverneur colonial qui délogea de force les équipages indigènes et les remplaça par les troupes. En effet, épuisés par de longues semaines de lutte, privés de ressources financières nécessaires à l’entretien de leur famille, bref pour éviter de crever de faim, les marins durent reprendre le travail, d’où la jubilation gourmande du représentant du pouvoir colonial sur place que traduit son propre récit de l’événement :
"[A la fin de la grève] les marins ont demandé à rembarquer sur les navires de la Société des Messageries Africaines. Ils ont été repris aux anciennes conditions, le résultat de la grève s’est donc traduit, pour les marins, par la perte d’un mois de salaire, alors que s’ils avaient écouté les propositions du Chef du service de l’Inscription maritime, ils bénéficieraient d’un relèvement de solde de 50 à 100 F par mois". (Thiam, ibid.)
Ce repli des grévistes, somme toute réaliste, fut considéré par la bourgeoisie comme une "victoire" pour elle alors que s’annonçait la crise de 1929, dont les effets commençaient à se faire sentir au niveau local. Dès lors le pouvoir colonial ne tarda pas à profiter de sa "victoire" sur les marins grévistes et de la conjoncture pour renforcer davantage son arsenal répressif.
"Placé devant cette situation, le Gouverneur colonial, tirant les leçons des tensions politiques déjà décrétées, des déclarations de Ameth Sow Télémaquem 7 parlant de révolution à faire au Sénégal, de la succession des mouvements sociaux, de la dégradation de la situation budgétaire, et du mécontentement des populations, avait pris deux mesures relevant du domaine de maintien de l’ordre.
Dans la première il avait accéléré le processus, amorcé depuis 1927, en vue d’établir la direction des services de sécurité du Sénégal à Dakar d’où la surveillance de la colonie devait, selon lui, être accentuée. (…) La seconde mesure avait été la mise en application accélérée, elle aussi, de l’instruction règlementant le service de la gendarmerie chargé de la police du Thiès-Niger". (Thiam, ibid.).
En clair, la présence de gendarmes affectés au service d’escorte de trains pour "accompagner" les roulants avec des brigades d’intervention sur toutes les lignes, des mesures visant les individus ou groupes qui seraient arrêtés et mis en prison s’ils devaient braver les ordres de police, tandis que les auteurs de "troubles sociaux" (grèves et manifestations) seraient sévèrement punis. Signalons que tous ces moyens de répression, venant accentuer la militarisation du travail, visaient principalement les deux secteurs qui étaient des poumons sur lesquels reposait l’économie coloniale, à savoir le maritime et le ferroviaire.
Mais, en dépit de ce quadrillage militaire, la classe ouvrière ne cessa pas pour autant de constituer une menace pour les autorités coloniales.
"Pourtant lorsque l’agitation sociale reprit dans des sections du Railway à Thiès, où des menaces de grève furent proférées à la suite du non-paiement des rappels de solde dus au personnel, de la présentation de revendications visant des augmentations de salaires et de la dénonciation de l’incurie d’une administration qui se désintéressait complètement de leur sort, le Gouverneur prit très au sérieux lesdites menaces et en s’employant à constituer, au cours de 1929, une nouvelle police privée, composée cette fois d’anciens militaires, la plupart gradés, qui, sous la direction du Commissaire de la police spéciale, devaient veiller d’une façon permanente à la tranquillité au dépôt de Thiès". (Thiam, ibid.)
Donc, dans cette période de fortes et menaçantes tensions sociales, en lien avec la terrible crise économique mondiale, le régime colonial n’avait pas d’autre moyen que de s’appuyer plus que jamais sur ses forces armées pour venir à bout de la combativité ouvrière.
L’entrée dans la Grande Dépression et la militarisation du travail affaiblissent la combativité ouvrière
Comme on a pu le voir précédemment, le pouvoir colonial n’avait pas attendu l’arrivée de la crise de 1929 pour militariser le monde du travail, car il commença dès 1925 à recourir à l’armée pour faire face à la pugnacité de la classe ouvrière. Mais cette situation combinée de surgissement de la crise économique mondiale et de militarisation du travail dut peser lourdement sur la classe ouvrière de la colonie car, entre 1930 et 1935, il y eut peu de lutte. En fait le seul mouvement de classe conséquent connu fut celui des ouvriers du port de Kaolack 8 :
"(…) Une grève courte mais violente à Kaolack le 1er mai 1930 : 1500 à 2000 ouvriers de seccos d’arachides et du port ont arrêté le travail pendant le chargement des bateaux. Ils réclament le doublement de leurs salaires de 7,50 francs. La gendarmerie intervient ; un gréviste est légèrement blessé. Le travail reprend à 14 heures : les ouvriers ont obtenu un salaire journalier de 10 francs".
Cette grève courte et néanmoins vigoureuse vint clôturer la série de luttes fulgurantes entamées depuis 1914. En d’autres termes, 15 ans d’affrontements de classes au bout desquels le prolétariat de la colonie de l’AOF sut tenir tête à son ennemi et construire son identité de classe autonome.
Pour sa part, dans la même période, la bourgeoisie montra sa vraie nature de classe sanguinaire en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris les plus féroces, pour tenter de venir à bout de la combativité ouvrière. Mais au bout du compte elle dut cependant reculer régulièrement face aux assauts de la classe ouvrière en cédant souvent totalement aux revendications des grévistes.
1936/1938 : importantes luttes ouvrières sous le gouvernement de Front populaire
Dans la foulée de l’avènement du gouvernement de Front populaire de Léon Blum, on put assister au redémarrage fulgurant de la combativité ouvrière à travers l’éclatement de nombreuses grèves. Ainsi, on ne dénombra pas moins de 42 "grèves sauvages" au Sénégal entre 1936 et 1938, dont celle de septembre 1938 que nous verrons ci-après. Ce fait est d’autant plus significatif que les syndicats venaient d’être légalisés avec de "nouveaux droits" par le gouvernement de Front populaire, en bénéficiant donc d’une légitimité.
Ces mouvements de lutte furent souvent victorieux. Par exemple celui de 1937 où des marins d’origine européenne d’un navire français en escale en Côte d’Ivoire qui, sensibilisés par les conditions de vie misérables des marins indigènes (des Kroumen), incitèrent ces derniers à formuler des revendications visant à améliorer leurs conditions de travail. Mais les ouvriers indigènes furent chassés manu militari par l’administrateur colonial, ce qui mit aussitôt l’équipage français en grève en soutien à leurs camarades africains en obligeant ainsi les autorités à satisfaire pleinement les revendications des grévistes.
Voilà encore un énième acte de solidarité ouvrière qui vint s’ajouter aux nombreux épisodes cités précédemment où l’unité et la solidarité entre européens et africains fut à l’origine d’un bon nombre de luttes victorieuses, ce en dépit de leurs "différences raciales".
1938 : la grève des cheminots suscita la haine de toute la bourgeoisie contre les ouvriers
Un autre mouvement hautement significatif en termes d’affrontement de classes fut la grève des cheminots en 1938, menée par les ouvriers à contrats précaires dont les syndicats "négligeaient" les revendications. En l’occurrence des journaliers ou auxiliaires, plus nombreux et plus démunis chez les cheminots, payés à la journée en travaillant les dimanches et jours fériés, jours de maladie compris et en faisant 54 heures par semaine sans aucune des prérogatives accordées aux agents titulaires, le tout avec un emploi révocable chaque jour.
Ce sont donc ces cheminots-là qui déclenchèrent la célèbre grève de 1938 9 :
"(…) Le mouvement a d’ailleurs éclaté spontanément et en dehors de l’organisation syndicale. Le 27 septembre, les cheminots auxiliaires (non titulaires) du Dakar-Niger se mettent en grève à Thiès et à Dakar pour protester contre le déplacement arbitraire d’un de leurs camarades.
Le lendemain, au dépôt de Thiès, les grévistes organisent un barrage pour empêcher les "jaunes" de venir travailler. La police du Dakar-Niger tente d’intervenir, mais elle est vite débordée ; la direction du chemin de fer fait appel à l’administrateur qui envoie la troupe : les grévistes se défendent à coups de pierres ; l’armée fait feu. Il y a six morts et trente blessés. Le lendemain (le 29) la grève est générale sur tout le réseau. Le jeudi 30, un accord est signé entre les délégués ouvriers et le gouvernement général sur les bases suivantes :
1) Pas de sanctions ; 2) Pas d’entrave au droit d’association ;3) Indemnisation des familles de victimes nécessiteuses ; 4) Examen des revendications.
Le 1e octobre, le syndicat donne l’ordre de reprise du travail".
Nous voyons, là encore, une autre lutte spectaculaire et héroïque livrée par les cheminots, en dehors des consignes syndicales, qui firent plier la puissance coloniale, ce malgré le recours à son bras sanguinaire, en l’occurrence l’armée, comme l’indique le nombre de morts et de blessés sans compter les dizaines d’ouvriers jetés en prison. D’ailleurs, pour mieux mesurer le caractère barbare de la répression, voici le témoignage d’un ouvrier peintre, un des rescapés du carnage 10 :
"Lorsque nous apprîmes l’affectation à Gossas de Cheikh Diack, un violent mécontentement gagna les milieux des travailleurs, surtout les auxiliaires dont il était le porte-parole. Nous décidâmes de nous y opposer par la grève qui éclata le lendemain où notre dirigeant rejoignit son poste. En me réveillant ce jour-là, un mardi - je m’en souviendrai toujours - j’entendais des coups de feu. J’habitais à proximité de la Cité Ballabey. Quelques instants après, j’ai vu mon frère Domingo partir précipitamment vers le Dépôt. Je me jetai à sa poursuite, conscient du danger qu’il courait. Bientôt je le vis franchir la ligne du chemin de fer et tomber quelques mètres plus loin. Lorsque j’arrivai près de lui, je le crus victime d’un malaise, car je ne voyais aucune blessure, quand je le relevai, il poussa un gémissement rauque. Le sang coulait à flots d’une blessure qu’il portait près de l’épaule gauche. Il expira quelques instants après dans mes bras. Ivre de rage, je fonçai sur le soldat en face de moi. Il tira. J’avançai toujours sans savoir que j’étais blessé. Je crois que c’est la colère qui grondait en moi qui me donna la force de l’atteindre et de lui arracher son fusil, son ceinturon, son calot, après l’avoir assommé, avant de tomber évanoui".
Ce récit illustre la férocité des tirailleurs sénégalais envers les ouvriers "indigènes", ignorant l’exemple de leurs collègues qui avaient refusé de tirer sur les ouvriers lors de la rébellion sur le chantier de Thiès en 1925. Reste à saluer la combativité et le courage dont firent preuve les ouvriers grévistes dans la défense de leurs intérêts et de leur dignité de classe exploitée.
Il faut noter ici le fait qu’avant de partir en grève, les ouvriers furent harcelés par toutes les forces de la bourgeoisie, partis et divers notables, patronat et syndicats. Tous ces représentants de l’ordre du capital lancèrent injures et intimidations aux ouvriers qui osèrent partir en grève sans "bénédiction" de personne sauf d’eux-mêmes et, de fait, en rendant fous et hystériques les chefs religieux musulmans qui se déchaînèrent contre les grévistes, ce à la demande du Gouverneur, comme le rappelle Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Il (le gouverneur) fait aussi appel aux chefs religieux et coutumiers ; Seydou Nourou Tall, qui a souvent joué un rôle d’émissaire du gouverneur général, parle à Thiès (devant les ouvriers grévistes) ; Cheikh Amadou Moustapha Mbacke parcourt le réseau en expliquant qu’un bon musulman ne doit pas faire grève car c’est une forme de rébellion".
Une fois n’est pas coutume, nous sommes tout à fait d’accord avec ce cynique marabout pour dire que faire grève est bien un acte de rébellion, pas seulement contre l’exploitation et l’oppression, mais aussi contre l’obscurantisme religieux.
Quant aux syndicats, qui ne furent pas à l’initiative de la lutte des cheminots, ils durent quand même prendre le "train en marche" pour ne pas perdre totalement le contrôle du mouvement. Et voici décrit leur état d’esprit par le délégué des grévistes 11
"(…) Nous demandions une augmentation de 1,50 francs par jour pour les débutants jusqu’à 5 ans d’ancienneté, 2,50 francs de 5 à 10 ans, et 3,50 francs au dessus de 10 ans ainsi qu’une indemnité de déplacement en faveur des chefs de train, convoyeurs, mécaniciens etc.(…) Si invraisemblable que cela puisse paraître, ces revendications accueillies favorablement par la Direction du réseau, furent au contraire battues en brèche par le Syndicat des Travailleurs Indigènes du Dakar-Niger qui groupait les agents cadres. En effet, celui-ci ne pouvait pas se résigner à nous voir emporter cette première manche. Ses dirigeants cultivaient et tentaient de monopoliser le droit exclusif à la revendication auprès des autorités du réseau. La conjoncture syndicale de l’époque faite de rivalités, de luttes obscures intestines et de surenchère sur la fidélité à l’égard du patronat, explique largement une telle prise de position. Le résultat est que je fus muté à Dakar. On eut, en haut lieu, la candeur de croire que cette mutation pouvait étouffer le mouvement revendicatif qui avait pris naissance chez les "gagne-petit" ".
Encore une terrible démonstration du rôle d’agent traître à la cause ouvrière et de "négociateur de paix sociale" qu’exerce le syndicalisme au bénéfice du capital et de l’Etat bourgeois. Bref comme le dit Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Aussi est-il à peu près certain que les secrétaires des syndicats ont tout fait pour enrayer les menaces de grève qui auraient pu gêner les autorités.
Mais en plus des forces militaro-policières, syndicales, patronales et religieuses, ce fut surtout leur porte-parole, à savoir la presse aux ordres (de droite et de gauche) qui s’acharna comme un charognard affamé contre les grévistes :
Le "Courrier colonial" (du patronat) :
"Dans la métropole, on a eu trop longtemps à déplorer les désastreuses conséquences des grèves se produisant un peu partout, sur des mots d’ordre d’agitateurs le plus souvent étrangers, ou à la solde de l’étranger, pour que les gouvernements coloniaux se hâtent de refreiner énergiquement toute velléité de transformer nos colonies en champ d’actions de gréviculture" ;
"L’Action française" (droite) :
"Ainsi, alors que les responsables marxistes de l’émeute sont clairement établis, le ministre des Colonies envisage de prendre des sanctions contre les tirailleurs sénégalais (et non contre les grévistes). Et tout cela pour plaire aux socialistes et sauver leur créature, le Gouverneur général De Coppet, dont on verra la scandaleuse carrière". "
Voilà donc un aperçu de ce que fut l’attitude des vautours médiatiques de la droite. Pourtant en ce domaine la presse de gauche ne fut guère moins acharnée :
"Les journaux proches du Front populaire sont très amers. L’A.O.F. impute la grève à des agents provocateurs, une "grève absurde" (…).
Le Périscope Africain parle d’une grève "frisant la rébellion" alors qu’aucun gréviste ne faisait partie du syndicat indigène. Le Bulletin de la Fédération des fonctionnaires flétrit l’usage des balles pour disperser les grévistes, interprète la grève comme une émeute, les auxiliaires n’étant ni des cégétistes, ni des communistes. Ils ne sont même pas syndiqués. "Aux fascistes les responsabilités".
Le Populaire (SFIO) impute la responsabilité des incidents à un "parti local de droite violemment hostile à la CGT et aux menées fascistes de certains syndicalistes (allusion au porte-parole des grévistes)"." (Nicole Bernard-Duquenet, ibid.)
Et pour caractériser toutes ces ignobles réactions anti-ouvrières, écoutons les conclusions de l’historien Iba Der Thiam 12 quand il dit ceci :
"Comme on le voit, on ne vit à gauche, comme à droite, dans les événements survenus à Thiès, que le prolongement de la politique intérieure française, c'est-à-dire, une lutte opposant démocrates et fascistes, en l’absence de toute motivation sociale concrète et plausible.
C’est cette erreur d’appréciation, qui expliquerait dans une large mesure, pourquoi la grève des cheminots de Thiès n’a jamais été correctement appréhendée par les syndicats français, même les plus avancés.
(…) Les récriminations de l’AOF et du Périscope Africain, contre les grévistes, ressemblent sur bien des points aux articles du Populaire et de l’Humanité".
Autrement dit, une attitude similaire entre la presse de droite et de gauche face au mouvement des cheminots. Voilà, tout est dit dans ce dernier paragraphe ; en effet, on voit là l’unanimité des forces de la bourgeoisie, nationales et coloniales, contre la classe ouvrière qui lutta contre la misère et pour sa dignité. Manifestement, ces réactions haineuses de la presse de gauche envers les ouvriers grévistes confirmèrent avant tout l’encrage définitif du "PC" au sein du capital français, sachant que c’était déjà le cas du "PS" depuis 1914. Aussi, il faut se rappeler que ce comportement anti-ouvrier s’inscrivait dans le contexte d’alors des préparatifs militaires en vue de la seconde boucherie mondiale, pendant laquelle la gauche française joua un rôle actif d’embrigadement du prolétariat en France métropolitaine et dans les colonies africaines.
Lassou (à suivre)
1 Il s’agit du gros commerce dominé par les négociants bordelais comme Maurel & Prom, Peyrissac, Chavanel, Vézia, Devès, etc., groupe dont le monopole du crédit s’exerçait sur l’unique Banque de l’Afrique Occidentale.
2 Une grève générale et une émeute de 5 jours étendue à toute la région de Dakar, paralysant totalement la vie économique et politique et obligeant la bourgeoisie coloniale à céder aux revendications des grévistes (voir la Revue internationale n° 146).
3 Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Éditions L’Harmattan, 1991.
4 Voir Afrique noire, l'Ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, Paris 1961.
5 Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations".
6 Les informations dont nous disposons ne donnent pas d’indication sur les auteurs de ces attentats.
7 Syndicaliste africain, membre de la Fédération syndicale internationale, de tendance social-démocrate.
8 Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L’Harmattan, 1985
9 Jean Suret-Canale, op. cit.
10 Antoine Mendy, cité par la publication Sénégal d’Aujourd’hui, n° 6, mars 1964.
11 Cheikh Diack, cité par le même journal Sénégal d’Aujourd’hui.
12 Iba Der Thiam, La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938, Mémoire de Maîtrise, Dakar 1972.
Géographique:
- Afrique [162]
Le syndicalisme-révolutionnaire en Allemagne (III) : la FVDG syndicaliste-révolutionnaire au cours de la Première Guerre mondiale
- 2802 lectures
L'épreuve de l'heure : Union sacrée ou internationalisme ?
Main dans la main avec la social-démocratie qui vote publiquement les crédits de guerre le 4 août 1914, les directions des grands syndicats sociaux-démocrates s’inclinent également devant les plans de guerre de la classe dominante. À la conférence des comités directeurs des syndicats sociaux-démocrates du 2 août 1914, où il fut décidé de suspendre toute grève et toute lutte revendicative pour ne pas troubler la mobilisation dans la guerre, Rudolf Wissell exprime le paroxysme du chauvinisme qui a envahi les syndicats sociaux-démocrates : "Si l'Allemagne est vaincue dans la lutte actuelle, ce qu'aucun de nous n'espère, alors toutes les luttes syndicales après la fin de la guerre sont vouées à l'échec et inutiles. Si l’Allemagne triomphe, alors une conjoncture ascendante s’inaugure et les moyens de l’organisation n’auront ensuite pas besoin de peser autant dans la balance." 1 La logique effrayante des syndicats consiste à lier directement le sort de la classe ouvrière à l’issue de la guerre : si "leur propre nation" et leur classe dominante tirent profit de la guerre, alors c’est aussi un bénéfice pour les ouvriers, parce qu'on peut compter ensuite sur des concessions de politique intérieure pour la classe ouvrière. Par conséquent, il faut soutenir tous les moyens en vue de la victoire militaire de l'Allemagne.
L'incapacité des syndicats sociaux-démocrates et du SPD à adopter une position internationaliste face à la guerre n’est pas surprenante. Quand on enchaîne la défense des intérêts de la classe ouvrière au cadre national, quand on encense le parlementarisme bourgeois comme panacée au lieu de prendre comme orientation politique l’antagonisme international entre la classe ouvrière et le capitalisme, cela conduit inévitablement dans le camp du capital.
Effectivement la classe dominante en Allemagne n’a pu faire la guerre que grâce à la conversion publique du SPD et de ses syndicats ! Les syndicats sociaux-démocrates n’ont pas seulement joué un rôle de suiveurs. Non, ils ont développé une véritable politique de guerre, de propagande chauvine et ont constitué le facteur crucial dans l'établissement d'une intensive production de guerre. Le "réformisme socialiste" s'était transformé en "social-impérialisme" comme l’a formulé Trotski en 1914.
Parmi les ouvriers qui, dans les premiers temps de la déclaration de guerre en Allemagne, ont tenté de nager contre le courant, nombre d’entre eux étaient influencés par le syndicalisme révolutionnaire. La grève sur le paquebot "Vaterland" 2 en mai-juin 1914, peu avant le début de la guerre, constitue un exemple de l’affrontement entre les fractions combatives de la classe ouvrière et la centrale syndicale social-démocrate qui défendait l’Union Sacrée. Le plus grand paquebot du monde de l'époque constituait l’orgueilleux emblème de l'impérialisme allemand. Une partie de l'équipage, comportant une forte présence d’ouvriers de la fédération industrielle syndicaliste révolutionnaire, s’était mise en grève pendant le voyage inaugural Hambourg-New York. La Fédération des Ouvriers Allemands des Transports social-démocrate s'est opposée avec agressivité à cette grève : "Par conséquent, tous ceux qui ont participé à ces assemblées de syndicalistes révolutionnaires ont commis un crime contre les marins. (…) Nous rejetons par principe les grèves sauvages. (…) Et dans la gravité des temps présents, où il s'agit de rassembler toutes les forces des travailleurs, les syndicalistes révolutionnaires mènent leurs tentatives de division parmi les ouvriers et se revendiquent par-dessus le marché du mot d’ordre de Marx : l’émancipation des travailleurs ne peut être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes." 3 Les appels à l’unité du mouvement ouvrier par les syndicats sociaux-démocrates n'étaient plus que des phrases pour s’assurer du contrôle des mouvements dans la classe ouvrière afin de la faire basculer dans "l'union pour la guerre" en août 1914.
On ne peut pas du tout faire le reproche aux syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne d’avoir abandonné la lutte des classes dans les semaines avant la déclaration de la guerre. Au contraire, pendant un court temps, ils ont formé un centre de ralliement de prolétaires combatifs : "Là arrivèrent des ouvriers qui entendaient pour la première fois le terme de syndicalisme révolutionnaire et escomptaient ici du jour au lendemain assouvir leurs désirs révolutionnaires." 4 Toutes les organisations de la classe ouvrière, le courant syndicaliste révolutionnaire y compris, devaient cependant faire face à une autre tâche. Outre maintenir la lutte des classes, il était indispensable de démasquer le caractère impérialiste de la guerre qui se profilait.
Quelle a été l'attitude de la FVDG syndicaliste révolutionnaire par rapport à la guerre ? Le 1er août 1914, elle a clairement pris position dans son organe principal Die Einigkeit contre la guerre imminente, non en tant que pacifistes naïfs, mais en tant qu’ouvriers recherchant la solidarité avec ceux des autres pays : "Qui veut la guerre ? Pas le peuple laborieux, mais une camarilla militaire de vauriens, qui dans tous les États européens est avide de gloire martiale. Nous travailleurs ne voulons pas de guerre ! Nous l’exécrons, elle assassine la culture, elle viole l'humanité et augmente jusqu’à la monstruosité le nombre des estropiés de la guerre économique actuelle. Nous travailleurs voulons la paix, la paix intégrale ! Nous ne connaissons pas d’Autrichiens, de Serbes, de Russes, d’Italiens, de Français, etc. Frères du travail, voilà notre nom ! Nous tendons les mains aux travailleurs de tous les pays pour empêcher un crime atroce qui produira des torrents de larmes dans les yeux des mères et des enfants. Les barbares et les individus hostiles à toute civilisation peuvent bien voir dans la guerre une sublime et sainte expression - les hommes au cœur sensible, les socialistes, portés par une conception du monde faite de justice, d'humanité et d'amour des hommes, dédaignent la guerre ! Par conséquent, travailleurs et camarades, élevez partout la voix en protestation contre ce crime contre l'humanité qui se prépare ! Il coûte leurs biens et leur sang aux pauvres, mais il apporte le profit aux riches, gloire et honneur aux représentants du militarisme. A bas la guerre !"
Le 6 août 1914 se produisait l'attaque des troupes allemandes contre la Belgique. Franz Jung, un sympathisant syndicaliste révolutionnaire de la FVDG et ultérieurement membre du KAPD, dresse le tableau de ses expériences saisissantes dans le Berlin de ces jours-là, pris dans l’ivresse guerrière : "Pour le moins toute une foule fondit sur les quelques douzaines de manifestants pour la paix, auxquels je m'étais joint. Autant que je me le rappelle, cette manifestation avait été organisée par les syndicalistes révolutionnaires autour de Kater et de Rocker. Une banderole tendue entre deux perches a été brandie, un drapeau rouge déployé et la manifestation "A bas la guerre !" a commencé à s’ordonner en rangs. Nous ne sommes pas allés loin." 5
Laissons s’exprimer une autre révolutionnaire de l'époque, l'anarchiste internationaliste Emma Goldman : "En Allemagne Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater, et beaucoup d'autres camarades restaient en liaison. Évidemment, nous n’étions qu’une poignée en comparaison des millions grisés par la guerre, cependant nous sommes parvenus à diffuser dans le monde entier un manifeste de notre Bureau International et nous dénoncions chez nous avec la dernière énergie la véritable nature de la guerre." 6 Oerter et Kater étaient les principaux membres expérimentés de la FVDG. La FVDG a solidement maintenu sa position contre la guerre pendant toute la durée du conflit. Cela constitue incontestablement la force la plus saillante de la FVDG - mais curieusement le chapitre de son histoire le moins documenté.
Dès le début de la guerre, la FVGD a été immédiatement interdite. Beaucoup de ses membres - elle en comptait en 1914 encore environ 6000 - ont été placés en détention ou envoyés de force au front. Dans la revue Der Pionier, un autre de ses organes, la FVDG écrit le 5 août 1914 dans l'éditorial "Le Prolétariat international et la guerre mondiale imminente" que "chacun sait que la guerre entre la Serbie et l'Autriche n'est qu’une expression visible de la fièvre guerrière chronique…". La FVDG décrit comment les gouvernements de Serbie, d'Autriche et d'Allemagne ont réussi à gagner la classe ouvrière à la "furie guerrière" et dénonce à ce propos le SPD et le mensonge de la prétendue "guerre défensive" : "L’Allemagne ne sera jamais l’agresseur, c’est cette conception que ces messieurs du gouvernement nous inculquent déjà, et c’est pour cette raison que les sociaux-démocrates allemands, comme leur presse et leurs orateurs, l’ont déjà mis en sûre perspective, se retrouveront comme un seul homme dans les rangs des armées allemandes." Le numéro 32 du 8 août 1914 de "Die Einigkeit" fut le dernier numéro distribué aux militants.
Un antimilitarisme internationaliste
Dans la partie introductive de cette série d'articles sur le syndicalisme révolutionnaire, nous avons fait une distinction entre l’antimilitarisme et l’internationalisme. "L'internationalisme se base sur la compréhension du fait que, si le capitalisme est un système mondial, il reste néanmoins incapable de dépasser le cadre national et la concurrence de plus en plus effrénée entre les nations. En tant que tel, il engendre un mouvement visant à renverser la société capitaliste au niveau international, par une classe ouvrière unie elle aussi au niveau international. (…) L'antimilitarisme, par contre, n'est pas forcément internationaliste puisqu'il tend à prendre comme ennemi principal, non pas le capitalisme en tant que tel, mais seulement un aspect de celui-ci." 7 Dans quel camp la FVDG s'est-elle rangée
Dans la presse de la FVDG de cette période, on trouve peu d’analyses politiques fouillées ou développées concernant les causes de la guerre ou les relations entre les différentes puissances impérialistes. Cette lacune provient de la vision syndicaliste de la FVDG. Celle-ci se concevait, à ce moment surtout, comme une organisation de lutte sur le plan économique, même si, plutôt qu'un syndicat, elle était en réalité beaucoup plus une coordination de groupes défendant des idées syndicalistes. Les dures confrontations avec le SPD qui prirent fin en 1908 avec son exclusion, avaient produit dans les rangs de la FVDG une aversion exacerbée de la "politique" et, conséquence supplémentaire, la perte de l'héritage des combats passés contre l'idéologie de la séparation entre économie et politique, véhiculée par les grands syndicats de la social-démocratie. Bien que la compréhension par la FVDG de la dynamique de l'impérialisme n'ait pas été réellement à la hauteur des nécessités, cette organisation était cependant inévitablement poussée par la guerre à adopter un positionnement fortement politique.
L'histoire du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne montre, à l'exemple de la FVDG, que les analyses théoriques sur l'impérialisme ne suffisent pas à elles seules pour adopter une position vraiment internationaliste. Un sain instinct prolétarien, un profond sentiment de solidarité avec la classe ouvrière internationale, sont également indispensables - et c'est précisément cela qui formait l’épine dorsale de la FVDG en 1914.
La FVDG se qualifie généralement d’"antimilitariste" dans ses publications ; on y trouve à peine le terme d’internationalisme. Mais pour rendre pleine justice aux syndicalistes révolutionnaires de la FVDG, il est absolument nécessaire de prendre en considération la vraie nature de son travail d'opposition contre la guerre. Le point de vue de la FVDG sur la guerre ne faisait pas partie de ceux qui se bornaient aux frontières nationales ni de ceux bercés par les illusions répandues par le pacifisme quant à la possibilité d'un capitalisme pacifique. Contrairement à la grande majorité des pacifistes qui, pour la plupart, se sont trouvés immédiatement après la déclaration de guerre dans les rangs de la défense de la nation contre le militarisme étranger, prétendument le plus barbare, la FVDG a, le 8 août 1914, mis clairement la classe ouvrière en garde contre toute coopération avec la bourgeoisie nationale : "Les travailleurs ne doivent donc pas crédulement faire confiance en l'humanité du moment, celle des capitalistes et des patrons. La fureur guerrière actuelle ne doit pas brouiller la conscience des antagonismes de classe existant entre le Capital et le Travail." 8
Pour les camarades de la FVDG il ne s’agissait pas de combattre seulement un aspect du capitalisme, le militarisme, mais d’intégrer la lutte contre la guerre à la lutte générale de la classe ouvrière pour le dépassement du capitalisme à l’échelle mondiale, comme l’avait formulé Karl Liebknecht déjà en 1906 dans sa brochure "Militarisme et antimilitarisme". En 1915, dans l’article "Antimilitarisme !", celui-ci avait, à juste titre, critiqué les formes héroïques et radicales en apparence de l’antimilitarisme comme la désertion, qui livre encore plus l’armée aux mains des militaristes par l’élimination des meilleurs antimilitaristes, en conséquence de quoi "toutes les méthodes opérant uniquement individuellement ou exercées individuellement sont à rejeter par principe". Dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international, il y eut les points de vue les plus différents sur la lutte antimilitariste. Domela Nieuwenhuis, un représentant historique de l’idée de la grève générale, en a défini les moyens en 1901 dans sa brochure "Le Militarisme" comme un curieux mélange de réformes et d’objection individuelle. Il en va tout autrement pour la FVDG ; celle-ci partageait la préoccupation de Liebknecht selon laquelle c’est la lutte de classe de tous les travailleurs collectivement – et non pas l'action individuelle – qui constitue l’unique moyen contre la guerre.
La réalisation de la presse de la FVDG, assurée surtout par le secrétariat (Geschäftskommission) à Berlin se composant de 5 camarades autour de Fritz Kater, exprimait fortement les propres positions politiques de ces camarades du fait de la cohésion organisationnelle lâche du FVDG. L'internationalisme dans la FVDG ne se limite toutefois pas à une minorité de l'organisation comme dans la CGT syndicaliste révolutionnaire en France. Il ne s'est pas produit de scission en son sein sur la question de la guerre. Ce sont plutôt la répression contre l'organisation et les incorporations forcées sur le front qui ont eu pour conséquence que seule une minorité a pu maintenir une activité permanente. Des groupes syndicalistes révolutionnaires restaient encore actifs principalement à Berlin et dans environ 18 autres localités. Suite à l'interdiction de Die Einigkeit en août 1914, ils restèrent en liaison par le biais de la Mitteilungsblatt, puis après la suppression de celle-ci en juin 1915, à travers l'organe Rundschreiben, interdit à son tour en mai 1917. La forte répression contre les syndicalistes révolutionnaires internationalistes en Allemagne fait que leurs publications ont, dès le début de la guerre, plutôt pris le caractère de bulletins internes que de revues publiques : "Les comités directeurs, ou les personnes de confiance, doivent immédiatement n’éditer que le nombre nécessaire d’exemplaires pour leurs membres existants et ne distribuer le bulletin qu’à ceux-ci." 9
Les camarades de la FVDG ont aussi eu le courage de s'opposer à la mobilisation de la majorité de la CGT syndicaliste révolutionnaire en France pour la participation à la guerre : "Toute cette excitation à la guerre de la part de socialistes, de syndicalistes et d’antimilitaristes internationaux ne contribue pas le moins du monde à ébranler nos principes." 10, écrivirent-ils à propos de la capitulation de la majorité de la CGT. La question de la guerre était devenue la pierre de touche dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international. S’opposer à la grande sœur CGT syndicaliste révolutionnaire exigeait une solide fidélité à la classe ouvrière, alors que la CGT et ses théories avaient constitué durant des années un important point de repère dans l’évolution de la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Au cours de la guerre, les camarades de la FVDG soutiennent la minorité internationaliste, autour de Pierre Monatte, sortie de la CGT.
Pourquoi la FVDG est-elle restée internationaliste ?
Tous les syndicats en Allemagne en 1914 ont succombé à la fièvre nationaliste de la guerre. Pourquoi la FVDG fut-elle une exception ? Il est impossible de répondre à cette question en invoquant seulement la "chance" d’avoir possédé, comme ce fut le cas, un secrétariat (Geschäftskommission) ferme et internationaliste. De même qu’on ne peut pas expliquer la capitulation des syndicats sociaux-démocrates face à la question de la guerre par la "poisse" d’avoir eu à leur tête des directions traitres.
La FVDG a tout aussi peu acquis une solidité internationaliste du simple fait de sa claire évolution vers le syndicalisme révolutionnaire à partir de 1908. L'exemple de la CGT française montre que le syndicalisme révolutionnaire de l'époque n'a pas représenté en soi une garantie d'internationalisme. On peut dire en général que ni la profession de foi de marxisme, d'anarchisme ou bien de syndicalisme révolutionnaire n’offre en soi la garantie d’être internationaliste.
La FVDG a rejeté le mensonge patriotique de la classe dominante, avec dans ses rangs la social-démocratie, d'une pure "guerre défensive" (un piège dans lequel Kropotkine est tragiquement tombé). Elle a dénoncé dans sa presse la logique selon laquelle chaque nation se présente comme "l’agressée", l'Allemagne par le sombre tsarisme russe, la France par le militarisme prussien, etc. 11 Cette clarté ne pouvait se développer que sur la base de la conception de l’impossibilité de pouvoir désormais distinguer, au sein du capitalisme, des nations plus modernes ou des nations plus arriérées, et que le capitalisme dans son ensemble était devenu destructeur pour l'humanité. La position internationaliste s'est distinguée à l'époque de la Première Guerre mondiale surtout par la dénonciation politique de la "guerre défensive". Ce n’est pas par hasard si Trotski a consacré, à l’automne 1914, une brochure entière à cette question. 12 La FVDG argumentait aussi en recourant à des principes humains : "Le socialisme place les principes humains au-dessus des principes nationaux." (…) "Il est (…) difficile de se trouver du côté de l’humanité plongée dans l’affliction, mais si nous voulons être des socialistes, là est notre place." 13 La question de la solidarité et de la relation humaine aux autres travailleurs du monde entier constitue une base pour l’internationalisme. L'internationalisme de la FVDG exprimé en 1914 de façon prolétarienne contre la guerre étaitun signe de la force du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne par rapport à la question décisive de la guerre.
Les racines fondamentales de l'internationalisme de la FVDG se trouvent toutefois surtout dans l’histoire de sa longue opposition au réformisme qui s'insinuait dans le SPD et les syndicats sociaux-démocrates. Son aversion pour la panacée universelle du parlementarisme du SPD a joué un rôle essentiel puisqu'elle empêcha justement, contrairement aux syndicats sociaux-démocrates, son intégration idéologique dans l'État capitaliste.
Dans les années immédiatement avant l`éclatement de la Guerre mondiale, il se manifesta une opposition entre trois tendances au sein de la FVDG : une exprimant l'identité syndicale, une autre la résistance contre "la politique" (du SPD) et une troisième la propre réalité de FVDG comme un ensemble de groupes de propagande (réalité qui, comme on l'a déjà expliqué, a aussi freiné la capacité à produire des analyses claires de l`impérialisme). Cette confrontation n'a pas produit que des faiblesses. Face à la politique ouvertement chauvine du SPD et des autres syndicats, le vieux réflexe de la résistance contre la dépolitisation des luttes ouvrières, assez fort jusqu'au débat sur la grève de masse en 1904, s'était trouvé ravivé.
Même si, comme le décrit notre précédent article, la résistance de la FVDG au réformisme portait en elle d’étranges faiblesses comme l’aversion envers "la politique", ce qui était déterminant en 1914, c'était l'attitude par rapport à la guerre. La contribution internationaliste de la FVDG était à ce moment beaucoup plus importante, pour la classe ouvrière, que ses faiblesses.
La saine réaction de ne pas se replier sur l’Allemagne, en dépit des conditions les plus difficiles, avait été décisive pour le maintien d'une fermeté internationaliste. La FVDG a recherché le contact non seulement avec la minorité internationaliste de Monatte dans la CGT, mais aussi avec d'autres syndicalistes révolutionnaires au Danemark, en Suède, en Espagne, en Hollande (Nationaal Arbeids Secretariaat) et en Italie (Unione Sindacale Italiana) qui tentaient de s'opposer à la guerre.
Une coopération insuffisante avec les autres internationalistes en Allemagne
Avec quelle force la voix internationaliste de la FVDG pouvait-elle se faire entendre dans la classe ouvrière pendant la guerre ? Elle s’est opposée vigoureusement aux perfides organes d’intégration à l’Union Sacrée. Comme formulé dans son organe interne, Rundschreiben, elle s'est opposée de façon très conséquente à la participation à des comités de guerre 14 : "Certainement pas ! De telles fonctions ne sont rien pour ceux de nos membres ou fonctionnaires (…) personne ne peut exiger cela d'eux." 15 Mais dans les années 1914-1917, elle s’adresse presque exclusivement à ses propres membres. Avec une estimation réaliste de l'impuissance présente et de l'impossibilité de pouvoir faire vraiment obstacle à la guerre, mais surtout avec une crainte légitime de la destruction de l’organisation, Fritz Kater au nom du secrétariat (Geschäftskommission) s’adressa le 15 août 1914 dans la Mitteilungsblatt aux camarades de la FVDG : "Nos points de vue sur le militarisme et la guerre, comme nous les avons défendus et propagés depuis des décennies, dont nous nous portons garants jusqu’à la fin de la vie, ne sont pas admissibles à une époque d'enthousiasme débridé en faveur de la guerre, on nous condamne au silence. C’était à prévoir et donc l'interdiction n’a absolument pas été pour nous une surprise. Nous devons ainsi nous résigner au silence, au même titre aussi que tous les autres camarades du syndicat."
Kater exprime d'une part l'espoir de maintenir les activités comme avant la guerre (ce qui cependant était impossible du fait de la répression) et d'autre part l'objectif minimal de sauver l'organisation : "Le secrétariat (Geschäftskommission) est toutefois d'avis qu’il agirait en oubliant ses devoirs s’il cessait maintenant, avec l’interdiction des journaux, toutes les autres activités. Cela, il ne le fera pas. (…) Il maintiendra les liaisons entre les différentes organisations et fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher leur décomposition."
La FVDG a survécu en effet à la guerre. Cela non pas sur la base d'une stratégie de survie particulièrement habile ou d’appels insistants à ne pas quitter l'organisation. C'est clairement son internationalisme qui a constitué tout le temps de la guerre un point d’ancrage pour ses membres.
Lorsqu’en septembre 1915 l’appel international contre la guerre du Manifeste de Zimmerwald retentit avec un grand écho, celui-ci a été salué solidairement par la FVDG. Cela surtout en raison de sa proximité avec la minorité internationaliste de la CGT présente à Zimmerwald. Mais la FVDG nourrissait une méfiance envers une grande partie des groupements de la conférence de Zimmerwald, parce que ceux-ci étaient encore par trop reliés à la tradition du parlementarisme. Cela il est vrai n’était pas injustifié, six des présents, parmi eux Lénine, avaient déclaré : "Le manifeste accepté par la conférence ne nous satisfait pas complètement. (…) Le manifeste ne contient aucune caractéristique claire des moyens de combattre la guerre." 16. La FVDG n'avait pas non plus, contrairement à Lénine, la clarté nécessaire sur les moyens pour combattre la guerre. Sa méfiance exprimait plutôt un manque d'ouverture par rapport aux autres internationalistes comme le montrent clairement ses relations avec ceux d'Allemagne.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu en Allemagne même de coopération entre l'opposition internationaliste du Spartakusbund et les syndicalistes révolutionnaires de la FVDG ? Pendant une longue période, il y a eu entre eux de profonds fossés qui n’avaient pu être comblés. Karl Liebknecht, 10 ans auparavant, dans le débat sur la grève de masse, avait durement généralisé à la FVDG les faiblesses individualistes de l’un de ses porte-paroles temporaires, Rafael Friedeberg. Pour autant que nous sachions, les révolutionnaires autour de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht n’ont pas non plus recherché le contact avec la FVDG pendant les premières années de la guerre, certainement à cause d'une sous-estimation des capacités internationalistes des syndicalistes révolutionnaires.
La FVDG elle-même a eu vis-à-vis de Liebknecht, la figure symbolique du mouvement contre la guerre en Allemagne, une attitude très fluctuante empêchant tout rapprochement. D’une part, elle ne put jamais pardonner à Liebknecht son approbation des crédits de guerre en août 1914, votés non par conviction mais exclusivement sur la base d’une conception fausse de la discipline de fraction qu’il a lui-même critiquée par la suite. Toutefois, dans sa presse, la FVDG a toujours pris sa défense quand il fut victime de la répression. La FVDG ne croyait pas l'opposition révolutionnaire au sein du SPD capable de se défaire du parlementarisme, une étape qu’elle-même n’avait accomplie que par sa séparation du SPD en 1908. Une profonde méfiance existait. Ce n'est que fin 1918, lorsque le mouvement révolutionnaire envahit complètement l'Allemagne, que la FVDG appelle ses membres à adhérer temporairement au Spartakusbund en double affiliation.
Rétrospectivement, ni la FVDG ni les Spartakistes n'ont suffisamment cherché le contact sur la base de leur position internationaliste pendant la guerre. C'est plutôt la bourgeoisie qui a mieux reconnu le point commun internationaliste de la FVDG et des Spartakistes que ces deux organisations elles-mêmes : la presse contrôlée par la direction du SPD a souvent essayé de dénigrer les Spartakistes comme étant les proches de la "tendance Kater." 17
Si, à l’aune de l'histoire de la FVDG pendant la Première Guerre mondiale, nous pouvons tirer un enseignement pour aujourd'hui et l'avenir, c'est bien le suivant : la nécessité de chercher le contact avec les autres internationalistes, même s’il existe des différences sur d'autres questions politiques. Cela n'a absolument rien à voir avec un "front unique" (qui en raison d’une faiblesse sur les principes recherche même la coopération avec des organisations du camp bourgeois) comme en a connu l'histoire du mouvement ouvrier dans les années 1920-30, mais au contraire avec la reconnaissance du point commun prolétarien le plus important.
Mario 5. 8. 2011
1 H.J. Bieber : Gewerkschaften in Krieg und Revolution, 1981, tome 1, p. 88, (notre traduction)
2 "Patrie" en allemand.
3 Voir Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf dem Ozean-Dampfer "Vaterland“ 1914, 2008, (notre traduction)
4 Die Einigkeit, principal organe de la FVDG, 27 juin 1914, article de Karl Roche, "Ein Gewerkschaftsführer als Gehilfe des Staatsanwalts“, (notre traduction)
5 Franz Jung, Der Weg nach unten, Nautilus, p.89, (notre traduction)
6 Emma Goldman, Living My Life, p.656, (notre traduction). En février 1915, Emma Goldman s’est publiquement prononcée avec d’autres anarchistes internationalistes, tels Berkman et Malatesta, contre l’approbation de la guerre par la principale figure de l’anarchisme, Kropotkine, et d’autres. La FVDG salua dans la Mitteilungsblatt du 20 février 1915 cette défense de l’internationalisme vis-à-vis de Kropotkine par des anarchistes révolutionnaires.
7 "Ce qui distingue le mouvement syndicaliste révolutionnaire [246]", Revue internationale n° 118.
8 Die Einigkeit, n° 32, 8 août 1914
9 Mitteilungsblatt, 15 août 1914
10 Mitteilungsblatt, 10 octobre 1914. Cité d’après Wayne Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War. Cet ouvrage est, avec les documents originaux de la FVDG, la seule (et très précieuse) source sur le syndicalisme révolutionnaire allemand au cours de la Première Guerre mondiale.
11 Voir entre autres Mitteilungsblatt, novembre 1914 et Rundschreiben, août 1916.
12 La Guerre et l‘Internationale
13 Mitteilungsblatt, 21 novembre 1914
14 Ces comités de guerre (Kriegsausschüsse) ont été fondés après février 1915, d’abord dans l’industrie métallurgique de Berlin, entre représentants des associations patronales de la métallurgie et des grands syndicats. Le but poursuivi était de faire cesser la tendance croissante chez les ouvriers à trop souvent changer de lieu de travail à la recherche de salaires plus élevés, le début de la saignée de la société par les massacres ayant provoqué une pénurie des forces de travail. Cette fluctuation "incontrôlée" était, aux yeux du gouvernement et des syndicats, nuisible à l’efficacité de la production de guerre. La mise en place de ces comités s'était basée sur une tentative précédente lancée dès août 1914 par le leader syndical social-démocrate Theodor Leipart visant la formation de Kriegsarbeitsgemeinschaften (collectifs de guerre avec les employeurs) qui, sous couvert hypocrite d’agir en faveur de la classe ouvrière pour "combattre le chômage" et réguler le marché du travail, visaient en réalité à mettre tout en œuvre pour rendre plus efficace la production pour la guerre.
15 Cité d‘après W. Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War.
16 Déclaration de Lénine, Zinoviev, Radek, Nerman, Höglund, Berzin à la conférence de Zimmerwald, cité par J. Humbert-Droz, L’Origine de l’Internationale Communiste, p.144
17 Vorwärts, 9 janvier 1917
Géographique:
- Allemagne [247]
Courants politiques:
Décadence du capitalisme (XI) : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme
- 3634 lectures
Dans les articles précédents de cette série, nous avons montré que les marxistes (et même certains anarchistes) partageaient en grande partie le même point de vue sur l'étape historique atteinte par le capitalisme au milieu du 20e siècle. La guerre impérialiste dévastatrice de 1914-18, la vague révolutionnaire internationale qui avait pris place dans son sillage et la dépression économique mondiale sans précédent qui avait marqué les années 1930, tous ces événements étaient considérés comme la preuve irréfutable du fait que le mode de production bourgeois était entré dans sa phase de déclin, l'époque de la révolution prolétarienne mondiale. L'expérience du deuxième massacre impérialiste ne remit pas en cause ce diagnostic ; au contraire, il constituait une preuve encore plus décisive du fait que le système avait fait son temps. Victor Serge avait déjà écrit à propos des années 1930 qu'il était "minuit dans le siècle" - une décennie qui avait vu la contre-révolution vaincre sur tous les fronts au moment même où les conditions objectives du renversement du système n'avaient jamais été si nettement développées. Mais les événements de 1939-45 ont montré que la nuit pouvait s'obscurcir encore plus.
Comme nous l'avons écrit dans le premier article de cette série 1 : "Le tableau de Picasso, Guernica, est célébré à juste raison comme une représentation sans précédent des horreurs de la guerre moderne. Le bombardement aveugle de la population civile de cette ville espagnole par l'aviation allemande qui soutenait l'armée de Franco, constitua un grand choc car c'était un phénomène encore relativement nouveau. Le bombardement aérien de cibles civiles avait été limité durant la Première Guerre mondiale et très inefficace. La grande majorité des tués pendant cette guerre étaient des soldats sur les champs de bataille. La Deuxième Guerre mondiale a montré à quel point la capacité de barbarie du capitalisme en déclin s'était accrue puisque, cette fois, la majorité des tués furent des civils : "L'estimation totale en pertes de vies humaines causées par la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du camp dont elles faisaient partie, est en gros de 72 millions. Le nombre de civils atteint 47 millions, y compris les morts de faim et de maladie à cause de la guerre. Les pertes militaires se montent à environ 25 millions, y compris 5 millions de prisonniers de guerre" 2. L'expression la plus terrifiante et la plus concentrée de cette horreur est le meurtre industrialisé de millions de Juifs et d'autres minorités par le régime nazi, fusillés, paquets par paquets, dans les ghettos et les forêts d'Europe de l'Est, affamés et exploités au travail comme des esclaves jusqu'à la mort, gazés par centaines de milliers dans les camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen ou Treblinka. Mais le nombre de morts civils victimes du bombardement des villes par les protagonistes des deux côtés prouve que cet Holocauste, ce meurtre systématique d'innocents, était une caractéristique générale de cette guerre. En fait, à ce niveau, les démocraties ont certainement surpassé les puissances fascistes, et les tapis de bombes, notamment de bombes incendiaires, qui ont recouvert les villes allemandes et japonaises confèrent, en comparaison, un air plutôt "amateur" au Blitz allemand sur le Royaume-Uni. Le point culminant et symbolique de cette nouvelle méthode de massacre de masse a été le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki ; mais en termes de morts civils, le bombardement "conventionnel" de villes comme Tokyo, Hambourg et Dresde a été encore plus meurtrier."
Contrairement à la Première Guerre mondiale à laquelle avait mis fin l'éclatement des luttes révolutionnaires en Russie et en Allemagne, le prolétariat n'a pas secoué les chaînes de la défaite à la fin de la Deuxième. Non seulement il avait été écrasé physiquement, en particulier par l'assommoir du stalinisme et du fascisme, mais il avait également été embrigadé idéologiquement et physiquement derrière les drapeaux de la bourgeoisie, essentiellement à travers la mystification de l'antifascisme et de la défense de la démocratie. Il y eut des explosions de lutte de classe et des révoltes à la fin de la guerre, en particulier dans les grèves qui éclatèrent dans le nord de l'Italie et qui avaient clairement un esprit internationaliste. Mais la classe dominante s'était bien préparée à de telles explosions et elle les a traitées avec une cruauté impitoyable, en particulier en Italie où les forces alliées, guidées de main de maître par Churchill, ont permis aux forces nazies de réprimer la révolte ouvrière pendant qu'elles-mêmes bombardaient les villes du nord touchées par les grèves ; pendant ce temps, les staliniens faisaient de leur mieux pour recruter les ouvriers combatifs dans la résistance patriotique. En Allemagne, la terreur des bombardements des villes élimina toute possibilité que la défaite militaire du pays permette une répétition des luttes révolutionnaires de 1918. 3
Bref, l'espoir qui avait animé les petits groupes révolutionnaires ayant survécu au naufrage des années 1920 et 30 – qu'une nouvelle guerre donne lieu à un nouveau surgissement révolutionnaire – s'éteignit rapidement.
L'état du mouvement politique prolétarien après la Deuxième Guerre mondiale
Dans ces conditions, le petit mouvement révolutionnaire qui avait maintenu des positions internationalistes au cours de la guerre, après une brève période de revitalisation à la suite de l'effondrement des régimes fascistes en Europe, fut confronté aux conditions les plus difficiles quand il entreprit d'analyser la nouvelle phase de la vie du capitalisme après six ans de carnage et de destruction. La plupart des groupes trotskistes avaient signé leur sentence de mort en tant que courant prolétarien en soutenant au cours de la guerre le camp Allié, au nom de la défense de la "démocratie" contre le fascisme ; cette trahison se confirma avec leur soutien ouvert à l'impérialisme russe et à ses annexions en Europe de l'Est après la guerre. Il existait encore un certain nombre de groupes qui avaient rompu avec le trotskisme et maintenu une position internationaliste contre la guerre, comme les RKD d'Autriche, le groupe autour de Munis, et l'Union communiste internationaliste en Grèce animée par Aghis Stinas et Cornelius Castoriadis, qui forma le groupe Socialisme ou Barbarie par la suite. Les RKD, dans leur hâte d'analyser ce qui avait conduit le trotskisme à la mort, commencèrent par rejeter le bolchevisme et finirent par abandonner complètement le marxisme. Munis évolua vers des positions communistes de gauche et fut toute sa vie convaincu que la civilisation capitaliste était profondément décadente, appliquant cette vision avec une grande clarté à des questions clé telles que la question syndicale et la question nationale. Mais il semble qu'il ne parvint pas à comprendre comment cette décadence était liée à l'impasse économique du système : dans les années 1970, son organisation, le Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR), quitta les Conférences de la Gauche communiste parce que les autres groupes participants pensaient tous qu'il y avait une crise économique ouverte du système, position qu'elle rejetait. Comme nous le verrons plus loin, Socialisme ou Barbarie fut abusé par le boom qui débuta dans les années 1950 et remit également en cause les fondements de la théorie marxiste. De ce fait, aucun des anciens groupes trotskistes ne semble avoir apporté de contribution durable à la compréhension marxiste des conditions historiques auxquelles était maintenant confronté le capitalisme mondial.
L'évolution de la Gauche communiste hollandaise après la guerre donne également des indications sur la trajectoire générale du mouvement. Il y eut un bref renouveau politique et organisationnel avec la formation du Spartacusbond en Hollande. Comme nous le montrons dans notre livre La Gauche communiste hollandaise, ce groupe retrouva momentanément la clarté du KAPD, non seulement en reconnaissant le déclin du système mais aussi en abandonnant la peur conseilliste du parti. Cette attitude fut facilitée par son ouverture à d'autres courants révolutionnaires, en particulier envers la Gauche communiste de France. Mais cela ne dura pas longtemps. La majorité de la Gauche hollandaise, en particulier le groupe autour de Cajo Brendel, fit vite marche arrière vers des conceptions anarchisantes de l'organisation et une démarche ouvriériste qui ne voyait que peu d'intérêt à situer les luttes ouvrières dans leur contexte historique général.
Les débats dans la Gauche communiste d'Italie
Le courant révolutionnaire qui avait été le plus clair sur la trajectoire suivie par le capitalisme dans les années 1930 – la Gauche communiste d'Italie – ne fut pas épargné par le désarroi qui avait affecté le mouvement révolutionnaire à la fin de la guerre. Au départ, la plus grande partie de ses membres a vu, dans l'éclatement d'une révolte prolétarienne significative en Italie du nord en 1943, l'expression d'un changement de cours historique, les frémissements de la révolution communiste qu'on attendait. Les camarades de la Fraction française de la Gauche communiste internationale, qui s'était formée au cours de la guerre dans la France de Vichy, partageaient initialement ce point de vue mais estimèrent rapidement que la bourgeoisie, profitant de toute l'expérience de 1917, était bien préparée à de telles explosions et avait utilisé tout son arsenal d'armes pour les écraser impitoyablement. En revanche, la majorité des camarades restés en Italie, rejointe par les membres de la Fraction italienne rentrée d'exil, avait déjà proclamé la constitution du Parti communiste internationaliste (qu'on désignera comme PCInt, pour le distinguer des "Parti communiste international" ultérieurs). La nouvelle organisation avait une claire position internationaliste contre les deux camps impérialistes, mais elle s'était constituée à la hâte et rassemblait toute une série d'éléments politiquement différents et en grande partie disparates ; et ceci allait donner lieu à de nombreuses difficultés dans les années suivantes. La majorité des camarades de la Fraction française s'opposa à la dissolution de la Fraction italienne et à l'entrée de ses membres dans le nouveau parti. Elle allait rapidement mettre ce dernier en garde contre l'adoption de positions qui marquaient une claire régression par rapport à celles de la Fraction italienne. Sur des questions aussi centrales que les rapports entre le parti et les syndicats, la volonté de participer aux élections et la pratique organisationnelle interne, la Fraction française décelait une manifestation claire d'un glissement vers l'opportunisme.4 Le résultat de ces critiques fut que la Fraction française fut exclue de la Gauche communiste internationale et se constitua en Gauche communiste de France (GCF).
L'une des composantes du PCInt était la "Fraction des Socialistes et des Communistes" à Naples autour d'Amadeo Bordiga ; et le projet de former le parti avec Bordiga, qui avait joué un rôle incomparable dans la formation du Parti communiste d'Italie au début des années 1920 et dans la lutte contre la dégénérescence de l'Internationale communiste par la suite, constituait un élément central dans la décision de proclamer le parti. Bordiga avait été le premier à critiquer ouvertement Staline dans les sessions de l'IC, le dénonçant en face comme fossoyeur de la révolution. Mais depuis le début des années 1930 et au cours des premières années de la guerre, Bordiga s'était retiré de la vie politique malgré les nombreux appels de ses camarades pour qu'il reprenne l'activité. En conséquence, les acquis politiques développés par la Fraction italienne – sur les rapports entre la fraction et le parti, les leçons qu'elle avait tirées de la révolution russe, sur le cours du déclin du capitalisme et son impact sur des problèmes comme la question syndicale et la question nationale - lui échappèrent en grande partie et il resta figé sur les positions des années 1920. En fait, dans sa détermination à combattre toutes les formes d'opportunisme et de révisionnisme incarnées par les constants "nouveaux tournants" des partis "communistes" officiels, Bordiga commença à développer la théorie de "l'invariance historique du marxisme" : selon cette vision, ce qui distingue le programme communiste, c'est sa nature fondamentalement immuable, et cela implique que les grands changements qui eurent lieu dans les positions de l'IC ou de la Gauche communiste, quand ils rompirent avec la social-démocratie, ne constituaient qu'une "restauration" du programme d'origine incarné par le Manifeste communiste de 1848.5 Cette démarche avait pour implication logique qu'il n'y avait pas eu de changement d'époque dans la vie du capitalisme au 20e siècle ; le principal argument de Bordiga contre la notion de décadence du capitalisme se trouve dans la polémique contre ce qu'il appelait "la théorie de la courbe descendante" : "La théorie de la courbe descendante compare le développement historique à une sinusoïde : tout régime (par exemple le régime bourgeois) commence par une phase ascendante, atteint un point maximum, après quoi un autre régime remonte. Cette vision est celle du réformisme gradualiste : il n’y a pas de bonds, de secousses, ni de sauts. [...] La vision marxiste peut être représentée schématiquement par un certain nombre de courbes toujours ascendantes jusqu’à des sommets (en géométrie «points singuliers» ou «points de rupture») suivis d’une chute, presque verticale, puis, tout en bas, d’une autre branche historique ascendante, c’est-à-dire un nouveau régime social [...] L’affirmation courante selon laquelle le capitalisme est dans sa phase descendante et ne peut plus remonter, contient deux erreurs: le fatalisme et le gradualisme." (Réunion de Rome, avril 1951 6).
Bordiga écrit aussi : "Pour Marx 1e capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite…" 7. Le capitalisme serait constitué d'une série de cycles dans lesquels chaque crise, succédant à une période d'expansion "illimitée", est plus profonde que la précédente et pose la nécessité d'une rupture complète et soudaine avec le vieux système.
Nous avons répondu à ces arguments dans les Revue internationale n° 48 et 55 8, et rejeté l'accusation de Bordiga selon laquelle la notion de déclin du capitalisme ouvre la porte à une vision gradualiste et fataliste ; nous avons expliqué pourquoi de nouvelles sociétés ne naissent pas sans que les êtres humains aient fait une longue expérience de l'incompatibilité de l'ancien système avec leurs besoins. Mais dans le PCInt déjà, des voix s'élevaient contre la théorie de Bordiga. Tout le travail de la Fraction n'avait pas été perdu parmi les forces qui avaient constitué le PCInt. Face à la réalité de l'après-guerre – principalement marquée par un isolement croissant des révolutionnaires d'avec la classe et transformant inévitablement une organisation qui avait pu se prendre pour un parti en un petit groupe communiste – deux tendances principales surgirent, ce qui prépara le terrain de la scission de 1952. Le courant autour d'Onorato Damen, ancêtre de l'actuelle Tendance communiste internationaliste (TCI), conserva la notion de décadence du capitalisme – c'est ce courant qui constituait la cible principale de la polémique de Bordiga sur "la courbe descendante" – et cela lui permit de maintenir la clarté de la Fraction sur des questions clés telles que la caractérisation de la Russie comme une forme de capitalisme d'État, l'accord avec Rosa Luxemburg sur la question nationale et la compréhension de la nature capitaliste des syndicats (cette dernière position était défendue de façon particulièrement claire par Stefanini qui avait été l'un des premiers de la Fraction en exil à comprendre leur intégration dans l'État capitaliste).
Le numéro de l'été 2011 de Revolutionary Perspectives, journal de la Communist Workers' Organisation (groupe affilié à la TCI au Royaume-Uni), republie l'introduction de Damen à la correspondance que ce dernier avait échangée avec Bordiga à l'époque de la scission. Damen, se référant à la conception de Lénine d'un capitalisme moribond et au point de vue de Rosa Luxemburg sur l'impérialisme en tant que processus précipitant l'effondrement du capitalisme, rejette la polémique de Bordiga contre la théorie de la courbe descendante : "Il est vrai que l'impérialisme accroît énormément et fournit les moyens de prolonger la vie du capital mais, en même temps, il constitue le moyen le plus sûr de l'abréger. Ce schéma d'une courbe toujours ascendante non seulement ne montre pas cela mais, dans un certain sens, le nie." (Traduit de l'anglais par nous)
De plus, comme Damen le souligne, la vision d'un capitalisme en ascendance perpétuelle en quelque sorte permet à Bordiga de laisser des ambiguïtés sur la nature et le rôle de l'URSS : "Face à l'alternative de rester ce que nous avons toujours été, ou de pencher vers une attitude d'aversion platonique et intellectualiste vis-à-vis du capitalisme américain et de bienveillante neutralité envers le capitalisme russe simplement du fait qu'il n'est pas encore mûr du point de vue capitaliste, nous n'hésitons pas à réaffirmer la position classique que les communistes internationalistes ont défendue envers tous les protagonistes du second conflit impérialiste et qui n'est pas d'espérer la victoire de l'un ou l'autre des adversaires mais de chercher une solution révolutionnaire à la crise capitaliste."
A cela, nous pourrions ajouter que cette idée selon laquelle les parties les moins développées de l'économie mondiale pourraient contenir une forme de "jeunesse" du capitalisme et donc un caractère progressiste a amené le courant bordiguiste à une dilution encore plus explicite des principes internationalistes avec son soutien au mouvement des "peuples de couleur" dans les anciennes colonies.
C'est une marque du repliement de la Gauche italienne dans les confins de l'Italie après la guerre que la plus grande partie du débat entre les deux tendances au sein du PCInt soit longtemps restée inaccessible au monde qui ne parlait pas italien. Mais il nous semble que, tandis que le courant de Damen était de façon générale bien plus clair sur les positions de classe fondamentales, aucun des deux courants n'avait le monopole de la clarté. Bordiga, Maffi et d'autres avaient raison dans leur intuition que la période qui s'ouvrait, encore caractérisée par le triomphe de la contre-révolution, signifiait inévitablement que les tâches théoriques seraient prioritaires sur un travail de large agitation. La tendance de Damen, en revanche, comprenait encore moins qu'un véritable parti de classe, capable de développer une présence effective au sein de la classe ouvrière, n'était tout simplement pas à l'ordre du jour dans cette période. En ce sens, la tendance de Damen perdit complètement de vue les clarifications cruciales de la Fraction italienne, précisément sur la question de la Fraction en tant que pont entre l'ancien parti dégénéré et le nouveau parti rendu possible par le renouveau de la lutte de classe. En fait, sans véritable élaboration, Damen établit un lien injustifié entre le schéma de Bordiga d'une courbe toujours ascendante – schéma indiscutablement faux - et la théorie de "l'inutilité de créer un parti dans une période contre-révolutionnaire" qui, de notre point de vue, était essentiellement valide. Contre cette idée, Damen propose la suivante : "la naissance du parti ne dépend pas, et nous sommes d'accord là-dessus, ‘du génie ou de la valeur d'un leader ou d'une avant-garde’, mais c'est l'existence historique du prolétariat en tant que classe qui pose, non pas de façon simplement épisodique dans le temps et l'espace, la nécessité de l'existence de son parti."
On pourrait également dire que le prolétariat a en permanence "besoin" de la révolution communiste : à un niveau c'est vrai, mais cela ne nous amène nulle part pour comprendre si le rapport de forces entre les classes fait de la révolution quelque chose de tangible, à sa portée, ou si c'est une perspective pour un futur plus lointain. De plus, si nous mettons en relation ce problème général avec les spécificités de l'époque de déclin du capitalisme, la logique de Damen apparaît encore plus boiteuse : les conditions réelles de la classe ouvrière dans la période de décadence, en particulier l’absorption de ses organisations de masse permanentes dans les mâchoires du capitalisme d'État, ont clairement rendu non pas moins mais plus difficile pour le parti de classe de se maintenir en dehors des phases d'intenses surgissements prolétariens.
La contribution de la Gauche communiste de France
La GCF, bien que formellement exclue de la branche italienne de la Gauche communiste, fut bien plus fidèle à la conception développée par l'ancienne Fraction italienne sur le rôle de la minorité révolutionnaire dans une période de défaite et de contre-révolution. C'est aussi le groupe qui fit les avancées les plus importantes dans la compréhension des caractéristiques de la période de décadence. Il ne s'est pas contenté de répéter ce qui avait été compris dans les années 1930 mais avait pour but d'arriver à une synthèse plus profonde : ses débats avec la Gauche hollandaise lui permirent de surmonter certaines erreurs de la Gauche italienne sur le rôle du parti dans la révolution et affinèrent sa compréhension de la nature capitaliste des syndicats. Et ses réflexions sur l'organisation du capitalisme dans la période de décadence lui permirent de développer une vision plus claire des profonds changements dans le rôle de la guerre et dans l'organisation de la vie économique et sociale qui marquaient cette période. Ces avancées furent résumées avec une clarté particulière dans deux textes clés : le "Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945 de la GCF 9 et "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" publié dans Internationalisme n°46 en 1952. 10
Le rapport de 1945 était centré sur la façon dont la fonction de la guerre capitaliste avait changé entre la période d'ascendance et celle de décadence. La guerre impérialiste constituait l'expression la plus concentrée du déclin du système :
"Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre - période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent." ("Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945)
En réponse à ceux qui défendaient que le caractère destructeur de la guerre ne constituait qu'une continuation du cycle classique de l'accumulation capitaliste et était donc un phénomène totalement "rationnel", la GCF mettait en avant le caractère profondément irrationnel de la guerre impérialiste – pas seulement du point de vue de l'humanité mais même de celui du capital lui-même :
"La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'État capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres États impérialistes. (…) La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité" (Idem)
Ainsi, la GCF considérait la guerre impérialiste comme une expression de la tendance du capitalisme sénile à s'autodétruire. On pourrait dire la même chose du mode d'organisation devenu dominant dans la nouvelle époque : le capitalisme d'État.
Dans "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", la GCF analysait le rôle de l'État dans la survie du système dans la période de décadence ; là encore, la distorsion de ses propres lois par le capitalisme est typique de l'agonie qui mène à son effondrement :
"Devant l'impossibilité de s'ouvrir de nouveaux marchés, chaque pays se ferme et tend désormais à vivre sur lui-même. L'universalisation de l'économie capitaliste, atteinte au travers du marché mondial, se rompt : c'est l'autarcie. Chaque pays tente de se suffire à lui-même ; on y crée un secteur non rentable de production, lequel a pour objet de pallier aux conséquences de la rupture du marché. Ce palliatif même aggrave encore la dislocation du marché mondial.
La rentabilité, par la médiation du marché, constituait avant 1914 l'étalon, mesure et stimulant, de la production capitaliste. La période actuelle enfreint cette loi de la rentabilité : celle-ci s'effectue désormais non plus au niveau de l'entreprise mais à celui, global, de l'État. La péréquation se fait sur un plan comptable, à l'échelle nationale ; non plus par l'entremise du marché mondial. Ou bien, l'État subventionne la partie déficitaire de l'économie, ou bien l'État prend en mains l'ensemble de l'économie.
De ce qui précède, on ne peut conclure à une "négation" de la loi de la valeur. Ce à quoi nous assistons tient en ce que la production d'une unité de la production semble détachée de la loi de la valeur cette production s'effectuant sans considération apparente de sa rentabilité.
Le surprofit monopolistique se réalisait au travers de prix "artificiels", cependant sur le plan global de la production, celle-ci demeurait liée à la loi de la valeur. La somme des prix, pour l'ensemble des produits, n'exprimait rien d'autre que la globale valeur des produits. Seule la répartition des profits entre divers groupes capitalistes se trouvait transformée : les monopoles s'arrogeaient un surprofit aux dépens des capitalistes moins bien armés. De même peut-on dire que la loi de la valeur joue au niveau de la production nationale. La loi de la valeur n'agit plus sur un produit pris individuellement, mais sur l'ensemble des produits. On assiste à une restriction du champ d'application de la loi de la valeur. La masse totale du profit tend à diminuer du fait de la charge que fait peser l'entretien des branches déficitaires sur les autres branches de l'économie."
Nous avons dit que personne ne détenait le monopole de la clarté dans les débats au sein du PCInt ; on peut dire la même chose de la GCF. Face à la sombre situation du mouvement ouvrier au lendemain de la guerre, elle allait jusqu'à conclure non seulement que les anciennes institutions du mouvement ouvrier, partis et syndicats, étaient irréversiblement intégrées dans le Léviathan de l'État capitaliste, mais aussi que la lutte défensive elle-même avait perdu son caractère de classe :
"Les luttes économiques des ouvriers ne peuvent plus amener que des échecs - au mieux le maintien habile de conditions de vie d'ores et déjà dégradées. Elles lient le prolétariat aux exploiteurs en l'amenant à se considérer solidaire du système en échange d'une assiette de soupe supplémentaire (et qu'il n'obtiendra, en fin de compte, qu'en améliorant sa "productivité")." (L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective)
Il est certainement juste que les luttes économiques ne pouvaient permettre aucun acquis durable dans la nouvelle période mais l'idée qu'elles ne servent qu'à attacher le prolétariat à ses exploiteurs n'était pas correcte : au contraire, elles continuaient de constituer une précondition indispensable pour briser cette "solidarité avec le système".
La GCF ne voyait pas non plus de possibilité que le capitalisme puisse connaître une reprise quelconque après la guerre. D'un côté, elle pensait qu'il y avait un manque absolu de marchés extra-capitalistes permettant un véritable cycle de reproduction élargie. Dans sa polémique légitime contre l'idée de Trotski qui voyait dans les mouvements nationalistes des colonies ou des anciennes colonies une possibilité de saper le système impérialiste mondial, elle défendait :
"En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés, ce qui rend moins énergique la résistance des vieux impérialismes aux revendications des bourgeoisies coloniales. A ceci s'ajoute le fait que les difficultés propres à ces impérialismes ont favorisé l'expansion économique - au cours des deux guerres mondiales - des colonies. Le capital constant s'amenuisait en Europe, tandis que la capacité de production des colonies ou semi-colonies augmentait, amenant une explosion du nationalisme indigène (Afrique du Sud, Argentine, Inde, etc...). Il est significatif de constater que ces nouveaux pays capitalistes passent, dès leur création, en tant que nations indépendantes, au stade de capitalisme d'État présentant ces mêmes aspects d'une économie tournée vers la guerre que l'on décèle par ailleurs.
La théorie de Lénine et de Trotski s'effondre. Les colonies s'intègrent au monde capitaliste et, par là même, le renforcent d'autant. Il n'y a plus de "maillon le plus faible : la domination du capital est également répartie sur la surface entière du globe."
Il est vrai que la guerre avait permis à certaines colonies situées en dehors du terrain principal du conflit de se développer dans un sens capitaliste et que, globalement, les marchés extra-capitalistes étaient devenus de plus en plus inadéquats pour fournir un débouché à la production capitaliste. Mais il était prématuré d'annoncer leur disparition totale. En particulier, l'éviction des vieilles puissances comme la France et la Grande-Bretagne de leurs anciennes colonies, avec leurs rapports en grande partie parasitaires vis-à-vis de leurs empires, a permis au grand vainqueur de la guerre – les États-Unis - de trouver de nouveaux champs lucratifs d'expansion, en particulier en Extrême-Orient 11. A la même époque, il existe des marchés extra-capitalistes non encore épuisés dans certains pays européens (en France notamment) constitués en grande partie par ce secteur de la petite paysannerie qui n'a pas encore été intégré dans les rouages de l'économie capitaliste.
La survivance de certains marchés solvables extérieurs à l'économie capitaliste a constitué l'un des facteurs qui a permis au capitalisme de se ranimer après la guerre pendant une période d'une longueur inattendue. Mais c'était beaucoup lié à la réorganisation politique et économique plus générale du système capitaliste. Dans le rapport de 1945, la GCF avait reconnu que, bien que le bilan global de la guerre fût catastrophique, certaines puissances impérialistes pouvaient quand même se renforcer grâce à leur victoire dans la guerre. En fait, les États-Unis en étaient sortis dans une position de force sans précédent qui leur a permis de financer la reconstruction des puissances européennes et japonaise ravagées par la guerre, évidemment pour leurs propres intérêts impérialistes et économiques. Et les mécanismes utilisés pour revivifier et étendre la production au cours de cette phase furent précisément ceux que la GCF avait identifiés : le capitalisme d'État, en particulier sous sa forme keynésienne, qui a permis une certaine "harmonisation" forcée entre la production et la consommation, non seulement au niveau national mais, également, international, à travers la formation d'énormes blocs impérialistes ; et, allant de pair, une véritable déformation de la loi de la valeur, sous la forme de prêts massifs et même de "cadeaux" tout court de la part des États-Unis triomphants envers les puissances vaincues et ruinées, ce qui a permis à la production de reprendre et de croître non sans que commence à s’accroître, de façon irréversible, une dette qui ne pourra jamais être remboursée, à la différence du développement du capitalisme ascendant.
Ainsi en se rechapant à l'échelle globale, le capitalisme a connu, pour la première fois depuis la "Belle Époque" au début du 20e siècle, une période de boom. Ce n'était pas encore visible en 1952 quand dominait encore l'austérité d'après-guerre. Ayant analysé avec justesse qu'il n'y avait pas eu de revitalisation du prolétariat après la guerre, la GCF conclut de façon erronée qu'une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour pour bientôt. Cette erreur participa à accélérer la disparition du groupe qui se dissout en 1952 – l'année où avait lieu la scission dans le PCInt. Ces deux événements confirmaient que le mouvement ouvrier vivait encore dans l'ombre de la profonde réaction qui avait suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23.
"Le grand boom keynésien"
Au milieu des années 1950, quand la phase d'austérité absolue tirait à sa fin dans les pays capitalistes centraux, il devenait clair que le capitalisme connaissait un boom sans précédent. En France, cette période est connue sous le nom des "Trente Glorieuses" ; d'autres l'appellent "le grand boom keynésien". La première expression est évidemment plutôt inexacte. On peut certainement douter du fait qu'elle ait duré trente ans 12, et elle fut moins que glorieuse pour une partie très importante de la population globale. Néanmoins, elle connut des taux de croissance très rapides dans les pays occidentaux, et même dans ceux de l'Est, bien plus léthargiques et économiquement arriérés, il y eut une poussée de développement technologique qui suscita des discussions sur la capacité de la Russie de "rattraper" l'Ouest comme le suggéraient de façon frappante les succès russes initiaux dans la course à l'espace. Le "développement" de l'URSS était toujours basé sur l'économie de guerre, comme dans les années 1930. Mais bien que le secteur d'armement continuât à peser lourdement à l'Ouest, les salaires réels des ouvriers des principaux pays industrialisés augmentèrent de façon importante (en particulier relativement aux conditions très dures qui avaient prévalu durant la période de reconstruction de l'économie) et le "consumérisme" de masse devint un élément de la vie de la classe ouvrière, combiné à des programmes sociaux importants (santé, vacances, paiement des congés maladie) et un taux de chômage très bas. C'est ce qui permit au Premier ministre conservateur britannique, Harold Macmillan, de proclamer de façon paternaliste que "la plus grande partie de notre population n'a jamais vécu aussi bien" (discours à Bedford, juillet 1957).
Un économiste universitaire résume ainsi le développement économique au cours de cette période :
"Rien qu'un bref coup d'œil aux chiffres et aux taux de croissance révèle que la croissance et la reprise après la Deuxième Guerre mondiale furent étonnamment rapides. Si l'on considère les trois plus importantes économies d'Europe occidentale – la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne – la Deuxième Guerre mondiale leur a infligé bien plus de dommages et de destructions que la Première. Et (sauf pour la France) les pertes humaines ont été également plus grandes pendant la Deuxième. A la fin de la guerre, 24% des Allemands nés en 1924 étaient morts ou disparus, 31% handicapés ; après la guerre, il y avait 26% de plus de femmes que d'hommes. En 1946, l'année qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le PNB par tête dans les trois plus grandes économies européennes avait chuté d'un quart par rapport au niveau d'avant-guerre de 1938. C'était équivalent à la moitié de la chute de la production par tête en 1919 par rapport au niveau d'avant-guerre en 1913."
Pourtant le rythme de la reprise d'après la Deuxième Guerre surpassa rapidement celui d'après la Première. En 1949, le PNB moyen par tête dans les trois grands pays avait quasiment retrouvé son niveau d'avant-guerre et, comparativement, la reprise avait deux ans d'avance sur le rythme d'après la Première Guerre. En 1951, six ans après la guerre, le PNB par tête était supérieur de plus de 10% à celui d'avant-guerre, un niveau de reprise qui ne fut jamais atteint au cours des onze années d'après la Première Guerre, avant que ne commence la Grande Dépression. Ce qui fut accompli en six ans après la Deuxième Guerre, avait pris seize ans après la Première.
La restauration de la stabilité financière et le libre jeu des forces du marché permirent à l'économie européenne de connaître deux décennies d'une croissance rapide jamais vue. La croissance économique européenne entre 1953 et 1973 fut deux fois plus rapide que tout ce qu'on avait connu jusqu'alors et qu'on a connu depuis pour une telle période. Le taux de croissance du PNB était de 2% par an entre 1870 et 1913, de 2,5% par an entre 1922 et 1937. Comparativement, la croissance s'accéléra incroyablement jusqu'à 4,8% par an entre 1953 et 1973, avant de ralentir à la moitié de ce taux de 1973 à 1979." (Traduit de l'anglais par nous.13)
Socialisme ou Barbarie : théoriser le boom
Sous le poids de cette avalanche de faits, la vision marxiste du capitalisme comme système sujet aux crises et entré dans sa période de déclin depuis quasiment un demi-siècle s'est trouvé mise en cause sur tous les fronts. Et étant donné l'absence de mouvements de classe généralisés (avec quelques exceptions notables comme les luttes massives dans le bloc de l'Est en 1953 et en 1956), la sociologie officielle s'est mise à parler de "l'embourgeoisement" de la classe ouvrière, de la récupération du prolétariat par la "société de consommation" qui semblait avoir réglé les problèmes de gestion de l'économie. La mise en question des principes fondamentaux du marxisme affecta inévitablement des éléments qui se considéraient comme des révolutionnaires. Marcuse accepta l'idée que la classe ouvrière des pays avancés s'était plus ou moins intégrée au système et estima que le sujet révolutionnaire était désormais constitué par les minorités ethniques opprimées, les étudiants révoltés des pays avancés et les paysans du "Tiers-Monde". Mais l'élaboration la plus cohérente à l'encontre des catégories marxistes "traditionnelles" provint du groupe Socialisme ou Barbarie (S ou B) en France, un groupe dont les communistes de gauche de la GCF avaient salué la rupture avec le trotskisme officiel.
Dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne rédigé par le principal théoricien du groupe, Paul Cardan/Cornelius Castoriadis, celui-ci analyse les principaux pays capitalistes au milieu des années 1960 et conclut que le capitalisme "bureaucratique" "moderne" est parvenu à éliminer les crises économiques et peut donc poursuivre indéfiniment son expansion.
"Le capitalisme est parvenu à contrôler le niveau de l’activité économique à un degré tel que les fluctuations de la production et de la demande sont maintenues dans des limites étroites et que des dépressions de l’ordre de celles d’avant-guerre sont désormais exclues (…)
(…) il y a une intervention consciente continue de l'État en vue de maintenir l’expansion économique. Même si la politique de l'État capitaliste est incapable d’éviter à l’économie l’alternance de phases de récession et d’inflation, encore moins d’en assurer le développement rationnel optimum, elle a été obligée d’assumer la responsabilité du maintien d’un 'plein emploi' relatif et de l’élimination de dépressions majeures. La situation de 1933, qui correspondrait aujourd’hui aux États-Unis à un chômage de 30 millions, est absolument inconcevable, ou bien conduirait à l’explosion du système dans les vingt-quatre heures ; ni les ouvriers, ni les capitalistes ne la toléreraient plus longuement." 14
Ainsi, la vision du capitalisme de Marx comme un système sujet aux crises ne n'applique qu'au 19e siècle et non plus à notre époque. Il n'y a pas de contradictions économiques "objectives" et les crises économiques, si elles ont lieu, ne seront désormais essentiellement que des accidents (il existe une introduction datée de 1974 à ce livre qui décrit précisément la récession de cette période comme le produit de "l'accident" de l'augmentation des prix du pétrole 15). La tendance à l'effondrement comme résultat de contradictions économiques internes - en d'autres termes le déclin du système – ne constitue plus la base d'une révolution socialiste dont il faut chercher ailleurs les fondements. Cardan défend l'idée que, tandis que les convulsions économiques et la pauvreté matérielle peuvent être surmontées, ce dont le capitalisme bureaucratique ne peut se débarrasser, c'est l'augmentation de l'aliénation au travail et dans les loisirs, la privatisation croissante de la vie quotidienne 16 et, en particulier, la contradiction entre le besoin du système de traiter les ouvriers comme des objets stupides seulement capables d'obéir à des ordres et la nécessité d'un appareil technologique de plus en plus sophistiqué qui s'appuie sur l'initiative et l'intelligence des masses pour lui permettre de fonctionner.
Cette démarche reconnaissait que le système bureaucratique avait fondamentalement annexé les anciens partis ouvriers et les syndicats 17, augmentant le manque d'intérêt des masses pour la politique traditionnelle. Il critiquait férocement le vide de la vision du socialisme défendue par la "gauche traditionnelle" dont la défense d'une économie totalement nationalisée (additionnée d'un peu de contrôle ouvrier si l'on prend la version trotskiste) n'offrait tout simplement aux masses qu'un renforcement des conditions présentes. Contre ces institutions fossilisées et contre la bureaucratisation débilitante qui affectait toutes les habitudes et les organisations de la société capitaliste, S ou B défendait la nécessité de l'auto-activité des ouvriers à la fois dans la lutte quotidienne et comme seul moyen d'atteindre le socialisme. Comme ce dernier était présenté autour de la question essentielle de qui contrôle vraiment la production dans la société, il y avait là une base bien plus solide pour la création d'une société socialiste que la vision "objectiviste" des marxistes traditionnels qui attendaient la prochaine grande dégringolade pour entrer en scène et mener les ouvriers à la terre promise, non sur la base d'une véritable élévation de la conscience, mais simplement sur celle d'une sorte de réaction biologique à l'appauvrissement. Un tel schéma de la révolution, pour faire court, ne pourrait jamais mener à une véritable compréhension des rapports humains.
"Et quelle est l’origine des contradictions du capitalisme, de ses crises et de sa crise historique ? C’est l’"appropriation privée", autrement dit la propriété privée et le marché. C’est cela qui fait obstacle au "développement des forces productives", qui serait par ailleurs le seul, vrai et éternel objectif des sociétés humaines. La critique du capitalisme consiste finalement à dire qu’il ne développe pas assez vite les forces productives (ce qui revient à dire qu’il n’est pas assez capitaliste). Pour réaliser ce développement plus rapide, il faudrait et il suffirait que la propriété privée et le marché soient éliminés : nationalisation des moyens de production et planification offriraient alors la solution à la crise de la société contemporaine.
Cela d’ailleurs les ouvriers ne le savent pas et ne peuvent pas le savoir. Leur situation leur fait subir les conséquences des contradictions du capitalisme, elle ne les conduit nullement à en pénétrer les causes. La connaissance de celles-ci ne résulte pas de l’expérience de la production, mais du savoir théorique portant sur le fonctionnement de l’économie capitaliste, savoir accessible certes à des ouvriers individuels, mais non pas au prolétariat en tant que prolétariat. Poussé par sa révolte contre la misère, mais incapable de se diriger lui-même puisque son expérience ne lui donne aucun point de vue privilégié sur la réalité ; le prolétariat ne peut être, dans cette optique, que l’infanterie au service d’un état-major de spécialistes, qui eux, savent, à partir d’autres considérations auxquelles le prolétariat comme tel n’a pas accès, ce qui ne va pas avec la société actuelle et comment il faut la modifier. La conception traditionnelle sur l’économie et la perspective révolutionnaire ne peut fonder, et n’a fondé effectivement dans l’histoire, qu’une politique bureaucratique.
Certes Marx lui-même n’a pas tiré ces conséquences de sa théorie économique ; ses positions politiques sont allées, la plupart du temps, dans un sens diamétralement opposé. Mais ce sont ces conséquences qui en découlent objectivement, et ce sont elles qui ont été affirmées de façon de plus en plus nette dans le mouvement historique effectif, aboutissant finalement au stalinisme. La vue objectiviste de l’économie et de l’histoire ne peut être que la source d’une politique bureaucratique, c’est-à-dire d’une politique qui, sauvegardant l’essence du capitalisme, essaye d’en améliorer le fonctionnement." 18
Dans ce texte, il est clair que Cardan ne cherche pas à distinguer la "gauche traditionnelle" – c'est-à-dire l'aile gauche du capital – des authentiques courants marxistes qui survécurent à la récupération par le capitalisme des anciens partis et qui défendirent vigoureusement l'auto-activité de la classe ouvrière malgré leur adhésion à la critique par Marx de l'économie politique. Ces derniers (malgré les discussions d'après-guerre entre S ou B et la GCF) ne sont presque jamais mentionnés ; mais, plus centralement, malgré la continuation de l'attachement à Marx contenu dans ce passage, Cardan ne cherche pas à expliquer pourquoi Marx ne tira pas de conclusions "bureaucratiques" de son économie "objectiviste", pas plus qu'il ne cherche à mettre en lumière le gouffre qui sépare la conception du socialisme de Marx de celle des staliniens et des trotskistes. En fait, ailleurs, dans le même texte, il accuse la méthode de Marx d'objectivisme, d'ériger d'implacables lois économiques vis-à-vis desquelles les êtres humains ne peuvent rien, de tomber dans la même réification de la force de travail qu'il critiquait lui-même. Et malgré son approbation ici et là des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, Cardan n'accepte jamais le fait que la critique de l'aliénation est à la base de l'ensemble de l'œuvre de Marx qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre la réduction de la puissance créatrice de l'homme à une marchandise mais qui, en même temps, reconnaît cette généralisation des rapports marchands comme la base "objective" du déclin ultime du système. De même, malgré une reconnaissance du fait que Marx a vu un aspect "subjectif" à la détermination de la valeur de la force de travail, cela n'empêche pas Cardan de tirer la conclusion que "Marx, qui a découvert la lutte des classes, écrit un ouvrage monumental analysant le développement du capitalisme, ouvrage d’où la lutte des classes est totalement absente." (Cardan, Ibid.)
De plus, les contradictions économiques que Cardan écarte sont présentées de façon très superficielle. Cardan s'aligne sur l'école néo-harmoniste (Otto Bauer, Tugan-Baranovski, etc.) qui tenta d'appliquer les schémas de Marx dans le 2e livre du Capital pour prouver que le capitalisme pouvait poursuivre l'accumulation sans crises : pour Cardan, le capitalisme régulé de la période d'après-guerre avait finalement apporté l'équilibre nécessaire entre la production et la consommation, éliminant le problème du "marché" pour toujours. C'est vraiment une simple resucée du keynésianisme, et les limites inhérentes à la réalisation d'un "équilibre" entre la production et le marché allaient se révéler très rapidement. Il expédie la baisse du taux de profit brièvement dans un appendice. L'aspect le plus parlant de cette partie est quand il écrit :
"L'argument dans son ensemble est de plus hors de propos : c'est une diversion. Nous ne l'avons discuté que parce que c'est devenu une obsession dans les esprits de beaucoup de révolutionnaires honnêtes, qui ne peuvent pas se défaire des chaînes de la théorie traditionnelle. Quelle différence cela fait-il pour le capitalisme dans son ensemble que les profits soient aujourd'hui disons de 12 % en moyenne, alors qu'ils étaient de 15 % il y a un siècle ? Cela ralentirait-il l'accumulation et ainsi l'expansion de production capitaliste comme parfois dit dans ces discussions ? Et même en supposant que ce soit le cas : ET ALORS ? Quand et de combien ? […] Et même si cette "loi" était juste, pourquoi cesserait-elle de l'être sous le socialisme ?
Le seul "fondement" de cette "loi" chez Marx est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le capitalisme lui-même ; c'est le fait technique qu'il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'hommes [les actionnant, NDLR]. Sous le socialisme, les choses seraient "encore pires". Le progrès technique serait accéléré et, ce qui, dans le raisonnement de Marx, s'oppose à la baisse du taux de profit sous le capitalisme, à savoir l'augmentation du taux d'exploitation, n'aurait pas d'équivalent sous le socialisme. Une économie socialiste connaitrait-elle un blocage à cause d'une pénurie de capital à accumuler ?" 19
Ainsi, pour Cardan, une contradiction fondamentale enracinée dans la production de valeur elle-même n'a pas d'importance parce que le capitalisme traverse une période d'accumulation accélérée. Pire : il y aura toujours (pourquoi pas ?) production de valeur dans le socialisme puisque la production de marchandises en elle-même n'amène pas inéluctablement à la crise et à l'effondrement. En fait, l'utilisation des catégories capitalistes de base comme la valeur et la monnaie pourrait même s'avérer une façon rationnelle de distribuer le produit social, comme Cardan l'explique dans la brochure Sur le contenu du socialisme (publiée à l'été 1957 dans Socialisme ou Barbarie n° 22).
Cette superficialité a empêché Cardan de saisir la nature contingente et temporaire du boom d'après-guerre. 1973 n'était pas un accident et n'a pas eu pour première cause l'augmentation des prix du pétrole, c'était la réapparition manifeste des contradictions fondamentales du capitalisme que la bourgeoisie avait tant cherché à nier et qu'elle avait tenté de conjurer au cours des 40 dernières années, avec plus ou moins d'effet. Aujourd'hui plus que jamais, la prédiction de Cardan qu'une nouvelle dépression était impensable semble ridiculement obsolète. Ce n'est pas surprenant que S ou B et son successeur en Grande-Bretagne, Solidarity, aient disparu entre les années 1960 et 90, lorsque la réalité de la crise économique s'est révélée de plus en plus sévère à la classe ouvrière et à ses minorités politiques. Cependant, beaucoup des idées de Cardan – comme son rejet du "marxisme classique" comme étant "objectiviste" et niant la dimension subjective de la lutte révolutionnaire – se sont avérées remarquablement persistantes, comme nous le verrons dans un autre article.
Gerrard
1 "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [248]", Revue internationale n° 132,
2 https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties [249]
3 Voir "La lutte de classe contre la guerre impérialiste : les luttes ouvrières en Italie 1943 [250]", Revue internationale n° 75,
4 Voir notre livre La Gauche communiste d'Italie pour plus de détails sur la façon dont s'est formé le PCInt. Pour les critiques portées par la GCF à la plateforme du parti, lire "Le Deuxième Congrès du PCInt en Italie [251]" dans Internationalisme n° 36, juillet 1948, republié dans la Revue internationale n°36.
5 "L'invariance" bordiguiste, comme nous l'avons souvent montré, est en réalité très variable. Ainsi, tout en insistant sur la nature intégrale du programme communiste depuis 1848 et donc la possibilité du communisme depuis cette époque, Bordiga, par loyauté aux congrès de fondation de l'IC, était également obligé d'admettre que la guerre avait marqué l'ouverture d'une crise historique générale du système. Comme Bordiga l'a écrit lui-même dans les "Thèses caractéristiques du parti" en 1951 : "Les guerres impérialistes mondiales démontrent que la crise de désagrégation du capitalisme est inévitable du fait que celui-ci est entré définitivement dans la période où son expansion n'exalte plus historiquement l'accroissement des forces productives, mais lie leur accumulation à des destructions répétées et croissantes." https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vami/vamimfebif.html [252]. Nous avons écrit plus longuement sur l'ambiguïté des bordiguistes concernant le problème du déclin du capitalisme dans la Revue internationale n° 77, 1994 :"Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre - Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste ", https://fr.internationalism.org/rinte77/decad.htm [253]
6 https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm [254]
7 "Dialogue avec les morts", 1956.
8 "Comprendre la décadence du capitalisme" (1 et 5) , https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [255] et https://fr.internationalism.org/french/rinte55/decad.htm [256]
9 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59, au sein de l'article "Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2 [257]e [257] guerre mondiale [257]".
10 Republié [258] dans la Revue internationale n° 21.
11 Dans ses articles "Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant", publiés en 1934 dans les numéros 10 et 11 de Bilan (republiés dans les numéros 102 [259] et 103 [260] de la Revue internationale), que nous avons examinés dans le précédent article de cette série, Mitchell avait affirmé que les marchés asiatiques constitueraient l'un des enjeux de la guerre à venir. Il n'a pas développé cette affirmation, mais cela vaudrait la peine de se pencher sur cette question, étant donné que, dans les années 1930, l'Asie et l'Extrême-Orient en particulier constituaient une région du globe où subsistaient des vestiges considérables des civilisations pré-capitalistes, et étant donné l'importance de la capitalisation de cette région pour le développement du capitalisme au cours des dernières décennies.
12 La fin des années 1940 fut une période d'austérité et de privations dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas avant le milieu des années 1950 que la "prospérité" commença à se faire sentir dans des parties de la classe ouvrière et les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique apparurent vers 1966-67, devenant évidente au niveau global au début des années 1970.
13 Slouching Towards Utopia? The Economic History of the Twentieth Century – chapitre XX "The Great Keynesian Boom : 'Thirty Glorious Years' ", J.Bradford DeLong, Université de Californie, Berkeley et NBER, février 1997
14 Cornelius Castoriadis. Brochure n°10. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne [261]. Chap. I : "Quelques traits importants du capitalisme contemporain".
15 Cette introduction à la réédition anglaise de 1974 est disponible dans la brochure n° 9.
16 Les situationnistes, dont la vision de l' "économie" était très influencée par Cardan, sont allés bien plus loin dans la critique de la stérilité de la culture capitaliste moderne et de la vie quotidienne.
17 La critique des syndicats est cependant limitée : le groupe avait beaucoup d'illusions sur le système des shop-stewards britanniques qui en réalité avait fait depuis longtemps la paix avec la structure syndicale officielle.
18 Cornelius Castoriadis, op. cit., Chap. II : "La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel"
19 Ibid. Notre traduction à partir de la version anglaise de l'ouvrage mentionné de Castoriadis, Modern Capitalism and Revolution ; Appendix – The “Falling Rate of Profit” ; https://libcom.org/library/modern-capitalism-revolution-paul-cardan [262].
Rubrique:
Revue Internationale 2012 - n° 148 - 150
- 2051 lectures
Revue Internationale n° 148 - 1er trimestre 2012
- 1463 lectures
La crise économique n'est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d'un système et la lutte pour un autre monde
- 2172 lectures
Depuis 2008, il ne se passe pas une semaine sans qu’un pays n'annonce un nouveau plan d’austérité draconien. Baisse des pensions de retraite, hausse des impôts et des taxes, gel des salaires… rien ni personne ne peut y échapper. L’ensemble de la classe ouvrière mondiale est en train de plonger dans la précarité et la misère. Le capitalisme est frappé par la crise économique la plus aiguë de toute son histoire. Le processus actuel, laissé à sa seule logique, mènera inexorablement à l’effondrement de toute la société capitaliste. C’est ce que montre dès aujourd’hui l’impasse totale dans laquelle se trouve la bourgeoisie. Toutes ses mesures se révèlent vaines et stériles. Pire ! De manière immédiate, elles aggravent même la situation. Cette classe d'exploiteurs n’a plus la moindre solution pérenne, même à moyen terme. La crise n'est pas "arrêtée" à son niveau de 2008, elle continue de s'aggraver. Face à cela, l'impuissance de la bourgeoisie entraîne aujourd'hui des tensions, voire des déchirements, en son sein. D'économique, la crise tend à devenir aussi politique.
Ces derniers mois, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux États-Unis… les gouvernements sont devenus de plus en plus instables ou incapables d'imposer leur politique alors que des divisions de plus en plus fortes se développent entre les différentes fractions de la bourgeoisie nationale. Les différentes fractions nationales de la bourgeoisie mondiale sont également souvent divisées entre elles quant aux politiques anti-crises à mettre en place. Il en résulte parfois que c'est avec retard que sont prises des mesures qui auraient dû l'être des mois auparavant, comme on l'a vu dans la zone euro avec le "plan de sauvetage de la Grèce". Quant aux politiques anti-crises actuelles, de même que celles les ayant précédées, elles ne peuvent que refléter l'irrationalité croissante du système capitaliste. Crise économique et crise politique frappent dorénavant simultanément à la porte de l’histoire.
Cependant, cette crise politique majeure de la bourgeoisie ne saurait réjouir les exploités. Face au danger de la lutte de classe, c’est une unité de fer que rencontrera le prolétariat en lutte, l’union sacrée de la bourgeoisie mondiale. Aussi difficile que soit la tâche qui attend le prolétariat, celui-ci possède en lui la force de détruire ce monde agonisant et de construire une société nouvelle. C’est ce but à atteindre que tous les exploités du monde doivent, par la généralisation de leurs luttes, s’approprier collectivement.
Pourquoi la bourgeoisie ne trouve-t-elle aucune solution à la crise ?
En 2008 et 2009, malgré la gravité de la situation économique mondiale, la bourgeoisie a poussé un "ouf !" de soulagement dès que la situation a paru cesser de se dégrader. En effet, à l'en croire, la crise n'était que passagère. La classe dominante et ses spécialistes serviles clamaient dans toutes les langues qu’ils avaient la situation bien en main, que tout était "sous contrôle". Le monde n'était confronté qu'à un ajustement de l’économie, une petite purge chargée d’éliminer les excès des dernières années. Mais la réalité se moque totalement des discours mensongers de la bourgeoisie. Le dernier trimestre 2011 a été rythmé par des sommets internationaux qualifiés, les uns après les autres, de "réunion de la dernière chance" pour tenter de sauver la zone euro de l’éclatement. Les médias conscients de ce danger vital ne parlent plus que de ça, de la "crise de la dette". Tous les jours les journaux et toutes les télévisions y vont de leurs analyses, toutes aussi contradictoires les unes que les autres. La panique est là qui affleure sous tous les discours. On en oublierait presque que la crise continue à se développer en dehors de la zone euro : États-Unis, Grande-Bretagne, Chine etc. Le capitalisme mondial est confronté à un problème qu’il ne peut ni dépasser ni résoudre. Celui-ci peut se représenter sous l’image d’un mur devenu infranchissable : le "mur de la dette".
Pour le capitalisme, ce qui lui est fatal aujourd’hui, c’est sa dette brute. Il est vrai qu’une dette à un endroit du monde correspond à une créance ailleurs d’un même montant, si bien que certains affirment que l'endettement mondial est nul. Il s'agit là d'une pure illusion, une entourloupe comptable, d'un jeu d’écriture sur un morceau de papier. Dans le monde réel, toutes les banques sont par exemple en situation quasi permanente de faillite. Pourtant leur bilan est "équilibré", comme elles aiment à le dire. Mais que valent réellement leurs actifs de dettes grecque, italienne ou ceux représentant des prêts immobiliers espagnols ou américains ? La réponse est claire et nette : presque plus rien ! Leurs tiroirs sont vides, restent alors… les dettes et rien que les dettes.
Mais pourquoi en ce début 2012, le capitalisme est-il confronté à un tel problème ? D’où vient cet océan d’argent emprunté et qui, depuis longtemps déjà, est totalement déconnecté de la richesse réelle de la société ? La dette puise sa source dans le crédit. Ce sont des prêts consentis par les banques centrales ou les banques privées aux États et à tous les agents économiques de la société. Ces prêts deviennent des entraves pour le capital lorsqu’ils ne peuvent plus être remboursés, lorsqu’il est nécessaire de créer de nouvelles dettes pour payer les intérêts en cours sur les dettes anciennes ou tenter d’en rembourser ne serait-ce qu’une partie.
Quel que soit l’organisme qui émet de la monnaie, banques centrales ou banques privées, il est vital, du point de vue du capital global, que soient produites suffisamment de marchandises vendues avec profit sur le marché mondial. C’est la condition même de la survie du capital. Depuis maintenant plus de quarante ans, tel n’est plus le cas. Pour que soit vendu l’ensemble des marchandises produites, c'est de l'argent qui doit être emprunté pour, à la fois, payer les marchandises en question sur le marché, rembourser les dettes déjà contractées et payer les intérêts existants qui s’accumulent au cours du temps. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de contracter de nouvelles dettes. Il arrive alors un moment où la dette globale des particuliers, banques et États ne peut plus être honorée, ni même, dans plus en plus de cas, le seul service de la dette. Sonne alors l’heure de la crise générale de la dette. C'est le moment où l’endettement et la création toujours plus importante d’argent fictif par le capitalisme sont devenus le poison par lequel tout l’organisme du capital se contamine mortellement.
Quelle est la réelle gravité de la situation économique mondiale ?
Ce début d’année 2012 voit l’économie mondiale retomber en récession. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, en plus graves, en plus dramatiques. Au début de l’année 2008, le système financier a manqué s’effondrer. Les nouveaux crédits octroyés par les banques à l’économie se sont raréfiés et l’économie est entrée en récession. Depuis lors, les banques centrales américaines, britanniques et japonaises, entre autres, ont injecté des milliers de milliards de dollars. Le capitalisme a pu ainsi acheter du temps et relancer un minimum l’économie tout en empêchant les banques et les assurances de s’effondrer. Comment a-t-il procédé ? La réponse est maintenant connue. Les États se sont surendettés auprès des banques centrales et des marchés en reprenant à leur compte une petite partie des dettes des banques. Mais rien n’y a fait !
En ce début d’année 2012, l’impasse dans laquelle se trouve le capital global s'illustre, entre autres, par les 485 milliards d'euros que vient d’octroyer la BCE afin de sauver les banques de la zone d’une faillite immédiate. La BCE a prêté de l’argent, par l’entremise des banques centrales des pays de la zone, en échange d’actifs pourris. Actifs qui sont des morceaux de dettes des États de cette zone. Les banques doivent alors à leur tour acheter de nouvelles dettes d’État pour que ceux-ci ne s’effondrent pas. Chacun soutient l'autre, chacun achète la dette de l’autre avec de l’argent créé de toutes pièces à cet effet. Si bien que si l’un tombe, l’autre tombe.
Tout comme en 2008, mais de manière encore plus drastique, le crédit ne va plus à l’économie réelle. Chacun se protège et garde ou sécurise son argent pour tenter de ne pas tomber. En ce début d’année, au niveau de l’économie privée, les investissements des entreprises se font rares. La population paupérisée se serre la ceinture. La dépression économique est de nouveau là. La zone euro, comme les États-Unis, sont sur un rythme de croissance qui s’approche de zéro. Le fait que les États-Unis aient connu, en cette fin 2011, une activité en léger mieux par rapport au reste de l’année ne saurait changer durablement cette tendance générale qui, à terme, finira par s’imposer. A plus court terme, selon le FMI, la croissance pourrait se situer en 2012 pour ce pays, entre 1,8% et 2,4%. Là encore, "si tout va bien", c'est-à-dire en l'absence d'évènement économique majeur, ce qui correspond aujourd’hui à un pari que personne ne voudrait prendre !
Les pays émergents, tels l’Inde et le Brésil, voient leurs propres activités se réduire rapidement. Même la Chine, présentée depuis 2008 comme la nouvelle locomotive de l'économie mondiale, va officiellement de plus en plus mal. Un article paru sur le site du China Daily, le 26 décembre, affirme ainsi que deux provinces (dont le Guangdong qui est certainement l’une des plus riches car abritant une grande part du secteur manufacturier pour les produits de grande consommation) ont notifié à Pékin qu’elles allaient retarder le paiement des intérêts de leur dette. Autrement dit, la faillite menace aussi en Chine.
L’année 2012 se présente comme une période de contraction de l’activité mondiale dont personne n’est en mesure d’évaluer l’ampleur. La croissance mondiale est évaluée comme pouvant se situer au mieux autour de 3,5%. Au cours du mois de décembre, le FMI, l’OCDE et tous les organismes de prévisions économiques ont revu leurs chiffres de croissance à la baisse. Un constat s’impose alors à nous : des injections colossales de nouveaux crédits ont eu pour effet d'ériger, en 2008, ce qui est appelé le mur de la dette. Depuis, de nouvelles dettes n'ont plus alors comme conséquence que d'élever encore plus ce mur, avec un impact de plus en plus limité pour relancer l'économie. Ce faisant, le capitalisme se retrouve au bord du gouffre : pour l’année 2011, le financement de la dette, c'est-à-dire l’argent qui aura été nécessaire au paiement des dettes arrivant à échéance, et des intérêts de la dette globale, s'est élevé à 10 000 milliards de dollars. En 2012, il est prévu que ce poste atteigne 10 500 milliards alors que, dans le même temps, l’épargne mondiale est évaluée à 5000 milliards. Où le capitalisme va-t-il trouver ce financement ?
La fin de l’année 2011 aura vu apparaître, au premier plan, la crise de la dette au niveau des banques et des assurances, laquelle est venue ainsi s’ajouter aux dettes souveraines des États et s'imbriquer de plus en plus avec celles-ci. Il est légitime de se demander aujourd’hui qui va s’effondrer en premier ? Une grande banque privée et, donc, tout le secteur bancaire mondial ? Un nouvel État comme l'Italie ou la France ? La Chine ? La zone euro ? Le dollar ?
De la crise économique à la crise politique
Nous avions mis en évidence, dans le numéro précédent de la Revue internationale, l'ampleur des désaccords qui avaient surgi entre les principaux pays de la zone Euro pour faire face au problème du financement des cessations de paiement de certains pays, avérées (la Grèce) ou menaçantes (l'Italie, etc.), et les différences qu'il existait entre l'Europe et les États-Unis pour appréhender le problème de la dette mondiale. 1
Depuis 2008, toutes les politiques menant à une impasse croissante, des désaccords au sein des différentes bourgeoisies nationales sur la dette et la croissance donnent lieu à des crispations et se transforment peu à peu en conflits et en affrontements ouverts. Avec l’inévitable évolution de la crise, ce "débat" ne fait que commencer.
Il y a ceux qui veulent tenter de réduire le montant de la dette par une violente austérité budgétaire. Pour eux, un seul mot d’ordre s’impose alors : couper drastiquement dans toutes les dépenses de l’État. Dans ce domaine, la Grèce est un modèle qui montre le chemin à tous. L’économie réelle y connaît une récession de 5%. Les commerces ferment, le pays et la population s’enfoncent dans la ruine et la misère. Pourtant cette politique désastreuse se généralise un peu partout : Portugal, Espagne, Italie, Irlande, Grande-Bretagne, etc. La bourgeoisie s’illusionne encore, à l’image des médecins du XVIIème siècle qui croyaient aux vertus d'une saignée appliquée au malade atteint d'anémie. L’activité économique ne peut supporter un tel remède sans périr.
Une autre partie de la bourgeoisie veut monétiser la dette, c'est-à-dire transformer celle-ci en émissions de monnaie. C’est ce que font, à une échelle inconnue jusque-là, les bourgeoisies américaine et japonaise, par exemple. C’est ce que fait, en tout petit, la Banque Centrale Européenne. Cette politique a le mérite de donner un peu de temps au temps. Elle permet de faire face, à court terme, aux échéances du roulement de la dette. Elle permet de freiner la vitesse de développement de la récession. Mais elle comporte un revers catastrophique pour le capitalisme, c’est celui de provoquer à terme un effondrement global de la valeur de la monnaie. Or, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans une monnaie, pas plus que l’homme ne peut vivre sans respirer. Ajouter de la dette à la dette quand celle-ci, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon, ne permet plus une relance durable de l’activité conduit, là encore, à terme, à l’effondrement de l’économie.
Enfin, il y a ceux qui souhaitent combiner les deux démarches précédentes. En termes clairs, ils veulent de l’austérité couplée à de la relance par la création monétaire. L’impasse totale de la bourgeoisie ne peut sans doute pas s'exprimer mieux que dans cette orientation. C’est pourtant celle-ci qu’applique depuis au moins deux ans la Grande-Bretagne et que réclame Monti, le nouveau chef du gouvernement italien. Cette partie de la bourgeoisie qui, comme lui, est en faveur d'une telle politique tient le raisonnement suivant : "Si nous faisons des efforts pour réduire nos dépenses drastiquement, les marchés reprendront confiance dans la capacité des États de rembourser. Ils nous prêteront alors à des taux supportables et nous pourrons à nouveau nous endetter." La boucle est bouclée. Une partie de la bourgeoisie pense encore pouvoir revenir en arrière, à la situation d’avant 2007-2008.
Aucune de ces alternatives n’est viable, même à moyen terme. Toutes conduisent le capital dans une impasse. Si la création monétaire expansive effectuée par les banques centrales semble constituer la voie qui va octroyer un peu de répit, le bout de la route est identique, c’est celui de l’effondrement historique du capitalisme.
Les gouvernements seront de plus en plus instables
L’impasse économique du capitalisme engendre inévitablement la tendance historique à la crise politique au sein de la bourgeoisie. Depuis le printemps dernier, en l’espace de quelques mois, nous avons vu des crises politiques s’ouvrir spectaculairement, successivement au Portugal, aux États-Unis, en Grèce et en Italie. De manière plus sournoise, la même crise avance cachée, pour le moment, dans d’autre pays centraux comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.
Malgré toutes ses illusions, une partie croissante de la bourgeoisie mondiale commence à percevoir, du moins en partie, l’état catastrophique de son économie. Des déclarations de plus en plus alarmistes se font jour. En réponse à cette montée de l’inquiétude, de l’angoisse et de la panique au sein de la bourgeoisie, grandissent des certitudes toujours plus rigides au sein des différents secteurs de la classe dominante y compris au niveau national. Chacun se raccroche à ce qu’il considère être la meilleure façon de défendre l’intérêt de la nation, selon le secteur économique ou politique auquel il appartient. La classe dominante s’affronte autour des options caduques que nous avons citées précédemment. En conséquence, toute orientation politique proposée par l’équipe gouvernementale en place provoque l’opposition violente des autres secteurs de la bourgeoisie.
En Italie, c’est la perte de crédibilité totale de Berlusconi pour faire appliquer les plans d’austérités supposés réduire la dette publique qui a poussé, sous la pression des marchés et avec l’aval des principaux dirigeants de la zone euro, l’ancien président du Conseil italien vers la sortie. Au Portugal, en Espagne, en Grèce, au-delà des particularités nationales, se sont ces mêmes raisons qui ont provoqué des départs précipités des équipes gouvernementales en place.
L’exemple des États-Unis est le plus significatif historiquement. Il s’agit de la plus importante puissance mondiale. Cet été, la bourgeoisie américaine s’est déchirée autour de la question du relèvement du plafond de sa dette. Ce relèvement a été opéré bien des fois depuis la fin des années 1960 sans que cela ne pose apparemment de problème majeur. Alors pourquoi cette fois la crise a-t-elle pris une ampleur telle que l’économie américaine est passée à deux doigts de la paralysie totale ? Il est vrai qu'une fraction de la bourgeoisie qui acquiert un poids croissant dans la vie politique de bourgeoisie américaine, le Tea Party, est totalement décalée et irresponsable du point de vue même de la défense des intérêts du capital national. Cependant, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire, ce n’était pas le Tea Party qui était la cause première de la paralysie de l’administration centrale américaine mais l’affrontement ouvert entre les démocrates et les républicains au Sénat et à la chambre des représentants, chacun pensant que la solution apportée par l’autre était catastrophique, inadaptée, suicidaire pour le pays. Il en a résulté un compromis douteux, fragile et très probablement de courte durée. Celui-ci sera mis à l'épreuve au moment des prochaines élections américaines dans quelques mois. La poursuite de l’affaiblissement économique des États-Unis ne pourra qu'alimenter le développement de la crise politique dans ce pays.
Mais l'impasse grandissante des politiques économiques actuelles se perçoit également dans les exigences contradictoires des marchés financiers à l’égard des gouvernements. Ces fameux marchés exigent eux aussi des gouvernements à la fois des plans de rigueur draconiens et, de plus en plus, une relance de l’activité. Lorsqu'il leur arrive de perdre confiance dans la capacité d’un État à rembourser une partie significative de sa dette, ils font monter rapidement les taux d’intérêts de leurs prêts. Le résultat à terme est garanti : ces États ne peuvent plus emprunter sur les marchés. Ils deviennent totalement dépendants des banques centrales. Après la Grèce, c’est ce qui est en train de se passer actuellement pour l’Espagne et l’Italie. L’impasse économique se resserre encore plus sur ces pays et la crise politique y puise de nouvelles ressources.
L’attitude de Cameron lors du dernier sommet de l’Union européenne, refusant d’entériner une discipline budgétaire et financière pour tous, sonne, là aussi, le glas de cette union. L’économie britannique survit de fait grâce aux bénéfices de son secteur financier. Le simple fait d’envisager un début hypothétique de contrôle de celui-ci est impensable pour une bonne partie des conservateurs britanniques. Cette prise de position de Cameron a entraîné un affrontement, dans ce pays, entre libéraux démocrates et conservateurs, fragilisant encore plus la coalition au pouvoir. De même qu'elle a entraîné des dissensions au Pays de Galles et en Écosse autour de la question de l’appartenance ou non à l’Union européenne.
Enfin, un nouveau facteur favorisant le développement de la crise politique de la bourgeoisie commence à s’inviter au sein de ses débats. L’impasse dans laquelle se trouve le capital fait resurgir un vieux démon, depuis longtemps contenu, que l’on peut qualifier de néoprotectionnisme. Aux États-Unis, dans la zone euro, une grande partie des conservateurs et des partis populistes, de gauche comme de droite, entonne le chant de la mise en place de nouvelles barrières douanières. Pour cette partie de la bourgeoisie, rejointe par certains secteurs démocrates ou socialistes, il faut réindustrialiser le pays, produire et consommer "national". Sur ce terrain, la Chine se dresse violemment contre les mesures de rétorsion déjà prises par les États-Unis à son égard. Pourtant, à Washington, les tensions sur ce sujet sont loin de se calmer. Le très fameux Tea Party mais, aussi, une part significative du parti conservateur poussent ces exigences jusqu'à la caricature, obligeant les démocrates et Obama (comme sur la question du plafond de la dette) à monter au créneau pour qualifier ces secteurs de la bourgeoisie américaine de passéistes et d’irresponsables. Ce phénomène n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, personne n’est en mesure de prévoir sous quelle forme et à quelle vitesse cela va se développer. Mais ce qui est certain, c’est que cela aura un impact important sur la cohérence d’ensemble de la vie de la bourgeoisie, sur sa capacité à maintenir des partis et des équipes gouvernementales stables.
Quel que soit l’angle sous lequel on aborde cette réalité de crise au sein de la classe dominante, nos regards sont attirés vers une seule direction, celle de l’instabilité croissante des équipes dirigeantes et gouvernementales, y compris au niveau des principales puissances de la planète.
La bourgeoisie divisée face à la crise mais unie face à la lutte de classe
Le prolétariat ne doit pas se réjouir en soi de cette crise politique dans laquelle entre la bourgeoisie. Les divisions, les déchirements au sein de cette classe ne sont pas une garantie de succès pour sa lutte .Tous les prolétaires et les jeunes générations d’exploités doivent comprendre que, quel que soit le niveau de crise existant au sein de la classe bourgeoise, ses divisions, ses querelles et autres guerres intestines, celle-ci se présentera unie devant la menace de la lutte de classe. Cela s’appelle l’union sacrée. Tel fut le cas pendant la Commune de Paris en 1871. Rappelons-nous comment les bourgeoisies prussienne et française s’affrontaient alors dans la guerre. Mais, face à l’insurrection des Communards à Paris, tous ces exploiteurs se sont retrouvés unis, le temps d’écraser dans le sang le premier grand surgissement prolétarien de l’histoire. Tous les grands mouvements de lutte du prolétariat se sont trouvés face à cette union sacrée. Il n’y a aucune exception envisageable à cette règle.
Le prolétariat ne peut pas miser sur les faiblesses de la bourgeoisie. Pour vaincre, il ne doit pas compter sur les crises politiques internes de la classe ennemie. C’est sur ses propres forces, et elles seules, que la classe ouvrière doit compter. Depuis maintenant quelque temps, nous voyons cette force apparaître et se manifester dans de nombreux pays.
En Chine pays où se concentre aujourd’hui une partie importante de la classe ouvrière mondiale – et particulièrement la classe ouvrière industrielle -, les luttes sont pratiquement quotidiennes. On peut parler, dans ce pays, de véritables explosions de colère qui impliquent non seulement les salariés mais plus généralement la population pauvre et démunie comme la paysannerie. Salaires de misère, conditions de travail insoutenables, répression féroce…, les conflits sociaux se multiplient notamment dans les usines où la production est touchée par le ralentissement de la demande européenne et américaine. Ici dans une usine de fabrications de chaussures, là dans une usine à Sichuan, ou encore à HIP, sous-traitant de Apple, à Honda, à Tesco etc. "Il y a presque une grève par jour résume Liu Kalming." (militant du droit du travail) 2. Même si ces luttes restent, pour le moment, isolées et sans perspectives, elles démontrent cependant que les ouvriers d’Asie, comme leurs frères de classe en Occident, ne sont pas près d'accepter sans réagir les conséquences de la crise économique du capital. En Égypte, après les grandes mobilisations des mois de janvier et février 2011, le sentiment de révolte est toujours présent dans la population. Corruption généralisée, misère totale, impasse politique et économique poussent des milliers de gens dans les rues et sur les places. Le gouvernement, actuellement dirigé par les militaires, y répond par la mitraille et la calomnie, répression d’autant facilitée du fait que, contrairement aux mouvements de l’année dernière, la classe ouvrière n’est pas capable de se remobiliser massivement. Car, pour la bourgeoisie le danger est là : "on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison." (Ibrahim al Sahari, Représentant du Centre des études socialistes au Caire) 3
Voilà qui est clairement dit : la peur de la bourgeoisie, c’est le mouvement ouvrier qui pourrait se développer sur son propre terrain de lutte. Dans ce pays, les illusions démocratiques sont fortes après tant d’années de dictature, mais la crise économique est là qui resserre son étreinte. La bourgeoisie égyptienne, quelle que soit la fraction qui sera au gouvernement après les récentes élections, ne pourra pas empêcher la situation de se dégrader et l'impopularité du gouvernement de grandir. Toutes ces luttes ouvrières et sociales, malgré leurs faiblesses et leurs limites, expriment un début de refus, de la part de la classe ouvrière et d’une partie croissante de la population exploitée, d’accepter passivement le sort que leur réserve le capitalisme.
Les ouvriers des pays centraux du capitalisme aussi ne sont pas restés inertes ces derniers mois. Le 30 novembre dernier en Grande-Bretagne, deux millions de personnes se sont rassemblées dans la rue pour refuser la dégradation permanente de leurs conditions de vie. Cette grève fut la plus massive depuis plusieurs dizaines d’années sur ces terres où la classe ouvrière (la plus combative d’Europe dans les années 1970) avait été écrasée sous la botte de fer du thatchérisme dans les années 1980. C’est pourquoi, voir ainsi deux millions de manifestants dans les rues anglaises, même lors d’une journée syndicale stérile et sans lendemain, est très significatif du retour de la combativité ouvrière à l’échelle internationale. Le mouvement des Indignés, notamment en Espagne, nous a montré de manière embryonnaire de quoi la classe ouvrière pourra être capable. Les prémisses de sa propre force sont apparues clairement : assemblées générales ouvertes à tous, débats libres et fraternels, prise en main de l’ensemble de la lutte par le mouvement lui-même, solidarité et confiance en soi (Voir notre dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy sur notre site Internet 4). La capacité qu'aura la classe ouvrière de s’organiser comme force autonome, en tant que corps collectif uni, sera un enjeu vital du développement des futures luttes massives du prolétariat. Les ouvriers des pays centraux du capitalisme, plus à même de déjouer les mystifications démocratiques et syndicales auxquelles ils sont confrontés depuis des décennies, montreront ainsi aux yeux du prolétariat mondial que c’est à la fois possible et nécessaire.
Le capitalisme mondial est en train de s’effondrer économiquement, la classe bourgeoise est secouée de manière croissante par des crises politiques. Ce système montre chaque jour un peu plus qu’il n’est pas viable.
Compter sur nos propres forces, c’est aussi savoir ce qui nous manque. Partout commence à naitre un mouvement de résistance contre les attaques du capitalisme. En Espagne, en Grèce, aux États-Unis des critiques émanant des ailes prolétariennes des mouvements de contestation fusent contre ce système économique pourri. On voit même apparaître un début de rejet du capitalisme. Mais alors, la question fondamentale qui taraude la classe ouvrière vient taper aux portes de la conscience ouvrière. Détruire ce monde est une nécessité que l’on peut percevoir mais pour mettre quoi à la place ? Ce dont nous avons besoin, c’est d’une société sans exploitation, sans misère et sans guerre. Une société où l’humanité sera enfin unie à l’échelle mondiale et non divisée en nations, en classes, ni triée par couleur ou par religion. Une société où chacun aura ce dont il a besoin pour se réaliser pleinement. Cet autre monde, qui doit être le but de la lutte de classe lorsque celle-ci s’attaque au renversement du capitalisme, est possible : c'est à la classe ouvrière (actifs, chômeurs, employés, futurs prolétaires encore scolarisés, travaillant derrière une machine ou un ordinateur, manœuvre, technicien ou scientifique, etc.) qu'il échoit de prendre en charge la transformation révolutionnaire qui y conduit et il porte un nom : le communisme qui n'a évidemment rien à voir avec le monstre hideux du stalinisme qui a usurpé ce nom ! Il ne s’agit pas là d’un rêve ou d’une utopie. Le capitalisme, pour se développer et exister, a aussi développé en son sein les moyens techniques, scientifiques et de production qui permettront à la société humaine mondiale et unifiée d’exister. Pour la première fois de son histoire, la société pourra sortir du règne de la pénurie pour établir celui de l’abondance et du respect de la vie. Les luttes qui se déroulent actuellement dans le monde, même si elles sont encore très embryonnaires, ont commencé sous les coups de boutoir de ce monde en faillite, à se réapproprier ce but à atteindre. La classe ouvrière mondiale porte, en elle-même, les capacités historiques de le réaliser.
Tino (10 janvier 2012)
1 "La catastrophe économique mondiale est inévitable [264]".
2 Dans le journal Cette semaine. cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=4602
3 Cité dans l'article "En Égypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ? [265]", Révolution Internationale n° 428.
4 fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes.html [266]
Récent et en cours:
- Crise économique [153]
L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire)
- 2877 lectures
Nous publions ci-après une contribution d'un groupe politique du camp prolétarien, OPOP 1, à propos de l'État dans la période de transition et de ses rapports avec l'organisation de la classe ouvrière pendant cette période.
Bien que cette question ne soit pas "d'actualité immédiate", c'est une des responsabilités fondamentales des organisations révolutionnaires de développer la théorie qui permettra au prolétariat de mener à bien sa révolution. En ce sens, nous saluons l'effort d'OPOP pour clarifier une question qui sera de la première importance lors de la future révolution, si elle est victorieuse, afin de pouvoir mettre en œuvre à l'échelle mondiale la transformation de la société léguée par le capitalisme vers une société sans classes et sans exploitation.
L'expérience de la classe ouvrière a déjà apporté sa contribution à la clarification pratique et à l'élaboration théorique de cette question. La brève expérience de la Commune de Paris, où le prolétariat a pris le pouvoir pendant deux mois, a clarifié la nécessité de détruire l'État bourgeois (et non de le conquérir comme le pensaient les révolutionnaires auparavant) et de la révocabilité permanente des délégués élus par les prolétaires. La révolution russe de 1905 a fait surgir des organes spécifiques, les conseils ouvriers, organes du pouvoir de la classe ouvrière. Après l'éclatement de la révolution russe en 1917, Lénine allait condenser dans son ouvrage L'État et la révolution les acquis du mouvement prolétarien sur cette question à cette époque. C'est de la conception résumée par Lénine d'un État prolétarien, l'État des Conseils, que se réclame le texte d'OPOP ci-après.
Pour OPOP, l'échec de la révolution russe (du fait de son isolement international) ne permet pas de tirer des leçons nouvelles par rapport au point de vue de Lénine. C'est sur cette base qu'elle rejette la conception du CCI qui remet en cause la notion d' "État prolétarien". Tout en développant sa critique, la contribution d'OPOP prend soin de délimiter le champ des désaccords entre nos organisations, ce que nous saluons, en soulignant que nous avons en commun la conception selon laquelle "les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité (…) et constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Le point de vue du CCI sur la question de l'État ne fait que poursuivre l'effort de réflexion théorique mené par les fractions de gauche (italienne en particulier) surgies en réaction à la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste. S'il est parfaitement juste de rechercher la cause fondamentale de la dégénérescence de la révolution russe dans l'isolement international de celle-ci, ce n'est pas pour autant que cette expérience ne peut pas apporter d'enseignements quant au rôle de l'État, permettant ainsi d'enrichir la base théorique que constitue L'État et la révolution de Lénine. Contrairement à la Commune de Paris, qui a été clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie, en Russie, c'est en quelque sorte "de l'intérieur", de la dégénérescence de l'État lui-même, qu'est venue la contre-révolution (en l'absence de l'extension de la révolution). Comment comprendre ce phénomène ? Comment et pourquoi la contre-révolution a-t-elle pu prendre cette forme ? C'est justement en nous basant sur les apports théoriques élaborés à partir de cette expérience que nous critiquons la position de "l'État prolétarien" défendue dans l'ouvrage de Lénine, de même que certaines formulations de Marx et Engels allant dans le même sens.
Évidemment, contrairement aux apports "en positif" de la Commune, ces leçons que nous tirons sur le rôle de l'État sont "en négatif" et, en ce sens, elles font l'objet d'une question ouverte, qui n'est pas tranchée par l'histoire. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il est de la responsabilité des révolutionnaires de préparer l'avenir. Nous publierons, dans un prochain numéro de la Revue internationale, une réponse aux thèses développées par OPOP. On peut ici évoquer, de façon très résumée, les idées essentielles autour desquelles elle s'articulera 2 :
-
Il est impropre de parler de l'État comme pouvant être le produit d'une classe en particulier. Comme Engels l'a mis en évidence, l'État est le produit de l'ensemble de la société divisée en classes antagoniques. S'identifiant aux rapports production dominants (et donc à la classe qui les incarne), sa fonction est celle de préservation de l'ordre économique instauré ;
-
Après la révolution victorieuse, il persiste des classes sociales différentes, même après la défaite de la bourgeoisie au niveau international ;
-
Si la révolution prolétarienne est l'acte par lequel la classe ouvrière se constitue en classe politiquement dominante, cette classe n'en devient pas pour autant la classe économiquement dominante. Elle demeure, jusqu'à l'intégration de l'ensemble des membres de la société dans le travail associé, la classe exploitée de la société et la seule classe révolutionnaire, c'est-à-dire porteuse du projet communiste. À ce titre, elle doit en permanence maintenir son autonomie de classe afin de défendre ses intérêts immédiats de classe exploitée et son projet historique de société communiste.
CCI
Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat dans la phase socialiste de transition vers la société sans classes (OPOP)
1. Introduction
Les gauches sont en retard dans la discussion très urgente à mener concernant les questions de stratégie, tactique, organisation et également de la transition [au communisme]. Parmi les nombreux sujets qui nécessitent des réponses, l'un d'entre eux se détache particulièrement, celui de l'État, qui mérite un débat systématique.
Sur cette question, certaines forces de gauche ont une conception différente de la nôtre, en ce qui concerne essentiellement les conseils, véritables structures de la classe ouvrière, qui surgissent en tant qu'organes d'un pré-État-Commune et, par extension, de l'État-Commune lui-même. Pour ces organisations, l'État est une chose et les conseils en sont une autre, totalement différente. Pour nous, les conseils sont la forme au moyen de laquelle la classe ouvrière se constitue sur le plan organisationnel en État, en tant que dictature du prolétariat, vu que l'État signifie le pouvoir institué d'une classe sur une autre.
La conception marxiste de l'État prolétarien contient, pour le court terme, l'idée de la nécessité d'un instrument de domination de classe mais, pour le moyen terme, elle indique la nécessité de la fin de l'État lui-même. Ce qu'elle propose et qui devra prévaloir dans le communisme c'est une société sans classes et l'absence de nécessité de l'oppression de l'homme ou de la femme, étant donné qu'il n'existera plus d'antagonisme social entre différents groupes sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui à cause de l'appropriation privée des moyens de production et de la séparation entre les producteurs directs et les moyens – et les conditions - de travail et donc de production.
La société, qui sera alors hautement évoluée, passera par une étape d'auto-gouvernement et d'administration des choses, où il n'y aura besoin d'aucune des organisations sociales transitoires expérimentées depuis qu'existe Homo sapiens, à l'exception de la forme conseils qui est la forme la plus évoluée de l'État (son caractère simplifié, sa dynamique d'auto-extinction délibérée et consciente et sa force sociale ne sont autres que des manifestations de sa supériorité sur toutes les autres formes passées de l'État), que la classe ouvrière utilisera pour passer de la première phase du communisme (le socialisme) à une phase supérieure de la société, la société sans classes. Mais pour atteindre ce stade, la classe ouvrière devra construire, bien avant, le moyen de la transition que sont les conseils à l'échelle planétaire.
Il reviendra alors aux organisations marxistes la tâche, non pas de contrôler l'État, moins encore de l'extérieur que de l'intérieur, mais bien de lutter en permanence au sein de l'État-Commune édifié par la classe ouvrière et l'ensemble du prolétariat au moyen des conseils, afin que celui-ci se hisse à la hauteur de son combat le plus révolutionnaire. Les conseils, à leur tour, devront effectivement assumer la lutte pour le nouvel État, avec la compréhension que ce sont eux-mêmes qui constituent l'État, lequel n'a pas sans raison été qualifié d'État-Commune par Lénine.
L'État des Conseils est révolutionnaire tant dans sa forme que dans son contenu. Il diffère, par essence, de l'État bourgeois de la société capitaliste ainsi que des autres sociétés qui l'ont précédée. L'État des Conseils découle de la constitution de la classe ouvrière en classe dominante comme le pose le Manifeste du Parti communiste de 1848, écrit par Marx et Engels. En ce sens, les fonctions qui lui reviennent diffèrent radicalement de celles de l'État bourgeois capitaliste, dans la mesure où s'opère un changement, une transformation quantitative et qualitative au moment même de la rupture entre l'ancien pouvoir et la nouvelle forme d'organisation sociale : l'État des Conseils.
L'État des Conseils est, en même temps et dialectiquement, la négation politique et sociale de l'ordre antérieur ; c'est pour cela qu'il est, également dialectiquement, l'affirmation et la négation de la forme de l'État : négation en ce sens qu'il entreprend sa propre extinction et en même temps celle de toute forme d'État ; affirmation en tant qu'expression extrême de sa force, condition de sa propre négation, dans la mesure où un État post-révolutionnaire faible serait impuissant à résoudre sa propre existence ambigüe : mener à bien la tâche de répression de la bourgeoisie comme prémices de son pas décisif, l'acte de sa disparition. Dans l'État bourgeois, la relation dictature - démocratie se réalise à travers une relation combinée d'unité contradictoire (dialectique) dans laquelle la grande majorité est soumise au moyen de la domination politique et militaire de la bourgeoisie. Dans l'État des Conseils, au contraire, ces pôles sont inversés. Le prolétariat, qui avait auparavant une participation politique nulle en raison du processus de manipulation et d'exclusion des décisions auquel il était soumis, vient jouer le rôle dominant dans le processus de lutte des classes. Il y établit la plus large démocratie politique connue de l'histoire, laquelle sera associée, comme il se doit, à la dictature de la majorité exploitée sur une minorité dépouillée et expropriée, qui fera tout pour organiser la contre-révolution.
C'est cela l'État des Conseils, l'expression ultime de la dictature du prolétariat qui utilise ce pouvoir, non seulement pour assurer une plus grande démocratie pour les travailleurs en général et la classe ouvrière en particulier, mais avant tout et par-dessus tout, pour réprimer de façon organisée à l'extrême les forces de la contre-révolution.
L'État des Conseils condense en lui, comme cela a déjà été dit, l'unité entre le contenu et la forme. C'est durant la période de situation révolutionnaire, alors que les bolcheviks organisaient l'insurrection en Russie en Octobre 1917, que cette question est devenue la plus claire. A ce moment-là, il était impossible de faire une distinction entre le projet de pouvoir par la classe ouvrière, le socialisme, le contenu et la forme d'organisation, le nouveau type d'État qu'on voulait construire en le basant sur les soviets. Le socialisme, le pouvoir des travailleurs et les soviets, tout cela était la même chose, si bien qu'on ne pouvait parler de l'un sans comprendre qu'on parlait automatiquement de l'autre. Ainsi, ce n'est pas parce que, par la suite, il s'est édifié une organisation étatique toujours plus éloignée de la classe ouvrière en Russie que nous devons laisser de côté la tentative révolutionnaire de mettre en place l'État des Soviets.
Les soviets (conseils), à travers tous les mécanismes et les éléments hérités de la bureaucratie ont, en URSS, été privés de leur contenu révolutionnaire pour se constituer, dans le moule d'un État bourgeois, comme organe institutionnalisé. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrions abandonner la tentative de construire un État d'un type nouveau, avec un fonctionnement dont les principes de base seraient nécessairement en adéquation avec ce que la classe ouvrière a créé de plus important à travers le processus historique de sa lutte, à savoir une forme d'organisation nécessitant seulement d'être améliorée sur certains aspects en vue de mener à bien la transition, mais qui, fondamentalement, depuis la Commune de Paris de 1871, a fait l'objet de répétitions générales, à travers une série de tentatives et d'erreurs, pour réaliser l'État des Conseils.
Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière. Par conséquent, nous nous proposons à travers ce bref essai, de réaliser une tentative pour comprendre ce qu'est l'État des Conseils ou, autrement dit, une élaboration théorique sur une question que la classe ouvrière a déjà expérimentée pratiquement, à travers son expérience historique et dans sa confrontation aux forces du capital. Passons à l'analyse.
2. Préambule
Pour éviter les répétitions et les redondances, nous considérons comme établi que, dans ce texte, nous assumons à la lettre toutes les définitions théoriques et politiques principielles qui définissent le corps de doctrine de L'État et la révolution de Lénine.3 De plus, nous avertissons le lecteur que nous ne rappellerons les prémisses léninistes que dans la seule mesure où elles sont indispensables pour fonder théoriquement quelques postulats qui sont nécessaires au besoin réellement urgent d'une actualisation de ce sujet. De plus, nous ne le ferons que si les prémisses en question sont nécessaires pour clarifier et fonder l'objectif théorique - politique qui nous préoccupe, à savoir les relations entre le système des conseils et l'État prolétarien (= dictature du prolétariat) avec sa forme préalable, le pré-État.
D'un autre point de vue, l'œuvre de Lénine mentionnée précédemment se révèle de façon tout autant nécessaire et irremplaçable, car elle inclut l'aperçu le plus complet des passages de Marx et d'Engels relatifs à l'État de la phase de transition, mettant ainsi à portée de main une quantité plus que suffisante de positions existantes et autorisées produites sur L'État et la révolution dans toute la littérature politique.
3. Quelques prémisses du pouvoir ouvrier
Commentant Engels, Lénine fait, dans deux passages de son texte, les affirmations suivantes: "L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables (...) Selon Marx, l'État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes était possible" et "... l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre" 4 (l'accentué est de l'auteur). Conciliation et domination sont deux concepts très précis dans la doctrine sur l'État de Marx, Engels et Lénine. Conciliation signifie la négation de toute contradiction quelle qu'elle soit entre les termes d'une relation donnée. Dans la sphère sociale, en l'absence de contradictions dans la constitution ontologique des classes sociales fondamentales d'une formation sociale, parler d'État n'a pas de sens. Il est prouvé historiquement que, dans les sociétés primitives, il n'existe pas d'État tout simplement parce qu'il n'y a pas de classes sociales, d'exploitation, d'oppression et de domination d'une classe sur une autre. D'autre part, lorsqu'on parle de la constitution ontologique même des classes sociales, la domination est une notion qui exclut l'hégémonie, vu que l'hégémonie suppose le partage – même inégal – de positions au sein du même contexte structurel. Le résultat est que, dans le domaine de la socialité bourgeoise, qui s'étend jusqu'à celui de la révolution, au sein duquel la bourgeoisie et le prolétariat sont situés et se battent à partir de positions diamétralement antagoniques, parler de l'hégémonie de la bourgeoisie sur le prolétariat n'a pas de sens, alors qu'il y en a un de parler d'hégémonie entre les fractions de la bourgeoisie qui se partagent le même pouvoir d'État ; cela a un sens également de parler de l'hégémonie du prolétariat sur les classes avec lesquelles il partage l'objectif commun de prendre le pouvoir par le renversement de l'ennemi stratégique commun 5.
Ailleurs, citant Engels, Lénine parle de la force publique, ce pilier caractéristique de l'État bourgeois - l'autre étant la bureaucratie - constitué de tout un appareil répressif militaire et spécialisé, qui est séparé de la société et au-dessus d'elle et "... qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée" 6. La mise en évidence de cette composante de base de l'ordre bourgeois a ici un clair objectif : montrer comment, en contrepartie, est également incontournable la mise en place d'une force armée, beaucoup plus forte et cohérente, celle du prolétariat en armes pour réprimer, avec une détermination encore plus résolue, l'ennemi de classe battu, mais pas abattu, la bourgeoisie. Dans quelle instance de la dictature du prolétariat doit se trouver cette force répressive ? C'est une question à traiter dans un chapitre spécifique du présent texte.
L'autre pilier sur lequel repose le pouvoir bourgeois est la bureaucratie, comprenant des fonctionnaires de l'État, qui jouissent de privilèges cumulatifs, parmi lesquels des honoraires différenciés, des postes de tout repos attribués à vie, qui accumulent tous les avantages des pratiques inhérentes à une corruption de grande ampleur et récurrente. De même que pour les milices populaires qui redoublent de force à mesure qu'elles sont structurellement simplifiées, les tâches exécutives, législatives et judiciaires sont plus efficaces dans la mesure même où elles sont également simplifiées ; et exactement pour la même raison, les tâches exécutives des tribunaux et les fonctions législatives gagnent en force dans la mesure même où elles sont prises en charge directement par les travailleurs dans des conditions où la révocabilité des charges est établie afin d'enrayer, dès le début, la tendance à la résurgence des castes, mal dont souffrent toutes les sociétés qui ont été accouchées par des révolutions "socialistes" durant tout le vingtième siècle.
La bureaucratie et la force publique professionnelles, les deux poutres maîtresses sur lesquelles repose le pouvoir politique de la bourgeoisie, les deux piliers dont les fonctions devraient être remplacées par les travailleurs dans des structures simplifiées (au cours de leur extinction) mais alors beaucoup plus efficaces et fortes ; simplification et force qui s'opposent et s'attirent dans le mouvement qui accompagne tout le processus de transition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de la précédente société de classe. Le problème qui nous est maintenant posé est le suivant : quelle est l'instance qui, pour Marx, Engels et Lénine, doit assumer la dictature du prolétariat ?
4. La dictature du prolétariat chez Marx, Engels et Lénine
Notre trio ne laisse aucun doute à ce sujet :
"Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives" 7.
Ou encore, État prolétarien (sic) = "prolétariat organisé en classe dominante." "L'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante." (sic). Jusqu'ici, le sens du raisonnement de Lénine, Engels et Marx est le suivant : le prolétariat renverse la bourgeoisie par la révolution ; en renversant la machine étatique bourgeoise, il détruira la machine d'État en question pour, immédiatement, ériger son État, simplifié et en voie d'extinction, lequel est plus fort car il est dirigé par la classe révolutionnaire et assume deux types de tâches : réprimer la bourgeoisie et construire le socialisme (comme phase de transition au communisme).
Mais d'où Marx tire-t-il cette conviction que la dictature du prolétariat est l'État prolétarien ? De la Commune de Paris ... tout simplement ! En effet, "La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière." 8 (souligné par l'auteur). La question va beaucoup plus loin : les membres de l'État prolétarien (sic), l'État-Commune, sont élus dans les conseils d'arrondissement, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de conseils de travailleurs qui se mettent à la tête de tels conseils, comme en Russie, dans les soviets. La question de l'hégémonie de la direction ouvrière est garantie par l'existence d'une majorité d'ouvriers dans ces conseils et, bien sûr, par l'action de direction que le parti doit exercer dans de telles instances.
Il ne manque qu'un seul ingrédient pour articuler la position État prolétarien, État des Conseils, État-Commune, État socialiste ou dictature du prolétariat : la méthode de prise des décisions et c'est là que se formule et se comprend ce principe universel que beaucoup de marxistes ne parviennent pas à comprendre, il s'agit du centralisme démocratique. "Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l'entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petit-bourgeois, dont, parmi ces derniers, les anarchistes. Le centralisme, pour Engels, n'exclut pas du tout une large autonomie administrative locale qui, à condition que les "communes" et les régions défendent de leur plein gré l'unité de l'État, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout "commandement" par en haut." 9. Il est clair que le terme et le concept de centralisme démocratique ne sont pas la création du stalinisme, comme le veulent certains - qui tentent de dénaturer cette méthode essentiellement prolétarienne - mais celle d'Engels lui-même. Par conséquent, il ne peut leur être donnée la connotation péjorative qui vient du centralisme bureaucratique utilisé par la nouvelle bourgeoisie d'État de l'URSS.
5. Système des conseils et dictature du prolétariat
La séparation antinomique entre le système des conseils et l'État post-révolutionnaire est une erreur, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elle réside dans une position qui s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat. Une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel). Cette conception résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois). Elle est le produit des ambiguïtés de la Révolution russe et place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils.
Une autre cause de cette même erreur, qui est liée à la précédente, réside dans l'établissement d'un lien étrange identifiant de façon acritique l'État surgi dans l'URSS post-révolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même. C'est une erreur qui découle d'une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort. De telles ambiguïtés, qui se reflétaient dans la pensée qui tentait de les comprendre, se situaient plus dans les avancées et les reculs de la révolution que dans la conception théorique politique de Lénine et des chefs bolcheviques qui continuaient à être d'accord avec lui.
Une troisième cause à cette erreur est la non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée - dont la forme bureaucratique dans le système Gosplan (Comité étatique pour la planification) a longtemps été confondue avec la "centralisation socialiste" – rien que pour parler de cet aspect digne d'attention, ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiés" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients. Aujourd'hui, on sait que la planification ultra centralisée "socialiste" n'était qu'un aspect de la centralisation bureaucratique du capitalisme d'État "soviétique" qui maintenait le prolétariat éloigné et étranger à tout le système de définition des objectifs, des décisions concernant ce qui doit être produit et comment cela doit être réparti, l'allocation des ressources, etc. S'il s'était agi d'une véritable planification socialiste, tout ceci aurait dû faire l'objet d'une large discussion au sein des conseils, ou de l'État-Commune, vu que l'État prolétarien se confond avec le système des conseils, l'État socialiste étant "une "machine" très simple, presque sans "machine", sans appareil spécial, par la simple organisation des masses armées (comme, dirons-nous par anticipation, les Soviets des députés ouvriers et soldats)." 10
Une autre incompréhension réside dans la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine à travers les paroles rapportées précédemment, implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification / extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils. Par conséquent, cela n'a pas de sens de prendre comme référence l'État "soviétique" de l'URSS pour mettre en question l'État socialiste que Marx et Engels ont vu naître de la Commune de Paris. En fait, établir un trait d'union entre l'État des Conseils et l'État bureaucratique issu de la Révolution russe revient à donner à l'État prolétarien une structure bureaucratique, qu'un véritable État post-révolutionnaire, simplifié et en voie de simplification / extinction, non seulement ne possède pas mais encore rejette précisément.
En fait, le caractère et l'étendue de l'État des Conseils (État prolétarien = État socialiste = dictature du prolétariat = État-Commune = État de transition) sont magnifiquement résumés dans ce passage écrit par Lénine lui-même : "l' "État" est encore nécessaire, mais c'est déjà un État transitoire, ce n'est plus l'État proprement dit". 11 Mais, direz-vous, si c'était cela la véritable conception de l'État socialiste de Lénine, pourquoi ne l'a-t-il pas "appliquée" en URSS après la révolution d'Octobre, vu que ce qui est alors apparu est l'exact opposé de tout cela, des distorsions allant de l'extrême centralisation bureaucratique (depuis l'armée à la bureaucratie étatique et aux unités de production) jusqu'à la répression la plus brutale des marins de Cronstadt ? Eh bien, tout cela ne fait que révéler que des révolutionnaires de l'envergure de Lénine peuvent éventuellement être traversés par des contradictions et des ambiguïtés d'une telle importance – et cela a été le contexte exact national et international de la Révolution d'Octobre - qui peuvent les conduire, dans la pratique, à des actions et des décisions souvent diamétralement opposées à leurs convictions les plus profondes. Dans le cas de Lénine et du Parti bolchevique, une seule des impossibilités [à la révolution, NDT] (et elles étaient nombreuses) était suffisante pour orienter la révolution dans une direction non souhaitée. Une de ces impossibilités était plus que suffisante : la situation d'isolement d'une révolution qui ne pouvait pas reculer, mais qui s'est trouvée isolée et n'avait pas d'autre choix que d'essayer d'ouvrir la voie à la construction du socialisme dans un seul pays, la Russie soviétique - tentative contradictoire qui fut initiée déjà à l'époque de Lénine et Trotsky. Que furent le communisme de guerre, la NEP, et autres entreprises, sinon cela ?
Et alors, que devons-nous faire ? Devons-nous rester fermes sur les conceptions de Lénine, Marx et Engels sur l'État, le programme, la révolution et le parti pour, dans le futur, lorsque les problèmes concrets comme celui de l'internationalisation de la lutte de classe, entre autres, montreront les réelles possibilités pour la révolution et la construction du socialisme dans plusieurs pays, mettre en avant et donner corps aux conceptions de Marx, Engels et Lénine ? Ou bien, inversement, devons-nous, face aux premières difficultés, renoncer aux positions de principe, en les échangeant contre des figurations politiques au rabais qui ne pourront que conduire à l'abandon de la perspective de la révolution et de l'édification socialiste ?
6. Pour une conclusion : Conseils, État (socialiste) et pré- État (socialiste)
a) L' État-Conseil
Après avoir analysé les prémisses économiques de l'abolition des classes sociales, c'est-à-dire, les prémisses "pour que 'tous' puissent réellement participer à la gestion de l'État", Lénine, toujours en référence aux formulations de Marx et d'Engels, dit qu' "on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la production et de la répartition, pour l'enregistrement du travail et des produits, par les ouvriers armés, par le peuple armé tout entier". "Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel, et pour la 'mise en route' et pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l'État constitué par les ouvriers armés. Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul 'cartel' du peuple entier, de l'État" 12. De plus, "En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et s'habituera vite à ce que personne ne gouverne." L'étape du socialisme "placera la majeure partie de la population dans des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les 'fonctions publiques'." 13
Tous les citoyens, rappelons-le, organisés dans le système des conseils, ou un autre, dans l'État ouvrier, vu que pour Marx, Engels et Lénine, la simplification des tâches atteindra un point tel que les tâches "administratives" de base, réduites à l'extrême, non seulement pourront être assumées par le prolétariat et les gens en général, comme pourront être prises en charge par le système des conseils qui, après tout, n'est que l'État lui-même.
Ainsi, l'État prolétarien, l'État socialiste, la dictature du prolétariat n'est pas autre chose que le système des conseils, lequel assurera l'hégémonie de la classe ouvrière dans son ensemble, assumera directement, sans qu'il y ait la nécessité d'aucun organe administratif spécifique, à la fois la défense du socialisme et les fonctions de gestion de l'État et des unités de production. Enfin, cette unité de la dictature du prolétariat, sera garantie par l'unité administrative / politique simplifiée, dans une même totalité appelée l'État des Conseils.
b) Le pré-État des Conseils
Le système des conseils qui, dans la situation post-insurrectionnelle, devra assumer la transition structurelle (mise en place de nouveaux rapports de production, élimination de toute hiérarchie dans la production, refus de toute forme mercantile, etc.) et superstructurelle (élimination de toute hiérarchie héritée de l'État bourgeois, de toute la bureaucratie, refus de toute idéologie héritée de la formation sociale antérieure, etc.) est le même système des Conseils que celui qui, avant la révolution, était l'organisation révolutionnaire qui a renversé la bourgeoisie et son État. Il s'agit donc d'un même corpus dont les tâches ont évolué avec les deux étapes du même processus de révolution sociale : une fois réalisée la tâche de l'insurrection, il faut initier la mise en œuvre d'une nouvelle tâche qui devra mener à son terme la véritable révolution sociale – la rupture avec une formation sociale qui a expiré et l'inauguration d'une nouvelle, le socialisme, lui-même aussitôt en marche pour la transition communiste, la seconde société sans classes de l'histoire (la première ayant été, bien sûr, la société primitive).
Eh bien c'est ce système des conseils que nous appelons pré-État (prolétarien). On voit que ce nom n'a, par son contenu, rien d'original, car il était, est et sera toujours une évidence du processus révolutionnaire ouvert par la Commune de Paris. Là, les Communards qui ont pris le pouvoir à partir des arrondissements étaient les mêmes qui ont assumé le pouvoir d'État - dictature du prolétariat - et qui ont inauguré, bien qu'avec des erreurs évidentes de jeunesse, l'édification d'un ordre socialiste. Un processus similaire s'est produit de nouveau en Octobre 1917. La première expérience ne pouvait pas, dans les circonstances où elle s'est produite, aller à son terme et a été frappée par la force contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, après plus de deux mois à peine d'une vie mémorable. La seconde, comme on le sait, ne pouvait pas non plus aller à son terme en raison de l'absence de conditions, externes et internes, parmi lesquelles l'impossibilité de mener à terme la construction du socialisme dans un seul pays.
Dans les deux cas, il y eut un pré-État mais, dans les deux cas, un pré-État qui, si d'un côté il put conduire à terme l'insurrection, de l'autre ne put être préparé suffisamment tôt pour la tâche de construction du socialisme. Dans le cas de 1917, ce n'est qu'à la veille d'Octobre que le seul parti (le Parti bolchevique) qui était doté des prérequis théoriques pour préparer l'avant-garde de la classe organisée dans les soviets, surtout à Saint-Pétersbourg, put seulement enseigner à la classe les tâches les plus urgentes de l'insurrection. Pour nous, il semble que, malgré la conscience, surtout chez Lénine, de l'importance fondamentale des soviets depuis 1905, ce n'est seulement qu'après février 1917 que, dans le cas de Lénine, cette conscience devint conviction. C'est pourquoi le parti de Lénine (dont le retour en Russie était facilement prévisible, vu qu'il était déjà revenu en 1905) ne s'est pas soucié de mobiliser à fond le militantisme de ses cadres ouvriers dans les soviets (les mencheviks étaient arrivés plus tôt), y inclus dans la préparation préalable des travailleurs à un resurgissement des soviets, plus tôt et au moyen d'une formation plus efficace. Une telle formation, y compris pour l'avant-garde la plus résolue de la classe organisée dans les soviets, devait inclure, sous le feu d'un débat incessant entre ces travailleurs, les questions de la prise insurrectionnelle du pouvoir et des notions de toute la théorie marxiste concernant l'établissement de leur État et la construction du socialisme. Ce débat a fait défaut, soit par l'incapacité à percevoir plus tôt l'importance des soviets, soit par manque de temps pour porter le débat parmi les ouvriers du soviet deux mois seulement avant l'insurrection. Quoi qu'il en soit, l'impréparation de l'avant-garde à la prise du pouvoir et à l'exercice de celui-ci, à son intervention et son rôle dirigeant, en vue de la construction du socialisme, a constitué un des facteurs défavorables pour une véritable dictature du prolétariat (en tant que base représentée dans les conseils) en URSS. Une telle lacune, provoquée en grande partie par l'absence d'un pré-État approprié, c'est-à-dire un pré-État qui constitue une école de la révolution, a constitué une difficulté supplémentaire dans le naufrage de la révolution russe de 1917.
Comme Lénine lui-même l'a toujours signalé, les révolutionnaires communistes sont des hommes et des femmes qui doivent avoir une formation marxiste très solide. Une solide formation marxiste requiert des connaissances relatives à la dialectique, l'économie politique, le matérialisme historique et dialectique qui permettront aux militants d'un parti de cadres non seulement d'analyser et comprendre les conjonctures passées et présentes, mais également de capter l'essentiel des processus prévisibles, au moins en ce qui concerne leurs grandes lignes (de tels niveaux de prédiction peuvent être identifiés dans beaucoup des analyses présentes dans les Cahiers philosophiques de Lénine). D'où le fait qu'une véritable formation marxiste peut assurer aux cadres militants d'un authentique parti communiste la faculté de prévoir, en les anticipant, les scénarios possibles du développement d'une crise comme la crise actuelle. De même que prévoir un large processus de situations révolutionnaires ne constitue en rien une "Bête à sept têtes" 14.
De plus, il est parfaitement faisable de prévoir la chose la plus évidente de ce monde, le surgissement de formes embryonnaires des conseils - parce que, ici et là, elles commencent à faire surface de façon embryonnaire – et qui devront être analysées, en toute franchise, sans préjugé, afin que, une fois interprétées théoriquement, les travailleurs puissent corriger les erreurs et les lacunes de telles expériences, pour qu'ils les multiplient et en renforcent le contenu, jusqu'à ce qu'elles deviennent, dans un futur proche - cette garantie est donnée par le stade avancé de la crise structurelle du capitalisme - dans le contexte de situations révolutionnaires concrètes, le système des conseils, issus de l'interaction dialectique de petits cercles (dans les lieux de travail, d'éducation et de logement), de commissions (d'usines) et de conseils (de quartiers, de régions, de zones industrielles, nationales, etc.) qui devront se constituer, dans le même temps, en tant qu'épine dorsale de l'insurrection et, dans le futur, organe de la dictature révolutionnaire du prolétariat.
7. En conclusion : le CCI et la question de l'État post-révolutionnaire
Pour nous, les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité et, comme tels, doivent se constituer dans les organes de base du pouvoir ouvrier, en plus du fait qu'ils doivent constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat. Mais c'est à partir de là que nous nous différencions de certains exégètes du marxisme qui établissent une rupture entre les conseils et l'État-Commune, comme si cet État-Commune et les conseils étaient deux choses qualitativement distinctes. C'est la position, par exemple, du CCI (Courant communiste international). Après avoir opéré cette séparation, de tels exégètes établissent un trait d'union au moyen duquel les conseils devraient exercer une pression et leur contrôle sur le "demi-État de la période de transition", pour que ce même État (= Commune) – qui dans la vision du CCI, "n'est ni le porteur ni l'agent actif du communisme" - ne remplisse pas son rôle immanent de conservateur du statu quo (sic) et "d'obstacle" à la transition.
Pour le CCI, "L'État tend toujours à s'accroître démesurément", devenant ainsi "terrain de prédilection à toute la fange d'arrivistes et autres parasites et recrute facilement ses cadres parmi les éléments résidus et vestiges de l'ancienne classe dominante en décomposition." 15 Et il termine sa vision de l'État socialiste en affirmant que Lénine "a pu constater [cette fonction de l'État] quand il parle de l'État comme la reconstitution de l'ancien appareil d'État tsariste" et quand il dit que l'État accouché par la Révolution d'Octobre avait tendance "à échapper à notre contrôle et tourne dans le sens contraire à ce que nous voulons". Pour le CCI, "l'État prolétarien est un mythe" et "Lénine le rejetait, rappelant que c'était 'un gouvernement des ouvriers et des paysans avec une déformation bureaucratique'". Par ailleurs, pour le CCI :
"La grande expérience de la révolution russe est là pour en témoigner. Chaque fatigue, chaque défaillance, chaque erreur du prolétariat a immédiatement pour conséquence le renforcement de l'État, et inversement, chaque victoire, chaque renforcement de l'État se fait en évinçant un peu plus le prolétariat. L'État se nourrit de l'affaiblissement du prolétariat et de sa dictature de classe. La victoire de l'un est la défaite de l'autre." 16
Il dit aussi, dans d'autres passages [NDLR: du même article], que "Le prolétariat garde sa pleine et entière liberté par rapport à l'État. Sous aucun prétexte, le prolétariat ne saurait reconnaître la primauté de décision des organes de l'État sur celle de son organisation de classe : les conseils ouvriers, et devrait imposer le contraire", que le prolétariat "ne saurait tolérer l'immixtion et la pression d'aucune sorte de l'État dans la vie et l'activité de la classe organisée excluant tout droit et possibilité de répression de l'État à l'égard de la classe ouvrière" et que "Le prolétariat conserve son armement en dehors de tout contrôle de l'État". "La condition première en est la non-identification de la classe avec l'État"
Qu'en est-il de la vision des camarades du CCI sur l'État-Commune ? En premier lieu que ni Marx ni Engels, ni Lénine, comme on l'a vu dans les observations faites plus avant et empruntées à L'État et la révolution, ne défendent la conception de l'État développée par le CCI. Comme nous l'avons vu, l'État-Commune était, pour eux, l'État des Conseils, l'expression de la puissance du prolétariat et de sa dictature de classe. Pour Lénine, l'État post-révolutionnaire non seulement n'était pas un mythe, comme le pense le CCI, mais bien l'État prolétarien. En vertu de quoi cet État peut-il être ainsi qualifié par le CCI alors qu'il le conçoit par ailleurs comme un État-Commune ?
Deuxièmement, comme nous l'avons déjà analysé précédemment, la séparation antinomique entre les conseils et l'État post-révolutionnaire, posée par le CCI, s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Il nous faut ici réitérer ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir que séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et existe sous la dictature du prolétariat et qu'une telle séparation place, d'un côté, l'État en tant que structure administrative complexe et gérée par un corps de fonctionnaires - un non-sens dans la conception simplifiée de l'État selon Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique au sein des conseils exerçant sa pression sur l'État en tant que tel.
Troisièmement, nous le répétons : cette conception, qui résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme et identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois) issu des ambiguïtés de la Révolution russe, place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire en créant alors effectivement une dichotomie qui, elle-même, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif séparé organiquement des conseils ouvriers. Le CCI confond le concept de l'État de Lénine avec l'État produit des ambiguïtés de la Révolution d'Octobre 1917. Lorsque Lénine se plaint des atrocités de l'État tel qu'il s'est développé en URSS, ce n'est pas pour autant sa conception de l'État-Commune qu'il rejette, mais bien les déviations de l'État-Commune russe depuis Octobre.
Quatrièmement, les camarades du CCI semblent ne pas se rendre compte, comme nous en avons également traité, du fait que les tâches organisationnelles et administratives que la révolution met à l'ordre du jour, dès le début, sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux.
Cinquièmement, les camarades du CCI ne semblent pas réaliser, également comme indiqué ci-dessus, la simplification véritable de l'État-Commune, dans le sens où Lénine l'exprime, avec un minimum de structure administrative, tellement minime – c'est un processus de simplification / extinction – qu'elle peut être prise en charge directement par le système des conseils.
Sixième et dernier point. C'est seulement en assumant, directement et de l'intérieur, les tâches simplifiées relevant de l'État des Conseils, de défense et de transition / construction socialiste, que la classe ouvrière sera en condition d'éviter que ne se produise un schisme étatique étranger à l'État des conseils et qu'elle pourra exercer son contrôle, non seulement sur ce qui se passe au sein de l'État, mais également sur la société dans son ensemble. Pour cela, il vaut la peine de rappeler que l'État prolétarien, l'État-Commune, l'État socialiste, la dictature du prolétariat ne sont autre chose que le système des conseils qui a pris en charge les tâches élémentaires d'organisation des milices, de la durée quotidienne du travail, des brigades de travail et autres types de tâches également révolutionnaires (révocabilité des postes, égalité des salaires, etc.), des tâches également simplifiées concernant la lutte et l'organisation d'une société en transition. Pour cela, il ne sera pas nécessaire de créer un monstre administratif, encore moins bureaucratique, ni une quelconque autre forme héritée de l'État bourgeois abattu ou lui ressemblant ou encore de l'État bureaucratique du capitalisme d'État de l'ex-URSS.
Ce serait formidable que le CCI se penche sur les passages que nous avons mis en évidence dans ce texte relatif à L'État et la révolution de Lénine, où celui-ci justifie, en s'appuyant sur Engels et Marx, la nécessité de l'État-Commune comme celle de l'État des Conseils, de l'État prolétarien, de la dictature du prolétariat.
OPOP
(Septembre 2008, révisé en décembre 2010).
1 OPOP, OPosição OPerária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [267]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [268]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 Celles-ci sont développées dans les articles suivants : "Période de transition – Projet de résolution" de la Revue internationale n° 11 (https://fr.internationalism.org/rint11/periode_de_transition.htm [269]) et "L'État dans la période de transition" de la Revue internationale n° 15 (https://fr.internationalism.org/rinte15/pdt.htm [270]).
3 NDLR : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [271]
4 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "L'État, produit de contradictions de classes inconciliables".
5 Ceci est un exemple des confusions et des ambiguïtés de l'accumulation de catégories théoriques et politiques, les unes à côté des autres, introduites par Antonio Gramsci dans la doctrine marxiste, portées à leurs limites logiques et politiques par ses épigones et dont les difficultés logiques (apories) ont été brillamment investiguées par Perry Anderson dans son classique, Sur Gramsci.
6 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "Détachements spéciaux d'hommes armés, prisons, etc."
7 NDLR. Extrait du Manifeste communiste, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre II, "La veille de la révolution".
8 NDLR. Extrait de La guerre civile en France, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre III, "Par quoi remplacer la machine d'État démolie ?"
9 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre IV, "Critique du projet de programme d'Erfurt".
10 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "La transition du capitalisme au communisme".
11 NDLR. L'État et la révolution, Ibid.
12 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "Phase supérieure de la société communiste".
13 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre VI, "Polémique de Kautsky avec Pannekoek".
14 NDLR. "La Bête à sept têtes est un type de monstre de légende qui se retrouve, sous des formes différentes (souvent un dragon ou un serpent à sept têtes) dans de nombreuses religions, mythologies et traditions à travers le monde. Dans plusieurs traditions, lorsqu'une tête est tranchée, elle repousse en un ou plusieurs exemplaires" (Wikipédia).
15. NDLR. "L'État dans la période de transition", Revue internationale n° 15.
16. NDLR. Idem.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
- Période de transition [273]
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (IV) : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la veille de Mai 1968
- 2887 lectures
Il est bien connu que l’impérialisme français puisa généreusement de la chair à canon parmi la jeunesse de ses colonies africaines, comme l'exigeait son implication de premier plan dans la seconde boucherie mondiale. En effet, des centaines de milliers de "tirailleurs", dont une écrasante majorité de jeunes, travailleurs et sans travail, furent embrigadés et sacrifiés dans les sanglantes tueries impérialistes. Le conflit terminé, s'ouvrit une période de reconstruction de l’économie française ; ses répercussions dans la colonie se firent sentir à travers une exploitation insoutenable, contre laquelle les ouvriers se mirent courageusement à lutter.
Mutinerie de soldats réprimée dans le sang et mouvements de grève
Il y eut d’abord la révolte menée par des soldats rescapés de la grande boucherie mondiale qui se soulevèrent contre le non-paiement de leur solde. En effet, immobilisés dans le camp de Thiaroye (banlieue de Dakar) après leur retour au pays, des centaines de soldats qui, en décembre 1944, réclamaient leur pension en s’adressant au "Gouvernement provisoire" présidé par de Gaulle, ne reçurent comme seule réponse que la mitraille de la part de leur commandement. La répression fit, officiellement, 35 morts, 33 blessés et 50 arrestations. Voilà comment les ouvriers et les anciens combattants, qui avaient épaulé les "libérateurs" de la France, furent remerciés par ces derniers, lesquels comptaient d’ailleurs dans leurs rangs des "socialistes" et des "communistes", membres du gouvernement d’alors présidé par le général de Gaulle. C'est là une belle leçon d’"humanisme" et de "fraternité" de la part de la célèbre "Résistance française" vis-à-vis de ses "tirailleurs indigènes" en révolte contre le non versement de leur maigre pension.
Cependant, cette réponse sanglante de la bourgeoisie française aux revendications des mutins ne put empêcher durablement l’éclatement d’autres luttes. En fait une certaine ébullition allait se développer :
"D’abord, les enseignants, du 1er au 7 décembre 1945, les ouvriers de l’industrie, du 3 au 10 décembre, avaient lancé le mouvement. La grève reprit en janvier, toucha de nouveau les métallurgistes, mais aussi les employés de commerce et le personnel auxiliaire du Gouverneur général. Les mesures de réquisition prises par le Gouverneur provoquèrent le 14 janvier 1946, une grève générale décrétée par 27 syndicats. Le travail ne reprit que le 24 janvier pour les fonctionnaires, le 4 février pour les employés de commerce, le 8 février pour les métallurgistes".( El hadj Ibrahima Ndao, Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques, les Nouvelles Édit. Africaines, 2003.) En dépit des terribles souffrances subies pendant la guerre, la classe ouvrière recommençait à relever la tête, exprimant ainsi sa révolte contre la misère et l’exploitation.
Mais la reprise de la combativité se faisait dans un nouvel environnement peu favorable à l’autonomie de la classe ouvrière. En effet, le prolétariat de l’AOF de l’après-guerre ne put éviter d’être pris en tenaille entre les tenants de l’idéologie panafricaniste (indépendantistes) et les forces de gauche du capital colonial (SFIO, PCF et syndicats). Mais, malgré cela, la classe ouvrière poursuivit son combat avec beaucoup de pugnacité face aux attaques du capitalisme.
Grève héroïque et victorieuse des cheminots entre octobre 1947 et mars 1948
Au cours de cette période, les cheminots de l’ensemble de l’AOF se mirent en grève pour satisfaire nombre de revendications, dont celle de l'établissement d'une catégorie unique pour l’emploi des Africains et des Européens, et contre le licenciement de 3000 employés.
"Ces travailleurs du chemin de fer étaient initialement organisés au sein de la CGT. Quelque 17 500 cheminots l’ont quittée en 1948 à la suite d’une grève très dure. Au cours de ce mouvement, un certain nombre d’employés français s’étaient opposés violemment à une amélioration de la situation du personnel africain." (Mar Fall, L’Etat et la question syndicale au Sénégal, L’Harmattan, 1989)
Cette grève des cheminots se termina victorieusement grâce à la solidarité active des autres secteurs salariés (dockers et autres employés de l’industrie) qui entrèrent en grève générale pendant 10 jours, contraignant ainsi le pouvoir colonial à satisfaire l’essentiel des revendications des grévistes. Tout se décida au cours d’un grand meeting à Dakar convoqué par le gouverneur général. Dans l’espoir de briser le mouvement, la parole fut donnée aux notables politiques et aux chefs religieux qui avaient pour mission d’endormir et d’intimider les grévistes. Et, coutume oblige, les plus zélés furent les religieux.
"Une campagne de démoralisation des grévistes et surtout de leurs femmes avait été entreprise par les "guides spirituels", les imams et les prêtres des différentes sectes. (…) Les imams, furieux de la résistance des ouvriers à leurs injonctions, se déchaînaient contre les délégués, les chargeant de tous les péchés : l’athéisme, l’alcoolisme, la prostitution, la mortalité infantile ; ils prédisaient même que ces mécréants amèneraient la fin du monde". (Ousmane Sembene, Les bouts de bois de Dieu, Pocket, 1960)
Mais rien n’y fit. Même accablés de tous les "péchés", les cheminots persistèrent et leur combativité demeura intacte. Elle se renforça même lorsqu’au cours d'une assemblée générale leur appel à la solidarité reçut un écho grandissant chez les ouvriers des autres secteurs présents qui scandèrent : "Nous, les maçons, nous sommes pour la grève !...Nous, les ouvriers du port, nous sommes pour la grève !... Nous, les métallos...Nous les…". (Ousmane Sembene, ibid)
Et effectivement, dès le lendemain, ce fut la grève générale dans pratiquement tous les secteurs. Pourtant, avant d’en arriver là, les ouvriers du rail eurent à subir non seulement la pression des notables politiques et des religieux, mais aussi, la terrible répression militaire. Des sources (O. Sembene, ibid.) indiquent qu’il y eut des morts, et la "marche des femmes" (épouses et proches des cheminots) sur Dakar, en soutien aux grévistes, fut réprimée dans le sang par les "tirailleurs" et l’encadrement colonial.
La classe ouvrière ne dut compter que sur elle-même. La CGT collecta symboliquement quelques souscriptions financières venant de Paris alors que, sur place, elle stigmatisait "ceux qui voulaient leur autonomie" en se lançant dans une "grève politique". En fait, la CGT se retranchait derrière "l'opinion" de ceux de ses adhérents européens de la colonie qui s’opposaient aux revendications des "indigènes". Aussi ce comportement de la CGT poussa les cheminots indigènes à déserter massivement la centrale stalinienne suite à ce magnifique combat de classe.
SFIO, PCF, syndicats et nationalistes africains détournent la lutte de la classe ouvrière
La grève des cheminots terminée en mars 1948 s'était déroulée dans une atmosphère de grande agitation politique au lendemain du référendum ayant donné naissance à l’"Union française".1 De ce fait, le mouvement des cheminots acquit une dimension éminemment politique, en obligeant toutes les forces politiques coloniales et les éléments indépendantistes à se positionner tactiquement pour ou contre les revendications des grévistes. On vit ainsi le PCF se cacher derrière la CGT pour saboter le mouvement de grève, alors que la SFIO au pouvoir tenta de réprimer le mouvement par tous les moyens. De leur côté, Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré, deux rivaux panafricanistes qui allaient devenir respectivement présidents du Sénégal et de la Guinée, se déclarèrent ouvertement pour les revendications des cheminots.
Mais dès le lendemain de la victoire des grévistes, les forces de gauche et les nationalistes africains s’affrontèrent, les uns et les autres se revendiquant de la classe ouvrière. En instrumentalisant chacun les luttes de la classe ouvrière au service de leur chapelle, ils parvinrent à détourner la lutte autonome du prolétariat de ses véritables objectifs de classe.
Ainsi, les syndicats s’emparèrent de la question du Code du travail pour empoisonner les relations entre ouvriers. En effet, à travers ce "code", la législation sociale française avait instauré dans les colonies une véritable discrimination géographique et ethnique : d’une part, entre travailleurs d’origine européenne et travailleurs d’origine africaine ; d’autre part, entre ressortissants de différentes colonies, voire même entre citoyens d’un même pays 2. Il se trouve que la SFIO (ancêtre de l'actuel Parti Socialiste), qui avait promis en 1947 l’abolition de cet inique Code du travail, tergiversa jusqu’en 1952, donnant ainsi l’occasion aux syndicats, notamment indépendantistes africains, de focaliser exclusivement les revendications des travailleurs sur cette question à travers la mise en avant systématique du slogan "égalité de droits entre blancs et noirs". Cette idée d’égalité de droits et de traitement avec les Africains suscitait l'opposition ouverte des plus rétrogrades des syndiqués d'origine européenne de la CGT ; et il faut dire que, dans cette situation, la CGT joua un rôle particulièrement ignoble dans la mesure où elle eut tendance à profiter de cette opposition pour justifier son positionnement.
D’ailleurs, en écho, des militants de la CGT d’origine africaine 3 décidèrent alors de créer leur propre syndicat en vue de défendre les "droits spécifiques" des travailleurs africains. Tout cela donna lieu à la formulation de revendications de plus en plus nationalistes et interclassistes, comme l'illustre ce passage de la doctrine de cette organisation :
"Les conceptions importées [celles du syndicalisme français métropolitain- NDLR] éclairent insuffisamment l’évolution et les tâches de progrès économique et social en Afrique, d’autant plus que, malgré les contradictions existantes entre les diverses couches sociales locales, la domination coloniale rend inopportune toute référence à la lutte des classes et permet d’éviter la dispersion des forces dans les compétitions doctrinales". (Cité par Mar Fall, ibid)
De ce fait, les syndicats purent passer à l’acte avec efficacité car, malgré la persistance d'une combativité incessante de la classe ouvrière entre 1947 et 1958, tous les mouvements de lutte pour des revendications d’ordre salarial ou d’amélioration des conditions de travail furent détournés vers la contestation de l’ordre colonial, en faveur de l’avènement de "l’indépendance". En clair, si, lors du mouvement des cheminots de 1947-48, la classe ouvrière de la colonie de l’AOF eut encore la force de diriger sa lutte sur un terrain de classe avec succès, en revanche, par la suite, les grèves furent systématiquement contrôlées et orientées vers les objectifs des forces de la bourgeoisie, syndicats et partis politiques. Ce fut précisément cette situation qui servit de tremplin à Léopold Sédar Senghor et à Ahmed Sékou Touré pour enrôler les populations et la classe ouvrière derrière leur propre lutte pour la succession de l’autorité coloniale. Et dès la proclamation de "l’indépendance" des pays de l’AOF, les dirigeants africains décidèrent aussitôt d’intégrer les syndicats dans le giron de l'État en assignant à ceux-ci un rôle de police auprès des ouvriers. Bref, un rôle de chien de garde des intérêts de la nouvelle bourgeoisie noire aux commandes. Cela est manifeste à travers ce propos du président Senghor :
"Malgré ses services, à cause de ses services, le syndicalisme doit aujourd’hui se convertir en se faisant une idée plus précise de son rôle propre et de ses tâches. Parce qu’il y a aujourd’hui des partis politiques bien organisés et qui représentent sur le plan de la politique générale l’ensemble de la Nation, le syndicalisme doit revenir à son rôle naturel qui est, avant tout, de défendre le pouvoir d’achat de ses membres (…) La conclusion de cette réflexion est que les syndicats feront leur le programme de politique générale du parti majoritaire et des gouvernements". (Fall, ibid.)
En un mot, les syndicats et les partis politiques doivent partager le même programme en vue de la défense des intérêts de la nouvelle classe dominante. Un dirigeant syndical, David Soumah, fait écho aux propos de Senghor :
"Notre mot d’ordre durant cette lutte (anticoloniale) était que les syndicats n’avaient pas de responsabilités dans la production, qu’ils n’avaient pas à se préoccuper des répercussions de leurs revendications sur la marche d’une économie conçue dans le seul intérêt de la puissance coloniale et organisée par elle en vue de l’expansion de son économe nationale. Cette position devient sans objet au fur et à mesure de l’accession des pays africains à l’indépendance nationale et une reconversion syndicale s’impose". (Fall, ibid.)
Par conséquent, durant la première décennie de "l’indépendance", le prolétariat de l'ancienne AOF resta sans véritable réaction de classe, complètement ligoté par la nouvelle classe dirigeante assistée par les syndicats dans sa politique antiouvrière. Il fallut attendre 1968 pour la voir ressurgir sur son terrain de classe prolétarien contre sa propre bourgeoisie.
Lassou (A suivre)
1. Une "fédération" entre la France et ses colonies dont le but était d’encadrer les "indépendances" en vue.
2. Par exemple, les Sénégalais résidents des communes de Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis étaient considérés comme "citoyens français", ce qui n’était pas le cas des autres Sénégalais du pays.
3. Cela aboutit à la création de l’UGTAN (Union générale des travailleurs d’Afrique noire), syndicat par ailleurs dominé par la corporation des cheminots.
Géographique:
- Afrique [162]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" (introduction)
- 2531 lectures
Au moment où l'humanité connaît une accélération tragique de la crise économique mondiale, nous avons décidé de revenir à travers cet article sur des questions fondamentales se posant à quiconque est désireux de comprendre la dynamique de la société capitaliste pour mieux combattre un système condamné à périr soit de ses propres contradictions, soit par son renversement en vue de l'instauration d'une nouvelle société. Ces questions ont déjà été largement traitées dans de nombreuses publications du CCI mais si, aujourd'hui, nous jugeons nécessaire de les aborder à nouveau, c'est en critique à la vision développée dans le livre Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme 1. Ce livre se réclame explicitement, citations à l'appui, des analyses de Marx concernant la caractérisation des contradictions et de la dynamique du capitalisme, notamment le fait que ce système, à l'instar des autres sociétés de classe qui l'ont précédé, est nécessairement appelé à connaître successivement une phase ascendante et une phase de déclin. Mais la manière dont ce cadre théorique d'analyse est parfois interprété et appliqué à la réalité n'est pas sans ouvrir la porte à l'idée que des réformes seraient possibles au sein du capitalisme qui permettraient d'atténuer la crise. Par opposition à cette démarche que nous critiquons, l'article qui suit se veut une défense argumentée du caractère insurmontable des contradictions du capitalisme.
Dans la première partie de cet article ("Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ? [274]"), nous examinons si, depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme ayant cessé d'être un système progressiste, il est devenu, selon les propres paroles de Marx, "un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail" 2. En d'autres termes, les rapports de production propres à ce système, après avoir été un formidable facteur de développement des forces productives, ont-ils constitué, depuis 1914, un frein au développement de ces mêmes forces productives ? Dans une seconde partie ("Existe-t-il une solution à la crise au sein du capitalisme ? [275]"), nous analysons l'origine des crises de surproduction, insurmontables au sein du capitalisme, et démasquons la mystification réformiste d'une possible atténuation de la crise du capitalisme au moyen de "politiques sociales".
1 Marcel Roelandts. Éditions Contradictions. Bruxelles, 2010.
2 Principes d'une critique de l'économie politique – p. 272. Éd. La Pléiade Économie II.
Questions théoriques:
- L'économie [81]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" : le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ? (I)
- 3255 lectures
Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ?
En déchaînant la Première Guerre mondiale, les forces aveugles du capitalisme avaient été la cause d'une destruction considérable de forces productives, sans commune mesure avec les crises économiques qui avaient émaillé la croissance du capitalisme depuis sa naissance. Elles avaient plongé le monde, en particulier l'Europe, dans une barbarie menaçant d'engloutir la civilisation. Cette situation provoqua, en réaction, une vague révolutionnaire mondiale se donnant pour objectif d'en finir avec la domination d'un système dont les contradictions constituaient désormais une menace pour l'humanité. La position défendue à l'époque par l'avant-garde du prolétariat mondial s'inscrivait dans la vision de Marx pour qui "C'est par des conflits aigus, des crises, des convulsions que se traduit l'incompatibilité croissante entre le développement créateur de la société et les rapports de production établis"[1]. La Lettre d'invitation (fin janvier 1919) au Congrès de fondation de l'Internationale communiste déclare : "La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n'est pas abattu."[2]. Sa plate-forme souligne : "Une nouvelle époque est née : l'époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat."[3]
L'auteur du livre (Marcel Roelandts, identifié MR dans la suite de l'article) rejoint cette caractérisation quant à la signification de la Première Guerre mondiale et de la vague révolutionnaire internationale qui l'a suivie, souvent d'ailleurs avec les mêmes termes. Son analyse recoupe en partie les éléments suivants relatifs à l'évolution du capitalisme depuis 1914 et qui, pour nous, viennent confirmer ce diagnostic de décadence du capitalisme :
- La Première Guerre mondiale (20 millions de morts) eut pour conséquence une baisse de plus d'un tiers de la production des puissances européennes impliquées dans le conflit, phénomène d'une ampleur alors sans égale dans toute l'histoire du capitalisme ;
- Elle fut suivie par une phase de faible croissance économique débouchant sur la crise de 1929 et la dépression des années 1930. Cette dernière a entraîné une chute de la production supérieure à celle causée par la Première Guerre mondiale ;
- La Seconde Guerre mondiale, encore plus destructrice et barbare que la première (plus de 50 millions de morts), a provoqué un désastre sans comparaison possible avec la crise de 1929. Elle est venue confirmer tragiquement l'alternative posée par les révolutionnaires lors de la Première Guerre mondiale : socialisme ou barbarie.
- Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un seul instant de paix dans le monde et des centaines de guerres se sont soldées, depuis lors, par des dizaines de millions de tués, sans compter les catastrophes humanitaires (famines) qui en ont résulté. La guerre, omniprésente dans de nombreuses régions du monde, avait néanmoins épargné pendant un demi-siècle l'Europe, le principal théâtre des deux guerres mondiales. Elle y fit un retour sanglant avec le conflit en Yougoslavie à partir de1991 ;
- Durant cette période, à l'exception de la phase de prospérité des années 1950 / 60, le capitalisme, tout en maintenant une certaine croissance, n'a pu s'éviter des récessions nécessitant, pour être surmontées, l'injection dans l'économie de doses de plus en plus massives de crédit ; ce qui signifie que le maintien de cette croissance n'a pu être obtenu qu'en hypothéquant le futur au moyen d'une dette finalement impossible à rembourser ;
- L'accumulation d'une dette colossale est devenue à partir de 2007 / 2008 un obstacle incontournable au maintien de la croissance durable, même la plus faible, et a fragilisé considérablement ou menacé de faillite, non plus seulement des entreprises, des banques mais également des États, mettant à l'ordre du jour de l'histoire une récession désormais sans fin.
Nous nous sommes volontairement limités, dans cet aperçu, aux éléments les plus saillants relatifs à la crise et à la guerre et qui confèrent au 20ème siècle sa qualité de siècle le plus barbare que l'humanité ait jamais connu. Même s'ils n'en sont pas le produit mécanique, on ne peut dissocier ces éléments de la dynamique économique même du capitalisme durant cette période.
Avec quelle méthode évaluer la production capitaliste et sa croissance ?
Pour MR, ce tableau de la vie de la société depuis la Première Guerre mondiale ne suffit pas pour confirmer le diagnostic de décadence. Pour lui, "si certains arguments fondant ce diagnostic d'obsolescence du capitalisme peuvent encore se défendre, force est de reconnaître qu'il en existe d'autres [depuis la fin des années 1950] venant infirmer ses fondements les plus essentiels". Il s'appuie sur Marx pour qui il ne peut y avoir décadence du capitalisme que si "le système capitaliste devient un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail". Ainsi, selon MR, l'examen des données quantitatives ne permet raisonnablement pas de "soutenir que le système capitaliste freine les forces productives" ni "qu'il démontre son obsolescence aux yeux de l'humanité". De même, dit-il, "en comparant avec la période de plus forte croissance du capitalisme avant la Première Guerre mondiale, le développement depuis lors (1914-2008) est encore nettement supérieur" (Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, noté Dyn dans la suite de l'article ; pp. 56 et 57).
Les données empiriques doivent nécessairement être prises en compte. Mais cela ne saurait évidemment suffire. Il faut une méthode pour les analyser. En effet, face à elles, nous ne pouvons nous contenter d'un regard comptable, mais devons aller au-delà des chiffres bruts de la production et examiner attentivement de quoi la production et la croissance sont faites, de manière à identifier l'existence éventuelle de freins au développement des forces productives. Ce n'est pas le point de vue de MR pour qui "ceux qui ont maintenu le diagnostic d'obsolescence n'ont pu le faire qu'en évitant de se confronter à la réalité ou en usant d'expédients pour tenter de l'expliquer : recours au crédit, dépenses militaires et frais improductifs, existence d'un supposé marché de la décolonisation, recours à l'argument de soi-disant trucages statistiques ou de mystérieuses manipulations de la loi de la valeur, etc. En effet, rares sont les marxistes qui ont apporté une explication claire et cohérente à la croissance des Trente Glorieuses et qui sont parvenus à discuter sans a priori de certaines réalités en contradiction flagrante avec le diagnostic d'obsolescence du capitalisme". (Dyn p. 63). Nous imaginons que MR est de l'avis que lui-même appartient à la catégorie des "rares marxistes [parvenant] à discuter sans a priori" et que, de ce fait, c'est avec le plus grand empressement qu'il se saisira de la question suivante que nous lui posons, puisqu'elle ne trouve nulle trace de réponse dans son livre : en quoi le fait d'invoquer les "frais improductifs" constitue-t-il un "expédient" pour tenter d'expliquer la nature de la croissance en phase de décadence ?
En fait, comprendre de quoi est faite la production capitaliste correspond tout à fait aux nécessités de la méthode marxiste dans sa critique du capitalisme. Celle-ci a su voir en quoi ce système, grâce à l'organisation sociale de la production qui lui est propre, a été capable de faire faire un bond énorme à l'humanité en développant les forces productives à un niveau tel qu'une société basée sur la libre satisfaction des besoin humains devient une possibilité, une fois le capitalisme renversé. Peut-on dire que le développement des forces productives depuis la Première Guerre mondiale, et le prix à payer pour celui-ci par la société et la planète, ont constitué une condition nécessaire de l'éclosion de la révolution victorieuse ? En d'autres termes, le capitalisme a-t-il continué à constituer, depuis 1914, un système progressiste, favorisant les conditions matérielles de la révolution et du communisme ?
Les données quantitatives de la croissance
Le Graphique 1[4] représente (en traits continus horizontaux), sur différentes périodes depuis 1820 jusqu'à 1999, le taux moyen annuel de croissance. Il fait apparaître également les écarts significatifs du taux de croissance, au-dessus et au-dessous de ces chiffres moyens.
Les taux moyens annuels de croissance du Graphique 1 sont repris sous forme du Tableau 1 concernant la période 1820-1999. Pour compléter ce tableau, nous avons nous-mêmes estimé le taux moyen annuel de croissance sur la période 1999-2009 en utilisant une série statistique relative à cette période[5] et en nous basant sur une croissance négative mondiale de 0,5% en 2009[6].
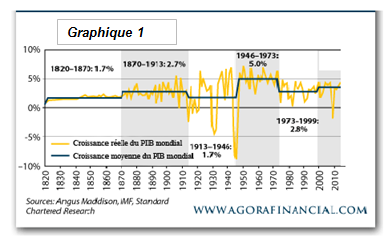
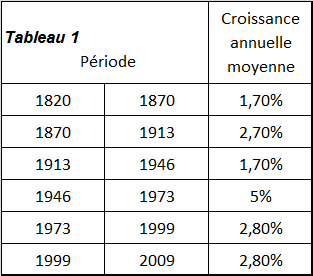
À partir des données présentées ci-dessus, un certain nombre de constats élémentaires peuvent être faits et commentés brièvement :
- Les quatre creux les plus importants de l'activité économique interviennent tous depuis 1914 et correspondent aux deux guerres mondiales, à la crise de 1929 et à la récession de 2009.
- La période la plus faste de la vie du capitalisme avant la Première Guerre mondiale est celle qui va de 1870 à 1913. Cela tient au fait qu'elle est la plus représentative d'un mode de production complètement dégagé des rapports de production hérités de la féodalité et disposant, suite à la poussée impérialiste des conquêtes coloniales[7], d'un marché mondial dont les limites ne se faisaient pas encore sentir. De surcroît, et comme conséquence de cette situation, la vente d'une quantité importante de marchandises pouvait compenser la tendance à la baisse du taux de profit et permettre de dégager une masse de profit largement suffisante à la poursuite de l'accumulation. C'est aussi cette période qui clôt la phase d'ascendance, l'entrée en décadence survenant au faîte de la prospérité capitaliste lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale.
- La période qui fait suite à la Première Guerre mondiale et s'étend jusqu'à la fin des années 1940 vient pleinement confirmer le diagnostic de décadence. En ce sens, nous partageons l'appréciation de MR selon laquelle les caractéristiques de la période 1914 – 1945, et même au-delà, jusqu'à la fin des années 1940, correspondent en tout point à la description que le mouvement révolutionnaire en 1919, dans la continuité de Marx, avait faite de la phase de décadence du capitalisme ouverte avec fracas par la guerre mondiale.
- La période des Trente Glorieuses, qui approximativement recouvre celle allant de 1946 à 1973, avec des taux de croissance bien supérieurs à ceux de 1870 - 1913, contraste énormément avec la période précédente.
- La période suivante, jusqu'à 2009, présente des taux de croissance légèrement supérieurs à la phase la plus faste de l'ascendance du capitalisme.
Les Trente Glorieuses remettent-elles en cause le diagnostic de décadence ? La période suivante confirme-t-elle qu'elles n'auraient pas constitué une exception ?
Le niveau de l'activité économique de chacune de ces deux périodes trouve des explications dans les modifications qualitatives de la production intervenues depuis 1914, en particulier avec le gonflement des dépenses improductives, dans la manière dont le crédit a été utilisé depuis les années 1950 et, également, avec la création de valeur fictive à travers ce qui est appelé la financiarisation de l'économie.
Les dépenses improductives
Qu'entend-on par dépenses improductives ?
Nous rangeons dans la catégorie des dépenses improductives le coût de cette partie de la production dont la valeur d'usage ne permet pas qu'elle puisse être employée, de quelque manière que ce soit, dans la reproduction simple ou élargie du capital. L'exemple le plus parlant de dépense improductive est celui relatif à la production d'armements. Les armes peuvent servir à faire la guerre mais pas à produire quoi que ce soit, pas même d'autres armes. Les dépenses de luxe destinées essentiellement à agrémenter la vie de la bourgeoisie entrent également dans cette catégorie. Marx en parlait en ces termes péjoratifs : "Une grande partie du produit annuel est consommée comme revenu et ne retourne pas à la production comme moyen de production ; il s'agit de produits (valeurs d'usage) extrêmement nuisibles, qui ne font qu'assouvir les passions, lubies, etc. les plus misérables"[8].
Le renforcement de l'appareil étatique
Entrent également dans cette catégorie toutes les dépenses prises en charge par l'État et qui sont destinées à faire face aux contradictions croissantes qu'affronte le capitalisme sur les plans économique, impérialiste et social. Ainsi, à côté des dépenses d'armements on trouve également le coût de l'entretien de l'appareil répressif et judiciaire, de même que celui de l'encadrement de la classe ouvrière (syndicats). Il est difficile d'estimer la part des dépenses de l'État qui appartiennent à la catégorie des dépenses improductives. En effet, un poste comme l'éducation qui, a priori, est nécessaire au maintien et au développement de la productivité du travail (laquelle nécessite une main d'œuvre éduquée) comporte aussi une dimension improductive notamment comme moyen de masquer et rendre plus supportable le chômage à la jeunesse. D'une manière générale, comme le met d'ailleurs fort bien en évidence MR, "Le renforcement de l'appareil étatique, ainsi que son intervention croissante au sein de la société ont constitué l'une des manifestations les plus évidentes d'une phase d'obsolescence d'un mode de production (…) Oscillant autour de 10 % tout au long de la phase ascendante du capitalisme, la part de l'État dans les pays de l'OCDE grimpe progressivement depuis la Première Guerre mondiale pour avoisiner les 50% en 1995, avec une fourchette basse autour de 35% pour les États-Unis et le Japon, et une haute de 60 à 70% pour les pays nordiques" (Dyn pp. 48 et 49).
Parmi ces dépenses, le coût du militarisme surpasse largement les 10% du budget militaire atteint en certaines circonstances par certains des pays les plus industrialisés, puisqu'à la fabrication de l'armement il faut ajouter le coût des différentes guerres. Le poids croissant du militarisme[9] depuis la Première Guerre mondiale n'est évidemment pas un phénomène indépendant de la vie de la société mais constitue bien l'expression du haut niveau des contradictions économiques qui contraignent chaque puissance à s'engager toujours davantage dans la fuite en avant dans les préparatifs guerriers, en tant que condition de sa survie dans l'arène mondiale.
Le poids des dépenses improductives dans l'économie
Le pourcentage des dépenses improductives, qui dépasse très certainement les 20% du PIB, ne correspond, dans la réalité, qu'à la stérilisation d'une partie importante de la richesse créée qui ne peut ainsi être employée à la création d'une plus grande richesse, ce qui est fondamentalement contraire à l'essence du capitalisme. Nous avons ici la claire manifestation d'un freinage au développement des forces productives qui trouve son origine dans les rapports de production eux-mêmes.
A ces dépenses improductives, il convient d'en ajouter un autre type, celui des trafics en tous genres, la drogue en particulier, qui constitue une consommation improductive mais qui, cependant, est comptabilisée en partie dans le PIB. Ainsi, le blanchiment des revenus du commerce de cette activité illicite représente quelques pourcents du PIB mondial :"Les trafiquants de drogue auraient blanchi environ 1600 milliards de dollars, soit 2,7% du PIB mondial, en 2009, (…) selon un nouveau rapport publié mardi par l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC) (…) Le rapport de l’ONUDC indique que tous les bénéfices de la criminalité, à l’exclusion d’évasions fiscales, s’élèveraient à environ 2100 milliards de dollars, ou 3,6% du PIB en 2009"[10].
Pour rétablir la vérité concernant la croissance réelle, ce sont environ 3,5% supplémentaires du montant du PIB qui devraient lui être amputés du fait du blanchiment de l'argent des différents trafics.
Le rôle des dépenses improductives dans le miracle des Trente Glorieuses
Les mesures keynésiennes, visant à stimuler la demande finale et ayant ainsi permis que les problèmes de surproduction ne se manifestent pas ouvertement durant toute une partie de la période des Trente Glorieuses, sont en grande partie des dépenses improductives dont le coût a été pris en charge par l'État. Parmi celles-ci figurent les hausses de salaires, au-delà de ce qui est socialement nécessaire à la reproduction de la force de travail. Le secret de la prospérité de la période des Trente Glorieuses se résume à un énorme gaspillage de plus-value qui a pu alors être supporté par l'économie grâce aux gains importants de productivité enregistrés durant cette période.
Le miracle des Trente Glorieuses a donc, dans des conditions favorables, été permis par une politique de la bourgeoisie qui, instruite par la crise de 1929 et la dépression des années 1930, s'est appliquée à retarder le retour ouvert de la crise de surproduction. En ce sens, cet épisode de la vie du capitalisme correspond bien à ce qu'en dit MR : "La période exceptionnelle de prospérité d'après-guerre apparaît en tous points analogue aux parenthèses de reprise durant les périodes d'obsolescence antique et féodale. Nous faisons donc nôtre l'hypothèse que les Trente Glorieuses ne constituent qu'une parenthèse dans le cours d'un mode de production qui a épuisé sa mission historique." (Dyn p. 65).
Des mesures keynésiennes seraient-elles à nouveau envisageables ? On ne peut exclure que des avancées scientifiques et technologiques viennent à nouveau permettre des gains de productivité importants et la réduction des coûts de production des marchandises. Il continuerait néanmoins de se poser la question d'un acquéreur pour celles-ci vu qu'il n'existe plus de marché extra-capitaliste et guère plus de possibilité d'augmenter la demande au moyen d'un endettement supplémentaire. Dans ces conditions la répétition du boom des Trente Glorieuses apparaît totalement irréaliste.
La financiarisation de l'économie
Nous reproduisons ici le sens le plus communément admis de ce terme : "La financiarisation est au sens strict le recours au financement et en particulier à l'endettement, de la part des agents économiques. On appelle par ailleurs financiarisation de l'économie la part croissante des activités financières (services de banque, d'assurance et de placements) dans le PIB des pays développés notamment. Elle provient d'une multiplication exponentielle des types d'actifs financiers et du développement de la pratique des opérations financières, tant par les entreprises et autres institutions que par les particuliers. On peut parler par ailleurs d'un essor du capital financier à distinguer de la notion plus étroite de capital centrée sur les équipements de production"[11]. Nous nous distinguons nettement des altermondialistes, et de la gauche du capital en général, pour qui la financiarisation de l'économie serait à l'origine de la crise que traverse actuellement le capitalisme. Nous avons largement développé dans notre presse en quoi c'est exactement l'inverse dont il s'agit[12]. En effet, c'est parce que l'économie "réelle" est plongée depuis des décennies dans un profond marasme que les capitaux tendent à se détourner de cette sphère qui est de moins en moins rentable. MR semble partager notre point de vue. Ceci étant dit, il ne semble pas intéressé à prendre en compte les implications significatives de ce phénomène pour la composition des PIB.
Les États-Unis sont certainement le pays où l'activité financière a connu le développement le plus important. Ainsi, en 2007, 40% des profits du secteur privé aux États-Unis ont été réalisés par les banques, qui n'emploient que 5% des salariés[13]. Le Tableau 2 détaille, pour les États-Unis et l'Europe, le poids pris par les activités financières[14] (l'évolution parallèle de la production industrielle aux États-Unis sur la même période n'a été donnée qu'à titre indicatif) :
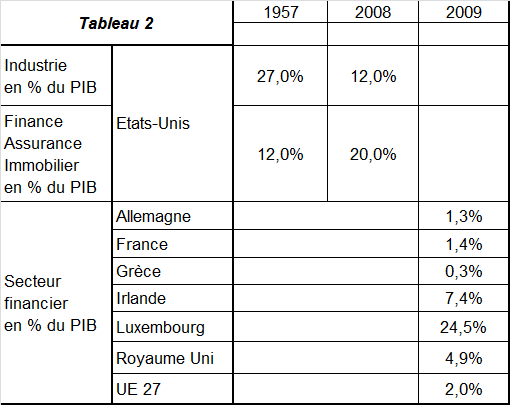
Contrairement aux dépenses improductives, nous n'avons pas ici affaire à une stérilisation de capital, mais dans le même sens que celles-ci, le développement de la finance induit un gonflement artificiel de l'estimation de la richesse annuelle de certains pays, dans une fourchette qui va de 2% pour l'Union Européenne à 27% pour les États-Unis. En effet, la création de produits financiers ne s'accompagne pas de la création d'une richesse réelle, si bien que, en toute objectivité, sa contribution à la richesse nationale est nulle.
Si l'on expurgeait du PIB l'activité correspondant à la financiarisation de l'économie, l'ensemble des principaux pays industrialisés verrait leur PIB diminué d'un pourcentage variant entre 2% et 20%. Une moyenne de 10% parait acceptable compte-tenu du poids respectif de l'UE et des États-Unis.
Le recours croissant à l'endettement depuis les années 1950
De notre point de vue, se priver de prendre en compte l'endettement croissant qui accompagne le développement du capitalisme depuis les années 1950 relève des mêmes préjugés qui consistent à écarter l'analyse qualitative de la croissance.
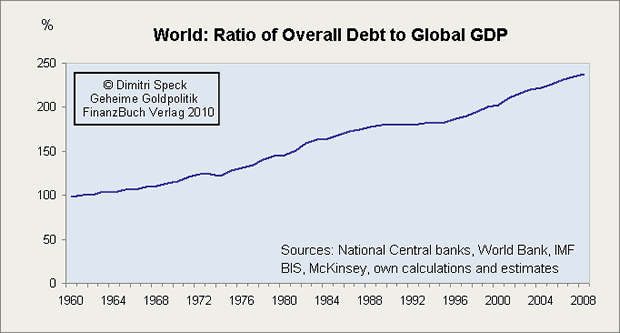
Peut-on nier sa réalité ? Le Graphique 2 illustre la progression de l'endettement total mondial (relativement à celle du PIB) depuis les années 1960. Durant cette période, l'endettement augmente plus rapidement que la croissance économique.
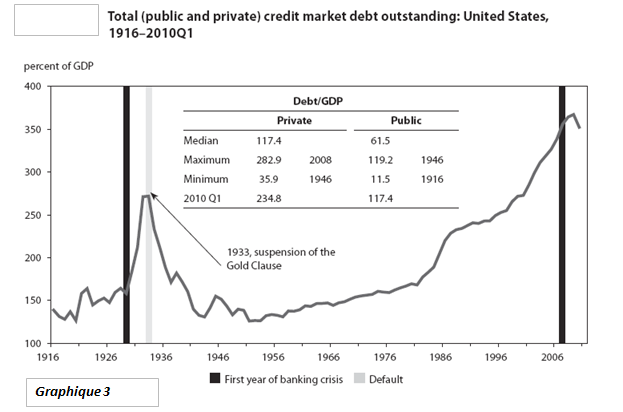 Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Depuis les années 1950-60, l'endettement a constitué la "demande solvable" qui a permis à l'économie de croître. Il s'agit d'un endettement croissant qui, pour l'essentiel, était condamné à ne pouvoir être remboursé, comme en témoigne la situation actuelle de surendettement de tous les acteurs économiques dans tous les pays. Une telle situation, en mettant à l'ordre du jour la faillite d'acteurs économiques majeurs, dont des États, signe la fin de la croissance au moyen d'un accroissement de la dette. Autant dire que cela signifie la fin de la croissance tout court, en dehors de phases limitées dans le temps au sein d'un cours général à la dépression. Il est indispensable de prendre en compte, dans nos analyses, le fait que la réalité va infliger une correction brutale à la baisse des taux de croissance depuis les années 1960. Ce ne sera que le retour de bâton d'une énorme tricherie avec la loi de la valeur. MR rejette l'expression "tricherie avec la loi de la valeur" pour qualifier cette pratique au sein du capitalisme mondial. Elle est pourtant de la même nature que les mesures de protectionnisme qui avaient été prises en URSS afin de maintenir artificiellement en vie une économie très peu performante par rapport à celle des principaux pays du bloc occidental. L'effondrement du bloc de l'Est vint rétablir la vérité. MR devra-t-il attendre l'effondrement de l'économie mondiale pour se rendre compte des conséquences de l'existence d'une masse de dettes non remboursables ?
En toute rigueur, afin de pouvoir juger objectivement de la croissance réelle depuis les années 1960, il faudrait amputer l'augmentation officielle du PIB entre 1960 et 2010 du montant de l'accroissement de la dette durant la même période. En fait, comme le montre le Graphique 2, l'augmentation du PIB mondial a été moins importante que l'accroissement de la dette mondiale sur la période concernée. Si bien que cette période importante des Trente Glorieuses, non seulement n'a pas été génératrice de richesse, mais a participé de créer un déficit mondial qui réduit à néant le miracle des Trente Glorieuses.
L'évolution des conditions de vie de la classe ouvrière
Durant toute la période d'ascendance du capitalisme, la classe ouvrière avait pu arracher des réformes durables sur le plan économique concernant la réduction du temps de travail et l'augmentation des salaires. Celles-ci résultaient à la fois de la lutte revendicative et de la capacité du système de les accorder, en particulier grâce à des gains de productivité importants. Cette situation change avec l'entrée du capitalisme en décadence où, sauf en ce qui concerne la période des Trente Glorieuses, les gains de productivité se trouvent de plus en plus mis au service de la mobilisation de chaque bourgeoisie nationale contre les contradictions qui se manifestent sur tous les plans (économique, militaire et social) et se traduisent, comme on l'a vu, par le renforcement de l'appareil étatique.
Les augmentations de salaires depuis la Première Guerre mondiale ne sont plus, en général, que des rattrapages de la hausse constante du niveau des prix. Les augmentations accordées en France en juin 1936 (accords de Matignon : 12% en moyenne) étaient annulées en six mois puisque, rien que de septembre 1936 à janvier 1937, les prix avaient monté en moyenne de 11%. On sait également ce qui resta un an plus tard des augmentations obtenues en mai 1968 avec les accords de Grenelle.
Sur cette question, MR s'exprime en ces termes : "De même, le mouvement communiste a défendu l'idée que des réformes réelles et durables sur le plan social étaient désormais impossibles à obtenir après la Première Guerre mondiale. Or, si l'on examine l'évolution séculaire des salaires réels et du temps de travail, non seulement rien ne vient attester une telle conclusion, mais les données indiquent le contraire. Ainsi, si les salaires réels dans les pays développés ont, au grand maximum, doublé ou triplé avant 1914, ils ont été multipliés par six à sept ensuite : soit trois à quatre fois mieux durant la période de 'décadence' du capitalisme que durant son ascendance" (Dyn p. 57).
Il est assez difficile de discuter de cette analyse, vu que ce sont des ordres de grandeur très approximatifs qui sont fournis. On peut très bien comprendre qu'il soit difficile de faire mieux compte tenu du matériel disponible sur cette question, mais le minimum de la rigueur scientifique était de citer les sources à partir desquelles des extrapolations éventuelles ont été effectuées. De plus, on nous parle des augmentations de salaires en ascendance et en décadence du capitalisme sans indiquer les périodes auxquelles elles s’appliquent. Il est aisé de comprendre qu'une augmentation sur 30 ans ne peut être comparée à une augmentation sur 100 ans (sauf si celles-ci sont données sous la forme d'augmentations moyennes annuelles, ce qui n'est manifestement pas le cas). Mais, de plus, la connaissance de la période est importante pour que la comparaison puisse intégrer d'autres données de la vie de la société, primordiales à notre sens pour relativiser la réalité des hausses de salaires. Il en est ainsi en particulier de l'évolution du chômage. Une augmentation du salaire concomitante à celle du chômage peut très bien avoir pour conséquence une baisse du niveau de vie des ouvriers.
Dans le livre, à la suite du passage que nous venons de commenter, est publié un graphique dont le titre annonce qu'il concerne à la fois l'augmentation des salaires réels en Grande-Bretagne de 1750 à 1910 et celle d'un manœuvre en France de 1840 à 1974. Mais, manque de chance, les données relatives au manœuvre français sont absentes pour la période s'étendant entre 1840 et 1900 et illisibles concernant la période 1950 - 1980. Plus exploitables sont les informations relatives à la Grande-Bretagne. De 1860 à 1900, il semblerait que le salaire réel y ait augmenté de 60 à 100, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,29% sur la période. Nous retenons ce dernier chiffre comme pouvant être indicatif de l'augmentation des salaires en période d'ascendance.
Pour l'examen des salaires en décadence, nous procéderons à la division de cette période en deux sous périodes :
- de 1914 à 1950, période pour laquelle nous ne disposons pas de séries statistiques mais de chiffres épars et hétérogènes, significatifs toutefois d'un niveau de vie affecté par les deux guerres mondiales et la crise de 29 ;
- la période suivante, qui court jusqu'à nos jours, pour laquelle nous disposons de davantage de données fiables et homogènes.
1) 1914-1950[16]:
Pour les pays européens, la Première Guerre mondiale est synonyme d'inflation et de pénurie de marchandises. Après celle-ci, les deux camps se trouvent face à la nécessité de rembourser une dette colossale (trois fois supérieure au revenu national d'avant-guerre dans le cas de l'Allemagne) ayant servi à financer l'effort de guerre. La bourgeoisie la fera payer à la classe ouvrière et à la petite bourgeoisie à travers l'inflation qui, en même temps qu'elle réduit la valeur de la dette, opère une diminution drastique des revenus et a pour effet que l'épargne s'envole en fumée. En Allemagne en particulier, de 1919 à 1923, l'ouvrier voit son revenu diminuer sans arrêt, avec des salaires très inférieurs à ceux d'avant-guerre. C'est le cas aussi en France, et dans une moindre mesure en Angleterre. Cependant, toute la période de l'entre-deux-guerres se caractérisera pour ce pays par un chômage permanent immobilisant des millions de travailleurs, phénomène inconnu jusque-là dans l'histoire du capitalisme tant anglais que mondial. En Allemagne, y compris lorsque se termine la période de forte inflation, vers 1924, et jusqu'à la crise de 1929, le nombre des chômeurs reste toujours largement supérieur à 1 million (2 millions en 1926).
Contrairement à l'Allemagne, mais comme la France, la Grande-Bretagne n'avait pas encore retrouvé en 1929 sa position de 1913.
Tout autre est la dynamique des États-Unis. Avant la guerre, le développement de l'industrie américaine suivait un rythme plus rapide que celui de l'Europe. Cette tendance allait se renforcer pendant toute la période qui va de la fin de la guerre jusqu'au commencement de la crise économique mondiale. Ainsi, les États-Unis traversent la Première Guerre mondiale et la période qui s'ensuit dans la prospérité, jusqu'à la crise ouverte de 1929. Mais cette dernière a pour effet de ramener le salaire réel de l'ouvrier américain à un niveau inférieur à celui de 1890 (il ne représente plus alors que 87% de celui-ci), l'évolution pour cette période étant celle présentée dans le Tableau 3[17] :
2) de 1951 à nos jours (en comparaison à 1880 – 1910)
Nous disposons des statistiques du Tableau 4 concernant l'évolution des salaires de l'ouvrier français :
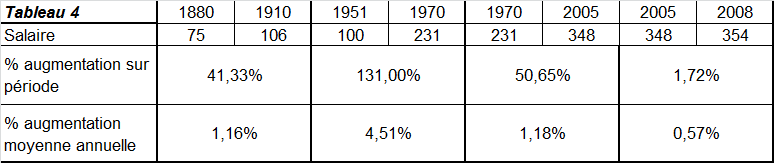
- exprimée en francs sur la période 1880 - 1910[18]
- exprimée sur une base 100 en 1951 sur la période 1951 – 2008[19]
Le Tableau 4 fait apparaître les réalités suivantes :
- La période 1951 – 1970, au cœur des Trente Glorieuses, connaît les taux d'augmentation de salaires les plus importants de l'histoire du capitalisme, ce qui est cohérent avec la phase de croissance économique qui lui correspond et ses particularités, à savoir les mesures keynésiennes de soutien de la demande finale au moyen, entre autres, de l'augmentation des salaires.
De tels taux de croissance des salaires s'expliquent aussi par d'autres facteurs loin d'être secondaires :
- le niveau de vie en France en 1950 était très bas, ce qui va de pair avec le fait que c'est seulement en 1949 que fut aboli le système des cartes et tickets de rationnement mis en place en 1941 pour faire face à la pénurie relative à la période de guerre.
- Depuis les années 1950, le coût de la reproduction de la force de travail doit inclure un certain nombre de frais qui n'existaient pas auparavant de façon aussi importante : les exigences de technicité accrue d'un nombre important d'emplois impliquent que les enfants de la classe ouvrière sont scolarisés jusqu'à un âge plus élevé, en restant à la charge de leurs parents ; les conditions "modernes" de travail dans les grandes villes ont également un coût. Si des objets ménagers entourent le prolétaire moderne alors que ce n'était pas le cas au 19e siècle, ce n'est pas le signe d'un meilleur niveau de vie de ce premier, son exploitation relative n'ayant fait que croître. Beaucoup de ces "objets ménagers" n'existaient pas auparavant : chez les bourgeois, c'étaient les domestiques qui faisaient tout à la main. Ils sont devenus indispensables dans les foyers ouvriers, pour gagner du temps, alors que souvent ce sont l'homme et la femme qui doivent travailler pour faire vivre la famille. De même, l'automobile, lorsqu'elle est apparue, était un luxe réservé aux riches. Celle-ci est devenue un objet incontournable pour beaucoup de prolétaires, afin de pouvoir se rendre sur le lieu de travail autrement qu'en passant des heures dans des transports publics insuffisants. C'est l'élévation de la productivité du travail qui a permis de produire de tels objets, qui ont cessé d'être de luxe, à un coût compatible avec le niveau des salaires ouvriers.
- b) La période suivante, 1970 – 2005, connaît des taux d'augmentation de salaires sensiblement égaux à ceux de l'ascendance du capitalisme (1,18% contre 1,16% - pour mémoire l'augmentation est de 1,29% en Grande-Bretagne sur la période 1860 - 1900). Ceci dit, un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte qui fait apparaître qu'en réalité les conditions de vie de la classe ouvrière ne se sont pas améliorées dans les mêmes proportions, et se sont même dégradées par rapport à la période précédente :
- Cette période correspond à une montée importante du chômage qui affecte lourdement le niveau de vie des foyers ouvriers. Pour la France, nous disposons des chiffres du chômage présentés dans le Tableau 5[20]:
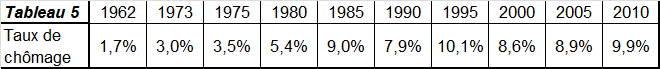
- A partir des années 1980, des directives visant à faire diminuer les chiffres officiels du chômage ont nécessité la modification de la méthode de décompte des chômeurs (par exemple, en ne comptabilisant pas le chômage partiel) et ont aussi abouti à la radiation de chômeurs sur des critères de plus en plus sévères. C'est fondamentalement ce qui explique la moindre envolée du chômage par la suite.
- La période postérieure à 1985 voit se développer la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée et le travail à temps partiel, qui n'est autre qu'un chômage déguisé.
- L'évaluation du salaire réel, ajustée au moyen de l'estimation officielle du coût de la vie, est largement surestimée par les données officielles. C'est à un point tel que l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) en France ne peut faire autrement que d'admettre une différence entre l'inflation officielle et l'inflation "perçue", cette dernière étant basée sur le constat des ménages d'une augmentation des produits de base indispensables (les postes dits incompressibles) bien supérieure à celle de l'inflation officielle[21].
- c) La période 2005 – 2008, bien que plus courte que la précédente, avec ses taux officiels d'augmentation de salaires voisins de 0,5%, est néanmoins plus significative car elle annonce l'avenir. En effet, cette augmentation de seulement 0,5% correspond à une détérioration encore plus importante, en ce sens que tous les facteurs invoqués pour la période précédente sont encore à prendre en compte mais dans des proportions plus grandes. En fait, c'est la disponibilité des statistiques sur les salaires qui nous faire clore en 2008 la période qui commence en 2005. Depuis 2008, la situation de la classe ouvrière a connu une détérioration très importante qui ne peut être ignorée dans notre étude, comme en témoigne l'évolution des chiffres de la pauvreté. En 2009, la proportion de pauvres en France métropolitaine a non seulement augmenté, mais leur pauvreté s’est accrue. Elle concerne désormais 13,5% de la population soit 8,2 millions de personnes, 400 000 de plus qu'en 2008.
Que retenir de presqu'un siècle de développement du capitalisme ?
Nous avons vu que la prise en compte, dans les PIB, de l'ensemble des dépenses improductives, des activités purement financières ou mafieuses contribuait grandement à une surestimation de la richesse créée annuellement.
Nous avons vu également que les contradictions mêmes du capitalisme stérilisent un pourcentage significatif de la production capitaliste (en particulier à travers la production "improductive"). Quant aux conditions de vie de la classe ouvrière, elles sont loin d'être aussi brillantes que les statistiques officielles essaient de le faire croire.
En plus de cela, il est un aspect que ne met pas en évidence l'examen de la production ou de la condition ouvrière que nous avons effectuée, c'est le coût qu'a impliqué la domination des rapports de production capitalistes depuis la Première Guerre mondiale, tant en terme de destruction du milieu ambiant que d'épuisement des ressources de la Terre en matières premières. C'est difficilement chiffrable mais terriblement crucial pour le devenir de l'humanité. C'est une raison supplémentaire, et pas des moindres, pour exclure de façon décisive que le capitalisme ait pu depuis près d'un siècle constituer, du point de vue du devenir de la classe ouvrière et du devenir de l'humanité, un système progressiste.
MR fait le constat que le développement capitaliste a été accompagné durant cette période, de guerres, de barbarie et de dommages à l'environnement. Par ailleurs, et de façon tout-à-fait surprenante, il conclut sa plaidoirie visant à démontrer que les rapports de production n'ont pas constitué, depuis les années 1950, un frein croissant au développement des forces productives, en affirmant que le système est bien en décadence : "Pour notre part, il n'y a donc aucune contradiction à reconnaître, d'un côté, l'indéniable prospérité de la période d'après-guerre avec toutes ses conséquences et à néanmoins maintenir, de l'autre côté, le diagnostic d'obsolescence historique du capitalisme depuis le début du XXème siècle. Il en découle que, pour l'immense majorité de la population laborieuse, le capitalisme ne lui est pas encore apparu comme un outil obsolète dont elle devrait se débarrasser : il a toujours pu faire espérer que 'demain sera meilleur qu'hier'. Si cette configuration tend aujourd'hui à s'inverser dans les vieux pays industrialisés, c'est loin d'être le cas pour les pays émergents" (Dyn p. 67). Si donc le critère marxiste d'un freinage des forces productives ne peut plus être retenu pour caractériser la décadence d'un mode de production, sur quoi donc fonder celle-ci ? Réponse de MR, la "domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié", ce qu'il explique en ces termes : "La fin de la conquête coloniale au début du XXème siècle, et la domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié vont marquer un tournant historique et inaugurer une nouvelle phase du capitalisme " (Dyn p. 41). Et en quoi cette caractéristique de la nouvelle phase du capitalisme permet-elle d'expliquer la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 ? Comment permet-elle de faire le lien avec les nécessaires luttes de résistance du prolétariat face aux manifestations des contradictions du capitalisme ? Nous n'avons pas trouvé de réponse à ces questions dans le livre.
Nous reviendrons en partie sur celles-ci dans la deuxième partie de l'article, au sein de laquelle nous examinerons également en quoi MR met la théorie marxiste, adaptée par ses soins, au service du réformisme.
Silvio (décembre 2011)
[1] Principes d'une critique de l'économie politique – p. 273. Éd. La Pléiade Économie II.
[2] Plate-forme de l'Internationale communiste, P. Broué, EDI, 1974.
[3] Idem.
[4] Ce graphique est une adaptation d'un graphique reproduit au lien suivant : www.regards-citoyens.com/article-quelques-nouvelles-du-pib-mondial-par-a... [276]. Nous avons supprimé de celui-ci la partie estimation sur la période 2000 – 2030.
[5] equity-analyst.com/world-gdp-us-in-absolute-term-from-1960-2008.html
[6] Conforme aux statistiques du FMI : Perspectives de l'économie mondiale, p. 2, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship-issues/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/_textfpdf.ashx [277]
[7] "de 1850 à 1914, le commerce mondial est multiplié par 7, celui de la Grande-Bretagne par 5 pour les importations et par 8 pour les exportations. De 1875 à 1913, le commerce global de l’Allemagne est multiplié par 3,5, celui de la Grande-Bretagne par 2 et celui des États-Unis par 4,7. Enfin, le revenu national en Allemagne est multiplié par près de 4 entre 1871 et 1910, celui des États-Unis de près de 5." (thucydide.over-blog.net/article-6729346.html)
[8] Matériaux pour l'"Économie" – p. 394. Éd. La Pléiade Économie II.
[9] Lire à ce sujet nos deux articles des Revue internationale n° 52 et 53, "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme"
[10] Drogues Blog. droguesblog.wordpress.com/2011/10/27/la-presse-ca-trafic-de-drogue-chiffres-astronomiques-saisies-minimes-selon-lonu
[12] Lire en particulier "Crise économique : ils accusent la finance pour épargner le capitalisme ! [279]".
[13] lexinter.net/JF/financiarisation_de_l'economie.htm
[14] socio13.wordpress.com/2011/06/06/la-financiarisation-de-l’accumulation-par-john-bellamy-foster-version-complete
[15] A decade of debt, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. https://www.piie.com/publications/chapters_preview/6222/01iie6222.pdf [280]. Légend :Debt / GDP:Dette / PIB
[16] Les données chiffrées ou qualitatives contenues dans l'étude de cette période, dont la source ne figure pas explicitement, sont extraites du livre Le conflit du siècle, de Fritz Sternberg. Éditions du Seuil.
[17] Stanley Lebergott, Journal of the American Statistical Association.
[20] Pour 1962 et 1973, source : "La rupture : les décennies 1960-1980, des Trente Glorieuses aux Trente Piteuses".
Guy Caire. www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Guy_Caire_-_La_rupture-_les_decennies_1960-198O_d... [283]. Pour 1975 à 2005, source : INSEE. www.insee.fr/fr/statistiques [282]. Pour 2010, source Google. https://www.google.fr/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:fr&fdim_y=seasonality:sa&dl=fr&hl=fr&q=taux+de+chômage+en+france [284] :
[21] En fait l'inflation officielle est basée également sur l'évolution du coût de produits que les consommateurs achètent rarement ou qui ne sont pas indispensables. https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20100813trib000538586/comment-reconcilier-les-menages-francais-avec-l-insee.html [285]
Questions théoriques:
- L'économie [81]
Décadence du capitalisme (XII) : 40 années de crise ouverte montrent que le capitalisme en déclin est incurable
- 2959 lectures
Le boom d'après-guerre en a conduit beaucoup à conclure que le marxisme était obsolète, que le capitalisme avait découvert le secret de l'éternelle jeunesse 1 et que désormais la classe ouvrière ne constituait plus l'instrument du changement révolutionnaire. Mais une petite minorité de révolutionnaires, travaillant très souvent dans un isolement quasi total, maintenait ses convictions envers les principes fondamentaux du marxisme. L'un des plus importants d'entre eux était Paul Mattick aux États-Unis. Mattick répondit à Marcuse, qui cherchait à découvrir un nouvel acteur révolutionnaire, en publiant Les limites de l’intégration : l'homme unidimensionnel dans la société de classe (1972) 2, où il réaffirmait le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière pour le renversement du capitalisme. Mais sa contribution la plus durable a probablement été son livre Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, publié pour la première fois en 1969 (en français en 1972) mais basé sur des études et des essais réalisés dès les années 1950.
Bien qu'à la fin des années 1960 les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique ouverte aient commencé à apparaître (avec, par exemple, la dévaluation de la livre sterling en 1967), défendre l'idée que le capitalisme était toujours un système miné par une crise structurelle profonde était vraiment aller à contre le courant. Mais Mattick était là, plus de 30 ans après avoir résumé et développé la théorie de Henryk Grossman sur l'effondrement du capitalisme dans son travail majeur, "La crise permanente" (1934) 3, et il maintenait que le capitalisme était toujours un système social en régression, que les contradictions sous-jacentes au processus d'accumulation n'avaient pas été exorcisées et étaient vouées à ressurgir. Se centrant sur l'utilisation de l'État par la bourgeoisie afin de réguler le processus d'accumulation, sous la forme keynésienne d' "économie mixte" en faveur en Occident, ou dans sa version stalinienne à l'Est, il montra que l'obligation d'interférer dans l'opération de la loi de la valeur ne constituait pas le signe d'un dépassement des contradictions du système (comme Paul Cardan / Cornelius Castoriadis, par exemple, l'a notamment défendu dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne, 1979) mais était précisément une expression de son déclin :
- "Malgré la longue durée de la conjoncture dite de prospérité, que les pays industriels avancés ont connue, rien ne permet de supposer que la production de capital a pu venir à bout des contradictions qui lui sont inhérentes par le biais d'interventions étatiques. Au contraire, la multiplication de ces dernières dénote la persistance de la crise subie par la production de capital, tandis que la croissance du secteur déterminé par l'État rend manifeste le déclin toujours plus accentué du système de l'entreprise privée." (page 188) 4 "On s'apercevra alors que les solutions keynésiennes étaient factices, aptes à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200)
Ainsi, Mattick maintenait que "… le capitalisme – en dépit de tout ce qui en apparence pourrait donner à penser le contraire – est devenu aujourd'hui un système régressif et destructeur" (page 315) 5. Ainsi, au début du chapitre 19, "L'impératif impérialiste", Mattick affirme que le capitalisme ne peut pas échapper à la tendance à la guerre car elle est le résultat logique du blocage du processus d'accumulation. Mais tout en écrivant que : "… on peut supposer que, par le biais de la guerre, [la production pour le gaspillage] amènera des transformations structurelles de l'économie mondiale et du rapport de forces politiques permettant aux puissances victorieuses de bénéficier d'une nouvelle phase d'expansion" (page 329), il ajoute aussitôt que cela ne doit pas rassurer la bourgeoisie pour autant : "Mais ce genre d'optimisme a cessé de prévaloir en raison des capacités de destruction propres aux armes modernes, dont les engins atomiques." (page 330, idem). De plus, pour le capitalisme, "savoir que la guerre peut conduire à un suicide général (...) n'affaiblit en rien la tendance à une nouvelle guerre mondiale." (idem). La perspective qu'il annonce dans la dernière phrase de son livre reste donc celle que les révolutionnaires avaient annoncée à l'époque de la Première Guerre mondiale : "socialisme ou barbarie".
Cependant, il y a certains défauts dans l'analyse que fait Mattick de la décadence du capitalisme dans Marx et Keynes. D'un côté, il voit la tendance à la distorsion de la loi de la valeur comme une expression du déclin ; mais, de l'autre, il prétend que les pays entièrement étatisés du bloc de l'Est ne sont plus assujettis à la loi de la valeur et donc à la tendance aux crises. Il défend même que, du point de vue du capital privé, ces régimes peuvent être "définis comme un socialisme d'État, du seul fait que le capital y est centralisé par l'État" (page 383) 6, même si du point de vue de la classe ouvrière, il faut les décrire comme du capitalisme d'État. En tous cas, "le capitalisme d'État ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival (....) le capitalisme d'État peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."(page 350) 7. Il développe l'idée selon laquelle les États staliniens constituent, en un sens, un système différent, profondément antagoniste aux formes occidentales de capitalisme – et c'est dans cet antagonisme qu'il semble situer la force motrice derrière la Guerre froide, puisqu'il écrit à propos de l'impérialisme contemporain que "contrairement à l'impérialisme et au colonialisme du temps du laisser-faire, il s'agit cette fois non seulement d'une lutte pour des sources de matières premières, des marchés privilégiés et des champs d'exportation du capital, mais aussi d'une lutte contre de nouvelles formes de production de capital échappant aux rapports de valeur et aux mécanismes concurrentiels du marché et donc, en ce sens ,d'une lutte pour la survie du système de la propriété privé." (page 318) 8. Cette interprétation va de pair avec son argument selon lequel les pays du bloc de l'Est n'ont pas, strictement parlant, de dynamique impérialiste propre.
Le groupe Internationalism aux États-Unis - qui allait devenir plus tard une section du CCI - releva cette faiblesse dans l'article qu'il publia dans le n° 2 de sa revue au début des années 1970, "Capitalisme d'État et loi de la valeur, une réponse à Marx et Keynes". L'article montre que l'analyse par Mattick des régimes staliniens sape le concept de décadence qu'il défend par ailleurs : car si le capitalisme d'État n'est pas sujet aux crises ; s'il est en fait, comme le défend Mattick, plus favorable à la cybernétisation et au développement des forces productives ; si le système stalinien n'est pas poussé à suivre ses tendances impérialistes ; alors les fondements matériels de la révolution communiste tendent à disparaître et l'alternative historique posée par l'époque de déclin devient également inintelligible :
- "L'utilisation par Mattick du terme capitalisme d'État est donc une appellation impropre. Le capitalisme d'État ou "socialisme d'État", que Mattick décrit comme un mode de production exploiteur mais non capitaliste, ressemble beaucoup à la description par Bruno Rizzi et Max Shachtman du "collectivisme bureaucratique", développée dans les années d'avant-guerre. L'effondrement économique du capitalisme, du mode de production basé sur la loi de la valeur dont Mattick prédit l'inévitabilité, ne pose pas l'alternative historique socialisme ou barbarie, mais l'alternative socialisme ou barbarie ou "socialisme d'État" ".
La réalité a donné raison à l'article d'Internationalism. De façon générale, il est vrai que la crise à l'Est n'a pas pris la même forme qu'à l'Ouest. Elle s'est plutôt manifestée par une sous-production plutôt qu'une surproduction, en tout cas en ce qui concerne les biens de consommation. Mais l'inflation qui a ravagé ces économies pendant des décennies, et a souvent été l'étincelle mettant le feu aux poudres de luttes de classe majeures, était le signe que la bureaucratie n'avait aucunement conjuré les effets de la loi de la valeur. Par dessus tout, avec l'effondrement du bloc de l'Est - qui illustrait aussi son impasse militaire et sociale - la loi de la valeur a pris sa "revanche" sur des régimes qui avaient cherché à la circonvenir. En ce sens, tout comme le keynésianisme, le stalinisme s'est révélé une "solution factice", "apte à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200) 9
Le courage de Mattick avait été nourri par l'expérience directe de la révolution allemande et la défense des positions de classe contre la contre-révolution triomphante des années 1930 et 1940. Un autre "survivant" de la Gauche communiste, Marc Chirik, a aussi continué de militer pendant la période de réaction et de guerre impérialiste. Il a été un membre fondamental de la Gauche communiste de France dont nous avons examiné la contribution dans le précédent article. Au cours des années 1950, il était au Vénézuéla et fut temporairement coupé de toute activité organisée. Mais au début des années 1960, il a cherché à regrouper un cercle de jeunes camarades qui ont formé le groupe Internacionalismo, fondé sur les mêmes principes que la GCF, y compris bien sûr sur la notion de décadence du capitalisme. Mais alors que la GCF avait lutté pour tenir dans une période sombre du mouvement ouvrier, le groupe vénézuélien exprimait quelque chose qui pointait dans la conscience de la classe ouvrière mondiale. Il reconnut avec une clarté surprenante que les difficultés financières qui commençaient à ronger l'organisme apparemment sain du capitalisme signifiaient en réalité un nouveau plongeon dans la crise et qu'il serait confronté à une génération non défaite de la classe ouvrière. Comme il l'écrivit en janvier 1968 : "Nous ne sommes pas des prophètes et nous ne prétendons pas non plus prédire quand et comment se dérouleront les événements dans le futur. Mais ce qui est conscient et certain : le processus dans lequel plonge le capitalisme aujourd'hui ne peut être arrêté et mène directement à la crise. Et nous sommes aussi certains que le processus inverse de développement de la combativité de classe dont nous sommes témoins aujourd'hui amènera le prolétariat à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois." Ce groupe fut l'un des plus lucides dans l'interprétation des mouvements sociaux massifs en France en mai de cette année-là, en Italie et ailleurs l'année suivante, comme marquant la fin de la contre-révolution.
Pour Internacionalismo, ces mouvements de classe constituaient une réponse du prolétariat aux premiers effets de la crise économique mondiale qui avait déjà produit une montée du chômage et des tentatives de contrôler les augmentations de salaire. Pour d'autres, ceci n'était qu'une application mécanique d'un marxisme dépassé : ce que Mai 1968 exprimait avant tout, c'était la révolte directe du prolétariat contre l'aliénation d'une société capitaliste fonctionnant à plein. Tel était le point de vue des situationnistes qui écartaient toute tentative de relier la crise et la lutte de classe comme l'expression de sectes de l'époque des dinosaures : "Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, ils avaient besoin au moins d'une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire au retour de cette dernière et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en Mai, ils doivent prouver que cette crise économique "invisible" était là au printemps 1968. Sans peur du ridicule, c'est à cela qu'ils travaillent aujourd'hui, produisant des schémas sur la montée du chômage et de l'inflation. Ainsi pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective terriblement visible qui a été si durement vécue en 1929, mais le fils de la présence eucharistique qui soutient leur religion." (L'Internationale situationniste n° 12) En réalité, comme nous l'avons vu, le point de vue d'Internacionalismo sur les rapports entre la crise et la lutte de classe n'a pas été modifié rétrospectivement : au contraire, sa fidélité à la méthode marxiste lui a permis d'envisager, sur la base de quelques signes avant-coureurs non spectaculaires, l'éclatement de mouvements tels que Mai 1968. L'approfondissement plus visible de la crise à partir de 1973 clarifia rapidement le fait que c'était l'IS – qui avait plus ou moins adopté la théorie de Cardan d'un capitalisme ayant surmonté ses contradictions économiques – qui était liée à une période de la vie du capitalisme désormais définitivement terminée.
L'hypothèse selon laquelle Mai 1968 exprimait une réapparition significative de la classe ouvrière fut confirmée par la prolifération internationale de groupes et de cercles cherchant à développer une critique authentiquement révolutionnaire du capitalisme. Naturellement, après une si longue période de reflux, ce nouveau mouvement politique prolétarien était extrêmement hétérogène et inexpérimenté. Réagissant aux horreurs du stalinisme, il était souvent méfiant envers la notion même d'organisation politique, avait une réaction viscérale envers tout ce qui sentait le "léninisme" ou envers ce qui était considéré comme la rigidité du marxisme. Certains de ces groupes se perdirent dans un activisme frénétique et, en l'absence d'analyse à long terme, ne survécurent pas à la fin de la première vague internationale de luttes commencée en 1968. D'autres ne rejetaient pas le lien entre les luttes ouvrières et la crise, mais le considéraient d'un point de vue totalement différent : c'est fondamentalement la combativité ouvrière qui avait produit la crise en mettant en avant des revendications d'augmentations de salaires sans restrictions et en refusant de se soumettre aux plans de restructuration capitalistes. Ce point de vue était défendu en France par le Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs (l'un des nombreux héritiers de Socialisme ou Barbarie) et en Italie par le courant autonomiste des ouvriers, qui considérait le marxisme "traditionnel" comme désespérément "objectiviste" (nous y reviendrons dans un autre article) dans sa compréhension des rapports entre la crise et la lutte de classe.
Cependant, cette nouvelle génération découvrait également les travaux de la Gauche communiste et la défense de la théorie de la décadence faisait partie de ce processus. Marc Chirik et quelques jeunes camarades du groupe Internacionalismo étaient venus en France et, dans le feu des événements de 1968, participèrent à la formation d'un premier noyau du groupe Révolution internationale. Dès le début, Révolution internationale plaça la notion de décadence au cœur de sa démarche politique et réussit à convaincre un certain nombre de groupes et d'individus conseillistes ou libertaires du fait que leur opposition aux syndicats, aux libérations nationales et à la démocratie capitaliste ne pouvait être comprise et défendue correctement sans un cadre historique cohérent. Dans les premiers numéros de Révolution internationale, il y a une série d'articles sur "La décadence du capitalisme" qui allait être publiée ensuite comme brochure du Courant communiste international. Ce texte est disponible en ligne 10 et contient toujours les principaux fondements de la méthode politique du CCI, surtout dans son large survol historique qui va du communisme primitif via les différentes sociétés de classes précédant le capitalisme, jusqu'à l'examen de la montée et du déclin du capitalisme lui-même. Comme les articles actuels de cette série, il se base sur la notion de Marx des "époques de révolutions sociales", il met en évidence des éléments-clés et des caractéristiques communes à toutes les sociétés de classes dans les périodes où elles sont devenues des entraves au développement des forces productives de l'humanité : l'intensification des luttes entre les fractions de la classe dominante, le rôle croissant de l'État, la décomposition des justifications idéologiques, les luttes croissantes des classes opprimées et exploitées. Appliquant cette démarche générale aux spécificités de la société capitaliste, il tente de montrer comment le capitalisme, depuis le début du 20e siècle, de "forme de développement" qu'il était, s'est transformé en une "entrave" aux forces productives, mettant en évidence les guerres mondiales et les nombreux autres conflits impérialistes, les luttes révolutionnaires qui ont éclaté en 1917, l'énorme augmentation du rôle de l'État et l'incroyable gaspillage de travail humain dans le développement de l'économie de guerre et d'autres formes de dépenses improductives.
Cette vision générale, présentée à une époque où les premiers signes d'une nouvelle crise économique devenaient plus que visibles, convainquit un certain nombre de groupes d'autres pays que la théorie de la décadence constituait un point de départ fondamental pour les positions communistes de gauche. Elle n'était pas seulement au centre de la plateforme du CCI mais fut également adoptée par d'autres tendances comme Revolutionary Perspectives et, par la suite, la Communist Workers Organisation en Grande-Bretagne. Il y eut d'importants désaccords sur les causes de la décadence du capitalisme : la brochure du CCI adoptait, en gros, l'analyse de Rosa Luxemburg, bien que l'analyse du boom d'après-guerre (qui voyait la reconstruction des économies détruites par la guerre comme une sorte de nouveau marché) fût par la suite l'objet de discussions dans le CCI, et il y eut toujours, au sein du CCI, d'autres points de vue sur la question, en particulier de la part de camarades défendant la théorie de Grossman - Mattick qui était également partagée par la CWO et d'autres. Mais dans cette période de réémergence du mouvement révolutionnaire, "la théorie de la décadence" semblait faire des acquis significatifs.
Bilan d'un système moribond
Dans notre survol des efforts successifs des révolutionnaires pour comprendre la période de déclin du capitalisme, nous arrivons maintenant aux années 1970 et 1980. Mais avant d'examiner l'évolution – et les nombreuses régressions – qui ont eu lieu au niveau théorique depuis ces décennies jusqu'à aujourd'hui, il nous paraît utile de rappeler et de mettre à jour le bilan que nous avions tiré dans le premier article de cette série 11, puisque des événements spectaculaires, sur le plan économique en particulier, se sont déroulés depuis le début 2008, date à laquelle nous avons publié ce premier article.
1. Sur le plan économique
Dans les années 1970 et 1980, la vague de lutte de classe internationale a connu une série d'avancées et de reculs, mais la crise économique, elle, avançait inexorablement et infirmait la thèse des autonomistes pour qui c'étaient les luttes ouvrières qui étaient la cause des difficultés économiques. La dépression des années 1930, qui coïncidait avec une défaite historique majeure de la classe ouvrière, avait déjà largement démenti cette idée, et l'évolution visible de la faillite économique telle qu'elle est apparue, de façon intermittente, au milieu des années 1970 et au début des années 1980, même dans des moments où la classe ouvrière était en retrait et, de façon plus soutenue, au cours des années 1990, a clairement montré qu'un processus "objectif" était à l'œuvre et qu'il n'était pas fondamentalement déterminé par le degré de résistance de la classe ouvrière. Il n'était pas non plus soumis à un contrôle efficace par la bourgeoisie. Abandonnant les politiques keynésiennes qui avaient accompagné les années du boom d'après-guerre mais étaient devenues la source d'une inflation galopante, la bourgeoisie dans les années 1980 cherchait désormais à "équilibrer les comptes" par des politiques qui suscitèrent une marée de chômage massif et de désindustrialisation dans la plupart des pays-clés du capitalisme. Au cours des années suivantes, il y eut de nouvelles tentatives pour stimuler la croissance par un recours massif à l'endettement, ce qui permit l'existence de booms économiques de courte durée mais provoqua aussi une accumulation sous-jacente de profondes tensions qui allaient exploser à la surface avec les krachs de 2007-08. Un aperçu général de l'économie capitaliste mondiale depuis 1914 ne nous fournit donc pas le scénario d'un mode de production ascendant mais celui d'un système incapable d'échapper à l'impasse, quelles que soient les techniques qu'il ait tenté d'utiliser :
- 1914 - 1923 : Première Guerre mondiale et première vague internationale de révolutions prolétariennes ; l'Internationale communiste annonce l'aube d'une "époque de guerres et de révolutions" ;
- 1924 – 1929 : brève reprise qui ne dissipe pas la stagnation d'après-guerre des "vieilles" économies et des "vieux" empires ; le "boom" est restreint aux États-Unis ;
- 1929 : l'expansion exubérante du capital américain se termine dans un krach spectaculaire, précipitant le capitalisme dans la dépression la plus profonde et la plus étendue de son histoire. Il n'y a pas de revitalisation spontanée de la production comme c'était le cas lors des crises cycliques du 19e siècle. On utilise des mesures capitalistes d'État pour relancer l'économie mais elles font partie d'une poussée vers la Seconde Guerre mondiale ;
- 1945-1967 : Un développement très important des dépenses de l'État (mesures keynésiennes) financées essentiellement au moyen de l'endettement et s'appuyant sur des gains de productivité inédits crée les conditions d'une période de croissance et de prospérité sans précédent, bien qu'une grande partie du "Tiers-Monde" en soit exclue ;
- 1967-2008 : 40 années de crise ouverte, que démontrent en particulier l'inflation galopante des années 1970 et le chômage massif des années 1980. Cependant, au cours des années 1990 et au début des années 2000, c'est à certains moments seulement que la crise apparaît plus "ouvertement" et plus clairement, plus dans certaines parties du globe que dans d'autres. L'élimination des restrictions vis-à-vis du mouvement du capital et de la spéculation financière ; toute une série de délocalisations industrielles vers des régions où la main d'œuvre est bon marché ; le développement de nouvelles technologies ; et, surtout, le recours quasi illimité au crédit par les États, les entreprises et les ménages : tout ceci crée une bulle de "croissance" dans laquelle de petites élites font de très grands profits, des pays comme la Chine connaissent une croissance industrielle frénétique et le crédit à la consommation atteint des hauteurs sans précédent dans les pays capitalistes centraux. Mais les signaux d'alarme sont discernables tout au long de cette période : des récessions succèdent aux booms (par exemple celles de 1974-75, 1980-82, 1990-93, 2001-2002, le krach boursier de 1987, etc.) et, à chaque récession, les options ouvertes pour le capital se rétrécissent, contrairement aux "effondrements" de la période ascendante quand existait toujours la possibilité d'une expansion extérieure vers des régions géographiques et économiques jusqu'alors en dehors du circuit capitaliste. Ne disposant quasiment plus de ce débouché, la classe capitaliste est de plus en plus contrainte de "tricher" avec la loi de la valeur qui condamne son système à l'effondrement. Ceci s'applique tout autant aux politiques ouvertement capitalistes d'État du keynésianisme et du stalinisme qui ne font pas mystère de leur volonté de freiner les effets du marché en finançant les déficits et en maintenant des secteurs économiques non rentables afin de soutenir la production, qu'aux politiques dites "néo-libérales" qui semblaient tout balayer devant elles après les "révolutions" personnifiées par Thatcher et Reagan. En réalité, ces politiques sont elles-mêmes des émanations de l'État capitaliste et, par leur incitation au recours au crédit illimité et à la spéculation, elles ne sont pas du tout ancrées dans un respect des lois classiques de la production capitaliste de valeur. En ce sens, l'un des événements les plus significatifs ayant précédé la débâcle économique actuelle est l'effondrement en 1997 des "Tigres" et des "Dragons" en Extrême-Orient, où une phase de croissance frénétique alimentée par de la (mauvaise) dette s'est soudainement heurtée à un mur – la nécessité de commencer à tout rembourser. C'était un signe avant-coureur de l'avenir, même si la Chine et l'Inde ont pris la suite en s'attribuant le rôle de "locomotive" qui avait été réservé à d'autres économies d'Extrême-Orient. "La révolution technologique", dans la sphère informatique en particulier, dont on a fait un grand battage dans les années 1990 et au tout début des années 2000, n'a pas non plus sauvé le capitalisme de ses contradictions internes : elle a augmenté la composition organique du capital et donc abaissé le taux de profit, et cela n'a pu être compensé par une extension véritable du marché mondial. En fait, elle a tendu à aggraver le problème de la surproduction en déversant de plus en plus de marchandises tout en jetant de plus en plus d'ouvriers au chômage ;
- 2008 -... : la crise du capitalisme mondial atteint une situation qualitativement nouvelle dans laquelle les "solutions" appliquées par l'État capitaliste au cours des quatre décennies précédentes et, par dessus tout, le recours au crédit, explosent à la face du monde politique, financier et bureaucratique qui les avaient pratiquées si assidûment avec une confiance mal placée au cours de la période précédente. Maintenant la crise rebondit vers les pays centraux du capitalisme mondial – aux États-Unis et dans la zone Euro – et toutes les recettes utilisées pour maintenir la confiance dans les possibilités d'une expansion économique constante se révèlent sans effet. La création d'un marché artificiel via le crédit montre désormais ses limites historiques et menace de détruire la valeur de la monnaie et de générer une inflation galopante ; en même temps, le contrôle du crédit et les tentatives des États de réduire leurs dépenses afin de commencer à rembourser leurs dettes ne font que restreindre encore plus le marché. Le résultat net, c'est que le capitalisme entre maintenant dans une dépression qui est fondamentalement plus profonde et plus insoluble que celle des années 1930. Et tandis que la dépression s'étend en Occident, le grand espoir qu'un pays comme la Chine porte l'ensemble de l'économie sur ses épaules s'avère aussi une illusion complète ; la croissance industrielle de la Chine est basée sur sa capacité à vendre des marchandises bon marché à l'Ouest, et si ce marché se contracte, la Chine est confrontée à un krach économique.
Conclusion : tandis que dans sa phase ascendante, le capitalisme a traversé un cycle de crises qui étaient à la fois l'expression de ses contradictions internes et un moment indispensable de son expansion globale, aux 20e et 21e siècles, la crise du capitalisme, comme Paul Mattick l'avait défendu dès les années 1930, est permanente. Le capitalisme a désormais atteint un stade où les palliatifs qu'il a utilisés pour se maintenir en vie sont devenus un facteur supplémentaire de sa maladie mortelle.
2. Sur le plan militaire
La poussée vers la guerre impérialiste exprime aussi l'impasse historique de l'économie capitaliste mondiale :
- "Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre États. La lutte économique exaspérée entre États ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des États impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme." ("Rapport sur la situation internationale", juillet 1945, GCF 12)
Les guerres impérialistes, qu'elles soient locales ou mondiales, sont l'expression la plus pure de la tendance du capitalisme à s'autodétruire, qu'il s'agisse de la destruction physique de capital, du massacre de populations entières ou de l'immense stérilisation de valeurs que représente la production militaire qui ne se réduit plus aux phases de guerre ouverte. La compréhension par la GCF de la nature essentiellement irrationnelle de la guerre dans la période de décadence a été en quelque sorte obscurcie par la réorganisation et la reconstruction globale de l'économie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ; mais le boom d'après-guerre était un phénomène exceptionnel qui ne pourra jamais se répéter. Et quel que soit le mode d'organisation internationale adopté par le système capitaliste à cette époque, la guerre a également été permanente. Après 1945, quand le monde a été divisé en deux énormes blocs impérialistes, le conflit militaire a généralement pris la forme de guerres de "libération nationale" sans fin à travers lesquelles les deux super-puissances rivalisaient pour la domination stratégique ; après 1989, l'effondrement du bloc russe, plus faible, loin d'atténuer la tendance à la guerre, a rendu l'implication directe de la super-puissance restante, les États-Unis, plus fréquente, comme nous l'avons vu pendant la Guerre du Golfe de 1991, dans les guerres des Balkans à la fin des années 1990, et en Afghanistan et en Irak après 2001. Ces interventions des États-Unis avaient en grande partie pour but – et de façon tout à fait vaine - d'enrayer les tendances centrifuges auxquelles la dissolution de l'ancien système de blocs avait ouvert la voie, ce qui s'est vu dans l'aggravation et la prolifération des rivalités locales, concrétisées dans les conflits atroces qui ont ravagé l'Afrique, du Rwanda au Congo, de l'Éthiopie à la Somalie, dans les tensions exacerbées autour du problème israélo-palestinien, jusqu'à la menace d'un face-à-face nucléaire entre l'Inde et le Pakistan
Les Première et Seconde Guerres mondiales ont apporté un changement majeur dans le rapport de forces entre les principaux pays capitalistes, essentiellement au bénéfice des États-Unis. En fait la domination écrasante des États-Unis à partir de 1945 a constitué un facteur-clé de la prospérité d'après-guerre. Mais contrairement à l'un des slogans des années 1960, la guerre n'était pas "la santé de l'État". De la même façon que le gonflement extrême de son secteur militaire a provoqué l'effondrement du bloc de l'Est, l'engagement des États-Unis pour se maintenir comme gendarme du monde est aussi devenu le facteur de leur propre déclin en tant qu'empire. Les énormes sommes englouties dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak n'ont pas été compensées par les profits rapides d'Halliburton ou autres de ses acolytes capitalistes ; au contraire, cela a contribué à transformer les États-Unis de créditeurs du monde en l'un de ses principaux débiteurs.
Certaines organisations révolutionnaires, comme la Tendance communiste internationaliste, défendent l'idée que la guerre, et surtout la guerre mondiale, est éminemment rationnelle du point de vue du capitalisme. Elles défendent l'idée qu'en détruisant la masse hypertrophiée de capital constant qui est à la source de la baisse du taux de profit, la guerre dans la décadence du capitalisme a pour effet la restauration de ce dernier et le lancement d'un nouveau cycle d'accumulation. Nous n'entrerons pas ici dans cette discussion mais, même si une telle analyse était juste, cela ne pourrait plus être une solution pour le capital. D'abord, parce que rien ne permet de dire que les conditions d'une troisième guerre mondiale – qui requiert, entre autres, la formation de blocs impérialistes stables - soient réunies dans un monde où la règle est de plus en plus celle du "chacun pour soi". Et même si une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour, elle n'initierait certainement pas un nouveau cycle d'accumulation, mais aboutirait quasi certainement à la disparition du capitalisme et, probablement, de l'humanité. 13 Ce serait la démonstration finale de l'irrationalité du capitalisme, mais il n'y aurait plus personne pour dire "je vous l'avais bien dit".
3. sur le plan écologique
Depuis les années 1970, les révolutionnaires ont été obligés de prendre en compte une nouvelle dimension du diagnostic selon lequel le capitalisme n'apportait plus rien de positif et était devenu un système tourné vers la destruction : la dévastation croissante de l'environnement naturel qui menace maintenant de désastre à l'échelle planétaire. La pollution et la destruction du monde naturel sont inhérentes à la production capitaliste depuis le début mais, au cours du siècle dernier et, en particulier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles se sont étendues et amplifiées du fait que le capitalisme a occupé sans répit tous les recoins de la planète jusqu'au dernier. En même temps, et comme conséquence de l'impasse historique du capitalisme, l'altération de l'atmosphère, le pillage et la pollution de la terre, des mers, des rivières et des forêts ont été exacerbés par l'accroissement d'une concurrence nationale féroce pour les ressources naturelles, la main d'œuvre à bas prix et de nouveaux marchés. La catastrophe écologique, notamment sous la forme du réchauffement climatique, est devenue un nouveau chevalier de l'apocalypse capitaliste, et les sommets internationaux qui se sont succédé ont montré l'incapacité de la bourgeoisie à prendre les mesures les plus élémentaires pour l'éviter.
Une illustration récente : le dernier rapport de l'Agence Internationale de l'Énergie, organisme qui ne s'était jamais distingué auparavant pour ses prédictions alarmistes, assure que les gouvernements du monde ont cinq ans pour renverser le cours du changement climatique avant qu'il ne soit trop tard. Selon l'AIE et un certain nombre d'institutions scientifiques, il est vital d'assurer que la hausse des températures ne dépasse pas 2 degrés. "Pour maintenir les émissions en dessous de cet objectif, la civilisation ne pourrait continuer, comme c'était le cas jusqu'ici, que pendant cinq ans, avant d'avoir "dépensé" le montant total des émissions permises. Dans ce cas, si on veut atteindre les objectifs de réchauffement, toutes les nouvelles infrastructures construites à partir de 2017 ne devraient plus produire aucune émission." 14 Un mois après la parution de ce rapport en novembre 2011, le sommet de Durban était présenté comme un pas en avant car, pour la première fois de toutes ces réunions internationales entre États, on se mit d'accord sur la nécessité de limiter légalement les émissions de gaz carbonique. Mais ce n'est qu'en 2015 que les niveaux devraient être fixés et en 2020 être effectifs – bien trop tard selon les prévisions de l'AIE et de beaucoup d'organismes environnementaux associés à la Conférence. Keith Allot, responsable "changement climatique" au WWF-Royaume-Uni (World Wide Fund for nature / Fonds mondial pour la nature), a déclaré : "Les gouvernements ont préservé une voie aux négociations, mais nous ne devons nous faire aucune illusion – l'issue de Durban nous présente la perspective de limites légales de 4° de réchauffement. Ce serait une catastrophe pour les populations et la nature. Les gouvernements ont passé leur temps, dans ce moment crucial, à négocier autour de quelques mots dans un texte, et ont porté peu d'attention aux avertissements répétés de la communauté scientifique disant qu'une action bien plus urgente et bien plus vigoureuse était nécessaire pour réduire les émissions". 15
Le problème avec les conceptions réformistes des écologistes, c'est que le capitalisme est étranglé par ses propres contradictions et par ses luttes toujours plus désespérées pour survivre. Pris dans une crise, le capitalisme ne peut pas devenir moins compétitif, plus coopératif, plus rationnel ; à tous les niveaux, il est entraîné dans la concurrence la plus extrême, surtout au niveau de la concurrence entre États nationaux qui ressemblent à des gladiateurs se battant dans une arène barbare pour la moindre chance de survie immédiate. Il est forcé de chercher des profits à court terme, de tout sacrifier à l'idole de "la croissance économique" – c'est-à-dire à l'accumulation du capital, même si c'est une croissance fictive basée sur une dette pourrie comme dans les dernières décennies. Aucune économie nationale ne peut se permettre le plus petit moment de sentimentalisme quand il s'agit d'exploiter sa "propriété" nationale naturelle jusqu'à sa limite absolue. Il ne peut pas exister non plus, dans l'économie capitaliste mondiale, de structure légale ni de gouvernance internationales qui soit capable de subordonner les intérêts nationaux étroits aux intérêts globaux de la planète. Quelle que soit la véritable échéance posée par le réchauffement climatique, la question écologique dans son ensemble constitue une nouvelle preuve que la perpétuation de la domination de la bourgeoisie, du mode de production capitaliste, est devenue un danger pour la survie de l'humanité.
Examinons une illustration édifiante de tout cela – une illustration qui montre également en quoi le danger écologique, tout comme la crise économique, ne peut être séparé de la menace de conflit militaire.
- "Au cours des derniers mois, les compagnies pétrolières ont commencé à faire la queue pour obtenir des droits d'exploration de la mer de Baffin, région de la côte occidentale du Groenland riche en hydrocarbures qui, jusqu'ici, était trop obstruée par les glaces pour qu'on puisse forer. Des diplomates américains et canadiens ont rouvert une polémique à propos des droits de navigation sur une route maritime traversant le Canada arctique et qui permettrait de réduire le temps de transport et les coûts des pétroliers.
Même la propriété du pôle Nord est devenue l'objet de discorde, la Russie et le Danemark prétendant chacun détenir la propriété des fonds océaniques dans l'espoir de se réserver l'accès à toutes ses ressources, des pêcheries aux gisements de gaz naturel.
L'intense rivalité autour du développement de l'Arctique a été révélée dans les dépêches diplomatiques publiées la semaine dernière par le site web "anti-secret" Wikileaks. Des messages entre des diplomates américains montrent comment les nations du nord, y compris les États-Unis et la Russie, ont manœuvré afin d'assurer l'accès aux voies maritimes et aux gisements sous-marins de pétrole et de gaz qui sont évalués à 25 pour cent des réserves inexploitées mondiales.
Dans leurs câbles, les officiels américains redoutent que les chamailleries autour des ressources puissent amener à un armement de l'Arctique. "Bien que la paix et la stabilité règnent en Arctique, on ne peut exclure qu'une redistribution du pouvoir ait lieu dans le futur et même une intervention armée", dit un câble du Département d'État en 2009, citant un ambassadeur russe." 16
Ainsi, l'une des manifestations les plus graves du réchauffement climatique, la fonte des glaces aux pôles, qui contient la possibilité d'inondations cataclysmiques et d'un cercle vicieux de réchauffement une fois que les glaces polaires ne seront plus là pour refléter la chaleur du soleil en dehors de l'atmosphère terrestre, est immédiatement considérée comme une immense occasion économique pour laquelle les États nationaux font la queue – avec la conséquence ultime de consommer plus d'énergies fossiles, venant s'ajouter à l'effet de serre. Et en même temps, la lutte pour les ressources qui s'amenuisent – ici le pétrole et le gaz mais, ailleurs, ça peut être l'eau et les terres fertiles – produit un mini-conflit impérialiste à quatre ou cinq (la Grande-Bretagne est elle aussi impliquée dans cette dispute). C'est le cercle vicieux de la folie croissante du capitalisme.
Le même article (du Washington Post) se poursuit par "la bonne nouvelle" d'un modeste traité signé entre certains des protagonistes lors du sommet du Conseil arctique à Nuuk au Groenland. Et nous savons à quel point on peut compter sur les traités diplomatiques quand il s'agit de prévenir la tendance inhérente du capitalisme vers le conflit impérialiste.
Le désastre global que le capitalisme prépare ne peut être évité que par une révolution globale.
4. Sur le plan social
Quel est le bilan du déclin du capitalisme sur le plan social et, en particulier, pour la principale classe productrice de richesses pour le capitalisme, la classe ouvrière ? Quand, en 1919, l'Internationale communiste proclama que le capitalisme était entré dans l'époque de sa désintégration interne, elle traçait également un trait sur la période de la social-démocratie au cours de laquelle la lutte pour des réformes durables avait été possible et nécessaire. La révolution était devenue nécessaire parce que, désormais, le capitalisme ne pourrait qu'augmenter ses attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Comme nous l'avons montré dans les précédents articles de cette série, cette analyse fut plusieurs fois confirmée au cours des deux décennies suivantes qui virent la plus grande dépression de l'histoire du capitalisme et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle fut mise en question, même chez les révolutionnaires, pendant le boom des années 1950 et 1960, quand la classe ouvrière des pays capitalistes centraux connut des augmentations de salaires sans précédent, une réduction importante du chômage et une série d'avantages sociaux financés par l'État : les allocations maladie, les congés payés, l'accès à l'éducation, les services de santé, etc.
Mais ces avancées invalident-elles l'idée, maintenue par les révolutionnaires qui défendaient la thèse selon laquelle le capitalisme était globalement en déclin, que des réformes durables n'étaient plus possibles ?
La question posée ici n'est pas de savoir si ces améliorations ont été "réelles" ou significatives. Elles l'ont été et cela doit être expliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles le CCI, par exemple, a ouvert un débat sur les causes de la prospérité d'après-guerre, en son sein puis publiquement. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est le contexte historique dans lequel ces acquis eurent lieu, car on peut alors montrer qu'ils ont peu en commun avec l'amélioration régulière du niveau de vie de la classe ouvrière au 19e siècle qui avait été permise, pour sa plus grande part, grâce à la bonne santé du capitalisme ainsi qu'à l'organisation et à la lutte du mouvement ouvrier :
- s'il est vrai que bien des "réformes" d'après-guerre furent mises en œuvre pour assurer que la guerre ne donne pas lieu à une vague de luttes prolétariennes sur le modèle de 1917-23, l'initiative de mesures comme l'assurance maladie ou pour le plein emploi est directement venue de l'appareil d'État capitaliste, de son aile gauche en particulier. Elles eurent pour effet d'augmenter la confiance de la classe ouvrière dans l'État et de diminuer sa confiance dans ses luttes propres ;
- même pendant les années du boom, la prospérité économique avait d'importantes limites. De grandes parties de la classe ouvrière, en particulier dans le Tiers-Monde mais, également, dans des poches importantes des pays centraux (par exemple, les ouvriers noirs et les blancs pauvres aux États-Unis) étaient exclus de ces avantages. Dans tout le "Tiers-Monde", l'incapacité du capital à intégrer les millions de paysans et de personnes d'autres couches, ruinés, dans le travail productif, a créé les prémices des bidonvilles hypertrophiés actuels, de la malnutrition et de la pauvreté mondiales. Et ces masses furent aussi les premières victimes des rivalités entre les blocs impérialistes, qui eurent pour conséquences des batailles sanglantes par procuration dans une série de pays sous-développés, de la Corée au Vietnam, du Moyen-Orient à l'Afrique du Sud et de l'Ouest ;
- une autre preuve de l'incapacité du capitalisme à véritablement améliorer la qualité de vie de la classe ouvrière réside dans la journée de travail. L'un des signes de "progrès" au 19e siècle fut la diminution continue de la journée de travail, de plus de 18 heures au tout début du siècle à la journée de 8 heures qui constituait l'une des principales revendications du mouvement ouvrier à la fin du siècle et qui a été formellement accordée dans les années 1900 et les années 1930. Mais depuis lors – et cela inclut également le boom d'après-guerre - la durée de la journée de travail est restée plus ou moins la même alors que le développement technologique, loin de libérer les ouvriers du labeur, a mené à la déqualification, au développement du chômage et à une exploitation plus intensive de ceux qui travaillent, à des temps de transport de plus en plus longs pour aller au travail et au développement du travail continu même en dehors du lieu de travail grâce aux téléphones mobiles, aux ordinateurs portables et à internet ;
- quels que soient les acquis apportés pendant le boom d'après-guerre, ils ont été grignotés de façon plus ou moins continue au cours des 40 dernières années et, avec la dépression imminente, ils sont maintenant l'objet d'attaques bien plus massives et sans perspective de répit. Au cours des quatre dernières décennies de crise, le capitalisme a été relativement prudent dans sa façon de baisser les salaires, d'imposer un chômage massif et de démanteler les allocations sociales de l'État-providence. Les violentes mesures d'austérité qui sont imposées aujourd'hui dans un pays comme la Grèce constituent un avant-goût de ce qui attend les ouvriers partout ailleurs.
Au niveau social plus large, le fait que le capitalisme ait été en déclin pendant une période aussi longue contient une énorme menace pour la capacité de la classe ouvrière à devenir "classe pour soi". Quand la classe ouvrière a repris ses luttes à la fin des années 1960, sa capacité à développer une conscience révolutionnaire était grandement entravée par le traumatisme de la contre-révolution qu'elle avait traversée – une contre-révolution qui s'était présentée elle-même dans une grande mesure dans un habit "prolétarien", celui du stalinisme, et avait rendu des générations d'ouvriers extrêmement méfiants vis-à-vis de leurs propres traditions et de leurs organisations. L'identification frauduleuse entre stalinisme et communisme fut même poussée à son extrême quand les régimes staliniens s'effondrèrent à la fin des années 1980, sapant encore plus la confiance de la classe ouvrière en elle-même et en sa capacité à apporter une alternative politique au capitalisme. Ainsi, un produit de la décadence capitaliste – le capitalisme d'État stalinien - a été utilisé par toutes les fractions de la bourgeoisie pour altérer la conscience de classe du prolétariat.
Au cours des années 1980 et 1990, l'évolution de la crise économique a fait que les concentrations industrielles et les communautés de la classe ouvrière dans les pays centraux ont été détruites, et une grande partie de l'industrie a été transférée dans des régions du monde où les traditions politiques de la classe ouvrière ne sont pas très développées. La création de vastes no man's land urbains dans beaucoup de pays développés amena avec elle un affaiblissement de l'identité de classe et, plus généralement, l'émoussement des liens sociaux ayant pour contrepartie la recherche de fausses communautés qui ne sont pas neutres mais ont des effets terriblement destructeurs. Par exemple, des secteurs de la jeunesse blanche exclus de la société subissent l'attraction de bandes d'extrême-droite comme la English Defence League en Grande Bretagne ; d'autres de la jeunesse musulmane qui se trouvent dans la même situation matérielle sont attirés par les politiques fondamentalistes islamistes et jihadistes. De façon plus générale, on peut voir les effets corrosifs de la culture des bandes dans quasiment tous les centres urbains des pays industrialisés, même si ses manifestations connaissent l'impact le plus spectaculaire dans les pays de la périphérie comme au Mexique où le pays est aux prises avec une guerre civile quasi permanente et incroyablement meurtrière entre des gangs de la drogue, dont certains sont directement liés à des fractions de l'État central non moins corrompu.
Ces phénomènes –la perte effrayante de toute perspective d'avenir, la montée d'une violence nihiliste– constituent un poison idéologique qui pénètre lentement dans les veines des exploités du monde entier et entravent énormément leur capacité à se considérer comme une seule classe, une classe dont l'essence est la solidarité internationale.
A la fin des années 1980, il y eut des tendances dans le CCI à considérer les vagues de luttes des années 1970 et 1980 comme avançant d'une façon plus ou moins linéaire vers une conscience révolutionnaire. Cette tendance fut vivement critiquée par Marc Chirik qui, sur la base d'une analyse des attentats terroristes en France et de l'implosion soudaine du bloc de l'Est, fut le premier à développer l'idée que nous entrions dans une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui fut décrite comme une phase de décomposition. Cette nouvelle phase était fondamentalement déterminée par une sorte d'impasse globale, une situation où ni la classe dominante, ni la classe exploitée n'étaient capables de mettre en avant leur alternative propre pour l'avenir de la société : la guerre mondiale pour la bourgeoisie, la révolution mondiale pour la classe ouvrière. Mais comme le capitalisme ne peut jamais être immobile et que sa crise économique prolongée était condamnée à toucher de nouveaux fonds, en l'absence de toute perspective, la société était condamnée à pourrir sur pied, apportant à son tour de nouveaux obstacles au développement de la conscience de classe du prolétariat.
Que l'on soit ou non d'accord avec les paramètres du concept de décomposition défendu par le CCI, ce qui est essentiel, dans cette analyse, c'est que nous sommes dans la phase terminale du déclin du capitalisme. La preuve que nous assistons aux dernières étapes du déclin du système, à son agonie mortelle, n'a fait qu'augmenter au cours des dernières décennies au point qu'un sentiment général d' "apocalypse" – une reconnaissance du fait que nous sommes au bord de l'abîme - se répand de plus en plus. 17 Et pourtant, au sein du mouvement politique prolétarien, la théorie de la décadence est loin de faire l'unanimité. Nous examinerons certains des arguments à l'encontre de cette notion dans le prochain article.
Gerrard
1 Lire le précédent article dans la Revue internationale n° 147, "Décadence du capitalisme : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme [286]".
2 En réponse à l'essai de Marcuse L'homme unidimensionnel – Essai sur l'idéologie de la société avancée, 1964 (en français en 1968).
3 Voir dans la Revue internationale n° 146, "Décadence du capitalisme : pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [233]".
4 Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, Éditions Gallimard 1972, chapitre XIV "L'économie mixte".
5 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
6 Ibid., chapitre XXII, "Valeur et socialisme".
7 Ibid., chapitre XX, "Capitalisme d'État et économie mixte".
8 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
9 Une autre faiblesse dans Marx et Keynes est l'attitude méprisante de Mattick envers Rosa Luxemburg et le problème qu'elle avait soulevé concernant la réalisation de la plus-value. Il ne fait qu'une seule référence directe à Luxemburg dans son livre : "Et, au début du siècle actuel, la marxiste Rosa Luxemburg voyait dans ce même problème [la réalisation de la plus-value] la raison objective des crises et des guerres ainsi que de la disparition finale du capitalisme. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec Marx qui, tout en estimant, il va de soi, que le monde capitaliste réel était en même temps processus de production et processus de circulation, soutenait néanmoins que rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable, et accordait pour ce motif la priorité aux problèmes de la production. Dès lors que seule la création de plus-value permet une expansion accélérée du capital, quel besoin a-t-on de supposer que le capitalisme se trouvera ébranlé dans la sphère de la circulation ?" (page 116, chapitre IX, "La crise du capitalisme")
A partir de la tautologie "rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable" et de l'idée marxiste "qu'une création adéquate de plus-value permet une expansion accélérée du capital", Mattick effectue une déduction abusive en prétendant que la plus-value en question pourra nécessairement être réalisée sur le marché. Le même type de raisonnement est encore présent dans un passage précédent : "La production marchande crée son propre marché dans la mesure où elle est capable de convertir la plus-value en capital additionnel. La demande du marché concerne tant les biens de consommation que les biens capitaux. Mais seuls ces derniers sont accumulables, le produit consommé étant par définition appelé à disparaître. Et seule la croissance du capital sous sa forme matérielle permet de réaliser la plus-value en dehors des rapports d'échange capital-travail. Tant qu'il existe une demande convenable et continue de biens capitaux, rien ne s'oppose à ce que soient vendues les marchandises offertes au marché." (page 97, chapitre VIII, "La réalisation du la plus-value"). Ceci est contradictoire avec le point de vue de Marx selon lequel "le capital constant n'est jamais produit pour lui-même, mais pour l'emploi accru dans les sphères de production dont les objets entrent dans la consommation individuelle" (Le Capital, Livre III, Éd. La Pléiade Économie II. p 1075). En d'autres termes, c'est la demande de moyens de consommation qui tire la demande en moyens de production, et non l'inverse. Mattick lui-même reconnaît (dans Crises et théories des crises) cette contradiction entre sa propre conception et certaines formulations de Marx, comme celle qui précède.
Mais nous ne voulons pas entrer une fois de plus dans ce débat ici. Le problème principal, c'est que bien que Mattick ait bien sûr considéré Rosa Luxemburg comme une marxiste et une révolutionnaire authentiques, il s'est joint au courant de pensée qui rejette le problème qu'elle posait à propos du processus d'accumulation comme un non-sens extérieur au cadre de base du marxisme. Comme nous l'avons montré, ça n'a pas été le cas de tous les critiques de Luxemburg, de Roman Rosdolsky par exemple (voir notre article dans la Revue internationale n° 142 : "Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme [187]".)
Cette démarche en grande partie sectaire a toujours énormément entravé le débat entre les marxistes sur ce problème depuis.
10 fr.internationalism.org/brochures/decadence [287]
11 Lire Revue internationale n° 132, "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [248]" (2008).
Pour plus de détails et de statistiques concernant l'évolution globale de la crise historique, son impact sur l'activité productive, le niveau de vie des travailleurs, etc., lire l'article dans ce n° : "Le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ?"
12 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59 [257] (1989).
13 Ceci ne veut évidemment pas dire que l'humanité est plus en sécurité dans un système impérialiste qui devient de plus en plus chaotique. Au contraire, sans la discipline imposée par l'ancien système de blocs, des guerres locales et régionales encore plus dévastatrices sont de plus en plus probables et leur potentiel destructeur s'est considérablement accru avec la prolifération des armes nucléaires. En même temps, comme elles pourraient très bien éclater dans des zones éloignées des centres capitalistes, elles sont moins dépendantes d'un autre élément qui a retenu la poussée vers la guerre mondiale depuis le début de la crise à la fin des années 1960 : la difficulté à mobiliser la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme dans une confrontation impérialiste directe.
14 www.nationalgeographic.com/science/article/111109-world-energy-outlook-2011 [288]
15 www.theguardian.com/environment/2011/dec/11/global-climate-change-treaty-durban [289]
16 https://www.washingtonpost.com/national/environment/warming-arctic-opens-way-to-competition-for-resources/2011/05/15/AF2W2Q4G_story.html [290]
17 Voir par exemple The Guardian, "The news is terrible. Is the world really doomed? [291]", A. Beckett, 18/12/2011.
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Rubrique:
Revue Internationale n° 149 - 2e trimestre 2012
- 1419 lectures
Massacres en Syrie, crise iranienne, .... La menace d'un cataclysme impérialiste au Moyen-Orient
- 1456 lectures
En Syrie, chaque jour qui passe apporte son nouveau lot de massacres. Ce pays a rejoint les terrains des guerres impérialistes au Moyen-Orient. Après la Palestine, l’Irak, l’Afghanistan et la Libye, voici maintenant venu le temps de la Syrie. Malheureusement, cette situation pose immédiatement une question particulièrement inquiétante. Que va-t-il se passer dans la période à venir? En effet, le Proche et le Moyen-Orient dans leur ensemble paraissent au bord d'un embrasement dont on voit difficilement l'aboutissement. Derrière la guerre en Syrie, c’est l’Iran qui attise aujourd’hui toutes les peurs et les appétits impérialistes, mais tous les principaux brigands impérialistes sont également préparés à défendre leurs intérêts dans la région. Celle-ci est sur le pied de guerre, une guerre dont les conséquences dramatiques seraient irrationnelles et destructrices pour le système capitaliste lui-même.
Destruction de masse et chaos en Syrie. Qui est responsable?
Pour le mouvement ouvrier international, comme pour tous les exploités de la terre, la réponse à cette question ne peut être que la suivante: le responsable et le seul, c’est le capital. C'était déjà le cas pour les boucheries des Première et Seconde Guerres mondiales. Mais aussi des guerres incessantes qui, depuis celles-ci, ont fait à elles seules plus de morts que ces deux guerres mondiales réunies. Il y a un peu plus de 20 ans, George Bush, alors président des Etats-Unis, et ceci bien avant que son propre fils n’accède à la Maison Blanche, déclarait d’un air triomphant "que le monde entrait dans un nouvel ordre mondial". Le bloc soviétique s’était littéralement écroulé. L’URSS disparaissait et, avec elle, devaient disparaître également toutes les guerres et les massacres. Grâce au capitalisme enfin triomphant et sous le regard bienveillant et protecteur des États-Unis, la paix allait désormais régner dans le monde. Que de mensonges encore une fois démentis immédiatement par la réalité. N’est-ce pas ce même président qui allait, peu après ce discours cynique et hypocrite, déclencher la première guerre d’Irak?
En 1982 l'armée syrienne avait réprimé dans le sang la population révoltée de la ville de Hama. Le nombre de victimes n'a jamais pu être déterminé avec certitude: les estimations varient entre 10.000 et 40.000.[1] Personne à l'époque n'avait parlé d'intervention pour secourir la population, personne n'avait exigé le départ de Hafez El-Assad, père de l'actuel président syrien. Le contraste avec la situation actuelle n'est pas mince! La raison en est qu'en 1982, la scène mondiale était encore dominée par la rivalité entre les deux grands blocs impérialistes. Malgré le renversement du Shah d'Iran par le régime des Ayatollahs au début 1979 et l'invasion russe de l'Afghanistan un an après, la domination américaine sur la région n'avait pas été contestée par les autres grandes puissances impérialistes et elle était à même de garantir une relative stabilité.
Depuis lors les choses ont bien changé: l'effondrement du système des blocs et l'affaiblissement du "leadership" américain donnent libre cours aux appétits impérialistes des puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie, l'Égypte, la Syrie, Israël... L'approfondissement de la crise réduit les populations à la misère et attise leur sentiment d'exaspération et de révolte face aux régimes en place.
Si aujourd'hui aucun continent n’échappe à la montée des tensions inter-impérialistes, c’est au Moyen-Orient que se concentrent tous les dangers. Et, au centre de ceux-ci, nous trouvons en premier lieu la Syrie, après plusieurs mois de manifestations contre le chômage et la misère et qui impliquaient des exploités de toutes origines: Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants tous unis dans leurs protestations pour une vie meilleure. Mais la situation dans ce pays a pris une sinistre tournure. La contestation sociale y a été entraînée, récupérée, sur un terrain qui n’a plus rien à voir avec ses raisons d’origine. Dans ce pays, où la classe ouvrière est très faible et les appétits impérialistes très forts, cette triste perspective était, en l’état actuel des luttes ouvrières dans le monde, pratiquement inévitable.
Au sein de la bourgeoisie syrienne, tous se sont jetés tels des charognards sur le dos de cette population révoltée et en détresse. Pour le gouvernement en place et les forces armées pro Bachar Al-Assad, l’enjeu est clair. Il s’agit de garder le pouvoir à tout prix. Pour l’opposition, dont les différents secteurs sont prêts à s’entretuer et que rien ne réunit si ce n’est la nécessité de renverser Bachar el-Assad, il s’agit de prendre ce même pouvoir. Lors des réunions de ces forces d’opposition à Londres et à Paris, il y a peu de temps, aucun ministre ou service diplomatique n’a voulu préciser leur composition. Que représente le Conseil national syrien ou le Comité national de coordination ou encore l’Armée syrienne libre? Quel pouvoir ont en leur sein les Kurdes, les Frères musulmans ou les djihadistes salafistes? Ce n’est qu’un ramassis de cliques bourgeoises, chacune rivalisant avec les autres. Une des raisons pour lesquelles le régime d'Assad n'a pas encore été renversé, c'est qu'il a pu jouer sur les rivalités internes à la société syrienne. Ainsi, les chrétiens voient d'un mauvais œil la montée des islamistes et craignent de subir le même sort que les coptes en Égypte ; une partie des Kurdes essaie de négocier avec le régime; et ce dernier garde le soutien de la minorité religieuse alaouite dont fait partie la clique présidentielle.
De toute façon, le Conseil national n’existerait pas militairement et politiquement de manière significative s'il n’était pas soutenu par des forces extérieures, chacune essayant de tirer ses marrons du feu. Au nombre d’entre elles, il faut citer les pays de la Ligue arabe, Arabie Saoudite en tête, la Turquie, mais également la France, la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis.
Tous ces requins impérialistes prennent le prétexte de l’inhumanité du régime syrien pour préparer la guerre totale dans ce pays. Par l’intermédiaire du média russe La voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Press TV, des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait, avec le soutien américain, à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication russe ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir ez-Zor, à la frontière de l’Irak. Car le régime de Bachar Al-Assad est lui-même soutenu par des puissances étrangères, notamment la Chine, la Russie et l’Iran.
Cette bataille féroce des plus puissants vautours impérialistes de la planète à propos de la Syrie se mène également au sein de cette assemblée de brigands qui est dénommée ONU. En son sein, la Russie et la Chine avaient à deux reprises mis leur veto à des projets de résolution sur la Syrie, dont le dernier appuyait le plan de sortie de crise de la Ligue arabe prévoyant ni plus ni moins que la mise à l’écart de Bachar Al-Assad. Après plusieurs jours de tractations sordides, l’hypocrisie de tous s’est encore étalée au grand jour. Le Conseil de sécurité des Nations unies, avec l'accord de la Russie et de la Chine, a adopté le 21 mars dernier une déclaration qui vise à obtenir un arrêt des violences, grâce à l’arrivée dans ce pays d’un envoyé spécial de renom, monsieur Kofi Annan, tout cela n’ayant par ailleurs bien entendu aucune valeur contraignante. Ce qui veut dire en clair que cela n’engage en réalité que ceux qui y croient. Tout cela est sordide.
La question que nous pouvons nous poser est alors bien différente. Comment se fait-il que, pour le moment, aucune puissance impérialiste étrangère impliquée dans cet affrontement n'ait encore frappé directement – évidemment en défense de ses intérêts nationaux - comme ce fut par exemple le cas en Libye, il y a seulement quelques mois? Principalement parce les fractions de la bourgeoisie syrienne s’opposant à Bachar Al-Assad le refusent officiellement. Elles ne veulent pas d’une intervention militaire massive étrangère et elles le font savoir. Chacune de ces fractions a très certainement la crainte légitime de perdre dans ce cas-là toute possibilité de diriger elle-même le pouvoir. Mais ce fait ne constitue pas une garantie que la menace de la guerre impérialiste totale, qui est aux portes de la Syrie, ne fasse pas irruption dans ce pays dans la période qui vient. En fait, la clé de la situation réside certainement ailleurs.
On ne peut que se demander pourquoi ce pays attise aujourd’hui autant d’appétits impérialistes de par le monde. La réponse à cette question se trouve à quelques kilomètres de là. Il faut tourner les yeux vers la frontière orientale de la Syrie pour découvrir l’enjeu fondamental de cette empoignade impérialiste et du drame humain qui en découle. Celui-ci a pour nom Iran.
L’Iran au cœur de la tourmente impérialiste mondiale
Le 7 février dernier le New York Times déclarait: "La Syrie c’est déjà le début de la guerre avec l’Iran". Une guerre qui n’est pas encore déclenchée directement, mais qui est là, tapie dans l’ombre du conflit syrien.
En effet le régime de Bachar Al-Assad est le principal allié régional de Téhéran et la Syrie constitue une zone stratégique essentielle à l’Iran. L'alliance avec ce pays permet en effet à Téhéran de disposer d'une ouverture directe sur l’espace stratégique méditerranéen et israélien, avec des moyens militaires directement au contact de l’État hébreu. Mais cette guerre potentielle, qui avance cachée, trouve ses racines profondes dans l’enjeu vital que représente le Moyen-Orient au moment où se déchaînent de nouveau toutes les tensions guerrières contenues dans ce système pourrissant.
Cette région du monde est un grand carrefour qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident. L’Europe et l’Asie s’y rencontrent à Istanbul. La Russie et les pays du Nord regardent par-dessus la Méditerranée le continent africain et les vastes océans. Mais, plus encore, alors que l’économie mondiale a commencé à vaciller sur ses bases, l’or noir devient une arme économique et militaire vitale. Chacun doit tenter de contrôler son écoulement. Sans pétrole n’importe qu’elle usine se retrouve à l’arrêt, tout avion de chasse reste cloué au sol. Cette réalité fait partie intégrante des raisons pour lesquelles tous ces impérialismes s’impliquent dans cette région du monde. Pourtant, toutes ces considérations ne constituent pas les motifs les plus opérants et pernicieux qui poussent cette région dans la guerre.
Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont été les chefs d’orchestre d’une campagne idéologique anti-iranienne. Cette campagne vient de connaître un violent coup d’accélérateur. En effet, le tout récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA) laisse entendre une possible dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Et un Iran possédant l’arme atomique est insupportable pour bon nombre de pays impérialistes de par le monde. La montée en puissance d’un Iran nucléarisé, s’imposant dans toute la région, est totalement insupportable pour tous ces requins impérialistes, d'autant plus que le conflit israélo-palestinien y maintient une instabilité permanente. L'Iran est totalement encerclé militairement. L’armée américaine est installée à proximité de toutes ses frontières. Quant au Golfe Persique, il regorge d’une telle quantité de bâtiments de guerre de tous ordres que l’on pourrait le traverser sans se mouiller les pieds! L’État israélien ne cesse de proclamer qu’il ne laissera jamais l’Iran posséder la bombe atomique et, selon ses dires, l'Iran devrait en être doté dans un délai maximum d’un an. L’affirmation proclamée haut et fort à la figure du monde est effrayante car ce bras de fer est très dangereux: l’Iran n’est pas l’Irak, ni même l’Afghanistan. C'est un pays de plus de 70 millions d’habitants avec une armée "respectable".
Des conséquences catastrophiques majeures
Économiques
Mais l'utilisation de l'arme atomique par l'Iran n'est pas le seul danger, ni le plus important: ces derniers temps, les dirigeants politiques et religieux iraniens ont affirmé qu’ils riposteraient par tous les moyens à leur disposition si leur pays était attaqué. Celui-ci dispose d'un moyen de nuisance dont personne n’est en mesure d’évaluer la portée. En effet, si l’Iran était conduit à empêcher, y compris en coulant ses propres bateaux, toute navigation dans le détroit d’Ormuz, la catastrophe serait mondiale.
Une partie considérable de la production mondiale de pétrole ne pourrait plus parvenir à ses destinataires. L’économie capitaliste en pleine crise de sénilité serait alors automatiquement entraînée dans une tempête de force maximale. Les dégâts seraient incommensurables sur une économie déjà particulièrement malade.
Écologiques
Les conséquences écologiques peuvent être irréversibles. Attaquer des sites atomiques iraniens, qui sont enterrés sous des milliers de tonnes de béton et de mètres cubes de terre, nécessiterait une attaque aérienne tactique aux moyens de frappes atomiques ciblées. C'est ce qu’expliquent les experts militaires de toutes ces puissances impérialistes. Si tel était le cas, que deviendrait l’ensemble de la région du Moyen-Orient? Quelles seraient les retombées sur les populations et l'écosystème, y compris à l’échelle planétaire? Tout ceci n’est pas le produit d’une imagination morbide sortie du cerveau d'un Docteur Folamour totalement fou. Ce n’est pas non plus un scénario pour un nouveau film catastrophe. Ce plan d’attaque fait partie intégrante de la stratégie étudiée et mise en place par l’État israélien et, avec plus de recul pour le moment, par les États-Unis. L’État-major de l’armée israélienne étudie, dans ses préparatifs, la possibilité, en cas d’échec d’une attaque aérienne plus classique, de passer à ce stade de destruction. La folie gagne un capital en pleine décadence.
Humanitaires
Depuis le déclenchement des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye au cours des années précédentes, le chaos le plus total règne dans ces pays. La guerre s’y poursuit interminablement. Les attentats sont quotidiens et meurtriers. Les populations tentent désespérément de survivre au jour le jour. La presse bourgeoise l’affirme: "L’Afghanistan est sujet à une lassitude générale. A la fatigue des Afghans répond la fatigue des occidentaux". (Le Monde du 21-03-2012) Si, pour la presse bourgeoise, tout le monde semble fatigué de la poursuite sans fin de la guerre en Afghanistan, pour la population ce n’est pas de fatigue qu’il s’agit mais d’exaspération et d’abattement. Comment survivre dans une telle situation de guerre et de décomposition permanente? Et en cas de déclenchement de la guerre en Iran, la catastrophe humaine serait d'une ampleur encore plus considérable. La concentration de la population, les moyens de destruction qui seraient employés laissent entrevoir le pire. Le pire, c’est un Iran à feu et à sang, un Moyen-Orient plongé dans un chaos total. Aucun de ces assassins de masse à la tête des instances dirigeantes civiles et militaires n’est capable de dire où la guerre en Iran s’arrêterait. Que se passerait-il dans les populations arabes de toutes ces régions? Que feraient les populations chiites? Cette perspective est tout simplement humainement effroyable.
Des bourgeoisies nationales divisées, des alliances impérialistes au bord d’une crise majeure
Le fait même d’entrevoir seulement une petite partie de ces conséquences effraie les secteurs de la bourgeoisie qui tentent de garder un minimum de lucidité. Le journal koweïtien Al-Jarida vient de laisser filtrer une information, relayant ainsi comme à son habitude les messages que les services secrets israéliens veulent faire connaître publiquement. Son dernier directeur Meir Dagan vient en effet d’affirmer "que la perspective d’une attaque contre l’Iran est la plus stupide idée dont il ait jamais entendu parler." Tel est l’avis qui semble également exister au sein de l’autre officine des forces secrètes de sécurité externe israélienne: le Shin Bet.
Il est de notoriété publique que toute une partie de l’état-major israélien ne souhaite pas cette guerre. Mais il est également connu qu'une partie de la classe politique israélienne, rassemblée derrière Netanyahou, veut son déclenchement au moment jugé le plus propice pour l’État hébreu. En Israël, pour des raisons de choix de politique impérialiste, la crise politique couve sous les braises d’une guerre possible. En Iran, le chef religieux Ali Khamenei s’affronte également sur cette question avec le président de ce pays, Mahmoud Ahmadinejad. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c’est le bras de fer que se livrent les États-Unis et Israël sur cette question. L’administration américaine ne veut pas, pour le moment, d’une guerre ouverte avec l’Iran. Il faut dire que l'expérience américaine en Irak et en Afghanistan n'est guère probante, et que l'administration Obama a préféré jusqu'ici se fier aux sanctions de plus en plus lourdes. La pression des États-Unis sur Israël, pour que cet État patiente, est énorme. Mais l’affaiblissement historique du leadership américain se fait même sentir sur son allié traditionnel au Moyen-Orient. Israël affirme haut et fort que, de toute manière, il ne laissera pas l’Iran posséder l’arme atomique, quel que soit l’avis de ses plus proches alliés. La main de fer de la surpuissance américaine continue à s’affaiblir et même Israël conteste maintenant ouvertement son autorité. Pour certains commentateurs bourgeois, il pourrait s’agir là potentiellement d’une première rupture du lien États-Unis/ Israël, jusqu’ici indéfectible.
Le joueur majeur de la région immédiate est la Turquie, avec les forces armées les plus importantes du Moyen-Orient (plus de 600 000 en service actif). Alors que ce pays était autrefois un allié indéfectible des États-Unis et un des rares amis d'Israël, avec la montée du régime Erdogan la fraction plus "islamiste" de la bourgeoisie turque est tentée de jouer sa propre carte d'islamisme "démocratique" et "modéré". De ce fait, elle essaie de profiter des soulèvements en Égypte et en Tunisie. Et cela explique aussi le revirement de ses relations avec la Syrie. Il fut un temps où Erdogan prenait ses vacances avec Assad mais, à partir du moment où le leader syrien a refusé d'obtempérer aux exigences d'Ankara et de traiter avec l'opposition, l'alliance a été rompue. Les efforts de la Turquie d'exporter son propre "modèle" d'islam "modéré" sont d'ailleurs en opposition directe avec les tentatives de l'Arabie Saoudite d'accroître sa propre influence dans la région en s'appuyant sur le wahhabisme ultra-conservateur.
La possibilité du déclenchement d’une guerre en Syrie, et peut être ensuite en Iran, est à ce point présente que les alliés de ces deux pays que sont la Chine et la Russie réagissent de plus en plus fortement. Pour la Chine, l'Iran est d'une grande importance puisqu'elle lui fournit 11% de ses besoins énergétiques [2]. Depuis sa percée industrielle, la Chine est devenue un nouveau joueur de taille dans la région. Au mois de décembre dernier, elle mettait en garde contre le danger de conflit mondial autour de la Syrie et de l'Iran. Ainsi elle déclarait par la voix du Global Times [3]: "L’Occident souffre de récession économique, mais ses efforts pour renverser des gouvernements non occidentaux en raisons d’intérêts politiques et militaires est à son point culminant. La Chine, tout comme son voisin géant la Russie, doit rester en alerte au plus haut niveau et adopter les contre-mesures qui s’imposent" [4]. Même si une confrontation directe entre les grandes puissances impérialistes du monde n'est pas envisageable dans le contexte mondial actuel, de telles déclarations mettent en évidence le sérieux de la situation.
Le capitalisme marche tout droit vers l’abîme
Le Moyen-Orient est une poudrière et certains sont tout près d’y mettre le feu. Certaines puissances impérialistes envisagent et organisent froidement l’utilisation de certaines catégories d’armes atomiques dans une prochaine guerre éventuelle contre l’Iran.
Des moyens militaires sont déjà prêts et disposés stratégiquement à cet effet. Comme, dans le capitalisme agonisant, le pire est toujours le plus probable, nous ne pouvons pas écarter totalement cette éventualité. Dans tous les cas, la fuite en avant du capitalisme devenu entièrement sénile et obsolète conduit l’irrationalité de ce système toujours plus loin. La guerre impérialiste, portée à un tel niveau, s’apparente à une réelle autodestruction du capitalisme. Que le capitalisme, maintenant condamné par l’histoire, disparaisse n’est pas un problème pour le prolétariat et pour l’humanité. Malheureusement cette destruction du système par lui-même va de pair avec la menace d'une destruction totale de l’humanité. Cette constatation de l’enfoncement du capitalisme dans un processus de destruction de la civilisation ne doit pas nous conduire à l’abattement, au désespoir ou à la passivité. Dans cette même revue, au premier trimestre de cette année, nous écrivions ceci: "La crise économique n’est pas une histoire sans fin. Elle annonce la fin d’un système et la lutte pour un autre monde." Cette affirmation s'appuie sur l’évolution de la réalité de la lutte de classe internationale. Cette lutte mondiale pour un autre monde vient de commencer. Certes difficilement et à un rythme encore lent, mais elle est maintenant bien présente et en marche vers son développement. C’est cette force à nouveau en mouvement, dont la lutte des Indignés en Espagne au printemps dernier en est, pour le moment, l’expression la plus marquante, qui nous permet d’affirmer qu’existent potentiellement les capacités de faire disparaître toute cette barbarie capitaliste de la surface de notre planète.
Tino (11 avril 2012)
[3] Journal d’actualité internationale appartenant à l’officiel Quotidien du Peuple.
[4] Rapporté par www.solidariteetprogres.org/Iran-La-Chine-ne-doit-pas-reculer-devant-une... [295].
Géographique:
- Moyen Orient [167]
Mobilisations massives en Espagne, Mexique, Italie, Inde, ... Le barrage syndical contre l'auto-organisation et l'unification des luttes
- 2178 lectures
Alors même que les gouvernements de tous les pays s’acharnent à imposer des plans d’austérité de plus en plus violents, les mobilisations de 2011 - le mouvement des Indignés en Espagne, en Grèce, etc., et les occupations aux États-Unis et autres pays - se sont poursuivies durant le premier trimestre 2012. Les luttes se heurtent cependant à une puissante mobilisation syndicale qui parvient à entraver sérieusement le processus d’auto-organisation et d’unification commencé en 2011.
Comment s’affranchir de la tutelle syndicale? Comment retrouver et vivifier les tendances apparues en 2011? Quelles sont les perspectives? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse.
Les manifestations massives
Nous commencerons par rappeler brièvement les luttes (cf. notre presse territoriale pour une chronique plus détaillée de chacune d’entre elles).
En Espagne, les coupes sociales brutales (dans l’éducation, la santé et les services de base) et l’adoption d’une "Réforme du travail", qui simplifie les procédures de licenciement et permet aux entreprises des baisses immédiates de salaire, ont provoqué de grandes manifestations, particulièrement à Valence, mais aussi à Madrid, Barcelone et Bilbao.
En février, la tentative de créer un climat de terreur policière dans la rue, en prenant comme têtes de Turcs les élèves de l’enseignement secondaire à Valence, a provoqué une série de manifestations massives où des étudiants et des travailleurs de toutes les générations sont descendus dans la rue pour lutter au coude à coude avec les lycéens. La vague de protestations s’est étendue dans tout le pays, générant des manifestations à Madrid, Barcelone, Saragosse, Séville, qui étaient bien souvent spontanées ou décidées au cours d’assemblées improvisées([1]).
En Grèce, une nouvelle grève générale en février a favorisé des manifestations massives dans tout le pays. Y ont participé les employés des secteurs public et privé, des jeunes et des vieux, des chômeurs; même des flics s’y sont joints. Les travailleurs de l’hôpital de Kilki ont occupé les locaux, appelé à la solidarité et à la participation de l’ensemble de la population, lançant un appel à la solidarité internationale([2]).
Au Mexique, le gouvernement a concentré le gros de ses attaques contre les travailleurs de l’enseignement, en attendant de les généraliser vers d’autres secteurs, dans un contexte de dégradation générale des conditions de vie dans un pays dont on dit par ailleurs qu’il est "blindé contre la crise". Malgré l’encadrement syndical extrêmement fort, les enseignants ont massivement manifesté dans le centre de Mexico([3]).
En Italie ont éclaté en janvier plusieurs luttes contre l’avalanche de licenciements et les mesures adoptées par le nouveau gouvernement: chez les cheminots, dans des entreprises comme Jabil ex-Nokia, Esselunga di Pioltello à Milan; FIAT à Termini Imerese, Cerámica Ricchetti à Mordado/Bologna; à la raffinerie de Trapani; chez les chercheurs précaires de l’hôpital Gasliani de Gênes, etc.; et, aussi, parmi des secteurs proches du prolétariat comme les camionneurs, les conducteurs de taxis, les bergers, pêcheurs, paysans… Cela dit, ces mouvements ont été très dispersés. Une tentative de coordination dans la région milanaise a échoué, restée prisonnière de sa vision syndicaliste([4]).
En Inde, que l’on considère communément avec la Chine comme "l’avenir du capitalisme", a éclaté une grève générale le 28 février, convoquée par plus de cent syndicats représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays (mais qui n'ont pas tous été appelés à faire grève par leur syndicat, loin de là). Cette mobilisation a été saluée comme étant l’une des grèves les plus massives du monde à ce jour. Cependant elle a surtout été une journée de démobilisation, une façon de "lâcher la vapeur", en réponse à une vague croissante de luttes depuis 2010, dont le fer de lance a été celle des travailleurs de l’automobile (Honda, Maruti-Suzuki, Hyundai Motors). Ainsi, récemment, entre juin et octobre 2011, toujours dans les usines de production d’automobiles, les travailleurs avaient agi de leur propre initiative et n’avaient pas attendu les consignes syndicales pour se mobiliser, manifestant de fortes tendances à la solidarité et une volonté d’extension de la lutte à d’autres usines. Ils avaient aussi exprimé des tendances à l’auto-organisation et à la mise en place d’assemblées générales, comme lors des grèves à Maruti-Suzuki à Manesar, une ville nouvelle dont le développement est lié au boom industriel dans la région de Delhi. Au cours de cette lutte, les ouvriers ont occupé l’usine contre l’avis de “leur” syndicat. La colère ouvrière gronde, c’est pourquoi les syndicats se sont tous mis d’accord sur l’appel commun à la grève… pour faire face, unis, à… la classe ouvrière!([5]).
2011 et 2012: une seule et même lutte
Les jeunes, chômeurs et précaires ont été la force motrice des actions des Indignés et des Occupy en 2011, même si celles-ci ont mobilisé des travailleurs de tous âges. La lutte tendait alors à s’organiser autour d’assemblées générales, ce qui s’accompagnait d’une critique des syndicats, et n’avançait pas de revendications concrètes, se centrant sur l’expression de l’indignation et la recherche d’explications sur la situation.
En 2012, les premières luttes de riposte aux attaques des États se présentent sous une forme différente: leur fer de lance est constitué à présent par les travailleurs "installés" de 40-50 ans du secteur public, fortement soutenus par les "usagers" (pères de famille, parents des malades, etc.) et auxquels se joignent les chômeurs et la jeunesse. Les luttes se polarisent sur des revendications concrètes et la tutelle syndicale y est très présente.
Il semblerait alors qu’il s’agit de luttes "différentes" sinon "opposées", comme s’efforcent de nous le faire croire les différents medias. Les premières seraient "radicales", "politiques", animées par des "idéalistes n’ayant rien à perdre"; les secondes, par contre, seraient le fait de pères de familles imprégnés de conscience syndicaliste et qui ne veulent pas perdre "les privilèges acquis".
Une telle caractérisation de ces "deux types de luttes", qui occulte leurs tendances sociales communes profondes, a comme objectif politique de diviser et d’opposer deux ripostes nées du prolétariat, fruits de la maturation de sa conscience et exprimant un début de réponse à la crise, et qui doivent s’unir dans la perspective des luttes massives. Il s’agit réellement de deux pièces d’un puzzle qui doivent s’emboîter.
Cela ne sera cependant pas facile. La lutte où les travailleurs prennent une part de plus en plus active et consciente, en particulier dans les secteurs les plus avancés du prolétariat, devient une nécessité et sa première condition est un regard lucide sur toutes les faiblesses qui touchent le mouvement ouvrier.
Les mystifications
L’une d’elles est le nationalisme, qui affecte particulièrement la Grèce. Là, la colère provoquée par l’austérité insupportable est canalisée "contre le peuple allemand", dont la prétendue "opulence"([6]) serait à l’origine des malheurs du "peuple grec". Ce nationalisme est utilisé pour proposer des "solutions" à la crise basées sur "la récupération de la souveraineté économique nationale", vision autarcique que se partagent les staliniens et les néofascistes([7]).
La prétendue rivalité entre Droite et Gauche est une autre des mystifications avec lesquelles l’État essaie d’affaiblir la classe ouvrière. Nous pouvons particulièrement le voir en Italie et en Espagne. En Italie, l’éviction de Berlusconi, personnage particulièrement répugnant, a permis à la Gauche de créer une "euphorie artificielle" - "Nous sommes enfin libérés!" - qui a fortement joué dans la dispersion des ripostes ouvrières que nous avions pu voir au début des plans d’austérité imposés par le Gouvernement "technique" de Monti([8]). En Espagne, l’autoritarisme et la brutalité de la répression qui caractérisent traditionnellement la Droite ont permis aux syndicats et aux partis de gauche d’attribuer la responsabilité des attaques à la "méchanceté" et à la vénalité de la droite et de détourner le mécontentement vers la "défense de l’État social et démocratique". En ce sens, il existe une convergence des mystifications de ces forces traditionnelles de l'encadrement de la classe ouvrière que sont les syndicats et les partis de gauche et avec celles plus récemment déployées par la bourgeoisie pour faire face au mouvement des indignés, en particulier DRY ("Democracia Real Ya !" - "La démocratie réelle, tout de suite"). Comme nous l'avons mis en évidence, "la stratégie de la DRY, au service de l’État démocratique de la bourgeoisie, consiste dans le fait de mettre en avant un mouvement citoyen de réformes démocratiques, pour essayer d’éviter que ne surgisse un mouvement social de lutte contre l’État démocratique, contre le capitalisme".[9]
Le barrage syndical
En 2011, la bourgeoisie en Espagne a été surprise par le mouvement des Indignés, qui est parvenu, paradoxalement, à développer assez librement les méthodes classiques de la lutte ouvrière: les assemblées massives, les manifestations non encadrées, les débats de masse, etc.([10]) du fait même qu’il s’est mobilisé non sur le terrain des entreprises mais dans la rue et que les jeunes et les précaires qui en constituaient la force motrice étaient fondamentalement méfiants envers toute institution "reconnue" telle que les syndicats.
Aujourd’hui, la mise en place de plans d’austérité est à l’ordre du jour de tous les États, particulièrement en Europe, provoquant un fort mécontentement et une combativité croissante. Ces États ne veulent pas se laisser surprendre et, à cette fin, ils accompagnent les attaques de tout un dispositif politique qui rend plus difficile l’émergence de cette lutte unie, auto-organisée et massive des travailleurs qui pousserait plus loin les tendances apparues en 2011.
Les syndicats sont le fer de lance de ce dispositif. Leur rôle est d’occuper tout le terrain social en proposant des mobilisations qui créent un labyrinthe où toutes les initiatives, l’effort, la combativité et l’indignation de masses croissantes de travailleurs ne peuvent s’exprimer ou pataugent dans un terrain miné par la division.
Nous voyons clairement cela dans l’une des armes de prédilection des syndicats: la grève générale. Dans les mains des syndicats, de telles mobilisations sans lendemain, qui rassemblent souvent un nombre important d'ouvriers, coupent la classe ouvrière de toute possibilité de prendre en charge sa lutte en vue d'en faire un instrument d'une riposte massive aux attaques de la bourgeoisie. En Grèce ont été convoquées pas moins de seize grèves générales en trois ans! Il y en a déjà eu trois au Portugal, une autre se prépare en Italie, une grève – limitée au secteur de l'enseignement! - est annoncée en Grande-Bretagne, nous avons déjà parlé de la grève en Inde fin février et, en Espagne, suite à la grève générale de septembre 2010, une autre est annoncée pour le 29 mars.
La multitude de grèves générales convoquées par les syndicats est bien sûr un indice de la pression exercée par les travailleurs, de leur mécontentement et de leur combativité. Mais, pour autant, la grève générale n’est pas un pas en avant sinon une façon de "lâcher la vapeur" face au mécontentement social([11]).
Le Manifeste communiste rappelle que "Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs"; le principal acquis d’une grève se trouve dans l’unité, la conscience, la capacité d’initiative et d’organisation, la solidarité qui s'y manifestent, les liens actifs qu’elle permet de nouer.
Et ce sont ces acquis que précisément les convocations à la grève générale et les méthodes syndicales de lutte affaiblissent et dénaturent.
Les leaders syndicaux annoncent la grève générale et, dans un grand barouf médiatique de presse et de télévision, lancent de grandes proclamations invoquant "l’unité" mais, sur les lieux de travail, la "préparation" de la grève générale constitue en fait une immense manœuvre de division, d’affrontement et d’atomisation.
La participation à la grève générale est présentée comme relevant de la décision personnelle de chaque travailleur. Dans beaucoup d’entreprises, ce sont même les cadres de l’entreprise ou de l’administration publique qui les interrogent individuellement sur leur participation éventuelle, avec tout ce que cela suppose de chantage et d’intimidation. Voilà ce qu’il en est du droit de grève, "citoyen" et "constitutionnel"!
Cette manœuvre reproduit fidèlement le schéma mensonger de l’idéologie dominante selon laquelle chaque individu est autonome et indépendant, devant décider "en son âme et conscience" ce qu’il doit faire. La grève serait un autre de ces mille dilemmes angoissants que la vie nous impose dans cette société et auxquels nous devons répondre seuls dans le plus grand des désarrois: dois-je accepter ce travail? Dois-je profiter de telle occasion? Dois-je acheter tel objet? Pour qui vais-je voter? Est-ce que je vais faire grève? De ces dilemmes, nous sortons avec le sentiment d’être encore plus aliénés; c’est le monde de la concurrence, de la lutte de tous contre tous, du chacun pour soi, c'est-à-dire la quintessence de cette société.
Les jours qui précèdent la grève générale voient proliférer les scènes de conflits et de tensions entre travailleurs. Chacun s’affronte à d’angoissantes questions: vais-je faire grève sachant qu’elle ne donnera rien? Est-ce que je laisse tomber mes camarades qui font grève? Puis-je me payer le luxe de perdre un jour de salaire? De perdre mon emploi? Chacun se voit pris entre deux feux: d’un côté les syndicalistes qui culpabilisent celui qui n’y participe pas, de l’autre les chefaillons qui profèrent toutes sortes de menaces. C’est un véritable cauchemar d’affrontements, de divisions et de tensions entre travailleurs, exacerbé par la question du "service minimum" qui est une nouvelle source de conflits([12]).
Le monde capitaliste fonctionne comme une addition de millions de "libres décisions individuelles". En réalité, aucune de ces décisions n’est libre mais est esclave d’un complexe réseau de rapports aliénants: de l’infrastructure des rapports de production - la marchandise et le travail salarié - jusqu’à l’immense structure des rapports juridiques, militaires, idéologiques, religieux, politiques, policiers…
Marx disait que "la véritable richesse intellectuelle de l'individu dépend entièrement de la richesse de ses rapports réels"[13], ces derniers étant le pilier de la lutte prolétarienne et de la force sociale qui, seule, pourra détruire le capitalisme, alors que les convocations syndicales dissolvent les rapports sociaux et enferment les prolétaires dans l’isolement, l’enfermement corporatif, suppriment les conditions qui leur permettent de décider consciemment, le corps collectif des travailleurs en lutte.
C’est la capacité des travailleurs à discuter collectivement du pour et du contre d’une action qui leur donne leur force, car c’est dans ce cadre qu’ils peuvent examiner les arguments, les initiatives, les éclaircissements, prendre en compte les doutes, les désaccords, les sentiments, les réserves de chacun, dans ce cadre qu’ils peuvent prendre des décisions communes. C’est là la façon de réaliser une lutte où s’intègre le maximum de prolétaires avec leurs responsabilités et leurs convictions.
C’est précisément tout cela qui est jeté à la poubelle par les pratiques syndicales qui poussent à "oublier les parlottes" et les "sentimentalismes" au nom de la prétendue "force que donne le blocage de la production ou des services dans lesquels on travaille". La classe ouvrière tire sa force de la place centrale qu’elle occupe dans la production, du fait qu'elle produit la quasi-totalité des richesses que la bourgeoisie s’approprie. Ainsi, par la grève, les ouvriers sont potentiellement capables de bloquer toute la production et de paralyser l’économie. Mais, dans la réalité, l'arme du "blocage tout de suite" est souvent utilisée par les syndicats comme un moyen pour détourner les ouvriers de leur première priorité, développer la lutte à travers sa prise en charge et son extension[14]. Par ailleurs, dans la période de décadence du capitalisme, et de surcroît dans les périodes de crise comme celle que nous vivons, c’est le système capitaliste lui-même, avec son fonctionnement chaotique et contradictoire, qui se charge de paralyser la production et les services sociaux. Un blocage de la production - et d’autant plus de 24 heures! - est mis à profit par les capitalistes pour éliminer des stocks. En ce qui concerne les services, comme l’enseignement par exemple, la santé ou les transports publics, ce blocage est mis à profit par l’État pour faire s’affronter les travailleurs "usagers" à leurs camarades en grève!
Le combat pour une lutte unitaire et massive
Pendant les mouvements de 2011, des masses d’exploités avaient pu agir selon leurs propres initiatives et leurs aspirations les plus profondes, s’exprimer selon les méthodes classiques de la lutte ouvrière, héritées des révolutions russes de 1905 et de 1917, de Mai 68, etc. L’imposition actuelle de la tutelle syndicale rend plus difficile cette "expression libre" mais, cependant, celle-ci suit son cours. Contre la tutelle syndicale, commencent à surgir des initiatives ouvrières: en Espagne par exemple, nous en avons vu plusieurs expressions. Lors de la manifestation du 29 mars, à Barcelone, Castellón, Alicante, Valence, Madrid, des grévistes portaient leurs propres banderoles, formaient des piquets pour expliquer leur mobilisation, réclamaient le droit à la parole lors des meetings syndicaux, tenaient des assemblées alternatives… Il est significatif que ces initiatives s’inscrivent dans le même sens que celles qui se sont développées lors des événements en France en 2010 contre la réforme des retraites([15]).
Il s’agit de livrer le combat sur ce terrain piégé qui nous est imposé pour ouvrir la voie à l’authentique lutte prolétarienne. La tutelle des syndicats semble insurmontable mais les conditions murissent dans le sens de son usure croissante et, en conséquence, dans le sens du renforcement de la capacité d’autonomie du prolétariat.
La crise, qui dure depuis déjà cinq ans et menace de nouvelles convulsions, dissipe peu à peu les illusions sur une possible "sortie du tunnel", et révèle à son tour une préoccupation profonde quant au futur. La faillite croissante du système social devient de plus en plus évidente, avec tout ce que cela implique quant au mode de vie, aux rapports humains, à la pensée, à la culture… Alors que pendant la période où la crise n'était pas aussi aigüe, les travailleurs semblaient pouvoir suivre un chemin tout tracé à leur intention, malgré les souffrances souvent terribles qui accompagnent l’exploitation salariée, cette voie disparaît progressivement. Et cette dynamique est aujourd’hui mondiale.
La tendance qui s’est déjà exprimée en 2011 avec le mouvement des Indignés et des Occupy([16]) à prendre massivement la rue et les places est un autre puissant levier du mouvement. Dans la vie courante du capitalisme, la rue est un espace d’aliénation: embouteillages, foules solitaires qui achètent, vendent, gèrent, font des affaires… Que les masses s’emparent de la rue pour en faire "un autre usage" - des assemblées, des discussions massives, des manifestations - peut faire de celle-ci un espace de libération. Ceci permet aux travailleurs de commencer à entrevoir la force sociale qu’ils sont capables de constituer s’ils apprennent à agir de façon collective et autonome. Ils sèment pour l’avenir les premières graines de ce qui pourrait être le "gouvernement direct des masses" à travers lequel celles-ci s’éduqueront, se libèreront de tous les haillons que la société leur a collés au corps et trouveront la force pour détruire la domination capitaliste et construire une autre société.
Une autre des forces qui pousse le mouvement vers le futur se trouve dans la convergence de toutes les générations ouvrières dans la lutte. Ce phénomène s’est déjà vu il y a peu dans des luttes comme celle contre le CPE en France (2006)([17]) ou dans les révoltes de la jeunesse en Grèce (2008)([18]). La capacité de converger en une action commune de toutes les générations ouvrières est une condition indispensable pour mener à bien une lutte révolutionnaire. Lors de la Révolution russe de 1917, se côtoyaient dans le mouvement les prolétaires de tous âges, des enfants hissés sur les épaules des frères ou des pères jusqu’aux vieillards chenus.
Il s’agit d’un ensemble de facteurs qui ne va développer sa puissance ni immédiatement, ni facilement. De durs combats, animés par l’intervention persévérante des organisations révolutionnaires, ponctués de défaites souvent amères et de moments difficiles de confusion et de paralysie temporaire, seront encore nécessaires pour permettre la pleine éclosion de cette puissance. L’arme de la critique, une critique ferme des erreurs et des insuffisances, sera fondamentale pour aller de l’avant.
"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière, et que les circonstances elles-mêmes crient: Hic Rhodus, hic salta ! C'est ici qu'est la rose, c'est ici qu'il faut danser!"([19]).
C.Mir (27-3-12)
[1] Cf. en espagnol Por un movimiento unitario contra recortes y reforma laboral (voir https://es.internationalism.org/node/3323 [296]); Ante la escalada represiva en Valencia (voir https://es.internationalism.org/node/3324 [297]).
[3] Cf. en espagnol "Nuestra intervención en las movilizaciones del magisterio en México [299]".
[4] Cf. en italien https://it.internationalism.org/node/1147 [300]
[5] Cf. Journée de manifestation en Inde: grève générale ou pare-feu syndical; https://fr.internationalism.org/ri431/journee_de_manifestation_en_inde_g... [301]
[6] Oubliant délibérément les 7 millions de “mini-jobs” (rémunérés à 400 euros mensuels) que supporte la classe ouvrière en Allemagne.
[7] Une minorité de travailleurs en Grèce prend conscience de ce danger, c’est ainsi que les travailleurs de l’hôpital occupé de Kilkis lancent un appel à la solidarité internationale, tout comme les étudiants et professeurs de la faculté de droit occupée d’Athènes.
[8] Qui n’est même pas passé par la mascarade électorale!
[9] Lire notre article, "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya!": une dictature sur les assemblées massives"; /content/4693/mouvement-citoyen-democracia-real-ya-dictature-assemblees-massives [196].
[10] La bourgeoisie n’avait pas réellement laissé le champ libre au mouvement, elle avait utilisé contre lui des forces "nouvelles" mais inexpérimentées, comme DRY. Cf. "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya!": une dictature sur les assemblées massives".
[11] Si l’on en croit “l’inquiétude” ou “la colère” des grands chefs d’entreprise ou des dirigeants politiques, la grève générale semble grandement les inquiéter et évoquerait quelque chose comme une "révolution". Mais l’histoire a largement démontré que tout ce battage n’est que pure comédie, au-delà de ce que tel ou tel personnage de la classe dominante croit réellement.
[12] Rappelons ce que nous disions dans l’article "Rapport sur la lutte de classe" publié dans la Revue internationale no 117 (2004): "En 1921, pendant l'Action de mars en Allemagne, les scènes tragiques des chômeurs essayant d'empêcher les ouvriers de rentrer dans les usines étaient une expression de désespoir face au reflux de la vague révolutionnaire. Les récents appels des gauchistes français à empêcher les élèves de passer leurs examens [pendant le mouvement du printemps 2003 en France], le spectacle des syndicalistes ouest-allemands voulant empêcher les métallos est-allemands -qui ne voulaient plus faire une grève longue pour les 35 heures- de reprendre le travail [pendant la grève des métallos en Allemagne en 2003] sont des attaques dangereuses contre l'idée même de classe ouvrière et de solidarité. Elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles alimentent l'impatience, l'immédiatisme et l'activisme décervelé que produit la décomposition. Nous sommes avertis: si les luttes à venir sont potentiellement un creuset pour la conscience, la bourgeoisie fait tout pour les transformer en tombeau de la réflexion prolétarienne" (https://fr.internationalism.org/rinte117/ldc.htm [302]).
[13] L’idéologie allemande, I "Feuerbach".
[14] Lire à ce propos notre article en deux parties, "Bilan du blocage des raffineries", écrit à propos du blocage des raffineries dans la lutte contre la réforme des retraites en France en 2010: https://fr.internationalism.org/ri418/bilan_du_blocage_des_raffineries_1ere_partie.html [303] et https://fr.internationalism.org/ri420/bilan_du_blocage_des_raffineries.html [304].
[15] Cf. Revue internationale no 144, “Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie”, https://fr.internationalism.org/node/4524 [192]. De fait, ces luttes de 2010 ont préparé politiquement et dans la pratique le terrain pour l’évolution de la conscience de classe en 2011.
[16] Pour un bilan de ces mouvements, voir “De l’indignation à l’espoir", https://fr.internationalism.org/icconlinz/2012/2011_de_l_indignation_a_l... [305]
[17] Cf. “Thèses sur le mouvement des étudiants”, Revue internationale no 125, https://fr.internationalism.org/rint125/france-etudiants [148]
[18] Cf. “Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe", Revue internationale no 136, https://fr.internationalism.org/rint136/les_revoltes_de_la_jeunesse_en_g... [207]
[19] Marx, Le 18 de Brumaire de Louis Bonaparte, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum3.htm [306].
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (V)
- 1587 lectures
Mai 1968
Nous publions la dernière partie de notre série de 5 articles sur la lutte de classe en Afrique française, centrée en particulier sur le Sénégal. Cette série couvre la période allant de la fin du 18e siècle jusqu'à 1968. Elle a commencé à être pubiée dans le n°145 de la Revue Internationale.
Mai 1968 en Afrique, expression de la reprise de la lutte de classe internationale
Il s’est effectivement produit un "Mai 68" en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, avec des caractéristiques très proches du "Mai français" (agitation étudiante en prélude à l’entrée en scène du mouvement ouvrier), ce qui n'est pas étonnant étant donnés les liens historiques entre la classe ouvrière de France et celle de l’ancienne colonie africaine.
Si le caractère mondial de "Mai 68" est admis par tous, en revanche son expression dans certaines zones du monde n’est que partiellement connue, voire tout bonnement ignorée:
"Cela s’explique en grande partie par le fait que ces événements se sont déroulés en même temps que d’autres de même nature un peu partout à travers le monde. Cette situation a facilité la tâche des analystes et propagandistes qui s’attachaient à brouiller la signification du Mai 68 sénégalais. En optant pour une lecture sélective insistant sur l'aspect étudiant et scolaire de la crise au détriment de ses autres dimensions." (Abdoulaye Bathily, Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Édit. Chaka, Paris 1992)
En fait le "Mai sénégalais" est plus connu en milieu étudiant: du monde entier, des étudiants envoyèrent des messages de protestation au gouvernement de Senghor qui réprimait leurs camarades africains. Signalons aussi que l’université de Dakar fut l’unique université existant dans les colonies de l’AOF, et ce jusqu’au lendemain de "l'indépendance", ce qui explique la présence en son sein d'un nombre important d'étudiants africains étrangers.
Les organes de presse bourgeois ont à l'époque des interprétations variées des causes du déclenchement du mouvement de Mai à Dakar. Pour certains, comme Afrique Nouvelle (catholique), c’est la crise de l’enseignement qui fut à l’origine du mouvement. Marchés Tropicaux et Méditerranéens (milieux d’affaires) considère qu'il est le prolongement du mouvement déclenché en France. Pour sa part, Jeune Afrique, avance la conjonction du mécontentement politique des étudiants et du mécontentement social des salariés.
Il existe un autre point de vue, consistant à faire le lien entre ce mouvement et la crise économique: c'est celui d'Abdoulaye Bathily, un des anciens acteurs de la célèbre révolte, alors qu'il était étudiant à l’époque; plus tard, en sa qualité de chercheur, il fera le bilan global de "Mai à Dakar". Nous lui donnons largement la parole dans cet article pour apporter son témoignage de l’intérieur.
Déroulement des événements
"Le mois de mai 1968 est resté dans l’histoire pour avoir été marqué, à travers le monde, par des bouleversements de grande ampleur dont les étudiants et lycéens ont servi de fer de lance. En Afrique, le Sénégal a été le théâtre très remarqué de la contestation universitaire et scolaire. De nombreux observateurs de l’époque en ont conclu que les événements de Dakar n’étaient rien d’autre que le prolongement de Mai 68 français. (…) Ayant participé directement, et à partir du niveau le plus élevé, à la lutte des étudiants de Dakar, en mai 68, cette thèse m’a toujours paru erronée. (…) L’explosion de Mai 68 a été sans aucun doute, préparée par un climat social particulièrement tendu. Elle fut l’aboutissement d’une agitation sans précédent des salariés des villes, des opérateurs économiques nationaux mécontents du maintien de la prépondérance française, des membres de la bureaucratie face au contrôle des rouages de l'État par l’assistance technique. La crise agricole contribua elle aussi à l’aggravation de la tension dans les villes et à Dakar, notamment en intensifiant l’exode rural (…). Le mémorandum de l’UNTS [Union Nationale des Travailleurs du Sénégal, NDLR] du 8 mai estimait la dégradation du pouvoir d’achat depuis 1961 à 92,4 %." (Bathily, ibid.)
C’est donc dans ce contexte que Dakar connut elle aussi un "Mai 68", entre le 18 mai et le 12 juin, qui faillit ébranler définitivement le régime pro-français de Senghor, avec grèves générales illimitées du monde étudiant puis du monde du travail, avant que le pouvoir en place n’arrive à bout du mouvement au moyen d'une féroce répression policière et militaire, tout en bénéficiant de l’appui décisif de l’impérialisme français.
Le "Mai sénégalais" fut précédé par plusieurs heurts avec le gouvernement Senghor, notamment entre 1966 et 1968, alors que les étudiants organisaient des manifestations de soutien aux luttes de "libération nationale" et contre le "néo-colonialisme" et "l’impérialisme".
De même, il y eut en milieu scolaire des "grèves d’avertissement". Une grève des cours fut déclenchée le 26 mars 1968 par les élèves du lycée de Rufisque (banlieue de Dakar) suite aux sanctions disciplinaires infligées à un lycéen. Le mouvement dura 3 semaines, installant les établissements scolaires de la région dans un climat d’agitation et de contestation du gouvernement.
Le détonateur du mouvement
Le déclenchement du mouvement de mai 1968 eut pour origine immédiate la décision du gouvernement du président Senghor de réduire le nombre de mensualités des bourses d’études de 12 à 10 par an, tout en diminuant fortement le montant alloué, en invoquant "la situation économique difficile que traverse le pays".
"La nouvelle de la décision du gouvernement se répandit comme une traînée de poudre à la cité universitaire, causant partout l’inquiétude et suscitant un sentiment général de révolte. C’était le seul objet de conversations partout sur le campus. Dès son élection, le nouveau comité exécutif de l’UDES [Union Démocratique des Étudiants Sénégalais, NDLR] s’employa à développer l’agitation autour de la question des bourses en milieu étudiant, parmi les élèves des lycées et auprès des syndicats." (Bathily, ibid.)[1]
En effet, dès cette annonce gouvernementale, l’agitation s’installe et la contestation du gouvernement s’intensifie, notamment à la veille des élections que les étudiants dénoncent, comme le montre le titre d’un de leurs tracts: "De la situation économique et sociale du Sénégal à la veille de la mascarade électorale du 25 février…". L’agitation continue et, le 18 mai, les étudiants décident d’une "grève générale d’avertissement" suite à l’échec des négociations avec le gouvernement sur les conditions d’études, grève massivement suivie dans toutes les facultés.
Galvanisés par le franc succès de la grève et gonflés à bloc par le refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications, les étudiants lancent un mot d’ordre de grève générale illimitée des cours et de boycott des examens à partir du 27 mai. Déjà, à la veille de cette date, les meetings se succèdent dans le campus et en milieu scolaire en général; bref, c’est l’épreuve de force avec le pouvoir. De son côté, le gouvernement s’empare de tous les médias officiels pour annoncer une série de mesures répressives contre les grévistes, tout en visant à opposer les étudiants, qualifiés de "privilégiés", aux travailleurs et aux paysans. Et l’Union Progressiste Sénégalaise (le parti de Senghor) de dénoncer la "position antinationale" du mouvement des étudiants, mais sans aucun écho cependant; bien au contraire, les campagnes du gouvernement ne font qu’aggraver la colère des étudiants et susciter la solidarité des salariés et de la population.
"Les meetings de l’UED (Union des étudiants de Dakar) constituaient des temps forts de l’agitation dans le campus. Ils enregistraient une influence considérable d’étudiants, d’élèves, d’enseignants, de jeunes chômeurs, d’opposants et, bien entendu, de nombreux agents de renseignement. Au fil du temps, ils constituaient le baromètre qui indiquait les mouvements de la contestation politique et sociale. Chaque meeting était une sorte de messe de l’opposition sénégalaise et de celles des autres pays présents dans le campus. Les interventions étaient ponctuées des morceaux de musique révolutionnaire du monde entier." (Bathily, ibid.)
Effectivement, on assiste là à une véritable veillée d’armes. De fait, le 27 mai à minuit, les étudiants en éveil entendent le bruit des bottes et voient l’arrivée massive d’un cordon policier autour de la cité universitaire. Dès lors une foule d’étudiants et d’élèves s'attroupe et converge vers les résidences en vue de monter des piquets de grève.
En fait, le pouvoir, en faisant encercler le campus universitaire par les forces de l’ordre, cherche à empêcher tout mouvement de l’extérieur vers l’intérieur et inversement.
"Ainsi, des camarades se virent privés de leurs repas et d’autres de leur lit car, comme l’UED a eu souvent à le dire, les conditions sociales sont telles que nombre de camarades mangent en ville (non boursiers) ou y dorment faute de logement à la cité universitaire. Même les étudiants en médecine qui soignaient leurs malades à l’hôpital restaient bloqués à la Cité en même temps que d’autres étudiants en urgence médicale. C’était l’exemple type de violation des franchises universitaires." (Bathily, ibid.)
Le 28 mai, lors d’une entrevue avec le Recteur et les doyens de l’université, l’UED demande la levée du cordon policier, tandis que les autorités universitaires exigent que les étudiants fassent une déclaration sous 24 heures "certifiant que la grève n’a pas pour but de renverser le gouvernement Senghor". Les organisations étudiantes répondent qu’elles n’étaient pas liées à un régime donné et que le temps qui leur est imparti ne permet pas de consulter leur base. Dès lors, le président du gouvernement ordonne la fermeture totale des établissements universitaires.
"Le groupe mobile d’intervention, renforcé par la police, sonna une nouvelle charge et investit les pavillons les uns après les autres. Il avait reçu l’ordre de dégager les étudiants par tous les moyens. Ainsi à coups de matraque, de crosse de fusil, baïonnettes, de grenades lacrymogènes et quelquefois offensives, défonçant portes et fenêtres, les sbires allèrent chercher les étudiants jusque dans leur chambre. Les gardes et les policiers se comportèrent en véritables pillards. Ils volèrent tout et brisèrent ce qui leur paraissait encombrant, déchirèrent les vêtements, les livres et les cahiers. Des femmes enceintes furent maltraitées et des travailleurs malmenés. Au pavillon des mariés, femmes et enfants furent frappés. Il y eut sur le champ un mort et beaucoup de blessés (une centaine) selon les chiffres officiels." (Bathily, ibid.)
L’explosion
La brutalité de la réaction du pouvoir provoque un élan de solidarité et renforce la sympathie envers le mouvement des étudiants. Dans tous les milieux de la capitale s’exprime une forte réprobation du comportement brutal du régime, contre les sévices policiers et l’internement d’un grand nombre d’étudiants. Au soir du 29 mai, tous les ingrédients sont réunis pour un embrasement social car l’effervescence est à son comble parmi les élèves et les salariés.
Ce sont les lycéens, déjà massivement présents lors des "grèves d’avertissement" du 26 mars et du 18 mai, qui se mettent les premiers en grève illimitée. Dès lors la jonction est réalisée entre le mouvement universitaire et le mouvement scolaire. Les uns après les autres, tous les établissements de l’enseignement secondaire se déclarent en grève totale et illimitée tout en formant des comités de lutte et en appelant à manifester avec les étudiants.
Inquiet de l’ampleur de la mobilisation de la jeunesse, ce même 29 mai, le président Senghor fait diffuser un communiqué dans les médias annonçant la fermeture sine die de tous les établissements scolaires (facultés, lycées, collèges) de la région de Dakar et de Saint-Louis, et appelant les parents d’élèves à retenir leurs enfants à la maison. Mais sans le succès escompté.
"La fermeture de l’université et des écoles ne fit qu’augmenter la tension sociale. Les étudiants qui avaient échappé aux mesures d’internement, les élèves et les jeunes se mirent à ériger des barricades dans les quartiers populaires comme la Médina, Grand Dakar, Nimzat, Baay Gainde, Kip Koko, Usine Ben Talli, Usine Nyari Talli, etc. Dans la journée des 29 et 30 notamment, des cortèges imposants composés de jeunes occupaient les principales artères de la ville de Dakar. Les véhicules de l’administration et des personnalités du régime étaient particulièrement recherchés. Selon la rumeur, de nombreux ministres furent ainsi contraints de renoncer à utiliser leurs voitures de fonction, les fameuses voitures de marque Citroën appelées DS 21. En effet, ce type de véhicule officiel symbolisait, aux yeux de la population et des étudiants et élèves en particulier, le "train de vie insolent de la bourgeoisie politico-bureaucratique et compradore". " (Bathily, ibid.)
Face à la combativité montante et à la dynamique du mouvement, le gouvernement décide de renforcer ses mesures répressives en les étendant à toute la population. Ainsi dès le 30 mai, un décret gouvernemental indique d’une part, que jusqu’à nouvel ordre, tous les établissements recevant du public (cinémas, théâtres, cabarets, restaurants, bars) sont appelés à fermer nuit et jour; d’autre part, les réunions, manifestations et attroupements de plus de 5 personnes interdits.
Grève générale des travailleurs
Face à ces mesures martiales et à la poursuite des brutalités policières contre la jeunesse en lutte, tout le pays s’agite et la révolte s’intensifie partout, cette fois-ci plus amplement chez les salariés. C’est alors que les appareils syndicaux traditionnels, notamment l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal, regroupant plusieurs syndicats, décident d’entrer en scène pour ne pas se faire déborder par la base.
"La base des syndicats pressait les directions à l’action. Le 30 mai, à 18 heures, l’union régionale UNTS du Cap-Vert (région de Dakar), à la suite d’une réunion conjointe avec le bureau national de l’UNTS, lança un mot d’ordre de grève illimitée à partir du 30 mai à minuit." (Bathily, ibid.)
Face à la situation explosive pour son régime, le président Senghor décide de s’adresser au pays et tient un discours menaçant envers les travailleurs, les exhortant à désobéir au mot d’ordre de grève générale, tout en accusant les étudiants d’être "téléguidés" de "l’étranger". Mais en dépit des menaces réelles du pouvoir allant jusqu’à donner des ordres de réquisition de certaines catégories de travailleurs, le mouvement de grève s’avère très suivi dans le public comme dans le privé.
Le 31 mai à 10 heures, des assemblées générales sont organisées à la bourse du travail auxquelles sont invitées les délégations des secteurs en grève afin de décider de la suite à donner au mouvement.
"Mais les forces de l’ordre avaient déjà bouclé le quartier. À 10 heures, l’ordre fut donné de charger les travailleurs à l’intérieur de la Bourse. Les portes et fenêtres furent défoncées, les armoires éventrées, les archives détruites. Les bombes lacrymogènes et les coups de matraque eurent raison des travailleurs les plus téméraires. En réponse aux brutalités policières, les travailleurs auxquels se mêlèrent les élèves et le lumpen proletariat, s’attaquèrent aux véhicules et magasins dont plusieurs furent incendiés. Le lendemain Abdoulaye Diack, secrétaire d'État à l’information, révélait devant la presse que 900 personnes avaient été interpellées dans la Bourse du Travail et ses environs. Parmi celles-ci, on comptait 36 responsables syndicaux dont 5 femmes. En réalité, au cours de la semaine de crise, pas moins de 3000 personnes avaient été interpellées. Certains dirigeants syndicaux furent déportés (…). Ces actes ne firent qu’accentuer l’indignation des populations et la mobilisation des travailleurs." (Bathily, ibid.)
En effet, aussitôt après cette conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du gouvernement donne ses chiffres sur les victimes, grèves, manifestations et émeutes ne font que s’intensifier jusqu’à ce que la bourgeoisie décide d’arrêter les frais.
"Les syndicats alliés du gouvernement et le patronat sentaient la nécessité de lâcher du lest pour éviter un durcissement au sein des travailleurs qui, au cours des manifestations, avaient pu prendre conscience de leur poids." (Bathily, ibid.)
Dès lors, après une série de réunions entre le gouvernement et les syndicats, le 12 juin, le président Senghor annonce un accord de fin de grève basé sur 18 points comprenant 15% d’augmentation de salaire. En conséquence, le mouvement prend fin officiellement à cette date-là, ce qui n’empêche pas la poursuite du mécontentement et le resurgissement d’autres mouvements sociaux, car la méfiance est de mise chez les grévistes vis-à-vis des promesses du pouvoir de Senghor. Et, de fait, quelques semaines après la signature de l’accord de fin de grève, des mouvements sociaux repartent de plus belle, avec des moments vigoureux, jusqu’au début des années 1970.
En fin de compte, il convient de souligner l’état de désarroi dans lequel s’est trouvé le pouvoir sénégalais au plus fort de sa confrontation au "mouvement de mai à Dakar":
"Du 1er au 3 juin, on avait l’impression que le pouvoir était vacant. L’isolement du gouvernement était démontré par l’inaction du parti au pouvoir. Devant l’ampleur de l’explosion sociale, les structures de l’UPS (parti de Senghor) n’ont pas réagi. La fédération des étudiants UPS s’est contentée de la distribution furtive de quelques tracts contre l’UDES au début des événements. Cette situation était d’autant plus frappante que l’UPS s’était vantée, trois mois plus tôt, d’avoir été plébiscitée à Dakar lors des élections législatives et présidentielles du 25 février 1968. Or, voilà qu’elle était incapable de trouver une riposte populaire face à ce qui se passait.
Selon la rumeur, les ministres avaient été consignés au building administratif, siège du gouvernement, et de hauts responsables du parti et de l'État s’étaient cachés dans leur maison. C’était là un bien curieux comportement pour des dirigeants d’un parti qui se disait majoritaire dans le pays. En un moment, le bruit avait couru que le président Senghor se serait réfugié à la base militaire française de Ouakam. Ces rumeurs étaient d’autant plus vraisemblables que les informations concernant la "fuite" du général de Gaulle en Allemagne, le 29 mai, étaient connues à Dakar." (Bathily, ibid.)
En effet, le pouvoir sénégalais a vraiment tangué et, en ce sens, il est tout à fait symptomatique de voir la quasi-simultanéité entre les moments où de Gaulle et Senghor cherchaient soutien ou refuge auprès de leur armée respective.
Par ailleurs, à l’époque, d’autres "rumeurs" plus persistantes indiquaient clairement que ce fut l’armée française, sur place, qui arrêta brutalement les manifestants qui marchaient sur le palais présidentiel en causant plusieurs morts et blessés.
Rappelons aussi que, pour venir à bout du mouvement, le pouvoir sénégalais n’utilisa pas seulement ses chiens de garde habituels, à savoir ses forces policières, mais il eut aussi recours aux forces les plus rétrogrades que sont les chefs religieux et les paysans des campagnes reculées. Au plus fort du mouvement, le 30 et le 31 mai, les chefs de cliques religieuses furent invités par Senghor à occuper les médias nuit et jour pour faire des déclarations condamnant la grève et exhortant les travailleurs à reprendre le travail.
Quant aux paysans, le gouvernement essaya de les dresser, sans succès, contre les grévistes, en les faisant venir en ville en soutien aux manifestations pro-gouvernementales.
"Les recruteurs avaient fait croire à ces paysans que le Sénégal avait été envahi à partir de Dakar par une nation appelée "Tudian" (étudiant) et qu’on faisant appel à eux pour défendre le pays. Par groupes, ces paysans furent déposés aux allées du Centenaire (actuel boulevard du général de Gaulle) avec leurs armes blanches (haches, coupe-coupes, lances, arcs et flèches).
Mais ils se rendirent bien vite compte qu’ils avaient été menés en bateau. (…) Les jeunes les dispersèrent à coups de pierres et se partagèrent les victuailles. (…) D’autres furent lapidés lors de leur passage à Rufisque. En tout état de cause, l’émeute révéla la fragilité des bases politiques de l’UPS et du régime en milieu urbain, à Dakar en particulier." (Bathily, ibid.)
Décidément, le pouvoir de Senghor aura utilisé tous les moyens y compris les plus obscurs pour venir à bout du soulèvement social contre son régime. Cependant, pour éteindre définitivement le feu, l’arme la plus efficace pour le pouvoir fut sans doute le rôle joué par Doudou Ngome, le chef du principal syndicat de l’époque, l’UNTS. Ce fut lui qui "négocia" les conditions de l’étouffement de la grève générale. D’ailleurs, en guise de remerciement, le président Senghor le nomma ministre quelques années plus tard. Voilà encore une illustration du rôle de briseur de grèves des syndicats qui, en compagnie de l’ex-puissance coloniale, sauvèrent définitivement la tête de Senghor.
Le rôle précurseur des lycéens dans le mouvement
"Les lycées de la région du Cap-Vert, déjà "chauffés" par la grève du lycée de Rufisque au mois d’avril, furent les premiers à entrer en action. Les élèves étaient d’autant plus prompts à investir la rue qu’ils se considéraient, à l’instar des étudiants, comme les victimes de la politique éducative du gouvernement et concernés en particulier par la politique de fractionnement des bourses. En tant que futurs étudiants, ils se disaient partie prenante de la lutte engagée par l’UDES. De Dakar, le mouvement de grève se répandit très rapidement dans les autres établissements secondaires du pays à partir du 27 mai. (…) La direction du mouvement des élèves était très instable, d’une réunion à l’autre les délégués, très nombreux, changeaient. (…) Un important noyau de grévistes très actifs se faisait également remarquer à l’école normale des jeunes filles de Thiès. Quelques dirigeants élèves s’installèrent même à la Cité et, à partir de là, coordonnaient la grève. Par la suite, un comité national des lycées et collèges d’enseignement général du Sénégal se constitua, devenant ainsi une sorte d’état-major du mouvement élève." (Bathily, ibid.)
L’auteur décrit là le rôle actif des lycéens dans le mouvement massif du Mai 68 local, en particulier la prise en main de la lutte à travers des assemblées générales et coordinations. En effet, dans chaque lycée, il y avait un comité de lutte et des assemblées générales se dotant de directions changeantes, élues et révocables.
Le magnifique engagement des lycéens et des lycéennes fut d’autant plus significatif que c’était la première fois dans l’histoire du pays que cette partie de la jeunesse se mobilisait avec ampleur en tant que mouvement social revendicatif devant la nouvelle bourgeoisie au pouvoir. Si le point de départ du mouvement fut une réaction de solidarité avec un camarade victime d’une "punition administrative", les lycéens, comme les étudiants et les salariés, prenaient aussi conscience de la nécessité de lutter contre les effets de la crise du capitalisme que le pouvoir de Senghor voulait leur faire payer.
L’impérialisme occidental au secours de Senghor
Au plan impérialiste, la France suivait de très près la crise provoquée par les événements de 1968 et pour cause, elle était vraiment chez elle au Sénégal. En effet, outre ses bases militaires (navales, aériennes et terrestres) implantées dans la zone de Dakar, dans chaque ministère et à la présidence, il y avait un "conseiller technique" désigné par Paris dans le but évident d’orienter la politique du pouvoir sénégalais, bien entendu dans le sens de ses intérêts.
On se rappelle à cet égard qu’avant d’être un des meilleurs "élèves" du bloc occidental, le Sénégal fut longtemps le principal bastion historique du colonialisme français en Afrique (de 1659 à 1960), et c’est bien à ce titre que le Sénégal participa, avec ses "tirailleurs", à toutes les guerres que la France dut mener dans le monde depuis la conquête de Madagascar au 19e siècle, en passant par les deux Guerres mondiales et par les guerres d’Indochine et d’Algérie. C’est donc en toute logique que la France mit naturellement à profit son rôle de "gendarme délégué" en Afrique pour le compte du bloc impérialiste occidental pour protéger, en utilisant tous les moyens à sa disposition, le régime de Senghor:
"Dès le lendemain des événements de 68, la France intervint auprès de ses partenaires de la CEE pour voler au secours du régime sénégalais. L'État n’avait pas les moyens pour faire face à l’ardoise découlant des négociations du 12 juin. Dans un discours du 13 juin, le président Senghor a expliqué que les accords avec les syndicats se chiffraient à 2 milliards CFA. Une semaine après ces négociations, le FED [Fonds européen de développement, NDLR] consentit à la Caisse de stabilisation des prix de l’arachide une avance de 2 milliards et 150 millions CFA "destinée à pallier les conséquences des fluctuations des cours mondiaux au cours de la campagne 1967/68". (…) Mais même les USA, qui avaient été pris à partie par le président Senghor pendant les événements, participèrent, avec les autres pays occidentaux, au rétablissement du climat de paix sociale au Sénégal. En effet, les USA et le Sénégal signèrent des accords portant sur la construction de 800 logements pour revenus moyens, pour un total de 5 millions de dollars." (Bathily, ibid.)
Ce faisant, il est clair que l’enjeu principal pour le bloc occidental fut d’éviter la chute du régime sénégalais et son basculement dans le camp des ennemis (la Chine et le bloc de l’Est).
De fait, après avoir repris le contrôle de la situation, le président Senghor prit aussitôt le chemin des "pays amis"; parmi eux l’Allemagne l’accueillit à Francfort, alors qu’il venait de réprimer dans le sang les grévistes sénégalais. Cet accueil de Francfort est d’ailleurs riche d’enseignements car Senghor y allait pour recevoir de l’aide et se faire "décorer" par un pays membre éminent de l’OTAN. De l’autre côté, cette visite fut l’occasion pour les étudiants allemands, à la tête desquels se trouvait "Dany le rouge", de manifester dans la rue leur soutien à leurs camarades sénégalais, comme le relate le journal Le Monde daté du 25/09/1968:
"Monsieur Daniel Cohn-Bendit arrêté dimanche à Francfort au cours de manifestations hostiles à Monsieur Léopold Senghor, Président du Sénégal, a été inculpé (en compagnie de 25 camarades) lundi après-midi par un magistrat allemand de la ville d’incitation à l’émeute et de rassemblement interdit (…)."
Dans leur lutte, les étudiants sénégalais purent recevoir également le soutien de leurs camarades à l’étranger qui occupaient souvent les ambassades et consulats du Sénégal. Le mouvement au Sénégal eut un écho en Afrique même:
"En Afrique, les événements de Dakar connurent leurs prolongements, grâce à l’action des unions nationales (syndicats étudiants). De retour dans leur pays, les étudiants africains expulsés de l’Université de Dakar poursuivirent leur campagne d’information. (…) Les gouvernements africains d’alors considéraient avec méfiance les étudiants venus de Dakar. Autant la plupart d’entre eux montrèrent une certaine irritation face à la manière dont leurs ressortissants avaient été expulsés, autant ils redoutaient la contagion de leurs pays par "la subversion venue de Dakar et de Paris"." (Bathily, ibid.)
A vrai dire, ce fut la quasi-totalité des régimes africains qui craignaient la "contagion" et la "subversion" de Mai 68. À commencer par Senghor lui-même qui dut recourir à de violents moyens répressifs contre la jeunesse scolarisée. Ainsi beaucoup de grévistes connurent la prison ou le service militaire forcé ressemblant fort à des déportations dans des camps militaires. De même de nombreux étudiants africains étrangers furent massivement expulsés, dont certains furent maltraités de retour chez eux.
Quelques enseignements des événements de Mai 68 à Dakar
Incontestablement, le "Mai à Dakar" est un des maillons de la chaîne du Mai 68 mondial. L’importance des moyens déployés par le bloc impérialiste occidental pour sauver le régime sénégalais se mesure à l'aune de la puissance du mouvement de lutte des ouvriers, étudiants et jeunes scolarisés.
Mais au-delà de la radicalité de l’action des étudiants, le mouvement de Mai 68 au Sénégal, avec sa composante ouvrière, venait de renouer avec l’esprit et la forme de lutte prolétarienne qu'avait pratiquée la classe ouvrière de la colonie de l’AOF dès le début du 20e siècle, mais que la bourgeoisie africaine au pouvoir avait réussi à étouffer, notamment durant les premières années de "l’indépendance nationale".
Mai 68 a été finalement plus qu’une ouverture sur un nouveau monde rompant avec la période contre-révolutionnaire, il a été un moment d’éveil pour beaucoup de protagonistes, en particulier chez les jeunes. De par leur engagement dans la lutte contre les forces du capital national, ils ont mis à nu nombre de mythes et d’illusions, notamment sur la "fin de la lutte des classes" sous prétexte de l’absence d’antagonismes entre la classe ouvrière (africaine) et la bourgeoisie (africaine).
Aussi, il convient de remarquer que, pour parvenir à vaincre le mouvement social, la répression policière et l’emprisonnement de milliers de grévistes furent insuffisants; à cela durent s’ajouter le piège syndical et l’appui décisif de la France et du bloc de l’Ouest à leur "poulain protégé". Mais il fallut aussi satisfaire une bonne partie des revendications des étudiants et des travailleurs par une forte augmentation des salaires.
Reste l’essentiel: les grévistes ne furent pas "endormis" très longtemps par l’accord qui mit fin à la grève car, dès l’année suivante, la classe ouvrière reprenait le combat de plus belle en s'inscrivant pleinement dans la vague internationale de luttes initiée par Mai 68.
Enfin, on aura noté dans ce mouvement le recours aux modes d’organisation véritablement prolétariens que sont les comités de grève et assemblées générales, haute expression d’auto-organisation; bref une claire volonté de prise en main des luttes par les grévistes eux-mêmes. Voilà un aspect particulier qui caractérise la lutte d’une fraction de la classe ouvrière mondiale, pleinement partie prenante du combat à venir pour la révolution communiste.
Lassou (fin)
[1] Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations."
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" : le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ? (II)
- 3318 lectures
La surproduction, contradiction de base du capitalisme, est liée à l'existence du salariat. Ses déterminations seront mises à nu dans cette seconde partie de l'article afin de pouvoir répondre aux grandes questions qui font l'objet de désaccords importants avec le livre de Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme[1] (identifiés MR et Dyn dans la suite de l'article): pourquoi augmenter les salaires des ouvriers ne résout pas le problème de la surproduction? D'où émane la demande extérieure à celle des ouvriers et quelles en sont le rôle et les limites? Existe-t-il une solution à la surproduction au sein du capitalisme? Comment caractériser les courants qui prônent la résolution des crises du capitalisme au moyen de l'augmentation des salaires? Le capitalisme est-il condamné à un effondrement catastrophique?
Existe-t-il une solution à la crise au sein du capitalisme ?
Les déterminations de la surproduction
La surproduction est la caractéristique des crises du capitalisme, par opposition aux crises des modes de production qui l'ont précédé et qui étaient, elles, caractérisées par la pénurie.
Elle résulte, en premier lieu, de la nature même de l'exploitation de la force de travail propre à ce mode de production, le salariat, qui fait que les ouvriers doivent toujours produire au-delà de leurs besoins. C'est cette caractéristique qu'exprime de la façon la plus fondamentale le passage suivant de Marx:
"Le simple rapport salarié-capitaliste implique que (…) la majorité des producteurs (les ouvriers) (…) Pour pouvoir consommer ou acheter dans les limites de leurs besoins, (…) doivent toujours être surproducteurs, toujours produire au-delà de leurs besoins."[2]
Cela suppose donc l'existence d'une demande extérieure à celle des ouvriers, cette dernière ne pouvant par essence jamais suffire à absorber la production capitaliste:
"On oublie que, selon Malthus, "l'existence même d'un profit sur n'importe quelle marchandise présuppose une demande extérieure à celle de l'ouvrier qui l'a produite", et que, par conséquent "la demande de l'ouvrier lui-même ne peut jamais être une demande adéquate" (Malthus, Principles … p.405)."[3]
C'est justement lorsque la demande extérieure à celle des ouvriers est insuffisante, que la surproduction se manifeste:
"si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate."[4]
La contradiction est d'autant plus violente que, d'un côté, le salaire des ouvriers est contraint au minimum social nécessaire pour reproduire leur force de travail et, de l'autre, les forces productives du capitalisme tendent à être développées au maximum:
"La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société"[5]
Pourquoi augmenter les salaires des ouvriers ne résout pas le problème de la surproduction?
Il existe différents procédés permettant à la bourgeoisie de masquer la surproduction:
1) Détruire la production en excédent, de manière à éviter que sa mise sur le marché ne tire vers le bas les prix de vente. C'est en particulier ce qui s'est passé dans les années 1970 et 80 avec la production agricole dans les pays de la Communauté économique européenne. Ce procédé présente pour la bourgeoisie l'inconvénient de révéler au grand jour les contradictions du système et de susciter l'indignation alors que les produits ainsi détruits font défaut, de façon vitale, à une partie importante de la population mondiale.
2) Réduire l'utilisation des capacités productives ou même détruire une partie de celles-ci. Une illustration de ce type de réduction drastique de la production avait été le plan Davignon mis en place dès 1977 par la Commission européenne pour réaliser la restructuration industrielle (avec des dizaines de milliers de licenciements à la clé) du secteur sidérurgique, face à la surproduction mondiale d'acier. Il s'était traduit par la destruction d'une grande partie du parc des hauts-fourneaux dans plusieurs pays européens et la mise à la rue de dizaines de milliers de sidérurgistes conduisant à des mouvements de lutte importants, notamment en France en 1978 et 1979.
3) Augmenter artificiellement la demande, c'est-à-dire générer une demande non pas tirée par des besoins en investissements devant être rentabilisés ultérieurement mais directement motivée par le besoin de faire tourner l'appareil productif. C'est typiquement le cas des mesures keynésiennes qui ont un coût assumé par l'État et qui, de ce fait, se répercutent nécessairement sur la compétitivité de l'économie nationale où elles sont appliquées. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent être mises en œuvre que dans des conditions permettant de compenser, grâce à des gains importants de productivité, la perte de compétitivité. De telles mesures peuvent tout aussi bien concerner l'augmentation des salaires que des programmes de travaux publics n'ayant pas une rentabilité immédiate.
Ces trois procédés, quoique différents dans la forme, ont exactement la même signification quant au développement du capitalisme et, dans le fond, ils peuvent se ramener au premier d'entre eux, le plus parlant, la destruction volontaire de la production. Cela peut paraître choquant, du point de vue ouvrier, d'entendre dire qu'une augmentation de salaire non justifiée par les besoins de la reproduction de la force de travail, revient à du gaspillage. Il s'agit bien évidemment de gaspillage du point de vue de la logique capitaliste (laquelle n'a que faire du bien-être de l'ouvrier), pour laquelle payer plus cher l'ouvrier n'augmentera en rien sa productivité.
MR, qui pense que le mécanisme à l'œuvre durant les Trente Glorieuses a été compris par peu de marxistes[6], n'a lui-même pas compris de Marx, ou pas voulu comprendre, que "le but de la production est la mise en valeur du capital et non sa consommation"[7] (Cité explicitement dans la suite de l'article), que cette consommation soit le fait de la classe ouvrière ou des bourgeois.
On peut appeler ce gaspillage "régulation", comme le fait MR sans reconnaître qu'il s'agit de gaspillage; cela lui permettra peut-être de rendre sa thèse plus présentable. Mais cela ne change en rien le fait que, dans une grande mesure, la prospérité des Trente Glorieuses est le gaspillage d'une partie des gains de productivité utilisés à produire pour produire.
D'où émane la demande extérieure à celle des ouvriers?
Pour MR, et contrairement à Rosa Luxemburg dont il critique la théorie de l'accumulation, la demande autre que celle de l'ouvrier peut parfaitement émaner du capitalisme lui-même, et non pas nécessairement de sociétés basées sur des rapports de production non encore capitalistes et qui ont longtemps coexisté avec le capitalisme.
Cette demande, selon Marx, n'émane ni des ouvriers ni des capitalistes eux-mêmes mais des marchés n'ayant pas encore accédé au mode de production capitaliste.
Dans son livre, MR mentionne l'opinion de Malthus à ce sujet: "Il est à noter que cette "demande autre que celle émanant du travailleur qui l'a produite" recouvre, sous la plume de Malthus, une demande interne au capitalisme pur puisqu'elle se réfère aux couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value et non pas une demande extra-capitaliste selon la théorie luxemburgiste de l'accumulation" (Dyn p.27). Marx, soutenant en cela Malthus, est catégorique sur le fait que cette demande ne peut pas provenir de l'ouvrier: "La demande provoquée par le travailleur productif en personne ne peut jamais être une demande adéquate, puisqu'elle ne concerne pas la totalité de ce qu'il produit. Si tel était le cas, il n'y aurait pas de profit et par conséquent nul motif pour le capitaliste d'employer le travail de l'ouvrier."[8] Il est aussi explicite sur le fait que, pour Malthus, cette demande émane de "couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value" mais, dans le même temps, il dénonce la motivation de Malthus qui est relative à la défense des intérêts du "clergé d'Église et d'État": "Malthus n’a pas intérêt à masquer les contradictions de la production bourgeoise; au contraire: il est de son intérêt de les souligner, d’une part pour prouver le caractère nécessaire des classes laborieuses (il l’est pour ce mode de production) et, d’autre part, pour démontrer aux capitalistes la nécessité d’un clergé d’Église et d’État bien gras, afin de créer une demande adéquate. […] Il souligne donc, contre les ricardiens, la possibilité d’une surproduction généralisée".[9] Ainsi, ce n'est pas parce que Malthus pense que la demande adéquate peut provenir des "couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value" qu'il en est de même pour Marx. Au contraire, ce dernier est très explicite quant au fait que cette demande adéquate ne peut provenir ni des ouvriers ni des capitalistes: "La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage".[10]
A ce propos, on ne peut que relever une mauvaise volonté évidente de MR pour fournir à ses lecteurs les moyens d'élargir le champ de leur réflexion lorsqu'il s'agit de rapporter le point de vue de Marx sur la nécessité d'une demande autre que celle émanant des ouvriers et des capitalistes. Sinon, comment expliquer qu'il n'ait pas évoqué le passage suivant où Marx explicite la nécessité de "commandes au loin", de "marchés étrangers" pour vendre les marchandises produites:
"Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation."[11] (Souligné par nous)
Il est vrai que la citation ne nous donne pas plus de précisions permettant de mieux caractériser la nature de ces "marchés étrangers", de ces "commandes" qui sont passées "au loin". Ceci dit, celle-ci étant explicite quant au fait que la demande en question ne peut pas émaner des capitalistes eux-mêmes, car le but de la production est la mise en valeur du capital et non pas sa consommation, à partir de là il n'est pas interdit de réfléchir. La demande en question ne peut pas, non plus, émaner de quelque autre agent économique au sein du capitalisme qui vit de la plus-value extraite et redistribuée par la bourgeoisie. Qui reste-t-il en fin de compte dans la société capitaliste? Personne et c'est pourquoi il faut s'adresser aux "marchés au loin", c'est-à-dire non encore conquis par les rapports de production capitalistes.
C'est exactement ce que nous dit le Manifeste communiste lorsqu'il décrit la conquête de la planète par la bourgeoisie, poussée par le besoin de débouchés toujours plus importants:
"Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations. (…) Par suite du perfectionnement rapide de tous les instruments de production et grâce à l'amélioration incessante des communications, la bourgeoisie précipite dans la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, à adopter le mode de production bourgeois; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit: elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image."[12]
Marx nous fournit une description plus détaillée concernant la manière dont s'effectue l'échange avec des sociétés marchandes non capitalistes, aussi variées soient-elles, grâce auquel le capital bénéficie à la fois d'un débouché et d'une source d'approvisionnement nécessaires à son développement: "dans le processus de circulation où le capital industriel fonctionne soit comme argent, soit comme marchandise, son circuit s'entrecroise – comme capital-argent ou comme capital-marchandise – avec la circulation marchande des modes sociaux de production les plus divers, dans la mesure où celle-ci est en même temps production marchande. Il importe peu que les marchandises soient le fruit d'une production fondée sur l'esclavage, ou le produit de paysans (Chinois, ryots des Indes), de communes rurales (Indes hollandaises), d'entreprises d'État (comme on les rencontre aux époques anciennes de l'histoire russe, sur la base du servage), ou de peuples chasseurs demi-sauvages, etc.: comme marchandises et argent, elles affrontent l'argent et les marchandises qui représentent le capital industriel; elles entrent dans le circuit du capital industriel tout autant que dans le circuit de la plus-value véhiculée par le capital-marchandise et dépensée comme revenu; elles entrent donc dans les deux phases de circulation du capital-marchandise. Ce qui caractérise par conséquent le processus de circulation du capital industriel, c'est l'origine universelle des marchandises, l'existence du marché comme marché mondial."[13]
La fin de la phase d'accumulation primitive a-t-elle modifié les relations du capital avec sa sphère extérieure?
MR reproduit également la deuxième partie de la citation ci-dessus du Manifeste communiste, mais en prenant soin de souligner que "tous les ressorts et limites du capitalisme dégagés par Marx dans Le Capital ne l'ont été qu'en faisant abstraction des rapports avec sa sphère extérieure (non capitaliste). Plus précisément, Marx analyse ces derniers uniquement dans le cadre de l'accumulation primitive, car il se réservait de traiter les autres aspects de "l'extension du champ extérieur de la production" dans deux volumes spécifiques consacrés, pour l'un, au commerce international et, pour l'autre, au marché mondial". (Dyn p.36. Souligné par nous)
Il poursuit en affirmant que, pour lui, les "marchés étrangers" n'ont plus continué à jouer un rôle important pour le développement du capitalisme, une fois achevée la phase d'accumulation primitive: "Cependant, une fois ses fondements cimentés par trois siècles d'accumulation primitive, c'est essentiellement sur ses propres bases que le capitalisme s'est déployé. En regard de l'importance et du dynamisme pris par la production capitaliste, la contribution de son environnement extérieur est devenue relativement marginale pour son développement." (Dyn p.38)
Le raisonnement de Marx démontre, nous l'avons vu, la nécessité d'un marché extérieur. La description qu'il fait de cette sphère extérieure dans le Manifeste communiste montre qu'elle est constituée de sociétés marchandes n'ayant pas encore accédé aux relations de production capitalistes. Marx n'explique évidemment pas dans le détail pourquoi cette sphère doit être extérieure aux relations de production capitalistes, cependant il fait clairement découler sa nécessité des caractéristiques mêmes de la production capitaliste. Si, comme MR, Marx ou Engels avaient pensé que, depuis la première publication du Manifeste, des modifications importantes étaient intervenues concernant les relations du capital avec sa sphère extérieure, les "marchés au loin" ayant de cessé de jouer le rôle qu'ils avaient eu jusque-là durant l'accumulation primitive, on peut penser qu'ils auraient ressenti la nécessité d'en rendre compte dans les préfaces des éditions successives du Manifeste[14], alors que l'un et l'autre ont été témoin, sur des périodes différentes, de la marche triomphante du capitalisme après la phase d'accumulation primitive. Or, non seulement cela n'a pas été le cas mais encore le livre III est commencé en 1864 et "terminé" en 1875. On peut penser qu'à cette date-là Marx avait acquis déjà suffisamment de recul par rapport à la phase d'accumulation primitive (de la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du 19e siècle) et, pourtant, il poursuit dans cet ouvrage l'idée du Manifeste communiste en invoquant, "les commandes au loin", "les marchés étrangers".
MR persiste dans sa thèse, en prétendant qu'elle correspond à la vision qu'avait Marx: "C'est pourquoi, nous pensons comme Marx que "la tendance à la surproduction" ne provient pas d'une insuffisance de marchés extra-capitalistes, mais bien du "rapport immédiat du capital" au sein du capitalisme pur: "Il va de soi que nous n'avons pas l'intention d'analyser ici en détail la nature de la surproduction; nous dégageons simplement la tendance à la surproduction qui existe dans le rapport immédiat du capital. Nous pouvons donc laisser de côté ici tout ce qui a trait aux autres classes possédantes et consommatrices, etc., qui ne produisent pas, mais vivent de leurs revenus, c'est-à-dire procèdent à un échange avec le capital et constituent autant de centres d'échange pour lui. Nous n'en parlerons que là où elles ont une importance véritable, c'est-à-dire dans la genèse du capital" (Grundrisse, chapitre sur le capital, Éditions 10/18. p.226)." (Dyn p.38)
Ce que dit la citation de Marx, c'est que, pour l'examen de la surproduction, on peut laisser de côté le rôle joué par les classes possédantes dans leurs échanges avec le capitalisme car, de ce point de vue, elles n'ont plus qu'un rôle marginal. Or, les classes possédantes ici nommées sont celles qui subsistent de l'ancien ordre féodal. Ce que la citation ne dit pas, en revanche, c'est ce que MR veut lui faire dire, à savoir que les "marchés étrangers", des "commandes" qui sont passées "au loin" n'ont plus qu'un rôle marginal face à la surproduction. Or c'est bien cela qui est au cœur de la polémique.
La théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg à l'épreuve
Il revient à Rosa Luxemburg d'avoir mis en évidence que l'enrichissement du capitalisme, comme un tout, dépendait des marchandises produites en son sein et échangées avec des économies précapitalistes, c'est-à-dire pratiquant l'échange marchand mais n'ayant pas encore adopté le mode de production capitaliste. Rosa Luxemburg n'a pas fait que développer l'analyse de Marx, elle en a également fait la critique dans L'Accumulation du capital lorsque c'était nécessaire, en ce qui concerne notamment les schémas de l'accumulation dont certaines erreurs résultaient, selon elle, du fait que ceux-ci ne font pas intervenir les marchés extra-capitalistes, pourtant indispensables à l'accomplissement de la reproduction élargie. Elle attribue cette erreur au fait que, Le Capital étant une œuvre inachevée, Marx réservait à des travaux ultérieurs l'étude du capital en lien avec son environnement.[15]
MR critique la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg. Pour lui, en effet, c'est de façon délibérée et justifiée d'un point de vue théorique que Marx écarte, dans sa description de l'accumulation au moyen de schémas, la sphère des relations extra-capitalistes: "Appréhender la place que Marx attribue à cette sphère dans le développement historique du capitalisme permet de comprendre pourquoi il l'élimine de son analyse dans Le Capital: non pas seulement par hypothèse méthodologique comme le pense Luxemburg, mais parce qu'elle représente une entrave dont le capitalisme a dû se débarrasser. Ignorant cette analyse, Luxemburg n'a pas compris les raisons profondes pour lesquelles Marx écarte cette sphère dans Le Capital". (Dyn p.36) Sur quoi MR appuie-t-il une telle affirmation? Sur l'argument que nous avons réfuté précédemment, selon lequel pour lui et Marx, les "marchés lointains" n'auraient plus joué qu'un rôle marginal dans le développement du capitalisme après sa phase d'accumulation primitive.
MR avance trois autres arguments venant, selon lui, étayer sa critique de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg.
1) "Pour Rosa Luxemburg, la force du capital dépend de l'importance de la sphère précapitaliste et l'épuisement de celle-ci annonce sa mort. Marx soutient une compréhension opposée: "Tant que le capital est faible, il cherche à s'appuyer sur les béquilles d'un mode de production disparu ou en voie de disparition; sitôt qu'il se sent fort, il se débarrasse de ses béquilles et se meut conformément à ses propres lois" (Le Capital, p.295. Éd. La Pléiade Économie II). Cette sphère ne constitue donc pas un milieu dont le capitalisme devrait se nourrir pour pouvoir s'élargir, mais une béquille qui l'affaiblit et dont il doit se débarrasser pour être fort et se mouvoir conformément à ses propres lois." (Dyn p.36) Cette conclusion est pour le moins hâtive et tirée par les cheveux.[16] Le Manifeste contient d'ailleurs une idée très proche de celle de la citation de Marx ci-dessus empruntée au Capital, mais exprimée de manière telle que, contrairement à ce que pense MR, elle permet d'affirmer que le milieu précapitaliste a constitué un terreau nourricier pour le capitalisme:
"La grande industrie a fait naître le marché mondial, que la découverte de l'Amérique avait préparé. Le marché mondial a donné une impulsion énorme au commerce, à la navigation, aux voies de communication. En retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie. À mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer prirent de l'extension, la bourgeoisie s'épanouissait, multipliant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan toutes les classes léguées par le Moyen Âge."[17] (souligné par nous)
On voit ici que, alors qu'il crée le marché mondial et qu'il se développe, ce n'est pas le marché mondial que le capitalisme rejette mais bien les classes léguées par le Moyen Âge qu'il refoule à l'arrière-plan.
2) "Les meilleures estimations des ventes à destination du tiers-monde montrent que la reproduction élargie du capitalisme ne dépendait pas des marchés extra-capitalistes en dehors des pays développés: "En dépit d'une opinion très répandue, il n'y a jamais eu, dans l'histoire du monde occidental développé, de période au cours de laquelle les débouchés offerts par les colonies, ou même l'ensemble du tiers-monde, aient joué un grand rôle dans le développement de ses industries. Le tiers-monde dans son ensemble ne représentait même pas un débouché très important [...] on peut estimer que le tiers-monde n'absorbait que 1,3% à 1,7% du volume total de la production des pays développés, dont seulement 0,6 à 0,9% pour les colonies" (Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, p.104-105). Déjà très faible, ce pourcentage l'est en réalité bien plus puisque ce n'est qu'une partie des ventes au tiers-monde qui est destinée à la sphère extra-capitaliste". (Dyn p.39)
Nous traiterons de cette objection plus globalement en prenant en compte également la suivante: "Ce sont les pays disposant d'un vaste empire colonial qui connaissent les taux de croissance les plus faibles, alors que ceux vendant sur les marchés capitalistes ont des taux bien supérieurs! Ceci se vérifie tout au long de l'histoire du capitalisme, et en particulier aux moments où les colonies jouent, ou devraient jouer, leur plus grand rôle! Ainsi, au XIXème siècle, au moment où les marchés coloniaux interviennent le plus, tous les pays capitalistes non coloniaux ont connu des croissances nettement plus rapides que les puissances coloniales (71% plus rapides en moyenne – moyenne arithmétique des taux de croissance non pondérée par les populations respectives des pays). Il suffit de prendre les taux de croissance du PIB par habitant durant les 25 années d'impérialisme (1880-I913), que Rosa Luxemburg définissait comme la période la plus prospère et dynamique du capitalisme:
1) Puissances coloniales: Grande-Bretagne (1,06%), France (1,52%), Hollande (0,87%), Espagne (0,68%), Portugal (0,84%);
2) Pays très peu ou non coloniaux: USA (1,56%), Allemagne (1,85%), Suède (1,58%), Suisse (1,69%), Danemark (1,79%) (Taux de croissance annuel moyen; source: www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison [307])." (Dyn p.39 et 40)
Notre réponse à ce qui précède tient en quelques mots. Il est faux d'identifier marchés extra-capitalistes et colonies car les marchés extra-capitalistes incluent aussi bien les marchés intérieurs que les colonies non encore assujetties aux relations de production capitalistes. Pendant la période 1880-1913, tous les pays cités ci-dessus bénéficient au minimum de l'accès à leur propre marché extra-capitaliste intérieur, voire à celui d'autres pays industrialisés. De plus, du fait de la division internationale du travail, le commerce avec la sphère extra-capitaliste peut également bénéficier, indirectement, aux pays ne possédant pas directement de colonies.
Quant aux États-Unis, ils sont l'illustration type du rôle que jouent les marchés extra-capitalistes dans le développement économique et industriel. Après la destruction de l’économie esclavagiste des États du Sud par la Guerre civile (1861-1865), le capitalisme s’est étendu au cours des 30 années suivantes vers l’Ouest américain selon un processus continu qu’on peut résumer ainsi: massacre et nettoyage ethnique de la population indigène; établissement d’une économie extra-capitaliste à travers la vente et la concession de territoires nouvellement annexés par le gouvernement à des colons et de petits éleveurs; destruction de cette économie extra-capitaliste au moyen de la dette, la fraude et la violence, et extension de l’économie capitaliste. En 1898, un document du Département d’État américain expliquait: "Il semble à peu près certain que tous les ans nous aurons à faire face à une surproduction croissante de biens qui devront être placés sur les marchés étrangers si nous voulons que les travailleurs américains travaillent toute l'année. L'augmentation de la consommation étrangère des biens produits dans nos manufactures et nos ateliers est, d'ores et déjà, devenue une question cruciale pour les autorités de ce pays comme pour le commerce en général."[18]. Suivit alors une rapide expansion impérialiste: Cuba (1898), Hawaï (1898 également), Philippines (1899), la zone du canal de Panama (1903). En 1900, Albert Beveridge (un des principaux partisans de la politique impérialiste américaine) déclarait au Sénat: "Les Philippines sont à nous pour toujours (...). Et derrière les Philippines, il y a les marchés illimités de Chine (...). Le Pacifique est notre océan (...) Où trouver des consommateurs pour nos surplus? La géographie apporte la réponse. La Chine est notre client naturel." Il n'est nul besoin des "meilleures statistiques" pour prouver qu'un atout ayant permis aux États-Unis de devenir la première puissance mondiale avant la fin du 19e siècle consiste dans le fait qu'ils ont pu disposer d'un accès privilégié à de vastes marchés extra-capitalistes.
3) Voici un dernier argument présent dans le livre nécessitant un court commentaire: "La réalité est donc pleinement conforme à la vision de Marx, et exactement à l'opposé de la théorie de Rosa Luxemburg. Ceci s'explique aisément pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici. Signalons rapidement qu'en règle générale, toute vente de marchandise sur un marché extra-capitaliste sort du circuit de l'accumulation et tend donc à freiner cette dernière. La vente de marchandises à l'extérieur du capitalisme pur permet bien aux capitalistes individuels de réaliser leurs marchandises, mais elle freine l'accumulation globale du capitalisme, car cette vente correspond à une sortie de moyens matériels du circuit de l'accumulation au sein du capitalisme pur." (Dyn p.40)
Loin de constituer une entrave à l'accumulation, la vente aux secteurs extra-capitalistes est un facteur qui la favorise. Non seulement ce qui est vendu à la sphère extra-capitaliste ne fait pas défaut à l'accumulation, grâce au dynamisme de ce mode de production qui, par nature, tend toujours à produire de façon excédentaire mais, de plus, elle permet à la sphère des relations de production capitaliste de recevoir des moyens de paiement (le produit de la vente) qui pourront, d'une manière ou d'une autre, accroître le capital accumulé.
L'examen des "arguments" de MR selon lesquels l'existence d'un important secteur extra-capitaliste n'avait pas constitué la condition de l'important développement du capitalisme, montre que ceux-ci ne sont pas consistants. Mais nous sommes évidemment disposés à prendre en compte toute critique concernant la méthode que nous avons employée dans notre propre critique.
Les limites du marché extérieur au capitalisme
L'existence en abondance de marchés extra-capitalistes dans les colonies a permis que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'excédent de la production des principaux pays industrialisés ait pu être écoulé. Mais au sein de ces pays, il subsistait aussi à cette époque, en quantité plus ou moins importante, des marchés extra-capitalistes (la Grande-Bretagne a été la première puissance industrielle à les avoir épuisés) servant également de déversoir à la production capitaliste. C'est pendant cette phase de la vie du capitalisme que les crises furent les moins violentes. "Si différentes qu'elles fussent à maints égards, toutes ces crises cependant présentent un point commun: elles font figure d'interruptions relativement brèves d'un gigantesque mouvement ascendant qu'une vue d'ensemble pourrait considérer comme continu".[19]
Mais les marchés extra-capitalistes n'étaient pas illimités, comme le soulignait Marx: "Du point de vue géographique, le marché est limité: le marché intérieur est restreint par rapport à un marché intérieur et extérieur, qui l’est par rapport au marché mondial, lequel - bien que susceptible d’extension - est lui-même limité dans le temps."[20]. C'est à l'Allemagne que s'imposa en premier cette réalité.
La phase du développement industriel le plus rapide de ce pays se situe à une époque où le partage des richesses du monde était à peu près achevé et où les possibilités de nouvelles poussées impérialistes se faisaient de plus en plus rares. En effet, cet État arrivait sur le marché mondial à un moment où les territoires naguère libres de toute domination européenne étaient presque tous répartis et réduits au rang de colonies ou semi-colonies de ces mêmes États industriels plus anciens et qui formaient, précisément, ses concurrents les plus redoutables. La surproduction et la nécessité d'exporter à tout prix constituent des facteurs qui orientent la politique extérieure de l'Allemagne dès le début du 20e siècle (voir à ce propos les développements du Conflit du siècle, pp.51, 53 et 151). Les restrictions d'accès aux marchés extra-capitalistes furent la conséquence de la transformation de ceux-ci, par les plus grandes puissances coloniales, en véritables chasses gardées. Si bien que le seuil du 20e siècle est marqué par le renforcement des tensions internationales nées de l'expansion impérialiste qui aboutiront à la conflagration mondiale de 1914, lorsque l'Allemagne prit l'initiative d'une guerre en vue d'un repartage du monde et de ses marchés.
MR signale à ce propos la grande disparité des analyses au sein de l'avant-garde révolutionnaire pour expliquer l'entrée en décadence que marque l'éclatement du premier conflit mondial: "Si cette sentence historique [le capitalisme entraîné dans une spirale de crises et de guerres] était communément partagée au sein du mouvement communiste, les facteurs qui étaient censés l'expliquer, l'étaient beaucoup moins". (Dyn p.47) Il omet cependant de relever la grande convergence de Rosa Luxemburg et Lénine autour de l'analyse d'une guerre pour le repartage du monde, Lénine s'exprimant sur ce sujet de la manière suivante: "… le trait caractéristique de la période envisagée, c'est le partage définitif du globe, définitif non en ce sens qu'un nouveau partage est impossible - de nouveaux partages étant au contraire possibles et inévitables - mais en ce sens que la politique coloniale des pays capitalistes en a terminé avec la conquête des territoires inoccupés de notre planète. Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître."[21]
Qui dit nécessité de repartage du monde pour les pays les plus mal lotis en colonies, ne dit pas insuffisance des marchés extra-capitalistes relativement aux besoins de la production. C'est une identification qui a trop souvent été faite. En effet, il existe encore, au début du 20e siècle, des marchés extra-capitalistes en abondance (dans les colonies et au sein même des pays industrialisés) dont l'exploitation est encore capable de faire faire des bonds en avant très importants au développement du capitalisme. C'est ce que met en avant Rosa Luxemburg en 1907 dans son Introduction à l'économie politique: "À chaque pas de son propre développement, la production capitaliste s'approche irrésistiblement de l'époque où elle ne pourra se développer que de plus en plus lentement et difficilement. Le développement capitaliste en soi a devant lui un long chemin, car la production capitaliste en tant que telle ne représente qu'une infime fraction de la production mondiale. Même dans les plus vieux pays industriels d'Europe, il y a encore, à côté des grandes entreprises industrielles, beaucoup de petites entreprises artisanales arriérées, la plus grande partie de la production agricole, la production paysanne, n'est pas capitaliste. À côté de cela, il y a en Europe des pays entiers où la grande industrie est à peine développée, où la production locale a un caractère paysan et artisanal. Dans les autres continents, à l'exception de l'Amérique du Nord, les entreprises capitalistes ne constituent que de petits îlots dispersés tandis que d'immenses régions ne sont pas passées à la production marchande simple. (…) Le mode de production capitaliste pourrait avoir une puissante extension s'il devait refouler partout les formes arriérées de production. L'évolution va dans ce sens."[22]
C'est la crise de 1929 qui viendra signaler l'insuffisance des marchés extra-capitalistes subsistants, non pas de façon absolue mais au regard de la nécessité du capitalisme d'exporter des marchandises en quantités toujours plus importantes. Ces marchés n'étaient pas pour autant épuisés. Les progrès de l'industrialisation et des moyens de transport réalisés dans les métropoles capitalistes rendirent possible une meilleure exploitation des marchés existants, si bien qu'ils purent encore jouer un rôle au début des années 1950, en tant que facteur de la prospérité des Trente Glorieuses.
Cependant, à ce stade, était posée, selon Rosa Luxemburg, la question de l'impossibilité même du capitalisme: "Cependant, cette évolution enferme le capitalisme dans la contradiction fondamentale: plus la production capitaliste remplace les modes de production plus arriérés, plus deviennent étroites les limites du marché créé par la recherche du profit, par rapport au besoin d'expansion des entreprises capitalistes existantes. La chose devient tout à fait claire si nous nous imaginons pour un instant que le développement du capitalisme est si avancé que sur toute la surface du globe tout est produit de façon capitaliste, c'est-à-dire uniquement par des entrepreneurs capitalistes privés, dans des grandes entreprises, avec des ouvriers salariés modernes. L'impossibilité du capitalisme apparaît alors clairement."[23] Comment cette impossibilité allait-elle être surmontée? Nous y reviendrons plus avant en examinant la question de l'effondrement catastrophique du capitalisme.
Il n'existe pas de solution à la surproduction au sein du capitalisme
Du fait même qu'il n'est pas possible, sous le capitalisme, de résoudre les crises de surproduction en augmentant le salaire des ouvriers, ni d'augmenter indéfiniment la demande solvable extérieure à celle des ouvriers, la surproduction ne peut pas être dépassée au sein du capitalisme. En fait, elle ne peut réellement l'être que par l'abolition du salariat et donc le remplacement du capitalisme par la société des producteurs librement associés.
MR ne peut se résoudre à cette logique implacable et sans appel pour le capitalisme et ses réformateurs. En fait, il a beau citer Marx de différentes façons autour du thème "l'ouvrier ne peut constituer une demande adéquate", il a vite fait de l'oublier et d'entrer en contradiction avec cette idée de base selon laquelle "si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate". C'est ainsi qu'il en vient à faire résulter la crise de surproduction de la diminution de la masse salariale, ce qui n'est autre qu'une resucée des thèmes malthusianistes combattus par Marx: "la masse salariale dans les pays développés s'élève aujourd'hui en moyenne aux deux tiers du revenu total et a toujours représenté une composante majeure de la demande finale. Sa diminution restreint les marchés et aboutit à une mévente qui est à la base des crises de surproduction. Cette réduction de la consommation touche directement les salariés, mais indirectement aussi les entreprises puisque la demande se restreint. En effet, l'augmentation correspondante de la part des profits et de la consommation des capitalistes ne parvient que très partiellement à compenser la réduction relative de la demande salariale. C'est d'autant moins le cas que le réinvestissement des profits est limité par la contraction générale des marchés." (Dyn p.14)
Il est indéniable que la diminution des salaires, au même titre que le développement du chômage, ont un impact négatif sur l'activité économique des entreprises du secteur de la production des biens de consommation, en premier lieu celles qui produisent ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail. Mais ce n'est pas la compression salariale qui constitue la cause de la crise. C'est justement l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'il y a crise que l'État ou les patrons sont amenés à licencier et diminuer les salaires.
MR a complètement renversé la réalité. Sa problématique devient "si la demande des ouvriers eux-mêmes s'amenuise, la crise éclate". C'est ainsi que, pour lui, la cause ultime du krach boursier immédiatement antérieur au moment où le livre a été écrit (4e trimestre 2010) réside dans la compression de la demande salariale: "La meilleure preuve en est la configuration qui a mené au dernier krach boursier: comme la demande salariale était drastiquement comprimée, la croissance n'a été obtenue qu'en boostant la consommation (graphique 6.6) par une envolée de l'endettement (qui débute justement en 1982: graphique 6.5), une diminution du taux d'épargne (qui débute en 1982 également: graphique 6.4) et une montée des revenus patrimoniaux." (Dyn p.106). Cela revient ni plus ni moins à mettre sur le compte de la compression de la demande salariale l'ampleur actuelle de l'endettement.
De là à l'idée que la crise est le produit de la rapacité des capitalistes, il n'y a qu'un pas.
Ainsi, comme nous venons de le mettre en évidence et comme il est très clair pour quiconque aborde cette question sérieusement et avec honnêteté, MR défend sur la question des causes fondamentales des crises économiques du capitalisme une analyse différente de celle défendue en leur temps par Marx et Engels. C'est tout à fait son droit, et même sa responsabilité s'il l'estime nécessaire. En effet, quelles que soient la valeur et la profondeur de la contribution, considérable, qu'il a apportée à la théorie du prolétariat, Marx n'était pas infaillible et ses écrits ne sont pas à considérer comme des textes sacrés. Ce serait là une démarche religieuse totalement étrangère au marxisme, comme à toute méthode scientifique d'ailleurs. Les écrits de Marx doivent eux aussi être soumis à la critique de la méthode marxiste. C'est la démarche qu'a adoptée Rosa Luxemburg dans L'Accumulation du capital (1913) lorsqu'elle relève les contradictions contenues dans le livre II du Capital. Cela dit, lorsqu'on remet en cause une partie des écrits de Marx, l'honnêteté politique et scientifique commande d'assumer explicitement et en toute clarté une telle démarche. C'est bien ce qu'a fait Rosa Luxemburg dans son livre, ce qui lui a valu une levée de boucliers de la part des "marxistes orthodoxes", scandalisés qu'on puisse critiquer ouvertement un écrit de Marx. Ce n'est pas, malheureusement, ce que fait MR lorsque il s'écarte de l'analyse de Marx tout en prétendant y rester fidèle. Pour notre part, si sur cette question nous reprenons les analyses de Marx, c'est parce que nous considérons qu'elles sont justes et qu'elles rendent compte de la réalité de la vie du capitalisme.
En particulier, nous nous revendiquons pleinement de la vision révolutionnaire qu’elles contiennent, fermant résolument la porte à toute vision réformiste. Malheureusement, ce n’est pas le cas de MR dont la fidélité affichée aux textes de Marx, de même que ses petits tours de passe-passe, constituent justement le moyen de faire passer "en douceur" une telle vision réformiste. Et c’est là, incontestablement, l’aspect le plus déplorable de son livre.
Comment caractériser les courants qui prônent la résolution de la crise du capitalisme au moyen de l'augmentation des salaires?
Marx défendait la nécessité de la lutte pour des réformes, mais il dénonçait de toute son énergie les tendances réformistes qui tentaient d'y enfermer la classe ouvrière, qui "ne voyaient dans la lutte pour les salaires que des luttes pour les salaires" et non une école de combat où la classe forge les armes de son émancipation définitive. En fait Marx critiquait Proudhon qui ne voyait "dans la misère que la misère" et les trade-unions qui "manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent à une guerre d'escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force organisée comme d'un levier pour l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition définitive du salariat".[24] Lorsque l'entrée du capitalisme en décadence a mis la révolution prolétarienne à l'ordre du jour et rendu impossible toute réelle politique réformiste au sein du système, une mystification majeure pour essayer de détourner le prolétariat de sa tâche historique a consisté à lui faire croire qu'il pouvait encore s'aménager une place au sein du système, en particulier en portant au pouvoir les bonnes équipes, les bonnes personnes, appartenant en général à la gauche ou à l'extrême-gauche de l'appareil politique du capital. En ce sens, depuis que la révolution prolétarienne est historiquement à l'ordre du jour, la défense de la lutte pour des réformes n'est plus seulement un travers opportuniste au sein du mouvement ouvrier, elle est ouvertement contre-révolutionnaire. C'est pourquoi une responsabilité des révolutionnaires est de combattre toutes les illusions véhiculées par la gauche du capital visant à faire croire à la possibilité de réformer le capitalisme, tout en encourageant les luttes de résistance de la classe ouvrière contre la dégradation de ses conditions de vie sous le capitalisme; celles-ci sont la condition pour n'être pas broyé par les empiètements incessants du capitalisme en crise et constituent une préparation indispensable pour la confrontation à l'État capitaliste.
A ce sujet, il convenait, comme nous l'avons fait précédemment, de signaler les ouvertures béantes qu'offre au réformisme la théorie de MR. Son livre fait mention de son engagement politique. Qu'il nous soit permis d'en douter quelque peu au vu de ses accointances avec des représentants du "marxisme", eux aussi engagés politiquement, mais très clairement dans la défense de thèses réformistes. C'est pourquoi nous avons pensé nécessaire de relever l'hommage appuyé qu'il rend à la contribution de "certains économistes marxistes": "il existe trop peu de considérations sur l'évolution du taux de plus-value, les problèmes de répartition, l'état de la lutte de classe et l'évolution de la part salariale. Ce n'est qu'avec les travaux de certains économistes marxistes (Jacques Gouverneur, Michel Husson, Alain Bihr, etc.) que ces préoccupations reviennent quelque peu sur le devant de la scène. Nous les partageons et espérons qu'elles seront suivies par d'autres". (Dyn p.86)[25] Le premier, Jacques Gouverneur, qui "a fourni" à MR "de nombreuses clés pour approfondir le Capital" (Dyn p.8) est l'auteur d'un "document de travail"[26] au titre évocateur, "Quelles politiques économiques contre la crise et le chômage ?", où il plaide, contre les politiques néolibérales, pour le retour à des politiques keynésiennes assorties de "politiques alternatives" ("augmentation des prélèvements publics - essentiellement sur les profits - pour financer des productions socialement utiles, …"). Quant à Michel Husson, membre du Conseil scientifique d’Attac, qui "a beaucoup appris" à MR "par la rigueur et l'énorme richesse de ses analyses" (Dyn p. 8), écoutons ses réflexions pour lutter contre le chômage et la précarité: "C’est donc sur le terrain de l’emploi qu’il faut interroger les projets de gauche. Sur ce sujet, le programme du Parti socialiste est très faible, même s’il comporte des propositions intéressantes (comme tous les programmes) (…) plutôt que de vouloir augmenter la richesse, il faut en changer la répartition. Autrement dit, ne pas compter sur la croissance, et surtout en changer le contenu, ce qui est rigoureusement impossible avec la répartition des revenus actuelle. Cela veut dire, en premier lieu, dégonfler les rentes financières et refiscaliser sérieusement les revenus du capital." (Chronique du 6 mai 2001. www.regards.fr/nos-regards/michel-husson/la-gauche-et-l-emploi [308]). Et, enfin, Alain Bihr, moins connu que ses prédécesseurs réformistes, s'il est moins marqué à droite que Husson, il n'est pas le dernier à apporter son soutien à la campagne visant à faire endosser par le libéralisme les ravages du capitalisme: "L’adoption de politiques néolibérales, leur mise en œuvre résolue et leur poursuite méthodique depuis près de trente ans auront donc produit ce premier effet de créer les conditions d’une crise de surproduction en comprimant par trop les salaires: en somme, une crise de surproduction par sous-consommation relative des salariés." Tous ces gens ont appris à MR, s'il ne le savait déjà, qu'à la racine des crises du capitalisme on trouve, non pas les contradictions insurmontables de celui-ci, mais les politique néolibérales, une mauvaise répartition des richesses et qu'en conséquence il faut faire appel à l'État pour mettre en place des politique keynésiennes, taxer les revenus du capital, augmenter les salaires, en un mot tenter de réguler l'économie.
MR semble également sympathiser avec l'idée, chère à Alain Bihr, selon laquelle le prolétariat serait en crise du fait de la crise du capitalisme et que la désyndicalisation serait une manifestation de cette prétendue crise de la classe ouvrière[27] lorsqu'il écrit: "la peur de perdre son travail détruit les solidarités ouvrières et le taux de syndicalisation s'inverse pour amorcer un déclin rapide à partir de 1978-79. Significatif de ce phénomène est l'isolement dans lequel restera la longue lutte menée par les mineurs anglais en 1984-85". (Dyn p. 84) Ce n'est pas là une mince contribution au discours de la bourgeoisie, lorsqu'on sait que le principal facteur de l'isolement et de la défaite des mineurs anglais a été le syndicat, et les illusions persistantes dans la classe ouvrière vis-à-vis de ses versions radicales, "à la base".
Le capitalisme est-il condamné à un effondrement catastrophique?
Arrivé à une certaine étape de son histoire, le capitalisme ne peut que plonger la société dans des convulsions croissantes, détruisant les progrès qu'il avait apportés à celle-ci auparavant. C'est dans ce contexte que se déploie la lutte de classe du prolétariat dans la perspective du renversement du capitalisme et de l'avènement d'une nouvelle société. Si le prolétariat ne parvient pas à hisser ses luttes aux niveaux élevés de conscience et d'organisation nécessaires, les contradictions du capitalisme ne permettront pas l'avènement d'une nouvelle société mais mèneront à "la ruine commune des classes en lutte", comme ce fut le cas de certaines sociétés de classes passées: "… oppresseurs et opprimés se sont trouvés en constante opposition; ils ont mené une lutte sans répit, tantôt cachée, tantôt ouverte, une guerre qui chaque fois finissait soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la ruine commune des classes en lutte."[28]
Ce cadre étant posé, il nous importe de comprendre si, au-delà même de la barbarie croissante inhérente à la décadence du capitalisme, les déterminations économiques de la crise ont nécessairement pour conséquence, à un moment donné, une impossibilité pour le système de continuer à fonctionner en conformité avec ses propres lois, l'accumulation devenant ainsi impossible[29]. C'est effectivement le point de vue d'un certain nombre de marxistes et nous le partageons[30]. Ainsi, pour Rosa Luxemburg, "L'impossibilité du capitalisme apparaît alors clairement" dès lors que "le développement du capitalisme est si avancé que sur toute la surface du globe tout est produit de façon capitaliste" (cf. citations précédentes de l'Introduction à l'économie politique)[31]. Toutefois Rosa Luxemburg apporte la précision suivante: "Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes"[32]
De même, Paul Mattick[33], qui considère aussi que les contradictions du système doivent aboutir à un effondrement économique tout en pensant que ces contradictions s'expriment fondamentalement sous la forme de la baisse du taux de profit et non pas de la saturation des marchés, rappelle comment historiquement cette question a été posée: "De la polémique engagée à propos de la théorie marxienne de l'accumulation et des crises se dégagèrent deux points de vue antithétiques qui firent eux-mêmes l'objet de plusieurs variantes. Selon l'une, des barrières absolues s'opposent à l'accumulation, avec pour conséquence à plus ou moins long terme un effondrement économique du système; selon l'autre, c'était là un raisonnement absurde, la disparition du système ne pouvant avoir de causes économiques. Comme on se doute bien, le réformisme, ne serait-ce que pour se justifier, avait fait sienne cette dernière conception. Mais d'un point de vue d'extrême-gauche également, celui de Pannekoek notamment, l'idée d'un effondrement aux causes purement économiques était étrangère au matérialisme historique. (…). Les déficiences du système capitaliste telles que Marx les a décrites et les phénomènes de crise concrets qui résultent de l'anarchie de l'économie lui apparaissaient de nature à faire mûrir la conscience révolutionnaire du prolétariat et, au-delà, la révolution prolétarienne."[34]
MR ne partage pas cette vision d'un capitalisme condamné par ses contradictions fondamentales (saturation des marchés, baisse du taux de profit) à une crise catastrophique. À celle-ci, il oppose le point de vue suivant: "En effet, il n'existe pas de point matériel alpha où le capitalisme s'effondrerait, que ce soit un pourcentage X de taux de profit, ou une quantité Y de débouchés, ou un nombre Z de marchés extra-capitalistes. Comme le disait Lénine dans L'impérialisme stade suprême: "il n'y a pas de situation d'où le capitalisme ne peut sortir"[35]!" (Dyn p.117 et 118)
MR précise sa vision: "Les limites des modes de production sont avant tout sociales, produites par leurs contradictions internes, et par la collision entre ces rapports devenus obsolètes et les forces productives. Dès lors, c'est le prolétariat qui abolira le capitalisme, et pas ce dernier qui mourra de lui-même suite à ses limites 'objectives'. Telle est la méthode posée par Marx: "La production capitaliste tend constamment à surmonter ces limites [NDLR: la dépréciation périodique du capital constant s'accompagnant de crises du processus de production] inhérentes; elle n'y réussit que par des moyens qui dressent à nouveau ces barrières devant elle, mais sur une échelle encore plus formidable, de nouveau, et à une échelle plus imposante, dressent devant elle les mêmes barrières." (Le Capital, p.1032. Éd. La Pléiade Économie II). Nulle vision catastrophiste ici, mais développement croissant des contradictions du capitalisme posant les enjeux à une échelle chaque fois supérieure. Cependant, il est clair que si le capitalisme ne s'effondrera pas de lui-même, il n'échappera pas davantage à ses antagonismes destructeurs." (Dyn p.53)
On voit mal comment le prolétariat pourrait renverser le capitalisme si, comme MR n'a de cesse de vouloir le prouver dans son livre, toute l'histoire de ce système depuis la seconde moitié du 20e siècle dément la réalité de l'existence d'entraves au développement des forces productives.
Ceci étant dit, s'il est tout à fait juste de dire que seul le prolétariat pourra abolir le capitalisme, cela n'implique en rien que le capitalisme ne pourra pas s'effondrer sous l'effet de ses contradictions fondamentales, ce qui évidemment n'est en rien équivalent à son dépassement révolutionnaire par le prolétariat. Nulle part dans son texte, MR ne démontre formellement une telle impossibilité. Au lieu de cela, il plaque sur la crise de la période de décadence des caractéristiques des crises telles que celles-ci se manifestaient à l'époque de Marx. De plus, pour décrire ces dernières, il ne s'appuie pas sur des citations de Marx relatives à la saturation des marchés, comme celle-ci: "dans le cycle de sa reproduction — un cycle dans lequel il n'y a pas seulement reproduction simple, mais élargie —, le capital décrit non pas un cercle, mais une spirale: il arrive un moment où le marché semble trop étroit pour la production. C'est ce qui arrive à la fin du cycle. Mais cela signifie simplement que le marché est sursaturé. La surproduction est manifeste. Si le marché s'était élargi de pair avec l'accroissement de la production, il n'y aurait ni encombrement du marché ni surproduction."[36]. MR préfère des passages où Marx traite uniquement du problème de la baisse du taux de profit. Cela lui permet de proclamer, en se couvrant de l'autorité de Marx, que le capitalisme récupérera toujours de ses crises. En effet, dans ce cadre, la dévalorisation du capital opérée par la crise est souvent la condition de la récupération d'un taux de profit permettant à nouveau la reprise de l'accumulation sur une échelle supérieure. Le seul problème c'est que faire découler la crise actuelle d'abord et avant tout de la contradiction "baisse du taux de profit", c'est passer à côté de la réalité qui a produit un endettement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il existe un autre problème à cette démarche et qui renvoie MR aux contradictions de ses constructions spéculatives, c'est que par ailleurs il affirme: "Il est totalement incongru d'affirmer – comme c'est trop souvent le cas – que la perpétuation de la crise depuis les années 1980 serait due à la baisse tendancielle du taux de profit". (Dyn p.82)
En fait, l'évolution même du capitalisme, déjà avant la Première Guerre mondiale, ne permettait plus de caractériser l'occurrence des crises comme un phénomène cyclique. C'est cette évolution que signale Engels dans une note au sein du Capital, où il dit: "la forme aigüe du processus périodique avec son cycle décennal semble avoir fait place à une alternance plus chronique, plus étendue (…) chaque facteur qui s'oppose à une répétition des anciennes crises recèle le germe d'une crise future bien plus puissante"[37]. Cette description par Engels du surgissement de la crise ouverte est une préfiguration de la crise de la décadence du capitalisme, dont la manifestation violente, généralisée et profonde n'a aucun caractère cyclique mais est préparée par toute une accumulation de contradictions, comme en ont témoigné les deux guerres mondiales, la crise de 1929 et des années 1930, la phase actuelle de la crise qui a été ouverte à la fin des années 1960.
Dire comme le fait MR, en s'appuyant sur des citations de Marx toujours relatives à la baisse du taux de profit, sorties de leur contexte, "Le mécanisme même de la production capitaliste élimine donc les obstacles qu'il se crée"[38], ne peut contribuer qu'à minimiser la profondeur des contradictions qui minent le capitalisme dans sa phase de décadence. Cela ne peut que conduire à sous-estimer la gravité de la phase actuelle de la crise, en particulier en reléguant au second plan les contradictions en question et en invoquant des sornettes selon lesquelles le capitalisme peut être régulé.
On pourrait nous objecter que les prévisions de Rosa Luxemburg se sont révélées inexactes puisque l'assèchement des derniers marchés extra-capitalistes conséquents dans les années 1950 n'a pas donné lieu à une "impossibilité" du capitalisme. C'est en effet à présent une évidence qu'à cette date le capitalisme ne s'est pas écroulé. Cependant, il n'a pu poursuivre son développement qu'en hypothéquant son avenir à travers l'injection de doses de plus en plus importantes de crédit irremboursable. Le problème insurmontable auquel est confrontée actuellement la bourgeoisie, c'est que, quelles que soient les cures d'austérité qu'elle fera subir à la société, en aucun cas celles-ci ne pourront améliorer la situation de l'endettement. Par ailleurs, les défauts de paiement et les faillites de certains acteurs économiques, y compris des États, ne pourront que favoriser une situation similaire chez leurs partenaires, accentuant les conditions de l'effondrement du château de cartes. Par ailleurs, ne pouvant relancer suffisamment l'économie au moyen de nouvelles dettes ou de la planche à billets, le capitalisme ne peut s'éviter une plongée dans la récession. Et, contrairement aux formules enchanteresses déroulées dans ce livre, cette plongée ne prépare pas, grâce à la dévalorisation du capital dont elle va s'accompagner, une future reprise. En revanche, elle prépare le terrain de la révolution.
Silvio (décembre 2011)
[1] Éditions Contradictions. Bruxelles, 2010.
[2] Marx. Matériaux pour l'"Économie" – "Les crises", p.484. Éd. La Pléiade Économie II.
[3] Marx. Principes d'une critique de l'économie politique, p.268. Éd. La Pléiade Économie II.
[4] Idem p.268.
[5] Marx, Le Capital. Livre III, section V, Chap.XVII, p.1206. Éd. La Pléiade Économie II.
[6] "Cette analyse des bases de la régulation keynésiano-fordiste n'a que très rarement été comprise dans le camp du marxisme. À notre connaissance, ce n'est qu'en 1959 qu'est énoncée, pour la première fois, une compréhension cohérente des Trente Glorieuses" (Dyn p. 74). MR reproduit à la suite un extrait d'article publié dès octobre 1959 dans le Bulletin intérieur du groupe Socialisme ou Barbarie. Effectivement le groupe Socialisme ou Barbarie a tellement compris les Trente Glorieuses qu'il achoppera sur le boom des années 1950 et, abusé par celui-ci, il remettra en cause les fondements de la théorie marxiste. Lire à ce propos, pour d'avantage d'explications, l'article "Le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme", dans la Revue internationale n° 147, https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [286]. Paul Mattick est cité par MR pour la compréhension qu'il a également su développer du phénomène des Trente Glorieuses. Nous doutons réellement que l'auteur partage ce passage suivant de Mattick: "Les économistes ne font pas la distinction entre économie tout court et économie capitaliste, ils n'arrivent pas à voir que la productivité et ce qui est "productif pour le capital" sont deux choses différentes, que les dépenses, et publiques et privées, ne sont productives que dans la mesure où elles sont génératrices de plus-value, et non simplement de biens matériels et autres agréments de la vie". (Crise et théorie des crises, Paul Mattick. Éditions Champ libre. Souligné par nous.) En d'autres termes, les mesures keynésiennes, non productrices de plus-value, aboutissent à une stérilisation de capital.
[7] Le Capital. Livre III, section III.
[8] Marx, Le Capital livre IV, tome 3, 19e chapitre : "Malthus ; Critique par les Ricardiens de la conception de Malthus des "consommateurs improductifs"". p.60. Éd sociales.
[9] Marx; idem, pp.61 et 62.
[10] Marx, Le Capital livre IV, tome 2. p.560. Éd sociales.
[11] Marx, Le Capital. Livre III, section III: "La loi tendancielle de la baisse du taux de profit", Chapitre X: "Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation [309]".
[12] Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". P. 165. Éd. La Pléiade Économie I.
[13] Marx, Le Capital. Livre II, section I: "Le mouvement circulaire du capital", Chapitre II: "Les trois formes du processus de circulation", partie II: "Les trois circuits en tant que formes particulières et exclusives". p. 553. Éd. La Pléiade Économie II.
[14] Conformément à ce qu'ils firent dans la préface à l'édition de 1872 pour indiquer des insuffisances révélées par l'expérience de la Commune de Paris, et à ce que fit Engels dans l'édition de 1890 pour indiquer des évolutions intervenues au sein de la classe ouvrière depuis la première édition du Manifeste.
[15] Sur ces questions, nous recommandons la lecture des articles "Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme", "Le Comintern et le virus du 'Luxemburgisme' en 1924" dans les Revue internationale n° 142 et 145.
[16] Nous reproduisons in extenso le contexte de la citation de Marx, où, en fait, celui-ci traite du rapport entre le capitalisme et la libre concurrence: "Le règne du capital est la condition de la libre concurrence, tout comme le despotisme des empereurs romains était la condition du libre droit de Rome. Tant que le capital est faible, il cherche à s'appuyer sur les béquilles d'un mode de production disparu ou en voie de disparition; sitôt qu'il se sent fort, il se débarrasse de ses béquilles et se meut conformément à ses propres lois. De même, sitôt qu'il commence à se sentir et à être ressenti comme une entrave au développement, il cherche refuge dans des formes qui, tout en semblant parachever le règne du capital, annoncent en même temps, par les freins qu'elles imposent à la libre concurrence, la dissolution du capital et du mode de production dont il est la base."
[17] Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". P. 163. Éd. La Pléiade Économie I.
[18] Cité dans Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis, p. 344. Éditions Agone 2002.
[19] Fritz Sternberg, Le conflit du siècle. p. 75. Éditions du Seuil.
[20] Marx. Matériaux pour l'"Économie, p.489. La Pléiade, Économie II.
[21] L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. "Le partage du monde entre les grandes puissances [139]".
[22] Rosa Luxembourg, Introduction à l’économie politique, "Les tendances de l'économie mondiale". https://www.marxists.org/francais/luxembur/intro_ecopo/intro_ecopo_6.htm [310]
[23] Suite de la citation extraite de l'Introduction à l’économie politique.
[24] Marx. Salaire, prix et profit; "La lutte entre le Capital et le Travail et ses résultats". Éditions sociales.
[25] Michel Husson est, d'après Wikipédia, un ancien militant du Parti socialiste unifié (PSU, social-démocrate), de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, trotskiste) dont il a fait partie du comité central. Il est membre du Conseil scientifique d’Attac et a soutenu la candidature de José Bové (altermondialiste) à l'élection présidentielle française de 2007. Alain Bihr, toujours selon la même source, se réclame du communisme libertaire et est connu comme un spécialiste de l'extrême droite française (en particulier du Front national) et du négationnisme.
[26] www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [80]Žéconomiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf
[27] Idée que nous avions déjà critiquée dans un article de notre Revue internationale n° 74, "Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire" (https://fr.internationalism.org/rinte74/proletariat [311])
[28]Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". Éd. La Pléiade Économie I.
[29]Lire à ce propos l'article "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme", Revue internationale n° 144. https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [233]
[30] MR avance l'idée selon laquelle l'impossibilité économique objective du capitalisme contenue dans la vision luxemburgiste aurait été responsable de l'immédiatisme qui s'était manifesté au 3e Congrès de l'Internationale communiste où "le KAPD (scission oppositionnelle du parti communiste allemand) défend une théorie de l'offensive à tout prix en s'appuyant sur la vision luxemburgiste selon laquelle le prolétariat serait face à "l'impossibilité économique objective du capitalisme" et confronté à "l'effondrement économique inévitable du capitalisme... " (Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital)". (Dyn p. 54) Lorsque Rosa Luxemburg défend effectivement la perspective d'une impossibilité du capitalisme, une telle perspective ne s'applique clairement pas au futur proche. Mais il se trouve que justement l'auteur, ou ses proches, défendent frauduleusement une vision attribuant à Rosa Luxemburg une telle perspective pour l'immédiat, étant donné l'insuffisance des marchés extra-capitalistes relativement aux besoins de la production. C'est ce que nous explicitons dans la note suivante. Pour un aperçu plus juste des causes de l'immédiatisme s'étant manifesté dans le mouvement ouvrier par rapport à la perspective, nous renvoyons le lecteur à l'article "Décadence du capitalisme: l'âge des catastrophes". Revue internationale n° 143. https://fr.internationalism.org/rint143/decadence_du_capitalisme_l_age_des_catastrophes.html [220].
[31]"Pour une bonne explication et critique de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg" (Dyn p. 36), MR nous aiguille vers l'article suivant: "Théorie des crises: Marx – Luxemburg (I)" (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article110 [312]). Sur le site recommandé, nous avons lu l'article "L’accumulation du capital au XXe siècle – I" (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article223 [313]) et avons eu la surprise d'y apprendre que, selon Rosa Luxemburg, citée à partir de son ouvrage L'Accumulation du capital, "le capitalisme avait atteint "la phase ultime de sa carrière historique: l’impérialisme" car "le champ d’expansion offert à celui-ci apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes…" ". N'en croyant pas nos yeux, nous sommes retournés à l'ouvrage cité et c'est une autre réalité qui s'est offerte à nous. Ce qui pour Rosa Luxemburg est minime (comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes), ce n'est pas, comme le dit l'article, le champ d’expansion offert au capitalisme, mais les derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. La différence est de taille puisqu'à l'époque les colonies contiennent une proportion importante de marchés extra-capitalistes vierges ou non épuisés, alors que de tels marchés n'existent effectivement que de façon beaucoup plus rare en dehors des colonies et des pays industrialisés. La restitution exacte de ce que dit réellement Rosa Luxemburg met en évidence le petit tour de passe-passe opéré par les amis de MR. Dans cette citation, nous avons souligné ce qui est reproduit dans l'article incriminé, et mis en caractères gras une idée importante écartée par l'auteur de l'article: "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes", L'Accumulation du capital, III: "Les conditions historiques de l'accumulation", 31: "Le protectionnisme et l'accumulation", https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/index.htm [107]
[32] L'Accumulation du capital, III: "Les conditions historiques de l'accumulation", 31: "Le protectionnisme et l'accumulation", https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/index.htm [107]
[33] Pour davantage d'informations sur le positionnement politique de Paul Mattick lire l'article "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme" dans la Revue internationale n° 146. https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [233]
[34] Paul Mattick. Crises et théories des crises. pp.136 et 137. Éditions Champ libre.
[35] NDLR: Ce passage est absent de la version de L'impérialisme stade suprême en ligne sur marxists.org (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm [314]). Par contre, il en existe un autre qui lui ressemble comme un frère correspondant également à des paroles de Lénine dans le Rapport sur la situation internationale et les tâches fondamentales de l'I.C: "Il n'existe pas de situation absolument sans issue" (). Cependant il n'est pas relatif à la crise économique mais à la crise révolutionnaire.
[36] Matériaux pour l'"Économie", "Les crises". p.489. La Pléiade - Économie II.
[37] Note d'Engels au Capital, livre III, section V: "Le capital productif d'intérêt", Chapitre XVII: "Accumulation du capital monétaire et crises", partie III "Capital monétaire et capital réel". p.1210. Éd. La Pléiade Économie II.
[38]La référence donnée par MR est la suivante, Le Capital, Livre I, 4e édition allemande; Éditions sociales 1983, p.694. Elle ne comporte pas d'avantage de précisions quant à la section du Livre considéré. Il n'existe pas l'équivalent évident de cette phrase en français sur marxists.org.
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Décadence du capitalisme (XIII) : Rejet et régressions
- 2801 lectures
Dans le précédent article de cette série[1], nous avons mis en évidence que la "théorie de la décadence", qu’une minorité intransigeante avait persisté à défendre malgré le triomphe apparent du capitalisme durant le boom d’après-guerre, avait gagné de nouveaux adhérents, car elle fournissait un cadre historique cohérent aux positions révolutionnaires que cette nouvelle génération avait acquises d’une façon plus ou moins intuitive: l’opposition aux syndicats et au réformisme, le rejet des luttes de libération nationale et des alliances avec la bourgeoisie, la compréhension que les pays prétendument "socialistes" étaient une forme de capitalisme d'État et ainsi de suite.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la crise ouverte du capitalisme ne faisait que commencer; au cours des quatre décennies suivantes, il est apparu de plus en plus clairement qu’elle était insurmontable. De ce fait, on aurait pu s’attendre à ce que la majorité des éléments attirés par l'internationalisme au cours de cette période soient plus facilement convaincus du fait que le capitalisme était vraiment un système social obsolète et décadent. Non seulement cela n’a pas été le cas mais on pourrait même parler d'un rejet persistant de cette théorie de la décadence – et c’est particulièrement vrai pour les nouvelles générations de révolutionnaires qui ont commencé à surgir au cours de la première décennie du 21e siècle – et, simultanément, d’une tendance à la remettre en question, voire à la rejeter ouvertement, de la part de beaucoup d’éléments qui y adhéraient auparavant.
L’attraction de l’anarchisme
En ce qui concerne le rejet de la part des nouvelles générations de révolutionnaires, nous parlons essentiellement des éléments internationalistes influencés par les différentes sortes d’anarchisme. L’anarchisme a connu un renouveau important au cours des années 2000, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il a eu une telle attraction sur de jeunes camarades désireux de combattre le capitalisme mais profondément critiques envers la gauche "officielle", dont une partie a vu comme une catastrophe l’effondrement du "socialisme existant réellement" dans le bloc de l’Est. Ainsi, la nouvelle génération se tourne souvent vers l’anarchisme parce qu’elle le voit comme un courant qui n’a pas trahi la cause du socialisme comme l’ont fait les courants social-démocrate, stalinien et trotskiste.
L’analyse des raisons pour lesquelles, dans les pays capitalistes centraux en particulier, tant d'éléments de la nouvelle génération ont été attirés par les différents courants de l’anarchisme et non par la Gauche communiste, qui constitue certainement le plus cohérent des courants politiques restés loyaux aux principes prolétariens après la terrible défaite de la période qui va de la fin des années 1920 à la fin des années 1960, prendrait un article à lui tout seul. Le problème de l’organisation des révolutionnaires – la question du "parti" - qui a toujours été une pomme de discorde entre les marxistes et les éléments révolutionnaires de l’anarchisme, constitue certainement un élément central. Mais dans cet article, notre préoccupation principale est la question spécifique de la décadence du capitalisme. Pourquoi la majorité des anarchistes, y compris ceux qui s’opposent authentiquement aux pratiques réformistes et défendent la nécessité d’une révolution internationale, rejettent-ils cette notion de façon si véhémente?
Il est vrai que certains des meilleurs éléments du courant anarchiste n’ont pas toujours eu cette réaction. Dans un article précédent de cette série[2], nous avons montré comment face à la crise économique mondiale et à la poussée vers la seconde guerre impérialiste mondiale, des camarades anarchistes comme Maximoff n’ont eu aucune difficulté à expliquer ces phénomènes comme des expressions d’un rapport social devenu une entrave au progrès de l’humanité, d’un mode de production en déclin.
Mais ce point de vue a toujours été minoritaire au sein du mouvement anarchiste. À un niveau plus profond, bien que beaucoup d’anarchistes reconnaissent que la contribution de Marx à la compréhension de l’économie politique est irremplaçable, leur point de vue sur la méthode historique qui sous-tend la critique du capital par Marx est bien plus sévère. Depuis Bakounine, il y a toujours eu chez les anarchistes une forte tendance à considérer le "matérialisme historique" (ou, si l’on préfère, la démarche matérialiste vis-à-vis de l’histoire) comme une forme de déterminisme rigide qui sous-estime et déprécie l’élément subjectif dans la révolution. Bakounine en particulier considérait que c’était un prétexte pour une pratique fondamentalement réformiste de la part du "parti de Marx", qui défendait à l’époque que le capitalisme n’avait pas encore épuisé son utilité historique pour l’humanité, que la révolution communiste n’était pas encore à l’ordre du jour et que la classe ouvrière devait développer ses forces et prendre confiance en elle-même dans le cadre de la société bourgeoise; ce point de vue était la base de la défense par Marx du travail syndical et de la constitution de partis ouvriers qui devaient, entre autres choses, participer aux élections bourgeoises. Pour Bakounine, le capitalisme avait toujours été mûr pour la révolution. Par extension, si les marxistes de l’époque historique actuelle défendent que les anciennes tactiques ne sont plus valables, cette position est souvent ridiculisée par les anarchistes d’aujourd’hui comme étant une justification rétrospective des erreurs de Marx et une façon d’éviter la conclusion désagréable que les anarchistes ont toujours eu raison.
Nous ne faisons qu’effleurer la question ici; nous y reviendrons plus loin en traitant une version plus élaborée de cette argumentation défendue par le groupe Aufheben dans une série d’articles critiquant la notion de décadence et que beaucoup dans le milieu communiste libertaire considèrent comme étant le dernier mot sur la question. Mais il y a d’autres éléments à examiner dans le fait que la génération actuelle rejette ce qui est pour nous la pierre de touche théorique d’une plateforme révolutionnaire aujourd’hui et qui sont moins liés à la tradition anarchiste.
Le paradoxe auquel nous sommes confrontés est le suivant: tandis que, pour nous, le capitalisme semble se décomposer de plus en plus, au point que nous pouvons parler de phase finale de son déclin, pour beaucoup d’autres, la capacité du capitalisme à prolonger ce processus de déclin constitue la preuve que le concept même de déclin est réfuté. En d’autres termes, plus un capitalisme, sénile depuis longtemps, approche de sa fin catastrophique, plus certains révolutionnaires le considèrent capable de se renouveler quasiment sans fin.
Il est tentant de faire un peu de psychologie ici. Nous avons déjà noté[3] que la perspective de sa propre fin constitue un élément du rejet par la bourgeoisie non seulement du marxisme mais même de ses propres tentatives pour appréhender de façon scientifique le problème de la valeur, une fois qu’il est apparu clairement que le comprendre impliquait aussi la compréhension du caractère transitoire du système capitaliste et de sa condamnation à périr de ses propres contradictions internes. Il serait étonnant que cette idéologie du déni n’affecte pas aussi ceux qui cherchent à rompre avec la vision bourgeoise du monde. En fait, puisque cette fuite de la réalité par la bourgeoisie grandit désespérément au fur et à mesure qu’elle s’approche de sa véritable fin, on peut s’attendre à voir ce mécanisme de défense pénétrer toutes les couches de la société, y compris la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. Après tout, qu’est ce qui est plus terrifiant, plus susceptible de susciter une réaction de fuite ou de se cacher la tête dans le sable que la possibilité réelle d’un capitalisme agonisant nous écrasant tous dans les affres de ses derniers moments?
Mais le problème est plus complexe. D’abord il est connecté à la façon dont la crise a évolué au cours des quarante dernières années, qui a rendu le diagnostic de la véritable gravité de la maladie mortelle du capitalisme plus difficile.
Comme nous l’avons noté, les premières décennies qui ont suivi 1914 étaient une preuve très claire du fait que le capitalisme était en déclin. Ce n’est que lorsque le boom d’après-guerre s’est vraiment déployé dans les années 1950 et 1960 qu’un certain nombre d’éléments du mouvement politique prolétarien ont commencé à exprimer de profonds doutes envers l’idée que le capitalisme était dans sa phase de décadence. Le retour de la crise – et de la lutte de classe – à la fin des années 1960 a permis de voir la nature passagère de ce boom et de redécouvrir les fondements de la critique marxiste de l’économie politique. Mais tandis que la nature "permanente" de la crise depuis la fin des années 1960 et, par-dessus tout, l’explosion plus récente de toutes les contradictions qui s’étaient accumulées au cours de cette période (la "crise de la dette") ont confirmé cette analyse au niveau fondamental, la longueur de la crise a aussi témoigné de l’extraordinaire capacité du capitalisme à s’adapter et à survivre, même si c’était en trichant avec ses propres lois et en accumulant des problèmes encore plus dévastateurs pour lui-même à long terme. Le CCI a certainement, en certaines occasions, sous-estimé ces capacités: certains des articles publiés dans les années 1980 – décennie au cours de laquelle le chômage massif a de nouveau fait partie de la vie quotidienne – ne prévoyaient pas le "boom" (ou plutôt les booms, puisqu’il y a eu aussi de nombreuses récessions) des années 1990 et 2000, et il est certain que nous n’avions pas prévu la possibilité qu’un pays comme la Chine s'industrialise au rythme frénétique qu’on a connu au cours des années 2000 grosso modo. Pour une génération élevée dans de telles conditions où le consumérisme rampant et éhonté des pays développés fait paraître la société de consommation des années 1950 et 1960 surannée en comparaison, il est compréhensible que parler de déclin du capitalisme puisse paraître quelque peu dépassé. L’idéologie officielle des années 1990 et des premières années 2000 était que le capitalisme avait triomphé sur toute la ligne et que le néo-libéralisme et la mondialisation ouvraient la porte à une nouvelle ère de prospérité sans précédent. En Grande-Bretagne, par exemple, le porte-parole économique du gouvernement de Tony Blair, Gordon Brown, proclamait, dans son discours sur le budget en 2005, que le Royaume-Uni connaissait la période de croissance économique la plus longue depuis les premiers relevés qui commencèrent en 1701. Il n’est pas surprenant que des versions "radicales" de ces idées soient reprises, même parmi des défenseurs de la révolution. Après tout, la classe dominante elle-même continue de se quereller sur la question de savoir si elle s’est débarrassée en fin de compte du cycle "expansion-récession". Beaucoup de "pro-révolutionnaires", qui sont capables de citer Marx sur les crises périodiques du 19e siècle et d’expliquer que même s’il peut encore y avoir des crises périodiques, celles-ci servent à nettoyer l’économie de ses branches mortes et à apporter un regain de croissance, se sont fait écho de cette problématique.
Régressions à partir de la cohérence de la gauche italienne
Tout cela est très compréhensible, mais on peut peut-être moins le pardonner quand cela vient des rangs de la Gauche communiste, qui avait déjà une certaine connaissance du caractère maladif de la croissance capitaliste à l’époque de son déclin. Et pourtant, depuis les années 1970, nous avons connu une série de défections vis-à-vis de la théorie de la décadence dans les rangs de la Gauche communiste, et dans le CCI en particulier, s’accompagnant souvent de sévères crises organisationnelles.
Ce n’est pas le lieu d’analyser l’origine de ces crises. Nous pouvons dire que les crises dans les organisations politiques du prolétariat constituent un moment inévitable de leur vie, comme un coup d’œil rapide à l’histoire du Parti bolchevique ou des gauches allemande et italienne le confirme. Les organisations révolutionnaires sont une partie de la classe ouvrière, qui est une classe constamment soumise à l’immense pression de l’idéologie dominante. L’avant-garde ne peut échapper à cette pression et est contrainte de mener un combat permanent contre elle. Les crises organisationnelles éclatent en général à un moment où une partie voire l'ensemble de l’organisation est confrontée – ou succombe – à une dose particulièrement forte d’idéologie dominante. Très souvent, ces convulsions sont initiées ou exacerbées par la nécessité de faire face à de nouvelles situations ou à des crises plus larges dans la société.
Les crises du CCI ont presque toujours été centrées sur des questions d’organisation et de comportement politique. Mais il est également notable que pratiquement toutes les scissions importantes dans nos rangs ont mis en question également notre vision de l’époque historique.
Le GCI : le progrès est-il un mythe bourgeois?
En 1987, dans la Revue internationale n° 48, nous avons commencé la publication d’une nouvelle série intitulée "Comprendre la décadence du capitalisme". C’était une réponse au fait que, de plus en plus, des éléments à l’intérieur ou autour du mouvement révolutionnaire étaient en train de changer d’avis sur la notion de décadence. Le premier des trois articles de la série[4] était une réponse aux positions du Groupe communiste internationaliste (GCI) qui était à l’origine une scission du CCI à la fin des années 1970. Certains des éléments qui avaient initialement formé le GCI se voyaient comme des continuateurs du travail de la Fraction italienne de la Gauche communiste, s’opposant à ce qu’ils considéraient comme des déviations conseillistes du CCI. Mais à la suite de nouvelles scissions au sein du GCI lui-même, le groupe évolua vers ce que l’article de la Revue internationale qualifiait de "bordiguisme anarcho-punk": une étrange combinaison de concepts tirés du bordiguisme tels que "l’invariance" du marxisme et une régression vers une vision volontariste à la Bakounine. Ces deux éléments menèrent le GCI à s’opposer de façon véhémente à l’idée que le capitalisme avait connu une phase ascendante et une phase décadente, principalement dans l’article "Théories de la décadence ou décadence de la théorie?" (Le Communiste n° 23, 1985).
L’article de la Revue internationale réfute un certain nombre d’accusations portées par le GCI. Il critique le sectarisme grossier du GCI qui mettait dans le même sac les groupes défendant l’idée que le capitalisme était décadent et les Témoins de Jéhovah, la secte Moon ou les néo-nazis; le GCI montrait son ignorance quand il déclarait que le concept de décadence était né après la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 et que "certains produits de la victoire de la contre-révolution se mirent à théoriser une ‘longue période’ de stagnation et de ‘déclin’"; surtout, l’article montre que ce qui sous-tend "l’anti-décadence" du GCI, c’est un abandon de l’analyse matérialiste de l’histoire en faveur de l’idéalisme anarchiste.
Ce que le GCI rejette vraiment dans le concept de décadence, c’est l’idée que le capitalisme ait été autrefois un système ascendant, qu’il ait joué un rôle progressiste pour l’humanité: en fait le GCI rejette la notion même de progrès historique. Pour lui, c’est de la simple idéologie pour justifier la mission "civilisatrice" du capitalisme: "La bourgeoisie présente tous les modes de production qui l’ont précédée comme ‘barbares’ et ‘sauvages’ et deviendraient, avec l’évolution historique, progressivement ‘civilisés’. Le mode de production capitaliste est évidemment l’incarnation finale et la plus haute de la Civilisation et du Progrès. La vision évolutionniste correspond donc à ‘l’être social capitaliste’ et ce n’est pas pour rien que cette vision a été appliquée à toutes les sciences (c’est-à-dire toutes les interprétations partielles de la réalité du point de vue bourgeois): les sciences de la nature (Darwin), la démographie (Malthus), la logique, l’histoire, la philosophie (Hegel)…" (Ibid.)
Mais ce n’est pas parce que la bourgeoisie a une certaine vision du progrès où tout culmine dans la domination du capital que tout concept de progrès est faux: c’est précisément la raison pour laquelle Marx n’a pas rejeté les découvertes de Darwin mais les a considérées – en les interprétant correctement et en utilisant une vision dialectique plutôt que linéaire – comme un argument supplémentaire en faveur de sa vision de l’histoire.
Cela ne veut pas dire non plus que la vision marxiste du progrès historique signifie l’adhésion et l’alignement sur la classe dominante, comme le GCI le proclame: "Les décadentistes sont donc pour l’esclavage jusqu’à une certaine date, pour le féodalisme jusqu’à une autre… pour le capitalisme jusqu’en 1914! Ainsi, à cause de leur culte du progrès, ils s’opposent à chaque étape à la guerre de classe menée par les exploités, s’opposent aux mouvements communistes qui ont eu le malheur d’éclater dans la ‘mauvaise période’." (Ibid.) Le mouvement marxiste au 19e siècle, tout en reconnaissant généralement que le capitalisme n’avait pas encore créé les conditions de la révolution communiste, a toujours considéré son rôle comme étant de défendre de façon intransigeante les intérêts de classe du prolétariat au sein de la société bourgeoise et il a reconnu "rétrospectivement" l’importance absolument vitale des révoltes des exploités dans les sociétés de classes précédentes, tout en considérant que ces révoltes ne pouvaient aboutir à la société communiste.
On rencontre souvent le radicalisme superficiel du GCI chez ceux qui épousent ouvertement les conceptions anarchistes et il leur a même parfois fourni une justification semi-marxiste plus "élaborée" pour maintenir leurs vieux préjugés. Alors que les anarchistes peuvent reconnaître à Marx certaines contributions théoriques (critique de l’économie politique, concept d’aliénation, etc.), ils ne tolèrent pas sa pratique politique qui était de construire des partis ouvriers participant au parlement, de développer des syndicats et même, dans certains cas, de soutenir des mouvements nationaux. Selon eux, toutes ces pratiques (à l’exception peut-être du développement de syndicats) étaient déjà bourgeoises (ou autoritaires) à l’époque et elles sont toujours bourgeoises (ou autoritaires) aujourd’hui.
Dans la pratique cependant, ce rejet général de toute une partie du passé du mouvement ouvrier n’est pas une garantie de la radicalité des positions aujourd’hui. Comme le conclut le deuxième article de la série: "… pour les marxistes, les formes de lutte du prolétariat dépendent des conditions objectives dans lesquelles celle-ci se déroule et non des principes abstraits de révolte éternelle. C'est seulement en se fondant sur l'analyse objective du rapport de forces entre les classes envisagé dans sa dynamique historique que l'on peut fonder la validité ou non d'une stratégie, d'une forme de combat. En dehors de cette base matérialiste, toute prise de position sur les moyens de la lutte prolétarienne repose sur du sable mouvant; c'est la porte ouverte au déboussolement dès que les formes superficielles de la ‘révolte éternelle’ - la violence, l'anti-légalité - font leur apparition"[5]. L’article en veut pour preuve le flirt du GCI avec le Sentier lumineux au Pérou. C’est une position idéologique que le GCI a reprise dans des déclarations plus récentes sur la violence du Jihad en Irak.[6]
PI : l’accusation de "productivisme"
La série publiée dans les années 1980 contenait également une réponse à un autre groupe né d’une scission du CCI en 1985: la Fraction Externe du CCI (FECCI) qui publiait la revue Perspective Internationaliste (PI). La FECCI, proclamant faussement avoir été exclue du CCI et dédiant une grande partie de ses premières polémiques à apporter la "preuve" de la "dégénérescence du CCI" et même de son "stalinisme", était née en déclarant qu’elle avait l’intention de défendre la plateforme du CCI à l’encontre du CCI lui-même – d’où son nom. Ce nom de ‘FECCI’ fut finalement abandonné et le groupe adopta le titre de sa publication. Contrairement au GCI, cependant, PI n’a jamais dit qu’il rejetait la notion même d’ascendance et de décadence du capitalisme: il a expliqué qu’il voulait approfondir et clarifier ces concepts. C’est certainement un projet louable. Le problème est que ses innovations théoriques ajoutent peu de chose qui soit vraiment profond et servent principalement à diluer l’analyse de base.
D’une part, PI a de plus en plus développé une périodisation "parallèle" du capitalisme, basée sur ce qu’il appelle la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital qui, dans la version de PI, correspond plus ou moins au même cadre historique que celui du changement "traditionnel" du capitalisme passant à sa période de déclin dans la première partie du 20e siècle. Dans la vision de PI, la pénétration globale croissante de la loi de la valeur dans tous les domaines de la vie économique et sociale constitue la domination réelle du capital, et c’est cela qui nous fournit la clé pour comprendre les frontières de classe que le CCI avait basées auparavant sur la notion de décadence: la banqueroute du travail syndical, du parlementarisme et du soutien à la libération nationale, etc.
Il est certain que l’émergence réelle du capitalisme comme une économie mondiale, sa "domination" effective sur le globe correspondent à l’ouverture de la période de décadence; et que, comme le souligne PI, cette période a été marquée par une pénétration croissante de la loi de la valeur dans quasiment tous les recoins de l’activité humaine. Mais comme nous le défendons dans notre article de la Revue internationale n° 60[7], la définition que donne PI de la transition entre la domination formelle et la domination réelle part d’un concept élaboré par Marx et l’élargit au-delà de la signification spécifique que ce dernier lui attribuait. Pour Marx, la transition en question concernait le passage de la période de la manufacture – quand le travail artisanal était regroupé par des capitalistes individuels sans véritablement transformer les anciennes méthodes de production – à celui du système d’usines, basé sur le travailleur collectif. Dans son essence, ce changement avait déjà eu lieu à l’époque de Marx, quand le capitalisme ne "dominait" encore qu’une petite partie de la planète: son expansion ultérieure allait se baser sur la "domination réelle" du processus de production. Notre article montrait que le point de vue des bordiguistes de Communisme ou Civilisation était plus conséquent quand il défendait la possibilité du communisme dès 1848, puisque, pour ce groupe, cette date marquait en fait la transition à la domination réelle.
Mais PI développait un autre argument dans sa mise en question du concept de décadence hérité du CCI: l'accusation de "productivisme". Dans l’une de ses premières salves (PI n° 28, automne 1995), Mac Intosh affirmait que tous les groupes la Gauche communiste, depuis Bilan jusqu’aux groupes existants tels que le CCI ou le BIPR, souffraient de la même maladie: ils étaient "désespérément et inextricablement empêtrés dans le productivisme qui est le cheval de Troie du capital dans le camp du marxisme. Ce productivisme fait du développement de la technologie et des forces productives l’étalon du progrès historique et social; dans cette optique théorique, tant qu’un mode de production assure le développement technologique, on doit le considérer comme historiquement progressiste." La brochure du CCI, La décadence du capitalisme[8], fit particulièrement l’objet de critiques. Rejetant l’idée de Trotsky, exprimée dans le document programmatique de 1938: Programme de Transition - L’agonie du capitalisme et les tâches de la Quatrième Internationale[9], selon laquelle les forces productives de l’humanité avaient cessé de croître, notre brochure définissait la décadence comme une période au cours de laquelle les rapports de production agissaient comme une entrave au développement des forces productives mais non comme une barrière absolue, et menait une sorte d’expérience intellectuelle en cherchant à montrer combien le capitalisme aurait pu se développer s’il n’avait pas été limité par ses contradictions internes.
Mac Intosh se focalisa sur ce passage et le contredit par différents chiffres qui indiquaient, à son avis, des taux de croissance si formidables à l’époque de la décadence que toute notion de décadence vue comme ralentissement du développement des forces productives devait être remplacée par l’idée que c’était précisément la croissance du système qui était profondément inhumaine – comme en témoigne, par exemple, le développement de la crise écologique.
D’autres membres de PI poursuivirent dans le même sens, par exemple dans l’article: "For a Non-productivist Understanding of Capitalist Decadence" par E.R. dans PI n° 44[10]. Mais il y avait déjà eu une réponse assez profonde à Mac Intosh dans le n° 29 de PI[11] par M. Lazare (ML). Si l’on ne tient pas compte de la caricature occasionnelle des prétendues caricatures du CCI, cet article montre bien comment la critique du productivisme par Mac Intosh est elle-même prise dans une logique productiviste[12]. D’abord il met en question l’utilisation par Mac Intosh des chiffres prétendant montrer que le capital avait crû d’un facteur 30 entre 1900 et 1980. ML montre que ce chiffre est bien moins impressionnant si on le rapporte à un taux annuel qui nous donne une croissance moyenne de 4,36% par an. Mais, surtout, il défend l’idée que si nous parlons en termes quantitatifs, malgré les taux de croissance impressionnants que le capitalisme en déclin a pu connaître, quand on regarde le gigantesque gaspillage de forces productives qu’entraînent la bureaucratie, les armements, la publicité, la finance, une multitude de "services" inutiles ainsi que la crise économique quasi-permanente ou récurrente, l’expansion à proprement parler de l’activité productrice réelle aurait pu être alors bien plus grande. En ce sens, l’idée que le capitalisme est une entrave qui freine mais ne bloque pas totalement le développement des forces productives, même en termes capitalistes, reste totalement valable. Comme Marx l’a écrit, le capital est la contradiction vivante et "la véritable barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même" (Livre III du Capital[13]).
Cependant, et de façon tout à fait correcte, ML ne s’arrête pas là. La question de la "qualité" du développement des forces productives dans la période de décadence se pose dès qu’on fait entrer des facteurs comme le gaspillage et la guerre dans l’équation. Contrairement à certaines insinuations de ML, la vision que le CCI a de la décadence n’a jamais été purement quantitative, mais a toujours pris en compte le "coût" humain de la survie prolongée du système. Et il n’y a rien dans notre vision de la décadence excluant l’idée, également mise en avant par ML, que nous avons besoin d’une conception bien plus profonde de ce que signifie exactement le développement des forces productives. Les forces productives ne sont pas intrinsèquement du capital – illusion entretenue à la fois par les primitivistes qui considèrent le progrès technologique comme la source de tous les maux et par les staliniens qui mesurent le progrès vers le "communisme" à l’aune du ciment et de l’acier. À la base des forces productives de l’humanité, il y a sa puissance créatrice, et le mouvement vers le communisme ne peut se mesurer qu’en fonction du degré de libération des capacités de créativité humaine. L’accumulation du capital – "la production pour la production" - a constitué une étape dans ce sens, mais une fois qu’elle eut établi les prérequis pour une société communiste, elle a cessé de jouer un rôle progressiste. En ce sens, loin d’être gouvernée par une vision productiviste, la Gauche communiste italienne fut l’une des premières à critiquer ouvertement cette vision, puisqu’elle rejetait les hymnes de Trotsky sur les miracles de la production "socialiste" dans l’URSS stalinienne et qu’elle insistait sur le fait que les intérêts de la classe ouvrière (même dans un "État prolétarien") étaient nécessairement antagoniques aux besoins de l’accumulation (ML note aussi cela, contrairement aux accusations portées par Mac Intosh à la tradition de la Gauche communiste).
Pour Marx, et pour nous, la "mission progressiste" du capital se mesure au degré de sa contribution à la libération de la puissance créatrice de l’homme, vers une société où la mesure des richesses n’est plus le temps de travail mais le temps libre. Le capitalisme a constitué une étape inévitable vers cet horizon, mais sa décadence se signale précisément par le fait que ce potentiel ne peut être réalisé qu’en abolissant les lois du capital.
Il est crucial d’envisager ce problème dans toute sa dimension historique, qui embrasse aussi bien le futur que le passé. Les tentatives du capital pour maintenir l’accumulation dans le carcan imposé par ses limites globales créent une situation où ce n'est pas seulement le potentiel de l’humanité qui est ainsi emprisonné, c’est aussi la survie de l'humanité elle-même qui est menacée au fur et à mesure que les contradictions des rapports sociaux capitalistes s’expriment de plus en plus violemment, entraînant la société à sa ruine. C’est sûrement ce à quoi Marx fait allusion dans les Grundrisse quand il parle du développement comme déclin[14].
Une illustration actuelle: la Chine, dont les taux de croissance vertigineux obsèdent tant les anciens inconditionnels de la théorie de la décadence. Le capital chinois a-t-il développé les forces productives? Selon ses propres critères, oui, mais quel est le contexte historique global dans lequel cela a lieu? Il est certainement vrai que l’expansion du capital chinois a accru la taille du prolétariat industriel mondial, mais cela s’est produit à travers un vaste processus de désindustrialisation à l’Ouest et la perte de beaucoup de secteurs centraux de la classe ouvrière dans les pays d’origine du capital, allant de pair avec la perte d’une grande partie de ses traditions de lutte. En même temps, le coût écologique du "miracle" chinois est gigantesque. Les besoins de la Chine en matières premières pour sa croissance industrielle amènent au pillage accéléré des ressources mondiales et toute la production qui en découle porte avec elle une grande augmentation de la pollution globale. Au niveau économique, tandis que la Chine dépend entièrement du marché occidental de consommation. Tant du point de vue du marché intérieur que de celui des exportations, les perspectives économiques, à terme, de l'économie chinoise sont à la baisse, Ttout comme le sont celles de l'Europe et des Etats-Unis. La seule différence c'est que ce pays part de plus haut [15]. Mais il pourrait bien perdre son avance, ou du moins une partie de celle-ci si, à son tour, il devait être ébranlé par des faillites en série[16]. Tôt au tard la Chine ne pourra que s'inscrire pleinement dans la dynamique récessioniste de l'économie mondiale.
Marx, à la fin du 19e siècle, voyait des raisons d’espérer que le développement capitaliste ne serait pas nécessaire en Russie, car il pouvait voir que, à l’échelle mondiale, les conditions du communisme étaient déjà en train d’être réunies. Cela n’est-il pas encore plus vrai aujourd’hui?
Des hésitations dans le BIPR?
En 2003-04, nous avons commencé une nouvelle série d’articles sur la décadence, en réponse à un certain nombre de charges contre ce concept mais, en particulier, à cause de signes alarmants de la part du Bureau international pour le Parti révolutionnaire (BIPR) – maintenant Tendance communiste internationaliste (TCI) – qui avait généralement fondé ses positions sur une notion de décadence, et semblait à présent être aussi influencé par les pressions "anti-décadentistes" prédominantes.
Dans une prise de position "Éléments de réflexion sur les crises du CCI" de février 2002 et publiée dans la revue Internationalist Communist n° 21, le concept de décadence est critiqué ainsi: "aussi universel que confus", "étranger à la critique de l’économie politique", " étranger à la méthode et à l’arsenal de la critique de l’économie politique". On nous demande aussi: "Quel rôle joue donc le concept de décadence sur le terrain de la critique de l’économie politique militante, c’est à dire de l’analyse approfondie des phénomènes et des dynamiques du capitalisme dans la période que nous vivons? Aucun. Au point que le mot lui-même n’apparaît jamais dans les trois volumes qui composent le Capital."[17]
Une contribution publiée en italien dans Prometeo n° 8, Série VI (décembre 2003) et en français sur le site, "Pour une définition du concept de décadence"[18] contenait toute une série d’affirmations inquiétantes.
La théorie de la décadence, apparemment, est considérée comme une notion fataliste de la trajectoire du capitalisme et du rôle des révolutionnaires: "L'ambiguïté réside dans le fait que l'idée de décadence ou de déclin progressif du mode de production capitaliste, provient d'une sorte de processus d'autodestruction inéluctable dépendant de son essence propre. (…) [la] disparition et [la] destruction de la forme économique capitaliste [serait] un événement historiquement daté, économiquement inéluctable et socialement prédéterminé. Outre une approche infantile et idéaliste, cela finit par avoir des répercussions négatives sur le plan politique, générant l’hypothèse que pour voir la mort du capitalisme, il suffit de s’asseoir sur la berge, ou, au mieux, d’intervenir dans une situation de crise, et seulement celle-ci, les instruments subjectifs de la lutte de classe sont perçus comme le dernier coup de pouce d’un processus irréversible."
La décadence ne semble plus aboutir à l’alternative "socialisme ou barbarie" puisque le capitalisme est capable de se renouveler sans fin: "L’aspect contradictoire de la forme capitaliste, les crises économiques qui en dérivent, le renouvellement du processus d’accumulation qui est momentanément interrompu par les crises mais qui reçoit de nouvelles forces à travers la destruction de capitaux et des moyens de production excédentaires, ne mettent pas automatiquement en cause sa disparition. Ou bien c’est le facteur subjectif qui intervient, dont la lutte de classe est l’axe matériel et historique, et les crises la prémisse économique déterminante, ou bien, le système économique se reproduit, rééditant à un niveau supérieur toutes ses contradictions, sans pour cela créer les conditions de sa propre destruction."
Comme dans la prise de position de 2002, ce nouvel article défendait l’idée que le concept de décadence n’avait pas grand-chose à voir avec une critique sérieuse de l’économie politique: il n’était considéré comme utile que si l’on pouvait le "prouver" économiquement en examinant les tendances du taux de profit: "La théorie évolutionniste suivant laquelle le capitalisme se caractérise par une phase progressiste et décadente ne vaut rien, si l’on n’en donne pas une explication économique cohérente. (…) La recherche sur la décadence conduit soit à identifier les mécanismes qui président au ralentissement du processus de valorisation du capital avec toutes les conséquences que cela comporte, soit à demeurer dans une fausse perspective, vainement prophétique (…) Mais l’énumération des phénomènes économiques et sociaux une fois identifiés et décrits, ne peut être considérée elle-même comme la démonstration de la phase de décadence du capitalisme; en effet, ces phénomènes n’en sont que les effets et la cause première qui les impose, réside dans la loi de la crise des profits."
Les deux articles de la Revue internationale en réponse[19] montraient que si le Parti communiste internationaliste (PCInt) - Battaglia comunista, la section du BIPR/TCI en Italie - qui a écrit la contribution d’origine, avait toujours été assez inconséquent dans son adhésion à la notion de décadence; celui-ci traduisait ici une réelle régression vers la vision bordiguiste qui avait été l’un des éléments conduisant à la scission de 1952 du PCInt. Bordiga – dont la position était fortement combattue par Damen comme nous l’avons vu dans un article précédent de cette série[20] - affirmait que la "théorie de la courbe descendante" était fataliste tout en niant toute limite objective à la croissance du capital. Quant à l’idée de prouver "économiquement" la décadence, la reconnaissance que 1914 avait ouvert une nouvelle phase qualitative dans la vie du capital avait été défendue par des marxistes comme Lénine, Luxemburg et la Gauche communiste, avant tout sur la base de facteurs sociaux, politiques et militaires – comme tout bon médecin, ils avaient diagnostiqué la maladie à partir de ses symptômes les plus évidents, avant tout la guerre mondiale et la révolution mondiale.[21]
Nous ne savons pas comment la discussion s’est déroulée dans le BIPR/TCI suite à la publication de cet article par Battaglia comunista.[22] En tous cas, il reste que les deux articles que nous venons de mentionner sont le reflet d’un rejet plus général de la cohérence de la gauche italienne, ils sont l'expression de cette tendance au sein d'un des groupes les plus solides de cette tradition.
La régression vis-à-vis de la théorie de la décadence de la part d’éléments de la Gauche communiste peut être vue comme une libération par rapport à un dogmatisme rigide et une ouverture vers un enrichissement théorique. Mais alors que nous sommes les derniers à rejeter la nécessité d’élucider et d’approfondir toute la question de l’ascendance et du déclin du capitalisme[23], il nous semble que ce à quoi nous sommes principalement confrontés ici, c’est à un recul par rapport à la clarté de la tradition marxiste et à une concession envers le poids énorme de l’idéologie bourgeoise, qui se fonde nécessairement sur la foi dans la nature éternelle et auto-renouvelable de cet ordre social.
Aufheben. C’est le capital qui est "objectiviste", pas le marxisme
Comme nous l’avons dit au début de cet article, ce problème – l’incapacité de voir le capitalisme comme une forme transitoire d’organisation sociale qui a déjà montré son obsolescence – domine particulièrement dans la nouvelle génération de minorités politisées fortement influencées par l’anarchisme. Mais, comme tel, l’anarchisme n’a pas grand-chose à proposer au niveau théorique, surtout quand il s’agit de la critique de l’économie politique, et a l’habitude d’emprunter au marxisme s’il veut se donner une apparence de véritable profondeur. Dans une certaine mesure, c'est le rôle du groupe Aufheben dans le milieu communiste libertaire en Grande-Bretagne et internationalement. Beaucoup attendent impatiemment la parution annuelle de la revue Aufheben qui propose des analyses solides sur les questions de l’heure, du point de vue du "marxisme autonomiste". La série sur la décadence en particulier ("Decadence: The Theory of Decline or the Decline of Theory?" - Décadence: la théorie du déclin ou le déclin de la théorie? – qui a commencé dans le n° 2 d’Aufheben, été 1993) est considérée par beaucoup comme la réfutation définitive du concept de déclin du capitalisme qui serait un héritage de la Deuxième Internationale, exprimant un point de vue "objectiviste" sur la dynamique du capitalisme qui sous-estime totalement la dimension subjective de la lutte de classe.
"Pour les social-démocrates de gauche, insister sur le fait que le capitalisme est en déclin, qu’il approche de son effondrement, est considéré comme essentiel. Le sens du "marxisme" est de s’inscrire dans l’idée que le capitalisme est en banqueroute et que l’action révolutionnaire est donc nécessaire. Les marxistes s’engagent donc dans l’action révolutionnaire mais, comme nous l’avons vu, parce que le centre d’attention porte sur les contradictions objectives du système et que l’action subjective révolutionnaire est une réaction à celles-ci, ils n’ont rien à voir avec les véritables prérequis nécessaires à la fin du capitalisme – le développement concret du sujet révolutionnaire. Il semblait aux membres les plus révolutionnaires du mouvement comme Lénine et Luxemburg qu’une position révolutionnaire était une position croyant dans l’effondrement alors que la théorie de l’effondrement avait en fait permis l’adoption d’une position réformiste au début de la Deuxième Internationale. La question, c’est que la théorie du déclin du capitalisme en tant que théorie de son effondrement du fait de ses propres contradictions objectives implique un état d’esprit essentiellement contemplatif face au caractère objectif du capitalisme tandis que ce qui est vraiment requis pour la révolution, c’est de rompre avec cette attitude contemplative."[24]
Aufheben considère que les trotskystes comme les communistes de gauche d’aujourd’hui sont les héritiers de cette tradition social-démocrate (de gauche): "Notre critique est que leur théorie contemple le développement du capitalisme; les conséquences pratiques sont que les trotskystes courent après tout ce qui bouge afin de recruter pour leur confrontation finale tandis que les communistes de gauche se tiennent à l’écart en attendant le pur exemple d’action révolutionnaire des ouvriers. Derrière cette opposition apparente dans la façon de voir la lutte, ils partagent une conception de l’effondrement du capitalisme qui signifie qu’ils n’apprennent pas du mouvement réel. Bien qu’ils prennent des positions qui glissent vers l’idée de l’inévitabilité du socialisme, en général pour les théoriciens de la décadence cet avènement n’est pas inévitable – nous ne devons pas tous sortir au pub – mais le capitalisme s’effondrera. Cette théorie peut ainsi s’accompagner de la construction d’une organisation léniniste maintenant ou bien, comme pour Mattick, on peut attendre le moment de l’effondrement quand il sera possible de créer une véritable organisation révolutionnaire. La théorie du déclin et de la Crise est détenue et comprise par le parti, le prolétariat doit se mettre derrière sa bannière. Ça veut dire "Nous comprenons l’Histoire, suivez-nous". La théorie du déclin va très bien avec la théorie léniniste de la conscience qui, bien sûr, s’est beaucoup inspirée de Kautsky qui a terminé son commentaire sur le Programme d’Erfurt par la prévision que les classes moyennes allaient s’engager "dans le Parti socialiste et, main dans la main avec le prolétariat qui avance irrésistiblement, suivront sa bannière jusqu’à la victoire et au triomphe".
Comme on peut le voir de cette affirmation selon laquelle la théorie de la décadence amène logiquement à la théorie "léniniste" de la conscience de classe, la vision globale d’Aufheben a été influencée par Socialisme ou Barbarie (S ou B), dont l’abandon de la théorie marxiste de la crise dans les années 1960 a été examiné dans un article précédent de cette série[25]) et plus encore par l’autonomisme italien[26]. Ces deux courants partageaient la critique d’un "objectivisme" de Marx, en faisant une lecture d’après laquelle l’étude constante des lois économiques du capital minimiserait l’impact de la lutte de classe sur l’organisation de la société capitaliste et ne parviendrait pas à saisir l’importance de l’expérience subjective de la classe ouvrière face à son exploitation. En même temps, Aufheben est conscient que la théorie de l’aliénation de Marx est fondée, précisément, sur la subjectivité et critique Paul Cardan/Cornelius Castoriadis (le principal théoricien de S ou B) pour avoir érigé une critique de Marx ne prenant pas en compte cet élément-clé de sa pensée: "La "contradiction fondamentale" de S ou B est de ne pas saisir pleinement le radicalisme de la critique de l’aliénation par Marx. En d’autres termes, il présentait comme une innovation ce qui était en réalité un appauvrissement de la critique de Marx."[27]
Les autonomes sont aussi allés au-delà de l’idée superficielle de Cardan selon laquelle Marx avait écrit "un ouvrage monumental [Le Capital] analysant le développement du capitalisme, ouvrage d’où la lutte des classes est totalement absente."[28] Le livre de Harry Cleaver, Reading Capital Politically, publié en 1979 et qui s’identifie explicitement à la tradition du "marxisme autonomiste", démontre très bien que, dans la démarche de Marx, le capital est défini comme un rapport social et, comme tel, inclut nécessairement la résistance du prolétariat à l’exploitation qui, à son tour, modifie la façon dont le capital s’organise. C’était évident par exemple dans la lutte pour la réduction du temps de travail, dans le passage de l’extraction de la plus-value absolue à la plus-value relative (au 19e siècle) et dans le besoin croissant du système d’une planification de l'État pour faire face au danger prolétarien (au 20e siècle).
Ceci apporte un correctif valable à une vision mécaniste "kautskyste", qui s’est vraiment développée à l’époque de la Deuxième Internationale et selon laquelle les lois inexorables de l’économie capitaliste garantissaient plus ou moins que le pouvoir tomberait "comme un fruit mûr" dans les mains d’un parti social-démocrate bien organisé. De plus, souligne Cleaver, cette démarche qui sous-estime réellement le développement subjectif de la conscience de classe n’épargne pas une sorte d’ultra-léninisme qui intercale le parti comme seul élément de subjectivité, comme dans la fameuse formule de Trotsky selon laquelle "La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire" (Programme de Transition - L’agonie du capitalisme et les tâches de la Quatrième Internationale[29]). Le parti est vraiment un facteur subjectif mais sa capacité à grandir et à influencer le mouvement de la classe dépend d’un développement bien plus grand de la conscience et du combat prolétariens.
Il est également juste que la bourgeoisie a besoin de tenir compte de la lutte de la classe ouvrière dans ses efforts pour gérer la société – pas seulement sur le plan économique mais aussi aux niveaux politique et militaire. Et les analyses du CCI de la situation mondiale prennent assurément en compte cet aspect. On peut donner plusieurs exemples: quand nous interprétons le choix des équipes politiques qui doivent diriger l'État "démocratique", nous considérons toujours la lutte de classe comme un élément central; c’est pourquoi au cours des années 1980 nous écrivions que la bourgeoisie préférait maintenir les partis de gauche dans l’opposition pour mieux affronter les réactions prolétariennes face aux mesures d’austérité; de même, la stratégie de privatisation n’a pas seulement une fonction économique dictée par les lois abstraites de l’économie (généralisant la sanction du marché à chaque étape du processus du travail) mais, aussi, une fonction sociale ayant pour but de fragmenter la réponse du prolétariat aux attaques contre ses conditions de vie, qui n’apparaissent plus comme émanant d’un seul patron, l'État capitaliste. Sur un plan plus historique, nous avons toujours défendu que la lutte de classe, qu’elle soit ouverte ou potentielle, joue un rôle crucial dans la détermination du cours historique vers la guerre ou vers la révolution. Nous donnons ces exemples pour montrer qu’il n’y a pas de lien logique entre le fait de défendre une théorie du déclin du capitalisme et la négation du facteur subjectif de la classe pour déterminer la dynamique générale de la société capitaliste.
Mais les autonomes perdent complètement la tête quand ils concluent que la crise économique, qui a refait surface à la fin des années 1960, était elle-même un produit de la lutte de classe. Même si, à certains moments, les luttes ouvrières peuvent exacerber les difficultés économiques de la bourgeoisie et faire barrage à ses "solutions", nous ne savons que trop bien à quel point la crise économique peut atteindre des proportions catastrophiques dans des phases où la lutte de classe connaît un profond reflux. La Grande Dépression des années 1930 en est le plus clair exemple. Cette vision selon laquelle les luttes ouvrières provoquent la crise économique pouvait sembler plausible dans les années 1970 vu la concomitance des deux phénomènes, mais Aufheben lui-même en voit les limites dans l'article de la série sur la décadence consacré notamment aux autonomes: "La théorie de la crise provoquée par la lutte de classe a quelque peu déraillé dans les années 1980 car, alors que dans les années 1970 la rupture des lois objectives du capital sautait aux yeux, avec le succès partiel du capital le sujet qui émergeait a été repoussé. Durant les années 1980, nous avons vu les lois objectives du capital donner libre cours à leur folie furieuse dans notre vie. Une théorie qui faisait le lien entre les manifestations de la crise et le comportement concret de la classe trouvait peu de luttes offensives sur lesquelles s’appuyer et, pourtant, la crise a continué. Cette théorie est devenue moins appropriée aux conditions."[30]
Alors que reste-t-il de l’équation entre la théorie de la décadence et "l’objectivisme"? Plus haut, nous avons mentionné qu’Aufheben avait critiqué à juste raison Cardan parce qu’il ignorait les véritables implications de la théorie de l’aliénation de Marx. Malheureusement, Aufheben commet la même erreur quand il amalgame la théorie du déclin du capitalisme avec la vision "objectiviste" du capital comme n'étant rien d’autre qu’une machine réglée comme une horloge, par des lois inhumaines. Mais, pour le marxisme, le capital n’est pas quelque chose qui plane au-dessus de l’humanité comme Dieu; ou, plutôt, comme Dieu, il est engendré par l’activité humaine. Cependant, c’est une activité aliénée, ce qui veut dire qu’il devient indépendant de ses créateurs – en fin de compte tant de la bourgeoisie que du prolétariat, puisque tous deux sont menés par les lois abstraites du marché vers l’abîme du désastre économique et social. Cet objectivisme du capital est précisément ce que la révolution prolétarienne veut abolir, non en humanisant ses lois mais en les remplaçant par la subordination consciente de la production aux besoins humains.
Dans World Revolution n° 168 (octobre 1993)[31], nous avions publié une réponse au premier article d’Aufheben sur la décadence. L’argument central de cette réponse est qu’en critiquant la théorie de la décadence, Aufheben rejetait toute la démarche de Marx vis-à-vis de l’histoire. En particulier, en portant l’accusation d’ "objectivisme", il ignorait l’avancée cruciale faite par le marxisme rejetant à la fois la méthode matérialiste vulgaire et la méthode idéaliste et surmontant ainsi la dichotomie entre l’objectif et le subjectif, entre la liberté et la nécessité[32].
Il est intéressant de noter que, dans ses premiers articles sur la décadence, Aufheben ne reconnait pas seulement l’inadéquation de l’explication de la crise par les autonomes: dans une introduction très critique de la série publiée en ligne sur libcom.org[33], il admet qu’il n’a pas réussi à saisir de façon précise la relation entre les facteurs objectifs et subjectifs chez un certain nombre de penseurs marxistes (y compris Rosa Luxemburg qui défendait clairement la notion de déclin du capitalisme) et admet que la critique que nous avions portée sur un certain nombre d’aspects de cette question-clé était tout à fait valable. Après la publication du troisième article, il a réalisé que toute la série faisait fausse route et, pour cette raison, il l’a abandonnée. Cette autocritique n’est pas particulièrement connue tandis que la série d’origine continue de servir de référence comme étant le dernier mot contre la théorie de la décadence.
Cet auto-examen ne peut qu’être bienvenu mais nous ne sommes pas convaincus que ses résultats aient été particulièrement positifs. L’indication la plus évidente étant que, précisément dans une période où l’impasse économique à laquelle ce système est confronté paraît de plus en plus évidente, les dernières publications du groupe montrent qu’il s’est engagé dans une montagne de travaux qui ont accouché d’une souris: la "crise de la dette" qui a éclaté en 2007 n’est pas, selon lui, l’expression d’un problème sous-jacent du processus d’accumulation mais provient fondamentalement des erreurs du secteur financier. De plus, celle-ci pourrait très facilement mener à un nouveau et vaste "redressement" du même type que ceux qui l’ont précédé dans les années 1990 et dans les années 2000[34]. Nous n’avons pas la place de développer plus longuement cette question ici, mais il semble que l’anti-décadentisme est en train d’atteindre la phase finale de son déclin.
Nous arrêterons ici cette polémique mais le débat sur cette question doit se poursuivre. Il est rendu d’autant plus urgent qu'un nombre croissant de personnes, et par-dessus tout la nouvelle génération, est de plus en plus conscient du fait que le capitalisme n’a vraiment pas d’avenir et que la crise est vraiment une crise terminale. C’est une question qui doit de plus en plus être débattue dans les batailles de classe et les révoltes sociales que la crise provoque sur toute la planète. Il est plus que jamais vital de fournir un cadre théorique clair pour comprendre la nature historique de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste, d’insister sur le fait que c’est un mode de production hors de contrôle et qui va à son autodestruction, et donc de souligner l’impossibilité de toutes les solutions réformistes ayant pour but de rendre le capital plus humain ou plus démocratique. Bref, de démontrer que l’alternative "socialisme ou barbarie", annoncée fortement et clairement par les révolutionnaires en 1914, est plus valable aujourd’hui que jamais. Cet appel n’a rien à voir avec un plaidoyer pour l’acceptation passive de la voie suivie par la société. Au contraire, c’est un appel à ce que le prolétariat agisse, devienne de plus en plus conscient et ouvre la voie à un avenir communiste qui est possible, nécessaire, mais en aucune façon garanti.
Gerrard (printemps 2012)
[1] https://fr.internationalism.org/rint148/40_annees_de_crise_ouverte_montrent_que_le_capitalisme_en_declin_est_incurable.html [315]
[2] "Décadence du capitalisme (X) : Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [233]".
[3] "Quelle méthode scientifique pour comprendre l'ordre social existant, les conditions et moyens de son dépassement" https://fr.internationalism.org/node/3485 [316]
[4] https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [255], https://fr.internationalism.org/french/rinte49/decad.htm [317], https://fr.internationalism.org/french/rinte50/decadence.htm [318]
[10] internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_44_decadence-2.html en français : « Une contribution au débat sur la décadence" qui comporte quelques variations par rapport à la version anglaise, internationalist-perspective.org/PI/pi-archives/pi_44_decadence-2.html.
[11] internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_29_decadence.html. L’article n’est pas publié en français sur le web.
[12] Mac Intosh n’est ni le premier ni le dernier des anciens membres du CCI à être si ébloui par les taux de croissance du capitalisme qu’il finit par mettre en question ou par abandonner le concept de décadence du capitalisme. À la fin des années 1990, dans le sillage d’une grave crise centrée une fois de plus sur la question de l’organisation, un certain nombre d’anciens membres du CCI ont constitué le Cercle de Paris, parmi lesquels RV, rédacteur de la brochure La décadence du capitalisme et des articles de réponse à la critique par le GCI du « décadentisme". Bien que la question de la décadence n’ait jamais été un objet de débat dans la crise interne, le Cercle de Paris publia rapidement un texte important rejetant le concept de décadence – son argument essentiel portant sur le développement considérable des forces productives depuis 1914 et surtout depuis 1955.(cercledeparis.free.fr/indexORIGINAL.html [322])
[13] Le Capital, Livre III, Troisième section, Éd. La Pléiade, p. 1032
[14] Lire à ce propos notre article "L'étude du Capital et des fondements du communisme" de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle" (https://fr.internationalism.org/rinte75/communisme.htm [323]).
[15] En fait une estimation du FMI prévoit que "l'économie chinoise pourrait voir sa croissance divisée par deux si la crise de la zone euro s'aggrave". (Les Echos. www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0201894521951-... [324]).
[16] Pour maintenir sa croissance, malgré le ralentissement de la conjoncture économique mondiale, la Chine a misé sur son marché intérieur à travers un endettement renforcé des administrations locales. Mais, ici aussi, il n'y a pas de miracle possible. On ne peut pas s'endetter sans fin sans créer des risques de faillite, en l'occurrence des banques commerciales chinoise. Or, justement, "Pour éviter des défauts de paiements en cascade", celles-ci ont "repoussé dans le temps les échéances d'une grande partie des titres de la dette des collectivités locales, ou s'apprêtent à le faire" (Les Echos).
[17] www.leftcom.org/fr/articles/2002-02-01/el%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-les-crises-du-cci [325]
[18] www.leftcom.org/fr/articles/2003-12-01/pour-une-d%C3%A9finition-du-concept-de-d%C3%A9cadence [326]
[19] https://fr.internationalism.org/rinte119/decadence.htm [327] et https://fr.internationalism.org/rint/120_decadence [328]
[20] https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [286]
[21] L’article de la Revue internationale n° 120 dénonce aussi les affirmations hypocrites d’un groupe d’éléments exclus du CCI pour leur comportement inacceptable: la « Fraction interne du CCI", qui avait publié un article flagorneur sur la contribution de Battaglia comunista. Ayant attaqué le CCI pour avoir « abandonné" le concept de décadence à travers la théorie de la décomposition (qui n’est aucunement en dehors du concept de décadence), le projet politique de cette « fraction" - celui d’attaquer le CCI tout en flattant le BIPR – se démasquait très clairement dans cet article.
[22] Il semblerait que l’article de Prometeo n°8 était un document de discussion et non une prise de position du BIPR ou de l’un de ses affiliés, ce qui rend le titre de notre réponse (« Battaglia comunista abandonne le concept marxiste de décadence") en quelque sorte inadapté.
[23] Par exemple, le débat sur la base économique du boom d’après-guerre (https://fr.internationalism.org/rint133/les_causes_de_la_periode_de_prosperite_consecutive_a_la_seconde_guerre_mondiale.html [217] et les articles dans les numéros suivants) et la reconnaissance que la décadence a une histoire, menant au concept de décomposition en tant que stade final du déclin du capitalisme.
[24] https://libcom.org/library/decadence-aufheben-2 [329] (toutes les citations sont traduites de l’anglais par nous)
[25] https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [286]
[28] Cornelius Castoriadis. Brochure n°10. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne. Chap. II : « La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel".
[29] https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [233]
[32] Voir aussi l’article de cette série dans la Revue internationale n° 141 https://fr.internationalism.org/rint140/la_theorie_du_declin_du_capitalisme_et_la_lutte_contre_le_revisionnisme.html [103] , qui contient une critique de l’idée d’Aufheben selon laquelle la notion de décadence trouve son origine dans la Deuxième Internationale.
[33] https://libcom.org/article/aufheben-decadence [333]. Dans cette introduction, Aufheben dit clairement qu’au début, les écrits du CCI avaient constitué un point de référence important pour le groupe. Cependant, il dit aussi que notre démarche dogmatique et sectaire à son égard (par exemple lors d’une réunion à Londres sur l'avenir de l'Union européenne) l’avait convaincu du fait qu’il n’était pas possible de discuter avec nous. Il est vrai que le CCI a eu, dans une certaine mesure, une démarche sectaire envers Aufheben – ce qui se reflète dans notre article de 1993, par exemple lorsque nous écrivons, à la fin, que ce serait mieux que le groupe disparaisse.
[34] Voici les derniers paragraphes d'un article datant de 2011: « il n’y a pas grand-chose qui suggère que nous soyons entrés dans une longue descente ou que le capitalisme soit maintenant embourbé dans la stagnation sinon la crise financière elle-même. En fait, la reprise rapide des profits et la confiance de la plus grande partie de la bourgeoisie dans les perspectives à long terme d’une accumulation renouvelée du capital semblent suggérer l’inverse. Mais si le capitalisme dans son ensemble est encore au milieu du chemin d’un long redressement, avec historiquement de hauts taux de profit, comment expliquer la crise financière imprévue de 2007-2008?
Comme nous l’avons depuis longtemps défendu contre l’orthodoxie « stagnationniste", la théorie du « redressement" s’est avérée correcte en comprenant que la restructuration de l’accumulation globale du capital qui a eu lieu au cours de la dernière décennie, en particulier par l’intégration dans l’économie mondiale de la Chine et de l’Asie, a mené à la restauration des taux de profit et, en conséquence, à un redressement économique soutenu. Mais comme nous le reconnaissons aujourd’hui, le problème est que la théorie du redressement n’a pas réussi à saisir de façon adéquate l’importance de l’émergence des banques et de la finance au niveau global, ni le rôle qu’elles ont joué dans cette restructuration.
Ainsi, afin de surmonter les limites des théories « stagnationniste" et « redressementiste" sur la crise, il était nécessaire d’examiner les rapports entre l’émergence et le développement des secteurs bancaire et financier au niveau global et la restructuration de la véritable accumulation du capital qui a eu lieu au cours des trente dernières années. Sur la base de cet examen, nous avons pu conclure que la crise financière de 2007-08 n’avait pas eu lieu par hasard à cause d’une politique erronée ni que c’était une crise du système financier qui ne faisait que refléter une crise sous-jacente de stagnation de la réelle accumulation du capital. Mais, au contraire, la cause sous-jacente de la crise financière était une trop grande fourniture de capital-monnaie empruntable au sein du système bancaire et financier dans son ensemble qui s’est développée à la fin des années 1990. Ceci à son tour était le résultat de développements dans l’accumulation réelle de capital – comme la montée de la Chine, le décollage de la « nouvelle économie" et la liquidation continue de la « vieille économie" - qui ont été centraux pour soutenir la longue montée.
De cela, nous pourrions tenter de conclure que la nature et la signification de la crise financière ne sont pas à un tournant décisif menant à une descente économique ou à la fin du néolibéralisme comme beaucoup l’ont supposé mais, plutôt, un point d’inflexion indiquant une nouvelle phase à long terme. La signification de cette phase et les implications que cela a pour le développement futur du capitalisme et de la lutte contre lui sont une question que nous n’avons pas la place de traiter ici." Aufheben n° 19, « Return of the crisis: Part 2 - the nature and significance of the crisis", https://libcom.org/article/return-crisis-part-2-nature-and-significance-crisis [334]
Questions théoriques:
- Décadence [76]
Rubrique:
Revue Internationale n° 150 - 3e et 4e trimestre 2012
- 1370 lectures
Sommet de l'Euro de juin 2012 : derrière les illusions, un nouveau pas dans la catastrophe
- 1243 lectures
Le 29 juin 2012 au matin, comme par enchantement, une douce euphorie gagnait rapidement les politiciens et dirigeants de la zone Euro. Les médias bourgeois et les économistes n’étaient pas en reste. Le dernier sommet européen venait de prendre apparemment des "décisions historiques". Contrairement à ceux, nombreux, qui l'avaient précédé au cours des dernières années et qui avaient tous échoué. Mais, aux dires de beaucoup de commentateurs, ce temps était désormais révolu ; la bourgeoisie de cette zone, pour une fois unie et solidaire, venait d’adopter les mesures nécessaires pour sortir du tunnel de la crise. Pour peu, on se serait cru dans le monde d’Alice aux pays des merveilles. Mais en y regardant de plus près et une fois les brumes matinales dissipées, apparaissent alors les vraies questions : Quel est le contenu réel de ce sommet ? Quelle va être sa portée ? Va-t-il réellement apporter une solution durable à la crise de la zone Euro et donc pour l'économie mondiale ?
Le dernier sommet européen : des décisions en trompe l’œil
Si le sommet européen du 29 juin 2012 a été présenté comme "historique" c'est qu'il est censé constituer un tournant dans la façon dont les autorités affrontent la crise de l'Euro. D'une part, au niveau de la forme, ce sommet, pour la première fois, ne s'est pas contenté, suivant les commentateurs, d'entériner les décisions prises auparavant par "Merkozy", c'est-à-dire le tandem Merkel-Sarkozy (en réalité, la position de Merkel entérinée par Sarkozy) 1 mais a tenu compte des demandes de deux autres pays importants de la zone, l'Espagne et l'Italie, des demandes appuyées par le nouveau président français, François Hollande. Par ailleurs, ce sommet devait inaugurer une nouvelle donne dans la politique économique et budgétaire au sein de la zone : après des années où la seule politique promue par les instances dirigeantes de l'Euro consistait en une austérité de plus en plus impitoyable, on prenait enfin en compte une des critiques à cette politique (portée notamment par les économistes et politiciens de gauche) suivant laquelle, sans relance de l'activité économique, les États surendettés seraient incapables de trouver les ressources fiscales pour payer leurs dettes.
C'est pour cela que le président de gauche François Hollande, venu pour arracher un "pacte pour la croissance et l’emploi" tenait la scène comme un acteur de théâtre fier de sa prestation et des résultats obtenus. Il était accompagné, dans sa satisfaction, par deux hommes pourtant de droite, Monti chef du gouvernement italien et Rajoy son homologue espagnol qui, eux-aussi, paradaient : leurs calculs ayant apparemment payé, l’étau financier sur leur pays devait se desserrer. La situation réelle était bien trop grave pour que tous ces messieurs prennent un air triomphant, mais l’humeur y était : "on pouvait espérer voir le début de la fin de la sortie du tunnel de la crise dans la zone euro !" Cette déclaration particulièrement alambiquée aurait été prononcée par le chef du gouvernement italien !
Avant de soulever le voile sur ce matin qui s’annonçait ainsi presque radieux, un petit retour dans le temps s’impose. Souvenons-nous : depuis six mois, la zone Euro s’est retrouvée deux fois en situation de voir ses banques s’effondrer. La première fois, cela a donné naissance à ce qui a été appelé LTRO (Long Term Refinancing Operation) : la Banque centrale européenne (BCE) a accordé pour 1000 milliards environ de prêts à celles-ci. En réalité 500 milliards avaient déjà été provisionnés dans ce sens. Quelques mois après, voilà à nouveau que ces mêmes banques appellent au secours ! Racontons maintenant une petite histoire dérisoire qui illustre ce qui se passe réellement dans la finance européenne. Au début de cette année 2012 les dettes souveraines (celles des États) explosent. Les marchés financiers font alors eux-mêmes grimper les taux auxquels ils acceptent de prêter de l’argent à ces États. Certains d'entre eux, notamment l’Espagne, ne peuvent plus aller chercher de prêts sur le marché. C’est trop cher. Pendant ce temps-là les banques espagnoles rendent l’âme. Que faire ? Que faire en Italie, au Portugal et ailleurs ? Une idée géniale germe alors dans les grands esprits de la BCE. Nous allons prêter massivement aux banques, qui vont elles-mêmes financer les dettes souveraines de leur État national et l’économie "réelle" sous forme de prêts à l'investissement ou à la consommation. Cela se passait l'hiver dernier, la Banque centrale européenne faisait "bar ouvert et boissons à discrétion". Le résultat est là, début juin tout le monde se réveille avec une cirrhose du foie. Les banques n’ont pas prêté à l’économie "réelle" ; elles ont mis cet argent en sécurité, en rapportant elles-mêmes son équivalent à la Banque centrale, avec en plus un petit intérêt en retour. En quoi cet équivalent consistait-il ? En des obligations d’État qu’elles venaient d’acheter avec l’argent de cette même Banque centrale. Véritable tour de passe-passe et d’illusion qui ne pouvait tenir que le temps d’un spectacle décidément totalement dérisoire !
Au mois de juin, les "médecins économistes" crient à nouveau haut et fort : nos malades sont en train de mourir. Il faut immédiatement des mesures radicales prises conjointement par les hôpitaux de toute la zone Euro. Nous sommes maintenant au moment de la tenue du sommet du 29 juin. Après toute une nuit de négociations, un accord "historique" semble trouvé. Les décisions prises :
les fonds de stabilisation financière (FESF et MES 2) vont pouvoir renflouer directement les banques, après accord de la BCE, ainsi qu’acheter de la dette publique afin de détendre les taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers ;
les européens vont confier à la BCE la supervision du système bancaire de la zone Euro ;
une extension de la règle de contrôle des déficits public des États de cette zone est adoptée ;
enfin, à la grande satisfaction des économistes et politiciens de gauche, un plan de 100 milliards d’euros de relance de l’activité est mis en scène.
Pendant quelques jours les mêmes discours fleurissent. La zone Euro a enfin pris les bonnes décisions. Si l’Allemagne a réussi à maintenir sa "Règle d’or" en matière de dépenses publiques (qui impose aux États d'inscrire dans leur loi fondamentale l'élimination du déficit budgétaire), elle a par contre accepté d’aller dans le sens de la mutualisation des dettes des États de la zone Euro et de la monétisation de ces dettes, c'est-à-dire de la possibilité de les rembourser en imprimant de la monnaie.
Comme toujours dans ce genre d’accord, la réalité se cache dans le calendrier et dans la mise en pratique des décisions qui sont prises. Cependant, dès ce fameux petit matin, un élément sautait aux yeux. Une question essentielle semblait avoir été écartée, celle des moyens financiers et de leurs sources réelles. Tout le monde s’accordant par ailleurs pour sous-entendre que l’Allemagne finirait par payer puisqu’elle seule semble apparemment en avoir les moyens ! Et puis, pendant le mois de juillet, oh surprise ! Tout paraît remis en question. Grâce à des manœuvres juridiques, l'application des accords est renvoyée au plus tôt en septembre. Il y a en effet un tout petit problème. Au 16 juillet l’ardoise de l’Allemagne devenait tout simplement insupportable. Lorsqu’on additionne tous les engagements en termes de garanties déguisées et lignes de crédits, l’exposition totale de ce pays à ses voisins européens aux abois s’élève à 1500 milliards d’euros. Le PNB de l’Allemagne est de 2650 milliards d’euros et ceci avant la prise en compte de la contraction de son activité qui a commencé il y a quelques mois. C’est là une somme ahurissante équivalant à plus de la moitié de son PNB. Les derniers chiffres annoncés en matière de dette pour la zone Euro s’élèvent eux à environ 8000 milliards dont une grande partie représente des actifs dits "toxiques" (c'est-à-dire des reconnaissances de dette qui ne seront jamais honorées). Il n’est pas bien difficile de comprendre que l’Allemagne est incapable d’assurer un tel niveau d’endettement. Elle n’est pas en mesure non plus, dans la durée, de cautionner, avec suffisamment de crédibilité, par sa seule signature, ce mur de la dette auprès des marchés financiers. La preuve effective de cette réalité existe ; elle s’exprime dans un paradoxe dont seule une économie en plein désarroi a le secret. L’Allemagne place sa dette à court et moyen terme à des taux négatifs. En clair les acheteurs de cette dette acceptent de ne percevoir que des intérêts ridicules tout en perdant du capital avec l’évolution de l’inflation. La dette souveraine allemande semble être un refuge de montagne capable d’affronter toutes les tempêtes mais, en même temps, les prix des assurances contractées par les acheteurs pour assurer cette dette en leur possession grimpe au niveau de ceux de la Grèce ! Finalement ce refuge se révèle bien vulnérable ! Les marchés savent pertinemment que si l’Allemagne continue de financer la dette de la zone Euro, elle deviendra alors elle-même insolvable et c'est pour cela que chacun des prêteurs veille à s’assurer au mieux en cas de chute brutale.
Alors reste la tentation de l’arme ultime. Celle qui consisterait à dire à la Banque centrale européenne de faire comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis : "Imprimons des billets et encore des billets sans regarder la valeur de ce que l’on prend en échange". Les banques centrales peuvent bien se transformer à leur tour en banques "pourries", ce n’est pas le problème. Ce n’est plus le problème. Le problème est d’éviter que tout s’arrête aujourd’hui ! Nous verrons bien ce qui se passera demain, le mois prochain, l’année prochaine. C’est cela l’avancée du dernier sommet européen. Mais la BCE ne l’entend pas de cette oreille. Certes cette banque centrale n’a pas la même autonomie que les autres banques centrales du monde. Elle est liée aux différentes banques centrales de chaque nation composant la zone Euro. Mais le problème de fond est-il là ? Si la BCE pouvait opérer comme la Banque centrale du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, l’insolvabilité du système bancaire et des États de la zone Euro serait-elle résolue ? Qu'en est-il dans ces autres pays, par exemple aux États-Unis ?
Des banques centrales plus fragilisées que jamais
Alors que de lourds nuages s'amoncellent au-dessus de l’économie américaine, pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas encore sorti de leur manche un troisième plan de relance, une nouvelle phase de monétisation de leur dette ?
Il faut se rappeler que le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke a été surnommé "Monsieur Hélicoptère". Il y a déjà eu aux États-Unis, en quatre ans, deux plans de création monétaire massive, les fameux "quantitative easings". Ce monsieur semblait pouvoir survoler sans relâche les États-Unis et balancer de l’argent, inondant tout sur son passage. Un raz de marée ininterrompu de liquidités, et que chacun s’enivre à satiété ! Et bien non, désolé, cela ne marche pas comme cela. Depuis quelques mois une nouvelle création monétaire massive est indispensable aux États-Unis. Mais elle ne vient pas, elle se fait attendre. Parce qu’un "quantitative easing" n°3 est à la fois indispensable, vital et en même temps impossible, comme l’est en Europe une mutualisation et une monétisation globale de la dette de la zone Euro. Le capitalisme est engagé dans une rue qui finit en cul de sac ! Même la première puissance économique au monde ne peut pas fabriquer ex-nihilo de l’argent à l’infini. Toute dette a besoin d’être financée à un moment ou à un autre. La Banque centrale américaine a, comme toute banque centrale, deux sources de financement qui sont de fait liées et interdépendantes. La première consiste à capter l’épargne, l’argent qui existe au-dedans ou en-dehors du pays, soit à un coût d’emprunt tolérable, soit par un renforcement de la fiscalité. La seconde consiste à fabriquer de l’argent en contrepartie de reconnaissances de dettes, notamment en achetant ce qu’on appelle les obligations représentant la dette publique ou d’État. La valeur de ces obligations est en dernière instance déterminée par l’évaluation qu’en font les marchés financiers. Une voiture d’occasion est à vendre. Son prix est affiché sur le pare-brise par le vendeur. Les acheteurs potentiels vérifient l’état du véhicule. Des offres de prix d’achat sont proposées et le vendeur choisira sans aucun doute la moins mauvaise pour lui. Si l’état de la voiture est trop dégradé alors le prix devient dérisoire et celle-ci reste pourrir dans la rue. Ce petit exemple illustre le danger d’une nouvelle création monétaire aux États-Unis… et ailleurs. Depuis quatre ans, des centaines de milliards de dollars ont été injectées dans l’économie américaine sans que la moindre relance durable ne soit au rendez-vous. Pire : la dépression économique a poursuivi de manière souterraine son bonhomme de chemin. Nous voici arrivés au cœur du problème. L’évaluation de la valeur réelle de la dette souveraine est connectée de fait à la solidité de l’économie du pays, tout comme la valeur de notre voiture à son état réel. Si une Banque centrale (que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans la zone Euro) imprime des billets pour acheter des obligations, ou des reconnaissances de dettes, qui ne pourront jamais être remboursés (parce que les emprunteurs sont devenus insolvables) elle ne fait qu'inonder le marché de morceaux de papier qui ne correspondent à aucune valeur réelle car ils n'ont pas de contrepartie effective en termes d'épargne ou de richesses nouvelles en garantie. En d'autres termes, elles fabriquent de la fausse monnaie.
En route vers une récession généralisée
Une telle affirmation peut toujours paraître un peu exagérée ou aventureuse et pourtant ! Voici ce qui est écrit dans le bulletin Global Europe Anticipation de janvier 2012 : "Pour générer un dollar de croissance en plus, les USA doivent désormais emprunter autour de 8 dollars. Ou bien l’inverse, si on préfère, chaque dollar emprunté ne génère que 0,12 dollar de croissance. Cela illustre l’absurdité du moyen-long terme des politiques menées par la FED et le Trésor US ces dernières années. C’est comme une guerre où il faut tuer de plus en plus de soldats pour gagner de moins en moins de terrain." La proportion n’est sans doute pas exactement la même dans tous les pays du monde. Mais la tendance générale suit le même chemin. C'est pour cela, notamment, que les 100 milliards d'euros prévus par le sommet du 29 juin en vue de financer la croissance ne seront pas autre chose qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Les profits réalisés sont dérisoires au regard de l’évolution du mur de la dette. Un film comique célèbre avait pour titre : "Y a-t-il un pilote dans l’avion ?". Pour ce qui concerne l’économie mondiale, il faudrait rajouter : "Il n’y a plus de moteur non plus". Voilà un avion et ses passagers en bien mauvaise posture.
Face à cette débandade générale des pays les plus développés, certains, afin de minimiser la gravité de la situation du capitalisme, tentent d'opposer l'exemple de la Chine et des pays "émergents". Il y a quelques mois encore, la Chine nous était vendue comme étant la prochaine locomotive de l’économie mondiale, aidée dans ce rôle par l’Inde et le Brésil. Qu'en est-il en réalité ? Ces "moteurs" connaissent à leur tour de très sérieux ratés. La Chine a annoncé officiellement, le vendredi 13 juillet, un taux de croissance de 7,6% ce qui en fait le taux le plus bas pour ce pays depuis le début de la phase actuelle de la crise. Le temps des taux à deux chiffres est bien fini. Et pourtant, même à 7%, ces chiffres n’intéressent plus les spécialistes. Tous savent qu’ils sont faux. Ces gens avisés préfèrent se tourner vers d’autres chiffres qu’ils jugent plus fiables. Voici ce qui était dit le même jour sur une radio économique spécialisée française (BFM) : "En regardant l’évolution de la consommation électrique, on peut déduire que la croissance chinoise se situe en réalité autour de 2 à 3%. Soit moins de la moitié des chiffres officiels." En ce début d’été, tous les chiffres de la croissance de l’activité sont en berne. Ils diminuent partout. Le moteur tourne au ralenti, proche de zéro. L’avion s’apprête à plonger et l'économie mondiale avec lui.
Le capitalisme entre dans la zone des grandes tempêtes
Face à la récession mondiale et à l’état financier des banques et des États, la guerre économique va faire rage entre différents secteurs de la bourgeoisie. La relance de l’activité par une politique keynésienne classique (qui suppose un endettement de l'État) ne peut plus être, comme on l'a vu, réellement efficace. Dans ce contexte de récession, l’argent collecté par les États ne peut que diminuer et, malgré l’austérité généralisée, leur dette souveraine ne pourra que continuer à exploser comme en Grèce ou maintenant en Espagne. La question qui va déchirer la bourgeoisie est la suivante : "Faut-il prendre le risque insensé de relever une nouvelle fois le plafond de la dette ?" De manière croissante, l’argent ne veut plus aller à la production, à l’investissement ou à la consommation. Ce n’est plus rentable. Mais les intérêts et les remboursements des dettes à échéances sont là. Il est nécessaire au capital de fabriquer de la monnaie nouvelle et factice au moins pour retarder la cessation de paiements généralisée. Bernanke, le patron de la banque centrale américaine, et son homologue Mario Draghi dans la zone Euro, comme tous leurs confrères sur cette planète sont pris en otage par l’état de l’économie capitaliste. Soit ils ne font rien et alors la dépression et les faillites vont prendre à court terme l’allure d’un cataclysme. Soit ils injectent à nouveau massivement de l’argent et alors commencera à sonner le glas pour la valeur de la monnaie. Une chose est certaine, même si elle perçoit maintenant ce danger, la bourgeoisie, divisée irrémédiablement sur ces sujets, ne réagira que dans des situations d’urgence absolue, au dernier moment, et dans des proportions toujours plus insuffisantes. La crise du capitalisme malgré tout ce que nous avons connu depuis l’année 2008 n’en est qu’à ses débuts.
Tino (30-07-2012)
1 Il faut noter que depuis que cet article a été écrit, le gouvernement français est revenu à plus de coopération avec la chancelière allemande. Peut-être faudra-t-il parler bientôt de "Merkhollande". En tout cas, en septembre 2012, le nouveau président Hollande et la direction du Parti socialiste font campagne pour forcer la main aux parlementaires de leur majorité afin qu'ils votent en faveur du Pacte de stabilité (la "règle d'or") que le candidat Hollande avait promis de renégocier. Comme le disait un vieux routard du gaullisme réputé pour son cynisme, Charles Pasqua, "les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient".
2 Fonds européen de stabilité financière et Mécanisme européen de stabilité.
Récent et en cours:
- Crise économique [153]
Rubrique:
Le Mexique entre crise et narcotrafic
- 4503 lectures
La presse et les informations télévisées du monde entier transmettent régulièrement des images du Mexique dans lesquelles sont mis au premier plan les affrontements, la corruption et les assassinats, qui résultent de la "guerre contre le narcotrafic". Mais tout ceci apparaît comme un phénomène étranger au capitalisme ou anormal, alors que toute la réalité barbare qui va de pair est profondément enracinée dans la dynamique du système d’exploitation actuel. C'est, dans toute son étendue, la façon d’agir de la classe dominante qui est ainsi révélée, à travers la concurrence et les rivalités politiques exacerbées entre ses différentes fractions. Aujourd'hui, un tel processus de plongée dans la barbarie et la décomposition du capitalisme est effectivement dominant dans certaines régions du Mexique.
Au début de la décennie 1990, nous disions que "parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l'évolution de la situation sur le plan politique" 1. Ce phénomène apparaît plus clairement dans la dernière décennie du xxe siècle où il tend à devenir une tendance majeure.
Ce n'est pas seulement la classe dominante qui est affectée par la décomposition, le prolétariat et les autres couches exploitées en subissent aussi les effets les plus pernicieux. Au Mexique, les groupes maffieux et le propre gouvernement enrôlent, en vue de la guerre qu'ils se livrent, des éléments appartenant aux secteurs les plus paupérisés de la population. Les affrontements entre ces groupes, qui tirent sans distinction sur la population, laissent des centaines de victimes sur le carreau que gouvernement et maffias qualifient de "dommages collatéraux". Il en résulte un climat de terreur que la classe dominante a su utiliser pour éviter et contenir les réactions sociales aux attaques continues des conditions de vie de la population.
Le narcotrafic et l’économie
Dans le capitalisme, la drogue n’est rien de plus qu’une marchandise dont la production et la distribution nécessitent obligatoirement du travail, même si celui-ci n’est pas toujours volontaire ou salarié. L’esclavage dans ce milieu est courant, quoique soit aussi employé le travail volontaire et rémunéré d’un milieu lumpen pour des activités criminelles, mais aussi de journaliers et autres travailleurs comme des charpentiers (par exemple, pour la construction de maisons et de magasins) qui se voient contraints, pour survivre dans la misère qu’offre le capitalisme, de servir des capitalistes producteurs de marchandises illégales.
Ce qui est vécu aujourd’hui au Mexique a déjà existé (ou existe encore) dans d’autres parties du monde : les maffias tirent profit de la misère pour leurs agissements, et leur collusion avec les structures étatiques leur permet de "protéger leurs investissements" et leurs activités en général. En Colombie, dans les années 1990, l’enquêteur H. Tovar-Pinzón donnait un certain nombre d’éléments pour expliquer pourquoi les paysans pauvres devenaient les premiers complices des maffias du narcotrafic : "Une propriété produisait, par exemple, dix cargaisons de maïs par an qui permettaient une recette brute de 12 000 pesos colombiens. Cette même propriété pouvait produire cent arrobes de coca, qui représentaient pour le propriétaire un revenu brut de 350 000 pesos par an. N’est-il pas tentant alors de changer de culture quand l’une permet de gagner trente fois plus ?" 2.
Ce qui se passait en Colombie s’est étendu à toute l’Amérique latine, entraînant vers le narcotrafic, non seulement les paysans propriétaires, mais aussi la grande masse des journaliers sans terre qui vendent leur force de travail à ces derniers. Cette grande masse de salariés devient ainsi la proie facile des maffias, à cause du niveau extrêmement bas des salaires octroyés par l’économie légale. Au Mexique, par exemple, un journalier employé à couper la canne à sucre perçoit un peu plus de deux dollars par tonne (27 pesos) et voit son salaire amélioré lorsqu’il produit une marchandise illégale. Ce faisant, une grande partie des travailleurs employés dans cette activité perd sa condition de classe. Ces travailleurs sont toujours plus impliqués dans le monde du crime organisé et au contact direct des pistoleros et des transporteurs de drogue dont ils partagent directement le quotidien, dans un contexte de banalisation des assassinats et du crime. Mêlés étroitement à cette ambiance, la contagion les amène progressivement vers la lumpenisation. C’est un des effets nocifs de l’avancée de la décomposition affectant directement la classe ouvrière.
Il existe des estimations selon lesquelles les maffias du narcotrafic au Mexique emploieraient 25 % de personnes en plus que McDonald’s dans le monde entier 3. Il faut en outre ajouter qu’au-delà de l'utilisation d'agriculteurs, l’activité des maffias implique le racket et la prostitution imposés à des centaines de jeunes. Aujourd’hui, la drogue est une branche supplémentaire de l’économie capitaliste, c’est-à-dire que l’exploitation y est présente comme dans n’importe quelle autre activité économique mais, de plus, les conditions de l’illégalité poussent la concurrence et la guerre pour les marchés à prendre des formes bien plus violentes.
La violence pour gagner les marchés et augmenter les profits est d’autant plus acharnée que le gain est important. Ramón Martinez Escamilla, membre de l’Institut de recherches économiques de l’Université nationale autonome du Mexique, considère que "le phénomène du narcotrafic représente entre 7 et 8 % du PIB du Mexique" 4. Ces chiffres, comparés aux 6% du PIB mexicain que représente la fortune de Carlos Slim, le plus grand magnat du monde, donnent une idée de l’importance prise par le narcotrafic dans l’économie, permettant d'en déduire la barbarie que celui-ci engendre. Comme n’importe quel capitaliste, le narcotrafiquant n’a d’autre objectif que le profit. Pour expliquer les raisons de ce processus, il suffit de reprendre les paroles du syndicaliste Thomas Dunning (1799-1873), cité par Marx :
"Que le profit soit convenable, et le capital devient courageux : 10 % d'assurés, et on peut l'employer partout; 20 %, il s'échauffe !, 50 %, il est d'une témérité folle ; à 100 %, il foule aux pieds toutes les lois humaines ; 300 %, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux" 5.
Fondées sur le mépris des vies humaines et sur l’exploitation, ces immenses fortunes trouvent certes refuge dans les paradis fiscaux mais sont aussi utilisées directement par des capitaux légaux qui se chargent de la besogne de blanchiment. Les exemples ne manquent pas pour l’illustrer, comme celui de l’entrepreneur Zhenli Ye Gon ou plus récemment de l’Institution financière HSBC. Dans ces deux exemples, il a été mis en lumière que ce personnage ou cette institution brassaient d’immenses fortunes de cartels de la drogue, que ce soit pour la promotion de projets politiques (au Mexique et ailleurs) ou pour "d’honorables" investissements.
Edgar Buscaglia 6 affirme que des entreprises de toute sorte ont été "désignées comme douteuses par les agences de renseignement d’Europe et des États-Unis, dont l’Office de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain, mais que personne n’a voulu les mettre en cause au Mexique, fondamentalement parce que plusieurs d’entre elles financent les campagnes électorales" 7.
Il existe d’autres processus marginaux (mais non moins significatifs) qui permettent l’intégration de la maffia à l’économie, tels que le dépouillement violent de propriétés et d’immenses territoires, à tel point que certaines zones du pays sont à présent des "villes fantômes". Certains chiffres parlent du déplacement, ces dernières années, d’un million et demi de personnes fuyant "la guerre entre l’armée et les narcos" 8.
Il est indispensable à présent de signaler l’impossibilité, pour les projets des maffiosi de la drogue, d'exister hors du domaine des États. Ceux-ci sont la structure qui les protège et les aide à déplacer leur argent vers les géants financiers, mais sont aussi le siège des équipes gouvernementales de la bourgeoisie qui ont mêlé leurs intérêts à ceux des cartels de la drogue. Il est évident que les maffias ne pourraient guère avoir autant d’activités si elles ne recevaient pas le soutien de secteurs de la bourgeoisie mêlés aux gouvernements. Comme nous l’avancions dans les "Thèses sur la décomposition", "il devient de plus en plus difficile de distinguer l'appareil gouvernemental du milieu des gangsters" 9.
Le Mexique, exemple de l’avancée de la décomposition capitaliste
Depuis 2006, ce sont presque soixante mille personnes qui ont été abattues, que ce soit sous les balles des unités de la maffia ou celles de l’armée officielle ; une grande partie de ces tués a été victime de la guerre entre cartels de la drogue, mais ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’État, quoi qu’en dise le gouvernement. Il est impossible de rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres, à cause des liens existant entre les groupes maffieux et l’État lui-même. Si les difficultés ont à ce niveau été croissantes, c’est précisément parce que les fractures et divergences au sein de la bourgeoisie se sont amplifiées et que, à tout instant, n’importe quel lieu peut devenir le champ de bataille entre fractions de la bourgeoisie ; bien entendu, la structure étatique elle-même est aussi un lieu privilégié pour que s’expriment ces conflits. Chaque groupe de la maffia surgit sous la houlette d’une fraction de la bourgeoisie, et tant la concurrence économique que les querelles politiques font que ces conflits croissent et se multiplient de jour en jour.
Au milieu du xixe siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, le commerce de la drogue (l’opium par exemple) était déjà à l'origine de difficultés politiques aboutissant à des guerres, celles-ci révélant tant l’essence barbare de ce système que la participation directe des États dans la production et la distribution de marchandises telles que la drogue. Cependant, une telle situation était alors inséparable de la vigilance stricte des États et la classe dominante pouvait maintenir le cadre d'une ferme discipline sur cette activité, permettant de parvenir à des accords politiques et évitant qu'elle n'affaiblisse la cohésion de la bourgeoisie 10. Ainsi, même si la "guerre de l’opium" – déclarée principalement par l’État britannique – illustrait un trait de comportement du capital, nous pouvons comprendre pourquoi le commerce de la drogue n’était cependant pas un phénomène dominant du xixe siècle.
L’importance de la drogue et la formation de groupes maffieux prennent une importance croissante durant la phase de décadence du capitalisme. La bourgeoisie tente certes de limiter et ajuster par des lois et des règlements la culture, la préparation et le trafic de certaines drogues pendant les premières décennies du xxe siècle, mais seulement dans le but de bien contrôler le commerce de cette marchandise.
L’évidence historique montre que la "filière de la drogue" n’est pas une activité répudiée par la bourgeoisie et son État. Bien au contraire, c’est cette même classe qui se charge d’étendre son usage et de profiter des bénéfices qu’elle procure, et dans le même temps d'étendre ses effets ravageurs chez l’être humain. Les États, au xxe siècle, ont distribué massivement de la drogue aux armées. Les États-Unis donnent le meilleur exemple d'un tel usage pour "stimuler" les soldats pendant la guerre : le Viêt-Nam fut ainsi un grand laboratoire et il n’est pas surprenant que ce soit effectivement l’Oncle Sam qui ait encouragé la demande de drogue pendant les années 1970, et y ait répondu en impulsant sa production dans les pays de la périphérie.
Au début de la seconde moitié du xxe siècle au Mexique, l’importance de la production et de la distribution de drogue est encore loin d’être significative et reste sous le contrôle strict des instances gouvernementales. Le marché est alors strictement contrôlé par l’armée et la police. À partir des années 1980, l’État américain encourage le développement de la production et de la consommation de drogue au Mexique et dans toute l’Amérique latine.
L’affaire "Iran-Contra" (1986) avait mis en lumière que le gouvernement de Ronald Reagan, pour pallier la limitation du budget destiné à soutenir les bandes militaires opposées au gouvernement du Nicaragua (les "contras"), utilisait des fonds provenant de la vente d’armes à l’Iran et, surtout, du trafic de drogue via la CIA et la DEA. Le gouvernement des États-Unis poussait les maffias colombiennes à augmenter leur production, déployant même, à cette fin, un soutien militaire et logistique auprès des gouvernements du Panama, du Mexique, du Honduras, du Salvador, de la Colombie et du Guatemala, destiné à faciliter le passage de cette si convoitée marchandise. Pour "élargir le marché", la bourgeoisie américaine s'était mise à produire des dérivés de la cocaïne bien moins coûteux et donc plus faciles à commercialiser massivement, quoique bien plus ravageurs.
Ces mêmes pratiques, utilisées par le grand parrain américain pour se procurer des fonds lui permettant de mener à bien ses aventures putschistes, ont aussi été utilisées en Amérique latine pour lutter contre la guérilla. Au Mexique, ladite "sale guerre" menée par l’État dans les années 1970 et 80 contre la guérilla fut financée par l’argent qui venait de la drogue. L’armée et des groupes paramilitaires (comme la Brigade blanche ou le groupe Jaguar) avaient alors carte blanche pour assassiner, séquestrer et torturer. Certains projets militaires comme "l’Opération Condor" (qui soi-disant visait la production de drogue), étaient en réalité dirigés contre la guérilla et servirent en même temps à protéger les cultures de pavot et de marijuana.
À cette époque, la discipline et la cohésion de la bourgeoisie mexicaine lui permettaient de maintenir sous contrôle le marché de la drogue. De récentes enquêtes journalistiques affirment que pas la moindre cargaison de drogue n'échappait au contrôle et à la surveillance de l’armée ou de la police fédérale 11. L’État assurait, sous un corset de fer, l’unité de tous les secteurs de la bourgeoisie et, quand un groupe ou capitaliste individuel manifestait des désaccords, il était soumis pacifiquement par le biais de privilèges ou de parts de pouvoir. C’est ainsi que se maintenait unie la soi-disant "famille révolutionnaire" 12.
Avec l’effondrement du bloc impérialiste de l’Est disparut aussi l’unité du bloc opposé dirigé par les États-Unis, ce qui en retour provoqua une accentuation du chacun pour soi parmi les différentes fractions nationales de certains pays. Au Mexique, cette rupture s’exprima à travers la dispute au grand jour des fractions de la bourgeoisie à tous les niveaux : partis, clergé, gouvernements régionaux, fédéral… Chaque fraction cherchait à s'octroyer une plus grande part de pouvoir, sans qu'aucune d'entre elles ne prenne pour autant le risque de remettre en question la discipline historique derrière les États-Unis.
Dans ce contexte de bagarre générale, des forces bourgeoises opposées se sont disputées la répartition du pouvoir. Ces pressions internes ont débouché sur des tentatives de remplacer le parti au pouvoir et de "décentraliser" les responsabilités du maintien de l’ordre. C'est ainsi que les pouvoirs locaux, représentés par les gouvernements des États fédérés et les présidents municipaux, ont décrété leur contrôle régional. Ceci, en retour, n'a fait qu'accentuer le chaos : le gouvernement fédéral et chaque gouvernement de région ou municipalité, afin de renforcer son contrôle politique et économique, s’est associé avec telle ou telle bande maffieuse. Chaque fraction au pouvoir protège et renforce tel ou tel cartel en fonction de ses intérêts, lui assurant ainsi l’impunité, ce qui explique l’arrogance violente des maffias.
L’ampleur de ce conflit peut se vérifier dans les règlements de comptes entre personnalités politiques. On peut estimer par exemple que, ces cinq dernières années, vingt-trois maires et huit présidents municipaux ont été assassinés, et que les menaces faites à des secrétaires d’État et des candidats ont été innombrables. La presse bourgeoise tente de faire passer les personnalités assassinées pour des victimes alors que, dans la majeure partie des cas, celles-ci ont été l'objet de règlements de comptes entre bandes rivales ou bien au sein même des bandes, pour cause de trahison.
En analysant de la sorte ces événements, on peut comprendre que les problèmes de drogue ne pourront pas être résolus dans le capitalisme. Pour limiter les excès de la barbarie, la seule solution de la bourgeoisie est d’unifier ses intérêts et de se regrouper autour d’une seule bande maffieuse, isolant ainsi les autres bandes pour les maintenir dans une existence marginale.
L’issue pacifique de cette situation est très improbable du fait en particulier de la division aiguë entre fractions de la bourgeoisie au Mexique, rendant difficile et peu probable que puisse être atteinte ne serait-ce qu’une cohésion temporaire permettant une pacification. La tendance dominante semble bien être à l’avancée de la barbarie… Dans une interview datée de juin 2011, Buscaglia faisait une estimation de l’ampleur que prenait le narcotrafic dans la vie de la bourgeoisie : "près de 65 % des campagnes électorales au Mexique sont contaminées par de l’argent provenant de la délinquance organisée, principalement du narcotrafic" 13.
Les travailleurs sont les victimes directes de l’avancée de la décomposition capitaliste qui s’exprime à travers des phénomènes comme "la guerre contre le narco" et ils sont aussi la cible des attaques économiques que la bourgeoisie impose face à l’approfondissement de la crise ; c’est sans le moindre doute une classe qui souffre de grandes pénuries, mais ce n’est pas une classe contemplative, c’est un corps social capable de réfléchir, de prendre conscience de sa condition historique et de réagir collectivement.
Décomposition et crise… le capitalisme est un système en putréfaction
Drogue et assassinats font partie des faits divers majeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et si la bourgeoisie leur donne une telle importance c'est aussi parce que cela lui permet de faire passer au second plan les effets de la crise économique.
La crise du capitalisme n’a pas son origine dans le secteur financier, comme le prétendent les "experts" bourgeois. C’est une crise profonde et générale du système qui n’épargne aucun pays. La présence active des maffias au Mexique, bien qu’elle pèse d’un poids très lourd sur les exploités, n’efface pas les effets de la crise sur ceux-ci ; bien au contraire, elle les aggrave.
La cause principale des tendances à la récession qui affecte actuellement le capitalisme mondial est l’insolvabilité généralisée, mais ce serait une erreur de croire que le poids de la dette souveraine est l’unique indicateur permettant d'évaluer l’avancée de la crise. Dans certains pays, comme le Mexique, le poids de la dette ne crée pas encore de difficultés majeures, quoiqu’au cours de la dernière décennie, selon la Banque du Mexique, la dette souveraine ait augmenté de 60 % pour atteindre 36,4 % du PIB fin 2012 selon les prévisions. Ce montant est bien sûr modeste quand on le compare au niveau de l’endettement de pays comme la Grèce (où il atteint 170 % du PIB), mais cela implique-t-il que le Mexique ne soit pas exposé à l’approfondissement de la crise ? La réponse est non, bien entendu.
Tout d’abord, que l'endettement ne soit pas aussi important au Mexique que dans d'autres pays ne signifie pas qu’il ne va pas le devenir.
Les difficultés de la bourgeoisie mexicaine à relancer l’accumulation de capital s’illustrent particulièrement dans la stagnation de l’activité économique. Le PIB n’est même pas parvenu à atteindre ses niveaux de 2006 (voir graphique 1) et, qui plus est, les fugaces embellies récentes ont concerné le secteur des services, en particulier le commerce (comme l’explique la propre institution de l’État chargée des statistiques, l’INEGI). Par ailleurs, il faut prendre aussi en considération que si ce secteur dynamise le commerce intérieur (et permet ainsi au PIB de croître), c’est parce que le crédit à la consommation a augmenté (fin 2011 l’usage des cartes de crédit avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente).
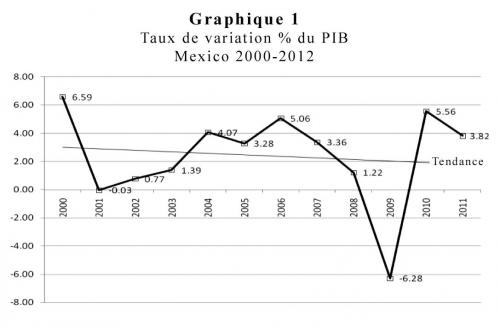
Les mécanismes utilisés par la classe dominante pour affronter la crise ne sont ni nouveaux ni particuliers au Mexique : augmenter les niveaux d’exploitation et doper l’économie à travers le crédit. L’application de mesures de ce genre avait permis aux États-Unis, dans les années 1990, de donner l’illusion d’une croissance. Anwar Shaikh, spécialiste de l’économie américaine, l’explique ainsi : "La principale impulsion en faveur du boom était venue de la dramatique chute du taux d’intérêt et de l’effondrement spectaculaire des salaires réels en rapport avec la productivité (croissance du taux d’exploitation), qui ensemble élevèrent considérablement le taux de profit de l’entreprise. Les deux variables jouèrent des rôles différents dans différents endroits…" 14.
De telles mesures se répètent au rythme de l’avancée de la crise, et bien que leurs effets soient toujours plus limités, il n’y a pas d’autre solution que de continuer à y recourir, en attaquant toujours davantage les conditions de vie des travailleurs. Les chiffres officiels, pour maquillés qu’ils soient, témoignent de la précarité des solutions. Il n’est pas surprenant que l’alimentation des travailleurs mexicains soit basée sur les calories les moins chères provenant du sucre (le pays étant le second consommateur de sodas derrière les États-Unis, chaque Mexicain en consommant quelques 150 litres en moyenne par an) ou des céréales.
Ce n'est donc pas surprenant si le Mexique est un des pays dont la population adulte est la plus en proie aux problèmes d’obésité et où culminent des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. La dégradation des conditions de vie atteint de tels extrêmes que toujours plus d’enfants entre 12 et 17 ans sont obligés de travailler (selon la CEPALC, 25 % en zone rurale et 15 % en ville). En compressant les salaires, la bourgeoisie parvient à se réapproprier les ressources financières auparavant destinées à la consommation des ouvriers, cherchant ainsi à augmenter la masse de plus-value que s’approprie le capital. Cette situation est d'autant plus grave pour les conditions de vie de la classe ouvrière que, comme le montre le graphique 2, les prix de la nourriture augmentent plus vite que l’indice général des prix utilisé par l’État pour affirmer que le problème de l’inflation est sous contrôle.
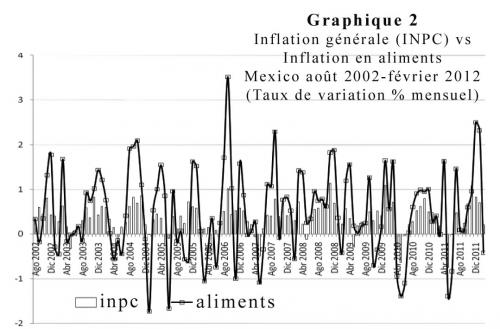
Les porte-paroles des gouvernements en Amérique latine partent du principe que si les conflits économiques majeurs touchent les pays centraux (États-Unis et Europe), le reste du monde est épargné par cette dynamique, d’autant plus que le FMI et la BCE sont alimentés en liquidités par les gouvernements de ces régions, y compris celui du Mexique. Mais ceci ne signifie en rien que ces économies ne soient pas menacées par la crise. Ces mêmes processus d’insolvabilité que traverse aujourd’hui l’Europe furent le lot de l’Amérique latine pendant les années 1980 et, avec elles, les sévères mesures découlant de plans d'austérité draconiens (qui donnèrent lieu à ce qui fut nommé le Consensus de Washington).
La profondeur et l’amplitude de la crise peuvent se manifester différemment selon les pays, mais la bourgeoisie recourt aux mêmes stratégies dans tous les pays, même ceux qui sont moins étranglés par l’accroissement de la dette souveraine.
Les plans de réduction des coûts de production que la bourgeoisie applique de moins en moins discrètement, licenciements massifs et augmentation de l'exploitation, ne peuvent en aucun cas favoriser un quelconque redressement.
Les taux de chômage et de paupérisation atteints par le Mexique nous aident à comprendre comment s’étend et s’approfondit la crise partout ailleurs. Coparmex, l’association patronale, reconnaît qu’au Mexique 48 % de la population économiquement active se trouve dans "le sous-emploi" 15, ce qui dans un langage plus franc signifie en situation précaire : bas salaires, contrats temporaires, journées de plus en plus longues sans assurance médicale. Cette masse de chômeurs et de précaires est le fruit de la "flexibilisation du travail" imposée par la bourgeoisie pour amplifier l’exploitation et faire retomber sur nos épaules les principaux effets de la crise.
La misère et l’exploitation sont les moteurs du mécontentement
Nombreuses sont les régions, essentiellement dans les zones rurales, qui sont soumises au couvre-feu et au contrôle permanent par les patrouilles armées, qu’elles soient militaires, policières ou maffieuses (si ce n’est les deux), qui assassinent sous le moindre prétexte, faisant de la vie des exploités un véritable cauchemar. À cette terreur s’ajoutent des attaques permanentes sur le plan économique. Début 2012, la bourgeoisie mexicaine a annoncé une "réforme du travail" qui, comme ailleurs dans le monde, va porter le coût de la force de travail à un niveau plus intéressant pour le capital, réduisant ainsi les coûts de production et amplifiant davantage les taux d’exploitation.
La "réforme du travail" a pour but l’augmentation des cadences et de la durée du travail, mais aussi la baisse des salaires (réduction du salaire direct et élimination de parts substantielles du salaire indirect), le projet prévoyant par ailleurs l’augmentation du nombre d’années de travail nécessaires pour avoir droit à la retraite.
Cette menace a commencé à se concrétiser dans le secteur de l’éducation. L’État a choisi ce secteur pour porter une première attaque qui devra en appeler d'autres ailleurs. Il peut se le permettre car, bien que les travailleurs y soient nombreux et aient une grande tradition de combativité, il est très fermement contrôlé par la structure syndicale, tant officielle (Syndicat national des travailleurs de l’Education – SNTE) que "démocratique" (Coordination nationale des travailleurs de l’Éducation – CNTE). C'est ainsi que le gouvernement a pu y déployer la stratégie suivante : d’abord provoquer le mécontentement en annonçant une "Évaluation universelle" 16, et ensuite mettre en scène toute une série de manœuvres (manifestations interminables, tables de négociations séparées par région…) reposant sur les syndicats pour user, isoler et ainsi vaincre les grévistes, convaincre de l'inutilité de "la lutte" et enfin démoraliser et intimider l’ensemble des travailleurs.
Bien que les enseignants aient fait l'objet d’un traitement particulier, les "réformes" s’appliquent cependant progressivement et discrètement à tous les travailleurs. Les mineurs, par exemple, subissent déjà ces attaques qui réduisent le coût de leur force de travail et précarisent leurs conditions de travail. La bourgeoisie considère normal que, pour un salaire de misère (le salaire maximum auquel peut prétendre un mineur est de 455 dollars mensuels), les ouvriers passent au fond des puits et galeries des mines de longues et intensives journées de travail qui excèdent bien souvent les huit heures, dans des conditions de sécurité innommables dignes de celles qui prévalaient au xixe siècle. C’est ce qui explique, d’une part, que le taux de profit des entreprises minières au Mexique soit parmi les plus élevés du monde et, d’autre part, l’augmentation spectaculaire des "accidents" dans les mines, avec leur lot croissant de blessés et de morts. Depuis l’an 2000, dans le seul état de Coahuila, la plus active des zones minières du pays, plus de 207 travailleurs sont morts à la suite d’effondrements de galeries ou de coups de grisou.
Cette misère, à laquelle s’ajoutent les agissements criminels des gouvernements et des maffias, provoque un mécontentement croissant parmi les exploités et opprimés qui commence à s’exprimer, même si c'est encore avec de grandes difficultés. Dans d’autres pays comme l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Chili ou le Canada, les rues ont été envahies par les manifestations exprimant ainsi le courage de lutter contre la réalité du capitalisme, même si ce n'était pas encore clairement en tant que force d'une classe de la société, la classe ouvrière.
Au Mexique, les manifestations massives convoquées par des étudiants du mouvement "#yo soy 132" (#je suis le 132), bien qu’ayant été dès l’origine encadrées par la campagne électorale de la bourgeoisie en vue des présidentielles, n’en sont pas moins le produit d'un malaise social qui couve. Ce n’est pas pour nous consoler que nous affirmons cela ; nous ne nous berçons pas de l'illusion d'une classe ouvrière avançant sans faiblir dans un processus de lutte et de clarification, nous nous efforçons simplement de comprendre la réalité. Nous devons pour cela prendre en compte que le développement des mobilisations sur l’ensemble de la planète n’est pas homogène et qu'au sein de celles-ci, la classe ouvrière comme telle n’a pas assumé une position dominante. Du fait de sa difficulté à se reconnaître en tant que classe de la société ayant la capacité de constituer une force au sein de celle-ci, la classe ouvrière n’a pas confiance en elle, elle craint de se lancer dans la lutte et de prendre la tête du combat. Une telle situation favorise, au sein des mouvements, l'influence des mystifications bourgeoises qui présentent des "solutions" réformistes comme des alternatives possibles à la crise du système. Cette tendance générale est aussi présente au Mexique.
Ce n’est qu’en constatant les difficultés rencontrées par la classe ouvrière que l’on peut comprendre que le mouvement animant la création du regroupement "#yo soy 132" exprime aussi le ras-le-bol envers les gouvernements et partis de la classe dominante. Cette dernière a su réagir très rapidement à la menace en enchaînant le regroupement au faux espoir porté par les élections et la démocratie, et le convertir en un organe creux, inutile au combat des exploités (qui s'étaient rapprochés de ce groupe en croyant y trouver un moyen de lutter) mais très utile à la bourgeoisie qui continue à utiliser "#yo soy 132" afin d’encadrer la combativité des jeunes ouvriers révoltés par la réalité du capitalisme.
La classe au pouvoir sait parfaitement que l’aggravation des attaques provoquera inévitablement une réponse de la part des exploités. José A. Gurría, secrétaire général de l’OCDE, l’exprime en ces termes le 24 février : "Que peut-il se passer quand on mixe la baisse de la croissance, un taux élevé de chômage et une inégalité croissante ? Le résultat ne peut être que le Printemps arabe, les Indignés de la Puerta del Sol et ceux de Wall Street". C’est pourquoi, face à ce mécontentement latent, la bourgeoisie mexicaine favorise la campagne de contestation de l’élection de Peña Nieto 17 à la présidence de la république, mot d’ordre fédérateur qui stérilise toute combativité réelle, d’autant plus qu’au-delà des déclarations radicales de López Obrador 18 et de "#yo soy 132" rien n’ira plus loin que la défense de la démocratie et de ses institutions.
Accentuée par les effets nocifs de la décomposition, la crise capitaliste a généralisé la paupérisation des prolétaires et autres opprimés mais elle a, ce faisant, montré la réalité à nu, dans toute sa cruauté : le capitalisme ne peut plus offrir que chômage, misère, violence et mort.
La crise profonde du capitalisme et l’avancée destructive de la décomposition annoncent les dangers que représente la survie du capitalisme, affirmant la nécessité impérative de sa destruction par la seule classe capable de l’affronter, le prolétariat.
Rojo (mars 2012)
1 Cf. Revue internationale no 62,
"La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [200]".
2 Nueva sociedad no 130, Colombie, 1994, "L’économie de la coca en Amérique latine. Le paradigme colombien" (notre traduction).
3 Cf. "Narco SA, una empresa global" [336] sur www.cnnexpansion.com [337].
4 La Jornada, 25 juin 2010 (notre traduction).
5 Karl Marx, Le Capital, Livre premier, "Le développement de la production capitaliste" ; VIIIe section, "L'accumulation primitive" ; Chapitre XXXI, "Genèse du capitaliste industriel". https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm [338].
6 Coordinateur du Programme international de Justice et Développement de l’Institut technologique autonome du Mexique (ITAM).
7 La Jornada, 24 mars 2010 (notre traduction).
8 Dans des états du nord du pays comme Durango, Nuevo León et Tamaulipas, certaines zones sont considérées comme "villes fantômes" car abandonnées par la population. Les villageois qui se consacraient à l’agriculture se sont vus dans l’obligation de fuir, liquidant leur propriété à bas prix dans le meilleur des cas ou les abandonnant purement et simplement. Le sort des ouvriers est encore plus grave car leur mobilité est limitée faute de moyens ; quand ils parviennent à fuir vers d’autres régions, ils sont forcés de vivre dans les pires conditions de précarité, devant en outre continuer à rembourser les crédits des logements qu’ils ont été forcés d’abandonner.
9 Cf. Revue internationale no 62, op. cit., point 8.
10 Aujourd’hui encore, pour certains pays comme les États-Unis, qui sont cependant les plus grands consommateurs de drogues, les affrontements armés et les victimes qu’ils provoquent restent surtout concentrés hors des frontières.
11 Cf. Anabel Hernández, Los Señores del narco (les Seigneurs de la drogue), Editions Grijalbo, México 2010.
12 C’est ainsi que l’on appelait l’unité que la bourgeoisie avait atteinte avec la création du Parti national révolutionnaire (PNR, 1929), qui se consolida en se transformant en Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et qui se maintint au pouvoir jusqu’en 2000.
13 Cf. "Edgardo Buscaglia : el fracaso de la guerra contra el narco - Pour le Journal allemand Die Tageszeitung" [339] sur nuestraaparenterendicion.com
14 In "The first great depression of the 21st century" [340], 2010.
15 L’institution officielle (INEGI) calcule pour sa part que le taux de travailleurs “informels” est de 29,3 %.
16 "L’Évaluation universelle" est une partie du projet "Alliance pour la qualité de l’Éducation" (ACE) Cette mesure vise non seulement à imposer un système d’évaluation pour amener les travailleurs à rivaliser entre eux et réduire les postes, mais aussi pour augmenter les charges de travail, comprimer les salaires, faciliter les protocoles de licenciement rapide et à bas coût, attaquer les retraites…
17 Dirigeant du Parti révolutionnaire institutionnel [341] (social-démocrate).
18 Dirigeant du Parti de la révolution démocratique [342] (social-démocrate de gauche).
Géographique:
- Mexique [343]
Rubrique:
L'État dans la période de transition au communisme (II) : notre réponse au groupe Oposição Operária (Opposition ouvrière) - Brésil
- 3380 lectures
Nous publions ci-après notre réponse à l'article "Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat" du groupe Oposição Operária (OPOP) 1 au Brésil, paru dans le numéro 148 de la Revue internationale 2.
La position développée dans l'article de OPOP se réclame intégralement de l'ouvrage de Lénine, L'État et la révolution, et c'est à partir de ce point de vue que cette organisation rejette une idée centrale de la position du CCI. Cette dernière, tout en reconnaissant la contribution fondamentale de L'État et la révolution à la compréhension de la question de l'État durant la période de transition, met à profit l'expérience de la révolution russe, des réflexions de Lénine lui-même durant cette période et des écrits fondamentaux de Marx et Engels, pour en tirer des enseignements conduisant à remettre en question l'identité entre État et dictature du prolétariat, admise classiquement jusque-là par les courants marxistes.
Dans son article, OPOP développe également une autre position qui lui est propre à propos de ce qu'elle appelle le "pré-État", c'est-à-dire l'organisation des conseils, avant la révolution, appelée à renverser la bourgeoisie et son État. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question car nous estimons qu'il est prioritaire de faire préalablement toute la lumière sur nos divergences avec OPOP concernant la question de l'État de la période de transition.
L'essentiel de la thèse défendue par OPOP dans son article
Afin d'éviter au lecteur des allers et retours incessants avec l'article de OPOP de la Revue internationale n° 148, nous en reproduisons les passages que nous estimons les plus significatifs.
Pour OPOP, la "séparation antinomique entre le système des conseils et l'État postrévolutionnaire" "s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État", revenant ainsi à "briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat". En effet, "une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel)."
C'est une erreur qui, selon OPOP, s'explique par les incompréhensions suivantes relatives à l'État-Commune et ses relations avec le prolétariat :
-
"une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois)." Celle-ci "place le prolétariat hors de l'État postrévolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils."
-
"l'identification entre l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même".
-
"La non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée (…) ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiées" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients".
-
"la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine (…) implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification/extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils"
Enfin, un autre facteur intervient, selon OPOP, pour expliquer les leçons erronées tirées par le CCI de la Révolution russe quant à la nature de l'État de transition ; il s'agit de la non prise en compte par notre organisation des conditions défavorables que la révolution a dû confronter : "une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la Révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort."
L'inévitabilité d'une période de transition et de l'existence d'un État durant celle-ci
La différence entre les marxistes et les anarchistes ne réside pas en ceci que les premiers concevraient le communisme avec un État et les seconds comme étant une société sans État. Sur ce point, il y accord total : le communisme ne peut être qu'une société sans État. C'est donc plutôt avec les pseudo-marxistes de la social-démocratie, héritiers de Lassalle, qu'une telle différence fondamentale a existé vu que, pour eux, c'est l'État qui était le moteur de la transformation socialiste de la société. C'est contre eux qu'Engels avait écrit le passage suivant de l'Anti-Dühring : "Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas "aboli", il s'éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur l'"État populaire libre 3", tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d'agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique ; de juger également la revendication de ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après laquelle l'État doit être aboli du jour au lendemain" 4. Le vrai débat avec les anarchistes porte sur leur méconnaissance totale d'une période de transition inévitable et sur le fait qu'ils dictent à l'histoire un saut à pieds joints, immédiat et direct, du capitalisme à la société communiste.
Sur cette question de la nécessité de l'État durant la période de transition, nous sommes donc parfaitement d'accord avec OPOP. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous étonner que cette organisation nous reproche de nous "éloigner de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État". En quoi, en effet, d'un point de vue marxiste, notre position peut-elle s'approcher de celle des anarchistes selon laquelle "il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain" ?
Si on se base sur ce qu'écrit Lénine dans L'État et la révolution, à propos de la critique marxiste de l'anarchisme sur la question de l'État, il apparaît que cette dernière est loin de confirmer le point de vue de OPOP : "Marx souligne expressément — pour qu'on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l'anarchisme — la "forme révolutionnaire et passagère" de l'État nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n'a besoin de l'État que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs, de même que, pour supprimer les classe, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée" 5. Le CCI fait pleinement sienne cette formulation, à un mot près. Il s'agit de la qualification, par Lénine, de "révolutionnaire" de cette forme passagère qu'est l'État. Cette différence peut-elle être apparentée à une variante des conceptions anarchistes, comme le pense OPOP, ou bien au contraire renvoie-t-elle à un débat beaucoup plus profond sur la question de l'État ?
Quel est le véritable débat ?
Sur la question de l'État, notre position diffère effectivement de celle de L'État et la révolution et de celle de la Critique du programme de Gotha pour qui, durant la période de transition, "l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat" 6. C'est le fond du débat entre nous : pourquoi ne peut-il y avoir d'identité entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition qui surgit après la révolution ? Voila une idée qui heurte beaucoup de marxistes, lesquels ont souvent posé la question : "D'où le CCI tire-t-il sa position sur l'État de la période de transition ?" Nous pouvons répondre : "Non pas de son imagination mais bien de l'histoire, des leçons qu'en ont tirées des générations de révolutionnaires, des réflexions et élaborations théoriques du mouvement ouvrier". Ainsi en particulier :
- les perfectionnements successifs à la compréhension de la question de l'État apportés par le mouvement ouvrier jusqu'à la révolution russe et dont L'État et la révolution de Lénine rend compte de façon magistrale ;
- la prise en compte de l'ensemble des considérations théoriques de Marx et Engels sur la question de l'État, qui vient en fait contredire l'idée que l'État de la période de transition constituerait le vecteur de transformation socialiste de la société ;
- la dégénérescence de la Révolution russe qui illustre que l'État a constitué le vecteur principal de développement de la contre-révolution au sein du bastion prolétarien ;
- au sein de ce processus, certaines prises de positions critiques de Lénine en 1920-21 démontrant que le prolétariat devait pouvoir se défendre contre l'État et qui, tout en restant prisonnières des limitations propres à la dynamique de dégénérescence qui allait mener à la contre-révolution, apportent un éclairage essentiel sur la nature et le rôle de l'État de transition.
C'est avec cette démarche qu'un travail de bilan de la vague révolutionnaire mondiale a été effectué par la Gauche communiste d'Italie 7. Selon cette dernière, si l'État subsiste après la prise du pouvoir du prolétariat du fait qu'il subsiste des classes sociales, celui-ci est fondamentalement un instrument de conservation de la situation acquise mais nullement l'instrument de la transformation des rapports de production vers le communisme. En ce sens, l'organisation du prolétariat comme classe, à travers ses conseils ouvriers, doit imposer son hégémonie sur l'État mais ne jamais s'identifier à celui-ci. Il doit être capable, si nécessaire, de s'opposer à l'État, comme l'avait compris partiellement Lénine en 1920-21. C'est justement parce que, avec l'extinction de la vie des soviets (inévitable du fait de l'échec de la Révolution mondiale), le prolétariat avait perdu cette capacité d'agir et de s'imposer sur l'État que ce dernier a pu développer ses tendances conservatrices propres au point de se faire le fossoyeur de la révolution en Russie en même temps qu'il absorbait dans ses rouages le parti bolchevique lui-même et en faisait un instrument de la contre-révolution.
La contribution de l'histoire à la compréhension de la question de l'État de la période de transition
L'État et la révolution de Lénine avait constitué, en son temps, la meilleure synthèse de ce que le mouvement ouvrier avait élaboré concernant la question de l'État et de l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière 8. En effet, cet ouvrage offre une excellente illustration quant à la manière dont s'est éclaircie, à travers l'expérience historique, la question de l'État. En se basant sur son contenu, nous rappelons ici les perfectionnements successifs ayant été apportés par le mouvement ouvrier à la compréhension de ces questions :
- Le Manifeste communiste de 1848 met en évidence la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir politique, de se constituer en classe dominante et conçoit que ce pouvoir sera exercé au moyen de l'État bourgeois qui aura été investi par le prolétariat : "Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l'État - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives" 9.
- Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), la formulation devient déjà plus "précise" et "concrète" (selon les propres termes de Lénine) par rapport à celle du Manifeste communiste. En effet, il est question, pour la première fois, de la nécessité de détruire l'État : "Toutes les révolutions perfectionnèrent cette machine au lieu de la briser. Les partis qui se disputèrent à tour de rôle le pouvoir considéraient la mainmise sur cet énorme édifice d'État comme le butin principal du vainqueur" 10.
- À travers l'expérience de la Commune de Paris (1871), Marx voit, comme le dit Lénine, "un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements" 11 qui justifie, à ses yeux et à ceux d'Engels, que le programme du Manifeste communiste, ayant " perdu, par endroits, son actualité " 12 soit modifié à travers une nouvelle préface. La Commune a notamment démontré, poursuivent-ils, que la " classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d'État telle quelle et l'utiliser pour ses propres fins." 13.
La révolution de 1917 n'a pas laissé le temps à Lénine d'écrire dans L'État et la révolution des chapitres dédiés aux apports des révolutions russes de 1905 et février 1917. Lénine s'est limité à identifier les soviets comme les successeurs naturels de la Commune de Paris. On peut ajouter que, même si aucune de ces deux révolutions n'a permis au prolétariat de prendre le pouvoir politique, elles fournissent cependant des enseignements supplémentaires par rapport à l'expérience de la Commune de Paris concernant le pouvoir de la classe ouvrière : les soviets de députés ouvriers basés sur des assemblées dans les lieux de travail s'avèrent plus adaptés à l'expression de l'autonomie de classe du prolétariat que ne l'étaient les unités territoriales de la Commune.
En plus de constituer une synthèse de ce que le mouvement ouvrier a écrit de meilleur sur ces questions, L'État et la révolution contient des développements propres à Lénine qui, à leur tour, constituent des avancées. En effet, alors qu'ils tiraient les leçons essentielles de la Commune de Paris, Marx et Engels avaient laissé une ambiguïté quant à la possibilité que le prolétariat arrive pacifiquement au pouvoir à travers le processus électoral dans certains pays, précisément ceux qui disposaient des institutions parlementaires les plus développées et de l'appareil militaire le moins important. Lénine n'a pas eu peur de corriger Marx, en utilisant pour cela la méthode marxiste et replaçant la question dans le contexte historique adapté : "Aujourd'hui, en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. (…). Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine de 1’État toute prête". " 14
Seule une vision dogmatique pourrait s'accommoder de l'idée que L'État et la révolution de Lénine devrait constituer la dernière et suprême étape dans la clarification de la notion d'État dans le mouvement marxiste. S'il est un ouvrage qui est l'antithèse d'une telle vision c'est bien celui-là. OPOP elle-même ne craint pas de s'éloigner de ce que dit littéralement Lénine dans L'État et la révolution en poussant à son terme l'idée de la citation précédente : "Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière" 15
Écrit en août-septembre 1917, c'est très rapidement, avec l'éclatement de la révolution d'octobre, que L'État et la révolution a servi d'arme théorique en vue de l'action révolutionnaire pour le renversement de l'État bourgeois et la mise en place de l'État-Commune. Les leçons tirées jusque là de la Commune de Paris se trouvent ainsi mises à l'épreuve de l'histoire à travers des événements historiques d'une portée bien plus considérable encore, la Révolution russe et sa dégénérescence.
Peut-on tirer des leçons de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 sur le rôle de l'État ?
OPOP répond négativement à cette question dans la mesure où, nous dit-elle, les conditions en Russie étaient tellement défavorables qu'elles ne permettaient pas la mise en place d'un État ouvrier tel que Lénine le décrit dans L'État et la révolution. Ainsi, elle nous reproche d'identifier "l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même". Et d'ajouter : "Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe (…) n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS".
Nous sommes d'accord avec OPOP pour dire que la première leçon à tirer de la dégénérescence de la révolution russe est que celle-ci est le produit de l'isolement international du bastion prolétarien du fait de la défaite des autres tentatives révolutionnaires en Europe, en Allemagne en particulier. En effet, non seulement il ne peut y avoir de transformation des rapports de production vers le socialisme dans un seul pays mais encore il n'est pas possible qu'un pouvoir prolétarien se maintienne indéfiniment isolé dans un monde capitaliste. Mais n'existe-t-il pas d'autres enseignements de grande importance à tirer de cette expérience ?
Si, bien sûr ! Et OPOP reconnaît l'un d'entre eux, bien que celui-ci contredise explicitement le passage suivant de L'État et la révolution relatif à la première phase du communisme : "... l'exploitation de l'homme par l'homme sera impossible, car on ne pourra s'emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc.". 16 En effet, ce qu'ont montré la révolution russe et, surtout, la contre-révolution stalinienne, c'est que la simple transformation de l'appareil productif en une propriété d’État ne supprime pas l'exploitation de l'homme par 1’homme.
En fait, la révolution russe et sa dégénérescence constituent des événements historiques d'une telle portée qu'on ne peut pas ne pas en tirer des enseignements. Pour la première fois dans l'histoire, se produit la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, comme expression la plus avancée d'une vague révolutionnaire mondiale, avec le surgissement d'un État alors appelé prolétarien ! Et ensuite il se produit ce fait, également totalement inédit dans l'histoire du mouvement ouvrier, la défaite d'une révolution, non pas clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie comme ce fut le cas de la Commune de Paris, mais comme conséquence d'un processus de dégénérescence interne ayant pris par la suite le visage hideux du stalinisme.
Dans les semaines suivant l'insurrection d'octobre, l’État-Commune est déjà autre chose que "les ouvriers en armes" décrits dans L'État et la révolution 17. Par-dessus tout, avec l'isolement croissant de la révolution, le nouvel État est de plus en plus infesté par la gangrène de la bureaucratie, répondant de moins en moins aux organes élus par le prolétariat et les paysans pauvres. Loin de commencer à dépérir, le nouvel État est en train d'envahir toute la société. Loin de se plier à la volonté de la classe révolutionnaire, il est devenu le point central d'une sorte de dégénérescence et de contre-révolution internes. Dans le même temps, les soviets se vident de leur vie. Les soviets ouvriers sont transformés en appendices des syndicats dans la gestion de la production. Ainsi, la force qui avait fait la révolution et aurait dû garder son contrôle sur celle-ci perdait son expression politique autonome et organisée. Le vecteur de la contre-révolution n'a été ni plus ni moins que l'État et, plus la révolution était en difficulté, plus le pouvoir de la classe ouvrière était affaibli et plus l'État-Commune manifestait sa nature non prolétarienne, son côté conservateur, voire réactionnaire. Nous allons nous expliquer sur cette caractérisation.
De Marx, Engels à l'expérience russe : la convergence vers une même caractérisation de l'État de la période de transition
Ce serait une erreur que de s'arrêter définitivement à la formulation de Marx de la Critique du programme de Gotha, concernant la caractérisation de l'État de la période de transition, identifié à la dictature du prolétariat. En effet, il existe d'autres caractérisations de l'État faites par Marx et Engels eux-mêmes, plus tard par Lénine et ensuite par la Gauche communiste, qui contredisent dans le fond la formule "État-Commune = dictature du prolétariat" pour converger vers l'idée d'un État conservateur par nature, y inclus l'État-Commune de la période de transition.
L'État de transition est l'émanation de la société et non pas du prolétariat
Comment explique-t-on le surgissement de l'État ? À ce propos, Engels ne laisse aucune ambiguïté : "L'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel 18. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État." 19 Lénine reprend à son compte ce passage d'Engels en le citant, dans L'État et la révolution. Malgré tous les aménagements apportés par le prolétariat à l'État-Commune de transition, celui-ci conserve en commun, avec tous les États des sociétés de classes du passé, le fait d'être un organe conservateur au service du maintien de l'ordre dominant, c'est-à-dire celui des classes économiquement dominantes. Ceci a des implications, au niveau théorique et pratique, concernant les questions suivantes : qui exerce le pouvoir durant la société de transition, l'État ou le prolétariat organisé en conseils ouvriers ? Qui est la classe économiquement dominante de la société de transition ? Quel est le moteur de la transformation sociale et du dépérissement de l'État ?
L'État de transition ne peut, par nature, être au service des seuls intérêts de classe du prolétariat
Là où le pouvoir politique de la bourgeoisie a été renversé, les rapports de production demeurent des rapports capitalistes, même si la bourgeoisie n'est plus là pour s'approprier la plus-value produite par la classe ouvrière. Le point de départ de la transformation communiste a pour condition la défaite militaire de la bourgeoisie dans un nombre suffisant de pays déterminants permettant de donner l'avantage politique à la classe ouvrière au niveau mondial. C'est la période pendant laquelle se développent lentement les bases du nouveau mode de production, au détriment de l'ancien, jusqu'à le supplanter et constituer le mode de production dominant.
Après la révolution et tant que n'aura pas été réalisée la communauté humaine mondiale, c'est-à-dire tant que l'immense majorité de la population mondiale n'aura pas été intégrée au sein du travail libre et associé, c'est le prolétariat qui demeure la classe exploitée. Ainsi, contrairement aux classes révolutionnaires du passé, le prolétariat n'est pas destiné à devenir la classe économiquement dominante. C'est la raison pour laquelle, même si l'ordre établi après la révolution n'est plus celui de la domination politique et économique de la bourgeoisie, l'État, qui surgit pendant cette période en tant que garant du nouvel ordre économique, ne peut pas être intrinsèquement au service du prolétariat. C'est au contraire à ce dernier qu'il appartient de le contraindre dans le sens de ses intérêts de classe.
Le rôle de l'État de transition : intégration de la population non exploiteuse dans la gestion de la société et lutte contre la bourgeoisie
Dans L'État et la révolution, Lénine lui-même dit que le prolétariat a besoin de l’État, non seulement pour supprimer la résistance de la bourgeoisie, mais aussi pour mener le reste de la population non exploiteuse dans la direction socialiste : "Le prolétariat a besoin du pouvoir d'État, d'une organisation centralisée de la force, d'une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population — paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires — dans la "mise en place" de l'économie socialiste" 20.
Nous soutenons ce point de vue de Lénine selon lequel, pour renverser la bourgeoisie, le prolétariat doit pouvoir entraîner derrière lui l'immense majorité de la population pauvre et opprimée, au sein de laquelle il peut être lui-même minoritaire. Il n'existe pas d'alternative à une telle politique. Comment s'est-elle concrétisée dans la révolution russe ? Pendant celle-ci surgirent deux types de soviets : d'une part, les soviets basés essentiellement sur les lieux de production et regroupant la classe ouvrière, appelés encore conseils ouvriers ; d'autre part, les soviets basés sur des unités territoriales (les soviets territoriaux) dans lesquels participaient activement toutes les couches non exploiteuses à la gestion locale de la société. Les conseils ouvriers organisaient l'ensemble de la classe ouvrière, c'est-à-dire la classe révolutionnaire. Les soviets territoriaux 21, quant à eux, élisaient des délégués révocables destinés à faire partie de l'État-Commune 22, ce dernier ayant pour fonction la gestion de la société dans son ensemble. En période révolutionnaire, l'ensemble des couches non exploiteuses, tout en étant pour le renversement de la bourgeoisie et contre la restauration de sa domination, ne sont pas pour autant acquises à l'idée de la transformation socialiste de la société. Elles peuvent même y être hostiles. En effet, au sein de celles-ci, la classe ouvrière est souvent très minoritaire. C'est la raison pour laquelle, en Russie, des mesures avaient été prises dans le mode d'élection des délégués pour renforcer le poids de la classe ouvrière au sein de l'État-Commune : 1 délégué pour 125 000 paysans, 1 délégué pour 25 000 ouvriers des villes. Il n'en demeure pas moins que la nécessité de mobiliser la population largement paysanne contre la bourgeoisie et de l'intégrer dans le processus de gestion de la société donna naissance, en Russie, à un État qui n'était pas seulement constitué des délégués ouvriers des soviets, mais aussi de délégués de soldats et de paysans pauvres.
Les mises en garde du marxisme contre l'État, fût-il de la période de transition
Dans son introduction de 1891 à La Guerre civile en France et rédigée à l'occasion du 20e anniversaire de la Commune de Paris, Engels ne craint pas de mettre en évidence des traits communs à tous les États, qu'ils soient de classiques États bourgeois ou l'État-Commune de la période de transition : "Mais, en réalité, l'État n'est rien d'autre qu'un appareil pour opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État." 23 Considérer l'État comme un "mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe" est une idée qui se situe parfaitement dans le prolongement du fait que l'État est une émanation de la société (L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État), et non du prolétariat révolutionnaire. Et cela a de lourdes implications quant aux relations nécessaires entre cet État et la classe révolutionnaire. Même si celles-ci ne purent pas être complètement clarifiées avant la Révolution russe, Lénine saura s'en inspirer à travers une forte insistance, dans L'État et la révolution, sur la nécessité que les ouvriers soumettent tous les membres de l’État à une supervision et à un contrôle constant, en particulier les éléments de l’État qui incarnent avec le plus d'évidence une certaine continuité avec l'ancien régime, tels les "experts" techniques et militaires que les soviets seront forcés d'utiliser.
Lénine élabore également un fondement théorique concernant cette nécessité d'une attitude de méfiance saine du prolétariat envers le nouvel État. Dans le chapitre intitulé "Les bases économiques de l'extinction de l'État", il explique que, vu que son rôle sera de sauvegarder à certains égards la situation de "droit bourgeois", on peut définir 1’État de transition comme "l’État bourgeois, sans la bourgeoisie !" 24. Même si cette formulation représente plus un appel à la réflexion qu'une claire définition de la nature de classe de l’État de transition, Lénine a saisi l'essentiel : puisque la tâche de 1’État est de sauvegarder un état de choses qui n'est pas encore communiste, 1’État-Commune révèle sa nature fondamentalement conservatrice et c'est ce qui le rend particulièrement vulnérable à la dynamique de la contre-révolution.
Une intervention de Lénine en 1920-21 mettant en avant la nécessité pour les ouvriers de pouvoir se défendre contre l'État
Ces perceptions théoriques ont certainement favorisé une certaine lucidité de Lénine, à propos de la nature de l'État en Russie, lors du débat de 1920-21 sur les syndicats 25. Il s'opposait en particulier à Trotsky, alors partisan de la militarisation du travail et pour qui le prolétariat devait s'identifier à "l'État prolétarien" et même s'y subordonner. Bien que lui-même ait été pris dans le processus de dégénérescence de la révolution, Lénine défend alors la nécessité pour les ouvriers de maintenir des organes de défense de leurs intérêts 26, même contre l’État de transition, de même qu'il renouvelle ses avertissements sur la croissance de la bureaucratie d’État. C'est dans les termes suivants qu'il pose le cadre de la question dans un discours à une réunion de délégués communistes à la fin de 1920 : "(…) le camarade Trotsky (…) prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotsky parle d'un "État ouvrier". Mais c'est une abstraction. Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, c'était normal ; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : "Pourquoi défendre la classe ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier", on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une des principales erreurs du camarade Trotsky. (...) En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. De nombreuses conséquences en découlent. (Boukharine : "Comment ? Ouvrier-paysan ?") Et bien que le camarade Boukharine crie derrière : "Comment ? Ouvrier -paysan ?", je ne vais pas me mettre à lui répondre sur ce point. Que ceux qui en ont le désir se souviennent du Congrès des Soviets qui vient de s'achever ; il a donné la réponse.
Mais ce n'est pas tout. Le programme de notre parti, document que l'auteur de L'ABC du communisme connaît on ne peut mieux, ce programme montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique.(...) Notre État est tel aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État, et pour que les ouvriers défendent notre État." 27
Nous considérons cette réflexion lumineuse et de la plus haute importance. Lui-même happé dans la dynamique dégénérescente de la révolution, Lénine n'a malheureusement pas été en mesure de lui donner suite en l'approfondissant (au contraire de cela, il reviendra sur sa caractérisation d'État ouvrier-paysan). Par ailleurs, cette intervention n'a pas été à même de susciter (surtout du propre fait de Lénine lui-même), une réflexion et un travail commun avec l'Opposition ouvrière menée par Kollontaï et Chliapnikov, laquelle exprimait à l'époque une réaction prolétarienne à la fois contre les théorisations bureaucratiques de Trotsky et contre les véritables distorsions bureaucratiques qui étaient en train de ronger le pouvoir prolétarien. Néanmoins, cette précieuse réflexion n'a pas été perdue pour le prolétariat. En effet, comme nous l'avons signalé précédemment, elle a constitué le point de départ d'une réflexion plus approfondie sur la nature de l'État de la période de transition menée par la Gauche communiste d'Italie que celle-ci a pu transmettre aux générations suivantes de révolutionnaires.
C'est le prolétariat et non l'État qui est la force de transformation révolutionnaire de la société
Une des idées fondamentales du marxisme c'est que la lutte de classe constitue le moteur de l'histoire. Ce n'est évidemment pas par hasard que cette idée est exprimée dès la première phrase, juste après l'introduction, du Manifeste communiste : "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe" 28. Ce n'est donc pas l'État qui peut jouer ce rôle de moteur puisque sa fonction historique est justement d'"estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"" (L'origine de la famille, …). Cette caractéristique de l'État des sociétés de classes, s'applique encore à la société de transition, où c'est la classe ouvrière qui demeure la force révolutionnaire. Déjà Marx, à propos de la Commune de Paris, avait clairement distingué d'une part la force révolutionnaire du prolétariat et d'autre part l'État-Commune : "... la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe... mais elle crée l'ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine." 29
La caractéristique du prolétariat après la révolution, à la fois classe dominante politiquement et encore exploitée sur le plan économique, fait que c'est à la fois sur le plan économique et sur le plan politique que, par essence, État-Commune et dictature du prolétariat sont antagoniques :
-
c'est en tant que classe exploitée que le prolétariat doit défendre ses "intérêts matériels et moraux" (comme le dit Lénine) contre la logique économique de l'État-Commune, représentant de la société dans son ensemble à un instant donné ;
-
c'est en tant que classe révolutionnaire que le prolétariat doit défendre ses orientations politiques et pratiques en vue de transformer la société contre le conservatisme social de l'État et ses tendance à l'autoconservation en tant qu'organe qui, selon Engels "se place au-dessus [de la société] et lui devient de plus en plus étranger" (L'origine de la famille, …)
Afin de pouvoir assumer sa mission historique de transformation de la société pour en finir avec toute domination économique et politique d'une classe sur une autre, la classe ouvrière assume sa domination politique sur l'ensemble de la société à travers le pouvoir international de conseils ouvriers, le monopole du contrôle des armes et le fait qu'elle est la seule classe de la société qui soit armée en permanence. Sa domination politique s'exerce également sur l'État. Ce pouvoir de la classe ouvrière est par ailleurs inséparable de la participation effective et illimitée des immenses masses de la classe, de leur activité et organisation et il prend fin lorsque tout pouvoir politique devient superflu, lorsque le classes ont disparu.
Conclusion
Nous espérons avoir répondu de la façon la plus argumentée possible aux critiques que notre position sur l'État dans la période de transition a suscitées chez OPOP. Nous sommes bien conscients de n'avoir pas répondu spécifiquement à un certain nombre d'objections concrètes et explicites (par exemple, "les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux".). Si nous ne l'avons pas fait cette fois-ci, c'est parce qu'il nous apparaissait nécessaire de présenter en priorité les grandes lignes historiques et théoriques de notre cadre d'analyse et que, très souvent, celles-ci constituaient une réponse implicite aux objections de OPOP. Nous pourrons y revenir, si nécessaire, dans un prochain article.
Enfin, nous pensons que, pour être essentielle, cette question de l'État dans la période de transition n'est pas la seule dont la clarification théorique et pratique ait pu avancer considérablement suite à l'expérience de la Révolution russe : il en est ainsi également de la question du rôle et de la place du parti prolétarien. Son rôle est-il l'exercice du pouvoir, sa place était-elle au sein de l'État, au nom de la classe ouvrière ? Non, pour nous, il s'agit là d'erreurs qui ont contribué à la dégénérescence du Parti bolchevik. Nous espérons également pouvoir revenir sur cette question dans un prochain débat avec OPOP.
Silvio (9/8/2012)
1 OPOP, Oposição Operária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [267]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [268]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 "L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire) [344]", Revue internationale n° 148.
3 Note présente dans le passage cité de l'Anti-Dühring : "L'État populaire libre, revendication inspirée de Lassalle et adoptée au congrès d'unification de Gotha, a fait l'objet d'une critique fondamentale de Marx dansla Critique du programme de Gotha."
4 Friedrich Engels, Anti-Dühring. Troisième partie : Socialisme. Chapitre II : Notions théoriques. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1878/06/fe18780611.htm [345]
5 Lénine. L'État et la révolution. Chapitre IV : Suite. Explications complémentaires d'Engels. 2. Polémique avec les anarchistes. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [271].
6 Karl Marx. Critique du programme du Parti ouvrier allemand. Partie IV, Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1429..
7 Gauche communiste italienne. De la même manière que le développement de l’opportunisme de la Seconde Internationale avait suscité une réponse prolétarienne sous la forme de courants de gauche, la montée de l'opportunisme dans la Troisième Internationale allait rencontrer la résistance de la gauche communiste. La gauche communiste était essentiellement un courant international et avait des expressions dans de nombreux pays, depuis la Bulgarie jusqu’à la Grande-Bretagne et des États-Unis à l’Afrique du Sud. Mais ses représentants les plus importants allaient se trouver précisément dans ces pays où la tradition marxiste était la plus forte : l’Allemagne, l’Italie et la Russie. En Italie, la gauche communiste – qui était au début majoritaire au sein du Parti communiste d’Italie – avait une position particulièrement claire sur la question de l'organisation. Cela lui a permis non seulement de mener une bataille courageuse contre l’opportunisme au sein de l’Internationale dégénérescente, mais aussi de donner naissance à une fraction communiste qui a été capable de survivre au naufrage du mouvement révolutionnaire et de développer la théorie marxiste pendant les sombres années de la contre-révolution. Au début des années 1920, ses arguments en faveur de l’abstentionnisme vis à vis des parlements bourgeois, contre la fusion de l’avant-garde communiste avec de grands partis centristes pour donner l’illusion "d’une influence sur les masses", contre les mots d’ordre de front unique et de "gouvernement ouvrier" étaient déjà fondés sur une profonde assimilation de la méthode marxiste. Pour d'avantage d'informations lire "La Gauche Communiste et la continuité du marxisme". https://fr.internationalism.org/icconline/1998/gauche-communiste [112].
8 Lire à ce propos notre article "L'État et la révolution, une vérification éclatante du marxisme" au sein de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [2° partie]". Revue Internationale n° 91. https://fr.internationalism.org/french/rint91/communisme.htm [173]. Beaucoup des thèmes abordés dans notre réponse à OPOP, sont développés plus largement dans cet article.
9 Le Manifeste communiste. "II. Prolétaires et communistes". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 181-182.
10 Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Chapitre VII Éd. La Pléiade, Politique I, p. 531.
11 L'État et la révolution. Chapitre III : L'expérience de la Commune de Paris. "1. En quoi la tentative des communards est-elle héroïque". En fait, l'expression ici utilisée par Lénine est une adaptation de paroles de Marx dans une lettre à Bracke du 5 mai 1875 à propos du programme de Gotha : "Un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes". Critique du programme Parti ouvrier allemand. " Marx à W. Bracke". Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1411.
12 Préface à la réédition allemande de 1872 du Manifeste communiste. Éd. La Pléiade, Économie I, Appendice V, p. 1481.
13 Idem
14 L'État et la révolution chapitre III. Idem.
15 Cf. "L'État dans la période de transition au communisme (débat dans le milieu révolutionnaire)". Revue internationale n° 148. https://fr.internationalism.org/rint148/l_État_dans_la_periode_de_transition_au_communisme_debat_dans_le_milieu_revolutionnaire.html [344]
16 L'État et la révolution. Chapitre V : les bases économiques de l'extinction de l'État. "3. Première phase de la société communiste."
17 Cette expression est extraite de la phrase suivante : "Une fois les capitalistes renversés, la résistance de ces exploiteurs matée par la main de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucratique de l'État actuel brisée, nous avons devant nous un mécanisme admirablement outillé au point de vue technique, affranchi de "parasitisme", et que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre en marche eux-mêmes en embauchant des techniciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant leur travail à tous, de même que celui de tous les fonctionnaires "publics", par un salaire d'ouvrier". L'État et la révolution. Chapitre III : L'État et la révolution. L'expérience de la Commune de Paris (1871). Analyse de Marx. "3. Suppression du parlementarisme"
18 Note présente dans le passage cité de L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État : "Hegel: Principes de la Philosophie du droit, §§ 257 et 360."
19 L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. IX : Barbarie et civilisation. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1884/00/fe18840000.htm [346]
20 L'État et la révolution chapitre II : l'expérience des années 1848-1851.
21 Dans notre série de 5 articles de la Revue internationale, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers", nous mettons en évidence les différences sociologiques et politiques entre les conseils ouvriers et les soviets territoriaux. Les conseils ouvriers sont les conseils d'usine. À côté de ceux-ci on trouve également des conseils de quartier, ces derniers intégrant les travailleurs des petites entreprises et des commerces, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les familles qui faisaient partie de la classe ouvrière comme un tout. Les conseils d'usine et de quartiers (ouvriers) jouèrent un rôle décisif à différents moments du processus révolutionnaire (voire à ce propos les articles de la série publiés dans les Revue internationale n° 141 et 142). Ce n'est donc pas un hasard si, avec le processus de dégénérescence de la révolution, les conseils d'usine disparurent fin 1918 et les conseils de quartier fin 1919. Les syndicats eurent un rôle décisif dans la destruction de ces derniers (voire à ce propos l'article de la Revue n° 145).
22 Participèrent en fait aussi à cet État, de façon de plus en plus importante, des experts, des dirigeants de l'Armée rouge et de la Tcheka, etc.
23 F. Engels, introduction de 1891 à La Guerre civile en France. Avant-dernier paragraphe. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/03/fe18910318.htm [347]
24 Le contexte de cette expression extraite du texte de Lénine est le suivant :
"Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu'est le maintien de l'"horizon borné du droit bourgeois", en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un État bourgeois, car le droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes.
Il s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l'État bourgeois — sans bourgeoisie !" (Chapitre 5. "4. Phase supérieure de la société communiste")
25 Lire en particulier à ce propos notre article "Comprendre la défaite de la révolution russe" dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire" (Revue internationale n° 100). https://fr.internationalism.org/french/rint/100_communisme_ideal [348]
26 Il s'agit ici des syndicats qui sont alors considérés, par tous les points de vue en présence, comme d'authentiques défenseurs des intérêts du prolétariat. Cela s'explique par les conditions d'arriération de la Russie, la bourgeoisie n'ayant pas développé un appareil d'État sophistiqué capable de reconnaître la valeur des syndicats en tant qu'instruments de la paix sociale. De ce fait, tous les syndicats qui s'étaient formés avant et même pendant la révolution de 1917, n'étaient pas nécessairement des organes de l'ennemi de classe. Il y a eu notamment une forte tendance à la création de syndicats industriels qui exprimaient toujours un certain contenu prolétarien.
27 "Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky", 30 décembre 1920. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/12/vil19201230.htm [186]
28 Le Manifeste communiste. "I. Bourgeois et Prolétaires". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 161.
29 La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 217.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
- Période de transition [273]
Rubrique:
À propos du livre Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était (I): le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la culture
- 5034 lectures
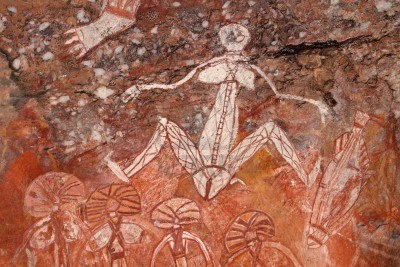 Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
C'est pour cette raison qu'on ne peut que saluer la publication en 2009 d'un livre intitulé Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était par Christophe Darmangeat ; de même, on ne peut qu’être encouragé par le fait que le livre en soit déjà à sa deuxième édition, ce qui indique un intérêt certain pour le sujet parmi le public.1 À travers une lecture critique de ce livre, nous chercherons dans cet article à revenir sur les problèmes posés par la question des premières sociétés humaines ; nous profiterons aussi de l'occasion pour explorer les thèses exposées il y a maintenant plus de 20 ans par Chris Knight 2 dans son livre Blood Relations 3.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons d'abord une chose : la question de la nature du communisme primitif, et de l'humanité en tant qu'espèce, sont des questions non pas politiques mais scientifiques. Dans ce sens, il ne peut y avoir de "position" de la part d'une organisation politique au sujet de la nature humaine, par exemple. Si nous sommes convaincus que l'organisation communiste doit stimuler le débat et la soif de connaissance pour les questions scientifiques parmi ses militants et plus généralement au sein du prolétariat, le but est d'encourager le développement d'une vision matérialiste et scientifique du monde basée autant que possible, pour les non scientifiques que nous sommes pour la plupart, sur une connaissance des théories scientifiques modernes. Les idées présentées dans cet article ne sont donc pas des "positions" du CCI et n'engagent que l'auteur. 4
Pourquoi la question des origines est-elle importante ?
Pourquoi donc la question des origines de l'espèce et des premières sociétés humaines est-elle importante pour les communistes ? Les termes du problème ont sensiblement changé depuis le 19e siècle lorsque Marx et Engels s'enthousiasmèrent pour les travaux de l'anthropologue américain Lewis Morgan. En 1884, quand Engels publie L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, on était à peine sorti d'une époque où les estimations de l'âge de la Terre et de la société humaine se basaient sur les calculs bibliques de l'évêque Ussher, pour qui la Création avait eu lieu en 4004 avant J.-C. Engels écrit dans sa Préface de 1891 : "Jusqu'en 1860 environ, il ne saurait être question d'une histoire de la famille. Dans ce domaine, la science historique était encore totalement sous l'influence du Pentateuque. La forme patriarcale de la famille, qui s'y trouve décrite avec plus de détails que partout ailleurs, n'était pas seulement admise comme la plus ancienne, mais, déduction faite de la polygamie, on l'identifiait avec la famille bourgeoise actuelle, si bien qu'à proprement parler la famille n'avait absolument pas subi d'évolution historique." 5 Il en était de même pour les notions de propriété, et la bourgeoisie pouvait encore opposer au programme communiste de la classe ouvrière l'objection selon laquelle la "propriété privée" était inscrite dans la nature même de la société humaine. L'idée de l'existence d'un état communiste primitif de la société était à ce point inconnue en 1847 que le Manifeste Communiste commence son premier chapitre par les mots "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de luttes de classes." (affirmation qu'Engels a estimé nécessaire de rectifier dans une note en 1888).
Le livre de Morgan, Ancient Society, a largement contribué à démanteler la vision ahistorique de la société humaine éternellement basée sur la propriété privée, même si son apport a été souvent escamoté ou passé sous silence par l'anthropologie officielle, notamment anglaise. Comme le dit Engels, encore dans sa Préface, "Morgan dépassa la mesure non seulement en critiquant la civilisation, la société de la production marchande, forme fondamentale de notre société actuelle, d'une façon qui rappelle Fourier, mais aussi en parlant d'une transformation future de cette société en termes qu'aurait pu énoncer Karl Marx".
Aujourd'hui en 2012, la situation a bien changé. Les découvertes successives ont repoussé encore et encore plus loin dans le passé les origines de l'Homme, si bien que maintenant nous savons que non seulement la propriété privée n'est pas un fondement éternel de la société mais qu'elle est, au contraire, une invention relativement récente puisque l'agriculture - et donc la propriété privée et la division de la société en classes - ne datent que de 10 000 ans environ. Certes, comme Alain Testart l'a montré dans son livre Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités, la formation des classes et des richesses ne s'est pas faite en une nuit ; il a dû s’écouler une longue période avant l'émergence de l'agriculture proprement dite où le développement du stockage a favorisé l'émergence d'une répartition inégale des richesses accumulées. Néanmoins, il est clair aujourd'hui que la partie de loin la plus longue de l'histoire humaine n'est pas celle de la lutte des classes, mais d'une société sans classes, communiste : c'est ce qu'on appelle le communisme primitif.
L'objection qu'on entend aujourd'hui à l'idée d'une société communiste n'est donc plus qu'elle violerait les principes éternels de propriété privée mais, plutôt, qu'elle serait contraire à "la nature humaine". "On ne peut changer la nature humaine" dit-on, et par cela on veut dire la nature prétendument violente, compétitive et égocentrique de l’Homme. L'ordre capitaliste ne serait donc plus éternel, mais seulement le résultat logique et inévitable d'une nature immuable. Cette argumentation n'est pas limitée à des idéologues de droite. Des scientifiques humanistes, en pensant suivre la même logique d'une nature humaine déterminée par la génétique, en arrivent à des conclusions similaires. Le New York Review of Books (journal intellectuel plutôt orienté à gauche) nous en donne un exemple dans un numéro d'octobre 2011 : "Les êtres humains se font concurrence pour les ressources, l'espace vital, les partenaires sexuels, et presque tout le reste. Chaque être humain se trouve au sommet d'une lignée de concurrents ayant réussi, qui remonte jusqu'aux origines de la vie. La pulsion compétitive entre dans pratiquement tout ce que nous faisons, qu'on le reconnaisse ou non. Et les meilleurs concurrents sont souvent les mieux remerciés. Il suffit de regarder Wall Street pour en trouver un exemple flagrant (...) Le dilemme humain de surpopulation et surexploitation des ressources est fondamentalement déterminé par les impulsions primordiales qui ont permis à nos ancêtres d'atteindre un succès reproductif au-dessus de la moyenne". 6
Cet argument peut sembler a priori inattaquable : on n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples à ne plus en finir de la cupidité, de la violence, de la cruauté et de l'égoïsme dans la société humaine de nos jours ou dans son histoire. Mais est-ce que cela prouve que ces tares sont le résultat d'une nature déterminée - dirait-on aujourd'hui – génétiquement ? Rien n'est moins sûr. Pour faire une analogie, un arbre qui pousse sur une falaise balayée par le vent marin risque fort de pousser chétif et tordu : ce n'est pas pour autant que ce qui apparaît ainsi de sa structure soit intégralement inscrit dans ses gènes - dans des conditions plus favorables l'arbre pousserait droit.
Peut-on en dire de même pour les êtres humains ?
C'est une évidence, souvent relevée dans nos articles, que la résistance du prolétariat mondial est bien en deçà du niveau des attaques qu'il subit de la part d'un capitalisme en crise. La révolution communiste n'a peut-être jamais semblé aussi nécessaire et, en même temps, aussi difficile. Et l’une des raisons en est certainement, à notre avis, le fait que les prolétaires manquent de confiance non seulement dans leurs propres forces mais dans la possibilité même du communisme. "Une belle idée", nous dit-on, "mais vous savez, la nature humaine"...
Pour prendre confiance en lui, le prolétariat doit affronter non seulement les problèmes immédiats de la lutte mais aussi les problèmes plus vastes, historiques, posés par la confrontation révolutionnaire potentielle avec la classe dominante. Parmi ces problèmes, il y a précisément celui de la nature humaine ; et nous devons traiter ce problème avec un esprit scientifique. Il ne s'agit pas de prouver que l'Homme est "bon", mais d'arriver à une meilleure compréhension de quelle est précisément sa nature, de façon à pouvoir intégrer cette connaissance dans le projet politique du communisme. Ainsi, nous ne faisons pas dépendre le projet communiste de la "bonté naturelle" de l'Homme : le besoin du communisme est aujourd'hui inscrit dans les données de la société capitaliste comme seule solution au blocage de la société, qui amènera sans nul doute l'humanité à un avenir catastrophique si le capitalisme n'est pas renversé par la révolution communiste.
Méthode scientifique
Le passage qui précède nous amène, avant d'entrer dans le vif du sujet, à quelques considérations sur la méthode scientifique et, plus particulièrement, la méthode scientifique appliquée à l'étude de l'histoire et du comportement humain. Un passage situé au début du livre de Knight, relatif à la place de l'anthropologie dans les sciences, nous semble poser la question très justement : "Plus que tout autre domaine de connaissance, l'anthropologie prise dans son ensemble enjambe le gouffre qui a traditionnellement divisé les sciences naturelles et humaines. En puissance, sinon toujours en pratique, elle occupe donc une place centrale parmi les sciences dans leur ensemble. Les éléments cruciaux qui, s'ils pouvaient seulement être rassemblés, pourraient relier les sciences naturelles aux sciences humaines, traversent l'anthropologie plus que tout autre domaine. C'est ici que les deux bouts se rejoignent ; ici que l'étude de la nature prend fin, et que celle de la culture commence. À quel moment de l'évolution est-ce que les principes biologiques ont laissé la place à de nouveaux principes dominants, plus complexes ? Où, précisément, se trouve la ligne de partage entre la vie animale et la vie sociale ? La différence est-elle de nature, ou seulement de degré ? Et, à la lumière de cette question, est-il réellement possible d'étudier les phénomènes humains avec la même objectivité désintéressée dont un astronome peut faire preuve envers des galaxies, ou un physicien envers des particules subatomiques ?
Si ce domaine des rapports entre les sciences semble confus pour beaucoup, ce n'est qu'en partie à cause des difficultés réelles que cela implique. À un bout, la science est enracinée dans la réalité objective mais, à l'autre, elle est enracinée dans la société et en nous-mêmes. En fin de compte, c'est pour des raisons sociales et idéologiques que la science moderne, fragmentée et distordue par des pressions politiques immenses et pourtant largement non reconnues, a rencontré son plus grand problème et son plus grand défi théorique : réunir les sciences humaines et les sciences naturelles en une seule science unifiée sur la base d'une compréhension de l'évolution de l'humanité, et de la place de cette dernière dans l'univers." (pp. 56-57).
La question de la "ligne de partage" entre le monde animal non-humain où le comportement est déterminé surtout par le patrimoine génétique, et le monde humain où le comportement dépend beaucoup plus de l'environnement, notamment social et culturel, nous semble effectivement la question cruciale pour comprendre la "nature humaine". Les grands singes sont capables d'apprendre, d'inventer et de transmettre, jusqu'à un certain point, des comportements nouveaux, mais cela ne veut pas dire qu'ils possèdent une "culture" au sens humain du terme. Ces comportements appris restent "périphériques à la continuité sociale et structurelle du groupe" (ibid., p. 11). 7 Ce qui a permis à la culture de prendre le dessus, dans une "explosion créative" (ibid., p. 12), c'est le développement de la communication entre groupes humains, le développement d'une culture symbolique basée sur le langage et le rite. Knight fait par ailleurs la comparaison entre la culture symbolique et le langage, qui ont permis aux humains de communiquer et de transmettre les idées et donc la culture de manière universelle, et la science, qui est basée sur un symbolisme ayant rencontré un accord universel entre scientifiques au niveau de la planète et, potentiellement au moins, entre tous les êtres humains. La pratique de la science est inséparable du débat, et de la capacité de chacun de vérifier les conclusions auxquelles elle arrive ; elle est donc l'ennemi de toute forme d'ésotérisme qui ne vit que par la connaissance secrète, fermée aux non-initiés.
Parce qu'elle est une forme de connaissance universelle, que depuis la Révolution industrielle elle est également une force productive à part entière nécessitant le travail associé de scientifiques dans le temps et l'espace,8 la science dépasse le cadre national par nature et, en ce sens, le prolétariat et la science sont des alliés naturels.9 Cela ne veut absolument pas dire qu'il puisse exister une "science prolétarienne". Dans son article "Marxisme et science", Knight cite ces mots d'Engels : "plus la science avance de manière implacable et désintéressée, plus elle se trouve en harmonie avec les intérêts des ouvriers". Et Knight de poursuivre : "La science, en tant que seule forme de connaissance universelle, internationale, unificatrice de l'espèce, que l'humanité possède, doit venir en premier. Si elle doit s'enraciner dans les intérêts de la classe ouvrière, ce n'est que dans la mesure où elle doit s'enraciner dans les intérêts de l'humanité dans son ensemble, et dans la mesure où la classe ouvrière donne corps à ces intérêts dans l'époque actuelle."
Il y a deux autres aspects de la pensée scientifique, qui ont été mis en exergue dans le livre de Carlo Rovelli à propos du philosophe grec Anaximandre de Milet 10, et que nous reprenons ici car ils nous semblent fondamentaux : le respect pour les prédécesseurs et le doute.
Rovelli montre que l'attitude d'Anaximandre envers son maître Thalès a rompu avec les attitudes caractéristiques de son époque : soit un rejet total pour s'établir comme nouveau "maître" à la place de l'ancien, soit un dévouement à la lettre aux paroles du "maître" pour les maintenir à l'état momifié. L'attitude scientifique, au contraire, est de se baser sur les travaux des "maîtres" qui nous ont précédés tout en critiquant leurs erreurs et en cherchant à aller plus loin dans la connaissance. C'est cette attitude qu'on doit saluer chez Knight envers Lévi-Strauss, et chez Darmangeat envers Morgan.
Le doute - à l'inverse de la pensée religieuse qui cherche toujours la certitude et la consolation dans l'invariance d'une vérité établie à tout jamais - est fondamental pour la science. Comme le dit Rovelli 11, "La science offre les meilleures réponses justement parce qu’elle ne considère pas ses réponses comme certainement vraies ; c’est pourquoi elle est toujours capable d’apprendre, de recevoir de nouvelles idées". C'est tout particulièrement le cas de l'anthropologie et de la paléoanthropologie, dont les données sont éparses et souvent incertaines, et dont les théories les plus en vogue du moment peuvent se trouver remises en question, voire bouleversées, du jour au lendemain par de nouvelles découvertes.
Mais est-il possible d'avoir une vision scientifique de l'histoire ? Karl Popper 12, qui est une référence chez la plupart des scientifiques, pensait que non, puisqu'il considérait l'histoire comme un "événement" unique, non reproductible, et que la vérification d'une hypothèse scientifique dépendait de la reproductibilité des expériences ou des observations. Popper, pour les mêmes raisons, avait également considéré la théorie de l'évolution comme non scientifique de prime abord et, pourtant, il est aujourd'hui une évidence que la méthode scientifique a pu mettre à nu les mécanismes fondamentaux de l'évolution des espèces au point de permettre à l'humanité de manipuler le processus de l'évolution grâce au génie génétique. Sans suivre Popper, il est clair qu'utiliser la méthode scientifique pour faire des prévisions sur la base de l'étude de l'histoire reste un exercice fort hasardeux : d'un côté parce que l'histoire humaine - comme la météorologie par exemple - incorpore un nombre incalculable de variables, de l'autre, et surtout, parce que - comme le disait Marx - "les hommes font leur propre histoire" ; l'histoire est donc déterminée non seulement par des lois mais aussi par la capacité ou non des êtres humains de baser leurs actions sur la pensée consciente et la connaissance de ces lois. L'évolution de l'histoire reste toujours soumise à des contraintes : à un moment donné, certaines évolutions sont possibles, d'autres non. Mais la façon dont une situation donnée évoluera est aussi déterminée par la capacité des hommes de devenir conscients de ces contraintes et d'agir en conséquence.
Il est donc particulièrement hardi de la part de Knight d'accepter toute la rigueur exigée par la méthode scientifique, et de soumettre sa théorie à l'épreuve de l'expérience. Évidemment, il n'est pas possible de "reproduire" l'histoire expérimentalement. À partir de ses hypothèses sur les débuts de la culture humaine, Knight fait donc des prévisions (en 1991, date de la publication de Blood Relations) quant aux découvertes paléontologiques à venir : notamment qu'on trouverait parmi les traces les plus anciennes de la culture symbolique chez l'Homme une utilisation importante de l'ocre rouge. En 2006, 15 ans plus tard, il semblerait que ces prévisions aient été confirmées par les découvertes dans les cavernes de Blombos (Afrique du Sud) des premiers vestiges connus de la culture humaine (voir les travaux de la Conférence de Stellenbosch réunis dans The cradle of language, OUP, 2009, ou encore l'article publié sur le site web de La Recherche en novembre 2011)13 ; on y trouve de l’ocre rouge et également des collections de coquillages utilisés apparemment comme décoration corporelle, ce qui s'intègre dans le modèle évolutif proposé par Knight (nous y reviendrons plus loin). Évidemment, ceci ne constitue pas en soi une "preuve" de sa théorie mais il nous semble indéniable que cela lui donne une plus grande consistance.
Cette méthodologie scientifique est très différente de celle suivie par Darmangeat. Celui-ci, nous semble-t-il, reste cantonné dans la logique inductiviste, qui part d'un rassemblement de faits observés pour essayer d'en extraire les traits communs. La méthode n'est pas sans valeur pour l'étude historique et scientifique : toute théorie doit, après tout, se conformer aux faits observés. Darmangeat semble d'ailleurs très réticent vis-à-vis de toute théorie qui cherche à aller au-delà. Ceci nous paraît une démarche empiriste plutôt que scientifique : la science n'avance pas par induction à partir des faits observés, mais par hypothèses qui doivent certes être conformes aux observations, mais qui doivent également proposer une démarche (expérimentale si possible) à suivre pour avancer vers de nouvelles découvertes, donc de nouvelles observations. En physique, la théorie des cordes nous en offre un exemple éclatant : bien qu'en accord, autant que faire se peut, avec les faits observés, elle ne peut être vérifiée de façon expérimentale puisque les éléments dont elle postule l'existence sont inaccessibles de par leur petite taille aux appareils de mesure dont nous disposons aujourd'hui. La théorie des cordes reste donc une hypothèse spéculative, mais sans ce genre de spéculation hardie, il n'y aurait pas non plus d'avancée scientifique.
Un autre inconvénient de la méthode inductiviste est que, par la force des choses, elle doit opérer une sélection au préalable dans l'immensité de la réalité observée. C'est ce que fait Darmangeat lorsqu'il se base uniquement sur des observations ethnographiques en laissant de côté toute considération évolutionniste ou génétique, ce qui nous semble rédhibitoire dans une œuvre qui cherche à mettre au clair "l'origine de l'oppression des femmes" (le sous-titre du livre dont il est question).
Morgan, Engels et la méthode scientifique
Après ces considérations (bien modestes) sur la méthodologie, revenons maintenant au livre de Darmangeat qui a motivé cet article.
L’œuvre est divisée en deux parties : la première examine le travail de l'anthropologue Lewis Morgan sur lequel Engels a basé son Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État; la deuxième reprend la question que pose Engels à propos de l'origine de l'oppression des femmes. Dans cette deuxième partie, Darmangeat s'attaque surtout à l'idée de l'existence d'un communisme primitif, aujourd'hui disparu, qui aurait été basé sur le matriarcat.
La première partie du livre nous paraît particulièrement intéressante 14 et nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de l'auteur quand il s'insurge contre une certaine conception prétendument "marxiste" qui érige les travaux de Morgan (et a fortiori d'Engels) au statut de textes religieux intouchables. Rien ne pourrait être plus étranger à l'esprit scientifique du marxisme. Si les marxistes se doivent d'avoir une vision historique de l'émergence et du développement de la théorie sociale matérialiste, et donc de tenir compte des théories antérieures, il nous semble absolument évident que nous ne pouvons pas prendre des textes du 19e siècle comme le fin mot de l'histoire en ignorant l'accumulation impressionnante de connaissances ethnographiques réunies depuis. Certes, il convient de garder un esprit critique sur l'utilisation de ces connaissances : Darmangeat, tout comme Knight d'ailleurs, a bien raison d'insister sur le fait que la lutte contre les théories de Morgan est loin de la science "pure" et "désintéressée". Lorsque les adversaires contemporains et ultérieurs de Morgan signalaient les erreurs qu'il a commises ou lorsqu'ils mettaient en avant les découvertes qui ne cadraient pas avec sa théorie, le but n'était pas neutre en général. En s'attaquant à Morgan, on s'attaquait à la vision évolutionniste de la société humaine et on cherchait à rétablir ces catégories "éternelles" de la société bourgeoise que sont la famille patriarcale et la propriété privée comme les fondements de toute société humaine passée, présente et future. Ceci est parfaitement explicite chez Malinowski, un des plus grands ethnographes de la première moitié du 20e siècle, dont Knight (dans "Early Human Kinship was Matrilineal", publié dans Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction, 2008, Blackwell Publishing Ltd.15) cite les propos dans une émission radiodiffusée : "Je crois que l'élément le plus perturbateur des tendances révolutionnaires modernes est l'idée que la parentalité peut être rendue collective. Si jamais nous nous débarrassions de la famille individuelle comme élément essentiel de notre société, nous serions confrontés à une catastrophe sociale par rapport à laquelle les bouleversements politiques de la Révolution française et les changements économiques du bolchevisme seraient insignifiants. La question de savoir si la maternité de groupe a jamais existé comme institution, si elle est un arrangement compatible avec la nature humaine et l'ordre social, est donc d'un intérêt pratique considérable". Quand on fait dépendre ses conclusions sur le plan scientifique d’un parti pris politique, on est loin de l'objectivité scientifique...
Passons donc à la critique de Morgan faite par Darmangeat. Celle-ci est à notre sens d'un grand intérêt, ne serait-ce que parce qu'elle commence par un résumé assez détaillé de sa théorie, et qui rend cette dernière éminemment accessible pour un lecteur non expert. Nous avons particulièrement apprécié le tableau qui fait le rapprochement entre les stades de l’évolution sociale ("sauvagerie", "barbarie", etc.) définis par l'anthropologie de Morgan avec ceux utilisés aujourd'hui (paléolithique, néolithique, etc.), ce qui permet de mieux se situer dans le temps, et les diagrammes explicatifs des différents systèmes de parenté. Le tout est accompagné d'explications claires et didactiques.
Le fond de la théorie de Morgan est de relier type de famille, système de parenté et développement technique, dans une évolution progressive qui passe de "l’état sauvage" (première étape de l'évolution sociale humaine, qui correspondrait au paléolithique), à la "barbarie" (le néolithique et l'âge des métaux) et, enfin, à la civilisation. Cette évolution serait déterminée par l'évolution de la technique, et les contradictions apparentes que Morgan notait chez de nombreux peuples (dont les Iroquois en particulier) entre le système de parenté et le système familial, représenteraient justement des étapes intermédiaires entre d'une part une économie et une technique plus primitive et, d'autre part, une technique plus évoluée. Malheureusement pour la théorie, il se trouve en y regardant de plus près que ce n'est pas le cas. Pour ne prendre qu'un des multiples exemples que nous propose Darmangeat : le système "punaluen" de parenté qui est censé, d'après Morgan, représenter une des étapes sociales et techniques les plus primitives, se trouve à Hawaï ; c'est une société qui connaît richesses, inégalités sociales, une couche sociale aristocratique, et qui serait sur le point de passer le cap vers une société étatique. La famille, les systèmes de parenté y sont donc déterminés par des besoins sociaux, mais non pas en ligne droite depuis les plus primitifs jusqu’au plus modernes.
Est-ce que cela veut dire que l'évolutionnisme social marxiste est à jeter aux oubliettes ? Pas du tout, selon l'auteur. Par contre, il faut dissocier ce que Morgan, puis Marx et Engels après lui, avaient essayé d'associer : l'évolution de la technique (donc de la productivité) et les systèmes de famille. "Les modes de production, bien que différents d'un point de vue qualitatif, possèdent tous une quantité commune, la productivité, qui permet de les ordonner en une série croissante, qui se trouve de surcroît correspondre globalement à la chronologie (...) [Pour la famille] il n'existe aucune quantité à laquelle les différentes formes puissent être ramenées et à partir de laquelle on pourrait constituer une série croissante" (p. 136). Il est évident que l'économie est déterminante "en dernière instance", pour reprendre les termes d'Engels : s'il n'y avait pas d'économie (c'est à dire la reproduction de tout ce qui est nécessaire à la vie humaine), alors il n'y aurait pas de vie sociale non plus. Mais cette "dernière instance" laisse beaucoup de place aux autres influences, géographiques, historiques, culturelles, etc. Les idées, la culture - dans son sens le plus large - sont aussi des déterminants de l'évolution de la société. Et c'est Engels lui-même qui a regretté, vers la fin de sa vie, que la nécessité pour lui et pour Marx d'établir le matérialisme historique sur des bases sûres, et de se battre pour le défendre, les ait amenés parfois à laisser insuffisamment de place dans leurs analyses aux autres déterminants historiques.16
Critique de l'anthropologie
C'est dans la deuxième partie de son livre que Darmangeat expose ses propres réflexions. On y trouve, en quelque sorte, deux trames : d'une part, une critique historique des théories anthropologiques sur la position des femmes dans les sociétés primitives ; d’autre part, l'exposé de ses propres conclusions sur le sujet. Cette critique historique est axée autour de l'évolution de ce que Darmangeat considère être la vision marxiste, ou au moins marxisante, du communisme primitif, du point de vue de la place des femmes dans la société primitive, et constitue une dénonciation en règle des tentatives de mettre en avant une vision "féministe" qui cherche à défendre l'idée d'un matriarcat originel dans les premières sociétés humaines.
Le choix se défend mais, à notre avis, il n'est pas toujours heureux et amène l'auteur à ignorer certains théoriciens du marxisme qui auraient dû y avoir leur place, et à en inclure d'autres qui n'y ont rien à faire. Pour ne prendre que quelques exemples, Darmangeat consacre plusieurs pages à critiquer les idées d'Alexandra Kollontaï17, alors qu'il passe Rosa Luxemburg quasiment sous silence. Or, quel qu'ait pu être son rôle dans la Révolution russe et dans la résistance à sa dégénérescence (elle était une figure importante de l'Opposition ouvrière après la révolution), Kollontaï n'a jamais joué un rôle important dans le développement de la théorie marxiste, et encore moins dans l'anthropologie. Luxemburg, par contre, était non seulement une théoricienne de premier plan, elle est également l'auteur de l’Introduction à l'économie politique qui accorde une place importante à la question du communisme primitif en se basant sur les connaissances de l'époque. Le seul motif qui justifie ce déséquilibre est que Kollontaï a été très engagée, au sein du mouvement socialiste puis dans la Russie soviétique, dans la lutte pour les droits des femmes, alors que Luxemburg ne s'est jamais intéressée de près au féminisme. Deux autres auteurs marxistes qui ont écrit sur le thème des sociétés primitives ne sont même pas évoqués : Karl Kautsky (L'éthique et la conception matérialiste de l'histoire), et Anton Pannekoek (Anthropogenèse).
Du côté des "inclusions" malheureuses, prenons par exemple, celle d'Evelyn Reed : ce membre du Socialist Workers' Party américain (organisation trotskiste qui a soutenu de façon "critique" la participation à la Seconde Guerre mondiale) trouve sa place dans l'œuvre pour avoir écrit en 1975 un livre à succès dans les milieux de gauche, Féminisme et anthropologie. Mais comme le dit Darmangeat, le livre a été ignoré quasi-systématiquement par les anthropologues, en grande partie à cause de la faiblesse de son argumentation, soulignée même par des critiques bienveillantes par ailleurs.
Mêmes absences parmi les anthropologues : Claude Lévi-Strauss, une des figures les plus importantes du 20e siècle dans ce domaine, et qui a basé sa théorie du passage de la nature à la culture sur la notion de l'échange de femmes entre les hommes18, n'est mentionné qu’en passant, et Bronislaw Malinowski n'y figure pas du tout.
L'absence la plus surprenante, peut-être, est celle de Knight. Le livre de Darmangeat est axé tout particulièrement sur la situation des femmes dans les sociétés communistes primitives et sur la critique des théories se trouvant dans une certaine tradition marxiste, ou du moins marxisante, sur le sujet. Or, Blood Relations de Chris Knight, qui se revendique explicitement de la tradition marxiste, traite précisément du problème qui préoccupe Darmangeat. On aurait pu imaginer que ce dernier y prêterait la plus grande attention, d'autant plus qu'il reconnaît lui-même la "grande érudition" de Knight. Mais il n'en est rien, bien au contraire : Darmangeat n'y consacre qu'une page (p. 321), où il nous dit, entre autres, que la thèse de Knight "réitère les plus graves fautes de méthode présentes chez Reed et Briffault (Knight garde le silence sur la première, mais cite le second abondamment)", ce qui peut laisser croire au lecteur n'ayant pas lu le livre que Knight ne fait que suivre des gens dont Darmangeat aurait déjà démontré le peu de sérieux.19 Mais un simple coup d'œil à la bibliographie de Blood Relations suffit à montrer que si Knight cite effectivement Briffault, il donne beaucoup plus de place à Marx, Engels, Lévi-Strauss, Marshall Sahlins,... et nous en passons. Et que si on se donne la peine de consulter les références à Briffault, on constate immédiatement que Knight considère que le livre de ce dernier20 (publié en 1927) "date dans ses sources et sa méthodologie" (p. 328).
En somme, notre sentiment est que le choix de Darmangeat nous laisse plutôt "le cul entre deux chaises" : on finit avec une narration critique qui n'est ni une vraie critique des positions défendues par les marxistes, ni une vraie critique des théories anthropologiques, et cela nous donne parfois l'impression d'être les témoins d'une joute contre des moulins à vent. Notre impression est que ce choix de départ tend à obscurcir une argumentation fort intéressante par ailleurs.
À suivre
Jens (août 2012)
1 Éditions Smolny, Toulouse 2009. Nous avons pris connaissance de la parution de la 2e édition du livre de Darmangeat (Smolny, Toulouse 2012) alors que nous nous préparions à mettre cet article sous presse. Nous nous sommes évidemment demandé s’il n’allait pas falloir entièrement reprendre notre critique. Après avoir eu la nouvelle édition en mains, il nous a semblé que nous pouvions légitimement laisser l’essentiel de cet article tel quel. L’auteur lui-même nous signale dans la nouvelle préface ne pas avoir "modifié les thèses essentielles du texte et les arguments sur lesquels elles s’appuient", ce qui, à la lecture, se confirme. Nous nous sommes donc limités à élaborer certains arguments sur la base de la 2e édition. Sauf indication contraire, les citations et les références aux numéros de page sont celles de la première édition.
2 Chris Knight est un anthropologue anglais, membre du "Radical Anthropology Group". Il a participé aux débats sur la science au 19e Congrès du CCI, et nous avons publié sur notre site ses textes "Marxisme et science" (https://fr.internationalism.org/node/4850 [349]) et "La solidarité humaine et le gène égoïste" (https://fr.internationalism.org/ri434/la_solidarite_et_le_gene_egoiste_article_de_l_anthropologue_chris_knight.html [350]).
3 Yale University Press, New Haven and London, 1991. Le livre n'est malheureusement disponible qu'en langue anglaise.
4 Ceci dit, il aurait été impossible de développer ces idées sans la stimulation des discussions avec les camarades au sein de l’organisation.
7 On peut faire ici une analogie avec la production marchande et la société capitaliste. Si la production marchande et le commerce existent depuis le début de la civilisation, et peut-être même avant, ce n'est qu’avec le capitalisme qu'ils deviennent déterminants.
8 Voir à ce sujet notre article "Reading notes on science and marxism", https://en.internationalism.org/icconline/201203/4739/reading-notes-science-and-marxism [353]
9 Il en va ainsi de la science comme des autres forces productives sous le capitalisme : "Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait toutes les générations passées dans leur ensemble. Asservissement des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemins de fer, télégraphe électrique, défrichement de continents entiers, canalisation des rivières, populations entières surgies du sol - quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? […] Les forces productives dont elle dispose ne jouent plus en faveur de la civilisation bourgeoise et du régime de la propriété bourgeoise ; elles sont, au contraire, devenues trop puissantes pour les institutions bourgeoises qui ne font plus que les entraver ; et dès qu'elles surmontent ces entraves, elles précipitent dans le désordre toute la société bourgeoise et mettent en péril l'existence de la propriété bourgeoise." Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste communiste, "I – Bourgeois et prolétaires", Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 166-167.
10 Anaximandre de Milet, ou la naissance de la pensée scientifique, éditions Dunod, juin 2009.
11 Cité dans notre article "La place de la science dans l'histoire humaine", Révolution internationale n° 422,
12 Karl Popper (1902-1994) est un des philosophes des sciences les plus influents du 20e siècle et une référence incontournable pour tout scientifique qui s’intéresse à des questions de méthodologie. Il insiste notamment sur la notion de "réfutabilité", l’idée que toute hypothèse, pour être scientifique, devrait permettre l’élaboration d’expériences ou d'observations qui pourraient permettre de la réfuter : en l’absence de possibilité de telles expériences ou observations, une hypothèse ne pourrait être qualifiée de scientifique. C’est sur cette base que Popper considérait que le marxisme, la psychanalyse et – dans un premier temps – le darwinisme, ne pouvaient prétendre au statut de science.
13 Il s’agit de restes d’ocre rouge gravé et de coquillages percés. L’article de La Recherche signale même la découverte d’un "nécessaire à peinture" vieux de 100 000 ans (voir www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=30891 [355]).
14 C’est sans doute par une forme d'ironie que Darmangeat, dans la 2e édition de son livre, a préféré déplacer toute la partie sur Morgan en appendice, apparemment par crainte de rebuter le lecteur non spécialiste à cause de son "aridité" selon le terme de l’auteur.
15 Ce texte est disponible à l'adresse : www.chrisknight.co.uk/wp-content/uploads/2007/09/Early-Human-Kinship-Was-Matrilineal1.pdf [356]
16 " C'est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu'il ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni l'occasion de donner leur place aux autres facteurs qui participent à l'action réciproque. Mais dès qu'il s'agissait de présenter une tranche d'histoire, c’est-à-dire de passer à l'application pratique, la chose changeait et il n'y avait pas d'erreur possible. Mais, malheureusement, il n'arrive que trop fréquemment que l'on croie avoir parfaitement compris une nouvelle théorie et pouvoir la manier sans difficulté, dès qu'on s'en est approprié les principes essentiels, et cela n'est pas toujours exact. Je ne puis tenir quitte de ce reproche plus d'un de nos récents “marxistes”, et il faut dire aussi qu'on a fait des choses singulières." (Lettre d'Engels à J. Bloch, 21-22 septembre 1890 : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1890/09/18900921.htm [357])
17 Dans la 2e édition, Kollontaï a même droit à un sous-chapitre qui lui est entièrement dédié.
18 La critique de la théorie de Lévi-Strauss est traitée de manière approfondie dans Blood Relations.
19 La critique de Knight n’est pas plus étoffée dans la 2e édition que dans la 1ère, à une exception près : l’auteur cite une revue critique du livre de la part de Joan M. Gero, anthropologue féministe et auteur de Engendering archaeology. Cette critique nous paraît très superficielle et inclut un fort parti pris idéologique. En voici un échantillon : "Ce que Knight met en avant en tant que perspective, vue sous l'angle du sexe, des origines de la culture est une vision paranoïaque et distordue de la 'solidarité féminine', présentant (toutes) les femmes comme exploitant sexuellement et manipulant (tous) les hommes. Les relations hommes-femmes sont caractérisées de tout temps et en tout lieu comme des relations entre victimes et manipulatrices : les femmes exploiteuses sont supposées avoir toujours voulu piéger les hommes d'une manière ou d'une autre, et leur conspiration pour ce faire est la base fondamentale même du développement de notre espèce. Les lecteurs peuvent être également offensés par l'idée que les hommes ont toujours été volages et que seule une activité sexuelle agréable, distribuée parcimonieusement et avec coquetterie par des femmes calculatrices, peut les retenir à la maison et maintenir leur intérêt pour leur progéniture. Ce scénario est non seulement improbable et non démontré, répugnant pour les féministes tout comme les non féministes, mais le raisonnement sociobiologique balaye d'un revers de main toutes les versions nuancées de la construction sociale des relations entre genres, des idéologies et des activités qui sont devenues si centrales et fascinantes pour les études de genre aujourd'hui." (traduit par nos soins). En somme, non seulement Gero n'a visiblement pas compris grand chose à l'argumentation qu'elle prétend critiquer, mais, pire encore, elle nous invite à rejeter une thèse scientifique, non pas parce qu'elle est fausse – ce que Gero ne se donne même pas la peine d'essayer de démontrer – mais parce qu'elle est "répugnante" pour (entre autres) les féministes.
20 The Mothers : A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, 1927
Personnages:
- Christophe Darmangeat [358]
- Lewis Morgan [359]
- Chris Knight [360]
- Bronislaw Malinowski [361]
Rubrique:
Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire dans la révolution allemande de 1918-19
- 4700 lectures
Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, partie IV
L'article précédent a donné un aperçu des efforts du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne pour défendre une position internationaliste contre la guerre de 1914-18. L’Union Libre des Syndicats Allemands (Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften - FVDG) avait survécu à la guerre avec seulement quelques centaines de membres dans la clandestinité qui, dans des conditions de brutale répression, avaient été, comme d'autres révolutionnaires, la plupart du temps condamnés au silence. Fin 1918 les événements se précipitent en Allemagne. Avec le déclenchement des luttes en novembre 1918, l'étincelle de la révolution russe d'Octobre 1917 embrasait finalement le prolétariat en Allemagne.
La réorganisation de la FVDG en 1918
Au cours de la première semaine de novembre 1918, la révolte des matelots de la flotte de Kiel met à genoux le militarisme allemand. Le 11 novembre, l'Allemagne signe l'armistice. La FVDG écrit : "Le gouvernement impérial a été renversé, non par la voie parlementaire et légale, mais par l'action directe ; non par le bulletin de vote, mais par la force des armes des ouvriers en grève et des soldats mutinés. Sans attendre la consigne de chefs, des conseils ouvriers et de soldats ont partout été formés spontanément et ont immédiatement commencé à écarter les anciennes autorités. Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats ! Voilà quel est maintenant le mot d’ordre." 1
Avec le déclenchement de la vague révolutionnaire s’ouvre pour le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne une ère turbulente d'afflux rapide de militants. Celui-ci passe d’environ 60 000 membres au moment de la Révolution de novembre 1918 jusqu’à mi 1919 à plus de 111 000 fin 1919. La large radicalisation politique de la classe ouvrière à la fin de la guerre pousse vers le mouvement syndicaliste-révolutionnaire de nombreux ouvriers qui se sont détachés des grands syndicats sociaux-démocrates en raison du soutien ouvert de ces derniers à la politique de guerre. Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire constitue incontestablement un lieu de rassemblement de travailleurs intègres et combatifs.
A travers la publication de son nouveau journal, Der Syndikalist, à partir du 14 décembre 1918, la FVDG fait de nouveau entendre sa voix : "Dès les premiers jours d’août [1914], notre presse a été interdite, nos camarades les plus en vue placés en ‘détention préventive’, toute activité publique a été rendue impossible aux agitateurs et aux unions locales. Et pourtant, les armes du syndicalisme révolutionnaire sont aujourd'hui utilisées dans tous les recoins de l'Empire allemand, les masses ressentent instinctivement que le temps de la revendication et de la requête est passé et que commence celui où c’est à nous de prendre." 2 Les 26 et 27 décembre, Fritz Kater organise à Berlin une Conférence à laquelle assistent 43 syndicats locaux de la FVDG et où celle-ci se réorganise après la période de clandestinité de la guerre.
C’est dans les agglomérations industrielles et minières de la région de la Ruhr que la FVDG connaît l’accroissement numérique le plus important. L'influence des syndicalistes-révolutionnaires est particulièrement forte à Mülheim et contraint les syndicats sociaux-démocrates à se retirer du conseil d’ouvriers et de soldats le 13 décembre 1918, celui-ci rejetant clairement leur rôle de représentants des ouvriers pour prendre ce rôle directement en main. A partir des mines de la région de Hamborn, des grèves massives de mineurs dirigées par le mouvement syndicaliste-révolutionnaire se produisent de novembre 1918 à février 1919. 3
Conseils ouvriers ou syndicats ?
Face à la guerre de 1914, le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne avait passé le test historique auquel il était soumis : défendre l’internationalisme contre la guerre, et non, comme la grande majorité des syndicats, se ranger derrière les buts guerriers de la classe dirigeante. L’éclatement de la Révolution de 1918 pose un nouvel enjeu énorme : comment la classe ouvrière s’organise pour renverser la bourgeoisie et passer à l’action révolutionnaire ?
Comme elle l’avait fait en Russie en 1905, puis en 1917, en novembre 1918 en Allemagne, la classe ouvrière fait surgir des conseils ouvriers, marquant l’éclosion d’une situation révolutionnaire. L’ensemble de la période depuis la constitution des "Localistes" en 1892 et la fondation formelle en 1901 de la FVDG n'avait pas connu de soulèvement révolutionnaire. Contrairement à la Russie, où, en 1905, apparurent les premiers conseils ouvriers, la réflexion sur les conseils est restée très abstraite en Allemagne jusqu'en 1918. Au cours de l’enthousiasmant mais bref "hiver des Conseils" de 1918/19 en Allemagne, la FVDG concevait toujours clairement sa forme d'organisation comme un syndicat et c’est en tant que syndicat qu’elle réapparaît sur la scène. La FVDG répond à la situation inédite du surgissement des conseils ouvriers avec un grand enthousiasme. Le cœur révolutionnaire de la majorité des membres de la FVDG palpite pour les conseils ouvriers, de telle sorte que Der Syndikalist n°2 du 21 décembre 1918 revendique clairement : "Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats révolutionnaires".
Mais la conscience théorique retarde souvent sur l’intuition prolétarienne. En dépit de l'émergence des conseils ouvriers, et comme si rien de bien nouveau ne s’était produit, Der Syndikalist n°4 écrit, que la FVDG est la seule organisation ouvrière "dont les représentants et les organes n’ont pas besoin de se remettre à jour", une expression qui résume l’orgueil de la Conférence de réorganisation de la FVDG de décembre 1918 et qui devint la devise du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne. Mais pour le mouvement ouvrier s’était ouverte une ère de grand bouleversement, où il avait justement beaucoup à remettre à jour, notamment en ce qui concerne ses formes d’organisation !
Pour expliquer les politiques honteuses des principaux syndicats de soutien à la guerre et d’opposition aux conseils ouvriers, la FVDG avait tendance à se contenter d'une demi-vérité, et à en ignorer l’autre moitié. Seule "l’éducation sociale-démocrate" était mise en cause. La question des différences fondamentales entre la forme syndicale et celle des conseils ouvriers est complètement négligée.
Sans aucun doute la FVDG et l’organisation qui lui fit suite, la FAUD, furent des organisations révolutionnaires. Mais elles ne voyaient pas que leur organisation procédait des mêmes germes que les conseils ouvriers : la spontanéité, l’aspiration à l’extension et l'esprit révolutionnaire – tous caractères allant bien au-delà de la tradition syndicale.
Dans les publications de l’année 1919 de la FVDG, il est quasiment impossible de trouver une tentative de traiter la contradiction fondamentale entre la tradition syndicale et les conseils ouvriers, instruments de la révolution. Au contraire, celle-ci concevait les "syndicats révolutionnaires" comme la base du mouvement des conseils. "Les syndicats révolutionnaires doivent exproprier les expropriateurs. (...) Les conseils ouvriers et les conseils d’usine doivent prendre en charge la direction socialiste de la production. Le pouvoir aux conseils ouvriers ; les moyens de production et les biens produits au corps social. Tel est l'objectif de la révolution prolétarienne : le mouvement syndicaliste révolutionnaire est le moyen d’y parvenir."Mais le mouvement révolutionnaire des conseils en Allemagne surgissait-il effectivement du mouvement syndical ? "C’étaient des ouvriers qui s’étaient rassemblés au sein de ‘comités d'usine’ qui agissaient comme les comités d'usine des grandes entreprises de Petrograd en 1905, sans en avoir connu l’activité. En juillet 1916, la lutte politique ne pouvait pas être menée à l'aide des partis politiques et des syndicats. Les dirigeants de ces organisations étaient les adversaires d'une telle lutte ; après la lutte, ils ont également contribué à livrer les leaders de cette grève politique au fléau de la répression des autorités militaires. Ces "comités d'usine", le terme n'est pas tout à fait exact, peuvent être considérés comme les précurseurs des conseils ouvriers révolutionnaires d'aujourd'hui en Allemagne. (...) Ces luttes n'ont pas été soutenues et dirigées par les partis et les syndicats existants. Il y avait là les prémices d'un troisième type d’organisation, les conseils ouvriers." 4 C’est ainsi que décrit Richard Müller, membre des Revolutionäre Obleute (‘Hommes de confiance’ révolutionnaires) le "moyen d’y parvenir."
Les syndicalistes de la FVDG n’étaient pas les seuls à ne pas remettre en cause la forme syndicale d'organisation. A cette époque, il était extrêmement difficile pour la classe ouvrière de tirer pleinement et en toute clarté l’ensemble des conséquences qu’impliquait l’irruption de la "période des guerres et des révolutions". Les illusions quant à la forme d'organisation syndicale, la faillite de celle-ci devant la révolution devaient encore être inévitablement, douloureusement et concrètement soumises à l’expérience pratique. Richard Müller cité plus haut écrivait seulement quelques semaines plus tard, lorsque les conseils ouvriers sont dépossédés de leur pouvoir : "Mais si nous reconnaissons la nécessité de la lutte revendicative quotidienne – et personne ne peut la contester – alors nous devons également reconnaître la nécessité de préserver les organisations qui ont pour fonction de mener cette lutte, et ce sont les syndicats. (...) Si nous reconnaissons la nécessité des syndicats existants (…) alors nous devons examiner plus en avant si les syndicats peuvent trouver une place au sein du système des conseils. Dans la période de mise en place du système des conseils, il faut inconditionnellement répondre à cette question par l'affirmative." 5
Les syndicats sociaux-démocrates avaient perdu leur crédit vis-à-vis des larges masses de travailleurs et les doutes croissaient de plus en plus quant à savoir si ces organisations pouvaient encore représenter les intérêts de la classe ouvrière. Dans la logique de la FVDG, le dilemme de la capitulation et de la faillite historique de la vieille forme d’organisation syndicale se résolvait par la perspective d'un "syndicalisme révolutionnaire."
En ce début de l'ère de la décadence du capitalisme, l'impossibilité de la lutte pour des réformes pose à terme l'alternative suivante pour les organisations de masse permanentes de la classe ouvrière : soit le capitalisme d'État les intègre à l'État (comme en général cela a été le cas avec les organisations sociales-démocrates - mais aussi pour des syndicats syndicalistes-révolutionnaires comme la CGT en France), soit il les détruit (ce qui fut finalement le sort de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire). Se pose alors la question de savoir si la révolution prolétarienne exige d'autres formes d'organisation. Avec l'expérience dont nous disposons aujourd'hui, nous savons qu’il n’est pas possible d’apporter de nouveaux contenus à d’anciennes formes, telles que les syndicats. La révolution n'est pas seulement une affaire de contenu, mais aussi de forme. C'est ce que le théoricien de la FAUD, Rudolf Rocker, formulait de façon très juste en décembre 1919 dans son approche contre les fausses visions de "l’État révolutionnaire" : "L'expression d'État révolutionnaire ne peut pas nous convenir. L'État est toujours réactionnaire et qui ne le comprend pas n'a pas compris la profondeur du principe révolutionnaire. Chaque instrument possède une forme adaptée au but auquel il doit servir ; et c'est aussi le cas pour les institutions. Les pinces du maréchal-ferrant ne sont pas adaptées pour arracher des dents et avec les pinces du dentiste on ne peut pas former un fer à cheval (...)" 6. C’est exactement ce que, malheureusement, le mouvement syndicaliste-révolutionnaire a manqué d’appliquer de façon conséquente à la question de la forme d’organisation.
Contre le piège des "comités d’entreprise"
Pour émasculer politiquement l'esprit du système des conseils ouvriers, les sociaux-démocrates et leurs syndicats au service de la bourgeoisie commencèrent adroitement à saper de l'intérieur les principes d'organisation autonome de la classe ouvrière dans les conseils. Cela n’a été possible que parce que, les conseils ouvriers ayant émergé des luttes de novembre 1918, ceux-ci avaient perdu leur force et leur dynamisme avec le premier reflux de la révolution. Le premier Congrès des Conseils du 16 au 20 décembre 1918, sous l'influence subtile du SPD et du poids persistant des illusions de la classe ouvrière sur la démocratie, avait abandonné son pouvoir et proposé l’élection d’une Assemblée Nationale, se désarmant ainsi complètement de lui-même.
Au printemps de 1919, après la vague de grèves dans la Ruhr, il a été proposé, à l'initiative du gouvernement SPD, d’instaurer dans les usines des "comités d’entreprises" - des représentations de facto de la main-d'œuvre remplissant en fait la même fonction de négociation et de collaboration avec le capital que les syndicats traditionnels. Sous les auspices des responsables du Parti social-démocrate et des syndicats, Gustav Bauer et Alexander Schlicke, les comités d'entreprise sont définitivement inscrits dans la Constitution bourgeoise de l'État allemand en février 1920.
Il fallait développer l’illusion dans la classe ouvrière que son esprit combatif porté vers les conseils trouvait son incarnation dans cette forme de représentation directe des intérêts des ouvriers. "Les comités d’entreprise sont conçus pour régler toutes les questions relatives à l'emploi et aux salariés. Il leur revient d’assurer la poursuite et l'augmentation de la production dans l’entreprise et de veiller à éliminer tout obstacle pouvant survenir. (...) Les comités de district en collaboration avec les directions régissent et supervisent le rendement du travail dans le district, ainsi que la répartition des matières premières." 7 Après la répression sanglante contre la classe ouvrière, l'intégration démocratique dans l'État devait sceller définitivement l’œuvre de la contre-révolution. De façon encore plus directe qu’avec les syndicats et en liaison encore plus étroite avec les entreprises, la mise en place de ces comités venait compléter sur place la collaboration avec le capital.
La presse de la FVDG au printemps de 1919 a pris position avec courage et clarté contre ce stratagème des comités d’entreprise : "Le capital et l'État admettent uniquement les comités ouvriers que l’on nomme désormais comités d’entreprise. Le comité d’entreprise ne vise pas à représenter seulement les intérêts des travailleurs, mais aussi ceux de l’entreprise. Et puisque ces sociétés sont la propriété du capital privé ou d'État, les intérêts des travailleurs doivent être subordonnés aux intérêts des exploiteurs. Il s'ensuit que le comité d’entreprise défend l'exploitation des travailleurs et incite ceux-ci à la poursuite docile du travail comme esclaves salariés. (...) Les moyens de lutte des syndicalistes-révolutionnaires sont incompatibles avec les fonctions du comité d’entreprise." 8
Cette attitude était largement partagée parmi les syndicalistes révolutionnaires parce que, d’une part les comités d’entreprise apparaissaient de façon évidente pour ce qu’ils étaient, un outil de la social-démocratie et, d'autre part, la combativité du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne n'avait pas encore été brisée. L'illusion d'avoir "obtenu quelque chose", et "d’avoir franchi une étape concrète" ne trouvait que peu de prise en 1919 dans les fractions les plus déterminées du prolétariat - la classe ouvrière n'avait pas encore été défaite. 9
Plus tard, après le déclin évident du mouvement révolutionnaire à partir de 1921, il n'est donc pas surprenant qu’au sein de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire des débats houleux éclatent durant une année à propos de la participation aux élections aux comités d'entreprise. Une minorité développait l’orientation qu'il fallait désormais, à travers les comités d’entreprises légalisés, établir "une liaison avec les masses laborieuses pour déclencher des luttes massives dans les situations favorables."10 La FVDG en tant qu’organisation refusa de s’engager dans "la voie morte des comités d’entreprise voués à neutraliser l'idée révolutionnaire des conseils" selon la formulation du militant August Beil. C'est du moins la position qui prévalut jusqu'à novembre 1922, lorsque, en conséquence de l'impuissance produite par la défaite de la révolution, le 14ème Congrès de la FAUD l’atténua, octroyant le droit à ses membres de participer aux élections aux comités d’entreprise.
La dynamique de la révolution rapproche les syndicalistes révolutionnaires et la Ligue Spartacus
Comme en Russie en Octobre 1917, le soulèvement de la classe ouvrière en Allemagne avait d’emblée suscité un élan solidaire au sein la classe ouvrière. Pour le mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne, la solidarité avec la lutte de la classe ouvrière en Russie avait, jusque fin 1919, constitué incontestablement une référence importante, partagée internationalement avec d'autres révolutionnaires. La Révolution russe, du fait de soulèvements révolutionnaires dans d'autres pays, possédait encore une perspective en 1918-1919 et n'avait pas encore succombé à sa dégénérescence intérieure. Pour défendre leurs frères de classe en Russie et contre la politique même du SPD et des syndicats sociaux-démocrates, la FVDG dénonçait dans le deuxième numéro de son journal Der Syndikalist : "(...) qu’aucun moyen ne leur était trop répugnant, aucune arme trop ignoble pour calomnier la Révolution russe et vitupérer la Russie soviétique et ses conseils d’ouvriers et de soldats." 11 Malgré de nombreuses réserves quant aux conceptions des Bolcheviks - dont toutes n’étaient pas infondées - les syndicalistes révolutionnaires restèrent solidaires avec la Révolution russe. Même Rudolf Rocker, théoricien influent au sein de la FVDG et critique véhément des Bolcheviks, appela deux ans après la révolution d’Octobre, lors de son célèbre discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD en décembre 1919, à manifester sa solidarité avec la Révolution russe : "Nous nous tenons unanimement du côté de la Russie soviétique dans sa défense héroïque contre les puissances des Alliés et les contre-révolutionnaires, et ceci, non pas parce que nous sommes Bolcheviks, mais parce que nous sommes des révolutionnaires."
Bien que les syndicalistes révolutionnaires en Allemagne eussent leurs réserves traditionnelles envers le "marxisme" qui "veut conquérir le pouvoir politiquement", ce qu'ils croyaient discerner également dans la Ligue Spartacus, ils défendaient clairement l’action commune avec toutes les autres organisations révolutionnaires : "Le syndicalisme révolutionnaire estime donc inutile la division du mouvement ouvrier, il veut la concentration des forces. Pour l’instant, nous recommandons à nos membres d’agir, dans les questions économiques et politiques, partout en commun avec les groupes les plus à gauche du mouvement ouvrier : les Indépendants, la Ligue Spartacus. Nous mettons en garde, cependant, contre toute participation au cirque des élections à l'Assemblée nationale." 12
La révolution de novembre 1918 ne fut pas l’œuvre d'une organisation politique particulière telle que la Ligue Spartacus et les Revolutionnäre Obleute (les délégués syndicaux révolutionnaires), même si ceux-ci ont adopté lors des journées de novembre la position la plus claire et la plus grande volonté d’action. Ce fut un soulèvement de l’ensemble de la classe ouvrière où s'est exprimé, pendant une courte période, l'unité potentielle de cette classe. Une expression de cette tendance à l’unité a été le phénomène répandu de double affiliation à la Ligue Spartacus et à la FVDG. "A Wuppertal, les militants de la FVDG s’engagèrent dans un premier temps au sein du Parti communiste. Une liste établie en avril 1919 par la police sur les communistes de Wuppertal contient le nom de tous les futurs principaux membres de la FAUD (...)" 13. A Mülheim, à partir du 1er décembre 1918 parut le journal "Die Freiheit, organe de défense des intérêts de l’ensemble du peuple du Travail. Organe de presse des Conseils d’ouvriers et de soldats", édité en commun par des syndicalistes révolutionnaires et des membres de la Ligue Spartacus.
Au début 1919, il existait au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire une aspiration prononcée à l’union avec d'autres organisations de la classe ouvrière. "Ils ne sont toujours pas unis, ils sont toujours divisés, ils ne sont pas tous encore de véritables socialistes en pensée et à l’attitude honnête et ils ne sont toujours pas unitairement et indissociablement associés par la merveilleuse chaine de la solidarité prolétarienne. Ils sont toujours divisés entre socialistes de droite, socialistes de gauche, Spartakistes, et autres. La classe ouvrière doit enfin en finir avec l’absurdité grossière du particularisme politique." 14 Cette attitude de large ouverture reflétait la situation de forte hétérogénéité politique, voire de confusion, au sein de la FVDG qui avait connu une croissance rapide. Sa cohésion interne reposait moins sur la clarification programmatique ou la démarcation vis-à-vis des autres organisations prolétariennes que sur le lien de solidarité ouvrière, comme le montre la caractérisation sans discrimination de tous les "socialistes".
L'attitude solidaire envers la Ligue Spartacus s’était développée dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires suite à la répression de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg au cours de la guerre et a continué jusqu'à l'automne 1919. Mais par contre, elle n’a pas permis d'asseoir une histoire commune avec la Ligue Spartacus. Jusqu'à la période de la conférence de Zimmerwald en 1915, c’était bien plus une méfiance réciproque qui avait dominé. La cause principale du rapprochement a été la clarification politique, mûrie au sein de la classe ouvrière tout entière et de ses organisations révolutionnaires au cours de la révolution de novembre : le rejet de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme. Le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne, qui avait rejeté depuis longtemps le système parlementaire, voyait cette position comme faisant partie de son patrimoine propre. La Ligue Spartacus, qui avait pris position avec une grande clarté contre les illusions sur la démocratie, considérait la FVDG, qui empruntait la même voie, comme l’organisation la plus proche d’elle en Allemagne.
Cependant, dès le départ, Rudolf Rocker, qui devait prendre en charge l’orientation politique du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne après décembre 1919, "ne porte pas dans son cœur les appels lancés aux camarades à soutenir l'aile gauche du mouvement socialiste, les Indépendants et les Spartakistes, ni l’intervention du journal en faveur de la ""dictature du prolétariat " (...)"15. De retour d'internement en Angleterre durant la guerre, Rocker, anarchiste syndicaliste-révolutionnaire fortement influencé par les idées de Kropotkine, adhéra à la FVDG en mars 1919.
Malgré les divergences d’opinions à l'égard de la Ligue Spartacus entre Rocker et la tendance réunie autour de Fritz Kater, Carl Windhoff et Karl Roche, la plus influente dans la FVDG dans les premiers mois de la Révolution de 1918-19, il serait erroné de parler à cette époque de luttes de tendances au sein de la FVDG telles qu'il en éclatera plus tard, à partir de 1920 au sein de la FAUD comme symptôme de la défaite de la révolution allemande. Il n'existe pour lors aucune tendance significative parmi les syndicalistes-révolutionnaires voulant a priori se démarquer du KPD. Au contraire, la recherche d'une unité d'action avec les Spartakistes était le produit de la dynamique vers l'unité des luttes ouvrières et de la "pression de la base" de ces deux courants dans les semaines et les mois où la révolution semblait à portée de main. Ce furent la défaite douloureuse du soulèvement prématuré de janvier 1919 à Berlin et l’écrasement consécutif de la vague de grèves en avril dans la Ruhr, soutenue par les syndicalistes-révolutionnaires, le KPD et l'USPD, qui, par le sentiment de déception qu’ils provoquèrent, suscitèrent des récriminations mutuelles et émotionnelles, exprimant un manque de maturité des deux côtés.
L’"alliance informelle" avec Spartacus, et le Parti communiste, devait par conséquent se briser dès l’été 1919. L'initiative en incombait moins à la FVDG qu’à l’attitude agressive que le KPD commença à adopter vis-à-vis des syndicalistes-révolutionnaires.
Le "programme provisoire" des syndicalistes-révolutionnaires au printemps 1919
Au printemps 1919, la FVDG publia une brochure rédigée par Roche, "Que veulent les syndicalistes-révolutionnaires ?". Celle-ci devait servir de programme et de texte d’orientation à son organisation jusqu’en décembre 1919. Il est difficile de juger le mouvement syndicaliste-révolutionnaire à l’aune d’un seul texte, vu la coexistence dans ses rangs d'idées différentes. Toutefois, ce programme du printemps 1919 constitue un jalon, et à plusieurs points de vue, l’une des prises de position les plus achevées du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne. En dépit des expériences passées douloureuses de leur propre histoire avec les sociaux-démocrates et de la diabolisation permanente de la politique 16 qui en résulte, celui-ci conclut : "La classe ouvrière doit se rendre maître de l'économie et de la politique." 17
La force des positions que propage la FVDG à l’aide de ce programme au sein de la classe ouvrière en Allemagne au printemps se trouve ailleurs : dans son attitude envers l'État, la démocratie bourgeoise et le parlementarisme. Il est fait spécifiquement référence à la description que Friedrich Engels fait de l'État en tant que produit de la société divisée en classes : "l’État est un produit de la société à une certaine étape de son développement" ; il est "l’aveu que cette société s’est empêtrée dans une insoluble contradiction avec elle-même, qu’elle s’est divisée en antagonismes inconciliables" et n’est pas "une force imposée à la société du dehors" ni un instrument de la classe dirigeante créé de façon purement arbitraire par elle. La FVDG appelle de façon conséquente à la destruction de l'État bourgeois.
Avec cette position, à une époque où la social-démocratie constituait sans doute l'arme la plus insidieuse de la contre-révolution, la FVDG mettait le doigt sur un point névralgique. Contre la farce du SPD visant à soumettre les conseils ouvriers par leur intégration au parlement bourgeois, son programme exhortait : "Le ‘socialisme’ social-démocrate a assurément besoin d’un État. Et d’un État qui aurait à utiliser de tous autres moyens contre la classe ouvrière que l’État capitaliste. (...) Il sera le fruit d'une demi-révolution prolétarienne et la cible de la révolution prolétarienne totale. C’est parce que nous avons reconnu la nature de l'État et que nous savons que la domination politique des classes possédantes s’enracine dans leur puissance économique, que nous n'avons pas à lutter pour la conquête de l'État, mais pour son élimination."
Karl Roche a aussi tenté de formuler dans le programme de la FVDG les leçons fondamentales des journées de novembre et décembre 1918 allant bien au-delà du rejet rebelle ou individualiste de l'État qu’on prête à tort aux syndicalistes révolutionnaires et démasquant clairement dans son essence le système de la démocratie bourgeoise. "La démocratie n'est pas l'égalité, mais l’utilisation démagogique d’une comédie d’égalité. (...) Les possédants ont, pour autant qu’ils affrontent les ouvriers, toujours les mêmes intérêts. (...) Les travailleurs n’ont d’intérêt commun qu’entre eux, et non avec la bourgeoisie. Là, la démocratie est une absurdité générale. (...) La démocratie est l'un des slogans les plus dangereux dans la bouche des démagogues qui comptent sur la paresse et l'ignorance des salariés. (...) Les démocraties modernes en Suisse, en France, en Amérique ne sont qu’une hypocrisie capitaliste démocratique sous la forme la plus répugnante." Face aux pièges de la démocratie cette formulation précise reste plus pertinente que jamais.
Nous pouvons porter de nombreuses critiques au programme de la FVDG du printemps 1919, notamment un certain nombre d’idées syndicalistes-révolutionnaires classiques que nous ne partageons pas comme "l’autodétermination complète" et "le fédéralisme". Mais sur des points cruciaux à ce moment-là, comme le rejet du parlementarisme, le programme, écrit par Roche, est demeuré inflexible. "Il en va du parlementarisme comme de la social-démocratie : si la classe ouvrière veut se battre pour le socialisme, elle doit écarter la bourgeoisie comme classe. Elle ne doit pas alors lui accorder de droit au pouvoir, ne doit pas voter avec elle ni traiter avec elle. Les conseils ouvriers sont les parlements de la classe ouvrière. (...) Ce ne sont pas les parlements bourgeois, mais la dictature du prolétariat qui mettra en œuvre le socialisme." A ce moment-là, le Parti communiste revenait sur ses positions initiales claires contre le parlementarisme et le travail dans les syndicats-sociaux-démocrates et commençait à régresser dramatiquement en deçà des positions de son Congrès de fondation.
Quelques mois plus tard, en décembre 1919, la Déclaration de principes de la FAUD mettait l’accent sur des points différents. Karl Roche qui, dans les premiers temps après la guerre avait influencé la FVDG de façon décisive au plan programmatique, rejoignit l’AAU en décembre 1919.
La rupture avec le Parti communiste
Lors de la Révolution de novembre 1918, de nombreux points communs rassemblent les révolutionnaires de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire et ceux de la Ligue Spartacus : la référence au soulèvement de la classe ouvrière en Russie en 1917, la revendication de tout le pouvoir aux conseils ouvriers, le rejet de la démocratie et du parlementarisme, ainsi qu’un rejet très clair de la social-démocratie et de ses syndicats. Comment expliquer alors qu'au cours de l'été 1919 ait commencé un dur règlement de comptes entre les deux courants qui avaient auparavant partagé tant de choses ?
Il existe différents facteurs faisant qu'une révolution peut échouer : la faiblesse de la classe ouvrière et le poids de ses illusions ou l'isolement de la révolution. En Allemagne en 1918-19, c’est surtout son expérience qui a permis à la bourgeoisie allemande, au moyen de la social-démocratie, de saboter de l'intérieur le mouvement, de fomenter des illusions démocratiques, de précipiter la classe ouvrière dans le piège de soulèvements isolés et prématurés comme en janvier 1919 et de la priver, par le meurtre, de ses révolutionnaires les plus clairs et de milliers de prolétaires engagés.
Les polémiques entre le KPD et les syndicalistes-révolutionnaires suite à l’écrasement de la grève d'avril 1919 dans Ruhr montrent des deux côtés la même tentative de rechercher les raisons de l'échec de la révolution chez les autres révolutionnaires. Roche s’était déjà laissé emporter par cette tendance dès avril dans la conclusion du programme de la FVDG affirmant "(...) ne pas laisser les Spartakistes diviser la classe ouvrière", mettant ainsi de façon confuse ces derniers dans le même sac que les "socialistes de droite". À partir de l'été 1919 cela devint la mode dans la FVDG de parler des "trois partis sociaux-démocrates", c’est-à-dire SPD, USPD et KPD - une attaque polémique qui dans l’atmosphère de frustration par rapport aux échecs de la lutte de classe, ne faisait plus aucune distinction entre les organisations contre-révolutionnaire et les organisations prolétariennes.
Le Parti communiste (KPD) publia en août une brochure sur les syndicalistes-révolutionnaires à l’argumentation tout aussi malheureuse. Il considérait désormais la présence de syndicalistes-révolutionnaires dans ses rangs comme une menace pour la révolution : "Les syndicalistes-révolutionnaires invétérés doivent enfin se rendre compte qu’ils ne partagent pas les choses fondamentales avec nous. Nous ne devons plus consentir que notre parti offre un terrain de jeu à des gens qui y propagent toutes sortes d'idées étrangères au parti." 18
La critique du Parti communiste envers les syndicalistes-révolutionnaires était axée sur trois points : la question de l'État et de l'organisation économique après la révolution, la tactique et la forme d’organisation – en fait les débats classiques avec le courant syndicaliste-révolutionnaire. Bien que le Parti communiste ait eu raison de conclure que : "Dans la révolution, l'importance des syndicats pour la lutte des classes régresse de plus en plus. Les conseils ouvriers et les partis politiques deviennent les protagonistes et les dirigeants exclusifs de la lutte", la polémique envers les syndicalistes révolutionnaires révéla surtout les faiblesses du Parti communiste sous la direction de Levi : une fixation sur la conquête de l'État. "Nous pensons que nous allons nécessairement utiliser l'État après la révolution. La Révolution signifie justement en premier lieu la prise du pouvoir au sein de l'État" ; la croyance erronée que la coercition au sein du prolétariat peut être un moyen pour mener à bien la révolution : "Disons avec la Bible et les Russes : ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Ceux qui ne travaillent pas ne recevront que ce dont les actifs pourront se passer" ; le flirt avec la reprise de l’activité parlementaire : "Notre attitude à l'égard du parlementarisme montre que pour nous la question de la tactique se pose différemment des syndicalistes révolutionnaires. (...) Et comme l’ensemble de la vie du peuple est quelque chose de vivant, de changeant, un processus qui prend constamment de nouvelles formes, toute notre stratégie doit ainsi aussi s'adapter en permanence aux nouvelles conditions" ; et pour finir la tendance à considérer le débat politique permanent, en particulier sur les questions fondamentales, comme quelque chose qui n’est pas positif : "Nous devons prendre des mesures contre les gens qui nous rendent difficile de planifier la vie du parti. Le parti est une communauté de combat unie et non un club de discussions. Nous ne pouvons pas continuellement avoir des discussions sur les formes d’organisation et autres."
Le Parti communiste tentait ainsi de se débarrasser des syndicalistes-révolutionnaires également membres du Parti communiste. En juin 1919, dans son appel Aux syndicalistes-révolutionnaires du Parti communiste !, celui-ci les présente certes comme "remplis d'honnêtes aspirations révolutionnaires." Mais le KPD définit cependant leur combativité comme un risque tendanciel au putschisme et leur pose l’ultimatum suivant : ou bien ils s'organisent dans un parti strictement centralisé ; ou bien "Le Parti communiste d'Allemagne ne peut pas tolérer dans ses rangs des membres qui, dans leur propagande par la parole, l'écriture et l'action, contreviennent à ces principes. Il se voit contraint de les exclure." Compte tenu de l’amorce de confusions et de dilution des positions du Congrès de fondation du Parti communiste, cet ultimatum sectaire contre les syndicalistes révolutionnaires était plutôt une expression d'impuissance face au reflux de la vague révolutionnaire en Allemagne. Il a privé le Parti communiste du contact vivant avec les parties les plus combatives du prolétariat. L'échange de coups entre le KPD et les syndicalistes révolutionnaires au cours de l'été 1919 montre également que l’atmosphère de défaite accompagnée de tendances renforcées à l'activisme forme une combinaison défavorable à la clarification politique.
Un bref cheminement commun avec les Unions
Au cours de l'été de 1919, l'atmosphère en Allemagne se caractérisait d'une part par une grande déception consécutive aux défaites et, d'autre part, par une radicalisation de certaines parties de la classe ouvrière. Il se produisit des défections en masse dans les syndicats sociaux-démocrates, et un afflux massif vers la FVDG, qui doubla le nombre de ses membres.
En plus des syndicalistes révolutionnaires il commença à se développer un second courant contre les syndicats traditionnels, lui aussi alimenté par un important afflux. Dans la région de la Ruhr apparurent l’Allgemeine Arbeiter Union-Essen (AAU-E : Union Générale des Travailleurs – Essen) et l'Allgemeine Bergarbeiter Union (Union générale des mineurs) sous l'influence de fractions de radicaux de gauche au sein du Parti communiste de Hambourg, et soutenues par la propagande active de regroupements proches des International Workers of the World (IWW) américains autour de Karl Dannenberg à Brunswick. À l’inverse de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire, les Unions voulaient abandonner le principe d’organisation syndicale par branches d’industrie pour regrouper la classe ouvrière par entreprises entières dans des "organisations de combat". De leur point de vue, c’étaient désormais les entreprises qui exerçaient leur force et possédaient une puissance dans la société et c’est de là, par conséquent, que la classe ouvrière tire sa force - quand elle s'organise conformément à cette réalité. Ainsi, les Unions recherchaient-elles une plus grande unité et considéraient les syndicats comme une forme historiquement obsolète de l'organisation de la classe ouvrière. On peut dire que les Unions constituaient d’une certaine façon une réponse de la classe ouvrière à la question qui lui était posée concernant de nouvelles formes d'organisation ; la question même que le courant syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne a cherché à éviter jusqu'à aujourd'hui 19.
Nous ne pouvons pas dans cet article développer notre analyse sur la nature des Unions, qui ne sont ni des conseils ouvriers, ni des syndicats, ni des partis. Pour cela il faudra y revenir dans un texte spécifique.
Il est souvent difficile dans cette phase de distinguer précisément les courants unioniste et syndicaliste-révolutionnaire. Au sein des deux courants il existait des réticences vis-à-vis des "partis politiques", même si les Unions étaient finalement beaucoup plus proches du Parti communiste. Ces deux tendances constituaient une expression directe des fractions les plus combatives de la classe ouvrière en Allemagne, se positionnaient contre la social-démocratie et préconisaient, au moins jusqu'à la fin 1919, le système des conseils.
Dans une première phase qui va jusqu'à l'hiver 1919-20, le courant unioniste dans la région de la Ruhr s’incorpora au mouvement syndicaliste révolutionnaire, qui était plus fort, avec la Conférence dite ‘de fusion’ des 15-16 septembre 1919 à Düsseldorf. Les unionistes prirent part ainsi à la fondation de la Freie Arbeiter Union (FAU) de Rhénanie-Westphalie. Cette Conférence était la première étape vers la création de la FAUD, qui devait avoir lieu trois mois plus tard. La FAU-Rhénanie-Westphalie exprimait dans son contenu un compromis entre le syndicalisme-révolutionnaire et l’unionisme. Les lignes directrices adoptées disaient que "(...) la lutte économique et politique doit être menée avec conséquence et fermeté par les travailleurs (...)" et que "en tant qu’organisation économique, la Freie Arbeiter Union ne tolère aucune politique de parti dans ses réunions, mais laisse à la libre appréciation de chaque membre d’adhérer aux partis de gauche et d’y exercer une activité s’il l’estime nécessaire."20 L’Allgemeine Arbeiter Union-Essen et l'Allgemeine Bergarbeiter Union allaient se retirer en grande partie de l'Alliance avec les syndicalistes-révolutionnaires dès avant la fondation de la FAUD en décembre.
La fondation de la FAUD et sa Déclaration de principes
La croissance numérique rapide de la FVDG au cours de l'été et de l’automne 1919, la propagation du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Thuringe, en Saxe, en Silésie, dans le Sud de l'Allemagne, dans les régions côtières de la Mer du Nord et de la Baltique réclamaient une structuration du mouvement au plan national. Le 12ème Congrès de la FVDG du 27 au 30 décembre à Berlin, se transforma en Congrès de fondation de la FAUD, auquel participent 109 délégués.
Ce Congrès est souvent décrit comme le "tournant" du syndicalisme révolutionnaire allemand vers l'anarcho-syndicalisme ou comme le début de l’ère Rudolf Rocker – une étiquette utilisée surtout par les adversaires catégoriques du syndicalisme-révolutionnaire y voyant un "pas en avant dans le sens négatif". La plupart du temps, on montre du doigt dans la fondation de la FAUD l’apologie du fédéralisme, les adieux à la politique, le rejet de la dictature du prolétariat et le retour au pacifisme. Cette analyse ne rend cependant pas justice à la FAUD de décembre 1919. "L'Allemagne est l'eldorado des slogans politiques. On prononce des paroles, on se grise de leurs flonflons sans se rendre compte du véritable sens de celles-ci" commente Rocker (que nous citons ci-dessous) dans son discours sur la Déclaration de principes à propos des allégations portées contre les syndicalistes-révolutionnaires.
Il ne fait aucun doute que les idées de Rocker, anarchiste resté internationaliste durant la guerre et rédacteur de la nouvelle Déclaration de principes, acquirent une influence notable au sein de la FAUD, favorisée par sa présence physique au sein de cette organisation. Mais la fondation de la FAUD reflètait d'abord et avant tout la popularité des idées syndicalistes-révolutionnaires au sein de la classe ouvrière en Allemagne et indiquait une claire démarcation vis-à-vis du Parti communiste et de l’unionisme naissant. Les positions fortes que la FVDG avait propagées depuis la fin de la guerre au sein de la classe ouvrière, l’expression de sa solidarité envers la Révolution russe, le rejet explicite de la démocratie bourgeoise et de toute forme d’activité parlementaire, la récusation de toutes "les frontières politiques et nationales arbitrairement tracées" étaient réaffirmés dans la Déclaration de principes de décembre 1919. La FAUD se situait ainsi sur le terrain des positions révolutionnaires.
Par rapport au programme de la FVDG du printemps 1919, le Congrès prit une plus grande distance critique vis-à-vis de l'enthousiasme envers la perspective des conseils ouvriers. Les signes d’affaiblissement des conseils ouvriers en Russie étaient pour le Congrès la marque du risque global latent que présentent les "partis politiques", et la preuve que la forme syndicale d'organisation est plus résistante et défend mieux l’idée des conseils 21. La dépossession des conseils ouvriers de leur pouvoir en Russie à cette époque était en effet une réalité et les Bolcheviks y avaient tragiquement contribué. Mais ce que la FAUD ne voyait pas dans son analyse, c’était tout simplement le carcan de l'isolement international de la révolution russe qui devait inévitablement conduire à l’asphyxie de la vie de la classe ouvrière.
"On nous combat, nous syndicalistes-révolutionnaires, principalement parce que nous sommes des partisans déclarés du fédéralisme. Les fédéralistes, nous dit-on, sont les diviseurs des luttes ouvrières", dit Rocker. L'aversion de la FAUD vis-à-vis du centralisme et son engagement en faveur du fédéralisme ne se fondaient pas sur une vision de la fragmentation de la lutte des classes. La réalité et la vie du mouvement syndicaliste révolutionnaire après la guerre ont suffisamment fait la preuve de son engagement pour l'unité et la coordination de la lutte. Le rejet exagéré de la centralisation trouvait ses racines dans le traumatisme de la capitulation de la social-démocratie : "Les comités centraux ordonnaient d’en haut, les masses obéissaient. Puis vint la guerre ; le parti et les syndicats étaient confrontés à un fait accompli : nous devons soutenir la guerre pour sauver la patrie. Désormais, la défense de la patrie devint un devoir socialiste, et les mêmes masses qui, la semaine précédente, protestaient contre la guerre, étaient désormais pour la guerre, mais sur ordre de leurs comités centraux. Cela vous montre les conséquences morales du système de la centralisation. La centralisation, c’est l'extirpation de la conscience du cerveau de l'homme, et rien d’autre. C’est la mort du sentiment d'indépendance." Pour beaucoup de militants de la FAUD, le centralisme était dans son principe même une méthode héritée de la bourgeoisie dans "(...) l'organisation de la société de haut en bas, afin de maintenir les intérêts de la classe dominante." Nous sommes absolument d'accord avec la FAUD de 1919 que c'est la vie politique et l'initiative de la classe ouvrière "par en bas" qui sont porteuses de la révolution prolétarienne. La lutte de la classe ouvrière doit être menée solidairement, et en ce sens, il s’engendre toujours spontanément une dynamique à l'unification du mouvement, et donc à sa centralisation au moyen de délégués élus et révocables. "L'eldorado des slogans politiques" a incité la majorité des syndicalistes révolutionnaires de la FAUD en décembre 1919 à s’affubler du slogan du fédéralisme, une étiquette qui ne représentait pas la véritable tendance après la fondation de la FAUD.
Le Congrès de fondation de la FAUD a-t-il effectivement rejeté l'idée de "dictature du prolétariat" ? "Si sous le terme de la dictature du prolétariat on entend la prise en main de la machine de l’État par un parti, si l’on entend là uniquement l’établissement d’un nouvel État, alors les syndicalistes-révolutionnaires sont les ennemis jurés d'une telle dictature. Si par contre on veut dire que le prolétariat va dicter aux classes possédantes de renoncer à leurs privilèges, s’il ne s’agit pas de la dictature du haut vers le bas, mais de la répercussion de la révolution du bas vers le haut, alors les syndicalistes révolutionnaires sont des partisans et des représentants de la dictature du prolétariat." 22 Absolument juste ! La réflexion critique sur la dictature du prolétariat, qui à ce moment-là était associée à la situation dramatique en Russie, était une question légitime à l'égard du risque de dégénérescence interne de la révolution en Russie. Il n’était pas encore possible de faire le bilan de la révolution russe en décembre 1919. Les assertions de Rocker étaient plus un baromètre des contradictions déjà perceptibles, et le tout début d'un débat qui durera des années dans le mouvement ouvrier sur les raisons de l'échec de la vague révolutionnaire mondiale après la guerre. Ces doutes n’émergèrent pas par hasard dans une organisation comme la FAUD, laquelle devait fortement fluctuer avec les hauts et les bas de la vie "à la base" de la classe ouvrière.
Même le catalogage classique du Congrès de fondation de la FAUD comme "étape vers le pacifisme" qui sans aucun doute sabote la détermination de la classe ouvrière, ne correspond pas à la réalité. Comme la discussion sur la dictature du prolétariat, les débats sur la violence dans la lutte des classes a été plutôt le signe d'un véritable problème auquel était confrontée la classe ouvrière au plan international. À l’aide de quels moyens est-il possible de maintenir l’élan de la vague révolutionnaire qui marque le pas et de briser l'isolement de la classe ouvrière en Russie ? En Russie, comme en Allemagne il était inévitable pour la classe ouvrière d’utiliser des armes pour se défendre contre les attaques de la classe dominante. Mais l’extension de la révolution par des moyens militaires, voire la "guerre révolutionnaire" était impossible, si ce n'est absurde. Particulièrement en Allemagne, la bourgeoisie tentait avec perfidie de provoquer en permanence le prolétariat militairement. "L'essence de la révolution ne réside pas dans l’utilisation de la violence, mais dans la transformation des institutions économiques et politiques. La violence en soi n'est absolument pas révolutionnaire, mais au contraire réactionnaire au plus haut degré. (...) Les révolutions sont la conséquence d'une grande transformation spirituelle dans les opinions des hommes. Elles ne peuvent pas s’accomplir arbitrairement par la force des armes (...) Mais je reconnais aussi la violence comme un moyen de défense, lorsque les conditions elles-mêmes nous refusent tout autre moyen", argumente Rocker contre Krohn, un défenseur du Parti communiste. Les événements tragiques de Cronstadt en 1921 ont confirmé que l’attitude critique envers les faux espoirs que les armes puissent sauver la révolution, n'a rien à voir avec le pacifisme. La FAUD, dans la foulée de son Congrès fondateur, n’a pris aucune position pacifiste. Une grande partie de l'Armée Rouge de la Ruhr qui a riposté au putsch de Kapp au printemps de 1920 était formée de syndicalistes-révolutionnaires.
Dans le présent article, c'est intentionnellement que, par delà nos critiques, nous avons également fait ressortir les points forts des positions des syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne à l'époque de 1918-19. La partie suivante de notre article traitera de la période allant de la fin des années 1920 jusqu’à l’avènement d'Hitler en 1933 et la destruction de la FAUD.
Mario (16/ 6/ 2012)
1 Der Syndikalist n° 1, "Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!", 14 décembre 1918
2 Ibidem
3 Voir Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag
4 Richard Müller, 1918: Räte in Deutschland, p. 3
5 Richard Müller, Hie Gewerkschaft, hie Betriebsorganisation!‘, 1919
66 Discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD par R. Rocker.
7 Protokoll der Ersten Generalversammlung des Deutschen Eisenbahnerverbandes in Jena, 25-31 mai 1919, p. 244
8 Der Syndikalist n°36, „Betriebsräte und Syndikalismus“, 1919
9 Plus largement, au-delà de l’illusion des comités d’entreprise comme "partenaires de négociation" avec le capital, il existait celle, émanant de la Ruhr à Essen – mais présente aussi dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires – de la possibilité de la "socialisation" immédiate, c'est-à-dire la nationalisation des mines et des entreprises. Cette faiblesse commune à l’ensemble de la classe ouvrière en Allemagne constituait avant tout une expression de son impatience. Le gouvernement Ebert créa dès le 4 décembre 1918 à l’échelle nationale une commission à la socialisation comprenant des représentants du capital et des sociaux-démocrates renommés tels que Kautsky et Hilferding. Ceci dans le but déclaré du maintien de la production grâce aux nationalisations.
10 Voir à ce propos les débats du 15ème Congrès de la FAUD en 1925.
11 Der Syndikalist n°2, „Verschandelung der Revolution“, 21 décembre 1918
12 Der Syndikalist n°1, „Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!“, 14 décembre1918
13 Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag, p. 70
14 Karl Roche in Der Syndikalist n°13, „Syndikalismus und Revolution“, 29 mars 1919
15 Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Ed. Suhrkamp, p. 287
16 Roche écrit : "La politique de parti est la méthode bourgeoise de lutte pour s’accaparer le produit du travail extorqué aux ouvriers. (...) Les partis politiques et les parlements bourgeois sont complémentaires, ils entravent tous les deux la lutte de classe prolétarienne et produisent la confusion." comme si la possibilité de partis révolutionnaires de la classe ouvrière n’existait pas. Qu’en est-il du compagnon de lutte de la Ligue Spartacus, qui était un parti politique ?
17 Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der „Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften“, mars 1919
18 Syndikalismus und Kommunismus, F. Brandt, KPD-Spartakusbund, août 1919
19 En réalité, beaucoup de sections de la FAU en Allemagne telles qu'elles existent aujourd'hui, jouent depuis des décennies bien plus un rôle de groupe politique que de syndicat, en s’exprimant sur de nombreuses questions politiques et en ne se limitant nullement à la "lutte économique" - ce que nous, en dehors de savoir si nous sommes d'accord ou non, trouvons positif.
20 Der Syndikalist, n° 42, 1919
21 En dépit de la méfiance à l'égard des partis politiques existants Rocker affirmait clairement que : "(...) la lutte n'est pas seulement économique, mais doit aussi être une lutte politique. Nous disons la même chose. Nous rejetons seulement l'activité parlementaire, mais en aucune manière la lutte politique en général. (...) Même la grève générale est un outil politique tout comme la propagande antimilitariste des syndicalistes-révolutionnaires, etc." Le rejet théorisé de la lutte politique ne dominait pas la FAUD à cette époque, bien que sa forme d’organisation ait été clairement conçue pour la lutte économique.
22 Rocker, Der Syndikalist, n°2, 1920
Courants politiques:
Rubrique:
Revue Internationale 2013 - n° 151 - 154
- 1814 lectures
Revue Internationale n°151 - du 1er janvier au 30 avril 2013
- 1313 lectures
Avancées scientifiques et décomposition du capitalisme: les contradictions du système compromettent l’avenir de l’humanité
- 1877 lectures
En quoi le présent préfigure-t-il l’avenir de l’humanité ? Est-il encore envisageable de parler de progrès ? Quel futur se prépare pour nos enfants et les générations futures ? Pour répondre à ces questions que chacun peut se poser aujourd’hui de manière angoissante, il nous faut opposer deux legs du capitalisme dont dépendra la société future : d’un côté, le développement des forces productives qui sont en elles-mêmes des promesses d'avenir, notamment avec les découvertes scientifiques et les avancées technologiques que ce système est encore capable de porter ; de l’autre, la décomposition du système, qui menace d’annihiler tout progrès et compromet l’avenir même de l’humanité, et qui résulte inexorablement des contradictions du capitalisme. La première décennie du XXIe siècle montre que les phénomènes traduisant la décomposition du système, le pourrissement sur pied d'une société malade 1, prennent une ampleur croissante, ouvrant les portes aux démarches les plus irrationnelles, aux catastrophes en tout genre, générant une sorte d'atmosphère de "fin du monde" qu’exploitent les états avec cynisme pour faire régner la terreur et pour maintenir ainsi leur emprise sur des exploités de plus en plus mécontents.
C’est un contraste complet, une contradiction permanente qui existe entre ces deux réalités du monde actuel et qui justifie pleinement l’alternative posée il y a un siècle par le mouvement révolutionnaire, et notamment Rosa Luxemburg reprenant la formule d’Engels : ou bien le passage au socialisme ou bien la plongée dans la barbarie.
Quant aux potentialités positives que porte le capitalisme, c'est classiquement, du point de vue du mouvement ouvrier, le développement des forces productives qui constitue le sous-bassement de l'édification de la future communauté humaine. Celles-ci sont principalement constituées par trois éléments étroitement liés et conjugués dans la transformation efficace de la nature par le travail humain : les découvertes et progrès scientifiques, la production d’outils et d’un savoir-faire technologique de plus en plus sophistiqués et la force de travail fournie par les prolétaires. Tout le savoir accumulé dans ces forces productives serait utilisable au sein de l’édification d’une autre société, de même, ces dernières seraient décuplées si l’ensemble de la population mondiale était intégrée au sein de la production sur base d’une activité et d’une créativité humaine, au lieu d'en être rejetées de façon croissante par le capitalisme. Sous le capitalisme, la transformation, la maîtrise comme la compréhension de la nature n’est pas un but au service de l'humanité, la majeure partie de celle-ci étant exclue du bénéfice du développement des forces productives mais une dynamique aveugle au service du profit 2.
Les découvertes scientifiques au sein du capitalisme ont été nombreuses - et pas des moindres - dans la seule année 2012. De même de véritables prouesses technologiques ont été parallèlement accomplies dans tous les domaines, démontrant l’étendue du génie et du savoir-faire humains.
Les avancées scientifiques : un espoir pour l´avenir de l’humanité
Nous illustrerons notre propos à travers seulement quelques exemples 3 et laisserons volontairement de côté beaucoup de découvertes ou réalisations technologiques récentes. En effet, notre objectif ne vise pas à l'exhaustivité mais à illustrer comment l'homme dispose d'un ensemble croissant de possibilités, concernant la connaissance théorique et des avancées technologiques, qui lui permettraient de maîtriser la nature dont il fait partie, de même que son propre organisme. Les trois exemples de découvertes scientifiques que nous donnons touchent à ce qu'il y a de plus fondamental dans la connaissance et qui a été au cœur des préoccupations de l'humanité depuis ses origines :
qu'est-ce que la matière qui compose l'univers et quelle est l'origine de celui-ci ;
d'où vient notre espèce, l'espèce humaine ;
comment guérir de la maladie.
Une meilleure connaissance des particules élémentaires et des origines de l'univers
La recherche fondamentale, bien que ne contribuant généralement pas à des découvertes ayant une application immédiate, constitue néanmoins une composante essentielle de la connaissance de la nature par l'homme et, partant, de sa capacité à en pénétrer les lois et les propriétés. C'est de ce point de vue qu'il faut apprécier la récente mise en évidence de l'existence d'une nouvelle particule, très proche à de nombreux égards de ce qui est appelé le Boson de Higgs, après une traque acharnée au moyen d'expériences menées au CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) de Genève ayant mobilisé 10 000 personnes pour mettre en œuvre l’accélérateur de particules LHC. La nouvelle particule a cette propriété unique de conférer leur masse aux particules élémentaires, à travers son interaction avec celles-ci. En fait, sans elle, tout élément de l'univers ne pèserait rien. Elle permet aussi une approche plus fine de la compréhension de la naissance et du développement de l'univers. L'existence de cette nouvelle particule avait été prédite théoriquement en 1964 par Peter Higgs (en même temps que deux physiciens belges, Englert et Brout). Depuis lors, la théorie de Higgs a été l'objet de débats et de développements dans le milieu scientifique qui ont abouti à la mise en évidence de l'existence réelle, et plus seulement théorique, de la particule en question.
Un ancêtre potentiel des vertébrés ayant vécu il y a 500 millions d'années
Illustrant la théorie darwinienne et matérialiste de l'évolution, deux chercheurs anglais et canadiens ont mis en évidence que, cent ans après sa découverte, l'un des plus anciens animaux ayant peuplé la planète, Pikaia gracilens était un ancêtre des vertébrés. Ils ont procédé à un examen des fossiles de l'animal réalisé par différentes techniques d'imagerie qui leur a permis de décrire précisément son anatomie externe et interne. Grâce à un type particulier de microscope à balayage, ils ont réalisé une cartographie élémentaire de la composition chimique des fossiles en carbone, soufre, fer et phosphate. Se référant à la composition chimique des animaux actuels, ils en ont alors déduit où se trouvaient les différents organes chez Pikaia. Où placer Pikaia dans l'arbre de l'évolution ? En prenant en compte également d'autres facteurs comparatifs avec d'autres espèces voisines découvertes dans d'autres régions de la planète, ils concluent : "quelque part à la base de l'arbre des chordés", les chordés étant des animaux qui possèdent une colonne vertébrale ou une préfiguration de celle-ci. Ainsi, cette découverte permet de reconstituer un des "chaînons manquants" dans la longue chaine des espèces vivantes qui ont peuplé notre planète depuis plusieurs milliards d'années et qui sont nos ancêtres.
Vers la guérison totale du Sida
Depuis le début des années 1980, le Sida est devenu le principal fléau épidémique de la planète. Près de 30 millions de personnes en sont déjà mortes et, malgré les moyens énormes mis en œuvre pour le combattre et l'emploi des trithérapies, il tue encore 1,8 millions de personnes par an 4, loin devant d'autres maladies infectieuses particulièrement meurtrières comme le paludisme ou le rougeole. Un des aspects les plus sinistres de cette maladie consiste dans le fait que la personne qui en est victime, même si elle n'est pas maintenant condamnée à une mort certaine comme c'était le cas au début de l'épidémie, reste infectée toute sa vie, ce qui la soumet, outre l'ostracisme d'une partie de la population, à des médications extrêmement contraignantes. Et justement, une étape majeure dans la guérison des personnes infectées par le virus du Sida (VIH) a été franchie cette année par une équipe de l'université de Caroline du Nord. Le médicament qu'elle a testé sur huit séropositifs n'a rien à voir avec les traitements actuels, les antirétroviraux. En bloquant la multiplication du VIH, ces derniers réduisent sa concentration dans l'organisme des séropositifs, jusqu'à le rendre indétectable. Mais ils ne l'éradiquent pas et ne guérissent donc pas les malades. En effet, dès le début de l'infection, des exemplaires du virus se cachent dans certains globules blancs à longue vie, échappant ainsi à l'action des antirétroviraux. D'où, l'idée de détruire une bonne fois pour toutes ces "réservoirs" de VIH grâce à l'action d'un médicament dont l'action permettrait de rendre les globules blancs en question repérables par le système immunitaire qui pourra alors les détruire. Le médicament testé a permis de façon prometteuse d'activer la détection des "réservoirs". Reste à s'assurer de leur destruction par le système immunitaire, voire même stimuler celui-ci dans ce but.
Il faut d’emblée remarquer que les découvertes scientifiques actuelles et le développement de la technologie se produiraient dans un autre type de société, en particulier dans une société communiste, où elles auraient encore été largement surpassées. En effet, le mode de production capitaliste axé sur le profit, la rentabilité et la concurrence, marqué par la gabegie et l’irrationalité, mais aussi par l’altération, l’aliénation et souvent la destruction des rapports sociaux, constitue un obstacle sérieux au développement de ces forces productives. Néanmoins, cela reste un aspect positif de la société actuelle qui est encore capable de produire de telles choses, même si elle en entrave considérablement la réalisation. Par contre, la décomposition telle qu’elle se présente aujourd’hui est propre au capitalisme. Plus longtemps ce dernier se maintiendra, plus cette décomposition constituera un boulet de plus en plus lourd pour le futur, plus elle l'oblitèrera.
La projection morbide du capitalisme menace d’engloutir l’humanité
La réalité de ce monde au quotidien, c’est que la crise du capitalisme qui est réapparue et qui s'aggrave toujours plus depuis des décennies est la cause de l'enfoncement dans des difficultés de vivre toujours plus grandes ; et c'est parce que ni la bourgeoisie, ni la classe ouvrière n'ont réussi à dégager une perspective pour la société que les structures sociales, les institutions sociales et politiques, le cadre idéologique qui permettaient à la bourgeoisie de maintenir la cohésion de la société, se désagrègent toujours un peu plus. La décomposition, dans toutes ses dimensions et ses manifestations actuelles, illustre toutes les potentialités morbides de ce système qui menacent d’engloutir l’humanité. Le temps ne joue pas en faveur du prolétariat. C’est une "course contre la montre" que ce dernier a engagée dans son combat contre la bourgeoisie. De l'issue de ce combat entre les deux classes déterminantes de la société actuelle, de la capacité du prolétariat à porter les coups décisifs contre son ennemi avant qu'il ne soit trop tard, dépend l’avenir de l’espèce humaine.
Derrière les tueries de déséquilibrés, il y a l'irrationalité du capitalisme qui nous condamne à vivre dans un monde n'ayant plus de sens
Une des manifestations les plus frappantes et spectaculaires de cette décomposition a été encore récemment le massacre dans l’école élémentaire de Sandy Hook à Newtown (Connecticut) aux États-Unis le 14 décembre 2012. Comme lors des drames précédents, l'horreur de ce massacre sans mobile de 27 enfants et adultes par une seule personne a de quoi glacer le sang. Or, c'est le treizième événement de ce genre dans ce pays pour la seule année 2012.
Le massacre de vies innocentes à l’école est un rappel horrible de la nécessité d’une transformation révolutionnaire complète de la société. La propagation et la profondeur de la décomposition du capitalisme ne peuvent qu’engendrer d’autres actes aussi barbares, insensés et violents. Il n’y a absolument rien dans le système capitaliste qui puisse fournir une explication rationnelle à un tel acte et encore moins rassurer sur le futur d'une telle société.
Au lendemain de la tuerie dans l’école du Connecticut, et comme cela a également été le cas pour d’autres actes violents, tous les partis de la classe dirigeante ont soulevé un questionnement : comment est-il possible qu'à Newtown, réputée pour être la ville "la plus sûre d'Amérique", un individu dérangé ait trouvé le moyen de déchaîner tant d’horreur et de terreur ? Quelles que soient les réponses proposées, la première préoccupation des médias est de protéger la classe dirigeante et de dissimuler son propre mode de vie meurtrier. La justice bourgeoise réduit le massacre à un problème strictement individuel, suggérant en effet que le geste d’Adam Lanza, le meurtrier, s’explique par ses choix, sa volonté personnelle de faire le mal, penchant qui serait inhérent à la nature humaine. Niant tous les progrès réalisés depuis de nombreuses décennies par les études scientifiques sur le comportement humain qui, pourtant, permettent de mieux comprendre l’interaction complexe entre l’individu et la société, la justice prétend que rien n’explique l’action du tireur et avance comme solution le renouveau de la foi religieuse et la prière collective !
C’est également ainsi qu'elle justifie sa proposition d’emprisonner tous ceux qui relèvent d’un comportement déviant, en réduisant leurs crimes à un acte immoral. La nature de la violence ne peut pas être comprise si on la dissocie du contexte social et historique où elle s’exprime car elle est précisément fondée sur des rapports d’exploitation et d’oppression d’une classe dominante sur l’ensemble de la société. Les maladies mentales existent depuis longtemps, mais il ressort que leur expression a atteint son paroxysme dans une société en état de siège, dominée par le "chacun pour soi", par la disparition de la solidarité sociale et de l’empathie. Les gens pensent qu’ils doivent se protéger… contre qui, d'ailleurs ? Tout le monde est considéré comme un ennemi potentiel et c’est une image, une croyance renforcée par le nationalisme, le militarisme et l’impérialisme de la société capitaliste.
Pourtant la classe dirigeante se présente comme le garant de la "rationalité" et contourne soigneusement la question de sa propre responsabilité dans la propagation des comportements antisociaux. Ceci est encore plus flagrant lors des jugements par la cour martiale de l’armée américaine des soldats ayant commis des actes atroces, comme dans le cas de Robert Bales qui a massacré et tué 16 civils en Afghanistan, dont 9 enfants. Pas un mot, naturellement, sur sa consommation d’alcool, de stéroïdes et de somnifères pour calmer ses douleurs physiques et émotionnelles, ni sur le fait qu’il a été envoyé sur l’un des champs de bataille les plus meurtriers d'Afghanistan pour la quatrième fois !
Et les États-Unis ne sont pas le seul pays à connaître de telles abominations : en Chine, par exemple, le jour même du massacre de Newtown, un homme a blessé avec un couteau 22 enfants dans une école. Mais au cours des 30 dernières années, de nombreux actes similaires ont été perpétrés. Bien d'autres pays, l'Allemagne par exemple, autre pays du cœur du capitalisme, ont aussi connu de telles tragédies dont la tuerie d’Erfurt en 2007 et la surtout la fusillade, qui s'est déroulée le 11 mars 2009 au collège Albertville-Realschule, à Winnenden dans le Bade-Wurtemberg, qui a fait seize morts dont l'auteur des coups de feu. Cet événement présente beaucoup de similitudes avec le drame de Newtown.
L'extension internationale du phénomène montre qu'attribuer ces tueries au droit à la possession d'armes est avant tout de la propagande médiatique. En réalité, il existe de plus en plus d'individus, qui se sentent tellement écrasés, isolés, incompris, rejetés que les tueries perpétrées par des individus isolés ou les tentatives de suicide des jeunes sont de plus en plus nombreuses ; et le fait même du développement de cette tendance montre que face à la difficulté qu'ils ont de vivre, ils ne voient aucune perspective de changement qui leur permettrait d'espérer une évolution positive de leurs conditions de vie. Bien des trajectoires peuvent aboutir à de telles extrémités : chez les enfants, une présence insuffisante des parents parce que surchargés de travail ou rongés et moralement affaiblis par l’anxiété qu’entraîne le chômage et des revenus trop faibles ou, chez les adultes, un sentiment de haine et de frustrations accumulés face au sentiment de "ratage" de leur existence.
Cela provoque de telles souffrances et de tels troubles chez certains qu'ils en rendent responsables l'ensemble de la société et en particulier l'école, une des institutions essentielles par laquelle l'intégration du jeune dans la société est censée se faire, devant normalement ouvrir sur la possibilité de trouver un emploi mais qui n'ouvre souvent que sur le chômage. Cette institution, qui est devenue en fait le lieu où se créent de multiples frustrations et où s'ouvrent bien des blessures, est aussi devenue une cible privilégiée, parce que symboles de l'avenir bouché, de la personnalité et des rêves détruits. Le meurtre aveugle en milieu scolaire – suivi par le suicide des meurtriers –, apparaît alors comme le seul moyen de montrer sa souffrance et d'affirmer son existence.
Derrière la campagne sur le fait de poster des policiers à la porte des écoles, l'idée qui est instillée est celle de la méfiance à l'égard de tout le monde, ce qui vise à empêcher ou détruire tout sentiment de solidarité au sein de la classe ouvrière. Tout ceci est à l’origine de l’obsession de la mère d’Adam Lanza pour les armes à feu et de son habitude d’emmener ses enfants, y compris son fils, sur les stands de tir. Nancy Lanza est une "survivaliste". L’idéologie du "survivalisme" est fondée sur le "chacun pour soi" dans un monde pré et post-apocalyptique. Elle prône la survie individuelle, en faisant des armes un moyen de protection permettant de mettre la main sur les rares ressources vitales. En prévision de l’effondrement de l’économie américaine, qui est sur le point de survenir selon les survivalistes, ces derniers stockent des armes, des munitions, de la nourriture et s'enseignent des moyens de survivre à l’état sauvage. Est-ce si étrange qu’Adam Lanza ait pu être envahi par ce sentiment de "no future" ? D'un autre côté, cela signifie que l'on ne peut avoir confiance que dans l’État et dans la répression qu'il mène alors qu'il est le gardien du système capitaliste qui est la cause de la violence et des horreurs que nous sommes en train de vivre. Il est naturel d’éprouver de l’horreur et une très grande émotion face au massacre d’innocentes victimes. Il est naturel de chercher des explications à un comportement complètement irrationnel. Cela traduit un besoin profond d’être rassuré, d’avoir la maîtrise de son destin et de sortir l’humanité d’une spirale sans fin d’extrême violence. Mais la classe dirigeante profite des émotions de la population et utilise son besoin de confiance pour l’amener à accepter une idéologie où seul l’État serait capable de résoudre les problèmes de la société.
Aux États-Unis, ce ne sont pas seulement les marges fondamentalistes du camp républicain, mais toute une série d’idéologies religieuses, créationnistes et autres qui pèsent de tout leur poids sur le fonctionnement de la bourgeoisie et sur les consciences du reste de la population.
Il faut affirmer clairement que c’est le maintien de la société divisée en classes et l’exploitation du capitalisme qui sont les seuls responsables du développement de comportements irrationnels qu’ils sont incapables d'éliminer ou seulement maîtriser.
Où que l’on regarde, le capitalisme est automatiquement dirigé vers la recherche du profit. La gauche peut penser que le capitalisme contemporain subsiste sur une base rationnelle, mais l’expérience présente de la société actuelle révèle une décomposition aggravée, une partie de cette société s’exprimant dans une irrationalité grandissante où les intérêts matériels ne sont plus le seul guide de son comportement. Les expériences de Columbine, de Virginia Tech et de tous les autres massacres perpétrés par des individus isolés montrent qu’on n’a pas besoin d’un motif politique pour commencer à tuer au hasard n’importe lesquels de nos semblables.
La généralisation de la violence : délinquance, banditisme, narcotrafic et mœurs de gangsters de la bourgeoisie
Une vague de délinquance et de banditisme a secoué certaines villes du Brésil, durant les mois d'octobre et novembre 2012. C'est surtout le Grand São Paulo qui a été affecté où 260 personnes ont été assassinées durant cette période. Mais pas seulement, puisque d'autres villes où la criminalité est généralement bien moins élevée ont également été le théâtre de violences.
L'ampleur de la violence est difficilement contestable, de même que ses conséquences sur la population : "La police tue aussi bien que les criminels. C’est à une guerre à laquelle nous avons assisté tous les jours à la télé.", déclarait le directeur de l’ONG Conectas Direitos Humanos. Cette calamité supplémentaire s'ajoute à la misère générale d'une grande partie de la population.
Parmi les explications à cette situation, certaines mettent en cause le système pénitencier, qui crée des criminels au lieu d'aider à la réinsertion sociale. Mais le système pénitentiaire est lui-même un produit de la société et il est à son image. En fait, aucune réforme du système, du système pénitencier ou autre, ne pourra enrayer le phénomène du banditisme et de la répression policière, et donc de la terreur sous toutes ses formes. Et le problème majeur c'est que cela ne pourra qu'empirer avec la crise mondiale de ce système. C'est facilement constatable au niveau du Brésil lui-même. Il y a trente ans de cela, São Paulo qui apparaît aujourd'hui comme la capitale du crime, faisait alors figure de ville tranquille.
Du côté du Mexique, on voit les groupes mafieux et le propre gouvernement enrôler, en vue de la guerre qu'ils se livrent, des éléments appartenant aux secteurs les plus paupérisés de la population. Les affrontements entre ces groupes, qui tirent sans distinction sur la population, laissent des centaines de victimes sur le carreau que gouvernement et mafias qualifient de "dommages collatéraux". Les mafias tirent profit de la misère pour leurs activités liées à la production et au commerce de la drogue ; en particulier en convertissant les paysans pauvres, comme cela avait été le cas en Colombie dans les années 1990, à la production de la drogue. Au Mexique, depuis 2006, ce sont presque soixante mille personnes qui ont été abattues, que ce soit sous les balles des cartels ou celles de l’armée officielle ; une grande partie de ces tués a été victime de la guerre entre cartels de la drogue, mais ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’État, quoi qu’en dise le gouvernement. En effet, chaque groupe mafieux surgit sous la houlette d’une fraction de la bourgeoisie. La collusion des mafias avec les structures étatiques leur permet de "protéger leurs investissements" et leurs activités en général.5
Les désastres humains que provoque la guerre des narcotrafiquants sont présents dans toute l'Amérique latine mais le phénomène de la violence tel que l'illustrent le Brésil ou le Mexique est un phénomène mondial qui est loin d'épargner l'Amérique du Nord ou l'Europe.
Les catastrophes industrielles à grande échelle
Aucune région du monde n'est épargnée par celles-ci et leurs premières victimes sont en général les ouvriers. Leur cause n'est pas le développement industriel en soi, mais le développement industriel entre les mains du capitalisme en crise, où tout doit être sacrifié aux objectifs de la rentabilité pour faire face à la guerre commerciale mondiale.
Le cas le plus emblématique est la catastrophe nucléaire de de Fukushima dont la gravité a encore surpassé celle de Tchernobyl (un million de morts "reconnus" entre 1986 et 2004). Le 11 mars 2011, un gigantesque tsunami inonde les côtes Est du Japon, débordant les digues censés protéger la centrale nucléaire. Plus de 20 000 personnes sont tuées par les inondations, et la population autour de la centrale a dû être évacuée: deux ans plus tard, plus de 300.000 personnes vivent toujours dans des campements de fortune. Face à ce désastre, la classe dominante a encore une fois étalé son incurie. L’évacuation de la population a commencé trop tard et la zone de sécurité s'est révélé insuffisante. Parce qu’il voulait minimiser absolument la perception des dangers réellement encourus, le gouvernement a surtout évité une évacuation à grande échelle et a rendu difficile l'accès de la région aux journalistes indépendants.
Au-delà du débat au Japon sur les défaillances de la compagnie Tepco, ou sur les rapports plus que bienveillants que l'organisme de réglementation de l'industrie nucléaire entretenait avec les entreprises qu'il était censé surveiller, c'est le fait même d'avoir développé le nucléaire au Japon qui constitue une véritable folie alors que ce pays est situé au croisement de quatre grandes plaques tectoniques (les plaques eurasiatique, nord-américaine, des Philippines, et pacifique) et, de ce fait, subit à lui seul 20% des séismes les plus violents du monde).
Dans un pays de haute technologie et surpeuplé comme le Japon, les effets sont encore plus dramatiques pour les populations. La contamination irréversible de l’air, des terres et des océans, l’amas et le stockage des déchets radioactifs, les sacrifices permanents de la protection et de la sécurité sur l’autel de la rentabilité jettent une lumière crue sur la dynamique irrationnelle du système.au niveau mondial.
Les catastrophes "naturelles" et leurs conséquences
Certes, on ne peut reprocher au capitalisme d'être à l'origine d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou de la sècheresse. En revanche, on peut mettre à son passif le fait que tous ces cataclysmes liés aux phénomènes naturels se transforment en immenses catastrophes sociales, en gigantesques tragédies humaines. Ainsi, le capitalisme dispose de moyens technologiques tels qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la lune, de produire des armes monstrueuses susceptibles de détruire des dizaines de fois la planète, mais en même temps il ne donne pas les moyens de protéger les populations des pays exposés aux cataclysmes naturels alors que cela pourrait être fait en construisant des digues, en détournant des cours d'eau, en édifiant des maisons qui puissent résister aux tremblements de terre ou aux ouragans. Cela ne rentre pas dans la logique capitaliste du profit, de la rentabilité et d’économie des coûts.
Mais la plus dramatique des menaces qui pèse sur l'humanité, sur laquelle nous ne pouvons développer ici est celle de la catastrophe écologique 6
La décomposition idéologique du capitalisme
Cette décomposition ne se limite pas au seul fait que le capitalisme, malgré tout le développement des sciences et de sa technologie, se retrouve de plus en plus soumis aux lois de la nature, qu'il est incapable de maîtriser les moyens qu'il a mis en œuvre pour son propre développement. Elle n'atteint pas seulement les fondements économiques du système. Elle se répercute aussi dans tous les aspects de la vie sociale à travers une décomposition idéologique des valeurs de la classe dominante qui entraîne avec elle un écroulement de toute valeur rendant possible la vie en société, notamment à travers un certain nombre de phénomènes :
le développement d'idéologies de type nihiliste, expressions d'une société qui est de plus en plus aspirée vers le néant ;
la profusion des sectes, le regain de l'obscurantisme religieux, y compris dans certains pays avancés, le rejet d'une pensée rationnelle, cohérente, construite, y inclus de la part de certains milieux "scientifiques", et qui prend dans les médias une place prépondérante notamment dans des publicités abrutissantes, des émissions décervelantes ;
le développement du racisme et de la xénophobie, de la peur et donc la haine de l'autre, du voisin ;
le "chacun pour soi", la marginalisation, l'atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l'exclusion des personnes âgées.
La décomposition du capitalisme renvoie l'image d'un monde sans avenir, un monde au bord du gouffre, qui tend à s'imposer à toute la société. C'est le règne de la violence, de la "débrouille individuelle", du "chacun pour soi", de l’exclusion qui gangrène toute la société, et particulièrement ses couches les plus défavorisées, avec son lot quotidien de désespoir et de destruction : chômeurs qui se suicident pour fuir la misère, enfants qu'on viole et qu'on tue, vieillards qu'on torture et assassine pour quelques dizaines d’euros...
Seul le prolétariat peut sortir la société de cette impasse
A propos du sommet de Copenhague fin 2009 7, il avait été dit que c'était l'impasse, que le futur était sacrifié au présent. Ce système a pour seul horizon le profit (pas toujours à court terme), cependant celui-ci est de plus en plus limité (comme l'illustre la spéculation). Il va droit dans le mur mais il ne peut pas faire autrement ! L’ex-candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Al Gore, était-il sincère quand, en 2005, il a présenté son documentaire Une Vérité qui dérange montrant les effets dramatiques du réchauffement climatique sur la planète ? En tous cas, il a pu le faire car il n'était plus "aux affaires" après huit de vice-présidence des États-Unis. Cela signifie que ces gens-là qui dirigent le monde peuvent parfois comprendre le danger encouru mais, quelle que soit leur conscience morale, ils continuent dans la même direction car ils sont prisonniers d'un système qui va à la catastrophe. Il y a un engrenage qui dépasse la volonté humaine et dont la logique est plus forte que la volonté des politiques les plus puissants. Les bourgeois d'aujourd'hui eux-mêmes ont des enfants dont l'avenir les préoccupe… Les catastrophes qui s'annoncent vont toucher d’abord les plus pauvres, mais les bourgeois aussi vont être de plus en plus touchés. La classe ouvrière est non seulement porteuse d'avenir pour elle-même, mais pour l'humanité entière, y compris les descendants des bourgeois actuels.
Après toute une période de prospérité où il a été capable de faire accomplir un bond gigantesque aux forces productives et aux richesses de la société, en créant et unifiant le marché mondial, ce système a atteint depuis le début du siècle précédent ses propres limites historiques, marquant ainsi son entrée dans sa période de décadence. Bilan : deux guerres mondiales, la crise de 1929 et de nouveau la crise ouverte à la fin des années 1960, laquelle n'en finit plus de plonger le monde dans la misère.
Le capitalisme décadent, c'est la crise permanente, insoluble, de ce système qui est elle-même une immense catastrophe pour toute l'humanité, comme le révèle en particulier le phénomène de paupérisation croissante de millions d'êtres humains réduits à l'indigence, à la misère la plus totale.
En se prolongeant, l'agonie du capitalisme confère une qualité nouvelle aux manifestations extrêmes de la décadence en donnant naissance au phénomène de décomposition de celui-ci, phénomène visible depuis les trois dernières décennies.
Alors que dans les sociétés précapitalistes, les rapports sociaux de même que les rapports de production d'une nouvelle société en gestation pouvaient éclore au sein même de l'ancienne société en train de s'effondrer (comme c'était le cas pour le capitalisme qui a pu se développer au sein de la société féodale en déclin), il n'en est plus de même aujourd'hui.
La seule alternative possible ne peut être que l'édification, sur les ruines du système capitaliste, d'une autre société - la société communiste – qui, en débarrassant l'humanité des lois aveugles du capitalisme, pourra apporter une pleine satisfaction des besoins humains grâce à un épanouissement et une maîtrise des forces productives que les lois mêmes du capitalisme rendent impossibles.
En fait, comme c'est bien l'évolution du capitalisme qui est responsable de la chute dans la barbarie actuelle, cela signifie qu'en son sein, la classe qui produit l'essentiel des richesses, qui non seulement n'a aucun intérêt matériel à la perpétuation de ce système mais, au contraire, en constitue la principale classe exploitée, celle-là seule est capable par sa lutte révolutionnaire, d'entraîner à sa suite l'ensemble de population non exploiteuse, de renverser l'ordre social actuel pour ouvrir la voie à une société véritablement humaine : le communisme.
Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis quarante ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la forme ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle. C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique.
À la méfiance de tous qui est diffusée par la bourgeoisie, il faut explicitement opposer la nécessité de la solidarité, ce qui veut dire la confiance entre les ouvriers ; au mensonge de l'État "protecteur", il faut opposer la dénonciation de cet organe qui est le gardien de ce système qui provoque la décomposition sociale. Face à la gravité des enjeux que pose cette situation, le prolétariat doit prendre conscience du risque d'anéantissement qui le menace aujourd'hui. La classe ouvrière doit extraire de toute cette pourriture qu'elle subit quotidiennement, en plus des attaques économiques contre l'ensemble de ses conditions de vie, une raison supplémentaire, une plus grande détermination pour développer ses combats et forger son unité de classe.
Les luttes actuelles du prolétariat mondial pour son unité et sa solidarité de classe constituent l'unique lueur d'espoir au milieu de ce monde en pleine putréfaction. Elles seules sont en mesure de préfigurer un embryon de communauté humaine. C'est de la généralisation internationale de ces combats que pourront enfin éclore les germes d'un monde nouveau, que pourront surgir de nouvelles valeurs sociales.
Wim / Sílvio (février 2013)
1 "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste", disponible en format papier dans la Revue internationale n° 62, 3e trimestre 1990 et sur notre site Web
22 On peut souligner qu’au début du développement de l’informatique, les ordinateurs les plus puissants étaient mis exclusivement au service de l’armée. C’est beaucoup moins vrai aujourd’hui concernant l'ensemble des domaines de pointe, bien que la recherche militaire continue à absorber et à orienter la plus grande partie des avancées de la technologie.
33 Les informations relatives à ces exemples sont pour la plupart extraites d'articles de la revue La Recherche concernant des découvertes effectuées en 2012.
4 Chiffres de l'ONUSIDA pour 2011.
5 Lire l’article "Le Mexique entre crise et narcotrafic" (Revue internationale n° 150).
6 Lire à ce propos Chris Harman, Une histoire populaire de l’humanité : De l’Âge de pierre au nouveau millénaire (2002), en particulier pp. 653-654 de l’édition française, La Découverte, 2011
7 Voir notre article "Sauver la planète ? No, they can't !" (Revue internationale n° 140, 1er trimestre 2010)
Récent et en cours:
- Science [363]
Rubrique:
Moyen-Orient et Afrique du Nord: l'alternative est guerre impérialiste ou guerre de classe
- 2723 lectures
Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, durement touchés par les effets de la crise économique mondiale, ont également été secoués tout au long de 2011 par l'agitation sociale. Les événements qui ont suivi l’immolation de Mohamed Bouazizi ne sont pas, aujourd'hui encore, totalement effacés. Suite à ces événements, certains gouvernements de pays du sud de la Méditerranée ont été amenés à reculer, certains autres ont dû être remplacés. Ces mouvements, qui sont passés à l’histoire sous le nom de "printemps arabe", changent toute la configuration politique de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Face à cette situation, les bourgeoisies régionales, ou mondiales, essaient de rétablir l’équilibre politique.
Il est important de pouvoir analyser la situation en Égypte et en Syrie, deux pays où l’agitation sociale et les conflits perdurent, en y intégrant en particulier des évènements récents : en Égypte, l'exacerbation de l'agitation dans les rues suite à la provocation intervenue à l'occasion d'un match de football dans la ville de Port-Saïd de même que les manifestations contre le régime des Frères Musulmans ; en Syrie, la guerre qui s'installe. Doivent également être prises en compte les tensions impérialistes qui s'exacerbent et attirent l'attention du monde autant que les développements de la crise économique aux États-Unis et dans l’Union Européenne, notamment comme conséquence de la politique agressive de l’Iran, ainsi que des efforts de la Turquie pour devenir un acteur dans la région en choisissant de soutenir l’opposition dans la guerre en Syrie. Si des pays tels que l’Iran, la Turquie et Israël peuvent être caractérisés comme étant les principales puissances régionales, la situation au Moyen-Orient est également déterminée par la politique d'États impérialistes plus puissants : les États-Unis évidemment et, à côté de ceux-ci, la Chine et la Russie, du fait des rapports que ces deux pays entretiennent avec la Syrie et de leur influence en Égypte.
Lorsqu'on analyse les événements, il convient évidemment de les situer dans le cadre international, en prenant en compte la politique de la bourgeoisie et le niveau de la lutte de classe. Il faut également clarifier la nature d'événements de cette région faussement présentés comme des révolutions, en analysant quel y a été le rôle de la classe ouvrière et ce qu'il a signifié quant aux perspectives de développement de la lutte de classe au niveau international. Pour ce faire, la question de la révolution requiert une clarification à laquelle nous procéderons dans cet article sans cependant pouvoir entrer dans les détails.
Un constat s'impose : lorsque les événements ont explosé en Tunisie et se sont étendus à l’Égypte, les ouvriers y ont pris part, même si ce fut de façon limitée. La section en Turquie du CCI a publié un article dans la période où les événements ont eu lieu 1 comportant une analyse de l'importance numérique et de la forme de la participation des ouvriers à ce mouvement. Comme nous le savons, la classe ouvrière n’a pas été capable de prendre la tête du mouvement et de développer une lutte déterminée pour ses propres revendications.
Ennadha (le Parti de la Renaissance) dirigé par Rached Ghannouchi a gagné les élections à l’Assemblée Constituante Nationale qui ont eu lieu le 23 octobre 2011 en Tunisie. Ce parti a ses racines dans la même tradition que celle des Frères Musulmans en Égypte. A la suite des événements qui ont débuté en janvier 2011, l'espoir d'un changement pour la classe ouvrière en Tunisie s’est brisé avec l'arrivée de ce parti au gouvernement et la poursuite d’une exploitation de la force de travail des ouvriers aussi féroce qu'avant. Nous pouvons voir un processus similaire en cours en Egypte sous le gouvernement Morsi.
Pour être à même de voir de plus près ces événements et comprendre leur fondement, il est nécessaire d’analyser les positions des États impérialistes plus puissants ainsi que des impérialismes dans la région. Des pays tels que l’Iran, la Turquie et Israël peuvent être caractérisés comme les principales puissances régionales ; les États impérialistes plus forts qui doivent être pris en compte, à côté des États-Unis évidemment, sont la Chine et la Russie, spécialement en ce qui concerne leurs rapports avec la Syrie et les événements en Egypte.
Les tendances impérialistes de l’Iran et de la Turquie
L'Iran
L’Iran construit sa politique étrangère en fonction du fait qu'il se considère comme étant une puissance régionale au Moyen-Orient. Le facteur le plus déterminant de cette situation est qu'il est l’opposant à Israël le plus puissant de la région. Pour donner plus de poids à ses revendications, il s'efforce d'établir une unité politique, économique et même militaire basée sur l’identité chiite. Parmi les facteurs les plus importants de l'influence chiite dans la région, il y a le fait que le premier ministre d'Irak, Maliki, soit lui-même chiite et que la plus grande faction au pouvoir de l’Irak post-Saddam soit composée de Chiites. Il existe d'autres facteurs de cette influence : le Hezbollah au Liban et le Parti Baas 2, dominé par les Nosairi 3, qui ont gouverné la Syrie depuis 1963. L’Iran entend profiter de cette unité bâtie autour de l'identité sectaire chiite pour en prendre la tête contre Israël tout autant que contre les États-Unis.
L’économie de l’Iran est basée sur le pétrole et le gaz naturel, ce pays possédant 10 % des réserves mondiales de pétrole et 17 % des réserves de gaz naturel. L'État y détient 80 % des investissements économiques. De telles réserves de pétrole confèrent à l’Iran une marge de manœuvre bien plus importante que d'autres économies en développement dans la région.
Les contradictions internes au régime iranien demeurent insolubles, aucune solution n'étant en vue. La raison la plus fondamentale de celles-ci a pour origine la pression économique et politique croissante que la bourgeoisie exerce sur la classe ouvrière en vue de réaliser ses visées impérialistes. Le mouvement qui a eu lieu après les élections iraniennes de 2009 peut bien être décrit comme le début des événements sociaux qui ont constitué ce qu’on appelle le printemps arabe. Alors qu’on a tenté de faire passer ceux qui avaient gagné la rue et rempli la Place Valiasr pour des supporters de Mir-Hossein Mousavi, c’était en réalité la jeunesse ouvrière et au chômage qui s’affrontait aux forces répressives de la bourgeoisie (les Gardiens de la Révolution) dans les rues de Téhéran. Les événements qui ont eu lieu à la suite des 10èmes élections présidentielles peuvent bien avoir été déclenchés par la protestation contre le trucage des élections par Ahmadinedjad, cela n'empêche que le mécontentement qui portait sur différentes questions, était beaucoup plus profond et a commencé rapidement à prendre un caractère de classe. Par la suite, quand Mousavi, un réformiste bourgeois, a appelé à déserter la rue, ses efforts n’ont pas été pris au sérieux par les masses et on lui a même répondu avec des mots d’ordre tels que "Mort à ceux qui font des compromis" ! La plus grande faiblesse de ce mouvement spontané fut qu’il a manqué de revendications de classe et que les ouvriers, pour la plupart, participaient au mouvement en tant qu’individus. Les travailleurs remplissant les rues n’avaient pas fait surgir les organes qui auraient pu donner forme à leur identité de classe et leur permettre de s’exprimer politiquement. En fait, il n’y a eu qu’une seule grève, qui n’a concerné qu’une usine. 4 Le mouvement ouvrier a néanmoins encore un potentiel important en Iran et peut réapparaître dans une période d’instabilité ou dans des conditions économiques plus difficiles. L’expérience des luttes ouvrières en 1979 en Iran quand le Shah a été renversé recèle toujours des leçons importantes pour la classe ouvrière iranienne.
Il faut aussi analyser les rapports entre l’Iran et le capitalisme mondial et le rôle que ce pays joue en son sein. Nous pouvons dire que le partenaire le plus proche de l’Iran est la Russie. Un partenariat stratégique, basé en première instance sur l’armement et l’énergie nucléaire, existe entre les deux pays. À la différence de la Chine, la Russie est un producteur d’énergie et bénéficie jusqu’à un certain point des tensions au Moyen-Orient qui font monter le prix du pétrole. La construction d’usines nucléaires en Iran a suscité chez beaucoup l’idée de la possibilité pour le régime de fabriquer des armes nucléaires plutôt que de produire simplement de l’énergie nucléaire. Cela a eu pour conséquence une certaine distanciation de la Russie vis-à-vis de l'Iran sur la question de l’énergie nucléaire. Néanmoins l’Iran reste son plus gros acheteur d’armes et un partenaire stratégique. L’Iran a signé un accord sur l’énergie pour 20 ans avec son autre partenaire, la Chine. Les rapports entre ces deux pays reposent entièrement sur une base économique. La Chine achète 22 % du pétrole iranien 5, ce qui lui permet de s'approvisionner en sources énergétiques stratégiques. De plus, c'est avantageux pour l’économie chinoise, qui est basée sur des coûts de production bon marché, puisque le prix qui lui est concédé par l'Iran est très intéressant comparé à celui du marché mondial.
Les investissements dans le nucléaire, les efforts pour créer sa propre technologie d’armement et les manœuvres militaires récentes dans le Détroit d’Ormuz, tout cela montre que l’Iran veut associer sa puissance militaire à sa force économique. Cela veut dire être prêt à une guerre régionale ou internationale et avoir son mot à dire au Moyen-Orient grâce à sa force militaire. Les manœuvres dans le Détroit d’Ormuz peuvent être considérées comme un exercice pour s'affirmer contre les États-Unis, Israël et d’autres pays arabes, comme une démonstration de la puissance de l’armée iranienne dans le détroit d’Ormuz, stratégiquement important puisque lieu de transit de 40 % du pétrole mondial. Malgré les sanctions des États-Unis et de l’UE portant sur le pétrole iranien, l’Iran a réveillé d’autres rivalités inter-impérialistes en menaçant de fermer le détroit d’Ormuz. Le pétrole qui transite par cette voie constitue une alternative au pétrole iranien et russe, en d’autres termes, il en est un produit concurrent. D'où l’importance stratégique des pipelines russes au nord de la Mer Noire. La course à la domination stratégique basée sur le transport de pétrole joue un rôle clef dans ce qui se passe au Moyen-Orient.
Le fait que l’Iran ait des réserves significatives de pétrole et qu'il dispose de moyens de nuisance importants qui menacent l'acheminement du pétrole via le détroit d’Ormuz lui permet de trouver des alliés au niveau international. Ceci dit, alors que l’Iran semble être un État qui renforce son influence, la menace de mouvements sociaux en son sein a provoqué de nombreuses insomnies chez la bourgeoisie iranienne et ce n’est pas fini.
La Turquie
La Turquie est restée silencieuse au début des mouvements sociaux dans le monde arabe. Cependant, elle a fait en sorte de tirer le maximum de profit de la période d’instabilité créée par les événements en Afrique du Nord.
Un examen des relations passées entre la Turquie et la Syrie permet de mieux comprendre leurs relations actuelles. Avec sa politique de "zéro conflit" en politique extérieure initiée en 2005, la Turquie visait à accroître son influence politique et économique dans la région et, dans ce cadre, elle a essayé d’améliorer ses relations avec la Syrie, traditionnellement réduites. Ces deux États bourgeois, dont l'histoire commune est riche en contentieux, avaient pris, au cours des dix dernières années, certaines dispositions pour les résoudre. Parmi les contentieux en question, on trouve l'annexion par la Turquie de la province d’Hatay 6, l'approvisionnement en eau de la Syrie rendu plus difficile à cause de la construction des barrages sur le Tigre et l'Euphrate et le fait que, depuis longtemps, le PKK 7 a ses camps militaires en Syrie.
L’occupation par les États-Unis, d’abord de l’Afghanistan et ensuite de l’Irak, a changé toute la politique de la région. Comme les États-Unis souhaitaient que la Turquie soit plus active dans la région, une série de mesures ont été prises pour améliorer ses relations avec la Syrie. De nombreuses visites entre États ont été organisées, dont une visite juste après l’assassinat du Premier Ministre libanais, Rafic Hariri, un opposant à la Syrie. La bourgeoisie turque a été la première à donner son soutien international au régime Baas, alors qu'il était isolé et se trouvait dans une situation délicate dans la région. Analysant la situation comme une occasion d’accroître son influence dans cette zone, la bourgeoisie turque a soutenu le régime d’Assad 8 dans cette phase difficile pour lui. Par la suite, les rapports entre les deux pays se sont encore améliorés à travers une série de visites et de gestes diplomatiques. Cette période a témoigné de la plus grande activité diplomatique entre les deux pays ayant jamais existé. Par la suite, le "Conseil de coopération stratégique à haut niveau", fondé en 2009, a conclu une série d’investissements communs et d’accords économiques, politiques et militaires. Ce conseil, qui a aboli l'obligation de visa entre les deux pays et décidé de manœuvres militaires communes, de l'établissement d’une union douanière et d'un marché libre, a représenté le plus haut point, historiquement, des relations entre la Syrie et la Turquie. Ces accords, en créant la possibilité pour la Turquie de s’ouvrir au monde arabe, donnaient aussi à la Syrie la possibilité de s’ouvrir sur l’Europe. La Syrie, un vieil ennemi de la Turquie, était devenue une amie. Ce rapprochement était supposé se baser sur "une histoire commune, une religion commune et une destinée commune". Cette relation a duré jusqu’à ce que la rébellion contre Assad commence. C’est à ce moment que la bourgeoisie turque a soudainement tourné le dos à Assad.
Quand les événements qui ont secoué le monde arabe ont atteint la Syrie, il s'est créé l’union arabe sunnite contre Assad. En soutenant directement ce mouvement, la Turquie mettait un terme aux "jours heureux" durant lesquels le premier ministre turc Erdogan et Assad passaient leurs vacances familiales ensemble. La formation du Conseil National Syrien à Istanbul et l'accueil en Turquie des officiers qui ont formé l’Armée libre syrienne montraient clairement que les opposants à Assad étaient ouvertement soutenus par la Turquie. Le motif de cette nouvelle politique était la volonté de la Turquie de maintenir sa position en tant que puissance ayant son "mot à dire" dans la région en soutenant les dissidents qui, semblait-il, allaient sûrement arriver au pouvoir, et ceci de façon à conserver avec le nouveau pouvoir le niveau des relations atteint sous l’ère Assad. Cependant, il est vite apparu qu’avec la Russie et le Chine qui défendaient ouvertement le régime syrien, Assad n’allait pas partir facilement. Alors la Turquie a changé son fusil d’épaule et a commencé à essayer d’accroître la pression internationale plutôt que d’attaquer le régime d’Assad directement. En vue de faciliter une opération possible de l’OTAN, la Turquie est devenue un participant actif de la Conférence des amis de la Syrie 9 et a agi de concert avec la Ligue Arabe. Tous ces développements démontrent que bien que la Turquie tende en général à mener une politique étrangère en tant qu'allié des États-Unis au Moyen-Orient, elle est capable de voler de ses propres ailes de temps en temps et d’avoir son mot à dire dans la politique des puissances régionales.
Par ailleurs, conformément à ses plans concernant le futur de la Syrie, en renforçant ses liens avec les Frères musulmans 10, qui représentent une bonne partie de l’opposition à Assad, la Turquie entend aussi renforcer ses liens avec des partis qui se rattachent aux Frères Musulmans en Égypte et en Tunisie, et qui font certainement partie du même réseau.
Par ailleurs, suite à la chute de Moubarak, la Turquie a fait des efforts pour améliorer ses relations avec l’Égypte. Elle s'est appliquée à jouer un rôle dans la structuration du nouveau régime. Souhaitant exporter son régime tout autant que son capital, la bourgeoisie turque tente de tisser des liens avec le Parti de la Justice et de la Liberté formé par les Frères Musulmans en Égypte via le Parti de la Justice et du Développement 11 au pouvoir en Turquie.
Lorsque le premier ministre turc Erdogan a adopté une attitude anti-Israël au cours de la crise dite "une minute" 12 et du raid israélien sur le Mavi Marmara, un bateau turc qui faisait partie de la flottille qui transportait des aides pour Gaza, il a gagné une certaine popularité dans le monde arabe. Dans le sillage de ces initiatives pro-arabes, Erdogan a effectué une tournée en Égypte, Tunisie et Libye, accompagné de 7 ministres et de 300 hommes d’affaire. Ces visites étaient entreprises sur la base du modèle islamique laïc du Parti pour la Justice et le Développement (AKP, Adalet ve Kalkinma Partisi, actuellement au pouvoir en Turquie) et le message le plus marquant adressé par Tayyip Erdogan en Égypte et en Tunisie était celui de l’Islam laïc, ou d’un État islamique mais laïc. La presse mondiale, qui suivait ces visites, avait présenté le modèle d’Erdogan comme une alternative aux régimes wahhabite saoudien ou chiite iranien. Et ce n’était pas par hasard ! Tayyip Erdogan avait insisté sur l’Islam laïc dans son discours en Tunisie en disant : "une personne n’est pas laïque, un État l’est". Les États-Unis ont spécifiquement affirmé qu’un pays musulman tel que la Turquie a un régime qui est également laïc et parlementaire. Conformément à ce que nous avons déjà analysé dans notre presse en langue turque 13, ce que ces évènements traduisent c'est que la Turquie est bien en train d’essayer de renforcer son influence au Moyen-Orient et en Égypte en exportant son propre régime contre le Wahhabisme saoudien et le régime iranien chiite.
Dans le même temps, les puissances impérialistes occidentales veulent que la région retrouve la stabilité dès que possible, de même qu'elles désirent la mise en place de régimes qui maintiendraient ouverts les marchés régionaux, et le modèle le plus approprié de tels régimes est celui de la Turquie.
La Syrie s'enlise dans la guerre
Lorsque l'agitation sociale en Tunisie a gagné l’Égypte, les commentateurs pensaient qu'il allait être très difficile, pour les régimes de type Baas, dont la Syrie, d'y résister. En fait, dans ce pays, la population révoltée et en détresse s'est littéralement fait happer par les camps en présence, pro ou anti Assad. On pouvait s’attendre à ce qu’Assad se retire quand il serait face à l’opposition, mais ça n’a pas été le cas. Assad a tenté d’interdire les manifestations qui avaient fait éruption dans la ville de Dera et s’étaient étendues à des villes telles que Hama et Homs ; il a répandu des fleuves de sang et continue à le faire. Cette situation ouverte avec les évènements du 15 mars 2011 se prolonge encore aujourd'hui et, même si on peut supposer qu'Assad sera finalement renversé, on ne peut dire quand et comment elle va connaître un terme.
Les groupes qui défendent le régime d’Assad autant que ceux qui s’y opposent dans ce pays se définissent eux-mêmes par leur identité ethnique ou religieuse. 55 % de la population syrienne est composée de musulmans arabes sunnites, alors que les arabes alaouites chiites en représentent 15 % et les chrétiens arabes, 15 % également. 10 % de la population sont constitués de kurdes sunnites et les 5 % restant par les druses, les circassiens et les kurdes Yesidi. Plus de deux millions de réfugiés palestiniens et irakiens résident aussi en Syrie 14. La majeure partie de l’opposition au régime d’Assad est constituée d’arabes sunnites. En ce qui concerne les kurdes, qui occupent une position clef par rapport à l’équilibre politique de la Syrie, une partie soutient Assad tandis que l’autre fait partie du Conseil National Syrien anti-Assad. Les autres groupes ethniques soutiennent le régime actuel parce qu’ils craignent pour leur avenir sous un régime différent. Les arabes Nosairi (alaouites), une autre couche importante, ont soutenu le régime Baas en place en Syrie depuis des années.
La première initiative contre le régime Baas s’était unie derrière le nom de Conseil National Syrien. Cette organisation, fondée à Istanbul le 23 août 2011, inclut tous les opposants au régime d’Assad, excepté une certaine fraction des kurdes 15. A la suite d’une division parmi les kurdes qui se trouvent dans la région de Syrie la plus stratégique pour la Turquie, l’Iran et le Sud-Kurdistan, une partie de ceux-ci a rejoint le Conseil. La majorité du Conseil est constituée d’arabes sunnites qui, comme nous l’avons dit, représentent la plus grande partie de l’opposition à Assad. Si nous gardons à l’esprit que la Syrie est le pays où les Frères Musulmans sont les plus forts, après l’Egypte, nous pouvons dire que ce sont eux qui mènent le mouvement contre le régime en place en ce moment. En réalité, ce n’est pas le premier soulèvement sunnite contre le régime. En 1982, les Frères Musulmans s’étaient dressés contre Hafez-El-Assad (le père de Bachar el Assad) dans une rébellion qui avait été écrasée dans le sang : il y avait eu entre 17 000 et 40 000 morts 16. Il est plus que probable que cette organisation, qui est au centre de l’opposition au régime Baas, viendra au pouvoir à la suite du renversement d’Assad. Une telle issue est favorisée par le fait que les partis revendiquant l'appartenance aux Frères Musulmans ont gagné les élections en Tunisie et en Égypte.
Le secrétaire général des Frères Musulmans en Syrie, Mohammad Riad al-Shafka, a dit dans une interview qu’ils pourraient coopérer avec des forces régionales et globales dans le cadre d’intérêts mutuels, en expliquant le point de vue de son organisation sur ce qu’il faudrait faire à la suite de la chute d’Assad. Dans la même interview, al-Shafka dit qu’ils ne peuvent faire de compromis avec Assad à aucune condition et qu’il faut renverser le régime, montrant par là que la guerre va devenir de plus en plus violente.
Le régime Baas est soutenu par des groupes ethniques et religieux à un niveau non négligeable comparé aux groupes de l’opposition. Le plus grand est celui des Nosairi. Le régime d’Assad est constitué socialement par cette secte. Toute l’élite, la structure militaire, la bureaucratie du régime sont constituées par les arabes Nosairi. En ce sens, les Nosairi ont une position privilégiée en Syrie. La fin du régime Baas les mettrait dans une situation difficile car les membres de cette secte ont détenu le pouvoir politique depuis si longtemps, en s'y maintenant par des méthodes totalitaires, que cela a créé des haines profondes et entraînerait une vague de persécutions animées par la vengeance. Pour cette raison, ils veulent empêcher Assad de démissionner, même s’il en avait envie. En ce qui concerne les chrétiens, les Druses, les circassiens et les yezidi, ils soutiennent le régime Baas par peur du fondamentalisme islamique des candidats les plus à même de remplacer Assad. Cependant, tout peut changer d’un jour à l’autre.
Les kurdes sont dans une position différente qui constitue, dans la situation actuelle, une carte maîtresse du régime d’Assad. Jusqu’en mai dernier, les kurdes syriens étaient obligés de vivre dans des conditions telles qu’ils n’avaient même pas de cliniques médicales officielles et leurs représentants politiques étaient emprisonnés par le régime Baas. Bien qu’ils se soient rebellés contre le régime de temps en temps, leurs mouvements avaient été écrasés ou s’étaient éteints d'eux-mêmes. Un exemple : les événements dans la ville kurde de Qamishlo en 2004 17. De même, les différentes puissances impérialistes ont parfois essayé de se servir des kurdes contre le régime Baas. Après le début des événements, Assad a changé d’attitude vis-à-vis des kurdes et a libéré leurs prisonniers politiques. Il a même déclaré qu’un gouvernement autonome kurde allait être fondé dans le nord. C'est à plusieurs titres que les kurdes sont si importants pour Assad. Onze partis kurdes ont formé l’Assemblée Nationale Kurde de Syrie avec le soutien de Massoud Barzani 18, président du Gouvernement de la Région du Kurdistan en Irak. Cela a poussé Assad à chercher un accord avec les Kurdes mais, du même coup, a aussi poussé certains kurdes à s’intégrer à l’opposition sunnite arabe. En réponse, Assad a amnistié le leader du Parti nationaliste kurde de l’Unité et la Démocratie (PYD) 19, Salih Muslim, lui permettant d’organiser des manifestations pro-gouvernementales et d’y parler. En bref, Assad a cherché à gagner de l’influence sur les kurdes et à diviser l’opposition ; il y a en partie réussi.
Toutefois, le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PYD) a décidé de boycotter les élections du 26 février 2012 et a annoncé qu’il n’y avait rien pour les kurdes dans la nouvelle constitution. Par l’intermédiaire des représentants directs ou indirects de la bourgeoisie kurde syrienne hors de Syrie, le PDP et le PKK tentent de gagner de l’espace dans la région kurde de Syrie. Barzani veut exercer son pouvoir sur les kurdes syriens via l’Assemblée nationale kurde de Syrie. Le PKK détermine la politique des kurdes syriens grâce à ses relations avec le PYD et, en même temps, gagne un espace stratégique à la fois contre la bourgeoisie turque et ses propres rivaux kurdes, en particulier Barzani. Il semble que les kurdes, qui ont été oppressés par le régime Baas pendant des années, auront un rôle à jouer concernant l'avenir du régime en place.
Il faut aussi prendre en compte les rapports Syrie-Israël. Tout d'abord à propos du plateau du Golan 20, ensuite concernant la présence militaire et l’influence politique de la Syrie au Liban, deux causes de l'état de guerre entre ces deux États bourgeois pendant des années. Le début des événements en Syrie a compliqué les relations entre ce pays et Israël. On dit maintenant que les israéliens négocient avec le régime Baas, qu’ils combattaient auparavant, par peur de l’arrivée des Frères Musulmans au pouvoir. Israël voit d'un mauvais œil l'arrivée de régimes islamiques au pouvoir au Moyen-Orient et son attitude vis-à-vis du régime d’Assad a été significativement affectée par cette considération.
Il faut aussi analyser comment et à quel degré la classe ouvrière participe aux événements en Syrie. Naturellement, la classe ouvrière représentait une partie significative des masses dans la rue. Cependant le problème est que les ouvriers syriens ne sont pas parvenus à exprimer une réaction à la misère et l'oppression, contrairement à ce qu'on a vu en Tunisie ou en Égypte. Malheureusement, les ouvriers syriens s’expriment dans les événements selon leur identité ethnique ou de secte. Cela donne un éclairage sur quoi se fondent, depuis le début, les événements en Syrie. Le jour où les observateurs de la Ligue Arabe allaient arriver en Syrie, l’opposition a appelé à la grève générale. Cet appel a été largement ignoré, et un peu plus tard il y a eu un jour de grève générale, mais cependant encore sous l’influence de l’opposition. Cela a été décrit comme un acte de désobéissance : ceux qui voulaient voir le départ du régime d’Assad n’avaient aucune revendication de classe. De plus, la participation des employeurs et commerçants dans la grève a été aussi importante que celle des ouvriers, ce qui montre assez clairement la nature de cette grève. En fait, les ouvriers syriens ne se sont pas manifestés comme tels et se sont rangés du côté d’Assad ou de l’opposition en tant qu’individus.
Bien que Bachir el Assad ait déclaré qu’il y aurait des réformes et des élections, le nouveau referendum sur la constitution a été boycotté par l’opposition, ce qui indique que, soit le régime Baas va s’en aller, soit l’opposition va être éliminée après une guerre sanglante. Il semble en effet qu’il n’y ait pas le moindre espace pour une réconciliation entre les deux fractions bourgeoises. Par ailleurs, le soutien des russes et des chinois dont bénéficie Assad semble avoir bloqué la possibilité d’une intervention de l’ONU. Le fait que la Russie, avec ses bases militaires et ses fournitures d’armes, et la Chine avec ses investissements dans l’énergie, protègent la Syrie au niveau international est de toute évidence lié aux intérêts de ces deux États. En prenant en compte ces relations, nous pouvons dire que le départ d’Assad ne se fera pas comme celui de Muammar Kadhafi en Libye. En se basant sur la chute, un par un, des régimes analogues confrontés à des manifestations massives dans la région, on aurait pu penser que le régime d’Assad allait rapidement être mis en pièces. Il semble clair maintenant que, conformément aux souhaits de l’élite Nosairi, Assad ne va pas démissionner facilement et que l’intensité de la guerre civile va aller en croissant.
L'Égypte : un marché pour la force de travail à bas prix
A la suite du départ de Moubarak, on a annoncé que commençait une nouvelle ère pour l’Égypte. Cependant ce pays, où la classe ouvrière est une des plus importantes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, reste instable. La crise d’identité de la bourgeoisie n’est pas résolue et devient même plus intense après la provocation de Port-Saïd et les récentes manifestations contre Morsi.
La raison la plus importante pour laquelle les événements en Afrique du Nord se sont étendus à l’Égypte était que le taux de chômage et le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté étaient très élevés, comme ils l’étaient en Tunisie. 20 % de la population égyptienne vit dans la pauvreté, plus de 10 % est au chômage, selon les chiffres officiels et plus de 90 % des gens au chômage sont des jeunes. Les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité et les taux de chômage sont bien plus élevés étant donné que le chômage non-déclaré est très largement répandu dans des pays comme l’Égypte. L’économie égyptienne a déjà connu certains problèmes fondamentaux d’accumulation et s'est trouvée par la suite encore plus affaiblie par l’approfondissement de la crise mondiale, si bien que le chômage croissant a ouvert la voie à la chute de Moubarak. La bourgeoisie égyptienne a tenté de résoudre ce problème structurel d’abord avec la politique de la porte ouverte adoptée en 1974. Elle a choisi ainsi de combler les déficits créés par son propre capital avec des investissements étrangers. Cependant, du fait, entre autres, de son instabilité politique, elle n’a pas été capable d’améliorer beaucoup la situation. Aujourd’hui, les investissements en capitaux étrangers restent à un taux très bas, de l'ordre de 6 % du PIB de l’Égypte.
La situation de misère et de chômage ne s’est pas traduite par un mouvement de classe généralisé. Bien que les masses ouvrières se soient mises en mouvement, les travailleurs ne sont pas descendus dans la rue en tant que classe, avec leurs objectifs propres. Le mouvement s’est limité à des grèves d’environ 50 000 ouvriers et n’a pas réussi à imprimer une marque décisive de classe aux manifestations de la place Tahrir. Il n’a pas réussi non plus à sortir de la logique de pures revendications économiques couplées à des revendications bourgeoisies démocratiques.
Sur quelle politique économique va être fondée l’ère post-Moubarak ? Sans aucun doute, la bourgeoisie égyptienne va promettre un autre paradis d’exploitation à la classe ouvrière. Comme nous l’avons dit précédemment, l’économie égyptienne souffre de problèmes structuraux d’accumulation de capital. Pour une intégration complète dans l’économie mondiale, il faut en particulier l’extraction de plus-value. Le processus de bascule de la production agricole à la production industrielle, qui avait débuté sous l’ère Moubarak, va sans aucun doute continuer quand le nouveau rapport de force sera établi au sein de la bourgeoisie. Grâce à son potentiel en force de travail bon marché, la bourgeoisie va tenter de bâtir l’économie égyptienne sur l’exploitation intense de la force de travail. Les chances pour l’économie égyptienne d’attirer les investissements seront un peu meilleures parce qu’elle offrira de la main d’œuvre à bas prix sur le marché mondial. Mais, en même temps, beaucoup d'autres pays sont capables d'offrir une main-d'œuvre bon marché.
Le futur de l'Égypte dépend également des rivalités politiques au sein des forces bourgeoises dans ce pays. Lorsque les opposants au régime de Moubarak se sont emparés de la place Tahrir, la plupart des mouvements politiques bourgeois actuels n’existaient pas. Ils ont commencé à apparaître seulement quand le trône de Moubarak a été ébranlé. La plus grande structure politique dans l’Égypte post-Moubarak est sans aucun doute constituée par les Frères Musulmans. Une autre force significative est le mouvement salafiste radical qui a une influence croissante. L’armée également conserve encore un pouvoir majeur dans la vie politique en Égypte. Dans les premières élections après Moubarak, le Parti de la Justice et de la Liberté formé par les Frères Musulmans a obtenu un tiers des votes, suivi par les salafistes qui réussissaient à en obtenir 25 %. Des deux organisations islamistes, ce sont les salafistes les plus radicaux et une grande partie des votes en leur faveur émanent de la campagne. Les Frères Musulmans, eux, sont plus modérés et pragmatiques en matière d’économie et de politique. Ils ont même formé une alliance avec quelques partis laïcs aux élections. Ils démontrent en cela qu'ils constituent la force politique bourgeoise la plus à même de servir l'intérêt national dans un contexte économique extrêmement difficile et face à un prolétariat qui ne laissera pas sans réagir empirer ses conditions de vie. Les travailleurs sont capables, nous l'avons vu, de relever la tête quoique de façon ambiguë et par à-coups. La provocation de l'État, lors d’un match de football, a entraîné la mort de 74 personnes. En suscitant une confrontation entre les supporters de deux équipes, la police avait voulu se venger du groupe de supporters de l’équipe de football du Caire Al Ahly, lequel avait été très actif dans le mouvement qui a conduit à la chute de Moubarak et après. A cette fin, des hommes armés de bâtons et de couteaux avaient pénétré dans le stade et ensuite les barrières de celui-ci furent fermées. Beaucoup de scénarios ont été évoqués à propos de cette provocation et toutes les forces de la bourgeoisie ont essayé de tirer parti de la situation. A la suite de ces événements, on a entendu des voix demander que l’armée donne le pouvoir aux civils. Cependant, ce serait de la naïveté de ne pas voir que le motif réel de la provocation était la lutte pour le pouvoir. Le mot d’ordre des Ultras Ahlawy qui ont pris la tête du mouvement de protestation violente contre la provocation a des intonations très antisystème : "Un crime a été commis contre la révolution et les révolutionnaires. Ce crime n’arrêtera pas ni n’intimidera les révolutionnaires". Cependant, les revendications de celui-ci sont restées limitées et n’ont pas rencontré de véritable écho dans d’autres parties de la classe ouvrière 21. Il y a eu des appels à la grève générale contre la répression brutale de la manifestation par l’armée et parmi les revendications avancées, il y avait celui-ci : "le Conseil Militaire doit démissionner et justice pour les martyrs d’Égypte". Cette situation, qui se reflétait aussi dans les mots d’ordre dans la rue, montrait que rien n’a changé pour la classe ouvrière.
En fait, ce mouvement s'est terminé dans la même confusion que les manifestations contre la prise des pouvoirs spéciaux par Morsi. Les protestations initiales contre Morsi, localisées essentiellement au Caire, fin 2012, ont été l’expression d’un mécontentement social largement répandu, tout autant que d’une méfiance profonde et grandissante vis-à-vis des solutions offertes par le nouveau gouvernement des Frères Musulmans. Mais les mouvements de protestation semblent avoir été dominés par l’opposition laïque, avec le danger que la classe ouvrière soit prise dans un conflit entre fractions bourgeoises rivales. La situation s’est encore compliquée avec la nouvelle de grèves dans le centre textile de Mahalla et d’une assemblée de masse qui déclarait "l’indépendance" de Mahalla vis-à-vis du régime des Frères Musulmans. Quelques rapports ont même parlé du "soviet de Mahalla". Mais ici, de nouveau, l’influence de l’opposition démocratique bourgeoise pouvait être perçue avec le chant de l’hymne national à la fin de l’assemblée, alors que l’appel à une "indépendance" symbolique reflétait un manque de perspective : les travailleurs qui combattent pour leurs propres revendications ont besoin avant tout de généraliser leur lutte aux autres ouvriers dans le reste du pays, pas de se retrancher derrière les murs du localisme. Néanmoins, la classe ouvrière en Égypte garde un grand potentiel de lutte et n’a subi aucune grande défaite de la part de ses ennemis de classe. Elle est loin d’avoir dit son dernier mot dans la situation.
Pour conclure…
Bien que nous ayons dit, au début de cet article, que nous n’allions pas aborder cette question en profondeur, nous ressentons néanmoins la nécessité de faire quelques commentaires sur la question de la révolution. La transformation sociale que nous appelons révolution n’est pas simplement un changement des gouvernements ou des régimes actuels, elle représente un changement complet à tous les niveaux de toute la structure économique, des moyens de production, lié à des changements des rapports de production et de la forme de propriété. Cela veut dire que la classe ouvrière affirme son pouvoir sous la forme de conseils ouvriers. Une telle transformation n’a cependant pas eu lieu à la suite des événements en Afrique du Nord. Ainsi, présenter ces mouvements comme des révolutions relève soit d’un manque de compréhension de ce qu’est la lutte du prolétariat soit traduit une approche idéologique bourgeoise de ce sujet.
Cela ne veut pas dire que ces mouvements n’ont pas eu de valeur pour la lutte de classe. Les événements en Afrique du Nord ont inspiré des centaines de milliers de prolétaires à travers le monde, de l’Espagne aux États-Unis, d’Israël à la Russie et de la Chine à la France. De plus, malgré toutes ses limitations, l’expérience de la lutte a été immensément importante pour la classe ouvrière en Égypte et en Tunisie.
Un des développements les plus significatifs des dernières années a été celui de conflits sociaux en Israël et en Palestine. Les manifestations de rue massives de l’été 2011 ont été la réponse à des problèmes sociaux tels que le logement ou les revendications par rapport à la vie quotidienne de plus en plus dure pour la majorité de la population israélienne, comme conséquence de l’économie de guerre et de la crise économique. Les manifestants s’identifiaient explicitement aux mouvements du monde arabe, criant des slogans comme "Moubarak, Assad, Netanyahu sont tous les mêmes" et réclamaient des logements accessibles pour les juifs et les arabes. En dépit des difficultés à poser la question épineuse de la guerre et de l’occupation, ce mouvement renfermait clairement des germes d’internationalisme 22. Il a eu un écho plus récemment avec les manifestations et les grèves contre l’augmentation du coût de la vie dans la bande de Gaza, où les travailleurs palestiniens, chômeurs, élèves et étudiants ont critiqué impitoyablement les autorités palestiniennes et se sont affrontés à la police palestinienne. Malgré toutes leurs faiblesses, ces mouvements ont réaffirmé que lutter sur un terrain social et de classe représente les prémisses de l’unification du prolétariat par-delà et contre les conflits impérialistes 23.
C’est plus une promesse pour le futur, le poids du nationalisme restant extrêmement fort et étant appelé à se renforcer parmi les populations israéliennes et palestiniennes du fait des récentes attaques militaires de Gaza. Ainsi, même si l'inspiration et l'expérience qui viennent de ces luttes sont en elles-mêmes de petites victoires, la situation concrète et immédiate du prolétariat en Afrique du Nord et au Moyen-Orient peut être décrite comme rien de moins que sinistre.
Des deux côtés du conflit entre le régime et l’opposition en Syrie, il y a des puissances bourgeoises locales mais aussi des puissances régionales et mondiales, avec leurs intérêts et leurs relations politiques. La réalité actuelle pousse les États-Unis, l’UE, Israël et la Turquie dans un camp, pendant que la Russie et la Chine semblent prendre position aux côtés de l’Iran et de l’Irak chiite. C’est la perspective générale mais toutes les forces en dehors de l’Iran et d’Israël peuvent changer d’attitude si leurs intérêts le requièrent. De plus, les ouvertures d’Israël à l’égard du gouvernement syrien montrent que même ces États peuvent être flexibles jusqu’à un certain point.
Cette description montre que les puissances régionales et mondiales se préparent à un conflit impérialiste sans merci. Ce qui arrive en Syrie aujourd’hui est à un niveau où les prolétaires se déchirent entre eux parce qu’ils sont divisés en sectes et ethnies. Il ne fait aucun doute que c’est la caractéristique que toutes les guerres vont prendre dans cette région. Par ailleurs, la formation d’un régime aux fortes tendances islamistes est plus que probable en Égypte et cela peut continuer à enflammer la situation dans la région et un autre virage peut se produire dans les forces bourgeoises en conflit. Néanmoins, alors que tous ces conflits qui ont lieu, ou vont avoir lieu, représentent la destruction pour la classe ouvrière, la potentialité reste intacte pour que soit détruit ce système parasite qui se nourrit de l’exploitation de la force de travail. La classe ouvrière a besoin d’une lutte internationale. C’est justement sur ce point que nous avons essayé de nous exprimer et de contribuer à la lutte de classe.
Ekrem (7 janvier 2013)
1 Voir l’article écrit par la section du CCI en Turquie à cette époque. https://en.internationalism.org/icconline/2011/04/middle-east-libya-egyp... [364]
2 Le Parti arabe socialiste Baas, le parti au pouvoir en Syrie, a de nombreuses sections dans différentes régions du monde arabe et plonge ses racines dans la scission intervenue en 1966 dans le mouvement Baas qui a donné naissance à une faction dirigée par la Syrie et une autre par l’Irak.
3 Aussi connus aussi sous le nom d’alaouites, chiites alwi et ansaris, une secte quelque peu non orthodoxe qui dérive de l’Islam chiite. Les chiites se réfèrent aux arabes qui ont suivi Ali, le cousin et gendre du prophète Mahomet, quatrième calife de l’Islam. La principale division dans l’Islam se situe entre les disciples d’Ali (le chiisme) et la majorité des musulmans qui suivirent Mouawia (les sunnites), le premier calife de la dynastie des Omeyyades.
4 Les trois équipes de la plus grande usine en Iran, l’usine de voiture Khodro, ont toutes fait une heure de grève pour protester contre la répression étatique.
5 Comme en 2011, le pétrole iranien a représenté environ 11 % des besoins énergétiques de la Chine, ce qui n’est pas négligeable, (de plus, il représente aussi environ 9 % des besoins en énergie du Japon. La Corée du Sud et l’Europe sont , ou étaient, aussi les plus grands importateurs) Voir https://www.energybulletin.net/stories/2012-01-19/sanctioning-iranian-oi... [365]
6 La Turquie a annexé la province du Hatay, y compris les villes d’Antakya (anciennement Antioche) et Iskenderun (Alexandrette) en 1938, précédemment syrienne, à la suite d’une série de manœuvres.
7 Partiya Karkeren Kurdistan, ou Parti Ouvrier du Kurdistan, un parti nationaliste kurde d’abord stalinien surtout actif en Turquie mais opérant aussi en Irak et au Kurdistan iranien.
8 Les dirigeants dynastiques du régime Baas en Syrie, la famille Assad, sont au pouvoir en Syrie depuis 1970. Hafez el Assad est resté au pouvoir jusqu’à sa mort en 2000 et son fils, Bachar el Assad, qui est encore au pouvoir lui a succédé.
9 P.sdfootnote-western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }P.sdfootnote-cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }P.sdfootnote-ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }P { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); } Une réunion des pays "amis de Syrie" pour soutenir l’opposition à Assad et à laquelle participèrent des représentants de celle-ci.
10 Un des plus vieux et plus grands mouvements politiques islamiste sunnite du monde : les Frères Musulmans ont été fondés en Egypte en 1928 en tant que parti fasciste. Aujourd’hui, les Frères Musulmans sont une partie modérée et libérale du mouvement islamique qui n’est interdit ni aux États-Unis ni en Grande Bretagne. L’organisation a été très populaire avec son mélange de charité et d’activisme populiste, elle existe dans tout le monde arabe et dans plusieurs autres pays occidentaux et en Afrique.
11 Un parti "musulman démocratique" populiste de centre-droit, comparable aux partis démocrates-chrétiens d’Europe.
12 Le Premier Ministre turc Erdogan a quitté le sommet de Davos en 2009, après avoir interrompu le modérateur en répétant sans cesse : "une minute", pour pouvoir s’exprimer contre l’israélien Shimon Peres.
13 Lire l'article en turc https://tr.internationalism.org/ekaonline-2000s/ekaonline-2011/kuzey-afr... [366]
17 En mars 2006, pendant un match de football chaotique, une émeute s’est déclenchée quand quelques personnes ont commencé à agiter des drapeaux des kurdes séparatistes, saluant Barzani et Talabani, transformant le match en conflit politique. L’ameute a dépassé les grilles du stade et des armes furent utilisées contre la police et les civils non kurdes. Par la suite, au moins 30 kurdes furent tués et le service de sécurité reprit la ville.
18 Massoud Barzani est aussi le chef du Parti Démocrate du Kurdistan (PDK) et le fils de Moullah Barzani, leader de la guérilla peshmerga nationaliste kurde et précédent président du PDK,.
19 Partiya Yekîtiya Démocrate, ou Parti de l’Unité et de la Démocratie, un parti politique syrien kurde affilié au Parti Ouvrier Kurde (PKK)
20 Bien que reconnu internationalement comme territoire syrien, le plateau du Golan a été occupé et administré par Israël depuis la guerre israélo-arabe de 1967.
Géographique:
- Afrique [162]
- Moyen Orient [167]
Rubrique:
1914-23: dix années qui ébranlèrent le monde: les échos de la Révolution russe de 1917 en Amérique latine-Brésil 1918-21
- 3196 lectures
Nous poursuivons ici la rubrique sur la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 que nous avions commencée dans la Revue internationale no 139 1.
Nous nous donnions comme objectif "d’apporter, en continuité avec les nombreuses contributions que nous avons déjà faites, un essai de reconstitution de cette époque selon les témoignages et les récits des protagonistes eux-mêmes. Nous avons consacré de nombreuses pages à la révolution en Russie et en Allemagne. De ce fait, nous publierons des travaux sur des expériences moins connues en divers pays avec, pour objectif, de donner une perspective mondiale. Quand on se penche un peu sur cette époque, on est étonné par le nombre de luttes qui l'ont traversée, par l'ampleur de l'écho de la révolution de 1917."
Entre 1914 et 1923, le monde a connu la première manifestation de la décadence du système capitaliste qui a pris la forme d’une guerre mondiale embrasant l’Europe entière, avec des répercussions dans le monde entier, provoquant quelque vingt millions de morts. Et cette tuerie aveugle s’acheva non par la volonté des gouvernants, mais à cause d'une vague révolutionnaire du prolétariat mondial auquel se rallièrent bon nombre d’exploités et d’opprimés de par le monde, et dont le fer de lance se trouva être la Révolution russe de 1917.
Nous sommes en train de vivre aujourd’hui une nouvelle manifestation de la décadence capitaliste. Elle prend cette fois la forme du gigantesque cataclysme de la crise économique (aggravée par une forte crise de l’environnement, la multiplication des guerres impérialistes locales et une dégradation morale alarmante). Dans bon nombre de pays 2, nous voyons se dresser, contre les effets de celle-ci, les premières tentatives de riposte, encore très limitées, du prolétariat et des opprimés. Il est indispensable de tirer les leçons de cette première vague révolutionnaire (1917-23), pour dégager les points communs et les différences avec la situation actuelle. Les luttes futures seront bien plus puissantes si elles sont à même d’assimiler les leçons de cette expérience.
L’agitation révolutionnaire qui ébranla le Brésil entre 1917 et 1919 constitue, avec les mouvements en Argentine de 1919, l’expression la plus importante en Amérique du Sud de la vague révolutionnaire mondiale concomitante avec la Révolution russe.
Cette agitation fut le fruit tant de la situation au Brésil que de la situation internationale, la guerre et particulièrement la solidarité avec les ouvriers russes et les tentatives de suivre leur exemple. Elle n'a pas surgi du néant, le Brésil ayant aussi été le théâtre de la maturation des conditions objectives et subjectives au cours des vingt années précédentes. L’objet de cet article est d’analyser cette maturation et l’éclosion des événements qui se succédèrent entre 1917 et 1919 dans le sous-continent brésilien. Nous n’avons pas la prétention de tirer des conclusions définitives et restons ouverts au débat qui permettra de préciser les questions, les faits et les analyses, sachant qu'il existe réellement peu de documents sur cette époque. Ceux que nous avons pu utiliser seront référencés en notes.
1905-1917 : explosions périodiques de lutte au Brésil
L’évolution de la situation mondiale au cours de la première décennie du xxe siècle se fait ressentir sur trois plans :
– la longue période d’apogée du capitalisme touche à sa fin. Pour reprendre les termes de Rosa Luxemburg, nous sommes déjà "sur l'autre versant de la montagne, au-delà de l'apogée de la société capitaliste" 3 ;
– l’éclosion de l’impérialisme comme expression de l’affrontement croissant entre les différentes puissances capitalistes dont les ambitions se heurtent aux limites d’un marché mondial complètement partagé, inégalement, entre elles et dont l'issue, selon la logique capitaliste, ne pouvait qu'être une guerre généralisée ;
– l’explosion de luttes ouvrières sous de nouvelles formes et tendances, qui expriment le besoin de répondre à cette nouvelle situation : c’est la période de l’apparition de la grève de masse dont l’expression majeure fut la Révolution russe de 1905.
Dans ce contexte, quelle était la situation au Brésil ? Nous ne pouvons développer ici une analyse de la formation du capitalisme dans ce pays. Sous la domination portugaise se développa, à partir du xvie siècle, une puissante économie d’exportation, basée en premier lieu sur l'extraction du "Pau-brasil" 4 puis sur la culture de la canne à sucre dès le début du xviie siècle. Il s’agissait d’une extraction/production esclavagiste, la tentative d’exploitation des Indiens ayant rapidement échoué ce qui favorisa, dès le xviie siècle, l’importation de millions d’Africains. Après l’Indépendance (1822), pendant le dernier tiers du xixe siècle, le sucre fut détrôné par le café et le caoutchouc comme principal produit d'exportation, accélérant le développement du capitalisme et provoquant une immigration massive de travailleurs venant d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, etc. Ceux-ci constituaient la main-d’œuvre nécessaire à l’industrie qui commençait à prendre son essor, et ils étaient aussi envoyés coloniser ce vaste territoire en grande partie inexploré.
Une des premières manifestations du prolétariat urbain eut lieu en 1798, avec la fameuse "Conjura Bahiana" 5 : menée surtout par des tailleurs, cette rébellion réclamait, outre la satisfaction de revendications corporatives, l’abolition de l’esclavage et l’indépendance du Brésil. Tout au long du xixe siècle, de petits noyaux prolétariens impulsent la lutte pour la République 6 et l’abolition de l’esclavage ; il s’agit bien sûr de revendications dans le cadre capitaliste, qui impulsent son développement et préparent ainsi les conditions de la future révolution prolétarienne.
La vague d’immigration de la fin du siècle modifia notablement la composition du prolétariat au Brésil 7. En riposte à des conditions de travail insoutenables – journées de 12 à 14 heures, salaires de famine, logements inhumains 8, mesures disciplinaires incluant les châtiments corporels – commencent à surgir des grèves à partir de 1903, les plus significatives étant celles de Rio (1903) et de Santos (le port de São Paulo) en 1905, qui s’étendit spontanément et se transforma en grève générale.
La Révolution russe de 1905 provoqua une grande impression : le Premier mai 1906, une grande quantité de meetings lui furent consacrés. À São Paulo eut lieu une réunion massive dans un théâtre, à Rio une manifestation sur une place publique, à Santos une réunion de solidarité avec les révolutionnaires russes.
C’est à cette même époque que commencèrent à se réunir entre elles les minorités révolutionnaires, composées essentiellement d’immigrants. Ces réunions donneront naissance en 1908 à la fondation de la Confederação Operária Brasileira (COB – Confédération Ouvrière Brésilienne), qui regroupait les organisations de Rio et São Paulo et était fortement marquée par l’anarchosyndicalisme, s’inspirant de la CGT française 9. La COB proposa la célébration du Premier Mai, réalisa un important travail de culture populaire (essentiellement sur l’art, la pédagogie et la littérature) et organisa une campagne énergique contre l’alcoolisme qui faisait des ravages parmi les travailleurs.
En 1907, la COB mobilisa les travailleurs pour la journée de huit heures. Les grèves se multiplièrent à partir de mai dans la région de São Paulo. Les mobilisations furent un succès : les tailleurs de pierre et les menuisiers obtinrent une réduction de la journée de travail. Mais cette vague de luttes reflua rapidement, comme conséquence à la fois de la défaite des dockers de Santos (qui demandaient la journée de 10 heures), de l’entrée dans une phase de récession de l’économie à la fin de 1907 et de la répression policière omniprésente qui remplissait littéralement les prisons d’ouvriers grévistes et expulsait les immigrés actifs.
Le recul des luttes ouvertes n’impliqua pas le recul des minorités les plus conscientes, qui se consacrèrent alors au débat sur les principales questions qui se discutaient en Europe : la grève générale, le syndicalisme-révolutionnaire, les causes du réformisme… La COB qui les regroupait entreprit des actions d’orientation internationaliste. Elle mena une campagne contre la guerre entre le Brésil et l’Argentine et se mobilisa aussi contre la condamnation à mort par le gouvernement espagnol de Ferrer Guardia 10.
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 provoqua une forte mobilisation de la COB avec les anarchistes à sa tête. La Fédération ouvrière de Rio de Janeiro créa en mars 1915 une Commission populaire d’agitation contre la guerre, tandis qu’à São Paulo se créait une Commission internationale contre la guerre. Dans les deux villes s’organisèrent, le Premier Mai 1915, des manifestations contre la guerre au cours desquelles fut acclamée l’Internationale des travailleurs.
Les anarchistes brésiliens tentèrent d’envoyer des délégués à un Congrès contre la guerre qui devait se tenir en Espagne 11 et, suite à l'échec de cette tentative, organisèrent en octobre 1915 un Congrès international pour la paix qui se tint à Rio de Janeiro.
À ce Congrès participèrent des anarchistes, des socialistes, des syndicalistes et des militants d’Argentine, d’Uruguay et du Chili. Un manifeste dirigé vers le prolétariat d’Europe et d’Amérique fut adopté, qui appelait à "abattre les bandes de potentats et d’assassins qui maintiennent le peuple dans l’esclavage et la souffrance" 12. Cet appel ne pouvait être mis en pratique que par le prolétariat, puisque lui seul "pouvait mener une action décisive contre la guerre, car c’est lui qui fournit les éléments nécessaires à tout conflit guerrier, en fabriquant les instruments de destruction et de mort et en fournissant l’élément humain qui va servir de chair à canon" (idem). Le Congrès décida de mener une propagande systématique contre le nationalisme, le militarisme et le capitalisme.
Ces efforts furent étouffés par l’agitation patriotique déclenchée en faveur de l’engagement du Brésil dans la guerre. De nombreux jeunes de toutes les classes sociales s’engagèrent volontairement dans l’armée, dans un climat de défense nationale qui rendait les positionnements internationalistes ou simplement critiques très difficiles, se heurtant à la répression énergique de groupes de volontaires patriotes qui n’hésitaient pas à faire usage de la violence. L’année 1916 fut très dure pour le prolétariat et les internationalistes, qui se retrouvèrent isolés et harcelés.
Juillet 1917, la Commune de São Paulo
Cette situation ne dura cependant pas longtemps. Les industries s’étaient développées particulièrement dans la région de São Paulo, profitant du commerce lucratif que permettait l’approvisionnement de tout type de marchandises aux belligérants. Mais cette prospérité n’avait guère de répercussions positives sur la masse ouvrière. Il était plus qu’évident qu’il existait deux São Paulo : l’un, minoritaire, fait de maisons luxueuses et de rues jouissant de toutes les inventions importées de l’Europe "Belle époque", l’autre majoritaire faite de quartiers insalubres suintant la misère.
Comme il fallait faire vite pour tirer le maximum de bénéfices de la situation, les patrons augmentèrent brutalement la pression sur les travailleurs : "Au Brésil, le mécontentement croissait à cause des conditions abusives de travail dans les usines, semblables à celles du début de la révolution industrielle en Grande Bretagne : journées de 14 heures, sans vacances, sans jours de repos rémunérés durant la semaine, les ouvriers mangeaient à côté des machines ; les salaires étaient insuffisants et la paye irrégulière ; il n’existait pas d’assistance sociale ou de santé ; les réunions et l’organisation des ouvriers étaient interdites ; ces derniers n’avaient aucun droit et il n’existait pas d’indemnisation pour les accidents du travail" 13. Pour comble, une forte inflation fît ressentir ses effets, en particulier sur les produits de première nécessité. Tout ceci favorisa le développement de l’indignation et du mécontentement, stimulés par les informations qui commençaient à arriver d’Europe sur la Révolution de février en Russie. En mai éclatent plusieurs grèves à Rio, en particulier celle de l’usine textile de Corcovado. Le 11 mai, 2500 personnes parviennent à se réunir dans la rue, dans l’intention de se diriger vers l’usine pour manifester leur solidarité, malgré l’interdiction expresse des réunions ouvrières décidée quelques jours auparavant par le chef de la police. La police s’interpose devant la manifestation et de violents affrontements se déclenchent.
Début juillet éclate une grève massive dans la région de São Paulo, qui sera connue sous le nom de "la Commune de São Paulo". Elle trouve son origine dans l’intolérable coût de la vie et, surtout, dans le rejet de la guerre : dans plusieurs usines, les patrons avaient imposé une "contribution patriotique", impôt sur le salaire pour soutenir l’Italie. Cet impôt est rejeté par les ouvriers de l’usine textile Cotonificio Crespi, qui réclament une augmentation de 25 %. La grève s’étend comme une traînée de poudre aux quartiers industriels de São Paulo : Mooca, Bras, Ipiranga, Cambuci… Plus de 20 000 travailleurs sont en grève. Un groupe de femmes rédige un tract qu’elles distribuent parmi les soldats, dans lequel on peut lire : "Vous ne devez pas persécuter vos frères de misère. Vous faites aussi partie de la masse populaire. La faim règne dans nos foyers et nos enfants demandent du pain. Les patrons comptent sur les armes qu’ils vous ont confiées pour étouffer nos revendications".
Une brèche sembla s’ouvrir début juillet dans le front ouvrier : les travailleurs de Nami Jaffet acceptèrent de rentrer au travail avec une augmentation de 20 %. Mais dans les jours suivants des incidents favorisèrent la poursuite de la grève : le 8 juillet, une foule d’ouvriers rassemblés devant les portes de Cotonificio Crespi alla prêter main-forte à deux mineurs qui allaient être arrêtés par une patrouille de soldats. La police vint à la rescousse de ces derniers et une bataille de positions s’ensuivit. Le jour suivant vit de nouveaux affrontements aux portes de l’usine de bières Antartica. Après avoir débordé la police, les ouvriers se dirigèrent vers l’usine textile Mariángela et parvinrent à faire débrayer ses employés. De nouveaux incidents se produisirent les jours suivants ainsi que de nouveaux débrayages qui vinrent grossir les rangs des grévistes.
La nouvelle d’un ouvrier battu à mort par la police courut le 11 juillet. C’était la goutte qui fit déborder le vase : "… la nouvelle du décès de l’ouvrier assassiné à proximité d’une usine de tissus à Bras fut vécue comme un défi jeté à la dignité du prolétariat. Elle eut l’effet d’une violente décharge émotionnelle qui secoua toutes les énergies. L’enterrement de la victime donna lieu à une des plus impressionnantes démonstrations populaires à Sao Paulo" 14. Une manifestation de deuil impressionnante s’ensuivit, regroupant plus de cinquante mille personnes. Après l’enterrement, la foule se divisa en deux cortèges, l’un se dirigeant vers la maison du travailleur assassiné, à Bras, où se tint une assemblée au terme de laquelle la foule assaillit une boulangerie. La nouvelle fusa comme une traînée de poudre et de nombreux magasins d’alimentation furent pillés dans de nombreux quartiers.
L’autre cortège se dirigea vers la Praça da Se où plusieurs orateurs prirent la parole pour encourager à la poursuite de la lutte. Les assistants décidèrent de s’organiser en plusieurs cortèges qui se dirigèrent vers les quartiers industriels, où ils firent débrayer plusieurs entreprises et parvinrent à convaincre les travailleurs de Nami Jaffet de se remettre en grève.
La détermination comme l’unité des ouvriers grandit spectaculairement : dans la nuit du 11 au 12 et durant toute la journée se tinrent des assemblées dans les quartiers ouvriers, avec la participation très déterminée des anarchistes, au cours desquelles fût décidée la formation de Ligues ouvrières. Le 12, l’usine à gaz se mit en grève et les tramways cessèrent de fonctionner. Malgré l’occupation militaire, la ville était entre les mains des grévistes.
Les grévistes maîtrisaient la situation dans "l’autre São Paulo", la police et l’armée ne pouvaient y entrer, harcelées par la multitude qui occupait des barricades à tous les points stratégiques, où se produisirent de violents affrontements. Les transports et l’approvisionnement étant paralysés, ce furent les grévistes qui organisèrent la fourniture en aliments, en donnant la priorité aux hôpitaux et aux familles ouvrières. Des patrouilles ouvrières furent organisées pour éviter vols et pillages et pour alerter les habitants des incursions de la police ou de l’armée.
Les Ligues ouvrières de quartier, avec des délégués élus par un certain nombre d'usines en lutte et des membres des sections de la COB, tinrent des réunions pour unifier les revendications, ce qui aboutit, le 14, à la formation d’un Comité de défense prolétarienne qui proposa onze revendications, les principales étant la liberté pour tous les emprisonnés et une augmentation de 35 % pour les bas salaires et 25 % pour les autres. Un secteur influent du patronat comprit que la répression ne suffirait pas et qu’il fallait faire quelques concessions. Un groupe de journalistes s’offrit pour servir de médiateurs auprès du gouvernement. Le même jour se tint une assemblée générale qui réunit plus de 50 000 participants qui arrivèrent en cortèges massifs dans l’ancien hippodrome de Mooca. Au cours de celle-ci il fut décidé de reprendre le travail si les revendications étaient acceptées. Les 15 et 16 se tinrent de nombreuses réunions entre les journalistes et le gouvernement, ainsi qu’avec un comité qui réunissait les principaux employeurs. Ces derniers acceptèrent une augmentation générale de 20 % et le gouverneur ordonna la mise en liberté immédiate de tous les prisonniers. Le 16, de nombreuses assemblées votèrent la reprise du travail. Une manifestation gigantesque qui regroupa 80 000 personnes célébra ce qui était considéré comme une grande victoire. Quelques grèves isolées éclatèrent çà et là en juillet-août pour forcer les patrons récalcitrants à appliquer les accords.
La grève de São Paulo provoqua la solidarité immédiate dans les industries de l'État du Rio Grande do Sul et de la ville de Curitiba où eurent lieu des manifestations massives. L’onde de choc solidaire tarda cependant à arriver à Rio. Mais une usine de meubles fut paralysée par la grève le 18 juillet – quand la lutte était déjà finie à São Paulo – et peu à peu s’étendit à d’autres entreprises, de telle sorte que le 23 juillet, on pouvait compter 70 000 grévistes dans différents secteurs. Affolée, la bourgeoisie déclencha une répression violente : charges de police contre les manifestants, arrestations, fermeture de locaux ouvriers. Elle dût cependant faire quelques concessions, qui mirent fin à la grève le 2 août.
Bien qu’elle ne fût pas parvenue à s’étendre, la Commune de São Paulo eut un écho important dans tout le Brésil. La première chose remarquable, c’est qu’elle revêtit pleinement les caractéristiques que Rosa Luxemburg avait dégagées de la Révolution Russe de 1905 qui définissent la nouvelle forme que prend la lutte ouvrière dans la décadence du capitalisme. Elle n’avait pas été préalablement préparée par une organisation mais fut le produit d’une maturation de la conscience, de la solidarité, de l’indignation, de la combativité dans les rangs ouvriers ; elle avait créé, à travers son propre mouvement, son organisation directe de masse et, sans perdre son aspect économique, avait développé rapidement son caractère politique avec l'affirmation du prolétariat comme classe qui s’affronte ouvertement à l’État. "Nul ne peut affirmer que la grève générale de juillet 1917 avait été préparée, organisée suivant les schémas classiques des délégués des syndicats et de la Fédération ouvrière. Elle fut le produit direct du désespoir dans lequel était plongé le prolétariat de Sao Paulo, soumis à des salaires de famine et à un travail exténuant. L’état de siège était permanent, les associations ouvrières fermées par la police, les locaux fermés et la surveillance des éléments considérés comme "agitateurs dangereux pour l’ordre public" était sévère et permanente" 15.
Comme nous le verrons plus loin, le prolétariat brésilien, encouragé par le triomphe de la Révolution d’Octobre, se lancera dans de nouvelles luttes ; la Commune de São Paulo fut cependant le moment culminant de sa participation à la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elle ne surgit pas directement sous l’impulsion de la Révolution d’Octobre, elle contribua plutôt à créer les conditions mondiales qui la préparèrent. Entre juillet et septembre 1917, nous voyons non seulement la Commune de São Paulo mais aussi la grève générale en août en Espagne, des grèves massives et des mutineries de soldats en Allemagne en septembre, événements qui pousseront Lénine à insister sur la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir en Russie puisque "Il est hors de doute que la fin de septembre nous a apporté le tournant le plus grand de l'histoire de la révolution russe et, selon toutes les apparences, de l'histoire de la révolution mondiale" 16.
L’effet "Appel" de la Révolution russe
Pour revenir à la situation au Brésil, la bourgeoisie semblait bien décidée à participer à la guerre mondiale malgré l’agitation sociale. Non pas qu’elle eût des intérêts économiques ou stratégiques directs, mais pour compter pour quelque chose dans le concert impérialiste mondial, pour donner une impression de puissance et se faire respecter par le reste des vautours nationaux. Elle misa pour le camp qu’on devinait vainqueur – celui de l’Entente (France et Grande-Bretagne), qui achevait de bénéficier de l’appui décisif des États-Unis – et profita du bombardement d’un navire brésilien par un vaisseau allemand pour déclarer la guerre à l’Allemagne.
La guerre a besoin de l’abrutissement de la population, que celle-ci soit convertie en populace agissant irrationnellement. Dans ce but, des Comités patriotiques furent créés dans toutes les régions. Le Président de la République, Venceslau Brás, intervint en personne pour faire cesser la grève d’une usine textile de Rio. Quelques syndicats collaborèrent, organisant des "bataillons patriotiques" pour mobiliser dans la guerre. L’Église déclara que la guerre était une "Sainte Croisade" et ses évêques se répandirent en homélies enflammées d’ardeur patriotique. Toutes les organisations ouvrières furent déclarées hors-la-loi, leurs locaux fermés, livrées à de féroces et incessantes campagnes de presse les traitant "d’étrangers sans cœur", de "fanatiques de l’internationalisme allemand" et autres mots doux.
L’impact de cette violente campagne nationaliste fut limité, car il se vit rapidement contrecarré par l’éclatement de la Révolution russe, laquelle provoqua un choc électrisant pour de nombreux ouvriers brésiliens, particulièrement pour les groupes anarchistes qui assumèrent la défense de la Révolution russe et des bolcheviks avec le plus d’enthousiasme. L’un d’eux, Astrogildo Pereira, regroupa ses écrits dans un opuscule publié en février 1918 – A Revolução Russa e a Imprensa –, où il défendait que "les maximalistes 17 russes ne se sont pas appropriés la Russie. Ils sont l’immense majorité du peuple russe, le seul réel et naturel maître de la Russie. Kerenski et sa bande s’étaient indûment approprié du pays". Cet auteur défendait aussi que la Révolution russe "est une révolution libertaire qui ouvre la voie à l’anarchisme" 18.
La Révolution de 1917 provoqua un puissant "effet d’appel", plus au niveau de la maturation de la conscience que par l’explosion de nouvelles luttes. Le recul inévitable après la Commune de São Paulo, le constat des maigres améliorations obtenues malgré la puissance des forces engagées, à quoi s’ajoutait la pression idéologique patriotique qui accompagnait la mobilisation pour la guerre, avaient provoqué une certaine désorientation et un questionnement stimulé et accéléré par les informations sur la Révolution russe.
Le processus de "maturation souterraine" – les ouvriers semblaient passifs quand en réalité ils étaient agités par un courant de doutes, de questions et de réponses – aboutit à un mouvement de luttes. En août 1918 éclata la grève de Cantareira (compagnie qui assurait la navigation entre Rio et Niteroi). L’entreprise avait augmenté les salaires des seuls employés terrestres au mois de juillet. Se sentant discriminé, le personnel maritime se déclara en grève. Des manifestations de solidarité intervinrent rapidement, principalement à Niteroi. La police à cheval dispersa la foule la nuit du 6 août. Le 7, les soldats du 58e bataillon de chasseurs de l’armée, envoyés à Niteroi, fraternisèrent avec les manifestants et s’affrontèrent aux forces conjointes de la police et d’autres unités de l’armée. De graves affrontement se produisirent, qui se soldèrent par deux morts : un soldat du 58e Bataillon et un civil. Niteroi fut envahi par de nouvelles troupes qui parvinrent à rétablir l’ordre. Les morts furent enterrés le 8, une énorme foule défila pacifiquement. La grève s’acheva le 9.
L’enthousiasme suscité par la Révolution russe, le développement des luttes revendicatives, la mutinerie d’un bataillon de l’armée, constituaient-ils une base suffisante pour se lancer dans la lutte révolutionnaire insurrectionnelle ? Un groupe de révolutionnaires de Rio donna à cette question une réponse affirmative et il commença à préparer l’insurrection. Analysons les faits.
En novembre 1918 avait eu lieu à Rio de Janeiro une grève pratiquement générale exigeant la journée de huit heures. Le gouvernement avait dramatisé la situation en affirmant que ce mouvement était une "tentative insurrectionnelle". Il est certain que la dynamique donnée par la Révolution russe et le soulagement et la joie provoqués par la fin de la guerre mondiale animaient le mouvement. Il est certain qu’en dernière instance, tout mouvement prolétarien tend à faire rejoindre l’aspect revendicatif et l’aspect révolutionnaire. Cependant, la lutte de Rio ne s’était pas étendue à tout le pays, elle ne s’était pas auto-organisée, elle ne mettait pas en évidence une conscience révolutionnaire. Mais quelques groupes de Rio crurent venu le moment de l’assaut révolutionnaire. Un autre facteur venait chauffer les esprits : une des plus graves séquelles de la guerre mondiale fut une épouvantable épidémie de grippe espagnole 19 qui finit par envahir le Brésil, à tel point que le Président de la République élu, Rodrigues Alves, y succomba avant son investiture et dut être remplacé par le vice-président.
Un Conseil qui prétendait organiser l’insurrection se constitua à Rio de Janeiro, sans même se coordonner avec les autres grands centres industriels. Y participaient des anarchistes ainsi que des leaders ouvriers de l’industrie textile, des journalistes, des avocats et quelques militaires également. L’un d’entre eux, le lieutenant Jorge Elías Ajus, n’était en fin de comptes qu’un espion qui informait les autorités des activités du Conseil.
Le Conseil tint plusieurs réunions, au cours desquelles les tâches furent distribuées aux ouvriers des usines et des districts : prise du palais présidentiel, occupation des dépôts d’armement et de munitions de l’Intendance de guerre, assaut de la cartoucherie de Raelengo, attaque de la préfecture de police, occupation de l’usine électrique et de la centrale téléphonique. Vingt mille travailleurs étaient prévus dans cette action, qui devait se réaliser le 18.
Le 17 novembre, Ajus fit un coup de théâtre : "Il déclara que n’étant pas de service le 18, il ne pourrait coopérer au mouvement, demandant que la date de l’insurrection soit ajournée au 20" 20. Les organisateurs furent déstabilisés mais, après beaucoup d’hésitations, décidèrent de poursuivre ce qui avait été décidé. Mais lors d’une ultime réunion qui se tint le 18 en début d’après-midi, la police envahit les lieux et arrêta la majorité des dirigeants.
Le 18, la grève éclata dans l’industrie textile et dans la métallurgie, mais ne s’étendit pas aux autres secteurs et les tracts qui circulèrent dans les casernes appelant les soldats à se mutiner ne causèrent que peu d’effets. L’appel à constituer des "Comités d’ouvriers et de soldats" fut un échec, tant dans les usines que dans les casernes.
Un grand rassemblement avait été prévu au Campo de San Cristobal, qui devait être le point de départ de colonnes chargées d’occuper des édifices gouvernementaux ou stratégiques. Les participants ne dépassèrent pas le millier et ils furent rapidement encerclés par les troupes de la police et de l’armée. Le reste des actions prévues ne fut même pas engagé, et la tentative de dynamiter deux tours électriques échoua le 19.
Le gouvernement emprisonna des centaines d’ouvriers, ferma les locaux syndicaux et interdit toute manifestation ou rassemblement. La grève commença à refluer le 19, et la police et l’armée entrèrent systématiquement dans toutes les usines en grève pour obliger à la pointe de l’épée les travailleurs à reprendre le travail. Quelques actes de résistance se soldèrent par la mort de trois ouvriers. Le 25 novembre, l’ordre régnait dans la région.
1919-21 – Le déclin de l’agitation sociale
Malgré ce fiasco, des braises de combativité et de conscience ouvrières étaient encore ardentes. La Révolution prolétarienne en Hongrie et le triomphe de la Commune révolutionnaire de Bavière insufflèrent un grand enthousiasme. De gigantesques manifestations eurent lieu dans de nombreuses villes le Premier Mai. A Rio, São Paulo et Salvador da Bahia, des résolutions furent votées dans le sens de soutenir la lutte révolutionnaire en Hongrie, en Bavière et en Russie.
En avril 1919, l’augmentation constante des prix provoqua une grande agitation ouvrière dans de nombreuses usines de São Paulo et de la région, à San Bernardo do Campo, et dans d'autres comme Campinas et Santos. Des grèves partielles éclataient ici ou là, formulant des listes de revendications, mais l’événement le plus notable fut la tenue d’assemblées générales et leur décision d’élire des délégués pour établir une coordination, ce qui aboutit à la constitution d’un Conseil général d’ouvriers qui organisa la manifestation du Premier Mai et formula une série de revendications : journée de huit heures, augmentation des salaires indexés à l’inflation, interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans et du travail de nuit pour les femmes, réduction du prix des marchandises de première nécessité et des loyers. La 4 mai, la grève devint générale.
La riposte du Gouvernement et des capitalistes se fit sur deux plans : d’un côté la répression féroce pour empêcher les manifestations et les regroupements tout en persécutant les ouvriers considérés comme les dirigeants, qui étaient emprisonnés sans jugement et déportés dans des régions lointaines du Brésil. De l’autre, les patrons et le gouvernement se montrèrent réceptifs aux revendications et, à petite dose, en semant toutes les divisions possibles, ils augmentèrent les salaires par-ci, ils réduisirent la journée de travail par là, etc.
Cette tactique eut du succès. La grève s’acheva ainsi le 6 mai aux faïenceries de Santa Catalina, avec la promesse de la journée de huit heures, la suppression du travail des enfants et une augmentation de salaire. Les travailleurs portuaires de Santos reprirent le travail le 7. Le 17, ce fut le tour de la Compagnie nationale de tissus de Yute. La question de la nécessité d’une attitude unitaire ne fut à aucun moment posée (ne pas reprendre le travail si les revendications n’étaient pas accordées à tous), pas plus que la possibilité d’étendre le mouvement à Rio, alors que dans cette ville avaient éclaté de nombreuses grèves depuis la mi-mai, adoptant la même plate-forme revendicative. Une fois la paix sociale rétablie dans la région de São Paulo, les grèves dans les États de Rio, Bahía et la ville de Recife, malgré leur massivité, furent finalement étouffées par la même tactique combinant des concessions mesurées et la répression sélective. Une grève massive à Porto Alegre en septembre 1919, qui partit de la compagnie électrique Light & Power en réclamant une augmentation de salaires et une réduction d’horaires, provoqua la solidarité des boulangers, des conducteurs, des travailleurs du téléphone, etc. La bourgeoisie eut alors recours à la provocation – des bombes firent sauter quelques installations de la compagnie électrique et la maison d’un briseur de grève – pour interdire les manifestations et les assemblées. Le 7 septembre, une manifestation massive place Montevideo fut attaqué par la police et l’armée, provoquant un mort parmi les manifestants. Le lendemain, de nombreux grévistes furent arrêtés par la police et les locaux syndicaux furent fermés. La grève s’acheva le 11, sans avoir obtenu satisfaction à la moindre revendication.
L’épuisement, l’absence d’une claire perspective révolutionnaire, les concessions obtenues dans bon nombre de secteurs, provoquèrent un reflux général. Le gouvernement durcit alors la répression, lançant une nouvelle vague d’arrestations et de déportations, fermant les locaux ouvriers, favorisant les licenciements disciplinaires. Le Parlement approuva de nouvelles lois répressives : il suffisait d’une provocation, l’explosion d’une bombe chez des militants connus ou dans un lieu fréquenté, pour déclencher l’application des lois répressives. Une tentative de grève générale en novembre 1919 à São Paulo échoua lamentablement, et le gouvernement mit à profit cet événement pour lancer un nouveau coup de filet, emprisonnant tous ceux qui pouvaient être considérés comme des leaders, qui furent cruellement torturés à Santos et à São Paulo avant d’être déportés.
La combativité ouvrière et le mécontentement général connurent cependant leur chant du cygne en mars 1920 : la grève de Leopoldina Railways à Rio et celle de Mogiana dans la région de Sao Paulo.
La première se déclencha le 7 mars à partir d’une plate-forme revendicative, à laquelle la compagnie répondit en utilisant les employés du public comme "jaunes". Les travailleurs firent des appels à la solidarité en sortant tous les jours dans la rue. Le 24 commença une première vague de grèves de soutien : métallurgistes, taxis, boulangers, tailleurs, bâtiment… Une grande assemblée se tint où un appel fut lancé à ce que "toutes les classes ouvrières présentent leurs propres plaintes et revendications". Ils furent rejoints le 25 par les travailleurs de l’industrie textile. Il y eut également une grève solidaire dans les transports à Salvador et dans des villes de l'État du Minas Gerais.
Le gouvernement riposta par une répression violente qui, le 26 mars, jeta plus de 3000 grévistes dans les prisons. Celles-ci étaient tellement pleines qu’il fallut utiliser les locaux des entrepôts du port pour enfermer les ouvriers.
Le mouvement commença à refluer le 28, avec la reprise du travail des ouvriers de l’industrie textile. Les syndicalistes réformistes servirent de "médiateurs" pour que les entreprises réembauchent les "bons ouvriers" qui avaient "au moins cinq ans d’ancienneté". Ce fut une débandade dans les rangs ouvriers et, le 30, la lutte était terminée sans avoir obtenu la moindre revendication.
La seconde, qui commença sur la ligne ferroviaire du nord de São Paulo, dura du 20 mars au 5 avril, recevant la solidarité de la Federação Operária de São Paulo qui décréta une grève générale suivie partiellement dans l’industrie textile. Les grévistes occupèrent des gares, tentant d’expliquer leur lutte aux voyageurs, mais le gouvernement régional se montra intraitable. Les gares occupées furent attaquées par les troupes, provoquant de nombreux affrontements violents, en particulier à Casa Branca où furent tués quatre ouvriers. Une violente campagne de presse fut orchestrée contre les grévistes pour accompagner cette répression sauvage, soldée par de nombreuses arrestations et déportations non seulement d’ouvriers mais aussi de leurs femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants étaient enfermés dans des casernes où de cruels châtiments corporels leurs étaient infligés.
Quelques éléments de bilan
Les mouvements au Brésil entre 1917 et 1920 font indiscutablement partie de la vague révolutionnaire de 17-23 et ne peuvent être compris qu’à la lumière des leçons de celle-ci. Le lecteur peut consulter deux articles où nous tentons d’en faire le bilan 21. Nous nous limiterons ici à mettre en avant quelques leçons qui se dégagent directement de l’expérience brésilienne.
La fragmentation du prolétariat
La classe ouvrière au Brésil était très fragmentée. La majorité des travailleurs immigrés récemment avaient très peu de liens avec le prolétariat autochtone, lequel était très lié à l’artisanat ou constitué de journaliers dans d’immenses exploitations agricoles complètement isolées 22. Les travailleurs immigrants étaient eux-mêmes divisés en "ghettos linguistiques", italiens, espagnols, portugais, allemands, etc. : "São Paulo était une ville où l’on parlait plus l’italien, dans ses divers dialectes pittoresques, que le portugais. Cette influence de la langue et la culture péninsulaires touchait tous les secteurs de la vie pauliste" 23.
Mais il faut aussi signaler la grande dispersion des centres industriels. Rio et São Paulo ne parvinrent jamais à synchroniser les luttes. La Commune de São Paulo ne s’étendit à Rio que quand la lutte était finie. La tentative insurrectionnelle de novembre 1918 resta circonscrite à Rio sans que soit posée la question d’une action commune, ne serait-ce qu’à São Paulo ou Santos.
A la dispersion du prolétariat s’ajouta le faible écho que l’agitation ouvrière rencontra dans les masses paysannes – qui constituaient la majorité de la population –, tant dans les régions lointaines (Mato Grosso, Amazonie, etc.) que dans celles qui subissaient des conditions proches de l’esclavage dans les plantations de café et de cacao 24.
La fragmentation du prolétariat et son isolement du reste de la population non exploiteuse donna une énorme marge de manœuvre à la bourgeoisie qui, après avoir fait certaines concessions, put déchaîner une brutale répression.
Les illusions sur le développement du capitalisme
La guerre mondiale avait mis en lumière que le capitalisme, en formant le marché mondial et imposant ainsi ses lois à tous les pays de la planète, avait atteint ses limites historiques. La Révolution en Russie mit en évidence que la destruction du capitalisme était non seulement nécessaire, mais possible.
Il existait cependant des illusions sur la capacité du capitalisme à continuer à se développer 25. Il y avait au Brésil un énorme territoire à coloniser. Comme dans d’autres pays d’Amérique, y compris les États-Unis, les ouvriers restaient très vulnérables à la mentalité "pionnière", à l’illusion de "tenter de faire fortune" et de gagner correctement sa vie à travers la colonisation agricole ou la découverte de gisements de minerais. Beaucoup d’immigrants considéraient leur condition ouvrière comme une "période transitoire" qui devait réaliser leurs rêves et les transformer en colons aisés. La défaite de la révolution en Allemagne et dans d’autres pays, l’isolement croissant de la Russie, les graves erreurs de l’Internationale communiste sur les possibilités de développement du capitalisme dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux donnèrent des ailes à cette illusion.
La difficulté pour développer un élan internationaliste
Avec la Commune de São Paulo, les prolétaires au Brésil contribuèrent à la maturation internationale des conditions qui favorisèrent la Révolution d’Octobre en Russie, comme ils furent enthousiasmés par elle. Comme dans d’autres pays, existaient les germes du positionnement internationaliste qui est le point de départ incontournable d’une révolution ouvrière.
Ce positionnement internationaliste donne au prolétariat les bases pour renverser l’État dans tous les pays, mais il a besoin pour cela de trois conditions : l’unification des minorités révolutionnaires dans un parti mondial, la formation de conseils ouvriers et leur coordination croissante à l’échelle mondiale. Aucune de ces trois conditions n’était présente au Brésil :
1) les contacts avec l’Internationale communiste ne se prirent que très tard, en 1921, quand la vague révolutionnaire refluait et que l’IC était en plein processus de dégénérescence ;
2) les conseils ouvriers ne furent présents à aucun moment, excepté les tentatives encore embryonnaires de la Commune de São Paulo en 1917 et lors de la grève massive de 1919 ;
3) les liens avec le prolétariat des autres pays étaient pratiquement inexistants.
L’absence de réflexion théorique et l’activisme des minorités révolutionnaires
Le gros de l’avant-garde du prolétariat au Brésil était composé de militants de tendance anarchiste internationaliste 26. Ils eurent le mérite de défendre des positions contre la guerre, et de soutenir la Révolution russe et le bolchevisme. Ce furent eux qui, en 1919, créèrent de leur propre initiative et sans le moindre contact avec Moscou un Parti communiste de Rio de Janeiro, qui poussèrent la COB à adhérer à l’IC.
Mais ils n’avaient pas un positionnement historique, théorique et mondial, tout était basé sur "l’action" qui devait amener les masses à lutter. En conséquence, tous leurs efforts étaient concentrés vers la création de syndicats et vers les convocations à des manifestations et des actions de protestation. L’activité théorique pour comprendre quels étaient les objectifs de la lutte, ses moyens, quels étaient les obstacles qui se dressaient face à elle, quelles étaient les conditions nécessaires pour qu’elles puissent se développer, fut complètement négligée. En d’autres termes, ils négligèrent tous ces éléments indispensables pour que le mouvement développe une conscience claire, sache voir les pas en avant à réaliser, évite les pièges et ne soit pas le jouet des événements et des manœuvres d’un ennemi tel que la bourgeoisie, la classe exploiteuse la plus intelligente de l’histoire sur le plan politique. Cet activisme lui fut fatal. Une expression significative de cela fut, comme on l'a vu, l’échec de l’insurrection de Rio en 1918 dont, à notre connaissance, aucune leçon ne fut tirée.
C. Mir, 24 novembre 2012
1 Revue internationale no 139, "1914 - 23 : dix années qui ébranlèrent le monde (I) – La révolution hongroise de 1919 ",
https://fr.internationalism.org/rint139/1914_23_dix_annees_qui_ebranlere... [155]
2 Cf. une contribution au bilan de ces expériences, in "2011, de l’indignation à l’espoir ", https://fr.internationalism.org/ri431/2011_de_l_indignation_a_l_espoir.html [372]
3 Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicat, chapitre VII,
https://www.marxists.org/francais/luxembur/gr_p_s/greve7.htm [373].
4 Il s’agit d’un grand arbre (Caesalpinia echinata) dont le tronc contient une teinture rouge très appréciée ; sa surexploitation l'a fait quasiment disparaître.
6 Jusqu’au coup d’État de 1889, le Brésil était un empire dont l’empereur procédait de la dynastie portugaise.
7 On calcule qu’entre 1871 et 1920 arrivèrent au Brésil 3 900 000 immigrants du Sud de l’Europe.
8 L’introduction de l’article "Trabalho e vida do operairiado brasileiro nos séculos xix e xx", de Rodrigo Janoni Carvalho, publié dans la revue Arma da Critica, An 2, no 2, mars 2010, contient une description terrifiante des logements du prolétariat de São Paulo au début du xxe siècle. Jusqu’à vingt personnes pouvaient partager les lieux d’aisance.
9 La CGT française était alors un pôle de référence pour les secteurs ouvriers dégoûtés par l’opportunisme croissant des partis sociaux-démocrates et l’attitude toujours plus conciliatrice des syndicats. Cf. Revue internationale no 120, "L'anarcho-syndicalisme face à un changement d'époque : la CGT jusqu'à 1914 ", https://fr.internationalism.org/rint/120_cgt [375].
10 "Francisco Ferrer Guardia (Alella, 1859-Barcelonne, 1909) fut un célèbre pédagogue libertaire espagnol. Il fut arrêté à Barcelone en juin 1909, accusé d’avoir été l’instigateur de la révolte connue sous le nom de 'la Semaine tragique'. Ferrer fut déclaré coupable par le Tribunal militaire et, le 13 octobre 1909, à 9 heures du matin, fût fusillé dans la prison de Montjuic. Il est de notoriété publique que Ferrer n’avait aucun rapport avec les faits et que le tribunal le condamna sans disposer de la moindre preuve contre lui" (wikipedia en espagnol, traduit par nos soins, es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ferrer_Guardia [376]).
11 Cf. Revue internationale no 129, "la CNT face à la guerre et à la révolution (1914-1919)", https://fr.internationalism.org/user/login?destination=discussthis/new/2905 [377].
12 Pereira, "Formação do PCB", cité par John Foster Dulles, Anarquistas e comunistas no Brasil, p. 37.
13 Cecilia Prada, "Les barricades de 1917 : la mort d’un cordonnier anarchiste provoque la première grève générale du pays", cf. www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=292&Artigo_... [378]
14 Cité de l’article "Traços biográficos de um homem extraordinário", Dealbar, São Paulo, 1968, an 2, no 17. Il s’agit du militant anarchiste Edgard Leuenroth, qui participa activement à la grève de Sao Paulo.
15 Everardo Dias, História das lutas sociais no Brasil, p. 224.
17 C’est ainsi que la presse nommait les bolcheviks.
18 John Foster Dulles, Anarquistas e comunistas no Brasil p. 63.
19 La grippe espagnole (connue aussi sous le nom de la Grande pandémie de grippe, l’Épidémie de grippe de 1918 ou la Grande grippe) fut une épidémie de grippe d’une dimension inconnue jusque-là (…). On considère que ce fut l'épidémie la plus mortelle de l’histoire de l’humanité, provoquant entre cinquante et cent millions de morts dans le monde entre 1918 et 1920. (…). Les Alliés de la Première Guerre mondiale la baptisèrent "Grippe espagnole" parce que la pandémie attira l’attention de la presse en Espagne alors qu’elle était maintenue secrète dans les pays engagés dans la guerre, qui censuraient les informations concernant l’affaiblissement des troupes atteintes par la maladie ; https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola [381]
20 Anarquistas e comunistas no Brasil p. 68.
21 Cf. Revue internationale no 75, "La révolution d'octobre 1917 : Œuvre collective du prolétariat (3° partie) [382]", et Revue internationale no 80, "Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial", https://fr.internationalism.org/rinte80/vague.htm [383]
22 Depuis les grèves de 1903, où journaliers et paysans autochtones avaient servi de "jaunes", la méfiance et la rancune entre ouvriers immigrants et ouvriers autochtones n’avaient cessé d’exister. Voir l’essai en anglais de Colin Everett,
Organized Labor in Brazil
23 Barricadas de 1917, Cecilia Prada, thèse de doctorat.
24 Selon nos informations, le mouvement paysan le plus significatif eut lieu en 1913, et rassembla plus de 15 000 grévistes, colons et journaliers.
25 Ces illusions affectaient même l’Internationale communiste, qui concevait la possibilité de la libération nationale dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Voir les "Thèses du IIe Congrès de l’IC ", https://www.marxists.org/francais/inter_com/1920/ic2_19200700f.htm [385]
26 A notre connaissance, il y eut très peu de groupes marxistes. Ce n’est que vers 1916 (après une tentative avortée en 1906) que se forma un Parti socialiste, qui se divisa rapidement en deux tendances également bourgeoises, l’une étant partisane de l’entrée du Brésil dans la Guerre mondiale et l’autre défendant la neutralité du Brésil.
Rubrique:
À propos du livre Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était (II): le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la solidarité
- 4061 lectures
Le rôle des femmes dans la société primitive
Quel est donc, selon Darmangeat, le rôle et la situation des femmes dans les sociétés primitives ? Nous ne voulons pas reprendre ici toute l'argumentation de son livre, étayée par de solides connaissances ethnographiques et des exemples parlants. Nous nous limiterons donc à un résumé de ses conclusions. Un premier constat peut sembler évident, mais ne l'est pas en réalité : la division sexuelle du travail est une constante universelle de toute société humaine jusqu'à l'avènement du capitalisme. Le capitalisme demeure une société fondamentalement patriarcale, basée sur l'exploitation (qui inclut l'exploitation sexuelle, l'industrie du sexe étant devenue l'une des industries les plus rentables des temps modernes). Néanmoins, en exploitant directement la force de travail des ouvrières, et en développant le machinisme au point où la force physique ne joue presque plus de rôle dans le monde du travail, le capitalisme a détruit la division du travail dans la société entre rôles féminins et masculins ; il a donc jeté les bases pour une véritable libération de la femme dans la société communiste. 2
La situation des femmes dans les sociétés primitives varie énormément selon les sociétés qui ont pu être étudiées par les anthropologues : si dans certains cas les femmes souffrent d'une oppression qui peut presque ressembler à une oppression de classe, dans d'autres elles jouissent non seulement d'une réelle considération dans la vie sociale, mais détiennent aussi un vrai pouvoir social. Là où ce pouvoir existe, il est basé sur la possession de droits sur la production, qui sont amplifiés en quelque sorte par la vie religieuse et rituelle de la société : pour ne prendre qu'un seul exemple parmi tant d'autres, Malinowski nous apprend (dans Les Argonautes du Pacifique occidental) que les femmes des Îles Trobriand ont un monopole non seulement sur les travaux de jardinage (très important dans l'économie des Îles), mais aussi sur certaines formes de magie, y compris les formes considérées comme les plus dangereuses. 3
Cependant, si la division sexuelle du travail recouvre des situations très différentes selon les peuples et leur mode de vie, il y en a une qui ne souffre pas d'exception ou presque : partout, ce sont les hommes qui détiennent le monopole du maniement des armes et, par conséquent, le monopole de la guerre. De ce fait, ce sont les hommes qui détiennent également le monopole de ce qu'on pourrait appeler "les affaires étrangères". Lorsque les inégalités sociales ont commencé à se développer, avec le stockage d'abord, puis à partir du néolithique avec l'agriculture proprement dite et l'émergence de la propriété privée et des classes sociales, c'est cette position sociale spécifique des hommes qui leur a permis de dominer petit à petit toute la vie sociale. En ce sens, Engels a sans doute raison d'affirmer, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, que "La première opposition de classe qui se manifeste dans l'histoire coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal, et la première oppression de classe, avec l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin". 4 Il faut néanmoins se garder d'une vision trop schématique puisque même les premières civilisations sont loin d'être homogènes. Dans son étude comparative de plusieurs "civilisations premières", Understanding early civilizations, Bruce Trigger fait apparaître un large spectre : si la situation des femmes dans les sociétés méso-américaines et Inca n'était guère enviable, chez les Yoruba en Afrique par contre, les femmes non seulement détenaient des biens et se voyaient réserver la pratique de certaines industries, mais aussi pouvaient pratiquer le commerce à grande échelle pour leur propre compte, voire mener des expéditions diplomatiques et militaires.
La question des mythes
Jusqu'ici nous sommes restés, avec Darmangeat, dans le domaine de l'étude des sociétés primitives "historiquement connues" (dans le sens où elles ont pu être décrites par des sociétés qui maîtrisaient l'écriture, depuis le monde antique jusqu'à nos jours). Cette étude nous apprend quelle est la situation depuis l’invention de l'écriture au IVe millénaire av. J.-C. Mais que dire des près de 200 000 années d'existence de l'Homme moderne qui l'ont précédée ? Comment comprendre ce moment crucial où la nature a cédé la place à la culture comme déterminant principal du comportement humain, et comment les déterminants génétiques et environnementaux, notamment sociaux et culturels, sont-ils combinés dans la société humaine ? Il est évident que, pour répondre à ces questions, la simple vision empirique des sociétés connues est insuffisante.
Une chose qui frappe dans le livre de Trigger est que, malgré toute la variété qu'elles nous offrent quant à la condition féminine, toutes les civilisations qu’il étudie 5 possèdent des légendes qui font référence à des femmes chefs du passé, parfois identifiées avec des déesses. Toutes ont également vu un déclin de la condition de la femme dans le temps. Il semble se profiler ici une règle générale : plus on remonte vers le passé, plus les femmes détiennent une autorité sociale.
Cette impression est confirmée si on regarde les sociétés plus primitives. Sur tous les continents, on retrouve des mythes similaires voire parfois identiques : autrefois, c'étaient les femmes qui détenaient le pouvoir mais, depuis, les hommes le leur ont volé, et maintenant ce sont eux qui dirigent. Le pouvoir des femmes est associé au plus puissant des pouvoirs magiques, celui qui repose sur le cycle mensuel féminin et leur sang menstruel, à un point tel où très souvent existent des rites masculins où les hommes imitent la menstruation. 6
Quelles déductions peut-on faire à partir de cette réalité omniprésente ? Peut-on en conclure qu'elle représente une réalité historique, qu'il y avait effectivement une société première où les femmes détenaient un rôle dirigeant, sinon dominant ?
Pour Darmangeat, la réponse est sans équivoque et négative : "penser que lorsque les mythes parlent du passé, ils parlent nécessairement d'un passé réel, même déformé, est en effet une hypothèse extrêmement hardie, pour ne pas dire insoutenable" (p. 167). Les mythes "racontent des histoires, histoires qui n'ont un sens que par rapport à une situation présente qu'ils ont pour fonction de justifier. Le passé dont ils parlent est inventé à seule fin de satisfaire à cet objectif" (p. 173).
Cet argument nous pose deux problèmes.
Le premier problème est que Darmangeat se veut un marxiste qui actualise l’œuvre d'Engels tout en restant fidèle à sa méthode. Or, celui qui le premier a utilisé l'analyse de la mythologie pour essayer d'éclaircir les relations entre les sexes dans le passé lointain est un juriste suisse, Johann Bachofen ; et si dans L'origine de la famille, Engels s'appuie certes largement sur Lewis Morgan, il accorde aussi une place importante aux travaux de Bachofen. Mais, pour Darmangeat, Engels "ne reprend à son compte la théorie du matriarcat de Bachofen qu'avec une évidente réserve (...) S'il s'abstient de critiquer la théorie du juriste suisse, Engels ne lui apporte donc qu'une caution fort mesurée. Rien d'étonnant à cela : étant donné sa propre analyse des causes de la domination d'un sexe sur un autre, Engels ne pouvait guère admettre qu'avant le développement de la propriété privée, la domination des hommes soit précédée par celle des femmes ; il concevait le rapport entre les sexes dans la préhistoire bien davantage sous la forme d'une certaine égalité" (pp. 150-151).
Engels est peut-être resté prudent sur les conclusions de Bachofen mais, quant à la méthode qui consiste à utiliser l'analyse mythologique pour découvrir la réalité historique, il n'hésite pas : dans sa préface à la 4e édition de L'Origine de la famille (c'est à dire après avoir eu tout le temps pour remanier l'œuvre et corriger ses conclusions initiales), Engels reprend l'analyse de Bachofen du mythe d'Oreste (notamment la version mise en scène par le dramaturge grec Eschyle) et termine avec ce commentaire : "Cette interprétation de L'Orestie, neuve, mais absolument juste, est l'un des plus beaux et des meilleurs passages de tout le livre (...) c'est Bachofen qui, le premier, a remplacé la formule creuse d'un état primitif inconnu où auraient régné des rapports sexuels exempts de toute règle, par la preuve que la littérature classique de l'Antiquité abonde en traces fort nombreuses témoignant que, chez les Grecs et les Asiatiques, il a effectivement existé avant le mariage conjugal un état de choses où non seulement un homme avait des rapports sexuels avec plusieurs femmes, mais aussi une femme avec plusieurs hommes, sans pécher contre les mœurs (...) Il est vrai que Bachofen n'a pas énoncé aussi clairement ces propositions - sa conception mystique l'en empêchait. Mais il les a prouvées, et cela équivalait, en 1861, à une révolution totale."
Cela nous amène au deuxième problème, qui est celui d'expliquer les mythes. Les mythes font partie de la réalité matérielle autant que n'importe quel autre phénomène : ils sont donc eux-mêmes déterminés par la réalité. Or Darmangeat ne nous offre que deux déterminations possibles : soit ce sont tout simplement "des histoires" inventées par les hommes pour justifier leur domination sur les femmes, soit ils relèvent de l'irrationnel : "Durant la préhistoire, et très longtemps après, les phénomènes naturels ou sociaux étaient, dans l'esprit de tous, inévitablement interprétés au travers d'un prisme magico-religieux. Cela ne veut pas dire que la pensée rationnelle était absente ; cela veut dire que, même lorsqu'elle était présente, elle était toujours associée dans une certaine mesure à un discours irrationnel, les deux n'étant pas perçus comme différents, et encore moins comme incompatibles" (p. 319). Le tour est joué, en quelque sorte. Tous ces mythes autour du pouvoir mystérieux porté par le sang menstruel et la lune, et d'un pouvoir originel des femmes, ne sont que des expressions "irrationnelles", et donc en-dehors du champ de l'explication scientifique. Au mieux, Darmangeat admet que les mythes doivent satisfaire aux exigences de cohérence 7 de l'esprit humain : mais alors, à moins d’accepter une explication purement idéaliste dans le sens propre du terme, la question se pose : d'où viennent ces exigences ? Pour Lévi-Strauss, la remarquable unité des mythes de l’ensemble des sociétés primitives des Amériques trouvait sa source dans la structure même de l’esprit humain, d’où le nom de "structuralisme" donné à son œuvre et à sa théorie 8 ; "l’exigence de cohérence" de Darmangeat semble refléter ici, en beaucoup moins élaboré, le structuralisme de Lévi-Strauss.
Cela nous laisse sans explication sur deux points capitaux : pourquoi ces mythes prennent-ils cette forme précise, et comment expliquer leur universalité ?
Si ce ne sont que "des histoires" inventées pour justifier la domination des hommes, alors pourquoi inventer des histoires aussi invraisemblables ? Si on regarde la Bible, la Genèse nous offre une justification tout à fait logique pour la domination des hommes : c'est Dieu qui les a créés en premier ! Quitte à nous faire avaler l'invraisemblable notion, que tout un chacun peut voir contredite à chaque instant, selon laquelle la femme est sortie du corps de l'homme. Pourquoi donc inventer un mythe qui non seulement prétend que les femmes ont autrefois détenu le pouvoir, mais exige que les hommes continuent d'exercer tous les rites qui y étaient associés jusqu'au point d'imaginer la menstruation masculine ? Cette dernière, attestée partout dans le monde chez les peuples de chasseurs-cueilleurs à forte domination masculine, consiste pour les hommes, dans certains rites importants, à faire couler leur propre sang en se lacérant les membres et particulièrement leur pénis, en imitation des menstrues.
Si ce genre de rite se trouvait limité à un peuple, ou à un groupe de peuples, on pourrait peut-être admettre qu'il ne s'agissait que d'une invention fortuite et "irrationnelle". Mais lorsqu'il se trouve répandu dans le monde entier, sur tous les continents, alors nous sommes obligés, si nous voulons rester fidèles au matérialisme historique, d'en chercher les déterminants sociaux.
Quoi qu’il en soit, il nous semble nécessaire, du point de vue matérialiste, de prendre au sérieux les mythes et les rites qui structurent la société comme sources de connaissance de celle-ci, ce que Darmangeat ne fait pas.
Aux origines de l'oppression des femmes
Si on résume la pensée de Darmangeat, on arrive à ceci : à l’origine de l’oppression des femmes, il y a une division sexuelle du travail qui accorde systématiquement aux hommes le maniement des armes et la chasse au gros gibier. Malgré tout l’intérêt de son œuvre, il nous semble qu’elle laisse deux questions entières.
Il semble assez évident qu’avec l’apparition de la société de classes, basée nécessairement sur l’exploitation et donc sur l’oppression, le monopole du maniement des armes est presque une raison suffisante pour y assurer la domination des hommes (du moins à la longue, le processus d’ensemble étant sans aucun doute plus complexe que cela). De même, il semble a priori raisonnable de supposer que le monopole des armes ait joué un rôle dans l’émergence d’une domination masculine contemporaine, avec l’émergence des inégalités préalable à la société de classes proprement dite.
Par contre, et c’est là notre première question, Darmangeat est beaucoup moins clair quant à expliquer pourquoi la division sexuelle du travail devrait accorder ce rôle aux hommes, puisque lui-même nous dit que "les raisons physiologiques (...) peinent à expliquer pourquoi les femmes ont été exclues de la chasse" (p. 315). Darmangeat n’est pas plus clair quant à expliquer pourquoi la chasse, et la nourriture qui en résulte, se verraient accorder un bien plus grand prestige que les produits de la cueillette ou de l’horticulture, en particulier là où la cueillette fournit l’essentiel des ressources sociales.
Plus fondamentalement encore, d’où vient la première division du travail, et pourquoi se ferait-elle sur une base sexuelle ? Ici, Darmangeat se perd en conjectures : "Il est permis de penser que la spécialisation, même embryonnaire, a permis à l’espèce humaine d’acquérir une efficacité plus grande que si chacun de ses membres avait continué à s’adonner indifféremment à toutes les activités (...) Il est également permis de penser que cette spécialisation a joué dans le même sens en renforçant les liens sociaux en général, et au sein du groupe familial en particulier". 9 Certes, "il est permis de penser"... mais n’est-ce pas ce qu’il fallait plutôt démontrer ?
Quant à savoir "pourquoi la division du travail s’est effectuée selon le critère du sexe", pour Darmangeat, cela ne "semble pas soulever des difficultés. Il semble assez évident que, pour les membres des sociétés préhistoriques, la différence entre hommes et femmes était la première qui sautait aux yeux". 10 On peut objecter que si la différence sexuelle devait certainement "sauter aux yeux" des premiers Hommes, cela n’en fait pas une condition suffisante pour l’émergence d’une division sexuelle du travail. Les sociétés primitives abondent en classifications, notamment celles basées sur les totems. Pourquoi la division du travail ne se baserait-elle pas sur le totémisme ? Pure élucubration, évidemment, mais pas plus que l’hypothèse de Darmangeat. Plus sérieusement, Darmangeat ne fait aucune mention d’une autre différence très visible, et qui est partout d’une grande importance dans les sociétés archaïques : l’âge.
En fin de compte, le livre de Darmangeat - malgré son titre un peu tapageur - ne nous éclaire guère. L'oppression de la femme se base sur la division sexuelle du travail, soit. Mais d'où vient cette dernière ? "Bien qu'en l'état actuel des connaissances, on en soit réduit aux simples hypothèses, on peut donc supposer que ce sont certaines contraintes biologiques, vraisemblablement liées à la grossesse et à l'allaitement, qui ont fourni, à une époque inconnue, le substrat physiologique de la division sexuelle du travail et de l'exclusion des femmes de la chasse" (p. 322). 11
De la génétique à la culture
À la fin de son argumentation, Darmangeat nous laisse avec la conclusion suivante : à l'origine de l'oppression des femmes se trouve la division sexuelle du travail et cette division elle-même a été, malgré tout, un formidable progrès dans la productivité du travail dont les origines sont perdues dans un passé lointain et inaccessible.
Ainsi, l'auteur cherche à rester fidèle au cadre marxiste. Mais n'a-t-il pas posé le problème à l'envers ? Si on observe le comportement des primates les plus proches de l'Homme, et particulièrement des chimpanzés, ce sont les mâles qui chassent - les femelles étant trop occupées à nourrir et à soigner leurs petits (et à les protéger des mâles : n'oublions pas que très souvent les primates mâles pratiquent l'infanticide de la progéniture d’autres mâles, afin de rendre les mères disponibles pour leur propre reproduction). La "division du travail" entre les mâles qui chassent et les femelles qui ne chassent pas n'a donc rien de spécifiquement humain. Le problème – ce qu'il faut expliquer - n'est pas de savoir pourquoi ce sont les mâles qui chassent chez Homo sapiens, mais plutôt de savoir pourquoi ils partagent systématiquement les fruits de la chasse. Le plus frappant, quand on compare Homo sapiens à ses cousins primates, c'est l'ensemble des règles et des tabous souvent très stricts, et qu'on retrouve depuis les brûlants déserts australiens jusqu'aux glaces de l'Arctique, qui exigent la consommation collective des produits de la chasse. Le chasseur n'a pas le droit de consommer son propre produit, il doit le ramener au campement pour qu'il soit partagé avec les autres. Les règles qui déterminent comment ce partage se fait sont très variables selon les peuples, et peuvent être plus ou moins strictes, mais elles sont partout présentes.
Il est à remarquer également que le dimorphisme sexuel d'Homo sapiens est nettement réduit par rapport à celui d’Homo erectus, ce qui indique en général, dans le monde animal, des relations plus égales entre les sexes.
Partout, le partage et le repas collectif sont des éléments fondateurs des sociétés primitives – et le repas partagé est même arrivé jusqu'aux temps modernes : même aujourd'hui, aucune grande occasion de la vie (naissance, mariage ou enterrement) n'est envisageable sans repas collectif. Quand des gens se regroupent en simple amitié, c'est le plus souvent autour d'un repas commun, que ce soit autour d'un barbecue en Australie ou d'une table de restaurant en France.
Ce partage de nourriture, qui semble remonter aux temps premiers, est un des éléments d'une vie collective et sociale très différente de celle de nos lointains ancêtres. Nous nous trouvons face à ce que le darwinologue Patrick Tort a appelé un "effet réversif" de l'évolution, ou ce que l'anthropologue Chris Knight a décrit comme étant "une expression sans prix de l’"égoïsme” de nos gènes" 12 : les mécanismes décrits par Darwin et Mendel, et confirmés par la génétique moderne, ont généré une vie sociale où la solidarité joue un rôle central alors que ces mêmes mécanismes procèdent par compétition.
Cette question du partage, fondamentale selon nous, n'est qu'une partie d'un problème scientifique plus vaste : comment expliquer le processus qui a transformé une espèce dont la modification du comportement était déterminée par le rythme lent de l'évolution génétique, en la nôtre dont le comportement, sur une base évidemment génétique, se modifie grâce à l'évolution bien plus rapide de la culture et des rapports sociaux ? Et comment expliquer le fait qu'un mécanisme basé sur la compétition ait pu créer une espèce qui ne peut survivre que solidairement : les femmes solidaires entre elles dans l'enfantement et l'éducation de leurs enfants, les hommes solidaires dans l'exercice de la chasse, les chasseurs solidaires de toute la société en rapportant le produit de leur chasse, les valides solidaires des invalides qui ne sont plus capables de chasser ou de trouver leur propre nourriture, et les vieux solidaires des jeunes à qui ils inculquent non seulement la connaissance du monde et de la nature nécessaire à la survie, mais aussi la connaissance sociale, historique, rituelle et mythique qui permettent la survie d'une société structurée. Ceci nous paraît être le problème fondamental posé par la question de la "nature humaine".
Ce passage d'un monde à un autre a eu lieu au cours d’une période cruciale, de plusieurs centaines de milliers d’années, une période qu'on pourrait bien qualifier de "révolutionnaire". 13 Il est étroitement lié à l'évolution du cerveau humain en taille (et on peut supposer également en structure, même si une telle évolution est évidemment bien plus difficile à déceler dans les vestiges paléontologiques). L'augmentation de la taille du cerveau pose toute une série de problèmes à notre espèce en évolution, dont le moindre n'est pas sa consommation d'énergie : environ 20% du besoin énergétique total de l'individu, ce qui est énorme.
Mais si l'espèce tire indubitablement des avantages de ce processus d'encéphalisation, ce processus même pose de gros problèmes pour les femelles. La taille de la tête fait que la naissance doit se faire plus tôt, sinon le nouveau-né ne pourrait pas passer par le bassin de sa mère. À son tour, cela implique une période bien plus longue de dépendance du nouveau-né, "prématuré" par rapport aux autres primates ; la croissance du cerveau exige également un apport de nourriture supplémentaire, à la fois calorifique et structurelle (protides, lipides, glucides). Nous avons l'impression de nous confronter à une énigme insoluble, ou plutôt à une énigme que la nature n'a résolue qu'après une longue période pendant laquelle Homo erectus a vécu, s'est répandu hors d'Afrique, mais sans changement majeur dans sa morphologie ou dans son comportement semble-t-il. Et puis survient une période de changement rapide qui voit grandir le cerveau et apparaître tous ces comportements spécifiquement humains : le langage articulé, la culture symbolique, l'art, l'utilisation intensif d'outils et leur très grande variété, etc. À cette énigme s'en ajoute une autre. Nous avons remarqué le changement radical dans le comportement du mâle Homo sapiens, mais les modifications physiologiques et comportementales de la femelle ne sont pas moins remarquables, surtout sur le plan de la reproduction.
Il existe en effet une différence très frappante entre la femelle Homo sapiens et les autres primates sur ce plan. Chez ces derniers (en particulier ceux les plus proches de nous), il est très fréquent que la femelle exhibe avec ostentation aux mâles sa période d'ovulation (et donc de fécondité optimale) : organes génitaux très visibles, comportement de chaleur, en particulier auprès du mâle dominant, odeur caractéristique. Mais chez l'être humain, rien de tel, tout au contraire même : les organes sexuels sont bien cachés et ne changent pas d'aspect lors de l'ovulation et, mieux encore, la femelle elle-même n'est pas consciente d'être "en chaleur". À l'autre bout du cycle d'ovulation, la différence entre Homo sapiens et les autres primates est tout aussi frappante : chez la femelle de notre espèce, les règles sont abondantes et visibles, chez les femelles chimpanzés par exemple, c'est l'inverse. Étant donné que la perte de sang représente une perte d'énergie, la sélection naturelle devrait a priori opérer contre des règles abondantes ; cette abondance pourrait donc s'expliquer par un avantage sélectif : lequel ?
Autres caractéristiques remarquables des règles chez les humains : leur synchronisation et leur périodicité. De nombreuses études ont démontré la facilité avec laquelle les femmes en groupe se mettent à synchroniser leurs règles, et Knight reproduit dans son livre un tableau des périodicités de l'ovulation chez différentes femelles primates qui montre que seul l'être humain a un cycle parfaitement calqué sur le cycle lunaire : pourquoi ? Est-ce seulement une coïncidence fortuite ?
On pourrait être tenté de mettre tout cela de côté comme étant peu pertinent pour expliquer l'apparition du langage articulé et la spécificité humaine en général. D'ailleurs, une telle réaction serait parfaitement conforme à l'idéologie de notre époque, pour laquelle les règles des femmes sont un sujet sinon tabou du moins plutôt négatif : on pense à toutes ces publicités pour les produits "d'hygiène féminine" qui vantent justement leur capacité de rendre les règles invisibles. Découvrir, à la lecture du livre de Knight, l'immense importance des menstrues et de tout ce qui les entoure dans les sociétés primitives est donc d'autant plus frappant pour les membres d’une société moderne. Cela semble être un phénomène universel des sociétés primitives : la croyance dans l'énorme pouvoir, en bien et en mal, des règles des femmes. C’est à peine exagéré de dire que les menstrues "règlent" tout, jusqu'à l'harmonie de l'univers ; et même chez des peuples à forte domination masculine où on fait tout pour diminuer l'importance des femmes, leurs règles inspirent la crainte chez les hommes. Le sang menstruel possède un pouvoir de souillure apparemment insensé - mais c'est justement là un signe de sa puissance. On est même tenté de conclure que la violence des hommes envers les femmes est proportionnelle à la peur qu’inspirent ces dernières. 14
L'universalité de cette croyance est significative et exige une explication : nous en voyons trois possibles :
Soit il s’agit de structures inscrites dans l’esprit humain, comme le supposerait le structuralisme de Lévi-Strauss. Aujourd’hui, nous dirions plutôt que c’est inscrit dans le patrimoine génétique de l’Homme ; mais cela semble être contredit par tout ce que nous savons aujourd’hui de la génétique.
Soit cette unité provient du principe de "même cause, mêmes effets". Des sociétés similaires du point de vue de leurs rapports de production et de leur niveau technique engendreraient des mythes similaires.
Soit la similarité des mythes est l’expression d’une origine culturelle commune. Si tel était le cas, étant donné que les différentes sociétés où les mythes sur la menstruation s’expriment sont très éloignées géographiquement, l’origine commune doit remonter très loin dans le passé.
Knight privilégie la troisième explication : il voit en effet la mythologie universelle autour de la menstruation des femmes comme ayant une origine très ancienne, aux sources mêmes de la société humaine.
L'émergence de la culture
Comment ces différentes problématiques sont-elles reliées entre elles ? Quel peut être le lien entre la menstruation des femmes et la nouvelle pratique collective de la chasse ? Et entre celles-ci et tous les autres phénomènes émergents que sont le langage articulé, la culture symbolique, la société basée sur des règles communes ? Ces questions nous paraissent fondamentales parce que toutes ces évolutions ne sont pas des phénomènes isolés mais des éléments d'un seul processus qui mène d'Homo erectus à nous-mêmes. La spécialisation à outrance, caractéristique de la science moderne, a le grand désavantage (reconnu en premier d'ailleurs par les scientifiques eux-mêmes) de rendre très difficile la compréhension d'un processus d'ensemble qui ne peut être englobé par aucune spécialité.
Ce qui nous a intéressés dans l'œuvre de Knight, c'est justement l'effort de rassembler des données génétiques, archéologiques, paléontologiques et anthropologiques dans une grande "théorie du tout" pour l'évolution humaine, analogue aux tentatives en physique fondamentale qui nous ont donné les théories des cordes ou de la gravitation quantique à boucles. 15
Disons-le tout de suite : nous ne sommes pas en mesure d'apprécier l'œuvre de Knight en tant que scientifiques, nous ne prétendons pas avoir les connaissances nécessaires. Par contre, ce qui est certain, c'est que sa façon de poser les questions nous oblige à ouvrir notre esprit et à regarder ces problèmes sous un angle différent et, surtout, nous aide à ouvrir la voie vers une vision unifiée qui seule peut nous permettre d'appréhender notre question de départ : la question de la nature humaine.
Essayons donc de résumer la théorie de Knight, connue aujourd'hui sous le nom de "théorie de la grève du sexe". Pour simplifier et schématiser, Knight suppose une modification du comportement, d'abord de la femelle du genre Homo face aux difficultés de l'enfantement et de la charge des petits : se détourner des mâles dominants pour privilégier des rapports avec des mâles secondaires dans une sorte de pacte d'aide mutuelle. Les mâles acceptent de quitter les femelles pour partir à la chasse et de ramener les produits de la chasse ; en retour, ils trouvent un accès aux femelles, et donc à la reproduction, qui leur aurait été auparavant interdit par le mâle dominant. Cette modification dans le comportement des mâles - qui au départ, rappelons-le, est soumise aux lois de l'évolution - n'est possible qu'à certaines conditions, dont deux en particulier : d'une part, il n’est pas possible pour les mâles de trouver ailleurs un accès aux femelles ; d'autre part, les mâles doivent avoir confiance dans le fait qu'ils ne seront pas supplantés pendant leur absence. Il s'agit donc de comportements collectifs. Les femelles - qui sont la force motrice de cette évolution - doivent maintenir un refus collectif du sexe aux mâles. Ce refus collectif est signalé aux mâles, et aux autres femelles, par un signe extérieur : les menstrues, qui sont synchronisées sur un événement "universel" et visible, le cycle lunaire et les marées qui lui sont associées dans l'environnement semi-aquatique de la vallée du Rift.
La solidarité est née : solidarité entre femelles d'abord, mais ensuite aussi entre mâles. Exclus collectivement de l'accès aux femelles, ils peuvent mettre en pratique de façon de plus en plus organisée et à plus grande échelle la chasse collective au gros gibier, qui exige une capacité de planification et de solidarité face au danger.
La confiance mutuelle est née de la solidarité collective au sein de chaque sexe, mais aussi entre les sexes : les femelles confiantes dans la participation des mâles aux soins des petits, les mâles confiants qu'ils ne seront pas exclus de la possibilité de se reproduire.
Ce modèle théorique nous permet de résoudre l’énigme que Darmangeat laisse sans réponse : pourquoi les femmes sont-elles exclues de manière absolue de la chasse ? Selon le modèle de Knight, cette exclusion ne peut être qu’absolue puisque si des femelles, surtout celles sans progéniture, partaient à la chasse avec les mâles, ces derniers auraient accès à des femelles fécondables, et ne seraient donc pas contraints de partager le produit de la chasse avec les autres femelles et leurs petits. Pour que le modèle fonctionne, les femelles sont obligées de maintenir une solidarité totale entre elles. À partir de ce constat, nous pouvons comprendre le tabou qui maintient une séparation absolue entre les femmes et la chasse, qui est à la base de tous les autres tabous qui tournent autour de la menstruation et du sang des proies, et de l’interdiction pour les femmes de manier tout outil tranchant. Le fait que cette interdiction, autrefois source de la force des femmes et de leur solidarité, devienne dans d’autres circonstances une source de leur faiblesse sociale et de leur oppression, peut sembler à première vue paradoxal : en réalité, il nous donne un exemple éclatant d’un retournement dialectique, encore une illustration de la logique profondément dialectique de tout changement historique et évolutif. 16
Les femelles qui réussissent à imposer ce nouveau comportement, entre elles et aux mâles, laissent plus de descendants. Le processus d'encéphalisation se prolonge. Le chemin est ouvert au développement de l'humain moderne.
La solidarité et la confiance mutuelle ne sont donc pas nées d'une sorte de béatitude mystique, mais au contraire des lois impitoyables de l'évolution.
Cette confiance mutuelle est un préalable pour l'émergence d'une véritable capacité linguistique qui dépend de l'acceptation mutuelle de règles communes (aussi basiques que l'idée qu'un mot a le même sens pour toi que pour moi, par exemple) et d'une véritable société humaine fondée sur la culture et les lois, qui n'est plus seulement soumise à la lenteur de l'évolution génétique, mais qui est aussi capable de s'adapter beaucoup plus rapidement à de nouveaux environnements. Logiquement, un élément fondamental de la culture première est la transposition depuis le plan génétique vers le plan culturel (si on peut s'exprimer ainsi) de tout ce qui a permis l'émergence de cette nouvelle forme sociale : les mythes et les rituels les plus anciens tourneront donc eux aussi autour de la menstruation des femmes (et de la lune qui assure sa synchronisation) et de son rôle dans la régulation de l'ordre non seulement social mais aussi naturel.
Quelques difficultés, et une proposition de suite
Comme le dit Knight lui-même, sa théorie est une sorte de "mythe des origines" qui reste au niveau de l'hypothèse. Cela ne pose pas de problème en soi, évidemment : la science n'avance que grâce à l'hypothèse et à la spéculation ; c'est la religion, non la science, qui cherche à établir des certitudes.
Pour notre part, nous voulons soulever deux objections à la trame de la narration proposée par Knight.
La première concerne la période. Knight écrit, en 1991, que les premiers signes d'une vie artistique, donc de l'existence d'une culture symbolique capable de porter les mythes et rituels qui sont à la base de son hypothèse, datent de seulement 60 000 ans environ. Les premiers vestiges de l'Homme moderne datent d'environ 200 000 ans : quid donc des 140.000 années "manquantes" ? Et que peut-on envisager comme signe précurseur de l'émergence d'une culture symbolique à part entière, par exemple chez nos ancêtres immédiats ?
Il ne s'agit pas là d'une mise en cause de la théorie mais plutôt d'un problème qui appelle d'autres recherches. Depuis les années 1990, les fouilles en Afrique du Sud (Blombos, Klasies River, De Kelders) semblent repousser la date de l'usage de l'abstraction symbolique et de l'art jusqu'à 80 000, voire 140 000 ans av. J.-C 17 ; du côté d'Homo erectus, les vestiges découverts à Dmanisi en Géorgie au début des années 2000 et datés d’environ 1,8 million d'années semblent indiquer déjà l'existence d'un certain niveau de solidarité : un des individus a vécu plusieurs années sans dents sauf une canine, ce qui laisse supposer que les autres l'aidaient à manger. 18 En même temps, le niveau d'outillage reste primitif et, selon les spécialistes, ces individus ne pratiquaient pas encore la chasse au gros gibier. Cela ne devrait pas nous étonner : Darwin avait déjà démontré que des caractéristiques humaines comme l'empathie, l'appréciation du beau, l'amitié existent dans le reste du monde animal, même si c'est à un niveau plus rudimentaire que chez l'Homme.
Notre deuxième objection est plus importante : elle concerne la "force motrice" qui pousse à l'encéphalisation progressive du genre humain. Pour Knight, dont la problématique est plutôt de cerner comment cette encéphalisation a pu avoir lieu, cette question n'est pas centrale et - selon ses dires lors de notre congrès de 2011 - il a plutôt adopté la théorie d'une plus grande complexification sociale (c'est la théorie proposée par Robin Dunbar 19 et reprise par Jean-Louis Dessalles, entre autres, dans son livre Aux origines du langage, dont il a exposé l’argumentation lors de notre congrès de 2009) du fait de la vie en groupes plus importants. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails ici, mais cette théorie nous semble poser certaines difficultés. Après tout, la taille des groupes de primates peut varier d'une dizaine pour les gorilles à quelques centaines pour les babouins hamadryas : il faudrait alors démontrer en quoi les Hominines avaient des besoins sociaux dépassant ceux des babouins, mais aussi (et c'est loin d'être fait) que les Hominines vivaient en groupes de plus en plus importants. 20
Pour notre part, l'hypothèse la plus probable nous semble être celle reliant le processus d'encéphalisation, et du développement du langage articulé, à la place grandissante occupée par la culture (au sens large) dans la capacité des humains de s'adapter à leur environnement. On a souvent tendance à envisager la culture uniquement sous sa forme matérielle (outils en pierre, etc.). Mais lorsqu'on étudie la vie des chasseurs-cueilleurs de notre époque, nous sommes surtout impressionnés par la profondeur de leurs connaissances de la nature qui les entoure : les propriétés des plantes, le comportement des animaux, etc. Or, tout animal chasseur connaît le comportement de sa proie et peut s'y adapter jusqu'à un certain point. La différence chez l'Homme, c'est que cette connaissance est culturelle et non pas instinctive, et doit être transmise de génération en génération. Si le mimétisme permet de transmettre une culture très limitée de l'outil (les chimpanzés qui utilisent une tige pour pêcher dans une fourmilière par exemple), il est évident que la transmission de la connaissance humaine (ou proto-humaine, sans doute) nécessite autre chose que le mimétisme.
On peut suggérer également que, au fur et à mesure que la culture prend la place de la génétique dans la détermination de notre comportement, la transmission de ce qu'on pourrait appeler la culture spirituelle (mythe, rituel, connaissance des lieux sacrés, etc.) prend une plus grande importance dans le maintien de la cohésion du groupe. Ceci nous amène à relier le développement du langage articulé à un autre signe extérieur ancré dans notre biologie : une ménopause "précoce" suivie d'une longue période post-reproductive, encore une caractéristique que les femelles humaines ne partagent avec aucune de leurs cousines primates. Comment donc une ménopause "précoce" a-t-elle pu apparaître et se maintenir au cours de l'évolution, alors qu'elle limite apparemment le potentiel reproducteur des femelles ? L'hypothèse la plus probable est que la femelle ménopausée aide sa propre fille à mieux assurer la survie de ses petits-enfants, donc de son patrimoine génétique. 21
Les problèmes que nous venons d’évoquer concernent la période couverte par Blood Relations. Mais une autre difficulté se présente : il est évident que les sociétés primitives dont nous avons connaissance (et dont parle Darmangeat) sont très différentes de la société hypothétique des premiers Hommes, que cherche à décrire Knight. Pour prendre l’exemple de l’Australie, dont la société aborigène est une des plus primitives que nous connaissons sur le plan technique, la persistance de mythes et de pratiques rituelles qui attribuent une très grande importance à la menstruation va de pair avec une domination totale des hommes sur les femmes. La question se pose évidemment : si l’hypothèse de Knight est juste, même dans ses grandes lignes, comment expliquer ce qu’on pourrait appeler une véritable "contre-révolution" masculine ? Dans le treizième chapitre de son livre (p. 449), Knight propose une hypothèse pour expliquer cette "contre-révolution" : il suggère que c’est la disparition de la mégafaune, des grandes espèces comme le wombat géant, et une période de sécheresse à la fin du Pléistocène, qui auraient perturbé les coutumes de chasse et mis fin à l’abondance qui, selon lui, est la condition matérielle pour la survie du communisme primitif. En 1991, Knight dit lui-même que cette hypothèse reste à être mise à l’épreuve de l’archéologie, et que sa propre investigation se limite à l’Australie. En tout état de cause, il nous semble que ce problème ouvre un large champ d’investigation qui nous permettrait d’envisager une véritable histoire de la plus longue période de l’existence humaine : celle qui va de nos origines jusqu’à l’invention de l’agriculture. 22
L'avenir communiste
Comment l'étude des origines de l'Homme pourrait-elle nous éclairer sur son avenir dans la société communiste ? Darmangeat nous dit que le capitalisme est la première société humaine qui permet de concevoir la fin de la division sexuelle du travail et d'imaginer une égalité des femmes et des hommes - égalité qui est aujourd'hui inscrite dans le droit d'un nombre limité de pays et qui n’est nulle part une égalité de fait : "si le capitalisme n’a en tant que tel ni amélioré, ni aggravé la situation des femmes, il a en revanche été le premier système ayant permis de poser la question de leur égalité avec les hommes ; et tout en étant incapable de réaliser cette égalité, il a néanmoins réuni les éléments qui la rendront effective". 23
Il nous semble que deux critiques peuvent être formulées ici : la première est d’ignorer l’immense importance de l’intégration des femmes dans le monde du travail salarié. Bien malgré lui, le capitalisme a ainsi donné aux ouvrières, pour la première fois dans les sociétés de classes, une réelle indépendance matérielle par rapport aux hommes et, ainsi, la possibilité de lutter à part entière pour la libération du prolétariat et donc de toute l’humanité.
La deuxième critique concerne la notion même d’égalité. 24 Cette notion est empreinte de l'idéologie démocratique héritée du capitalisme, et ce n'est pas le but d'une société communiste qui, au contraire, reconnaîtra les différences entre individus, se donnant comme devise "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins" pour reprendre les termes de Marx. 25 Or, en dehors du domaine de la science-fiction 26, les femmes ont à la fois une capacité et un besoin que les hommes n'auront jamais : celui d'enfanter. Cette capacité doit être exercée, sinon la société humaine n'a plus d'avenir, mais c'est aussi une fonction physique et donc un besoin pour les femmes. 27 Une société communiste doit donc offrir à toute femme qui le désire la possibilité d'enfanter avec joie, et dans la confiance que son enfant sera accueilli au sein de la communauté humaine.
Ici on peut se permettre un parallèle avec la vision évolutionniste proposée par Knight. Les proto-femmes ont déclenché le processus d'évolution du genre humain vers la culture symbolique, parce qu'elles ne pouvaient plus élever leurs enfants seules : elles devaient obliger les mâles à fournir une aide matérielle à l'enfantement et à l'éducation des jeunes. Ce faisant, elles ont introduit dans la société humaine la notion de solidarité entre femmes occupées par les enfants, entre hommes occupés par la chasse, et entre hommes et femmes partageant les responsabilités conjointes de la société.
Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le capitalisme nous réduit de plus en plus à l'état d'individus atomisés, et les femmes qui enfantent subissent cette situation de plein fouet. Non seulement la règle dans l'idéologie capitaliste veut que la famille soit réduite à sa plus simple expression (père, mère, enfants) mais, en plus, la désagrégation exacerbée de toute vie sociale fait que, de plus en plus souvent, les femmes se trouvent seules à élever leurs enfants même en très bas âge, et la nécessité de trouver du travail les éloigne de leurs propres mères, tantes ou sœurs qui constituaient autrefois le réseau de soutien naturel de toute femme qui venait d'enfanter. Et le "monde du travail" est impitoyable pour les femmes qui enfantent, obligées soit de sevrer leurs enfants après quelques mois au mieux (selon les congés maternité en vigueur dans les différents pays, quand ils existent) et de les laisser aux nourrices, soit - si elles sont au chômage - de se retrouver privées de vie sociale et contraintes d'élever leurs bébés seules et avec des ressources limitées à l'extrême.
En quelque sorte, les femmes prolétaires se retrouvent dans une situation analogue à leurs lointains ancêtres - et seule une révolution pourra améliorer leur situation. Tout comme la "révolution" supposée par Knight a permis aux femmes de s'entourer du soutien social, d'abord des autres femmes, puis des hommes, pour l'enfantement et l'éducation des enfants, la révolution communiste à venir devra mettre au cœur de ses préoccupations le soutien à l'enfantement et l'éducation collective des enfants. Seule une société qui donne une place privilégiée à ses enfants et à sa jeunesse peut prétendre être porteuse d'avenir : à ce titre, le capitalisme se condamne lui-même par le fait qu'une proportion grandissante de sa jeunesse est "en sureffectif" par rapport aux besoins de la production capitaliste.
Jens
1 Éditions Smolny, Toulouse 2009 et 2012. Sauf indication contraire, les citations et les références aux numéros de page sont celles de la première édition
2 Darmangeat mène d’ailleurs une réflexion intéressante à propos de l’importance accrue de la force physique dans la détermination des rôles sexuels à partir de l’invention de l’agriculture (lors du labour exemple).
3 Darmangeat souligne, sans doute à juste titre, que l’implication dans la production sociale est une condition nécessaire mais insuffisante pour assurer une situation favorable de la femme dans la société.
4 Dans la section "La famille monogamique" [346].
5 Cette étude comparative couvre les civilisations de l’Égypte entre 2700 et 1780 av. J-C, de la Mésopotamie entre 2500 et 1600 av. J-C, de la Chine du nord pendant les périodes des Shang et des Zhou occidentaux (entre 1200 et 950 av. J-C), de la Vallée du Mexique pendant les 15e et 16e siècles de notre ère, de la période classique des Mayas, du royaume des Incas au 16e siècle, et des peuples Yoruba et Béninois à partir du 18e siècle.
6 Le livre de Chris Knight, Blood Relations [387], consacre un sous-chapitre à la "menstruation symbolique des hommes" (cf. p. 428).
7 "L’esprit humain a ses exigences, dont celle de la cohérence" (p. 319). Nous ne traiterons pas ici de la question de savoir d’où viennent ces "exigences", et pourquoi elles prennent des formes précises, questions que Darmangeat laisse sans réponse.
8Donner une explication de fond du structuralisme de Lévi-Strauss nous éloignerait trop de notre sujet. Pour un résumé élogieux mais critique de la pensée de Lévi-Strauss, on peut se reporter au chapitre "Lévi-Strauss and ‘The Mind’" dans le livre de Knight.
9 Darmangeat, 2e édition, pp. 214-215.
10 p. 318.
11 Darmangeat met cependant en lumière certaines sociétés indiennes en Amérique du Nord où, dans des circonstances particulières, les femmes "savaient tout faire ; elles maîtrisaient toute la gamme des activités féminines comme des activités masculines" (p. 314).
12 Voir "À propos du livre L'effet Darwin : une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation" [52], Révolution internationale n° 400 et "La solidarité humaine et le gène égoïste (article de l'anthropologue Chris Knight)" [350], Révolution internationale n° 434.
13 Cf. l'article "The great leaps forward [388]" d’Anthony Stigliani.
14 C’est un thème qui revient tout au long du livre de Darmangeat. Voir entre autres l’exemple des Huli de Nouvelle-Guinée (p. 222, 2e édition).
15 Et mieux encore, d’avoir su rendre cette théorie lisible et accessible à une audience non experte.
16 À ce propos, lorsque Darmangeat nous dit que la thèse de Knight "ne souffle mot sur les raisons pour lesquelles les femmes, elles, sont écartées de manière absolue et permanente de la chasse et des armes", on ne peut que se demander s'il n’a pas abandonné sa lecture avant d’arriver à la fin du livre.
18 Voir l’article publié dans La Recherche n° 419 : "Étonnants primitifs de Dmanisi".
19 Voir par exemple The Human Story. Robin Dunbar explique l’évolution du langage par l’augmentation de la taille des groupes humains ; le langage articulé serait apparu comme substitut moins coûteux en temps et en énergie que le toilettage grâce auquel nos cousins primates entretiennent leurs amitiés et alliances. Le "nombre de Dunbar" est entré dans la théorie paléoanthropologique en tant que plus grand nombre de connaissances proches avec lesquelles il est possible de garder un contact social stable, et que le cerveau humain est capable de retenir (environ 150) ; Dunbar considère que ceci aurait été la taille maximale des premiers groupes humains.
20Les Hominines (la branche de l'arbre évolutif à laquelle appartiennent les humains) ont divergé d'avec les Panines (la branche à laquelle appartiennent les chimpanzés et les bonobos) il y a environ 6 à 9 millions d'années.
21 Pour un résumé de l’hypothèse de la grand-mère, voir l'article du même nom sur Wikipedia [390].
22 Un travail en ce sens a déjà été réalisé, pour un pays aux antipodes de l’Australie, par l’anthropologue Lionel Sims, dans un article publié dans le Cambridge Archaeological Journal 16:2, intitulé "The ‘Solarization’ of the moon: manipulated knowledge at Stonehenge [391]".
23 Darmangeat, op.cit., p. 426.
24 Il ne s’agit pas ici de faire un procès d’intention. Darmangeat parle d’une "égalité authentique" : encore faudrait-il savoir ce que cette notion recouvre, ce qui bien évidemment sort très largement de la matière de son livre.
25 Ce n’est pas pour rien que Marx écrivait, dans sa Critique du programme de Gotha : "Par sa nature le droit ne peut consister que dans l’emploi d’une mesure égale pour tous ; mais les individus inégaux (et ils ne seraient pas distincts, s’ils n’étaient pas inégaux) ne peuvent être mesurés à une mesure égale qu’autant qu’on les considère d’un même point de vue, qu’on ne les regarde que sous un aspect unique et déterminé ; par exemple, dans notre cas, uniquement comme des travailleurs en faisant abstraction de tout le reste" (Karl Marx, Œuvres Économie I, La Pléiade, p. 1420).
26 Iain M. Banks, un des très rares auteurs de science-fiction qui fait preuve d’une réelle originalité aujourd'hui, imagine une civilisation galactique organisée de façon essentiellement communiste ("La Culture"), où les humains contrôlent leurs glandes hormonales au point de pouvoir changer de sexe volontairement, et où tous peuvent donc enfanter.
27 Ceci ne veut pas dire, évidemment, que toutes les femmes souhaiteront – et encore moins devront – enfanter.
Rubrique:
Bilan, la Gauche hollandaise et la transition au communisme (le communisme, l'entrée de l'humanité dans sa véritable histoire, X)
- 2145 lectures
Après un certain temps, beaucoup plus long que prévu à l’origine, nous reprenons le troisième volume de la série sur le communisme. Rappelons brièvement que le premier volume, qui a été publié en français sous forme de brochure-résumé et en anglais sous forme de livre, commence par analyser le développement du concept de communisme depuis les sociétés précapitalistes jusqu’aux socialistes utopiques, et est ensuite dédié au travail de Marx et Engels, et de leurs successeurs dans la Deuxième Internationale, pour comprendre que le communisme n’est pas un idéal abstrait, mais une nécessité matérielle rendue possible par l’évolution de la société capitaliste elle-même. 1 Le deuxième volume examine la période dans laquelle la prévision marxiste de la révolution prolétarienne, formulée pour la première fois dans la période du capitalisme ascendant, s’est concrétisée à l’aube de "l’époque des guerres et des révolutions" reconnue par l’Internationale Communiste en 1919. 2 Le troisième volume s’est jusqu'ici concentré sur la tentative soutenue de la Gauche communiste d’Italie pendant les années 1930 de tirer les leçons de la défaite de la première vague internationale de révolutions, et surtout de la révolution russe, et d'examiner les implications de ces leçons pour une future période de transition au communisme. 3
Comme nous l’avons souvent rappelé, la Gauche communiste était d’abord et avant tout le produit d’une réaction internationale contre la dégénérescence de l’Internationale communiste et de ses partis. Les groupes de gauche en Italie, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Grande-Bretagne et ailleurs convergeaient sur les mêmes critiques de la régression de l’IC vers le parlementarisme, le syndicalisme, et vers des compromis avec les partis de la social-démocratie. Il y avait des débats intenses au sein des différents courants de gauche et quelques tentatives concrètes de coordination et de regroupement, telles que la formation de l’Internationale communiste ouvrière en 1922, essentiellement avec des groupes proches de la Gauche communiste germano-hollandaise. En même temps, cependant, l’échec rapide de cette nouvelle formation démontrait que la marée de la révolution refluait et que les temps n’étaient pas mûrs pour la fondation d’un nouveau parti mondial. De plus, cette initiative précipitée, prise par des éléments au sein du mouvement allemand, mettait en évidence ce qui était peut-être la plus grave division dans les rangs de la Gauche communiste, la séparation entre ses deux expressions les plus importantes, celle en Italie et celle en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette division n’a jamais été absolue : dans les premiers temps du Parti communiste d’Italie, il y avait eu des tentatives de comprendre et de débattre avec les autres courants de gauche ; et nous avons ailleurs attiré l’attention sur le débat entre Bordiga et Korsch au milieu des années 1920. 4 Ces contacts se sont cependant raréfiés avec le reflux de la révolution et parce que les deux courants ont réagi de façon différente face au nouveau défi qui se présentait à eux. La gauche italienne était, de façon toute à fait juste, convaincue de la nécessité de rester dans l’IC tant qu’existait en son sein une vie prolétarienne et d’éviter des scissions prématurées ou la proclamation de nouveaux partis artificiels – ce qui était précisément la voie suivie par la majorité de la gauche germano-hollandaise. De plus, l’émergence de tendances ouvertement anti-parti dans la gauche germano-hollandaise, en particulier le groupe autour de Rühle, ne pouvait que renforcer la conviction de Bordiga et d'autres que ce courant était dominé par des conceptions et des pratiques anarchisantes. En même temps, les groupes de la gauche germano-hollandaise, ayant tendance à définir toute l’expérience du bolchevisme et d’Octobre 1917 comme des expressions d’une révolution bourgeoise tardive, étaient de moins en moins capables de distinguer la gauche italienne du courant majoritaire de l’IC, principalement parce que la gauche italienne continuait à défendre que la place des communistes était à l’intérieur de l’Internationale et d'y combattre son cours opportuniste.
Aujourd’hui, les groupes bordiguistes ont théorisé cette séparation tragique et qui a coûté cher, quand ils insistent e sur le fait qu'eux seuls constitueraient la Gauche communiste et que le KAPD et ses descendants ne seraient rien de plus qu’une déviation anarchiste petite-bourgeoise. Le Parti communiste international (Il programma comunista) est allé jusqu’à publier une défense de La maladie infantile du communisme (le "gauchisme") de Lénine, en en faisant l’éloge comme avertissement contre des "futurs renégats". 5 Cette attitude révèle un manque de reconnaissance plutôt tragique du fait que les communistes de gauche auraient dû combattre ensemble, en tant que camarades, contre la trahison grandissante de l’IC.
C’était cependant loin d’être l’attitude de la gauche italienne pendant sa période la plus fructueuse sur le plan théorique : celle qui a suivi la formation, en exil hors de l’Italie fasciste, de la Fraction de Gauche à la fin des années 1920 et pendant laquelle elle a publié la revue Bilan entre 1933 et 1938. Dans un "Projet de résolution sur les liens internationaux" dans Bilan n° 22, elle écrit que "les communistes internationalistes de Hollande (la tendance Gorter) et les éléments du KAPD représentent la première réaction aux difficultés de l’État russe, la première expérience de gestion prolétarienne, en se reliant au prolétariat mondial au travers d’un système de principes élaborés par l’Internationale". Elle en conclut que l’exclusion de ces camarades de l’Internationale "n’a apporté aucune solution à ces problèmes".
Cette démarche posait les fondements élémentaires de la solidarité prolétarienne sur la base desquels le débat pouvait avoir lieu, malgré les divergences considérables entre les deux courants ; divergences qui se sont énormément amplifiées au milieu des années 1930, quand la gauche germano-hollandaise a évolué vers les positions du communisme de conseils, définissant non seulement le bolchevisme, mais la forme parti elle-même, comme étant de nature bourgeoise. Il y avait d’autres difficultés liées à la langue et au manque de connaissance de part et d’autre des positions respectives, le résultat étant, comme nous le notons dans notre livre La Gauche communiste d’Italie, que les rapports entre les deux courants étaient en grande partie indirects.
Le principal point de connexion entre les deux courants était la Ligue des Communistes Internationalistes (LCI) en Belgique, qui était en contact avec le Groep van Internationale Communisten (GIC) et d’autres groupes en Hollande. Il est peut être significatif que le principal résultat de ces contacts à apparaître dans les pages de Bilan ait été le résumé, écrit par Hennaut de la LCI, du livre du GIC Grundprinzipien Kommunistischer Produktion und Verteilung (Principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes) 6 et les remarques fraternelles mais critiques sur le livre que contenait la série "Problèmes de la période de transition" de Mitchell. À notre connaissance, le GIC n’a répondu à aucun de ces articles, mais il est toujours important de nous rappeler que les prémisses pour un débat existaient à l’époque où les Grundprinzipien ont été publiés, d'autant plus qu’il n’y a eu que quelques très rares tentatives ultérieures de poursuivre la discussion. 7 Disons clairement que cet article ne tentera pas de faire une analyse en profondeur et détaillée des Grundprinzipien. Son but, plus modeste, est d’étudier les critiques du résumé publié dans Bilan et de souligner quelques questions pour une future discussion.
Le GIC examine les leçons de la défaite
À la Conférence de Paris de groupes de la Gauche communiste récemment formés, en 1974, Jan Appel, le vétéran du KAPD et du GIC qui avait été un des principaux auteurs des Grundprinzipien, expliquait que ce texte avait été écrit comme une contribution à l’effort de compréhension de ce qui avait mal tourné dans l’expérience du capitalisme d’État ou "communisme d’État comme nous disions quelques fois" dans la révolution russe, en vue de dégager quelques lignes de conduite qui permettraient d’éviter de telles erreurs à l’avenir. Malgré leurs divergences sur la nature de la révolution russe, c’était précisément ce qui motivait précisément les camarades de la gauche italienne quand ils ont entrepris une étude des problèmes de la période de transition, en dépit du fait qu’ils ne comprenaient que trop bien qu’ils étaient en train de traverser une profonde la contre-révolution.
Pour Mitchell, comme pour le reste de la gauche italienne, le GIC, c’étaient les "internationalistes hollandais", des camarades qui étaient animés par un engagement profond pour le renversement du capitalisme et son remplacement par une société communiste. Les deux courants comprenaient qu’une étude sérieuse des problèmes de la période de transition allait beaucoup plus loin qu’un exercice intellectuel en soi. C’étaient des militants pour qui la révolution prolétarienne était une réalité qu’ils avaient vue de leurs propres yeux ; malgré sa terrible défaite, ils restaient pleinement confiants dans le fait qu’elle surgirait de nouveau, et étaient convaincus qu’elle devait être armée d’un programme communiste clair pour triompher la prochaine fois.
Au début de son résumé des Grundprinzipien, Hennaut pose précisément cette question : "Ne paraît-il pas vain, en effet, de se torturer les méninges à propos des règles sociales que les travailleurs auront à faire respecter, une fois la révolution accomplie, alors que les travailleurs ne marchent nullement à la lutte finale mais cèdent pas à pas le terrain conquis devant la réaction triomphante ? D’autre part, tout n’a-t-il pas été dit à ce sujet par les Congrès de l’I.C. ? … Bien sûr, à ceux pour qui toute la science de la révolution consiste à discerner toute la gamme des manœuvres à faire accomplir par les masses, l’entreprise doit apparaître particulièrement oiseuse. Mais à ceux qui considèrent que la précision des buts de la lutte est une des fonctions essentielles de tout mouvement d’émancipation et que les formes de cette lutte, son mécanisme et les lois qui la régissent, ne peuvent être mis complètement à jour que dans la mesure où se précisent les buts finaux à atteindre, en d’autres termes que les lois de la révolution se dégagent de plus en plus nettement selon que la conscience des travailleurs grandit - pour ceux-là l’effort théorique pour définir exactement ce que sera la dictature du prolétariat apparaît comme une tâche d’une primordiale nécessité." (Bilan n° 19, "Les fondements de la production et de la distribution communistes")
Comme nous l’avons mentionné, Hennaut n’était pas membre du GIC mais de la LCI belge. En un sens, il était bien placé pour agir comme un "intermédiaire" entre la gauche italienne et la gauche hollandaise puisqu’il avait des accords et des divergences avec les deux. Dans une contribution précédente dans Bilan 8, il critiquait la notion de "dictature du parti" des camarades italiens et mettait l’accent sur le fait que c’est la classe ouvrière qui exerce le contrôle sur les sphères politiques et économiques avec ses propres organes généraux tels que les conseils. En même temps, il rejetait la vision qu'avait Bilan de l’URSS comme État prolétarien dégénéré et définissait comme capitalistes tout autant le régime politique que l’économie en Russie. Mais on doit ajouter qu’il s’était aussi engagé dans un processus de rejet du caractère prolétarien de la révolution russe, mettant en exergue que les conditions objectives n’étaient pas mûres, si bien que "la révolution a été faite par les ouvriers mais ce n’était pas une révolution prolétarienne". 9 Cette analyse était très proche de celle des communistes de conseils, mais Hennaut se démarquait de ces derniers sur nombre de points cruciaux : au tout début de son résumé, il dit clairement qu’il n’est pas d’accord avec leur rejet du parti. Pour Hennaut, le parti allait être encore plus nécessaire après la révolution pour combattre les vestiges idéologiques du vieux monde, bien qu’il n’ait pas ressenti que la faiblesse du GIC sur ce point était la principale question posée par les Grundprinzipien ; à la fin de son résumé, dans Bilan n° 22, il souligne la faiblesse de la conception de l’État du GIC et de sa vision quelque peu colorée en rose des conditions dans lesquelles a lieu une révolution. Cependant, il est convaincu de l’importance de la contribution du GIC et fait un effort très sérieux pour la résumer de façon précise en quatre articles (publiés dans les 5 numéros de Bilan cités précédemment). Évidemment, il ne lui était pas possible, dans le cadre de ce résumé, de faire ressortir toute la richesse – et certaines des contradictions apparentes - des Grundprinzipien, mais il a fait un excellent travail pour mettre en évidence les points essentiels du livre.
Le résumé de Hennaut met en lumière le fait significatif que les Grundprinzipien ne se situent pas du tout en dehors des traditions et des expériences de la classe ouvrière, mais se basent sur une critique historique de conceptions erronées qui avaient surgi au sein du mouvement ouvrier, et sur les expériences révolutionnaires concrètes – en particulier les révolutions russe et hongroise – dont les leçons étaient surtout négatives. Les Grundprinzipien contiennent donc des critiques des visions de Kautsky, Varga, de l’anarcho-syndicaliste Leichter et d’autres, tout en cherchant à se rattacher aux travaux de Marx et Engels, en particulier La critique du programme de Gotha et l’Anti-Dühring. Le point de départ en est la simple insistance sur le fait que l’exploitation des ouvriers dans la société capitaliste est entièrement liée à leur séparation des moyens de production via les rapports sociaux capitalistes du travail salarié. Depuis la période de la Deuxième Internationale, le mouvement ouvrier avait dérivé vers l’idée que la simple abolition de la propriété privée signifiait la fin de l’exploitation, et les bolcheviks ont, dans une large mesure, mis en application cette vision après la révolution d’Octobre.
Pour les Grundprinzipien, la nationalisation ou la collectivisation des moyens de production peuvent parfaitement coexister avec le travail salarié et l’aliénation des ouvriers par rapport à ce qu’ils produisent. Ce qui est la clef, cependant, c’est que les travailleurs eux-mêmes, à travers leurs organisations enracinées sur les lieux de travail, disposent non seulement des moyens matériels de production mais de tout le produit social. Pour être sûrs, cependant, que le produit social reste aux mains des producteurs, du début à la fin du processus du travail (décisions sur quoi produire, en quelles quantités, distribution du produit y compris la rémunération du producteur individuel), il faut une loi économique générale qui puisse être sujette à des décomptes rigoureux : le calcul du produit social sur la base de la "valeur" du temps de travail moyen socialement nécessaire. Bien que ce soit précisément le temps de travail socialement nécessaire qui est à la base de la "valeur" des produits dans la société capitaliste, ce ne serait plus une production de valeur parce que, bien que la contribution des entreprises individuelles soit considérable dans la détermination du temps de travail contenu dans leurs produits, celles-ci ne vendront plus leurs produits sur le marché (et les Grundprinzipien critiquent les anarcho-syndicalistes justement parce qu’ils envisagent la future économie comme un réseau d’entreprises indépendantes liées par des rapports d’échange). Dans la vision du GIC, les produits seraient simplement distribués selon les besoins généraux de la société, lesquels seraient déterminés par un congrès de conseils associé à un bureau central des statistiques et un réseau de coopératives de consommateurs. Les Grundprinzipien prennent soin d’insister sur le fait que ni le congrès des conseils ni le bureau des statistiques ne sont "centralisés" ou des organes "d’État". Leur tâche n’est pas de contrôler le travail mais d’utiliser le critère du temps de travail socialement nécessaire, calculé en prenant en compte essentiellement les usines ou les lieux de travail, afin de superviser le planning et la distribution du produit social à l’échelle globale. Une application cohérente de ces principes assurerait qu’une situation dans laquelle "la machine vous échappe des mains" (les fameuses paroles de Lénine sur la trajectoire de l’État soviétique, citées par les Grundprinzipien), ne se répéterait pas dans la nouvelle révolution. En somme, la clef de la victoire de la révolution réside dans la capacité des ouvriers de maintenir un contrôle direct de l’économie, et le moyen le plus sûr pour y parvenir est la régulation de la production et de la distribution en se basant sur le temps de travail.
Les critiques de la gauche italienne
La gauche italienne 10 comme nous l’avons dit, a salué la contribution du GIC mais ne lui a pas épargné ses critiques du texte. En général, ces critiques peuvent être réparties en quatre rubriques, bien qu’elles mènent toutes à d’autres questions et soient toutes étroitement liées entre elles :
-
une vision nationale de la révolution ;
-
une vision idéaliste des conditions réelles de la révolution prolétarienne ;
-
un manque de compréhension du problème de l’État et une focalisation sur l’économie au détriment des questions politiques ;
-
certaines divergences théoriques concernant l’économie de la période de transition : le dépassement de la loi de la valeur et le contenu du communisme ; l’égalitarisme et la rémunération du travail.
1. Une vision nationale de la révolution
Dans sa série "Parti-État-Internationale" 11, Vercesi avait déjà critiqué Hennaut et les camarades hollandais pour leur approche du problème de la révolution en Russie d’un point de vue étroitement national. Il insistait sur le fait qu’aucune avancée réelle ne pouvait se faire tant que la bourgeoisie détiendrait le pouvoir à l’échelle mondiale – quelles que soient les avancées réalisées dans une zone sous "gestion" prolétarienne, elles ne pouvaient être définitives :
"L’erreur que commettent à notre avis les communistes de gauche hollandais, et avec eux le camarade Hennaut, c’est de se mettre en une direction foncièrement stérile, car le fondement du marxisme consiste justement à reconnaître que les bases d’une économie communiste ne peuvent se présenter que sur le terrain mondial, et jamais elles ne peuvent être réalisées à l’intérieur des frontières d’un État prolétarien. Ce dernier pourra intervenir dans le domaine économique pour changer le processus de la production, mais nullement pour asseoir définitivement ce processus sur des bases communistes, car à ce sujet les conditions pour rendre possible une telle économie ne peuvent être réalisées que sur la base internationale. C’est enfreindre la théorie marxiste dans son essence même que de croire possible de réaliser les tâches économiques du prolétariat à l’intérieur d’un seul pays. Nous ne nous acheminerons pas vers la réalisation de ce but suprême en faisant croire aux travailleurs qu’après la victoire sur la bourgeoisie, ils pourront directement diriger et gérer l’économie dans un seul pays." (Bilan n° 21, dans la série, Parti – Internationale – État, 3e partie : l'État soviétique).
Dans sa série, Mitchell revient sur ce thème :
"S’il est indéniable qu’un prolétariat national ne peut aborder certaines tâches économiques qu’après avoir instauré sa propre domination, à plus forte raison, la construction du socialisme ne peut s’amorcer qu’après la destruction des États capitalistes les plus puissants, bien que la victoire d’un prolétariat "pauvre" puisse acquérir une immense portée, pourvu qu’elle soit intégrée dans la ligne de développement de la révolution mondiale. En d’autres termes, les tâches d’un prolétariat victorieux, par rapport à sa propre économie, sont subordonnées aux nécessités de la lutte internationale des classes.
Il est caractéristique de constater que, bien que tous les véritables marxistes aient rejeté la thèse du "socialisme en un seul pays", la plupart des critiques de la Révolution russe se sont surtout exercées sur les modalités de construction du socialisme, en partant de critères économiques et culturels plutôt que politiques, et en omettant de tirer à fond les conclusions logiques qui découlent de l’impossibilité du socialisme national." (Bilan n° 37, "Quelques données pour une gestion prolétarienne", republié dans la Revue internationale n° 132, article "Les problèmes de la période de transition [178]").
Mitchell a aussi dédié une grande partie de la série d’articles à argumenter contre l’idée des Mencheviks, reprise en grande partie par les communistes de conseils, selon laquelle la révolution russe ne pouvait avoir été purement prolétarienne parce que la Russie n’était pas mûre pour le socialisme. Contre cette approche, Mitchell affirme que les conditions de la révolution communiste ne peuvent être posées qu’à l’échelle mondiale et que la révolution en Russie n’a simplement été que le premier pas d'une révolution au niveau mondial, rendue nécessaire par le fait que le capitalisme en tant que système mondial était entré dans sa période de déclin. Toute compréhension de ce qui avait mal tourné en Russie devait donc se situer dans le contexte de la révolution mondiale : la dégénérescence de l’État soviétique fut d’abord et avant tout non pas une conséquence des mesures économiques prises par les bolcheviks mais de l’isolement de la révolution. De son point de vue, les camarades hollandais ont été "conduits à fausser leur jugement sur la révolution russe et surtout à restreindre singulièrement le champ de leurs recherches quant aux causes profondes de l'évolution réactionnaire de l'U.R.S.S. L'explication de celle-ci ils ne vont pas la chercher dans le tréfonds de la lutte nationale et internationale des classes (c'est une des caractéristiques négatives de leur étude, qu'elle fait quasi abstraction des problèmes politiques), mais dans le mécanisme économique" (Bilan n° 35, republié dans la Revue internationale n° 131, article "Les problèmes de la période de transition [392]").
En bref, il existe des limites à ce que nous pouvons déduire des mesures économiques prises pendant la révolution russe. Même les mesures les plus parfaites, en l’absence d’extension de la révolution mondiale, n’auraient pas préservé le caractère prolétarien du régime en URSS, et cela s’applique à n’importe quel pays, avancé ou arriéré, qui se retrouverait isolé dans un monde dominé par le capitalisme.
2. Les conditions réelles après la révolution prolétarienne
Nous avons remarqué que Hennaut lui-même mettait en évidence la tendance des camarades hollandais à simplifier les conditions qui prévalent à la suite d’une révolution prolétarienne : "il pourrait apparaître à maints lecteurs qu’en réalité tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La révolution est en marche, elle ne pourrait pas ne pas venir et il suffit de laisser aller les choses à elles-mêmes pour que le socialisme devienne réalité. ( "Les internationalistes hollandais sur le programme de la révolution prolétarienne", Bilan n° 22). Vercesi avait aussi défendu que ces camarades tendaient à sous-estimer grandement l’hétérogénéité de la conscience de classe même après la révolution – une erreur directement liée à l’incapacité des communistes de conseils de comprendre la nécessité d’une organisation politique des éléments les plus avancés de la classe ouvrière. De plus, cela était aussi lié à la sous-estimation, par les camarades hollandais, des difficultés qu'allaient rencontrer les ouvriers pour prendre en charge directement l’organisation de la production. Pour sa part, Mitchell défend que les camarades hollandais partent d’un schéma idéal, abstrait, qui exclut déjà les stigmates du passé capitaliste, comme base pour avancer vers le communisme :
"Nous avons déjà laissé entendre que les internationalistes hollandais dans leur essai d'analyse des problèmes de la période de transition, s'étaient beaucoup plus inspirés de leurs désirs que de la réalité historique. Leur schéma abstrait, d'où ils excluent, en gens parfaitement conséquents avec leurs principes, la loi de la valeur, le marché, la monnaie devait, tout aussi logiquement, préconiser une répartition "idéale" des produits. Pour eux puisque "la révolution prolétarienne collectivise les moyens de production et par là ouvre la voie à la vie communiste, les lois dynamiques de la consommation individuelle doivent absolument et nécessairement se conjuguer parce qu'elles sont indissolublement liées aux lois de la production, cette liaison s'opérant de 'soi-même' par le passage à la production communiste. (Page 72 de leur ouvrage déjà cité, Essai sur le développement de la société communiste". (Bilan n° 35, cité dans la Revue internationale n° 131).
Plus tard, Mitchell se concentre sur les obstacles que rencontre l’institution d’une rémunération égale du travail pendant la période de transition (nous y reviendrons dans un second article). En somme, les camarades hollandais mélangent complètement les stades du communisme :
"D'autre part, répudiant l'analyse dialectique en sautant l'obstacle du centralisme, ils en sont arrivés à se payer réellement de mots en considérant non la période transitoire, la seule intéressant les marxistes du point de vue des solutions pratiques, mais la phase évoluée du communisme. Il est dès lors facile de parler d'une "comptabilité sociale générale en tant que centrale économique où affluent tous les courants de la vie économique, mais qui n'a pas la direction de l'administration ni le droit de disposition sur la production et la répartition qui n'a que la disposition d'elle-même" (!) (P 100/101.) Et ils ajouteront que "dans l’association des producteurs libres et égaux, le contrôle de la vie économique n'émane pas de personnes ou d'instances mais résulte de l'enregistrement public du cours réel de la vie économique. Cela signifie : la production est contrôlée par la reproduction" (P. 135) ; autrement dit : "la vie économique se contrôle par elle-même au moyen du temps de production social moyen." (!)
Avec de telles formulations, les solutions relatives à la gestion prolétarienne ne peuvent évidemment avancer d'un pas, car la question brûlante qui se pose au prolétariat n'est pas de chercher à deviner le mécanisme de la société communiste, mais la voie qui y conduit." (Bilan n° 37, republié dans la Revue internationale n° 132)
Il est vrai que dans un certain nombre de passages des Grundprinzipien les camarades hollandais parlent de la distinction faite par Marx entre les premières étapes et celles plus avancées de la période de transition, et qu’ils reconnaissent qu’il y existe un processus, un mouvement vers le communisme intégral dans lequel la nécessité du décompte du temps de travail, par exemple, perdra de l'importance en ce qui concerne la consommation individuelle :
"Une caractéristique essentielle des entreprises de T.S.G. (entreprises de Travail Social Général) est le fait qu’elles permettent à chacun de "prendre selon ses besoins". L’heure de travail n’est donc plus ici la mesure de la répartition. Le développement de la société communiste entraînera un accroissement de ce type d’entreprise, si bien que l’alimentation, les transports, l’habitat, et en bref la satisfaction des besoins généraux deviendront eux aussi "gratuits". Cette évolution est un processus qui, en ce qui concerne le côté technique de l’opération, peut s’effectuer rapidement. Le travail individuel sera d’autant moins la mesure de la consommation individuelle que la société évoluera dans une telle direction, qu’il y aura de plus en plus de produits distribués selon ce principe. Bien que le temps de travail individuel soit la mesure de la répartition individuelle, le développement de la société entraînera la suppression progressive de cette mesure." (Grundprinzipien ; Chapitre 6 : La socialisation de la répartition) 12
En même temps encore, comme Mitchell le remarque plus haut, ils parlent de "producteurs libres et égaux" qui décident de ceci ou de cela précisément dans le stade le plus bas, un moment dans lequel le prolétariat organisé combat pour la véritable liberté et l’égalité, mais ne les a pas encore conquises définitivement. Le terme "producteurs libres " ne peut réellement s’appliquer qu’à une société où il n’y a plus de classe ouvrière.
Un exemple de cette tendance à simplifier est la façon dont ils traitent de la question agraire. Selon cette partie des Grundprinzipien, la "question paysanne", qui a pesé d’un si grand poids dans la révolution russe, ne poserait pas de grands problèmes à la révolution dans le futur parce que le développement de l’industrie capitaliste a déjà intégré la majorité de la paysannerie dans le prolétariat. C’est un exemple d’une certaine vision eurocentrique (et même en Europe, c’était loin d’être le cas en 1930), qui ne prend pas en compte le grand nombre des masses à la fois non-exploiteuses et non-prolétariennes qui existent à l’échelle mondiale et que la révolution prolétarienne aura à intégrer à la production vraiment socialisée.
3. L’État et l’économisme.
Parler de l’existence de classes autres que le prolétariat dans la période de transition pose immédiatement la question d’un semi-État qui, entre autres choses, a la tâche de représenter politiquement ces masses. L’esquive du problème de l’État est donc une autre conséquence du schéma abstrait des camarades hollandais. Comme nous l’avons déjà noté, Hennaut voit que "l’État occupe, dans le système des camarades hollandais, une place disons pour le moins équivoque" (Bilan n° 22). Mitchell pointe le fait que tant que les classes existent, la classe ouvrière aura à faire avec le fléau d’un État, et que cela est lié au problème du centralisme :
"L'analyse des internationalistes hollandais s'éloigne incontestablement du marxisme parce qu'elle ne met jamais en évidence cette vérité, pourtant fondamentale, que le prolétariat est encore obligé de supporter le "fléau" de l'État jusqu'à la disparition des classes, c'est-à-dire jusqu’à l'abolition du capitalisme mondial. Mais souligner une telle nécessité historique, c'est admettre que les fonctions étatiques se confondent encore temporairement avec la centralisation, bien que celle-ci, sur la base de la destruction de la machine oppressive du capitalisme, ne s'oppose plus nécessairement au développement de la culture et de la capacité de gestion des masses ouvrières. Au lieu de rechercher la solution de ce développement dans les limites des données historiques et politiques, les internationalistes hollandais ont cru la trouver dans une formule d'appropriation à la fois utopique et rétrograde qui, de plus, n'est pas aussi nettement opposée au "droit bourgeois" qu'ils pourraient se l'imaginer." (Bilan n° 37, republié dans la Revue internationale n° 132).
À la lumière de l’expérience russe, les camarades hollandais avaient certainement raison d’être vigilants sur le fait que tout corps organisé pourrait exercer un pouvoir dictatorial sur la classe ouvrière. En même temps, les Grundprinzipien ne rejettent pas la nécessité d’une certaine forme de coordination centrale. Ils parlent d’un bureau central des statistiques et d’un "congrès économique des conseils ouvriers", mais ceux-ci sont présentés comme des organes économiques avec de simples tâches de coordination : ils semblent n’avoir aucune fonction politique ou étatique. En décrétant simplement à l’avance que de tels organes centraux ou de coordination n’assumeront des fonctions étatiques, et n'auront pas de lien avec elles, ils affaiblissent réellement la capacité de la classe à se défendre d’un danger réel qui existera tout au long de la période de transition : le danger que l’État, même un semi-État dirigé de façon rigoureuse par les organes unitaires des ouvriers, développe de façon croissante un pouvoir autonome vis-à-vis de la société et réimpose des formes directes d’exploitation économique.
La notion d’État postrévolutionnaire apparaît brièvement dans le livre (en fait au tout dernier chapitre). Mais selon les termes du GIC, il "existe simplement en tant qu’appareil de pouvoir pur et simple de la dictature du prolétariat. Sa tâche est de briser la résistance de la bourgeoisie … mais en ce qui concerne l’administration de l’économie, il n’a aucun rôle que ce soit à remplir". (Grundprinzipien, chapitre 19, "Le prétendu utopisme").
Mitchell ne se réfère pas à ce passage mais celui-ci n’irait pas à l’encontre de ses craintes vis-à-vis de la tendance du GIC à considérer l’État et la dictature du prolétariat comme une même chose, une identification qui, à ses yeux, désarme les travailleurs et favorise l’État :
"La présence agissante d’organismes prolétariens est la condition pour que l’État reste asservi au prolétariat et non le témoignage qu’il s’est retourné contre les ouvriers. Nier le dualisme contradictoire de l’État prolétarien, c’est fausser la signification historique de la période de transition.
Certains camarades considèrent, au contraire, que cette période doit exprimer l’identification des organisations ouvrières avec l’État (camarade Hennaut, "Nature et évolution de l’État russe" - Cf. Bilan n°34, p. 1124). Les internationalistes hollandais vont même plus loin lorsqu’ils disent que puisque "le temps de travail est la mesure de la répartition du produit social et que la distribution entière reste en dehors de toute "politique", les syndicats n’ont plus aucune fonction dans le communisme et la lutte pour l’amélioration des conditions d’existence a cessé" (p. 115 de leur ouvrage).
Le centrisme également est parti de cette conception que, puisque l’État soviétique était un État ouvrier, toute revendication des prolétaires devenait un acte d’hostilité envers "leur" État, justifiant ainsi l’assujettissement total des syndicats et comités d’usines au mécanisme étatique." (Bilan n° 37, republié dans la Revue internationale n° 132).
La gauche germano-hollandaise avait, évidemment, reconnu bien plus rapidement le fait que les syndicats avaient déjà cessé d’être des organes prolétariens sous le règne du capitalisme décadent, sans parler de la période de transition au communisme quand la classe ouvrière aurait créé ses propres organes unitaires (les comités d’usine, les conseils ouvriers, etc.). Mais le point fondamental de Mitchell reste parfaitement valable. En confondant le voyage avec la destination, en éliminant de l’équation les autres classes non-prolétariennes et toute l’hétérogénéité sociale complexe de la situation post-insurrectionnelle et, surtout, en envisageant une abolition quasi-immédiate de la condition du prolétariat comme classe exploitée, les camarades hollandais, du fait de toute leur antipathie pour l’État, laissent la porte ouverte à l’idée que, pendant la période de transition, le besoin, pour la classe ouvrière, de défendre ses intérêts immédiats serait devenu superflu. Pour la gauche italienne, la nécessité de préserver l’indépendance des syndicats et/ou des comités d’usine au sein de l’organisation générale de la société –bref, par rapport à l’État de transition – était une leçon fondamentale de la révolution russe où c'est "l’État ouvrier" qui avait fini par réprimer les ouvriers.
Cette esquive ou cette simplification de la question de l’État, de même que l'incapacité du GIC à comprendre la nécessité de l’extension internationale de la révolution, font partie d’une sous-estimation plus large de la dimension politique de la révolution. L’obsession du GIC est de chercher d’une méthode pour calculer, distribuer et rémunérer le travail social de façon à ce qu’un contrôle central puisse être maintenu à un minimum et que l’économie de la période de transition puisse avancer de façon semi-automatique vers le communisme intégral. Mais pour Mitchell, l’existence de telles lois ne peut se substituer à la maturité politique croissante des masses travailleuses, à leur capacité réelle d’imposer leur propre direction à la vie sociale :
"Les camarades hollandais ont, il est vrai, proposé une solution immédiate : pas de centralisation économique ni politique qui ne peut revêtir que des formes oppressives, mais le transfert de la gestion aux organisations d’entreprises qui coordonnent la production au moyen d’une "loi économique générale". Pour eux, l’abolition de l’exploitation (donc des classes) ne paraît pas se réaliser dans un long processus historique, enregistrant une participation sans cesse croissante des masses à l’administration sociale, mais dans la collectivisation des moyens de production, pourvu que celle-ci implique pour les conseils d’entreprises le droit de disposer, et de ces moyens de production, et du produit social. Mais outre qu’il s’agit ici d’une formulation qui contient sa propre contradiction, puisqu’elle revient à opposer la collectivisation intégrale (propriété à tous, mais à personne en particulier) à une sorte de "collectivisation" restreinte, dispersée entre groupes sociaux (la société anonyme est aussi une forme partielle de collectivisation), elle ne tend tout simplement qu’à substituer une solution juridique (le droit de disposition des entreprises) à l’autre solution juridique qu’est l’expropriation de la bourgeoisie. Or, nous avons vu précédemment que cette expropriation de la bourgeoisie n’est que la condition initiale de la transformation sociale (encore que la collectivisation intégrale ne soit pas immédiatement réalisable), alors que la lutte des classes se poursuit, comme avant la Révolution, mais sur des hases politiques qui permettent au prolétariat de lui imprimer un cours décisif." (Bilan n° 37, republié dans la Revue internationale n° 132)
Derrière ce rejet de la dimension politique de la lutte de classe, nous pouvons noter une divergence fondamentale entre les deux branches de la Gauche communiste dans leur compréhension de la transition au communisme. Les camarades hollandais reconnaissent la nécessité d’être vigilant à l’égard des restes de " puissantes tendances héritées du mode de production capitaliste qui jouent en faveur de la concentration du pouvoir de contrôle dans une autorité centrale" (Grundprinzipien, chapitre 10, "Les méthodes objectives de contrôle"). Mais ce paragraphe éclairant apparaît au milieu d’une recherche sur les méthodes de calcul dans la période de transition, et dans tout le livre, on ne perçoit que peu la lutte immense qui sera nécessaire pour surmonter les habitudes du passé tout autant que leur personnification matérielle et sociale dans les classes, les couches et les individus plus ou moins hostiles au communisme. Il semble que dans la vision du GIC, la bataille politique soit peu nécessaire, que ce soit sur les lieux de travail ou à un niveau social plus élevé. C’est aussi cohérent avec leur rejet de la nécessité d’organisations politiques communistes, du parti de classe.
Dans la seconde partie de cet article, nous examinerons certains des problèmes plus théoriques concernant la dimension économique de la transformation communiste.
CD Ward
1 Pour un résumé du premier volume, voir l'article "Le communisme n’est pas un bel idéal, mais une nécessité matérielle [résumé du volume I] [393]", Revue internationale n° 124.
2 Pour un résumé du deuxième volume, voir l'article "Le communisme n’est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [résumé du volume II]", Revue internationale n° 125 [394] et 126 [395].
3 Voir les articles de cette série dans les Revue internationale n° 127 à 134.
4 Voir la 10e partie du volume 2 de la série, "1926-1936 : l'énigme russe élucidée [183]", Revue Internationale n° 105.
5 Voir "La "Maladie infantile", condamnation des futurs renégats [396]" sur www.sinistra.net [397].
6 Bilan numéros 19, 20, 21, 22, 23
7 Parmi les études des Grundprinzipien, nous pouvons mentionner l’introduction de Paul Mattick [398], 1970, à la réédition en allemand du livre, disponible sur le site bataillesocialiste.wordpress.com.. L’édition de 1990 du livre, publiée par le Mouvement pour les Conseils Ouvriers, contient un long commentaire de Mike Baker, écrit peu avant sa mort, qui a aussi causé la disparition du groupe. Notre propre livre : La Gauche hollandaise, renferme une section sur les Grundprinzipien que nous publions en annexe de cet article. Cette partie démontre que notre vision est dans la continuité avec les critiques du texte déjà soulevées par les articles de Mitchell. Le texte des Grundprinzipien lui-même peut être trouvé sur mondialisme.org.
8 "Nature et évolution de la révolution russe", Bilan n° 33 et 34.
9 Bilan n° 34, p. 1124.
10 Nous devons être plus précis : Mitchell, lui-même un ancien membre de la LCI, faisait alors partie de la Fraction belge qui avait rompu avec la LCI sur la question de la guerre en Espagne. Dans une de ses séries d’articles sur la période de transition (Bilan n° 38), il a exprimé certaines critiques envers les ‘camarades de Bilan’, ayant le sentiment qu’ils n’avaient pas porté assez d’attention aux aspects économiques de la période de transition.
11 Voir "Les années 1930 : le débat sur la période de transition [176]", Revue internationale n° 127.
12 Traduction en français issue du site www.mondialisme.org/IMG/article_PDF/article_a1308.pdf [399].
Rubrique:
Revue Internationale n° 152 - 2e semestre 2013
- 1858 lectures
Le 20e congrès du CCI
- 1610 lectures
Le CCI a tenu récemment son 20e congrès international. Le Congrès d'une organisation communiste constitue un des moments les plus importants de son activité et de sa vie. C'est celui où l'ensemble de l'organisation (au moyen des délégations nommées par chacune de ses sections) fait le bilan de ses activités, analyse en profondeur la situation internationale, établit des perspectives et élit l'organe central qui a pour tâche d'assurer que les décisions du Congrès sont mises en œuvre.
Parce que nous sommes convaincus de la nécessité du débat et de la coopération entre les organisations qui combattent pour le renversement du système capitaliste, nous avons invité trois groupes – deux de Corée et Opop du Brésil qui ont déjà assisté à nos congrès internationaux. C'est donc parce que les travaux d'un congrès d'une organisation communiste ne sont pas une question "interne" mais intéressent l'ensemble de la classe ouvrière que nous informons nos lecteurs des questions essentielles qui ont été discutées lors de ce congrès.
Ce congrès s'est tenu dans un contexte d'aiguisement des tensions en Asie, de poursuite de la guerre en Syrie, d'aggravation de la crise économique et d'une situation de la lutte de classe complexe, marquée par un faible développement des luttes ouvrières "classiques" contre les attaques économiques de la bourgeoisie mais aussi par le surgissement international de mouvements sociaux dont les exemples les plus significatifs ont été celui des "Indignados" en Espagne et celui de "Occupy Wall Street" aux États-Unis.
L'analyse de la situation mondiale : un défi qui requiert un important effort théorique
La résolution sur la situation internationale adoptée pas le 20e Congrès du CCI, et qui résume les analyses qui se sont dégagées des discussions, est publiée dans ce même numéro de la Revue internationale. Il est donc inutile de la détailler ici.
Cette résolution rappelle le cadre historique dans lequel nous comprenons la situation présente de la société, celui de la décadence du mode de production capitaliste, décadence qui a débuté avec la première guerre mondiale, et la phase ultime de cette décadence que le CCI, depuis le milieu des années 1980, a analysée comme celle de la décomposition, du pourrissement sur pieds de cette société. Cette décomposition s'illustre particulièrement avec la forme que prennent à l'heure actuelle les conflits impérialistes, et dont la situation en Syrie constitue un exemple tragique (comme on peut le voir dans le rapport sur cette question adopté par le congrès et que nous publions ici), mais également avec la dégradation catastrophique de l'environnement que la classe dominante, malgré toutes ses déclarations et campagnes alarmées, est parfaitement incapable d'empêcher, et même de freiner.
Le congrès n'a pas mené de discussion spécifique sur les conflits impérialistes du fait d'un manque de temps et aussi parce que les discussions préparatoires avaient mis en évidence la grande homogénéité dans nos rangs sur cette question. Toutefois, le congrès a pris connaissance d'une présentation effectuée par le groupe coréen Sanoshin sur les tensions impérialistes en Extrême-Orient, présentation que nous publions en annexe sur notre site Internet.
Sur la crise économique
Sur cette question, la résolution souligne l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la bourgeoisie qui est incapable de surmonter les contradictions du mode de production capitaliste, ce qui constitue une confirmation éclatante de l'analyse marxiste. Une analyse que tous les "experts", qu'ils se réclament du "néolibéralisme" ou qu'ils le rejettent, considèrent avec le mépris des ignorants et surtout qu'ils combattent parce que, justement, elle prévoit la faillite historique de ce mode de productions et la nécessité de le remplacer par une société où le marché, le profit et le salariat auront été rangés au musée de l'histoire, où l'humanité sera libérée des lois aveugles qui l'enfoncent dans la barbarie pour vivre suivant le principe "De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins".
Concernant la situation présente de la crise du capitalisme, le congrès s'est prononcé clairement pour considérer que la "crise financière" actuelle n'est nullement à la source des contradictions dans lesquelles s'enfonce l'économie mondiale ni qu'elle trouverait ses racines dans une "financiarisation de l'économie" se préoccupant uniquement de profits immédiats et spéculatifs : "C'est la surproduction qui se trouve à la source de la 'financiarisation' et c'est le fait qu'il soit de plus en plus hasardeux d'investir dans la production, face à un marché mondial de plus en plus saturé, qui oriente de façon croissante les flux financiers vers la simple spéculation. C'est pourquoi toutes les théories économiques 'de gauche' qui préconisent une 'mise au pas de la finance internationale' pour 'sortir de la crise' sont des songes creux puisqu'elles 'oublient' les causes véritables de cette hypertrophie de la sphère financière." (Résolution sur la situation internationale, point 10) De même, le Congrès a considéré que : "La crise des 'subprimes' de 2007, la grande panique financière de 2008 et la récession de 2009 ont marqué le franchissement d'une nouvelle étape très importante et significative de l'enfoncement du capitalisme dans sa crise irréversible." (Ibid. point 11)
Cela dit, le Congrès a constaté qu'il n'y avait pas unanimité au sein de notre organisation et qu'il convenait de poursuivre la discussion autour d'un certain nombre de questions comme celles qui suivent.
L'aggravation de la crise en 2007 a-t-elle constitué une rupture qualitative et ouvert un nouveau chapitre menant l'économie à un effondrement rapide et immédiat ? Quelle est la signification de l'étape qualitative constituée par les événements de 2007 ? De façon plus générale, à quel type d'évolution de la crise faut-il s'attendre : à un effondrement soudain ou à un 'lent' déclin accompagné "politiquement" par les États capitalistes ? Et quels pays plongeront les premiers et qui seront les derniers ? La classe dominante a-t-elle une marge de manœuvre et quelles erreurs veut-elle éviter ? Ou, de façon plus générale, quand elle analyse les perspectives de la crise, la classe dominante peut-elle ignorer la possibilité de réactions de la classe ouvrière ? Quels critères la classe dominante prend-elle en considération quand elle adopte des programmes d'austérité dans les différents pays ? Sommes-nous dans une situation où toutes les classes dominantes peuvent attaquer la classe ouvrière comme cela a été fait en Grèce ? Pouvons-nous nous attendre à une reproduction des attaques à une même échelle (réduction des salaires jusqu'à 40 %, etc.) dans les vieux pays industriels centraux ? Quelles sont les différences entre la crise de 1929 et celle d'aujourd'hui ? Quel est le degré de paupérisation dans les grands pays industrialisés ?
L'organisation a rappelé que, très rapidement après 1989, elle a pris conscience et a prévu les changements fondamentaux sur le plan impérialiste et dans la lutte de classe qui avaient eu lieu avec l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes dits "socialistes" 1. Cependant, sur le plan des conséquences économiques, nous n'avons pas prévu les grands changements qui ont eu lieu depuis. Qu'est-ce que l'abandon d'une certaine autarcie et des mécanismes d'isolement vis-à-vis du marché mondial de la part de régimes comme la Chine et l'Inde allait signifier pour l'économie mondiale ?
Évidemment, comme nous l'avons fait pour le débat mené il y a quelques années au sein de notre organisation à propos des mécanismes ayant permis le "boom" qui a suivi la Seconde Guerre mondiale 2, nous porterons à la connaissance de nos lecteurs les principaux éléments du débat actuel dès lors que celui-ci aura atteint un degré suffisant de clarté.
Sur la lutte de classe
Le Rapport sur la lutte de classe au congrès a tiré un bilan des deux dernières années (depuis le Printemps arabe, les mouvements des Indignados, de Occupy, les luttes en Asie, etc.) et des difficultés de la classe pour répondre aux attaques toujours grandissantes des capitalistes en Europe et aux États-Unis. Les discussions au congrès ont traité principalement des questions suivantes : comment expliquer les difficultés de la classe ouvrière à répondre "de façon adéquate" aux attaques croissantes ? Pourquoi n'évolue-t-on pas encore vers une situation révolutionnaire dans les vieux centres industriels ? Quelle politique suit la classe dominante pour éviter des luttes massives dans les vieux centres industriels ? Quelles sont les conditions de la grève de masse ?
Quel rôle la classe ouvrière d'Asie joue-t-elle dans le rapport de forces global entre les classes, en particulier celle de Chine ? Que pouvons-nous attendre de la classe ? Le centre de l'économie mondiale et du prolétariat mondial s'est-il déplacé en Chine ? Comment évalue-t-on les changements dans la composition de la classe ouvrière mondiale ? La discussion a repris notre position sur le maillon faible que nous avons développée au début des années 1980 en opposition à la thèse de Lénine suivant laquelle la chaîne de la domination capitaliste allait se rompre à son "maillon le plus faible" 3, c'est-à-dire dans les pays faiblement développés.
Même si les discussions n'ont pas mis en évidence de désaccords sur le rapport présenté (et qui est résumé par la partie lutte de classe de la résolution), nous avons estimé que l'organisation se devait de poursuivre la réflexion sur cette question, notamment en discutant du thème "Avec quelle méthode faut-il aborder l'analyse de la lutte de classe dans la période historique présente ?"
Sur les activités et la vie de l'organisation
Les discussions sur la vie de l'organisation, sur le bilan et les perspectives de ses activités et de son fonctionnement ont occupé une place importante dans les travaux du 20e congrès, comme ce fut toujours le cas dans les précédents congrès. C'est la manifestation du fait que les questions d'organisation ne sont pas de simples questions "techniques" mais des questions politiques à part entière qu'il est nécessaire d'aborder avec un maximum de profondeur. Lorsqu'on se penche sur l'histoire des trois internationales que s'est données la classe ouvrière, on constate que ces questions ont résolument été prises en charge par l'aile marxiste de celles-ci comme l'illustrent, parmi beaucoup d'autres, les exemples suivants :
- combat de Marx et du Conseil général de l'AIT contre l'Alliance de Bakounine, notamment lors du congrès de La Haye en 1872 ;
- combat de Lénine et des bolcheviks contre les conceptions petite-bourgeoises et opportunistes des mencheviks lors du 2e congrès du POSDR, en 1903 et par la suite ;
- combat de la Fraction de Gauche du parti communiste d'Italie contre la dégénérescence de l'Internationale communiste et pour préparer les conditions politiques et programmatiques du surgissement d'un nouveau parti prolétarien lorsque les conditions historiques en seraient données.
L'expérience historique du mouvement ouvrier a mis en évidence le caractère indispensable d'organisations politiques spécifiques défendant la perspective révolutionnaire au sein de la classe ouvrière pour que celle-ci soit capable de renverser le capitalisme et édifier la société communiste. Mais il ne suffit pas de proclamer l'existence des organisations politiques prolétariennes, il faut les construire. Alors que le but est le renversement du système capitaliste et qu'une société communiste ne peut être construite qu'en dehors de celui-ci une fois que le pouvoir de la bourgeoisie a été renversé, c'est dans la société capitaliste qu'il faut construire une organisation révolutionnaire. Cette construction se trouve donc confrontée à toutes sortes de pressions et d'obstacles venant du système capitaliste et de son idéologie. Cela veut dire que cette construction n'a pas lieu dans le vide, que les organisations révolutionnaires sont comme un corps étranger dans la société capitaliste que celle-ci cherche constamment à détruire. Une organisation révolutionnaire est obligée de se défendre en permanence contre toute une série de menaces provenant de la société capitaliste.
C'est une évidence qu'elle doit résister à la répression. La classe dominante n'a jamais hésité, lorsqu'elle le jugeait nécessaire, à déchaîner ses moyens policiers, voire militaires, pour faire taire la voix des révolutionnaires. La plupart des organisations du passé ont vécu longtemps dans des conditions de répression, elles étaient "hors-la-loi", beaucoup de militants étaient exilés. Cela-dit, cette répression ne les a pas brisés. Bien souvent, au contraire, elle a renforcé leur résolution et les a aidés à se défendre contre les illusions démocratiques. Ce fut par exemple le cas du Parti Social-démocrate d'Allemagne (SPD) durant la période des lois antisocialistes où il a bien mieux résisté au poison de la "démocratie" et du "parlementarisme" que pendant la période où il était légal. Ce fut également le cas du Parti Ouvrier Social-démocrate de Russie (et particulièrement de sa fraction bolchevique) qui a été illégal pendant la presque totalité de son existence.
L'organisation révolutionnaire doit également résister à la destruction de l'intérieur venant de dénonciateurs, d'informateurs ou d'aventuriers qui peuvent provoquer des dégâts souvent bien plus importants que la répression ouverte.
Enfin, et surtout, elle doit résister à la pression de l'idéologie dominante, en particulier celle du démocratisme et du "bon sens commun" (stigmatisé par Marx), et lutter contre toutes les "valeurs" et tous les "principes" de la société capitaliste. L'histoire du mouvement ouvrier nous a appris, à travers la gangrène opportuniste qui a emporté la 2e et la 3e Internationales, que la principale menace qui affecte les organisations prolétariennes est justement celle de leur incapacité à combattre la pénétration en leur sein des "valeurs" et des modes de pensée de la société bourgeoise.
De ce fait, l'organisation révolutionnaire ne peut fonctionner comme la société capitaliste, elle doit fonctionner de façon associée.
La société capitaliste fonctionne sur la base de la concurrence, de l'aliénation, de la "comparaison" des uns avec les autres, de l'établissement de normes, de l'efficacité maximum. Une organisation communiste requiert de travailler ensemble et de surmonter l'esprit de compétition. Elle ne peut fonctionner que si ses membres ne se comportent pas comme un troupeau de moutons, et ne suivent ni n'acceptent aveuglément ce que disent l'organe central ou d'autres camarades. La recherche de la vérité et de la clarté doit être un stimulant permanent dans toutes les activités de l'organisation. L'autonomie de la pensée, la capacité de réfléchir, de mettre les choses en question est indispensable. Cela signifie qu'on ne peut se cacher derrière un collectif mais prendre ses responsabilités en exprimant son point de vue et en poussant à la clarification. Le conformisme est un grand obstacle dans notre lutte pour le communisme.
Dans la société capitaliste, si on n'est pas dans la "norme", on est rapidement "exclu", transformé en bouc-émissaire, en celui qui est blâmé pour tout ce qui arrive. Une organisation révolutionnaire doit établir un mode de fonctionnement au sein duquel les divers individus, les personnalités différentes peuvent s'intégrer dans un grand tout unique, c'est-à-dire un fonctionnement qui développe l'art de mettre à contribution et d'intégrer la richesse de toutes les personnalités. Cela signifie combattre l'orgueil personnel et d'autres attitudes liées à la compétition tandis qu'on estime et attache de l'importance à la contribution de chaque camarade. Et, en même temps, cela signifie qu'une organisation doit avoir un ensemble de règles et de principes. Ceux-ci doivent être élaborés, ce qui est un combat politique en soi. Tandis que l'éthique de la société capitaliste ne connaît aucun scrupule, les moyens de la lutte prolétarienne doivent être en harmonie avec le but à atteindre.
La construction et le fonctionnement d'une organisation implique donc une dimension théorique et morale, les deux requérant des efforts constants et permanents. Toute faiblesse et tout affaiblissement des efforts et de la vigilance dans une dimension pave la voie de l'affaiblissement dans une autre dimension. Ces deux dimensions sont inséparables l'une de l'autre et se déterminent mutuellement. Moins une organisation fait d'efforts théoriques, plus vite et plus facilement peut se développer une régression morale, et la perte de la boussole morale à son tour affaiblira inévitablement les capacités théoriques. Ainsi, au tournant du 19e et du 20e siècle, Rosa Luxemburg avait déjà mis en évidence que la dérive opportuniste de la Social-démocratie allemande allait de pair avec sa régression morale et théorique.
Un des aspects fondamentaux de la vie d''une organisation communiste est son internationalisme, non seulement sur le plan des principes mais aussi au niveau de la conception qu'elle se fait de son mode de vie et de fonctionnement.
Le but – une société sans exploitation et qui produit pour les besoins de l'humanité – ne peut être réalisé qu'au niveau international et il requiert l'unification du prolétariat par-delà toutes les frontières. C'est pourquoi l'internationalisme a été le mot d'ordre central du prolétariat depuis son apparition. Les organisations révolutionnaires doivent être l'avant-garde, toujours adopter un point de vue international et lutter contre toute perspective "localiste".
Bien que, dès sa naissance, le prolétariat ait toujours cherché à s'organiser au niveau international (La Ligue des Communistes de 1847-1852 fut la première organisation internationale), le CCI est la première organisation à être centralisée au niveau international et où toutes les sections défendent les mêmes positions. Nos sections sont intégrées au débat international dans l'organisation et tous les membres – dans différents continents – peuvent s'appuyer sur l'expérience de toute l'organisation. Ceci veut dire que nous devons apprendre à rassembler des militants venant de milieux de toutes sortes, et à mener des débats malgré les différentes langues – tout cela constitue un processus passionnant et fructueux où la clarification et l'approfondissement de nos positions sont enrichis par les contributions de camarades de toute la planète.
Enfin, last but not least, il importe que l'organisation ait en permanence une claire compréhension du rôle qui lui revient dans le combat du prolétariat pour son émancipation. Comme le CCI l'a souvent souligné, la fonction de l'organisation révolutionnaire ne saurait être aujourd'hui "d'organiser la classe" ou même ses luttes (comme cela pouvait être le cas lors des premiers pas du mouvement ouvrier, au 19e siècle). Son rôle essentiel, tel qu'il est déjà énoncé dans le Manifeste Communiste de 1848, découle du fait "que [les communistes] ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien", En ce sens, la fonction permanente et essentielle de l'organisation_ est l'élaboration des positions politiques et, pour ce faire, elle ne doit pas être complètement absorbée par les tâches d'intervention au sein de la classe. Elle doit faire preuve de "recul", d'une vue générale des questions et approfondir en permanence les questions qui se posent à la classe dans son ensemble et dans le cadre de sa perspective historique. Cela signifie qu'elle ne peut se contenter d'analyser la situation mondiale mais, de façon plus large, elle doit étudier les questions théoriques sous-jacentes, contrairement à la superficialité et aux distorsions de la société et de l'idéologie capitalistes. C'est une lutte permanente, avec une vue à long terme qui embrasse toute une série d'aspects qui dépassent de loin les questions qui peuvent se poser à la classe à tel ou tel moment de son combat.
Puisque la révolution prolétarienne n'est pas simplement une lutte pour "de couteaux et des fourchettes", comme le soulignait Rosa Luxemburg, mais la première révolution dans l'histoire de l'humanité où sont brisées toutes les chaînes de l'exploitation et de l'oppression, cette lutte comporte nécessairement une immense transformation culturelle. Une organisation révolutionnaire ne traite pas seulement de questions d'économie politique et de lutte de classe au sens étroit ; elle doit développer une vision des questions les plus importantes auxquelles est confrontée l'humanité, développer constamment cette vision et être ouverte et prête à faire face à de nouvelles questions. L'élaboration théorique, la recherche de la vérité, le désir de clarification doivent être une passion quotidienne.
Et, en même temps, nous ne pouvons remplir notre rôle que si la vieille génération de militants transmet l'expérience et les leçons de celle-ci aux nouveaux militants. Si la vieille génération n'a aucun "trésor" d'expérience ni aucune leçon à transmettre à la nouvelle génération, elle faillit à sa tâche. La construction de l'organisation requiert donc l'art de combiner les leçons du passé afin de préparer le futur.
Comme on peut le voir, la construction d'une organisation révolutionnaire est une tâche extrêmement complexe et nécessite un combat permanent. Par le passé, notre organisation a déjà mené d'importants combats pour la défense des principes que nous avons énoncés plus haut. Mais l'expérience a montré que ces combats étaient encore insuffisants et qu'ils devaient être poursuivis face aux difficultés et aux faiblesses résultant des origines de notre organisation et des conditions historiques dans lesquelles elle mène son activité :
"Il n'existe pas de cause unique, exclusive à chacune des différentes faiblesses de l'organisation. Celles-ci résultent de la combinaison de divers facteurs qui, même s'ils peuvent être liés entre eux, doivent être clairement identifiés :
- le poids de nos origines au sein de la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 1960, et notamment celui de la rupture organique ;
- le poids de la décomposition qui commence à produire ses effets au milieu des années 1980 ;
- la pression de la "main invisible du marché", de la réification dont l'empreinte sur la société n'a fait que s'accentuer avec la prolongation de la survie des rapports de production capitalistes.
Les différentes faiblesses que nous avons pu identifier, même si elles peuvent s'entre déterminer, relèvent, en dernière instance de ces trois facteurs ou de leur combinaison :
- La sous-estimation de l'élaboration théorique, et particulièrement sur les questions organisationnelles, trouve ses sources dans nos origines mêmes : l'impact de la révolte estudiantine avec sa composante académiste (de nature petite-bourgeoise) à laquelle s'est opposée une tendance qui confondait anti-académisme et mépris de la théorie, et cela dans une ambiance de contestation de l'autorité" [des militants plus anciens]. "Par la suite, cette sous-estimation de la théorie a été alimentée par l'ambiance générale de destruction de la pensée propre à la période de décomposition et à l'imprégnation croissante du "bon sens commun" (…).
- La perte des acquis est une conséquence directe de la sous-estimation de l'élaboration théorique : les acquis de l'organisation, que ce soit sur des questions programmatiques, d'analyse ou organisationnelles, ne peuvent se maintenir, notamment face à la pression constante de l'idéologie bourgeoise, que s'ils sont étayés et alimentés en permanence par la réflexion théorique : une pensée qui ne progresse pas, qui se contente de répéter des formules stéréotypées n'est pas seulement menacée de stagnation, elle régresse. (…).
- L'immédiatisme fait partie des péchés de jeunesse de notre organisation qui a été formée par de jeunes militants éveillés à la politique au moment d'une reprise spectaculaire des combats de classe et qui, pour beaucoup, s'imaginaient, que la révolution était déjà à portée de main. Les plus immédiatistes d'entre nous n'ont pas résisté et se sont finalement démoralisés, abandonnant le combat, mais cette faiblesse s'est également maintenue parmi ceux qui sont restés (…). C'est une faiblesse qui peut être fatale car, associée à la perte des acquis, elle débouche inexorablement sur l'opportunisme, une démarche qui vient régulièrement saper les fondements de l'organisation. (…)
- Le routinisme, pour sa part, est une des manifestations majeures du poids dans nos rangs des rapports aliénés, réifiés, qui dominent la société capitaliste et qui tend à transformer l'organisation en machine et les militants en robots. (…)
- L'esprit de cercle constitue, comme l'atteste toute l'histoire du CCI, et aussi celle de tout le mouvement ouvrier, un des poisons les plus dangereux pour l'organisation qui porte avec lui non seulement la transformation d'un instrument du combat prolétarien en une simple "bande de copains", non seulement la personnalisation des questions politiques -sapant ainsi la culture du débat- et la destruction du travail collectif au sein de l'organisation, mais son unité, notamment à travers le clanisme. Il est également responsable de la recherche de boucs émissaires sapant sa santé morale, de même qu'il est un des pires ennemis de la culture de la théorie par la destruction de la pensée rationnelle et profonde au bénéfice des contorsions et des commérages. De même, c'est un vecteur fréquent de l'opportunisme, antichambre de la trahison." (Résolution d'activités adoptée par le congrès, point 4)
Pour combattre les faiblesses et les dangers auxquelles s'affronte l'organisation, il n'existe pas de formule magique et il est nécessaire de porter nos efforts dans plusieurs directions. Un des points qui a fait l'objet d'une insistance particulière est la nécessité de combattre le routinisme et le conformisme en soulignant le fait que l'organisation n'est pas un corps uniforme et anonyme mais une association de militants différents qui tous doivent apporter leur contribution spécifique à l'œuvre commune :
"De façon à œuvrer à la construction d’une véritable association internationale de militants communistes où chacun doit pouvoir continuer à apporter sa pierre à l'édifice collectif, l'organisation rejette l’utopie réactionnaire du "militant modèle", du "militant standard", du "super-militant" invulnérable et infaillible. (…) Les militants ne sont ni des robots ni des "surhommes" mais des êtres humains ayant des personnalités, des histoires, des origines socioculturelles différentes. C'est seulement par une meilleure compréhension de notre "nature" humaine et de la diversité spécifique à notre espèce que la confiance et la solidarité entre les militants pourront être construites et consolidées. (…) Dans cette construction, chaque camarade a la capacité de faire une contribution unique à l'organisation. Il a aussi la responsabilité individuelle de le faire. En particulier, c'est la responsabilité de chacun d'exprimer sa position dans les débats, en particulier ses désaccords et questionnements sans lesquels l'organisation ne sera pas capable de développer la culture du débat et l'élaboration théorique." (Résolution d'activités, point 9)
Et, justement, le congrès a apporté une insistance toute particulière sur la nécessité de prendre à bras le corps, avec détermination et persévérance, l'effort d'élaboration théorique.
"Le premier défi pour l’organisation est de prendre conscience des dangers auxquels nous sommes confrontés. Nous ne pouvons surmonter ces dangers par une "action de pompiers" (…) nous devons affronter tous les problèmes avec une démarche théorique et historique et nous opposer à toute analyse pragmatique, superficielle. Cela veut dire développer une vision à long terme et ne pas tomber dans la démarche empirique et "au jour le jour". L’étude théorique et le combat politique doivent revenir au centre de la vie de l’organisation, pas seulement en ce qui concerne notre intervention au quotidien, mais, plus important, en poursuivant sur les questions théoriques plus profondes, sur le marxisme lui-même, qui nous ont été posées au cours des dix dernières années dans les orientations que nous nous sommes données (…) Cela signifie que nous nous donnons le temps d’approfondir et de combattre tout conformisme dans nos rangs. L’organisation encourage le questionnement critique, l’expression de doutes et les efforts pour explorer les choses plus à fond.
Nous ne devons pas oublier que "la théorie n’est pas une passion du cerveau mais le cerveau d'une passion" et que lorsque cette "théorie s’empare des masses, elle devient une force matérielle" (Marx). La lutte pour le communisme ne comporte pas seulement une dimension économique et politique, mais également et surtout une dimension théorique ("intellectuelle" et morale). C’est en développant la "culture de la théorie", c'est-à-dire la capacité de placer en permanence dans un cadre historique et/ou théorique tous les aspects de l'activité de l'organisation, que nous pourrons développer et approfondir la culture du débat en notre sein, et mieux assimiler la méthode dialectique du marxisme. Sans le développement de cette "culture de la théorie", le CCI ne sera pas capable de "garder le cap" sur le long terme pour s’orienter et s’adapter à des situations inédites, d’évoluer, d’enrichir le marxisme qui n’est pas un dogme invariant et immuable mais une théorie vivante orientée vers l’avenir.
Cette "culture de la théorie" n'est pas un problème de "niveau d'études" des militants. Elle contribue au développement d'une pensée rationnelle, rigoureuse et cohérente (indispensable à l'argumentation), au développement de la conscience de tous les militants et à consolider dans nos rangs la méthode marxiste.
Ce travail de réflexion théorique ne peut ignorer l’apport des sciences (et notamment des sciences humaines, telles la psychologie et l'anthropologie), l’histoire de l’espèce humaine et du développement de sa civilisation. C'est en particulier pour cela que la discussion sur le thème "marxisme et science" était de la plus haute importance et que les avancées qu’elle a permises doivent rester présentes et se renforcer dans la réflexion et la vie de l'organisation." (Résolution d'activités, point 8)
L'invitation de scientifiques
Cette préoccupation pour l'apport des sciences n'est pas nouvelle de la part du CCI. En particulier, nous avons rendu compte dans les articles sur nos précédents congrès de l'invitation de scientifiques qui ont contribué à la réflexion de l'ensemble de l'organisation en lui soumettant leurs propres réflexions dans leur domaine de recherche. Cette fois-ci, nous avions invité deux anthropologues britanniques, Camilla Power et Chris Knight, qui étaient déjà venus à de précédents congrès et à qui nous voulons, dans cet article, adresser de chaleureux remerciements. Ces deux scientifiques se sont réparti une présentation sur le thème de la violence dans la préhistoire, dans les sociétés qui ne connaissaient pas encore la division en classes. L'intérêt de ce thème pour les communistes est évidemment fondamental. Déjà le marxisme a dédié toute une réflexion sur le rôle de la violence. En particulier, Engels consacre une partie importante de "L'Anti-Dühring au rôle de la violence dans l'histoire. Aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à célébrer le centenaire de la première guerre mondiale, un siècle qui a été marqué par les pires violences qu'ait connues l'humanité, alors que la violence est omniprésente dans la société et qu'elle s'étale au quotidien sur les écrans de télévision, il est important que ceux qui militent pour une société débarrassée des fléaux de la société capitaliste, des guerres et de l'oppression s'interrogent sur la place de la violence dans les différentes sociétés. En particulier, face aux thèses de l'idéologie bourgeoise suivant lesquelles la violence de la société actuelle correspond à la "nature humaine", dont la règle est "le chacun pour soi", ou domine nécessairement la "loi du plus fort", il importe de se pencher sur la place de la violence dans les sociétés qui ne connaissaient pas la division en classes, comme dans le communisme primitif.
Nous ne pouvons rendre compte ici des présentations très riches faites par Camilla Power et Chris Knight (qui vont être publiées en postcast sur notre site Internet). Mais il vaut la peine de souligner que ces deux scientifiques ont contredit la thèse de Steven Pinker selon laquelle grâce à la "civilisation" et à l'influence de l'État, la violence a reculé. Ils ont montré que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs existait un niveau de violence bien plus bas que dans les sociétés qui leur ont succédé.
La discussion qui a suivi la présentation de Camilla Power et Chris Knight a été, comme lors des autres congrès, très animée. Elle a en particulier illustré, une fois de plus, combien pouvait être enrichissant pour la pensée révolutionnaire l'apport des sciences, une idée dont Marx et Engels se sont faits les défenseurs il y a plus d'un siècle et demi.
Conclusion
Le 20e congrès du CCI, à travers la mise en évidence des obstacles qu'affronte la classe ouvrière dans le combat en vue de son émancipation, de même que sur les obstacles que rencontre l'organisation des révolutionnaires dans l'accomplissement de sa responsabilité spécifique au sein de ce combat, a pu constater la difficulté et la longueur du chemin qui est devant nous. Mais cela n'est pas pour nous décourager. Comme le dit la résolution adoptée par le congrès :
"La tâche qui nous attend est longue et difficile. Il nous faut de la patience, dont Lénine disait qu'elle était une des principales qualités du bolchevik. Il nous faut résister au découragement face aux difficultés. Celles-ci sont inévitables et il nous faut les considérer non comme une malédiction mais au contraire comme un encouragement à poursuivre et intensifier le combat. Les révolutionnaires, et c'est une de leurs caractéristiques fondamentales, ne sont pas des personnes qui recherchent le confort ou la facilité. Ce sont des combattants qui se donnent pour objectif de contribuer de façon décisive à la tâche la plus immense et la plus difficile que devra accomplir l'espèce humaine, mais aussi la plus enthousiasmante puisqu'elle signifie la libération de l'humanité de l'exploitation et de l'aliénation, et le début de sa 'véritable histoire'". (Résolution d'activités, point 16)
CCI
1 Cf. Revue internationale n° 60 (1er trimestre 1990) "Effondrement du bloc de l'Est : des difficultés accrues pour le prolétariat",
https://fr.internationalism.org/rinte60/prolet.htm [201]
et Revue internationale n° 64 (1er trimestre 1991) "Texte d'orientation : Militarisme et décomposition",
2 "Débat interne au CCI : Les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale", dans les Revue internationale n° 133, 135, 136, 138 – 2008-2009.
3 Voir à ce sujet "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" dans la Revue Internationale n° 31 (/nation_classe.htm [402]
Rubrique:
Résolution sur la situation Internationale (20e congrès du CCI)
- 1262 lectures
La décomposition du capitalisme
1) Depuis un siècle, le mode de production capitaliste est entré dans sa période de déclin historique, de décadence. C'est l'éclatement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, qui a signé le passage entre la "Belle Époque", celle de l'apogée de la société bourgeoise, et "l'Ère des guerres et des révolutions", comme l'a qualifiée l'Internationale communiste lors de son premier congrès, en 1919. Depuis, le capitalisme n'a fait que s'enfoncer dans la barbarie avec à son actif, notamment, une Seconde Guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts. Et si la période de "prospérité" qui a suivi cette horrible boucherie a pu semer l'illusion que ce système avait pu enfin surmonter ses contradictions, la crise ouverte de l'économie mondiale, à la fin des années 60, est venu confirmer le verdict que les révolutionnaires avaient déjà énoncé un demi-siècle auparavant : le mode de production capitaliste n'échappait pas au destin des modes de production qui l'avaient précédé. Lui aussi, après avoir constitué une étape progressive dans l'histoire humaine, était devenu un obstacle au développement des forces productives et au progrès de l'humanité. L'heure de son renversement et de son remplacement par une autre société était venue.
2) En même temps qu'elle signait l'impasse historique dans laquelle se trouve le système capitaliste, cette crise ouverte, au même titre que celle des années 1930, plaçait une nouvelle fois la société devant l'alternative : guerre impérialiste généralisée ou développement de combats décisifs du prolétariat avec, en perspective, le renversement révolutionnaire du capitalisme. Face à la crise des années 1930, le prolétariat mondial, écrasé idéologiquement par la bourgeoisie suite à la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23, n'avait pu apporter sa propre réponse, laissant la classe dominante imposer la sienne : une nouvelle guerre mondiale. En revanche, dès les premières atteintes de la crise ouverte, à la fin des années 1960, le prolétariat a engagé des combats de grande ampleur : Mai 1968 en France, le "Mai rampant" italien de 1969, les grèves massives des ouvriers polonais de la Baltique en 1970 et beaucoup d'autres combats moins spectaculaires mais tout aussi significatifs d'un changement fondamental dans la société : la contre-révolution avait pris fin. Dans cette situation nouvelle, la bourgeoisie n'avait pas les mains libres pour prendre le chemin d'une nouvelle guerre mondiale. Il s'en est suivi plus de quatre décennies de marasme croissant de l'économie mondiale, accompagné d'attaques de plus en plus violentes contre le niveau et les conditions de vie des exploités. Au cours de ces décennies, la classe ouvrière a mené de multiples combats de résistance. Cependant, même si elle n'a pas subi de défaite décisive qui aurait pu inverser le cours historique, elle n'a pas été en mesure de développer ses luttes et sa conscience au point de présenter à la société, ne serait-ce qu'une ébauche de perspective révolutionnaire. "Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l'histoire ne saurait pourtant s'arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société." (La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste – Revue Internationale n° 62). C'est donc une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui s'est ouverte depuis un quart de siècle. Celle où le phénomène de la décomposition sociale est devenu une composante déterminante de la vie de toute la société.
3) Le terrain où se manifeste de façon la plus spectaculaire la décomposition de la société capitaliste est celui des affrontements guerriers et plus généralement des relations internationales. Ce qui avait conduit le CCI à élaborer son analyse sur la décomposition, dans la seconde moitié des années 1980, c’était la succession d’attentats meurtriers qui avaient frappé de grandes villes européennes, notamment Paris, au milieu de la décennie, des attentats qui n’étaient pas le fait de simple groupes isolés mais d’États constitués. C’était le début d’une forme d’affrontements impérialistes, qualifiés par la suite de "guerres asymétriques", qui traduisait un changement en profondeur dans les relations entre États et, plus généralement, dans l’ensemble de la société. La première grande manifestation historique de cette nouvelle, et ultime, étape dans la décadence du capitalisme a été constituée par l’effondrement des régimes staliniens d’Europe et du bloc de l’Est en 1989. Immédiatement, le CCI avait mis en avant la signification que cet événement revêtait du point de vue des conflits impérialistes : "La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux ‘partenaires’ d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (…). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible." (Revue Internationale n° 61, "Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos") Depuis, la situation internationale n’a fait que confirmer cette analyse :
- 1ère guerre du Golfe en 1991 ;
- guerre dans l’ex Yougoslavie entre 1991 et 2001 ;
- deux guerres en Tchétchénie (en 1994-1995 et en 1999-2000) ;
- guerre en Afghanistan à partir de 2001 qui se poursuit encore, 12 ans après ;
- la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine ;
- les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, Côte d’Ivoire, Mali, etc.) ;
- les nombreuses opérations militaires d’Israël contre le Liban ou la Bande de Gaza répliquant aux tirs de roquettes depuis les positions du Hezbollah ou du Hamas.
4) En fait, ces différents conflits illustrent de façon dramatique combien la guerre a acquis un caractère totalement irrationnel dans le capitalisme décadent. Les guerres du 19e siècle, aussi meurtrières qu’elles aient pu être, avaient une rationalité du point de vue du développement du capitalisme. Les guerres coloniales permettaient aux États européens de se constituer un Empire où puiser des matières premières ou écouler leurs marchandises. La Guerre de Sécession de 1861-65 en Amérique, remportée par le Nord, a ouvert les portes à un plein développement industriel de ce qui allait devenir la première puissance mondiale. La guerre franco-prussienne de 1870 a été un élément décisif de l’unité allemande et donc de la création du cadre politique de la future première puissance économique d’Europe. En revanche, la Première Guerre mondiale a laissé exsangues les pays européens, "vainqueurs" aussi bien que "vaincus", et notamment ceux qui avaient eu la position la plus "belliciste" (Autriche, Russie et Allemagne). Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle a confirmé et amplifié le déclin du continent européen où elle avait débuté, avec une mention spéciale pour l’Allemagne qui était en 1945 un champ de ruines, à l’image aussi du Japon, autre puissance "agressive". En fait, le seul pays qui ait bénéficié de cette guerre fut celui qui y était entré le plus tardivement et qui a pu éviter, du fait de sa position géographique, qu’elle ne se déroule sur son territoire, les États-Unis. D’ailleurs, la guerre la plus importante qu’ait menée ce pays après la Seconde Guerre mondiale, celle du Vietnam, a bien montré son caractère irrationnel puisqu’elle n’a rien rapporté à la puissance américaine malgré un coût considérable du point de vue économique et surtout humain et politique.
5) Cela-dit, le caractère irrationnel de la guerre s’est hissé à un niveau supérieur dans la période de décomposition. C’est bien ce qui s’est illustré, par exemple, avec les aventures militaires des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Ces guerres, elles aussi, ont eu un coût considérable, notamment du point de vue économique. Mais leur bénéfice est des plus réduits, sinon négatif. Dans ces guerres, la puissance américaine a pu faire étalage de son immense supériorité militaire, mais cela n’a pas permis qu’elle atteigne les objectifs qu’elle recherchait ; stabiliser l’Irak et l’Afghanistan et obliger ses anciens alliés du bloc occidental à resserrer les rangs autour d’elle. Aujourd’hui, le retrait programmé des troupes américaines et de l’OTAN d’Irak et d’Afghanistan laisse une instabilité sans précédent dans ces pays avec le risque qu’elle ne participe à l’aggravation de l’instabilité de toute la région. En même temps, c’est en ordre dispersé que les autres participants à ces aventures militaires ont quitté ou quittent le navire. Pour la puissance impérialiste américaine, la situation n'a cessé de s'aggraver : si, dans les années 1990, elle réussissait à tenir son rôle de "Gendarme du Monde", aujourd'hui, son premier problème est d'essayer de masquer son impuissance face à la montée du chaos mondial comme le manifeste, par exemple, la situation en Syrie.
6) Au cours de la dernière période, le caractère chaotique et incontrôlable des tensions et conflits impérialistes s’est illustré une nouvelle fois avec la situation en Extrême-Orient et, évidemment, avec la situation en Syrie. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des conflits qui portent avec eux la menace d’un embrasement et d’une déstabilisation bien plus considérables.
En Extrême-Orient on assiste à une montée des tensions entre États de la région. C’est ainsi qu’on a vu au cours des derniers mois se développer des tensions impliquant de nombreux pays, des Philippines au Japon. Par exemple, la Chine et le Japon se disputent les îles Senkaku/Diyao, le Japon et la Corée du Sud l’île Takeshima/Dokdo, alors que d’autres tensions se font jour impliquant aussi Taiwan, le Vietnam ou la Birmanie. Mais le conflit le plus spectaculaire concerne évidemment celui opposant la Corée du Nord d’un côté et, de l’autre, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Prise à la gorge par une crise économique dramatique, la Corée du Nord s’est lancée dans une surenchère militaire qui, évidemment, vise à faire du chantage, notamment auprès des États-Unis, pour obtenir de cette puissance un certain nombre d’avantages économiques. Mais cette politique aventuriste contient deux facteurs de gravité. D’une part, le fait qu’elle implique, même si c’est de façon indirecte, le géant Chinois, qui reste un des seuls alliés de la Corée du Nord, alors que cette puissance tend de plus en plus à faire valoir ses intérêts impérialistes partout où elle le peut, en Extrême Orient, évidemment, mais aussi au Moyen-Orient, grâce notamment à son alliance avec l'Iran (qui est par ailleurs son principal fournisseur d'hydrocarbures) et aussi en Afrique où une présence économique croissante vise à préparer une future présence militaire quand elle en aura les moyens. D'autre part, cette politique aventuriste de l'État Nord-Coréen, un État dont la domination policière barbare témoigne de la fragilité fondamentale, contient le risque d'un dérapage, de l'entrée dans un processus incontrôlé engendrant un nouveau foyer de conflits militaires directs avec des conséquences difficilement prévisibles mais dont on peut déjà penser qu'elles constitueront un autre épisode tragique venant s'ajouter à toutes les manifestations de la barbarie guerrière qui accablent la planète aujourd'hui.
7) La guerre civile en Syrie fait suite au "printemps arabe" qui, en affaiblissant le régime d’Assad, a ouvert la Boite de Pandore d’une multitude de contradictions et de conflits que la main de fer de ce régime avait maintenue sous le boisseau pendant des décennies. Les pays occidentaux se sont prononcés en faveur du départ d’Assad mais ils sont bien incapables de disposer d’une solution de rechange sur place alors que l’opposition à celui-ci est totalement divisée et que le secteur prépondérant de cette dernière est constitué par les islamistes. En même temps, la Russie apporte un soutien militaire sans faille au régime d'Assad qui, avec le port de Tartous, lui garantit la présence de sa flotte de guerre en Méditerranée. Et ce n'est pas le seul État puisque l'Iran n'est pas en reste de même que la Chine : la Syrie est devenue un nouvel enjeu sanglant des multiples rivalités entre puissances impérialistes de premier ou de deuxième ordre dont les populations du Moyen-Orient n'ont cessé de faire les frais depuis des décennies. Le fait que les manifestations du "Printemps arabe" en Syrie aient abouti non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées mais sur une guerre qui a fait plus de 100 000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c'est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye.
Ainsi, la Syrie nous offre aujourd'hui un nouvel exemple de la barbarie que le capitalisme en décomposition déchaîne sur la planète, une barbarie qui prend la forme d'affrontements militaires sanglants mais qui affecte également des zones qui ont pu éviter la guerre mais dont la société s'enfonce dans un chaos croissant comme par exemple en Amérique latine où les narcotrafiquants, avec la complicité de secteurs de l'État, font régner la terreur.
8) Mais c’est au niveau de la destruction de l'environnement que les conséquences à court terme de l'effondrement de la société capitaliste atteignent une qualité totalement apocalyptique. Bien que le développement du capitalisme se soit caractérisé dès ses origines par son extrême rapacité dans sa recherche de profit et d'accumulation au nom de la « domination de la nature », les déprédations menées depuis 30 ans atteignent des niveaux de dévastation inconnus dans les sociétés du passé et dans le capitalisme lui-même lors de sa naissance "dans la boue et dans le sang". La préoccupation du prolétariat révolutionnaire face à l'essence destructive du capitalisme est ancienne, comme ancienne est la menace. Marx et Engels alertaient déjà sur l'impact néfaste – tant pour la nature que pour les hommes –du rassemblement et du confinement des populations dans les premières concentrations industrielles en Angleterre au milieu du xixe siècle. Dans le même esprit, les révolutionnaires de différentes époques ont compris et dénoncé la nature atroce du développement capitaliste, en prévenant contre le danger qu'il représente non seulement pour la classe ouvrière, mais pour toute l'humanité et, de nos jours, pour la vie sur la planète.
Aujourd'hui, la tendance à la détérioration définitive et irréversible du monde naturel est réellement alarmante, comme le démontrent le manifestations répétées et terribles du réchauffement climatique, du saccage de la planète, la déforestation, l’érosion des sols, la destruction des espèces, la pollution des nappes phréatiques, des mers et de l’air et les catastrophes nucléaires. Ces dernières constituent l’exemple par excellence du danger latent de dévastation résultant du potentiel que le capitalisme a mis au service de sa logique folle, le transformant en une épée de Damoclès qui menace l’humanité.
Et bien que la bourgeoisie tente d'attribuer la destruction de l'environnement à la mesquinerie d’individus "sans conscience écologique" – créant ainsi une atmosphère de culpabilité et d’angoisse –, la vérité mise en évidence par ses efforts hypocrites et vains pour "résoudre" le problème, c’est qu'il ne s'agit pas d'un problème d'individus, ni même d'entreprises ou de nations, mais de la logique même de dévastation propre à un système qui, au nom de l'accumulation, du profit comme principe et but, n'a aucun scrupule à saper peut-être pour toujours les prémisses matérielles de l'échange métabolique entre la vie et la Terre, du moment qu'il peut en tirer un bénéfice immédiat.
C'est là le résultat inévitable de la contradiction entre les puissances productives – humaines et naturelles – que le capitalisme a développées, et qui se trouvent aujourd'hui contraintes et sur le point d'exploser de façon atroce, et les rapports de production antagoniques basés sur la division en classes et la compétition capitaliste. C'est là aussi le tableau mondial dramatique dont la transformation par le prolétariat doit stimuler ce dernier dans ses efforts révolutionnaires parce que seule la destruction du capitalisme peut permettre à la vie de fleurir à nouveau.
La crise économique
9) Fondamentalement, cette impuissance de la classe régnante face au phénomène de la destruction de l'environnement, dont pourtant elle a de plus en plus conscience de la menace qu'elle fait peser sur l'ensemble de l'humanité, trouve ses sources dans son incapacité à surmonter les contradictions économiques qui assaillent le mode de production capitaliste. C'est bien l'aggravation irréversible de la crise économique qui constitue la cause fondamentale de la barbarie qui s'étend de plus en plus dans la société. Pour le mode de production capitaliste, la situation est sans issue. Ce sont ses propres lois qui l'ont conduit dans l'impasse où il se trouve et il ne pourrait sortir de cette impasse qu'en abolissant ces lois, c'est-à-dire en s'abolissant lui-même. Concrètement, le capitalisme, depuis ses débuts, a eu comme moteur essentiel de son développement la conquête permanente de nouveaux marchés à l'extérieur de sa propre sphère. Les crises commerciales qu'il a connues dès le début du 19e siècle, et qui exprimaient le fait que les marchandises produites par un capitalisme en plein développement n'arrivaient pas à trouver suffisamment d'acheteurs pour s'écouler, étaient surmontées par une destruction du capital excédentaire mais aussi et surtout par la conquête de nouveaux marchés, principalement dans les zones de la planète qui n'étaient pas encore développées d'un point de vue capitaliste. C'est pour cela que ce siècle est celui des conquêtes coloniales : pour chaque puissance capitaliste développée, il était primordial de se constituer des zones où puiser des matières premières à bas prix mais aussi et surtout où écouler les marchandises produites. La Première Guerre mondiale a justement comme cause fondamentale le fait que le partage du monde étant achevé entre puissances capitalistes, toute conquête d'une nouvelle zone de domination par telle ou telle puissance passait désormais par l'affrontement avec les autres pays coloniaux. Cela ne voulait pas dire cependant qu'il n'existait plus de marchés extra-capitalistes capables d'absorber le trop plein de marchandises produites par le capitalisme. Comme l'écrivait Rosa Luxemburg à la veille de la Première Guerre mondiale : "Plus s'accroît la violence avec laquelle à l'intérieur et à l'extérieur le capital anéantit les couches non capitalistes et avilit les conditions d'existence de toutes les classes laborieuses, plus l'histoire quotidienne de l'accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions, qui, se joignant aux crises économiques périodiques finiront par rendre impossible la continuation de l'accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital avant même que celui-ci n'ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement." (L’accumulation du capital) La Première Guerre mondiale fut justement la plus terrible à cette époque "des catastrophes et des convulsions" connues par le capitalisme "avant même que celui-ci n'ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement". Et dix ans après la boucherie impérialiste, la grande crise des années 1930 en fut la seconde, une crise qui allait déboucher sur un nouveau massacre impérialiste généralisé. Mais la période de "prospérité" qu'a connue le monde dans le second après-guerre, une prospérité pilotée par les mécanismes que s'était donnés le bloc occidental avant-même la fin de la guerre (notamment avec les accords de Bretton Woods en 1944), et qui s'appuyaient sur une intervention systématique de l'État dans l'économie, a fait la preuve que ces "limites objectives" n'étaient pas encore atteintes. La crise ouverte à la fin des années 1960 a démontré que le système s'était rapproché considérablement de ces limites, notamment avec la fin de la décolonisation qui, paradoxalement, avait permis l'ouverture momentanée de nouveaux marchés. Désormais, l'étroitesse croissante des marchés extra-capitalistes a contraint le capitalisme, menacé de plus en plus par une surproduction généralisée, de faire appel de façon croissante au crédit, véritable fuite en avant car, à mesure que s'accumulaient les dettes, plus la possibilité qu'elles soient un jour remboursées s'amenuisait.
10) La montée en puissance de la sphère financière de l'économie, au détriment de la sphère proprement productive, et qui est aujourd'hui stigmatisée par les politiciens et journalistes de tous bords comme responsable de la crise, n'est donc nullement le résultat du triomphe d'une pensée économique sur une autre pensée économique ("monétaristes" contre "keynésiens", ou "libéraux" contre "interventionnistes"). Elle découle fondamentalement de ce fait que la fuite en avant dans le crédit a donné un poids toujours croissant à ces organismes dont la fonction est de distribuer ces crédits, les banques. En ce sens, la "crise de la finance" n'est pas à l'origine de la crise économique et de la récession. Bien au contraire. C'est la surproduction qui se trouve à la source de la "financiarisation" et c'est le fait qu'il soit de plus en plus hasardeux d'investir dans la production, face à un marché mondial de plus en plus saturé, qui oriente de façon croissante les flux financiers vers la simple spéculation. C'est pourquoi toutes les théories économiques "de gauche" qui préconisent une "mise au pas de la finance internationale" pour "sortir de la crise" sont des songes creux puisqu'elles "oublient" les causes véritables de cette hypertrophie de la sphère financière.
11) La crise des "subprimes" de 2007, la grande panique financière de 2008 et la récession de 2009 ont marqué le franchissement d'une nouvelle étape très importante et significative de l'enfoncement du capitalisme dans sa crise irréversible. Pendant 4 décennies, le capitalisme a usé et abusé du crédit afin de contrecarrer la tendance croissante à la surproduction qui s’est exprimée notamment par une succession de récessions de plus en plus profondes et dévastatrices suivies de "reprises" de plus en plus timides. Il en a résulté que, au-delà des variations des taux de croissance d’une année à l’autre, la croissance moyenne de l’économie mondiale n’a cessé de décliner de décennie en décennie en même temps qu’on assistait à une augmentation parallèle du chômage. La récession de 2009 a été la plus importante connue par le capitalisme depuis la grande dépression des années 1930 faisant monter, dans beaucoup de pays, le taux de chômage à des niveaux jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est seulement une intervention massive du FMI et des États, décidée lors du sommet du G20 de mars 2009, qui a pu sauver les banques d’une banqueroute généralisée du fait de l’accumulation de leurs "actifs toxiques", c’est-à-dire de créances qui ne pouvaient plus être remboursées. Ce faisant, la "crise de la dette", comme la dénomment les commentateurs bourgeois, est passée à un stade supérieur : ce ne sont plus seulement les particuliers (comme c’est arrivé aux États-Unis en 2007 avec la crise immobilière), ni les entreprises ou les banques, qui sont incapables de rembourser leurs dettes, ou même de payer les intérêts de celles-ci. Ce sont maintenant les États qui sont confrontés au poids de plus en plus écrasant de leur endettement, la "dette souveraine", ce qui affecte encore plus leur capacité à intervenir pour relancer leurs économies nationales respectives à travers les déficits budgétaires.
12) C’est dans ce contexte que s’est déclaré et développé, depuis l’été 2011, ce qui est désormais connu sous le nom de "crise de l’Euro". Au même titre que celle de l’État japonais ou de l’État américain, la dette des États européens a connu depuis 2009 une augmentation spectaculaire, et particulièrement dans les pays de la zone Euro où l’économie était la plus fragile ou la plus dépendante des palliatifs illusoires mis en œuvre dans la période précédente, les PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne). Dans les pays qui ont leur propre monnaie, comme les États-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, l’endettement de l’État peut être en partie compensé par la création monétaire. C’est ainsi que la FED américaine a racheté de grosses quantités de Bons du Trésor de l’État américain, c’est-à-dire des reconnaissances de dette de celui-ci, afin de les transformer en billets verts. Mais une telle possibilité n’existe pas individuellement pour les pays qui ont abandonné leur monnaie nationale au bénéfice de l’Euro. Privés de cette possibilité de "monétisation de la dette", les pays de la zone Euro n’ont d’autre recours que de faire de nouveaux emprunts pour combler le trou béant de leurs finances publiques. Et si les pays du nord de l’Europe sont encore capables de lever des fonds auprès des banques privées à des taux raisonnables, une telle possibilité est interdite aux PIIGS dont les emprunts sont soumis à des taux d’intérêt exorbitants du fait de leur insolvabilité flagrante, ce qui les oblige à faire appel à une succession de "plans de sauvetage" mis en œuvre par la Banque centrale européenne et le FMI assortis de l’obligation de restrictions drastiques des déficits publics. Ces restrictions ont pour conséquence des attaques dramatiques contre les conditions de vie de la classe ouvrière sans permettre, pour autant, une réelle capacité de ces États de limiter leurs déficits puisque la récession qu’elles provoquent a pour conséquence de réduire les ressources prélevées par l’impôt. Ainsi, les remèdes de cheval proposés pour "soigner les malades" menacent, de plus en plus, de les tuer. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle la Commission européenne a décidé tout récemment d’assouplir ses exigences de réduction des déficits publics pour un certain nombre de pays comme l’Espagne ou la France. Ainsi, on peut constater une nouvelle fois l’impasse dans laquelle s’enferme de plus en plus le capitalisme : l’endettement a constitué un moyen de suppléer à l’insuffisance des marchés solvables mais celui-ci ne peut s’accroitre indéfiniment, ce qu’a mis en évidence la crise financière à partir de 2007. Cependant, toutes les mesures qui peuvent être prises pour limiter l’endettement placent à nouveau le capitalisme devant sa crise de surproduction, et cela dans un contexte économique international chaque jour toujours plus dégradé qui limite de plus en plus sa marge de manœuvre.
13) Le cas des pays "émergents", notamment les "BRIC" (Brésil, Russie, Inde, Chine) dont les taux de croissance se maintiennent bien au-dessus de ceux des États-Unis, du Japon ou de l’Europe occidentale, ne saurait constituer un démenti du caractère insoluble des contradictions du système capitaliste. En réalité, le "succès" de ces pays (dont il faut souligner les différences puisqu’un pays comme la Russie se singularise par la prépondérance des exportations de matières premières, particulièrement les hydrocarbures) a été en partie la conséquence de la crise de surproduction générale de l’économie capitaliste qui, en exacerbant la concurrence entre les entreprises et en les obligeant à réduire de façon drastique le coût de la force de travail a conduit à la "délocalisation" de pans considérables de l’appareil productif des vieux pays industriels (automobile, textiles et habillement, électronique, etc.) vers des régions où les salaires ouvriers sont incomparablement plus bas que dans ces pays. Cette nouvelle donne dans l’exploitation de la force de travail a été grandement favorisée par l’effondrement des régimes staliniens, à la fin des années 1980, qui a porté un coup décisif à un modèle de développement fortement autarcique des pays arriérés. La fin de ce modèle a également permis l’accès à des marchés extra capitalistes résiduels auparavant hors de portée du fait de cette autarcie ce qui a permis un léger répit pour l’économie mondiale dont un pays comme l’Allemagne a pu bénéficier pour ses exportations. Cela-dit, l’étroite dépendance de l’économie des pays émergents vis-à-vis des exportations vers les pays les plus développés provoquera, tôt ou tard, de forts soubresauts dans ces économies lorsque les achats de ces derniers seront affectés par des récessions de plus en plus profondes, ce qui ne manquera pas d’arriver.
14) Ainsi, comme nous le disions il y a 4 ans, "même si le système capitaliste ne va pas s’effondrer comme un château de cartes… sa perspective est celle d’un enfoncement croissant dans son impasse historique, celle du retour à une échelle toujours plus vaste des convulsions qui l’affectent aujourd’hui. Depuis plus de quatre décennies, la bourgeoisie n'a pas pu empêcher l’aggravation continue de la crise. Elle part aujourd'hui d'une situation bien plus dégradée que celle des années 60. Malgré toute l’expérience qu’elle a acquise au cours de ces décennies, elle ne pourra pas faire mieux mais pire encore." (Résolution sur la situation internationale du 18e Congrès, point 4) Cela ne veut pas dire cependant que nous allons revenir à une situation similaire à celle de 1929 et des années 1930. Il y a 70 ans, la bourgeoisie mondiale avait été prise complètement au dépourvu face à l’effondrement de son économie et les politiques qu’elle avait mises en œuvre, notamment le repliement sur soi de chaque pays, n’avaient réussi qu’à exacerber les conséquences de la crise. L’évolution de la situation économique depuis les 4 dernières décennies a fait la preuve que, même si elle était évidemment incapable d’empêcher le capitalisme de s’enfoncer toujours plus dans la crise, la classe dominante avait la capacité de ralentir le rythme de cet enfoncement et de s’éviter une situation de panique généralisée comme ce fut le cas à partir du "jeudi noir" 24 octobre 1929. Il existe une autre raison pour laquelle nous n’allons pas revivre une situation similaire à celle des années 1930. A cette époque, l’onde de choc de la crise, partie de la première puissance économique du monde, les États-Unis, s’était propagée principalement vers la seconde puissance mondiale, l’Allemagne. C’est dans ces deux pays qu’on avait vu les conséquences les plus dramatiques de la crise, comme ce chômage de masse touchant plus de 30% de la population active, ces queues interminables devant les bureaux d’embauche ou les soupes populaires, alors que des pays comme la Grande-Bretagne ou la France étaient plus épargnés. A l’heure actuelle, c’est une situation quelque peu comparable qui se développe dans les pays du Sud de l’Europe (notamment en Grèce) sans atteindre encore cependant le degré de misère ouvrière des États-Unis ou de l’Allemagne des années 1930. En même temps, les pays les plus développés de l’Europe du Nord, les États-Unis ou le Japon sont encore très loin d’une telle situation et il est plus qu’improbable qu’ils y parviennent un jour, d’une part, du fait de la plus grande résistance de leur économie nationale face à la crise, d’autre part, et surtout, du fait qu’aujourd’hui le prolétariat de ces pays, et particulièrement ceux d’Europe, n’est pas prêt à accepter un tel niveau d’attaques contre ses conditions d’existence. Ainsi, une des composantes majeures de l’évolution de la crise échappe au strict déterminisme économique et débouche sur le plan social, sur le rapport de forces entre les deux principales classes de la société, bourgeoisie et prolétariat.
Lutte de classe
15) Alors que la classe dominante voudrait nous faire passer ses abcès purulents pour des grains de beauté, l'humanité commence à se réveiller d'un rêve devenu cauchemar et qui montre la faillite historique totale de sa société. Mais alors que l'intuition de la nécessité d'un ordre de choses différent gagne du terrain face à la brutale réalité d'un monde en décomposition, cette conscience vague ne signifie pas que le prolétariat est convaincu de la nécessité d'abolir ce monde, encore moins de celle de développer la perspective d’en construire un nouveau. Ainsi, l'aggravation inédite de la crise capitaliste dans le contexte de la décomposition est le cadre dans lequel s’exprime la lutte de classes actuellement, bien que d'une manière encore incertaine dans la mesure où cette lutte ne se développe pas sous la forme de confrontations ouvertes entre les deux classes. A ce sujet, nous devons souligner le cadre inédit des luttes actuelles puisqu’elles ont lieu dans le contexte d’une crise qui dure depuis presque 40 ans et dont les effets graduels dans le temps – en dehors des moments de convulsion –ont "habitué" le prolétariat à voir ses conditions de vie se dégrader lentement, pernicieusement, ce qui rend plus difficile de percevoir la gravité des attaques et de répondre en conséquence. Plus encore, c'est une crise dont le rythme rend difficile la compréhension de ce qui se trouve derrière de telles attaques rendues "naturelles" de par leur lenteur et leur échelonnement. C’est là un cadre très différent de celui de convulsions et de bouleversements évidents, immédiats, de l’ensemble de la vie sociale que l'on connaît dans une situation de guerre. Ainsi, il y a des différences entre le développement de la lutte de classe – au niveau des ripostes possibles, de leur ampleur, de leur profondeur, de leur extension et de leur contenu – dans un contexte de guerre qui rend le besoin de lutter dramatiquement urgent et vital (comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale au début du xxe siècle même s'il n'y eut pas immédiatement de réponse à la guerre) et dans un contexte de crise ayant un rythme lent.
Ainsi, le point de départ des luttes d'aujourd'hui est précisément l’absence d'identité de classe d’un prolétariat qui, depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition, a connu de grandes difficultés non seulement pour développer sa perspective historique mais même pour se reconnaître comme une classe sociale. La prétendue "mort du communisme" qu'aurait sonné la chute du bloc de l'Est en 1989, déchaînant une campagne idéologique qui avait pour but de nier l'existence même du prolétariat, a porté un coup très dur à la conscience et à la combativité de la classe ouvrière. La violence de l’attaque de cette campagne a pesé sur le cours de ses luttes depuis lors. Mais malgré cela, comme nous le constations dès 2003, la tendance vers des affrontements de classe a été confirmée par le développement de divers mouvements dans lesquels la classe ouvrière a "démontré son existence" à une bourgeoisie qui avait voulu "l'enterrer vivante". Ainsi, la classe ouvrière dans le monde entier n'a pas cessé de se battre, même si ses luttes n'ont pas atteint l'ampleur ni la profondeur espérées dans la situation critique où elle est se trouve. Toutefois, penser la lutte de classes en partant de "ce qui devrait être", comme si la situation actuelle "était tombée du ciel", n’est pas permis aux révolutionnaires. Comprendre les difficultés et les potentialités de la lutte de classes a toujours été une tâche exigeant une démarche matérialiste et historique patiente afin de trouver un "sens" au chaos apparent, de comprendre ce qui est nouveau et difficile, ce qui est prometteur.
16) C’est dans ce contexte de crise, de décomposition et de fragilisation de l'état du prolétariat sur le plan subjectif que prennent leur sens les faiblesses, les insuffisances et les erreurs, tout comme les potentialités et les forces de sa lutte, en nous confirmant dans la conviction que la perspective communiste ne dérive pas de façon automatique ni mécanique de circonstances déterminées. Ainsi, pendant les deux années passées, nous avons assisté au développement de mouvements que nous avons caractérisés par la métaphore des 5 cours :
1. des mouvements sociaux de la jeunesse précaire, au chômage ou encore étudiante, qui commencent avec la lutte contre le CPE en France en 2006, se poursuivent par les révoltes de la jeunesse en Grèce en 2008 et qui culminent dans les mouvements des Indignés et d’Occupy en 2011 ;
2. des mouvements massifs mais très bien encadrés par la bourgeoisie qui avait préparé le terrain à l'avance, comme en France en 2007, en France et en Grande-Bretagne en 2010, en Grèce en 2010-2012, etc. ;
3. des mouvements subissant le poids de l’interclassisme comme en Tunisie et en Égypte en 2011 ;
4. des germes de grèves massives en Égypte en 2007, Vigo (Espagne) en 2006, Chine en 2009 ;
5. la poursuite de mouvements dans des usines ou des secteurs industriels localisés mais contenant des germes prometteurs comme Lindsay en 2009, Tekel en 2010, les électriciens en Grande-Bretagne en 2011.
Ces 5 cours appartiennent à la classe ouvrière parce que malgré leurs différences, ils expriment chacun à son niveau l'effort du prolétariat pour se retrouver lui-même malgré les difficultés et les obstacles que sème la bourgeoisie ; chacun à son niveau a porté une dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social. A différents niveaux, ils s'inscrivent dans la recherche "du mot qui nous emmènera jusqu’au socialisme" (comme l'écrit Rosa Luxemburg en parlant des conseils ouvriers) au moyen des assemblées générales. Les expressions les plus avancées de cette tendance ont été les mouvements des Indignés et d’Occupy – principalement en Espagne – parce que ce sont ceux qui ont le plus clairement posé les tensions, les contradictions et les potentialités de la lutte de classes aujourd'hui. Malgré la présence de couches en provenance de la petite bourgeoisie appauvrie, l’empreinte prolétarienne de ces mouvements s’est manifestée par la recherche de la solidarité, les assemblées, l’ébauche d’une culture du débat, la capacité d’éviter les pièges de la répression, les germes d’internationalisme, une sensibilité aigue à l’égard des éléments subjectifs et culturels. Et c’est à travers cette dimension, celle de la préparation du terrain subjectif, que ces mouvements montrent toute leur importance pour le futur.
17) La bourgeoisie, pour sa part, a montré des signes d'inquiétude face à cette "résurrection" de son fossoyeur mondial réagissant aux horreurs qui lui sont imposées au quotidien pour maintenir en vie le système. Le capitalisme a donc amplifié son offensive en renforçant son encadrement syndical, en semant des illusions démocratiques et en allumant les feux d'artifice du nationalisme. Ce n’est pas un hasard si sa contre-offensive s'est centrée sur ces questions : l’aggravation de la crise et ses effets sur les conditions de vie du prolétariat provoquent une résistance que les syndicats tentent d’encadrer par des actions qui fragmentent l’unité des luttes et prolongent la perte de confiance du prolétariat dans ses propres forces.
Comme le développement de la lutte de classe auquel nous assistons aujourd’hui se réalise dans un cadre de crise ouverte du capitalisme depuis près de 40 ans – ce qui est dans une certaine mesure une situation sans précédent par rapport aux expériences passées du mouvement ouvrier , la bourgeoisie tente d’empêcher le prolétariat de prendre conscience du caractère mondial et historique de la crise en en cachant la nature. Ainsi, l'idée de solutions "nationales" et la montée des discours nationalistes empêchent la compréhension du véritable caractère de la crise, indispensable pour que la lutte du prolétariat prenne une direction radicale.. Puisque le prolétariat ne se reconnaît pas lui-même comme classe, sa résistance tend à démarrer comme une expression générale d'indignation contre ce qui a lieu dans l'ensemble de la société. Cette absence d’identité de classe et donc de perspective de classe permet à la bourgeoisie de développer des mystifications sur la "citoyenneté" et les luttes pour une "vraie démocratie". Et il y a d’autres sources à cette perte d’identité de classe qui prennent racine dans la structure même de la société capitaliste et dans la forme que prend actuellement l’aggravation de la crise. La décomposition, qui entraîne une aggravation brutale des conditions minimales de survie humaine, s’accompagne d’une insidieuse dévastation du terrain personnel, mental et social. Cela se traduit par une "crise de confiance" de l'humanité.. De plus, l’aggravation de la crise, à travers l'extension du chômage et de la précarité, vient affaiblir la socialisation de la jeunesse et faciliter la fuite vers un monde d’abstraction et d'atomisation
18) Ainsi, les mouvements de ces deux dernières années, et en particulier les "mouvements sociaux", sont marqués par de multiples contradictions. En particulier, la rareté des revendications spécifiques ne correspond apparemment pas à la trajectoire "classique" qui va du particulier au général que nous attendions de la lutte de classe. Mais nous devons aussi prendre en compte les aspects positifs de cette démarche générale qui dérive du fait que les effets de la décomposition se ressentent sur un plan général et à partir de la nature universelle des attaques économiques menées par la classe dirigeante. Aujourd’hui, le chemin qu’a pris le prolétariat a son point de départ dans "le général", ce qui tend à poser la question de la politisation d'une façon bien plus directe. Confrontée à l’évidente faillite du système et aux effets délétères de sa décomposition, la masse exploitée se révolte et ne pourra aller de l’avant que quand elle comprendra ces problèmes comme des produits de la décadence du système et de la nécessité de le dépasser. C’est à ce niveau que prennent toute leur importance les méthodes de lutte proprement prolétariennes que nous voyons (assemblées générales, débats fraternels et ouverts, solidarité, développement d'une perspective de plus en plus politique) car ce sont ces méthodes qui permettent de mener une réflexion critique et d'arriver à la conclusion que le prolétariat peut non seulement détruire le capitalisme mais construire un monde nouveau. Un moment déterminant de ce processus sera l’entrée en lutte des lieux de travail et leur conjonction avec les mobilisations plus générales, une perspective qui commence à se développer malgré les difficultés que nous devrons affronter dans les années qui viennent. C’est là le contenu de la perspective de la convergence des "cinq cours" dont nous parlions plus haut en cet "océan de phénomènes", comme Rosa Luxemburg décrit la grève de masse.
19) Pour comprendre cette perspective de convergence, le rapport entre l’identité de classe et la conscience de classe est d’une importance capitale et une question se pose : la conscience peut-elle se développer sans identité de classe ou cette dernière surgira-t-elle du développement de la conscience ? Le développement de la conscience et d'une perspective historique est à juste raison associé à la récupération de l'identité de classe mais nous ne pouvons pas envisager ce processus se développant petit à petit selon une séquence rigide : d'abord forger son identité, ensuite lutter, ensuite développer sa conscience et développer une perspective, ou n'importe quel autre ordonnancement de ces éléments. La classe ouvrière n’apparait pas aujourd’hui comme un pôle d'opposition de plus en plus massif ; aussi le développement d’une posture critique par un prolétariat qui ne se reconnaît pas encore lui-même est le plus probable. La situation est complexe, mais il y a plus de chances que nous voyions une réponse en forme de questionnement général, potentiellement positif en termes politiques, partant non d’une identité de classe distincte et tranchante mais à partir de mouvements tendant à trouver leur perspective propre au travers de leur propre lutte. Comme nous le disions en 2009, "Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives." (Résolution sur la situation internationale, point 11, 18e Congrès du CCI). La formulation "développer ses luttes pour retrouver confiance en soi et en sa perspective" est tout à fait adéquate car elle veut dire reconnaître un "soi" et une perspective, mais le développement de ces éléments ne peut dériver que des luttes elles-mêmes. Le prolétariat ne "crée" pas sa conscience, mais "prend" conscience de ce qu’il est réellement.
Dans ce processus, le débat est la clef pour critiquer les insuffisances des points de vue partiels, pour démonter les pièges, rejeter la chasse à des boucs-émissaires, comprendre la nature de la crise, etc. A ce niveau, les tendances au débat ouvert et fraternel de ces dernières années sont très prometteuses pour ce processus de politisation que la classe devra faire avancer. Transformer le monde en nous transformant nous-mêmes commence à prendre corps dans l’évolution des initiatives de débats et dans le développement de préoccupations qui se basent sur la critique des puissantes chaînes qui paralysent le prolétariat. Le processus de politisation et de radicalisation a besoin du débat pour critiquer l’ordre actuel et apporter une explication historique aux problèmes. A ce niveau reste valable que "La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d'être partie prenante de la réflexion qui se mène d'ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu'elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat." (Résolution sur la situation internationale du 17e Congrès du CCI, 2007). Nous devons être fermement convaincus que la responsabilité des révolutionnaires dans la phase qui s’ouvre est de contribuer, catalyser le développement naissant de la conscience qui s’exprime dans les doutes et les critiques qui commencent déjà à se poser dans le prolétariat. Poursuivre et approfondir l'effort théorique doit être le centre de notre contribution, non seulement contre les effets de la décomposition mais aussi comme moyen de fertiliser patiemment le champ social, comme antidote à l’immédiatisme dans nos activités, car sans la radicalité et l'approfondissement de la théorie par les minorités, la théorie ne pourra jamais s’emparer des masses.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Rubrique:
Mouvements sociaux en Turquie et au Brésil: l’indignation au cœur de la dynamique prolétarienne
- 1382 lectures
Partout dans le monde, grandit le sentiment que l'ordre actuel des choses ne peut plus continuer comme avant. Suite aux révoltes du "Printemps arabe", au mouvement des Indignados en Espagne et celui des Occupy aux États-Unis, en 2011, l'été 2013 a vu des foules énormes descendre dans la rue quasi-simultanément en Turquie et au Brésil.
Des centaines de milliers de personnes, voire des millions, ont protesté contre toutes sortes de maux : en Turquie, c'était la destruction de l'environnement par un "développement" urbain insensé, l'intrusion autoritaire de la religion dans la vie privée et la corruption des politiciens ; au Brésil, c'était l'augmentation des tarifs des transports en commun, le détournement de la richesse vers des dépenses sportives de prestige alors que la santé, les transports, l'éducation et le logement périclitent – et encore une fois, la corruption généralisée des politiciens. Dans les deux cas, les premières manifestations se sont heurtées à une répression policière brutale qui n'a fait qu'élargir et approfondir la révolte. Et dans les deux cas, le fer de lance du mouvement n'était pas les "classes moyennes" (c'est-à-dire, en langage médiatique, n'importe quelle personne qui possède encore un emploi), mais la nouvelle génération de la classe ouvrière qui, bien qu'éduquée, n'a qu'une maigre perspective de trouver un emploi stable et pour qui vivre au sein d'une économie "émergente" signifie surtout observer le développement de l'inégalité sociale et la richesse répugnante d'une minuscule élite d'exploiteurs.
C’est pourquoi, aujourd’hui, un "spectre hante le monde", celui de l’INDIGNATION. Deux ans après le "Printemps arabe", qui a ébranlé par surprise les bases de différents pays d’Afrique du Nord et le mouvement des Indignés en Espagne et des Occupy aux États-Unis, se déroulaient quasiment en même temps les mouvements qui ont secoué la Turquie et la vague de manifestations au Brésil, cette dernière parvenant à mobiliser des millions de personnes dans plus de cent villes, avec des caractéristiques inédites pour ce pays.
Ces mouvements, qui se sont produits dans des pays très différents et très éloignés géographiquement, partagent pourtant des caractéristiques communes : leur spontanéité, une répression brutale de l’État, leur massivité, une participation majoritaire de jeunes, notamment à travers les réseaux sociaux. Mais le dénominateur commun qui les caractérise est une grande INDIGNATION face à la détérioration des conditions de vie liée à celle de la population mondiale, provoquée par la profondeur d’une crise qui ébranle les fondements du système capitaliste et a connu une accélération importante depuis 2007. Cette détérioration s’exprime par une précarisation accélérée du niveau de vie des masses ouvrières et une grande incertitude envers l’avenir parmi la jeunesse prolétarisée ou en voie de prolétarisation. Ce n’est pas par hasard si le mouvement en Espagne a pris le nom "d’Indignados", et que dans cette vague de mouvements sociaux massifs, il est celui qui est allé le plus loin à la fois dans la remise en cause du système capitaliste et dans ses formes d’organisation à travers des assemblées générales massives [1] [403].
Les révoltes en Turquie et au Brésil de 2013 apportent la preuve que la dynamique créée par ces mouvements ne s’est pas épuisée. Bien que les médias éludent le fait que ces rébellions ont surgi dans des pays qui étaient dans une phase de "croissance" ces dernières années, ils n'ont pu éviter de répercuter la même "indignation" des masses de la population contre la façon dont ce système opère : l'inégalité sociale grandissante, l’avidité et la corruption de la classe dominante, la brutalité de la répression étatique, la faillite des infrastructures, la destruction de l’environnement. Et surtout, l’incapacité du système à offrir un futur à la jeune génération.
Il y a cent ans, face à la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg rappelait solennellement à la classe ouvrière que le choix offert par un ordre capitaliste sur le déclin était entre le socialisme ou la barbarie. L'incapacité de la classe ouvrière de mener à bien les révolutions qui ont répondu à la guerre de 1914-18 a eu comme conséquence un siècle de véritable barbarie capitaliste. Aujourd'hui, les enjeux sont plus élevés encore, parce que le capitalisme s'est donné les moyens de détruire toute vie sur la terre entière. La révolte des exploités et des opprimés, la lutte massive pour défendre la dignité humaine et un véritable avenir, c'est ça la promesse des révoltes sociales en Turquie et au Brésil.
Un aspect particulièrement significatif de la révolte en Turquie est sa proximité avec la guerre meurtrière en Syrie. La guerre en Syrie fut aussi initiée par des manifestations populaires contre le régime en place, mais la faiblesse du prolétariat dans ce pays, l’existence de profondes divisions ethniques et religieuses au sein de la population, permirent au régime d'y répondre avec la plus brutale des violences. Les fissures au sein de la bourgeoisie se sont élargies et la révolte populaire – comme en Libye en 2011 – a sombré dans une guerre "civile" qui est devenue une guerre par procuration entre puissances impérialistes. La Syrie s’est transformée aujourd’hui en cas d’école de la barbarie, un rappel effrayant de l’alternative que le capitalisme a en magasin pour toute l’humanité. Dans des pays comme la Tunisie et surtout l’Égypte, où pourtant les mouvement sociaux avaient montré un poids réel de la classe ouvrière, ceux-ci n’ont pas su résister à la pression de l’idéologie dominante et la situation est en train de dégénérer en tragédie dont la population et, en tout premier lieu les prolétaires, sont en train de devenir les victimes à travers les règlements de compte et les affrontements entre religieux intégristes, partisans de l’ancien régime et autres fractions rivales de la bourgeoisie qui ont fait ces derniers temps basculer la situation nationale dans un chaos sanglant. De l’autre côté, la Turquie, le Brésil comme les autres révoltes sociales, continuent à montrer le chemin qui s’est ouvert à l’humanité : la voie vers le refus du capitalisme, vers la révolution prolétarienne et la construction d’une nouvelle société basée sur la solidarité et les besoins humains.
La nature prolétarienne des mouvements
En Turquie
Le mouvement de mai/juin a commencé contre l’abattage des arbres effectué en vue de détruire le parc Gezi de la place Taksim à Istanbul, et il a pris une ampleur inconnue dans l'histoire du pays jusqu'à ce jour. Beaucoup de secteurs de la population mécontente de la politique récente du gouvernement y ont participé, mais ce qui a précipité les masses dans les rues a été la terreur d’État et cette même terreur a provoqué un profond émoi dans une grande partie de la classe ouvrière. Le mouvement en Turquie non seulement fait partie de la même dynamique que les révoltes du Moyen-Orient de 2011, les plus importantes d'entre elles (Tunisie, Égypte, Israël) ayant fortement été marquées par la classe ouvrière, mais il se situe surtout en continuité directe du mouvement des Indignés en Espagne et Occupy aux États-Unis, là où la classe ouvrière représentait non seulement la majorité de la population dans son ensemble mais aussi des participants au mouvement. Il en est de même de la révolte actuelle au Brésil, où l’immense majorité des composantes appartient à la classe ouvrière, et particulièrement la jeunesse prolétarienne.
Le secteur qui a participé le plus largement au mouvement en Turquie était celui nommé "la génération des années 1990". L'apolitisme était l'étiquette apposée sur les membres de cette génération, dont beaucoup ne pouvaient se souvenir de l’époque précédent le gouvernement AKP [2] [404]. Les membres de cette génération, dont on disait qu’ils n’étaient pas préoccupée par la situation sociale et ne cherchaient qu’à se sauver eux-mêmes, ont compris qu’il n’y avait pas de salut en restant seuls. Ils en avaient assez des discours du gouvernement lui disant ce qu’ils devait être et comment ils devaient vivre. Les étudiants, et particulièrement les lycéens, ont participé aux manifestations de façon massive. Les jeunes ouvriers et les jeunes chômeurs étaient largement présents dans le mouvement. Les ouvriers et les chômeurs éduqués étaient également présents.
Une partie du secteur du prolétariat ayant un travail a aussi participé au mouvement et a constitué le corps principal de la tendance prolétarienne en son sein. La grève de Turkish Airlines à Istanbul a essayé de rejoindre la lutte de Gezi. Particulièrement dans le secteur du textile, on a vu s'exprimer des voix en ce sens. Une de ces manifestations s’est tenue à Bagcilar-Gunesli, à Istanbul, où des ouvriers du textile, soumis à de dures conditions d’exploitation, ont voulu exprimer leurs revendications de classe en même temps qu'ils déclaraient leur solidarité avec la lutte du parc Gezi. Ils ont manifesté avec des banderoles "Salut de Bagcilar à Gezi !" et "Le samedi doit être jour de congé !". À Istanbul, des banderoles "Grève générale, résistance générale" appelaient d’autres ouvriers à les rejoindre lors d’une marche rassemblant des milliers d’entre eux dans Alibeykov ; ou encore "Pas au travail, à la lutte !" comme arboraient les salariés des centres commerciaux et des bureaux qui se rassemblaient sur la place Taksim. De plus, le mouvement a créé une volonté de lutte parmi les travailleurs syndiqués. Sans aucun doute, le KESK, le DISK et les autres organisations syndicales qui ont appelé à la grève ont dû prendre ces décisions non seulement à cause des réseaux sociaux mais sous la pression venant de leurs propres membres. Enfin, la Plateforme des différentes branches du Turk-Is [3] [405] d’Istanbul, émanation de toutes les sections syndicales de Turk-Is à Istanbul, a appelé cette organisation et tous les autres syndicats à déclarer une grève générale contre la terreur étatique dès le lundi après l’attaque contre le parc Gezi. Si ces appels ont été lancés, c'est parce qu’il y avait une profonde indignation parmi la base ouvrière face à ce qui passait.
Au Brésil
Les mouvements sociaux de juin dernier revêtent une signification très importante à la fois pour le prolétariat brésilien, d’Amérique latine et celui du reste du monde, brisant le cadre régionaliste traditionnel. Ces mouvements massifs se distinguent radicalement des "mouvements sociaux" sous le contrôle de l’État qui se sont déroulés dans différents pays de la région ces dernières décennies, comme celui de l’Argentine au début du siècle, des mouvements indigénistes en Bolivie et Équateur, du mouvement zapatiste au Mexique ou du chavisme au Venezuela, résultat de confrontations entre fractions bourgeoises et petites bourgeoises entre elles, se disputant le contrôle de l’État. En ce sens, les mobilisations de juin au Brésil représentent la plus importante mobilisation spontanée de masse dans ce pays et en Amérique latine de ces 30 dernières années. C'est pour cela qu'il est fondamental de tirer les leçons de ces événements d’un point de vue de classe.
Il est indéniable que ce mouvement a surpris la bourgeoisie brésilienne et mondiale. La lutte contre la hausse du prix des transports publics (qui font chaque année l’objet d’un accord entre les patrons d’entreprises de transport et l’État) n'a été qu'un détonateur au mouvement. Celui-ci a cristallisé toute l'indignation qui a fait son nid depuis quelque temps dans la société brésilienne et qui s’est manifestée notamment en 2012 avec les luttes dans la fonction publique et dans les universités, principalement à São Paulo, avec également de nombreuses grèves dans le pays contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l’éducation et de la santé au cours de ces dernières années.
À la différence des mouvements sociaux massifs qui se sont succédés dans différents pays depuis 2011, celui du Brésil a été engendré et s’est unifié autour d’une revendication concrète qui a permis la mobilisation spontanée de larges secteurs du prolétariat : contre la hausse de tarif des transports publics. Le mouvement a pris un caractère massif au niveau national depuis le 13 juin, quand les manifestations de protestation contre la hausse appelées par le MPL (Movimento Passe Livre ; mouvement pour le libre accès aux transports) [4] [406], ainsi que par d’autres mouvements sociaux, ont été violemment réprimées par la police à São Paulo [5] [407]. Pendant cinq semaines, outre de grandes mobilisations à São Paulo, se sont déroulées différentes manifestations autour de la même revendication dans différentes villes du pays, à tel point que, par exemple, à Porto Alegre, Goiânia et d’autres villes, cette pression a contraint plusieurs gouvernements locaux, quelle que soit leur couleur politique, à s’entendre pour révoquer la hausse des tarifs de transports, après de dures luttes fortement réprimées par l’État.
Le mouvement s’est d’emblée clairement inscrit sur le terrain prolétarien. En premier lieu, il faut souligner que la majorité des manifestants appartiennent à la classe ouvrière, principalement des jeunes ouvriers et des étudiants, en majorité issus de familles prolétariennes ou en voie de prolétarisation. La presse bourgeoise a présenté le mouvement comme une expression des "classes moyennes", avec la claire intention de créer une division entre les travailleurs. En réalité la majorité de ceux catalogués comme membres de la classe moyenne sont des ouvriers qui reçoivent des salaires souvent moins importants que ceux des ouvriers qualifiés des zones industrielles du pays. Cela explique le succès et les sympathies qu’a éveillés cette mobilisation contre la hausse de prix des tickets de bus urbains, qui représentait une attaque directe contre les revenus des familles prolétariennes. Cela explique aussi pourquoi cette revendication initiale s’est transformée rapidement en une remise en cause dirigée contre l’État à cause du délabrement de secteurs tels que la santé, l’éducation et l’aide sociale et, de plus, en protestation contre les colossales sommes d’argent public investies à l’occasion de l’organisation de la Coupe du monde de football de 2014 et des Jeux olympiques de 2016 [6] [408]. Pour les besoins de ces évènements, la bourgeoisie n'a pas hésité à recourir, par différents moyens, à l’expulsion forcée des habitants proches des stades : à la Aldeia Maracanã à Río au premier semestre de cette année ; dans des zones convoitées par les promoteurs immobiliers de São Paulo en mettant le feu aux favelas gênant leurs projets.
Il est très significatif que le mouvement se soit organisé pour réaliser des manifestations autour des stades des villes où se déroulaient les matches de foot de la Coupe des Confédérations, en vue d'obtenir une forte médiatisation et autour du rejet du spectacle préparé au bénéfice de la bourgeoisie brésilienne ; et aussi autour de la brutale répression de l’État contre les manifestants autour des stades responsable de la mort de plusieurs manifestants. Dans un pays où le football est le sport national que la bourgeoisie a évidemment su utiliser comme un défouloir nécessaire au contrôle sur la société, les manifestations des prolétaires brésiliens constituent une leçon pour le prolétariat mondial. La population brésilienne est réputée pour aimer le football, mais cela ne l'a pas empêchée de refuser l'austérité pour financer les dépenses somptuaires que représente l'organisation des événements sportifs que prépare la bourgeoisie pour montrer au monde entier qu'elle est capable de jouer dans la cour "du premier monde". Pour leur quotidien, les manifestants exigeaient une qualité de services publics du "Type FIFA"[7] [409].
Fait également très significatif, il y a eu un rejet massif des partis politiques (surtout du Parti des Travailleurs, le PT d'où sont est issus Lula et l'actuelle présidente) et des syndicats : à São Paulo, certains manifestants ont été expulsés des cortèges parce qu’ils arboraient des bannières ou des signes d’appartenance à des organisations politiques, syndicales ou étudiantes soutenant le pouvoir.
D’autres expressions du caractère de classe du mouvement se sont manifestées, même si elles ont été minoritaires. Dans le mouvement se sont tenues plusieurs assemblées, bien qu’elles n’aient pas eu la même extension ni atteint le degré d’organisation de celles des Indignés en Espagne. Par exemple, celles de Rio de Janeiro et de Belo Horizonte, qui se sont nommées "assemblées populaires et égalitaires", se proposaient de créer un "nouvel espace spontané, ouvert et égalitaire de débat", où il est arrivé que participent plus de 1000 personnes.
Ces assemblées, bien que démontrant la vitalité du mouvement et la nécessité d’auto-organisation des masses pour imposer leurs revendications, ont présenté plusieurs faiblesses :
- même si plusieurs autres groupes et collectifs ont participé à leur organisation, elles ont été animées par les forces de gauche et gauchistes du capital qui ont principalement enfermé leur activité dans la périphérie des villes ;
- leur objectif principal était d’être des moyens de pression et des organes de négociation avec l’État, pour des revendications particulières d’amélioration propres à telle ou telle communauté ou ville. Elles tendaient par la même occasion à s’affirmer comme des organes permanents ;
- elles prétendaient être indépendantes de l’État et des partis ; mais elles ont bel et bien été noyautées par les partis et les organisations pro-gouvernementales ou gauchistes qui y ont anéanti toute expression spontanée ;
- elles ont mis en avant une vision localiste ou nationale, luttant contre les effets et non contre les causes des problèmes, sans remettre en cause le capitalisme.
Dans le mouvement, il y a eu également plusieurs références explicites aux mouvements sociaux d’autres pays, principalement celui de Turquie, lequel s’est référé aussi à celui du Brésil. Malgré le caractère minoritaire de ces expressions, elles n'en constituent pas moins un révélateur de ce qui est ressenti comme commun aux deux mouvements. Dans différentes manifestations, on a ainsi pu voir déployées des banderoles proclamant : "Nous sommes des Grecs, des Turcs, des Mexicains, nous sommes sans patrie, nous sommes des révolutionnaires" ou des pancartes portant l’inscription : "Ce n’est pas la Turquie, ce n’est pas la Grèce ; c’est le Brésil qui sort de l'inertie."
À Goiânia, le Frente de Luta Contra o Aumento (Front de Lutte Contre l'Augmentation), qui regroupait différentes organisations de base, soulignait la solidarité et le débat nécessaires entre les différentes composantes du mouvement : "Nous ne devons pas contribuer à la criminalisation et à la pacification du mouvement ! NOUS DEVONS RESTER FERMES ET UNIS ! Malgré les désaccords, nous devons maintenir notre solidarité, notre résistance, notre combativité et approfondir notre organisation et nos discussions. Comme en Turquie, pacifiques et combatifs peuvent coexister et lutter ensemble, nous devons suivre cet exemple."
La grande indignation qui a animé le prolétariat brésilien peut se concrétiser dans la réflexion de la Rede Extremo Sul, réseau des mouvements sociaux de la périphérie de São Paulo : "Pour que ces possibilités deviennent réalité, nous ne pouvons pas laisser canaliser sur des objectifs nationalistes, conservateurs et moralistes, l'indignation qui s'exprime dans les rues ; nous ne pouvons pas permettre que les luttes soient capturées par l'État et par les élites en vue de les vider de leur contenu politique. La lutte contre l'augmentation du prix des transports et l'état déplorable de ce service est directement reliée à la lutte contre l'État et les grandes entreprises économiques, contre l'exploitation et l'humiliation des travailleurs, et contre cette forme de vie où l'argent est tout et les personnes ne sont rien."
Les pièges tendus par la bourgeoisie
En Turquie
Différentes tendances politiques bourgeoises ont été actives, essayant d’influencer le mouvement de l’intérieur pour le maintenir dans les frontières de l’ordre existant, pour éviter qu’il ne se radicalise et pour empêcher les masses prolétariennes qui avaient pris les rues contre la terreur étatique de développer des revendications de classe sur leurs propres conditions de vie. Ainsi, alors qu'on ne peut évoquer de revendication ayant emporté l'unanimité dans le mouvement, ce sont les revendications démocratiques qui ont généralement dominé. La ligne appelant à "plus de démocratie" qui s’est formée autour d’une position anti-AKP et, en fait, anti-Erdogan n’exprimait rien d’autre qu'une réorganisation de l’appareil d’État turc sur un mode plus démocratique. L’impact des revendications démocratiques sur le mouvement a constitué sa plus grande faiblesse idéologique. Car Erdogan lui-même a construit toutes ses attaques idéologiques contre le mouvement autour de cet axe de la démocratie et des élections ; les autorités gouvernementales alliant mensonges et manipulations ont répété à satiété l’argument selon lequel, même dans les pays considérés plus démocratiques, la police utilise la violence contre les manifestations illégales – ce en quoi elles n’avaient pas tort. De plus, la ligne visant à obtenir des droits démocratiques liait les mains des masses face aux attaques de la police et à la terreur étatique et pacifiait leur résistance.
L’élément le plus actif dans cette tendance démocratique, qui a pris le contrôle de la Plateforme de Solidarité de Taksim, se trouve dans les confédérations syndicales de gauche comme le KSEK et le DISK. La Plateforme de Solidarité de Taksim et donc la tendance démocratique, constituée de représentants de toutes sortes d’associations et d’organisations, a tiré sa force non pas d'un lien organique avec les manifestants mais de sa légitimité bourgeoise, des ressources qu'elle a pu, de ce fait, mobiliser. La base des partis de gauche qu’on peut aussi définir comme la gauche légale bourgeoise, a été pour une large part coupée des masses. De façon générale, elle a été à la queue de la tendance démocratique. Les cercles staliniens et trotskistes comme la gauche radicale bourgeoise, étaient aussi pour une grande part coupés des masses. Ils n'étaient réellement influents que dans les quartiers où ils ont traditionnellement une certaine force. Bien que s’opposant à la tendance démocratique au moment où cette dernière essayait de disperser le mouvement, ils l'ont généralement soutenue. Son slogan le plus largement accepté parmi les masses était "épaule contre épaule contre le fascisme".
Au Brésil
La bourgeoisie nationale a œuvré depuis des décennies pour faire du Brésil une grande puissance continentale et mondiale. Pour y parvenir, il ne suffisait pas de disposer d’un immense territoire qui occupe quasiment la moitié de l’Amérique du Sud, ni de compter sur d’importantes ressources naturelles ; il était nécessaire de créer les conditions pour maintenir l’ordre social, surtout le contrôle sur les travailleurs. De cette manière, depuis les années 80, s’est établie une sorte d’alternance de gouvernements de droite et de centre-gauche, reposant sur des élections "libres et démocratiques", indispensables pour pouvoir fortifier le capital brésilien sur l'arène mondiale.
La bourgeoisie brésilienne est ainsi parvenue à renforcer son appareil productif et à affronter le plus dur de la crise économique des années 90, pendant que, sur le plan politique, elle a réussi à créer une force politique qui lui a permis de contrôler les masses paupérisées et surtout de maintenir "la paix sociale". Cette situation s’est consolidée avec l’accession du PT au pouvoir en 2002 en utilisant le charisme et l’image "ouvrière" de Lula.
C’est ainsi qu’au cours de la première décennie du nouveau siècle, l’économie brésilienne est parvenue à se hisser au septième rang mondial selon la Banque mondiale. La bourgeoisie mondiale salue le "miracle brésilien" réussi sous la présidence de Lula, qui, selon ses dires, aurait permis de sortir de la pauvreté des millions de Brésiliens et faire accéder d’autres millions à cette fameuse "classe moyenne". En fait, cette "grande réussite" s’est effectuée en utilisant une partie de la plus-value pour la distribuer sous forme de miettes aux couches les plus paupérisées, alors que dans le même temps s'accentuait la précarisation des masses travailleuses.
La crise demeure néanmoins la toile de fond de la situation au Brésil. Pour en atténuer les effets, la bourgeoisie a lancé une politique de grands travaux provoquant un boom de la construction publique comme privée ; tout en favorisant le crédit et l’endettement des familles pour relancer la consommation intérieure. Les limites en sont déjà tangibles au niveau des indicateurs économiques (ralentissement de la croissance) mais surtout dans la détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière : hausse croissante de l’inflation (prévision annuelle de 6,7% en 2013), augmentation du prix des produits de consommation et des services (dont les transports), développement sensible du chômage, réduction des dépenses publiques. Ainsi, le mouvement de protestations au Brésil ne sort pas de nulle part.
Le seul résultat concret qui a été obtenu sous la pression des masses, a été la suspension de la hausse des transports publics que l’État parviendra à compenser par d’autres moyens. Au début de la vague de protestations, pour calmer les esprits, pendant que le gouvernement préparait une stratégie pour tenter de contrôler le mouvement, la présidente Dilma Rousseff déclarait, par l’intermédiaire d’une de ses porte-paroles, qu’elle considérait comme "légitime et compatible avec la démocratie" la protestation de la population ; de son côté Lula, "critiquait" les "excès" de la police. Mais la répression de l’État n’a pas cessé, et les protestations de la rue non plus.
Un des pièges les plus élaborés contre le mouvement a été la propagation du mythe d’un "coup d’État" de la droite, rumeur propagée non seulement par le PT et le parti stalinien, mais aussi par les trotskistes du PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) et du PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) : il s’agissait d’une tentative de dévoyer le mouvement en le transformant en un appui au gouvernement de Dilma Rousseff, fortement affaibli et discrédité. Alors que la réalité des faits montrait précisément que la répression féroce contre les protestations de juin au Brésil exercée par le gouvernement de gauche du PT ont été tout aussi, voire plus brutaleségalait parfois que celle des régimes militaires, la gauche et l'extrême-gauche du capital brésilien œuvraient à obscurcir cette réalité en identifiant le fascisme avec la répression ou les régimes de droite. Vint également le rideau de fumée constitué par le projet d’une "réforme politique" mis en avant par Dilma Rousseff, avec pour objectif de combattre la corruption dans les partis politiques et d’enfermer la population sur le terrain démocratique en l’appelant à voter sur les réformes proposées. En fait, la bourgeoisie brésilienne a fait preuve de plus d'intelligence et de savoir-faire que son homologue turque, laquelle s’est surtout cantonnée à répéter le cycle provocation/répression face aux mouvements sociaux.
Pour tenter de regagner une influence sur les mobilisations sociales dans la rue, les partis politiques de la gauche du capital et les syndicats ont lancé, plusieurs semaines à l’avance, un appel à une "Journée nationale de lutte" le 11 juillet, présentée comme un moyen de protester contre l’échec des accords de conventions collectives de travail. De même, Lula, faisant étalage de sa grande expérience anti-ouvrière, a convoqué le 25 juin une réunion avec les dirigeants des mouvements contrôlés par le PT et le parti stalinien, y compris les organisations alliées du gouvernement chez les jeunes et les étudiants, dans le but explicite de neutraliser la contestation dans la rue.
Les forces et les faiblesses des deux mouvements
En Turquie
Tout comme cela avait été le cas dans le mouvement des Indignés et des Occupy, ces mobilisations ont répondu à la volonté de rompre l'atomisation de secteurs de l'économie où travaillent principalement des jeunes dans des conditions précaires (livreurs des boutiques de kebab, personnel des bars, travailleurs des centres d'appel et des bureaux, …) et où il est habituellement difficile de lutter. Un moteur important de la mobilisation et de la détermination se trouve dans l'indignation mais aussi dans le sentiment de solidarité contre la violence policière et la terreur de l’État.
Mais, en même temps, ce n'est souvent qu’individuellement que les travailleurs des plus grandes concentrations ouvrières ont participé aux manifestations, ce qui a constitué une des faiblesses les plus significatives du mouvement. Les conditions d’existence des prolétaires, soumis à la pression idéologique de la classe dominante de ce pays, ont difficilement permis à la classe ouvrière de se concevoir en tant que classe et ont contribué à renforcer l'idée chez les manifestants qu’ils étaient essentiellement une masse de citoyens individuels, des membres légitimes de la communauté "nationale". Le mouvement n’a pas reconnu ses propres intérêts de classe, ses possibilités de maturation se sont trouvé bloquées, la tendance prolétarienne en son sein étant restée à l'arrière-plan. A cette situation a beaucoup contribué la focalisation sur la démocratie, axe central du mouvement face à la politique gouvernementale. Une faiblesse des manifestations dans toute la Turquie a résidé dans la difficulté à créer des discussions de masse et à gagner le contrôle du mouvement grâce à des formes d’auto-organisation. Cette faiblesse a certainement été favorisée par une expérience limitée de la discussion de masse, des réunions, des assemblées générales, etc. En même temps, le mouvement a pourtant ressenti la nécessité de la discussion et les moyens pour l’organiser ont commencé à émerger, ce dont témoignent certaines expériences isolées : la constitution d’une tribune ouverte dans le parc Gezi n’a pas attiré beaucoup l’attention ni duré bien longtemps, mais elle a eu néanmoins un certain impact ; lors de la grève du 5 juin, les salariés de l’université qui sont membres de Eğitim-Sen [8] [410] ont suggéré de mettre en place une tribune ouverte mais la direction du KSEK a non seulement rejeté la proposition mais elle a aussi isolé la branche d’Eğitim-Sen à laquelle appartiennent les employés de l’université. L’expérience la plus cruciale est fournie par les manifestants d’Eskişehir qui, dans une assemblée générale, ont créé des comités afin d’organiser et de coordonner les manifestations ; enfin, à partir du 17 juin, dans les parcs de différents quartiers d’Istanbul, des masses de gens inspirés par les forums du parc Gezi ont mis en place des assemblées de masse également intitulées "forums". Les jours suivants, d’autres se sont tenus à Ankara et dans d’autres villes. Les questions les plus débattues portaient sur les problèmes liés aux affrontements avec la police. Néanmoins, il a existé une tendance parmi les manifestants à comprendre l'importance de l’implication dans la lutte de la partie du prolétariat au travail.
Bien que le mouvement en Turquie n’ait pas réussi à établir un lien sérieux avec l’ensemble de la classe ouvrière, les appels à la grève via les réseaux sociaux ont rencontré un certain écho qui s’est manifesté à travers des arrêts de travail. De plus, des tendances prolétariennes se sont nettement affirmées au sein du mouvement de la part d’éléments qui étaient conscients de l’importance et de la force de la classe et qui étaient contre le nationalisme. De façon générale, une partie significative des manifestants défendait l’idée que le mouvement devait créer une auto-organisation qui devait lui permettre de déterminer son propre futur. Par ailleurs, le nombre de gens qui disaient que les syndicats comme le KSEK et le DISK, supposés être "combatifs", n’étaient pas différents du gouvernement a grandi de façon significative.
Enfin, une autre caractéristique du mouvement, et pas des moindres : les manifestants turcs ont salué la réponse venue de l'autre bout du monde avec les mots d’ordre en turc : "Nous sommes ensemble, Brésil + Turquie !" et "Brésil, résiste !".
Au Brésil
La grande force du mouvement a résidé en ceci que, depuis le début, il s’est affirmé comme un mouvement contre l’État, non seulement à travers la revendication centrale contre la hausse des tarifs des transports publics, mais aussi avec sa mobilisation contre l’état d’abandon des services publics et contre l’accaparement d'une grande partie des dépenses en vue des manifestations sportives. De même, l’ampleur et la détermination de la contestation ont contraint la bourgeoisie à faire marche arrière en annulant la hausse des transports dans plusieurs villes.
La cristallisation du mouvement autour d'une revendication concrète, si elle a constitué une force du mouvement, en a également constitué une limite dès lors que celui-ci ne parvenait pas à aller au-delà. Il a marqué le pas dès lorsqu'il a réussi à imposer que soit annulée la décision de hausse de tarif des transports. Mais, de plus, il ne s’est pas compris comme un mouvement remettant en cause l’ordre capitaliste, aspect qui a été présent par exemple dans le mouvement des Indignés en Espagne.
La méfiance envers les principaux moyens de contrôle social de la bourgeoisie s'est traduite par le rejet des partis politiques et des syndicats, ce qui représente une faille sur le plan idéologique pour la bourgeoisie marquée par l’épuisement des stratégies politiques qui ont émergé depuis la dictature militaire de 1965-85 et le discrédit des équipes successivement en place à la tête de l'État, aggravé par la corruption notoire en leur sein. Cependant, derrière ce rejet, réside le danger du rejet de toute politique, de l’apolitisme, qui constitue une faiblesse importante du mouvement. En effet, sans débat politique, il n’y a aucune possibilité d’avancée réelle de la lutte dont le sol nourricier est justement celui de la discussion pour comprendre la racine des problèmes contre lesquels on se bat, et qui ne peut éluder une critique des fondements du système capitaliste. Ce n'est donc pas un hasard si une faiblesse du mouvement a été l’absence d’assemblées de rues ouvertes à tous les participants où puissent se discuter les problèmes de société, les actions à mener, l’organisation du mouvement, son bilan et ses objectifs. Les réseaux sociaux ont constitué un moyen important de la mobilisation et pour rompre l'atomisation. Mais ils ne pourront jamais remplacer le débat vivant et ouvert des assemblées.
Le poison du nationalisme n'a pas épargné le mouvement comme en ont témoigné la présence, dans les mobilisations, de nombreux drapeaux brésiliens et des mots d’ordre nationalistes et il n'était pas rare d'entendre l’hymne national dans les cortèges. Cela n'avait pas été le cas dans le mouvement des Indignés en Espagne. En ce sens, le mouvement au Brésil a présenté les mêmes faiblesses que les mobilisations en Grèce ou dans les pays arabes, où la bourgeoisie a réussi à saper la grande vitalité du mouvement dans un projet national de réforme ou de sauvegarde de l’État. Dans ce contexte, la protestation contre la corruption a bénéficié en dernière analyse à la bourgeoisie et à ses partis politiques, surtout ceux de l’opposition, qui par ce moyen espèrent retrouver un certain crédit politique dans la perspective des prochaines élections. Le nationalisme est une voie sans issue pour les luttes du prolétariat qui viole la solidarité internationale des mouvements de classe.
Malgré une participation majoritaire des prolétaires au mouvement, ceux-ci s'y sont impliqués de manière atomisée. Le mouvement n’est pas parvenu à mobiliser les travailleurs des centres industriels qui ont un poids important, surtout dans la région de São Paulo ; il ne l’a même pas proposé. La classe ouvrière, qui sans aucun doute a accueilli le mouvement avec sympathie et s’est même identifié à lui, parce qu’il luttait pour une revendication où elle reconnaissait ses intérêts, n’est pas parvenue à se mobiliser comme telle. Cette attitude est en fait une caractéristique de la période où la classe ouvrière a du mal à affirmer son identité de classe, aggravée au Brésil par des décennies d’immobilité résultant de l’action des partis politiques et des syndicats, principalement le PT et la CUT.
Leur importance pour l'avenir
Le surgissement de mouvements sociaux de très grande ampleur et d’une importance historique inégalée depuis 1908 en Turquie, depuis 30 ans Brésil, donnent en exemple au prolétariat mondial la réponse d’une nouvelle génération de prolétaires à l’approfondissement de la crise mondiale du système capitaliste. En dépit de leurs particularités respectives, ces mouvements sont partie intégrante de la chaîne des mouvements sociaux internationaux, dont la mobilisation des Indignés en Espagne avait constitué une référence, en réponse à la crise historique et mortelle du capitalisme. Malgré toutes leurs faiblesses, ils constituent une source d’inspiration et d'enseignements pour le prolétariat mondial. Quant à leur faiblesses, elles doivent faire l'objet, par les prolétaires eux-mêmes, d'une critique sans concession afin que soient tirées des leçons qui, demain, armeront d'autres mouvements en les aidant à se dégager chaque fois davantage de l'emprise idéologique et des pièges de la classe ennemie.
Ces mouvements ne sont pas autre chose que la manifestation de "la vieille taupe" à laquelle Marx se réfère et qui sape les fondements de l'ordre capitaliste.
Wim (11 août)
[1] [411] Voir notre série d’articles publiés sur le mouvement des Indignés en Espagne, notamment dans la Revue Internationale n° 146 (3e trimestre 2011) et 149 (3e trimestre 2012).
[2] [412] Adalet ve Kalkınma Partisi (Parti pour la justice et le développement) Ce parti, islamiste "modéré", est au pouvoir depuis 2002 en Turquie.
[3] [413] Confédération des syndicats turcs.
[4] [414] Face à la hausse des tarifs dans les transports, le MPL a véhiculé de fortes illusions sur l’État en prétendant que, par la pression populaire, il pourrait garantir le droit aux transports gratuits pour toute la population face aux entreprises privées de transports.
[5] [415] Voir notre article "Manifestations contre l'augmentation du prix des transports au Brésil : la répression policière provoque la colère de la jeunesse", publié sur notre site le 20 juin 2013 et dans notre presse territoriale imprimée.
[6] [416] Selon les prévisions, ces deux événements coûteront 31,3 milliards de dollars au gouvernement brésilien soit 1,6 % de son PIB tandis que le programme "Bourse familiale", présentée comme la mesure sociale phare du gouvernement de Lula ne représente qu’une part de 0,5% de ce PIB.
[7] [417] FIFA : Fédération Internationale du Football Association
[8] [418] Syndicat d’enseignants faisant partie du KSEK.
Géographique:
Rubrique:
Rapport sur les tensions impérialistes pour le 20e Congrès du CCI
- 1677 lectures
Dès la fin des années 1980, le CCI mettait en évidence l’entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition. "Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l'histoire ne saurait pourtant s'arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société" (Revue internationale n° 62, 1990, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme").
L’implosion du bloc de l’Est a dramatiquement accéléré la débandade des différentes composantes du corps social dans le "chacun pour soi", l’enfoncement dans le chaos. S'il est un domaine où s'est immédiatement confirmée cette tendance, c’est bien celui des tensions impérialistes : "La fin de la "guerre froide" et la disparition des blocs n'a donc fait qu'exacerber le déchaînement des antagonismes impérialistes propres à la décadence capitaliste et qu'aggraver de façon qualitativement nouvelle le chaos sanglant dans lequel s'enfonce toute la société (...)" (Revue internationale n° 67, 1991, 9e congrès du CCI, "Résolution sur la situation internationale", point 6). Deux caractéristiques des affrontements impérialistes dans la période de décomposition étaient pointées :
a) l’irrationalité des conflits, qui est une des caractéristiques marquantes de la guerre en décomposition."Si la guerre du Golfe constitue une illustration de l'irrationalité d'ensemble du capitalisme décadent, elle comporte cependant un élément supplémentaire et significatif d'irrationalité qui témoigne de l'entrée de ce système dans la phase de décomposition. En effet, les autres guerres de la décadence pouvaient, malgré leur irrationalité de fond, se donner malgré tout des buts apparemment "raisonnables" (comme la recherche d'un "espace vital" pour l'économie allemande ou la défense des positions impérialistes des alliés lors de la seconde guerre mondiale). Il n'en est rien pour ce qui concerne la guerre du Golfe. Les objectifs que s'est donnée celle-ci, tant d'un côté comme de l'autre, expriment bien l'impasse totale et désespérée dans laquelle se trouve le capitalisme" (Revue internationale n° 67, 1991, 9e congrès du CCI, "Rapports sur la situation internationale (extraits)").
b) le rôle central joué par la puissance dominante dans l’extension du chaos sur l’ensemble de la planète : "La différence avec la situation du passé, et elle est de taille, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas une puissance visant à modifier le partage impérialiste qui prend les devants de l'offensive militaire, mais au contraire la première puissance mondiale, celle qui pour le moment dispose de la meilleure part du gâteau. (...). Le fait qu'à l'heure actuelle, le maintien de "l'ordre mondial" (...) ne passe plus par une attitude "défensive" (...) de la puissance dominante mais par un utilisation de plus en plus systématique de l'offensive militaire, et même à des opérations de déstabilisation de toute une région afin de mieux s'assurer de la soumission des autres puissances, traduit bien le nouveau degré de l'enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme le plus déchaîné. C'est justement là un des éléments qui distingue la phase de décomposition des phases précédentes de la décadence capitaliste (...)" (Revue internationale n° 67, 1991, 9e congrès du CCI, "Rapports sur la situation internationale (extraits)").
Ces caractéristiques nourrissent un chaos croissant qui s’est encore accéléré après les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres d’Irak et d’Afghanistan qui en ont découlé. Le rapport du 19e congrès du CCI visait précisément à évaluer l’impact de ces dix dernières années de "war against terror" sur l’expansion générale des tensions impérialistes, le développement du ‘chacun pour soi’, l’évolution du leadership américain. Il mettait en évidence les quatre orientations suivantes dans le développement des confrontations impérialistes :
a) L’accroissement du chacun pour soi, qui se traduisait en particulier par une multiplication tous azimuts des ambitions impérialistes, menant à l’exacerbation des tensions, surtout en Asie, autour de l’expansionnisme économique et militaire chinois. Cependant, malgré une expansion économique impressionnante, une puissance militaire croissante et une présence de plus en plus marquée dans les confrontations impérialistes, la Chine ne dispose pas des capacités industrielles et technologiques suffisantes pour s’imposer comme tête d’un bloc pour challenger des États-Unis sur un plan mondial.
b) L’impasse croissante de la politique des États-Unis et la fuite dans la barbarie guerrière. L’échec cuisant des interventions en Irak et en Afghanistan a affaibli le leadership mondial des États-Unis. Même si la bourgeoisie américaine sous Obama, en choisissant une politique de retraite contrôlée d’Irak et d’Afghanistan, a su réduire l’impact de la politique catastrophique menée par Bush, elle n’a pas pu en inverser la tendance et cela a entraîné sa fuite en avant dans la barbarie guerrière. L’exécution de Ben Laden a exprimé une tentative des États-Unis de réagir à ce recul de leur leadership et a souligné leur supériorité technologique et militaire absolue. Cependant, cette réaction ne remettait pas en question la tendance de fond à l’affaiblissement. Au contraire, cette liquidation a accéléré la déstabilisation du Pakistan et donc l’extension de la guerre, alors que les bases idéologiques pour la "guerre contre le terrorisme" sont plus que jamais minées.
c) Une tendance à l’extension explosive des zones d’instabilité permanente et de chaos sur des pans entiers de la planète, de l’Afghanistan jusqu’en Afrique, à un point tel que certains analystes bourgeois, tels le français Jacques Attali, parlent carrément de "somalisation" du monde.
d) L’absence de tout lien mécanique et immédiat entre l’aggravation de la crise et le développement des tensions impérialistes, même si certains phénomènes témoignent d’un certain impact de l’un sur l’autre :
- l’exploitation par certains pays de leur poids économique pour dicter leur volonté à d’autres pays et favoriser leur propre puissance industrielle (États-Unis, Allemagne) ;
- l’arriération industrielle et technologique (Chine, Russie), mais aussi les difficultés budgétaires (Grande-Bretagne, Allemagne) qui peuvent peser sur développement de l’effort militaire.
Ces caractéristiques générales, mises en avant lors du précédent congrès, ont non seulement été confirmées lors des deux dernières années, mais leur validité s'est trouvée rehaussée de manière spectaculaire durant cette période : leur exacerbation accroît de manière dramatique la déstabilisation des rapports de force entre impérialismes, le risque de guerre et de chaos dans des régions importantes de la planète, et plus particulièrement au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient, avec toutes les conséquences catastrophiques qui pourraient en découler sur les plans économique, écologique et humain pour l’ensemble de la planète et pour la classe ouvrière en particulier.
Quarante-cinq ans d’histoire au Moyen-Orient expriment de manière frappante l’avancée de la décomposition et la perte de contrôle de la première puissance mondiale :
- années 1970 : bien que le bloc américain s’assure du contrôle global du Moyen-Orient et réduise progressivement l’influence du bloc russe, la venue au pouvoir des Mollahs en Iran en 1979 marque le début du développement de la décomposition ;
- années 1980 : Le bourbier libanais souligne les difficultés d’Israël mais aussi des États-Unis à garder le contrôle sur la région, ces derniers poussant l’Irak à mener la guerre contre l’Iran ;
- 1991 : première guerre du golfe où le gendarme américain mobilise un grand nombre d'États autour de lui dans sa guerre contre Saddam Hussein pour le chasser du Koweït ;
- 2003 : échec de la tentative de mobilisation de George W. Bush contre l’Irak et montée de l’Iran qui, depuis les années 1990, est lui-même à l’offensive en tant que puissance régionale défiant les États-Unis ;
- 2011 : retrait américain d’Irak et chaos croissant au Moyen-Orient.
Certes, la politique de retrait progressif ("step by step") des États-Unis d’Irak et d’Afghanistan par l’administration Obama a réussi à limiter les dégâts pour le gendarme mondial, mais le résultat de ces guerres est un chaos incommensurable dans toute la région.
L’accentuation du chacun pour soi dans les confrontations impérialistes et l’extension du chaos, qui rendent le développement des événements particulièrement imprévisibles, ont été illustrés dans la période récente à travers quatre situations plus spécifiques :
1. le danger de confrontations guerrières et l’instabilité croissante des États au Moyen-Orient ;
2. la montée en puissance de la Chine et l’exacerbation des tensions en Extrême-Orient ;
3. la fragmentation des États et l’extension du chaos en Afrique ;
4. l’impact de la crise sur les tensions entre États en Europe.
1. L’extension du chaos au Moyen-Orient
1.1. Brève perspective historique.
Pour des raisons économiques et stratégiques (routes commerciales vers l’Asie, pétrole, ...) la région a toujours été un enjeu important dans la confrontation entre puissances. Depuis l’entrée en décadence du capitalisme et l’effondrement de l’empire ottoman en particulier, elle a été au centre des tensions impérialistes :
- jusqu'en 1945 : après l’effondrement de l’empire ottoman, l'application des accords Sykes-Picot répartit la région entre l’Angleterre et la France. Elle est le théâtre de la guerre civile turque et du conflit gréco-turc, de l’émergence du nationalisme arabe et du sionisme ; elle est un enjeu de la Seconde Guerre mondiale (offensives allemandes en Russie et en Afrique du nord).
- après 1945 : elle constitue une zone centrale pour les tensions Est-Ouest (1945-1989), avec les tentatives du bloc russe de s’implanter dans la région qui se heurtent à une forte présence des États-Unis. La période est marquée par l’implantation du nouvel État d’Israël, les guerres israélo-arabes, la question palestinienne, la "révolution" iranienne (première expression de la décomposition), la guerre Iran-Irak.
- après 1989 et l’implosion du bloc russe : toutes les contradictions qui existaient depuis l’effondrement de l’empire ottoman vont exacerber le développement du chacun pour soi, la mise en question du leadership américain et le développement du chaos. L’Irak, l’Iran et la Syrie sont dénoncés par les États-Unis comme des États voyous. La région connaît deux guerres américaines en Irak, trois guerres israéliennes au Liban, la montée en puissance de l’Iran et de son allié le Hezbollah au Liban.
- depuis 2003, on assiste à une explosion de l’instabilité : fragmentation de fait de l’Autorité palestinienne et de l’Irak, "printemps arabe" qui a mené à la déstabilisation de nombreux régimes dans la région (Libye, Égypte, Yémen) et à la guerre des factions et des impérialismes en Syrie. Massacres permanents en Syrie, tentatives d’acquisition par l’Iran de l’arme nucléaire, récents bombardements israéliens sur Gaza, instabilité politique permanente en Égypte, : chacun de ces événements doit être replacé dans la dynamique globale de la région.
1.2. Danger croissant de confrontations guerrières entre impérialismes
Plus que jamais, la guerre menace dans la région : intervention préventive d’Israël (avec ou sans l’aval des États-Unis) contre l’Iran, possibilité d’intervention de différents impérialismes en Syrie, guerre d’Israël contre les palestiniens (soutenus à présent par l’Égypte), tensions entre les monarchies du golfe et l’Iran. Le Moyen-Orient est une terrible confirmation de nos analyses à propos de l’impasse du système et de la fuite dans le "chacun pour soi" :
- la région est devenue une immense poudrière et les achats d’armes se sont encore multipliés ces dernières années (Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, Oman) ;
- une armada de vautours de premier, second ou troisième ordre se confrontent dans la région, comme l’illustre le conflit en Syrie : les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran, Israël, l’Arabie Saoudite, le Qatar, l’Égypte, avec en plus les gangs armés au service de ces puissances ou les chefs de guerre agissant pour leur propre compte ;
- dans ce contexte, il faut pointer le rôle déstabilisateur au Moyen-Orient de la Russie, intéressée à défendre ses derniers points d’appui dans la région, et de la Chine, avec une attitude plus offensive en soutien à l’Iran qui constitue pour elle un fournisseur crucial de pétrole. L’Europe est plus discrète, même si un pays comme la France avance ses cartes en Palestine, en Syrie, voire même en Afghanistan (organisation d'une conférence réunissant les principales factions afghanes en décembre 2012 à Chantilly, près de Paris).
Il s’agit d’une situation explosive qui échappe au contrôle des grands impérialismes et le retrait des forces occidentales d’Irak et d’Afghanistan accentuera encore la tendance à la déstabilisation, même si les États-Unis ont entrepris des tentatives de limiter les dégâts :
- en restreignant les velléités guerrières israéliennes envers l’Iran et envers le Hamas dans la bande de Gaza ;
- en tentant un rapprochement avec les Frères Musulmans et le nouveau président Morsi en Égypte.
Globalement cependant, dans le prolongement du "printemps arabe", les États-Unis ont montré leur incapacité à protéger des régimes à leur dévotion (ce qui conduit à une perte de confiance, comme l'illustre l'attitude de l'Arabie Saoudite cherchant à prendre ses distances envers les États-Unis) et ont encore gagné en impopularité.
Cette multiplication des tensions impérialistes peut mener à des conséquences majeures à tout moment : des pays comme Israël ou l’Iran peuvent provoquer des secousses terribles et entraîner toute la région dans un tourbillon, sans que quelque puissance que ce soit puisse empêcher cela, car ils ne sont véritablement sous le contrôle de personne. Nous sommes donc dans une situation extrêmement dangereuse et imprévisible pour la région, mais aussi, à cause des conséquences qui peuvent en découler, pour la planète entière.
1.3. Instabilité croissante de la plupart des États de la région
Dès 1991, avec l’invasion du Koweït et la première guerre du Golfe, le front sunnite mis en place par les occidentaux pour contenir l’Iran s’est effondré. L’explosion du "chacun pour soi" dans la région a été ahurissante. Ainsi, l’Iran a été le grand bénéficiaire des deux guerres du Golfe, avec le renforcement du Hezbollah et des mouvements chiites ; quant aux Kurdes, leur quasi-indépendance est un effet collatéral de l’invasion de l’Irak. La tendance au chacun pour soi s’est encore accentuée, surtout dans le prolongement des mouvements sociaux du "printemps arabe", en particulier là où le prolétariat est le plus faible. On a ainsi assisté à une déstabilisation de plus en plus marquée de nombreux États de la région :
- c’est de toute évidence le cas du Liban, de la Libye, du Yémen, de l’Irak, de la Syrie, du "Kurdistan libéré" ou des territoires palestiniens qui sombrent dans la guerre de clans voire la guerre civile ;
- c’est aussi le cas de l'Égypte, de Bahreïn, de la Jordanie (où les Frères musulmans s'opposent au roi Abdallah II) et même de l’Iran où les tensions sociales et oppositions de clans rendent la situation imprévisible.
L’exacerbation des tensions entre factions adverses recoupe tout autant les diverses tendances religieuses. Ainsi, outre l’opposition sunnites / chiites ou chrétiens / musulmans, les oppositions au sein du monde sunnite se sont aussi multipliées avec l’arrivée au pouvoir en Turquie de l’islamiste modéré Erdogan ou récemment celle des Frères musulmans et assimilés en Égypte, en Tunisie (Ennahda) et au sein du gouvernement marocain. Les Frères musulmans sont aujourd’hui soutenus par le Qatar, et s’opposent à la mouvance salafiste / wahhabite, financée par l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis., qui eux avaient soutenu Moubarak et Ben Ali respectivement en Égypte et en Tunisie.
Bien sûr, ces tendances religieuses, les unes plus barbares que les autres, ne sont là que pour cacher les intérêts impérialistes qui gouvernent la politique des diverses cliques au pouvoir. Plus que jamais aujourd’hui, avec la guerre en Syrie ou les tensions en Égypte, il est évident qu’il n’existe pas de "bloc musulman" ou de "bloc arabe", mais différentes cliques bourgeoises défendant leurs propres intérêts impérialistes en exploitant les oppositions religieuses (chrétiens, juifs, musulmans, diverses tendances au sein du sunnisme ou du chiisme), ce qui apparaît d’ailleurs aussi dans le combat de pays comme la Turquie, le Maroc, l’Arabie Saoudite ou le Qatar pour le contrôle des mosquées à "l’étranger", en Europe en particulier.
Mais cette explosion des antagonismes et du fractionnement religieux depuis la fin des années 1980 et l’effondrement des régimes "laïcs" ou "socialistes" (Égypte, Syrie, Irak, ...) exprime aussi et surtout le poids de la décomposition, du chaos et de la misère, de l’absence totale de perspective à travers une fuite dans des idéologies totalement rétrogrades et barbares.
Bref, l’idée que les États-Unis pourraient rétablir une forme de contrôle sur la région, par l’éviction d'el-Assad par exemple, est une pure vue de l’esprit. Depuis la première guerre du Golfe, toutes les tentatives de ce pays pour restaurer son leadership ont échoué et ont, au contraire, favorisé l’éclosion d’appétits régionaux, celui de l’Iran en particulier, fortement militarisé, riche en énergies et soutenu par la Russie et la Chine. Mais ce pays est en compétition avec l’Arabie Saoudite, Israël, la Turquie. Les ambitions impérialistes "ordinaires" de chaque État, l’explosion du "chacun pour soi", la question israélo-palestinienne, les oppositions religieuses, mais aussi les divisions ethniques (Kurdes, Turcs, Arabes) jouent dans l’ensemble des foyers de tension et rendent la situation particulièrement imprévisible et dramatique pour les habitants de la région, mais potentiellement aussi pour l’ensemble de la planète : ainsi, toute nouvelle exacerbation des tensions autour de l’Iran et un blocage éventuel du détroit d'Ormuz auraient des conséquences incalculables sur l’économie mondiale.
2. Exacerbation des oppositions impérialistes en Extrême-Orient
2.1. Brève perspective historique.
L’Extrême-Orient a constitué une zone cruciale pour le développement des confrontations impérialistes dès les prémices de la décadence du capitalisme : guerre russo-japonaise de 1904-1905, "révolution" chinoise de 1911 et guerre civile féroce entre les diverses cliques de seigneurs de la guerre, offensive japonaise en Mandchourie (1931), invasion japonaise de la Chine (1937), conflit entre le Japon et l’URSS (mai-septembre 1939), débouchant sur la Seconde Guerre mondiale où l’Extrême-Orient constituera un des fronts principaux de cette guerre et des conflits ultérieurs.
- entre 1945 et 1989, la région est au centre des tensions Est-Ouest : s’y déroulent la guerre civile en Chine (1946-1950), les guerres de Corée, d’Indochine et du Vietnam, mais aussi les conflits frontaliers russo-chinois, sino-vietnamien, sino-indien et indo-pakistanais. La politique américaine de "neutralisation" de la Chine dans le courant des années 1970 allait être un moment important dans l’augmentation de la pression exercée par le bloc américain sur le bloc russe.
- depuis l’implosion du bloc russe, le "chacun pour soi" s’est aussi développé en Extrême-Orient (État voyou de Corée du Nord, décomposition du Pakistan). La région est surtout marquée par la montée en puissance sur le plan économique et militaire de la Chine, ce qui a exacerbé les tensions impérialistes régionales (incidents réguliers ces derniers mois en mer de Chine avec le Vietnam ou les Philippines et surtout avec le Japon, accrochages répétés dans la zone des deux Corées, ...) et a, à son tour, accéléré l’armement des autres États de la région (Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, ...).
2.2. Montée en puissance de la Chine et exacerbation des tensions guerrières.
Le développement de la puissance économique et militaire de la Chine et ses tentatives de s’imposer comme puissance de premier plan non seulement en Extrême-Orient mais aussi au Moyen-Orient (Iran), en Afrique (Soudan, Zimbabwe, Angola) ou même en Europe où elle recherche un rapprochement stratégique avec la Russie, font qu’elle est perçue par les États-Unis comme le danger potentiel le plus important pour leur hégémonie. Ceux-ci orientent dès lors l’essentiel de leurs manœuvres stratégiques contre la Chine, comme l’illustre la visite fin 2012 d’Obama en Birmanie et au Cambodge, deux pays alliés de la Chine.
L’essor économique et militaire de la Chine la pousse inévitablement à mettre en avant ses intérêts économiques et stratégiques nationaux, à exprimer en d’autres mots une agressivité impérialiste croissante et donc à être de plus en plus un facteur déstabilisant en Extrême-Orient.
Cette montée en puissance de la Chine inquiète non seulement les États-Unis, mais aussi de nombreux pays d’Asie eux-mêmes, du Japon à l’Inde, du Vietnam aux Philippines, qui se sentent menacés par l’ogre chinois et qui ont accru très sensiblement leurs dépenses d’armement. Stratégiquement, les États-Unis ont beau jeu de promouvoir une large alliance visant à contenir les ambitions chinoises, regroupant autour des piliers que sont le Japon, l’Inde et l’Australie d’autres pays moins puissants, tels que la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines, l’Indonésie ou Singapour. En se profilant comme chef de file d’une telle alliance et surtout dans l’hypothèse d’un "rappel à l’ordre" de la Chine, le "gendarme mondial" vise à restaurer la crédibilité de son leadership en chute libre partout dans le monde.
Les données récentes confirment que, dans la période actuelle, le développement économique important d’un pays ne peut se faire sans une exacerbation importante des tensions impérialistes. Le contexte d’apparition de ce rival actuellement le plus important sur la scène mondiale, dans une situation d’affaiblissement des positions du premier gendarme mondial, annonce un futur de confrontations plus nombreuses et plus dangereuses, pas seulement en Asie mais dans le monde entier.
Ce danger de confrontations est d’autant plus réel que les tendances au "chacun pour soi" sont également très présentes dans d’autres pays en Extrême-Orient. Ainsi, le raidissement du Japon se confirme avec le retour au pouvoir de Shinzo Abe qui a fait campagne sur le thème de la restauration de la puissance nationale : il veut remplacer les Forces d’autodéfense par une véritable armée de défense nationale, promet de tenir tête à la Chine sur le conflit à propos d'un groupe d’îles en mer de Chine orientale et veut rétablir les liens quelque peu dégradés avec les anciens alliés dans la région, les États-Unis et la Corée du Sud. De même, en Corée du Sud, l’élection de Park Geun-hye, candidate du parti conservateur (et fille de l’ancien dictateur Park Chung-hee) pourrait également entraîner une accentuation du "chacun pour soi" et des ambitions impérialistes de ce pays.
De plus, toute une série d’autres conflits apparemment secondaires entre pays asiatiques peuvent apporter de l’eau au moulin de la déstabilisation : il y a bien sûr le conflit indo-pakistanais, les accrochages continuels entre les deux Corées, mais aussi des tensions moins médiatisées entre la Corée du Sud et le Japon (à propos des rochers Liancourt), entre le Cambodge et le Vietnam ou la Thaïlande, entre la Birmanie et la Thaïlande, entre l’Inde et la Birmanie ou le Bangladesh, etc. qui participent à l’exacerbation des tensions guerrières tous azimuts.
2.3. Tensions au sein de l’appareil politique de la bourgeoisie chinoise.
L’organisation récente du congrès du Parti "communiste" chinois a révélé divers indices confirmant que la situation économique, impérialiste et sociale actuelle provoquait de fortes tensions au sein de la classe dirigeante. Cela pose une question insuffisamment traitée jusqu’à présent : la question des caractéristiques de l’appareil politique de la bourgeoisie dans un pays comme la Chine et la manière dont évoluent les rapports de force en son sein. L’inadéquation de cet appareil politique a été un facteur important dans l’implosion du bloc de l’Est, mais qu’en est-il de la Chine ? Rejetant toute "glasnost" ou "perestroïka", les classes dirigeantes ont introduit avec succès les mécanismes d’économie de marché tout en maintenant sur le plan politique une organisation stalinienne rigide. Dans les rapports précédents, nous avions pointé la faiblesse structurelle de l’appareil politique de la bourgeoisie chinoise comme un des arguments pour établir que la Chine ne pouvait devenir un véritable challenger des États-Unis. Aussi, la plongée de l’économie sous l’impact de la crise mondiale, la multiplication d’explosions sociales et la montée des tensions impérialistes renforcent sans aucun doute les tensions existantes entre fractions de la bourgeoisie chinoise comme en témoignent divers événements surprenants, tels l’éviction de "l’étoile montante" Bo Xilai et la disparition mystérieuse pendant quinze jours du futur président Xi Jinping quelques semaines avant la tenue du congrès.
Différentes lignes de fracture doivent être prises en compte pour saisir les luttes entre factions :
- une première ligne de fracture concerne l’opposition entre régions bénéficiant fortement du développement économique et d’autres quelque peu négligées, donc aussi entre politiques économiques. S’opposeraient ainsi deux grands réseaux marqués par le clientélisme. D’une part une coalition circonstancielle entre le "parti des princes", des enfants de cadres supérieurs du temps de Mao et de Deng, et la clique de Shanghai, des fonctionnaires des provinces côtières. Représentant les groupes dirigeants des provinces côtières plus industrialisées, elle prône la croissance économique à tout prix, même si cela accroît encore le fossé social ; cette faction serait représentée par le nouveau président Xi Jinping et l’expert macro-économique du Bureau politique Wang Qishan. Face à elle, il y a la faction "Tuanpai" autour de la Ligue de la jeunesse "communiste", au sein de laquelle les principales figures de ce réseau ont fait carrière. Comme il s’agit de fonctionnaires ayant fait carrière plutôt dans les provinces plus pauvres de l’intérieur, cette faction prône une politique de développement économique des régions du centre et de l’ouest, ce qui favoriserait une plus grande "stabilité sociale" ; ceux-ci représentent des groupes ayant plus d’expérience dans l’administration et la propagande. Représentée par l'ancien président Hu Jintao, cette faction est présente dans la nouvelle direction à travers Li Keqiang, qui a remplacé Wen Jiabao comme premier ministre. Cet affrontement semble avoir joué un rôle dans le clash autour de Bo Xilai.
- La situation sociale peut également générer des tensions entre factions au sein de l’État. Ainsi, certains groupes, en particulier dans les secteurs industriels et de l’exportation, sans doute aussi dans la production de biens de consommation, peuvent être sensibles aux tensions sociales et être favorables à plus de concessions au niveau politique envers la classe ouvrière. Ils s’opposent alors aux factions "dures", qui prônent la répression pour préserver les privilèges des cliques au pouvoir.
- la politique impérialiste joue également un rôle dans ces confrontations entre cliques. D’une part, des factions poussent à une attitude plus agressive, de confrontation, tels les gouvernements des régions côtières de Hainan, du Guangxi et du Guangdong, en quête de nouvelles ressources pour leurs entreprises, qui poussent au contrôle de zones riches en hydrocarbures et en ressources halieutiques. D’autre part, cette agressivité peut entraîner des contrecoups sur le plan des exportations ou des investissements étrangers, comme le montre le conflit avec le Japon précisément sur la question des îlots. Les poussées de fièvre nationalistes de plus en plus fréquentes en Chine sont sans doute le produit de ces affrontements internes. Quel est par ailleurs l’impact du nationalisme sur la classe ouvrière, quelle est la capacité de la jeune génération prolétarienne à ne pas se faire embobiner, à défendre ses intérêts ? Sur ce plan, le contexte est assez différent de celui de 1989-1991 en URSS.
Ces trois lignes de fracture ne sont bien sûr pas séparées, mais se recouvrent et ont joué dans les tensions qui ont marqué le congrès du PCC et la nomination de la nouvelle direction. Selon les observateurs, celui-ci a été marqué par la victoire des "conservateurs" sur les "progressistes" (les 4 nouveaux membres du Comité permanent du Bureau politique, composé de 7 membres, sont des "conservateurs"). Mais les révélations de plus en plus fréquentes que ces luttes internes apportent sur les mœurs, la corruption, l’accumulation de fortunes gigantesques qui touchent les plus hautes sphères du parti (ainsi, la fortune de la famille de l’ancien premier ministre Wen Jiabao est estimée à 2,7 milliards de dollars à travers un réseau complexe de sociétés, souvent au nom de sa mère, sa femme ou sa fille, et celle du nouveau président Xi Jinping est déjà d'au moins 1 milliard), mettent en évidence non seulement un problème aux proportions effectivement gigantesques mais aussi une instabilité croissante au sein même de la sphère dirigeante que la nouvelle direction conservatrice et vieillissante semble peu à même de prendre à bras le corps.
3. Extension de la "somalisation" : le cas de l’Afrique
L’explosion du "chacun pour soi" et du chaos a fait naître une zone d’instabilité et de "non-droit", qui n’a cessé de s’élargir depuis la fin du XXe siècle et qui s’étend à présent sur l’ensemble du Moyen-Orient jusqu’au Pakistan. Elle couvre également la totalité du continent africain qui s’enfonce dans une barbarie terrifiante. Cette "somalisation" s’y manifeste sous plusieurs formes:
3.1. Tendance à la fragmentation des États.
Inscrit dans la charte de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1964, le principe de l’intangibilité des frontières semble bien écorné. Dès 1991, l’Érythrée se sépare de l’Éthiopie et, depuis lors, ce processus touche l’ensemble de l’Afrique : depuis les années 1990, l’évaporation du pouvoir central en Somalie a vu la fragmentation du pays, avec l’apparition de semblants d’États, tels le Somaliland et le Puntland. Récemment, il y a eu la sécession du Soudan du Sud par rapport au Soudan et la sanglante rébellion du Darfour, la sécession de l’Azawad envers le Mali et des tendances séparatistes se manifestent en Libye (la Cyrénaïque autour de Benghazi), au Sénégal (la Casamance) et récemment dans la région de Mombasa au Kenya.
Outre la prise d’indépendance de régions de plus en plus nombreuses, on assiste aussi depuis les années 1990 à une multiplication de conflits internes à caractère politico-ethnique ou ethno-religieux : le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire tentent de se remettre de guerres civiles politico-ethniques qui ont fait imploser l’État au profit de clans armés. Au Nigéria, il y a la rébellion musulmane dans le nord, "l’Armée de résistance du Seigneur" en Ouganda et les clans Hutus et Tutsis qui s’entre-déchirent dans l’est de la RDC. La diffusion transnationale de tensions et de conflits dans un contexte d’États affaiblis, voire en cours d’effondrement et incapables d’assurer l’ordre national, pousse au repli sur les appartenances religieuse ou ethnique qui vont dominer. En conséquence, la défense de ses intérêts se fera à partir de milices constituées sur ces bases.
Ces fragmentations internes sont souvent attisées et exploitées par des interventions extérieures : ainsi, l’intervention occidentale en Libye a exacerbé l’instabilité interne et provoqué la dissémination d’armes et de groupes armés dans tout le Sahel. La présence accrue de la Chine sur le continent a constitué, par exemple, un appui pour la politique guerrière du Soudan et donc une déstabilisation de toute la région. Enfin, les grandes multinationales et leur État de tutelle instrumentalisent, voire orchestrent les conflits locaux pour s’emparer des richesses minières (dans l'est de la RDC par exemple).
Seul le sud du continent semble échapper à ce scénario. On assiste pourtant là aussi à une dilution des limites territoriales, mais ici cela se fait au profit d’une sorte "d’aspiration" des États faibles de la région (le Mozambique, le Swaziland, le Botswana, mais aussi la Namibie, la Zambie, le Malawi) par l’Afrique du Sud qui les transforme en semi-colonies.
3.2. Effacement des frontières.
La déstabilisation des États est alimentée par une criminalité transfrontalière, telle que le trafic d’armes, de drogue ou d’êtres humains. En conséquence, les limites territoriales se diluent au profit de zones frontalières, où les régulations s’effectuent "par le bas". Insurrections armées, incapacité des autorités à maintenir l’ordre, trafics transnationaux d’armes et de munitions, caïds locaux, ingérences étrangères, course aux ressources naturelles, etc. Les États déliquescents perdent le contrôle sur des "zones grises" de plus en plus amples, administrées souvent de manière criminelle (parfois aussi, il y a l’effet pervers de l’intervention des organisations humanitaires qui de fait rendent "extra-territoriales" les zones "protégées" ). Quelques exemples :
- toute la zone saharo-sahélienne, du désert de Libye à l’Azawad, la Mauritanie, le Niger ou le Tchad est de fait le terrain d’action de mouvements criminels et de groupes islamistes radicaux ;
- entre le Niger et le Nigéria existe une bande de 30 à 40 km qui échappe à la supervision de Niamey et d’Abuja. Les frontières se sont évaporées ;
- dans l’est de la RDC, le contrôle des frontières avec l’Ouganda, le Rwanda, et la Tanzanie par l’État central est inexistant, favorisant les trafics transnationaux de matières premières et d’armes ;
- à travers des États tels le Burkina Faso, le Ghana, le Bénin ou la Guinée existe une traite de migrants destinés à l’agriculture ou la pêche. Quant à la Guinée-Bissau, elle est devenue dans sa totalité une zone de "non-droit", centre névralgique d’entrée et de redirection de la drogue d’Amérique du Sud ou d’Afghanistan vers l’Europe et les États-Unis.
3.3. Dominance de clans et de seigneurs de guerre
Avec la déliquescence des États nationaux, des régions entières passent sous le contrôle de groupes et de seigneurs de guerre qui se jouent des frontières. Il n’y a pas qu’en Somalie et au Puntland où des clans et des chefs locaux font régner leur loi par les armes. Dans la région sahélienne, ce rôle est rempli par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ançar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), des groupes nomades touaregs. Dans l’est du Congo, un groupe comme le M23 est une armée privée au service d’un seigneur de guerre qui propose ses services au plus offrant.
De tels groupes sont généralement liés à des trafiquants avec lesquels ils échangent argent et services. Ainsi au Nigeria, dans le delta du Niger, des groupes similaires rançonnent les entreprises et sabotent les installations pétrolières.
L’émergence et l’extension de zones de "non-droit" ne sont certes pas limitées à l’Afrique. Ainsi, la généralisation du crime organisé, de la guerre entre gangs dans divers pays d’Amérique latine, comme le Mexique ou le Venezuela, voire le contrôle de quartiers entiers par des bandes dans les grandes villes occidentales, témoignent de la progression de la décomposition sur toute la planète. Cependant, le niveau de fragmentation et de chaos atteint à l’échelle d’un continent entier donne une idée de la barbarie qu’apporte la décomposition du système capitaliste à l’ensemble de l’humanité.
4. Crise économique et tensions entre États en Europe
Dans le rapport pour le 19e congrès du CCI, nous avions souligné l’absence de tout lien mécanique et immédiat entre l’aggravation de la crise économique et le développement des tensions impérialistes. Néanmoins, cela ne signifie pas l'absence d'impact de l’un sur l’autre. C’est particulièrement le cas du rôle des États européens sur la scène impérialiste.
4.1. Impact sur les ambitions impérialistes dans le monde.
La crise de l’Euro et de l’UE impose à la plupart des États européens des cures d’austérité budgétaire qui s’expriment aussi au niveau des dépenses militaires. Ainsi, contrairement aux États d’Extrême-Orient ou du Moyen-Orient, qui ont vu leurs dépenses d’armement exploser, les budgets des principales puissances européennes sont en baisse sensible.
Le recul des efforts d’armement va de pair avec des ambitions impérialistes moins prononcées des puissances européennes sur la scène internationale (à l’exception peut-être de la France, présente au Mali et tentant une percée diplomatique en Afghanistan en réunissant l’ensemble des factions afghanes sous sa tutelle à Chantilly) : elles manifestent une autonomie moins affirmée et ont même amorcé un certain rapprochement envers les États-Unis, une "rentrée dans le rang" partielle et sans doute conjoncturelle.
4.2. Impact sur les tensions entre États européens.
Cela va de pair, au sein de l’UE, avec une tension croissante entre une tendance centripète (un besoin de centralisation plus forte pour faire face à l’effondrement économique) et une tendance centrifuge (tendance au chacun pour soi de chaque État).
Les conditions de la naissance de l'UE avaient été un projet pour contenir l'Allemagne après 1989 ; mais ce dont la bourgeoisie a besoin aujourd'hui, c’est d'une centralisation beaucoup plus forte, une union budgétaire et donc beaucoup plus politique, si elle veut faire face à la crise de la manière la plus efficace possible, ce qui correspond aux intérêts allemands. La nécessité d’une centralisation plus poussée renforce donc le contrôle allemand sur l’ensemble des États européens, dans la mesure où cela permet à l’Allemagne de dicter les mesures à prendre et d’intervenir directement dans le fonctionnement d’autres États européens : "Désormais, l’Europe parle allemand", constatait en 2011 le président du groupe CDU/CSU au Bundestag.
D’autre part, la crise et les mesures drastiques imposées poussent vers un éclatement de l’UE et un rejet de la soumission au contrôle d’un pays quelconque, c’est-à-dire poussent vers le chacun pour soi. La Grande-Bretagne refuse radicalement les mesures de centralisation proposées et dans les pays du sud de l’Europe, un nationalisme anti-allemand croît. Les forces centrifuges peuvent aussi impliquer une tendance à la fragmentation d’États, à travers l’autonomisation de régions comme la Catalogne, l’Italie du nord, la Flandre ou l’Écosse.
Ainsi, la pression de la crise, à travers le jeu complexe des forces centripètes comme centrifuges, accentue le processus de désagrégation de l’UE et exacerbe les tensions entre États.
De manière globale, ce rapport accentue les orientations pointées dans le rapport pour le 19e congrès du CCI et souligne l’accélération des tendances identifiées. Plus que jamais apparaît le caractère de plus en plus absolu de l’impasse historique du mode de production capitaliste. Aussi, la période qui s’est ouverte "tendra à imposer de plus en plus nettement la connexion entre :
- la crise économique, révélant l'impasse historique du mode de production capitaliste,
- et la barbarie guerrière, mettant en relief les conséquences fondamentales de cette impasse historique : la destruction de l'humanité.
Ce lien représente dès aujourd’hui pour la classe ouvrière un point de réflexion fondamental sur le futur que le capitalisme réserve à l'humanité et sur la nécessité de trouver une alternative face à ce système à l’agonie".
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Rubrique:
Bilan, la Gauche hollandaise et la transition au communisme (II)
- 1597 lectures
Dans l’article précédent de cette série, nous avons examiné la manière dont les communistes de gauche, belges et italiens, autour de la revue Bilan dans les années 1930, avaient critiqué les conceptions des conseillistes de conseil hollandais de la phase de transition du capitalisme au communisme. Nous avons examiné principalement les aspects politiques de la période de transition, en particulier les arguments de Bilan qui considérait que les camarades hollandais sous-estimaient les problèmes posés par la révolution prolétarienne et par la recomposition inévitable d’une forme de pouvoir d’État durant la période de transition. Dans cet article, nous allons étudier les critiques portées par Bilan à ce qui constitue l’axe central du livre des communistes hollandais Grundprinzipien Kommunistischer Produktion und Veiteilung (Principes de la production et de la distribution communistes, publiés par le Groep van Internationale Communisten, GIC) : le programme économique de la révolution prolétarienne.
Les critiques de Bilan se concentrent autour de deux aspects principaux :
- Le problème de la valeur et de son élimination ;
- Le système de rémunération dans la période de transition.
La valeur et son élimination
L’auteur des articles de Bilan, Mitchell, commence par affirmer que la révolution prolétarienne ne peut être immédiatement le point de départ du communisme intégral, mais seulement ouvrir une période de transition, à la forme sociale hybride, encore marquée par les "stigmates" du passé, idéologiquement et dans leurs concrétisations les plus matérielles : la loi de la valeur et donc, également, l’argent et les salaires, bien que sous une forme modifiée. En bref, la force de travail ne cesse pas immédiatement d’être une marchandise parce que les moyens de production sont devenus propriété collective. Elle continue à être mesurée en termes de "valeur", cette qualité étrange qui "tout en trouvant sa source dans l'activité d'une force physique, le travail, n'a elle-même aucune réalité matérielle" [1] [403]. Quant aux difficultés posées par la notion de valeur, Mitchell cite Marx dans sa préface au Capital, où il fait remarquer que, en ce qui concerne la forme-valeur : "Cependant, l’esprit humain a vainement cherché depuis plus de 2 000 ans à en pénétrer le secret" [2] [404] (et il est juste de dire que cette question demeure une source de perplexité et de controverse, même parmi les disciples authentiques de Marx …).
Dans son effort pour en pénétrer le secret, pour découvrir ce qui fait qu’une marchandise "vaut" quelque chose sur le marché, Marx, en accord avec les économistes classiques, reconnait que le cœur de la valeur réside dans l'activité humaine concrète, dans le travail effectué au sein d'un rapport social donné - plus précisément, dans le temps de travail moyen incorporé dans la marchandise. Elle n'est pas un pur résultat de l'offre et de la demande, ni de caprices et de décisions arbitraires, même si ces éléments peuvent causer des fluctuations de prix. Elle est en fait le principe régulateur qui se cache derrière l'anarchie du marché. Mais Marx est allé plus loin que les économistes classiques en montrant comment elle est aussi la base de la forme particulière prise par l'exploitation dans la société bourgeoise et celle du caractère spécifique de la crise et de l'effondrement du capitalisme, à savoir une perte complète de contrôle par l'humanité de sa propre activité productive. Ces révélations ont conduit la majorité des économistes bourgeois à abandonner la théorie de la valeur-travail avant même que le système capitaliste soit entré dans sa période de déclin.
En 1928, l'économiste soviétique Isaak I. Roubine, qui allait bientôt être accusé de déviation du marxisme et éliminé comme beaucoup d'autres communistes, a publié une analyse magistrale de la théorie de la valeur de Marx, parue en français en 1978 sous le titre Essais sur la théorie de la valeur de Marx, publié par les Éditions François Maspero. Dès le début du livre, il insiste sur le fait que la théorie de la valeur de Marx est inséparable de sa critique du fétichisme de la marchandise et de la "réification" des rapports humains dans la société bourgeoise - la transformation d'un rapport entre les personnes en un rapport entre les choses : "La valeur est une relation de production entre des producteurs marchands autonomes ; elle prend la forme d’une propriété des choses et elle est en relation avec la répartition du travail social. Ou, si l’on considère le même phénomène d’un autre point de vue, la valeur est la propriété que possède le produit du travail de chaque producteur de marchandises et qui le rend échangeable contre les produits du travail de n’importe quel autre producteur de marchandises, dans un rapport déterminé qui correspond à un niveau donné de la productivité du travail dans les différentes branches de la production. Il s’agit d’un rapport humain qui prend la forme d’une propriété des choses et qui est en relation avec le procès de répartition du travail dans la production. En d’autres termes, il s’agit de rapports de production réifiés entre les hommes. La réification du travail dans la valeur est la conclusion la plus importante de la théorie du fétichisme ; elle explique le caractère inévitable de la "réification" des rapports de production entre les hommes dans une économie marchande." [3] [405]
La gauche hollandaise était certainement consciente du fait que la question de la valeur et de son élimination était la clé de la transition vers le communisme. Son livre constituait une tentative pour élaborer une méthode permettant de guider la classe ouvrière dans le passage d'une société où les produits dominent les producteurs, à une autre société où les producteurs ont la maitrise directe de l'intégralité de la production et de la consommation. Sa démarche était de chercher comment remplacer les relations "réifiées", caractéristiques de la société capitaliste, par la simple transparence des rapports sociaux que Marx évoque dans le premier chapitre du Capital lorsqu'il décrit la future société des producteurs associés.
Comment les camarades hollandais envisageaient-ils d'y parvenir ? Comme nous l'écrivions dans la première partie de cet article (Revue internationale n° 151): "Pour les Grundprinzipien, la nationalisation ou la collectivisation des moyens de production peuvent parfaitement coexister avec le travail salarié et l’aliénation des ouvriers par rapport à ce qu’ils produisent. Ce qui est la clef, cependant, c’est que les travailleurs eux-mêmes, à travers leurs organisations enracinées sur les lieux de travail, disposent non seulement des moyens matériels de production mais de tout le produit social. Pour être sûrs, cependant, que le produit social reste aux mains des producteurs, du début à la fin du processus du travail (décisions sur quoi produire, en quelles quantités, distribution du produit y compris la rémunération du producteur individuel), il faut une loi économique générale qui puisse être sujette à des décomptes rigoureux : le calcul du produit social sur la base de la "valeur" du temps de travail moyen socialement nécessaire".
Pour Mitchell, comme nous l'avons vu, la loi de la valeur persiste inévitablement au cours de la période de transition. C'est évidemment le cas lors de la phase de guerre civile, où le bastion prolétarien "ne peut pas s'abstraire de l'économie mondiale continuant à évoluer sur une base capitaliste" (Bilan 34). Mais il fait aussi valoir que, même dans "l'économie prolétarienne" (et après la victoire sur la bourgeoisie dans la guerre civile), ce ne sont pas tous les secteurs de l'économie qui peuvent être immédiatement socialisés (il avait en tête l'exemple de l'énorme secteur paysan en Russie et dans toute la périphérie du système capitaliste). Il y aura donc échange entre le secteur socialisé et ces vestiges considérables de la production à petite échelle, et cela imposera, avec plus ou moins de force, les lois du marché au secteur contrôlé directement par le prolétariat. La loi de la valeur, au lieu d'être abolie par décret, doit plutôt passer par une sorte de retour historique : "si la loi de la valeur, au lieu de se développer comme elle le fît en allant de la production marchande simple à la production capitaliste, suivait le processus inverse de régression et d’extinction qui va de l’économie "mixte" au communisme intégral". (Bilan 34)
Mitchell estime que les camarades hollandais se trompent en pensant qu'il est possible d'abolir la loi de la valeur simplement par le calcul du temps de travail. D'abord, leur idée de formuler une sorte de loi mathématique comptable, qui permettra d'en finir avec la forme-valeur, se heurtera à des difficultés considérables. Pour mesurer précisément la valeur du travail, il faut établir le temps de travail "social moyen" incorporé dans les marchandises. Mais l'unité de cette moyenne sociale ne peut qu'être du travail non qualifié ou simple, c’est-à-dire du travail réduit à son expression la plus élémentaire : le travail qualifié ou composé doit être réduit à sa forme la plus simple. Et selon Mitchell, Marx lui-même a admis qu'il n'avait pas réussi à résoudre ce problème. En somme, "le phénomène de réduction du travail composé en travail simple (qui est la réelle unité de mesure) reste inexpliqué et […] par conséquent l’élaboration d’un mode de calcul scientifique du temps de travail, nécessairement fonction de cette réduction, est impossible ; probablement même que les conditions d’éclosion d’une telle loi ne s’avéreront réunies que lorsqu’elle deviendra inutile ; c’est-à-dire lorsque la production pourra faire face à tous les besoins et que, par conséquent, la société n’aura plus à s’embarrasser de calculs de travail, l’administration des choses n’exigeant plus qu’un simple enregistrement de matière. Il se passera alors dans le domaine économique un processus parallèle et analogue à celui qui se déroulera dans la vie politique où la démocratie sera superflue au moment où elle se trouvera pleinement réalisée." (Bilan 34)
Peut-être plus importante est la critique de Mitchell selon laquelle, tant à travers les moyens qu'elle propose pour avancer vers les objectifs plus élevés, qu'à travers sa définition des stades plus avancés de la nouvelle société, la vision du communisme qui se dégage des Grundprinzipien renferme en fait une forme déguisée de la loi de la valeur, du fait qu'elle s'appuie sur son essence, à savoir la mesure du travail par le temps de travail social moyen.
Pour étayer cet argument, Mitchell met en garde contre le danger que le "réseau non centralisé" d'entreprises envisagé dans les Grundprinzipien fonctionne en réalité comme une société de production marchande (ce qui n'est pas très différent de la vision anarcho-syndicaliste que les camarades hollandais critiquent à juste titre dans leur livre) : "[Les camarades hollandais] conviennent cependant justement que "la suppression du marché doit être interprétée dans le sens qu’apparemment le marché survit dans le communisme, tandis que le contenu social sur la circulation est entièrement modifié : la circulation des produits sur la base du temps de travail est l’expression du nouveau rapport social" (p. 110). Mais, précisément, si le marché survit (bien que le fond et la forme des échanges soient modifiés), il ne peut fonctionner que sur la base de la valeur. Cela, les internationalistes hollandais ne l’aperçoivent pas, "subjugués" qu’ils sont par leur formulation de "temps de travail" qui, en substance, n’est cependant pas autre chose que la valeur elle-même. D’ailleurs pour eux, il n’est pas exclu que dans le "communisme", on parlera encore de "valeur" ; mais ils s’abstiennent de dégager la signification, du point de vue du mécanisme des rapports sociaux, qui résulte du maintien du temps de travail et ils s’en tirent en concluant que, puisque le contenu de la valeur sera modifié, il faudra substituer à l’expression "valeur", celle de "temps de production", et qui évidemment ne modifiera en rien la réalité économique ; tout comme ils diront qu’il n’y a plus échange des produits, mais passage des produits (pp. 53 et 54). Également : "au lieu de la fonction de l’argent, nous aurons l’enregistrement du mouvement des produits, la comptabilité sociale, sur la base de l’heure de travail social moyenne." (p. 55)" (Bilan 34)
La rémunération du travail et la critique de l'égalitarisme
La critique que fait Mitchell à la défense, par la gauche hollandaise, de l'égalité des rémunérations à travers le système de bons de temps de travail est reliée à une critique plus générale que nous avons examinée dans la première partie de cet article : celle d'une vision abstraite où tout fonctionne en douceur dès le lendemain de l'insurrection. Mitchell reconnaît que les camarades hollandais ainsi que Hennaut partagent la distinction que fait Marx (développée dans la Critique du programme de Gotha) entre les étapes inférieure et supérieure du communisme, et partagent également l'idée que, dans la première étape, il y a encore une persistance du "droit bourgeois". Mais pour Mitchell, les camarades hollandais ont une interprétation unilatérale de ce que Marx disait dans ce document : "Mais outre cela, les internationalistes hollandais faussent la signification des paroles de Marx quant à la répartition des produits. Dans l'affirmation que l'ouvrier émarge au prorata de la quantité de travail qu'il a donnée, ils ne découvrent qu'un aspect de la double inégalité que nous avons soulignée et c'est celui qui résulte de la situation sociale de l'ouvrier (page 81) ; mais ils ne s'arrêtent pas à l'autre aspect qui exprime le fait que les travailleurs, dans un même temps de travail, fournissent des quantités différentes de travail simple (travail simple qui est la commune mesure s'exerçant par le jeu de la valeur) donnant donc lieu à une répartition inégale. Ils préfèrent s'en tenir à leur revendication : suppression des inégalités des salaires, qui reste suspendue dans le vide parce qu'à la suppression du salariat capitaliste ne correspond pas immédiatement la disparition des différenciations dans la rétribution du travail" (Bilan 35, republié dans la Revue internationale n° 131)
En d'autres termes, bien que les camarades hollandais soient en continuité avec Marx qui voyait que les situations différentes dans lesquelles se trouvent les travailleurs individuels signifient une persistance de l'inégalité ("Mais un individu l'emporte physiquement ou moralement sur un autre, il fournit donc dans le même temps plus de travail ou peut travailler plus de temps (…) D'autre part : un ouvrier est marié, l'autre non ; l'un a plus d'enfants que l'autre, etc., etc.", comme le dit Marx dans la Critique du programme de Gotha [4] [406]), ils ignorent le problème plus profond du calcul du travail simple, ce qui veut dire que la rémunération des travailleurs sur la seule base des heures de travail signifie que des travailleurs dans la même situation sociale, mais travaillant avec des moyens de production différents ne seront pas rétribués de la même manière.
Mitchell critique Hennaut pour des motifs similaires : "Le camarade Hennaut apporte une solution semblable au problème de la répartition dans la période de transition, solution qu'il tire également d'une interprétation erronée parce qu'incomplète des critiques de Marx du programme de Gotha. Dans Bilan, page 747, il dit ceci :"l'inégalité que laisse subsister la première phase du socialisme résulte non pas de la rémunération inégale qui serait appliquée à diverses sortes de travail : le travail simple du manœuvre ou le travail composé de l'ingénieur avec, entre ces deux extrêmes, tous les échelons intermédiaires. Non, tous les genres de travail se valent, seules "sa durée" et "son intensité" devant être mesurées ; mais l'inégalité provient de ce qu'on applique à des hommes ayant des capacités et des besoins différents, des tâches et des ressources uniformes". Et Hennaut renverse la pensée de Marx lorsqu'il lui fait découvrir l'inégalité dans le fait que "la part au profit social restait égale - à prestation égale, bien entendu - pour chaque individu, alors que leurs besoins et l'effort déployé pour atteindre à une même prestation étaient différents" tandis que, comme nous l'avons indiqué, Marx voit l'inégalité dans le fait que les individus reçoivent des parts inégales, parce qu'ils fournissent des quantités inégales de travail et que c'est en cela que réside l'application du droit égal bourgeois." (Bilan )
En même temps, la base de ce rejet de l'égalitarisme "absolu" dans les premières phases de la révolution est une critique profonde de la notion même d'égalité : "le fait que dans l'économie prolétarienne le mobile fondamental n'est plus la production sans cesse élargie de plus-value et de capital, mais la production illimitée de valeurs d'usage, ne signifie pas que les conditions sont mûres pour un nivellement des "salaires" se traduisant par une égalité dans la consommation. D'ailleurs, pas plus une telle égalité ne se place au début de la période transitoire, qu'elle ne se réalise dans la phase communiste avec la formule inverse "à chacun selon ses besoins". En réalité l'égalité formelle ne peut exister à aucun moment, tandis que le communisme enregistre finalement l'égalité réelle dans l'inégalité naturelle." (Ibid)
L'adhésion de Marx au communisme a commencé par un rejet du communisme de "caserne" ou vulgaire qui s'était développé dans les premiers temps du mouvement ouvrier et, contre ce genre de "collectivisme au rabais", réalisé dans une certaine mesure par le capitalisme d'État stalinien, il oppose une association des individus libres où sera cultivée en positif "l'inégalité" naturelle ou la diversité.
Les bons de temps de travail et le système de rémunération
L'autre cible de la critique de Mitchell est la vision du GIC selon laquelle rémunérer le travail sur la base du temps de travail - le fameux système de bons de temps de travail - aurait déjà permis de surmonter l'essentiel du salariat. Mitchell ne semble pas être en désaccord avec le plaidoyer de Marx en faveur de ce système dans la Critique du programme de Gotha, car il le cite sans critique dans son article. Il est également d'accord avec Marx en ceci que, dans ce mode de distribution, l'argent a perdu son caractère de ""richesse abstraite" (…) capable de s'approprier n'importe quelle richesse" (Bilan 34). Mais contrairement au GIC, Mitchell souligne la continuité de ce mode de distribution avec le salariat plutôt que sa discontinuité, car il met particulièrement l'accent sur le passage de la Critique du Programme de Gotha où Marx dit franchement que "C'est manifestement ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises pour autant qu'il est échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail et que, par ailleurs, rien ne peut entrer dans la propriété de l'individu que des objets de consommation individuelle. Mais pour ce qui est du partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes : une même quantité de travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme."
En ce sens, il semble que Mitchell estime que les bons de temps de travail sont une sorte de salaire, qu'il ne les considère pas comme un système de qualité supérieure dans les premières étapes de la révolution : le système d'égalité de rationnement dans la révolution russe n'était pas "une méthode économique capable d'assurer le développement systématique de l'économie, mais du régime d'un peuple assiégé qui bandait toutes ses énergies vers la guerre civile". (Bilan 35).
Pour Mitchell, la clé de l'abolition réelle de la valeur ne résidait pas vraiment dans le choix des formes particulières dans lesquelles le travail serait rétribué dans la période de transition, mais dans la capacité à surmonter les horizons étroits du droit bourgeois en créant une situation où, selon les termes de Marx, "toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance" [5] [407]. Seule une telle société pourrait "écrire sur ses drapeaux : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !" [6] [408]". (Bilan 35)
Commentaires sur une réponse à la critique de Mitchell
Les camarades du GIC n'ont pas répondu aux critiques de Mitchell et le communisme de conseils, en tant que courant organisé, a plus ou moins disparu. Mais le camarade américain David Adam, qui a beaucoup écrit au sujet de Marx, Lénine et la période de transition [7] [409], s'identifie dans une certaine mesure avec la tradition représentée par le GIC et Mattick en Amérique. Dans une correspondance avec l'auteur de cet article, il a fait ces commentaires à propos de Mitchell et Bilan : "En ce qui concerne la lecture par Bilan de la Critique du programme de Gotha par Marx, je pense que c'est confus. Bilan identifie clairement la première phase du communisme avec celle de la transition vers le communisme où s'exerce la loi de la valeur, et semble identifier l'existence d'un "droit bourgeois" avec la loi de la valeur. Je pense que cela crée des problèmes, et non des moindres, concernant l'interprétation des Grundprinzipien. Bilan identifie avec la loi de la valeur le genre de comptabilité défendu par la Gauche hollandaise, alors que les Grundprinzipien sont clairs sur le fait qu'ils parlent d'une société socialiste émergeant après la période de la dictature du prolétariat, ce qui est en accord avec Marx. Mitchell semble également penser que la Gauche hollandaise parle d'une phase de transition dans laquelle le marché existe encore, et ce n'est pas le cas. Donc je pense que cela diminue la valeur de la critique faite aux Grundprinzipien, parce que je ne pense pas que celle-ci ait compris Marx. Et cela pourrait signifier que Bilan ne voit pas la nécessité d'une transformation des relations économiques dès le début du processus révolutionnaire, comme si la loi de la valeur ne pouvait tout simplement pas passer par "des changements profonds de nature" et finalement disparaître. Toute l'idée de sa disparition est liée à l'émergence d'un contrôle social efficace sur la production, qui est la première étape à laquelle le communisme s'attache. Mais Bilan semble dire qu'une fois que ces mécanismes de planification auront été élaborés, ils ne seront plus nécessaires. Je ne pense pas que ce soit vrai".
Ici, il y a plusieurs éléments différents :
1. Les camarades hollandais ont-ils toujours été clairs quant à la distinction entre les étapes inférieure et supérieure du communisme ? Nous avons vu que Mitchell accepte, comme eux, de faire cette distinction. Dans l'article précédent, nous avons aussi cité un passage des Grundprinzipien qui reconnaît clairement que la mesure du travail individuel devient moins importante au moment où on arrive au communisme intégral. Mais nous avons vu aussi que les Grundprinzipien contiennent un certain nombre d'ambiguïtés. Comme nous l'avons noté dans la première partie de cet article, ils semblent parler bien trop rapidement d'une société fonctionnant comme une association de producteurs libres et égaux, sans dire toujours clairement s'ils parlent d'un avant-poste prolétarien particulier ou d'une situation où la bourgeoisie a été renversée mondialement.
2. Peut-être la question ici est-elle de savoir si Marx lui-même envisageait l'étape inférieure du communisme comme commençant après ou pendant la dictature du prolétariat. Cela exigerait une discussion beaucoup plus longue. Il est certain que la période de transition, au sens plein du terme, ne peut débuter durant une phase dominée par la guerre civile et la lutte contre la bourgeoisie. Mais à notre avis, même après cette victoire "initiale" politique et militaire sur l'ancienne classe dirigeante, le prolétariat ne peut commencer la transformation communiste positive de la société sur la base de sa domination politique, parce qu'il ne sera pas la seule classe de la société. Nous reviendrons sur ce problème dans un futur article.
3. Est-ce que la mesure de la production et de la distribution en termes de temps de travail est nécessairement une forme de valeur , comme cela ressort de Mitchell lorsqu'il critique les internationalistes hollandais pour être "subjugués" (…) par leur formulation de "temps de travail" qui, en substance, n'est cependant pas autre chose que la valeur elle-même" (Bilan 34). Comme toujours avec la question de la valeur, cela soulève des questions complexes. Peut-il y avoir une valeur sans valeur d'échange ?
Il est vrai que Marx avait été obligé, dans Le Capital, de faire une distinction théorique entre la valeur et la valeur d'échange, "Le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises est par conséquent leur valeur ; et une valeur d'usage, ou un article quelconque, n'a une valeur qu'autant que du travail humain est matérialisé en lui." [8] [410]
Cependant, comme le souligne Roubine, il n'en demeure pas moins que : "la "forme valeur" est la forme la plus générale de l'économie marchande ; elle caractérise la forme sociale acquise par le processus de production à un niveau donné du développement historique. Puisque l'économie politique analyse une forme de production sociale historiquement transitoire, la production marchande capitaliste, la "forme valeur" est l'une des pierres angulaires de la théorie de la valeur de Marx. Comme cela apparaît dans le passage cité ci-dessus, la forme valeur est étroitement liée à la "forme marchandise", c'est-à-dire à la caractéristique fondamentale de l'économie contemporaine, à savoir le fait que les produits du travail sont produits par des producteurs privés et autonomes. C'est seulement par l'intermédiaire de l'échange des marchandises que s'établit la connexion entre les travaux des producteurs." [9] [420]
Les deux aspects, la valeur et la valeur d'échange, n'ont une application générale que dans le contexte des rapports sociaux de la société marchande capitaliste. Une société qui ne fonctionne plus sur la base d'échanges entre unités économiques indépendantes n'est plus régie par la loi de la valeur, si bien que la question qui se pose est de savoir jusqu'à quel point la Gauche hollandaise envisageait la survie des relations d'échange dans la phase inférieure du communisme. Et comme nous l'avons mentionné, il existe aussi des ambiguïtés dans les Grunprinzipien à ce sujet. Précédemment dans cet article, nous avons cité l'argument de Mitchell selon lequel le réseau d'entreprises envisagé par le GIC semble conserver des rapports marchands de ce type. D'autre part, d'autres passages vont dans le sens contraire et il y a de bonnes raisons de penser qu'ils expriment plus fidèlement la pensée du GIC. Par exemple, au chapitre 2, dans la section intitulée "communisme libertaire", le GIC développe une critique de l'anarchiste français Faure, qui indique clairement que le GIC est en faveur de forger l'économie en une seule unité : "On ne peut reprocher au système de Faure de réunir toute la vie économique en une seule unité organique. Cette fusion est l’aboutissement d’un processus que les producteurs-consommateurs doivent effectuer eux-mêmes. Mais pour cela, il faut que soient jetées les bases qui leur en donnent la possibilité." [10] [421]
Il faut ajouter que l'argument de Mitchell selon lequel toute forme de mesure du temps de travail est essentiellement une expression de la valeur n'est pas validé par la démarche de Marx dans ses descriptions de la société communiste. Dans les Grundrisse, par exemple, Marx affirme que "Sur la base de la production communautaire, la première loi économique demeure donc l'économie de temps, ainsi que la distribution rationnelle du temps de travail entre les différentes branches de la production. Cette loi y gagne encore en importance. Mais tout cela diffère fondamentalement de la mesure des valeurs d'échange (des travaux et des produits du travail) par le temps de travail. Les travaux des individus participant à la même branche d'activité et les multiples types de travail ne diffèrent pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. Or, qu'implique simplement la différence quantitative des choses, si ce n'est la qualité elle-même ? Si l'on mesure quantitativement des travaux, c'est qu'ils sont semblables et que leur qualité est la même." [11] [422]
La vraie faiblesse du GIC se trouve, dirions-nous, moins dans ses concessions occasionnelles à l'idée de marché, mais dans sa foi démesurée dans le système comptable. Comme le dit le GIC dans la phrase qui suit le passage cité ci-dessus : "Pour atteindre ce but, ils doivent tenir une comptabilité exacte du nombre d’heures de travail qu’ils ont effectuées, sous toutes les formes, de façon à pouvoir déterminer le nombre d’heures de travail que contient chaque produit. Aucune "administration centrale" n’a plus alors à répartir le produit social ; ce sont les producteurs eux-mêmes, qui, à l’aide de leur comptabilité en termes de temps de travail, décident de cette répartition." [12] [423] Nul doute que le calcul du montant exact du temps de travail effectué par les producteurs est extrêmement important, mais le GIC semble totalement sous-estimer à quel point le maintien du contrôle sur la vie économique et politique au cours de la période de transition est une lutte pour le développement de la conscience de classe, pour la construction consciente de nouveaux rapports sociaux, une lutte qui va beaucoup plus loin que l'élaboration d'un système comptable.
4. Bilan sous-estime-t-il la nécessité d'un changement radical, social et économique, dès le début ? C'est peut-être une critique plus importante. Par exemple, dans la critique par Mitchell de la rémunération égalitaire, celui-ci soutient qu'un tel système nuirait à la productivité du travail et que, pour arriver au communisme, un développement prodigieux des forces productives est nécessaire. Il est certain que la réalisation du communisme repose sur une transformation et un développement profonds des forces productives. Mais la question clé ici est la suivante : sur quelle base ce développement aura-t-il lieu ? Nous savons que le dernier chapitre de l'étude de Mitchell contient un clair rejet du "productivisme", du sacrifice de la consommation des travailleurs au profit du développement de l'industrie et que, tout au long de son existence, ce fut un aspect fondamental de la critique portée par Bilan à la soi-disant "réalisation du socialisme" en URSS. Néanmoins, comme Mitchell insiste tellement sur le fait que le salariat, au moins pour l'essentiel, ne peut pas disparaître jusqu'à un stade beaucoup plus avancé de la transformation révolutionnaire, le doute demeure de savoir si Mitchell ne préconise pas une version plus "ouvrière" de "l'accumulation socialiste".
Dans le dernier numéro de Bilan (n° 46, Décembre-Janvier 1938), un lecteur, répondant à la série d'articles "Problèmes de la période de transition", va jusqu'à rejeter les camarades de Bilan comme un nouveau type de réformistes pour lesquels la révolution ne fera que remplacer un ensemble de maîtres par un autre (voir ci-après, dans "Écho à l'étude de la période de transition", le contenu de cette lettre et la réponse de Mitchell).
Nous pensons évidemment que cette accusation manque à la fois d'esprit de camaraderie et de fondement, mais deux faiblesses principales de l'arsenal théorique de Bilan lui donnent un semblant de réalité : sa difficulté à voir la nature capitaliste de l'URSS, même dans les années 1930, et son incapacité à rompre avec la notion de dictature du parti. Malgré toutes leurs critiques du régime stalinien et leur reconnaissance du fait qu'une forme d'exploitation existait en URSS, les camarades de Bilan restaient toujours attachés à l'idée que la nature collectivisée de l'économie "soviétique" lui conférait un caractère prolétarien, même dégénéré. Cela semble trahir une sorte de difficulté à tirer les conséquences de ce qui était déjà fondamentalement compris par la gauche italienne, à savoir qu'une économie fondée sur salariat ne peut qu'être capitaliste, que la propriété des moyens de production soit "individuelle" ou "collective". Et une conséquence de cette difficulté serait une réticence à voir la lutte contre le salariat comme étant une partie intégrante de la révolution sociale. Et c'est justement un autre aspect de la lutte pour laquelle David Adam appelle au "contrôle social effectif de la production" par les travailleurs eux-mêmes.
En même temps, l'idée que le rôle du parti est d'exercer la dictature du prolétariat (bien qu'en évitant en quelque sorte une imbrication avec l'État [13] [424]) va à l'encontre de la nécessité que la classe ouvrière impose son contrôle à la fois sur la production et sur l'appareil du pouvoir politique. Il est certain que les travailleurs devront beaucoup apprendre pour prendre en charge la production, pas seulement dans le cadre de l'entreprise individuelle, mais dans la société tout entière. La même chose s'applique à la question du pouvoir politique, qui n'est en tous cas pas une sphère séparée du problème de la réorganisation de la vie économique. Il est également vrai que Bilan a toujours compris que les travailleurs devraient apprendre de leurs propres erreurs et qu'ils ne pourraient pas marcher vers le socialisme sous la contrainte. Néanmoins, l'idée de la dictature du parti conserve l'idée plutôt substitutionniste que les travailleurs ne seront en mesure de prendre le plein contrôle de leur destin qu'à un certain moment dans l'avenir, et que jusque-là, une minorité de la classe doit se maintenir au pouvoir "en leur nom".
Précisément, parce que la gauche italienne était un courant prolétarien et non une variante du réformisme, ces faiblesses pouvaient être traitées le moment venu et surmontées, comme elles l'ont été en particulier par la Fraction française et par des éléments au sein du parti formé en Italie en 1943. À notre avis, c'est la Fraction française, plus tard la Gauche Communiste de France, qui a poussé le plus loin ces clarifications et ce n'est pas un hasard si elle a pu, dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, s'engager dans un débat fructueux avec la tradition et les organisations de la gauche communiste hollandaise. Nous y reviendrons dans le prochain article de cette série.
Nous ne prétendons pas avoir résolu toutes les questions soulevées par le débat entre les gauches italienne et hollandaise sur la période de transition. Ces questions - telles que la façon dont la loi de la valeur sera éliminée, comment le travail sera rémunéré, comment les travailleurs garderont le contrôle sur la production et la distribution - restent à clarifier, voire ne peuvent être ni ne seront définitivement résolues qu'au cours de la révolution elle-même. Mais nous pensons que les contributions et les discussions développées par ces révolutionnaires dans une période sombre de défaite de la classe ouvrière restent un point de départ théorique indispensable pour les débats qui seront un jour peut-être utilisés pour guider la transformation pratique de la société.
CD Ward
[1] [411] Bilan 34, republié dans la Revue internationale n° 130.
[2] [412] Préface de la première édition du Capital. Éditions La Pléiade. Œuvres Économie. I. p. 147.
[3] [413] Roubine. Essais sur la théorie de la valeur de Marx, Éditions Maspéro. Chapitre 8, p 111.
[4] [414] Critique du programme de Gotha. Troisièmement, La conséquence : "Et comme le travail productif n'est possible …". https://www.marxists.org/francais/marx/works/1875/05/18750500a.htm [425].
[5] [415] Critique du Programme de Gotha. Idem.
[6] [416] Idem
[7] [417] Par exemple : https://libcom.org/article/karl-marx-and-state [426]; https://www.libcom.org/library/lenin-liberal-reply-chris-cutrone [427].
[8] [418] Marx Le Capital ; Éditions La Pléiade Économie I. Livre Premier ; Marchandise et Monnaie ; La marchandise. p. 565.
[9] [428] Isaak I. Roubine. Essais sur la théorie de la valeur de Marx. Éditions François Maspero. Chapitre 12, p. 160.
[10] [429] Fondements de la production et de la distribution communiste, traduction en français des Grunprinzipien publiée sur le site mondialisme.org [430] ; Chapitre 2 ; Le communisme libertaire.
[11] [431] Marx. Grundrisse. Éditions 10 18. Chapitre de l'argent. Temps de travail et production communautaire, p 181. L'hypothèse de Mitchell selon laquelle la mesure du temps de travail est toujours égale à une valeur est mentionnée dans les critiques aux Grundprinzipien dans notre livre en anglais sur la Gauche germano hollandaise. Le dernier paragraphe de cet article s'exprime en ces termes: "La faiblesse ultime des Grundprinzipien réside dans la question même de la comptabilité du temps de travail, même dans une société communiste avancée qui a dépassé la pénurie. Economiquement, ce système pourrait réintroduire la loi de la valeur, en attribuant au temps de travail nécessaire à la production une valeur comptable plutôt que sociale. Ici, le GIC va à l'encontre Marx, pour qui la mesure standard dans la société communiste n'est plus le temps de travail, mais le temps libre, le temps de loisirs". Ce dernier point est sans aucun doute tiré du passage des Grundrisse où Marx écrit: "La richesse véritable signifie, en effet, le développement de la force productive de tous les individus. Dès lors, ce n'est plus le temps de travail mais le temps disponible qui mesure la richesse" (Grundrisse. Édition 10 18 ; 3. Chapitre du capital ; Chapitre troisième. p. 348). Mais, pour Marx, cela ne signifiait pas que la société cesserait de mesurer le temps qui lui est nécessaire pour subvenir à ses nécessités et pour satisfaire les capacités créatrices de chaque individu. Cela est clairement exprimé dans les Théories sur la plus-value où Marx écrit : "le temps de travail, même après suppression de la valeur d'échange, demeure toujours la substance créatrice de la richesse et la mesure des coûts que la production requiert. Mais le temps libre, le temps disponible, est la richesse même, d'une part pour jouir des produits, d'autre part pour l'activité libre, activité qui n'est pas déterminée, comme le travail, par la contrainte d'une finalité extérieure qu'il faut satisfaire, dont la satisfaction est une nécessité naturelle ou un devoir social, comme on voudra." (Livre IV du Capital. Tome 3. Chapitre 21. Opposition aux économistes. Le temps libre considéré comme la véritable richesse. Éditions sociales. P. 301).
[12] [432] Fondements de la production et de la distribution communiste. Ibid
[13] [433] Les contradictions de Bilan sur "la dictature du parti" sont examinées de façon plus développée dans l'article de la série "Le communisme n’est pas un bel idéal, mais une nécessité matérielle", intitulé "Les années 1930: le débat sur la période de transition" et publié dans le n° 127 de la Revue internationale.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [434]
Rubrique:
Un lecteur répond à Bilan sur la période de transition (Bilan 46, Décembre-Janvier 1938)
- 1517 lectures
Nous avons reçu d'un lecteur de Clichy une lettre critique que nous publions intégralement, en la faisant suivre d'un bref commentaire de notre collaborateur. Notre impatient correspondant voudra bien nous excuser de n'avoir pu faire paraître sa lettre dans notre numéro précédent puisqu'elle nous est parvenue précisément au moment où ce numéro sortait de presse.
À propos de la période de transition
Après la publication dans Bilan du résumé du livre des communistes de gauche hollandais sur "Les fondements de la production et de la distribution communistes" par Hennaut, d'aucuns pouvaient penser que les réformistes de droite ou de gauche étaient définitivement désarmés et qu'ils n'oseraient plus broncher. C'était mal les connaître. En effet, dans le numéro qui publiait la fin du résumé, leurs critiques se firent entendre : les camarades hollandais ainsi que Hennaut ne résonnaient pas en marxistes. Ensuite, nous eûmes l'étude marxiste de Mitchell sur les "Problèmes de la période de transition". Cette étude avait, bien entendu, pour but de démontrer l'utopie antimarxiste de ceux qui croient que la révolution prolétarienne libérera réellement les travailleurs de l'exploitation sous toutes ses formes. Aussi ne faut-il pas s'étonner que Mitchell se soit évertué tout au long de son article à prouver avec forces citations que cette révolution ne servira qu'à faire changer de maître aux prolétaires qui la feront – tout comme dans les révolutions passées. Nous reconnaissons le point de vue traditionnel des réformistes de tout poil. D'ailleurs Mitchell a pris soin de nous avertir dans son "exposé introductif" que son travail traiterait les points suivants : "a) des conditions historiques où surgit la révolution prolétarienne ; b) de la nécessité de l'État transitoire ; c) des catégories économiques et sociales qui, nécessairement, survivent dans la phase transitoire ; d) enfin de quelques données quant à une gestion prolétarienne de l'État transitoire".
Une fois ces points énoncés, il était facile d'imaginer ce que serait l'article. En effet, Mitchell ne se gêne nullement pour affirmer, a priori, la survivance après la révolution "des catégories économiques et sociales qui, nécessairement (!) survivent dans la phase transitoire". Cette affirmation, à elle seule, suffisait grandement à tout esprit averti pour concevoir ce qui suivrait. Ce qui étonne le plus dans l'article de Mitchell, c'est l'abondance des citations qu'un marxiste révolutionnaire peut à tout instant retourner contre ce qu'il tente de prouver et de justifier. Il n'y a pas besoin de cinquante pages de Bilan pour réduite à néant l'argumentation savante du réformiste Mitchell. Tous ceux qui ont lu Marx et Engels savent que, pour ces derniers, la fameuse période de transition marque la fin de la société capitaliste et la naissance d'une société entièrement nouvelle dans laquelle l'exploitation de l'homme par l'homme aura cessé d'exister ; c'est-à-dire où les classes auront disparu et où l'État en tant que tel n'aura plus de raison d'être. Or, dans la société de transition telle que l'entendent Mitchell et tous les réformistes avérés ou non, l'exploitation du prolétariat subsiste et ce, de la même façon qu'en régime capitaliste : par le moyen du salariat. Il y aura dans cette société une échelle des salaires …. Tout comme actuellement ! Ce qui permet de socialiser (?) d'abord les branches les plus avancées de la production, puis, on ne sait pas quand ni comment, toute la production industrielle et agricole. Autrement dit, pendant la phase transitoire, une partie des travailleurs continueront à être exploités par des particuliers, les autres étant désormais exploités par l'État-Patron. Partant de ce point de vue, la phase supérieure du communisme correspondrait à l'étatisation intégrale de la production, au capitalisme d'État tel que nous le voyons fonctionner en Russie ! Le plus révoltant c'est qu'on ose s'appuyer sur Marx et Engels pour défendre un tel point de vue. On sait que Staline osa également, dans son discours du 23 juin 1931, s'appuyer sur Marx pour justifier l'incroyable inégalité des salaires qui règne en URSS et, tout comme Mitchell, en invoquant la qualité du travail fourni. Or Marx s'est expliqué clairement à ce sujet dans sa Critique du programme de Gotha. Est-il besoin de rappeler que, pour Marx, l'inégalité qui subsiste dans la première phase du communisme ne proviendra nullement, comme le pensent les Mitchell, de l'inégalité dans la rétribution du travail, mais simplement du fait que les ouvriers ne vivent pas tous de la même façon : "un ouvrier est marié, dit Marx, l'autre non ; l'un a plus d'enfants que l'autre, etc., etc. À égalité de travail et par conséquent à égalité de participation au fonds social de consommation, l'un reçoit effectivement plus que l'autre, etc… Pour éviter toutes ces difficultés, le droit devrait être non pas égal, mais inégal." Ceci est trop clair pour qu'il soit nécessaire d'insister.
On sait que, d'après Marx, "le salariat est la condition d'existence du capital", c'est-à-dire que si l'on veut tuer le capital, il faut abolir le salariat. Mais les réformistes ne l'entendent pas ainsi : la révolution consiste pour eux à faire passer progressivement tout le capital entre les mains de l'État afin que celui-ci devienne le seul maître. Ce qu'ils veulent c'est remplacer le capitalisme privé par le capitalisme d'État. Mais ne leur parlez pas d'abolir l'exploitation capitaliste, de détruire la machine étatique qui sert qui sert à maintenir cette exploitation : les prolétaires doivent faire la révolution uniquement pour changer de maître. Tous ceux qui conçoivent la révolution comme un moyen de se libérer de l'exploitation sont de vulgaires utopistes. Avis aux ouvriers révolutionnaires !
Réponse de Mitchell
Rien de plus pénible que de répondre à une critique qui prend la liberté de s'exercer contre une matière qu'elle ne s'est pas ou s'est imparfaitement assimilée et qui croit d'autant plus facilement pouvoir donner des formulations justes mais en réalité purement illusoires.
Rassurons immédiatement notre contradicteur sur notre pseudo "réformisme de gauche" : tout ce qu'il invoque contre nous pour justifier ce "réformisme" est précisément combattu dans notre étude de la manière la moins équivoque possible. Au surplus, il ne peut suffire que notre correspondant nous reproche "l'abondance" des citations, mais il lui faut prouver ce qu'il insinue, à savoir que ces citations ont une signification contraire à celle que nous leur donnons. S'il ne peut apporter cette démonstration, il lui est encore loisible, s'il aime les solutions faciles et simplistes, de contester le bien-fondé de certaines conceptions, par exemple des remarques de Marx quant à la nécessité de tolérer temporairement la rémunération inégale du travail dans la période transitoire. Il peut, dans ce cas, "répudier" Marx, mais non déformer sa pensée.
Sur la question de la rémunération du travail, puisque notre contradicteur est d'avis que Marx ne l'a pas développée comme nous l'affirmons, qu'il veuille donc recevoir toute la partie de notre travail où nous traitons de la mesure du travail (Bilan n° 34, pages 1133 à 1138) et toute la partie où nous traitons de la rétribution du travail, particulièrement à partir du bas de la page 1157 jusqu'au haut de la deuxième colonne de la page 1159 (n°35).
En outre, n'en déplaise au camarade, c'est Marx qui affirme la survivance d'une transition des catégories capitalistes comme la valeur, l'argent, le salaire puisque la période de dictature du prolétariat "porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle sort" (Voir Critique du Programme de Gotha et page 1137 de Bilan).
D'autre part, sur le problème de l'État, comment peut-on nous poser en défenseurs du capitalisme d'État sur la base de ce que nous avons développé dans la deuxième partie de notre travail ? (Bilan n° 31, page 1035)
Si notre correspondant ne partage pas notre opinion sur cette question capitale, qu'il donne au moins la sienne et s'engage dans la voie de la critique positive.
Mitchell
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [434]
Questions théoriques:
- Période de transition [273]
Rubrique:
Revue Internationale 2014
- 1711 lectures
Première Guerre Mondiale - numéro spécial
- 1425 lectures
100 ans de décadence du capitalisme
- 1931 lectures
Depuis un siècle, nous nous trouvons à un nouveau carrefour dans l'histoire de l'humanité. La classe révolutionnaire a très tôt déjà et avec une clarté aiguë qualifié cette époque charnière avec la formule: "socialisme ou barbarie". La lucidité de l'analyse marxiste que recèle ce slogan et qui s'exprime en lui, ne doit cependant pas être réduite à une formule creuse. C'est pourquoi, nous tenons à en souligner ici brièvement l'importance historique et la profondeur essentielle. En nous penchant sur les origines obscures et dissimulées du genre humain, nous ne pouvons qu'être stupéfaits et impressionnés par les étapes considérables qui ont permis à l'Homme d'opérer son émergence du monde animal et qui ont suivi cette émergence: les langues, l'écriture, les danses, l'architecture, la production d'une profusion de biens, sa capacité à se référer à la diversité et à la profondeur des besoins moraux, culturels, intellectuels et à la valeur de ces besoins, tout cela reflétant une richesse culturelle et une accélération de l'histoire qui nous fait frémir. Mais si nous portons notre attention sur les différentes époques de l'histoire humaine, nous devons aussi reconnaître qu'il n'y pas eu, et qu'il n'y a pas de développement continu et progressif. Encore plus dramatiquement, après l'avènement des sociétés de classes et la naissance des grandes "cultures" nous devons conclure que presque toutes ces dernières ont irrémédiablement disparu et que seules quelques-unes se sont transformées en quelque chose de nouveau. Nous constatons de nombreuses époques de régression culturelle et d'oubli des acquis, généralement accompagnées d'un abrutissement moral des hommes et de la brutalisation énorme des rapports humains. A la base des progrès accomplis par l'espèce humaine réside sa capacité à transformer la nature en vue de la satisfaction de ses besoins, en premier lieu matériels, et dans sa capacité à améliorer et développer ses moyens et techniques de production, ce que Marx appelle les "forces productives". C'est fondamentalement le degré de développement de ces forces productives et la division du travail qu'elles impliquent qui déterminent la façon dont s'organise la société pour les mettre en œuvre, les "rapports de production". Lorsque ces derniers constituent le cadre le plus adéquat au développement des premières, la société connaît un épanouissement, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et moral. Mais lorsque ces rapports de production deviennent une entrave à la poursuite du développement des forces productives, la société connaît des convulsions croissantes et se trouve menacée par la barbarie. Pour ne prendre qu'un exemple historique: un des piliers de l'Empire romain était l'exploitation des esclaves, notamment pour les travaux agricoles, mais lorsque de nouvelles techniques agricoles ont fait leur apparition, elles ne pouvaient être mises en œuvre par des producteurs ayant un statut de bétail ce qui constitue une des causes de la décadence et de l'effondrement de cet Empire.
Aujourd'hui, nous pouvons voir l'éclat des grands bonds culturels,1 de la révolution néolithique,, jusqu'à la Renaissance, l'Humanisme et la Révolution russe comme un prélude à la révolution mondiale. Ces bonds culturels sont à chaque fois le résultat de longues périodes de lutte, où les nouveaux rapports sociaux devaient triompher des anciens. Ces grands bonds culturels nous portent vers le prochain saut: la première socialisation mondiale consciente, le socialisme ! Le marxisme, la théorie dont s'est doté le prolétariat dans son combat contre le capitalisme, a la capacité de porter un regard lucide et non mystifié sur l'histoire et de reconnaître les grandes tendances de celle-ci. Cela ne signifie pas qu'il peut lire le futur dans une boule de cristal. Nous ne pouvons pas prédire quand se produira la révolution mondiale, ni même si elle pourra effectivement avoir lieu. Cependant, nous devons défendre et comprendre en profondeur, contre toutes les résistance et incompréhensions qui affectent même certains révolutionnaires, l'énorme importance historique que constitue l'entrée du capitalisme dans sa décadence. L'alternative devant laquelle nous nous trouvons depuis 100 ans peut se résumer ainsi: soit effectuer le prochain saut social et culturel, le socialisme soit la barbarie. La gravité de cette alternative est plus dramatique qu'à n'importe quelle époque connue jusqu'à aujourd'hui du fait que l'accroissement des contradictions entre les forces productives et les rapports de production ouvre la possibilité non seulement du déclin social et culturel, mais de la destruction totale de l'espèce humaine. Pour la première fois dans l'histoire, la question de l'existence-même de l'espèce humaine est en cause dans la décadence d'un mode de production. En même temps, il existe des possibilités historiques immenses pour un développement ultérieur: l'entrée dans la "véritable" histoire consciente de l'humanité. Le modèle capitaliste de socialisation est celui qui a connu la plus grande réussite dans l'histoire de l'humanité. Le capitalisme a absorbé en lui tous les milieux culturels des autres sociétés (pour autant qu'il ne les ait pas détruits) et a créé pour la première fois une société mondiale. La forme centrale de l'exploitation est le travail salarié, permettant l'appropriation et l'accumulation du surtravail dont l'appropriation gratuite du travail coopératif énormément productif, du travail associé, socialisé. C'est ce qui explique l'incomparable explosion technique et scientifique liée à l'histoire de la montée du capitalisme. Mais l'une des particularités de la socialisation capitaliste c'est qu'elle s'est réalisée de façon inconsciente, déterminée par des lois qui, si elle sont l'expression de rapports sociaux déterminés, l'échange force de travail contre salaire, entre les producteurs et les détenteurs des moyens de production, se présentent comme "naturelles", "immuables" et donc extérieures à toute volonté humaine.. C'est dans cette vision de la réalité mystifiée, réifiée, où les être humains et les rapports entre eux deviennent des "choses", que l'augmentation considérable des ressources matérielles, des forces productives apparait comme un produit du capital et non comme le produit du travail humain. Cependant, avec la conquête du monde, il s'avère que la terre est ronde et finie. Le marché mondial est créé (après la destruction des formes alternatives de production, telles que la production textile chinoise, indienne et ottomane). Même si le succès du mode de production capitaliste constitue une étape progressive dans l'histoire humaine, le saut de la révolution industrielle signifie pour la majorité de la population du centre du capitalisme la destruction des formes de vie existant précédemment ainsi qu'une exploitation féroce.alors que dans de grandes parties du reste du monde, il signifie les épidémies, la faim et l'esclavage. Le capitalisme est sans doute le rapport d'exploitation le plus moderne, mais il est finalement tout aussi parasite que ses prédécesseurs. Pour maintenir en marche la machine de l'accumulation, la socialisation capitaliste nécessite toujours plus de matières premières et de marchés, de même qu'il doit pouvoir compter sur une réserve d'êtres humains contraints de vendre leur force de travail pour survivre. C'est pour cela que sa victoire sur les autres modes de production passait par la ruine et la famine des anciens producteurs.
Le capitalisme se présente comme l'objectif et l'apogée du développement humain. Selon son idéologie, il n'y aurait rien en dehors de lui. Pour ce faire, cette idéologie doit occulter deux choses: d'une part que le capitalisme dépend historiquement au plus haut degré des rapports de production et du milieu extra-capitalistes, d'autre part que la socialisation capitaliste, comme toutes les formes qui l'ont précédée dans l'histoire de l'humanité, n'est qu'une étape dans le processus du devenir conscient de l'humanité. La force motrice de l'accumulation produit en permanence des contradictions internes, qui se déchargent de façon éruptive dans les crises. Dans la phase ascendante du capitalisme, ces crises étaient surmontées par la destruction du capital excédentaire et la conquête de nouveaux marchés. Le nouvel équilibre s'accompagnait d'une nouvelle extension des rapports sociaux capitalistes, mais avec le partage du marché mondial entre les puissances centrales du capitalisme, celui-ci atteint, dans les relations mondiales, une limite. A ce moment-là, les grands États nationaux ne peuvent poursuivre leur conquête du monde qu'en se trouvant face à face ; le gâteau étant entièrement partagé, chacun ne pouvait accroitre sa propre part de celui-ci qu'en réduisant celle des autres. Les États développent leurs armements et fondent l'un sur l'autre dans la première guerre mondiale. Les forces productives enchainées par les rapports de production historiquement dépassés se retournent dans la boucherie mondiale en force destructrice dotée d'un potentiel de destruction incroyable. Avec l'entrée du capitalisme dans sa décadence, la guerre devient une guerre de matériels soumettant l'essentiel de la production aux besoins militaires. La machine aveugle de destruction et d'anéantissement entraîne le monde entier dans l'abîme. Bien avant 1914, la gauche de l'Internationale socialiste, les forces révolutionnaires autour de Rosa Luxemburg et de Lénine, ont pris en main de toutes leurs forces la lutte contre la menace du massacre impérialiste. Le marxisme vivant, c'est-à-dire le véritable marxisme, qui n'est pas enfermé dans des dogmes et des formules toutes faites valables de tout temps, a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle guerre entre les États-nations, semblable aux précédentes, mais que celle-ci marquait l'entrée dans la décadence du capitalisme. Les marxistes savaient que nous étions à une croisée des chemins historique (où nous nous trouvons toujours), qui menace pour la première fois de devenir une lutte pour la survie de l'espèce entière. L'entrée du capitalisme dans sa décadence il y a 100 ans est irréversible, mais cela ne signifie pas l'arrêt des forces productives. En réalité, ces forces sont tellement entravées et comprimées par la seule logique de l'exploitation capitaliste que le développement de la société est aspiré dans un tourbillon de plus en plus barbare. Seule la classe ouvrière est capable de donner à l'histoire une direction différente et de construire une nouvelle société. Avec une brutalité inimaginable jusqu'alors nous avons connu la tendance pure de la barbarie capitaliste après la défaite du soulèvement révolutionnaire des années 1917-23. Le cours à une autre guerre mondiale était ouvert, les hommes ont été réduits à des numéros et des matricules, enfermés dans des camps en vue d'une exploitation meurtrière ou de leur assassinat pur et simple. Les meurtres de masse staliniens ont été surpassés par la folie exterminatrice des nazis mais la bourgeoisie "civilisée" elle-même n'a pas voulu rater ce rendez-vous de la barbarie: ce fut l'utilisation de la bombe atomique "démocratique" rasant deux villes deux villes du Japon et infligeant aux survivants d'horribles souffrance. La machine de l'État capitaliste n'a « appris » de l'histoire que dans la mesure où elle s'interdit à elle-même l'autodestruction (la bourgeoisie ne va pas tout simplement se suicider pour laisser la scène de l'histoire au prolétariat), mais c'est seulement le retour de la classe ouvrière après 1968 qui offre une garantie contre le cours ouvert à la guerre. Cependant, si la classe ouvrière a pu barrer le chemin d'un nouvel holocauste mondial, elle n'a pu, pour autant imposer sa propre perspective. Dans cette situation, où aucune des deux classes déterminantes de la société ne pouvait apporter de réponse décisive à une crise économique irréversible et de plus en plus profonde, la société a connu de façon croissante un véritable pourrissement sur pieds, une décomposition sociale croissante rendant encore plus difficile l'accession du prolétariat à une claire conscience de sa perspective historique, une perspective qui était largement répandue dans ses rangs il y a un siècle.
Il y a cent ans et depuis lors, la classe ouvrière a été confrontée à une tâche historique énorme. La classe du travail associé, la classe ouvrière, en tant que porteuse de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, en tant que classe centrale dans la lutte pour l'abolition des classes, doit s'élèver contre cette barbarie. Dans la lutte contre la barbarie nihiliste et amorale du capitalisme, elle est l'incarnation de l'humanité prenant conscience d'elle-même. Elle est la force productive encore enchaînée de l'avenir. Elle recèle en elle le potentiel d'un nouveau bond culturel. Dans la lutte contre l'entrée en décadence du capitalisme toute une génération de révolutionnaires est apparue au plan mondial pour opposer à la socialisation dénaturée et réifiée du capitalisme l'association consciente de la classe ouvrière – guidée par le phare de l'Internationale Communiste.
Avec la révolution russe, elle a pris en main la lutte pour la révolution mondiale. Cette grande tâche d'assumer sa responsabilité pour l'humanité reste toujours pour nous, près de 100 ans après, électrisante et enthousiasmante. Cela montre que même face à la menace d'abrutissement s'élève une indignation morale au cœur de la classe ouvrière, qui est encore une boussole pour nous aujourd'hui. La classe ouvrière souffre avec l'ensemble de la société sous le fardeau de la décadence. L'atomisation et l'absence de perspective attaquent notre propre identité. Dans les confrontations à venir, la classe ouvrière démontrera si elle est capable de reprendre à nouveau conscience de sa tâche historique. C'est peut-être une courte étape historiquement que de passer de l'indignation morale à la politisation de toute une génération. Un nouveau bond culturel dans l'histoire de l'humanité est possible et indispensable, c'est ce que nous enseigne l'histoire vivante.
CCI
1Soyons clair que nous regroupons sous le terme de "culture" tout ce qui fait une société donnée: sa façon de se reproduire matériellement, mais aussi l'ensemble de sa production artistique, scientifique, technique, et morale.
Rubrique:
L'art et la propagande
- 11495 lectures
La vérité et la mémoire
Une visite à l'exposition d'artistes de guerre britanniques, "La vérité et à la mémoire", qui s'est tenu au Musée de Guerre Impérial de Londres en 2014, suscite des réflexions concernant la relation complexe entre l'art, la politique et la propagande.
Pour commencer, il y a un contraste saisissant entre les peintures de "La vérité et la mémoire" et l'exposition spéciale conventionnelle du rez-de-chaussée dédiée à la Première Guerre mondiale 1. Là où l'art est brut, poignant, l'exposition spéciale conventionnelle du musée est insipide et incolore. Dans les juxtapositions d'uniformes militaires, d'armes, les reproductions d'affiches de propagande – un film montrant des champs boueux – il n'y a rien qui soit à même de choquer même le spectateur le plus sensible. Il y a des casques et des vestes destinées aux visiteurs pour être essayées ou pour prendre des selfies, mais il ne faut surtout pas rappeler ce que cette guerre fut vraiment, l'horreur et la puanteur des cadavres dans les tranchées. La Première Guerre mondiale a été assainie et empaquetée pour la consommation touristique et il semble peu probable que ceux qui visitent l'exposition du rez-de-chaussée apprendront beaucoup ; ils n'apprendront en fait rien du tout.
Ce n'est peut-être pas étonnant si l'exposition sur la Première Guerre mondiale, impossible à rater au rez-de-chaussée, est remplie par une file d'attente de familles, tandis que l'exposition sur l'art de guerre, discrètement cachée au troisième étage derrière des portes vitrées opaques, est presque vide. Cette exposition se divise en deux parties, situées sur les côtés opposés du musée : une partie appelée "La vérité" expose des peintures produites pendant le conflit, surtout par des artistes employés par le Bureau de Propagande de Guerre britannique et qui, dans certains cas, servaient en tant que soldat ; l'autre partie, appelée "la Mémoire", contient des peintures produites après la guerre, certaines officielles, d'autres non. Il faut dire que cette section est de loin la moins intéressante, artistiquement et pour ce qu'elle a à dire de la guerre elle-même. Les images sont, pour la plupart, immobiles et presque paisibles ; elles semblent éloignées de la réalité, manquant de réalisme, comme si tant l'artiste que les spectateurs – et certainement l'État – ne voulaient pas se rappeler, mais oublier, ou au moins gommer le souvenir en reléguant prudemment la guerre dans le passé. Seules deux toiles nous frappent avec force. Une, "Une batterie bombardée" de Percy Wyndham Lewis (qui a servi dans l'artillerie) montre les soldats s'affairant sous le feu, réduits à des personnages filiformes semblables à la machine, tandis que ceux qui sont extérieurs à la zone dangereuse sont détachés, indifférents.

L'autre toile, "A l’assaut" par John Nash (le frère de l'artiste beaucoup plus connu Paul Nash) évoque la futilité des assauts sans fin qui se sont soldés par des dizaines de milliers de morts et un résultat militaire nul ; il y a quelque chose d'affreux dans la marche désespérée des soldats vers la mort certaine, d'autant plus quand nous savons que l'objet de sa toile est une attaque menée par sa propre unité, les 1st Artists Rifles, qui se termina en ne laissant guère un seul homme vivant ou indemne.

On est enclin à penser qu'après la guerre, pour la plupart, les gens ont voulu oublier ou, au moins, retourner à la vie en laissant la guerre derrière eux. À penser aussi que les gouvernements étaient pour le moins heureux qu'il en soit ainsi parce que la Première Guerre mondiale avait discrédité – aux yeux de beaucoup - la société capitaliste et les gouvernements qui l'ont assumée.
Société, idéologie, recherche de la vérité
Plus que n'importe quelle société de classes l'ayant précédée, la société bourgeoise a une relation paradoxale à la vérité. Ceci est dû à deux facteurs : d'une part les conditions et les besoins de la production industrielle ; d'autre part les caractéristiques spécifiques de domination de classe bourgeoise.
Le capitalisme est le premier mode de production qui ne peut pas vivre sans constamment révolutionner et bouleverser le procès de production à travers la mise en œuvre d'innovations scientifiques et techniques. Au début, alors que la société bourgeoise commence à apparaître au sein de sa coquille féodale, ce n'est pas immédiatement visible : En Angleterre l'industrie textile de la laine au 13ème siècle commence à rompre ses liens contraignants avec le système des guildes féodales, mais la technologie demeure en grande partie inchangée. La révolution est sociale, pas encore technique, basée sur les nouvelles façons d'organiser la production et le commerce. Au 17ème siècle, la science expérimentale a pour but de contribuer à l'amélioration de la production et, au 18ème siècle, la recherche scientifique sur la nature est appliquée à l'industrie et devient une force productive à part entière. Aujourd'hui, la mécanique quantique et la théorie de relativité peuvent sembler abstruses et même bizarres – néanmoins, une multitude de produits dans l'utilisation quotidienne dépendent de leurs résultats.
Le capitalisme dépend donc de la science. Mais la science elle-même repose sur deux piliers : la supposition qu'un monde existe indépendant de la pensée, qu'elle soit humaine ou divine ; et la conviction qu'il est possible de comprendre ce monde matériel à travers la recherche et le libre débat 2. Une condition préalable pour le développement du capitalisme et de la société bourgeoise est donc la victoire de Copernic et de Galilée sur l'Église catholique et l'Inquisition : on ne peut pas permettre à l'Église catholique de maintenir son monopole de la pensée.
L'autorité de classe sous le capitalisme est aussi unique. En effet, la classe bourgeoise est la première dans l'histoire à feindre que sa domination de classe n'existe pas, la première à justifier sa propre autorité en la basant sur "la volonté du peuple". La société bourgeoise est donc la plus hypocrite de l'histoire.
Pourtant, s'il n'y avait que cela, une telle domination ne survivrait pas longtemps. La bourgeoisie domine, mais cela ne doit pas se voir ; son hypocrisie doit être sincère. La recherche de la vérité ne peut pas non plus être limitée au domaine de la science, sans embrasser la sphère sociale et artistique, car la science et l'art ne sont pas deux mondes séparés, ils ne sont pas du tout fondés sur des qualités antithétiques ou même différentes de l'esprit humain. Ainsi la bourgeoisie est contrainte de laisser libre cours à la recherche de la vérité autant dans le domaine artistique que dans le domaine scientifique, sous peine de laisser l'avantage à ses concurrents. Ce furent les États-Unis, pas l'Allemagne nazie, qui a réussi dans la production de la bombe atomique.
Il y a une autre caractéristique nouvelle de la société capitaliste : pour la première fois, la classe révolutionnaire est une classe exploitée. Plus important encore, cette classe exploitée est une classe cultivée. Pour la première fois, la classe exploitée doit être instruite pour s'adapter aux complexités de la production capitaliste : les travailleurs doivent pouvoir lire et écrire, prendre en charge de plus en plus des tâches techniques et sociales complexes.
Le capitalisme lui-même instruit et forme la masse des travailleurs dans les compétences nécessaires, à la maîtrise de l'organisation sociale. Ce faisant il les rend aptes à se revendiquer de l'héritage de la connaissance artistique, scientifique et technique de toute l'humanité et de ses réalisations qu'ils utiliseront pour satisfaire les besoins humains, y compris les besoins culturels humains. Plus encore : dans ce qu'elle a montré de meilleur d'elle-même, la classe des prolétaires ne s'est jamais satisfaite des restes de la table de la culture bourgeoise, elle a voulu comprendre cette culture et la faire sienne. "Le marxisme a acquis une importance historique en tant qu'idéologie du prolétariat révolutionnaire du fait que, loin de rejeter les plus grandes conquêtes de l'époque bourgeoise, il a - bien au contraire - assimilé et repensé tout ce qu'il y avait de précieux dans la pensée et la culture humaines plus de deux fois millénaires" 3.
Plus la présence de cette classe cultivée, révolutionnaire et exploitée est importante dans la société, moins la bourgeoisie est à même de s'appuyer seulement sur le mensonge et la répression. Ce n'est que dans des régimes où les ouvriers ont été écrasés - les régimes comme l'Allemagne nazie ou l'URSS staliniste – qu'il est possible à la propagande de ne compter idéologiquement que sur le knout.
La classe dirigeante britannique, peut-être plus que n'importe quelle autre, est consciente de cette situation étrange, changeante et contradictoire ; elle est consciente qu'elle doit développer sa propagande dans deux directions. Nous sommes presque tentés de répondre au célèbre dicton de Winston Churchill selon lequel, "En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être assistée par un garde du corps de mensonges" en le retournant : "les mensonges sont si précieux qu'ils doivent être entourés par un garde du corps de vérité".
L'art et la propagande
"Le vent d'est se lève, Watson." "Je ne crois pas, Holmes. Il fait très chaud." "Cher vieux Watson ! Vous êtes le seul point fixe d’une époque changeante. Un vent d’est se lève néanmoins : un vent comme il n’en a jamais soufflé sur l’Angleterre. Il sera froid et aigre, Watson ; bon nombre d’entre nous n’assisteront pas à son accalmie. Mais c’est toutefois le vent de Dieu; et une nation plus pure, meilleure, plus forte surgira à la lumière du soleil quand la tempête aura passé." 4
Ces mots proviennent de la toute fin de la dernière nouvelle de "Sherlock Holmes", Son dernier coup d’archet, par Arthur Conan Doyle, dans laquelle Holmes déjoue un maître espion allemand juste avant l'éruption de la guerre. Le Holmes fictif ne fait ici que répercuter des sentiments qui ont été exprimés par des personnages réels lors de l'éclatement de la guerre : Collins-Baker, le Conservateur à la Galerie nationale, écrivant en août 1914, a cru que l'art tirerait profit "d'une guerre purificatrice" 5 et ceci n'était pas un point de vue rare dans l'establishment britannique qui espérait que la guerre "régénérerait" l'art et la société et en les débarrassant des perturbations à la fois du Cubisme, du Modernisme, et de tout ce qui constituait une offense au prétendu "bon goût".
Des guerres précédentes avaient été célébrées "avec réalisme" et patriotisme comme appartenant à une série d'engagements héroïques, comme cela avait été le cas avec la Guerre de Crimée par exemple.

Sans aucun doute, l'aile réactionnaire de la classe dirigeante britannique et son entreprise artistique s'attendaient à ce qu'une telle sorte de peinture étouffe les influences étrangères, décadentes et corruptrices. Mais celle-ci s'est révélée être un genre mourant. Comme nous entrons dans l'exposition une illustration de cela s'offre symboliquement à nous, avec le "2e bataillon des "Ox & Bucks" battant la Garde prussienne à Nonne Bosschen" de William Barnes Wollen.

En effectuant un pas dans la pièce suivante, nous nous trouvons dans un monde totalement différent et ici nous voulons nous centrer sur l'évolution de deux artistes qui ont suivi des directions diamétralement opposées du point de vue artistique, comme conséquence de leur expérience de guerre : CRW Nevinson et William Orpen.
 Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.
Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.

Nevinson a entièrement destiné son art en vue d'en faire un acte d'accusation de la guerre et de ses motivations. À propos de sa peinture "La Patrie" (1916) il a écrit "je considère cette toile, tout à fait indépendamment de comment elle est peinte, comme l'expression d'une perspective absolument NOUVELLE sur le soi-disant "sacrifice" que constitue la guerre. C'est le dernier mot sur "l'horreur de guerre" pour les générations à venir" 7.
Les peintures de Nevinson ont été bien reçues quand il les a exposées en novembre 1916, malgré le fait que son style moderne et "étranger" constituait l'illustration de tout ce que le côté le plus patriotique et réactionnaire de la société britannique abhorrait. Mais après deux ans de guerre, la fatigue et la désillusion qu'elle engendrait s'installaient et la critique féroce de Nevinson captait l'opinion mieux que la propagande gouvernementale officielle. Les principaux critiques ont accepté que "des méthodes modernes devenaient nécessaire pour dépeindre la guerre moderne" et même le Times a vu dans son travail "un cauchemar de non réalité insistante, fausse mais réelle, quelque chose qui arrive certainement, mais auquel notre raison ne consentira pas". 8

Une autre peinture qui a fait sensation quand elle a été exposée en 1916 était "Les Kensingtons à Laventie" d'Eric Kennington. Cette peinture montre sa propre unité peu avant que lui-même ait été blessé (Kennington apparaît à l'arrière-plan sur la gauche portant un passe-montagne et un casque).

La réception enthousiaste suscitée par le travail de Kennington et de Nevinson était en grande mesure due à la perception par le public de ces peintures comme étant plus véridiques, plus crédibles, que les dessins produits sur la base des photographies ou de comptes rendus de deuxième main dans les magazines illustrés : d'abord, parce qu'ils reflétaient une réalité que les gens savaient être beaucoup plus près de la vérité, tant visuellement qu'au niveau des émotions, ensuite parce que les artistes étaient, ou avaient été, des soldats avec l'expérience réelle de la première ligne.
Ces peintures ont été toutes produites avant que Nevinson ou Kennington aient été employés comme artistes de guerre par le Département Britannique d'Informations. Celui-ci était le successeur du Bureau de Propagande de Guerre, qui avait été secrètement mis en place en août 1914 et s'était initialement concentré sur l'écrit, faisant monter des auteurs devenus célèbres comme John Buchan et HG Wells, afin de soutenir l'effort de guerre britannique. Un des premiers efforts du Bureau portait sur "le Rapport sur les présumées atrocités allemandes" (aussi connu sous le nom Rapport Bryce), qui accusait l'armée allemande de crimes de guerre contre des civils après l'invasion de la Belgique. Avant mai 1916, le président du Bureau, le député du parti libéral Charles Masterman, un allié du Premier ministre Lloyd George, décida de répondre à la demande de dessins pour la presse illustrée en recrutant le célèbre artiste Muirhead Bone (qui avait fait fortement pression en faveur de la mise en place d'un projet officiel d'Artistes de Guerre), lequel fut envoyé pour visiter le front avec une commission honoraire. Les croquis qu'il a fournis, malgré leur excellence graphique, sont insipides et sans vie comparés avec l'évidente émotion à l'état brut dans l'art de Nevinson.

Même son "Cimetière de soldats" est à peine plus exaltant que l'image d'un cimetière de campagne.

C'est indubitablement ce qui avait incité le Ministère de l'Information à s'ouvrir jusqu'à des artistes plus jeunes, particulièrement ceux servant sur le front dont le public accepterait le travail comme plus authentique. En même temps, faire entrer des artistes sous l'égide du Ministère signifiait que leurs travaux seraient soumis à la censure militaire. Au moment où sa seconde exposition - qui fut un énorme succès - s'ouvrait en 1918, Nevinson semble être arrivé à la conclusion que seul un retour au réalisme était adéquat pour exprimer son horreur de la guerre, comme nous pouvons le voir dans le tableau ironiquement intitulé "Les chemins de la Gloire" - un titre utilisé en 1957 par Stanley Kubrick pour son célèbre film contre la guerre où Kirk Douglas tenait le rôle principal.
L'ironie du titre n'est que trop évidente quand nous voyons les cadavres face contre terre dans la boue, déjà gonflés par la décomposition.

Si le travail précédent de Nevinson a montré l'homme déshumanisé, réduit au statut d'une machine, incorporé dans la machine, on pourrait se demander s'il a senti le besoin de s'échapper de l'esthétique, même une esthétique de la machine, pour montrer la vraie horreur de ce que la guerre faisait non pas aux machines, mais aux êtres humains réels, faits de chair et de sang, avec lesquels nous pouvons nous identifier et avoir de la sympathie - quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec une machine.
Le tableau a été interdit par les autorités. Nevinson l'a quand même accroché à l'exposition, barré d'un grand ruban où était inscrit le mot "Censuré".

Paul Nash, un autre artiste de guerre qui devait devenir un des peintres paysagistes britanniques les mieux connus du 20e siècle, a fait des remarques amères sur son emploi en tant qu'artiste de guerre : "je ne suis plus un artiste. Je suis un messager qui ramènera l'expression des hommes qui se battent à ceux qui veulent que la guerre continue pour toujours. Faible, inintelligible sera mon message, mais il aura une vérité amère et puisse-t-il brûler leurs âmes maudites". Et le public ne pouvait sûrement pas échapper aux implications de cette peinture intitulée "Nous construisons un nouveau monde".
La vérité a ses droits
Tandis que Nevinson passait du moderniste au traditionnel, un autre artiste très différent se déplaçait presque dans la direction opposée. William Orpen avait presque 40 ans lorsque la guerre a éclaté et il était même alors un portraitiste de la haute société fortunée. Envoyé en France comme artiste de guerre avec le rang de commandant, il a été raillé par certains pour sa situation privilégiée et sûre, bien loin de n'importe quelle expérience de combat et, en effet, les tous premiers portraits qu'il a produits pourraient aisément servir d'images de propagande en directions des troupes britanniques, particulièrement les pilotes présentés par la presse et les machines de propagande comme les nouveaux "chevaliers à l'armure brillante" de la guerre moderne.

Son portrait du jeune Lieutenant pilote Rhys Davids, tué peu après dans un combat aérien, a été très reproduit.

On a aussi largement loué les portraits d'Orpen des généraux Haig et Trenchard et l'artiste aurait pu s'attacher simplement à continuer à faire plus dans le même genre, mais ce ne fut pas le cas 9. Au contraire, il a été de plus en plus perturbé par les conséquences de la guerre, tant sur les soldats que sur les civils qu'elle concernait, et avec le temps, il s'est de plus en plus tourné vers des peintures qui parfois s'approchent d'un surréalisme à la Dali.
Nous savons qu'il avait été choqué de voir des jeunes prostituées françaises racoler à une cérémonie d'enterrement. C'est peut-être cela qui a inspiré son "Adam et Ève à Péronne".

Cette toile a quelque chose de presque pornographique. Ici il n'y a aucune perte d'innocence – celle-ci est déjà partie depuis longtemps, perdue dans les décombres de guerre que nous voyons à l'arrière-plan. Le foulard modeste d'Eve contraste curieusement avec son décolleté plongeant et avec l'expression d'un certain cynisme sur son visage, tandis que l'indifférence ennuyée du jeune soldat suggère quelqu'un qui a tant vu la mort qu'il est devenu indifférent à la vie.
Le même soldat apparaît dans "La femme folle de Douai" qui dépeint une scène, à laquelle Orpen avait assisté, d'une femme violée peu de temps avant par des soldats allemands qui se battaient en retraite. Ici il apparaît également indifférent au viol, à la tragédie de la victime et au cadavre enterré à la hâte dont le pied dépasse de sa tombe au premier plan.

Cachée dans une pièce à l'arrière de l'exposition se trouve une série de sept gravures de Percy Delf Smith, qui était un artilleur dans les Royal Marines sur le front.
Là où certaines des images d'Orpen reprennent des thèmes de Goya (par exemple, "Le Bombardement, la Nuit"), Smith retourne aux images de la société médiévale décadente avec ses représentations de mort omniprésentes. Ceux-ci sont certainement parmi les tableaux les plus choquants de l'exposition.

Dans "La Mort effrayée", même la Mort recule devant le massacre, incarné par deux bottes encore habitées de morceaux de jambes, tandis que "la Mort intoxiquée" représente une parodie de danse où la Mort cabriole de façon délirante derrière un soldat sur le point d'embrocher un ennemi sur sa baïonnette.

Cela semble assez naturel de vouloir, de presque attendre même, des artistes qui nous émeuvent par leur esprit critique qu'ils partagent nos idées. Naturel, mais profondément erroné. Les artistes qui figurent dans ce texte - et auxquels nous pourrions ajouter des poètes comme Wifred Owen et Siegried Sassoon et les expressionnistes allemands comme Otto Dix ou Käthe Kollwitz - ont été profondément révoltés par la guerre, et plusieurs d'entre eux ont souffert de dépressions nerveuses à différents degrés de gravité à la fin de la guerre. Mais, aucun d'entre eux, n'était en rien sensible à un point de vue politique prolétarien ; dans quelques cas ils n'étaient même pas des gens particulièrement sympathiques.
Nous oublions parfois que les grands maîtres que nous admirons aujourd'hui n'étaient pas seuls, au contraire (à de rares exceptions près) ils étaient les plus grands représentants d'un effort dans lequel beaucoup ont été impliqués. Et quand les artistes se détachent du commun des personnes qui les entoure, quand leur art atteint les hauteurs qui continuent à nous toucher aujourd'hui alors que tant de contemporains de moindre envergure ont été oubliés, alors ils nous communiquent, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui va au-delà de l'artiste lui-même. En de tels moments, l'artiste est à l'écoute de quelque chose dans l'atmosphère sociale, quelque chose qui n'est pas très souvent explicite. Est-ce vraiment un hasard si certains des actes d'accusation les plus cuisants contre la guerre avaient été produits la même année - et auraient presque pu servir d'illustrations dans la Brochure de Junius de Rosa Luxemburg. Dans la Brochure de Junius, Rosa Luxembourg écrit : "Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment." N'est-ce pas précisément ceci qui parvient à nous atteindre depuis les tableaux du Musée de Guerre Impérial ? Et, n'est-ce pas précisément parce qu'il a existé, quelque part, un esprit capable de Junius et un mouvement ouvrier ensanglanté et trahi, mais toujours vivant et capable de prendre en charge et de transformer dans l'action sociale les idées de Junius, qu'il pourrait aussi exister un esprit critique artistique capable de parler non pas à la conscience, comme le faisait Luxembourg, mais directement aux émotions (comme pouvait le faire également Luxembourg). De cette manière, ils parlent à quelque chose de constant dans la nature humaine, quelque chose de vraiment humain (comme Marx aurait pu dire) qui ne peut que réagir face au dégoût qu'inspire la monstrueuse machine de mort que le capitalisme était devenu.
Où est l'art de la Seconde Guerre mondiale ?
Le contraste suivant est saisissant. Tandis que la Première Guerre mondiale a produit certains des plus grands peintres du 20e siècle en Grande Bretagne, sans parler de certaines expressions artistiques les plus remarquables en Allemagne, rien de pareil ne peut être dit de la Seconde Guerre mondiale qui n'a produit absolument rien de comparable.
 En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.
En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.
Hitler était un grand admirateur de la propagande de guerre britannique et les Anglais eux-mêmes n'ont pas perdu de temps, quand la guerre a commencé, pour installer un "Comité consultatif d'Artistes de Guerre" subordonné au Ministère de l'Information. Il suffit de comparer "La Bataille de Grande-Bretagne", presque lyrique, de Paul Nash avec son "Nous faisons un nouveau monde" pour voir que l'esprit critique du dernier a complètement disparu.

Ou de nouveau, comparez la peinture de 1943 d'Alfred Thomson d'un aviateur blessé recevant des soins, avec la description de la Première Guerre mondiale de Nevinson d'une scène à l'hôpital dans "La Patrie". Ici nous avons une image d'un calme paisible, très loin de l'agonie et l'angoisse de l'hôpital de campagne.

L'esprit critique n'avait pas complètement disparu. Certains des artistes américains de combat qui figurent sur le site PBS 10 "They drew fire" - et sans aucun doute il est significatif que ces hommes ont été confrontés à la terreur de guerre – ont produit un art qui fait écho à l'horreur vécue par les combattants de la Première Guerre mondiale.
 Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".
Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".
Et il n'y a certainement rien de glorieux à propos de "L'aide à un homme blessé" (Eby avait servi dans un équipage ambulancier pendant la Première Guerre mondiale).

L'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale avait été relativement mineur, l'implication de l'ensemble la population dans le combat y avait été incomparablement moins importante que dans les pays européens et beaucoup moins importante que durant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pouvons-nous expliquer le puissant impact des tableaux précédents par la naïveté de la classe ouvrière américaine qui, bien qu'elle ait dû affronter dans ses luttes une des fractions les plus brutales de la classe capitaliste, devait encore faire l'expérience de la barbarie folle de la guerre moderne grandeur nature.
Ces images crues de la brutalité de la guerre - et la folie qu'elle inflige à des êtres humains que nous voyons nous fixer depuis les yeux de "l'homme blessé" d'Eby - révèlent une recherche honnête de la vérité artistique, qui montre que l'intégrité et l'humanité ont continué à survivre même au cœur de barbarie. Mais comparé aux œuvres inspirées par la Première Guerre mondiale il y a quelque chose qui manque : un sentiment de critique sociale plus large qui va au-delà de la réaction individuelle aux événements éprouvés individuellement. Marx avait tort lorsqu'il disait que seuls de mauvais artistes mettent des titres à leurs peintures (le plus grand des peintres paysagistes britanniques, William Turner, a non seulement donné de longs titres à ses œuvres, mais il les accompagnait parfois avec des lignes de sa propre poésie) et des titres comme "les Chemins de la gloire" ou "Nous faisons un nouveau monde" soulignent pour nous la protestation plus large de l'artiste contre la guerre, ses causes et ses conséquences.
À cause du "réalisme socialiste", la peinture russe de la Seconde Guerre mondiale était tout sauf réaliste et, durant la Guerre de Corée, les principes du réalisme socialiste semblent avoir été appliqués avec autant d'enthousiasme par les américains que par le chinois.
Le Viêt-Nam : L'art contre la guerre
Ce n'est qu'avec la Guerre du Viêt Nam que l'art revient vraiment à une attaque critique contre la guerre et, ici, c'est un art d'une nouvelle sorte qui vient sur le devant de la scène : la photographie.
La photographie et la peinture relèvent de compétences techniques très différentes : là où le peintre esquisse pour préparer un travail final, le photographe prendra des centaines, parfois même des milliers de clichés. Là où le peintre incrémente son travail, petit à petit, cernant la vérité en ajoutant de la peinture, le photographe rejette, pour aboutir à seul cliché, celui qui incarne le mieux l'événement, la scène ou le visage qu'il essaie de représenter. Et bien sûr, la photographie en noir et blanc implique en particulier un travail subtil avec des produits chimiques dans la chambre noire pour approfondir l'ombre, accentuer et centrer l'attention sur l'essentiel.
À leur plus haute expression, la peinture et la photographie, comme tout l'art, peuvent tous deux exprimer une recherche de la vérité. Et effectivement nous avons des images les plus emblématiques de la Guerre du Viêt Nam, comme la photo de Trang Bang par le photographe vietnamien Nick Ut après l'attaque au napalm du 8 juin, en 1972. Aucune œuvre de la Première Guerre mondiale n'a peint mieux que cette photo l'horreur pure, la barbarie et par-dessus tout l'absurdité de cette guerre.

Nick Ut était un photographe de l'Associated Press, une coopérative d'informations à but non lucratif fondée pendant la Guerre au Mexique de 1846, qui a produit une grande partie du meilleur - le plus émotionnellement vrai – des photos qui sont sorties de la Guerre du Viêt Nam 11. La guerre elle-même venait à un moment très spécifique et a été, à certains égards, unique dans les annales de photographie de guerre. Tout d'abord, elle était "la première guerre dans laquelle les journalistes étaient régulièrement accrédités pour accompagner des forces militaires, non encore soumis à la censure." 12 Ce fut une leçon que les États-Unis, en particulier, allaient apprendre pour des guerres futures. Les Guerres du Golfe, par exemple, ont été rigoureusement censurées avec la vérification systématique des reportages télé avant qu'il ne soient envoyés. Tous ces rapports "en direct" étaient en direct seulement dans le sens où ils arrivaient sur les écrans seulement quelques minutes après avoir été émis alors que le censeur militaire avait déjà vérifié leur contenu au fil de l'eau. Dans de telles conditions, beaucoup de journalistes ont appris à se censurer.

Les clichés d'Ut comme la photo d'Art Greenspon représentant des soldats américains qui attendent un hélicoptère pour évacuer le blessé, sont plus qu’une simple photographie de guerre racontant une histoire saisissante, ils sont aussi une forme de critique sociale. Bien qu'il y ait relativement peu de photos de troupes du Viêt-Cong autres que des prisonniers, il n'existe pas de doute concernant qui sont les victimes principales de la guerre : les civils tout d'abord, bien sûr, mais aussi les "grunts", ainsi que les conscrits G.I. américains ont été appelés pour les distinguer des "lifers" (terme qui désigne les soldats et officiers de carrière engagés à vie), et bien sûr l'armée vietnamienne du Sud et le Viêt-Cong avaient leurs équivalents : dans leur grande majorité, c'était les conscrits, les ouvriers en uniformes qui étaient envoyés dans les situations les plus dangereuses sur les lignes de front.
Si cette forme de critique sociale était possible, ce n'est pas seulement parce que l'armée américaine n'avait pas encore appris la censure. Une image, qu'elle soit une toile ou une photographie, est toujours un moyen de communiquer. L'artiste communique sa vérité, mais il ne peut le faire que si la vérité est aussi écoutée, si dans la société il existe ceux qui sont capables d'entendre et comprendre cette vérité. Ceux qui regardent l'art font aussi partie de sa signification. Ce n'est donc pas un hasard si ces photographies viennent de 1968 et 1972, de la Guerre du Viêt Nam et pas de celle de Corée (tout comme ce n'est pas un hasard si M.A.S.H., un film satirique sur la Guerre de Corée, a été réalisé seulement en 1970), car ceci est la période où les 30 Glorieuses tirent à leur fin, marquée par le renouveau de la lutte de classe qui trouve son expression la plus importante en mai 68 en France.
"L'esprit de l'époque", le Zeitgeist, peut sembler une notion insaisissable, nébuleuse. Pourtant quand nous considérons cette production artistique qui est née de guerres auxquelles il a été mis un terme du fait de l'action de la classe ouvrière, alors qu'elle se révoltait directement contre la guerre elle-même (la Première Guerre mondiale) ou encore parce que les ouvriers révoltés contre les effets de la crise, dont la guerre faisait partie, ont de plus en plus refusé de se battre sous l'uniforme (la Guerre du Viêt Nam), il nous semble clair qu'un tel art n'était possible que parce que dans la société il existe une classe ouvrière aux "chaînes radicales", une classe qui est historiquement opposée à l'état présent de société, même si les ouvriers eux-mêmes n'en sont pas conscients, et beaucoup moins encore les artistes.
Balzac, comme le disait Engels, est allé au-delà de ses propres préjugés de classe en représentant sincèrement ce qu'il voyait. Ainsi les artistes de la Première guerre mondiale nous apportent quelque chose qui va au-delà de ce qu'eux-mêmes étaient parce, sous la surface des choses, ils ont cerné la vérité. La relation entre l'expression artistique dans le capitalisme et la révolte contre celui-ci, n'est en aucun cas une mécanique. L'art n'est pas grand parce qu'il est socialiste. Comme la science, l'art a sa propre dynamique et la première responsabilité de l'artiste est d'être fidèle vis-à-vis de lui-même. On est tenté de paraphraser ce qu'Engels dit de la science : ".... plus il est impitoyable et désintéressée, plus [l’art] est en harmonie avec les intérêts des travailleurs."13
Jens, 27/02/2015
1� La topographie du Musée a sa propre signification. L'exposition sur la Première Guerre mondiale se trouve immédiatement, au rez-de-chaussée, dans une galerie spectaculaire hébergeant des avions et les originaux des missiles V1 et V2 de la Deuxième Guerre mondiale. Les artistes de guerre de l'exposition "La vérité et la mémoire" sont logés beaucoup plus discrètement, dans deux galeries sur les côtés opposés du troisième étage.
2� Le destin de la production agricole de l'URSS Staliniste, comme produit de l'imposition idéologique des théories de Lysenko de l'évolution est un contre-exemple. Et bien sûr, le fait que le monde scientifique échoue souvent à vivre en accord avec cette nécessité ne l'infirme en aucune façon.
3� 8 octobre 1920, Lénine, De la culture prolétarienne.
5� Voir Paul Gough, A terrible beauty, Sansom & Co., 2010, p17.
6� Citation tirée des cartons de présentation généralement pertinents qui annoncent les expositions.
7� Cité dans cette revue intelligente et utile [437] du livre de Paul Gough à propos des artistes de guerre britanniques, A terrible beauty [Une terrible beauté].
8� Extrait d'un carton de présentation.
9� C'est également significatif qu'il ait fait don de sa collection entière de peintures de guerre au Musée de Guerre Impérial, estimant qu'il serait immoral de profiter financièrement de peindre une guerre où tant de gens ont souffert.
11� Voir l'article du New York Times [439].
12� Voir l'article cité précédemment.
13� Engels, “Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique”
Personnages:
- Wyndham Lewis [440]
- Paul Nash [441]
- William Orpen [442]
- CRW Nevinson [443]
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [444]
Rubrique:
1914: le début de la saignée
- 8184 lectures
2014: une année d'oubli
Aujourd'hui, on appelle encore "Grande Guerre" celle qui débuta en août 1914. Pourtant, la Seconde guerre mondiale fit plus de deux fois plus de victimes. Et que dire des guerres sans fin qui, depuis 1945, ont répandu plus de morts et causé davantage de destructions encore.
Pour comprendre pourquoi la guerre de 14-18 est toujours "La Grande Guerre", il suffit de visiter n'importe quel village en France, même le plus isolé, perdu dans les prairies alpines : des familles entières sont là dont les noms sont inscrits sur un marbre commémoratif- des frères, des pères, des oncles, des fils. Ces témoins muets de l'horreur se trouvent non seulement dans les villes et les villages des nations belligérantes européennes, mais jusqu'à l'autre bout du monde : dans le petit hameau de Ross sur l'île australienne de Tasmanie, le mémorial porte les noms de 16 morts et de 44 survivants, qu'on présume issus de la campagne de Gallipoli.
Pendant deux générations après la fin de la guerre, 1914-1918 était synonyme d'un carnage insensé, impulsé par la stupidité aveugle et irréfléchie d'une caste aristocratique dominante, par l'avidité sans bornes des impérialistes, des profiteurs de guerre et des fabricants d'armes. Malgré toutes les cérémonies officielles, toutes les gerbes déposées devant les monuments aux morts et (en Grande Bretagne), le port symbolique de coquelicots à la boutonnière le jour de la commémoration annuelle, cette vision de la Première Guerre mondiale est passée dans la culture populaire des nations belligérantes. En France, le roman autobiographique de Gabriel Chevalier, La Peur, publié en 1930, a connu un succès énorme au point où le livre fut interdit par les autorités. En 1937, le film anti-guerre de Jean Renoir, La Grande Illusion, était projeté sans interruption au cinéma Marivaux de 10 heures jusqu'à 2 heures du matin, battant tous les records d'entrées ; à New York, il est resté 36 semaines à l'affiche.1
Dans l’Allemagne des années 1920, les dessins satiriques de George Grosz descendaient en flammes les généraux, les politiciens et ceux qui avaient profité de la guerre. Le livre de Remarque A l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen Nichts Neues) fut publié en 1929 : 18 mois après sa publication, on en avait vendu 2,5 millions d'exemplaires traduits en 22 langues ; la version cinématographique de Universal Studios en 1930 connaissait un succès retentissant aux Etats-Unis, où elle gagna l’Oscar du meilleur film.2
 En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.
En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.
Le dégoût provoqué par la mémoire de la Première Guerre mondiale a survécu à la saignée encore plus terrible de la Deuxième. Comparée aux horreurs d'Auschwitz et d’Hiroshima, la barbarie du militarisme prussien et de l'oppression tsariste - pour ne pas parler du colonialisme français ou britannique - qui avaient servi de justification à la guerre en 1914, pouvaient sembler presque insignifiants et de ce fait, le massacre dans les tranchées semblait encore plus absurde et monstrueux : on pouvait ainsi présenter la Deuxième Guerre mondiale comme, sinon une "bonne" guerre, au moins une "guerre juste" et nécessaire. Cette contradiction n’est nulle part plus flagrante qu'en Grande-Bretagne, où toute une série de films exaltant la "juste cause" dans le pur style patriotard (Dambusters en 1955, 633 Squadron en 1964, etc.) passaient aux écrans de cinéma pendant les années 1950 et 60, alors qu'en même temps les écrits anti-guerre des "poètes de la guerre" Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, et Robert Graves faisaient partie du cours obligatoire pour les collégiens.3 Peut-être que la plus grande oeuvre de Benjamin Britten, le compositeur britannique le plus célèbre du 20e siècle, est son Requiem de Guerre (1961) qui mit en musique la poésie de Owen, alors que l'année 1969 a vu la sortie de deux films très différents : dans le genre patriotique Battle of Britain, et la satire mordante Oh What a Lovely War! qui réalise une dénonciation musicale de la Première Guerre mondiale en se servant des chansons créées par les soldats dans les tranchées.
Deux générations plus tard, nous nous trouvons à la veille du 100e anniversaire de l'éclatement de la guerre (le 4 août 1914). Étant donné l'importance des anniversaires à chiffre rond et encore plus des centenaires, de grands préparatifs sont en cours pour commémorer ("fêter" n'est guère le mot qui convient) la guerre. En France et en Grande Bretagne, des budgets de plusieurs dizaines de millions en euros ou en sterling ont été alloués ; en Allemagne, pour des raisons évidentes, les préparatifs sont plus discrets et n'ont pas reçu de bénédiction gouvernementale.4
“Qui paie les violons, choisit la musique” : alors que vont recevoir les classes dominantes en échange des dizaines de millions qu'elles ont dépensés afin de “commémorer la Guerre”?
Si nous regardons les sites web des organismes responsables de la commémoration (en France, un organisme spécial a été mis en place par le gouvernement, en Grande-Bretagne - de façon assez appropriée – il s’agir de l’Imperial War Museum) la réponse semble assez claire : ils achètent un des rideaux de fumée idéologique les plus coûteux de l'histoire. En Grande-Bretagne, l'Imperial War Museum se donne pour tâche de récolter les histoires des individus qui ont vécu la guerre afin de les transformer en podcast.5 Le site web du Centenary Project (1914.org) nous propose des événements d'une importance aussi cruciale que l'exhibition du revolver utilisé pendant la Guerre par JRR Tolkien” (sans blague - on suppose que le but est de surfer sur le succès des films "Le Seigneur des Anneaux" tirés des livres dont Tolkien était l'auteur) ; la commémoration d'un dramaturge du Surrey, la collecte par le Musée des Transports de Londres de l’'histoire des bus pendant la Grande Guerre (non mais vraiment !) ; à Nottingham “un grand programme d'événements et d'activités (...) mettront en lumière comment le conflit catalysa des changements sociaux et économiques immenses dans les communautés de Nottinghamshire”. La BBC a produit un "documentaire innovant": "La Première Guerre mondiale vue d'en haut" avec des photos et des films tirés à partir des ballons captifs de l'artillerie. On rendra hommage aux pacifistes par des commémorations sur les objecteurs de conscience. En somme, nous allons être noyés dans un océan de futilités. Selon le Directeur Général de l’Imperial War Museum, “notre ambition est que beaucoup plus de gens comprendront que vous ne pouvez pas comprendre le monde aujourd'hui sans comprendre les causes, le cours, et les conséquences de la Première Guerre mondiale”6 et nous sommes d'accord à 100% avec cela. Mais en réalité, tout est fait - y compris par l'honorable Directeur Général pour nous empêcher de comprendre ses véritables causes et ses réelles conséquences.
En France, le site du centenaire affiche le très officiel Rapport au Président de la République pour commémorer la Grande Guerre daté de septembre 20117 et qui commence avec ces mots du discours du Général de Gaulle lors du cinquantenaire de la guerre en 1964 : "« Le 2 août 1914, jour de la mobilisation, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Cela n’avait jamais eu lieu. Toutes les régions, toutes les localités, toutes les catégories, toutes les familles, toutes les âmes, se trouvèrent soudain d’accord. En un instant, s’effacèrent les multiples querelles, politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé. D’un bout à l’autre du sol national, les mots, les chants, les larmes et, par-dessus tout, les silences n’exprimèrent plus qu’une seule résolution". Dans le rapport lui-même nous lisons que "S’il suscitera l’effroi des contemporains face à la mort de masse et aux immenses sacrifices consentis, le Centenaire fera également parcourir un frisson sur la société française, rappelant l’unité et la cohésion nationale affichée par les Français dans l’épreuve de la Première Guerre mondiale". Il paraît donc peu probable que la bourgeoisie française ait l'intention de nous parler de la répression policière brutale des manifestations ouvrières contre la guerre pendant juillet 1914, ni du notoire Carnet B (la liste tenue par le gouvernement des militants anti-militaristes socialistes et syndicalistes à arrêter et interner ou à envoyer au front dès l'éclatement de la guerre – les Britanniques avaient leurs propres équivalents), et encore moins des circonstances de l'assassinat du dirigeant socialiste anti-guerre Jean Jaurès à la veille du conflit ou des mutineries dans les tranchées8...
Comme toujours, les propagandistes peuvent compter sur le soutien de Messieurs les doctes universitaires pour fournir en matériel leurs documentaires et interviews. Nous prendrons ici un seul exemple qui nous semble emblématique : The Sleepwalkers, par l'historien Christopher Clark de l'université de Cambridge, publié en 2012 puis en 2013 en livre de poche, et déjà traduit en français (Les Somnambules) et en allemand (Die Schlafwandler).9 Clark est un empiriste sans complexe, son introduction annonce très clairement son intention : "Ce livre (…) traite moins de pourquoi la guerre a eu lieu que de comment elle est arrivée. Les questions du pourquoi et du comment sont inséparables dans la logique, mais elles nous mènent dans des directions différentes. La question du comment nous invite à regarder attentivement les séquences d'interactions qui ont produit certains résultats. La question du pourquoi, par contre, nous invite à partir à la recherche de causes éloignées et catégoriques : l'impérialisme, le nationalisme, les armements, les alliances, la finance, les idées d'honneur national, les mécanismes de la mobilisation".10 Ce qui manque dans la liste de Clark est, bien évidemment, le capitalisme. Serait-il possible que le capitalisme soit générateur de guerres ? Serait-il possible que la guerre ne soit pas seulement "la politique par d'autres moyens", pour reprendre l'expression bien connue de von Clausewitz, mais plutôt l'expression ultime de la concurrence inhérente au mode de production capitaliste ? Oh que non, que non, jamais de la vie ! Clark donc, s'adonne à nous livrer "les faits" sur le chemin de la guerre, ce qu'il fait avec une immense érudition et dans le moindre détail, jusqu'à la couleur des plumes d'autruche sur le casque de Franz-Ferdinand le jour de son assassinat (elles étaient vertes). Si quelqu'un avait pris la peine de noter la couleur des culottes de son assassin Gavrilo Princip ce jour-là, ce serait aussi dans ce livre.
La longueur du livre, sa maîtrise du détail, rend une omission d'autant plus remarquable. Malgré le fait qu'il consacre des sections entières à la question de "l'opinion publique", Clark n'a absolument rien à dire à propos de la seule partie de "l'opinion publique" qui importait vraiment : la position adoptée par la classe ouvrière organisée. Clark cite longuement des journaux comme le Manchester Guardian, le Daily Mail, ou Le Matin, et bien d'autres depuis longtemps tombés dans un oubli bien mérité, mais il ne cite même pas une seule fois ni le Vorwärts, ni L'Humanité (les journaux respectivement des partis socialistes allemand et français), ni La Vie Ouvrière, l'organe quasi-officiel de la CGT française,11 ni La Bataille Syndicaliste. Ce n'était pas des publications mineures ! Le Vorwärts n'était qu'un parmi les 91 quotidiens du SPD avec une diffusion totale de 1,5 million d'exemplaires (à titre de comparaison, le Daily Mail revendiquait une diffusion de 900 000),12 et le SPD lui-même était le plus grand des partis politiques allemands. Clark mentionne le congrès d’Ièna en 1905 où le SPD refusa d'appeler à la grève générale en cas de guerre, mais il n'y a pas un mot sur les résolutions contre la guerre adoptées aux congrès de l'Internationale Socialiste à Stuttgart (1907) et à Bâle (1912). Le seul dirigeant du SPD à mériter de se trouver dans le livre est Albert Südekum, un personnage relativement mineur à la droite du SPD, dont le rôle de figurant rassure le chancelier allemand Bethmann-Hollweg le 28 juillet, soulignant que le SPD ne s'opposera pas à une guerre "défensive".
A propos de la lutte entre gauche et droite dans le mouvement socialiste et plus largement ouvrier, c'est le silence. A propos du combat politique de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Anton Pannekoek, Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis, John MacLean, Vladimir Ilyich Lénine, Pierre Monatte, et tant d'autres, c'est encore le silence. A propos de l'assassinat de Jean Jaurès, silence toujours, rien que du silence...
Évidemment, les prolétaires ne peuvent compter sur l'historiographie bourgeoise pour comprendre vraiment les causes de la Grande Guerre. Tournons-nous donc plutôt vers deux militants remarquables de la classe ouvrière : Rosa Luxembourg, sans aucun doute la plus grande théoricienne de la Social-Démocratie allemande et Alfred Rosmer, un militant fidèle de la CGT française d'avant-guerre. En particulier, nous allons nous baser sur La Crise dans la Social-Démocratie de Rosa Luxembourg (mieux connu sous le nom de Brochure de Junius13) et Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale.14 Les deux œuvres sont très différentes : la brochure de Luxembourg fut écrite en prison en 1916 (elle ne bénéficia d'aucun accès privilégié aux bibliothèques et archives gouvernementales, la puissance et clarté de son analyse en est d'autant plus impressionnante) ; le premier tome15 de l’œuvre de Rosmer, où il traite de la période qui mena à la guerre, fut publié en 1936 et il est le fruit à la fois de son dévouement minutieux à la vérité historique et de sa défense passionnée des principes internationalistes.
La Première Guerre mondiale : son importance et ses causes
On pourrait nous demander si tout cela a vraiment de l'importance. C'était il y a bien longtemps, le monde a changé, que pouvons-nous vraiment apprendre de ces écrits d'un autre âge ?
Nous répondrions que comprendre la Première Guerre mondiale est primordial pour trois raisons.
D'abord, parce que la Première Guerre a ouvert une nouvelle époque : nous vivons toujours dans un monde formé par les conséquences de cette guerre.
Ensuite, parce que les causes sous-jacentes de la guerre sont toujours présentes et opérationnelles : il y a un parallèle on ne peut plus clair entre la montée de la nouvelle puissance allemande avant 1914, et la montée de la Chine aujourd'hui.
Enfin – et c'est peut-être le plus important parce que c'est cela que les propagandistes du gouvernement et les historiens aux ordres veulent surtout nous cacher – il n'y a qu'une seule force capable de mettre fin à la guerre impérialiste : la classe ouvrière mondiale. Comme le dit Rosmer : "les gouvernements savent bien qu'ils ne peuvent se lancer dans la dangereuse aventure qu'est la guerre – et surtout cette guerre – qu'à la condition d'avoir derrière eux la quasi-unanimité de l'opinion et, en particulier, de la classe ouvrière ; pour cela, il faut la tromper, la duper, l'égarer, l'exciter."16 Luxembourg cite la phrase de von Bülow, qui disait que c'était essentiellement par crainte de la social-démocratie que l'on s'efforçait autant que possible de différer toute guerre" ; elle cite également le Vom Heutigen Krieg du Général Bernhardi : "Si de grandes masses échappent au contrôle du haut commandement, si elles sont prises de panique, si l'intendance fait défaut sur une grande échelle, si l'esprit d'insubordination s'empare des troupes, dans ce cas, de telles masses non seulement ne sont plus capables de résister à l'ennemi, mais elles deviennent un danger pour elles-mêmes et pour le commandement de l'armée ; elles font sauter les liens de la discipline, troublent arbitrairement le cours des opérations et placent ainsi le haut commandement devant des tâches qu'il n'est pas en mesure d'accomplir". Et Luxembourg continue : "Des politiciens bourgeois et des experts militaires considéraient donc la guerre moderne menée avec des armées de masse comme un 'jeu risqué', et c'était là la raison essentielle qui pouvait faire hésiter les maîtres actuels du pouvoir à déclencher la guerre et les amener à tout faire pour qu'elle s'achève rapidement au cas où elle éclaterait. L'attitude de la social-démocratie au cours de la guerre actuelle (...) a dissipé leurs inquiétudes, elle a abattu les seules digues qui s'opposaient au torrent déchaîné du militarisme (...) Et ainsi, ces milliers de victimes qui tombent depuis des mois et dont les corps couvrent les champs de bataille, nous les avons sur la conscience."17
Le déclenchement d'une guerre impérialiste mondiale et généralisée (nous ne parlons pas ici des conflits localisés, même des conflits majeurs comme les guerres de Corée ou du Vietnam) est déterminé par deux forces qui s'affrontent : la poussée vers la guerre, vers une nouvelle division du monde entre les grandes puissances impérialistes, et la lutte pour la défense de leur propre existence par les masses laborieuses qui doivent fournir à la fois la chair à canon et l'armée industrielle sans laquelle la guerre moderne est impossible. La Crise dans la Social-Démocratie, et surtout dans sa fraction la plus puissante, la social-démocratie allemande – une crise qui est systématiquement passée sous silence par les historiens universitaires aux ordres – est donc le facteur critique qui a rendu la guerre possible en 1914.
Nous y reviendrons plus en détail dans un article ultérieur, mais ici nous nous proposons de reprendre l'analyse de Luxembourg des rivalités et alliances mouvantes qui ont poussé les grandes puissances inexorablement vers la saignée de 1914.
"Deux lignes de force de l'évolution historique la plus récente conduisent tout droit à la guerre actuelle. L'une part de la période de la constitution des « États nationaux », c'est-à-dire des États capitalistes modernes ; elle a pour point de départ la guerre de Bismarck contre la France. La guerre de 1870, qui, suite à l'annexion de l'Alsace-Lorraine, avait jeté la République française dans les bras de la Russie, provoqué la scission de l'Europe en deux camps ennemis et inauguré l'ère de la folle course aux armements, a apporté le premier brandon au brasier mondial actuel (…) Ainsi, la guerre de 1870 a eu comme conséquences : en politique extérieure, d'amener le regroupement politique de l'Europe autour de l'axe formé par l'opposition franco-allemande ; et dans la vie des peuples européens, d'assurer la domination formelle du militarisme. Cette domination et ce regroupement ont cependant donné ensuite à l'évolution historique un tout autre contenu.
La deuxième ligne de force qui débouche sur la guerre actuelle et confirme avec tant d'éclat la prédiction de Marx18 découle d'un phénomène à caractère international que Marx n'a plus connu : le développement impérialiste de ces vingt-cinq dernières années".19
Les trente dernières années du 19e siècle ont donc vu une expansion rapide du capitalisme à travers le monde, mais aussi l'émergence d'un capitalisme nouveau, dynamique, en expansion et plein de confiance, au cœur même de l'Europe : l'Empire allemand, déclaré dans le palais de Versailles en 1871 après la défaite française lors de la guerre franco-prussienne, dans laquelle la Prusse est entrée comme la plus grande puissance parmi une multiplicité de principautés et de petits États allemands, pour en émerger comme le composant dominant d'une Allemagne nouvelle et unifiée.
"(…) l'on pouvait prévoir", continue Luxembourg, "dès lors que ce jeune impérialisme, plein de force, qui n'était gêné par aucune entrave d'aucune sorte, et qui fit son apparition sur la scène mondiale avec des appétits monstrueux, alors que le monde était déjà pour ainsi dire partagé, devait devenir très rapidement le facteur imprévisible de l'agitation générale".20

Par une de ces bizarreries de l'histoire qui nous permettent de prendre une seule date comme symbole d'une modification de la dynamique de l'histoire, l'année 1898 fut témoin de trois événements qui marquèrent un tel changement.
Le premier était "l'Incident de Fachoda", une confrontation tendue entre les troupes françaises et britanniques qui se disputaient le contrôle du Soudan. A l'époque, il semblait y avoir un vrai danger de guerre entre ces deux pays pour le contrôle de l’Égypte et du canal de Suez, ainsi que pour la domination de l'Afrique. En fin de compte, l'incident s'est terminé par une amélioration des rapports franco-britanniques, formalisée en 1904 avec "l'Entente Cordiale", une tendance de plus en plus marquée pour la Grande-Bretagne de soutenir la France contre une Allemagne que tous les deux voyaient comme une menace. Les deux "Crises marocaines" de 1905 et 191121 montrèrent que dorénavant la Grande-Bretagne s'opposerait aux ambitions allemandes en Afrique du Nord (elle était néanmoins prête à laisser quelques miettes à l'Allemagne : les possessions coloniales du Portugal).
Le deuxième événement était la prise par l'Allemagne du port chinois de Tsingtao (aujourd'hui Qingdao),22 ce qui annonçait l'arrivée de l'Allemagne sur la scène impérialiste en tant que puissance aux aspirations mondiales et non plus seulement européennes – une Weltpolitik, comme on disait en Allemagne à l'époque.
Il est donc assez opportun que l'année 1898 voit également la mort d'Otto von Bismarck, le grand chancelier qui avait guidé l'Allemagne à travers son unification et son industrialisation rapide. Bismarck s'était toujours opposé au colonialisme et à la construction navale, son principal souci sur le plan de la politique étrangère étant d'empêcher l'émergence d'une alliance anti-germanique parmi les autres puissances jalouses – ou inquiètes – face à la montée de l'Allemagne. Mais au tournant du siècle, l'Allemagne était devenue une puissance industrielle de premier ordre, surpassée par les seuls États-Unis, avec les ambitions mondiales qui allaient avec. Luxembourg cite le ministre des Affaires Étrangères d'alors, von Bülow, dans un discours du 11 décembre 1899 : "Si les Anglais parlent d'une Greater Britain, si les Français parlent d'une Nouvelle France, si les Russes se tournent vers l'Asie, de notre côté nous avons la prétention de créer une Grösseres Deutschland... Si nous ne construisions pas une flotte qui soit capable de défendre notre commerce et nos compatriotes à l'étranger, nos missions et la sécurité de nos côtes, nous mettrions en danger les intérêts les plus vitaux du pays. Dans les siècles à venir, le peuple allemand sera le marteau ou l'enclume". Et Luxembourg fait la remarque : "Si on retire les fleurs de rhétorique de la défense des côtes, des missions et du commerce, il reste ce programme lapidaire : pour une Plus Grande Allemagne, pour une politique du marteau à l'égard des autres peuples."23
Au début du 20e siècle, se donner une Weltpolitik exigeait une marine à la hauteur de ses ambitions. Luxembourg montre on ne peut plus clairement que l'Allemagne n'avait aucun besoin économique pressant pour une marine : personne n'allait lui arracher ses possessions en Afrique ou en Chine. La marine était surtout une question de "standing" : pour pouvoir continuer son expansion l'Allemagne devait être vue comme une puissance sérieuse, une puissance avec laquelle il fallait compter, et pour cela une "flotte offensive de première qualité" était un pré-requis. Dans les mots inoubliables de Luxembourg, celle-ci était "une provocation qui visait non seulement la classe ouvrière allemande, mais tous les autres États capitalistes, un poing brandi vers aucun État en particulier, mais vers tous à la fois".
Le parallèle entre la montée de l'Allemagne au tournant des 19e et 20e siècles, et celle de la Chine cent ans plus tard, est évident. Comme celle de Bismarck, la politique étrangère de Deng Xiaoping s'efforçait de n'inquiéter ni les voisins de la Chine, ni la puissance hégémonique mondiale, les États-Unis. Mais avec sa montée au statut de deuxième puissance économique mondiale, le "standing" de la Chine exige qu'elle puisse, au minimum, contrôler ses frontières et protéger ses voies maritimes : d'où son programme de construction navale, de sous-marins et d'un porte-avions, avec sa déclaration récente d'une zone d'identification de la défense aérienne (ADIZ) couvrant les îles Senkaku/Diaoyu.
Ce parallèle n'est pas, bien sûr, une identité, pour deux raisons en particulier : d'abord, l'Allemagne du début du 20e siècle était non seulement la deuxième puissance industrielle après les États-Unis, elle était aussi à l'avant-garde du progrès technique et de l'innovation (comme on peut en juger, par exemple, au nombre de prix Nobel allemands et de l'innovation allemande dans les industries sidérurgiques, électriques, et chimiques) ; deuxièmement, l'Allemagne avait la capacité de transporter sa force militaire partout dans le monde.
Tout comme les États-Unis aujourd'hui se doivent de s'opposer à la menace chinoise à l'égard de son propre "standing" et la sécurité de ses alliés (le Japon, la Corée du Sud et les Philippines en particulier), la Grande- Bretagne aussi ne pouvait que voir une menace dans la montée de la marine militaire allemande, et pire encore une menace existentielle contre l'artère maritime vitale de la Manche et ses propres défenses côtières.24
Cependant, quelles que soient ses ambitions navales, la direction naturelle pour l'expansion d'une puissance terrestre comme l'Allemagne était vers l'Est, plus spécifiquement vers l'Empire ottoman en décomposition ; cela était d'autant plus vrai lorsque ses ambitions en Afrique et en Méditerranée occidentale se trouvaient bloquées par les français et les britanniques. L'argent et le militarisme allaient main dans la main, et le capital allemand a afflué en Turquie,25 jouant des coudes avec ses concurrents britanniques et français. Une grande partie de ce capital était voué au financement de la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad : en réalité, il s'agissait d'un réseau de voies ferrées qui devait relier Berlin à Constantinople, puis au sud de l'Anatolie, la Syrie, et Bagdad, mais aussi la Palestine, le Hedjaz et La Mecque. A une époque où le mouvement des troupes dépendait des chemins de fer, cela donnerait la possibilité à l'armée turque, équipée avec des armes allemandes et entraînée par des militaires allemands, d'envoyer des troupes qui menaceraient à la fois la raffinerie britannique d'Abadan (en Perse, aujourd'hui l'Iran),26 et le contrôle britannique de l’Égypte, du canal de Suez : voici encore une menace allemande directe envers les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne. Pendant une grande partie du 19e siècle, l'expansion russe en Asie Centrale, qui faisait peser une menace sur la frontière perse et sur l'Inde, était le principal danger pour la sécurité de l'Empire britannique ; la défaite de la Russie par le Japon en 1905 avait refroidi ses ardeurs orientales au point qu'en 1907 une convention anglo-russe pouvait – provisoirement du moins – résoudre les disputes entre les deux pays en Afghanistan, en Perse, et au Tibet. L’Allemagne était maintenant le rival à affronter.
Inévitablement, la politique orientale de l'Allemagne lui donnait un intérêt stratégique dans les Balkans, le Bosphore et les Dardanelles. Le fait que la voie du chemin de fer entre Berlin et Constantinople devait passer par Vienne et Belgrade faisait que le contrôle, ou du moins la neutralité de la Serbie, devenait du coup d'une grande importance stratégique pour l'Allemagne. Ceci à son tour la mettait en conflit avec un pays qui – du temps de Bismarck – avait été le bastion de la réaction et de la solidarité autocratique, donc l'allié principal de la Prusse et de l'Allemagne impériale : la Russie.
Depuis la règne de la Grande Catherine, la Russie s'était établie (dans les années 1770) comme puissance dominante de la Mer Noire, évinçant les Ottomans. Le commerce de plus en plus important de l'industrie et de l'agriculture russes dépendait de la liberté de navigation dans le détroit du Bosphore. L'ambition russe visait les Dardanelles et le contrôle du trafic maritime entre la Mer Noire et la Méditerranée (les visées russes sur les Dardanelles avaient déjà mené à la guerre avec la Grande-Bretagne et la France en Crimée en 1853). Luxembourg résume ainsi la dynamique au sein de la société russe qui impulsait sa politique impérialiste : "Dans les tendances conquérantes du régime tsariste s'exprime, d'une part, l'expansion traditionnelle d'un Empire puissant dont la population comprend aujourd'hui 170 millions d'êtres humains et qui, pour des raisons économiques et stratégiques, cherche à obtenir le libre accès des mers, de l'océan Pacifique à l'est, de la Méditerranée au sud, et, d'autre part, intervient ce besoin vital de l'absolutisme : la nécessité sur le plan de la politique mondiale de garder une attitude qui impose le respect dans la compétition générale des grands États, pour obtenir du capitalisme étranger le crédit financier sans lequel le tsarisme n'est absolument pas viable (…) Toutefois, les intérêts bourgeois modernes entrent toujours davantage en ligne de compte comme facteur de l'impérialisme dans l'Empire des tsars. Le jeune capitalisme russe, qui sous le régime absolutiste ne peut naturellement pas parvenir à un épanouissement complet et qui, en gros, ne peut quitter le stade du système primitif de vol, voit cependant s'ouvrir devant lui un avenir prodigieux dans les ressources naturelles immenses de cet Empire gigantesque (…) C'est parce qu'elle pressent cet avenir et qu'elle est, pour ainsi dire par avance, affamée d'accumulation, que la bourgeoisie russe est dévorée par une fièvre impérialiste violente, et qu'elle manifeste avec ardeur ses prétentions dans le partage du monde".27 La rivalité entre l'Allemagne et la Russie pour le contrôle du Bosphore trouva donc inéluctablement son point névralgique dans les Balkans, où la montée de l'idéologie nationaliste caractéristique d'un capitalisme en voie de développement créait une situation de tension permanente et de guerre sanglante intermittente entre les trois États s'étant dégagés de l'Empire ottoman en décomposition : la Grèce, la Bulgarie et la Serbie. Ces trois pays se sont alliés contre les Ottomans dans la Première Guerre des Balkans, puis se sont battus entre eux pour le partage du butin – en particulier en Albanie et en Macédoine – lors de la Deuxième Guerre des Balkans.28
La montée de ces nouveaux États nationaux agressifs dans les Balkans ne pouvait guère laisser indifférent l'autre empire déclinant de la région : l'Autriche-Hongrie. Pour Luxembourg, "la monarchie habsbourgeoise n'est pas une organisation politique d'État bourgeois, mais seulement un trust unissant par des liens assez lâches quelques coteries de parasites sociaux qui veulent se remplir les poches en exploitant au maximum les ressources du pouvoir tant que la monarchie tient encore debout", et l'Autriche-Hongrie se trouvait constamment sous la menace des nouvelles nations qui l'entouraient et qui toutes étaient composées des mêmes ethnies que certaines parties de l'Empire : d'où l'annexion par l'Autriche-Hongrie de la Bosnie-Herzégovine, afin d'empêcher la Serbie de se frayer un accès à la Méditerranée.
En 1914, la situation en Europe ressemblait à un cube de Rubik mortel, ses différentes pièces si étroitement imbriquées qu'en déplacer une devait nécessairement les déplacer toutes.
Les somnambules éveillés
Est-ce que cela veut dire que les classes dominantes, les gouvernements, ne savaient pas ce qu'ils faisaient ? Que – selon le titre du livre de Christopher Clark, Les Somnambules – ils sont, d'une certaine manière, entrés en guerre par accident, que la Première Guerre Mondiale n'était qu'une terrible erreur ?
Nullement. Certes, les forces historiques que décrit Luxembourg, dans ce qui est probablement l'analyse la plus profonde jamais écrite de l'entrée en guerre, tenait la société en tenaille : dans ce sens, la guerre était le résultat des rivalités impérialistes imbriquées. Mais les situations historiques appellent au pouvoir des hommes qui leur sont assortis et les gouvernements qui menèrent l'Europe et le monde à la guerre savaient très bien ce qu'ils faisaient, l'ont fait délibérément. Les années du tournant du siècle jusqu'à l'éclatement de la guerre étaient marquées par des alertes à répétition, chacune plus grave que la précédente : la crise de Tanger en 1905, l'incident d'Agadir en 1911, la Première et la Deuxième Guerre des Balkans. Chacun de ces incidents poussait plus en avant la fraction pro-guerre de chaque bourgeoisie, attisait le sentiment que la guerre était, de toutes façons, inévitable. Le résultat en était une course aux armements insensée : l'Allemagne lança son programme de construction navale et la Grande-Bretagne la suivit ; le France augmenta la durée du service militaire à trois ans ; des emprunts français énormes financèrent la modernisation des chemins de fer russes conçus pour transporter les troupes vers son front occidental, ainsi que la modernisation de la petite mais efficace armée serbe. Toutes les puissances continentales augmentèrent le nombre d'hommes sous les drapeaux.
De plus en plus convaincus que la guerre était inévitable, la question pour les gouvernements européens devenait tout simplement celle du "quand ?". Quand les préparatifs de chacun seraient-ils à leur maximum par rapport à ceux de leurs rivaux ? Parce que cela serait le "bon" moment pour la guerre.
Si Luxembourg voyait dans l'Allemagne le nouveau "facteur imprévisible" de la situation européenne, cela veut-il dire que les puissances de la Triple Entente (la Grande-Bretagne, la France et la Russie) n'étaient que les victimes innocentes de l’agression expansionniste allemande ? C'est la thèse de certains historiens révisionnistes aujourd'hui : non seulement que la lutte contre l'expansionnisme allemand était justifiée en 1914, mais qu'au fond, 1914 n'était que le précurseur de la "bonne guerre" de 1939. Cela est indubitablement vrai, mais les pays de la Triple Entente étaient tout, sauf des victimes innocentes. Et l'idée que seule l'Allemagne était "expansionniste" est risible quand nous comparons la taille de l'Empire britannique – le fruit de l'agression expansionniste britannique – avec celui de l'Allemagne : bizarrement, cela ne semble jamais traverser l'esprit des historiens anglais apprivoisés.29
En réalité, la Triple Entente préparait depuis des années une politique d'encerclement de l'Allemagne (tout comme les États-Unis ont développé une politique d'encerclement de l'URSS pendant la Guerre Froide et essaie de faire aujourd'hui de même avec la Chine). Rosmer montre ceci avec une limpidité inexorable, sur la base des correspondances secrètes entre les ambassadeurs belges des différentes capitales européennes.30
En mai 1907, l'ambassadeur à Londres écrivait : "Il est évident que l'Angleterre officielle poursuit une politique sourdement hostile, qui tend à aboutir à l'isolement de l'Allemagne, et que le roi Edouard n'a pas hésité à mettre son influence personnelle au service de cette idée".31 En février 1909, nous avons des nouvelles de l'ambassadeur à Berlin : "Le roi d'Angleterre affirme que la conservation de la paix a toujours été le but de ses efforts ; c'est ce qu'il n'a pas cessé de dire depuis le début de la campagne diplomatique qu'il a menée à bonne fin, dans le but d'isoler l'Allemagne ; mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la paix du monde n'a jamais été plus compromise que depuis que le roi d'Angleterre se mêle de la consolider".32 De Berlin à nouveau, nous lisons en avril 1913 : "L'arrogance et le mépris avec lesquels ces derniers [les Serbes] reçoivent les réclamations du cabinet de Vienne ne s'expliquent que par l'appui qu'ils croient trouver à Saint-Pétersbourg. Le chargé d'affaires de Serbie disait ici récemment que son gouvernement ne serait pas allé de l'avant depuis six mois, sans tenir compte des menaces autrichiennes, s'il n'avait pas été encouragé par le ministre de la Russie, Monsieur Hartwig...".33
En France, le développement conscient d'une politique agressive et chauvine était parfaitement clair pour l'ambassadeur belge à Paris (janvier 1914) : "J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que ce sont MM Poincaré, Delcassé, Millerand et leurs amis qui ont inventé et poursuivi la politique nationaliste, cocardière et chauvine dont nous avons constaté la renaissance (…) J'y vois le plus grand péril qui menace aujourd'hui la paix de l'Europe (…) parce que l'attitude qu'a prise le cabinet Barthou est, selon moi, la cause déterminante d'un surcroît de tendances militaristes en Allemagne".34
La réintroduction par la France d'un service militaire de trois ans n'était pas une politique de défense, mais un préparatif délibéré à la guerre. Voici de nouveau l'ambassadeur à Paris (juin 1913) : "Les charges de la nouvelle loi seront tellement lourdes pour la population, les dépenses qu'elle entraînera seront tellement exorbitantes, que le pays protestera bientôt, et la France se trouvera devant ce dilemme: une abdication qu'elle ne pourra souffrir ou la guerre à brève échéance".35
Comment déclarer la guerre
Deux facteurs entraient en ligne de compte dans les calculs des hommes d’État et des politiciens dans les années qui menèrent à la guerre : d'abord, l'évaluation de leurs propres préparatifs militaires et de ceux de leurs adversaires, la seconde – tout aussi importante, même dans la Russie tsariste et autocratique – était la nécessité de paraître devant le monde et devant leurs propres populations, surtout les ouvriers, comme le parti offensé, agissant uniquement pour se défendre. Tous les pouvoirs voulaient entrer dans une guerre que quelqu'un d'autre avait provoquée : "Le jeu consiste à amener l'adversaire à accomplir un acte qu'on pourra exploiter contre lui ou à mettre à profit une décision déjà prise".36
L'assassinat de Franz-Ferdinand, l'étincelle qui mis le feu aux poudres, n'était pas l'œuvre d'un individu isolé : Gavrilo Princip tira le coup mortel, mais il n'était qu'un membre d'un groupe d'assassins organisé et armé par un des réseaux entretenus par les groupes serbes ultra-nationalistes "La Main Noire" et Narodna Odbrana ("La Défense nationale"), qui formaient presque un État dans l’État et dont les activités étaient certainement connues du gouvernement serbe et plus particulièrement de son premier ministre, Nicolas Pasič. La Serbie entretenait des rapports étroits avec la Russie et n'aurait jamais entrepris une telle provocation si elle n'avait pas été assurée du soutien russe contre une réaction de l'Autriche-Hongrie.
Pour le gouvernement de l'Autriche-Hongrie, l'occasion de mettre la Serbie au pas n'était que trop belle.37 L'enquête policière n'avait guère de mal à pointer la Serbie du doigt et les Autrichiens comptaient sur le choc provoqué parmi les classes dirigeantes européennes pour en obtenir le soutien, ou du moins la neutralité, lorsqu'ils s'attaquèrent à la Serbie. Et en effet, l'Autriche-Hongrie n'avait pas d'autre choix que d'attaquer ou d'humilier la Serbie : faire moins aurait apporté un coup dévastateur à son "standing" et son influence dans la région critique des Balkans, la laissant complètement à la merci de son rival russe.
Pour le gouvernement français, une "guerre des Balkans" était le scénario idéal pour lancer une attaque contre l'Allemagne : si l'Allemagne pouvait être poussée dans une guerre pour défendre l'Autriche-Hongrie, et la Russie accourir à la défense des Serbes, la mobilisation française pourrait être dépeinte comme une mesure de défense préventive contre le danger d'une attaque allemande. Mieux encore, il était très peu probable que l'Italie, en principe un allié de l'Allemagne mais avec ses intérêts propres dans les Balkans, entrerait en guerre pour défendre la position de l'Autriche-Hongrie en Bosnie-Herzégovine.
Étant donnée l'alliance à laquelle elle faisait face, l'Allemagne se trouvait en position de faiblesse, avec comme seul allié l'Autriche-Hongrie, ce "tas de décomposition organisée" pour reprendre l'expression de Luxembourg. Les préparatifs militaires en France et en Russie, le développement de leur Entente avec la Grande-Bretagne, amenèrent les stratèges allemands à la conclusion qu'il vaudrait mieux se battre tôt, avant que leurs adversaires ne soient entièrement préparés, que tard. D'où la remarque suivante en 1914 : "Il faut absolument que si le conflit [entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie] s'étend (...,) ce soit la Russie qui en porte la responsabilité".38
La population britannique n’était pas chaude pour partir en guerre pour défendre la Serbie, ni même la France. La Grande-Bretagne aussi avait besoin d'un "prétexte, pour surmonter une partie importante de son opinion publique. L’Allemagne lui en fournit un, excellent, en lançant ses armées à travers la Belgique." Rosmer cite la Tragedy of Lord Kitchener du Viscount Esher, à cet effet : "L'épisode belge fut un coup de fortune qui vint à point donner à notre entrée dans la guerre le prétexte moral nécessaire pour préserver l'unité de la nation, sinon celle du gouvernement".39 En réalité, cela faisait des années que les plans britanniques pour une attaque contre l'Allemagne, préparés depuis longue date en collaboration avec les militaires français, prévoyaient la violation de la neutralité belge...
Tous les gouvernements des pays belligérants devaient donc tromper leur "opinion publique" en lui faisant croire qu'une guerre qu'ils préparaient et cherchaient depuis des années leur avait été imposée. L'élément critique de cette "opinion publique" était la classe ouvrière organisée, avec ses syndicats et ses partis socialistes, qui depuis des années déclamaient clairement leur opposition à la guerre. Le facteur principal ouvrant la route à la guerre était donc la trahison de la social-démocratie et son soutien accordé à ce que la classe dominante appela de façon mensongère une "guerre défensive".
Les causes sous-jacentes de cette trahison monstrueuse du devoir internationaliste le plus élémentaire de la social-démocratie fera l'objet d'un article prochain. Il suffit de dire ici que la prétention de la bourgeoisie française aujourd'hui que "en un instant, s’effacèrent les multiples querelles, politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé" est un mensonge éhonté. Au contraire, l'histoire des jours précédant l’éclatement de la guerre racontée par Rosmer est celle de manifestations constantes contre la guerre, brutalement réprimées par la police. Le 27 juillet, la CGT appela à une manifestation, et "de 9 heures à minuit (…), une foule énorme a déferlé sans cesse sur les boulevards. D'énormes forces de police avaient été mobilisées (…) Mais les ouvriers qui descendent des faubourgs sur le centre sont si nombreux que la tactique policière [de séparer les manifestants en petits groupes] aboutit à un résultat imprévu : on a bientôt autant de manifestations que de rues. Les violences et les brutalités policières ne peuvent avoir raison de la combativité de cette foule ; toute la soirée, le cri de 'A bas la guerre !' résonnera de l'Opéra jusqu'à la Place de la République".40 Les manifestations continuèrent le jour suivant, s'étendant aux principales villes des provinces.
La bourgeoisie française avait encore un autre problème : l'attitude du dirigeant socialiste Jean Jaurès. Jaurès était un réformiste, à un moment de l'histoire où le réformisme se trouvait coincé entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais il était profondément attaché à la défense de la classe ouvrière (c'était justement pour cela que son influence parmi les ouvriers était très grande) et passionnément opposé à la guerre. Le 25 juillet, lorsque la presse rapporte le rejet par la Serbie de l'ultimatum austro-hongrois, Jaurès devait parler devant un meeting électoral à Vaise, près de Lyon : son discours était centré non pas sur l'élection mais sur l'épouvantable danger de guerre. "Jamais, depuis quarante ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique (…) Nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes, à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter".41
Au départ, Jaurès a cru aux assurances frauduleuses du gouvernement français selon lesquelles ce dernier oeuvrait pour la paix, mais le 31 juillet, il avait perdu ses illusions et au Parlement appela de nouveau les ouvriers à faire tout leur possible pour s'opposer à la guerre. Rosmer raconte : "le bruit court-il que l'article qu'il va écrire tout à l'heure pour le numéro de samedi de L'Humanité sera un nouveau 'J'accuse !'42 dénonçant les intrigues et les mensonges qui ont mis le monde au seuil de la guerre. Dans la soirée (…) il conduit une délégation du groupe socialiste au Quai d'Orsay. [Le Ministère des Affaires Etrangères] Viviani n'est pas là. C'est le sous-secrétaire d’État qui reçoit la délégation. Après avoir écouté Jaurès, il lui demande ce que comptent faire les socialistes en face de la situation : 'Continuer notre campagne contre la guerre !', répond Jaurès. A quoi Abel Ferry réplique : 'C'est ce que vous n'oserez pas, car vous seriez tué au prochain coin de rue !'.43 Deux heures plus tard, quand Jaurès va regagner son bureau de L'Humanité pour écrire l'article redouté, l'assassin Raoul Villain l'abat ; deux balles de revolver tirées à bout portant ont provoqué une mort presque immédiate".44
Décidément, la classe bourgeoise française ne laissait rien au hasard, afin de s'assurer "l'unité et la cohésion nationales" !
Pas de guerre sans les ouvriers
Lorsque sont déposées les gerbes et quand les grands de ce monde s'inclinent devant le soldat inconnu lors des commémorations, que nos dirigeants se paient des millions d'euros ou de livres, lorsque le clairon sonne pour les morts à la fin des cérémonies solennelles, lorsque les documentaires déferlent sur les écrans de télévision et les doctes historiens nous racontent toutes les causes de la guerre, sauf celles qui comptent vraiment, tous les facteurs qui auraient été sensés l'empêcher, sauf ceux qui aurait vraiment pu peser dans la balance, les prolétaires du monde entier, eux, ont besoin de se souvenir.
Qu'ils se souviennent que la cause de la Première Guerre mondiale n'était pas le hasard historique, mais les rouages impitoyables du capitalisme et de l’impérialisme, que la Grande Guerre a ouvert une nouvelle période de l'histoire, une "époque de guerres et de révolutions" comme le disait l'Internationale Communiste. Cette période est toujours avec nous aujourd'hui, et les mêmes forces qui ont poussé le monde dans la guerre en 1914 sont aujourd'hui responsables des massacres sans fin au Moyen-Orient et en Afrique, alimentant des tensions toujours plus dangereuses entre la Chine et ses voisins dans la Mer de la Chine du Sud.
Qu'ils se souviennent que la guerre ne peut être menée sans ouvriers, comme chair à canon et chair à usine. Qu'ils se souviennent que les classes dominantes doivent s'assurer l'unité pour la guerre et qu'ils ne s'arrêteront à rien pour l'obtenir, depuis la répression brutale jusqu'au meurtre sanglant.
Qu'ils se souviennent que ce sont les mêmes partis "socialistes" qui aujourd'hui se mettent à la tête de toute campagne pacifiste et humanitaire, qui ont trahi la confiance de leurs aïeux en 1914, les laissant désorganisés et sans défense face à la machine de guerre capitaliste.
Qu'ils se souviennent, enfin, que si la classe dominante devait faire un tel effort afin de neutraliser le prolétariat en 1914, c'est parce que seul le prolétariat peut dresser une barrière fiable face à la guerre. Seul le prolétariat mondial porte en lui-même l'espoir de renverser le capitalisme et le danger de guerre, une fois pour toutes.
Il y a cent ans, l'humanité se tenait devant un dilemme dont la solution reste entre les mains du seul prolétariat : socialisme ou barbarie. Ce dilemme est encore devant nous aujourd'hui.
Jens
1Il est ironique de voir que le titre du film est tiré d'un livre d'avant-guerre écrit par l'économiste britannique Norman Angell, qui argumentait le fait que la guerre entre les puissances capitalistes avancées était devenue impossible parce que leurs économies étaient trop étroitement intégrées et interdépendantes - précisément le même genre d'argumentation que nous pouvons entendre aujourd'hui à propos de la Chine et des États-Unis.
2Il va sans dire que, comme toutes les œuvres que nous avons mentionnées ici, A l'ouest, rien de nouveau fut interdit par les Nazis après 1933. Il fut également interdit entre 1930 et 1941 par la censure australienne.
3Il est frappant par contre, que le plus célèbre des poètes de guerre patriotique anglais, Rupert Brooke, n'a jamais connu le combat puisqu'il est mort de maladie en route vers l'assaut sur Gallipoli.
4 Ceci a été l'objet d'une certaine polémique dans la presse allemande.
5Projet très louable en lui-même sans doute, mais qui ne contribuera pas à grand chose pour la compréhension des raisons de la Grande Guerre.
6 www.iwm.org.uk/centenary [446]
7“Commémorer la Grande Guerre (2014-2020) : propositions pour un centenaire international” par Joseph Zimet de la “Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives”, centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_jz.pdf.
8Il est frappant de voir que la grande majorité des exécutions pour désobéissance militaire dans l'armée française ont eu lieu pendant les premiers mois de la guerre, ce qui suggère un manque d'enthousiasme qui devait être tué dans l'oeuf d'emblée. (Cf. le rapport au Ministre auprès des Anciens Combattants Kader Arif d'octobre 2013) :
https://centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_fusi... [447]
9Cela vaut la peine de mentionner ici le fait que le titre Les Somnambules est tiré de la trilogie du même nom écrite par Hermann Broch en 1932. Broch est né en 1886 à Vienne, dans une famille juive, mais s'est converti en 1909 au catholicisme. En 1938, après l'annexion de l'Autriche il fut arrêté par la Gestapo. Cependant, grâce à l'aide d'amis (parmi lesquels James Joyce, Albert Einstein et Thomas Mann), il a pu émigrer aux Etats-Unis où il vécut jusqu'à sa mort en 1951. Die Schlafwandler raconte l'histoire de trois individus respectivement au cours des années 1888, 1905 et 1918, et examine les questions posées par la décomposition des valeurs et la subordination de la moralité aux lois du profit.
10La traduction de l'anglais est de nous.
11Voir notre article "L'anarcho-syndicalisme face à un changement d'époque : la CGT jusqu'à 1914", dans la Revue internationale n°120 : https://fr.internationalism.org/rint/120_cgt [375]
12Cf. Hew Strachan, The First World War ,volume 1
14Éditions d'Avron, mai 1993.
15Le deuxième tome fut publié après la Deuxième Guerre mondiale. Il est bien plus abrégé, puisque Rosmer a dû fuir Paris pendant l'occupation nazie et ses archives furent saisies et détruites pendant la guerre.
16Rosmer, p84.
17Brochure de Junius, chapitre "La fin de la lutte des classes"
18Luxembourg cite ici une lettre de Marx au Braunschweiger Ausschuss : "Celui qui n'est pas complètement assourdi par le tapage de l'heure présente, et qui n'a pas intérêt à assourdir le peuple allemand, doit comprendre que la guerre de 1870 donnera naissance à une guerre entre la Russie et l'Allemagne aussi nécessairement que celle de 1866 a amené celle de 1870. Nécessairement et inéluctablement, sauf au cas improbable du déclenchement préalable d'une révolution en Russie. Si cette éventualité improbable ne se produit pas, alors la guerre entre l'Allemagne et la Russie doit dès maintenant être considérée comme un fait accompli. Que cette guerre soit utile ou nuisible, cela dépend entièrement de l'attitude actuelle des vainqueurs allemands. S'ils prennent l'Alsace et la Lorraine, la France combattra contre l'Allemagne aux côtés de la Russie. Il est superflu d'en indiquer les conséquences funestes".
20Idem.
21La première crise marocaine de 1905 fut provoquée par une visite du Kaiser à Tanger, soi-disant pour soutenir l'indépendance marocaine, en réalité pour y contrer l'influence française. La tension militaire était au plus haut point : la France annula les permissions militaires et avança ses troupes à la frontière allemande, alors que l'Allemagne commençait à rappeler les réservistes sous les drapeaux. En fin de compte, les Français cédèrent et acceptèrent la proposition allemande d'une Conférence internationale, tenue à Algésiras en 1906. Mais les allemands y ont eu un choc : ils se sont trouvés abandonnés par toutes les puissances européennes, plus particulièrement par les Britanniques, ne trouvant de soutien qu'auprès de l'Autriche-Hongrie. La deuxième crise marocaine survint en 1911 lorsqu'une révolte contre le sultan Abdelhafid donna à la France un prétexte pour l'envoi de troupes au Maroc sous couvert d'y protéger les citoyens européens. Les Allemands, quant à eux, ont profité du même prétexte pour envoyer la canonnière Panther dans le port atlantique d'Agadir. Les Britanniques y voyaient le prélude de l'installation d'une base navale allemande sur la côte atlantique, menaçant directement Gibraltar. Le discours de Lloyd George au Mansion House (cité par Rosmer) fut une déclaration de guerre à peine voilée si l'Allemagne ne cédait pas. En fin de compte, l'Allemagne reconnut le protectorat français au Maroc, et reçut en échange quelques marécages à l'embouchure du Congo.
22Les Allemands y établirent la brasserie qui fabrique aujourd'hui la bière "Tsingtao".
23Brochure de Junius, idem.
24L'idée émise par Clark, mais aussi par Niall Fergusson dans The Pity of War, que l'Allemagne est restée loin derrière la Grande-Bretagne dans la course aux armements maritimes, est absurde : contrairement à la marine allemande, la marine britannique devait protéger un commerce mondial, et on voit difficilement comment la Grande-Bretagne pouvait ne pas se sentir menacée par la construction d'une flotte puissante stationnée à moins de 800 kilomètres de sa capitale et encore plus prêt de ses côtes.
25Bien que, dans les textes européens de l'époque, les termes "Turquie" et "Empire ottoman" sont identiques, il est important de se rappeler que le dernier terme est le plus approprié : au début du 19e siècle, l'Empire ottoman couvrait non seulement la Turquie mais aussi ce qu'aujourd'hui sont la Libye, la Syrie, l'Irak, la péninsule d'Arabie, plus une grande partie de la Grèce et des Balkans.
26Cette raffinerie était importante surtout pour des raisons militaires : la flotte britannique venait d'être convertie au fuel à la place du charbon, et alors que la Grande-Bretagne possédait du charbon en abondance, elle n'avait pas de pétrole. La recherche du pétrole en Perse fut impulsée avant tout par les besoins de la Marine Royale de s'assurer de ses fournitures en fuel.
27Junius, Chapitre 4
28La Première Guerre des Balkans éclata en 1912 lorsque les membres de la Ligue des Balkans (la Serbie, la Bulgarie et le Monténégro) s'attaquèrent à l'Empire ottoman avec le soutien tacite de la Russie. Bien qu'elle ne fasse pas partie de la Ligue, la Grèce s'est joint aux combats, à la fin desquels les armées ottomanes se trouvaient battues sur toute la ligne : l'Empire ottoman se trouvait privé pour la première fois en 500 ans de la plupart de ses territoires européens. La Deuxième Guerre des Balkans éclata immédiatement après, en 1913, lorsque la Bulgarie s'attaqua à la Serbie qui avait occupé, avec la connivence de la Grèce, une grande partie de la Macédoine qui avait été promise à la Bulgarie.
30Ces documents furent saisis par les Allemands qui en publièrent de longs extraits après la guerre. Comme Rosmer le signale : "Les appréciations des représentants de la Belgique à Berlin, Paris et Londres, ont une valeur particulière. La Belgique est neutre. Ils ont donc plus de liberté d'esprit que les partisans pour apprécier les événements ; de plus, ils n'ignorent pas qu'en cas de guerre entre les deux grands groupes de belligérants leur petit pays courra de grands risques, notamment de servir de champ de bataille" (Ibid, p68).
31Ibid, p69.
32Ibid, p70.
33Ibid, p70.
34Ibid, p73.
35Ibid, p72.
36Ibid, p87.
37D'ailleurs, le gouvernement austro-hongrois avait déjà essayé de mettre la pression sur la Serbie en divulguant à l'historien Heinrich Friedjung des documents frauduleux censés témoigner d'un complot serbe contre la Bosnie-Herzégovine (cf, Clark, p. 88, édition Kindle).
38Cité par Rosmer, p. 87, à partir de documents allemands publiés après la guerre.
39Rosmer, p. 87.
40Rosmer, p. 102
41Ibid, p. 84.
42Une référence à l'attaque dévastatrice portée par Emile Zola contre le gouvernement pendant l'affaire Dreyfus.
43Rosmer, p. 91. La conversation est rapportée dans la biographie de Jaurès de Charles Rappoport et confirmée dans les propres papiers d’Abel Ferry. (cf. Alexandre Croix, Jaurès et ses détracteurs, Éditions Spartacus, p. 313.
44Jaurès fut tué alors qu'il mangeait au Café du Croissant, en face des bureaux de L'Humanité. Raoul Villain présentait beaucoup de similarités avec Gavrilo Princip : instable, émotionnellement fragile, s'adonnant au mysticisme politique ou religieux – en somme, exactement le genre de personnage que les services secrets utilisent comme provocateur qu'on peut sacrifier sans état d'âme. Après le meurtre, Villain était arrêté et passa la guerre dans la sécurité, sinon le confort, d'une prison. A son procès il fut relâché, et Mme Jaurès se voyait obligée de payer les frais de justice.
Personnages:
- Rosa Luxemburg [451]
- Christopher Clark [452]
- Viviani [453]
- Abel Ferry [454]
- Albert Südekum [455]
- Alfred Rosmer [456]
- Bethman-Hollweg [457]
- Bismarck [458]
- Jean Jaurès [459]
- Raymond Poincaré [460]
- Gavrilo Princip [461]
- von Bülow [462]
- Wilfred Owen [463]
- Jaroslav Hasek [464]
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [444]
- Chemin de fer de Baghdad [465]
- Guerres des Balkans [466]
- Incident de Fashoda [467]
- Crise marocaine [468]
- Empire ottoman [469]
- Tsingtao [470]
Questions théoriques:
- Guerre [471]
Rubrique:
Le chemin vers la trahison de la Social-démocratie allemande
- 2337 lectures
De tous les partis de la 2ème Internationale, le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) était de loin le plus puissant. En 1914, le SPD comptait plus de 1 million de membres et il avait gagné plus de 4 millions de voix lors des élections législatives de 1912 1 : c'était, en fait, le seul parti de masse en Allemagne et le plus grand parti au Reichstag – bien que sous le régime autocratique impérial du Kaiser Guillaume II, il n'ait eu aucune chance de réellement former un gouvernement.
Pour les autres partis de la 2ème internationale, le SPD était le parti de référence. Karl Kautsky 2, rédacteur en chef de la Neue Zeit, la revue théorique du parti, était reconnu comme étant le "pape du marxisme", le théoricien phare de l'Internationale. Lors du Congrès de 1900 de l'Internationale, Kautsky a rédigé la résolution condamnant la participation du socialiste français Millerand dans un gouvernement bourgeois et, au Congrès de Dresde du SPD de 1903, sous la direction de son président August Bebel 3, il a condamné les théories révisionnistes d'Eduard Bernstein et réaffirmé les objectifs révolutionnaires du SPD. Lénine avait fait l'éloge de "l'esprit de parti" du SPD et de son immunisation face aux petites animosités personnelles comme celles qui avaient conduit les Mencheviks à provoquer la scission dans le POSDR (Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie) après son Congrès de1903 4. Enfin et surtout, la suprématie théorique et organisationnelle du SPD était clairement couronnée de succès sur le terrain : aucun autre parti de l'Internationale ne pouvait revendiquer, même de loin, des succès électoraux comme ceux du SPD et, s'agissant de l'organisation syndicale, seuls les britanniques pouvaient rivaliser avec les allemands quant au nombre et à la discipline de leurs membres.
"Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l'Internationale socialiste, tout était suspendu à l'opinion des Allemands. En particulier lors des débats sur les problèmes posés par la lutte contre le militarisme et sur la question de la guerre, la position de la social-démocratie allemande était toujours déterminante. "Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable" suffisait régulièrement pour décider de l'orientation de l'Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s'en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l'orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays." 5
Par conséquent, il était évident, alors que les nuages de la guerre avaient commencé à s'accumuler durant le mois de juillet 1914, que l'attitude de la social-démocratie allemande serait cruciale pour décider de l'issue de cette situation. Les travailleurs allemands – les grandes masses organisées au sein du parti et des syndicats pour l’existence desquels ils avaient mené de durs combats – se trouvaient dans une position où ils étaient les seuls à pouvoir faire pencher la balance : la résistance, la défense de l'internationalisme prolétarien, ou la collaboration de classe et la trahison, et des années de massacre, les plus sanglantes que l'humanité ait jamais connues.
"Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? À la chute la plus catastrophique, à l'effondrement le plus formidable. Nulle part l'organisation du prolétariat n'a été mise aussi totalement au service de l'impérialisme, nulle part l'État de siège supporté avec aussi peu de résistance, nulle part la presse autant bâillonnée, l'opinion publique autant étranglée, la lutte de classe économique et politique de la classe ouvrière aussi totalement abandonnée qu'en Allemagne." 6
La trahison de la social-démocratie allemande a provoqué un tel choc pour les révolutionnaires que lorsque Lénine a lu dans le Vorwärts 7 que la fraction parlementaire du SPD avait voté les crédits de guerre, il a pensé d'abord que ce numéro du journal était un faux confectionné par la propagande "noire" du gouvernement impérial. Comment un tel désastre avait-il été possible ? Comment, le fier et puissant SPD avait-il pu, en quelques jours, renier ses promesses les plus solennelles, se transformer, du jour au lendemain, de joyau de l'Internationale ouvrière en arme la plus puissante de l'arsenal guerrier de la classe dirigeante ?
En tentant de répondre à cette question, il peut sembler paradoxal de se concentrer en grande partie dans cet article sur les écrits et les actions d'un nombre relativement restreint d'individus ; après tout, le SPD et les syndicats étaient des organisations de masse, capables de mobiliser des centaines de milliers de travailleurs. Toutefois, il est justifié de procéder ainsi parce que des individus comme Karl Kautsky ou Rosa Luxemburg représentaient des tendances définies au sein du parti. En ce sens, leurs écrits exprimaient des tendances politiques avec lesquelles des masses de militants et de travailleurs – demeurés anonymes dans l'histoire - s'identifiaient. Il est également nécessaire de tenir compte des biographies politiques de ces personnalités si l'on veut comprendre le poids qu'elles avaient dans le parti. August Bebel, Président du SPD de 1892 jusqu'à sa mort en 1913, était l'un des fondateurs du parti et il fut emprisonné, en même temps que Wilhelm Liebknecht, également député au Reichstag, pour son refus de soutenir la guerre de la Prusse contre la France en 1870. Kautsky et Bernstein avaient tous deux été contraints à l'exil à Londres par les lois anti-socialistes de Bismarck, où ils avaient travaillé sous la direction d'Engels. Le prestige et l'autorité morale que cela leur avait donnés dans le parti étaient immenses. Même Georg von Vollmar, l'un des leaders réformistes de l’Allemagne du Sud, s'était tout d'abord fait connaître comme appartenant à l'aile gauche et comme un organisateur dynamique et talentueux dans la clandestinité, ayant connu des peines d'emprisonnement répétées.
C'était donc une génération qui s'était politisée durant la guerre franco-allemande et la Commune de Paris, au cours d'années de propagande clandestine et d'agitation sous la férule des lois anti-socialistes de Bismarck (1878-1890). D'une trempe très différente étaient des hommes comme Gustav Noske, Friedrich Ebert ou Philipp Scheidemann, tous membres de l'aile droite de la fraction parlementaire du SPD, qui ont voté les crédits de guerre en 1914 et ont joué un rôle clé dans la répression de la révolution allemande de 1919 – et dans l'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par les Corps Francs. A l’image de Staline plus tard, il s'agissait d'hommes d'appareil, travaillant dans les coulisses plutôt que participant activement au débat public, des représentants d'un parti qui, en grandissant, tendait à ressembler et à s'identifier de plus en plus à l'État allemand dont la chute était pourtant toujours l'objectif officiel.
La gauche révolutionnaire avait pris ses distances avec la tendance grandissante au sein du parti à faire des concessions à la "politique pratique". De façon frappante elle était en grande partie composée d'étrangers et de jeunes (à l'exception notable du vieux Franz Mehring). Mis à part le hollandais Anton Pannekoek et le fils de Wilhelm Liebknecht, Karl, des hommes comme Parvus, Radek, Jogiches, Marchlewski, venaient tous de l'empire russe et s'étaient forgés comme militants dans les conditions difficiles de l'oppression tsariste. Et bien sûr, la figure de gauche la plus exceptionnelle était Rosa Luxemburg, elle qui était un « outsider » dans le parti allemand sur tous les plans possibles : jeune, femme, polonaise, juive et, peut-être pire que tout du point de vue de certains dirigeants allemands, elle dominait intellectuellement et théoriquement les autres leaders du parti, lesquels ne lui arrivaient pas à la cheville.
La fondation du SPD
Le SAP (Parti ouvrier allemand) qui deviendra le SPD, fut fondé en 1875 à Gotha, par la fusion de deux partis socialistes : le SDAP (Parti ouvrier social-démocrate - Sozialdemokratische Arbeiterpartei) 8, dirigé par Wilhelm Liebknecht et August Bebel, et l'ADAV (Association des travailleurs allemands - Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) initialement fondée par Ferdinand Lassalle en 1863.
La nouvelle organisation avait donc deux origines très différentes. Le SDAP n'avait que six ans d'existence lors de la fusion. Grâce à la relation de longue date de Liebknecht avec Marx et Engels, ces derniers apportèrent une contribution importante au développement du SDAP - même si Liebknecht n'était en rien un théoricien, il joua un rôle important dans l'introduction des idées de Marx chez des hommes comme Bebel et Kautsky. En 1870, le SDAP adopta une ligne résolument internationaliste contre la guerre d'agression de la Prusse contre la France. Ainsi à Chemnitz, une réunion de délégués représentant 50 000 ouvriers saxons, avait adopté à l'unanimité une résolution en ce sens : "Au nom de la démocratie allemande, et spécialement des ouvriers du Parti social-démocrate, nous déclarons que la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France. Attentifs au mot d'ordre de l'Association internationale des Travailleurs : Prolétaires de tous les pays unissez-vous ! Nous n'oublierons jamais que les ouvriers de tous les pays sont nos amis et les despotes de tous les pays, nos ennemis !" 9
L'ADAV, en revanche, était restée fidèle à la position de son fondateur, Lassalle, opposé à la grève et convaincu que la cause des travailleurs pourrait avancer au moyen d'une alliance avec l'État bismarckien et, plus généralement, grâce aux recettes du "socialisme d'État" 10. Pendant la guerre franco-prussienne, l'ADAV est restée pro-allemande, son Président d'alors, Mende, allant jusqu'à réclamer que la France paie des réparations de guerre qui soient utilisées pour créer des ateliers nationaux pour les travailleurs allemands 11.
Marx et Engels furent profondément critiques envers le programme adopté lors de la fusion. Cependant les notes marginales de Marx sur ce programme n'ont été rendues publiques que bien plus tard 12, Marx estimant en effet que "Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes" 13. Bien qu'ils se soient abstenus de critiquer ouvertement le nouveau parti, ils firent clairement part de leur point de vue à ses dirigeants et, écrivant à Bebel, Engels soulignait deux points faibles qui, pour n'avoir pas été pris en compte, allaient semer les graines de la trahison de 1914 :
- "le principe de l'internationalisme du mouvement ouvrier est, dans la pratique, complètement abandonné pour le présent, et cela par des gens qui, cinq ans durant et dans les circonstances les plus difficiles, ont défendu hautement ce principe de la façon la plus digne d'éloges. Le fait que les ouvriers allemands sont aujourd'hui à la tête du mouvement européen repose avant tout sur l'attitude vraiment internationale qu'ils ont eue pendant la guerre ; il n'y a pas d'autre prolétariat qui se serait aussi bien conduit. Et c'est aujourd'hui, où partout à l'étranger les ouvriers affirment ce principe avec la même vigueur et où les gouvernements font tous leurs efforts pour l'empêcher de se manifester dans une organisation, qu'ils devraient l'abandonner ?"
- "la seule revendication sociale que le programme fasse valoir est l'aide lassalienne de l'État, présentée sous la forme la moins voilée et telle que Lassalle l'a volée chez Buchez. Et cela, après que Bracke ait prouvé tout le néant d'une pareille revendication ; après que presque tous, sinon tous les orateurs de notre Parti aient été obligés, dans leur lutte contre les lassalliens, de la combattre ! Notre parti ne pouvait pas tomber plus bas dans l'humiliation. L'internationalisme descendu au niveau d'Armand Goegg, le socialisme à celui du républicain-bourgeois Buchez, qui opposait cette revendication aux socialistes pour les combattre !" 14
Ces failles dans la pratique politique n'étaient guère surprenantes étant donné l'assise théorique éclectique du nouveau parti. Quand Kautsky fonda la Neue Zeit en 1883, il avait l'intention qu'elle soit "publiée comme un organe marxiste se fixant la tâche de relever le faible niveau théorique de la social-démocratie allemande, de détruire le socialisme éclectique et de faire remporter la victoire au programme marxiste" ; il écrivait à Engels : "J'ai peut-être réussi mes tentatives pour faire de la Neue Zeit le point de ralliement de l'école marxiste. Je gagne la collaboration de nombreuses forces marxistes, tandis que je me débarrasse de l'éclectisme et du Rodbertussianisme". 15
Dès le départ, y compris au cours de son existence clandestine, le SDAP constitua donc un champ de bataille entre des tendances théoriques contradictoires – comme c'est la norme dans toute organisation prolétarienne en bonne santé. Mais, suivant les mots de Lénine, "sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire", et ces différentes tendances, ou visions de l'organisation et de la société, devaient avoir des conséquences très pratiques.
Au milieu des années 1870, le SDAP regroupait quelque 32 000 membres dans plus de 250 districts et, en 1878, le chancelier Bismarck imposa une loi "anti-socialiste" en vue de paralyser l'activité du parti. Des dizaines de journaux, les réunions, les organisations furent interdits, et des milliers de militants envoyés en prison ou soumis à des amendes. Mais la détermination des socialistes resta intacte face à la loi anti-socialiste. L'activité du SDAP prospéra dans les conditions de semi-illégalité. Être mis hors la loi contraignit le parti et ses membres à s'organiser hors des circuits de la démocratie bourgeoise – même la démocratie limitée de l'Allemagne bismarckienne – et à développer une forte solidarité contre la répression policière et la surveillance permanente de l'État. En dépit du harcèlement policier constant, le parti réussit à maintenir sa presse et à augmenter la circulation de celle-ci, au point où le journal satirique Der wahre Jacob (fondé en 1884) comptait à lui seul 100 000 abonnés.
Malgré les lois anti-socialistes, une activité publique était encore accessible au SDAP : il était encore possible pour les membres du SDAP de participer aux élections au Reichstag en tant que candidats indépendants non affiliés. C'est pourquoi une grande partie de la propagande du parti fut centrée autour des campagnes électorales aux niveaux national et local. Cela peut expliquer à la fois le principe selon lequel la fraction parlementaire devait rester strictement subordonnée aux congrès du parti et à l'organe central du parti, le Vorstand 16, et le poids croissant de la fraction parlementaire dans le parti alors que son succès électoral augmentait.
Bismarck menait la politique classique de la "carotte et du bâton". Alors qu'il empêchait les travailleurs de s'organiser, l'État impérial cherchait à couper l'herbe sous le pied des socialistes en instaurant, à partir de 1883, des primes d'assurance sociale en cas de chômage, de maladie ou de départ à la retraite, et cela une bonne vingtaine d'années avant l'instauration, en France, de la Loi sur les pensions des travailleurs et des paysans (1910) et, en Grande-Bretagne, de la Loi sur l'assurance nationale (1911). À la fin des années 1880, environ 4,7 millions de travailleurs allemands recevaient des indemnités de la sécurité sociale.
Pas plus les lois anti-socialistes que l'introduction de la sécurité sociale n'eurent l'effet escompté, à savoir un affaiblissement du soutien dont jouissait la social-démocratie. Au contraire, entre 1881 et 1890, le résultat électoral du SDAP passa de 312 000 à 1 427 000 voix, faisant de lui le plus grand parti en Allemagne. En 1890, le nombre de ses membres atteignait 75 000 et quelques 300 000 travailleurs avaient rejoint les syndicats. En 1890, le chancelier Bismarck fut limogé par le nouvel Empereur Guillaume II et les lois anti-socialistes furent abrogées.
Au sortir de la clandestinité, le SDAP fut refondé en tant qu'organisation légale, le SPD (Parti social-démocrate allemand - Sozialdemokratische Partei Deutschlands), lors de son congrès d'Erfurt en 1891. Le Congrès adopta un nouveau programme, et bien qu'Engels ait considéré le programme d'Erfurt comme constituant une amélioration par rapport à son prédécesseur de Gotha, il jugea néanmoins nécessaire d'attaquer la tendance à l'opportunisme : "Mais, de toute façon, les choses doivent être poussées en avant. Combien cela est nécessaire, c'est ce que prouve précisément aujourd'hui l'opportunisme qui commence à se propager dans une grande partie de la presse social-démocrate. Dans la crainte d'un renouvellement de la loi contre les socialistes ou se souvenant de certaines opinions émises prématurément du temps où cette loi était en vigueur, on veut maintenant que le Parti reconnaisse l'ordre légal actuel en Allemagne comme pouvant suffire à faire réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique (…) Une pareille politique ne peut, à la longue, qu'entraîner le Parti dans une voie fausse. On met au premier plan des questions politiques générales, abstraites, et l'on cache par-là les questions concrètes les plus pressantes, qui, aux premiers événements importants, à la première crise politique, viennent d'elles-mêmes s'inscrire à l'ordre du jour. Que peut-il en résulter, sinon ceci que, tout à coup, au moment décisif, le Parti sera pris au dépourvu et que sur les points décisifs, il régnera la confusion et l'absence d'unité, parce que ces questions n'auront jamais été discutées ? (…) Cet oubli des grandes considérations essentielles devant les intérêts passagers du jour, cette course aux succès éphémères et la lutte qui se livre tout autour, sans se préoccuper des conséquences ultérieures, cet abandon de l'avenir du mouvement que l'on sacrifie au présent, tout cela a peut-être des mobiles honnêtes. Mais cela est et reste de l'opportunisme. Or, l'opportunisme "honnête" est peut-être le plus dangereux de tous." 17
Engels a fait preuve ici d’une remarquable prescience : les déclarations publiques d'intention révolutionnaire devaient se révéler impuissantes sans un plan d'action concret pour les sauvegarder. En 1914, le parti s'est en effet retrouvé "tout à coup pris au dépourvu".
Néanmoins, le slogan officiel du SPD restait : "Pas un homme ni un sou pour ce système", et ses députés au Reichstag refusaient systématiquement tout soutien aux budgets publics, en particulier les dépenses militaires. Cette opposition de principe à tout compromis de classe demeurait une possibilité au sein du système parlementaire parce que le Reichstag n'avait aucun pouvoir réel. Le gouvernement de l'Empire allemand de Guillaume était autocratique, peu différent de celui de la Russie tsariste 18, et l'opposition systématique du SPD n'avait en fait aucune conséquence pratique immédiate.
Dans le sud de l'Allemagne, les choses étaient différentes. Là, le SPD local, sous la direction d'hommes comme Vollmar, affirmait qu'il existait des "conditions particulières" et que si le SPD ne votait pas de façon significative dans les élections des Länder et ne se dotait pas d'une politique agraire faisant appel à la petite paysannerie, il serait voué à l'impuissance et à l'inutilité. Cette tendance apparut dès que le parti fut légalisé lors du Congrès d'Erfurt de 1891 et, dès lors, les députés SPD des parlements provinciaux de Wurtemberg, Bavière et Bade votèrent en faveur de budgets gouvernementaux. 19
La réaction du parti à cette attaque directe contre sa politique, exprimée de façon répétée dans les résolutions des congrès, fut de laisser la question sous le tapis. Une tentative de Vollmar de proposer un programme agraire spécial fut rejetée par le Congrès de Francfort de 1894 mais le même Congrès rejeta également une résolution interdisant le vote de tout député SPD en faveur de n'importe quel budget gouvernemental. On considérait que tant que la politique réformiste pouvait être limitée à "l'exception" du Sud de l'Allemagne, elle pouvait être tolérée. 20
La légalité sape l'esprit de combat du SPD
L'expérience par la classe ouvrière d'une dizaine d'années de semi-illégalité allait rapidement être minée par le poison de la démocratie. Par leur nature même, la démocratie bourgeoise et l'individualisme qui va de pair, sapent les tentatives du prolétariat pour développer une vision de lui-même comme classe historique avec sa propre perspective antagonique à celle de la société capitaliste. Parce qu'elle divise la classe ouvrière en une simple masse de citoyens atomisés, l'idéologie démocratique est un coin inséré en permanence dans la solidarité ouvrière. Au cours de cette période, les succès électoraux du parti, tant en termes de voix que de sièges au Parlement, augmentaient rapidement tandis que de plus en plus de travailleurs étaient organisés dans les syndicats et se trouvaient en mesure d'améliorer leurs conditions matérielles. La puissance politique grandissante du SPD et la force de la classe ouvrière industrielle organisée donnèrent naissance à un nouveau courant politique qui commença à théoriser l'idée que, non seulement il était possible de construire le socialisme au sein du capitalisme, d'œuvrer vers une transition progressive sans qu'il soit nécessaire de renverser le capitalisme par une révolution, mais encore que le SPD devrait avoir une politique étrangère expansionniste spécifiquement allemande : ce courant se cristallisa en 1897 autour de la Sozialistische Monatshefte, une revue hors du contrôle du SPD, dans des articles de Max Schippel, Wolfgang Heine et Heinrich Peus.21
Cette situation inconfortable, mais supportable, explosa en 1898 avec la publication des Préconditions du socialisme et les tâches de la social-démocratie (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie) de Eduard Bernstein. La brochure de Bernstein expliquait ouvertement ce que lui et d'autres avaient suggéré depuis un certain temps : "pratiquement parlant, écrivait-il en 1896 à Kautsky, nous ne sommes qu'un parti radical ; nous ne faisons que ce que font tous les partis bourgeois radicaux, si ce n'est que nous le dissimulons sous un langage entièrement disproportionné à nos actions et à nos moyens" 22. Les positions théoriques de Bernstein attaquaient les fondements mêmes du marxisme en ce sens qu'il rejetait le caractère inévitable du déclin du capitalisme et de son effondrement final. En se fondant sur la prospérité en plein essor des années 1890, couplée avec la rapide expansion colonialiste du capitalisme à travers la planète, Bernstein faisait valoir que le capitalisme avait surmonté sa tendance vers des crises auto-destructives. Dans ces conditions, le but n'était rien, le mouvement était tout, la quantité devait prévaloir sur la qualité, l'antagonisme entre l'État et la classe ouvrière devait pouvoir être surmonté 23. Bernstein proclamait ouvertement que le principe fondamental du Manifeste communiste, selon lequel les travailleurs n'ont pas de patrie, était "obsolète". Il appelait les travailleurs allemands à apporter leur soutien à la politique coloniale de l'Empereur en Afrique et en Asie. 24
En réalité, toute une époque, celle de l'expansion et de l'ascension du système capitaliste, tirait à sa fin. Pour les révolutionnaires, de telles périodes de profonde transformation historique posent toujours un défi majeur puisqu'ils doivent analyser les caractéristiques de la nouvelle période et développer un cadre théorique pour comprendre les changements fondamentaux en cours, mais aussi adapter leur programme, si nécessaire, tout en continuant à défendre le même objectif révolutionnaire.
L'expansion rapide du capitalisme à travers le globe, son développement industriel massif, la nouvelle fierté de la classe dirigeante et son positionnement impérialiste, tout cela faisait penser au courant révisionniste que le capitalisme durerait toujours, que le socialisme pourrait être introduit à partir du capitalisme, et que l'État capitaliste pourrait servir les intérêts de la classe ouvrière. L'illusion d'une transition pacifique montrait que les révisionnistes étaient devenus les prisonniers du passé, incapables de comprendre qu'une nouvelle période historique se profilait à l'horizon : la période de décadence du capitalisme et de l'explosion violente de ses contradictions. Leur incapacité à analyser la nouvelle situation historique et la théorisation du caractère "éternel" des conditions du capitalisme à la fin du 19e siècle signifiaient aussi que les révisionnistes étaient incapables de voir que les anciennes armes de la lutte, le parlementarisme et la lutte syndicale, n'étaient plus utilisables. La polarisation sur le travail parlementaire comme axe de l'activité du parti, l'orientation en faveur de la lutte pour des réformes au sein du système, l'illusion d'un "capitalisme exempt de crises" et sur la possibilité d'introduire le socialisme pacifiquement dans le capitalisme, montraient fait que'une grande partie de la direction du SPD s'était identifiée avec le système. Le courant ouvertement opportuniste au sein du parti exprimait une perte de confiance dans la lutte historique du prolétariat. Après des années de luttes défensives pour le programme "minimum", l'idéologie démocratique bourgeoise avait pénétré dans le mouvement ouvrier. Cela signifiait que l'existence et les caractéristiques des classes sociales étaient mises en cause, qu'une vision individualiste avait tendance à dominer et à dissoudre les classes dans "le peuple". L'opportunisme jetait par-dessus bord la méthode marxiste d'analyse de la société en termes de lutte des classes et de contradictions de classe ; en fait, l'opportunisme signifiait l'absence de toute méthode, de tout principe et l'absence de toute théorie.
La gauche contre-attaque
La réaction de la direction du parti au texte de Bernstein fut d'en minimiser l'importance (le Vorwärts l'accueillit comme une "stimulante contribution à débattre", déclarant que tous les courants au sein du parti devraient être libres d'exprimer leurs opinions), tout en regrettant, en privé, que de telles idées soient exprimées ouvertement. Ignaz Auer, le secrétaire du parti, écrivait à Bernstein : "Mon cher Ede, on ne prend pas formellement la décision de faire les choses que vous suggérez, on ne dit pas ces choses, on les fait simplement". 25
Au sein du SPD, l'opposition la plus déterminée à Bernstein venait des forces qui n'avaient pas été habituées à la longue période de légalité ayant suivi la fin des lois anti-socialistes. Ce n'est pas par hasard si les opposants les plus clairs et les plus virulents au courant de Bernstein étaient des militants d'origine étrangère et, plus précisément, de l'Empire russe. Parvus, d'origine russe, qui avait émigré en Allemagne dans les années 1890 et qui, en 1898, travaillait comme rédacteur en chef de la presse du SPD à Dresde, le Sächsische Arbeiterzeitung 26, lança une attaque enflammée contre les idées de Bernstein et fut soutenu par la jeune révolutionnaire, Rosa Luxemburg, qui avait émigré en Allemagne en mai 1898 et avait connu la répression en Pologne. Dès qu'elle s'installa en Allemagne, Rosa Luxemburg commença à mener la lutte contre les révisionnistes avec son texte Réforme sociale ou révolution rédigé en 1898-99 (dans lequel elle présente la méthode de Bernstein, réfute l'idée de l'établissement du socialisme par le biais de réformes sociales, dénonce la théorie et la pratique de l'opportunisme). Dans sa réponse à Bernstein, elle souligne que la tendance réformiste avait pris son plein essor depuis l'abolition des lois anti-socialistes et la possibilité de travailler légalement. Le socialisme d'État de Vollmar, l'approbation du budget bavarois, le socialisme agraire Sud-allemand, les propositions de compensations de Heine, la position de Schippel sur les douanes et la milice constituaient les éléments d'une pratique opportuniste grandissante. Elle soulignait le dénominateur commun de ce courant : l'hostilité à l'égard de la théorie : "Ce qui distingue [toutes les tendances opportunistes au sein du parti] en surface ? L'aversion de la "théorie" et cela est naturel étant donné que notre théorie, c'est-à-dire les bases du socialisme scientifique, assigne à notre activité pratique des tâches claires et des limites, tant en ce qui concerne les objectifs à atteindre que les moyens à utiliser et enfin la méthode de la lutte. Naturellement ceux qui ne veulent que courir après les réalisations pratiques développent rapidement un désir de se libérer, c'est-à-dire de séparer la pratique de la théorie." 27
Pour elle, la première tâche des révolutionnaires était de défendre le but final. "Le mouvement comme tel sans lien avec l'objectif final, le mouvement comme but en soi n'est rien, l'objectif final, c'est ce qui compte." 28
Dans un texte de 1903, Stagnation et progrès du marxisme, Rosa Luxemburg considère l'insuffisance théorique de la social-démocratie en ces termes : "l'effort scrupuleux pour rester "dans les limites du marxisme" a parfois été aussi désastreux pour l'intégrité du processus de pensée que l'autre extrême – le désaveu complet de la perspective marxiste et la détermination de manifester "l'indépendance de la pensée" face à tous les dangers".
En attaquant Bernstein, Luxemburg exigeait également que l'organe de presse central du parti défendît les positions décidées par les congrès du parti. Lorsqu'en mars 1899, le Vorwärts répondit que la critique par Luxemburg de la position de Bernstein (dans un article intitulé "Vains espoirs" - Eitle Hoffnungen) était injustifiée, celle-ci répliqua que le Vorwärts "se trouve dans la situation confortable de ne jamais courir le risque d'avoir une opinion erronée ou de changer d'avis, un péché qu'il aime à trouver chez les autres, tout simplement parce qu'il n'a jamais défendu ni ne défend jamais aucune opinion".29
Continuant dans la même veine, elle écrivait : "il y a deux sortes de créatures organiques : celles qui ont une colonne vertébrale et qui peuvent marcher debout, parfois même courir ; et il y en a d'autres qui n'ont aucune colonne vertébrale et ne peuvent donc que ramper et bidouiller", À ceux qui voulaient que le parti abandonne toute position programmatique et tout critère politique, elle répondit lors de la Conférence du parti à Hanovre en 1899 : "si cela signifie que le parti – au nom de la liberté de critique – ne doit pas prendre position ni le déclarer au moyen d'un vote à la majorité, nous ne défendons pas cette position. Nous devons donc protester contre cette idée, parce que nous ne sommes pas un club de discussion mais un parti de combat politique, qui doit défendre certaines visions fondamentales." 30
Le marais vacille
Entre l'aile gauche déterminée, autour de Rosa Luxemburg, et la droite défendant les idées de Bernstein et la révision des principes, il y avait un "marais", que Bebel décrit dans les termes suivants lors du Congrès de Dresde de 1903 : "c'est toujours la même vieille et éternelle lutte entre une gauche et une droite et, entre les deux, le marais. Ce sont des éléments qui ne savent jamais ce qu'ils veulent ou plutôt qui ne disent jamais ce qu'ils veulent. Ce sont les Monsieur-je-sais-tout qui, habituellement, écoutent d'abord pour voir qui dit quoi, ce qui est dit ici et là. Ils sentent toujours où se trouve la majorité et ils rejoignent habituellement la majorité. Nous avons aussi ce genre de gens dans le parti (...) l'homme qui défend sa position ouvertement, au moins je sais où il se trouve ; au moins je peux me battre avec lui. Ou il gagne ou c'est moi, mais les éléments paresseux qui esquivent toujours et évitent toujours une décision claire, qui toujours disent "nous sommes tous d'accord, oui nous sommes tous frères", ce sont les pires. Je les combats le plus durement." 31
Ce marais, incapable de prendre une position claire, vacillait entre ceux qui étaient clairement révisionnistes, la droite, et la gauche révolutionnaire. Le centrisme est l'un des visages de l'opportunisme. Il se positionne toujours entre les forces antagonistes, entre les courants réactionnaires et les courants radicaux, il tente de concilier les deux. Il évite la confrontation ouverte des idées, il fuit le débat, il estime toujours que "un côté n'a pas complètement raison", mais que "l'autre côté n'a pas tout à fait raison non plus". Il considère le débat politique avec des arguments clairs et un ton polémique comme "exagéré", "extrémiste", "troublant", voire "violent". Il pense que la seule façon de maintenir l'unité, afin de préserver l'organisation, est de permettre à toutes les tendances politiques de coexister, y compris celles dont les objectifs sont en contradiction directe avec ceux de l'organisation. Il répugne à prendre en charge ses responsabilités et à se positionner. Le centrisme dans le SPD avait tendance à s'allier avec réticence avec la gauche, tout en regrettant "l'extrémisme" et la "violence" de celle-ci et à empêcher effectivement que soient prises des mesures fermes – telles que l'expulsion des révisionnistes du parti – et que soit préservée la nature révolutionnaire du parti.
Rosa Luxemburg, au contraire, considérait que la seule façon de défendre l'unité du parti en tant qu'organisation révolutionnaire était d'insister sur l'exposition la plus complète et la discussion publique des points de vue opposés.
"En dissimulant les contradictions par "l'unité" artificielle de vues incompatibles, les contradictions ne peuvent qu'atteindre un sommet, jusqu'à ce qu'elles explosent violemment tôt ou tard dans une scission (...) Ceux qui mettent en avant les divergences de vue, et combattent les opinions divergentes, travaillent à l'unité du parti. Mais ceux qui dissimulent les divergences travaillent à une réelle scission dans le parti." 32
Le summum du centrisme à ce moment de la vie du SPD et son plus prestigieux représentant était Karl Kautsky.
Lorsque Bernstein commença à développer son point de vue révisionniste, Kautsky resta silencieux, au début, préférant ne pas s'opposer à son vieil ami et camarade en public. Il ne voyait pas non plus à quel point les théories révisionnistes de Bernstein sapaient les fondements révolutionnaires sur lesquels le parti avait été construit. Comme l'a souligné Luxemburg, dès lors qu'on accepte l'idée que le capitalisme peut durer éternellement, qu'il n'est pas voué à s'effondrer en raison de ses propres contradictions internes, on est inévitablement conduit à abandonner le but révolutionnaire 33. L'échec de Kautsky– comme de la plus grande partie de la presse du parti – était un signe évident de la perte de l'esprit de combat dans l'organisation : le débat politique n'était plus une question de vie ou de mort pour la lutte des classes, il était devenu une préoccupation académique d'intellectuels spécialistes.
L'arrivée de Rosa Luxemburg à Berlin en 1898 (de Zürich où elle venait de terminer avec brio ses études avec une thèse de doctorat sur le développement économique de la Pologne) et ses réactions aux théories de Bernstein, devaient jouer un rôle majeur dans l'attitude de Kautsky.
Lorsque Luxemburg, prenant conscience des hésitations de Bebel et de Kautsky et de leur refus de combattre les vues de Bernstein, critiqua cette attitude dans une lettre à Bebel 34. Elle demanda pourquoi ils n'insistaient pas pour répondre énergiquement à Bernstein et, en mars 1899, après qu'elle eut commencé la série d'articles qui allait devenir plus tard la brochure Réforme sociale ou révolution, elle rapporta à Jogiches : "quant à Bebel, dans une conversation avec Kautsky, je me suis plainte qu'il ne se lève pas ni ne se batte. Kautsky m'a dit que Bebel avait perdu son dynamisme, qu'il avait perdu sa confiance en lui-même et n'avait plus aucune énergie. Je le grondai à nouveau et lui demandai : 'pourquoi ne l'inspirez-vous pas, ne lui apportez-vous pas des encouragements et de l'énergie ?' Kautsky a répondu : 'vous devriez le faire, allez parler à Bebel, vous devriez l'encourager' ". Quand Luxemburg demanda à Kautsky pourquoi lui n'avait pas réagi, il répondit : "Comment puis-je m'impliquer dans des rassemblements et des réunions maintenant, alors que je suis pleinement engagé dans la lutte parlementaire, cela signifie seulement qu'il y aura des affrontements, et où cela mènerait-il ? Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour cela." 35
En 1899, dans Bernstein et le programme social-démocrate – une anti-critique (Bernstein und das sozialdemokratische Programm - Eine Antikritik), Kautsky s'exprima finalement contre les idées de Bernstein sur la philosophie marxiste et l'économie politique ainsi que sur ses vues sur le développement du capitalisme. Mais, néanmoins, il salua le livre de Bernstein comme étant une précieuse contribution au mouvement, s'opposa à l'idée de son expulsion du parti et évita de dire que Bernstein était en train de trahir le programme marxiste. Bref, comme Rosa Luxemburg le conclut, Kautsky voulait éviter toute contestation de la routine plutôt confortable de la vie du parti ainsi que la nécessité de critiquer son vieil ami en public. Comme Kautsky lui-même l'admit en privé à Bernstein : "Parvus et Luxemburg avaient déjà bien saisi la contradiction de votre point de vue avec nos principes programmatiques, alors que je ne voulais pas encore l'admettre et croyais fermement que tout cela était un malentendu (...) C'était mon erreur, je n'étais pas aussi perspicace que Parvus et Luxemburg qui, déjà à l'époque, avaient flairé la ligne de pensée de votre brochure." 36 En fait, dans le Vorwärts, Kautsky minimisait et banalisait l'attaque constituée par la nouvelle théorie révisionniste de Bernstein, disant qu'elle avait été amplifiée hors de toute proportion, d'une manière typique de l'"imagination absurde" d'une mentalité de petit-bourgeois. 37
Loyauté aux amis ou à la classe ?
Par fidélité à son vieil ami, Kautsky estima qu'il devait s'excuser auprès de Bernstein en privé, écrivant : "Il aurait été lâche de rester silencieux. Je ne crois pas que je vous aie fait du mal maintenant que j'ai parlé. Si je n'avais pas dit à August Bebel que je répondrai à votre déclaration, il l'aurait fait lui-même. Vous pouvez imaginer ce qu'il aurait dit, connaissant son tempérament et son insensibilité" 38. Cela signifiait qu'il préférait rester muet et aveugle face à son vieil ami. Il réagit contre son gré et seulement après y avoir été contraint par la gauche. Plus tard, il admit qu'il avait "péché" en permettant à son amitié avec Bernstein de dominer son jugement politique : "Dans ma vie, j'ai péché seulement une fois par amitié, et je regrette encore ce péché à ce jour. Si je n'avais pas tant hésité avec Bernstein, et si je l'avais confronté dès le début avec la netteté nécessaire, j'aurais pu épargner au parti de nombreux problèmes désagréables." 39 Toutefois, cet "aveu" est sans valeur tant qu'il ne va pas à la racine du problème. Bien qu'il ait confessé son "péché", Kautsky ne donna jamais une explication politique plus profonde, donnant les raisons pour lesquelles une telle attitude, basée sur l'affinité personnelle plutôt que sur les principes politiques, était un danger pour une organisation politique. En réalité, cette attitude l'amena à accorder aux révisionnistes une "liberté d'opinion" illimitée au sein du parti. Comme Kautsky le dit à la veille du Congrès du parti de Hanovre : "En général, il faut laisser à chaque membre du parti la possibilité de décider s'il partage encore les principes du parti ou non. En excluant une personne, nous agissons seulement contre ceux qui portent atteinte au parti ; personne n'a encore été exclu du parti à cause de critiques raisonnables, parce que notre parti a toujours hautement apprécié la liberté de discussion. Même si Bernstein n'avait pas mérité tant d'estime pour sa participation dans notre lutte, et pour le fait qu'il a dû s'exiler en raison de ses activités de parti, nous n'envisagerions quand même pas de l'exclure." 40
La réponse de Rosa Luxemburg était claire. "Si grand que soit notre besoin d'autocritique et si larges que soient les limites que nous lui traçons, il doit cependant exister un minimum de principes constituant notre essence et notre existence même, le fondement de notre coopération en tant que membres d'un parti. Dans nos propres rangs, la 'liberté de critique' ne peut pas s’appliquer à ces principes, peu nombreux et très généraux, justement parce qu'ils sont la condition préalable de toute activité dans le Parti, et par conséquent aussi de toute critique exercée à l'endroit de cette activité. Nous n'avons pas à nous boucher les oreilles lorsque ces principes mêmes sont critiqués par quelqu'un qui se trouve en dehors de notre Parti. Mais aussi longtemps que nous les considérons comme le fondement de notre existence en tant que parti, nous devons y demeurer attachés et ne pas les laisser ébranler par nos membres. À ce sujet, nous ne pouvons accorder qu'une liberté : celle d’appartenir ou de ne pas appartenir à notre Parti". 41
L'implication logique de "l'absence de position" de Kautsky, c'est que tout le monde pourrait rester au sein du parti et défendre ce qui lui plaît, que le programme est édulcoré, que le parti devient un "melting pot" d'opinions différentes et non le fer de lance d'une lutte déterminée. L'attitude de Kautsky montra qu'il préférait la fidélité à un ami à la défense des positions de classe. Dans le même temps, il voulut adopter la posture d'un "expert" théorique. Il est vrai qu'il avait écrit quelques livres très importants et précieux (voir ci-dessous), et qu'il jouissait de l'estime d'Engels. Mais, comme Luxemburg le relève dans une lettre à Jogiches : "Karl Kautsky se limite à la théorie" 42. Préférant s'abstenir de toute participation à la lutte pour la défense de l'organisation et de son programme, Kautsky perdit progressivement toute attitude de combat, et cela signifiait qu'il plaçait ce qu'il considérait comme ses obligations envers ses amis au-dessus de toute obligation morale envers son organisation et ses principes. Cela conduisit à ce que la théorie soit détachée de l'action pratique et concrète : par exemple, le précieux travail de Kautsky sur l'éthique, en particulier le chapitre sur l'internationalisme, n'était pas soudé à une défense sans faille de l'internationalisme dans l'action.
Il y a un contraste saisissant entre l'attitude de Kautsky vis-à-vis de Bernstein et celle de Rosa Luxemburg vis-à-vis de Kautsky. À son arrivée à Berlin, Luxemburg entretenait des relations étroites avec Kautsky et sa famille. Mais rapidement elle sentit que la grande estime que la famille de Kautsky lui démontrait devenait un fardeau. Déjà en 1899 elle se plaignait à Jogiches : "Je commence à fuir leurs belles paroles. Les Kautsky me considèrent comme faisant partie de leur famille." (11/12/1899). "Je ressens toutes ces marques d'affection (il est très bien intentionné envers moi, je peux le voir), comme un fardeau terrible, au lieu d'un plaisir. En fait, toute amitié mise en place dans l'âge adulte et plus encore quand elle est basée sur l'appartenance au parti, est un fardeau : elle vous impose certaines obligations, elle est une contrainte, etc. Et justement ce côté de l'amitié est un handicap pour moi. Après la rédaction de chaque article, je me demande : ne sera-t-il pas déçu, cela ne va-t-il pas refroidir notre amitié ?" 43. Elle était consciente des dangers d'une attitude fondée sur des affinités, où les considérations d'obligation personnelle, d'amitié ou des goûts communs, obscurcissent le jugement politique du militant mais, aussi, ce que nous pourrions appeler son jugement moral quant à savoir si une ligne d'action est conforme aux principes de l'organisation 44. Luxemburg osait néanmoins confronter Kautsky ouvertement : "J'ai eu une dispute de fond sur la manière d'aborder les choses avec Kautsky. Il m'a dit en conclusion que je penserai comme lui dans vingt an, ce à quoi j'ai répondu que si c'était le cas, c'est que je serai un zombie dans 20 ans." 45
Lors du Congrès de Lübeck en 1901, Luxemburg fut accusée de déformer les positions des autres camarades, une accusation qu'elle estima diffamatoire et pour laquelle elle exigea une clarification publique. Dans ce but, elle soumit une déclaration pour publication dans le Vorwärts 46. Mais Kautsky, au nom de la Neue Zeit, l'exhorta à retirer sa demande de publication. Elle répondit à Kautsky : "Bien sûr, je suis prête à renoncer à publier ma déclaration dans la Neue Zeit, mais permettez-moi d'ajouter quelques mots d'explication. Si j'étais un de ceux qui, sans considération pour personne, protégeait mes droits et mes intérêts – et ils sont légion dans notre parti – ou plutôt ils sont tous comme ça – j'insisterais naturellement pour la publication, parce que vous-même, en tant que rédacteur en chef, vous admettez que vous avez certaines obligations envers moi dans cette affaire. Mais, tout en admettant cette obligation, vous placez en même temps un revolver d'exhortation et de demande amicales sur mon cœur et me demandez de ne pas faire usage de cette obligation et donc de ne pas défendre mes droits. Eh bien je suis écœurée à l'idée de devoir insister sur ces droits si ceux-ci ne sont accordés qu'au milieu de soupirs et de grincements de dents et quand les gens, non seulement me saisissent par le bras dans l'espoir que je me "défende" moi-même, mais cherchent en plus à me réduire en bouillie, dans l'espoir que je serai ainsi convaincue de renoncer à mes droits. Vous avez gagné ce que vous cherchez, vous êtes libre de toute obligation envers moi dans cette affaire.
Mais il semblerait que vous agissez dans l'illusion que c'est uniquement par amitié et dans mon intérêt. Permettez-moi de détruire cette illusion. En tant qu'ami, vous auriez dû me dire : 'je vous conseille à tout prix et sans condition de défendre votre honneur comme rédacteur, car des écrivains plus grands (...) comme Marx et Engels, ont écrit des brochures entières, mené des guerres de plume sans fin, lorsque quelqu'un osait les accuser de falsification. Vous d'autant plus, comme jeune écrivain ayant beaucoup d'ennemis, devez chercher à obtenir entière satisfaction...' Voilà ce que vous auriez dû me conseiller en tant qu'ami.
L'ami, cependant, a été rapidement relégué au second plan par le rédacteur en chef de la Neue Zeit, et ce dernier n'a qu'un souhait depuis le Congrès du parti [de Lübeck] ; il veut la paix, il veut montrer que la Neue Zeit a appris les manières après avoir reçu une raclée, elle a appris à fermer la bouche 47. Et c'est pour de telles raisons que les droits essentiels d'un rédacteur en chef adjoint et collaborateur régulier... doivent être sacrifiés. Permettons qu'un collaborateur de la Neue Zeit - qui ne fait certainement pas le pire travail – avale même une accusation publique de falsification pourvu que la paix et le calme soient maintenus ! Voilà comment les choses sont, mon ami ! Et maintenant avec les meilleures salutations, votre Rosa". 48
Ici, nous voyons une révolutionnaire jeune, déterminée, et une femme de surcroît, qui déclare que l'autorité d'un "ancien", l'autorité "orthodoxe", expérimentée, devrait assumer sa responsabilité personnelle. Kautsky répondit à Luxemburg : "Vous voyez, nous ne devrions pas contrarier les gens de la fraction parlementaire, nous ne devrions pas laisser l'impression qu'on les prend de haut. Si vous souhaitez leur faire une suggestion, il est préférable de leur envoyer une lettre privée, qui sera beaucoup plus efficace" 49. Mais Rosa Luxemburg tentait de "ranimer" l'esprit combatif chez lui : "Vous devez vraiment vous battre avec les tripes et dans la joie, et non comme s'il s'agissait d'un intermède ennuyeux ; le public est toujours sensible à l'état d'esprit combatif et la joie du combat donne de la résonance à la controverse, et assure la supériorité morale" 50. Cette attitude de ne pas vouloir déranger le cours normal de la vie du parti, de ne pas prendre position dans le débat, de ne pas pousser à la clarification des divergences, de fuir le débat et de tolérer les révisionnistes, éloignait de plus en plus Rosa Luxemburg et montrait au grand jour à quel point la perte de la combativité, de la morale, la perte de conviction, de détermination, étaient devenues la caractéristique dominante de l'attitude de Kautsky : "Je viens de lire son [article] "Nationalisme et internationalisme" et c'était horrible et donnait la nausée. Bientôt je ne serai plus capable de lire un seul de ses écrits. J'ai l'impression qu'une toile d'araignée nauséabonde me recouvre la tête... " 51. "Kautsky devient de plus en plus saumâtre. Il est de plus en plus fossilisé à l'intérieur, il n'a plus aucune préoccupation humaine envers quiconque, sauf sa famille. Je me sens vraiment mal à l'aise avec lui". 52
L'attitude de Kautsky peut aussi être opposée à celle de Luxemburg et Leo Jogiches. Après la rupture de la relation de Rosa Luxemburg avec Leo Jogiches en 1906 (qui lui a causé un stress et une douleur immenses ainsi qu'une grande déception envers lui comme compagnon), ils sont tous deux restés les plus proches camarades jusqu'au jour l'assassinat de Rosa. Malgré des rancunes personnelles profondes, de la déception et de la jalousie, ces sentiments émotionnels profonds consécutifs à la rupture de leur relation ne les ont jamais empêchés de se tenir côte à côte dans la lutte politique.
On pourrait objecter que, dans le cas de Kautsky, son attitude reflétait son manque de personnalité et son caractère, mais il serait plus exact de dire qu'il personnifiait la pourriture morale au sein de la social-démocratie dans son ensemble.
Luxemburg a été forcée, dès le début, de faire face à la résistance de la "vieille garde". Quand elle critiqua la politique révisionniste lors du Congrès de Stuttgart 1898, "Vollmar m'a reproché amèrement, en tant que jeune du mouvement, de vouloir donner des leçons aux anciens vétérans (...) Mais si Vollmar répond à mes explications factuelles par un 'vous novice, je pourrais être votre grand-père', je ne vois cela que comme la preuve qu'il est à court d'arguments." 53. Concernant l'affaiblissement de la combativité des vétérans les plus centristes, dans un article rédigé après le Congrès de 1898, elle déclarait que : "Nous aurions préféré si les anciens combattants avaient repris le combat dès le début du débat (...) Si le débat a décollé, ce n'est pas à cause, mais en dépit du comportement des leaders du parti (...) Abandonnant le débat à son sort, regardant passivement pendant deux jours pour voir vers où le vent souffle et n'intervenant que lorsque les porte-paroles de l'opportunisme furent obligées de se montrer au grand jour, puis faisant des remarques sarcastiques sur le ton tranchant de ceux dont on défend ensuite le point de vue, c'est une tactique qui ne projette pas une bonne image des dirigeants du parti. Et les explications de Kautsky quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas fait de déclaration publique jusqu'à présent sur la théorie de Bernstein, parce qu'il voulait se réserver le droit de dire le dernier mot lors d'un possible débat, ne ressemble pas vraiment à une bonne excuse. En février, il publie l'article de Bernstein sans aucun commentaire éditorial dans la Neue Zeit, puis il reste muet pendant 4 mois, en juin, il ouvre les discussions avec quelques compliments au "nouveau" point de vue de Bernstein, cette nouvelle copie médiocre de socialiste en chambre, puis de nouveau, il reste muet pendant 4 mois, laisse le Congrès du parti commencer, puis déclare au cours du débat qu'il aimerait faire les remarques finales. Nous préférerions que le "théoricien d'office" intervienne toujours dans les débats et ne se contente pas de faire la conclusion de ces questions cruciales ; qu'il ne donne pas l'impression erronée et trompeuse que pendant longtemps, il ne savait pas ce qu'il devait dire." 54
Ainsi, beaucoup de membres de la vieille garde, qui avaient combattu dans les conditions de la Loi anti-socialiste, ont été désarmés par le poids du démocratisme et du réformisme. Ils furent incapables de comprendre la nouvelle période et commencèrent à théoriser l'abandon de l'objectif socialiste. Au lieu de transmettre les leçons de la lutte dans les conditions de la Loi anti-socialiste à une nouvelle génération, ils avaient perdu leur combativité. Et le courant centriste qui se cachait et évitait le combat, en fuyant la bataille ouverte contre l'opportunisme, ouvrait la voie à la montée de la droite.
Tandis que les centristes évitaient la lutte, l'aile gauche autour de Luxemburg montrait son esprit combatif et était prête à assumer ses responsabilités. Voyant qu'en réalité "Bebel lui-même est déjà devenu sénile et laisse aller les choses ; il est soulagé si d'autres luttent, mais lui-même n'a ni l'énergie ni l'élan pour prendre l'initiative. K [Kautsky] se limite à la théorie, personne ne prend aucune responsabilité." 55 "Cela signifie que le parti est sur une mauvaise voie (...) Personne ne le dirige, personne ne prend de responsabilités." L'aile gauche visait à gagner plus d'influence et était convaincue de la nécessité d'agir comme un fer de lance. Luxemburg écrivait à Jogiches : "Encore un an de travail persévérant, positif et ma position sera forte. Pour le moment je ne peux pas atténuer le tranchant de mon discours, parce que nous devons défendre la position la plus extrême" 56. Cette influence ne devait pas être obtenue au prix d'une dilution des positions.
Convaincue de la nécessité d'un leadership déterminé et reconnaissant qu'elle ferait face à la résistance des hésitants, elle voulait pousser le parti. "Une personne, qui de plus n'appartient pas à la clique au pouvoir, qui ne veut compter sur le soutien de personne mais n'utilise que ses propres coudes, une personne préoccupée de l'avenir non seulement à cause d'adversaires aussi évidents que Auer et Cie mais aussi d'alliés (Bebel, Kautsky, Singer), une personne qu'il vaut mieux tenir à distance car elle pourrait les dépasser de plusieurs têtes (…) Je n'ai aucunement l'intention de me limiter à critiquer. Au contraire, j'ai vraiment l'intention et le désir de "pousser" de façon positive, pas les individus mais le mouvement dans son ensemble... de montrer de nouvelles voies, de combattre, de faire la mouche du coche– en un mot, d'être un incitatif permanent pour l'ensemble du mouvement" 57. En octobre 1905, Luxemburg se voit proposer la possibilité de participer au Comité de rédaction du Vorwärts. Elle était intransigeante sur une possible censure de ses positions. "Si à cause de mes articles il y a un conflit avec la direction ou avec le Comité de rédaction, je ne serai pas seule à le quitter, mais c'est l'ensemble de la gauche qui exprimera sa solidarité et quittera le Vorwärts, et le Comité de rédaction sera balayé". Durant une courte période, la gauche gagna une certaine influence.
Le déclin de la vie prolétarienne dans le SPD
Le processus de dégénérescence du parti n'était pas seulement marqué par des tentatives ouvertes d'abandon des positions programmatiques et par le manque de combativité de larges secteurs en son sein. Sous la surface, il existait de façon permanente un courant sous-jacent fait de rancunes mesquines et de dénigrements personnels dirigés contre ceux qui défendaient de la façon la plus intransigeante les principes de l'organisation et perturbaient la façade d'unité. L'attitude de Kautsky vis-à-vis de la critique de Luxemburg à Bernstein, par exemple, était ambivalente. Malgré ses relations amicales avec Luxemburg, il pouvait néanmoins écrire à Bernstein : "Cette méchante créature Luxemburg est mécontente de la trêve jusqu'à la publication de votre brochure, chaque jour, elle inflige un autre coup d'épingle aux 'tactiques'" 58.
Parfois, comme nous le verrons, ce courant souterrain émergeait à la surface à travers des accusations calomnieuses et des attaques personnelles.
C'est surtout la droite qui réagit en personnalisant et faisant de "l'ennemi" au sein du parti un bouc-émissaire. Alors qu'une clarification des divergences profondes à travers une confrontation ouverte était nécessaire, la droite, au lieu d'apporter des arguments au débat, recula et se mit à calomnier les membres les plus importants de la gauche.
Montrant un clair sentiment d'infériorité sur le plan théorique, les membres de la droite répandent des insinuations calomnieuses sur Luxemburg en particulier, faisant des commentaires machistes et des insinuations sur sa vie sentimentale et ses relations sociales "malheureuses" (sa relation avec Leo Jogiches n'était pas connue du parti) : "Cette vieille fille intelligente et méchante viendra également à Hanovre. Je la respecte et considère qu'elle est plus forte que Parvus. Mais elle me déteste du fond de son cœur." 59
Le secrétaire de l'aile droite du parti, Ignaz Auer, admettait auprès de Bernstein : "Même si nous ne sommes pas égaux à nos adversaires, car tout le monde n'est pas capable de jouer un grand rôle, nous ne cédons pas contre la rhétorique et les propos insultants. Mais s'il y avait un divorce "propre", que personne d'ailleurs ne considère sérieusement, Clara [Zetkin] et Rosa se retrouveraient laissées à elles-mêmes. Pas même leurs [amoureux] ne prendraient leur défense, ni les anciens ni les actuels." 60
Le même Auer n'hésita pas à utiliser des intonations xénophobes ; il disait que "les principales attaques contre Bernstein et ses partisans et contre Schippel n'émanaient pas de camarades allemands et ne sont pas venues du mouvement en Allemagne. Les activités de ces personnes, en particulier de Mme Rosa Luxemburg, ont été déloyales et pas bienveillantes entre camarades" 61. Ce type de tonalité xénophobe - notamment contre Luxemburg qui était d'origine juive – est devenu un élément permanent de la campagne de la droite, qui allait évoluer de façon de plus en plus violente au cours des années précédant la Première Guerre mondiale. 62
L'aile droite du parti a même écrit des commentaires satiriques ou des textes sur Luxemburg 63. Luxemburg et d'autres personnalités de gauche avaient déjà été ciblées d'une manière particulièrement vile en Pologne. Paul Frölich rapporte, dans sa biographie de Luxemburg, que beaucoup de calomnies ont été portées contre des personnalités de gauche comme Warski et Luxemburg. Luxemburg a été accusée d'être payée par l'officier de police de Varsovie Markgrafski, lorsqu'elle publia un article sur la question de l'autonomie nationale ; elle a également été accusée d'être un agent rémunéré de l'Okhrana, la police secrète russe. 64
Rosa Luxemburg fut de plus en plus écœurée par l'ambiance au sein du parti. "Chaque contact plus étroit avec le gang du parti crée un tel sentiment de malaise que chaque fois je suis déterminée à dire : à trois miles marins du point le plus bas de la marée basse ! Après avoir été avec eux, je sens une telle odeur de saleté, je ressens une telle faiblesse de caractère, une telle mesquinerie, que je me précipite pour rentrer dans mon trou de souris." 65
C'était en 1899, mais dix ans plus tard, son opinion sur le comportement des dirigeants du parti ne s'était pas améliorée. "Après tout, essayez de rester calme et ne pas oublier qu'en dehors de la direction du parti et des gredins du type Zietz, il y a encore beaucoup de choses belles et pures. En dehors de l'inhumanité immédiate, il [Zietz] manifeste un symptôme douloureux de la misère générale dans laquelle notre "leadership" a sombré, le symptôme d'un état d'esprit effrayant et terriblement pauvre. Une autre fois, cette algue en décomposition sera je l'espère balayée par une vague écumante" 66. Et elle a souvent exprimé son indignation face à l'atmosphère bureaucratique étouffante au sein du parti : "Je me sens parfois vraiment misérable ici et j'ai envie de fuir d'Allemagne. Dans n'importe quel village de Sibérie dont vous avez envie de parler, il y a plus d'humanité que dans l'ensemble de la social-démocratie allemande." 67 Cette attitude de désigner des boucs-émissaires visant à détruire la réputation de la gauche a semé les germes de l'assassinat ultérieur de Rosa Luxemburg par les Corps francs qui la tuèrent, en janvier 1919, sous les ordres du SPD. Le ton employé contre elle au sein du parti préparait l'atmosphère de pogrom contre les révolutionnaires au cours de la vague révolutionnaire de 1918-1923. La diffamation qui, peu à peu, s'était infiltrée dans le parti et l'absence d'indignation à ce sujet, en particulier de la part du centre, ont contribué à désarmer moralement le parti.
Censurer et faire taire l'opposition
En plus de créer des boucs-émissaires, de personnaliser et de mener des attaques xénophobes, les différentes instances du parti, sous l'influence de la droite, commencèrent à censurer les articles de la gauche et de Luxemburg en particulier. Surtout après 1905, alors que la question de l'action de masse était à l'ordre du jour (voir ci-dessous), le parti était de plus en plus tenté de museler Rosa Luxemburg et d'empêcher la publication de ses articles sur la question de la grève de masse et de l'expérience russe. Bien que la gauche ait disposé de bastions dans certaines villes 68, l'ensemble de l'aile droite de l'appareil du parti tentait d'empêcher la propagation des positions de Rosa Luxemburg dans l'organe central du parti, le Vorwärts : "Nous devons malheureusement décliner votre article étant donné que, conformément à un accord entre l'exécutif du parti, le Conseil exécutif de l'organisation provinciale prussienne [du SPD] et le rédacteur en chef, la question de la grève de masse ne peut pas être examinée pour le moment dans le Vorwärts." 69
Comme nous le verrons, le déclin moral et l'affaiblissement de la solidarité au sein du parti eurent un effet nocif quand les tensions impérialistes s'aiguisèrent alors que la gauche insistait sur la nécessité d'y répondre au moyen de l'action de masse.
Franz Mehring, personnalité bien connue et respectée de la gauche, fut également souvent attaqué. Mais, contrairement à Rosa Luxemburg, il s'offensait facilement et avait tendance à se retirer de la lutte lorsqu'il sentait qu'il avait été injustement attaqué. Par exemple, avant le Congrès du parti à Dresde en 1903, Mehring avait dénoncé l'incompatibilité, pour des sociaux-démocrates, d'être affiliés au parti et, en même temps, d'écrire dans la presse bourgeoise. Les opportunistes avaient lancé une campagne de diffamation contre lui. Mehring demanda un tribunal du parti. Celui-ci se réunit et adopta un "jugement clément" contre les opportunistes. Mais, de plus en plus, alors qu'il était soumis à la pression croissante de la droite, Mehring eut tendance à se retirer de la presse du parti. Luxemburg insistait pour qu'il résiste à la pression de la droite et à ses calomnies : "Vous sentirez sûrement que nous approchons de plus en plus des moments où les masses du parti vont avoir besoin d'une direction énergique, impitoyable et généreuse et que, sans vous, nos pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, l'organe central, les primaires au Reichstag et le "journal scientifique", deviendront sans cesse plus pitoyables, mesquins et lâches. Il est clair que nous allons devoir faire face à cet avenir attractif, et nous devons occuper et tenir toutes les positions qui permettent de mettre hors d'action la direction officielle en exerçant le droit de critiquer. (…) Il est donc de notre devoir de tenir le coup et de ne pas faire la faveur aux patrons officiels du parti de plier bagages. Nous devons accepter les luttes et les frictions continuelles, particulièrement quand quelqu'un a attaqué ce saint des saints, le crétinisme parlementaire, aussi fortement que vous l'avez fait. Mais en dépit de tout, ne pas céder un pouce semble être le mot d'ordre juste. La Neue Zeit ne doit pas être livrée tout entière à la sénilité et à la bureaucratie." 70
Le tournant de 1905
Alors que s'ouvrait un nouveau siècle, le fondement sur lequel révisionnistes et réformistes avaient basé leur théorie et leur pratique commençait à s'effriter.
Superficiellement et en dépit de difficultés occasionnelles, la santé de l'économie capitaliste paraissait robuste ; celle-ci poursuivait son expansion irrésistible dans les dernières régions encore inoccupées par les puissances impérialistes, notamment en Afrique et en Chine. L'expansion du capitalisme dans le monde entier avait atteint un stade où les puissances impérialistes ne pouvaient plus étendre leur influence qu'au détriment de leurs rivales. Toutes les grandes puissances se trouvèrent de plus en plus impliquées dans une course aux armements sans précédent, l'Allemagne s'étant en particulier engagée dans un programme de renforcement massif de sa marine de guerre. Bien que peu s'en rendissent compte à l'époque, l'année 1905 marqua un tournant : un conflit entre deux grandes puissances mena à une guerre à grande échelle, et la guerre conduisit au premier surgissement révolutionnaire massif de la classe ouvrière.
La guerre débuta en 1904 entre la Russie et le Japon pour le contrôle de la péninsule coréenne. La Russie subit une défaite humiliante, et les grèves de janvier 1905 furent une réaction directe contre les effets de la guerre. Pour la première fois dans l'histoire, une gigantesque vague de grèves massives secouait un pays tout entier. Le phénomène ne se limitait pas à la Russie. Pas de manière aussi massive, avec des revendications et dans un contexte différents, des mouvements de grève similaires éclatèrent dans une série d'autres pays européens : 1902 en Belgique, 1903 aux Pays-Bas, 1905 dans la région de la Ruhr en Allemagne et aux Pays-Bas. Un certain nombre de grèves sauvages massives eurent également lieu aux États-Unis entre 1900 et 1906 (notamment dans les mines de charbon en Pennsylvanie). En Allemagne, Rosa Luxemburg – à la fois en tant qu'agitateur et journaliste révolutionnaire pour le parti allemand, et comme membre du Comité Central du SDKPiL 71 suivait attentivement les luttes en Russie et en Pologne 72. En décembre 1905, elle estima qu'elle ne pouvait plus rester en Allemagne comme simple observateur et partit pour la Pologne participer directement au mouvement. Fortement impliquée au jour le jour dans le processus de la lutte de classe et l'agitation révolutionnaire, elle fut le témoin direct de la dynamique nouvelle de déploiement de la grève de masse 73. Avec d'autres forces révolutionnaires, elle commença à en tirer les leçons. En même temps que Trotsky écrivait son célèbre livre sur 1905, où il mettait en évidence le rôle des conseils ouvriers, Luxemburg dans son texte, Grève de masse, parti et des syndicats 74 soulignait l'importance historique de la "naissance de la grève de masse" et ses conséquences pour la classe ouvrière au niveau international. Son texte sur la grève de masse fut un premier texte programmatique des courants de gauche dans la 2ème Internationale, visant à tirer les leçons les plus larges et à souligner l'importance d'une action autonome, massive de la classe ouvrière. 75
La théorie de Luxemburg de la grève de masse allait complètement à l'encontre de la vision de la lutte de classe généralement acceptée par le parti et les syndicats. Pour les seconds, la lutte de classe était un peu comme une campagne militaire, dans laquelle la confrontation ne devait être recherchée qu'après que l'armée ait rassemblé une force écrasante, tandis que les dirigeants des syndicats et du parti devaient agir comme un état-major général dirigeant la masse des travailleurs. Tout cela était très éloigné de l'insistance du Luxemburg sur l'auto-activité créatrice des masses, et toute idée selon laquelle les travailleurs eux-mêmes pourraient agir indépendamment de la direction était un anathème pour les dirigeants des syndicats qui, en 1905, furent confrontés pour la première fois à la perspective d'être submergés par une vague massive de luttes autonomes. La réaction de l'aile droite du SPD et de la direction syndicale fut tout simplement d'interdire toute discussion sur la question. Au Congrès des syndicats en mai 1905 à Cologne, elles rejetèrent toute discussion sur la grève de masse comme "répréhensible" 76 et en vinrent à dire que "le Congrès des Syndicats recommande à tous les travailleurs organisés de s'opposer énergiquement à ceci [la propagation de la grève de masse]". Cette attitude annonçait la coopération du SPD et des syndicats avec la classe dirigeante dans la lutte contre la révolution.
La bourgeoisie allemande avait également suivi le mouvement avec attention et voulait avant tout empêcher les travailleurs allemands de "copier l'exemple russe". En raison de son discours sur la grève de masse au Congrès du SPD à Iéna en 1905, Rosa Luxemburg fut accusée "d'incitation à la violence" et condamnée à deux mois de prison. Kautsky, dans le même temps, tentait de minimiser l'importance de la grève de masse, insistant sur le fait qu'elle était avant tout un produit des conditions arriérées de la Russie et ne pouvait être appliquée dans un pays avancé comme l'Allemagne. Il utilisa "le terme 'Méthode russe' comme symbole du manque d'organisation, de primitivisme, de chaos, de sauvagerie" 77. Dans son livre de 1909, Le chemin du pouvoir, Kautsky affirme que "l'action de masse est une stratégie obsolète pour renverser l'ennemi" et il l'oppose à la stratégie de "guerre d'usure" qu'il propose. 78
Le parti de masse contre la grève de masse
Refusant de considérer la grève de masse comme une perspective valable pour la classe ouvrière à travers le monde, Kautsky attaqua la position du Luxemburg comme s'il s'agissait simplement d'une lubie personnelle. Kautsky écrivit à Luxemburg : "Je n'ai pas le temps de vous expliquer les raisons que Marx et Engels, Bebel et Liebknecht ont considéré comme substantielles. En bref, ce que vous voulez est un genre totalement nouveau d'agitation, que nous avons toujours refusé jusqu'à présent. Mais cette nouvelle agitation est d'une nature telle qu'il ne convient pas d'en débattre en public. Si nous publiions l'article, vous agiriez pour votre propre compte, comme une personne individuelle et proclameriez une agitation et une action totalement nouvelles, que le parti a toujours rejetées. Une seule personne, quel que soit son statut, ne peut agir pour son propre compte et créer ainsi un fait accompli, ce qui aurait des conséquences imprévisibles pour le parti." 79
Luxemburg rejeta la tentative de présenter l'analyse et l'importance de la grève de masse comme une "politique personnelle" 80. Bien que les révolutionnaires doivent reconnaître l'existence de conditions différentes dans différents pays, ils doivent avant tout saisir la dynamique globale de l'évolution des conditions de la lutte de classe, en particulier les tendances qui annoncent l'avenir. Kautsky s'opposa à "l'expérience russe" considérée comme expression de l'arriération de la Russie, refusant ainsi indirectement la solidarité internationale et répandant un point de vue empreint de préjugés nationaux, prétendant que les travailleurs en Allemagne avec leurs puissants syndicats étaient plus avancés et leurs méthodes "supérieures"... et cela à un moment où les dirigeants syndicaux combattaient déjà la grève de masse et l'action autonome du prolétariat ! Et quand Luxemburg fut envoyée en prison pour avoir fait la propagande pour la grève de masse, Kautsky et ses partisans ne montrèrent aucun signe d'indignation et ne protestèrent pas.
Luxemburg, qui ne pouvait pas être réduite au silence par ces tentatives de censure, reprocha à la direction du parti de concentrer toute son attention sur la préparation des élections : "Toutes les questions de tactique devraient être étouffées par le délire de joie autour de nos succès électoraux actuels et futurs ? Le Vorwärts croit-il vraiment que l'approfondissement et la réflexion politiques de larges couches du parti pourraient être favorisés par cette atmosphère permanente d'acclamation des futurs succès électoraux un an, peut-être un an et demi avant la tenue des élections et en faisant taire toute autocritique au sein du parti ?" 81
En dehors de Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek était le plus critique de la "stratégie d'usure" de Kautsky. Dans son livre "Différences tactiques dans le mouvement ouvrier" 82 Pannekoek entreprit une critique fondamentale et systématique des "vieux outils" du parlementarisme et de la lutte syndicale. Pannekoek devait aussi être la victime de la censure et de la répression au sein de la Social-Démocratie et de l'appareil syndical et perdit ainsi son emploi à l'école du parti. De plus en plus, aussi bien les articles de Luxemburg que ceux de Pannekoek étaient censurés par la presse du parti. En novembre 1911, pour la première fois, Kautsky refusa de publier un article de Pannekoek dans la Neue Zeit. 83
Ainsi, les grèves de masse de 1905 contraignirent la direction du SPD à montrer son vrai visage et à s'opposer à toute mobilisation de la classe ouvrière qui tentait de reprendre à son compte l'expérience "russe". Bien des années avant le déclenchement de la Guerre, les dirigeants syndicaux étaient devenus un rempart du capitalisme. L'argument consistant à "prendre en compte des conditions différentes de la lutte de classe" était en réalité un prétexte pour rejeter la solidarité internationale, alors que l'aile droite de la social-démocratie essayait de susciter des craintes et même d'attiser le ressentiment national vis-à-vis du "radicalisme russe" ; cela allait constituer une arme idéologique importante dans la guerre qui éclata quelques années plus tard. Après 1905, le centre qui avait été hésitant jusqu'alors, fut progressivement de plus en plus attiré vers la droite. L'incapacité et le refus du centre de soutenir la lutte de la gauche dans le parti voulaient dire que la gauche était plus isolée au sein du parti.
Comme le souligna Luxemburg, "l'effet pratique de l'intervention du camarade Kautsky se réduit donc à cela : il a fourni une couverture théorique à ceux qui, dans le parti et les syndicats, assistent avec un sentiment de malaise à la croissance impétueuse du mouvement de masse, souhaiteraient y mettre un frein et le ramener aussi vite que possible sur le bon vieux chemin commode du train-train parlementaire et syndical. Kautsky a fourni un remède à leurs scrupules de conscience, ceci sous l'égide de Marx et Engels, il leur a en même temps fourni un moyen de briser l'échine d'un mouvement de manifestations qu'il prétendait rendre 'toujours plus puissant'". 84
La menace de guerre et l'Internationale
Le Congrès de l'Internationale à Stuttgart en 1907 tenta de tirer les leçons de la guerre russo-japonaise et de mettre dans la balance le poids de la classe ouvrière organisée contre la menace croissante de guerre. Quelques 60 000 personnes participèrent à une manifestation où les orateurs de plus d'une douzaine de pays mirent en garde contre le danger de guerre. August Bebel proposa une résolution contre le danger de guerre, qui évitait la question du militarisme comme faisant partie intégrante du système capitaliste et ne mentionnait pas la lutte des travailleurs en Russie contre la guerre. Le Parti allemand tenta d'éviter d'être lié par quelque prescription que ce soit quant à son action en cas de guerre, sous la forme d'une grève générale avant tout. Luxemburg, Lénine et Martov proposèrent ensemble un amendement donnant une tournure plus énergique à la résolution : "Au cas où la guerre éclaterait, [les partis socialistes] ont le devoir de s'entremettre pour la faire cesser promptement et d'utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste". 85 Le Congrès de Stuttgart vota à l'unanimité cette résolution, mais par la suite la majorité de la 2ème Internationale ne parvint pas à renforcer son opposition aux préparatifs de guerre croissants. Le Congrès de Stuttgart est entré dans l'histoire comme un exemple de déclarations verbales sans action de la plupart des partis participants 86. Mais ce fut un moment important de coopération entre les courants de l'aile gauche qui, malgré leurs divergences sur beaucoup d'autres questions, prirent une position commune sur la question de la guerre.
En février 1907, Karl Liebknecht publia son livre Militarisme et antimilitarisme avec une attention particulière pour le mouvement international de la jeunesse, dans lequel il dénonçait en particulier le rôle du militarisme allemand. En octobre 1907, il fut condamné à 18 mois de prison pour haute trahison. Au cours de la même année, un dirigeant de l'aile droite du SPD, Noske, déclarait dans un discours prononcé au Reichstag que, dans le cas d'une "guerre de défense", la social-démocratie soutiendrait le gouvernement et "défendrait la patrie avec grande passion... Notre attitude à l'égard de l'armée est déterminée par notre avis sur la question nationale. Nous exigeons l'autonomie de chaque nation. Mais cela signifie que nous insistons également sur la préservation de l'autonomie du peuple allemand. Nous sommes pleinement conscients que c'est notre devoir et notre obligation que de nous assurer que le peuple allemand ne soit pas poussé contre le mur par d'autres peuples" 87. Il s'agissait du même Noske qui, en 1918, devint le "chien sanglant" (suivant ses propres mots) de la répression du SPD dirigée contre les travailleurs.
Brader l'internationalisme pour des succès électoraux
En 1911, l'expédition allemande de la canonnière Panther à Agadir provoqua la seconde crise marocaine avec la France. La direction du SPD avait alors renoncé à toute action antimilitariste afin d'éviter de mettre en péril son succès électoral lors des prochaines élections de 1912. Quand Luxemburg dénonça cette attitude, la direction du SPD l'accusa de trahir les secrets du parti. En août 1911, après beaucoup d'hésitation et de tentatives d'éluder la question, la direction du parti distribua un tract sensé être une protestation contre la politique de l'impérialisme allemand au Maroc. Le tract fut fortement critiqué par Luxemburg dans son article "Notre tract sur le Maroc" 88, ignorant comme elle l'a écrit, que Kautsky en était l'auteur. Kautsky répondit alors par une attaque très personnalisée. Luxemburg riposta : "Kautsky, dit-elle, avait présenté sa critique comme 'un malveillant coup de couteau dans le dos, une perfide attaque contre [Kautsky] en tant que personne.' (…) Le camarade Kautsky aura du mal à douter de mon courage pour faire face ouvertement à une personne, pour critiquer ou me battre contre quelqu'un directement. Je n'ai jamais attaqué personne en embuscade et je rejette fermement l'idée du camarade Kautsky selon laquelle je savais qui avait écrit le tract et que – sans le nommer – je l'avais visé. (…) Mais j'aurais fait attention de ne pas commencer une polémique inutile avec un camarade qui réagit de manière excessive avec un tel déluge de vitupération personnelle, d'amertume et de suspicion contre une critique strictement factuelle, bien que forte, et qui soupçonne une intention personnelle, méchante, une vacherie derrière chaque mot de la critique". 89 Au Congrès du parti de Iéna en septembre 1911, la direction du parti distribua une brochure spéciale contre Rosa Luxemburg, pleine d'attaques contre elle, l'accusant de violation de confidentialité et d'avoir informé le Bureau socialiste international de la 2ème Internationale de la correspondance interne du SPD.
Kautsky déserte la lutte contre la guerre
Bien que dans son livre de 1909, le chemin du pouvoir, Kautsky ait averti que "la guerre mondiale approche dangereusement", en 1911 il prédit que "tout le monde deviendra un patriote" lorsque que la guerre éclatera. Et que si la Social-Démocratie décidait de nager contre le courant, elle serait réduite en miettes par la foule en colère. Il plaçait ses espoirs de paix dans les "pays qui représentent la civilisation européenne" formant des États-Unis d'Europe. Dans le même temps, il commençait à développer sa théorie du "super-impérialisme", faisant reposer cette théorie sur l'idée que le conflit impérialiste n'est pas une conséquence inévitable de l'expansion capitaliste, mais simplement une "politique" que les États capitalistes éclairés pourraient choisir de rejeter. Kautsky pensait déjà que la guerre pourrait reléguer les contradictions de classe à l'arrière-plan et que l'action de masse du prolétariat serait vouée à l'échec, que – comme il dira quand la guerre éclatera - l'Internationale était seulement utile en temps de paix. Cette attitude consistant à être conscient du danger de guerre, mais de s'incliner devant la pression nationaliste dominante et d'esquiver une lutte déterminée, désarmait la classe ouvrière et ouvrait la voie à la trahison des intérêts du prolétariat. Ainsi, d'une part, Kautsky minimisait l'explosivité réelle des tensions impérialistes avec sa théorie du "super-impérialisme" et donc échouait complètement à percevoir la détermination des classes dirigeantes à préparer à la guerre ; et, d'autre part, il cédait à l'idéologie nationaliste du gouvernement (et de plus en plus de l'aile droite du SPD aussi) plutôt que de l'affronter, par crainte pour le succès électoral du SPD. Son épine dorsale, son esprit combatif, avaient disparu.
Alors qu'une dénonciation déterminée de la préparation de la guerre était nécessaire, et que l'aile gauche faisait de son mieux pour organiser des réunions publiques contre la guerre qui attiraient des participants par milliers, la direction du SPD mobilisait jusqu'au bout pour les prochaines élections législatives de 1912. Luxemburg dénonça le silence imposé sur le danger de guerre comme une tentative opportuniste de gagner des sièges au Parlement, sacrifiant l'internationalisme pour d'obtenir plus de voix.
En 1912, la menace pour la paix que représentait la deuxième guerre balkanique conduisit le Bureau socialiste international à organiser d'urgence un Congrès extraordinaire qui se tint en novembre à Bâle, en Suisse, dans le but de mobiliser la classe ouvrière internationale contre le danger imminent de guerre. Luxemburg critiqua le fait que le parti allemand se soit limité à se placer à la queue des syndicats allemands qui avaient organisé quelques manifestations discrètes, faisant valoir que le parti comme organe politique de la classe ouvrière n'avait manifesté qu'un intérêt de pure forme à la dénonciation de la guerre. Alors que quelques partis dans d'autres pays avaient réagi plus vigoureusement, le SPD, le plus grand parti de travailleurs du monde, s'était essentiellement retiré de l'agitation et s'était abstenu de protestations plus mobilisatrices. En fait, le Congrès de Bâle qui, une fois de plus, prit fin avec une grande manifestation et un appel à la paix, masqua en réalité la pourriture et la trahison future d'un grand nombre des partis membres de l'Internationale.
Le 3 juin 1913, la fraction parlementaire du SPD vota en faveur d'une taxe militaire spéciale : 37 députés SPD qui s'opposèrent au vote de cette taxe furent réduits au silence par le principe de la discipline de la fraction parlementaire. La violation ouverte de la devise "pas un seul homme, pas un seul centime" pour le système préparait le vote des crédits de guerre par la fraction parlementaire en août 1914 90. Le déclin moral du parti se révélait également dans la réaction de Bebel. En 1870/71, August Bebel – ainsi que Wilhelm Liebknecht (père de Karl Liebknecht) – s'était distingué par son opposition résolue à la guerre franco-prussienne. Maintenant, quatre décennies plus tard, Bebel fut incapable d'adopter une position résolue contre le danger de guerre. 91
Il devenait de plus en plus évident que, non seulement la droite allait trahir ouvertement, mais aussi que les centristes vacillants avaient perdu tout esprit de combat et échoueraient à s'opposer à la préparation à la guerre d'une manière déterminée. L'attitude défendue par le plus célèbre représentant du "centre", Kautsky, selon lequel le parti devait adapter sa position sur la question de la guerre en fonction des réactions de la population (soumission passive si la majorité du pays se soumettait au nationalisme ou une attitude plus résolue s'il y avait une opposition croissante à la guerre), fut alors justifiée par le risque de "s'isoler soi-même de la plus grande partie du parti". Lorsque, après 1910, le courant autour de Kautsky prétendit être le "centre marxiste", contrairement à la gauche (radicale, extrémiste, non marxiste), Luxemburg étiqueta ce "centre" de représentants de la lâcheté, de la prudence et du conservatisme.
Son abandon de la lutte, son incapacité à s'opposer à la droite et à suivre la gauche dans sa lutte déterminée, participa à désarmer les travailleurs. Ainsi, la trahison d'août 1914 par la direction du parti ne fut pas une surprise ; elle avait été préparée petit à petit dans un processus au coup par coup. Le soutien à l'impérialisme allemand devint tangible lors de plusieurs votes au Parlement à l'appui des crédits de guerre, dans les efforts visant à enrayer les manifestations contre la guerre, dans l'attitude d'ensemble pour prendre parti en faveur de l'impérialisme allemand et l’enchaînement de la classe ouvrière au nationalisme et au patriotisme. Le processus de musellement de l'aile gauche avait été crucial dans l'abandon de l'internationalisme et avait préparé la répression des révolutionnaires en 1919.
L'aveuglement par le nombre et l'intégration graduelle dans l'État
Alors que la direction du SPD avait axé ses activités sur les élections législatives, le parti lui-même était aveuglé par le succès électoral et perdait de vue l'objectif final du mouvement ouvrier. Le parti salua la croissance apparemment sans interruption de ses électeurs, du nombre de ses députés et de celui des lecteurs de la presse du parti. La croissance fut en effet impressionnante : en 1907, le SPD avait 530 000 membres ; en 1913, le chiffre avait plus que doublé à 1,1 million. Le SPD en réalité était le seul parti de masse de la 2ème Internationale et le plus grand parti de n'importe quel parlement européen. Cette croissance numérique donnait l'illusion d'une grande force. Même Lénine fut remarquablement dépourvu de sens critique sur les "chiffres impressionnants" relatifs à l'impact du parti, au nombre de ses électeurs et de ses membres. 92
Bien qu'il soit impossible d'établir une relation mécanique entre l'intransigeance politique et les scores électoraux, les élections de 1907, quand le SPD condamnait encore la répression barbare de l'impérialisme allemand contre les soulèvements des Hereros dans le sud-ouest africain, se soldèrent par un "revers". Le SPD y perdit 38 sièges au Parlement et se retrouva avec 43 sièges "seulement". En dépit du fait que le pourcentage du SPD dans le vote global ait effectivement augmenté, aux yeux de la direction du parti, ce revers électoral signifiait que celui-ci avait été sanctionné par les électeurs et avant tout par les électeurs de la petite bourgeoisie, en raison de sa dénonciation de l'impérialisme allemand. La conclusion qu'elle tirait, c'était que le SPD devait éviter de s'opposer trop fortement à l'impérialisme et au nationalisme, car cela lui coûterait des votes. Au lieu de cela, le parti devait concentrer toutes ses forces sur la campagne pour les prochaines élections, même si cela devait signifier censurer les discussions en son sein et éviter tout ce qui risquait de mettre en péril son score électoral. Lors des élections de 1912, le parti obtint 4,2 millions voix (38,5 % des suffrages exprimés) et remporta 110 sièges. Il était devenu le plus grand parti parlementaire, mais seulement en enterrant l'internationalisme et les principes de la classe ouvrière. Dans les parlements locaux, il avait plus de 11 000 élus. Le SPD comptait 91 journaux et 1,5 millions d'abonnés. Lors des élections de 1912, l'intégration du SPD dans le jeu de la politique parlementaire est allé encore plus loin puisqu'il retira ses candidats dans plusieurs circonscriptions au profit du Parti populaire progressiste (Fortschrittliche Volkspartei), bien que ce parti appuyât inconditionnellement la politique de l'impérialisme allemand. Pendant ce temps, le Sozialistische Monatshefte (en principe une publication indépendante du parti, mais en réalité l'organe théorique des révisionnistes) soutenait ouvertement la politique coloniale de l'Allemagne et les revendications de l'impérialisme allemand pour une redistribution des colonies.
En fait, la mobilisation totale du parti pour les élections législatives alla de pair avec son intégration progressive dans l'appareil d'État. Le vote indirect pour le budget en juillet 1910 93, le renforcement de la coopération avec les partis bourgeois (qui avait jusqu'alors constitué un tabou), le désistement de candidats pour faire élire comme députés des bourgeois du Fortschrittliche Volkspartei, la désignation d'un candidat pour les élections municipales à Stuttgart – telles furent certaines des étapes sur la route de la participation directe du SPD dans l'administration de l'État.
Cette tendance globale à une interconnexion croissante entre les activités parlementaires du SPD et son identification avec l'État fut fustigée par la gauche, en particulier par Anton Pannekoek et Rosa Luxemburg. Pannekoek consacra tout un livre aux Différences tactiques au sein du mouvement ouvrier. Luxemburg, qui était extrêmement attentive à l'effet asphyxiant du parlementarisme, fit pression pour l'initiative et l'action de la base : "L'exécutif le plus idéal d'un parti ne serait en mesure de parvenir à rien, s'enfoncerait involontairement dans l'inefficacité bureaucratique, si la source naturelle d'énergie, la volonté du parti, ne se faisaient pas sentir, si la pensée critique, l'initiative de la masse des membres du parti étaient en sommeil. En fait, c'est plus que cela. Si sa propre énergie, la vie intellectuelle indépendante de la masse du parti, n'est pas assez active, alors les autorités centrales ont la tendance assez naturelle non seulement à rouiller bureaucratiquement mais également à se faire une idée totalement fausse de leur propre autorité et de leur position de force à l'égard du parti. Le plus récent décret dit "secret" de l'exécutif concernant le personnel éditorial du parti peut servir de preuve récente, une tentative de prendre des décisions pour la presse du parti, qu'on ne peut que rejeter de la façon la plus sévère. Toutefois, ici aussi, il est nécessaire de préciser : contre l'inefficacité et les illusions excessives du pouvoir des autorités centrales du mouvement ouvrier, il n'y a pas d'autre chemin que sa propre initiative, sa propre pensée et la vie politique fraîche, palpitante de la large masse du parti." 94
En fait, Luxemburg insistait constamment sur la nécessité pour la masse des membres du parti de se "réveiller" et d'assumer leur responsabilité contre la direction du parti dégénérescente. "Les grandes masses [du parti] doivent s'activer selon leur propre voie, elles doivent être en mesure de développer leur propre énergie de masse, leur propre conduite, elles doivent devenir actives en tant que masses, agir, montrer et développer de la passion, du courage et de la détermination." 95
"Chaque pas en avant dans la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière doit en même temps signifier une indépendance intellectuelle croissante de la masse des ouvriers, la croissance de sa propre activité, l'autodétermination et l'initiative (...) C'est d'une importance vitale pour le développement normal de la vie politique dans le parti, pour garder éveillées et actives la pensée politique et la volonté de la masse du parti. Nous avons, bien sûr, la Conférence annuelle du parti, la plus haute instance qui fixe régulièrement la volonté de tout le parti. Toutefois, il est évident que les conférences des partis ne peuvent que donner de grandes lignes de la tactique pour la lutte social-démocrate. L'application de ces lignes directrices à la pratique exige une pensée infatigable et de l'initiative (...) Vouloir qu'un cadre du parti soit responsable de la tâche énorme de vigilance quotidienne et d'initiative politiques sur une organisation de presque 1 million de membres attendant passivement d'être commandée, c'est la chose la plus incorrecte qui soit du point de vue de la lutte de classe prolétarienne. C'est sans doute cette répréhensible "obéissance aveugle" que, assurément, nos opportunistes veulent voir dans la subordination qui va de soi à toutes les décisions du parti dans son ensemble". 96
La "discipline de fraction" étrangle la responsabilité individuelle
Le 4 Août 1914, la fraction parlementaire du SPD vota à l'unanimité les crédits de guerre. La direction du parti et de la fraction parlementaire avaient exigé la "discipline de fraction". La censure (censure de l'État ou autocensure ?) et la fausse unité du parti suivaient leur propre logique, tout le contraire de la responsabilité individuelle. Le processus de dégénérescence signifiait que la capacité de pensée critique et d'opposition à la fausse unité du parti avait été éliminée. Les valeurs morales du parti furent sacrifiées sur l'autel du capital. Au nom de la discipline du parti, celui-ci exigeait l'abandon de l'internationalisme prolétarien. Karl Liebknecht, dont le père avait osé rejeter le soutien aux crédits de guerre en 1870, cédait maintenant aux pressions du Parti. Ce n'est que quelques semaines plus tard, après un premier regroupement de camarades restés fidèles à l'internationalisme, qu'il osa exprimer ouvertement son rejet de la mobilisation pour la guerre par la direction du SPD. Mais le vote des crédits de guerre par le SPD allemand déclencha une avalanche de soumission au nationalisme dans d'autres pays européens. Avec la trahison du SPD, la 2ème Internationale signa son arrêt de mort et se désintégra.
La montée du courant opportuniste et révisionniste, qui était apparu le plus clairement dans le plus grand parti de la 2ème Internationale, et qui avait abandonné l'objectif du renversement de la société capitaliste, signifiait que la vie prolétarienne, la combativité et l'indignation morale avaient disparu du SPD, ou au moins dans les rangs de sa direction et de sa bureaucratie. En même temps, ce processus fut indissociablement lié à la dégénérescence programmatique du SPD, visible dans son refus d'adopter les nouvelles armes de la lutte des classes, la grève de masse et l'auto-organisation des travailleurs, et l'abandon progressif de l'internationalisme. Le processus de dégénérescence de la social-démocratie allemande, qui n'était pas un phénomène isolé dans la 2ème Internationale, conduisit à sa trahison en 1914. Pour la première fois, une organisation politique des travailleurs n'avait pas seulement trahi les intérêts de la classe ouvrière, elle était devenue l'une des armes les plus efficaces entre les mains de la classe capitaliste. La classe dirigeante en Allemagne pouvait désormais compter sur l'autorité du SPD, et la fidélité qu'il avait inspirée dans la classe ouvrière, pour déclencher une guerre et écraser la révolte contre la guerre de la part des travailleurs. Les leçons de la dégénérescence de la Social-démocratie restent donc d'une importance cruciale pour les révolutionnaires d'aujourd'hui.
Heinrich / Jens
1 . Avec 38,5 % des suffrages exprimés, le SPD avait 110 sièges au Reichstag.
2 . Karl Kautsky est né à Prague en 1854. Son père était chef décorateur et sa mère actrice et écrivaine. La famille s'est installée à Vienne quand Kautsky avait 7 ans. Il a étudié à l'Université de Vienne et rejoint le parti socialiste autrichien (SPÖ) en 1875. A partir de 1880, depuis Zürich, il a contribué à introduire la littérature socialiste en Allemagne.
3 . August Bebel est né en 1840, dans ce qui est maintenant une banlieue de Cologne. Orphelin à 13 ans, il est entré en apprentissage chez un charpentier et, jeune homme, il a beaucoup voyagé en Allemagne. Il rencontra Wilhelm Liebknecht en 1865, et fut immédiatement impressionné par l'expérience internationale de celui-ci ; dans son autobiographie, Bebel se souvient s'être exclamé : "C'est un homme dont vous pouvez apprendre quelque chose" ("Donnerwetter, von dem kann man das lernen", Bebel, Aus Meinen Leben, Berlin 1946, cité dans James Joll, La Deuxième Internationale). Avec Liebknecht, Bebel est devenu l'un des leaders de premier plan de la social-démocratie allemande dans ses premières années.
4 . Ceci est particulièrement visible dans le livre de Lénine, Un pas en avant Deux pas en arrière, concernant la crise du POSDR en 1903. Parlant des futurs Mencheviks, il s'exprime en ces termes : "L’esprit de cercle et le défaut de maturité politique frappant, qui ne peut supporter le vent frais d'un débat public, apparaît ici en toute netteté (…) Imaginez un instant qu’une pareille absurdité, qu'une querelle comme la plainte une "fausse accusation d'opportunisme" ait pu se produire dans le parti allemand ! L'organisation et la discipline prolétariennes ont depuis longtemps fait oublier là-bas cette veulerie d'intellectuels (…). Seul l'esprit de cercle le plus routinier, avec sa logique : un coup de poing dans la mâchoire, ou bien la main à baiser, s'il vous plaît, a pu soulever cette crise d'hystérie, cette vaine querelle et cette scission du Parti autour d'une "fausse accusation d'opportunisme" contre la majorité du groupe Libération du Travail". (Chapitre J, "Ceux qui ont souffert d’être faussement accusés d’opportunisme" - https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1904/05/vil19040500.htm [472])
5 . Rosa Luxemburg, La crise de la Social-Démocratie (encore connue sous le nom de Brochure de Junius).
6 . Rosa Luxemburg. Ibid.
7 . L'organe de presse central du SPD.
8 . Également connu comme Parti eisenachien, du nom de sa ville de fondation, Eisenach.
9 . Première Adresse du Conseil Général de l'AIT sur la guerre franco-allemande.
https ://www.marxists.org/francais/ait/1870/07/km18700723.htm [473]
10 . Une tendance similaire a survécu dans le socialisme français à travers la nostalgie pour le programme des "ateliers nationaux" qui avait suivi le mouvement révolutionnaire de 1848.
11 . Cf. Toni Offerman, dans Between reform and revolution : German socialism and communism from 1840 to 1990, Berghahn Books, 1998, p. 96.
12 . Elle est aujourd'hui connue sous le titre de Critique du Programme de Gotha.
13 . Lettre d'envoi de Karl Marx à W. Bracke, le 5 mai 1875. Dans Critique du Programme de Gotha.
14 . Engels, Sur le Programme de Gotha. Lettre à August Bebel. Mars 1875.
15 . Cité dans Aspects of international socialism 1871-1914 (Aspect du socialisme international 1871-1914). Cambridge University Press & Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Notre traduction.
16 . Le vote au Parlement des crédits de guerre a donc constitué une claire violation des statuts et des décisions du congrès du SPD, comme Rosa Luxemburg l'a souligné.
17 . Engels, Critique du projet de programme social-démocrate de 1891. II - Revendications politiques.
18 . Même si l'autocratie russe était plus extrême, il ne faut pas oublier que l'équivalent russe du Reichstag, la Douma d’État, n'a été appelée que sous la pression du mouvement révolutionnaire de 1905.
19 . Voir la biographie remarquable de Rosa Luxemburg par JP Nettl, p. 81 (édition Schocken brochée de l'édition abrégée Oxford University Press de 1969, avec un essai introductif par Hannah Arendt). Tout au long de cet article, les citations proviennent de l'abrégé ou de l'éditions intégrale.
20 . Il est significatif que, tandis que le parti tolérait le réformisme de l'aile droite, le cercle des "Jungen" ("jeunes"), qui avait violemment critiqué l'évolution vers le parlementarisme, ait été expulsé du parti lors du Congrès d'Erfurt. Il est vrai que ce groupe était essentiellement une opposition intellectuelle et littéraire avec des tendances anarchistes (un certain nombre de ses membres a d'ailleurs dérivé vers l'anarchisme, après avoir quitté le SPD). Il est tout de même significatif que le parti ait réagi beaucoup plus durement face à une critique de la gauche que face à la pratique opportuniste de la droite.
21 . Cf. Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, p. 41, Éditions Quadrige/PUF, 1974.
22 . Lettre à Kautsky, 1896, citée par Droz, op. cit., p. 42
23 . Le révisionnisme de Bernstein n'était en aucun cas une exception isolée. En France, le socialiste Millerand rejoignait le gouvernement Waldeck-Rousseau, aux côtés du général Gallifet, le bourreau de la Commune de Paris ; une tendance similaire existait en Belgique ; le mouvement travailliste britannique était complètement dominé par le réformisme et un syndicalisme nationaliste borné.
24 . "La question coloniale (...) est une question de propagation de la culture et, tant qu'il existe de grandes différences culturelles, il s'agit de la propagation, ou plutôt de l'affirmation, de la culture supérieure. Parce que tôt ou tard, il arrivera inévitablement que les cultures supérieures et inférieures entrent en collision et, en ce qui concerne cette collision, cette lutte pour l'existence entre les cultures, la politique coloniale des peuples cultivés doit être évaluée comme un processus historique. Le fait que généralement d'autres buts soient poursuivis avec d'autres moyens et des formes que nous sociaux-démocrates, nous condamnons, peut nous conduire dans des cas particuliers à les rejeter et à lutter contre, mais cela ne peut pas constituer une raison pour que nous changions notre jugement quant à la nécessité historique de la colonisation". (Bernstein, 1907, cité dans Discovering Imperialism, 2012, Haymarket Books, p. 41)
25 . Cf. Nettl, op. cit., p. 101.
26 . Parvus, également connu sous le nom de Alexander Helphand, était une figure étrange et controversée dans le mouvement révolutionnaire. Après quelques années à la gauche de la social-démocratie en Allemagne, puis en Russie pendant la révolution de 1905, il s'installe en Turquie où il créa une société de négoce en armements, s'enrichissant grâce à la guerre des Balkans et, en même temps, mettant en place, en tant que conseiller financier et politique, le mouvement nationaliste "Jeunes Turcs" et éditant la publication nationaliste Yurdu Turk. Pendant la guerre, Parvus devint un partisan ouvert de l'impérialisme allemand, au désespoir de Trotsky qui avait été fortement influencé par ses idées sur la "révolution permanente" (Cf. Deutscher, Le prophète armé, "La guerre et l'Internationale")
27 . Cité dans Nettl, op. cit., p. 133.
28 . Parteitag der Sozialdemokratie, Oktober 1898 in Stuttgart, Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke (Ges. Werke), T. 1/1 p, 241. Notre traduction.
29 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 1/1, p. 565, 29 septembre1899. Notre traduction.
30 . Rosa Luxemburg, 1899, Ges. Werke, T. 1/1, p. 578, 9.-14. Oktober. Notre traduction.
31 . August Bebel, Dresden, 13 septembre 1903, cité par Luxemburg After the Jena Party congress, Ges. Werke, T. 1/1, p. 351. Notre traduction.
32 . "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22 septembre 1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, T. 1/1, p. 558. Traduit en français par nos soins.
33 . De plus, Bernstein "avait commencé par abandonner le but final pour le mouvement. Mais comme il ne peut y avoir en pratique de mouvement socialiste sans but socialiste, il est obligé de renoncer au mouvement lui-même" (Réforme sociale ou révolution ? Chapitre 4 : L'effondrement.)
34 . "Je suis très reconnaissante pour l'information qui m'aide à mieux comprendre les orientations du parti. Bien sûr, il était clair pour moi que Bernstein et les idées qu'il a présentées jusqu'à maintenant n'étaient plus en ligne avec notre programme, mais il est douloureux que nous ne puissions plus du tout compter sur lui. Mais si vous et le camarade Kautsky aviez cette évaluation, je suis surprise que vous n'ayez pas mis à profit l'atmosphère favorable du Congrès pour lancer immédiatement un débat énergique, mais que vous ayez voulu encourager Bernstein à écrire une brochure, ce qui ne fera que retarder encore plus la discussion". Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 210, lettre à Bebel, 31 octobre 1898. Notre traduction.
35 . Rosa Luxemburg. Ges. Briefe, Bd 1, p. 289, lettre à Leo Jogiches, 11 mars 1899. Notre traduction.
36 . Kautsky à Bernstein, 29 juillet 1899, IISG-Kautsky-Nachlass, C. 227, C. 230, cité dans Till Schelz-Brandenburg, Eduard Bernstein und Karl Kautsky, Entstehung und Wandlung des sozialdemokratischen Parteimarxismus im Spiegel ihrer Korrespondenz 1879 bis 1932, Köln, 1992. Notre traduction.
37 . Rosa Luxemburg, “Parteifragen im Vorwärts”, Ges. Werke, T. 1/1, p. 564, 29 septembre 1899.
38 . Laschitza, Im Lebensrausch, Trotz Alledem, p. 104, 27 octobre 1898, Kautsky-Nachlass C 209 : Kautsky an Bernstein. Notre traduction.
39 . Karl Kautsky à Victor Adler, 20 juillet 1905, in Victor Adler Briefwechsel, a.a.O. S. 463, quoted by Till Schelz-Brandenburg, p. 338). Notre traduction.
40 . Rosa Luxemburg – Ges. Werke, T. 1/1, p. 528, quoting “Kautsky zum Parteitag in Hannover”, Neue Zeit 18, Stuttgart 1899-1900, 1. Bd. S. 12). Notre traduction.
41 . Rosa Luxemburg, "Liberté de la critique et de la science".
https ://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1899/rl189909.htm [474]
42 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1, p. 279, lettre à Leo Jogiches, 3 mars 1899. Notre traduction.
43 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1, p. 426, Lettre à Leo Jogiches, 21 décembre 1899. Notre traduction.
44 . Luxemburg mit un point d'honneur à apporter son soutien total, en tant qu'agitateur (elle était une oratrice publique très demandée) même aux membres du parti qu'elle critiquait le plus fortement, par exemple pendant la campagne électorale du révisionniste Max Schippel.
45 . Rosa Luxemburg Ges. Briefe, T. 1, p. 491, Lettre à Leo Jogiches, 7 juillet 1890. Notre traduction.
46 . Rosa Luxemburg, Erklärung, Ges. Werke, T. 1/2 , p. 146, 1er octobre 1901
47 . Lors du Congrès de Lübeck, la Neue Zeit et Kautsky en tant que rédacteur en chef avaient été fortement attaqués par les opportunistes en raison de la controverse sur le révisionnisme.
48 . JP Nettl, Rosa Luxemburg, Vol 1, p. 192 (cette citation est tirée de l'édition intégrale), Rosa Luxemburg, lettre à Kautsky, 3 octobre 1901. Notre traduction.
49 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1,. P. 565, Lettre à Jogiches, 12 janvier 1902. Notre traduction.
50 . Cité in Nettl, op.cit., p127. Traduit en français par nos soins.
51 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 3, p. 358, Lettre à Kostja Zetkin, 27 juin 1908. Notre traduction.
52 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 3, p. 57, Lettre à Kostja Zetkin, 1er août 1909. Notre traduction.
53 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 1/1, p. 239, p. 245, - Parteitag der Sozialdemokratie 1898 in Stuttgart, Oktober 1898
54 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke BDI 1/1, S. 255, Nachbetrachtungen zum Parteitag 12-14. Oktober 1898, Sächsische Arbeiter-Zeitung Dresden. Notre traduction.
55 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 279, Lettre à Leo Jogiches, 3 mars 1899. Notre traduction.
56 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe Bd 1, p. 384, Lettre à Leo Jogiches, 24 septembre 1899. Notre traduction.
57 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 322, lettre à Jogiches, 1 mai 1899. Notre traduction.
58 . Kautsky à Bernstein, 29 octobre 1898, IISG, Amsterdam, Kautsky-Nicholas, C 210. Notre traduction.
59 . Laschitza, Ibid, p. 129, (Ignatz Auer dans une lettre à Bernstein). Notre traduction. Dans son Histoire générale du socialisme, Jacques Droz décrit Auer de la manière suivante : "C'est un 'praticien', un 'réformiste' de la pratique qui se fait gloire de ne rien connaître aux doctrines, mais nationaliste au point d'exalter devant les auditoires socialistes l'annexion de l'Alsace-Lorraine et de s'opposer à la reconstitution de la Pologne, et cynique jusqu'à nier l'autorité de l'Internationale ; en fait, il couvre l'orientation des Sozialistische Monatshefte et favorise activement le développement du réformisme." (p. 41)
60 . Laschitza, ibid, p. 130. Notre traduction.
61 . Laschitza, ibid, p. 136, in Sächsische Arbeiterzeitung, 29 novembre 1899. Notre traduction.
62 . Rosa Luxemburg fut très tôt consciente de l'hostilité à son égard. Lors du Congrès du parti de Hanovre en 1899, la direction ne voulait pas lui laisser prendre la parole sur la question des douanes. Elle décrivit son attitude dans une lettre à Jogiches : "Nous ferions mieux de régler cela dans le parti, c'est-à-dire dans le clan. Voilà comment les choses fonctionnent avec eux : si la maison brûle, ils ont besoin d'un bouc-émissaire (un juif), si l'incendie a été éteint, le juif est chassé ". (Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 317, lettre à Leo Jogiches, 27 avril 1899). Victor Adler écrit à Bebel en 1910 qu'il avait "suffisamment de bas instincts pour prendre un certain plaisir à ce que Karl [Kautsky] souffre entre les mains de ses amis. Mais c'est vraiment dommage– la chienne toxique va encore faire beaucoup de dégâts, d'autant plus qu'elle est aussi intelligente qu'un singe tandis que d'autre part son sens des responsabilités est totalement absent et sa seule motivation est un désir presque pervers d’auto-justification". (Nettl, 1, p. 432, version intégrale, Victor Adler à Bebel, 5 août 1910). Notre traduction.
63 . Le journal satirique hebdomadaire Simplicissimus a même publié un poème méchant dirigé contre Luxemburg (Laschitza, 136, Simplicissimus, 4. Jahrgang, Nr. 33, 1899/1900, S. 263)
64 . Frölich, Paul, “Gedanke und Tat”, Rosa Luxemburg, Dietz-Verlag Berlin, 1990, p. 62
65 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe Bd 1, S. 316, lettre à Leo Jogiches, 27 avril 1899. Notre traduction.
66 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 3 S. 89, lettre à Clara Zetkin, 29 septembre 1909. Notre traduction.
67 . Rosa Luxemburg Ges. Briefe, Bd 3, p. 268, lettre à Kostja Zetkin, 30 novembre 1910. Notre traduction. Ces lignes furent provoquées par la réaction philistine de la direction du parti à un article qu'elle avait écrit sur Tolstoï, qui avait été considéré à la fois comme hors de propos (les disciplines artistiques n'étaient pas importantes) et peu souhaitable dans la presse du parti parce qu'il faisait l'éloge d'un artiste qui était russe et mystique.
68 . Étant donné que le parti avait un grand nombre de journaux, la plupart n'étaient pas sous le contrôle direct de la direction de Berlin. La publication d'articles du courant de gauche dépendait souvent de l'attitude du Comité de rédaction local. L'aile gauche avait la plus grande audience à Leipzig, Stuttgart, Brême et Dortmund.
69 . Nettl 1, p. 421 (édition intégrale). Notre traduction.
70 . Nettl, I, p. 464 (édition intégrale). Notre traduction.
71 . Social-Démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie. Le parti a été fondé en 1893 comme social-démocratie du Royaume de Pologne (SDKP), ses membres les plus connus étant Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Julian Marchlewski et Adolf Warszawski. Il est devenu le SDKPiL suite à la fusion avec le Syndicat des travailleurs en Lituanie dirigé par Feliks Dzerzhinski, entre autres. Une de ses plus importantes caractéristiques distinctives était son internationalisme inébranlable, sa conviction que l'indépendance nationale polonaise n'était pas dans l' intérêt des travailleurs et que le mouvement ouvrier polonais devrait au contraire s'allier étroitement avec la social-démocratie russe et les bolcheviks en particulier. Cela constituait en permanence un motif de désaccord avec le parti socialiste polonais (PPS - Polska Partia Socjalistyczna) qui adopta une orientation de plus en plus nationaliste sous la direction de Josef Pilsudski, lequel devint plus tard (de façon similaire à Mussolini) dictateur de la Pologne.
72 . La Pologne, il convient de le rappeler, n'existait pas comme un pays séparé. La plus grande partie de la Pologne historique faisait partie de l'empire des tsars, tandis que les autres parties avaient été absorbées par l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois.
73 . Elle a été arrêtée en mars 1906, avec Leo Jogiches qui était aussi rentré en Pologne. Il y avait de sérieuses craintes pour sa sécurité, le SDKPiL faisant savoir qu'il prendrait des représailles physiques contre des agents du gouvernement s'ils la touchaient. Un mélange de subterfuge et d'aide de sa famille permit de la faire sortir des geôles tsaristes, d'où elle est revenue en Allemagne. Jogiches fut condamné à huit ans de travaux forcés mais réussit à s'évader de prison.
74 . Le texte intégral peut être trouvé sur marxists.org
75 . Voir la série d'articles sur 1905 dans les numéros 120, 122, 123 et 125 de la Revue Internationale.
76 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 347
77 . Rosa Luxemburg, “Das Offiziösentum der Theorie”, Ges. Werke, T. 3, p. 307, article published in Neue Zeit, 1912. Notre traduction.
78 . Le débat entre Kautsky, Luxemburg et Pannekoek a été publié en français sous le titre Socialisme, la voie occidentale, Presses Universitaires de France, Paris, 1983.
79 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 380, “Theorie und die Praxis”, publié dans la Neue Zeit, 28. Jg, 1909/1910, en réponse à l'article de Kautsky “Was nun ?”. Notre traduction.
80 . Rosa Luxemburg, “Die Theorie und Praxis”, Ges. Werke, T. 2, p. 398.
81 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, S. 441 “Die totgeschwiegene Wahlrechtsdebatte” (“Le débat caché sur les droits électoraux”) 17 août 1910. Notre traduction.
82 . Publié en anglais sous le titre Théorie marxiste et tactiques révolutionnaires.
83 . À l'époque, une autre voix majeure de la gauche en Hollande, Herman Gorter, écrivait à Kautsky. "Des divergences tactiques entraînent souvent une brouille entre amis. Dans mon cas, alors que ma relation avec vous est concernée, ce n'est pas vrai ; comme vous l'avez remarqué. Même si vous avez souvent critiqué Pannekoek et Rosa, avec lesquels je suis d'accord en général (et vous m'avez donc également critiqué) j'ai toujours maintenu le même genre de relation avec vous." Gorter. lettre à Kautsky. Déc. 1914. Kautsky Archive IISG, DXI 283, cité dans Herman Gorter, Herman de Liagre Böhl, Nijmegen, 1973, p. 105). "Par admiration et affections anciennes, nous nous sommes toujours abstenus, autant que possible, de nous battre contre vous dans La Tribune." (De Tribune était la publication de la Gauche hollandaise à cette époque)
84 . Dans "Socialisme, la voie occidentale", p. 123.
85 . Nettl, I, p. 401 (édition intégrale). Notre traduction.
86 . Une faiblesse majeure des déclarations les plus combatives a été l'idée d'une action simultanée. Ainsi, la jeune garde socialiste belge adopta une résolution : "C'est le devoir des partis socialistes et des syndicats de tous les pays de s'opposer à la guerre. Le moyen le plus efficace de cette opposition est la grève générale et l'insubordination en réponse à la mobilisation de guerre." (Le danger de guerre et la 2ème Internationale, J. Jemnitz, p. 17). Mais ces moyens ne pouvaient être utilisés que s'ils étaient adoptés simultanément dans tous les pays, en d'autres termes l'internationalisme intransigeant et l'action antimilitariste étaient subordonnés à la nécessité que tout le monde partage la même position.
87 . Fricke, Dieter, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1869 bis 1917 ; Dietz-Verlag, Berlin, 1987, p. 120. Notre traduction.
88 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 34, publié dans le Leipziger Volkszeitung, 26 août 1911. Notre traduction.
89 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 43, publié dans le Leipziger Volkszeitung, 30 août 1911. Notre traduction.
90 . Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 11
91 . "Je suis dans une situation absolument absurde – je dois assumer la responsabilité de me condamner au silence bien que, si je suivais mes propres désirs je me retournerais contre la direction, me condamnant ainsi." (Jemnitz, p. 73, Lettre de Bebel à Kautsky). Bebel meurt d'une crise cardiaque dans un sanatorium en Suisse, le 13 août.
92 . Dans un article intitulé "Comment V. Zassoulitch anéantit le courant liquidateur", il écrivait : "On compte actuellement en Allemagne environ 1 million de membres du parti. Les électeurs sociaux-démocrates y sont au nombre approximatif de 4,25 millions, et les prolétaires de 15 millions (…) Le million, c'est le parti. Ce million adhère aux organisations du parti ; les 4,25 millions, c'est la 'large couche'. Il met en évidence que "En Allemagne, par exemple, c'est 1/15 environ de la classe qui est organisée dans le parti ; en France, c'est environ 1/140 ; en Allemagne, pour un membre du parti on compte 4 à 5 Sociaux-démocrates de la "couche large" ; en France, 14." Lénine ajoute : "Le parti est la couche consciente et avancée de la classe, il en est l'avant-garde. La force de cette avant-garde est supérieure de dix fois, de cent fois, et davantage à son importance numérique. (…) L'organisation décuple les forces" (septembre 1913, Œuvres complètes, Tome 19. Éditions sociales.)
93 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 378
94 . Rosa Luxemburg, "De nouveau sur les masses et les leaders", août 1911, publié initialement dans le Leipziger Volkszeitung. Notre traduction.
95 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 253, "Taktische Fragen", Juin 1913. Notre traduction.
96 . "De nouveau sur les masses et les leaders", op. cit. Notre traduction.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Guerre [471]
Rubrique:
Revue Internationale n°153 - août 2014
- 1418 lectures
Conférence internationale extraordinaire du CCI: la "nouvelle" de notre disparition est grandement exagérée!
- 2814 lectures
En mai dernier, le CCI a tenu une conférence internationale extraordinaire. Une crise s'était développée depuis un certain temps dont l'épicentre s'est situé dans notre plus vieille section, la section en France. La convocation d'une conférence extraordinaire, en plus des congrès internationaux réguliers du CCI, a été jugée nécessaire face au besoin vital de comprendre pleinement la nature de cette crise et de développer les moyens de la surmonter. Le CCI a déjà convoqué des conférences internationales extraordinaires dans le passé, en 1982 et en 2002, en accord avec nos Statuts qui prévoient leur tenue lorsque les principes fondamentaux du CCI sont dangereusement mis en question. 1
Toutes les sections internationales du CCI ont envoyé des délégations à cette troisième Conférence extraordinaire et ont participé très activement aux débats. Les sections qui n'ont pu s'y rendre (du fait de la forteresse Schengen) ont adressé à la Conférence des prises de positions sur les différents rapports et résolutions soumis à la discussion.
Les crises ne sont pas nécessairement mortelles
Nos contacts et sympathisants peuvent être alarmés par cette nouvelle ; de même les ennemis du CCI auront certainement un frisson de jubilation. Certains d'entre eux sont déjà convaincus que cette crise est notre crise "ultime" et le signe annonciateur de notre disparition. Mais ce genre de prédictions avait déjà été fait lors de précédentes crises de notre organisation. Au lendemain de la crise de 1981-82 – il y a 32 ans – nous avions répondu à nos détracteurs, comme nous le faisons aujourd'hui, en rappelant ces mots de Mark Twain : "La nouvelle de notre mort est grandement exagérée !"
Les crises ne sont pas nécessairement le signe d'un effondrement ou d'un échec imminent ou irrémédiable. Au contraire, l'existence de crises peut être l'expression d'une saine résistance à un processus sous-jacent qui s'était paisiblement et insidieusement développé jusque-là et qui, laissé à son libre cours, risquait de mener au naufrage. Ainsi, les crises peuvent être le signe d'une réaction face au danger et de la lutte contre de graves faiblesses conduisant à l'effondrement. Une crise peut aussi être salutaire. Elle peut constituer un moment crucial, une opportunité d'aller à la racine de graves difficultés, d'en identifier les causes profondes pour pouvoir les surmonter. Ce qui permettra, en fin de compte, à l'organisation de se renforcer et de tremper ses militants pour les batailles à venir.
Dans la Deuxième Internationale (1889-1914), le Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) était connu pour avoir traversé une série de crises et de scissions et, pour cette raison, était considéré avec mépris par les partis plus importants de l'Internationale, comme le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) qui semblait voler de succès en succès et dont le nombre de membres ainsi que les résultats électoraux s'amplifiaient régulièrement. Cependant, les crises du parti russe et la lutte pour surmonter ces crises et en tirer les leçons menée par l'aile bolchevique, ont renforcé la minorité révolutionnaire et l'ont préparée à se dresser contre la guerre impérialiste en 1914 et à se porter à l'avant-garde de la révolution d'octobre en 1917. En revanche, l'unité de façade et le "calme" au sein du SPD (qui n'étaient remis en question que par des troublions comme Rosa Luxemburg) a conduit ce parti à s'écrouler complètement et irrévocablement en 1914 avec la trahison totale de ses principes internationalistes face à la Première Guerre mondiale.
En 1982, le CCI a identifié sa propre crise (provoquée par un développement de confusions gauchistes et activistes qui avait permis à l'élément Chénier 2 de faire des dégâts considérables dans notre section en Grande-Bretagne) et en a tiré des leçons pour rétablir plus profondément ses principes concernant sa fonction et son fonctionnement (voir la Revue internationale n° 29 : "Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire" et la Revue n° 33 : "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire"). C'est d'ailleurs à l'issue de cette crise que le CCI a adopté ses Statuts actuels.
Le Parti Communiste International "bordiguiste" (Programme communiste) qui était à l'époque le groupe le plus important de la Gauche communiste a connu, de façon plus grave encore, des difficultés similaires, mais ce groupe n'a pas été en mesure d'en tirer les leçons et a fini par s'effondrer comme un château de cartes avec la perte de la presque totalité de ses sections et de ses membres (Voir la Revue internationale n°32 : "Convulsions dans le milieu révolutionnaire").
En plus d'identifier ses propres crises, le CCI s'est appuyé sur un autre principe enseigné par l'expérience bolchevique : faire connaître les circonstances et les leçons de ses crises internes afin de contribuer à la clarification la plus large (contrairement aux autres groupes révolutionnaires qui cachent au prolétariat l'existence de leurs crises internes). Nous sommes convaincus que les combats pour surmonter les crises internes des organisations révolutionnaires permettent de faire ressortir plus clairement des vérités et des principes généraux concernant la lutte pour le communisme.
Dans la Préface de Un pas en avant, deux pas en arrière, en 1904, Lénine écrivait : "[Nos adversaires] exultent et grimacent à la vue de nos discussions : évidemment, ils s'efforceront, pour les faire servir à leurs fins, de brandir tels passages de ma brochure consacrée aux défauts et aux lacunes de notre Parti. Les social‑démocrates russes sont déjà suffisamment rompus aux batailles pour ne pas se laisser troubler par ces coups d'épingle, pour poursuivre, en dépit de tout, leur travail d'autocritique et continuer à dévoiler sans ménagement leurs propres lacunes qui seront comblées nécessairement et sans faute par la croissance du mouvement ouvrier. Que messieurs nos adversaires essaient donc de nous offrir, de la situation véritable de leurs propres "partis", une image qui ressemblerait même de loin à celle que présentent les procès-verbaux de notre Deuxième Congrès ! 3
A l'instar de Lénine, nous pensons que malgré le plaisir superficiel que nos ennemis éprouvent face à nos difficultés (en les interprétant avec leurs propres lunettes déformantes), les révolutionnaires authentiques apprendront de leurs erreurs et en ressortiront renforcés.
C'est pourquoi nous publions ici, même brièvement, une présentation de l'évolution de cette crise dans le CCI et du rôle qu'a joué notre Conférence extraordinaire pour y faire face.
La nature de la crise actuelle du CCI
L'épicentre de la crise actuelle du CCI a été l'existence au sein de sa section en France de la résurgence d'une campagne de dénigrement, dissimulée à l'ensemble de l'organisation, d'une camarade qui a été diabolisée (à tel point qu'un militant considérait même que sa présence dans l'organisation constituait une entrave au développement de celle-ci). Évidemment, l'existence d'une telle pratique de stigmatisation d'un bouc-émissaire – censé porter la responsabilité de tous les problèmes rencontrés par l'ensemble de l'organisation – est absolument intolérable dans une organisation communiste qui se doit de rejeter le harcèlement endémique existant dans la société capitaliste et résultant de la morale bourgeoise du chacun pour soi et Dieu pour tous. Les difficultés de l'organisation sont de la responsabilité de toute l'organisation. La campagne dissimulée d'ostracisme envers un membre de l'organisation met en question le principe même de solidarité communiste sur lequel le CCI est fondé.
Nous ne pouvions nous contenter de mettre un terme à cette campagne une fois qu'elle était apparue au grand jour suite à sa mise en évidence par l'organe central du CCI.
Ce n'était pas le genre de fait qu'on pouvait balayer comme quelque chose de simplement malencontreux. Il nous fallait aller à la racine et expliquer pourquoi et comment un tel fléau, une remise en cause si flagrante d'un des principes communistes fondamentaux, avait pu se développer de nouveau dans nos rangs. La tâche de la Conférence extraordinaire était de dégager un accord commun sur cette explication et de développer des perspectives pour éradiquer de telles pratiques dans l'avenir.
L'une des tâches de la Conférence extraordinaire était d'entendre et de se prononcer sur le rapport final du Jury d'Honneur qui avait été demandé début 2013 par la camarade diffamée à son insu. Il ne suffisait pas que chacun soit d'accord sur le fait que des calomnies et des méthodes de stigmatisation aient été employées contre la camarade ; il fallait le prouver dans les faits. Il fallait examiner de façon minutieuse la totalité des accusations portées contre cette camarade et identifier leur origine. Les allégations et les dénigrements devaient être dévoilés à l'ensemble de l'organisation afin d'éliminer toute ambiguïté et d'empêcher toute répétition des calomnies à l'avenir. Après un an de travail, le Jury d'Honneur (composé de militants de quatre sections du CCI) a réfuté systématiquement, comme dénuées de tout fondement, toutes les accusations (et particulièrement certaines calomnies honteuses développées par un militant). 4 Le Jury a pu mettre en évidence que cette campagne d'ostracisme était, en réalité, fondée sur l'infiltration dans l'organisation de préjugés obscurantistes véhiculés par l'esprit de cercle (et par une certaine "culture du ragot" héritée du passé et dont certains militants ne s'étaient pas encore débarrassés). En dédiant des forces à ce Jury, le CCI mettait en application une autre leçon du mouvement révolutionnaire : tout militant faisant l'objet de soupçons, d'accusations non fondées ou de calomnies a le devoir de faire appel à un Jury d'Honneur. Refuser de faire cette démarche conduit à reconnaître implicitement la validité des accusations.
Le Jury d'Honneur est un moyen aussi de "préserver la santé morale des organisation révolutionnaires" (comme l'affirmait Victor Serge) 5 puisque la méfiance entre ses membres est un poison qui peut rapidement détruire une organisation révolutionnaire.
C'est d'ailleurs quelque chose de bien connu par la police qui, comme le révèle l'histoire du mouvement ouvrier, a utilisé de façon privilégiée la méthode consistant à entretenir ou provoquer la méfiance pour tenter de détruire de l'intérieur les organisations révolutionnaires. On l'a vu, notamment dans les années 1930 avec les agissements de la Guépéou de Staline contre le mouvement trotskiste, en France et ailleurs. En fait, cibler des militants pour les soumettre à des campagnes de dénigrement et à la calomnie a constitué une arme de premier plan de l'ensemble de la bourgeoisie pour fomenter la méfiance envers le mouvement révolutionnaire et en son sein.
C'est pourquoi les marxistes révolutionnaires ont toujours dédié tous leurs efforts pour démasquer de telles attaques contre les organisations communistes.
À l'époque des procès de Moscou dans les années 1930, Léon Trotski en exil a demandé un Jury d'Honneur (connu sous le nom de Commission Dewey) pour réfuter les calomnies répugnantes portées contre lui par le procureur Vychinski dans ces procès. 6 Marx a interrompu ses travaux sur Le Capital pendant un an, en 1860, pour préparer un livre entier de réfutation systématique des calomnies portées contre lui par Herr Vogt.
En même temps qu'étaient menés les travaux du Jury d'Honneur, l'organisation a cherché les racines profondes de la crise en s'armant d'un cadre théorique. Après la crise du CCI de 2001-2002, nous avions déjà engagé un effort théorique prolongé pour comprendre comment avait pu apparaître au sein de l'organisation une prétendue fraction qui s'était distinguée par des comportements de voyous et de mouchards : circulation secrète de rumeurs accusant une de nos militantes d'être un agent de l'État, vol de l'argent et du matériel de l'organisation (notamment le fichier d'adresses de nos militants et de nos abonnés), chantage, menaces de mort à l'égard d'un de nos militants, publication vers l'extérieur d'informations internes favorisant délibérément le travail de la police, etc. Cette ignoble fraction aux mœurs politiques de gangsters (rappelant celles de la tendance Chénier lors de notre crise de 1981) est connue sous le nom de FICCI (Fraction interne du CCI).7
À la suite de cette expérience, le CCI a commencé à examiner sous un angle historique et théorique le problème de la morale. Dans les Revue internationale n°111 et 112, nous avons publié le "Texte d'orientation sur la confiance et la solidarité dans la lutte du prolétariat", et dans les Revue n°127 et 128 a été publié un autre texte sur "Marxisme et éthique". En lien avec ces réflexions théoriques, notre organisation a mené une recherche historique sur le phénomène social du pogromisme – cette antithèse totale des valeurs communistes qui était au cœur de la mentalité de la FICCI dans ses basses œuvres en vue de détruire le CCI. C'est sur la base de ces premiers textes et du travail théorique sur des aspects de la morale communiste que l'organisation a élaboré sa compréhension des causes profondes de la crise actuelle. La superficialité, les dérives opportunistes et "ouvriéristes", le manque de réflexion et de discussions théoriques au profit de l'intervention activiste et gauchisante dans les luttes immédiates, l'impatience et la tendance à perdre de vue notre activité sur le long terme, ont favorisé cette crise au sein du CCI. Cette crise a donc été identifiée comme une crise "intellectuelle et morale" et a été accompagnée par une perte de vue et une transgression des Statuts du CCI. 8
Le combat pour la défense des principes moraux du marxisme
La Conférence extraordinaire est revenue plus en profondeur sur une compréhension marxiste de la morale dans le but de préparer le cœur théorique de notre activité dans la période à venir. Nous allons poursuivre notre débat interne et explorer cette question comme principal outil de notre régénérescence face à la crise actuelle. Sans théorie révolutionnaire, il ne peut y avoir d'organisation révolutionnaire.
Contenue dans le projet communiste et inséparable de lui se trouve une dimension éthique. Et c'est cette dimension qui est particulièrement menacée par la société capitaliste qui a prospéré sur l'exploitation et la violence, "suant le sang et la boue par tous les pores", comme l'écrivait Marx dans Le Capital. Cette menace s'est particulièrement développée dans la période de décadence du capitalisme où, progressivement, la bourgeoisie a abandonné même ses propres principes moraux qu'elle défendait dans sa période libérale d'expansion du capitalisme. La phase finale de la décadence capitaliste – la période de décomposition sociale – dont l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 a constitué la première grande manifestation – accentue encore plus ce processus. Aujourd'hui, la société bourgeoise est de plus en plus ouvertement, fièrement même, barbare. Nous le voyons dans tous les aspects de la vie sociale : la prolifération des guerres et la bestialité des méthodes utilisées dont le principal objectif semble être d'humilier et de dégrader les victimes avant de les massacrer ; l'accroissement du gangstérisme – et sa célébration au cinéma et dans la musique ; le développement des pogroms à la recherche de boucs-émissaires désignés comme responsables des crimes du capitalisme et de la souffrance sociale ; la montée de la xénophobie envers les immigrés et du harcèlement sur les lieux de travail (le "mobbing") ; le développement de la violence à l'égard des femmes, du harcèlement sexuel et de la misogynie (y compris dans les écoles et parmi les bandes de jeunes des cités ouvrières). Le cynisme, les mensonges et l'hypocrisie ne sont plus considérés comme répréhensibles mais sont enseignés dans les écoles de "management". Les valeurs les plus élémentaires de toute vie sociale –sans parler des valeurs de la société communiste – sont profanées au fur et à mesure que le capitalisme se putréfie.
Les membres des organisations révolutionnaires ne peuvent échapper à l'influence de cet environnement social de pensée et de comportement barbares. Ils ne sont pas immunisés contre cette atmosphère délétère de la décomposition de la société bourgeoise, en particulier quand la classe ouvrière, comme c'est encore le cas aujourd'hui, reste relativement passive et désorientée et, de ce fait, incapable d'offrir une alternative de masse à l'agonie prolongée de la société capitaliste. D'autres couches de la société, pourtant proches du prolétariat dans leurs conditions de vie, constituent un vecteur actif de cette putréfaction. L'impuissance et la frustration traditionnelles de la petite bourgeoisie – cette couche intermédiaire sans avenir historique se situant entre le prolétariat et la bourgeoisie – augmentent de façon démesurée et trouvent une issue dans les comportements pogromistes, dans l'obscurantisme et la "chasse aux sorcières", qui lui procurent la lâche illusion d' "accéder au pouvoir" en pourchassant et persécutant des individus ou des minorités (ethniques, religieuses, etc.) stigmatisés comme "fauteurs de troubles".
Il était particulièrement nécessaire de revenir sur le problème de la morale à la Conférence extraordinaire de 2014. En effet, le caractère explosif de la crise de 2001-2002, les agissements répugnants de la FICCI, les comportements d'aventuriers nihilistes de certains de ses membres, avaient tendu à obscurcir, au sein du CCI, les incompréhensions sous-jacentes plus profondes qui avaient fourni le terreau de la mentalité pogromiste à l'origine de la constitution de cette prétendue "fraction". 9 Du fait de la brutalité de la secousse provoquée par les agissements ignobles de la FICCI il y a une décennie, il a existé par la suite une forte tendance dans le CCI à vouloir revenir à la normale – à chercher un illusoire moment de répit. Il s'est développé un état d'esprit tendant à se détourner d'une démarche théorique et historique envers les questions organisationnelles au bénéfice d'une focalisation sur des questions plus pratiques d'intervention immédiate dans la classe ouvrière et d'une construction régulière mais superficielle de l'organisation. Bien qu'un effort considérable ait été dédié au travail de réflexion théorique en vue du dépassement de la crise de 2001, ce travail était de plus en plus vu comme une question annexe, secondaire, et non comme une question cruciale, de vie et de mort, pour l'avenir de l'organisation révolutionnaire.
La lente et difficile reprise de la lutte de classe en 2003 et la plus grande réceptivité du milieu politique à la discussion avec la Gauche communiste ont tendu à renforcer cette faiblesse. Certaines parties de l'organisation ont commencé à oublier les principes et les acquis organisationnels du CCI et à développer un dédain pour la théorie. Les Statuts de l'organisation qui contiennent les principes de centralisation internationaliste ont tendu à être ignorés au profit des habitudes du philistinisme local et de cercle, du bon sens commun et de la "religion de la vie quotidienne" (comme le disait Marx dans le livre 1 du Capital). L'opportunisme a commencé à se répandre, de façon insidieuse.
Cependant, il y eut une résistance à cette tendance au désintérêt pour les questions théoriques, à l'amnésie politique et à la sclérose. Une camarade en particulier a critiqué ouvertement cette dérive opportuniste et a été, de ce fait, considérée de plus en plus comme "semeur de trouble" et un obstacle au fonctionnement normal, routinier de l'organisation. Au lieu de présenter une réponse politique cohérente aux critiques et arguments de la camarade, l'opportunisme s'est exprimé par de la diffamation personnelle sournoise. D'autres militants (notamment dans les sections du CCI en France et en Allemagne) qui partageaient le point de vue de la camarade contre ces dérives opportunistes, ont été également les "victimes collatérales" de cette campagne de diffamation.
Ainsi, la Conférence extraordinaire a mis en évidence qu'aujourd'hui, comme dans l'histoire du mouvement ouvrier, les campagnes de dénigrement et l'opportunisme vont main dans la main. En fait, les premières apparaissent dans le mouvement ouvrier comme une expression extrême du second. Rosa Luxemburg qui, comme porte-parole de la gauche marxiste, était impitoyable dans ses dénonciations de l'opportunisme, fut systématiquement diffamée par les dirigeants et bureaucrates de la social-démocratie allemande. La dégénérescence du Parti bolchevique et de la Troisième Internationale fut accompagnée par la calomnie et la persécution sans fin de la vieille garde bolchevique, et en particulier de Léon Trotski.
L'organisation se devait donc de revenir au concept classique d'opportunisme organisationnel dans l'histoire du mouvement ouvrier qui inclut les leçons de la propre expérience du CCI.
La nécessité de mener le combat contre l'opportunisme (et son expression conciliatrice sous la forme du centrisme) a constitué un axe central des travaux de la Conférence extraordinaire : la crise du CCI requérait une lutte prolongée contre les racines des problèmes qui avaient été identifiées et qui se trouvent dans une certaine tendance à rechercher un cocon au sein du CCI, à transformer l'organisation en "club d'opinions" et à s'installer dans la société bourgeoise en décomposition. En fait, la nature même du militantisme révolutionnaire est le combat permanent contre le poids de l'idéologie dominante et de toutes les idéologies étrangères au prolétariat qui s'infiltrent insidieusement au sein des organisations révolutionnaires. C'est ce combat qui doit être la norme de la vie interne de l'organisation communiste et de chacun de ses membres.
La lutte contre tout accord superficiel, l'effort individuel de chaque militant pour exprimer ses positions politiques face à l'ensemble de l'organisation, la nécessité de développer ses divergences avec des arguments politiques sérieux et cohérents, la force d'accepter les critiques politiques – telles sont les insistances mises en avant par la Conférence extraordinaire. Comme le souligne la Résolution d'Activités qui a été adoptée à la Conférence : "6d) Le militant révolutionnaire doit être un combattant, pour les positions de classe du prolétariat et pour ses propres idées. Ceci n'est pas une condition optionnelle du militantisme, c'est le militantisme. Sans cela, il ne peut pas y avoir de lutte pour la vérité, qui ne peut apparaître qu'à partir de la confrontation des idées et du fait que chaque militant se lève pour défendre son point de vue. L'organisation a besoin de connaître les positions de tous les camarades, l'accord passif est inutile et contre-productif (…) Prendre sa responsabilité individuelle, être honnête est un aspect fondamental de la morale prolétarienne."
La crise actuelle n'est pas la crise "ultime" du CCI
A la veille de la Conférence extraordinaire, la publication sur Internet d'un "Appel au Camp prolétarien et aux militants du CCI" annonçant "la crise ultime" du CCI a pleinement souligné l'importance de cet esprit de combat pour la défense de l'organisation communiste et de ses principes, en particulier face à tous ceux qui cherchent à la détruire. Cet "appel" particulièrement nauséabond émane d'un soi-disant "Groupe International de la Gauche Communiste" (GIGC), en réalité un déguisement de l'infâme ex-FICCI grâce à son mariage avec des éléments de Klabastalo de Montréal. C'est un texte transpirant la haine et l'appel au pogrom contre certains de nos camarades. Ce texte annonce de façon tapageuse que ce "GIGC" est en possession de documents internes du CCI. Son intention est claire : tenter de saboter notre Conférence extraordinaire, de semer le trouble et la zizanie au sein du CCI en répandant la suspicion généralisée dans nos rangs juste à la veille de cette Conférence internationale (en faisant passer le message : il y a un traître dans le CCI, un complice du "GIGC" qui lui communique nos bulletins internes 10).
La Conférence extraordinaire a pris immédiatement position sur cet "Appel" du GIGC : aux yeux de tous les militants, il a été clair que l'ex-FICCI est en train de faire encore une fois (et de façon encore plus pernicieuse) le travail de la police à la manière que Victor Serge décrit de façon si éloquente dans son livre Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression (rédigé sur la base des archives de la police tsariste découvertes après la révolution d'Octobre 1917). 11
Mais au lieu de monter les militants du CCI les uns contre les autres, le dégoût unanime engendré par les méthodes du "GIGC", dignes de la police politique de Staline et de la Stasi, a servi à mettre en lumière les plus grands enjeux de notre crise interne et a tendu à renforcer l'unité des militants derrière le mot d'ordre du mouvement ouvrier : "Tous pour un et un pour tous !" (rappelé dans le livre de Joseph Dietzgen, que Marx appelait le "philosophe du prolétariat", "L'essence du travail intellectuel humain"). Cette attaque policière du GIGC (ex-FICCI) a fait prendre conscience de façon encore plus claire à tous les militants que les faiblesses internes de l'organisation, le manque de vigilance face à la pression permanente de l'idéologie dominante au sein des organisations révolutionnaires, l'avait rendue vulnérable aux machinations de ses ennemis dont les intentions destructrices sont indubitables.
La Conférence extraordinaire a salué le travail extrêmement sérieux et gigantesque du Jury d'Honneur. Elle a salué également le courage de la camarade qui en a fait la demande et qui avait été ostracisée pour ses divergences politiques 12. Car seuls les lâches et ceux qui se savent coupables refusent de faire la clarté devant ce type de commission qui est un héritage légué par le mouvement ouvrier. Le nuage suspendu au-dessus de l'organisation a été dissipé. Et il était temps.
La Conférence extraordinaire ne pouvait mettre un terme à la lutte du CCI contre cette crise "intellectuelle et morale" – cette lutte continue nécessairement – mais elle a doté l'organisation d'une orientation sans ambiguïté : l'ouverture d'un débat théorique interne sur les "Thèses sur la morale" proposées par l'organe central du CCI. Bien évidemment, nous répercuterons ultérieurement dans notre presse les éventuelles positions divergentes lorsque notre débat aura atteint un niveau suffisant de maturité.
Certains de nos lecteurs penseront peut-être que la polarisation du CCI sur sa crise interne et sur le combat contre les attaques de type policier dont nous sommes la cible, est l'expression d'une "folie narcissique" ou d'un "délire paranoïaque collectif". Le souci de la défense intransigeante de nos principes organisationnels, programmatiques et éthiques serait, selon ce point de vue, une diversion par rapport à la tâche immédiate, pratique et "de bon sens" de développer le plus possible notre influence dans les luttes immédiates de la classe ouvrière. Ce point de vue ne fait que répéter, sur le fond mais dans un contexte différent, l'argument des opportunistes sur le fonctionnement sans à-coups du Parti social-démocrate allemand contre le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie secoué par les crises au cours de la période ayant précédé la Première Guerre mondiale. La démarche consistant à escamoter les divergences, à refuser la confrontation des arguments politiques, pour "préserver l'unité", et ceci à n'importe quel prix, ne fait que préparer la disparition, tôt ou tard, des minorités révolutionnaires organisées.
La défense des principes communistes fondamentaux, aussi éloignée qu'elle puisse sembler des besoins et de la conscience actuels de la classe ouvrière, est, néanmoins, la tâche première des minorités révolutionnaires. Notre détermination à engager un combat permanent pour la défense de la morale communiste – qui est au cœur du principe de la solidarité – est une clé pour préserver notre organisation face aux miasmes de la décomposition sociale capitaliste qui s'infiltrent inévitablement au sein de toutes les organisations révolutionnaires. Seul l'armement politique, le renforcement de notre travail d'élaboration théorique, peut nous permettre de faire face à ce danger mortel. De plus, sans la défense implacable de l'éthique de la classe porteuse du communisme, la possibilité que le développement de la lutte de classe mène à la révolution et à la construction future d'une véritable communauté mondiale unifiée, serait continuellement étouffée.
Une chose est apparue clairement à la Conférence extraordinaire de 2014 : il n'y aura pas de retour à la normale dans les activités internes et externes du CCI.
Contrairement à ce qui était advenu lors de la crise de 2001, nous pouvons déjà nous réjouir que les camarades qui ont été embarqués dans une logique de stigmatisation irrationnelle d'un bouc émissaire aient pris conscience de la gravité de leur dérive. Ces militants ont décidé librement de rester loyaux au CCI et à ses principes et sont aujourd'hui engagés dans notre combat de consolidation de l'organisation. Comme l'ensemble du CCI, ils sont désormais impliqués dans le travail de réflexion et d'approfondissement théorique qui avait été largement sous-estimé par le passé. En s'appropriant la formule de Spinoza "ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas désespérer mais comprendre", le CCI s'est attelé à la tâche de réappropriation de cette idée fondamentale du marxisme : la lutte du prolétariat pour la construction du communisme n'a pas seulement une dimension "économique" (comme se l'imaginent les matérialistes vulgaires) mais également et fondamentalement une dimension "intellectuelle et morale" (comme le mettaient en avant, notamment, Lénine et Rosa Luxemburg).
Nous sommes donc au regret d'apprendre à nos détracteurs de tous bords qu'il n'y a, au sein du CCI, aucune perspective immédiate d'une nouvelle scission parasitaire, comme cela fut le cas lors de nos crises précédentes. Il n'y a aucune perspective de constitution d'une nouvelle "fraction" susceptible de rejoindre l'"Appel" au pogrom du GIGC contre nos propres camarades ("Appel" frénétiquement relayé par différents "réseaux sociaux" et un dénommé Pierre "Hempel", qui se prend pour le représentant du "prolétariat universel"). Bien au contraire : les méthodes policières du GIGC (sponsorisé par une tendance "critique" au sein d'un parti réformiste bourgeois, le NPA ! 13) n'ont fait que renforcer l'indignation générale des militants du CCI et leur détermination à mener le combat pour le renforcement de l'organisation.
La "nouvelle" de notre disparition est donc grandement exagérée et prématurée !
Courant Communiste International
1 �Comme lors de la conférence extraordinaire de 2002 (voir notre article de la Revue Internationale n° 110 "Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels" [https://fr.internationalism.org/french/rint/110_conference.html] [478]), celle de 2014 s'est tenue en remplacement partiel du congrès régulier de notre section en France. Ainsi certaines séances ont été consacrées à la conférence internationale extraordinaire et d'autres au congrès de la section en France dont notre journal Révolution Internationale rendra compte ultérieurement.
2 Chénier était un membre de la section en France qui a été exclu durant l'été 1981 pour avoir mené une campagne secrète de dénigrements des organes centraux de l'organisation, de certains de ses militants les plus expérimentés et visant à dresser les militants les uns contre les autres, des agissements qui rappelaient étrangement ceux des agents du Guépéou au sein du mouvement trotskiste au cours des années 1930. Quelques mois après son exclusion, Chénier a pris des fonctions de responsabilité au sein de l'appareil du Parti Socialiste alors au gouvernement.
4 Parallèlement à cette campagne, s'était développés aussi, dans des discussions informelles au sein de la section en France, des ragots colportés par certains militants de la "vieille" génération dénigrant de façon scandaleuse notre camarade Marc Chirik, membre fondateur du CCI et sans lequel notre organisation n'existerait pas. Ces ragots ont été identifiés comme une manifestation du poids de l'esprit de cercle et de l'influence de la petite bourgeoisie décomposée qui avait profondément marqué la génération issue du mouvement estudiantin de Mai 68 (avec toutes ses idéologies anarcho-moderniste et gauchisantes).
5 Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression
6 �Le Jury d'Honneur du CCI s'est appuyé sur la méthode scientifique d'investigation et de vérification des faits de la Commission Dewey. L'ensemble de ses travaux (documents, procès-verbaux, enregistrements d'entretiens et de témoignages, etc.) est précieusement conservé dans les archives du CCI.
7 Voir notamment à ce sujet nos articles XVe Congrès du CCI, Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période [480] dans la Revue internationale n° 114 (https://fr.internationalism.org/french/rint/114_xv_congress.html [480]), Les méthodes policières de la FICCI dans Révolution internationale n° 330 (https://fr.internationalism.org/ri330/ficci.html [481]) et Calomnie et mouchardage, les deux mamelles de la politique de la FICCI envers le CCI (https://fr.internationalism.org/icconline/2006_ficci [482])
8 L'organe central du CCI (de même que le Jury d'Honneur) a clairement démontré que ce n'est pas la camarade ostracisée qui n'avait pas respecté les Statuts du CCI, mais au contraire les militants qui se sont engagés dans cette campagne de dénigrement.
9 �Les résistances dans nos rangs à développer un débat sur la question de la morale trouvent leur origine dans une faiblesse congénitale du CCI (et qui affecte, en réalité, l'ensemble des groupes de la Gauche communiste) : la première génération de militants rejetaient majoritairement cette question qui n'a pas pu être intégrée à nos Statuts, comme le souhaitait notre camarade Marc Chirik. La morale était vécue par ces jeunes militants de l'époque comme un carcan, un "produit de l'idéologie bourgeoise", à tel point que certains d'entre eux, issus du milieu libertaire, revendiquaient de vivre "sans tabou" ! Ce qui révélait une ignorance affligeante de l'histoire de l'espèce humaine et du développement de sa civilisation.
10 Voir notre "Communiqué à nos lecteurs : Le CCI attaqué par une nouvelle officine de l'État bourgeois" [https://fr.internationalism.org/icconline/201405/9079/communique-a-nos-l... [483].
11 Comme pour confirmer la nature de classe de cette attaque, un certain Pierre Hempel a publié sur son blog d'autres documents internes que l'ex-FICCI lui avait remis. Il a même froidement et publiquement affirmé sur son blog :,"Si la police m'avait fait parvenir un tel docu[ment], je l'en aurais remerciée au nom du prolétariat." ! La "sainte alliance" des ennemis du CCI (constituée, pour une bonne part, par une "amicale d'anciens combattants du CCI" recyclés) sait très bien à quel camp elle appartient !
12 Ce qui avait déjà été le cas au début de la crise de 2001 : lorsque cette même camarade a émis un désaccord politique avec un texte rédigé par un membre du Secrétariat International du CCI (sur la question de la centralisation), ce fut une levée de bouclier de la part de la majorité de ses membres qui, au lieu d'ouvrir un débat pour répondre aux arguments politique de la camarade, ont étouffé ce débat et ont engagé une campagne de calomnie contre elle, dans des réunions secrètes et en colportant des rumeurs dans les section en France et au Mexique, suivant lesquelles cette camarade, du fait de ses désaccords politiques avec des membres de l'organe central du CCI, était une "fouteuse de merde" et même un "flic", selon les dires des deux éléments de l'ex-FICCI (Juan et Jonas) qui sont à l'origine de la fondation du "GIGC".
13 �Il faut constater qu'à ce jour, le "GIGC" n'a toujours pas donné d'explication sur ses relations et convergences avec cette tendance qui milite au sein du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) d'Olivier Besancenot. Qui ne dit mot consent !
Vie du CCI:
Rubrique:
Les guerres de l'été 2014 illustrent l'avancée de la désintégration du système
- 1043 lectures
Durant l'été 2014, alors que la classe dirigeante nous régalait avec les "commémorations" bruyantes de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l'intensification des conflits militaires a encore une fois confirmé ce que les révolutionnaires avaient déjà compris en 1914 : la civilisation capitaliste est devenue un obstacle au progrès, une menace pour la survie même de l'humanité. Dans la Brochure de Junius, écrite de prison en 1915, Rosa Luxemburg avertissait que si la classe ouvrière ne renversait pas ce système, celui-ci entrainerait nécessairement l'humanité dans une spirale de plus en plus destructrice de guerres impérialistes. L'histoire des 20e et 21e siècles a tragiquement vérifié cette prédiction et, aujourd'hui, après un siècle de déclin du capitalisme, la guerre est de plus en plus omniprésente, plus chaotique et irrationnelle que jamais. Nous avons atteint un stade avancé de la désintégration du système, une phase qui peut être décrite comme la décomposition du capitalisme.
Tous les grands conflits de l'été illustrent les caractéristiques de cette phase :
- La "guerre civile" en Syrie a réduit en ruines une grande partie du pays, détruisant la vie économique et le travail accumulé par les cultures passées, tandis que l'opposition au régime Assad était de plus en plus dominée par les djihadistes de "l'État islamique", dont le sectarisme brutal va au-delà de ce qui était imaginable, même avec Al-Qaïda ;
- Initialement soutenu par les États-Unis contre le régime d'Assad, lui-même soutenu par la Russie, "l'État islamique" a maintenant clairement échappé au contrôle de ses anciens partisans avec, pour résultat, la propagation à l'Irak de la guerre en Syrie, menaçant le pays de désintégration et obligeant les États-Unis à intervenir par des frappes aériennes contre la progression des forces islamiques, et à armer les Kurdes, bien que cette option comporte à son tour le risque de créer une nouvelle entité kurde qui serait un facteur supplémentaire de déstabilisation de toute la région ;
- En Israël / Palestine, une nouvelle campagne de bombardements israéliens, encore plus meurtrière, a fait 2 000 tués, des civils en majorité, sans aucune perspective réelle de faire cesser les tirs de roquettes du Hamas et du Jihad islamique ;
- En Ukraine, le nombre de morts a également augmenté, après le bombardement de zones résidentielles par le gouvernement de Kiev, tandis que la Russie est de plus en plus entraînée dans le conflit avec son soutien à peine déguisé aux "rebelles" pro-russes. En retour, ce conflit a visiblement aiguisé les tensions entre la Russie et les puissances occidentales.
Toutes ces guerres expriment la marche du capitalisme vers la destruction. Elles ne constitueront pas la base d'un nouvel ordre mondial ou d'une phase de prospérité comme après la Seconde Guerre mondiale. Elles sont, comme Rosa Luxemburg l'a écrit à propos de la Première Guerre mondiale, l'expression la plus concrète de la barbarie. Dans le même temps, elles ont un coût terrible pour la classe exploitée, la seule force qui peut stopper la chute dans la barbarie et affirmer la seule alternative possible : le communisme. À nouveau dans la Brochure de Junius, Rosa Luxemburg s'exprime en ces termes : "La guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque. En vue d'un meurtre systématique, chez des hommes normalement constitués, il faut cependant d'abord produire une ivresse appropriée. C'est depuis toujours la méthode habituelle des belligérants. La bestialité des pensées et des sentiments doit correspondre à la bestialité de la pratique, elle doit la préparer et l'accompagner".
En Israël, le cri de "Mort aux Arabes" est scandé contre les manifestants pacifistes ; à Paris, des manifestations "antisionistes" y font écho avec le slogan "Mort aux Juifs" ; en Ukraine, les forces pro et anti-gouvernementales sont mues par le nationalisme le plus enragé ; en Irak, les djihadistes menacent les chrétiens et les Yézidis, leur laissant le choix entre la conversion à l'islam ou la mort. Cette ivresse de guerre, cette atmosphère de pogrom, sont une atteinte à la conscience du prolétariat et, dans les zones de conflit, le livrent pieds et poings liés à ses exploiteurs et à leurs mobilisations guerrières.
Ces éléments, ces dangers pour l'unité et la santé morale de notre classe, nécessitent une réflexion approfondie et nous reviendrons sur cette question dans de prochains articles qui analyseront plus en profondeur les conflits impérialistes actuels et l'état de la lutte de classe. En attendant, nous renvoyons le lecteur à notre site Internet et à notre presse territoriale pour les articles sur les affrontements impérialistes actuels.
(15/08/2014)
Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat (Internationalisme n° 38 – octobre 1948)
- 1521 lectures
Introduction du CCI
Le document que nous publions ci-dessous est paru pour la première fois en 1948 dans les pages d’Internationalisme, la presse du petit groupe Gauche Communiste de France, dont le CCI se réclame depuis sa formation en 1975. Il a été reproduit, au début des années 1970, dans le Bulletin d’études et de discussion publié par le groupe français Révolution internationale qui allait par la suite devenir la section en France du nouveau Courant Communiste International. Le Bulletin était lui-même le précurseur de l’organe théorique du CCI, la Revue internationale, et son but était d’ancrer plus solidement le nouveau groupe RI - et ses très jeunes militants - à travers une réflexion théorique et une meilleure connaissance de l’histoire du mouvement ouvrier, y compris l’histoire de ses confrontations avec les nouvelles questions théoriques posées par l’histoire. 1
Le principal objet de ce texte est d’examiner les conditions historiques qui déterminent la formation et l’activité des organisations révolutionnaires. L’idée même de “détermination” est fondamentale. Bien que la création et le maintien d’une organisation révolutionnaire soient le fruit d’une volonté militante cherchant à être facteur actif de l’histoire, la forme que cette volonté se donne n’existe pas indépendamment de la réalité sociale et surtout indépendamment du niveau de combativité et de conscience dans les larges masses de la classe ouvrière. La conception selon laquelle la création d’un parti de classe ne dépend que de la “volonté” des militants était celle du trotskisme dans les années 1930 mais aussi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du nouveau Partito Comunista Internazionalista, le précurseur des multiples groupes bordiguistes et de l’actuelle Tendance Communiste Internationale (ex-BIPR). L’article d’Internationalisme souligne, à juste raison selon nous, qu’il s’agit ici de deux conceptions fondamentalement différentes de l’organisation politique : l’une volontariste et idéaliste, l’autre matérialiste et marxiste. Au mieux, la conception volontariste ne pouvait mener qu’à un opportunisme congénital - comme ce fut le cas pour le PCInt et ses descendants ; au pire à la conciliation avec l’ennemi de classe et au passage dans le camp de la bourgeoisie.
L’importance de la réflexion théorique et historique sur cette question, pour la jeune génération de l’après-68, est évidente. Elle devait préserver le CCI (même si elle ne l’a pas immunisé, loin s’en faut) des pires effets de l’activisme effréné et de l’impatience typiques de cette période, et qui ont mené tant de groupes et de militants vers le néant politique.
Ce texte reste, nous en sommes profondément convaincus, tout autant d’actualité aujourd’hui pour une nouvelle génération de militants et, plus particulièrement, dans son insistance sur ce fait que la classe ouvrière n’est pas une simple catégorie sociologique mais une classe avec un rôle spécifique à jouer dans l’histoire : celui de renverser le capitalisme et d’édifier la société communiste 2. Le rôle des révolutionnaires dépend aussi des périodes historiques : lorsque la situation de la classe ouvrière fait qu’il lui est impossible d’influer sur le cours des évènements, le rôle des révolutionnaires n’est pas d’ignorer cette réalité et de s'illusionner sur le fait que leur intervention immédiate pourrait changer le cours des évènements, mais de s’atteler à une tâche bien moins spectaculaire, celle de préparer les conditions théoriques et politiques pour l’intervention déterminante dans les luttes de classes du futur.
Introduction d’Internationalisme
Notre groupe s’est donné comme tâche le réexamen des grands problèmes que pose la nécessité de reconstituer un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire. Il devait considérer 1’évolution de la société capitaliste vers le capitalisme d’État, et ce qui subsiste de 1ancien mouvement ouvrier, servant depuis un certain temps, d’appui à la classe capitaliste peur entraîner le prolétariat derrière elle, il devait aussi examiner ce qui, dans cet ancien mouvement ouvrier, sert de matériel à cette classe dans ce but, et comment. Puis nous avons été amenés à reconsidérer ce qui, dans le mouvement ouvrier, restait acquis et ce qui était dépassé depuis le Manifeste Communiste.
Enfin, il était normal que nous tendions à étudier les problèmes posés par la révolution et par le socialisme. C’est dans ce but que nous avons présenté une étude sur l’État après la révolution et que nous présentons aujourd’hui à la discussion une étude sur le problème du parti révolutionnaire du prolétariat.
Cette question est, rappelons-le, une des questions les plus importantes du mouvement ouvrier révolutionnaire. C’est elle qui opposa Marx et les marxistes aux anarchistes, à certaines tendances socialistes-démocratiques et ensuite, aux tendances syndicalistes-révolutionnaires. Elle est au centre des préoccupations de Marx qui a gardé surtout une attitude critique à l’égard des différents organismes qui se sont nommés partis “ouvriers”, “socialistes”, Internationales et autres. Marx, quoique participant activement, dans des moments donnés, à la vie de certains de ces organismes, ne les considéra jamais que comme des groupes politiques au sein desquels, selon la phrase du Manifeste, les communistes peuvent se manifester comme “avant-garde du prolétariat”. Le but des communistes était de pousser plus loin 1’action de ces organismes et de garder en leur sein toute possibilité de critique et d’organisation autonome. Ensuite, c’est la scission au sein du parti ouvrier social-démocrate russe entre tendance menchevik et bolchevik sur l’idée développée par Lénine dans Que faire ? C’est le problème qui opposa, dans les groupes marxistes ayant rompu avec la social-démocratie, Raden-kommunisten et le KAPD à la troisième Internationale. C’est aussi dans cet ordre de pensée que s’inscrit la divergence entre le groupe de Bordiga et Lénine au sujet de la politique de “front unique” préconisée par Lénine et Trotsky et adoptée par l’IC. C:est enfin sur ce problème que subsiste une des divergences essentielles entre différents groupes, au sein de l’opposition : entre “trotskystes”, “bordiguistes” et c’est ce problème qui fit l’objet des discussions de tous les groupes qui se manifestèrent à cette époque.
Aujourd’hui, nous avons à refaire 1’examen critique de toutes ces manifestations du mouvement ouvrier révolutionnaire. Nous devons dégager dans son évolution - c!’est-à-dire dans la manifestation de différents courants d’idées à ce sujet - un courant qui, selon nous, exprime le mieux l’attitude révolutionnaire, et essayer de poser le problème pour le futur mouvement ouvrier révolutionnaire.
Nous devons également reconsidérer d’une façon critique les points de vue d’où l’on a abordé ce problème, voir ce qu’il y a de constant dans l’expression révolutionnaire du prolétariat, mais aussi ce qu’il y a de dépassé et les problèmes nouveaux qui se posent.
Or, il est bien évident qu’un tel travail ne peut porter des fruits que s’il constitue un objet de discussion entre groupes et au sein des groupes qui se proposent de reconstituer un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire.
L’étude présentée aujourd’hui constitue donc une participation à cette discussion ; elle s’inscrit dans cet ordre de préoccupations et n’a donc pas d’autre prétention, quoique présentée sous la forme de thèses. Elle a surtout comme but de susciter la discussion et la critique, plus que d’apporter des solutions définitives. C’est un travail de recherche et qui vise moins à l’approbation ou au rejet pur et simple qu’à susciter d’autres travaux de ce genre.
Cette étude a comme objet de préoccupation essentielle “la manifestation de la conscience révolutionnaire” du prolétariat. Mais il y a nombre de questions qui s’inscrivent au programme de ce problème du parti et qui ne sont qu’effleurées : des problèmes organisationnels, des problèmes sur les rapports entre le parti et des organismes tels que les conseils d’ouvriers, des problèmes concernant 1’attitude des révolutionnaires devant la constitution de plusieurs groupes se réclament DU parti révolutionnaire et œuvrant à sa construction, les problèmes que posent les tâches pré et postrévolutionnaires, etc. …
Il convient donc que les militants qui comprennent que la tâche de l’heure est l’examen de ces divers problèmes interviennent activement dans cette discussion, soit au travers de leurs propres journaux ou bulletins, soit dans ce bulletin, pour ceux qui ne disposent pas momentanément d’une telle possibilité d’expression.
Le rôle décisif de la conscience pour la révolution prolétarienne
1. L’idée de la nécessité d’un organisme politique agissant du prolétariat, pour la révolution sociale, semblait être acquise dans le mouvement ouvrier socialiste.
Il est vrai que les anarchistes ont toujours protesté contre le terme “politique” donné à cet organisme. Mais la protestation anarchiste provenait du fait qu’ils entendaient le terme de l’action politique dans un sens très étroit, synonyme pour eux, d’une action pour des réformes législatives : participation aux élections et au parlement bourgeois, etc... Mais ni les anarchistes, ni aucun autre courant dans le mouvement ouvrier ne nient la nécessité du regroupement des révolutionnaires socialistes dans des associations qui, par l’action et la propagande, se donnent pour tâche d’intervenir et d’orienter la lutte des ouvriers. Or, tout groupement qui se donne pour tâche d’orienter dans une certaine direction les luttes sociales est un groupement politique.
Dans ce sens, la lutte d’idée autour du caractère politique ou non politique à donner à ces organisations n’est qu’un débat de mots, cachant au fond, sous des phrases générales, des divergences concrètes sur l’orientation, sur les buts à atteindre et les moyens pour y parvenir. En d’autres termes, des divergences précisément politiques.
Si aujourd’hui surgissent à nouveau des tendances qui remettent en question la nécessité d’un organisme politique pour le prolétariat, c’est une conséquence de la dégénérescence et du passage au service du capitalisme des partis qui furent autrefois des organisations du prolétariat : les partis socialistes et communistes. Les termes de politique et de partis politiques subissent actuellement un discrédit, même dans des milieux bourgeois. Cependant, ce qui a conduit à des faillites retentissantes n’est pas la politique mais CERTAINES politiques. La politique n’étant rien d’autre que l’orientation que se donnent les hommes dans l’organisation de leur vie sociale ; se détourner de cette action, c’est renoncer à vouloir orienter la vie sociale et par conséquent à vouloir la transformer, c’est subir et accepter la société présente.
2. La notion de classe est essentiellement une notion historico-politique, et non simplement une classification économique. Économiquement, tous les hommes font partie d’un et même système de production dans une période historique donnée. La division basée sur les positions distinctes que les hommes occupent dans un même système de production et de répartition et qui ne dépasse pas le cadre de ce système, ne peut devenir le postulat de la nécessité historique du dépassement de celui-ci. La division en catégories économiques n’est alors qu’un moment de la contradiction interne constante se développant avec le système, mais restant circonscrite à l’intérieur des limites de celui-ci. L’opposition historique est en quelque sorte extérieure, dans le sens qu’elle s’oppose à l’ensemble du système pris comme un tout, et cette opposition se réalise dans la destruction du système social existant et son remplacement par un autre basé sur un nouveau mode de production. La classe est la personnification de cette opposition historique en même temps qu’elle est la force sociale-humaine la réalisant.
Le prolétariat n’existe en tant que classe dans le plein sens du terme que dans l’orientation qu’il donne à ses luttes, non en vue de l’aménagement de ses conditions de vie à l’intérieur du système capitaliste, mais dans son opposition à l’ordre social existant. Le passage de la catégorie à la classe, de la lutte économique à la lutte politique, n’est pas un processus évolutif, un développement continu immanent, de façon que 1’opposition historique de classe émerge automatiquement et naturellement après avoir été longtemps contenue dans la position économique des ouvriers. De l’une à l’autre, il y a un bond dialectique qui s’effectue. Il consiste dans la prise de conscience de la nécessité historique de la disparition du système capitaliste. Cette nécessité historique coïncide avec l’aspiration du prolétariat à la libération de sa condition d’exploité et la contient.
3. Toutes les transformations sociales dans l’histoire avaient pour condition fondamentale déterminante le développement des forces productives devenues incompatibles avec la structure par trop étroite de l’ancienne société. C’est aussi dans l’impossibilité de dominer plus longtemps les forces productives qu’il a développées que le capitalisme accuse sa propre fin et la raison de son effondrement et apporte ainsi la condition et la justification historique de son dépassement par le socialisme.
Mais hormis cette condition, les différences dans le déroulement entre les révolutions antérieures (y compris la révolution bourgeoise) et la révolution socialiste, restent décisives et nécessitent une étude approfondie de la part de la classe révolutionnaire.
Pour la révolution bourgeoise, par exemple, les forces de production incompatibles avec le féodalisme, trouvent encore la condition de leur développement dans un système de propriété d’une classe possédante. De ce fait, le capitalisme développe économiquement ses bases lentement et longtemps à l’intérieur du monde féodal. La révolution politique suit le fait économique et le consacre. De ce fait également, la bourgeoisie n’a pas un besoin impérieux d’une conscience du mouvement économique et social. Son action est directement propulsée par la pression des lois du développement économique qui agissent sur elle comme des forces aveugles de la nature et déterminent sa volonté. Sa conscience demeure un facteur de second ordre. El1e retarde sur les faits. Elle est plus enregistrement qu’orientation. La révolution bourgeoise se situe dans cette préhistoire de l’humanité où les forces productives encore peu développées dominent les hommes.
Le socialisme au contraire est basé sur un développement des forces productives incompatible avec toute propriété individuelle ou sociale d’une classe. De ce fait le socialisme ne peut fonder des assises économiques au sein de la société capitaliste. La révolution politique est la première condition d’une orientation socialiste de l’économie et de la société. De ce fait également, le socialisme ne peut se réaliser qu’en tant que conscience des finalités du mouvement, conscience des moyens de leur réalisation et volonté consciente de l’action. La conscience socialiste PRECEDE ET CONDITIONNE l’action révolutionnaire de la classe. La révolution socialiste est le début de l’histoire où l’homme est appelé à dominer les forces productives qu’il a déjà fortement développées et cette domination est précisément l’objet que se pose la révolution socialiste.
4. Pour cette raison, toutes les tentatives d’asseoir le socialisme sur des réalisations pratiquées au sein de la société capitaliste sont par la nature même du socialisme vouées à l’échec. Le socialisme exige, dans le temps un développement avancé des forces productives, pour espace la terre entière, et pour condition primordiale la volonté consciente des hommes. La démonstration expérimentale du socialisme au sein de la société capitaliste ne peut pas dépasser, dans le meilleur des cas, le niveau d’une utopie. Et la persistance dans cette-voie mène de l’utopie à une position de conservation et de renforcement du capitalisme 3. Le socialisme en régime capitaliste ne peut être qu’une démonstration théorique, sa matérialisation ne peut prendre que la forme d’une force idéologique, et sa réalisation que la lutte révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre social existant.
Et puisque l’existence du socialisme ne peut se manifester d’abord que dans la conscience socialiste, la classe qui le porte et le personnifie n’a d’existence historique que par cette conscience. La formation du prolétariat en tant que classe historique n’est que la formation de sa conscience socialiste. Ce sont là deux aspects d’un même processus historique inconcevables séparément parce qu’inexistants l’un sans l’autre.
La conscience socialiste ne découle pas de la position économique des ouvriers, elle n’est pas un reflet de leur condition de salariés. Pour cette raison, la conscience socialiste ne se forge pas simultanément et spontanément dans les cerveaux de tous les ouvriers et uniquement dans leurs cerveaux. Le socialisme en tant qu’idéologie apparaît séparément et parallèlement aux luttes économiques des ouvriers, tous les deux ne s’engendrent pas l’un l’autre quoique s’influençant réciproquement et se conditionnant dans leur développement, tous les deux trouvent leurs racines dans le développement historique de la société capitaliste.
La formation du parti de classe dans l’histoire
5. Si les ouvriers ne deviennent “classe par elle-même et pour elle-même” (selon l’expression de Marx et Engels) que par la prise de conscience socialiste, on peut dire que le processus de constitution de la classe s’identifie au processus de formation des groupes de militants révolutionnaires socialistes. Le parti du prolétariat n’est pas une sélection, pas davantage une “délégation” de la classe, mais c’est le mode d’existence et de vie de la classe elle-même. Pas plus qu’on ne peut saisir la matière en dehors du mouvement, on ne peut saisir la classe en dehors de sa tendance à se constituer en organismes politiques. “L’organisation du prolétariat en classe, donc en parti politique” (Manifeste Communiste) n’est pas une formule du hasard, mais exprime la pensée profonde de Marx-Engels. Un siècle d’expérience a magistralement’’ confirmé la validité de cette façon de concevoir la notion de classe.
6. La conscience socialiste ne se PRODUIT pas par génération spontanée mais se REPRODUIT sans cesse, et une fois apparue elle devient dans son opposition au monde capitaliste existant, le principe actif déterminant et accélérant, dans et par l’action, son propre développement. Toutefois ce développement est conditionné et limité par le développement des contradictions du capitalisme. Dans ce sens la thèse de Lénine de la “conscience socialiste injectée aux ouvriers” par le parti en opposition à la thèse de Rosa de la “spontanéité” de la prise de conscience engendrée au cours d’un mouvement partant de la lutte économique pour aboutir à la lutte socialiste révolutionnaire, est certainement plus exact. La thèse de la “spontanéité”, aux apparences démocratiques, a quant au fond, une tendance mécaniste d’un déterminisme économique rigoureux. Elle part d’une relation de cause à effet : la conscience socialiste ne serait que la résultante, l’effet d’un mouvement premier, à savoir, la lutte économique des ouvriers qui l’engendrerait. Elle serait en outre d’une nature fondamentalement passive par rapport aux luttes économiques, qui seront 1’élément actif. La conception de Lénine restitue à la conscience socialiste et au Parti qui la matérialise leur caractère de facteur et de principe essentiellement actifs. Elle ne la détache pas mais l’inclut dans la vie et dans le mouvement.
7. La difficulté fondamentale de la révolution socialiste réside dans cette situation complexe et contradictoire : d’une part la révolution ne peut se réaliser qu’en tant quaction CONSCIENTE de la GRANDE MAJORITE de la classe ouvrière, d’autre part cette prise de conscience se heurte aux conditions qui sont faites aux ouvriers dans la société capitaliste, conditions qui empêchent et détruisent sans cesse la prise de conscience par les ouvriers de leur mission historique révolutionnaire. Cette difficulté ne peut absolument pas être surmontée uniquement par la propagande théorique indépendamment de la conjoncture historique. Mais moins encore que dans la propagande pure, la difficulté ne saurait trouver la condition de sa solution par les luttes économiques des ouvriers. Laissées à leur propre développement interne, les luttes des ouvriers contre les conditions d’exploitation capitaliste peuvent mener tout au plus à des explosions de révolte, c’est- à-dire à des réactions négatives mais qui sont absolument insuffisantes pour leur action positive de transformation sociale, uniquement possible par la conscience des finalités du mouvement. Ce facteur ne peut être que cet élément politique de la classe qui tire sa substance théorique, non des contingences et du particularisme de la position économique des ouvriers, mais du mouvement des possibilités et des nécessités historiques. Seule 1’intervention de ce facteur permet à la classe de passer du plan de la réaction négative au plan de 1’action positive, de la révolte à la révolution.
8. Mais il serait absolument erroné de vouloir substituer ces organismes, manifestations de la conscience et de 1’existence de la classe, à la classe elle-même et ne considérer la classe que comme une masse informe destinée à servir de matériau à ces organismes politiques. Cela serait substituer une conception militariste à la conception révolutionnaire du rapport entre la conscience et l’être, entre le parti et la classe. La fonction historique du parti n’est pas d’être un État-Major dirigeant 1!’action de la classe considérée comme une armée, et comme elle ignorant le but final, les objectifs immédiats des opérations, et le mouvement “d’ensemble des manœuvres”. La révolution socialiste n’est en rien comparable à l’action militaire. Sa réalisation est conditionnée par la conscience qu’ont les ouvriers eux-mêmes dictant leur décision et actions propres.
Le Parti n’agit donc pas à la place de la classe. Il ne réclame pas la “confiance” dans le sens bourgeois du mot, c’est-à-dire d’être une délégation à qui est confié le sort - et la destinée - de la société. Il a uniquement pour fonction historique d’agir en vue de permettre à la classe d’acquérir elle- même la conscience de sa mission, de ses buts et des moyens qui sont les fondements de son action révolutionnaire.
9. Avec la même vigueur que doit être combattue cette conception du Parti État-Major, agissant pour le compte et à la place de la classe, doit également être rejetée cette autre conception qui, partant du fait que “l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes” (Adresse Inaugurale de la première Internationale) prétend nier le rôle du militant et du parti révolutionnaire. Sous le prétexte très louable de ne pas imposer leur volonté aux ouvriers, ces militants s’esquivent de leur tâche, fuient leur propre responsabilité et mettent les révolutionnaires à la queue du mouvement ouvrier.
Les premiers se mettent en dehors de la classe, en la niant et en se substituant à elle, les seconds se mettent non moins en dehors d’elle, en niant la fonction propre à l’organisation de classe qu’est le parti, en se niant comme facteur révolutionnaire et en s’excluant par l’interdiction qu’ils jettent sur leur propre action.
10. Une correcte conception des conditions de la révolution socialiste doit partir des éléments suivants et les englober :
a. Le socialisme n’est une nécessité que du fait que le développement atteint par les forces de production n’est plus compatible avec une société divisée en classes.
b. Cette nécessité ne peut devenir réalité que par la volonté et l’action consciente de la classe opprimée, dont la libération sociale se confond avec la libération de l’humanité de son aliénation aux forces de production auxquelles elle a été assujettie jusqu’à ce jour.
c. Le socialisme étant à la fois nécessité objective et volonté subjective, il ne peut s’exprimer que dans L’ACTION révolutionnaire consciente de sa finalité.
d. L’action révolutionnaire est inconcevable en dehors d’un programme révolutionnaire. De même l’élaboration du programme est inséparable de l’action. Et c’est parce que le Parti révolutionnaire est un “corps de doctrine et une volonté d’action” (Bordiga) qu’il est la concrétisation la plus achevée de la conscience socialiste, et l’élément fondamental de sa réalisation.
11. La tendance à la constitution du Parti du prolétariat se fait dès la naissance de la société capitaliste. Mais tant que les conditions historiques pour le socialisme ne sont pas suffisamment développées, l’idéologie du prolétariat comme la construction du Parti ne peuvent que rester au stade embryonnaire. Ce n’est qu’avec la “Ligue des Communistes” qu’apparaît pour la première fois un type achevé d’organisation politique du prolétariat.
Quand on examine de près le développement de la constitution des partis de classe, il apparaît immédiatement le fait que l’organisation en partis ne suit pas une progression constante, mais au contraire enregistre des périodes de grand développement alternant avec d’autres pendant lesquelles le Parti disparaît. Ainsi l’existence organique du Parti ne semble pas dépendre uniquement de la volonté des individus qui le composent. Ce sont les situations objectives qui conditionnent son existence. Le parti étant essentiellement un organisme d’action révolutionnaire de la classe, il ne peut exister que dans des situations où l’action de la classe se fait jour. En absence de conditions d’action de classe des ouvriers (stabilité économique et politique du capitalisme, ou à la suite de défaites profondes des luttes ouvrières), le parti ne peut subsister. Il se disloque organiquement ou bien il est obligé pour subsister, c’est-à-dire pour exercer une influence, de s’adapter aux conditions nouvelles qui nient l’action révolutionnaire, et alors le Parti inévitablement se remplit d’un contenu nouveau. Il devient-conformiste, c1est-à-dire qu’il cesse d’être le parti de la dévolution.
Marx, mieux que tout autre a compris le conditionnement de l’existence du Parti. A deux reprises, il se fait l’artisan de la dissolution de la grande organisation, en 1851- au lendemain de la défaite de la révolution et du triomphe de la réaction en Europe, une seconde fois en 1873 après la défaite de la Commune de Paris, il se prononce franchement pour la dissolution. La première fois, de la Ligue des Communistes, et la seconde fois, de la première Internationale.
La tâche de l’heure pour les militants révolutionnaires
12. L’expérience de la deuxième Internationale confirme l’impossibilité de maintenir au prolétariat son parti dans une période prolongée d’une situation non révolutionnaire. La participation finale des partis de la deuxième Internationale à la guerre impérialiste de 1914 n’a fait que révéler la longue corruption de 1’organisation. La perméabilité et pénétrabilité, toujours possibles, de l’organisation politique du prolétariat par l’idéologie de la classe capitaliste régnante, prennent dans des périodes prolongées de stagnation et de reflux de la lutte de classe, une ampleur telle que l’idéologie de la bourgeoisie finit par se substituer à celle du prolétariat, qu’inévitablement le parti se vide de son contenu de classe primitif pour devenir l’instrument de classe de l’ennemi.
L’histoire des partis communistes de la troisième Internationale a de nouveau démontré l’impossibilité de sauvegarder le parti dans une période de reflux révolutionnaire et sa dégénérescence dans une telle période.
13. Pour ces raisons, la constitution de partis, celle d’une Internationale par les trotskystes depuis 1935 et la constitution récente d’un Parti Communiste Internationaliste en Italie, tout en étant des formations artificielles, ne peuvent être que des entreprises de confusion et d’opportunisme. Au lieu d’être des moments de la constitution du futur Parti de classe, ces formations sont des obstacles et le discréditent par la caricature qu’elles présentent. Loin d’exprimer une maturation de la conscience, et un dépassement de 1’ancien programme qu’elles transforment en dogmes, elles ne font que reproduire l’ancien programme et se font prisonnières de ces dogmes. Rien d’étonnant que ces formations reprennent les positions arriérées et dépassées de 1:ancien Parti en les aggravant encore, comme la tactique du parlementarisme, syndicalisme, etc. ...
14. Mais la rupture de l’existence organisationnelle du Parti ne signifie pas une rupture dans le développement de l’idéologie de classe. Les reflux révolutionnaires signifient en premier lieu l’immaturité du programme révolutionnaire. La défaite est le signal de la nécessité de réexamen critique de positions programmatiques antérieures, et l’obligation de son dépassement sur la base de l’expérience vivante de la lutte.
Cette œuvre critique positive d’élaboration programmatique se poursuit au travers des organismes émanant de l’ancien Parti. Ils constituent l’élément actif dans la période de recul pour la constitution du futur parti dans une période d’un nouveau flux révolutionnaire. Ces organismes, ce sont les groupes ou fractions de gauche issus du parti après sa dissolution organisationnelle ou son aliénation idéologique. Telles furent : la Fraction de Marx dans la période allant de la dissolution de la Ligue à la constitution de la première Internationale, les courants de gauche dans la deuxième Internationale (pendant la Première Guerre mondiale) et qui ont donné naissance aux nouveaux partis et Internationale en 1919 ; tels sont les fractions de gauche et les groupes qui poursuivent leur travail révolutionnaire depuis la dégénérescence de la troisième Internationale. Leur existence et leur développement sont la condition de l’enrichissement du programme de la révolution et de la reconstruction du parti de demain.
15. L’ancien parti une fois happé et passé au service de la classe ennemie cesse définitivement d’être un milieu où s’élabore et chemine la pensée révolutionnaire, et où peuvent se former des militants du prolétariat. Aussi c’est ignorer le fondement de la notion de parti que d’escompter sur des courants venant de la social-démocratie ou du stalinisme, pour servir de matériaux de construction du nouveau parti de classe. Les trotskystes adhérant aux partis de la deuxième Internationale ou poursuivant 1’hypocrite pratique du noyautage en direction de ces partis, afin de susciter dans ces milieux anti-prolétariens des courants “révolutionnaires” avec qui ils veulent constituer le nouveau parti du prolétariat, montrent par là qu’eux-mêmes ne sont qu’un courant mort, expression d’un mouvement passé et non d’avenir.
De même que le nouveau Parti de la révolution ne peut se constituer sur la base d’un programme dépassé par les événements, de même il ne peut se construire avec des éléments qui restent organiquement attachés à des organismes qui ont cessé à jamais d’être de la classe ouvrière.
16. L’histoire du mouvement ouvrier n’a jamais connu de période plus sombre et un recul plus profond de la conscience révolutionnaire que la période présente. Si l’exploitation économique des ouvriers apparaît comme condition absolument insuffisante pour la prise de conscience de leur mission historique, il s’avère que cette prise de conscience est infiniment plus difficile que ne 1e pensaient les militants révolutionnaires. Peut-être faut-il pour que le prolétariat puisse se ressaisir, que l’humanité connaisse le cauchemar de la Troisième Guerre mondiale et l’horreur du monde en chaos, et que le prolétariat se trouve d’une façon tangible placé dans le dilemme : mourir ou se sauver par la révolution, pour qu’il trouve la condition de son ressaisissement et de sa conscience.
17. Il ne nous appartient pas dans le cadre de cette thèse de rechercher les conditions précises qui permettront la prise de conscience du prolétariat, ni quelles seront les données de groupement et d’organisation unitaire que se donnera le prolétariat pour son combat révolutionnaire. Ce que nous pouvons avancer à ce sujet, et que l’expérience des trente dernières années nous autorise à affirmer, d’une façon catégorique, c’est que ni les revendications économiques, ni toute la gamme des revendications dites “démocratiques” (parlementarisme, droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, etc...) ne peuvent servir de fondement à l’action historique du prolétariat. Pour ce qui concerne les formes d’organisation, il apparaît avec encore plus d’évidence que ce ne pourront pas être les syndicats, avec leur structure verticale, professionnelle, corporatiste. Toutes ces formes d’organisation devront être reléguées au musée de l’histoire et appartiennent au passé du mouvement ouvrier. Mais dans la pratique elles doivent être absolument abandonnées et dépassées. Les nouvelles organisations devront être unitaires, c’est-à-dire englober la grande majorité des ouvriers et dépasser le cloisonnement particulariste des intérêts professionnels. Leur fondement sera le plan social, leur-structure la localité. Les conseils ouvriers, tels qu’ils ont surgi en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne, apparaissent comme le type nouveau d’organisation unitaire de la classe, c’est dans ce type de conseils ouvriers et non dans un rajeunissement des syndicats que les ouvriers trouveront le forme la plus appropriée de leur organisation.
Mais quelles que soient les formes nouvelles d’organisation unitaire de la classe, elles ne changent en rien le problème de la nécessité de l’organisme politique qu’est le Parti, ni le rôle décisif qu’il a à jouer. Le parti restera le facteur conscient de l’action de classe. Il est la force motrice idéologique indispensable à 1’action révolutionnaire du prolétariat. Dans l’action sociale il joue un rôle analogue à l’énergie dans la production. La reconstruction de cet organisme de classe est à la fois conditionnée par une tendance se faisant jour dans la classe ouvrière de rupture avec l’idéologie capitaliste et s’engageant pratiquement dans une lutte contre le régime existant en même temps que cette reconstruction est une condition d’accélération et d’approfondissement de cette lutte et la condition déterminante de son triomphe.
18. On ne saurait déduire du fait de l’inexistence, dans la période présente, des conditions requises pour la construction du parti, à l’inutilité ou à l’impossibilité de toute activité immédiate des militants révolutionnaires. Entre “l’activisme” creux des faiseurs de partis, et l’isolement individuel, entre un aventurisme et un pessimisme impuissants, le militant ne saurait faire un choix, mais les combattre comme étant également étrangers à l’esprit révolutionnaire et nuisibles à la cause de la révolution. Rejetant également la conception volontariste de l’action militante qui se présente comme l’unique facteur déterminant le mouvement de la classe et la conception mécaniste du parti, simple reflet du passif du mouvement, le militant doit considérer son action comme un des facteurs qui, dans l’interaction avec les autres facteurs, conditionne et détermine l’action de la classe. C’est en partant de cette conception que le militant trouve le fondement de la nécessité et de la valeur de son activité, en même temps que la limite de ses possibilités et de sa portée. Adapter son activité aux conditions de la conjoncture présente, c’est le seul moyen de la rendre efficiente et féconde.
19. La volonté de construire, en toute hâte et à tout prix, le nouveau parti de classe, en dépit des conditions objectives défavorables et en les violentant, relève à la fois d’un volontarisme aventuriste et infantile et d’une fausse appréciation de la situation et de ses perspectives immédiates, et finalement d’une totale méconnaissance de la notion de parti et des rapports entre le parti et la classe. Aussi, toutes ces tentatives sont fatalement vouées à l’échec, ne réussissant dans les meilleurs des cas qu’à créer des groupements opportunistes se traînant dans les sillages des grands partis de la deuxième et de la troisième Internationales. La seule raison qui justifie alors leur existence n’est plus que le développement en leur sein d’un esprit de chapelle et de secte.
Ainsi toutes ces organisations sont non seulement happées dans leur positivité par leur “activisme” immédiat dans 1’engrenage de l’opportunisme mais encore produisent dans leur négativité un esprit borné propre à des sectes, un patriotisme de clocher, un attachement craintif et superstitieux à ses “chefs”, à la reproduction caricaturale du jeu des grandes organisations, à la déification de règles d’organisation et à la soumission a une discipline “librement consentie” d’autant plus tyrannique et plus intolérable qu’elle est en proportion inverse du nombre.
Dans son double aboutissement, la construction artificielle et prématurée du parti conduit à la négation de la construction de l’organisme politique de la classe, à la destruction des cadres et à la perte, à échéance plus ou moins brève mais certaine, du militant, usé, épuisé, dans le vide et complètement démoralisé.
20. La disparition du Parti, soit par son rétrécissement et sa dislocation organisationnelle comme ce fut le cas pour la première Internationale, soit par son passage au service du capitalisme comme ce fut le cas pour les partis des deuxième et troisième Internationales, exprime dans l’un et l’autre cas la fin d’une période dans la lutte révolutionnaire du prolétariat. La disparition du parti est alors inévitable et aucun volontarisme ou la présence d’un chef plus ou moins génial ne saurait l’en empêcher.
Marx et Engels ont vu à deux reprises l’organisation du prolétariat, à la vie de laquelle ils ont pris part de façon prépondérante, se briser et mourir. Lénine et Luxembourg ont assisté impuissants à la trahison des grands partis sociaux-démocrates. Trotsky et Bordiga n’ont rien pu transformer de la dégénérescence des partis communistes et leur transformation en une monstrueuse machine du capitalisme que nous connaissons depuis.
Ces exemples nous enseignent, non pas l’inanité du Parti comme le prétend une analyse superficielle et fataliste, mais seulement que cette nécessité qu’est le Parti de la classe n’a pas une existence basée sur une ligne uniformément continue et ascendante, que son existence même n’est pas toujours possible, que son développement et son existence sont en correspondance et étroitement liés à la lutte de classe du prolétariat, qui lui donne naissance et qu’il exprime. C’est pourquoi la lutte des militants révolutionnaires au sein du parti au cours de sa période de dégénérescence et avant sa mort en tant que parti ouvrier a un sens révolutionnaire, mais non celui vulgaire que lui ont donné les diverses oppositions trotskystes. Pour ces dernières, il s’agissait de redressements, et pour redresser il fallait avant tout que l’organisation et son unité ne soient pas mises en péril. Il s’agissait pour eux de maintenir 1’organisation dans sa splendeur passée alors que précisément les conditions objectives ne le permettaient pas et que la splendeur de l’organisation ne pouvait se maintenir qu’au prix d’une altération constante et croissante, de sa nature révolutionnaire et de classe. Ils cherchaient dans des mesures organisationnelles les remèdes pour sauver l’organisation, sans comprendre que l’effondrement organisationnel est toujours l’expression et le reflet d’une période de reflux révolutionnaire et souvent la solution de loin préférable à sa survivance et qu’en tout cas ce que les révolutionnaires avaient à sauver c’était non 1’organisation mais l’idéologie de la classe risquant de sombrer dans l’effondrement de l’organisation.
Ne comprenant pas les causes objectives de l’inévitable perte de l’ancien parti, on ne pouvait comprendre la tâche des militants dans cette période. De l’échec de la sauvegarde de l’ancien parti à la classe, on concluait à la nécessité de construire dans l’immédiat un nouveau parti. L’incompréhension ne faisait que se doubler d’un aventurisme, le tout basé sur une conception volontariste du parti.
Une étude correcte de la réalité fait comprendre que la mort de 1’ancien parti implique précisément l’impossibilité immédiate de construire un nouveau parti ; elle signifie l’inexistence dans la période présente des conditions nécessaires pour 1’existence de tout parti, aussi bien ancien que nouveau.
Dans une telle période, seuls peuvent subsister des petits groupes révolutionnaires assurant une solution de continuité moins organisationnelle qu’idéologique, condensant en leur sein l’expérience passée du mouvement et de la lutte de la classe, présentant le trait d’union entre le parti d’hier et celui de demain, entre le point culminant de la lutte et de la maturité de la conscience de classe dans la période de flux passé vers son dépassement dans la nouvelle période de flux dans l’avenir. Dans ces groupes se poursuit la vie idéologique de la classe, l’autocritique de ses luttes, le réexamen critique de ses idées antérieures, l’élaboration de son programme, la maturation de sa conscience et la formation de nouveaux cadres de militants pour la prochaine étape de son assaut révolutionnaire.
21. La période présente que nous vivons est le produit, d’une part de la défaite de la première grandiose vague révolutionnaire du prolétariat international qui a mis fin à la Première Guerre impérialiste et qui a atteint son point culminant dans la révolution d:Octobre 1917 en Russie et dans le mouvement spartakiste de 1918-19, d’autre part par des transformations profondes opérées dans la structure économico-politique du capitalisme évoluant vers sa forme ultime et décadente, le capitalisme d’État. Au surplus, un rapport dialectique existe entre cotte évolution du capitalisme et la défaite de la révolution.
Malgré leur combativité héroïque, malgré la crise permanente et insurmontable du système capitaliste et l’aggravation inouïe et croissante des conditions de vie des ouvriers, le prolétariat et son avant-garde ne purent tenir tête à la contre-offensive du capitalisme. Ils ne trouvèrent pas face à eux le capitalisme classique et furent surpris par ses transformations posant des problèmes auxquels ils n’étaient pas préparés ni théoriquement ni politiquement. Le prolétariat et son avant-garde qui, longtemps et couramment, avaient confondu capitalisme et possession privée des moyens de production, socialisme et étatisation, se sont trouvés déroutés et désemparés devant les tendances du capitalisme moderne à la concentration étatique de l’économie et à sa planification. Dans leur immense majorité, les ouvriers se sont laissé gagner à l’idée que cette évolution présentait un mode de transformation original de la société du capitalisme vers le socialisme. Ils se sont associés à cette œuvre, ils ont abandonné leur mission historique et sont devenus les artisans les plus surs de la conservation de la société capitaliste.
Ce sont là les raisons historiques qui donnent au prolétariat sa physionomie actuelle. Tant que ces conditions prévaudront, tant que l’idéologie de capitalisme d’État dominera le cerveau des ouvriers, il ne saurait être question de reconstruction du parti de classe. Ce n’est que lorsqu’au travers des cataclysmes sanglants qui jalonnent la phase du capitalisme d’État, le prolétariat aura saisi tout 1’abîme qui sépare le socialisme libérateur du monstrueux régime étatique actuel, quand il se manifestera en son sein une tendance croissante à se détacher de cette idéologie qui 1’emprisonne et 1’annihile, que la voie sera à nouveau ouverte à “l’organisation du prolétariat en classe, donc en parti politique”. Cette étape sera d’autant plus vite franchie et facilitée par le prolétariat que les noyaux révolutionnaires auront su faire l’effort théorique nécessaire pour répondre aux problèmes nouveaux posés par le capitalisme d’État et aider le prolétariat à retrouver sa solution de classe et les moyens pour sa réalisation.
22. Dans la période présente, les militants révolutionnaires ne peuvent subsister qu’en formant des petits groupes se livrant à un travail patient de propagande forcément limité dans son étendue, en même temps qu’à un effort acharné de recherches et de clarification théorique.
Ces groupes ne s’acquitteront de leur tâche que par la recherche de contacts avec d’autres groupes sur le plan national et international, sur la base des critères délimitatifs des frontières de classe. Seuls de tels contacts et leur multiplication en vue de la confrontation des positions et la clarification des problèmes permettront aux groupes et militants de résister physiquement et politiquement à la terrible pression du capitalisme dans la période présente et permettre à ce que tous les efforts soient une contribution réelle à la lutte émancipatrice du prolétariat.
Le Parti de demain
23. Le Parti ne saurait être une simple reproduction de celui d’hier. Il ne pourra être reconstruit sur un modèle idéal tiré du passé. Aussi bien que son programme, sa structure organique et le rapport qui s’établit entre lui et l’ensemble de la classe sont fondés sur une synthèse de l’expérience passée et des nouvelles conditions plus avancées de l’étape présente. Le Parti suit l’évolution de la lutte de classe et à chaque étape de l’histoire de celle-ci correspond un type propre de l’organisme politique du prolétariat.
À l’aube du capitalisme moderne, dans la première moitié du 19è Siècle, la classe ouvrière encore dans sa phase de constitution menant des luttes locales et sporadiques ne pouvait donner naissance qu’à des écoles doctrinaires, à des sectes et des ligues. La Ligue des Communistes était l’expression la plus avancée de cette période en même temps que son Manifeste et son Appel de “prolétaires de tous les pays, unissez-vous”, elle annonçait la période suivante.
La première Internationale correspond à l’entrée effective du prolétariat sur la scène des luttes sociales et politiques dans les principaux pays d’Europe. Aussi groupe-t-el1e toutes les forces organisées de la classe ouvrière, ses tendances idéologiques les plus diverses. La première Internationale réunit à la fois tous les courants et tous les aspects de la lutte ouvrière contingente : économiques, éducatifs, politiques et théoriques. Elle est au plus haut point L’ORGANISATION UNITAIRE de la classe ouvrière, dans toute sa diversité.
La deuxième Internationale marque une étape de différenciation entre la lutte économique des salariés et la lutte politique sociale. Dans cette période de plein épanouissement de la société capitaliste, la deuxième Internationale est l’organisation de la lutte pour des réformes et des conquêtes politiques, l’affirmation politique du prolétariat, en même temps qu’elle marque une étape supérieure dans la délimitation idéologique au sein du prolétariat, en précisant et élaborant les fondements théoriques de sa mission historique révolutionnaire.
La Première Guerre mondiale signifiait la crise historique du capitalisme et l’ouverture de sa phase de déclin. La révolution socialiste passa dès lors du plan de la théorie au plan de la démonstration pratique. Sous le feu des événements, le prolétariat se trouvait en quelque sorte forcé de construire hâtivement son organisation révolutionnaire de combat. L’apport programmatique monumental des premières années de la troisième Internationale s’est avéré cependant insuffisant et inférieur à l’immensité des problèmes à résoudre posés par cette phase ultime du capitalisme et de sa transition révolutionnaire. En même temps, l’expérience a vite démontré l’immaturité idéologique générale de l’ensemble de la classe. Devant ces deux écueils, et sous la pression des nécessités surgies des événements et de leur rapidité, la troisième Internationale était amenée à répondre par des mesures organisationnelles : la discipline de fer des militants, etc...
L’aspect organisationnel devant suppléer 1’inachèvement programmatique et le parti à l’immaturité de la classe aboutissaient à la substitution du parti à l’action de la classe elle-même et à l’altération de la notion du parti et des rapports de celui-ci avec la classe.
24. Sur la base de cette expérience, le futur parti aura pour fondement le rétablissement de cette vérité que : la révolution si elle contient un problème d’organisation n’est cependant pas une question d’organisation. La révolution est avant tout un problème idéologique de maturation de la conscience dans les larges masses du prolétariat.
Aucune organisation, aucun parti ne peut se substituer à la classe elle-même, car plus que jamais il reste vrai que “l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes”. Le parti qui est la cristallisation de la conscience de la classe n’est ni différent ni synonyme de la classe. Le parti reste nécessairement une petite minorité ; son ambition n’est pas la plus grande force numérique. À aucun moment il ne peut ni se séparer, ni remplacer l’action vivante de la classe. Sa fonction reste celle d’inspiration idéologique au cours du mouvement et de l’action de la classe.
25. Au cours de la période insurrectionnelle de la révolution, le rôle du parti n’est pas de revendiquer le pouvoir pour lui, ni de demander aux masses de lui faire “confiance”. II intervient et développe son. activité en vue de l’auto-mobilisation de la classe à l’intérieur de laquelle il tend à faire triompher les principes et les moyens d’action révolutionnaires.
La mobilisation de la classe autour du parti à qui elle “confie” ou plutôt abandonne la direction est-une conception reflétant un état d’immaturité de la classe. L’expérience a montré que, dans de telles conditions, la révolution se trouve finalement dans l’impossibilité de triompher et doit rapidement dégénérer en entraînant un divorce entre la classe et le parti. Ce dernier se trouve rapidement dans 1’obligation de recourir de plus en plus à des moyens de coercition pour s’imposer à la classe et devient ainsi un obstacle redoutable pour la marche en avant de la révolution.
Le parti n’est pas un organisme de direction et d’exécution, ces fonctions appartenant en propre à l’organisation unitaire de: la classe. Si les militants du parti, participent à ces fonctions, c’est en tant que membres de la grande communauté du prolétariat.
26. Dans la période postrévolutionnaire, celle de la dictature du prolétariat, le parti n’est pas le parti unique, classique des régimes totalitaires. Ce dernier se caractérise par son identification et son assimilation avec le pouvoir étatique dont il détient le monopole. Au contraire, le parti de classe du prolétariat se caractérise en ce qu’il se distingue de l’État en face de qui il présente l’antithèse historique. Le parti unique totalitaire tend à s’enfler et à incorporer des millions d’individus pour en faire l’élément physique de sa domination et de son oppression. Le parti du prolétariat au contraire, de par sa nature, reste une sélection idéologique sévère, ses militante n’ont pas d’avantages à conquérir ou à défendre. Leur privilège est d’être seulement les combattants les plus clairvoyants et les plus dévoués à la cause révolutionnaire. Le parti ne vise donc pas à incorporer en son sein de larges masses car, au fur et à mesure que son idéologie deviendra celle des larges masses, la nécessité de son existence tendra à disparaître et l’heure de sa dissolution commencera à sonner.
Régime intérieur du parti
27. Les problèmes concernant les règles d’organisation qui constituent le régime intérieur du parti occupent une place aussi décisive que son contenu programmatique. L’expérience passée et plus particulièrement celle des partis de la troisième Internationale ont montré que la conception du parti constitue un tout unitaire. Les règles organisationnelles sont un aspect et une manifestation de cette conception. Il n’y a pas une question d’organisation séparée de l’idée qu’on a sur le rôle et la fonction du parti et du rapport de celui-ci avec la classe. Aucune de ces questions n’existe en soi, mais constitue des éléments constitutifs et expressifs du tout.
Les partis de la troisième Internationale avaient telles règles ou tels régimes intérieure parce qu’ils se sont constitués dans une période d’immaturité évidente de la classe, ce qui les a amenés à substituer le parti à la classe, 1’organisation a la conscience, la discipline à la conviction.
Les règles organisationnelles du futur parti devront donc être fonction d’une conception renversée du rôle du parti, dans une étape plus avancée de la lutte, reposant sur une maturité idéologique plus grande de la classe.
28. Les questions du centralisme démocratique ou organique qui occupèrent une place prépondérante dans la troisième Internationale perdront de leur acuité pour le futur parti. Quand l’action de la classe reposait sur l’action du parti, la question de l’efficacité pratique maxima de cette dernière devait nécessairement dominer le parti, qui d’ailleurs ne pouvait apporter que des solutions fragmentaires.
L’efficacité de l’action du parti ne consiste pas dans son action pratique de direction et d’exécution, mais dans son action idéologique. La force du parti ne repose donc pas sur la soumission disciplinaire des militants mais sur leur connaissance, leur développement idéologique plus grand, leurs convictions plus sures.
Les règles de l’organisation ne découlent pas des notions abstraites, hissées à la hauteur des principes immanents et immuables, démocratie ou centralisme. De tels principes sont vides de sens. Si la règle de décisions prises à la majorité (démocratie) apparaît, à défaut d’une autre, plus appropriée, être la règle à maintenir, cela ne signifie nullement que par définition la majorité possède la vertu d’avoir le monopole de la vérité et des positions justes. Les positions justes découlent de la plus grande connaissance de l’objet, de la plus grande pénétration et du serrement plus étroit de la réalité.
Aussi les règles intérieures de l’organisation sont fonction de l’objectif que se donne et qui est celui du parti. Quelle que soit l’importance de l’efficacité de son action pratique immédiate, qui peut lui donner l’exercice d’une discipline plus grande, elle demeure toujours moins importante que l’épanouissement maxima de la pensée des militants et en conséquence lui est subordonnée.
Tant que le Parti reste le creuset où s’élabore et s’approfondit 1’idéologie de la classe, il a pour règle, non seulement la liberté la plus grande des idées et des divergences dans le cadre de ses principes programmatiques, mais a pour fondement le souci de favoriser et d’entretenir sans cesse la combustion de la pensée, en fournissant les moyens pour la discussion et la confrontation des idées et des tendances en son sein.
29. Vue sous cet angle, rien n’est aussi étranger à la conception du Parti que cette monstrueuse conception d’un parti homogène monolithique et monopoliste.
L’existence de tendances et de fractions au sein du parti n’est pas tolérance, un droit pouvant être accordé, donc sujet à discussion.
Au contraire, l’existence des courants dans le Parti - dans le cadre des principes acquis et vérifiés - est une des manifestations d’une conception saine de la notion du Parti.
Juin 1948, Marco.
1. Aujourd’hui encore nous partageons le fond de l’ensemble des idées présentes dans ce texte et souvent même nous les soutenons à la lettre. C’est le cas en particulier du rôle politique fondamental et irremplaçable du parti du prolétariat pour la victoire de la révolution, mais l’expression suivante du texte ne permet pas au mieux de rendre compte de la dynamique de développement de la lutte de classe et des relations entre la classe et le parti : "Laissées à leur propre développement interne, les luttes des ouvriers contre les conditions d’exploitation capitaliste peuvent mener tout au plus à des explosions de révolte". En effet, le rôle des révolutionnaires doit ici être précisé. Il n'est pas d’apporter la conscience aux ouvriers mais d’approfondir et accélérer le développement de celle-ci dans ses rangs. Pour d’avantage d’éléments concernant notre position sur le sujet, nous renvoyons le lecteur aux articles suivants : "Le communisme n’est pas un bel idéal, il est à l’ordre du jour de l’histoire [1° partie]" dans la Revue internationale n° 90 ; "Question d’organisation ; sommes-nous devenus "léninistes"?" dans les n° 96 et 97 de la Revue internationale ; "1903-1904 : la naissance du bolchevisme (III). La polémique entre Lénine et Rosa Luxembourg" dans la Revue internationale n° 118.
Par ailleurs, nous signalons que nous avons tenté d’améliorer la lisibilité de la republication de cet article d’Internationalisme en corrigeant des coquilles ou des petites erreurs grammaticales et en introduisant des intertitres.
2. La même réflexion théorique sous-tend un autre article, “Les tâches de l’heure”, publié dans Internationalisme en 1946 et réédité dans la Revue internationale n°32 (https://fr.internationalism.org/rinte32/Internationalisme_1947_parti_ou_... [485])
3. C’est ce qu’il est advenu de tous les courants du socialisme utopique qui, devenus des écoles, ont perdu leur aspect révolutionnaire pour se transformer en forces conservatives actives. Voir le Proudhonisme, le Fouriérisme, le coopérativisme, le réformisme et le socialisme d’État.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [487]
Rubrique:
La guerre d'Espagne met en évidence les lacunes fatales de l'anarchisme (I)
- 1543 lectures
Première partie : Programme et pratique
L'article précédent de la série nous a conduits dans le travail du mouvement révolutionnaire alors que celui-ci sortait de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons montré comment, malgré cette catastrophe, les meilleurs éléments du mouvement marxiste ont continué à se maintenir sur la perspective du communisme. Leur conviction dans cette perspective n'avait pas disparu même si la Guerre mondiale n'avait pas, contrairement à ce que beaucoup de révolutionnaires avaient prédit, provoqué un nouveau surgissement du prolétariat contre le capitalisme et malgré aussi le fait que celle-ci avait aggravé la défaite déjà terrible qui s'était abattu sur la classe ouvrière dans les années 1920 et 1930. Nous nous sommes concentrés en particulier sur les travaux de la Gauche Communiste de France, qui était probablement la seule organisation à comprendre que les tâches de l'heure demeuraient celles d'une fraction, pour préserver et approfondir les acquis théoriques du marxisme afin de construire un pont vers les futurs mouvements prolétariens qui créeraient les conditions pour la reconstitution d'un réel parti communiste. Cela avait été le projet des fractions de gauche italienne et belge avant la guerre, même si une partie importante de cette gauche communiste internationale avait perdu de vue cela avec l'euphorie de courte durée suite à la reprise des luttes ouvrières en Italie en 1943 et la fondation du parti communiste internationaliste en Italie.
Dans le cadre de cet effort pour développer le travail des fractions de gauche avant la guerre, la GCF avait poursuivi le travail consistant à tirer les leçons de la révolution russe et à examiner les problèmes de la période de transition : la dictature du prolétariat, l'État de transition, le rôle du parti et l'élimination du mode de production capitaliste. Nous avons réédité et présenté la thèse de la GCF sur le rôle de l'État, destinée à servir de base pour des débats futurs sur la période de transition au sein du milieu révolutionnaire renaissant du début des années 1970.
Mais avant de procéder à une étude de ces débats, nous avons besoin de faire un retour en arrière sur une étape historique décisive de l'histoire du mouvement ouvrier : l'Espagne 1936-37. Comme nous allons l'argumenter, nous ne sommes pas de ceux qui voient dans ces événements un modèle de révolution prolétarienne étant allé beaucoup plus loin que n'importe point atteint en Russie en 1917-21. Mais cela ne fait aucun doute que la guerre en Espagne nous a appris beaucoup de choses, même si la plupart de ses leçons sont en négatif. En particulier, elle nous offre un aperçu très important des insuffisances de la vision anarchiste de la révolution et une réaffirmation frappante de la vision qui a été préservée et développée par les traditions authentiques du marxisme. Ceci est particulièrement important à souligner compte tenu du fait que, durant les dernières décennies, ces traditions ont souvent été décriées comme étant obsolètes et démodées et que, parmi la minorité politisée de la génération actuelle, les idées anarchistes sous diverses formes ont acquis une influence indéniable.
Cette série a toujours été basée sur la conviction que seul le marxisme fournit une méthode cohérente pour comprendre ce qu'est le communisme et sa nécessité et, en s'appuyant sur l'expérience historique de la classe ouvrière, qu'il est aussi une possibilité réelle et pas seulement le souhait d'un monde meilleur. C'est pourquoi une grande partie de cette série a été reprise avec l'étude des avancées et des erreurs de l'aile marxiste du mouvement ouvrier dans son effort pour comprendre et élaborer le programme communiste. Pour la même raison, elle s'est penchée à certains moments sur les tentatives du mouvement anarchiste pour développer sa vision de la future société. Dans l'article "Anarchisme ou communisme" 1, nous soulignons que la vision anarchiste puise ses origines historiques dans la résistance des couches de la petite bourgeoisie, comme les artisans et petits paysans, au processus de prolétarisation, qui était un produit inévitable de l'émergence et de l'expansion du mode de production capitaliste. Bien qu'un certain nombre de courants anarchistes fassent clairement partie du mouvement ouvrier, aucun d'entre eux n'a réussi à effacer entièrement ces marques de naissance petites-bourgeoises. L'article en question montre comment, dans la période de la Première internationale, cette idéologie essentiellement tournée vers le passé sous-tendait la résistance du clan autour de Bakounine aux avancées théoriques du marxisme à trois niveaux cruciaux : dans la conception de l'organisation des révolutionnaires, qui a été profondément infectée par les méthodes conspiratrices des sectes dépassées ; dans le rejet du matérialisme historique en faveur d'une conception volontariste et idéaliste des possibilités de la révolution ; et dans la conception de la future société, considérée comme un réseau de communes autonomes reliées entre elles par l'échange des marchandises.
Néanmoins, avec le développement du mouvement ouvrier dans la dernière partie du XIXe siècle, les tendances les plus importantes de l'anarchisme tendent à s'intégrer plus fermement dans la lutte du prolétariat et la perspective d'une nouvelle société, et c'est particulièrement vrai du courant anarcho-syndicaliste (bien que, dans le même temps, la dimension de l'anarchisme en tant qu'expression de la révolte de la petite bourgeoisie ait continué de vivre à travers les "actes exemplaires" de la bande à Bonnot et autres) 2. La réalité de cette tendance prolétarienne a été démontrée dans la capacité de certains courants anarchistes à prendre des positions internationalistes face à la Première Guerre mondiale (et, dans une moindre mesure, la Seconde) et dans la volonté d'élaborer un programme plus clair pour leur mouvement. Ainsi, la période de la fin du XIXe siècle aux années 1930 a vu plusieurs tentatives visant à élaborer des documents et des plates-formes à même d'orienter la mise en place du "communisme libertaire" au moyen de la révolution sociale. Un exemple évident en a été La conquête du pain de Kropotkine qui, d'abord, est paru comme une œuvre intégrale en Français en 1892 et a été publié, plus d'une décennie plus tard, en anglais 3. Malgré l'abandon par Kropotkine de l'internationalisme en 1914, cet écrit et d'autres dont il est l'auteur font partie des classiques de l'anarchisme et méritent une critique beaucoup plus développée qu'il n'est possible de le faire dans cet article.
En 1926 Makhno, Arshinov et d'autres publient la plateforme de l'Union générale des anarchistes 4. Il s'agit de l'acte fondateur du courant "plate-formiste" de l'anarchisme, et il appelle aussi à un examen plus approfondi, ainsi qu'à une analyse de sa trajectoire historique depuis la fin des années 1920 à nos jours. Son principal intérêt réside dans les conclusions qu'il tire de l'échec du mouvement anarchiste dans la révolution russe, en particulier l'idée que les révolutionnaires anarchistes doivent se regrouper dans leur propre organisation politique, basée sur un programme clair pour la mise en place de la nouvelle société. C'est cette idée en particulier qui a attiré les foudres d'autres anarchistes – pas moins que Voline et Malatesta - qui l'ont vue comme une expression d'une sorte d'anarcho-bolchevisme.
Dans cet article, cependant, nous nous intéressons d'avantage à la théorie et à la pratique de la tendance anarcho-syndicaliste durant les années 1930. Et ici encore il n'y aucune pénurie de matériel. Dans notre série la plus récente sur la décadence du capitalisme, publiée dans cette revue, nous avons mentionné le texte de l'anarcho-syndicaliste russe exilé Gregory Maximoff, Mon Credo Social. Écrit dans la profondeur de la grande dépression, il témoigne d'un degré remarquable de clarté sur la décadence du système capitaliste, un thème qui n'est presque jamais traité par les anarchistes d'aujourd'hui 5. Le texte contient également une section qui décrit les idées de Maximoff sur l'organisation de la nouvelle société. Durant cette période, il y avait aussi des débats importants dans l'anarcho-syndicalisme "International" créé en 1922 – l'Association Internationale des Travailleurs (AIT) - sur la façon de passer du capitalisme au communisme libertaire. Et sans doute l'écrit le plus pertinent a été la brochure d'Isaac Puente, Communisme libertaire. Publiée en 1932, elle était destinée servir de base à la plate-forme de la CNT lors du Congrès de Saragosse de 1936 et peut donc être considérée comme ayant influencé la politique de la CNT au cours de la "révolution espagnole" qui a suivi. Nous y reviendrons mais, tout d'abord, nous voulons examiner certains des débats de l'AIT, qui sont mis en évidence dans le travail très instructif de Vadim Damier, L'Anarcho-syndicalisme au XXe siècle 6.
Un des principaux débats – sans doute en réaction à la montée spectaculaire des techniques fordistes/tayloristes de production de masse dans les années 1920 – était centré sur la question de savoir si, oui ou non, ce type de rationalisation capitaliste, et bien sûr aussi l'ensemble du processus d'industrialisation, constituaient une expression du progrès, faisant ainsi de la société communiste libertaire une perspective plus tangible, ou simplement une intensification de l'asservissement de l'humanité par la machine. Différentes tendances ont apporté différentes nuances à cette discussion, mais grosso modo les anarchocommunistes se démarquaient en faveur de cette deuxième analyse et articulaient leur position avec un appel à un passage immédiat au communisme ; cela était considéré comme possible même - ou peut-être surtout – dans une société essentiellement agraire. La position alternative était plus généralement défendue par les tendances reliées à la tradition syndicaliste révolutionnaire, qui a eu une vision plus "réaliste" des possibilités offertes par la rationalisation capitaliste tout en faisant valoir, dans le même temps, qu'il y aurait la nécessité d'un certain type de régime de transition économique dans lequel les formes monétaires continueraient d'exister.
Ces divergences ont traversé diverses sections nationales (comme la FAUD allemande), mais la FORA 7 Argentine semble avoir eu une vision plus homogène qu'elle a défendue avec conviction, et elle a été à l'avant-garde des perspectives "anti-industrielles". Elle a rejeté ouvertement les prémices du matérialisme historique, au moins telles qu'elle les avait comprises (pour la plupart des anarchistes, le "marxisme" était un terme fourre-tout définissant quiconque se situait entre, d'une part, le stalinisme, la social-démocratie et, d'autre part, le trotskisme et la gauche communiste) en faveur d'une vision de l'histoire dans laquelle l'éthique et les idées n'avaient pas moins d'importance que le développement des forces productives. Elle a rejeté catégoriquement l'idée selon laquelle la nouvelle société pourrait être formée sur la base de l'ancienne, c'est pourquoi elle a critiqué non seulement le projet de construction du communisme libertaire sur les fondations de la structure industrielle existante, mais aussi le projet syndicaliste d'organiser les ouvriers dans les syndicats industriels qui, une fois venue la révolution, prendraient en charge cette structure et la dirigeraient au nom du prolétariat et de l'humanité. Elle a envisagé une nouvelle société organisée en une fédération de communes libres ; la révolution serait une rupture radicale avec toutes les formes anciennes et procéderait immédiatement au passage à l'étape de la libre association. Une déclaration du 5ème Congrès de la FORA en 1905 – qui, selon le récit d'Eduardo Columbo, allait devenir la base politique pour de nombreuses années – a mis en avant les critiques de la FORA à la forme syndicale : "Nous ne devons pas oublier qu'un syndicat n'est qu' un sous-produit économique du système capitaliste, né des besoins de cette époque. Le maintenir après la révolution impliquerait de maintenir le système qui l'a produit. La doctrine dite du syndicalisme révolutionnaire est une fiction. Nous, en tant qu'anarchistes, nous acceptons les syndicats comme des armes dans la lutte et nous essayons de faire en sorte qu'ils soient aussi proches que possible de nos idéaux révolutionnaires... C'est-à-dire, nous n'entendons pas être dominés au niveau des idées par les syndicats. Nous avons l'intention de les dominer. En d'autres termes, mettre les syndicats au service de la diffusion, de la défense et de l'affirmation de nos idées au sein du prolétariat" 8
Toutefois, les différences entre les "Foristes" et les syndicalistes à propos de la forme syndicale restaient plutôt obscures à bien des égards : d'une part, la FORA se concevait comme une organisation de travailleurs anarchistes plutôt que comme un syndicat "de tous les travailleurs" mais, d'autre part, elle avait émergé et se concevait comme une formation de type syndical organisant des grèves et autres formes d'action de classe.
Malgré la nature incertaine de ces divergences, celles-ci ont donné lieu à des confrontations animées lors du 4e Congrès de la CNT à Madrid en 1931, avec deux approches défendues principalement par la CGT-SR 9 française d'une part et par la FORA, d'autre part. Damier fait les remarques suivantes sur les visions de la FORA : "Les conceptions de la FORA contiennent une critique, brillante pour l'époque, du caractère aliénant et destructeur du système industriel-capitaliste : les propositions de la FORA anticipaient d'un demi-siècle les recommandations et les prescriptions du mouvement écologique contemporain. Néanmoins, leur critique présentait une faiblesse importante : un refus catégorique d'élaborer des notions plus concrètes sur la société de l'avenir, comment y accéder et comment s'y préparer. Selon la pensée des théoriciens argentins, cela aurait porté atteinte à la spontanéité révolutionnaire et à la créativité des masses elles-mêmes. Les ouvriers anarchistes argentins insistaient sur le fait que la réalisation du socialisme n'était pas une question de préparation technique et organisationnelle, mais plutôt la diffusion des sentiments de liberté, d'égalité et de solidarité" (Vadim Damier, "l'Anarcho-syndicalisme au XXe siècle" pp 110-11).
La perspicacité de la FORA concernant la nature des rapports sociaux capitalistes – comme ceux qui s'expriment dans la forme syndicale - sont certes intéressants, mais ce qui frappe une grande partie de ces débats est leur point de départ erroné, leur manque de méthode qui découle de leur rejet du marxisme ou même de l'absence de volonté pour discuter avec les courants marxistes authentiques de l'époque. La critique du matérialisme historique par la FORA ressemble plus à une critique d'une version rigidement déterministe du marxisme, typique de la deuxième Internationale et des partis staliniens. Encore une fois, elle a eu raison d'attaquer la nature aliénée de la production capitaliste et de récuser l'idée que le capitalisme était progressiste en lui-même - surtout dans une période où les relations sociales capitalistes avaient déjà prouvé qu'elles-mêmes étaient devenues un obstacle fondamental au développement humain ; mais leur rejet apparent de l'industrie en tant que telle était tout aussi abstrait et a abouti à une nostalgie passéiste pour les communes rurales locales.
Peut-être plus important a été l'absence de tout lien entre ces débats et des expériences parmi les plus importantes de la lutte de classes dans la nouvelle époque inaugurée par les grèves de masse en Russie en 1905 et la vague révolutionnaire internationale de 1917-23. Ces développements mondiaux et historiques, qui bien sûr incluent également la Première Guerre impérialiste, avaient déjà démontré l'obsolescence des formes anciennes d'organisation ouvrière (partis de masses et syndicats) et donné naissance à de nouvelles : d'un côté les soviets ou conseils ouvriers, constitués dans la chaleur de la lutte et non pas mis en place comme une structure préexistante à celle-ci ; de l'autre côté, l'organisation de la minorité communiste qui n'est plus considérée comme un parti de masse agissant principalement sur le terrain de la lutte pour les réformes. La formation des syndicats révolutionnaires ou industriels dans la dernière partie du XIXe siècle et dans les décennies qui suivirent a été en grande partie une tentative de la part d'une fraction radicale du prolétariat pour s'adapter à la nouvelle époque sans renoncer aux vieilles conceptions syndicalistes (et même sociale-démocrates) prônant la mise en place progressive d'une organisation de masse des travailleurs à l'intérieur du capitalisme, dans le but ultime de prise de contrôle de la société dans une phase de crise aiguë. La suspicion de la FORA envers l'idée de construire la nouvelle société dans la coquille de l'ancienne était justifiée. Cependant, sans aucune référence sérieuse à l'expérience de la grève de masse et de la révolution, dont la dynamique essentielle avait été brillamment analysée par Rosa Luxemburg dans "Grève de masse, parti et syndicats", écrit en 1906, ou aux nouvelles formes d'organisation que Trotsky, par exemple, avait reconnues comme étant un produit de la révolution de 1905 en Russie et d'une importance cruciale, la FORA retomba dans un espoir diffus d'une transformation soudaine et totale et semblait incapable d'examiner les liens réels entre les luttes défensives du prolétariat et la lutte pour la révolution.
La brochure Communisme libertaire de Isaac Puente
Dans les débats de 1931, la majorité de la CNT espagnole se rangea du côté des anarchosyndicalistes plus traditionnels. Mais les idées "communautaires" ont persisté et le programme de Saragosse de 1936, basé sur la brochure de Puente, contenait des éléments des deux.
La brochure de Puente 10 exprime clairement un point de vue prolétarien et son but ultime, le communisme "libertaire", est ce que nous appellerions simplement le communisme, une société fondée sur le principe, comme le dit Puente, "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". Dans le même temps, elle constitue une manifestation assez claire de la pauvreté théorique au cœur de la vision anarchiste du monde.
Un longue partie au début du texte est consacrée à argumenter contre tous les préjugés qui font valoir que les travailleurs sont ignorants et stupides, incapables de s'émanciper eux-mêmes, ayant du mépris pour la science, l'art et la culture, qu'ils ont besoin d'une élite intellectuelle, un architecte "social" ou un pouvoir policier, pour administrer la société en leur nom. Cette polémique est parfaitement justifiée. Et pourtant quand il écrit que "ce que nous appelons le sens commun, une compréhension rapide des choses, la capacité intuitive, l'initiative et l'originalité ne sont pas des choses qui peuvent être achetées ou vendues dans les universités", nous nous souvenons que la théorie révolutionnaire n'est pas simplement le bon sens, que ses propositions, étant dialectiques, sont généralement considérés comme outrageuses et absurdes du point de vue du "bon vieux sens commun" que Engels ridiculise dans Socialisme utopique et socialisme scientifique . La classe ouvrière n'a pas besoin d'éducateurs au-dessus d'elle pour s'affranchir du capitalisme, mais elle a absolument besoin d'une théorie révolutionnaire qui permet aller au-delà de la simple apparence et de comprendre les processus plus profonds à l'œuvre dans la société.
Les insuffisances de l'anarchisme à ce niveau se révèlent dans toutes les thèses principales présentées dans le texte de Puente. Au sujet des moyens qu'utilise la classe ouvrière pour confronter et renverser le capitalisme, Puente, à l'image des débats de l'AIT à l'époque, ne tient pas compte de toute la dynamique de la lutte des classes à l'époque de la révolution, qui émerge avec la grève de masse et le surgissement de la forme Conseil. Au lieu de voir que les organisations qui effectueront la transformation communiste expriment une rupture radicale avec les vieilles organisations de classe qui ont été incorporés dans la société bourgeoise, Puente insiste sur le fait que "le communisme libertaire repose sur les organisations qui existent déjà, grâce auxquelles la vie économique dans les villes et villages peut être développée à la lumière des besoins particuliers de chaque localité. Ces organismes sont le syndicat et la municipalité libre". C'est ici où Puente allie syndicalisme et communautarisme : dans les villes, les syndicats prendront le contrôle de la vie publique, à la campagne ce sera les assemblées traditionnelles de village. Les activités de ces organes sont envisagées principalement en termes locaux : ils peuvent également fédérer et former des structures nationales là où c'est nécessaire, mais selon Puente le produit en excédent d'unités économiques locales doit être échangé avec celui des autres. En d'autres termes, ce communisme libertaire peut coexister avec des relations de valeur, et on ne sait pas si c'est une mesure transitoire ou quelque chose qui va exister à perpétuité.
Pendant ce temps, cette transformation se déroule au moyen de "l'action directe" et non à travers l'engagement dans la sphère politique, laquelle est entièrement identifiée avec l'État actuel. Au moyen d'un comparatif entre "organisation basée sur la politique, qui est une caractéristique commune à tous les régimes basés sur l'État, et les organisations basées sur l'économie, dans un régime qui évite l'État", Puente dessine le caractère hiérarchique et exploiteur de l'État et lui oppose la vie démocratique des syndicats et des municipalités libres, basée sur les décisions prises par les assemblées et sur des besoins communs. Il y a deux problèmes fondamentaux dans cette approche : tout d'abord, elle échoue complètement à expliquer que les syndicats – y inclus les syndicats anarcho-syndicalistes comme la CNT - n'ont jamais été des modèles d'auto-organisation ou de démocratie mais sont soumis à une forte pression pour s'intégrer dans la société capitaliste et à devenir eux-mêmes des institutions bureaucratiques qui tendent à se fondre avec l'État. Et deuxièmement, il ignore la réalité de la révolution, dans laquelle la classe ouvrière est nécessairement confrontée à une conjonction de problèmes qui sont inévitablement politiques : l'autonomie organisationnelle et théorique de la classe ouvrière vis-à-vis des partis et des idéologies de la bourgeoisie, la destruction de l'État capitaliste et la consolidation de ses propres organes du pouvoir. Ces lacunes profondes dans le programme libertaire devaient être brutalement mises en lumière par la réalité de la guerre qui a éclaté en Espagne peu après le Congrès de Saragosse.
Mais il y a un autre problème non moins décisif : l'incapacité du texte à prendre en compte la dimension internationale, ce qui explique sa perspective strictement nationale. Il est vrai que le premier parmi les nombreux "préjugés" réfutés dans le texte est "la conviction que la crise n'est que temporaire". Comme ce fut le cas pour Maximoff, la grande dépression des années 30 semble avoir convaincu Puente que le capitalisme est un système en déclin, et le paragraphe suivant le sous-titre a au moins une dimension plus globale, mentionnant la situation de la classe ouvrière en Italie et en Russie. Mais il n'y a pas de tentative d'aucune sorte pour évaluer le rapport de force entre les classes, une tâche primordiale pour les révolutionnaires après une période de 20 ans à peine qui avait connu la Guerre mondiale, une vague révolutionnaire internationale et la série de défaites catastrophiques pour le prolétariat. Et, quand il s'agit d'examiner le potentiel pour le communisme libertaire en Espagne, c'est presque comme si le monde extérieur n'existait pas : il y a une longue partie consacrée à estimer les ressources économiques de l'Espagne, jusqu'aux oranges et pommes de terre, au coton, au bois et à l'huile. Tout l'objectif de ces calculs est de montrer que l'Espagne pourrait exister comme un îlot autosuffisant de communisme libertaire. Bien sûr, Puente estime que "l'introduction du communisme libertaire dans notre pays, isolé parmi les nations de l'Europe, apportera avec lui l'hostilité des nations capitalistes. Prétextant la défense des intérêts de ses sujets, l'impérialisme bourgeois tentera d'intervenir par la force des armes pour écraser notre système à sa naissance". Mais cette intervention sera être entravée par la menace ou bien d'une révolution sociale dans le pays de l'agresseur ou bien de la guerre mondiale contre les autres puissances. Les capitalistes étrangers pourront toutefois préférer employer des armées de mercenaires plutôt que leur propre armée, comme ils l'ont fait en Russie : dans les deux cas, les travailleurs devront être prêts à défendre la révolution les armes à la main. Mais les autres États bourgeois pourraient également chercher à imposer un blocus économique, soutenu par des navires de guerre. Et cela pourrait être un vrai problème car l'Espagne ne dispose pas de certaines ressources essentielles, en particulier du pétrole, et serait obligée de l'importer. La solution à un blocus sur les importations, cependant, n'est pas difficile à trouver : "il est vital que nous rassemblions toutes nos énergies dans la prospections de nouveaux puits de pétrole... le pétrole peut (aussi) être obtenu en distillant de l'Anthracite et de la lignite, dont nous disposons en abondance dans ce pays".
En résumé : pour créer le communisme libertaire, l'Espagne doit devenir autarcique. C'est une pure vision de l'anarchie dans un seul pays 11. Cette incapacité à partir du point de vue du prolétariat mondial allait s'avérer constituer une autre erreur fatale quand l'Espagne est devenue le théâtre d'un conflit impérialiste mondial.
Les événements de 36-37 : révolution sociale ou guerre impérialiste ?
Le modèle anarcho-syndicaliste de la révolution tel qu'exposé dans le texte de Puente et le programme de Saragosse devaient être définitivement mis en lumière et réfutés par les événements historiques importants, déclenchés par le coup d'État franquiste en juillet 1936.
Ce n'est certainement pas l'endroit pour écrire un récit détaillé de ces événements. Nous pouvons nous limiter en rappelant leur schéma général, dans le but de réaffirmer la vision de la gauche communiste à l'époque, à savoir : l'incohérence congénitale de l'idéologie anarchiste était devenue un véhicule pour la trahison de la classe ouvrière.
Il n'y a pas de meilleure analyse des premiers instants de la guerre en Espagne que l'article publié dans le journal de la Fraction de gauche italienne, Bilan n° 34, octobre-novembre 1936 et republié dans la Revue Internationale n° 6 12. Il a été écrit presque immédiatement après les événements par les camarades de Bilan, sans doute après avoir trié une masse d'informations très confuses et déroutantes. C'est remarquable la façon dont ces camarades sont parvenus à dissiper le brouillard dense des mystifications entourant la "révolution espagnole", que ce soit dans la version la plus médiatisée à l'époque par les puissants médias contrôlés par les démocrates et les staliniens, c’est-à-dire une sorte de révolution démocratique bourgeoise contre la réaction féodale-fasciste ; ou bien dans la version des anarchistes et trotskistes qui, tout en présentant la lutte en Espagne comme une révolution sociale étant allé beaucoup plus loin que n'importe quel moment atteint en Russie en 1917, a également servi à renforcer l'opinion dominante selon laquelle la lutte constituait une barrière populaire contre l'avancée du fascisme en Europe.
L'article de Bilan reconnaît sans hésitation que, face à l'attaque de la droite, la classe ouvrière, surtout dans son fief de Barcelone, a répondu avec ses propres armes de classe : la grève spontanée de masse, les manifestations de rue, la fraternisation avec les soldats, l'armement général des travailleurs, la formation de comités de défense et des milices basés sur les quartiers, l'occupation des usines et l'élection des comités d''usine. Bilan a également reconnu que c'était les militants de la CNT-FAI qui avaient partout joué un rôle de premier plan dans ce mouvement qui, par ailleurs, avait embrassé la majorité de la classe ouvrière de Barcelone.
Et pourtant, c'est précisément à ce moment, alors que la classe ouvrière était au bord de la prise du pouvoir politique dans ses propres mains, que les faiblesses programmatiques de l'anarchisme, son insuffisance théorique, devaient s'avérer un handicap mortel.
Tout d'abord, l'échec de l'anarchisme à comprendre le problème de l'État a conduit non seulement à laisser échapper la possibilité d'une dictature prolétarienne – parce que l'anarchisme est "contre tous les types de dictature" – mais peut-être plus important encore, à désarmer totalement les ouvriers face à des manœuvres de la classe dirigeante qui a réussi à reconstituer un pouvoir d'État avec des formes nouvelles et "radicales", étant donné que ses forces traditionnelles avaient été paralysées par le soulèvement prolétarien. Des instruments clés de ce processus ont été le Comité Central des milices contre le fascisme et le Conseil Central de l'économie :
"La constitution du Comité Central des milices devait donner l'impression de 1'ouverture d’une phase de pouvoir prolétarien et la constitution du Conseil Central de l'Economie l'illusion que l'on entrait dans la phase de la gestion d'une économie prolétarienne.
Pourtant, loin d'être des organismes de dualité des pouvoirs, il s'agissait bien d'organismes ayant une nature et une fonction capitalistes, car au lieu de se constituer sur la base d'une poussée du prolétariat cherchant des formes d'unité de lutte afin de poser le problème du pouvoir, ils furent, dès l'abord, des organes de collaboration avec l'État capitaliste.
Le C.C. des milices de Barcelone sera d'ailleurs un conglomérat de partis ouvriers et bourgeois et de syndicats et non un organisme du type des soviets surgissant sur une base de classe, spontanément, et où puisse se vérifier une évolution de la conscience des ouvriers. Il se reliera à la Généralité pour disparaître avec un simple décret lorsque sera constitué, en octobre, le nouveau gouvernement de la Catalogne.
Le C.C. des milices représentera l'arme inspirée par le capitalisme pour entraîner, par l'organisation des milices, les prolétaires en dehors des villes et de leurs localités, vers les fronts territoriaux où ils se feront massacrer impitoyablement, il représentera l'organe qui rétablira l'ordre en Catalogne, non avec les ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront dispersés sur les fronts. Certes, l'armée régulière sera pratiquement dissoute, mais elle sera reconstituée graduellement avec les colonnes de miliciens dont l'État-major restera nettement bourgeois, avec les Sandino, les Villalba et consorts. Les colonnes seront volontaires, elles pourront le rester jusqu'au moment où finiront la griserie et l'illusion de la révolution et réapparaîtra la réalité capitaliste. Alors on marchera à grands pas vers le rétablissement officiel de l'armée régulière et vers le service obligatoire."
La participation immédiate de la CNT et du POUM (Parti Ouvrier d'Unification Marxiste", situé quelque part entre la gauche de la social-démocratie et le trotskisme) dans ces institutions bourgeoises a été un grand coup contre la possibilité pour les organes de classe créés dans les rues et les usines pendant les jours de juillet de se centraliser et d'établir un authentique double pouvoir. Au contraire, ces derniers ont été rapidement vidés de leur contenu prolétarien et incorporés dans les nouvelles structures du pouvoir bourgeois.
Deuxièmement, une question politique brûlante n'était pas confrontée et, faute d'une analyse des tendances historiques au sein même de la société capitaliste, les anarchistes n'avaient aucune méthode pour y faire face : la nature du fascisme et de ce que Bordiga appelait son "pire produit", l'antifascisme. Si la montée du fascisme a été l'expression d'une série de défaites historiques de la révolution prolétarienne, préparant ainsi la société bourgeoise pour un deuxième massacre inter-impérialistes, l'antifascisme n'était pas moins un cri de ralliement pour une guerre impérialiste, pas moins un appel aux travailleurs pour abandonner la défense de leurs propres intérêts de classe au nom d'une "union sacrée" nationale. C'est surtout cette idéologie de l'unité contre le fascisme qui a permis à la bourgeoisie d'écarter le danger de la révolution prolétarienne en détournant la lutte de classe dans les villes vers un conflit militaire à l'avant, sur le front. L'appel à sacrifier tout pour la lutte contre Franco a conduit même les plus passionnés défenseurs du communisme libertaire, comme Durruti, à accepter cette grande manœuvre. Les milices, en étant incorporées dans un organe comme le Comité Central des Milices Antifascistes, dominé par les partis et syndicats tels que la gauche républicaine et nationaliste, les socialistes et les staliniens, qui se sont ouvertement opposés à la révolution prolétarienne, sont devenus des instruments dans une guerre entre deux factions capitalistes, un conflit qui presque immédiatement s'est transformé en un champ de bataille inter-impérialiste général, une répétition pour la prochaine Guerre mondiale. Leurs formes démocratiques, telles que l'élection des officiers, n'y a fondamentalement pas changé quoi que ce soit. C'est vrai que les principales forces bourgeoises de commandement – les staliniens et les républicains – n'ont jamais été à l'aise avec ces formes et, plus tard, insistèrent pour qu'elles se fondent complètement dans une armée bourgeoise traditionnelle, comme l'avait prédit Bilan. Mais également comme Bilan l'a compris, le coup fatal avait déjà été porté dans les premières semaines après le coup d'État militaire.
Il en a été de même avec l'exemple le plus évident de la faillite de la CNT, la décision de quatre de ses dirigeants les plus connus, y compris l'ancien radical Garcia Oliver, de devenir ministres dans le gouvernement central de Madrid, acte de trahison aggravé par leur infâme déclaration selon laquelle, grâce à leur participation au sein du ministère, l'État républicain "avait cessé d'être une force oppressive contre la classe ouvrière, tout comme l'État ne représente plus l'organisme qui divise la société en classes. Et les deux tendront encore moins à opprimer le peuple du fait de l'intervention de la CNT" 13. Il s'agissait de la dernière étape d'une trajectoire qui avait été préparée longtemps à l'avance par la lente dégénérescence de la CNT. Dans une série d'articles sur l'histoire de la CNT, nous avons montré que la CNT, malgré ses origines prolétariennes et les convictions profondément révolutionnaires d'un grand nombre de ses militants, n'a pas pu résister au sein du capitalisme, dans son époque du totalitarisme d'État, à la tendance sans merci pour les organisations ouvrières permanentes de masse à être intégrées à l'État. Cela avait déjà été démontré bien avant les événements de juillet, comme lors des élections de février 1936, quand la CNT a abandonné son abstentionnisme traditionnel en faveur de l'appui tactique à un vote pour la République 14. Et dans la période immédiatement après le coup d'État de Franco, quand le gouvernement républicain était à la dérive totale, le processus de la participation des anarchistes dans l'État bourgeois s'est accéléré à tous les niveaux. Ainsi, bien avant le scandale des quatre ministres anarchistes, la CNT avait déjà rejoint le gouvernement régional de Catalogne, la Generalidad, et au niveau local – sans doute conformément à sa notion plutôt vague de 'municipalités libres' – des militants anarchistes étaient devenus des représentants et des responsables des organes de l'administration locale, c'est-à-dire les unités de base de l'État capitaliste. Comme pour la trahison de la social-démocratie en 1914, ce n'était pas seulement une question de quelques mauvais chefs, mais le produit d'un processus graduel d'intégration de l'ensemble de l'appareil organisationnel dans la société bourgeoise et son État. Bien sûr, au sein de la CNT-FAI et dans le mouvement anarchiste plus large, à l'intérieur et en dehors de l'Espagne, il y eut des voix prolétariennes contre cette trajectoire, même si, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article, peu d'entre elles ont réussi à remettre en cause les racines théoriques sous-jacentes de la trahison.
Ah, mais qu'en est-il des collectivisations ? Les anarchistes les plus dévoués et courageux, comme Durruti, n'ont-ils pas insisté sur le fait que l'approfondissement de la révolution sociale était la meilleure façon de vaincre Franco ? Est-ce que ce ne sont pas avant tout les exemples des usines et fermes autogérées, les tentatives de se débarrasser de la forme salariale dans de nombreux villages dans toute l'Espagne, qui en ont convaincu beaucoup, voire des marxistes comme Grandizo Munis 15, que la révolution sociale en Espagne avait atteint des sommets inconnus en Russie, avec sa descente rapide dans le capitalisme d'État ?
Mais Bilan rejetait toute idéalisation des occupations d'usine :
"Lorsque les ouvriers reprirent le travail, là où les patrons avaient fui ou furent fusillés par les masses, se constituèrent des Conseils d'Usine qui furent 1'expression de 1'expropriation de ces entreprises par les travailleurs. Ici intervinrent rapidement les syndicats pour établir des normes tendant à admettre une représentation proportionnelle là où se trouvaient des membres de la CNT et de l'UGT. Enfin, bien que la reprise du travail s’effectua avec la demande des ouvriers de voir appliquées la semaine de 36 heures, l'augmentation des salaires, les syndicats intervinrent pour défendre la nécessité de travailler à plein rendement pour l'organisation de la guerre sans trop respecter une réglementation du travail et des salaires.
Immédiatement étouffés, les comités d’usine, les comités de contrôle des entreprises où l'expropriation ne fut pas réalisée (en considération du capital étranger ou pour d'autres considérations) se transformèrent en des organes devant activer la production et, par-là, furent déformés dans leur signification de classe. Il ne s'agissait pas d'organismes créés pendant une grève insurrectionnelle pour renverser l'État, mais d'organismes orientés vers l'organisation de la guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet État." (Ibid)
Damier ne s'appesantit pas trop sur les conditions dans les usines "contrôlées par les travailleur". Il est significatif qu'il passe plus de temps à examiner les formes démocratiques des sociétés des collectifs villageois, leur profonde préoccupation pour le débat et l'auto-éducation par le biais des assemblées de comités régulières et élues, leurs tentatives d'en finir avec le salariat. Il s'agissait d'efforts héroïques en effet mais les conditions de l'isolement rural avaient rendu moins urgent un assaut – par la ruse ou la force ouverte – de la part de l'État capitaliste sur les collectivités villageoises. En somme, ces changements dans la campagne n'ont pas altéré le processus général de récupération bourgeoise qui se concentrait sur les villes et les usines, où la discipline au travail pour l'économie de guerre de l'État capitaliste a été imposée rapidement et de façon impitoyable et n'aurait pas pu l'être sans la fiction d'un "contrôle syndical" par l'intermédiaire de la CNT :
"Le fait le plus intéressant dans ce domaine est le suivant : à l'expropriation des entreprises en Catalogne, à leur coordination effectuée par le Conseil de l'Economie en août, au décret d'octobre du gouvernement donnant les normes pour passer à la "collectivisation", succéderont, chaque fois, de nouvelles mesures pour soumettre les prolétaires à une discipline dans les usines, discipline que jamais ils n'auraient toléré de la part des anciens patrons. En Octobre, la CNT lancera ses consignes syndicales où elle interdira les luttes revendicatives de toute espèce et fera de l'augmentation de la production le devoir le plus sacré du prolétaire. A part le fait que nous avons déjà rejeté la duperie Soviétique qui consiste à assassiner physiquement les prolétaires au nom "de la construction d'un socialisme", que personne ne distingue encore, nous déclarons ouvertement qu'à notre avis, la lutte dans les entreprises ne cesse pas un seul moment tant que subsiste la domination de l'État capitaliste. Certainement, les ouvriers devront faire des sacrifices après la révolution prolétarienne, mais jamais un révolutionnaire ne pourra prêcher la fin de la lutte revendicative pour arriver au socialisme. Même pas après la révolution, nous n'enlèverons l'arme de la grève aux ouvriers et il va de soi que lorsque le prolétariat n'a pas le pouvoir - et c'est le cas en Espagne - la militarisation de 1’usine équivaut à la militarisation des usines de n'importe quel État capitaliste en guerre." (Bilan, op. cit.)
Bilan s'appuie ici sur l'axiome que la révolution sociale et la guerre impérialiste sont des tendances diamétralement opposées dans la société capitaliste. La défaite de la classe ouvrière – idéologique en 1914, physique et idéologique dans les années 1930 - ouvre la voie à la guerre impérialiste. La lutte de classe en revanche ne peut être menée qu'au détriment de l'économie de guerre. Grèves et mutineries ne renforcent pas l'effort de guerre national. Ce furent les irruptions révolutionnaires de 1917 et 1918 qui ont obligé les impérialismes belligérants à mettre immédiatement fin aux hostilités.
Il en va de même pour la guerre révolutionnaire. Mais elle peut uniquement être menée lorsque la classe ouvrière est au pouvoir, ce sur quoi Lénine et ceux qui se sont ralliés à lui dans le parti bolchevique ont été très clairs dans la période de février à octobre 1917. Et même dans ce cas, les exigences d'une guerre révolutionnaire menée sur les fronts territoriaux ne créent pas les meilleures conditions pour l'épanouissement de la puissance de la classe et pour une transformation sociale radicale, loin s'en faut. Ainsi entre 1917 et 1920, l'État soviétique a défait les forces contre-révolutionnaires internes et externes au niveau militaire, mais à un prix très élevé : l'érosion du contrôle politique de la classe ouvrière et l'autonomisation de l'appareil d'État.
Cette opposition fondamentale entre guerre impérialiste et révolution sociale a été doublement confirmée par les événements de mai 37.
Ici à nouveau, mais cette fois face à une provocation des staliniens et autres forces de l'État, qui ont tenté de s'emparer du central téléphonique alors contrôlé par les travailleurs, le prolétariat de Barcelone a répondu massivement et avec ses propres méthodes de lutte : grève de masse et barricades. Le "défaitisme révolutionnaire" prôné par la Gauche italienne, fustigé par pratiquement toutes les tendances politiques, des libéraux à des groupes comme Union Communiste, comme étant de la folie et une traîtrise a été mis en pratique par les travailleurs de Barcelone. C'était essentiellement une réaction de défense à une attaque par les forces répressives de l'État républicain mais, une fois de plus, elle a opposé les travailleurs à l'ensemble de la machine d'État, dont les porte-paroles les plus éhontés n'ont pas hésité à les dénoncer comme des traîtres, comme les saboteurs de l'effort de guerre. Et, implicitement, c'était en effet un défi direct à la guerre contre le fascisme, pas moins que la mutinerie de Kiel de 1918 avait été un défi à l'effort de guerre de l'impérialisme allemand et, par extension, au conflit inter-impérialiste dans son ensemble.
Les défenseurs ouverts de l'ordre bourgeois devaient répondre par la terreur brutale contre les travailleurs. Des révolutionnaires ont été arrêtés, torturés, tués. Camillo Berneri, l'anarchiste italien qui avait ouvertement exprimé ses critiques à la politique de collaboration de la CNT a été parmi les nombreux militants enlevés et tués, dans la majorité des cas par les voyous du parti "communiste". Mais la répression ne s'est vraiment abattue sur les travailleurs qu'une fois avoir été persuadés de déposer les armes et de retourner travailler par les porte-paroles de la "gauche", de la CNT et du POUM, qui étaient surtout terrifiés par une fracture dans le front antifasciste. La CNT – comme le SPD dans la révolution allemande de 1918 – était indispensable à la restauration de l'ordre bourgeois.
Dans la deuxième partie de cet article, nous examinerons certaines des tendances anarchistes qui ont dénoncé les trahisons de la CNT au cours de la guerre en Espagne – telles que les amis de Durruti en 1937-38, ou un représentant plus récent de l'anarcho-syndicalisme, comme Solidarity Federation en Grande-Bretagne. Nous essaierons de montrer que, bien qu'il se soit agi de saines réactions prolétariennes, celles-ci ont rarement remis en question les faiblesses sous-jacentes du "programme" anarchiste.
C D Ward
1. Dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [10e partie]". Volume I. Revue Internationale n° 79. https://fr.internationalism.org/rinte79/comm.htm [488].
2. Dans notre article de la Revue Internationale n° 120, "L'anarcho-syndicalisme face à un changement d'époque : la CGT jusqu'à 1914" (https://fr.internationalism.org/rint/120_cgt [375]), nous avons souligné que cette orientation de certains courants anarchistes vers les syndicats reposait plus sur la recherche d'un public plus réceptif à leur propagande que sur une réelle compréhension de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.
4. https://nefac.net/node/677 [490]
5. "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme". https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_gra... [233].
6. En anglais, Black Cat Press, Edmonton, 2009 et initialement publié en russe en russe en 2000. Damier est un membre du KRAS, la section russe de l'AIT. Le CCI a publié un certain nombre de ses déclarations internationalistes sur les guerres dans l'ex-URSS.
7. Fédération Ouvrière Régionale Argentine
8. Traduit de l'anglais par nos soins, à partir de l'ouvrage suivant Anarchism in Argentina and Uruguay in Anarchism Today, édité par David Apter and James Joll Macmillan, 1971. Également accessible sur Internet à l'adresse suivante https://www.libcom.org/files/Argentina.pdf [491].
9. Cette organisation – le SR signifie "Syndicaliste Révolutionnaire" – a été le résultat d'une scission en 1926 avec la CGT "officielle" qui, à l'époque, était dominée par le parti socialiste. Elle est restée un groupe relativement petit et a disparu sous le régime de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Son principal porte-parole lors du Congrès de Saragosse était Pierre Besnard.
10. Accessible en anglais sur le lien https://www.libcom.org/library/libertarian-communism [492]
. "Si ce mode de penser nous paraît au premier abord tout à fait évident, c'est qu'il est celui de ce qu'on appelle le bon sens. Mais si respectable que soit ce compagnon tant qu'il reste cantonné dans le domaine prosaïque de ses quatre murs, le bon sens connaît des aventures tout à fait étonnantes dès qu'il se risque dans levaste monde de la recherche ; et la manière de voir métaphysique, si justifiée et même si nécessaire soit elle dans de vastes domaines dont l'étendue varie selon la nature de l'objet, se heurte toujours, tôt ou tard, à une barrière au-delà de laquelle elle devient étroite, bornée, abstraite, et se perd en contradictions insolubles: la raison en est que, devant les objets singuliers, elle oublie leur enchaînement; devant leur être, leur devenir et leur périr : devant leur repos, leur mouvement; les arbres l'empêchent de voir la forêt". Chapitre II. https://www.marxists.org/francais/marx/80-utopi/utopi-2.htm [493]
11. Notre article sur la CGT, cité à la note 2, soulève la même question à propos d'un livre produit par deux leaders de l'organisation anarcho-syndicaliste française en 1909: "La lecture du livre de Pouget et Pataud Comment nous ferons la révolution, que nous avons déjà cité, est très instructive à cet égard, dans le sens que celui-ci décrit une révolution purement nationale. Les deux auteurs anarcho-syndicalistes n'ont pas attendu Staline pour envisager la construction de "l'anarchisme dans un seul pays" : la révolution ayant réussi en France, tout un passage du livre est consacré à la description du système de commerce extérieur qui continue de s'opérer selon le mode commercial, alors qu'à l'intérieur des frontières nationales, on produit selon un mode communiste".
12. Revue Bilan : "Leçons d'Espagne 1936 (2eme partie)". https://fr.internationalism.org/rinte6/bilan2.htm [494]
13. Traduit de l'anglais par nos soins à partir de Vernon Richards, Lessons of the Spanish Revolution, chapter VI, p 69.
14. Voir à ce sujet la série sur l'histoire de la CNT dans les n° 129 à 133 de la Revue Internationale, en particulier l'article "L'antifascisme, la voie de la trahison de la CNT (1934-1936)". https://fr.internationalism.org/rint133/l_antifascisme_la_voie_de_la_tra... [495]
15. Munis a été une figure de proue du groupe bolchévique-léniniste en Espagne qui était lié à la tendance de Trotsky. Plus tard, il rompt avec le trotskisme sur la question de son soutien à la Seconde Guerre mondiale et évolue vers de nombreuses positions de la gauche communiste. https://fr.internationalism.org/rinte58/Munis_militant_revolutionnaire.htm [496].
Nous avons publié des polémiques avec le groupe fondé plus tard par Munis, Fomento Obrero Revolucionario, sur sa vision de la guerre d'Espagne : https://fr.internationalism.org/rinte29/corresp.htm [497] https://fr.internationalism.org/rinte52/for.htm [498]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [499]
Rubrique:
Revue Internationale n°154 - 2e semestre 2014
- 2400 lectures
100 ans après la Première Guerre mondiale, la lutte pour les principes prolétariens demeure pleinement d'actualité
- 1422 lectures
Il y a cent ans, la guerre entre dans une nouvelle année de massacres. Elle devait être "terminée pour Noël", mais Noël est passé et la guerre est toujours là.
A partir du 24 décembre, des fraternisations sur les lignes de front ont donné lieu à la "Trêve de Noël". De leur propre initiative et au grand dam des officiers, les soldats – ouvriers ou paysans en uniforme – sont sortis spontanément de leurs tranchées pour échanger bière, cigarettes, et nourriture. Pris de court, les Etats-Majors n'ont pas su réagir sur le champ.
Les fraternisations posent la question : que serait-il passé s'il y avait eu un parti ouvrier, une Internationale, capable de leur donner une vision plus large, de les faire fructifier pour devenir une opposition consciente non seulement à la guerre mais à ses causes ? Mais les ouvriers sont abandonnés par leurs partis : pire, ces partis sont devenus les sergents-recruteurs de la classe dominante. Derrière les pelotons d'exécution qui attendent les déserteurs et les mutins, se tiennent des ministres "socialistes". La trahison des partis socialistes dans la plupart des pays belligérants fait que l'Internationale socialiste s'effondre, incapable de faire appliquer les résolutions contre la guerre adoptées par le congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 : cet effondrement est le thème d'un des articles de ce numéro.
L'année 1915 s'ouvre. Il n'y aura plus de "Trêve de Noël" : les Etats-Majors, inquiets, feront appliquer la discipline et tonner les canons le Noël prochain afin de tuer dans l'œuf toute velléité de mettre fin à la guerre de la part des soldats et des ouvriers.
Et pourtant, péniblement et sans plan d'ensemble, la résistance ouvrière ressurgit. En 1915 il y aura encore des fraternisations sur le front, de grandes grèves dans la vallée du Clyde en Ecosse, des manifestations d'ouvrières allemandes contre le rationnement. De petits groupes, comme Die Internationale (où milite Rosa Luxembourg) ou le groupe Lichtstrahlen en Allemagne, rescapés de la ruine des partis de l'Internationale, s'organisent malgré la censure et la répression. En septembre, certains participeront à la première conférence internationale des socialistes contre la guerre, à Zimmerwald en Suisse. Cette conférence, et les deux qui suivront, s'affronteront aux mêmes problèmes posés à la 2e Internationale : est-il possible de mener une politique de "paix" sans passer par la révolution prolétarienne ? Peut-on envisager une reconstruction de l'Internationale sur la base de l'unité d'avant 1914 qui s'est avérée apparente et non réelle, ?
Cette fois, c'est la gauche qui va gagner la bataille, et la 3e Internationale qui sortira de Zimmerwald sera explicitement communiste, révolutionnaire, et centralisée : ce sera la réponse à la faillite de l'Internationale, tout comme les Soviets en 1917 seront la réponse à la faillite du syndicalisme.
Il y a presque 30 ans (en 1986) nous avons commémoré le 70e anniversaire de Zimmerwald dans un article publié dans cette Revue. Six ans après l'échec des Conférences internationales de la Gauche communiste 1 nous écrivions : "Comme à Zimmerwald, le regroupement des minorités révolutionnaires se pose aujourd'hui de façon brûlante (...) Face aux enjeux actuels, la responsabilité historique des groupes révolutionnaires est posée. Leur responsabilité est engagée dans la formation du parti mondial de demain, dont l'absence aujourd'hui se fait cruellement sentir (...) L'échec des premières tentatives de conférences (1977-80) n'invalide pas la nécessité de tels lieux de confrontation. Cet échec est relatif : il est le produit de l'immaturité politique, du sectarisme et de l'irresponsabilité d'une partie du milieu révolutionnaire qui paie encore le poids de la longue période de contre-révolution (...) Demain, de nouvelles conférences des groupes se revendiquant de la Gauche se tiendront...".2
Force est de constater que nos espoirs, notre confiance d'alors ont souffert une amère déception. Des groupes ayant participé aux Conférences, seuls restent le CCI et la TCI (ex-BIPR, créé par Battaglia Comunista d'Italie et la CWO de Grande Bretagne peu après les Conférences). 3 Si la classe ouvrière ne s'est pas laissé enrôler sous les drapeaux dans une guerre impérialiste généralisée, elle n'a pas non plus su opposer sa propre perspective à la société bourgeoise. De ce fait, la lutte de classe n'a pas imposé aux révolutionnaires de la Gauche communiste un minimum des sens des responsabilités : les Conférences n’ont jamais été renouvelées, et nos appels répétés à un minimum d’action commune des internationalistes (notamment lors des guerres du Golfe dans les années 1990 et 2000) sont restés sans réponse et lettre morte. L'anarchisme nous offre un spectacle encore plus affligeant, si c'était possible. Avec les guerres en Ukraine et en Syrie, c'est la débandade dans le nationalisme et l'antifascisme dont peu s'en sortent avec honneur (le KRAS en Russie est une exception admirable).
Dans cette situation, caractéristique de la décomposition sociale ambiante, le CCI n'a pas été épargné. Notre organisation est secouée par une crise profonde, qui exige de nous une réflexion théorique et une mise en question toute aussi profonde pour y faire face. C'est le thème de l'article sur notre récente Conférence extraordinaire, également publié dans ce numéro.
Les crises ne sont jamais une situation confortable, mais sans crises il n'y a pas de vie, et elles peuvent être à la fois nécessaires et salutaires. Comme souligne notre article, s'il y a une leçon à tirer de la trahison des partis socialistes et de l'effondrement de l'Internationale, c'est que la voie tranquille de l'opportunisme mène à la mort et à la trahison, et que la lutte politique de la gauche révolutionnaire ne s'est jamais faite sans heurts et sans crises.
CCI, décembre 2014
1 Nous renvoyons le lecteur non informé sur ces conférences à notre article de la Revue internationale n° 22, "Le sectarisme, un héritage de la contrerévolution à dépasser" ; https://fr.internationalism.org/rinte22/conference.htm [501]..
2 Revue internationale n°44, 1er Trimestre 1986.
3 Le GCI étant passé du côté de la bourgeoisie en soutenant le Sentier lumineux péruvien.
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [444]
Rubrique:
Première Guerre mondiale: comment s'est produite la faillite de la Deuxième internationale
- 4350 lectures
Depuis plus de dix ans, le vacarme lointain des armes faisait écho en Europe, celui des guerres coloniales d'Afrique et des crises marocaines (1905 et 1911), celui de la guerre russo-japonaise de 1904, celui des guerres balkaniques. Les ouvriers d'Europe faisaient confiance à l'Internationale pour tenir à distance la menace d'un conflit généralisé. Les contours de la guerre à venir – déjà prévue par Engels en 1887 1 - se dessinaient de plus en plus clairement, année après, année, au point que les Congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 la dénoncèrent clairement : ce n'était pas une guerre défensive mais une guerre de concurrence impérialiste, de pillage et de rapine. L'Internationale et ses partis membres avaient constamment prévenu les ouvriers du danger et menacé de renverser les classes dominantes si elles osaient défier la classe ouvrière, puissante et organisée, et lâcher leurs meutes guerrières. Et pourtant, en août 1914, l'Internationale se désintégra, emportée comme poussière insignifiante tandis que, l'un après l'autre, ses leaders et ses députés aux parlements trahissaient leurs promesses solennelles, votaient les crédits de guerre et appelaient les ouvriers à la boucherie. 2
Comment un tel désastre a-t-il pu se produire ? Karl Kautsky, auparavant le théoricien le plus en vue de l'Internationale, faisait porter la responsabilité sur les ouvriers : "Qui osera affirmer que 4 millions de prolétaires allemands conscients peuvent, sur la simple injonction d'une poignée de parlementaires, faire en 24 heures demi-tour à droite et prendre le contre-pied de leurs objectifs antérieurs ? Si cela était exact, cela témoignerait, certes, d'une terrible faillite non seulement de notre parti, mais aussi de la masse (souligné par Kautsky). Si cette masse était un troupeau de moutons à tel point dépourvus de caractère, il ne nous resterait plus qu'à nous laisser enterrer." 3 Bref, si quatre millions d'ouvriers allemands se laissèrent emmener de force dans la guerre, c'était de leur propre gré, cela n'avait rien à voir avec les parlementaires qui, avec le soutien de la majorité de leurs partis, avaient voté les crédits et qui, en France et en Grande-Bretagne, se firent très vite une place dans des gouvernements bourgeois d'unité nationale. À cette excuse pitoyable et lâche, Lénine apporta une réponse cinglante : "Pensez donc : en ce qui concerne l'attitude à l'égard de la guerre, seule une "poignée de parlementaires" (ils ont voté en toute liberté, protégés par le règlement ; ils pouvaient parfaitement voter contre ; même en Russie, on n'a été ni frappé, ni molesté, ni même arrêté pour autant), une poignée de fonctionnaires, de journalistes, etc., a pu se prononcer avec quelque liberté (c'est-à-dire sans être immédiatement arrêtés et conduits à la caserne, sans courir le risque d'être immédiatement passés par les armes). Aujourd'hui, Kautsky rejette noblement sur les masses la trahison et la veulerie de cette couche sociale dont la liaison avec la tactique et l'idéologie de l'opportunisme a été soulignée des dizaines de fois par ce même Kautsky pendant des années !" 4
Trahis par leurs dirigeants, leurs organisations se changeant en une nuit d'organisations de lutte pour la défense des ouvriers en sergents recruteurs de la boucherie, les ouvriers en tant qu'individus se retrouvaient isolés et seuls à devoir confronter la toute puissance militaire de l'appareil d'État. Comme l'écrivit plus tard un syndicaliste français : "Je n'ai qu'un reproche à me faire (...) ce reproche, c'est - étant antipatriote, antimilitariste - d'être parti comme mes camarades au 4ème jour de la mobilisation. Je n'ai pas eu, quoique ne reconnaissant pas de frontières, ni de patrie, la force de caractère pour ne pas partir. J'ai eu peur, c'est vrai, du poteau d'exécution. J'ai eu peur... Mais, là-bas, sur le front, pensant à ma famille, traçant au fond de ma tranchée le nom de ma femme et de mon fils, je disais : "Comment est-il possible que moi, antipatriote, antimilitariste, moi qui ne reconnais que l'Internationale, je vienne donner des coups à mes camarades de misère et peut-être pour mourir contre ma propre cause, mes propres intérêts, pour des ennemis ?" ". 5
Dans toute l'Europe, les ouvriers avaient fait confiance à l'Internationale, ils avaient cru aux résolutions contre la guerre à venir, adoptées à plusieurs reprises lors de ses congrès. Ils avaient fait confiance à l'Internationale, cette expression la plus haute de la puissance de la classe ouvrière organisée, pour arrêter le bras criminel de l'impérialisme capitaliste.
En juillet 1914, alors que la menace de guerre se faisait de plus en plus imminente, le Bureau de l'Internationale socialiste (BSI) – l'organe le plus analogue à un organe central de l'Internationale – convoqua une réunion d'urgence à Bruxelles. Au début, les dirigeants des partis présents avaient du mal à croire qu'une guerre généralisée puisse vraiment éclater mais au moment où le Bureau se réunit, le 29 juillet, l'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie et imposé la loi martiale. Victor Adler, président du parti social-démocrate d'Autriche, intervint pour dire que son parti était impuissant, aucune tentative n'était prévue pour résister à la mobilisation ni à la guerre elle-même. Aucun plan n'avait été fait pour que le parti entre dans la clandestinité et continue illégalement son activité. La discussion se perdit en délibérations sur le changement de lieu du prochain congrès de l'Internationale qui était prévu à Vienne : aucune action pratique ne fut envisagée. Oubliant tout ce qui avait été dit lors des congrès précédents, les dirigeants continuaient à faire confiance à la diplomatie des grandes puissances pour empêcher la guerre d'éclater, inconscients du fait que, cette fois-ci, toutes les puissances inclinaient à la guerre – ou ils ne voulaient pas le voir.
Le délégué britannique, Bruce Glasier 6, écrivit que "bien que le péril effroyable d'une éruption généralisée de la guerre fût le sujet principal des délibérations, personne, pas même les représentants allemands, ne semblait envisager que puisse avoir lieu une rupture véritable entre les grandes puissances tant que toutes les ressources de la diplomatie n'avaient pas été épuisées." 7 Jaurès déclara même que "le gouvernement français veut la paix et travaille au maintien de la paix. Le gouvernement français est le meilleur allié de la paix de cet admirable gouvernement anglais qui a pris l’initiative de la médiation". 8
Après la réunion du BSI, des milliers d'ouvriers belges se rassemblèrent pour écouter les dirigeants de l'Internationale prendre la parole contre la menace de guerre. Jaurès fit l'un de ses plus grands discours contre la guerre et les ouvriers l'acclamèrent.
Mais un orateur resta remarquablement silencieux : Rosa Luxemburg, la combattante la plus clairvoyante et la plus indomptable de tous, refusa de parler, rendue malade par la veulerie et l'auto-illusion de tout ce qu'elle voyait autour d'elle ; elle seule pouvait voir la lâcheté et la trahison qui allaient emporter les partis socialistes dans le soutien aux ambitions impérialistes de leurs gouvernements nationaux.
Une fois la guerre ouverte, les traitres socialistes de tous les pays belligérants proclamèrent qu'il s'agissait d'une guerre "défensive" : en Allemagne, la guerre avait lieu pour défendre la "culture" allemande contre la barbarie cosaque de la Russie tsariste, en France, c'était pour défendre la république française contre l'autocratie prussienne, en Grande-Bretagne pour défendre "la petite Belgique". 9 Lénine démolit ces prétextes hypocrites, rappelant aux lecteurs les promesses solennelles que les dirigeants de la Deuxième Internationale avaient faites, au Congrès de Bâle en 1912, de s'opposer non seulement à la guerre en général mais à cette guerre impérialiste en particulier dont depuis longtemps le mouvement ouvrier avait vu les préparatifs : "La résolution de Bâle ne parle pas de la guerre nationale, de la guerre du peuple, dont on a vu des exemples en Europe et qui sont même typiques pour la période 1789-1871, ni de la guerre révolutionnaire que les sociaux-démocrates n'ont jamais juré de ne pas faire ; elle parle de la guerre actuelle, engagée sur le terrain de "l'impérialisme capitaliste" et des "intérêts dynastiques", sur le terrain de la "politique de conquête" des deux groupes de puissances belligérantes, du groupe austro-allemand comme du groupe anglo-franco-russe. Plékhanov, Kautsky et consorts trompent tout bonnement les ouvriers en reprenant le mensonge intéressé de la bourgeoisie de tous les pays, qui multiplie ses efforts pour présenter cette guerre de rapine impérialiste, coloniale, comme une guerre populaire, défensive (pour qui que ce soit), et en cherchant à la justifier par des exemples historiques relatifs à des guerres non impérialistes." 10
Sans centralisation, pas d'action possible
Comment fut-il possible que l'Internationale à qui les ouvriers faisaient tant confiance, se soit avérée incapable d'agir ? En réalité, sa capacité d'action était plus apparente que réelle : le BSI était un simple organisme de coordination dont le rôle se réduisait en grande partie à organiser les congrès et à servir de médiateur dans les conflits ayant lieu entre les partis socialistes ou au sein de ceux-ci. Bien que l'aile gauche de l'Internationale – autour de Lénine et de Luxemburg en particulier – ait considéré les résolutions des congrès contre la guerre comme de véritables engagements, le BSI n'avait aucun pouvoir pour les faire respecter ; il n'avait pas de possibilité de mener une action indépendante des partis socialistes de chaque pays – encore moins à l'encontre de leurs désirs – et en particulier du plus puissant d'entre eux : le parti allemand. En fait, bien que le Congrès de fondation de l'Internationale ait eu lieu en 1889, le BSI ne fut pas constitué avant le Congrès de 1900 : jusque-là, l'Internationale n'existait en effet que pendant les sessions des congrès. Le reste du temps, elle n'était pas grand-chose de plus qu'un réseau de relations personnelles entre les différents dirigeants socialistes, dont beaucoup s'étaient connu personnellement pendant les années d'exil. Il n'y avait même pas de réseau formel de correspondance. August Bebel s'était même plaint auprès d'Engels en 1894 du fait que tous les liens avec les autres partis socialistes étaient entièrement entre les mains de Wilhelm Liebknecht : "se mêler des relations de Liebknecht avec l'étranger est tout simplement impossible. Personne ne sait à qui il écrit ni ce qu'il écrit ; il ne parle de ça à personne". 11
Le contraste avec la Première Internationale (l'Association internationale des Travailleurs, AIT) est frappant. Le premier acte de l'AIT à la suite de sa fondation en 1864 à St Martin's Hall (Londres) lors d'une réunion d'ouvriers britanniques et français pour la plupart, fut de formuler un projet de programme organisationnel et de constituer un Conseil général – organisme centralisateur de l'Internationale. Une fois les statuts rédigés, un grand nombre d'organisations en Europe (des partis politiques, des syndicats, même des coopératives) se joignirent à l'organisation sur la base des statuts de l'AIT. Malgré les tentatives de "L'Alliance" de Bakounine de le saboter, le Conseil général, élu par les congrès de l'AIT, bénéficiait de toute l'autorité d'un véritable organe centralisateur.
Ce contraste entre les deux Internationales était lui-même le produit d'une situation historique nouvelle et confirmait en fait les paroles prémonitoires du Manifeste communiste : "Bien qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte nationale, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie en revêt cependant d'abord la forme. Le prolétariat de chaque pays doit, bien entendu, en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie." 12 Après la défaite de la Commune de Paris en 1871, le mouvement ouvrier est entré dans une période de forte répression et s'est réduit, en particulier en France – où des milliers de Communards furent tués ou exilés dans les pénitenciers des colonies – et en Allemagne où le SDAP (prédécesseur du SPD) dut travailler clandestinement sous les lois antisocialistes de Bismarck. Il était clair que la révolution n'était pas immédiatement à l'ordre du jour comme l'avaient espéré beaucoup de révolutionnaires, y compris Marx et Engels, au cours des années 1860. Economiquement et socialement, les trente années qui vont de 1870 à 1900 13 allaient connaître une période d'expansion massive du capitalisme, à la fois en son sein avec la croissance de la production de masse et de l'industrie lourde au détriment des classes artisanales, et à l'extérieur du monde capitaliste avec l'expansion vers de nouveaux territoires, aussi bien en Europe même qu'au-delà des océans, en particulier aux États-Unis et dans un nombre croissant des possessions coloniales des grandes puissances. Ceci voulait aussi dire une énorme augmentation du nombre d'ouvriers : au cours de cette période, la classe ouvrière devait en effet se transformer d'une masse amorphe d'artisans et de paysans déplacés en une classe du travail associé capable d'affirmer sa propre perspective historique et de défendre ses intérêts économiques et sociaux immédiats. En fait, ce processus avait déjà été annoncé par la Première Internationale : "…les seigneurs de la terre et les seigneurs du capital se serviront toujours de leurs privilèges politiques pour défendre et perpétuer leurs privilèges économiques. Bien loin de pousser à l'émancipation du travail, ils continueront à y opposer le plus d'obstacles possible. (…) La conquête du pouvoir politique est donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière. Elle semble l'avoir compris, car en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, on a vu renaître en même temps ces aspirations communes, et en même temps aussi des efforts ont été faits pour réorganiser politiquement le parti des travailleurs." 14
Par sa nature même, du fait des conditions de l'époque, cette auto-formation de la classe ouvrière allait prendre des formes spécifiques au développement historique de chaque pays et être déterminée par celui-ci. En Allemagne, les ouvriers luttèrent d'abord dans les conditions difficiles de clandestinité imposées par les lois antisocialistes de Bismarck sous lesquelles la seule action légale possible était au parlement, et où les syndicats se développèrent sous couvert du parti socialiste. En Grande-Bretagne, qui était toujours la puissance industrielle européenne la plus développée, la défaite écrasante de grand mouvement politique du Chartisme en 1848 avait discrédité l'action politique ; l'énergie organisationnelle des ouvriers était en grande partie dédiée à la construction de syndicats ; les partis socialistes restèrent petits et insignifiants sur la scène politique. En France, le mouvement ouvrier était divisé entre Marxistes (le "Parti ouvrier" de Jules Guesde fondé en 1882), Blanquistes inspirés par la tradition révolutionnaire de la grande Commune de Paris (le "Comité révolutionnaire central" de Édouard Vaillant), Réformistes (connus sous le nom de "possibilistes") et syndicats, groupés dans la CGT et fortement influencés par les idées du syndicalisme révolutionnaire. Inévitablement, toutes ces organisations luttaient pour développer l'organisation et l'éducation des ouvriers et pour acquérir des droits politiques et syndicaux contre leur classe dominante respective et donc au sein du cadre national.
Le développement d'organisations syndicales de masse et d'un mouvement politique de masse participa également à redéfinir les conditions dans lesquelles travaillaient les révolutionnaires. L'ancienne tradition blanquiste – l'idée d'un petit groupe conspiratif de révolutionnaires professionnels qui prend le pouvoir avec le soutien plus ou moins passif des masses – était dépassée, la nécessité de construire des organisations de masse l'avait remplacée, des organisations qui forcément devaient opérer dans un certain cadre légal. Le droit de s'organiser, de tenir des assemblées, le droit de libre parole, tout cela devint d'un intérêt vital pour le mouvement de masse : inévitablement, toutes ces revendications étaient une fois de plus posées dans le cadre spécifique de chaque nation. Pour prendre un seul exemple : tandis que les socialistes français pouvaient avoir des députés élus au parlement de la république qui détenait un pouvoir législatif effectif, en Allemagne, le gouvernement ne dépendait pas du Reichstag (le parlement impérial) mais des décisions autocratiques du Kaiser en personne. Il était donc bien plus facile pour les allemands de maintenir une attitude de refus rigoureux d'alliance avec les partis bourgeois puisqu'il était hautement improbable qu'ils soient appelés à le faire ; à quel point cette position de principe était fragile se vit dans la façon dont elle fut ignorée par le SPD dans le Sud de l'Allemagne dont les députés votèrent régulièrement en faveur des propositions de budget par les Landtags régionaux (parlements régionaux).
Néanmoins, au fur et à mesure que les mouvements ouvriers dans plusieurs pays émergeaient d'une période de réaction et de défaite, la nature par définition internationale du prolétariat se réaffirma. En 1887, le Congrès du Parti allemand se tint à St Gallen en Suisse et décida de prendre l'initiative d'organiser un congrès international ; la même année, la réunion du TUC britannique (Trade Unions Congress) à Swansea vota en faveur d'une conférence internationale qui défendrait la journée de huit heures. 15 Ceci mena à la tenue d'une réunion préliminaire, en novembre 1888 à Londres, à l'invitation du comité parlementaire du TUC, à laquelle des délégués de plusieurs pays assistèrent, mais aucun d'Allemagne. Ces deux initiatives simultanées firent rapidement apparaître une scission fondamentale au sein du mouvement du travail, entre les réformistes dirigés par les syndicats britanniques et les possibilistes français d'une part, et les marxistes révolutionnaires dont l'organisation la plus importante était le SDAP d'Allemagne (les syndicats britanniques étaient en fait opposés à toute participation à des initiatives d'organisations politiques).
En 1889 – 100e anniversaire de la Révolution française qui était toujours une référence pour tous ceux qui aspiraient au renversement de l'ordre existant – il se tint non pas un mais deux congrès ouvriers internationaux à Paris : le premier appelé par les possibilistes français, le deuxième par le Parti ouvrier marxiste 16 de Jules Guesde. Le déclin des possibilistes qui a suivi, a fait que le congrès marxiste (appelé d'après le lieu de sa tenue, salle Petrelle) fut ensuite considéré comme le Congrès de fondation de la Deuxième Internationale. Inévitablement, le Congrès était marqué par l'inexpérience et beaucoup de confusion : confusion sur la question très controversée de la validation des mandats des délégués, ainsi que sur les traductions dont se chargeaient les membres de cette assemblée polyglotte qui étaient disponibles. 17 Les aspects les plus importants du Congrès ne furent donc pas ses décisions pratiques mais d'abord et avant tout, le fait qu'il ait eu lieu et ensuite la personnalité des délégués. De France participèrent les gendres de Marx, Paul Lafargue et Charles Longuet, ainsi que Edouard Vaillant, héros de la Commune ; d'Allemagne, Wilhelm Liebknecht et August Bebel ainsi qu'Edouard Bernstein et Klara Zetkin ; de Grande-Bretagne, le représentant le mieux connu était William Morris et c'était en soi indicatif de l'arriération du socialisme britannique puisque les membres de la Socialist League n'étaient que quelques centaines. Un temps fort du Congrès fut la poignée de mains échangée entre les présidents Vaillant et Liebknecht, symbole de la fraternité internationale des socialistes français et allemands.
Dans son évaluation de l'Internationale en 1948, la Gauche communiste de France a donc raison de mettre en avant deux caractéristiques. D'abord, elle "marque une étape de différenciation entre la lutte économique des salariés et la lutte politique sociale. Dans cette période de plein épanouissement de la société capitaliste, la Deuxième Internationale est l’organisation de la lutte pour des réformes et des conquêtes politiques, l’affirmation politique du prolétariat." En même temps, le fait que l'Internationale fut explicitement fondée comme organisation révolutionnaire marxiste "marqu[ait] une étape supérieure dans la délimitation idéologique au sein du prolétariat, en précisant et élaborant les fondements théoriques de sa mission historique révolutionnaire". 18
Le Premier Mai et la difficulté de l'action unifiée
La Deuxième Internationale était fondée mais n'avait pas encore de structure organisationnelle permanente. N'existant que pendant ses congrès, elle n'avait pas de moyen de faire appliquer les résolutions adoptées par ceux-ci. Ce contraste entre l'apparente unité internationale et la pratique des particularités nationales apparut de façon évidente dans la campagne pour la journée de huit heures, centrée sur la manifestation du Premier Mai, qui était l'une des préoccupations majeures de l'Internationale au cours des années 1890.
La résolution la plus importante du Congrès de 1889 fut probablement celle proposée par le délégué français Raymond Lavigne : les ouvriers de tous les pays devaient s'engager dans la campagne pour la journée de huit heures, décidée à St Louis par le Congrès de la American Federation of Labour en 1888, sous la forme de manifestations de masse et d'un arrêt de travail général tous les ans le jour du Premier Mai. Cependant, il apparut rapidement que les socialistes et les syndicats avaient, selon les pays, une idée très différente de ce que signifiaient les célébrations du Premier Mai. En France, en partie du fait de la tradition syndicaliste révolutionnaire des syndicats, le Premier Mai allait vite devenir l'occasion de manifestations massives, menant à des confrontations avec la police : en 1891, à Fourmies dans le Nord, la troupe tira sur une manifestation ouvrière, faisant dix morts dont des enfants. En Allemagne, par contre, les conditions économiques difficiles encourageaient les patrons à transformer les grèves en lock-out, et se combinaient aux réticences des syndicats et du SPD à accepter qu'une intervention extérieure à l'Allemagne dicte leur action, même si elle venait de l'Internationale ; il y avait donc une forte tendance à ne pas appliquer la résolution et à se limiter à la tenue de meetings à la fin de la journée de travail. Les syndicats britanniques partageaient la même réticence.
Le fait que le Parti socialiste le plus puissant d'Europe sonnât ainsi la retraite alarma les Français et les Autrichiens et, lors du Congrès de l'Internationale en 1893 à Zürich, le dirigeant socialiste autrichien Victor Adler proposa une nouvelle résolution qui insistait sur le fait que le Premier Mai devait être l'occasion d'un véritable arrêt de travail : la résolution fut adoptée contre les voix de la majorité des délégués allemands.
Trois mois après seulement, le Congrès du SPD à Cologne réduisait la portée de la résolution de l'Internationale et déclarait qu'elle ne devait être appliquée que par les organisations qui pensaient qu'il était vraiment possible d'arrêter le travail.
L'histoire des arrêts de travail du Premier Mai illustre deux aspects importants qui déterminèrent la capacité – ou l'incapacité – de l'Internationale à agir comme un seul corps. D'une part, il était impossible de ne pas voir que ce qui était possible dans un pays ne l'était pas nécessairement dans un autre : Engels lui-même était dubitatif vis-à-vis des résolutions sur le Premier Mai précisément pour cette raison, craignant que les syndicats allemands ne se discréditent en prenant des engagements qu'ils ne pourraient en fin de compte pas honorer. D'autre part, le fait même d'agir dans un cadre national, combiné aux effets dissolvants du réformisme et de l'opportunisme au sein du mouvement, avait tendance à rendre les partis et les syndicats nationaux jaloux de leurs prérogatives : c'était particulièrement vrai pour les organisations allemandes puisque le parti y étant le plus important de tous, il était encore plus réticent à se voir dicter ses orientations par des partis plus restreints qui auraient dû – c'est ce que pensaient les dirigeants allemands – suivre son exemple.
Les difficultés rencontrées dans cette première tentative d'action internationale unie présageaient mal du futur, quand l'Internationale aurait à agir pour des enjeux bien plus importants.
L'illusion de l'inévitabilité
Lors de la réunion de la salle Pétrelle, non seulement l'Internationale fut fondée mais encore elle fut fondée en tant qu'organisation marxiste. A ses débuts, le marxisme de la Deuxième Internationale, dominé par le parti allemand et, en particulier, par Karl Kautsky qui était responsable de la revue théorique du SPD, la Neue Zeit, avait fortement tendance à avoir une vision du matérialisme historique défendant l'inévitabilité de la transformation du capitalisme en socialisme. C'était déjà évident dans la critique inattendue faite par Kautsky à la proposition de programme du SPD par le Vorstand (le comité exécutif du Parti) qui devait être adopté au Congrès d'Erfurt de 1891. Dans un article publié dans la Neue Zeit, Kautsky décrivait le communisme comme "une nécessité résultant directement de la tendance historique des méthodes de production capitalistes" et critiquait la proposition du Vorstand (rédigé par le dirigeant plus âgé du SPD, Wilhelm Liebknecht) pour faire découler le communisme "non des caractéristiques de la production actuelle mais des caractéristiques de notre parti (…) L'enchaînement de la pensée dans la proposition du Vorstand est le suivant : les méthodes actuelles de production créent des conditions insupportables ; nous devons donc les éliminer. (…) A notre avis, l'enchaînement correct est le suivant : les méthodes actuelles de production créent des conditions insupportables ; cependant, elles créent aussi la possibilité et la nécessité du communisme." 19 Finalement, la proposition de Kautsky d'insister sur la "nécessité inhérente" du socialisme a été intégrée dans le préambule théorique du Programme d'Erfurt. 20
Il est certain que l'évolution du capitalisme rend le communisme possible. C'est également une nécessité pour l'humanité. Mais, dans la conception de Kautsky, c'est aussi de plus en plus quelque chose d'inévitable : la croissance des syndicats, les victoires électorales retentissantes de la social-démocratie, tout cela apparaissait comme le fruit d'une force irrésistible, prévisible avec une précision scientifique. En 1906, à la suite de la révolution russe de 1905, il écrivait que "une coalition des puissances européennes contre la Révolution, comme en 1793, n’est pas à prévoir. (…) Ce n’est donc pas à une coalition contre la Révolution qu’il faut s’attendre". 21 Dans sa polémique avec Pannekoek et Luxemburg, intitulée "La nouvelle tactique", il argumente ainsi : "Pannekoek envisage comme une conséquence naturelle de l'aiguisement des conflits de classe que les organisations prolétariennes soient détruites, que ni droit, ni loi ne les protègent plus. (…) Assurément, la tendance, l'aspiration à détruire les organisations prolétariennes croît chez l'adversaire au fur et à mesure que ces organisations se renforcent et deviennent plus dangereuses pour l'ordre existant. Mais tout autant s'accroît, alors la capacité de résistance de ces organisations, voire, sous nombre d'aspects, leur caractère irremplaçable. Priver le prolétariat de toute possibilité de s'organiser est devenu déjà chose impossible dans les pays capitalistes développés (…) Ainsi, on ne peut aujourd'hui détruire l'organisation prolétarienne que de manière provisoire…" 22
Au cours des dernières années du 19e siècle quand le capitalisme était encore ascendant – profitant de la grande expansion et de la prospérité qui allaient être appelées plus tard La Belle époque en opposition à la période d'après 1914 – l'idée que le socialisme serait un résultat naturel et inévitable du capitalisme constituait sans aucun doute une source de force pour la classe ouvrière. Cela donnait une perspective et une signification historiques à la tâche méticuleuse de construction des organisations syndicales et du parti et cela donnait aux ouvriers une grande confiance en eux-mêmes, dans leur lutte et dans l'avenir - cette confiance dans l'avenir est l'une des différences les plus frappantes dans la classe ouvrière entre le début du 20e siècle et le début du 21e.
L'histoire cependant ne progresse pas de façon linéaire et ce qui fut une force des ouvriers quand ils construisaient leurs organisations, allait se transformer en une dangereuse faiblesse. L'illusion de l'inévitabilité du passage au socialisme, l'idée qu'il pourrait être atteint de façon graduelle par la construction d'organisations ouvrières jusqu'à ce que, presque facilement, il puisse simplement occuper la place laissée vacante par une classe capitaliste dont "la propriété privée des moyens de production est devenue inconciliable avec un sage emploi et avec le plein développement de ces moyens de production" (Programme d'Erfurt), dissimulait le fait qu'une transformation profonde avait lieu dans le capitalisme du 20e siècle. La signification de ce changement des conditions, en particulier pour la lutte de classe, apparut de façon explosive dans la révolution russe de 1905 : soudain, de nouvelles méthodes d'organisation et de lutte – les soviets et la grève de masse – surgirent sur la scène. Tandis que la gauche du SPD – surtout Rosa Luxemburg dans sa célèbre brochure Grève de masse, parti et syndicats – comprenait la signification de ces conditions nouvelles et cherchait à stimuler le débat dans le parti allemand, la droite et les syndicats firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher toute discussion de la grève de masse tandis que, dans le SPD, il devenait de plus en plus difficile de publier des articles dans la presse du parti sur ce sujet.
Chez le centre et la droite du SPD, la confiance dans le futur s'était transformée en un aveuglement tel qu'en 1909, Kautsky pouvait écrire : "Maintenant, le prolétariat est devenu si puissant qu'il peut envisager une guerre avec plus de confiance. Nous ne pouvons plus parler d'une révolution prématurée, car il a déjà acquis une si grande force sur la base légale actuelle qu'on peut s'attendre à ce que la transformation de celle-ci créerait les conditions d'un progrès ultérieur.(…) Si la guerre éclatait malgré tout, le prolétariat est la seule classe qui pourrait tranquillement attendre son issue". (Le chemin du pouvoir)
L'unité obscurcit la division
Dans le Manifeste communiste, Marx nous rappelle que "la condition naturelle" des ouvriers sous le capitalisme est celle de la concurrence et de l'atomisation des individus : ce n'est que dans la lutte qu'ils peuvent réaliser une unité qui est elle-même la précondition vitale pour que la lutte réussisse. Ce n'est donc pas par hasard si la plupart des drapeaux syndicaux du 19e siècle portaient le slogan "l'unité c'est la force" ; le slogan exprimait la conscience qu'avaient les ouvriers du fait que l'unité était quelque chose pour quoi il fallait lutter et qu'il fallait sauvegarder précieusement une fois qu'on l'avait réalisée.
L'effort de chercher l'unité existe au sein et entre les organisations politiques de la classe ouvrière dans la mesure où elles n'ont pas d'intérêts distincts à défendre, ni pour elles, ni par rapport à la classe elle-même. Assez naturellement, cet effort vers l'unité trouve son expression la plus haute quand la lutte de classe est historiquement en train de se développer au point qu'il devient possible de créer un parti international : l'AIT en 1864, la Deuxième Internationale en 1889, la Troisième Internationale en 1919. Les trois Internationales elles-mêmes exprimaient l'unification politique grandissante au sein de la classe ouvrière : tandis que l'AIT avait comporté en son sein une très large gamme de positions politiques – des Proudhoniens et des Blanquistes jusqu'aux Lassalliens et aux Marxistes – la Deuxième Internationale s'était déclarée marxiste et les 21 conditions d'adhésion à la Troisième Internationale avaient l'objectif explicite de restreindre ses participants aux éléments communistes et révolutionnaires et de corriger précisément les facteurs qui avaient causé la faillite de la Deuxième, en particulier l'absence de toute autorité centralisatrice capable de prendre des décisions pour l'ensemble de l'organisation.
Néanmoins, toutes les Internationales furent de véritables lieux de débat et de lutte idéologique, y compris la Troisième : en témoigne par exemple la polémique de Lénine contre l'aile gauche et sa réponse à Herman Gorter.
La Deuxième Internationale était profondément dévouée à l'unité des différents partis socialistes, sur la base du fait qu'il y avait un seul prolétariat dans chaque pays, ayant les mêmes intérêts de classe, aussi il ne devait y avoir qu'un seul parti socialiste. Il y eut de constants efforts pour maintenir l'unité des Mencheviks et des Bolcheviks russes après 1903 mais la principale question au cours des premières années de l'Internationale fut l'unification des différents partis français. Cela atteignit un point critique en 1904 au Congrès d'Amsterdam où Jules Guesde présenta une résolution qui n'était en fait rien de plus qu'une traduction de celle adoptée l'année précédente par le SPD à Dresde, condamnant "les tactiques révisionnistes [dont le résultat] ferait qu'à la place d'un parti travaillant pour la transformation la plus rapide possible de la société bourgeoise existante en un ordre social socialiste, c'est à dire révolutionnaire dans le meilleur sens du terme, le parti deviendrait un parti se contentant de réformer la société bourgeoise". 23 C'était une condamnation explicite de l'entrée de Millerand 24 dans le gouvernement et implicite du réformisme du Parti socialiste français de Jean Jaurès. La motion de Guesde fut adoptée à une grande majorité et le Congrès se poursuivit en adoptant unanimement une motion réclamant l'unification des socialistes français : en avril suivant, le Parti socialiste et le Parti ouvrier s'unirent et formèrent la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). C'est tout à l'honneur de Jaurès d'avoir accepté le vote de la majorité et abandonné ses convictions profondes 25 au nom de l'unité de l'Internationale. 26 Ce moment fut sans doute celui où l'Internationale fut le plus capable d'imposer le principe d'une unité d'action sur ses partis membres.
L'unité d'action, si nécessaire pour le prolétariat en tant que classe, peut être une arme à double tranchant dans les moments de crise. Et l'Internationale était justement en train d'entrer dans une période de crise avec l'augmentation des tensions entre puissances impérialistes et la menace de guerre qui se rapprochait. Comme l'écrivait Rosa Luxemburg : "En dissimulant les contradictions par "l'unité" artificielle de vues incompatibles, les contradictions ne peuvent qu'atteindre un sommet, jusqu'à ce qu'elles explosent violemment tôt ou tard dans une scission (...) Ceux qui mettent en avant les divergences de vue, et combattent les opinions divergentes, travaillent à l'unité du parti. Mais ceux qui dissimulent les divergences travaillent à une réelle scission dans le parti." 27
Nulle part ce danger n'était plus évident que dans les résolutions adoptées contre la menace imminente de la guerre. Les derniers paragraphes de la résolution de Stuttgart en 1907 disent ceci : "Si une guerre menace d'éclater, c'est le devoir des classes travailleuses des pays impliqués et de leurs représentants aux parlements, soutenus par l'activité coordonnée du Bureau socialiste international, d'unir tous leurs efforts pour empêcher l'éclatement de la guerre par les moyens qu'ils estiment les plus efficaces qui, naturellement, varient selon l'acuité de la lutte de classe et celle de la situation politique générale.
Au cas où la guerre éclate malgré tout, c'est leur devoir d'intervenir afin d'y mettre rapidement un terme et par tous les moyens d'utiliser la crise politique et économique créée par la guerre pour réveiller les masses et précipiter la chute de la domination de classe capitaliste."
Le problème est que cette résolution ne dit rien des moyens avec lesquels les partis socialistes devraient intervenir dans la situation : c'est seulement "les moyens qu'ils estiment les plus efficaces". Ceci mettait sous le tapis trois questions majeures.
La première était la grève de masse que la gauche du SPD n'avait eu de cesse de chercher à mettre en avant depuis 1905 contre l'opposition déterminée et largement réussie des opportunistes dans le parti et de la direction syndicale. Les socialistes français, Jaurès en particulier, étaient de fervents défenseurs de la grève générale comme moyen d'empêcher la guerre, bien qu'ils aient entendu par cela une grève organisée par les syndicats sur un modèle syndical et non le surgissement massif d'auto-activité du prolétariat qu'envisageait Rosa Luxemburg, dans un mouvement que le Parti devait stimuler mais ne pourrait lancer de façon artificielle. Il est notable qu'une tentative conjointe du français Edouard Vaillant et de l'écossais Keir Hardie au Congrès de Copenhague en 1910 de faire adopter une résolution engageant l'Internationale à lancer une action de grève générale en cas de guerre fut rejetée par la délégation allemande.
La deuxième était l'attitude que les socialistes de chaque pays devaient adopter si leur pays était attaqué : c'était une question critique puisque dans la guerre impérialiste, un des belligérants apparaît toujours comme "l'agresseur" et l'autre comme "l'agressé". L'époque des guerres nationales progressistes n'était pas loin et les causes nationales telles que l'indépendance de la Pologne ou de l'Irlande étaient toujours à l'ordre du jour socialiste : le SDKPiL 28 de Rosa Luxemburg était très minoritaire, même dans la gauche de l'Internationale, dans son opposition à l'indépendance de la Pologne. Dans la tradition française, la mémoire de la Révolution française et de la Commune de Paris était encore très vivace et on avait tendance à identifier la révolution à la nation : d'où la prise de position de Jaurès selon laquelle "la révolution est nécessairement active. Et elle ne peut l'être qu'en défendant l'existence nationale qui lui sert de base". 29 Pour les allemands, le danger de la Russie tsariste comme soutien "barbare" de l'autocratie prussienne était également un article de foi et, en 1891, Bebel pouvait écrire que "le sol de l'Allemagne, la patrie allemande nous appartient ainsi qu'aux masses tout autant qu'aux autres. Si la Russie, ce champion de la terreur et de la barbarie, venait à attaquer l'Allemagne (…), nous sommes aussi concernés que ceux qui sont à la tête de l'Allemagne". 30
Finalement, malgré toutes leurs déclarations sur les actions prolétariennes qui seraient menées contre la guerre, les dirigeants de l'Internationale (à l'exception de la gauche) continuaient à croire à la diplomatie des classes bourgeoises pour préserver la paix. De ce fait, tandis que le Manifeste de Bâle en 1912 déclarait : "Rappelons aux gouvernements que dans les conditions actuelles en Europe et avec l'état d'esprit de la classe ouvrière, ils ne peuvent déchaîner la guerre sans se mettre eux-mêmes en danger", il pouvait en même temps "considérer que les meilleurs moyens [pour surmonter l'hostilité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne] doivent être la conclusion d'un accord entre l'Allemagne et l'Angleterre concernant la limitation des armements navals et l'abolition du droit de butin de guerre". Les classes ouvrières étaient appelées à faire de l'agitation pour la paix, non à se préparer au renversement révolutionnaire du capitalisme qui, seul, pouvait garantir cette paix : "Le Congrès fait donc appel à vous, prolétaires et socialistes de tous les pays, à faire entendre votre voix en cette heure décisive ! (…) veiller à ce que les gouvernements soient toujours conscients de la vigilance et de la volonté de paix passionnée de la part du prolétariat ! Au monde capitaliste de l'exploitation et du meurtre de masse, opposons le monde prolétarien de la paix et de la fraternité des peuples !"
L'unité de l'Internationale dont tout espoir d'action unie contre la menace de guerre dépendait, était donc fondée sur une illusion. L'Internationale était en réalité divisée en une aile droite et une aile gauche, la première prête et même impatiente de faire cause commune avec la classe dominante en défense de la nation, la deuxième qui préparait une réponse à la guerre par le renversement révolutionnaire du capital. Au 19e siècle, il était encore possible pour la droite et la gauche de coexister au sein du mouvement ouvrier et de participer à l'organisation des ouvriers comme classe consciente de ses propres intérêts ; avec l'ouverture de "l'époque des guerres et des révolutions", cette unité devint une impossibilité.
Jens (décembre 2014)
1 "Huit à dix millions de soldats s’entr’égorgeront ; ce faisant, ils dévoreront toute l’Europe comme jamais ne le fit encore une nuée de sauterelles. Les dévastations de la guerre de Trente ans, condensées en trois ou quatre années et répandues sur tout le continent : la famine, les épidémies, la férocité générale, tant des armées que des masses populaires, provoquée par l’âpreté du besoin, la confusion désespérée dans le mécanisme artificiel qui régit notre commerce, notre industrie et notre crédit, finissant dans la banqueroute générale. L’effondrement des vieux États et de leur sagesse politique routinière est tel que les couronnes rouleront par douzaines sur le pavé et qu’il ne se trouvera personne pour les ramasser ; l’impossibilité absolue de prévoir comment tout cela finira et qui sortira vainqueur de la lutte ; un seul résultat est absolument certain : l’épuisement général et la création des conditions nécessaires à la victoire finale de la classe ouvrière." Préface à la brochure de Sigismund Borkheim, cité par Lénine, "Paroles prophétiques", Pravda n°133, 2 juillet 1918 (Œuvres complètes, Tome 27, pages 526-527).
2 La Social-Démocratie serbe dont les députés refusèrent de soutenir la guerre malgré les obus qui tombaient sur Belgrade, fut une exception remarquable.
3 Cité par Lénine dans La faillite de la Deuxième Internationale, chapitre VI (Œuvres complètes, Tome 21, pages 242-243)
4 Ibid., page 243.
5 Cité par Édouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier (1871-1936), tome II. Version électronique mise en ligne par la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. p. 155. https://classiques.uqac.ca/classiques/dolleans_edouard/hist_mouv_ouvrier... [502]
6 Membre du Conseil national du Independent Labour Party, opposé à la Première Guerre mondiale, il tomba malade d'un cancer en 1915 et fut incapable de jouer un rôle actif contre la guerre.
7 Cité par James Joll, The Second International, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.165.
8 Cité par James Joll, ibid., p. 165 et dormirajamais.org/jaures-1 [503]. Ce que Jaurès ne savait pas car il ne rentra à Paris que le 29 juillet, c'est que le président français, Raymond Poincaré, avait fait un voyage en Russie et y avait fait tout son possible pour soutenir la détermination de la Russie à entrer en guerre ; Jaurès devait changer de point de vue sur les intentions du gouvernement français à son retour à Paris, dans les jours qui précédèrent son assassinat.
9 La classe dominante britannique gagne le prix de l'hypocrisie puisque l'invasion de la Belgique en vue d'attaquer l'Allemagne faisait partie de ses propres plans.
10 La faillite de la Deuxième Internationale, op.cit, chapitre I, page 213.
11 Cité par Raymond H Dominick, Wilhelm Liebknecht, University of North Carolina Press, 1982, p.344.
12 Chapitre I, "Bourgeois et prolétaires".
13 Cette expansion économique allait continuer jusqu’à la veille de la guerre.
14 Adresse inaugurale de l'Association internationale des Travailleurs, 1864.
15 Joll, op.cit., p. 28.
16 Entretemps, le parti avait pris le nom de Parti ouvrier français.
17 Les difficultés de traduction rappellent beaucoup celles des premiers congrès du CCI !
18 "Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat", (Internationalisme n° 38 – octobre 1948), https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201409/9122/nature-... [504]
19 Voir Raymond H. Dominick, Wilhelm Liebknecht, 1982, University of North Carolina Press, p361.
21 "Ancienne et nouvelle révolution", 9 décembre 1905, https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1905/12/kautsky_19051209... [505]
22 "La nouvelle tactique", Neue Zeit, 1912 (in Socialisme, la voie occidentale, PUF 1983, page 360)
23 Cité par Joll, op.cit., p. 122.
24 Alexandre Millerand était un associé de Clémenceau et fut l'arbitre du conflit social de Carmaux en 1892. Il fut élu au parlement en 1885 en tant que socialiste radical et devait devenir le dirigeant de la fraction parlementaire du Parti socialiste de France de Jaurès. En 1899, il entra dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau qui était supposé défendre la République française contre les menaces des monarchistes et des militaires antidreyfusards – bien que la réalité de cette menace ait été sujette à débat comme l'a souligné Rosa Luxemburg. Selon Jaurès et Millerand lui-même, il entra dans le gouvernement à sa propre initiative et sans consulter le parti. L'affaire provoqua un scandale immense dans l'Internationale, à la fois parce que, en tant que ministre, il partageait la responsabilité collective de la répression par le gouvernement des mouvements ouvriers et parce que l'un de ses collègues ministres était le Général Galliffet qui avait été à la tête du massacre de la Commune de Paris en 1871.
25 Quels qu’aient pu être ses désaccords avec la façon dont Millerand est entré dans le gouvernement, Jaurès était un réformiste honnête, profondément convaincu de la nécessité pour la classe ouvrière d’utiliser la voie parlementaire pour arracher des réformes à la classe dominante.
26 Ce ne fut pas le cas d'A.Briand et de R.Viviani qui préférèrent quitter le parti plutôt qu'abandonner la perspective d'un portefeuille ministériel.
27 "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558 (cité dans notre article sur la dégénérescence du SPD).
28 Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie.
29 Cité par Joll, op.cit, p. 115
30 Ibid., page 114
Conscience et organisation:
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [444]
Rubrique:
La guerre d'Espagne met en évidence les lacunes fatales de l'anarchisme (II): des voix dissidentes au sein du mouvement anarchiste
- 4696 lectures
Dans la première partie de cet article, nous avons examiné le processus qui a conduit à l'intégration de l'organisation officielle anarcho-syndicaliste, la Confédération nationale du travail (CNT), dans l'État républicain bourgeois en Espagne en 1936-37 et cherché à relier ces trahisons aux faiblesses programmatiques et théoriques sous-jacentes dans la vision du monde de l'anarchisme. Certes, ces capitulations ne sont pas restées sans opposition de la part de courants prolétariens à l'intérieur et à l'extérieur de la CNT : les Jeunesses libertaires, une tendance de gauche du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM) autour de Josep Rebull 1, le groupe bolchevique léniniste (trotskiste) autour de Grandizo Munis, l'anarchiste italien Camillo Berneri qui a édité Guerra di Classe, et en particulier les Amis de Durruti 2, animés entre autres par Jaime Balius. Tous ces groupes étaient composés dans une mesure plus ou moins grande de militants de la classe ouvrière ayant participé aux luttes héroïques de juillet 1936 et de mai 1937. Sans jamais parvenir à la clarté de la Gauche communiste italienne, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cet article, ils se sont opposés à la politique officielle de la CNT et du POUM de participation dans l'État bourgeois et de briseur de grève pendant les journées de mai 1937.
Les Amis de Durruti
Les Amis de Durruti étaient peut-être la plus importante de toutes ces tendances. Ce groupe l'emportait numériquement largement sur les autres et a été en mesure de mener une intervention importante durant les journées de mai 1937, distribuant la célèbre brochure qui définit ses positions programmatiques :
"Le Groupe des Amis de Durruti" de la CNT-FAI. Travailleurs ! Junte révolutionnaire ! Tirez sur les coupables ! Désarmez les corps armés ! Socialisez l'économie ! Dissolvez les partis politiques qui se sont retournés contre la classe ouvrière ! Vous ne devez pas abandonner la rue ! La révolution avant tout ! Saluons nos camarades du POUM qui fraternisent avec nous dans la rue ! Vive la révolution sociale ! À bas la contre-révolution !"
Ce tract est une version courte de la liste des revendications que les Amis de Durruti avaient publiée sous la forme d'une affiche murale en avril 1937 :
"Le Groupe des Amis de Durruti. À la classe ouvrière :
1 - Constitution immédiate d’une Junte révolutionnaire formée par les ouvriers de la ville, de la campagne et par les combattants.
2 - Salaire familial. Carte de rationnement. Direction de l’économie et contrôle de la distribution par les syndicats.
3 - Liquidation de la contre-révolution.
4 - Création d’une armée révolutionnaire.
5 - Contrôle absolu de l’ordre public par la classe ouvrière.
6 - Opposition ferme à tout armistice.
7 - Justice prolétarienne.
8 - Abolition des échanges de prisonniers.
Travailleurs, attention ! Notre groupe s’oppose à l’avancée de la contre-révolution. Les décrets sur l’ordre public, soutenus par Aiguadé, ne seront pas appliqués. Nous exigeons la libération de Maroto et des autres camarades détenus.
Tout le pouvoir à la classe ouvrière.
Tout le pouvoir économique aux syndicats.
Contre la Généralité, la Junte révolutionnaire."
Les autres groupes, y compris les trotskistes, avaient tendance à voir les Amis de Durruti comme une avant-garde potentielle : Munis était même optimiste quant à son évolution vers le trotskisme. Mais peut-être l'aspect le plus important du Groupe des Amis de Durruti était que, bien qu'émergeant de la CNT elle-même, il ait reconnu l'incapacité de celle-ci à développer une théorie révolutionnaire et donc le programme révolutionnaire qu'exigeait, à son avis, la situation en Espagne. Agustin Guillamón attire notre attention sur un passage de la brochure Vers une nouvelle révolution, publiée en janvier 1938, où l'auteur, Balius, écrit:
"La CNT était totalement dépourvue de théorie révolutionnaire. Nous n'avions pas de programme concret. Nous ne savions pas où nous allions. Nous avions du lyrisme en abondance : mais quand tout est dit et fait, nous ne savions pas quoi faire avec nos masses de travailleurs ni comment donner de la substance à l'effusion populaire qui avait éclaté à l'intérieur de nos organisations. Ne sachant pas quoi faire, nous avons remis la révolution sur un plateau à la bourgeoisie et aux marxistes qui soutiennent la farce d'antan. Pire, nous avons fourni à la bourgeoisie une marge de manœuvre lui permettant de se reprendre, de se réorganiser et de se comporter comme le ferait un conquérant" 3
Comme indiqué dans notre article de la Revue internationale n° 102, "Anarchisme et communisme", la CNT avait en fait une théorie fumeuse à ce niveau - une théorie justifiant la participation dans l'État bourgeois, surtout au nom de l'antifascisme. Mais le Groupe des Amis de Durruti avait raison dans le sens plus général où le prolétariat ne peut pas faire la révolution sans une compréhension claire et consciente de la direction dans laquelle il se dirige, et c'est la tâche spécifique de la minorité révolutionnaire de développer et d'élaborer une telle compréhension, basée sur l'expérience de la classe dans son ensemble.
Dans cette quête de clarté programmatique, le Groupe des Amis de Durruti a été obligé de remettre en question certains postulats fondamentaux de l'anarchisme, notamment le rejet de la nécessité de la dictature du prolétariat et d'une avant-garde révolutionnaire combattant au sein de la classe ouvrière pour sa réalisation. Guillamón reconnaît clairement l'avancée faite par les Amis de Durruti sur ce plan, en particulier dans son analyse des articles que Balius a écrits en exil :
"Après une lecture de ces deux articles, il faut reconnaître que l'évolution de la pensée politique de Balius, basée sur une analyse de la richesse de l'expérience faite au cours de la guerre civile, l'avait conduit à aborder des questions taboues dans l'idéologie anarchiste : 1 La nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir. 2 L'inéluctabilité de la destruction de l'appareil d'État capitaliste pour ouvrir la voie à une alternative prolétarienne. 3 Le rôle indispensable d'une direction révolutionnaire" 4. À part les réflexions de Balius, la notion d'une direction révolutionnaire était, dans l'activité pratique du groupe, plus implicite que formulée explicitement, et n'était pas vraiment compatible avec la définition que le Groupe des Amis de Durruti avait de lui-même, à savoir un "groupe d'affinité" ce qui, au mieux, implique une formation politique limitée dans le temps et à des objectifs spécifiques, et non une organisation politique permanente basée sur un ensemble défini de principes programmatiques et organisationnels. Mais la reconnaissance par le groupe de la nécessité d'un organe de pouvoir prolétarien est plus explicite. Elle est contenue dans l'idée de "junte révolutionnaire", dont il admettait qu'elle constituait un certain type d'innovation pour l'anarchisme : "nous introduisons une légère variation de l'anarchisme dans notre programme. La mise en place d'une junte révolutionnaire" 5. Munis, dans une interview au journal français trotskiste Lutte ouvrière, considère la junte comme équivalente à l'idée de soviet et ne doute pas que "Ce cercle de travailleurs révolutionnaires [les Amis de Durruti] représentait un début d'évolution de l'anarchisme en direction du marxisme. Il avait été conduit à remplacer la théorie du communisme libertaire par celle de la "junte révolutionnaire" (soviet) en tant qu'incarnation du pouvoir prolétarien, élu démocratiquement par les travailleurs" 6.
Dans son livre, Guillamón reconnaît cette convergence entre les "innovations" des Amis de Durruti et les positions classiques du marxisme, bien qu'il s'attache à réfuter toute idée selon laquelle le groupe aurait été directement influencé par les groupes marxistes avec lesquels il était en contact, comme les bolcheviks-léninistes. Le groupe lui-même aurait certainement rejeté avec colère l'"accusation" d'évoluer vers le marxisme, qu'il était à peine capable de distinguer de ses caricatures contre-révolutionnaires, comme en témoigne le passage reproduit précédemment de la brochure de Balius. Mais si le marxisme est effectivement la théorie révolutionnaire du prolétariat, il n'est pas surprenant que les prolétaires révolutionnaires, réfléchissant sur les leçons de la lutte de classe, soient amenés à ses conclusions fondamentales. La question de l'influence spécifique dans ce processus de tel ou tel groupe politique n'est pas négligeable mais elle constitue un élément secondaire.
Une rupture incomplète avec l'anarchisme
Néanmoins, malgré ces avancées, le Groupe des Amis de Durruti n'est jamais parvenu à effectuer une rupture profonde avec l'anarchisme. Ils restèrent fortement attachés aux traditions et aux idées anarcho-syndicalistes. Pour rejoindre le groupe, il fallait aussi être membre de la CNT. Comme on peut le voir sur l'affiche du mois d'avril et dans d'autres documents, le groupe considérait toujours que le pouvoir des travailleurs pouvait s'exprimer non seulement à travers une "junte révolutionnaire" ou des comités de travailleurs créés au cours de la lutte mais, également, au moyen du contrôle syndical de l'économie et par l'existence de "municipalités libres" 7 - formules qui révèlent une continuité avec le programme de Saragosse dont nous avons examiné les importantes limites dans la première partie de cet article. Ainsi, le programme élaboré par les Amis de Durruti n'a pas réussi à se baser sur la véritable expérience des mouvements révolutionnaires de 1905 et de 1917 à 1923, où dans la pratique la classe ouvrière était allée au-delà de la forme syndicale et dans lesquels les Spartakistes, par exemple, avaient appelé à la dissolution de tous les organes existants de gouvernement local et leur remplacement par les conseils ouvriers. Il est significatif à cet égard que, dans les colonnes du journal du groupe, El Amigo del Pueblo [L'Ami du peuple], qui cherchait à tirer les leçons des événements de 1936-37, une importante série historique sur l'expérience de la Révolution bourgeoise française ait été publiée, et rien sur les révolutions prolétariennes en Russie ou en Allemagne.
Les Amis de Durruti considéraient certainement la "junte révolutionnaire" comme un moyen pour le prolétariat de prendre le pouvoir en 1937, mais pour autant Munis avait-il raison de dire que la "junte révolutionnaire" équivalait aux soviets ? Il y a ici une zone de flou, sans doute précisément à cause de l'incapacité apparente des Amis de Durruti à se relier à l'expérience des conseils ouvriers en dehors de l'Espagne. Par exemple, la vision du groupe concernant la manière dont la junte se constituerait n’apparaît pas clairement. La voyait-il naître comme émanation directe des assemblées générales dans les usines et dans les milices, ou devait-elle être le produit des travailleurs les plus déterminés eux-mêmes ? Dans un article du n° 6 de El Amigo del Pueblo, le groupe "défend que les seuls participants à la Junte révolutionnaire devraient être les travailleurs de la ville et de la campagne et les combattants qui, à chaque moment crucial du conflit, sont apparus comme les plus fervents défenseurs de la révolution sociale" 8. Guillamón n'a pas de doute quant à l'implication d'une telle vision : "L'évolution de la pensée politique des Amis de Durruti était désormais inéluctable. Après que la nécessité d'une dictature du prolétariat eut été reconnue, la prochaine question à se poser était : à qui revient-il d'exercer cette dictature du prolétariat ? La réponse était : à la Junte révolutionnaire, définie rapidement comme étant l'avant-garde révolutionnaire. Et son rôle? Nous ne pouvons pas croire qu'il soit autre que celui que les marxistes ont assigné au parti révolutionnaire" 9. Mais, de notre point de vue, l'une des leçons fondamentales des mouvements révolutionnaires de 1917 à 1923, et de la révolution russe en particulier, est que le parti révolutionnaire ne peut pas assumer son rôle s'il s'identifie à la dictature du prolétariat. Ici Guillamón semble théoriser les propres ambiguïtés des Amis de Durruti sur cette question ; nous reviendrons plus loin sur ce sujet. En tout cas, il est difficile de ne pas avoir l'impression que la junte était une sorte d'expédient, plutôt que la "forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" telle que des marxistes comme Lénine et Trotsky ont qualifié les soviets. Dans Towards a fresh revolution, par exemple, Balius fait valoir que la CNT elle-même aurait dû prendre le pouvoir : "Quand une organisation a passé toute son existence à prêcher la révolution, elle a l'obligation d'agir chaque fois qu'un ensemble de circonstances favorables survient. Et en juillet, l'occasion s'était présentée. La CNT aurait dû sauter dans le siège de conducteur du pays et donner un sévère coup de grâce à tout ce qui était dépassé et archaïque. De cette façon, nous aurions gagné la guerre et sauvé la révolution" 10. En plus du fait qu'il sous-estime gravement le profond processus de dégénérescence qui avait rongé la CNT bien avant 1936 11, ces propos révèlent à nouveau une incapacité à assimiler les leçons de toute la vague révolutionnaire de 1917-23, qui avait clarifié pourquoi ce sont les soviets et non les syndicats qui sont la forme indispensable de la dictature du prolétariat.
L'attachement des Amis de Durruti à la CNT eut également des répercussions importantes sur le plan organisationnel. Dans leur manifeste du 8 mai, le rôle joué par les échelons supérieurs de la CNT dans le sabotage du soulèvement de mai 1937 est caractérisé sans hésitation comme une trahison ; ceux qu'il dénonçait comme des traîtres avaient déjà attaqué les Amis de Durruti en les traitant d'agents provocateurs, faisant ainsi écho aux calomnies habituelles des staliniens, et les avaient menacés d'expulsion immédiate de la CNT. Cet antagonisme féroce était certes un reflet de la division de classe entre le camp politique du prolétariat et des forces qui étaient devenues une agence de l'État bourgeois. Mais, face à la nécessité d'opérer une rupture décisive avec la CNT, les Amis de Durruti firent marche arrière et acceptèrent d'abandonner l'accusation de trahison en échange de la levée de la demande d'expulsion les concernant, un changement qui sans aucun doute mina la capacité du groupe à continuer à fonctionner de façon indépendante. L'attachement sentimental à la CNT était tout simplement trop fort pour une grande partie des militants, même si un nombre important d'entre eux - et pas seulement des membres des Amis de Durruti ou d'autres groupes dissidents - avaient déchiré leur carte face à l'ordre de démanteler les barricades et de retourner au travail en mai 1937. Cet attachement est résumé dans la décision de Jaoquin Aubi et de Rosa Muñoz de démissionner des Amis de Durruti face à la menace d'expulsion de la CNT : "Je continue à considérer les camarades appartenant aux Amis de Durruti comme des camarades : mais je répète ce que j'ai toujours dit dans des réunions plénières à Barcelone : "la CNT a été le ventre qui m'a donné le jour et la CNT sera ma tombe"" 12
Les limitations "nationales" de la vision des Amis de Durruti
Dans la première partie de cet article, nous avons montré que le programme de la CNT était coincé dans un cadre strictement national qui voyait le communisme libertaire comme étant possible dans le contexte d'un seul pays auto-suffisant. Certes les Amis de Durruti avaient une forte attitude internationaliste à un niveau presque instinctif - par exemple, dans leur appel à la classe ouvrière internationale à venir en aide aux travailleurs insurgés en mai 1937 - mais celle-ci ne s'appuyait pas théoriquement sur une analyse sérieuse du rapport de forces entre les classes à une échelle mondiale et historique, ni sur une capacité à développer un programme basé sur l'expérience internationale de la classe ouvrière, comme nous l'avons déjà noté au sujet de l'imprécision de leur notion de "Junte révolutionnaire". Guillamón est particulièrement cinglant dans les critiques de cette faiblesse telle qu'elle s'exprime dans un chapitre de la brochure de Balius :
"Le chapitre suivant de la brochure aborde le sujet de l'indépendance de l'Espagne. Il est entièrement rempli de notions obtuses, à courte vue ou mieux adaptées à la petite-bourgeoisie. Un nationalisme bon marché et vide est défendu au moyen de références inconsistantes, simplistes, à la politique internationale. Nous allons donc passer ce chapitre, en disant seulement que les Amis de Durruti adhèrent à des idées bourgeoises, simplistes et/ou passéistes en matière de nationalisme" 13.
Les influences du nationalisme étaient particulièrement cruciales dans l'incapacité des Amis de Durruti à comprendre la véritable nature de la guerre d'Espagne. Comme nous l'écrivions dans notre article de la Revue internationale 102, "Anarchisme et communisme" :
"De fait les considérations des Amis de Durruti sur la guerre étaient faites en partant des positions nationalistes étroites et ahistoriques de l'anarchisme, les amenant à comprendre les événements actuels en Espagne en continuité avec les tentatives ridicules de révolution qu'avait faites la bourgeoisie en 1808 contre l'invasion napoléonienne. Alors que le mouvement ouvrier international débattait de la défaite du prolétariat mondial et de la perspective d'une Seconde Guerre mondiale, les anarchistes en Espagne en étaient à Fernand VII et à Napoléon.
"Aujourd'hui se répète ce qui s'est passé à l'époque de Fernand VII. De la même manière se tient à Vienne une réunion des dictateurs fascistes visant à préciser leur intervention en Espagne. Et le rôle qu'avait El Empecinado est joué aujourd'hui par les travailleurs en armes. L'Allemagne et l'Italie manquent de matières premières. Ces deux pays ont besoin de fer, de cuivre, de plomb, de mercure. Mais ces minerais espagnols sont détenus par la France et l'Angleterre. Alors qu'ils essaient de conquérir l'Espagne, l'Angleterre ne proteste pas de manière vigoureuse. En sous-main, elle tente de négocier avec Franco (...) La classe travailleuse a pour devoir d'obtenir l'indépendance de l'Espagne. Ce n'est pas le capital national qui y parviendra, étant donné que le capital au niveau international est intimement lié d'un bout à l'autre. C'est le drame de l'Espagne actuelle. Aux travailleurs il revient la tâche de chasser les capitalistes étrangers. Ce n'est pas un problème patriotique. C'est une question d'intérêts de classe. (Jaime Balius, Vers une nouvelle révolution, 1997, Centre de documentation historico-sociale, Etcétera,p. 32-33.)"
Comme on peut le constater toutes les ficelles sont bonnes pour transformer une guerre impérialiste entre États en guerre patriotique, en guerre "de classes". C'est une manifestation du désarmement politique auquel 1'anarchisme soumet les militants ouvriers sincères comme les Amis de Durruti. Ces camarades, qui cherchaient à lutter contre la guerre et pour la révolution, furent incapables de trouver le point de départ pour une lutte efficace : l'appel aux ouvriers et aux paysans (embrigadés par les deux camps, républicain et franquiste) à déserter, à retourner leurs fusils contre les officiers qui les opprimaient, à revenir à 1'arrière et à lutter par les grèves, par les manifestations, sur un terrain de classe contre le capitalisme dans son ensemble."
Et cela nous amène à la question la plus importante de toutes : la position des Amis de Durruti sur la nature de la guerre d'Espagne. Ici, il ne fait aucun doute que le nom du groupe signifie plus qu'une référence sentimentale à Durruti 14, dont la bravoure et la sincérité étaient très admirées par le prolétariat espagnol. Durruti était un militant de la classe ouvrière, mais il fut totalement incapable de faire une critique approfondie de ce qui était arrivé aux travailleurs espagnols après le soulèvement de juillet 1936 - de la façon dont l'idéologie antifasciste et le transfert de la lutte du front social aux fronts militaires constituaient déjà une étape décisive dans l’entraînement des travailleurs dans un conflit impérialiste. Durruti, comme beaucoup d'anarchistes sincères, était un "jusqu’au-boutiste" 15 quand il s'est agi de la guerre, il affirma que la guerre et la révolution, loin d'être en contradiction l'une avec l'autre, pourraient se renforcer mutuellement pour autant que la lutte sur les fronts soit combinée avec les transformations "sociales'' à l'arrière que Durruti identifiait avec l'instauration du communisme libertaire. Mais, comme Bilan l'a souligné, dans le contexte d'une guerre militaire entre blocs capitalistes, les entreprises industrielles et agricoles autogérées ne pouvaient fonctionner que comme un moyen de mobiliser davantage les travailleurs pour la guerre. Ce fut un "communisme de guerre" qui nourrissait une guerre impérialiste.
Les Amis de Durruti n'ont jamais contesté cette idée que la guerre et la révolution devaient être menées simultanément. Comme Durruti, ils ont appelé à la mobilisation totale de la population pour la guerre, même quand ils ont analysé que la guerre était perdue. 16
La position de Guillamón sur la guerre et ses critiques à Bilan
Pour Guillamón, en résumé, les événements d'Espagne étaient "la tombe de l'anarchisme en tant que théorie révolutionnaire" 17. Nous pouvons seulement ajouter que, malgré l'héroïsme des Amis de Durruti et leurs efforts louables pour développer une théorie révolutionnaire, le sol anarchiste sur lequel ils ont tenté de cultiver cette fleur a prouvé son inhospitalité.
Mais Guillamón lui-même n'est pas exempt d'ambiguïtés sur la guerre d'Espagne et cela est évident dans ses critiques à la Fraction italienne de la Gauche communiste qui publiait Bilan.
Sur la question centrale de la guerre, la position de Guillamón, comme il la résume dans son livre, semble assez claire :
"1. Sans destruction de l'État, il n'y a pas révolution. Le Comité central des milices antifascistes de Catalogne (CCMA) n'était pas un organe de double pouvoir, mais une agence pour la mobilisation militaire des travailleurs, pour l'union sacrée avec la bourgeoisie, en bref, une agence de la collaboration de classe.
2. L'armement du peuple n'a pas de sens. La nature de la guerre militaire est déterminée par la nature de la classe qui la dirige. Une armée qui combat pour la défense d'un État bourgeois, fût-il antifasciste, est une armée au service du capitalisme.
3. La guerre entre un État fasciste et un État antifasciste n'est pas une guerre de classe révolutionnaire. L'intervention du prolétariat dans un des camps est une indication qu'il a déjà été vaincu. L'infériorité technique et professionnelle insurmontable de la part de l'armée populaire ou basée sur des milices était implicite dans la lutte armée sur un front militaire.
4. La guerre sur les fronts militaires impliquait l'abandon du terrain de classe. L'abandon de la lutte de classe signifiait la défaite du processus révolutionnaire.
5. Dans l'Espagne d'août 1936, la révolution n'était plus présente et seule la guerre était possible : une guerre militaire non-révolutionnaire.
6. Les collectivisations et socialisations dans l'économie ne comptent pour rien quand le pouvoir d'État est dans les mains de la bourgeoisie." 18
Cela ressemble beaucoup à une reprise des positions défendues par la Gauche communiste. Mais Guillamón rejette effectivement certaines des positions les plus importantes de Bilan, comme nous pouvons le voir dans un autre document, "Thèses sur la guerre civile espagnole et la situation révolutionnaire créée le 19 juillet 1936", publié en 2001 par Balance 19. Tout en reconnaissant que certains aspects de l'analyse des événements en Espagne par Bilan étaient brillants, il porte des critiques fondamentales à la fois à cette analyse et aux conclusions politiques qui en sont tirées :
1. Bilan n'a pas vu qu'il y avait une "situation révolutionnaire" en juillet 1936. "D'une part, Bilan reconnaît le caractère de classe des luttes de Juillet 36 et Mai 37, mais, d'autre part, non seulement il nie leur caractère révolutionnaire, mais il nie même l'existence d'une situation révolutionnaire. Ce point de vue ne peut s'expliquer que par l'éloignement géographique d'un groupe parisien totalement isolé, qui a donné priorité à ses analyses plutôt qu'à l'étude de la réalité espagnole. Il n'y a pas un seul mot dans Bilan sur la véritable nature des comités, ni sur la lutte du prolétariat de Barcelone pour la socialisation et contre la collectivisation, ni sur les débats et les confrontations dans les Colonnes de la milice concernant la militarisation des milices, ni de critique sérieuse des positions des Amis de Durruti, pour la simple raison que Bilan ignore pratiquement totalement l'existence et l'importance de toutes ces questions. Il était facile de justifier cette ignorance en niant l'existence d'une situation révolutionnaire. L'analyse de Bilan échoue parce que, à son avis, l'absence d'un parti révolutionnaire (bordiguiste) implique nécessairement l'absence d'une situation révolutionnaire".
2. L'analyse que fait Bilan des événements de mai est incohérente : "L'incohérence de Bilan est mise en évidence par l'analyse des journées de mai 1937. Il se trouve que la "révolution" du 19 Juillet, qui a cessé une semaine plus tard d'être une révolution parce que ses objectifs de classe ont été transformés en objectifs de guerre, réapparaît aujourd'hui comme le Phénix de l'histoire, comme un fantôme qui s'était caché dans quelque lieu inconnu. Et maintenant, il se trouve que, en mai 1937, les travailleurs ont été une fois de plus "révolutionnaires", et ont défendu la révolution des barricades. Comment cela a-t-il pu être le cas puisque, selon Bilan, il n'y avait pas eu de révolution ? Ici, Bilan est tout empêtré. Le 19 Juillet (selon Bilan) il y a eu une révolution, mais une semaine plus tard, il n'y avait plus de révolution, car il n'y avait pas le parti (bordiguiste) ; en mai 1937, il y eut une autre semaine révolutionnaire. Mais comment pouvons-nous caractériser la situation entre le 26 Juillet 1936 et le 3 mai 1937 ? On ne nous dit rien à ce sujet. La révolution est considérée comme une rivière intermittente [parfois en surface, parfois souterraine comme la rivière d'Espagne "Guadiana", note du traducteur Libcom] qui émerge sur la scène historique lorsque Bilan veut expliquer certains événements qu'il ne comprend pas et n'est pas capable d'expliquer".
3. La position de Bilan sur le parti et l'idée que c'est le parti, pas la classe, qui fait la révolution, est basée sur un "concept léniniste, totalitaire et substitutionniste du parti".
4. Les conclusions pratiques de Bilan sur la guerre étaient "réactionnaires" : "Selon Bilan, le prolétariat a été plongé dans une guerre antifasciste, c’est-à-dire qu'il a été enrôlé dans une guerre impérialiste entre une bourgeoisie démocratique et une bourgeoisie fasciste. Dans cette situation, les seules positions appropriées étaient la désertion et le boycott, ou bien attendre des temps meilleurs, lorsque le parti (bordiguiste) entrerait sur la scène de l'histoire depuis les coulisses où il attendait son heure". Ainsi : nier l'existence d'une situation révolutionnaire en 1936 a amené Bilan à des "positions politiques réactionnaires telles que briser les fronts militaires, la fraternisation avec les troupes franquistes, couper l'acheminement des armes aux troupes républicaines".
Pour répondre en profondeur aux critiques que porte Guillamón à la Fraction italienne, il faudrait un autre article, mais nous voulons faire quelques remarques :
- Il est faux de dire que Bilan ignorait totalement le mouvement réel de la classe en Espagne. Il est vrai qu'il semblait ne pas connaître les Amis de Durruti, mais il était en contact avec Camillo Berneri. Ainsi, en dépit de ses critiques sévères envers l'anarchisme, il était tout à fait capable de reconnaître qu'une résistance prolétarienne pouvait encore apparaître dans ses rangs. Plus important encore, il a pu, comme Guillamón le reconnaît, percevoir le caractère de classe des événements de juillet 1936 et de mai 1937, et il est tout simplement faux de prétendre qu'il n'a pas dit pas un mot sur les comités qui ont émergé de l'insurrection de juillet : dans la première partie de cet article, nous avons cité un extrait du texte "La leçon des événements d'Espagne" publié dans Bilan n° 36 qui mentionne ces comités, les considère comme des organes prolétariens mais reconnaît également le processus de récupération rapide dont il font l'objet via les "collectivisations". Bilan laisse entendre dans ce même article que le pouvoir était à la portée des travailleurs et que la prochaine étape était la destruction de l'État capitaliste. Mais Bilan avait un cadre historique et international lui permettant d'avoir une vision plus claire du contexte général ayant déterminé l'isolement tragique du prolétariat espagnol - celui de la contre-révolution triomphante et d'un cours vers la guerre impérialiste mondiale, dont le conflit espagnol constituait une répétition générale. Guillamón traite à peine de cela, de la même manière que c'était plus ou moins absent des analyses des anarchistes espagnols à l'époque ;
- Les événements de mai ont confirmé l'analyse de Bilan plutôt que de montrer ses confusions. La lutte des classes, comme la conscience de classe elle-même, est en effet comparable à un fleuve qui peut devenir souterrain pour réapparaître ensuite à la surface : l'exemple le plus important de cela étant les événements révolutionnaires de 1917-1918 qui ont suivi une terrible défaite de la classe sur le plan idéologique en 1914. Le fait que l'élan prolétarien initial de juillet 1936 ait été contrecarré et détourné ne signifie pas que l'esprit combatif et la conscience de classe du prolétariat espagnol avaient été totalement brisés, et ils réapparurent dans une dernière action d'arrière-garde contre les attaques incessantes envers la classe, imposées surtout par la bourgeoisie républicaine. Mais cette réaction a été écrasée par les forces combinées de la classe capitaliste, des staliniens à la CNT, et ce fut un coup dont le prolétariat espagnol ne s'est pas relevé ;
- Rejeter la position de Bilan sur le parti comme étant "léniniste et substitutionniste", comme le fait Guillamón, est un exemple de raccourci douteux, surprenant de la part d'un historien normalement aussi rigoureux. Guillamón laisse entendre que Bilan voyait le parti comme un deus ex machina, qui attend dans les coulisses le moment venu. Cela pourrait être dit à propos des bordiguistes aujourd'hui qui prétendent être le Parti, mais Guillamón ignore totalement la conception de Bilan de ce qu'est la Fraction, qui est basée sur la reconnaissance que le parti ne peut pas exister dans une situation de contre-révolution et de défaite, précisément parce que le parti est le produit de la classe et non l'inverse. Il est vrai que la Gauche italienne n'avait pas encore rompu avec l'idée substitutionniste du parti qui prend le pouvoir et exerce la dictature du prolétariat - mais nous avons déjà montré que Guillamón lui-même n'est pas entièrement dégagé de cette conception, et Bilan avait commencé à élaborer un cadre global permettant de rompre avec le substitutionnisme 20. En Espagne en 1936, Bilan explique l'absence de parti comme le produit de la défaite de la classe ouvrière au niveau mondial et, bien qu'il ne néglige pas la possibilité de soulèvements révolutionnaires, il voyait que les dés étaient jetés, en défaveur du prolétariat. Et comme Guillamón le reconnaît lui-même, une révolution qui ne donne pas naissance à un parti révolutionnaire ne peut pas réussir. Ainsi, contrairement à ce qui fut si souvent faussement affirmé, Bilan n'avait pas une position idéaliste du type "il n'y a pas de révolution en Espagne parce qu'il n'y a pas de parti", mais une position matérialiste "il n'y a pas de parti parce qu'il n'y a pas de révolution".
Là où on peut voir le plus clairement l'incohérence de Guillamón, c'est dans le rejet de la position "défaitiste révolutionnaire" de Bilan sur la guerre. Guillamón accepte l'idée que la guerre a été très rapidement transformée en une guerre non-révolutionnaire, et que l'existence de milices armées, de collectivisations, etc. n'a apporté aucune changement à cela Mais l'idée d'une "guerre non-révolutionnaire" est ambiguë : Guillamón semble réticent à accepter l'idée que c'était une guerre impérialiste et que la lutte des classes ne pouvait se ranimer qu'en revenant au terrain de classe de la défense des intérêts matériels du prolétariat, contre la discipline du travail et les sacrifices imposés par la guerre. Cela aurait certainement sapé les fronts militaires et saboté l'armée républicaine – et c'est précisément la raison de la répression sauvage lors des événements de mai. Et pourtant, quand les choses se gâtent, Guillamón fait valoir que les méthodes classiques de lutte du prolétariat contre la guerre impérialiste - les grèves, les mutineries, les désertions, les fraternisations, les grèves à l'arrière - étaient réactionnaires, même s'il s'agissait d'une "guerre non-révolutionnaire". Ceci est, au mieux, une position centriste qui aligne Guillamón sur tous ceux qui ont cédé au chant des sirènes de la participation à la guerre, des trotskistes aux anarchistes, jusqu'à des parties de la Gauche communiste elle-même. Quant à l'isolement de Bilan, celui-ci l'a reconnu, non comme un produit de la géographie, mais bien de la période sombre qu'il traversait, quand tout autour de lui n'était que trahison des principes de l'internationalisme. Comme il l'a écrit dans un article intitulé précisément "L'isolement de notre Fraction devant les événements d’Espagne" du n° 36 de sa revue (Octobre-Novembre 1936) :
"Notre isolement n'est pas fortuit : il est la conséquence d'une profonde victoire du capitalisme mondial qui est parvenu à gangrener jusqu'aux groupes de la Gauche communiste dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour Trotsky. Nous ne poussons pas la prétention jusqu'à affirmer qu'à l'heure actuelle nous restons le seul groupe dont les positions aient été confirmées sur tous les points par la marche des événements, mais ce que nous prétendons catégoriquement c'est que, bien ou mal, nos positions ont été une affirmation permanente de la nécessité d'une action indépendante et de classe du prolétariat. Et c'est sur ce terrain que s'est précisément vérifiée la faillite de tous les groupes trotskistes et semi-trotskistes."
C'était la force de la tradition marxiste italienne qu'elle ait été capable de donner naissance à une Fraction aussi clairvoyante que Bilan. Ce fut une grave faiblesse du mouvement ouvrier en Espagne, caractérisé par la prédominance historique de l'anarchisme sur le marxisme, qu'aucune fraction de ce type n'ait pu y émerger.
Berneri et ses successeurs
Dans le manifeste produit en réponse à l'écrasement de la révolte des travailleurs en mai 1937 à Barcelone, les Fractions italienne et belge de la Gauche communiste ont rendu hommage à la mémoire de Camillo Berneri 21, dont l'assassinat par la police stalinienne fit partie de la répression générale de l'État républicain contre tous ceux qui, travailleurs et révolutionnaires, avaient joué un rôle actif durant les journées de mai et qui, en paroles ou en actes, s'étaient opposés à la politique de la CNT-FAI de collaboration avec l'État capitaliste.
Voici ce qu'écrivaient les Fractions de gauche en juin 1937, dans Bilan n° 41 :
"Les ouvriers du monde entier s'inclinent devant tous les morts et revendiquent leurs cadavres contre tous les traîtres : ceux d'hier, comme ceux d'aujourd'hui. Le prolétariat du monde entier salue en Berneri un des siens, et son immolation à l'idéal anarchiste est encore une protestation contre une école politique qui s'est effondrée au cours des événements d'Espagne : c'est sous la direction d'un gouvernement à participation anarchiste que la police a répété sur le corps de Berneri l'exploit de Mussolini sur le corps de Matteotti !"
Dans un autre article du même numéro, intitulé "Antonio Gramsci – Camillo Berneri", Bilan note que ces deux militants, qui sont morts à quelques semaines d'intervalle, avaient donné leur vie à la cause du prolétariat en dépit de graves lacunes de leurs positions idéologiques :
"Berneri, un chef des anarchistes ? Non, parce que, même après son assassinat, la CNT et la FAI mobilisent les ouvriers sur le danger de leur évincement d’un gouvernement qui est recouvert du sang de Berneri. Ce dernier avait cru pouvoir s’appuyer sur l’école anarchiste pour contribuer à l’œuvre de rédemption sociale des opprimés et c’est un ministère comprenant des anarchistes qui a lancé l’attaque contre les exploités de Barcelone !
Les vies de Gramsci et de Berneri appartiennent au prolétariat qui s’inspire de leur exemple pour continuer sa lutte. Et la victoire communiste permettra aux masses d’honorer dignement les deux disparus, parce qu’elle permettra aussi de mieux comprendre les erreurs dont ils furent les victimes et qui ont dû certainement ajouter, aux sévices de l’ennemi, le tourment intime de voir les événements contredire tragiquement leurs convictions, leurs idéologies."
L'article se termine en disant que le numéro suivant de Bilan reviendrait plus en détail sur ces deux figures du mouvement ouvrier. Dans le numéro en question (Bilan n° 42, juillet-août 1937), il y a en effet un article spécifique consacré à Gramsci qui, bien que d'un intérêt considérable, est en dehors du sujet du présent article. Berneri lui-même est mentionné dans l'éditorial de ce numéro, "La répression en Espagne et en Russie", qui examine les tactiques que la police avait utilisées pour assassiner Berneri et son camarade Barbieri :
"Nous savons aussi comment Berneri a été assassiné. Deux policiers se présentent d’abord chez lui. "Nous sommes des amis", disent-ils. Dans quel but viennent-ils ? Ils viennent se rendre compte où se trouvent deux fusils. Ils retournent, pour faire une simple perquisition, et ils emmènent les deux armes. Ils reviennent une dernière fois et cette fois c’est pour le coup final. Ils sont sûrs que Berneri et son camarade sont désarmés, qu’aucune possibilité de défense ne leur reste, ils procèdent à leur arrestation en vertu d’un mandat légalement décerné par les autorités d’un gouvernement dont font partie les amis politiques de Berneri, les représentants de la CNT et de la FAI. Les femmes de Berneri et de Barbieri apprendront, par la suite, que les cadavres de leurs camarades sont à la morgue.
Nous savons enfin que dans les rues de Madrid et de Barcelone, cela devient courant désormais. Des escadres armées, à la solde des centristes, parcourent les rues et tuent les ouvriers soupçonnés d’idées subversives.
Et tout cela, sans que l’édifice des socialisations, des milices, des syndicats gérant la production, ne soit encore anéanti par une nouvelle réorganisation de l’État capitaliste."
En fait il existe à ce jour différents récits de l'assassinat : celui d'Augustin Souchy contemporain des événements, "La semaine tragique en mai", publié à l'origine dans Spain and the World puis republié dans The May Days Barcelona 1937 (Freedom Press, 1998) qui est très similaire au récit de Bilan. D'autre part, il y a la courte biographie sur Libcom, écrite par Toni 22, et selon laquelle Berneri a été abattu dans la rue après être allé aux bureaux de Radio Barcelona pour parler de la mort de Gramsci. Et il existe encore d'autres variations dans la description des détails. Mais la question essentielle, comme l'a dit Bilan, était que dans la répression générale qui a suivi la défaite de la révolte de mai 1937, il était devenu pratique courante de procéder à l'élimination physique des éléments gênants comme Berneri qui eurent le courage de critiquer le gouvernement social-démocrate/stalinien/anarchiste, et la politique étrangère contre-révolutionnaire de l'URSS. Les staliniens, qui avaient la mainmise sur l'appareil de la police, étaient aux avant-postes de ces assassinats. Bien qu'il ait continué à utiliser le terme "centristes" pour décrire les staliniens, Bilan les voyait clairement pour ce qu'ils étaient : des ennemis violents de la classe ouvrière, des flics et des assassins avec lesquels aucune collaboration n'était possible. Cela tranche totalement avec la position des trotskistes qui continuaient à qualifier les "PC" de partis ouvriers avec qui un front uni était toujours souhaitable, et l'URSS de régime qui doit toujours être défendu contre l'attaque impérialiste.
Quel terrain commun entre Berneri et Bilan ?
Si certains des faits concernant l'assassinat de Berneri demeurent encore assez flous, nous sommes encore moins clairs sur la relation entre la Fraction italienne et Berneri. Notre livre sur la Gauche italienne nous dit que, suite au départ de la minorité de Bilan pour combattre dans les milices du POUM, la majorité envoya une délégation à Barcelone pour tenter de trouver des éléments avec qui un débat fructueux pourrait être possible. Les discussions avec les éléments du POUM se sont révélées infructueuses et "seule l'entrevue avec le professeur anarchiste Camillo Berneri eut des résultats positifs" (p. 129). Mais le livre ne précise pas ce qu'étaient ces résultats positifs. À première vue, il n'y a aucune raison évidente pour laquelle Bilan et Berneri auraient pu trouver un terrain d'entente. Par exemple, si on se penche sur un de ses textes les plus connus, la "Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny" 23, datée d'avril 1937, après que celle-ci soit devenue ministre dans le gouvernement de Madrid, nous ne trouvons pas grand-chose permettant de distinguer la position de Berneri de celle de beaucoup d'autres antifascistes de "gauche" à l'époque. À la base de sa démarche - qui est plus un dialogue avec une camarade égarée que la dénonciation d'une traîtresse – il y a la conviction qu'une révolution est effectivement en cours en Espagne, qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'approfondissement de la révolution et la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire, à condition d'utiliser des méthodes révolutionnaires - mais ces méthodes n'excluaient pas de demander au gouvernement de prendre des mesures plus radicales, comme l'octroi immédiat de l'autonomie politique au Maroc afin d'affaiblir l'emprise des forces franquistes sur leurs recrues d'Afrique du Nord. Certes, l'article est très critique envers la décision des dirigeants de la CNT-FAI d'entrer au gouvernement, mais il y a beaucoup d'éléments dans cet article permettant de soutenir l'affirmation de Guillamón selon laquelle "La critique des Amis de Durruti était encore plus radicale que celle de Berneri, parce que Berneri était critique vis-à-vis de la participation de la CNT dans le gouvernement, alors que le Groupe a critiqué la collaboration de la CNT avec l'État capitaliste" 24 Alors, pourquoi la Fraction italienne fut-elle en mesure de tenir des discussions positives avec lui ? Nous pensons que c'est parce que Berneri, comme la Gauche italienne, était d'abord et avant tout engagé dans la défense de l'internationalisme prolétarien et dans une perspective mondiale, alors que, comme Guillamón l'a lui-même noté, un groupe comme les Amis de Durruti montrait encore des signes du lourd bagage de patriotisme espagnol. Au cours de la Première Guerre mondiale, Berneri avait pris une position très claire : quand il était encore membre du Parti socialiste, il avait travaillé en étroite collaboration avec Bordiga pour exclure les "interventionnistes" 25 du journal socialiste L'Avanguardia. Son article "Burgos et Moscou" 26 portant sur les rivalités impérialistes sous-tendant le conflit en Espagne, publié dans Guerra di Classe n° 6, le 16 décembre 1936, malgré une tendance à appeler la France à intervenir pour défendre ses intérêts nationaux 27, est en même temps clair sur les objectifs antirévolutionnaires et impérialistes de toutes les grandes puissances, fascistes, démocratiques et "soviétique" dans le conflit en Espagne. En fait, Souchy défend l'idée que c'est en particulier cette dénonciation du rôle impérialiste de l'URSS dans la situation en Espagne qui a signé l'arrêt de mort de Berneri.
Dans notre texte "Marxisme et éthique", nous écrivons : "Une caractéristique du progrès moral est l’agrandissement du rayon d’application des vertus et des pulsions sociales, jusqu’à embrasser l’ensemble de l’humanité. La plus haute expression, de loin, de la solidarité humaine, du progrès éthique de la société jusqu’à présent, c’est l’internationalisme prolétarien. Ce principe est le moyen indispensable de la libération de la classe ouvrière, qui pose les bases de la future communauté humaine" 28
Derrière l'internationalisme qui unissait Bilan et Berneri, il y a un profond attachement à la morale prolétarienne - la défense des principes fondamentaux quel qu'en soit le coût : l'isolement, le ridicule, et la menace physique. Comme Berneri l'écrit dans la dernière lettre à sa fille Marie-Louise : "On peut perdre ses illusions sur tout et sur tout le monde, mais pas sur ce que l'on affirme avec sa conscience morale" 29
La position de Berneri contre le "circonstancialisme" adopté par tant de personnes dans le mouvement anarchiste de l'époque – "les principes sont bien beaux, mais dans ces circonstances particulières, nous devons être plus réalistes et plus pragmatiques" - avait certainement touché une corde sensible chez les camarades de la Gauche italienne, dont le refus d'abandonner les principes face à l'euphorie de l'unité antifasciste, de l'immédiatisme opportuniste qui balaya la quasi-totalité du mouvement politique prolétarien à cette époque, les avait en effet obligés à suivre un parcours très solitaire.
Vernon Richards et l'Enseignement de la révolution espagnole
Comme nous l'avons indiqué ailleurs 30, la fille de Camillo Berneri, Marie-Louise Berneri, et le compagnon de celle-ci, l'anarchiste anglo-italien Vernon Richards, faisaient partie des quelques éléments au sein du mouvement anarchiste, en Grande-Bretagne ou à l'étranger, qui ont maintenu une activité internationaliste pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers leur publication War Commentary [Commentaires de guerre]. Le journal "a vivement dénoncé que la lutte idéologique entre la démocratie et le fascisme n'était que le prétexte de la guerre, de même que les dénonciations par les alliés démocratiques des atrocités nazies, n'étaient qu'hypocrisie après leur soutien tacite aux régimes fascistes et à la terreur stalinienne dans les années 1930. Soulignant la nature cachée de la guerre comme lutte de pouvoir entre les intérêts impérialistes britanniques, allemands et américains, War Commentary a également dénoncé l'utilisation de méthodes fascistes par les alliés "libérateurs" et leurs mesures totalitaires contre la classe ouvrière dans leur propre pays" 31. Marie-Louise Berneri et Vernon Richards furent arrêtés à la fin de la guerre et accusés de fomenter l'insubordination parmi les forces armées. Bien que Marie-Louise Berneri ne soit pas passée en jugement en vertu d'une loi stipulant que des conjoints ne peuvent pas être considérés comme ayant comploté ensemble, Vernon Richards fit neuf mois de prison. Marie-Louise Berneri donna naissance à un enfant mort-né et mourut peu après en avril 1949 d'une infection virale contractée lors de son accouchement, une perte tragique pour Vernon Richards et pour le mouvement prolétarien.
Richards publia également un livre qui constitue une référence, Enseignement de la révolution espagnole, sur la base d'articles parus dans le journal Spain and the World au cours des années 1930. Ce livre, d'abord publié en 1953 et dédié à Camillo et à Marie-Louise, est absolument sans faille dans sa dénonciation de l'opportunisme et de la dégénérescence de l'anarchisme "officiel" en Espagne. Dans son introduction à la première édition anglaise, Richards nous dit que certains éléments du mouvement anarchiste "m'avaient suggéré que cette étude fournissait des munitions aux ennemis politiques de l'anarchisme", ce à quoi Richards répondit : "Mis à part le fait que la cause de l'anarchie ne peut certainement pas être lésée par n'importe quelle tentative d'établir la vérité, la base de ma critique n'est pas que les idées anarchistes ont fait la preuve, face à l'expérience espagnole, qu'elles étaient inapplicables, mais que les anarchistes et les syndicalistes espagnols n'ont pas réussi à mettre leurs théories à l'épreuve et ont adopté à la place la tactique de l'ennemi. Je ne vois donc pas comment les partisans de l'ennemi, à savoir les gouvernements et les partis politiques, pourraient utiliser cette critique contre l'anarchisme sans qu'elle se retourne contre eux" 32
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie du mouvement anarchiste avait succombé aux sirènes de l'antifascisme et de la résistance. C'est le cas en particulier d'importants éléments du mouvement espagnol qui ont légué à l'histoire l'image de voitures blindées ornées de bannières CNT-FAI en tête du défilé de la "Libération" à Paris en 1944. Dans son livre, Richards attaque le "mélange d'opportunisme politique et de naïveté" qui a fait adopter aux dirigeants de la CNT-FAI le point de vue selon lequel "tous les efforts devraient être faits pour prolonger la guerre à tout prix jusqu'au déclenchement des hostilités entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, dont tout le monde savait qu'il était inévitable, tôt ou tard. De la même manière que certains espéraient la victoire à la suite de la conflagration internationale, beaucoup de révolutionnaires espagnols ont apporté leur soutien à la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils croyaient que la victoire des "démocraties" (y compris la Russie !) entraînerait la libération automatique de l'Espagne de la tyrannie fasciste de Franco" 33.Encore une fois, cette fidélité à l'internationalisme était intégralement liée à une position éthique forte, exprimée tant au niveau intellectuel qu'à travers l'indignation évidente de Richards face au comportement répugnant et aux auto-justifications hypocrites des représentants officiels de l'anarchisme espagnol.
En réponse aux arguments du ministre anarchiste Juan Peiró, Richards mettait le doigt sur la mentalité du "circonstancialisme" : "tout compromis, toute déviation, nous expliquait-on, n'était pas une "rectification" des "principes sacrés" de la CNT, mais simplement des actions déterminées par les "circonstances" et, une fois celles-ci surmontées, il y aurait un retour aux principes" 34. Ailleurs, il dénonçait la direction de la CNT "prête à abandonner les principes pour la tactique", et pour sa capitulation face à l'idéologie de "la fin justifie les moyens" : "Le fait est que, pour les révolutionnaires ainsi que pour le gouvernement, tous les moyens étaient justifiés pour atteindre le but ; à savoir la mobilisation de l'ensemble du pays sur le pied de guerre. Et dans ces circonstances, l'hypothèse est que tout le monde soutiendrait la "cause". Ceux qui ne le font pas y sont contraints ; ceux qui résistent sont traqués, humiliés, punis ou liquidés".35
Dans cet exemple particulier, Richards parlait de la capitulation de la CNT face aux méthodes bourgeoises traditionnelles pour discipliner les prisonniers, mais il exprimait lucidement la même colère face aux trahisons politiques de la CNT dans toute une série de domaines. Certaines d'entre elles sont évidentes et bien connues :
- L'abandon rapide de la critique traditionnelle de la collaboration avec le gouvernement et les partis politiques en faveur de l'unité antifasciste. Le plus célèbre exemple en était l'acceptation de postes ministériels dans le gouvernement central et la justification idéologique infâme de ce pas par les ministres anarchistes qui affirmèrent que cela signifiait que l'État cessait d'être un instrument d'oppression. Mais Richards fustigeait également la participation des anarchistes à d'autres organes de l'État, comme le gouvernement régional de Catalogne et le Conseil national de défense - que Camillo Berneri avait lui-même reconnu comme faisant partie de l'appareil gouvernemental, en dépit de son étiquette "révolutionnaire", et dont il avait rejeté une invitation à siéger en son sein.
- La participation de la CNT dans la normalisation capitaliste de toutes les institutions qui émergèrent du soulèvement des travailleurs en juillet 1936 : l'incorporation des milices dans l'armée bourgeoise régulière et l'institution du contrôle des entreprises par l'État, même s'il se dissimulait derrière la fiction syndicaliste selon laquelle les travailleurs étaient désormais maîtres chez eux. Son analyse du Plenum national économique étendu de janvier 1938 (chapitre XVII) montre à quel point la CNT avait totalement adopté les méthodes de gestion capitaliste, et son obsession d'augmenter la productivité et de punir les désœuvrés. Mais la pourriture avait certainement commencé à se développer depuis bien plus longtemps, comme le montre Richards en dénonçant la signification pour la CNT de la signature du pacte "Unité d'action" avec le syndicat social-démocrate Union générale des travailleurs (UGT) et le Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC) stalinien - acceptation de la militarisation, de la nationalisation des entreprises avec une mince couche de "contrôle ouvrier", et ainsi de suite 36.
- Le rôle de la CNT dans le sabotage des journées de mai 1937. Richards a analysé ces événements comme une mobilisation spontanée et potentiellement révolutionnaire de la classe ouvrière et comme l'expression concrète d'un fossé croissant entre la base de la CNT et son appareil bureaucratique qui a utilisé toutes ses capacités de manœuvre et de pure tromperie pour désarmer les ouvriers et les remettre au travail.
Mais certains des exposés les plus révélateurs de Richards concernent la manière dont la dégénérescence politique et organisationnelle de la CNT a nécessairement impliqué une corruption morale croissante, surtout de la part des personnes les plus en pointe dans ce processus. Il montre comment cela s'exprimait à la fois dans les déclarations des dirigeants anarchistes et dans la presse de la CNT. Trois expressions de cette corruption en particulier suscitaient sa fureur :
- Un discours de Federica Montseny à un rassemblement de masse le 31 août 1936, où il est dit de Franco et de ses disciples qu'ils sont "cet ennemi manquant de dignité ou de conscience, démuni du sentiment d'être espagnol, parce que s'ils étaient espagnols, s'ils étaient patriotes, ils n'auraient pas laissé déferler sur l'Espagne les troupes régulières et les Maures pour imposer la civilisation des fascistes, non en tant que civilisation chrétienne, mais en tant que civilisation maure ; des gens que nous sommes allés coloniser pour que, maintenant, ils viennent nous coloniser, avec les principes religieux et les idées politiques qu'ils souhaitent imposer au peuple espagnol" 37. Richards commente avec amertume : "Ainsi parlait une révolutionnaire espagnole, l'un des membres les plus intelligents et les plus doués de l'organisation (et encore traité comme une des figures marquantes par la majorité de la section de la CNT en France). Dans cette seule phrase sont exprimés des sentiments nationalistes, racistes et impérialistes. Quelqu'un a-t-il protesté lors de la réunion ?"
- Le culte du leadership : Richards cite des articles de la presse anarchiste qui, presque dès le début de la guerre, visent à créer une aura semi-religieuse autour de figures comme García Oliver : "la mesure de jusqu'où vont les sycophantes est donnée dans un rapport publié dans Solidaridad Obrera (29 août 1936) à l'occasion du départ d'Oliver au front. Il est diversement décrit comme "notre cher camarade", "le militant exceptionnel", "le courageux camarade", "notre camarade le plus aimé" ", et ainsi de suite. Richards ajoute d'autres exemples de cette flagornerie et termine avec le commentaire : "Il va sans dire qu'une organisation qui encourage le culte du chef ne peut pas aussi cultiver un sens des responsabilités chez ses membres, qui est absolument fondamental pour l'intégrité d'une organisation libertaire" 38. Il est à noter que, à la fois, le discours de Montseny et la canonisation d'Oliver proviennent de la période antérieure à celle où ils devinrent ministres.
- La militarisation de la CNT : "Une fois résolue à l'idée de la militarisation, la CNT-FAI se jeta à corps perdu dans la tâche de démontrer à tout le monde que leurs militants de base étaient les plus disciplinés, les membres les plus courageux des forces armées. La presse de la Confédération publia d'innombrables photographies de ses chefs militaires (dans leur uniforme d'officier), les interviewa, écrivit des tribunes élogieuses sur leur promotion au rang de colonel ou de major. Et, alors que la situation militaire s'aggravait, le ton de la presse confédérale devenait plus agressif et militariste. Solidaridad Obrera publiait des listes quotidiennes d'hommes qui avaient été condamnés par les tribunaux militaires à Barcelone et exécutés pour "activités fascistes", "défaitisme" ou "désertion". On pouvait lire le cas d'un homme condamné à mort pour avoir aidé des conscrits à fuir en traversant la frontière… ". Richards cite ensuite un article de Solidaridad Obrera du 21 avril 1938 à propos d'un autre homme exécuté pour avoir quitté son poste, "pour faire un exemple plus fort. Les soldats de la garnison étaient présents et ont défilé devant le corps acclamant la République", et il conclut : "cette campagne pour la discipline et l'obéissance par la peur et la terreur […] n'a pas empêché les désertions des fronts à grande échelle (bien que pas souvent en direction des lignes de Franco) et la chute de la production dans les usines" 39.
Idéologie anarchiste et principe prolétarien
Ces exemples de l'indignation de Richards face à la trahison totale des principes de classe par la CNT sont un exemple de la morale prolétarienne qui est un fondement indispensable à toute forme de militantisme révolutionnaire. Mais nous savons aussi que l'anarchisme a tendance à fausser cette morale avec des abstractions ahistoriques, et ce manque de méthode souligne quelques-unes des principales faiblesses du livre.
La démarche de Richards envers la question syndicale en est une illustration. Derrière la question des syndicats, il y a un élément "invariant" de principe : la nécessité pour le prolétariat de se doter des formes d'association pour se défendre de l'exploitation et de l'oppression du capital. Historiquement, l'anarchisme, tout en restant opposé à tous les partis politiques, a généralement accepté que les syndicats de métier, les syndicats d'industrie de type IWW, ou les organisations anarcho-syndicalistes constituaient une telle forme d'association. Mais, parce qu'il rejette l'analyse matérialiste de l'histoire, il ne peut pas comprendre que ces formes d'association peuvent changer profondément dans différentes époques historiques. D'où la position de la gauche marxiste pour qui, avec l'entrée dans l'époque de décadence du capitalisme, les syndicats et les anciens partis de masse perdent leur contenu prolétarien et sont intégrés dans l'État bourgeois. Le développement de l'anarcho-syndicalisme au début du 20e siècle a constitué une réponse partielle à ce processus de dégénérescence des anciens syndicats et des anciens partis, mais il lui manquait les outils théoriques pour vraiment expliquer le processus, et il s'est ainsi trouvé piégé dans de nouvelles versions de l'ancien syndicalisme : le destin tragique de la CNT en Espagne était la preuve que, dans la nouvelle époque, il n'était pas possible de maintenir le caractère prolétarien et, moins encore, ouvertement révolutionnaire, d'une organisation permanente de masse. Influencé par Errico Malatesta 40 (comme l'était Camillo Berneri), Richards 41 était conscient de certaines des limites de l'idée anarcho-syndicaliste : la contradiction qu'implique la construction d'une organisation qui, à la fois, se proclame pour la défense au jour le jour des intérêts des travailleurs et est de ce fait ouverte à tous les travailleurs et, dans le même temps, est engagée pour la révolution sociale, un objectif qui, à tout moment au sein de la société capitaliste, ne pourra être partagé que par une minorité de la classe. Cela ne pouvait que favoriser les tendances à la bureaucratie et au réformisme qui, tous deux, firent brutalement surface lors des événements de 1936-39 en Espagne. Mais cette vision n'est pas suffisante pour expliquer le processus par lequel toutes les organisations de masse permanentes qui, par le passé avaient pu constituer des expressions du prolétariat, étaient désormais directement intégrées dans l'État. Ainsi Richards, malgré quelques intuitions sur le fait que la trahison de la CNT n'était pas simplement une question de "leaders", est incapable de reconnaître que l'appareil de la CNT lui-même, au terme d'un long processus de dégénérescence, s'était intégré à l'État capitaliste. Cette incapacité à comprendre la transformation qualitative des syndicats est aussi perceptible dans la manière dont il voit la fédération "socialiste" des syndicats, l'UGT : pour lui, alors que toute collaboration avec les partis politiques et le gouvernement constituait une trahison de principe, il était positivement en faveur d'un front uni avec l'UGT qui, en réalité, ne pouvait être qu'une version plus radicale du Front populaire.
La principale faiblesse du livre, cependant, est celle partagée par une écrasante majorité d'anarchistes dissidents et de groupes d'opposition de l'époque, l'idée selon laquelle il y aurait effectivement eu une révolution prolétarienne en Espagne, la classe ouvrière serait réellement arrivée au pouvoir, ou aurait au moins établi une situation de double pouvoir qui aurait duré bien au-delà des premiers jours de l'insurrection de juillet 1936. Pour Richards, l'organe de double pouvoir était le Comité central des milices antifascistes, même s'il savait que le CCMA était devenu plus tard un agent de la militarisation. En fait, comme nous l'avons noté dans l'article précédent, d'après Bilan, le CCMA a joué un rôle crucial dans la préservation de la domination capitaliste, presque dès le premier jour de l'insurrection. À partir de cette erreur fondamentale, Richards est incapable de rompre avec l'idée que nous avons déjà notée dans les positions des Amis de Durruti, à savoir que la guerre d'Espagne était essentiellement une guerre révolutionnaire qui aurait pu simultanément repousser Franco sur le front militaire et établir les bases d'une nouvelle société, au lieu de voir que les fronts militaires et la mobilisation générale pour la guerre étaient en eux-mêmes une négation de la lutte de classe. Bien que Richards fasse des critiques très lucides à la manière concrète dont la mobilisation pour la guerre a conduit à la militarisation forcée de la classe ouvrière, à l'écrasement de son initiative autonome et à l'intensification de son exploitation, il reste ambigu sur des questions telles que la nécessité d'augmenter le rythme et la durée du travail dans les usines afin d'assurer la production d'armes pour le front. Faute d'une vision globale et historique des conditions de la lutte de classe dans cette période, une période de défaite de la classe ouvrière et de préparation d'une nouvelle division impérialiste du monde, il ne saisit pas la nature de la guerre d'Espagne en tant que conflit impérialiste, répétition générale de l'holocauste mondial à venir. Son insistance selon laquelle la "révolution" a fait une erreur clé en n'utilisant pas les réserves d'or de l'Espagne pour acheter des armes à l'étranger démontre (comme pour Berneri avec son appel plus ou moins ouvert à l'intervention des démocraties) une sous-estimation profonde d'à quel point le basculement très rapide du terrain de la lutte de classe au terrain militaire avait également propulsé le conflit dans la cocotte-minute inter-impérialiste mondiale.
Pour Bilan, l'Espagne 1936 a été à l'anarchisme ce que 1914 avait été à la social-démocratie : un acte de trahison historique qui a marqué un changement dans la nature de classe de ceux qui avaient trahi. Cela ne signifie pas que toutes les différentes expressions de l'anarchisme étaient passées de l'autre côté de la barricade, mais - comme avec les survivants du naufrage de la social-démocratie - cela appelait vraiment à un processus d'auto-examen impitoyable, à une profonde réflexion théorique de la part précisément de ceux qui étaient restés fidèles à des principes de classe. Dans l'ensemble, les meilleures tendances au sein de l'anarchisme ne sont pas allées assez loin dans cette autocritique, et certainement pas aussi loin que la Gauche communiste dans l'analyse des échecs successifs de la social-démocratie, de la révolution russe, et de l'Internationale communiste. La majorité - et ce fut certainement le cas avec les Amis de Durruti, les Berneri et Richards - a essayé de préserver le noyau dur de l'anarchisme quand c'est précisément ce noyau qui reflète les origines petites-bourgeoises de l'anarchisme et sa résistance à la cohérence et à la clarté du "parti Marx" (en d'autres termes la tradition marxiste authentique). Le rejet de la méthode matérialiste historique l'a empêchée de développer une perspective claire dans la période d'ascendance du capitalisme et, ensuite, de comprendre les changements dans la vie de l'ennemi de classe et de la lutte prolétarienne à l'époque de la décadence capitaliste. Et il l'empêche toujours de faire sienne une théorie adéquate du mode de production capitaliste lui-même - ses forces motrices et sa trajectoire vers la crise et l'effondrement. Peut-être de façon plus cruciale, l'anarchisme est incapable de développer une théorie matérialiste de l'État - ses origines, sa nature et les modifications historiques qu'il a subi - et des moyens d'organisation du prolétariat pour le renverser : les conseils ouvriers et le parti révolutionnaire. En dernière analyse, l'idéologie anarchiste est un obstacle à la tâche d'élaboration du contenu politique, économique et social de la révolution communiste.
CDW
1. Voir la Revue internationale n° 104, "Document (Josep Rebull, POUM) : Sur les Journées de mai 1937 à Barcelone" [506] https://fr.internationalism.org/rinte104/espagne.htm [506]: Sur les Journées de mai 1937 à Barcelone".
2. Sur ce groupe, l'ouvrage écrit d'un point de vue clairement prolétarien et faisant autorité a été écrit par Agustin Guillamón : The Friends of Durruti Group 1937-39 [Le Groupe des Amis de Durruti 1937-1939] (AK Press, 1996). Nous en parlerons tout au long de cette partie de l'article. Voir aussi l'article de la Revue internationale du CCI n° 102, Anarchisme et communisme ; https://fr.internationalism.org/rinte102/anar.htm [507].
3. Guillamón, The Friends of Durruti Group, p. 78. Notre traduction.
4. The Friends of Durruti Group, p. 92
5. Towards a fresh revolution [Vers une nouvelle révolution], cité dans The Friends of Durruti Group p. 84
6. Lutte ouvrière, 24 février et 3 mars 1939, cité dans The Friends of Durruti Group, p. 98.
7. The Friends of Durruti Group, p. 64.
8. The Friends of Durruti Group, p. 68.
9. Ibid.
10. The Friends of Durruti Group, p. 79.
11. Voir nos articles sur l'histoire de la CNT de la série plus large sur l'anarcho-syndicalisme : "Histoire du mouvement ouvrier - La CNT : Naissance du syndicalisme révolutionnaire en Espagne (1910-1913)" ; [508]https://fr.internationalism.org/rint128/CNT_anarcho_syndicalisme_syndicalisme_revolutionnaire.htm [508] ; "Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme fait échouer l'orientation révolutionnaire de la CNT (1919-1923)" [509] ; ; [510]https://fr.internationalism.org/rint130/histoire_du_mouvement_ouvrier_le_syndicalisme_fait_echouer_l_orientation_revolutionnaire_de_la_cnt_1919_1923.html [509] ; "La contribution de la CNT à l'instauration de la République espagnole (1921-1931)" https://fr.internationalism.org/rint131/la_contribution_de_la_cnt_a_l_instauration_de_la_republique_espagnole.html [510].
12. Cité dans la préface de The Friends of Durruti Group, p. VII.
13. The Friends of Durruti Group, p. 82.
14. Buenaventura Durruti est né en 1896, fils d'un cheminot. Dès l'âge de 17 ans, il fut impliqué dans des luttes ouvrières combatives - d'abord dans les chemins de fer, puis dans les mines et, plus tard, dans les mouvements de classe massifs qui ont balayé l'Espagne lors de la vague révolutionnaire d'après-guerre. Il rejoignit la CNT à cette époque. Pendant le reflux de la vague révolutionnaire, Durruti fut impliqué dans les combats des "Pistoleros" contre les mercenaires de l'État et des patrons, et mena l'assassinat d'au moins une personnalité de haut rang. Exilé en Amérique du Sud et en Europe au cours de la plus grande partie des années 1920, il fut condamné à mort dans plusieurs pays. En 1931, après la chute de la monarchie, il retourna en Espagne et devint membre de la FAI et du groupe Nosotros, tous deux formés dans le but de lutter contre les tendances de plus en plus réformistes de la CNT. En juillet 1936, à Barcelone, il prit une part très active dans la réponse des travailleurs au coup d'État de Franco, puis forma la Colonne de Fer, une milice spécifiquement anarchiste qui alla combattre sur le front contre les franquistes, alors que dans le même temps elle suscitait ou soutenait les collectivisations agraires. En novembre 1936, il se rendit à Madrid avec un grand contingent de miliciens pour tenter de soulager la ville assiégée, mais fut tué par une balle perdue. 500 000 personnes assistèrent à ses funérailles. Pour celles-ci et pour bien d'autres travailleurs espagnols, Durruti était un symbole de courage et de dévouement à la cause du prolétariat. On peut trouver une courte notice biographique de Durruti en anglais sur libcom.org [511] et en français sur Wikipédia [512].
15. Un terme inventé durant la Première Guerre mondiale pour désigner ceux qui insistaient pour que la guerre soit menée "jusqu'au bout".
16. The Friends of Durruti Group, p. 71.
17. The Friends of Durruti Group, p. 108.
18. The Friends of Durruti Group, p. 10.
19. "Theses on the Spanish Civil War and the revolutionary situation created on July 19, 1936 - BALANCE (Agustín Guillamón)" [513], sur libcom.org. https://libcom.org/library/theses-spanish-civil-war-revolutionary-situation-created-july-19-1936-balance-agust%C3%ADn-gu [513]
20. En particulier, l'insistance selon laquelle le parti ne devait pas s'identifier à l'État de transition, une erreur qu'il considérait avoir été fatale aux Bolcheviks en Russie. Voir à ce sujet un article précédent de cette série, Revue internationale n° 127, "Le communisme (III) : Les années 1930 : le débat sur la période de transition" [176]; https://fr.internationalism.org/rint127/communisme_periode_de_transition.html [176].
21. Camillo Berneri est né dans le nord de l'Italie en 1897, fils d'un fonctionnaire et d'une enseignante. Il travailla lui-même pendant un certain temps comme professeur dans une école de formation des enseignants. Il rejoignit le Parti socialiste italien au cours de son adolescence et, pendant la guerre de 1914-18, avec Bordiga et d'autres, prit une position internationaliste contre le flottement centriste du parti et contre la trahison pure et simple de ses positions par Mussolini. Mais à la fin de la guerre, il était devenu anarchiste et était proche des idées d'Errico Malatesta. Poussé à l'exil par le régime fasciste, il resta une cible des machinations de la police secrète fasciste, l'OVRA. Ce fut durant cette période qu'il écrivit un certain nombre de contributions sur la psychologie de Mussolini, sur l'antisémitisme et sur le régime de l'URSS. Apprenant la nouvelle du soulèvement des travailleurs à Barcelone, il alla en Espagne et combattit sur le front d'Aragon. De retour à Barcelone, il critiqua de façon cohérente les tendances opportunistes et ouvertement bourgeoises dans la CNT, écrivit pour Guerra di Classe [Guerre de classe] et prit contact avec les Amis de Durruti. Comme relaté dans cet article, il fut assassiné par des tueurs staliniens durant les journées de mai 1937.
22. "Berneri, Luigi Camillo, 1897-1937" [514], sur libcom.org. https://libcom.org/article/berneri-luigi-camillo-1897-1937 [514]
23. Guerra di Classe No. 12, 14 avril 1937. Reproduite en anglais sur libcom.org,"The anarchists in government in Spain: Open letter to comrade Federica Montseny - Camillo Berneri" [515] ; https://libcom.org/article/anarchists-government-spain-open-letter-comrade-federica-montseny-camillo-berneri [515]. Cette lettre est partiellement reproduite en français sur le blog "La Bataille socialiste", "1937-04 Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny [Berneri]" [516].
24. The Friends of Durruti Group, p. 82.
25. Ce terme désigne en Italie les partisans de la participation de ce pays à la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Entente.
26. Connu également sous le titre "Entre la guerre et la révolution" ; disponible en anglais sur libcom.org "Between the war and the Revolution - Camillo Berneri" [517].
27. Cette position dangereuse est encore plus explicite dans un autre article de Berneri initialement publié dans Guerra di Classe n° 7, 18 juillet 1937, "Non intervention et implication internationale dans la guerre civile espagnole"; . On le trouve en anglais, "Non - intervention and international involvement in the Spanish Civil War" [518] sur le site "The Struggle Site" : https://struggle.ws/berneri/international.html [518].
28. Revue internationale n° 127, "Marxisme et éthique (débat interne au CCI)" [519] ; https://fr.internationalism.org/rint127/ethique_morale.html [519].
29. "Berneri's last letters to his family" [520], sur le site "The Struggle Site". https://struggle.ws/berneri/last_letter.html [520].
30. Voir notre article en anglais, World Revolution n° 270, décembre 2003, "Revolutionaries in Britain and the struggle against imperialist war, Part 3: the Second World War" [521] [Les révolutionnaires en Grande-Bretagne et la lutte contre la guerre impérialiste]. https://en.internationalism.org/wr/270_rev_against_war_03.html [521] Voir également notre article en français, "Notes sur le mouvement anarchiste internationaliste en Grande-Bretagne" ; https://fr.internationalism.org/icconline/2011/notes_sur_le_mouvement_anarchiste_internationaliste_en_grande_bretagne.html [522]" [522]Voir aussi notre brochure en anglais The British Communist Left [la Gauche communiste britannique] p. 101.
31. "Revolutionaries in Britain and the struggle against imperialist war", op. cit.
32. Lessons of the Spanish Revolution, 1995 Éditions Freedom Press, p. 14 [En français : Enseignement de la Révolution espagnole, 1997, Éditions Acratie, disponible en ligne sur le site www.somnisllibertaris.com [523]].
33. Lessons of the Spanish Revolution, pp. 153-4.
34. Lessons of the Spanish Revolution, pp. 179-80.
35. Lessons of the Spanish Revolution, p. 213.
36. Le souci de vérité de Richards signifie aussi que dans son livre, il est loin de faire l'apologie des collectifs anarchistes qui auraient constitué, pour certains, la preuve que la "révolution espagnole" avait largement dépassé la Russie concernant son contenu social. Ce que Richards montre vraiment c'est que, bien que la prise de décisions par les assemblées et les expériences de distribution sans argent aient duré plus longtemps à la campagne, surtout dans les domaines plus ou moins autosuffisants, toute contestation des normes de gestion capitaliste avait été très rapidement éliminée dans les usines, qui ont été plus immédiatement dominées par les besoins de la production de guerre. Une forme de capitalisme d'État gérée par les syndicats réimposa très rapidement la discipline sur le prolétariat industriel.
37. Lessons of the Spanish Revolution, p. 211.
38. Lessons of the Spanish Revolution, p. 181.
39. Lessons of the Spanish Revolution, p. 161. Marc Chirik, un membre fondateur de la Gauche communiste de France et du CCI, faisait partie de la délégation de la majorité de la Fraction qui est allée à Barcelone. Plus tard, il a parlé de l'extrême difficulté des discussions avec la plupart des anarchistes et estimé que certains d'entre eux étaient tout à fait capables de les descendre, lui et ses camarades, pour oser mettre en cause la validité de la guerre antifasciste. Cette attitude est le clair reflet des appels dans la presse de la CNT à l'exécution de déserteurs.
40. Voir par exemple, sur marxists.org, "Syndicalism and Anarchism" [524] [Syndicalisme et anarchisme], 1925.
41. Voir par exemple Lessons of the Spanish Revolution, p. 196.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Personnages:
- Camillo Berneri [525]
- Jaime Balius [526]
- Vernon Richards [527]
Evènements historiques:
- Guerre d'Espagne [528]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [499]
Approfondir:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud: de la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale
- 2625 lectures
Après l’Afrique de l’Ouest,1 nous entamons une seconde série sur l’histoire du mouvement ouvrier africain avec une contribution portant sur les luttes de classes en Afrique du Sud. Un pays célèbre surtout sur deux plans : d’un côté, ses richesses minières (or, diamant, etc.) grâce auxquelles il s’est relativement développé et, de l’autre, son système monstrueux d’apartheid dont on voit encore aujourd’hui un certain nombre des séquelles. En même temps, l’apartheid accoucha d’une immense "icône", à savoir Nelson Mandela, considéré comme la principale victime mais surtout l’exutoire de ce système d’un autre âge, d’où ses "titres" de "héros de la lutte anti-apartheid" et d’homme de "paix et de réconciliation des peuples d’Afrique du Sud" adulé dans toute la planète capitaliste. L’image médiatique de Mandela voile tout le reste à tel point que l’histoire et les combats de la classe ouvrière sud-africaine avant et pendant l’apartheid sont carrément ignorés ou déformés en étant systématiquement catégorisés dans la rubrique "luttes anti-apartheid" ou "luttes de libération nationale". Bien entendu, pour la propagande bourgeoise, ces luttes ne pouvaient être incarnées que par Mandela. Ceci alors même qu’il est de notoriété publique que, depuis leur arrivée au pouvoir, Mandela et son parti le Congrès National Africain (l’ANC) n’ont jamais été tendres envers les grèves de la classe ouvrière 2.
Le but principal de cette contribution vise à rétablir la vérité historique sur les luttes ayant opposé les deux classes fondamentales, à savoir la bourgeoisie (dont l’apartheid n’était qu’un des moyens de sa domination) et le prolétariat d’Afrique du Sud qui, le plus souvent, est parti en lutte sur ses propres revendications de classe exploitée, d’abord à l’époque de la bourgeoisie coloniale hollando-anglaise puis sous le régime de Mandela/ANC. En d’autres termes, un prolétariat sud-africain dont le combat s’inscrit parfaitement dans celui du prolétariat mondial.
Un bref survol de l'histoire de l'Afrique du sud
Selon certaines sources d’historiens, cette région était occupée initialement par les populations Xhosa, Tswana et Sotho qui s’y installèrent entre 500 et l’an 1000. À ce propos, l’historien Henri Wesseling 3 nous donne l'éclairage suivant : "L’Afrique du Sud n’était pas une terre vierge lorsque des navires européens accostèrent pour la première fois vers 1500 au pied des montagnes de la Table. Elle était peuplée par différentes ethnies, essentiellement nomades. Les colons hollandais les divisèrent en Hottentots et Bochimans. Ils les considérèrent comme deux peuples totalement distincts du point de vue physique et culturel. Les Bochimans étaient plus petits que les Hottentots et parlaient une autre langue qu’eux. En outre, ils étaient plus "primitifs", pratiquant la chasse et la cueillette, alors que les Hottentots avaient atteint le niveau des peuples pasteurs. Cette dichotomie traditionnelle a longtemps dominé l’historiographie. Aujourd’hui, nous n’employons plus ces termes, mais ceux de Khoi ou Khoikhoi pour les Hottentots et celui de San pour les Bochimans, le terme de Khoisan servant à désigner le groupe ethnique qu’ils forment ensemble. En effet, actuellement, on souligne moins la distinction entre ces peuples, essentiellement parce qu’ils sont tous deux très différents des ethnies voisines parlant des langues bantoues et autrefois dénommées Cafres, de l’arabe kafir (infidèles). Ce terme-là est également tombé en désuétude".
On peut noter comment les colons hollandais considéraient les premiers occupants de cette région du monde, selon l’idéologie coloniale établissant des classements entre "primitifs" et "évolués". Par ailleurs l’auteur du propos indique que le terme Afrique du Sud est un concept politique (récent) et que nombre de ses populations sont historiquement originaires des pays voisins (par exemple de l’Afrique australe).
Concernant la colonisation européenne, les Portugais y firent escale les premiers en Afrique du Sud en 1488 et les Hollandais les suivirent en débarquant dans la région en 1648. Ces derniers décidèrent de s’y installer définitivement à partir de 1652, ce qui marque le début de la présence "blanche" permanente dans cette partie de l'Afrique. En 1795, Le Cap fut occupé par les Anglais qui, 10 ans plus tard, s’emparèrent du Natal, tandis que les Boers (Hollandais) dirigèrent le Transvaal et l’État libre d’Orange en parvenant à faire reconnaître leur indépendance par l’Angleterre en 1854. Quant aux divers États ou groupes africains, ils résistèrent longtemps par la guerre à la présence des colons européens sur leur sol avant d’être vaincus définitivement par les puissances dominantes. Au terme des guerres qui les opposèrent aux Afrikaners et aux Zoulous, les Britanniques procédèrent en 1910 à l’unification de l’Afrique du Sud sous l’appellation "Union Sud-Africaine" et ce jusqu’en 1961 où le régime afrikaner décida simultanément de quitter le Commonwealth (communauté anglophone) et de changer le nom du pays.
L’apartheid fut établi officiellement en 1948 et aboli en 1990. Nous y reviendrons plus loin en détail.
Concernant les rivalités impérialistes, l’Afrique du Sud joua en Afrique australe le rôle de "gendarme délégué" du bloc impérialiste occidental et c’est à ce titre que Pretoria intervint militairement en 1975 en Angola, soutenu alors par le bloc impérialiste de l’Est au moyen de troupes cubaines.
L’Afrique du Sud est considérée aujourd’hui comme un pays "émergent" membre des BRIC (Brésil, Russie Inde, Chine) et cherche à faire son entrée dans l’arène des grandes puissances.
Depuis 1994, l’Afrique du Sud est gouvernée principalement par l’ANC, le parti de Nelson Mandela, en compagnie du Parti Communiste et de la centrale syndicale COSATU.
La classe ouvrière sud-africaine émergea à la fin du 19e siècle et constitue aujourd’hui le prolétariat industriel le plus nombreux et le plus expérimenté du continent africain.
Enfin, nous pensons utile d’expliquer deux termes proches mais cependant distincts que nous serons amenés à utiliser souvent dans cette contribution, à savoir les termes "boer" et "afrikaner" ayant à l’origine des racines hollandaises.
Sont appelés Boers (ou Trekboers) les fermiers hollandais (à dominante petite paysanne) qui, de 1835 à 1837, entreprirent une vaste migration en Afrique du Sud en raison de l’abolition de l’esclavage par les Anglais dans la colonie du Cap en 1834. Il se trouve que le terme est encore utilisé aujourd’hui à propos des descendants, directs ou non, de ces fermiers (y inclus des ouvriers d’usine).
Concernant la définition du terme afrikaner, nous renvoyons à l’explication que donne l’historien Henri Wesseling (Ibid.) : "La population blanche qui s’était installée au Cap était de diverses origines. Elle se composait de Hollandais, mais aussi de nombreux Allemands et de huguenots français. Cette communauté avait adopté progressivement un mode de vie propre. On pourrait même dire qu’une identité nationale se constitua, celle des Afrikaners, qui considérèrent le gouvernement britannique comme une autorité étrangère."
Nous pouvons donc dire que ce terme renvoie à une sorte d’identité revendiquée par un nombre de migrants européens de l’époque, une notion que l’on emploie encore dans des publications récentes.
Naissance du capitalisme sud-africain
Si le capitalisme naissant a été marqué dans chaque région du monde comme en Afrique du Sud par des caractéristiques spécifiques ou locales, néanmoins il s’est développé en général selon trois étapes différentes, comme l’explique Rosa Luxemburg 4 :
"Il convient d’y [dans son développement] distinguer trois phases : la lutte du capital contre l’économie naturelle, sa lutte contre l’économie marchande et sa lutte sur la scène mondiale autour de ce qui reste des conditions d’accumulation.
Le capitalisme a besoin pour son existence et son développement de formes de productions non capitalistes autour de lui. Mais cela ne veut pas dire que n’importe laquelle de ces formes puisse lui être utile. Il lui faut des couches sociales non capitalistes comme débouchés pour sa plus-value, comme sources de moyens de production et comme réservoirs de main-d’œuvre pour son système de salariat".
En Afrique du Sud, le capitalisme a emprunté ces trois étapes. Au 19e siècle il y existait une économie naturelle, une économie marchande et une main-d’œuvre suffisante pour développer le salariat.
"À la colonie du Cap et dans les républiques boers, une économie purement paysanne régnait jusqu’aux alentours de 1860. Pendant longtemps, les Boers menèrent la vie d’éleveurs nomades, ils avaient pris aux Hottentots et aux Cafres les meilleurs pâturages, les avaient exterminés ou chassés autant qu’ils le pouvaient. Au 18e siècle, la peste apportée par les bateaux de la Compagnie des Indes orientales leur rendait de grands services en anéantissant des tribus entières de Hottentots et en libérant ainsi des terres pour les migrants hollandais".
(…) En général l’économie des Boers resta, jusqu’aux alentours de 1860, patriarcale et fondée sur l’économie naturelle. Ce n’est qu’en 1859 que le premier chemin de fer fut construit en Afrique du Sud. Certes, le caractère patriarcal n’empêchait nullement les Boers d’être durs et brutaux. On sait que Livingstone se plaignait bien plus des Boers que des Cafres. (…) En réalité, il s’agissait de la concurrence entre l’économie paysanne (incarnée par les Boers) et la politique coloniale du grand capital (anglais) autour des Hottentots et des Cafres, c'est-à-dire autour de leurs territoires et de leurs forces de travail. Le but des deux concurrents était le même : ils voulaient asservir, chasser ou exterminer les indigènes, détruire leur organisation sociale, s’approprier leurs terres et les contraindre au travail forcé pour les exploiter. Seuls les méthodes étaient différentes. Les Boers préconisaient l’esclavage périmé comme fondement d’une économie naturelle patriarcale ; la bourgeoisie anglaise voulait introduire une exploitation moderne du pays et des indigènes sur une grande échelle". (Rosa Luxemburg, Ibid.)
À noter l’âpreté du combat que durent se livrer Boers et Anglais pour la conquête et l’instauration du capitalisme dans cette zone qui se fit, comme ailleurs, "dans le sang et dans la boue". Au final ce fut l’impérialisme anglais qui domina la situation et concrétisa l’avènement du capitalisme en Afrique du Sud comme le relate, à sa manière, la chercheuse Brigitte Lachartre 5 :
"L’impérialisme britannique, lors qu’il se manifesta dans le sud du continent en 1875, avait d’autres visées : citoyens de la première puissance économique de l’époque, représentants de la société mercantiliste puis capitaliste la plus développée d’Europe, les Britanniques imposèrent dans leur colonie d’Afrique australe une politique indigène beaucoup plus libérale que celle des Boers. L’esclavage fut aboli dans les régions contrôlées par eux, tandis que les colons hollandais fuyaient dans l’intérieur du pays pour échapper au nouvel ordre social et à l’administration des colons britanniques. Après avoir vaincu les Africains par les armes (une dizaine de guerres "cafres" en un siècle), les Britanniques s’attachèrent à "libérer" la force de travail : on regroupa d’abord les tribus vaincues dans des réserves tribales dont on restreignait de plus en plus les limites ; on empêcha les Africains d’en sortir sans autorisation et laissez-passer en règle. Mais le vrai visage de la colonisation britannique apparut avec la découverte des mines de diamants et d’or vers 1870. Une ère nouvelle commençait qui opéra une transformation profonde de toutes les structures sociales et économiques du pays : les activités minières entraînèrent l’industrialisation, l’urbanisation, la désorganisation des sociétés traditionnelles africaines, mais aussi des communautés boers, l’immigration des nouvelles vagues d’Européens (…)".
En clair, ce propos peut se lire comme un prolongement concret du processus, décrit par Rosa Luxemburg, selon lequel le capitalisme a vu le jour en Afrique du Sud. En effet, dans sa lutte contre "l’économie naturelle", la puissance économique anglaise dut briser les anciennes sociétés tribales et se débarrasser violemment des anciennes formes de productions comme l’esclavage qu’incarnèrent les Boers qui furent contraints de fuir pour échapper à l’ordre du capitalisme moderne. Précisément, ce fut au milieu de ces guerres entre tenants de l’ancien et du nouvel ordre économique que le pays passa illico au capitalisme moderne grâce à la découverte du diamant (en 1871), puis de l’or (en 1886). La "ruée vers l’or" se traduisit ainsi par une accélération fulgurante de l’industrialisation du pays consécutivement à l’exploitation et à la commercialisation des matières précieuses en attirant massivement les investisseurs capitalistes des pays développés. Dès lors, il fallait recruter des ingénieurs et ouvriers qualifiés, et c’est ainsi que des milliers d’Européens, d’Américains et Australiens vinrent s’installer en Afrique du Sud. Et la ville de Johannesburg de symboliser ce dynamisme naissant par la rapidité de son développement. Le 17 juillet 1896, un recensement y fut organisé et il en ressortit que la ville, qui comptait 3000 habitants en 1887, en comptait 100 000 dix ans plus tard. Ensuite, en un peu plus de dix ans, la population blanche passa de six cent mille à plus d’un million d’habitants. D’autre part dans la même période le produit intérieur brut (le PIB) passa de quelque 150 000 livres à près de quatre millions. Voilà comment l’Afrique du Sud est devenue le premier et l’unique pays africain relativement développé sur le plan industriel, ce qui ne tarda pas d’ailleurs à aiguiser les appétits des puissances économiques rivales 6 :
"Le centre économique et politique de l’Afrique du Sud ne se trouvait plus au Cap, mais à Johannesburg et à Pretoria. L’Allemagne, la plus grande puissance économique européenne, s’était établie dans le Sud-Ouest africain et avait manifesté de l’intérêt pour le Sud-Est africain. Si le Transvaal ne se montrait pas disposé à se soumettre à l’autorité de Londres, l’avenir de l’Angleterre serait remis en cause dans toute l’Afrique du Sud".
En effet, dès cette époque on pouvait voir que derrière les enjeux économiques se cachaient les enjeux impérialistes entre les grandes puissances européennes qui se disputaient le contrôle de cette région. D’ailleurs la puissance britannique fit tout pour circonscrire la présence de sa rivale allemande à l’ouest de l’Afrique du Sud, dans ce qui s’appelle aujourd’hui la Namibie (colonisée en 1883), et ce après avoir neutralisé le Portugal, autre puissance impérialiste aux moyens beaucoup plus limités. Dès lors, l’empire britannique pouvait pavoiser en restant le seul maître aux commandes de l’économie sud-africaine en pleine expansion.
Mais le développement économique de l’Afrique du Sud, propulsé par les découvertes minières, se heurta très vite à une série de problèmes en premier lieu d’ordre social et idéologique. En effet :
"Le développement économique, stimulé par la découverte des mines ne tardera pas à placer les colons blancs devant une contradiction profonde (…). D’une part la mise en place du nouvel ordre économique nécessitait la constitution d’une main-d’œuvre salariée ; de l’autre, la libération de la force de travail africaine hors réserves et hors de leur économie de subsistance traditionnelle mettait en péril l’équilibre racial dans l’ensemble du territoire. Dès la fin du siècle dernier (le 19e), les populations africaines furent donc l’objet d’une multitude de lois aux effets souvent contradictoires. Certaines visaient à les faire migrer dans les zones d’activités économiques blanches pour se soumettre au salariat. D’autres tendaient à les maintenir en partie dans les réserves. Parmi les lois destinées à fabriquer une main-d’œuvre disponible, il y en eut qui pénalisaient le vagabondage et devaient "arracher les indigènes à cette oisiveté et de paresse, leur apprendre la dignité du travail, et leur faire contribuer à la prospérité de l’État". Il y en eut pour soumettre les Africains à l’impôt. (…) Parmi les autres lois, celles sur les laissez-passer avaient pour but de filtrer les migrations, de les orienter en fonction des besoins de l’économie ou de les stopper en cas de pléthore". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
On voit là que les autorités coloniales britanniques se trouvèrent dans des contradictions liées au développement des forces productives. Mais on peut dire que la contradiction la plus forte d’alors fut d’ordre idéologique quand la puissance anglaise décida de considérer la main-d’œuvre noire sur des critères administratifs ségrégationnistes en particulier à l’instar des lois sur les laissez-passer et le parcage des africains. En fait cette politique était en contradiction flagrante avec l’orientation libérale ayant conduit à la suppression de l’esclavage.
D'autres difficultés liées aux guerres coloniales se manifestèrent également. Après avoir subi des défaites et gagné des guerres face à ses adversaires Zoulous et Afrikaners entre 1870 et 1902, l’empire britannique dut digérer le coût extrêmement élevé de ses victoires, notamment celle de 1899/1902, aussi bien sur le plan humain qu’économique. En effet, "la guerre des Boers" a été une boucherie : "La guerre des Boers fut la plus grande guerre coloniale de l’ère impérialiste moderne. Elle dura plus de deux ans et demi (du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902). Les Britanniques y engagèrent environ un demi-million de soldats, dont 22 000 trouvèrent la mort en Afrique du Sud. Leurs pertes totales, c'est-à-dire l’ensemble de leurs tués, blessés et disparus, s’élevèrent à plus de 100 000 hommes. Les Boers, quant à eux, mobilisèrent près 100 000 hommes. Ils perdirent plus de 7 000 combattants et près de 30 000 des leurs moururent dans les camps. Un nombre indéterminé d’Africains combattaient aux côtés des uns et des autres. Les pertes qu’ils subirent sont elles aussi indéterminées. Des dizaines de milliers d’entre eux perdirent sans doute la vie. Le War Office britannique calcula également que 400 346 chevaux, ânes et mules périrent lors de ce conflit, ainsi que des millions de têtes de bétail appartenant au Boers. Cette guerre coûta aux contribuables britanniques 200 000 000 de livres sterling, soit dix fois le budget annuel de l’armée ou 14 % du revenu national de 1902. Si l’assujettissement des futurs sujets britanniques d’Afrique coûta en moyenne quinze pennies par tête, la soumission des Boers coûta en revanche 1 000 livres sterling par homme". (H .Wesseling. Ibid.)
Autrement dit une sale guerre à ciel ouvert qui inaugura l’entrée du capitalisme britannique dans le 20e siècle. Surtout, on aura remarqué dans les détails de cette horrible boucherie que les camps de concentration hitlériens purent y trouver une source d’inspiration. En effet, le capitalisme britannique fit aménager au total quarante-quatre camps destinés aux Boers où furent emprisonnés environ 120 000 femmes et enfants. À la fin de la guerre, en 1902 on constata que 28 000 détenus blancs y avaient perdu la vie, parmi lesquels 20 000 enfants de moins de 16 ans.
Pourtant ce fut sans remords que le commandant de l’armée britannique Lord Kitchener 7 justifia les massacres en parlant des Boers comme "une espèce de sauvages issue de générations ayant mené une existence barbare et solitaire".
Il s’agit de propos cyniques d’un grand criminel de guerre. Certes on se doit de noter que, dans cette boucherie, les troupes afrikaners ne furent pas en reste en termes de massacres de masse et d’atrocités, et que des dirigeants Afrikaners furent plus tard des alliés de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre et ce avant tout pour régler leurs comptes avec la puissance britannique. "Vaincus par l’impérialisme britannique, soumis au système capitaliste, humiliés dans leur culture et leurs traditions, le peuple afrikaner (…) s’organise à partir de 1925-1930 dans un fort mouvement de réhabilitation de la nation afrikaner. Son idéologie revancharde, anticapitaliste, anticommuniste et profondément raciste désigne Africains, métis, Asiatiques et juifs, comme autant de menaces sur la civilisation occidentale qu’ils prétendent représenter sur le continent africain. Organisés à tous les niveaux, école, église, syndicat et en sociétés secrètes terroristes (dont la plus connue est Broederbond), les Afrikaners se montrèrent plus tard de fervents partisans de Hitler, du nazisme et de son idéologie". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Le fait que des ouvriers afrikaner aient été entraînés dans un mouvement adoptant un tel positionnement illustre l’immensité de l’obstacle que devait franchir la classe ouvrière dans ce pays pour se joindre aux combats ouvriers d’autres ethnies.
Ce conflit façonna durablement les rapports entre les colonialismes britannique et afrikaner sur le sol sud-africain jusqu’à la chute de l’apartheid. Aux divisions et haines ethniques entre blancs Britanniques et Afrikaners, se superposaient celles entre, d’une part, ces deux catégories et, d’autre part, les noirs (et autres hommes de couleur) que la bourgeoisie utilisa systématiquement pour briser toutes tentatives d’unité dans les rangs ouvriers.
Naissance de la classe ouvrière
La naissance du capitalisme entraîna la dislocation de bon nombre de sociétés traditionnelles africaines. En effet, à partir des années 1870, l’empire britannique entreprit une politique coloniale libérale en abolissant l’esclavage dans les régions qu’il contrôlait dans le but de "libérer" la force de travail constituée alors de travailleurs agricoles boers et africains. Signalons que les colons boers, eux, continuaient d’exploiter les agriculteurs noirs sous l’ancienne forme d’esclavage avant d’être vaincus par les britanniques. Mais, en dernière analyse, ce fut la découverte de l’or qui accéléra brusquement à la fois la naissance du capitalisme et celle de la classe ouvrière : "Le capital ne manquait pas. Les bourses de Londres et de New York fournirent volontiers les fonds nécessaires. L’économie mondiale, qui était en pleine croissance, réclamait l’or. Les ouvriers affluèrent aussi. L’exploitation minière attira les foules dans le Rand. Les gens vinrent s’y installer non pas par milliers, mais par dizaines de milliers. Aucune ville au monde ne connut alors un développement aussi rapide que Johannesburg" 8.
En effet, en l’espace de 20 ans la population européenne de Johannesburg passa de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers (250 000) dont une majorité d’ouvriers qualifiés, ingénieurs et autres techniciens. Ce sont eux qui donnèrent naissance à la classe ouvrière sud-africaine au sens marxiste du terme, c'est-à-dire ceux qui, sous le capitalisme, vendent leur force de travail en échange d’une rémunération. En fait, il convient de préciser que le capital avait un besoin important et urgent de main-d’œuvre plus ou moins qualifiée qui ne se trouvait pas sur place, d’où le recours aux migrants venus d’Europe et notamment de l’empire britannique. Mais, au fur et à mesure que progressait le développement économique, l’appareil industriel fut acculé à recruter de plus en plus de travailleurs africains non qualifiés se trouvant à l’intérieur du pays ou à l’extérieur, venant notamment du Mozambique et du Zimbabwe. Dès lors la main-d’œuvre économique sud-africaine "s’internationalisa" véritablement.
Comme conséquence de l’arrivée massive en Afrique du Sud des travailleurs d’origine britannique, la classe ouvrière fut d’emblée organisée et encadrée par les syndicats anglais et, au début des années 1880, nombreuses furent les sociétés et corporations qui se créèrent sur le "modèle anglais" (trade-union). Cela veut dire que les ouvriers d’origine sud-africaine, en tant que groupes ou individus sans expérience organisationnelle, pouvaient difficilement s’organiser en dehors des organisations syndicales préétablies 9. Certes, il y eut des dissidences au sein des syndicats comme au sein des partis se réclamant de la classe ouvrière avec tentatives de développer une activité syndicale autonome de la part d’éléments prolétariens radicaux qui ne supportaient plus la "trahison des dirigeants". Mais ceux-là furent très minoritaires.
Comme partout dans le monde où il existe des affrontements de classes sous le capitalisme, la classe ouvrière finit toujours par secréter des minorités révolutionnaires se réclamant, plus ou moins clairement, de l’internationalisme prolétarien. Ce fut aussi le cas en Afrique du Sud. Quelques éléments ouvriers furent à l’origine de luttes mais aussi à l’initiative de la formation d’organisations prolétariennes. Parmi ces éléments nous proposons de présenter trois figures de cette génération sous la forme d’un résumé succinct de leur trajectoire.
- Andrew Dunbar (1879-1964). Immigrant écossais, il fut secrétaire général du syndicat l’IWW (Industrial Workers of the World) créé en 1910 en Afrique du Sud. Il était cheminot à Johannesburg et participa activement à la grève massive de 1909 à l’issue de laquelle il fut licencié. En 1914, il lutta contre la guerre et participa à la création de la Ligue Internationale Socialiste (ISL), tendance syndicaliste révolutionnaire. Il lutta aussi contre les mesures répressives et discriminatoires contre les Africains, ce qui lui attira la sympathie des travailleurs noirs. Il fut d’ailleurs à l’origine de la création du premier syndicat africain "Union africaine" sur le modèle de l’IWW en 1917. Mais sa sympathie pour la révolution russe devenant de plus en plus grande, il décida alors, avec d’autres camarades, de former le "Parti communiste de l’Afrique" en octobre 1920 sur une plate-forme essentiellement syndicaliste et dont il fut secrétaire. En 1921, son organisation décida de fusionner avec le Parti Communiste officiel qui venait de voir le jour. Mais il en fut exclu quelques années plus tard et abandonna dans la foulée ses activités syndicales.
- TW Thibedi (1888-1960). Il fut considéré comme un grand syndicaliste membre de l’IWW (il y adhéra en 1916). Il était originaire de la ville sud-africaine de Vereeniging et exerça un métier d’enseignant dans une école dépendant d’une église à Johannesburg. Dans le cadre de ses activités syndicales il prônait l’unité de classe et l’action de masse contre le capitalisme. Il faisait partie de l’aile gauche du parti nationaliste africain "Congrès national indigène sud-africain" (SANNC). Thibedi lui aussi était membre de l’ISL et lors d'un mouvement de grève dirigé par ce groupe en 1918 il subit avec ses camarades une dure répression policière. Membre du PC sud-africain dès le début, il en fut exclu en 1928 mais, face à la réaction de nombre de ses camarades, il fut réintégré avant d’être définitivement chassé du parti et il décida ensuite de sympathiser brièvement avec la mouvance trotskiste avant d’entrer dans l’anonymat complet. Signalons que les sources dont nous disposons 10 ne donnent pas d’ordre de grandeur des militants trotskistes sud-africains de cette époque.
- Bernard Le Sigamoney (1888-1963). Indien d’origine et issue d’une famille d’agriculteurs, il fut membre actif du syndicat IWW indien et, comme ses camarades précédemment cités, il fut aussi membre de l’ISL. Il s’investit en faveur de l’unité des travailleurs de l’industrie de l’Afrique du Sud, de même que, avec ses camarades de l’ISL, il fut à la tête d’importants mouvements de grève en 1920/1921. Cependant, il ne rejoignit pas le Parti Communiste et décida d’abandonner ses activités politiques et syndicales en allant étudier en Grande Bretagne en 1922. En 1927 il revint en Afrique du Sud (Johannesburg) comme missionnaire pasteur anglican tout en reprenant ses activités syndicales au sein d’organisations proches de l’IWW. Il fut alors dénoncé comme "fauteur de troubles" par les autorités et finit par se décourager en se contentant de ses travaux dans l’église et de la promotion des droits civils des personnes de couleur.
Voilà donc 3 "portraits" de militants à trajectoires syndicales et politiques assez similaires tout en étant d’origine ethnique différente (un européen, un africain et un indien). Mais, surtout, ils partagent une caractéristique commune essentielle : la solidarité de classe prolétarienne et l’esprit internationaliste avec une grande combativité contre l’ennemi capitaliste. Ce furent eux et leurs camarades de lutte les précurseurs des combattants ouvriers actuels en Afrique du Sud.
D’autres organisations, de nature et origine différentes ont eu une action au sein de la classe ouvrière. Il s’agit des principaux partis et organisations 11 se réclamant à l’origine plus ou moins formellement de la classe ouvrière ou prétendant défendre ses "intérêts", ceci à l’exclusion de Parti Travailliste qui est demeuré fidèle à sa bourgeoisie depuis sa participation active à la première boucherie mondiale. Plus précisément nous donnons ici un aperçu 12 de la nature et origine de l’ANC et du PC sud-africain en tant que forces d’encadrement idéologique de la classe ouvrière depuis les années 1920.
- L’ANC. Cette organisation fut créée en 1912 par et pour la petite bourgeoisie indigène (médecins, juristes, enseignants et autres fonctionnaires, etc.), des individus qui réclamaient la démocratie, l’égalité raciale et en se revendiquant du système constitutionnel anglais comme l’illustrent les dires mêmes de Nelson Mandela 13 : "Pendant 37 ans, c'est-à-dire jusqu’en 1949, le Congrès national africain lutta en respectant scrupuleusement la légalité (…) On croyait alors que les griefs des Africains pourraient être pris en considération au terme de discussions pacifiques et que l’on s’acheminerait lentement vers une pleine reconnaissance des droits de la nation africaine".
En ce sens, depuis sa naissance jusqu’aux années 1950 14, l’ANC menait plutôt des actions pacifiques respectueuses de l’ordre établi, et était donc très loin de vouloir renverser le système capitaliste. De même que Mandela se vantait de son combat "anti-communiste" comme le souligne son autobiographie "Un long chemin vers la liberté". Mais l’orientation stalinienne, suggérant une alliance entre la bourgeoisie ("progressiste") et la classe ouvrière, permit à l’ANC de s’appuyer sur le PC pour avoir pied dans les rangs ouvriers, notamment par le biais des syndicats que ces deux partis contrôlent ensemble jusqu’aujourd’hui.
- Le Parti Communiste sud-africain. Le PC fut créé par des éléments se réclamant de l’internationalisme prolétarien et à ce titre fut membre de la Troisième Internationale (en 1921). À ses débuts, il préconisait l’unité de la classe ouvrière et mettait en perspective le renversement du capitalisme et l’instauration du communisme. Mais il devint, dès 1928, un simple bras exécutant des orientations de Staline dans la colonie sud-africaine. En effet, la théorie stalinienne du "socialisme en un seul pays" s’accompagnait de l’idée suivant laquelle les pays sous-développés devaient obligatoirement passer par "une révolution bourgeoise" et que, dans cette optique, le prolétariat pouvait toujours lutter contre l’oppression coloniale mais pas question d’instaurer un quelconque pouvoir prolétarien dans les colonies de l’époque.
Le PC sud-africain appliqua cette orientation jusqu’à l’absurde en devenant même le chien fidèle de l’ANC dans les années 1950, comme l’illustre ce propos : "Le PC fit des offres de service à l’ANC. Le secrétaire général du PC expliquait à Mandela : "Nelson, qu’est-ce tu as contre nous ? Nous combattons le même ennemi. Nous ne parlons pas de dominer l’ANC ; nous travaillons dans le contexte du nationalisme africain". Et au cours de l’année 1950 Mandela accepta que le PC mette son appareil militant au service de l’ANC, en lui offrant ainsi le contrôle sur une bonne partie du mouvement ouvrier et un avantage important permettant à l’ANC de prendre l’hégémonie sur l’ensemble du mouvement anti-apartheid. En échange l’ANC servirait de vitrine légale pour l’appareil du PC interdit." 15
De ce fait, ces deux partis ouvertement bourgeois sont devenus inséparables et se trouvent aujourd’hui à la tête de l’État sud-africain pour la défense des intérêts bien compris du capital national et contre la classe ouvrière qu’ils oppressent et massacrent, comme lors du mouvement de grève des mineurs de Marikana en août 2012.
L’apartheid contre la lutte de classe
Voilà un mot barbare honni aujourd’hui dans le monde entier, même par ses anciens soutiens tant il a longtemps symbolisé et incarné la forme d’exploitation capitaliste la plus ignoble contre les couches et classes appartenant au prolétariat sud-africain. Mais avant d’aller plus loin nous proposons une définition parmi d’autres de ce terme : En langue "afrikaans" parlée par les Afrikaners, apartheid signifie "séparation", plus précisément séparation raciale, sociale, culturelle, économique, etc... Mais derrière cette définition formelle du mot apartheid se cache une doctrine véhiculée par des capitalistes et colonialistes "primitifs" mêlant objectifs économiques et idéologiques : "L’apartheid est issu à la fois du système colonial et du système capitaliste ; à ce double titre, il imprime à la société sud-africaine des divisions de races caractéristiques du premier, et des divisions de classes inhérentes au second. Comme bien d’autres lieux du globe, il y a coïncidence presque parfaite entre races noires et classe exploitée. À l’autre pôle cependant, la situation est moins claire. En effet, la population blanche ne peut pas être assimilée à une classe dominante sans autre forme de procès. Elle est, certes, constituée d’une poignée de détenteurs des moyens de production, mais aussi de la masse de ceux qui en sont dépossédés : ouvriers agricoles et de l’industrie, mineurs, employés du tertiaire, etc. Il n’y a donc pas identité entre race blanche et classe dominante. (…) Or, rien de tel ne s’est jamais produit [la main-d’œuvre blanche côtoyant la main-d’œuvre noire sur un pied d’égalité] ni ne se produira jamais en Afrique du Sud tant que l’apartheid sera en vigueur. Car ce système a pour but d’éviter toute possibilité de création d’une classe ouvrière multiraciale .16 C’est là que l’anachronisme du système de pouvoir sud-africain, que ses mécanismes datant d’une autre époque viennent au secours du système capitaliste qui tend généralement à simplifier les rapports au sein de la société. L’apartheid - dans sa forme la plus complète -est venu consolider l’édifice colonial, au moment où le capitalisme risquait de faire crouler la toute-puissance des Blancs. Le moyen en a été une idéologie et une législation visant à annihiler les antagonismes de classe à l’intérieur de la population blanche, à en extirper les germes, à en gommer les contours et à les remplacer par des antagonismes de races.
En déplaçant les contradictions d’un terrain difficile à contrôler (division de la société en classes antagoniques) sur celui, plus facilement maîtrisable, de la division non antagonique de la société entre races, le pouvoir blanc a pratiquement atteint le résultat escompté : constituer un bloc homogène et uni du côté de l’ethnie blanche - bloc d’autant plus solide qu’il se croit historiquement menacé par le pouvoir noir et le communisme - et de l’autre côté, diviser les populations noires entre elles, par tribus distinctes ou par couches sociales aux intérêts différents.
Les dissonances, les antagonismes de classe qui sont minimisés, ignorés ou gommés du côté blanc, sont encouragés, soulignés et provoqués du côté noir. Cette entreprise de division - facilitée par la présence sur le sol sud-africain de populations aux origines très diverses - est systématiquement menée depuis la colonisation : détribalisation d’une partie des populations africaines, maintien dans les structures traditionnelles d’une autre ; évangélisation et instruction de certains, privation de toute possibilité d’éducation des autres ; instauration de petites élites de chefs et de fonctionnaires, paupérisation des grandes masses ; enfin, mise en place à grand renfort de publicité d’une petite bourgeoisie africaine, métisse, indienne, composée d’individus- tampons prêts à s’interposer entre leurs frères de races et leurs alliés de classe" (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Nous sommes globalement d’accord avec le cadre de définition et d’analyse du système d’apartheid de cet auteur. Nous sommes particulièrement de son avis quand elle affirme que l’apartheid est avant tout un instrument idéologique au service du capital contre l’unité (dans la lutte) des différents membres de la classe exploitée, en l’occurrence les ouvriers de toutes couleurs. Autrement dit, le système d’apartheid est avant tout une arme contre la lutte de classe comme moteur de l’histoire, la seule qui soit capable de renverser le capitalisme. Aussi, si l’apartheid fut théorisé et appliqué à fond à partir de 1948 par la fraction Afrikaner la plus rétrograde de la bourgeoisie coloniale sud-africaine, ce sont quand même les Britanniques porteurs de la "civilisation la plus moderne" qui posèrent les jalons de ce système abject. "En effet, c’est dès le début du XIXe siècle que les envahisseurs britanniques avaient pris des mesures législatives et militaires pour regrouper une partie des populations africaines dans les "réserves", laissant ou contraignant l’autre partie à en sortir pour s’employer à travers le pays dans les divers secteurs "économiques. La superficie de ces réserves tribales fut fixée en 1913 et légèrement agrandie en 1936 pour n’offrir à la population (noire) que 13 % du territoire national. Ces réserves tribales fabriquées de toutes pièces par le pouvoir blanc (…) ont reçu le nom Bantoustans (…) "foyers nationaux pour Bantous", chacun d’eux devant théoriquement regrouper les membres d’une même ethnie". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Ainsi, l’idée de séparer les races et les populations fut initiée par le colonialisme anglais qui appliqua méthodiquement sa fameuse stratégie dite "diviser pour régner" en instaurant une séparation ethnique, pas seulement entre blancs et noirs mais plus cyniquement encore entre les ethnies noires.
Cependant, les tenants du système ne purent jamais empêcher l’éclatement de ses propres contradictions générant inévitablement la confrontation entre les deux classes antagoniques. En clair, sous ce système barbare, de nombreuses luttes ouvrières furent menées aussi bien par les ouvriers blancs que par les ouvriers noirs (ou métis et indiens).
Certes, la bourgeoisie sud-africaine a remarquablement réussi à rendre les luttes ouvrières impuissantes en empoisonnant durablement la conscience de classe des prolétaires sud-africains. Cela se traduisit par le fait que certains groupes ouvriers se battaient souvent à la fois contre leurs exploiteurs mais aussi contre leurs camarades d’une ethnie différente de la leur, tombant ainsi dans le piège mortel tendu par l’ennemi de classe. En somme, rares furent les luttes unissant ouvriers d’origines ethniques diverses. On sait que nombreuses furent aussi les organisations dites "ouvrières", à savoir syndicats et partis, qui facilitèrent la tâche au capital en cautionnant cette politique de la "division raciale" de la classe ouvrière sud-africaine. Par exemple, les syndicats d’origine européenne en compagnie du Parti Travailliste sud-africain, défendaient d’abord (voire exclusivement) les "intérêts" des ouvriers blancs. De même, les divers mouvements noirs (partis et syndicats) luttaient avant tout contre le sort réservé aux noirs par le système d’exclusion en réclamant l’égalité puis l’indépendance. Cette orientation fut incarnée principalement par l’ANC. Soulignons ici le cas particulier du PC sud-africain qui, dans un premier temps (début années 1920), essaya d’unir la classe ouvrière sans distinction dans le combat contre le capitalisme mais ne tarda pas à abandonner le terrain de l’internationalisme en décidant de privilégier "la cause noire". C’était le début de sa "stalinisation" définitive.
Mouvements de grève et autres luttes sociales entre 1884 et 2013
Première lutte ouvrière à Kimberley.
Comme par hasard, le diamant qui donna naissance symboliquement au capitalisme sud-africain fut aussi à l’origine du premier mouvement de lutte prolétarienne. En effet, la première grève ouvrière éclata à Kimberley, "capitale diamantaire" en 1884 où les mineurs d’origine britannique décidèrent de lutter contre la décision des compagnies minières de leur imposer le système dit "compound" (camp de travail forcé) réservé jusqu’alors aux travailleurs noirs. Dans cette lutte, les mineurs organisèrent des piquets de grève pour imposer un rapport de force leur permettant de satisfaire leurs revendications. Tandis que pour faire plier les grévistes, les employeurs engagèrent d’un côté des "jaunes" et de l’autre des troupes armées jusqu’aux dents qui ne tardèrent pas à tirer sur les ouvriers. Et on dénombra 4 morts chez les grévistes qui poursuivirent cependant la lutte avec vigueur, ce qui obligea les employeurs à satisfaire leurs revendications. Voilà le premier mouvement de lutte opposant les deux forces historiques sous le capitalisme sud-africain qui se termina dans le sang mais victorieux pour le prolétariat. De ce fait, on peut dire qu’ici débuta la vraie lutte de classe en Afrique du Sud capitaliste, posant les jalons pour les confrontations ultérieures.
Grève contre la réduction des salaires en 1907
Non contents des cadences qu’ils imposèrent aux ouvriers en vue d’un meilleur rendement, les employeurs du Rand 17 décidèrent, courant 1907, de réduire les salaires de 15 %, en particulier ceux des mineurs d’origine anglaise considérés comme "privilégiés". Comme lors de la grève de Kimberley, le patronat recruta des jaunes (afrikaners très pauvres) qui, sans être solidaires des grévistes, refusèrent cependant de faire le sale boulot qu’on leur demandait. Malgré cela le patronat finit par réussir à faire plier les grévistes, notamment grâce à l’usure. Notons ici que les sources dont nous disposons parlent bien de grève d’ampleur mais ne donnent pas de chiffre concernant le nombre des participants au mouvement.
Grèves et manifestations en 1913
Face à la réduction massive des salaires et à la dégradation de leurs conditions de travail, les mineurs entrèrent massivement en lutte. En effet, courant 1913, une grève fut lancée par les ouvriers d’une mine contre les heures supplémentaires que l’entreprise voulait leur imposer. Et il n’en fallut pas plus pour généraliser le mouvement à tous les secteurs avec des manifestations de masse, lesquelles furent néanmoins brisées violemment par les forces de l’ordre. Au final on compta (officiellement) une vingtaine de morts et une centaine de blessés.
Grève des cheminots et des charbonniers en 1914
Au début de cette année-là éclata une série de grèves aussi bien chez les mineurs de charbon que chez les cheminots contre la dégradation des conditions de travail. Mais ce mouvement de lutte se situa dans un contexte particulier, celui des terribles préparatifs de la première boucherie impérialiste généralisée. Dans ce mouvement, on put remarquer la présence de la fraction afrikaner, mais à l’écart de la fraction anglaise. Bien entendu toutes deux bien encadrées par leurs syndicats respectifs dont chacun défendait ses propres "clients ethniques".
Dès lors le gouvernement s’empressa d’instaurer la loi martiale sur laquelle il s’appuya pour briser physiquement la grève et ses initiateurs et en emprisonnant ou en déportant un grand nombre de grévistes dont on ignore encore le nombre exact des victimes. Par ailleurs, nous tenons à souligner ici le rôle particulier des syndicats dans ce mouvement de lutte. En effet, ce fut dans ce même contexte de répression des luttes que les dirigeants syndicaux et du Parti Travailliste votèrent les "crédits de guerre" en soutenant l’entrée en guerre de l’Union Sud-Africaine contre l’Allemagne.
Agitations ouvrières contre la guerre de 1914 et tentatives d’organisation
Si la classe ouvrière fut muselée globalement durant la guerre 1914/18, en revanche quelques éléments prolétariens purent tenter de s’y opposer en préconisant l’internationalisme contre le capitalisme. Ainsi : " (…) En 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : "Venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et les indigènes". Ce texte est publié par l’International Socialist League (ISL), une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains (…) et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du parti travailliste sud-africain et des syndicats de métiers. Comptant au début surtout des militants blancs, l’ISL s’oriente très vite vers les ouvriers noirs, appelant dans son journal hebdomadaire L’International, à construire "un nouveau syndicat qui surmonte les limites des métiers, des couleurs de peau, des races et du sexe pour détruire le capitalisme par un blocage de la classe capitaliste" " 18.
Dès 1917, L’ISL organise des ouvriers de couleurs. En mars 1917, elle fonde un syndicat d’ouvriers indiens à Durban. En 1918, elle fonde un syndicat des travailleurs du textile (se déclarant aussi plus tard à Johannesburg) et un syndicat des conducteurs de cheval à Kimberley, ville d’extraction de diamant. Au Cape, une organisation sœur, L’Industrial Socialist League, fonde la même année un syndicat des travailleurs des sucreries et confiseries.
La réunion du 19 juillet est un succès et constitue la base de réunions hebdomadaires de groupes d’étude menés par des membres de L’ISL (notamment Andrew Dunbar, fondateur de L’IWW en Afrique du Sud en 1910). Dans ces réunions, on discute du capitalisme, de la lutte des classes et de la nécessité pour les ouvriers africains de se syndiquer afin d’obtenir des augmentations de salaires et de supprimer le système du droit de passage. Le 27 septembre suivant, les groupes d’étude se transforment en un syndicat, L’Industrial Workers of Africa (IWA), sur le modèle des IWW. Son comité d’organisation est entièrement composé d’Africains. Les demandes des nouveaux syndicats sont simples et intransigeantes dans un slogan : Sifuna Zonke ! ("Nous voulons tout !").
Enfin, voilà l’expression de l’internationalisme prolétarien naissant. Un internationalisme porté par une minorité d’ouvriers mais d’une haute importance à l’époque, car ce fut au moment où nombre de prolétaires étaient ligotés et entraînés dans la première boucherie impérialiste mondiale par le Parti Travailliste traître en compagnie des syndicats officiels. Un autre aspect qui illustre la force et la dynamique de ces petits regroupements internationalistes fut le fait que des éléments (notamment de la Ligue Internationale Socialiste et d’autres) purent s’en dégager pour former le Parti Communiste sud-africain en 1920. Ce furent ces groupes dominés apparemment par les tenants du syndicalisme révolutionnaire qui purent favoriser activement l’émergence de syndicats radicaux en particulier chez les travailleurs noirs ou de couleurs.
Une vague de grèves en 1918
Malgré la dureté des temps d’alors avec les lois martiales réprimant toute réaction ou mouvement de protestation, des grèves purent se produire : "En 1918, une vague sans précédent de grèves contre le coût de la vie et pour des augmentations de salaire, rassemblant ouvriers blancs et de couleur, submerge le pays. Lorsque le juge McFie fait jeter en prison 152 ouvriers municipaux africains en juin 1918, les enjoignant à continuer "d’effectuer le même travail qu'auparavant" mais maintenant depuis la prison sous surveillance d’une escorte armée, les progressistes blancs et africains sont outragés. Le TNT (le Transvaal Native Congres, ancêtre de l’ANC) appelle à un rassemblement de masse des ouvriers africains à Johannesburg le 10 juin". (http//www-pelloutier.net, déjà cité).
On doit souligner ici un fait important ou symbolique : voilà l’unique implication (connue) de l’ANC dans un mouvement de lutte de classe au sens premier du terme. C’est certainement une des raisons expliquant le fait que cette fraction nationaliste ait pu par la suite avoir une influence au sein de la classe ouvrière noire.
Grèves massives en 1919/1920 réprimées dans le sang
Courant 1919 un syndicat radical (Industrial and Commercial Workers Union) composé de noirs et métis mais sans les blancs lança un vaste mouvement de grève notamment chez les dockers du Port-Elisabeth. Mais une fois de plus ce mouvement fut brisé militairement par la police épaulée par des groupes blancs armés et provoquant plus de 20 morts chez les grévistes. Voilà encore des grévistes isolés et ainsi assurée la défaite de la classe ouvrière dans un combat inégal sur le plan militaire.
En 1920 ce furent cette fois les mineurs africains qui déclenchèrent une des plus grandes grèves du pays touchant quelques 70 000 travailleurs. Un mouvement qui dura une semaine avant d’être écrasé par les forces de l’ordre qui, par les armes, liquidèrent un grand nombre de grévistes. À souligner le fait que, malgré sa massivité, ce mouvement des ouvriers africains ne put bénéficier du moindre soutien des syndicats blancs qui refusèrent d’appeler à la grève et de venir en aide aux victimes des balles de la bourgeoise coloniale. Et malheureusement ce manque de solidarité encouragé par les syndicats devint systématique dans chaque lutte.
En 1922 une grève insurrectionnelle écrasée par une armée suréquipée
Fin décembre 1921, le patronat des mines de charbon annonça des réductions massives de salaires et des licenciements visant à remplacer 5 000 mineurs européens par des indigènes. En janvier 1922, 30 000 mineurs décidèrent de partir en lutte contre les attaques des employeurs miniers. En effet, face aux tergiversations des syndicats, un groupe d’ouvriers prit l’initiative de la riposte en se dotant d’un comité de lutte et décrétant une grève générale. De ce fait les mineurs forcèrent ainsi les dirigeants syndicaux à suivre le mouvement, mais cette grève ne fut pas tout à fait "générale" car elle ne concernait que les "blancs".
Face à la pugnacité des ouvriers, l’État et le patronat unis décidèrent alors d’employer les plus gros moyens militaires pour venir à bout du mouvement. En effet, pour faire face à la grève, le gouvernement décréta la loi martiale et regroupa quelques 60 000 mille hommes équipés de mitrailleuses, canons, chars et même des avions.
De leur côté, voyant l’ampleur de l’armement de leurs ennemis, les grévistes se mirent à s’armer en se procurant des armes (fusils et autres) et s’organisant en commandos. Dès lors on assista à une véritable bataille militaire comme dans une guerre classique. Au terme du combat on énuméra du côté ouvrier plus de 200 morts, 500 blessés, 4750 arrestations, 18 condamnations à mort. En clair, il s’est agi là d’une vraie guerre, comme si l’impérialisme sud-africain qui prit part active dans la première boucherie mondiale voulait prolonger son action en bombardant les ouvriers mineurs comme il affrontait les troupes allemandes. En clair, par ce geste la bourgeoisie coloniale britannique fit la démonstration de sa haine absolue du prolétariat sud-africain mais aussi de sa terrible peur de ce dernier.
En termes de leçons à tirer de ce mouvement, il convient de dire que, malgré son caractère très militaire, cette confrontation sanglante fut surtout une vraie guerre de classe, en l’occurrence le prolétariat contre la bourgeoisie, avec cependant des moyens inégaux. Cela ne fait que souligner que la force première de la classe ouvrière n’est pas militaire mais réside avant tout dans son unité la plus large possible. Au lieu de chercher le soutien de l’ensemble des exploités, les mineurs (blancs) tombèrent dans le piège tendu par la bourgeoisie à travers son projet de remplacer les 5 000 ouvriers européens par des indigènes. Cela se traduisit tragiquement par le fait que, durant toute la bataille rangée entre les mineurs européens et les forces armées du capital, les autres ouvriers (noirs, métis et indiens) eux, furent 200 000 à travailler ou à croiser les bras. Il est clair aussi que, dès le départ, la bourgeoisie était visiblement consciente de l’état de faiblesse des ouvriers allant au combat profondément divisés. En fait la recette abjecte "diviser pour régner" a été appliquée ici avec succès bien avant l’instauration officielle de l’apartheid (dont le but principal - rappelons-le - est avant tout contre la lutte de classe). Mais surtout la bourgeoisie profita de sa victoire militaire sur les prolétaires sud-africains pour renforcer son emprise sur la classe ouvrière. Elle organisa des élections en 1924 dont sortirent vainqueurs les partis populistes clientélistes se voulant défenseurs des "intérêts des Blancs", à savoir le Parti National (Boer) et le Parti Travailliste qui formèrent une coalition gouvernementale. Ce fut cette coalition gouvernementale qui promulgua les lois instaurant des divisions raciales allant jusqu’à assimiler à un crime une rupture de contrat de travail par un noir ; ou encore imposant un système de laissez-passer pour les noirs et instaurant des zones de résidence obligatoire pour les indigènes. De même "La barre de la couleur" ("color bar") visait à réserver aux Blancs les emplois qualifiés leur assurant un salaire nettement plus élevé que celui des Noirs ou des Indiens. À cela s’ajoutèrent d’autres lois ségrégationnistes dont celle intitulée "La Loi de Conciliation Industrielle" permettant l’interdiction d’organisations non blanches. Ce fut ce dispositif ultra répressif et ségrégationniste sur lequel s’appuya, en 1948, le gouvernement afrikaner pour instaurer juridiquement l’apartheid.
La bourgeoisie parvint ainsi à paralyser durablement toute expression de lutte de classe prolétarienne et il fallut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale pour voir la classe ouvrière sortir la tête de l’eau en reprenant le chemin des combats de classe. En fait, entre la fin des années 1920 et 1937, le terrain de la lutte fut occupé par le nationalisme : d’un côté, par le PC sud-africain, l’ANC et leurs syndicats, de l’autre, par le Parti National afrikaner et ses satellites.
(à suivre)
Lassou (décembre 2013)
1. Voir la série "Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique, au Sénégal en particulier", dans la Revue internationale : 145, 146, 147, 148 et 149.
2. En août 2012, la police du gouvernement de l’ANC a massacré 34 grévistes des mines de Marikana.
3. Henri Wesseling, Le partage de l’Afrique, Editions Denoel, 1996, pour la traduction française.
4. Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, tom 2, chapitre "La lutte contre l’économie naturelle", Editions Maspero, 1976.
5. Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Editions Syros, 1977.
6. Henri Wesseling. Ibid.
7. Lord Kitchener, commandant de l’armée britannique d’alors, cité par Henri Wesseling. Ibid.
8. Henri Wesseling, ibid.
9. L’État sud-africain y a certes contribué largement par des lois réprimant toute organisation non blanche.
10. Lucien van der Walt (Bikisha media collective) Site https://zabalaza.net/ [530]
11. Nous reviendrons ultérieurement sur les organisations syndicales se réclamant de la classe ouvrière.
12. Dans l’article suivant on développera sur les rôles des partis/ syndicats agissant au sein de la classe ouvrière.
13. Cité par Brigitte Lachartre. Ibid.
14. C’est au lendemain de l’instauration officielle de l’apartheid en 1948 que le PC et l’ANC entrèrent en lutte armée.
15. Cercle Léon Trotski, Exposé du 29/01/2010, site Internet www.lutte-ouvriere.org [531]
16. Souligné par nous.
17. Nom d'une région, Rand étant un raccourci de Witwatersrand.
18. Une histoire du syndicalisme révolutionnaire en Afrique du Sud, Site : http// www.pelloutier.net [532], 2008.
Géographique:
- Afrique [162]
Rubrique:
Revue Internationale 2015
- 1402 lectures
Revue Internationale n°155
- 1333 lectures
Editorial de la Revue internationale n°155 (été 2015)
- 1392 lectures
En ce mi-2015, le centenaire de la Grande Guerre – comme on l’appelle toujours – est derrière nous. Les gerbes de fleurs devant les monuments aux morts se sont fanées depuis bien longtemps, les expositions temporaires dans les mairies sont consignées aux oubliettes, les politiciens ont fait leurs beaux discours hypocrites, et la vie peut reprendre son cours qui passe pour être “normale”.
Mais en 1915, la guerre est tout sauf terminé, au contraire. Plus personne n’a la moindre illusion que les soldats seront rentrés chez eux “avant Noël”. Depuis que l’avance de l’armée allemande a été stoppée sur la Marne en septembre 1914, le conflit s’est enlisé dans une guerre de tranchées. Lors de la deuxième bataille d’Ypres, en avril 1915, les allemands pour la première fois ont lâché des gaz de guerre qui seront bientôt utilisés par les armées des deux côtés. Les morts se comptent déjà par centaines de milliers.
La guerre sera longue, ses souffrances terribles, son coût ruineux. Comment faire accepter l’horreur aux populations qui le subissent ? C’est à cette tâche cynique que s’attèle les bureaux de propagande des différents Etats, et c’est le sujet de notre premier article. En ceci, comme en tant d’autres domaines, 1914 marque l’entrée dans une période charnière qui verra l’installation progressive d’un capitalisme d’Etat omniprésent, comme seule réponse possible à la décadence de sa forme sociale.
Avec 1915 nous commençons à voir aussi les premières signes d’une résistance ouvrière, notamment en Allemagne où la fraction parlementaire du parti socialiste, le SPD, ne vote plus unanimement les crédits de guerre comme il avait fait en août de l’année précédent. Les révolutionnaires Otto Rühle et Karl Liebknecht, qui les premiers ont rompu les rangs pour s’opposer à la guerre, sont rejoints par d’autres. Ce mouvement d’opposition à la guerre, regroupant une poignée de militants des différents pays belligérants, donnera lieu en septembre 1915 à la première conférence de Zimmerwald.
Les groupes qui se réunissaient dans le village suisse de Zimmer
wald étaient loin de présenter un front uni. A côté des bolcheviques révolutionnaires de Lénine, pour qui seule la guerre civile pour le renversement du capitalisme pouvait répondre à la guerre impérialiste, se trouvait un courant – bien plus nombreux – qui espérait encore trouver un terrain d’entente avec les partis socialistes passé à l’ennemi. On appelait ce courant “centriste”, et il allait jouer un rôle important dans les difficultés et dans la défaite de la révolution allemande de 1919. C’est justement le thème d’un texte interne écrit par Marc Chirik en décembre 1984 dont nous publions ici de larges extraits. L’USPD centriste n’est plus, mais on aurait tort de penser que le centrisme comme type de comportement politique n’ait disparu pour autant ; bien au contraire, comme le montre ce texte, il est même particulièrement caractéristique de la décadence du capitalisme.
Pour conclure, nous publions également dans la Revue Internationale n° 155 [534] un nouvel article dans notre série sur la lutte des classes en Afrique, en particulier ici en Afrique du Sud. Celui-ci traite de la période sombre qui va de la Deuxième Guerre mondiale à la reprise mondiale des luttes à la fin des années 1960 ; malgré la division imposée par le régime d’apartheid, il montre que la lutte ouvrière a bien survécu, et qu’elle est très loin de se résumer à un soutien accessoire au mouvement nationaliste dirigé par l’ANC de Nelson Mandela.
CCI, juillet 2015
Naissance de la démocratie totalitaire
- 5949 lectures
La Propagande pendant la Première Guerre mondiale
"La manipulation habile et consciente des habitudes et des opinions des masses est une composante majeure de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme secret de la société constituent un gouvernement invisible qui est la véritable puissance dirigeante de notre société." Edward Bernays, Propaganda, 1928 1
Ce n'est pas au cours de la Première Guerre mondiale qu'a été inventée la propagande. Lorsqu’on admire les bas-reliefs sculptés sur les escaliers monumentaux de Persépolis, où les peuples en ligne apportent leur tribut et déposent les produits de l'Empire au pied du grand Roi Darius, ou les hauts faits des Pharaons immortalisés dans la pierre de Louxor, ou encore la Galerie des Glaces du château de Versailles, ce sont des œuvres de propagande que nous regardons, ayant pour but de communiquer la puissance et la légitimité du monarque à ses sujets. La mise en scène de la parade des troupes impériales à Persépolis aurait été tout-à-fait parlante pour l’Empire britannique du 19e siècle qui organisait lui-même des défilés immenses et colorés exhibant sa puissance militaire lors des Durbars de Delhi à l'occasion de grandes festivités royales.
Mais si en 1914 la propagande n’était pas quelque chose de nouveau, la guerre en transforma profondément la forme et la signification. Au cours des années qui suivirent la guerre, le terme "propagande" devint synonyme d'écœurement, signifiant la manipulation malhonnête ou la fabrication de l’information par l’État . 2 À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l’expérience du régime nazi et de la Russie stalinienne, la propagande prit une connotation encore plus sinistre : omniprésente à l‘exclusion de toute autre source d’information, envahissant tous les recoins de la vie privée, la propagande finit par se présenter comme une sorte de lavage de cerveau. Mais, en réalité, l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne n’étaient que des caricatures grossières de l’appareil de propagande omniprésent mis en place dans les démocraties occidentales après 1918 qui développaient de façon de plus en plus sophistiquée les techniques qui avaient été mises en œuvre à grande échelle pendant la guerre. Lorsque Edward Bernays 3 dont nous avons cité le travail précurseur sur la propagande au début de cet article, quitta le US Comittee on Public Information ("Comité américain pour l’information publique" - en réalité le bureau gouvernemental pour la propagande guerrière) à la fin de la guerre, il s’établit à son compte comme consultant pour l’industrie privée, non en propagande mais en "relations publiques" - une terminologie qu’il inventa lui-même. C’était une décision délibérée et consciente : déjà à cette époque, Bernays savait que le terme "propagande" était entaché de façon indélébile aux yeux de l’opinion publique de la marque du "mensonge".
La Première Guerre mondiale a marqué le moment où l’État capitaliste prit pour la première fois le contrôle massif et totalitaire de l’information, à travers la propagande et la censure, dans un but unique : la victoire dans la guerre totale. Comme dans tous les autres aspects de la vie sociale – l’organisation de la production et des finances, le contrôle social de la population et, en particulier, de la classe ouvrière, la transformation de la démocratie parlementaire composée d’intérêts bourgeois divergents en une coquille vide – la Première Guerre mondiale marqua le début de l’absorption et du contrôle de la pensée et de l’action sociales. Après 1918, les hommes qui, comme Bernays, avaient travaillé pour les ministères de la propagande pendant la guerre, ont été employés dans l’industrie privée comme responsables des "public relations", consultants en publicité, experts en "communication" comme on les appelle aujourd’hui. Ceci ne voulait pas dire que l'État n'était plus impliqué, au contraire, le processus initié pendant la guerre d’une osmose constante entre l’État et l’industrie privée s’est poursuivi. La propagande ne s’en est pas allée mais elle a disparu : elle est devenue une partie si omniprésente et si normale de la vie quotidienne qu’elle est devenue invisible, un des éléments les plus insidieux et les plus puissants de la "démocratie totalitaire" d’aujourd’hui. Lorsque George Orwell écrivit son grand et alarmant roman, 1984 (écrit en 1948 d’où son titre), il imaginait un avenir dans lequel tous les citoyens auraient l’obligation d’installer chez eux un écran au moyen duquel ils seraient tous soumis à la propagande étatique : soixante ans plus tard, les gens achètent eux-mêmes leur télévision et se divertissent de leur propre chef avec des produits dont la sophistication éclipse le "Ministère de la Vérité" de Big Brother. 4
L'arrivée de la guerre posait aux classes dominantes un problème sans précédent au niveau historique, bien que ce soit de façon progressive que toutes les implications en sont apparues, avec la progression de la guerre elle-même. D'abord, c'était une guerre totale qui impliquait d'immenses masses de troupes : jamais auparavant il n'y avait eu une telle proportion de la population masculine sous les armes. Deuxièmement et, en partie, comme conséquence, la guerre incorporait toute la population civile à la production de fournitures militaires, directement pour l'offensive (canons, fusils, munitions, etc.) ainsi que pour l'équipement (uniformes, approvisionnement alimentaire, transports). La masse des hommes étaient appelée pour le front ; les masses des femmes travaillaient dans les usines et les hôpitaux. Il fallait aussi financer la guerre ; c'était impossible de prélever des montants aussi énormes à travers les impôts et une préoccupation majeure de la propagande étatique était de faire appel aux économies de la nation en vendant des bons de la défense nationale. Parce que toute la population devait participer directement à la guerre, toute la population devait être convaincue que la guerre était juste et nécessaire et ce n'était pas quelque chose qui était simplement donné d'avance :
"Les résistances psychologiques à la guerre dans les nations modernes sont si grandes que chaque guerre doit apparaître comme une guerre de défense contre un agresseur menaçant et meurtrier. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ceux que le public doit haïr. Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ni la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes, mais la rapacité de l'ennemi. Culpabilité et innocence doivent être géographiquement établies et toute la culpabilité doit se trouver de l'autre côté de la frontière. Si la propagande veut mobiliser toute la haine des populations, elle doit veiller à ce que toutes les idées qui circulent fassent porter l'unique responsabilité sur l'ennemi. Des variations de ce thème peuvent être permises dans certaines circonstances que nous chercherons à spécifier, mais ce thème doit toujours être le schéma dominant.
Les gouvernements d'Europe occidentale ne peuvent jamais être tout-à-fait certains que le prolétariat existant dans leurs frontières et sous leur autorité qui a une conscience de classe se ralliera à leur clairon guerrier." 5
La propagande communiste et la propagande capitaliste
Etymologiquement, le terme propagande signifie ce qui doit être propagé, diffusé, du latin propagare : propager. Il fut utilisé en particulier par un organisme de l'église catholique créé en 1622 : la Congregatio de Propaganda Fide ("Congrégation de la Propagation de la Foi"). À la fin du 18e siècle, avec les révolutions bourgeoises, le terme commença à être également utilisé pour la propagande d'activités laïques, en particulier pour la diffusion d'idées politiques. Dans Que faire ?, Lénine citant Plekhanov écrivait que : "Le propagandiste inculque beaucoup d'idées à une seule personne ou un petit nombre de personnes ; l'agitateur n'inculque qu'une seule idée ou qu'un petit nombre d'idées ; en revanche il les inculque à toute une masse de personnes."
Dans son texte de 1897, "Les tâches des social-démocrates russes", Lénine insistait sur l'importance d' "une activité de propagande visant à faire connaître la doctrine du socialisme scientifique, (à) diffuser parmi les ouvriers une conception juste du régime économique et social actuel, des fondements et du développement de ce régime, des différentes classes de la société russe, de leurs rapports, de la lutte de ces classes entre elles, (…) une conception juste de la tâche historique de la social-démocratie internationale". Lénine insiste encore et encore sur la nécessité d'éduquer des ouvriers conscients ("Lettre à l'Union du Nord du POSDR", 1902) et, pour ce faire, les propagandistes doivent en premier lieu s'éduquer eux-mêmes, ils doivent lire, étudier, acquérir de l'expérience ("Lettre à un camarade sur nos tâches d'organisation", septembre 1902) , il insiste sur le fait que les socialistes se considèrent comme les héritiers du meilleur de la culture passée ("Quel héritage renions-nous ?", 1897). Pour les communistes, la propagande c'est donc l'éducation, le développement de la conscience et de l'esprit critique qui sont inséparables d'un effort volontaire et conscient de la part des ouvriers eux-mêmes pour acquérir cette conscience.
En comparaison, Bernays écrit : "La machine à vapeur, la presse multiple et l'école publique, ce trio de la révolution industrielle, ont ôté le pouvoir aux rois et l'ont donné au peuple. En fait le peuple a gagné le pouvoir que le roi a perdu. Car le pouvoir économique tend à venir après le pouvoir politique ; et l'histoire de la révolution industrielle montre comment ce pouvoir est passé du roi et de l'aristocratie à la bourgeoisie. Le suffrage universel a renforcé cette tendance et, finalement, même la bourgeoisie a peur face au peuple. Car les masses ont promis de devenir les rois.
Aujourd'hui cependant, une réaction est née dans la minorité qui a découvert un moyen puissant pour influencer les majorités. On a ainsi pu façonner l'esprit des masses qui jetteront leur force nouvellement gagnée dans la direction désirée. (…) L'alphabétisation universelle était supposée éduquer le commun des mortels pour qu'il sache contrôler son environnement. Une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait un esprit apte à diriger. Ainsi parlait la doctrine démocratique. Mais au lieu d'un esprit, l'alphabétisation universelle leur a donné des tampons pré-encrés de slogans publicitaires, d'éditoriaux, de données scientifiques publiées, de trivialités des tabloïds et de platitudes historiques, mais rien d'une pensée originale. Le tampon de chacun est le duplicata de millions d'autres de sorte que, quand ces millions sont exposés aux mêmes stimulations, ils reçoivent tous des empreintes identiques. (…)
En réalité, la pratique de la propagande depuis la guerre a pris des formes très différentes de celles qui prévalaient il y a vingt ans. Cette nouvelle technique peut avec justesse être qualifiée de nouvelle propagande.
Elle prend en considération non seulement l'individu, ni même l'esprit de masse seul, mais aussi, et en particulier, l'anatomie de la société, avec ses formations de groupes et de loyautés emboitées. Elle voit l'individu non seulement comme une cellule de l'organisme social mais comme une cellule organisée en une unité sociale. Touche un nerf à un point particulier et tu reçois une réponse automatique de certains membres spécifiques de l'organisme." 6
Bernays a été profondément impressionné par les théories de Freud, en particulier son œuvre Massenpsychologie und Ich-Analyse ("Psychologie des masses et analyse du moi") ; loin de chercher à éduquer et développer l'esprit conscient, il considérait que le travail du propagandiste était de manipuler l'inconscient. "Trotter et Le Bon, écrit-il, ont conclu que l'esprit de groupe ne pense pas dans le sens strict du terme. À la place des pensées, il a des impulsions, des habitudes et des émotions." Par conséquent, "si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l'esprit de groupe, n'est-il pas possible de contrôler et d'enrégimenter les masses selon notre volonté sans qu'elles le sachent ?" 7 Au nom de qui une telle manipulation doit-elle être entreprise ? Bernays utilise l'expression "gouvernement invisible" et il est clair qu'il se réfère ici à la grande bourgeoisie ou même à ses échelons supérieurs : "Le gouvernement invisible tend à être concentré entre les mains de quelques-uns à cause de la dépense engendrée par la manipulation de la machine sociale qui contrôle les opinions et les habitudes des masses. Faire de la publicité à une échelle qui atteint des millions de personnes est coûteux. Atteindre et persuader les dirigeants qui dictent les pensées et les actes du public est également coûteux." 8
S'organiser pour la guerre
Le livre de Bernays a été écrit en 1928 et se base en grande partie sur son travail de propagandiste pendant la guerre. Mais en août 1914 ceci appartenait encore au futur. Les gouvernements européens étaient depuis longtemps habitués à manipuler la presse en lui fournissant des histoires et même des articles complets, mais maintenant, cela devait être organisé – comme la guerre elle-même – à une échelle industrielle : le but, comme l'écrivit le général allemand Ludendorff était de "façonner l'opinion publique sans le montrer". 9
Il y a une différence frappante entre la démarche adoptée par les puissances continentales et celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Sur le continent, la propagande était d'abord et avant tout une affaire militaire. L'Autriche fut la plus rapide à réagir : le 28 juillet 1914, alors que la guerre était encore un conflit localisé entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, le KuK KriegsPressequartier ("Bureau de la presse de guerre impériale et royale") fut créé comme division du haut commandement de l'armée. En Allemagne, le contrôle de la propagande fut divisé au départ entre le Bureau de presse de l'État-major de l'armée et le Nachrichtenabteilung (Service des nouvelles) du Ministère des affaires étrangères qui se limitait à l'organisation de la propagande envers les pays neutres ; en 1917, les militaires créèrent le Deutsche Kriegsnachrichtendienst ("Service allemand des nouvelles de guerre") qui garda le contrôle de la propagande jusqu'à la fin. 10 En France, une Section d'information publiant des bulletins militaires et plus tard des articles fut mise en place en octobre 1914 comme division du renseignement militaire. Sous le général Nivelle, elle devint le Service d'Information pour les armées et c'est cette organisation qui accréditait les journalistes pour le front. Le Ministère des Affaires étrangères avait son propre Bureau de presse et de l'Information et ce n'est qu'en 1916 que les deux fusionnèrent en une Maison de la Presse unique.
La Grande-Bretagne, avec ses 150 ans d'expérience à la tête d'un vaste empire à partir de la population d'une petite île, était à la fois plus informelle et plus secrète. Le War Propaganda Bureau (Bureau de la Propagande de guerre) créé en 1914 n'était pas dirigé par les militaires mais par le politicien libéral Charles Masterman. Il ne fut jamais connu sous ce nom mais simplement sous celui de Wellington House, un immeuble qui abritait la National Insurance Commission que le Bureau de la Propagande utilisait comme façade. Au moins au début11 Masterman se concentra sur la coordination du travail d'auteurs connus comme John Buchan et HG Wells et les publications du Bureau étaient impressionnantes : en 1915, il avait imprimé 2,5 millions de livres et envoyait régulièrement des newsletters à 360 journaux américains. 12 A la fin de la guerre, la propagande britannique était entre les mains de deux magnats de la presse : Lord Northcliffe (propriétaire du Daily Mail et du Daily Mirror) était chargé de la propagande britannique d'abord aux États-Unis puis dans les pays ennemis, tandis que Max Aitken, plus tard Lord Beaverbrook, avait la responsabilité d'un véritable Ministère de l'Information qui devait remplacer le Bureau de la Propagande. Lloyd George, premier ministre britannique pendant la guerre, répondit aux protestations face à l'influence excessive qui était ainsi laissée aux barons de la presse, qu' "il avait pensé que seuls des hommes de presse pouvaient faire le travail" – selon Lasswell ; celui-ci poursuit en remarquant que "les journalistes gagnent leur vie en racontant leurs histoires dans un style bref et précis. Ils savent comment atteindre l'homme de la rue et utiliser son vocabulaire, ses préjugés et ses enthousiasmes (…), ils ne sont pas gênés par ce que le Dr Johnson a appelé ‘des scrupules inutiles’. Ils ressentent les mots, les états d'esprit et ils savent que le public n'est pas convaincu seulement par la logique mais qu'il est séduit par les histoires."13
Quand les Etats-Unis entrèrent en guerre en 1917, leur propagande prit immédiatement un caractère industriel, typique du génie logistique du pays. Selon George Creel qui dirigeait le Committee on Public Information, "une trentaine de livrets furent publiés en plusieurs langues, 75 millions d'exemplaires circulèrent en Amérique et des millions d'autres à l'étranger (…). Les Four-Minute Men 14 dirigeaient le service volontaire de 75 000 orateurs qui opéraient dans 5 200 communautés ; ils atteignirent un total de 775 190 discours 15 (…) ; ils utilisèrent 1 438 dessins préparés par les volontaires pour produire des affiches, affichettes de fenêtre et autres (…). Les films avaient beaucoup de succès commercial en Amérique et étaient efficaces à l'étranger, comme les Pershing's Crusaders ("Les croisés du Général Pershing"), l'American Answer ("La réponse de l'Amérique") et Under 4 Flags ("Sous 4 drapeaux"), etc." 16
La mention de volontaires est significative de la symbiose grandissante entre l'appareil d'État et la société civile qui caractérise le capitalisme d'État démocratique : ainsi l'Allemagne avait-elle sa "Ligue pangermanique" et son "Parti de la Patrie", la Grande-Bretagne son "Conseil des Sujets britanniques loyaux de l'Union de l'Empire britannique", et l'Amérique sa "Ligue patriotique américaine" et son "Ordre patriotique des Fils de l'Amérique" (qui étaient essentiellement des groupes d'auto-défense).
A une échelle plus vaste, l'industrie cinématographique 17 participait à la fois de façon indépendante et sous les auspices du gouvernement ainsi que dans un mélange moins formel des deux. En Grande-Bretagne, le Comité de recrutement parlementaire – qui n'était pas une agence gouvernementale au sens strict mais plutôt un groupement informel de députés – commissionna le film de recrutement You ! en 1915. D'autre part, le premier long métrage de guerre – The Battle of the Somme, 1916 – fut produit par un cartel industriel, le Comité britannique pour les films de guerre, qui paya pour avoir l'autorisation de filmer sur le front et vendit le film au gouvernement. Vers la fin de la guerre en 1917, Ludendorff créa le Universum-Film-AG (connu comme Ufa) dans le but d' "instruction patriotique" ; il était financé en commun par l'État et l'industrie privée et devait, après la guerre, devenir la plus importante compagnie cinématographique privée d'Europe. 18
Pour terminer sur une note technique : peut-être que le plus grand prix gagné grâce à la propagande de guerre fut le soutien des État-Unis. La Grande-Bretagne disposait d'un avantage immense ; dès le début de la guerre la Royal Navy avait coupé le câble transatlantique sous-marin de l'Allemagne et, à partir de ce moment-là, les communications entre l'Europe et l'Amérique ne pouvaient passer que par Londres. L'Allemagne tenta de répondre en utilisant le premier transmetteur radio du monde installé à Nauen mais c'était avant que la radio soit devenue un moyen de communication de masse et son impact resta marginal.
Le but de la propagande
Quel était le but de la propagande ? Sur le plan général, la propagande visait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant : regrouper toutes les énergies matérielles, physiques et psychologiques de la nation et les orienter dans un but unique – la défaite écrasante de l'ennemi.
La propagande directement orientée vers les troupes combattantes était relativement limitée. Cela peut sembler paradoxal mais cela révèle une certaine réalité au fondement de toute propagande : bien que son thème sous-jacent soit un mensonge – l'idée que la nation est unie, surtout les classes sociales, et que tous ont un intérêt commun à la défendre – elle perd de son efficacité quand elle diverge trop de la réalité vécue par ceux qu'elle cherche à influencer. 19
Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes au front raillaient généralement la propagande qui leur était destinée et réussirent à produire leur propre "presse" qui caricaturait la presse jaune qui leur était délivrée dans les tranchées : les Britanniques avaient le Wipers Times 20, les Français avaient Le Rire aux Éclats, Le Poilu et Le Crapouillot. Les troupes allemandes ne croyaient pas non plus à la propagande : en juillet 1915, un régiment saxon à Ypres envoya un message à la ligne britannique leur demandant : "Envoyez-nous un journal anglais pour que nous puissions connaître la vérité".
La propagande était également destinée aux troupes ennemies, les Français et les Britanniques notamment utilisant l'avantage de vents d'Ouest dominants pour envoyer des ballons et lancer des tracts sur l'Allemagne. Il y a peu de preuves que cela ait eu beaucoup d'effet.
La principale cible de la propagande était donc le front intérieur et non les troupes combattantes, et nous pouvons distinguer plusieurs buts dont l'importance varie selon les circonstances spécifiques de chaque pays. Trois ressortent en particulier :
- Le financement de la guerre. Dès le début, il était évident que le budget normal ne couvrirait pas les coûts du conflit qui augmentèrent dramatiquement au cours de la guerre. La solution était de faire appel aux économies accumulées de la nation au moyen des emprunts de guerre qui restaient volontaires, même dans les régimes autocratiques. 21
- Le recrutement pour les forces armées. Pour les puissances du continent européen où le service militaire obligatoire existait depuis longtemps 22, la question du recrutement ne se posait pas vraiment. Dans l'Empire britannique et aux Etats-Unis, il en allait différemment : la Grande-Bretagne n'introduisit la conscription qu'en 1916, le Canada en 1917, tandis qu'en Australie, deux referendums à ce sujet furent rejetés et le pays compta entièrement sur les volontaires ; aux Etats-Unis, un projet de loi était prêt dès que le pays entra en guerre mais le manque d'enthousiasme pour la guerre dans la population était tel que le gouvernement dut en fait "recruter" des américains pour soutenir le projet.
- Le soutien à l'industrie et à l'agriculture. La totalité de l'appareil productif de la nation doit constamment fonctionner à son plus haut rendement et être totalement orienté vers des buts militaires. Inévitablement, cela signifie l'austérité pour la population en général mais cela signifie aussi un grand bouleversement dans l'organisation de l'industrie et de l'agriculture : les hommes sur le front doivent être remplacés dans les champs et dans les usines par les femmes.
Voilà pour le front intérieur. Mais qu'en est-il pour l'étranger ? La guerre de 1914-18 fut pour la première fois dans l'histoire une guerre véritablement mondiale et de ce fait, l'attitude adoptée par les puissances neutres pouvaient avoir une importance critique. La question se posa immédiatement avec le blocus économique britannique de la côte allemande, imposé à tous les navires y compris ceux des puissances neutres : quelle attitude envers cette claire violation des accords internationaux sur la liberté des mers les gouvernements neutres allaient-ils adopter ? Mais l'effort de loin le plus important envers les États neutres fut, de la part des deux côtés, d'amener les Etats-Unis – seule grande puissance industrielle à ne pas s'être impliquée dès le début dans le conflit – à s'engager. L'intervention de l'Amérique au nom de l'Entente n'était absolument pas un résultat donné d'avance : elle pouvait rester neutre et ramasser les morceaux une fois que les Européens se seraient battus jusqu'à l'épuisement ; si elle entrait en guerre, elle pouvait tout aussi bien le faire dans le camp allemand : la Grande-Bretagne était son principal rival commercial et impérial et une vieille antipathie historique existait avec la Grande-Bretagne, remontant à la révolution américaine et à la guerre de 1812 entre les deux pays.
Les ressorts de la propagande
Les objectifs de la propagande que nous venons de présenter sont, en eux-mêmes, rationnels ou, du moins, accessibles à l'analyse rationnelle. Mais ceci ne répond pas à la question que la vaste masse de la population pourrait bien s’être posée : pourquoi devons-nous combattre ? Pourquoi la guerre ? Bref, pourquoi la propagande est-elle nécessaire ? Comment persuader des millions d'hommes de se lancer dans ce maelström de meurtre qu'était le front occidental, année après année ? Comment amener des millions de civils à accepter la boucherie de fils, de frères, de maris, l'épuisement physique du travail à l'usine, les privations du rationnement ?
Le raisonnement des sociétés précapitalistes ne s'applique plus. Comme le souligne Lasswell : "Les liens de loyauté et d'affection personnelles qui attachaient l'homme à son chef étaient dissous depuis longtemps. La monarchie et le privilège de classe avaient rendu l'âme ; l'idolâtrie de l'individu passe pour la religion officielle de la démocratie. C'est un monde atomisé…" 23 Mais le capitalisme n'est pas seulement l'atomisation de l'individu, il a aussi fait naître une classe sociale opposée à la guerre de façon inhérente et capable de renverser l'ordre existant, une classe révolutionnaire différente de toutes les autres parce que sa force politique se fonde sur sa conscience et sa compréhension. C'est une classe que le capitalisme lui-même a été forcé d'éduquer pour qu'elle remplisse son rôle dans le processus de production. Comment s'adresser alors à une classe ouvrière éduquée et formée au débat politique ?
Dans ces conditions, la propagande "est une concession à la rationalité du monde moderne. Un monde instruit, un monde éduqué préfère se développer sur la base d'arguments et d'informations (…) Tout un appareil d'érudition diffusée popularise les symboles et les formes d'appel pseudo-rationnel : le loup de la propagande n'hésite pas à s'habiller en peau de mouton. Tous les hommes éloquents de l'époque – les écrivains, les reporters, les éditeurs, les prêcheurs, les conférenciers, les professeurs, les politiciens – sont mis au service de la propagande et amplifient la voix du maître. Tout est conduit avec le décorum et l'habillage de l'intelligence car c'est une époque rationnelle qui demande que la viande crue soit cuite et garnie par des chefs adroits et compétents". Les masses doivent être gavées d'une émotion inavouable, qui devra donc être savamment cuite et garnie : "Une flamme nouvelle doit étouffer le chancre du désaccord et renforcer l'acier de l'enthousiasme belliqueux." 24
En un sens nous pouvons dire que le problème auquel était confrontée la classe dominante en 1914 était celle de perspectives différentes pour l'avenir : jusqu'à 1914, la Deuxième Internationale avait répété sans cesse, dans les termes les plus solennels, que la guerre qu'elle voyait à juste titre comme imminente serait menée dans l'intérêt de la classe capitaliste et avait appelé la classe ouvrière internationale à s'y opposer par la perspective de la révolution ou, au moins, par la lutte de classe massive et internationale 25 ; pour la classe dominante, la véritable perspective de la guerre, celle d'un épouvantable carnage en défense des intérêts d'une petite classe d'exploiteurs devait à tout prix être cachée. L'État bourgeois devait s'assurer du monopole de la propagande en brisant ou en séduisant les organisations qui exprimaient la perspective de la classe ouvrière et, en même temps, cacher sa propre perspective derrière l'illusion que la conquête de l'ennemi ouvrirait une nouvelle période de paix et de prospérité – un "nouvel ordre mondial" comme l'a dit George Bush dans le passé.
Ceci introduit deux aspects fondamentaux de la propagande de guerre : les "buts de guerre" et la haine de l'ennemi. Les deux sont étroitement liés : "Pour mobiliser la haine de la population contre l'ennemi, représenter la nation adverse comme un agresseur menaçant et meurtrier (…). C'est à travers l'élaboration des buts de guerre que le rôle d'obstruction de l'ennemi devient particulièrement évident. Représenter la nation adverse comme satanique : elle viole tous les standards moraux (les mœurs) du groupe et est une insulte à son estime de soi. Le maintien de la haine dépend du fait de compléter les représentations de l'ennemi menaçant, obstructeur, satanique, par l'assurance de la victoire finale." 26
Déjà avant la guerre, tout un travail avait été mené par des psychologues sur l'existence et la nature de ce que Gustave Le Bon 27 a appelé l'esprit de groupe, forme d'inconscient collectif formé par "la foule" dans le sens de la masse anonyme d'individus atomisés, coupés des obligations et des liens sociaux, qui est caractéristique de la société capitaliste, en particulier de la petite bourgeoisie.
Lasswell commente que "Toutes les écoles de pensée psychologique semblent être d'accord (…) sur le fait que la guerre est un type d'influence qui a de grandes capacités de libération des impulsions réprimées et autorise leur manifestation externe de façon directe. Il y a donc un consensus général selon lequel la propagande peut compter sur des alliés très primitifs et puissants pour mobiliser ses sujets dans la haine guerrière de l'ennemi". Il cite également John A Hobson, The psychology of jingoism (1900), 28 qui parle d' "un patriotisme grossier, nourri par les rumeurs les plus sauvages et les appels les plus violents à la haine et au désir animal de sang [qui] passe par contagion rapide dans la vie des foules des villes et se rend partout attractif par la satisfaction qu'il accorde aux désirs insatiables et sensationnels. C'est moins le sentiment sauvage de sa participation personnelle à la mêlée que le sentiment d'une imagination névrotique qui marque le Jingoisme." 29
Néanmoins, il y a ici une certaine contradiction. Le capitalisme, comme l'a dit Rosa Luxemburg, aime se présenter et, en fait, a une image de lui-même comme étant civilisé 30 ; cependant sous la surface gît un volcan bouillonnant de haine et de violence qui finalement explose ouvertement – ou est mis en action par la classe dominante. La question subsiste : cette violence est-elle un retour à des instincts primaires agressifs ou est-elle causée par la nature névrotique, antihumaine de la société capitaliste ? Il est certain que les êtres humains ont des instincts agressifs, asociaux comme ils ont des instincts sociaux. Cependant, il y a une différence fondamentale entre la vie sociale des sociétés archaïques et celle du capitalisme. Dans les premières, l'agression est contenue et régulée par l'ensemble du réseau d'interactions et d'obligations sociales en dehors desquelles la vie n'est pas seulement impossible mais même inimaginable. Dans le capitalisme, la tendance est au détachement de l'individu de tous les liens et de toutes les responsabilités sociales. 31 D'où un immense appauvrissement émotionnel et un manque de résistance aux instincts antisociaux.
Un élément important dans la culture de la haine dans la société capitaliste est la conscience coupable. Celle-ci n’est pas née avec le capitalisme : au contraire, si nous suivons le raisonnement de Freud elle est un acquis très ancien de la vie culturelle de l’homme. La capacité des êtres humains de réfléchir et de choisir entre deux actions différentes les met devant le bien et le mal, et donc des conflits moraux. Une conséquence de cette liberté même est le sentiment de culpabilité, qui est un produit de la culture avec sa source dans la capacité de réfléchir mais qui reste néanmoins en grande partie inconsciente et donc susceptible de manipulation. Un des moyens par lesquels l’inconscient gère la culpabilité est à travers la projection : le sentiment de culpabilité est projeté sur "l’autre". La haine de soi de la conscience coupable est soulagée par la projection vers l’extérieur, contre ceux qui souffrent de l’injustice et qui sont donc la cause du sentiment coupable. On pourrait objecter que le capitalisme n'est pas la première société dans laquelle le meurtre, l'exploitation et l'oppression ont existé – et c'est évidemment juste. La différence avec toutes les sociétés précédentes, c'est que le capitalisme prétend être basé sur "les droits de l'homme" : quand Genghis Khan massacrait la population de Khorasan, il ne prétendait pas le faire pour leur bien. Les peuples opprimés, asservis, exploités du capitalisme impérialiste pèsent sur la conscience de la société bourgeoise quelles que soient les auto-justifications (habituellement soutenues par l'église) qu'il peut inventer pour lui-même. Avant la Première Guerre mondiale, la haine de la société bourgeoise était dirigée logiquement contre les secteurs les plus opprimés de la société : c’est ainsi que les prédécesseurs des images haineuses de l’Allemand se trouvent dans les caricatures des Irlandais en Grande-Bretagne, ou des Noirs aux États-Unis, en particulier.
La haine de l'ennemi est bien plus efficace si elle peut être combinée à la conviction de sa propre vertu. Haine et humanitarisme sont donc de bons compagnons en temps de guerre.
Il est frappant que les régimes autocratiques plus arriérés d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ne furent pas capables de manier ces outils avec le succès et la sophistication de la Grande-Bretagne, de la France puis, plus tard, de l'Amérique. La plus caricaturale à cet égard est l'Autriche-Hongrie, empire multi-ethnique tentaculaire, en grande partie composé de minorités contaminées par un nationalisme indiscipliné. Sa caste dominante, aristocratique et semi-féodale, coupée des aspirations de sa population, n'avait rien de l'absence de scrupules versatile d'un Poincaré, d'un Clémenceau ou d'un Lloyd George. Sa vision sociale était limitée au cercle de Vienne, ville multiculturelle dont Stefan Zweig pouvait écrire que "la vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque bourgeois de cette ville recevait d'elle une éducation à ce cosmopolitisme qui répudiait tout nationalisme étroit, qui l'élevait à la dignité de citoyen du monde." Il n'est pas étonnant que dans la propagande austro-hongroise soient combinés une imagerie médiévale et un style art nouveau : St George écrasant un ennemi incarné par un dragon anonyme et mythique ; ou un beau prince portant une armure étincelante et escortant sa dame vers le royaume lumineux de la paix (les deux affiches visent les emprunts de guerre).32


Malgré tout son autoritarisme prussien brutal, la caste aristocratique allemande conservait encore un certain sens de Noblesse oblige, au moins dans la vision qu'elle avait d'elle-même et qu'elle cherchait à montrer au monde extérieur. Selon Lasswell, l'inefficacité allemande provenait du manque d'imagination des militaires allemands qui gardèrent le contrôle de la propagande tout au long de la guerre ; mais il y avait plus que cela : début 1915, le Leitsätze der Oberzensurstelle (le bureau de la censure) établit pour les journalistes les lignes directrices suivantes : "Le langage envers les États ennemis peut être dur (…). La pureté et la grandeur du mouvement qui a saisi notre peuple requièrent un langage digne (…). Les appels barbares à la guerre, à l'extermination des autres peuples sont dégoûtants ; l'armée sait où doit régner la sévérité et où doit régner la clémence. Notre bouclier doit rester pur. Des appels de ce type de la part de la presse jaune ennemie ne sont pas une justification pour que nous adoptions nous-mêmes un même comportement."
La Grande-Bretagne et la France n'avaient pas de tels scrupules, comme on peut constater dans la carte postale française reproduite ci-dessous, ni non plus l'Amérique. 33

Le contraste entre la façon dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont traité l'affaire Edith Cavell est frappante à cet égard. Edith Cavell était une infirmière britannique qui travaillait en Belgique pour la Croix rouge. En même temps, elle aidait les troupes britanniques, françaises et belges à gagner l'Angleterre via la Hollande (il a été également suggéré sans être confirmé qu'elle travaillait pour le renseignement britannique). Cavell fut arrêtée par les Allemands, jugée, déclarée coupable de trahison sous la loi militaire allemande et exécutée par un peloton en 1915. Ce fut un cadeau du ciel pour les Britanniques qui firent un énorme scandale ayant pour but le recrutement en Grande-Bretagne et le discrédit de la cause allemande aux États-Unis. Un torrent d'affiches, de cartes postales, de brochures et même de timbres postes maintinrent constamment le destin tragique de l'infirmière Cavell devant les yeux du public (sur l'affiche, elle apparaît bien plus jeune qu'elle n'était).
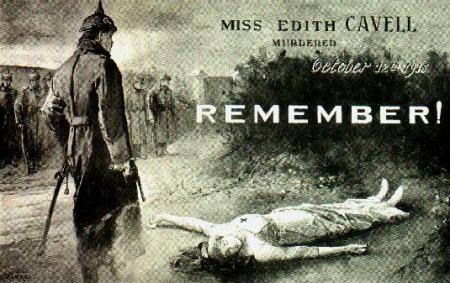
Non seulement l'Allemagne se montra totalement incapable de répondre mais tout autant de saisir des occasions. "Peu de temps après que les Alliés eurent fait le plus phénoménal vacarme autour de l'exécution de l'infirmière Cavell, les Français exécutèrent deux infirmières allemandes dans des circonstances tout à fait similaires", nous dit Lasswell. 34 Un journaliste américain demanda à l'officier chargé de la propagande allemande pourquoi ils n'avaient pas "fait un boucan d'enfer autour des infirmières que les Français avaient tuées l'autre jour", à quoi l'Allemand répondit : "Quoi ? Protester ? Les Français avaient parfaitement le droit de les exécuter !"
La Grande-Bretagne utilisa à fond l'occupation de la Belgique par l'Allemagne, non sans une bonne dose de cynisme puisque en fait l'invasion allemande contrecarrait tout simplement les plans de guerre britanniques. Elle propagea des histoires d'atrocités les plus macabres : les troupes allemandes tuaient les bébés à coups de baïonnette, faisaient de la soupe avec les cadavres, attachaient les prêtres la tête en bas au battant de la cloche de leur propre église, etc. Pour donner plus de véracité à ces contes fantaisistes, la Grande-Bretagne commissionna un rapport sur "Les prétendues atrocités allemandes", sous la responsabilité de James Bryce qui avait été un ambassadeur respecté aux États-Unis (1907-1913) et était connu comme un érudit imprégné et amateur de culture allemande (il avait étudié à Heidelberg) – présentant ainsi beaucoup de garanties d'impartialité. Puisque les atrocités sont inévitables quand une armée de conscrits commandée par des incompétents politiques est engagée au milieu d'une population civile révoltée 35, certains des cas condamnés par le "Rapport Bryce" sous le nom duquel il fut connu, étaient certainement vrais. Cependant, il est certain que le comité ne pouvait interviewer aucun témoin des atrocités supposées et que la majorité des cas était pure invention, en particulier les contes les plus révoltants de viol et de mutilation. Les Alliés n'étaient pas non plus au-dessus d'une touche de sensationnalisme pornographique, publiant des affiches de femmes dans des poses dénudées suggestives, appel simultané à la pruderie et à la grivoiserie.

Les appels à aider les veuves et les orphelins belges lancés par des organisations comme le Committee for Belgian Relief (Comité pour l'aide à la Belgique), avec l'aide d'un illustre panel de stars de la littérature comprenant (en Grande-Bretagne) Thomas Hardy, John Galsworthy et George Bernard Shaw parmi les plus connus 36 ou les appels à alimenter des fonds pour la Croix rouge belge sont les précurseurs des interventions militaires "humanitaires" d'aujourd'hui (bien qu'on hésite à comparer le "talent" d'un Bernard Henri-Lévy à celui de Thomas Hardy). La détresse de la Belgique fut utilisée encore et encore dans toutes sortes de contextes : pour le recrutement, pour dénoncer la barbarie allemande ou encore le mépris pernicieux de ce pays pour les traités diplomatiques (beaucoup a été dit sur le reniement par l'Allemagne de son engagement à honorer et à défendre la neutralité de la Belgique) et, par-dessus tout, pour gagner la sympathie de l'Amérique à la cause franco-britannique.

Les tentatives de l'Allemagne de répondre à ce barrage de campagnes haineuses de la part des Alliés, basées sur des histoires d'atrocités et une animosité culturelle, restèrent légalistes, au pied de la lettre et sans imagination. En effet, l'Allemagne restait sur la défensive et était constamment forcée de répondre aux attaques des Alliés mais n'utilisait pas efficacement les infractions des Alliés à la loi internationale – comme on l'a vu dans le cas Cavell.
Parlant des campagnes de haine et des atrocités, Lasswell écrit que : "Il est toujours difficile pour beaucoup d'esprits simples de la nation de mettre un visage sur un ennemi aussi vaste que toute une nation. Ils ont besoin d'avoir des individus sur qui porter leur haine. Il est donc important de distinguer une poignée de chefs ennemis et de leur faire porter le décalogue de tous les péchés." Et il poursuit : "Personne n'a été aussi maltraité de cette façon que le Kaiser". 37 Le Kaiser était présenté comme l'incarnation de tout ce qui est barbare, militariste, brutal, autocratique – "le chien fou de l'Europe" comme l'avait baptisé le Daily Express britannique, ou même "la bête de l'Apocalypse" selon le journal Liberté à Paris. On peut faire un parallèle évident avec l'utilisation de Saddam Hussein ou Osama Ben Laden par la propagande pour justifier les guerres en Irak et en Afghanistan.

La haine de ce qui est différent, de tout ce qui n'appartient pas au groupe, est une puissante force d'unification psychologique. La guerre – et avant tout la guerre totale des masses nationales – requiert que les énergies psychologiques de la nation soient soudées en une tension unique. Toute la nation doit être consciente d'elle-même en tant qu'unité, ce qui veut dire éradiquer de la conscience le fait indubitable que cette unité n'existe pas, qu'elle est un mythe, puisqu'en réalité la nation est composée de classes opposées ayant des intérêts antagoniques. Une façon de réaliser cela est de distinguer une figure de proue de l'unité nationale, qui peut être réelle, symbolique ou les deux. Les régimes autocratiques avaient leur chef : le Tsar en Russie, le Kaiser en Allemagne, l'Empereur en Autriche-Hongrie. La Grande-Bretagne avait le Roi et l'image symbolique de Britannia, la France et les États-Unis avaient la République, respectivement incarnées par Marianne et par Liberty. L'inconvénient de ce symbolisme positif est qu'il peut être critiqué, en particulier si la guerre tourne mal. Le Kaiser après tout était aussi le symbole du militarisme prussien et de la domination des Junkers qui étaient loin de soulever un enthousiasme universel en Allemagne ; le Roi en Grande-Bretagne pouvait aussi être associé à la caste dominante, aristocratique, arrogante et privilégiée. La haine dirigée à l'extérieur de la nation, contre l'ennemi, ne présentait pas de tels désavantages. Les défaites de la personnalité haïe peuvent le rendre méprisable mais jamais moins haïssable tandis que ses victoires ne font que le rendre plus haïssable encore : "…le chef ou l'idée [peuvent] revêtir pour ainsi dire un caractère négatif, c'est-à-dire où la haine pour une personne déterminée [est] susceptible d'opérer la même union et de créer les mêmes liens affectifs que s'il agissait d'un dévouement positif à l'égard de cette personne." 38 Nous sommes tentés de dire que plus la société est fracturée, atomisée, plus aigües sont les véritables contradictions de classe en son sein, plus grand est le vide émotionnel et spirituel de sa vie mentale, plus grandes sont ses réserves de frustration et de haine et plus efficacement celles-ci peuvent être dirigées en haine contre un ennemi extérieur. Ou, pour le dire autrement, plus la société a évolué vers un totalitarisme capitaliste développé, qu'il soit stalinien, fasciste ou démocratique, plus la classe dominante utilisera la haine de l'extérieur comme moyen d'unifier un corps social atomisé et divisé.
Ce n'est qu'en 1918 qu'apparurent en Allemagne des affiches dont on peut dire qu'elles préfiguraient la propagande anti-juive nazie. Elles n'étaient pas dirigées contre les ennemis militaires de l'Allemagne mais contre la menace interne incarnée par la classe ouvrière et, en particulier, contre son élément le plus combatif, le plus conscient et le plus dangereux : Spartacus.
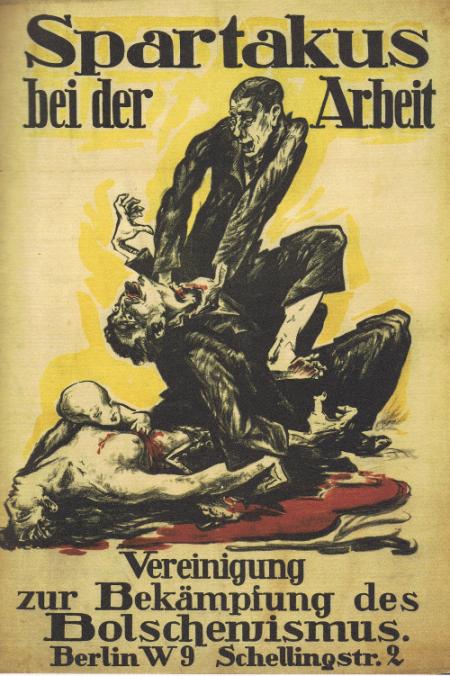

Ces affiches étaient reproduites à la fois par l' "Union de lutte contre le bolchevisme" de droite, alliée aux unités de corps-francs composées de soldats démobilisés et d'éléments lumpen qui allaient assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sur l'ordre du gouvernement social-démocrate. On se demande ce que les ouvriers pensaient de l'idée que le bolchevisme était responsable "[de la] guerre, [du] chômage et [de la] faim" comme le prétend l'affiche.

Tout comme le SPD a utilisé les corps-francs tout en les désavouant, l'affiche (ci-dessus) – vraisemblablement une affiche de la social-démocratie puisque le bébé étreint un drapeau rouge - évite de se référer directement au bolchevisme ou à Spartakus mais transmet pourtant le même message : "N'étranglons pas le bébé Liberté avec le désordre et le crime ! Sinon, nos enfants mourront de faim !"
La psychologie de la propagande
Pour Bernays, comme on l'a vu plus haut, la propagande ciblait "les impulsions, les habitudes et les émotions" des masses. Il nous semble indéniable que les théories de Le Bon, de Trotter et de Freud sur l'importance majeure de l'inconscient et, surtout, ce que Bernays appelle "l'esprit de groupe" ont fortement influencé la production de la propagande, au moins dans les pays alliés. Cela vaut donc la peine d'examiner ses thèmes à cette lumière. Plutôt que de nous préoccuper du message très direct – "Soutiens la guerre" – examinons quel est son véhicule : la source émotionnelle que la propagande cherchait à mettre à son service.
Nous sommes frappés d'abord par le fait que cette société extrêmement patriarcale, engagée dans une guerre dans laquelle les combattants sont tous des hommes et où la guerre est toujours un domaine strictement masculin, choisit des femmes comme symbole national : Britannia, Marianne, Liberty, Rome éternelle. Ces figures féminines peuvent être extrêmement ambigües. Britannia – un mélange d'Athéna et de l'autochtone Boadicée – tend à être sculpturale et royale mais elle peut également être maternelle, explicitement parfois ; Marianne à la poitrine dénudée est généralement héroïque mais elle peut avoir une allure simple à l'occasion, tout comme Roma ; Liberty parvient à jouer sur tous les tableaux – majestueuse, maternelle et séduisante tout à la fois.


La Grande-Bretagne et l'Amérique ont aussi leur symbole paternel : John Bull et Oncle Sam, tous deux sont présentés s'adressant sévèrement à l'extérieur de leur affiche "Wanting YOU ! For the armed forces".(…). Une affiche britannique présente avec optimisme un mariage entre Britannia et l'Oncle Sam.
Le véritable art de la propagande réside dans le fait de suggérer plutôt que de dire clairement, et cette combinaison ambigüe ou plutôt cette confusion de l'imagerie convie le message à travers toutes les émotions puissantes de l'enfance et de la famille. La culpabilité alimentée par le désir sexuel et la honte sexuelle est un puissant conducteur, en particulier pour les hommes jeunes vers qui sont dirigées les campagnes de recrutement. Ceci était critique dans les pays "anglo-saxons" dans lesquels la conscription fut tardivement introduite (Grande-Bretagne, Canada), ou très controversée (États-Unis) ou rejetée (Australie). En Grande-Bretagne, l'utilisation de la honte sexuelle était absolument explicite dans la "White Feather Campaign" orchestrée par l'amiral Charles Fitzgerald, avec le soutien enthousiaste des suffragettes et de ses dirigeantes, Emmeline et Christabel Pankhurst : dans cette campagne, de jeunes femmes étaient recrutées pour remettre une plume blanche –symbole traditionnel de lâcheté - aux hommes qui ne portaient pas l'uniforme. 39
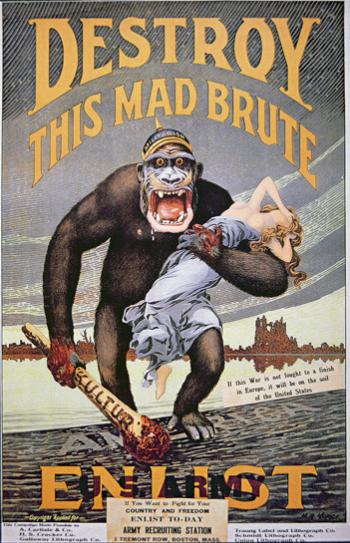
Le "King-Kong" coiffé d'un casque allemand (voir l'affiche ci-dessus) et portant une femme à demi-nue est une tentative typiquement américaine de manipuler les sentiments d'insécurité sexuelle. Le singe noir ravissant l'innocente blanche est un thème classique de la propagande anti-noire qui prévalut aux États-Unis jusque dans les années 1950 et 1960, qui jouait sur l' "animalité" et les prouesses sexuelles supposées des hommes noirs, dépeints comme une menace pour les femmes blanches "civilisées" et , évidemment par conséquent, pour son "protecteur" masculin. 40 Ceci permit à l'aristocratie des planteurs blancs dans le Sud des États-Unis d'attacher "la racaille blanche pauvre" à la défense de l'ordre existant de ségrégation et de domination de classe et à le soutenir, alors que ses véritables intérêts matériels auraient dû faire de ces travailleurs les alliés naturels des travailleurs noirs. 41 Le mythe de "la supériorité blanche" et le cortège d'émotions qui l'accompagnent de honte, de peur, de domination et de violence sexuelles infestaient la société américaine, y compris la classe ouvrière – avant la Première Guerre mondiale, le seul syndicat à avoir des sections dans lesquelles blancs et noirs étaient sur pied d'égalité était les syndicalistes-révolutionnaires IWW. 42
L'autre face de la pièce de la honte et de la peur sexuelles est l'image de "l'homme protecteur". Le soldat moderne, un travailleur en uniforme dont la vie dans les tranchées était faite de boue, de poux et de l'imminence de la mort sous les obus et les balles d'un ennemi qu'il ne voyait même pas, est dépeint encore et toujours comme le galant défenseur du foyer contre un ennemi bestial (souvent invisible).
Par ce biais, la propagande réussit un véritable détournement d’un des principes premiers du prolétariat : la solidarité. Depuis ses débuts la classe ouvrière a dû lutter pour la protection des femmes et des enfants, en particulier pour les soustraire des emplois les plus dangereux ou malsains, pour limiter leurs heures de travail, ou pour leur interdire le travail de nuit. En protégeant la fonction reproductrice assurée par les femmes, le mouvement ouvrier mettait en œuvre la solidarité entre les deux sexes, mais aussi envers les générations futures, tout comme la mise en place des premières caisses de retraite non contrôlées par l’État exprimait la solidarité envers les anciens ne pouvant plus travailler.
En même temps, et cela dès ses origines, le marxisme a à la fois défendu l'égalité des sexes comme condition sine qua non de la société communiste et a montré que l'émancipation des femmes à travers le travail salarié constituait une précondition de cet objectif.
Il est néanmoins indéniable que les attitudes patriarcales étaient profondément ancrées dans l'ensemble de la société et y compris dans la classe ouvrière : on ne se débarrasse pas de millénaires de patriarcat en quelques décennies. Afin d’affirmer leur indépendance, les femmes devaient toujours s’organiser dans des sections spéciales au sein des partis socialistes et des syndicats. A ce titre, l’exemple de Rosa Luxemburg est parlant : la direction du SPD a cru pouvoir réduire son influence en la poussant à se cantonner à l’organisation des "affaires féminines", ce qu’elle refusa net. La propagande chercha à subvertir la solidarité envers les femmes pour la transformer en idéal "chevaleresque" de protection des femmes, qui est évidemment la contrepartie de la réalité du statut inférieur des femmes dans la société de classe.
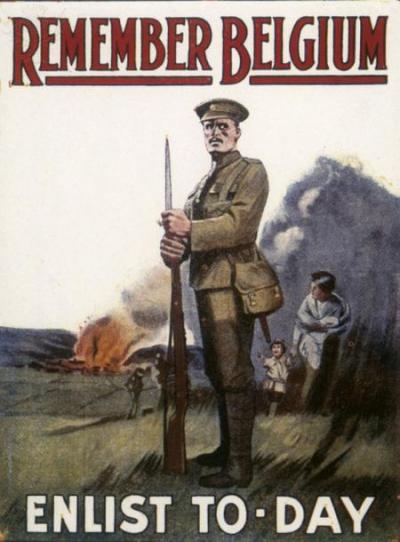
Cette idée d'un devoir masculin – plus particulièrement le devoir du chevalier – qui protège "la veuve et l'orphelin", les pauvres et les opprimés, plonge profondément ses racines dans la civilisation européenne, remontant aux efforts de l'église médiévale d'établir son autorité morale sur l'aristocratie guerrière. Il peut sembler "tiré par les cheveux" de faire le lien entre la propagande de 1914 avec une idéologie promue pour des raisons tout-à-fait différentes il y a mille ans. Mais les idéologies restent comme un sédiment dans les structures mentales de la société, même quand leurs sous-bassements matériels sont dépassés. De surcroit, ce qu’on ne peut qu’appeler le "médiévalisme" était utilisé par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie en Allemagne et en Grande Bretagne – et donc par extension aux États-Unis – pendant la grande période d’industrialisation au 19e siècle afin d’asseoir le principe national. En Allemagne, où l’unité nationale était à construire, il y avait un effort tout à fait conscient de créer la vision d’un "volk" unifié par une culture commune ; cela se voit, par exemple, dans le grand projet des frères Grimm de ressusciter la culture populaire des contes et des légendes. En Grande Bretagne, la notion des "libertés des anglais libres" remontait à la Grande Charte signé par le roi Jean en 1206. Les références médiévales y exercèrent une forte influence en architecture, non seulement dans la construction d'églises – aucun quartier victorien ne pouvait exister sans église pseudo-médiévale – mais aussi dans celle des institutions scientifiques comme le magnifique Museum of Natural History ou des gares de chemin de fer comme St Pancras (tous deux à Londres).43 Non seulement les travailleurs vivaient dans un espace marqué par l'imagerie médiévale, les mêmes références pénétrèrent dans le mouvement ouvrier, par exemple dans le roman utopiste de Willam Morris, News from Nowhere ("Nouvelles de nulle part"). Même aux États-Unis, le premier véritable syndicat s'appelait "Knights of Labor" ("Les chevaliers du travail"). Les idéaux aristocratiques de "chevalerie" et de "galanterie" étaient donc très présents – et très réels – dans une société qui, sur le plan de la vie économique quotidienne, s'adonnait à l'avarice, à l'exploitation du travail la plus impitoyable et vivait un implacable conflit entre les classes capitaliste et prolétarienne.

Si la propagande détournait la solidarité entre les sexes vers une idéologie chevaleresque réactionnaire, elle faisait également main basse sur la solidarité masculine entre ouvriers d’usine. En 1914, tous les ouvriers savaient quelle importance avait la solidarité sur les lieux de travail. Mais malgré l'Internationale, le mouvement ouvrier restait une collection d'organisations nationales : la solidarité au jour le jour s'exerçait envers des visages familiers. C'est surtout la propagande de recrutement qui a utilisé ces thèmes et nulle part plus qu'en Australie où la conscription n'existait pas. Montrer sa solidarité n'était plus lutter avec ses camarades contre la guerre, mais se joindre à ses camarades en uniforme, sur le front. Puisque ceci était nécessairement une solidarité masculine, il y a – comme dans "la défense de la famille" – une forte tonalité "masculine" dans beaucoup de ces affiches.

Inévitablement, la fierté et la honte vont ensemble de sorte que la fière affirmation de la masculinité qui accompagne (ou est supposée accompagner) le fait d'appartenir aux combattants comporte, comme contrepartie, la culpabilité de ne pas accomplir sa part et de ne pas partager les souffrances viriles de ses camarades. C'était peut-être un tel mélange d'émotions qui ont amené le poète Wilfred Owen à retourner au front après s'être remis d'une dépression nerveuse, malgré son horreur de la guerre et son profond dégoût pour les classes dominantes – et la presse jaune – qu'il tenait pour responsables de celle-ci. 44
Freud pensait non seulement que "l'esprit de groupe" était dirigé par l'inconscient émotionnel mais qu'il représentait un retour atavique à un état mental plus primitif caractéristique des sociétés archaïques et de l'enfance. Le moi, avec son calcul conscient habituel de son propre avantage, pouvait être submergé par "l'esprit de groupe" et, dans ces conditions, capable d'actions que l'individu n'envisagerait pas, autant pour le meilleur que pour le pire, capable d'une grande sauvagerie ou d'un grand héroïsme. Bernays et ses propagandistes partageaient sans aucun doute ce point de vue, du moins jusqu'à un certain point, mais ils étaient plus intéressés par les mécanismes de la manipulation que par la théorie et ils ne partageaient certainement pas le profond pessimisme de Freud sur la civilisation humaine et ses perspectives, surtout après l'expérience de la Première Guerre mondiale. Là où Freud était un scientifique dont le but était de développer la compréhension d'elle-même de l'humanité en rendant l'inconscient conscient, Bernays – et ses employeurs bien sûr- n'étaient intéressés par l'inconscient que dans la mesure où cela permettait de manipuler une masse qui devait rester inconsciente. Lasswell considère qu'on peut participer de "l'esprit de groupe" même si on est seul ; il dit que la propagande cherche à être omniprésente dans la vie de l'individu, à saisir toutes les occasions (publicités dans la rue, dans les transports, dans la presse) pour agir sur sa pensée en tant que membre du groupe. Nous touchons ici toute une série de questions bien trop complexes pour être traitées dans cet article : le rapport entre la psychologie individuelle profondément influencée par l'histoire personnelle et les "énergies psychologiques" dominantes (en l'absence d'un meilleur terme) dans l'ensemble de la société. Mais, à notre avis, il n'y a pas de doute que de telles "énergies psychologiques" existent et que les classes dominantes les étudient et cherchent à les utiliser pour manipuler les masses à leurs propres fins. C'est à leur propre péril si les révolutionnaires les ignorent – y compris parce qu'ils n'existent pas en dehors de la société bourgeoise et sont également soumis à son influence.
Aujourd'hui, la propagande guerrière de 1914 peut sembler naïve, absurde, grotesque même. La naïveté du 19e siècle a été cautérisée dans la société par deux guerres mondiales et cent ans de décadence et de guerres barbares. Le développement du cinéma, de la télévision et de la radio, l'omniprésence des médias visuels et l'éducation universelle qu'exige le processus de production ont rendu la société plus sophistiquée ; elle est également peut-être plus cynique. Mais cela ne l'immunise pas contre la propagande. Au contraire, non seulement les techniques de propagande ont été constamment raffinées, ce qui par le passé était simplement de la publicité commerciale est devenu l'une des principales formes de la propagande.
La publicité – comme Bernays disait qu'elle devait être – a depuis longtemps cessé d'être simplement de la pub pour des produits, elle promeut une vision du monde dans lequel le produit devient désirable et cette vision du monde est profondément, viscéralement bourgeoise (et petite-bourgeoise) et réactionnaire, et jamais plus que lorsqu'elle se prétend "rebelle".
Mais les buts de la propagande de la bourgeoisie ne sont pas seulement d'inculquer et de propager ; c'est aussi, peut-être même avant tout, de dissimuler, de cacher. Rappelons ce qu'écrivait Lasswell que nous avons cité au début de l'article : "Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ou la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes…" La différence avec la propagande communiste est saisissante car les communistes (comme Rosa Luxemburg l'a fait dans la Brochure de Junius) ont pour but de révéler, de mettre à nu, de rendre compréhensible l'ordre social auquel le prolétariat est confronté et donc d'ouvrir le changement révolutionnaire. La classe dominante cherche à submerger la pensée rationnelle et la connaissance consciente de l'existence sociale, elle cherche par le biais de la propagande de se servir de l’inconscient afin de manipuler et d’asservir. Ceci est d’autant plus vrai que la société est "démocratique", car là où il y a un semblant de choix et de "liberté" il faut s’assurer que la population fait "le bon choix" en toute liberté. Ainsi, le 20e siècle voit à la fois la victoire de la démocratie bourgeoise, et la montée en puissance et en sophistication de la propagande. La propagande des communistes au contraire cherche à aider la classe révolutionnaire à se libérer de l’emprise de l’idéologie de la société de classe y compris lorsque celle-ci est enfouie profondément dans l’inconscient. Elle cherche à allier la conscience rationnelle au développement des émotions sociales et à rendre chaque individu conscient de lui-même non comme un atome impuissant mais comme un maillon de la grande association qui s'étend non seulement géographiquement – parce que la classe ouvrière est par essence internationaliste – mais, également, historiquement, à la fois dans le passé et dans le futur qui doit être construit.
Jens / Gianni, 7 juin 2025
1 Propaganda, Ig Publishing 2005.
2 Un livre du pacifiste britannique, Arthur Ponsonby, Falsehood in wartime ("Mensonges en temps de guerre") publié en 1928 provoqua un énorme tollé car il rendait compte de façon détaillée du caractère mensonger des histoires colportées à grande échelle sur les atrocités commises par les Allemands : il fut réédité 11 fois entre 1928 et 1942.
3 Edward Bernays (1891-1995) est né à Vienne ; c’était le neveu de Sigmund Freud et de sa femme Anna Bernays. Sa famille déménagea à New York l’année qui suivit sa naissance mais, adulte, il resta en contact étroit avec son oncle et fut très influencé par ses idées ainsi que par les études sur la psychologie des foules publiées par Gustave Le Bon et William Trotter. Aux dires de tous, il fut profondément impressionné par l’impact que le Président américain, Woodrow Wilson, eut sur les foules européennes quand il fit le tour du continent à la fin de la guerre ; il attribua ce succès à la propagande américaine pour le programme de paix en "14 points" de Wilson. En 1919, Bernays ouvrit un bureau comme "Conseiller en Relations publiques" et devint un manager reconnu et très influent dans les campagnes de publicité pour de grandes compagnies américaines, en particulier pour le tabac américain (les cigarettes Lucky Strike) et la compagnie United Fruit. On peut considérer son livre Propaganda comme une publicité envers des clients potentiels. Toutes les citations du livre dans cet article sont traduites en français par nous.
4 Un exemple classique du rapport symbiotique entre la propagande étatique et les 'Relations publiques' privées est la campagne de publicité de 1954, dont la compagnie de Edward Bernays fut le cerveau ; au nom de la United Fruit Corporation, elle justifiait le renversement commandité par la CIA du gouvernement guatémaltèque récemment élu (qui avait l'intention de nationaliser les terres non cultivées détenues par la United Fruit) et son remplacement par un régime militaire d'escadrons de la mort fascistes, tout cela au nom de "la défense de la démocratie". Les techniques utilisées contre le Guatemala en 1954 avaient été esquissées par les bureaux étatiques de propagande au cours de la Première Guerre mondiale.
5 Harold Lasswell, Propaganda technique in the World War [535], 1927. Traduit de l'anglais par nous comme toutes les citations suivantes. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) était à son époque l'un des principaux spécialistes américains en Science politique ; il introduisit le premier dans la discipline de nouvelles méthodes basées sur les statistiques, l'analyse de contenu, etc. Il s'intéressait particulièrement à l'aspect psychologique de la politique et au fonctionnement de "l'esprit de groupe". Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il travailla pour l'unité de guerre politique de l'armée. Bien qu'élevé dans une petite ville de l'Illinois, il fit des études importantes, et connut les travaux de Freud par l'entremise d'un de ses oncles, et ceux de Marx et Havelock Ellis par l'un de ses professeurs. Sa thèse de doctorat en 1927 que nous citons largement dans cet article fut probablement la première étude en profondeur de ce sujet.
6 Edward Bernays, op.cit. Propaganda, p. 47, 48, 55.
7 Op.cit., p. 73 et p. 71
8 Op.cit, p. 63
9 Lasswell, op.cit., p. 28
10 Voir Niall Ferguson, The Pity of War, Penguin Books, 1999, p. 224-225, traduit de l'anglais par nous.
11 Cf. notre article sur "L'Art et la propagande" (https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201505/9218/lart-et... [536])
12 Ferguson, op. cit.
13 Op. cit., p. 32
14 Les Four-Minute Men sont une invention remarquable et tout-à-fait américaine. Des volontaires prenaient la parole pendant 4 minutes (sur des thèmes fournis par le Comité Creel) dans toutes sortes de lieux où il pourrait y avoir une audience : au coin des rues les jours de marché, au cinéma quand on changeait les bobines, etc.
15 Puisque les Etats-Unis n'entrèrent en guerre qu'en avril 1917, il y avait plus de mille prises de parole par jour. On estime que 11 millions de personnes les entendirent.
16 Cité dans Lasswell, op. cit. p.211-212. Nous nous sommes limités aux éléments les plus significatifs de la liste dressée par Lasswell.
17 Bien que muet, le cinéma était déjà un media important pour le divertissement du public. En Grande-Bretagne, rien qu'en 1917, il y avait déjà plus de 4 000 cinémas qui jouaient toutes les semaines pour des audiences de 20 millions (cf. John MacKenzie, Propaganda and Empire, Manchester University Press, 1984, p. 69)
18 Cf. Ferguson, op. cit, p. 226-225
19 Nous pouvons prendre deux exemples extrêmes pour illustrer cela : dans les années 1980, il était notoire que personne dans le bloc de l'Est ne croyait à la propagande officielle ; à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population allemande ne croyait plus rien de ce qu'elle lisait dans la presse – à l'exception, pour certains, de l'horoscope qui était dument préparé chaque jour par le Ministère de la Propagande (Cf. Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan 1970, p. 410-411)
20 "Wipers" est une distorsion anglaise de Ypres, la partie du front où était concentrée une grande partie de l'armée britannique et qui connut l'un des combats les plus meurtriers de la guerre.
21 La guerre était aussi financée par des emprunts à l'étranger, de façon importante par la France et la Grande-Bretagne aux Etats-Unis. "Comme le dit [le Président] Woodrow Wilson, ce qui est beau dans notre avantage financier sur la Grande-Bretagne et la France, c'est que lorsque la guerre sera finie, nous pourrons les forcer à adopter notre façon de voir." (Ferguson, op.cit., p. 329)
22 Et peu avant l'éclatement de la guerre, la France avait allongé la durée du service militaire à trois ans
23 Lasswell, op. cit. p. 222
24 Lasswell, op. cit. p. 221
25 C'était l'agitation publique, officielle de l'Internationale. Les événements devaient montrer de façon tragique que la force apparente de l'Internationale cachait une profonde faiblesses qui, en 1914, amena ses partis constitutifs à trahir la cause des ouvriers et à soutenir leurs classes dominantes respectives. Voir notre article Première Guerre mondiale: comment s'est produite la faillite de la Deuxième internationale [537], Revue internationale n°154
26 Lasswell, op.cit., p. 195
27 Gustave Le Bon (1841-1931) était un anthropologue et psychologue français dont l'œuvre majeure, La psychologie des foules, fut publiée en 1895.
28 John Atkinson Hobson (1858-1940) était un économiste britannique qui s'opposa au développement de l'impérialisme, pensant qu'il contenait les germes d'un conflit international. Lénine se basa largement sur l'œuvre majeure de Hobson, Imperialism, (avec laquelle il polémiqua) pour écrire L'impérialisme, stade suprême du capitalisme.
29 "Jingoism" est un terme anglais pour le patriotisme agressif, dérivé d'une chanson britannique populaire à l'époque de la guerre russo-turque de 1877 :
"We don't want to fight but by Jingo if we do
We've got the ships, we've got the men, we've got the money too
We've fought the Bear before, and while we"re Britons true
The Russians shall not have Constantinople".
30 Son "apparence cultivée" n'est pas seulement un masque. La société capitaliste contient aussi en elle-même une dynamique de développement de la culture, de la science, de l'art. Traiter cette question ici serait cependant trop long et nous éloignerait du sujet principal.
31 Ou, comme l'a dit Margaret Thatcher dans le passé, il n'y a pas de société, seulement des individus et leurs familles.
32 Plusieurs des images reproduites dans cet article sont tirées du livre d’Annie Pastor, Images de propagande 1914-1918, ou l’art de vendre la guerre.
33 La carte postale contient un "poème" supposé écrit par un fantassin français à sa sœur sur le thème "Qu'est-ce qu'un Boche ?" (terme péjoratif français pour Allemand) "Tu veux savoir, enfant, ce qu’est ce monstre, un boche ?
Un boche, mon chéri, c’est l’être sans honneur,
C’est un bandit sournois, lourdaud, haineux, et moche,
C’est un croquemitaine, un ogre empoisonneur.
C’est un diable en soldat qui brûle les villages,
Fusille les vieillards, les femmes, sans remords,
Achève les blessés, commet tous les pillages,
Enterre les vivants et dépouille les morts.
C’est un lâche égorgeur des enfants, des fillettes,
Embrochant les bébés avec des baïonnettes,
Massacrant par plaisir, sans raisons… sans quartier
C’est l’homme, mon enfant, qui veut tuer ton père,
Détruire ta Patrie et torturer ta mère,
C’est le teuton maudit par l’univers entier."
34 Op. cit., p. 32
35 Il suffit de se rappeler la Guerre du Viêtnam où des atrocités telles que le massacre de My Lai ont été fréquentes et attestées.
36 Cf. Lasswell, op. cit. p. 138
37 Lasswell, op. cit. p. 88. On peut cependant se demander si l'on doit considérer que c'est une "qualité" des esprits moins "simples" d'être capables de haïr toute une nation sans avoir de figure sur qui concentrer sa haine…
38 Freud, Psychologie collective et analyse du moi.
39 Comme on peut l'imaginer, les hommes en permission vivaient extrêmement mal le fait qu'on leur remette une plume blanche ; mais cela pouvait être également totalement dévastateur : le grand-père d'un des auteurs de cet article avait 17 ans et était apprenti dans la sidérurgie à Newcastle lorsque sa propre sœur lui remit une plume blanche, ce qui l'amena à s'engager dans la marine en mentant sur son âge.
40 Étant donné que – dans une société patriarcale dominée par les blancs - la prédation sexuelle était avant tout le fait d'hommes blancs sur les femmes noires, ceci serait presque drôle si ce n'était si vil.
41 Comme cela avait été le cas de façon embryonnaire au 18e siècle : cf. Howard Zinn, Histoire populaire des Etats-Unis
42 International Workers of the World
43 Même en France, où la référence fondamentale restait la Révolution de 1789 et la République, eut lieu le grand mouvement de restauration de l'architecture médiévale par Viollet-le-Duc, pour ne pas parler de la fascination exprimée en peinture pour la vie et les hauts faits du roi Louis IX (St Louis).
44 Les motivations de Owen étaient certainement plus complexes comme elles le sont pour chaque individu. Il était également officier et se sentait responsable de "ses" hommes.
Personnages:
- Freud [58]
- Edward Bernays [538]
- James Bryce [539]
- Harold Lasswell [540]
- Kaiser Guillaume II [541]
- Edith Cavell [542]
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [444]
- Rapport Bryce [543]
Questions théoriques:
- Démocratie [544]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [545]
Rubrique:
Conférence de Zimmerwald: les courants centristes dans les organisations politiques du prolétariat
- 1906 lectures
L’article que nous publions ci-après est une contribution du camarade MC écrite pour le débat interne dans les années 1980 visant à combattre des positions centristes envers le conseillisme qui s'étaient développées au sein du CCI. MC était la signature de Marc Chirik (1907-1990), ex-militant de la Gauche communiste, principal membre fondateur du CCI (voir la Revue Internationale numéros 61 et 62).
Il peut paraître surprenant qu'un texte dont le titre fait référence à la Conférence de Zimmerwald qui s'est tenue en septembre 1915 contre la guerre impérialiste ait été écrit dans le cadre d'un débat interne dans le CCI sur la question du conseillisme. En réalité, comme le lecteur pourra le constater, ce débat a été amené à s'élargir à des questions plus générales qui se posaient déjà il y cent ans et qui gardent aujourd'hui toute leur actualité.
Nous avons rendu compte de ce débat sur le centrisme envers le conseillisme dans les numéros 40 à 44 de la Revue internationale (1985/86). Nous renvoyons le lecteur plus particulièrement au n° 42 de la Revue où l'article "Les glissements centristes vers le conseillisme" fait une présentation des origines et de l'évolution de ce débat, présentation que nous résumons ci-dessous afin que soient mieux compréhensibles certains aspects de la polémique de MC :
Lors du 5e congrès du CCI, et surtout à la suite de celui-ci, il s'était développé au sein de l'organisation une série de confusions dans l'analyse de la situation internationale et notamment une position qui, sur la question de la prise de conscience du prolétariat, reprenait les visions conseillistes. Cette position était défendue principalement par des camarades de la section en Espagne (désignée par "AP" dans le texte de MC, du nom de la publication de cette section, Acción Proletaria).
"Les camarades qui s'identifiaient avec cette analyse pensaient être en accord avec les conceptions classiques du marxisme (et donc du CCI) sur le problème de la conscience de classe. En particulier, ils ne rejetaient nullement de façon explicite la nécessité d'une organisation des révolutionnaires dans le développement de celle-ci. Mais en fait, ils avaient été conduits à faire leur une vision conseilliste :
- en faisant de la conscience un élément uniquement déterminé et jamais déterminant de la lutte de classe ;
- en considérant que 'le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est la lutte massive et ouverte', ce qui ne laissait aucune place aux organisations révolutionnaires ;
- en niant toute possibilité pour celles-ci de poursuivre un travail de développement et d'approfondissement de la conscience de classe dans les moments de recul de la lutte.
La seule différence majeure entre cette vision et le conseillisme, c'est que ce dernier va jusqu'au bout de sa démarche en rejetant explicitement la nécessité des organisations communistes, alors que nos camarades n'allaient pas jusque-là."
Un des thèmes majeurs de cette démarche, c'était le rejet de la notion de "maturation souterraine de la conscience" excluant de fait la possibilité pour des organisations révolutionnaires de développer et d'approfondir la conscience communiste en dehors des luttes ouvertes de la classe ouvrière.
Dès qu'il eut pris connaissance des documents exprimant cette vision, notre camarade MC écrivit une contribution pour la combattre. En janvier 1984, la réunion plénière de l'organe central du CCI adoptait une résolution prenant position sur les analyses erronées qui s'étaient exprimées auparavant, et notamment sur les conceptions conseillistes :
"Lorsque cette résolution fut adoptée, les camarades du CCI qui avaient auparavant développé la thèse de la 'non-maturation souterraine' avec toutes ses implications conseillistes s'étaient rendu compte de leur erreur. Aussi se prononcèrent-ils fermement en faveur de cette résolution et notamment son point 7 qui avait comme fonction spécifique de rejeter les analyses qu'ils avaient élaborées auparavant. Par contre, on vit surgir de la part d'autres camarades des désaccords sur ce point 7 qui les conduisirent soit à le rejeter en bloc, soit à le voter 'avec réserves' en rejetant certaines de ses formulations. On voyait donc apparaître dans l'organisation une démarche qui, sans soutenir ouvertement les thèses conseillistes, que la résolution condamnait, consistait à servir de bouclier, de parapluie à ces thèses en se refusant à une telle condamnation ou en atténuant la portée de celle-ci. Face à cette démarche, l'organe central du CCI était amené à adopter en mars 84 une résolution rappelant les caractéristiques :
a) de l'opportunisme en tant que manifestation de la pénétration de l'idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes et qui s'exprime notamment par :
- un rejet ou une occultation des principes révolutionnaires et du cadre général des analyses marxistes ;
- un manque de fermeté dans la défense de ces principes ;
b) du centrisme en tant que forme particulière de l'opportunisme caractérisée par :
- une phobie à l'égard des positions franches, tranchantes, intransigeantes, allant jusqu'au bout de leurs implications ;
- l'adoption systématique de positions médianes entre les positions antagoniques ;
- un goût de la conciliation entre ces positions ;
- la recherche d'un rôle d'arbitre entre celles-ci ;
- la recherche de l'unité de l'organisation à tout prix y compris celui de la confusion, des concessions sur les principes, du manque de rigueur, de cohérence et de continuité dans les analyses.' (…)
Et la résolution conclut "qu'il existe à l'heure actuelle au sein du CCI, une tendance au centrisme -c'est-à-dire à la conciliation et au manque de fermeté- à l'égard du conseillisme."" (Revue Internationale n° 42, "Les glissements centristes vers le conseillisme)"
Face à cette analyse, un certain nombre de "réservistes", plutôt que de prendre en considération de façon sérieuse et rigoureuse les analyses de l'organisation, ont préféré, adoptant de fait une démarche centriste exemplaire, escamoter les vraies questions en se livrant à toute une série de contorsions aussi spectaculaires que lamentables. Le texte de McIntosh1, auquel répond la contribution de MC que nous publions ci-après, constitue une illustration flagrante de cet escamotage en défendant une thèse très simple (et inédite) : il ne peut y avoir de centrisme envers le conseillisme dans le CCI parce que le centrisme ne peut exister dans la période de décadence du capitalisme.
"En ne traitant dans son article que du problème du centrisme en général et dans l'histoire du mouvement ouvrier sans se référer à aucun moment à la façon dont la question s'est posée dans le CCI, il évite de porter à la connaissance du lecteur le fait que cette découverte (dont il est l'auteur) de la non-existence du centrisme dans la période de décadence, était la bienvenue pour les camarades "réservistes" (qui s'étaient abstenus ou avaient émis des "réserves" lors du vote de la résolution de janvier 84). La thèse de McIntosh, à laquelle ils se sont ralliés lors de la constitution de la "tendance", leur permettait de retrouver des forces contre l'analyse du CCI sur les glissements centristes envers le conseillisme dont ils étaient victimes et qu'ils s'étaient épuisés à combattre en essayant vainement de montrer (tour à tour ou simultanément) que "le centrisme c'est la bourgeoisie", "il existe un danger de centrisme dans les organisations révolutionnaires mais pas dans le CCI", "le danger centriste existe dans le CCI mais pas à l'égard du conseillisme"". (Revue Internationale n° 43, "Le rejet de la notion de "centrisme" : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe").
Ainsi, comme on l'a dit plus haut, bien que le débat de 1985 portât à l’origine sur la question du conseillisme en tant que courant et vision politique, il a été amené à s’élargir sur la question plus générale du centrisme en tant qu’expression de la manière dont les organisations de la classe ouvrière subissent l’influence de l’idéologie dominante de la société bourgeoise. Comme le souligne MC dans l’article ci-dessous, le centrisme en tant que tel ne peut disparaître tant qu’existe la société de classe.
L’intérêt de cet article pour sa publication aujourd'hui vers l’extérieur consiste avant tout dans le fait qu'il porte sur l’histoire de la Première Guerre mondiale (question que nous abordons sous différents aspects dans la Revue Internationale depuis 2014) et notamment sur le rôle des révolutionnaires et le développement de la conscience dans la classe ouvrière et dans son avant-garde face à cet événement. La conférence de Zimmerwald, qui s'est tenue il y aura 100 ans en Septembre, fait partie de notre histoire, mais elle illustre aussi de façon très significative les difficultés et les hésitations des participants à rompre non seulement avec les partis traîtres de la Deuxième Internationale mais aussi avec toute l’idéologie conciliatrice et pacifiste qui espérait mettre fin à la guerre sans se lancer dans la lutte explicitement révolutionnaire contre la société capitaliste qui l’avait engendrée. Voici comment Lénine présentait la question en 1917 :
"Trois tendances se sont dessinées dans tous les pays, au sein du mouvement socialiste et international, depuis plus de deux ans que dure la guerre... Ces trois tendances sont les suivantes :
1. Les social-chauvins, socialistes en paroles, chauvins en fait (...) Ce sont nos adversaires de classe. Ils sont passés à la bourgeoisie (...).
2. La deuxième tendance et celle dite du "centre", qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes (...) Le 'centre', c'est le règne de la phrase petite-bourgeoise bourrée de bonnes intentions, de l'internationalisme en paroles, de l'opportunisme pusillanime et de la complaisance pour les social-chauvins en fait. Le fond de la question, c'est que le 'centre' n'est pas convaincu de la nécessité d'une révolution contre son propre gouvernement, ne poursuit pas une lutte révolutionnaire intransigeante, invente pour s'y soustraire les faux fuyants les plus plats, bien qu'à résonance archi-'marxistes' (...) Le principal leader et représentant du 'centre' est Karl Kautsky, qui jouissait dans la 2ème Internationale (1889-1914) de la plus haute autorité et qui offre depuis août 1914 l'exemple d'un reniement complet du marxisme, d'une veulerie inouïe, d'hésitations et de trahisons lamentables.
3. La troisième tendance est celle des véritables internationalistes qui représente le mieux 'la gauche de Zimmerwald'." 2
Il serait cependant plus correct de dire, dans le contexte de Zimmerwald, que la droite est représentée non pas par les "social-chauvins", pour reprendre le terme de Lénine, mais par Kautsky et consorts –tous ceux qui formeront plus tard la droite de l’USPD 3– alors que la gauche est constituée par les bolcheviks et le centre par Trotsky et le groupe Spartakus de Rosa Luxemburg. Le processus qui mène vers la révolution en Russie et en Allemagne est justement marqué par le fait qu’une grande partie du "centre" est gagnée par les positions bolcheviques.
Par la suite, le terme centrisme ne sera pas utilisé de la même manière par tous les courants politiques. Pour les bordiguistes, par exemple, Staline et les staliniens dans les années 1930 sont toujours dénommés "centristes", la politique de Staline étant vue comme le "centre" entre la Gauche de l’Internationale (ce qu’on appelle aujourd’hui la Gauche communiste autour de Bordiga et Pannekoek en particulier) et la Droite de Boukharine. Bilan a retenu cette dénomination jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Pour le CCI, reprenant à son compte la démarche de Lénine, le terme centriste désigne la mouvance entre la gauche (révolutionnaire) et la droite (opportuniste, mais encore dans le camp prolétarien) : donc le stalinisme avec son programme du "socialisme dans un seul pays" n’est ni centriste ni opportuniste, mais fait partie du camp ennemi – du capitalisme. Comme le précise l’article qui suit, "le centrisme" ne représente pas un courant politique sur des positions spécifiques, mais plutôt une tendance permanente au sein des organisations politiques de la classe ouvrière, à chercher un "juste milieu" entre les positions révolutionnaires intransigeantes et celles représentant une forme de conciliation envers la classe dominante.
Le centrisme vu par (MIC) McIntosh
Dans mon article "Le centrisme et notre tendance informelle" paru dans le précédent numéro du Bulletin interne international (116), j’ai essayé de démontrer l’inconsistance des affirmations de McIntosh concernant la définition du centrisme dans la 2ème Internationale.
Nous avons pu voir la confusion établie par McIntosh :
- en identifiant le centrisme au réformisme ;
- en réduisant le centrisme à une « base sociale » qui serait constituée par les "fonctionnaires et les permanents de l’appareil de la social-démocratie et des syndicats" (la bureaucratie) ;
- en soutenant que "sa base politique" est donnée par l’existence d’un "programme précis" fixe ;
- en proclamant que l’existence du centrisme est liée exclusivement à une période déterminée du capitalisme, la période ascendante ;
- en ignorant complètement la persistance dans le prolétariat de la mentalité et des idées bourgeoises et petites-bourgeoises (l’immaturité de la conscience) dont il a le plus grand mal à se dégager ;
- en négligeant le fait de la pénétration constante de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise au sein de la classe ouvrière ;
- en éludant totalement le problème d’un processus possible de dégénérescence d’une organisation prolétarienne.
Nous rappelons ces points, non pas simplement pour résumer l’article précédent mais aussi parce que beaucoup de ces points nous seront nécessaire pour démonter la nouvelle théorie de McIntosh sur la non existence du centrisme dans le mouvement ouvrier dans la période de décadence du capitalisme.
(…)
Le centrisme dans la période de décadence
McIntosh fonde son affirmation qu’il ne peut y avoir de courant centriste dans la période de décadence sur le fait qu’avec le changement de période l’espace occupé autrefois (dans la période ascendante) par le centrisme est désormais occupé par le capitalisme, et notamment par le capitalisme d’État. Ceci n’est que partiellement vrai. Ceci est vrai pour ce qui concerne certaines positions politiques défendues autrefois par le centrisme, mais est faux concernant "l’espace" séparant le programme communiste du prolétariat de l’idéologie bourgeoise. Cet espace (qui représente un terrain pour le centrisme) déterminé par l’immaturité (ou la maturité) de la conscience de classe et par la force de pénétration de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise en son sein, peut tendre à se rétrécir, mais ne peut disparaître tant qu’existent les classes et, surtout, tant que la bourgeoisie reste la classe dominante de la société. Ceci reste également vrai même après la victoire de la révolution car tant qu’on peut parler du prolétariat comme classe, cela veut dire qu’il existe aussi d’autres classes dans la société et donc l’influence de leur idéologie et la pénétration de celle-ci dans la classe ouvrière. Toute la théorie marxiste sur la période de transition est fondée sur le fait que, contrairement aux autres révolutions dans l’histoire, la révolution prolétarienne ne clôt pas la période de transition mais ne fait que l’ouvrir. Seuls les anarchistes (et en partie les conseillistes) pensent qu’avec la révolution on saute à pieds joints directement du capitalisme au communisme. Pour les marxistes la révolution n’est que la condition préalable ouvrant la possibilité de la réalisation du programme communiste de la transformation sociale et d’une société sans classes. Ce programme communiste est défendu par la minorité révolutionnaire organisée en parti politique contre les positions des autres courants et organisations politiques qui se trouvent dans la classe et qui sont sur le terrain de classe, et cela, avant, pendant et après la victoire de la révolution.
À moins de considérer que toute la classe est déjà communiste-consciente ou le devient d’emblée avec la révolution, ce qui rend superflue sinon nuisible, l’existence de toute organisation politique dans la classe (sinon tout au plus une organisation avec une fonction strictement pédagogique, comme le veut le conseillisme de Pannekoek) ou bien de décréter que la classe ne peut avoir en son sein qu’un parti unique (comme le veulent les bordiguistes enragés), force nous est de reconnaître l’existence inévitable dans le prolétariat, à côté de l’organisation du parti communiste, d'organisations politiques confuses, plus ou moins cohérentes, véhiculant des idées petites bourgeoises et faisant des concessions politiques à des idéologies étrangères à la classe.
Dire cela c’est reconnaître l’existence au sein de la classe, dans toutes les périodes, de tendances centristes, car le centrisme n’est rien d’autre que la persistance dans la classe de courants politiques avec des programmes confus inconséquents, incohérents, pénétrés et véhiculant des positions relevant de l’idéologie petite-bourgeoise et lui faisant des concessions, oscillant entre cette idéologie et la conscience historique du prolétariat et tentant sans cesse de les concilier.
C’est justement parce que le centrisme ne peut être défini en terme d'un "programme précis" qu’il n’a pas, qu’on peut comprendre sa persistance en s’adaptant à chaque situation particulière, en changeant de position selon les circonstances du rapport de forces existant entre les classes.
Si c’est un non-sens de parler de centrisme en général, dans l’abstrait en terme de "base sociale" propre ou de "programme spécifique précis" mais qu’il faut le situer par rapport à d’autres courants politiques plus stables (en l’occurrence, dans le débat actuel, par rapport au conseillisme) on peut par contre parler d’une constance du comportement politique qui le caractérise : osciller, éviter de prendre une position claire et conséquente. (…)
Prenons un (…) exemple concret (…) édifiant du comportement centriste : McIntosh se réfère parfois dans son texte à la polémique Kautsky-Rosa Luxemburg de 1910. Comment a commencé cette polémique ? Elle a commencé par un article écrit par Rosa contre la politique et la pratique opportunistes de la direction du parti social-démocrate lui opposant la politique révolutionnaire de la grève de masse. Kautsky, en qualité de directeur de la Neue Zeit (organe théorique de la social-démocratie) refuse de publier cet article sous le prétexte que, tout en partageant l’idée générale de la grève de masse, il considère cette politique inadéquate dans ce moment précis, ce qui entrainerait nécessairement une réponse de sa part et une discussion entre deux membres de la tendance marxiste radicale face à la droite du parti, chose qu’il considère tout à fait regrettable. Devant ce refus, Rosa publie son article dans le Dortmunder Arbeiter Zeitung ce qui va obliger Kautsky à répondre et à s’engager dans la polémique que nous connaissons.
Quand j’ai annoncé, en septembre dans le SI 4, mon intention d’écrire un article mettant en lumière la démarche conseilliste des textes de AP, la camarade JA 5 a commencé par demander des explications sur le contenu et l’argumentation de cet article. Ces explications données, la camarade JA a trouvé cet article inopportun et suggérait d’attendre que le SI se mette préalablement d’accord, c’est-à-dire le "corriger" avant publication, de façon à ce que le SI dans son ensemble puisse le signer. Devant ce type de correction où il s’agissait d’arrondir les angles et de noyer le poisson, j’ai préféré le publier en mon nom propre. Une fois publié, JA trouvait cet article absolument déplorable du fait qu’il ne ferait que jeter le trouble dans l’organisation. Heureusement JA n’était pas la directrice (du Bulletin interne) comme l’était Kautsky [pour la Neue Zeit]et n’avait pas son pouvoir, car dans le cas contraire l’article n’aurait jamais vu le jour. Comme quoi avec 75 ans de décalage et de changement de période (ascendante et décadente) le centrisme a bien changé de visage et de positions mais a gardé le même esprit et la même démarche : éviter de soulever des débats pour ne pas "troubler" l’organisation.
Dans un de mes premiers articles polémiques contre les réservistes je disais que la période de décadence est par excellence la période de manifestations du centrisme. Un simple coup d’œil sur l’histoire de ces 70 ans nous fera immédiatement constater que, dans aucune autre période dans l’histoire du mouvement ouvrier, le centrisme ne s’est manifesté avec autant de force, avec autant de variantes et n’a fait autant de ravages que dans cette période de décadence du capitalisme. On ne peut être qu’absolument d’accord avec la définition très juste donnée par Bilan : qu’une Internationale ne trahit pas comme telle mais meurt, disparaît, cesse d’exister et que ce sont les partis devenus "nationaux" qui passent chacun du côté de sa bourgeoisie nationale. Ainsi, c’est dès le lendemain du 4 août 1914, quand les partis socialistes des pays belligérants signent leur trahison en votant les crédits de guerre, que commence à se développer, dans chaque pays, à côté des petites minorités restées fidèles à l’internationalisme, une opposition de plus en plus nombreuse, au sein des partis socialistes et de syndicats, contre la guerre et la politique de défense nationale. C’est le cas en Russie avec les menchéviks internationalistes de Martov, du groupe inter-rayons de Trotsky. C’est le cas en Allemagne avec le développement de l’opposition à la guerre qui va être exclue du parti SD pour donner naissance à l’USPD, c’est le cas en France avec le groupe syndicaliste-révolutionnaire de La Vie ouvrière de Monatte, Rosmer et Merrheim, de la majorité du parti socialiste d’Italie et celui de la Suisse, etc., etc. Tout cela constitue un courant varié pacifiste-centriste inconséquent qui s’oppose à la guerre au nom de la paix et non au nom du défaitisme révolutionnaire et de la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. C’est ce courant centriste qui organise la conférence socialiste contre la guerre de Zimmerwald en 1915 (où la gauche révolutionnaire conséquente et intransigeante représente une petite minorité réduite aux Bolcheviks russes, les tribunistes hollandais et les radicaux de Brême en Allemagne) et de Kienthal 1916 encore largement dominée par le courant centriste (où les Spartakistes de Rosa et de Liebknecht rejoignent enfin la gauche révolutionnaire). Ce courant centriste ne pose d’aucune façon la question de la rupture immédiate avec les partis socialistes devenus des partis social-chauvins et jusqu’auboutistes, mais pose la question de leur redressement dans l’unité organisationnelle6. La révolution commencée en février 17 en Russie trouve un parti bolchevique (et des soviets ouvriers et soldats soutenant le gouvernement de Kerenski-Milioukov dans sa presque totalité) qui se situe dans la position d’un soutien conditionnel au gouvernement bourgeois de Kerenski.
L’enthousiasme général produit dans la classe ouvrière dans le monde entier, suite à la victoire de la révolution d’octobre ne va pas beaucoup plus loin que de développer un immense courant fondamentalement centriste. Les partis et les groupes qui vont constituer et adhérer à l’Internationale communiste sont en grande majorité des partis encore profondément marqués par le centrisme. Dès 1920 on assiste aux premiers signes de l’essoufflement de la première vague révolutionnaire qui va aller vite en décroissant. Cela va se traduire sur le plan politique par un glissement centriste déjà très visible au 2ème Congrès de l’IC, par la prise de positions ambiguës et erronées sur des questions aussi importantes que celles du syndicalisme, du parlementarisme, de l’indépendance et de l’auto-détermination nationales. D’année en année, l’IC et les partis communistes qui la constituent vont suivre à un rythme accéléré le recul vers des positions centristes et la dégénérescence ; les tendances révolutionnaires-intransigeantes, devenues rapidement minoritaires dans les partis communistes, vont être tout à tour exclues de ces partis et vont subir elles-mêmes l’impact de la gangrène centriste comme ce fut le cas des différentes oppositions issues de l’IC et plus particulièrement de l’opposition de gauche de Trotsky pour finalement être entrainées à franchir les frontières de classe avec la guerre d’Espagne et la 2ème Guerre mondiale au nom de l’antifascisme et de la défense de l’État ouvrier dégénéré en Russie. La toute petite minorité qui reste fermement sur le terrain de classe et du communisme, comme la Gauche Communiste Internationale et la Gauche Hollandaise vont également subir le choc en retour de cette période noire qui a suivi au lendemain de la guerre, les uns comme les bordiguistes en se sclérosant et en régressant gravement politiquement, les autres comme la gauche hollandaise en se décomposant dans un conseillisme complètement dégénéré. Il faut attendre la fin des années 60, avec l’annonce de la crise ouverte, avec l’annonce d’une reprise de la lutte de classe, que ressurgissent de petits groupes révolutionnaires cherchant à se dégager de l’immense confusion de 68, pour s’efforcer péniblement de renouer avec le fil historique du marxisme-révolutionnaire.
(…) Il faut vraiment être frappé de cécité universitaire pour ne pas voir cette réalité. Il faut ignorer complètement l’histoire du mouvement ouvrier de ces 70 ans depuis 1914 pour affirmer péremptoirement, comme le fait McIntosh, que le centrisme n’existe pas et ne saurait exister dans la période de décadence. La phraséologie radicale grandiloquente, les indignations feintes, ne sauraient tenir lieu un tant soit peu d’argument sérieux.
Il est certes plus commode de faire la politique de l’autruche, en fermant les yeux pour ne pas voir la réalité et ses dangers, pour pouvoir d’autant plus facilement les nier. On se rassure ainsi à bon compte et on s’épargne bien des casse-têtes de réflexions. Ce n’est pas la méthode de Marx qui écrivait "Les communistes ne viennent pas pour consoler la classe ouvrière ; ils viennent pour la rendre encore plus misérable en la rendant consciente de sa misère". McIntosh suit la première voie en niant purement et simplement pour sa tranquillité et contre toute évidence, l’existence du centrisme dans la période de décadence. Pour les marxistes que nous devons être il s’agit de suivre l’autre voie : ouvrir tout grands les yeux pour reconnaître la réalité, la comprendre et la comprendre dans son mouvement et dans sa complexité. C’est donc à nous de tenter d’expliquer le pourquoi du fait indéniable que la période de décadence est aussi une période qui voit l’éclosion des tendances centristes.
La période de décadence du capitalisme et le prolétariat
(…) La période de décadence c’est l’entrée dans une crise historique, permanente, objective, du système capitaliste, posant ainsi le dilemme historique : son autodestruction, entrainant avec lui la destruction de toute la société, ou la destruction de ce système pour faire place à une nouvelle société sans classes, la société communiste. La seule classe susceptible de réaliser ce grandiose projet de sauver l’humanité est le prolétariat dont l’intérêt de se libérer de l’exploitation le pousse dans une lutte à mort contre ce système d’esclavagisme salarial capitaliste et qui, d’autre part, ne peut s’émanciper qu’en émancipant toute l’humanité.
Contrairement :
- à la théorie que c’est la lutte ouvrière qui détermine la crise du système économique du capitalisme (GLAT) ;
- à la théorie qui ignore la crise permanente historique et ne connaît que des crises conjoncturelles et cycliques offrant la possibilité de la révolution et, à défaut de sa victoire, permet un nouveau cycle de développement du capitalisme, ainsi à l’infini (A. Bordiga) ;
- à la théorie pédagogique pour laquelle la révolution n’est pas liée à une question de crise du capitalisme mais dépend de l’intelligence des ouvriers acquise au cours de leurs luttes (Pannekoek) ;
Nous affirmons avec Marx qu’une société ne disparaît pas tant qu’elle n’a pas épuisé toutes les possibilités de développement qu’elle contient en elle. Nous affirmons avec Rosa que c’est la maturation des contradictions internes au capital qui détermine sa crise historique, condition objective de la nécessité de la révolution. Nous affirmons avec Lénine qu’il ne suffit pas que le prolétariat ne veuille plus être exploité, mais il faut encore que le capitalisme ne puisse plus vivre comme auparavant.
La décadence c'est l’effondrement du système capitaliste sous le poids de ses propres contradictions internes. La compréhension de cette théorie est indispensable pour comprendre les conditions dans lesquelles se déroule et va se dérouler la révolution prolétarienne.
À cette entrée en décadence de son système économique, que la science économique bourgeoise ne pouvait ni prévoir ni comprendre, le capitalisme -sans pouvoir maitriser cette évolution objective- a répondu par une extrême concentration de toutes ses forces politiques, économiques et militaires qu’est le capitalisme d’État, à la fois pour faire face à l’exacerbation extrême des tensions inter-impérialistes et surtout face à la menace de l’explosion de la révolution prolétarienne dont il venait de prendre conscience avec l’éclatement de la révolution russe en 1917.
Si l’entrée en décadence signifie la maturité historique objective de la nécessité de la disparition du capitalisme, il n’en est pas de même de la maturation de la condition subjective (la prise de conscience par le prolétariat) pour pouvoir la réaliser. Cette condition est indispensable parce que, comme le disaient Marx et Engels : l’histoire ne fait rien par elle-même, ce sont les hommes (les classes) qui font l’histoire.
Nous savons qu’à l’encontre de toutes les révolutions passées dans l’histoire, dans lesquelles la prise de conscience des classes qui devaient les assumer jouait un rôle de second plan du fait qu’il ne s’agissait que d’un changement de système d’exploitation par un autre système d’exploitation, la révolution socialiste posant la fin de toute exploitation de l’homme par l’homme et de toute l’histoire des sociétés de classes, exige et pose comme condition fondamentale l’action consciente de la classe révolutionnaire. Or le prolétariat n’est pas seulement la classe à qui l’histoire impose la plus grande exigence qu’elle n’ait jamais posée à aucune autre classe ni à l’humanité, une tâche qui dépasse toutes les tâches que l’humanité a jamais affrontées, le saut de la nécessité à la liberté, mais encore le prolétariat se trouve devant les plus grandes difficultés. Dernière classe exploitée, il représente toutes les classes exploitées de l’histoire face à toutes les classes exploiteuses représentées par le capitalisme.
C’est la première fois dans l’histoire qu’une classe exploitée est amenée à assumer la transformation sociale et, de plus, une transformation qui porte avec elle la destinée et le devenir de toute l’humanité. Dans cette lutte titanesque, le prolétariat se présente au départ en état de faiblesse, état inhérent à toute classe exploitée, aggravé par le poids des faiblesses de toutes les générations mortes des classes exploitées qui pèse sur lui : manque de conscience, manque de conviction, manque de confiance, prenant peur de ce qu’elles osent penser et entreprendre, habitude millénaire de soumission à la force et à l’idéologie des classes dominantes. C’est pourquoi, contrairement à la marche des autres classes qui va de victoire en victoire, la lutte du prolétariat est faite par des avancées et et des reculs et qu'il ne parvient à sa victoire finale qu’à la suite d’une longue série de défaites.
(…) Cette suite dans la marche d’avancées et reculs de la lutte du prolétariat, dont Marx a déjà parlé au lendemain des évènements révolutionnaires de 1848, ne fait que s’accentuer et s’accélérer dans la période de décadence, du fait même de la barbarie de cette période qui pose au prolétariat la question de la révolution en termes plus concrets, plus pratiques, plus dramatiques, et cela se traduit, au niveau de la prise de conscience de la classe également en un mouvement accéléré et turbulent comme le déferlement des vagues dans une mer agitée.
Ce sont ces conditions (d’une réalité qui voit la maturité des conditions objectives et l’immaturité des conditions subjectives) qui déterminent le tourbillonnement dans la classe et font surgir une multitude de courants politiques divers et contradictoires, convergents et divergents, évoluant et régressant et notamment les différentes variétés du centrisme.
La lutte contre le capitalisme est en même temps une lutte et une décantation politique au sein même de la classe dans son effort vers la prise de conscience, et ce processus est d’autant plus violent et tortueux qu’il se déroule sous le feu nourri de l’ennemi de classe.
Les seules armes que possède le prolétariat dans sa lutte à mort contre le capitalisme et qui peuvent lui assurer la victoire ce sont : la conscience et son organisation. C’est dans ce sens et dans ce sens seulement que doit être comprise la phrase de Marx : "Il ne s'agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, se représente momentanément. Il s'agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu'il sera obligé historiquement de faire, conformément à cet être.".
(…) Les conseillistes interprètent cette phrase de Marx dans le sens que c’est chaque lutte ouvrière qui produit automatiquement la prise de conscience de la classe, niant la nécessité d’une lutte théorique-politique soutenue au sein de la classe (existence nécessaire de l’organisation politique-révolutionnaire). Nos réservistes ont glissé dans le même sens, lors des débats au BI plénier de janvier 84 et du vote du point 7 de la résolution. Aujourd’hui, (pour escamoter ce premier glissement) en s’alignant sur la thèse aberrante de McIntosh de l’impossibilité de l’existence de courants centristes dans la classe dans la période de décadence, ils ne font que poursuivre le même glissement, se contentant simplement de retourner la même pièce du côté face au côté pile.
Dire que dans cette période [de décadence du capitalisme] il ne saurait exister, ni avant, ni pendant, ni après la révolution aucun type de centrisme au sein de la classe, c’est ou bien considérer en idéaliste la classe comme uniformément consciente, absolument homogène et totalement communiste (rendant inutile l’existence même d’un parti communiste, comme le font les conseillistes conséquents) ou bien décréter que seul peut exister dans la classe un parti unique, en dehors duquel tout autre courant est par définition contre-révolutionnaire et bourgeois, tombant, par un curieux détour dans les pires manifestations de la mégalomanie du bordiguisme.
Les deux principales tendances du courant centriste
Comme nous l’avons déjà vu, le courant centriste ne se présente pas comme un courant homogène avec "un programme spécifique précis". C’est le courant politique le moins stable, le moins cohérent, tiraillé en son sein par l’attraction qui s’exerce sur lui par, d’un côté l’influence du programme communiste et, de l’autre, l’idéologie petite-bourgeoise. Cela est dû aux deux sources (existant en même temps et se croisant) qui lui donnent naissance et l’alimentent :
1) l’immaturité de la classe dans son mouvement de prise de conscience ;
2) La pénétration constante de l’idéologie petite-bourgeoise au sein de la classe.
Ces sources vont et poussent les courants centristes vers deux directions diamétralement opposées.
En règle générale c’est le rapport de forces existant entre les classes, à des périodes précises, le flux ou le reflux de la lutte de classe qui décident du sens de l’évolution ou de la régression des organisations centristes. (…) McIntosh voit, dans sa myopie congénitale, seulement la seconde source et ignore magistralement la première, comme il ignore les pressions contraires qui s’exercent sur le centrisme. Il ne connaît le centrisme que comme une "abstraction" et non dans la réalité de son mouvement. Quand McIntosh reconnaît le centrisme c’est quand celui-ci s’est définitivement intégré dans la bourgeoisie, c’est-à-dire quand le centrisme a cessé d’être centrisme et notre camarade est d’autant plus furieux et laisse éclater son indignation qu’il ne l’a ni connu ni reconnu auparavant.
C’est tout-à-fait dans la nature de nos minoritaires de s’acharner sur le cadavre d’une bête féroce qu’ils n’ont pas combattue de son vivant et qu’ils se gardent bien de reconnaître et de combattre aujourd’hui.
Examinons donc le centrisme alimenté par la première source, c’est-à-dire allant de l’immaturité vers la prise de conscience des positions de classe. Prenons l’exemple de l’USPD, bête noire découverte aujourd’hui et devenu le cheval de bataille de nos minoritaires.
La mythologie perse raconte que le diable, las de ses échecs à combattre le Bien et le Mal, a décidé, un beau jour, de changer de tactique en procédant d’une autre manière, ajoutant démesurément du bien au Bien. Ainsi quand Dieu a donné aux hommes le Bien de l’amour et du désir charnel, en augmentant et exaspérant ce désir, le diable a fait que les hommes se vautraient dans la luxure et le viol. De même quand Dieu a donné comme un bien le vin, le diable en augmentant le plaisir du vin a fait l’alcoolisme. On connaît le slogan : "un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts !".
Nos minoritaires font exactement la même chose aujourd’hui. Dans l’incapacité de défendre leur glissement centriste par rapport au conseillisme, ils changent de tactique. "Vous disiez centrisme, mais centrisme c’est la bourgeoisie ! En prétendant combattre le centrisme vous ne faites que l’habiliter en le situant et lui donnant le label de classe. Ainsi en le situant dans la classe vous vous faites son défenseur et ses apologistes."
Habile tactique d’inversement de rôle. Elle a parfaitement réussi au diable. Malheureusement pour eux, nos minoritaires ne sont pas des diables et entre leurs mains cette astucieuse tactique ne peut que faire long feu. Qui, quel camarade peut sérieusement croire à cette absurdité que la majorité du BI plénier de janvier 84 qui a décelé et mis en évidence l’existence d’un glissement centriste vers le conseillisme en notre sein et, depuis un an, ne fait que le combattre, serait en réalité le défenseur et l’apologiste du centrisme de Kautsky d’il y a 70 ans ? Nos minoritaires eux-mêmes ne le pensent pas. Ils cherchent plutôt à brouiller le débat sur le présent en divaguant sur le passé.
Pour revenir à l’histoire de l’USPD il faut commencer par rappeler le développement de l’opposition à la guerre dans la social-démocratie. L’Union sacrée contresignée par le vote unanime (moins le vote de Rühle) de la fraction parlementaire des crédits de guerre en Allemagne, stupéfia bien des membres de ce parti au point de les paralyser. La gauche qui va donner naissance à Spartakus est à ce point réduite que le petit appartement de Rosa sera assez grand pour se réunir au lendemain du 4 août 1914.
La gauche est non seulement réduite mais est en plus divisée en plusieurs groupes :
- la "gauche radicale" de Brême qui, influencée par les Bolcheviks, préconise la sortie immédiate de la social-démocratie ;
- ceux qui sont groupés autour de petits bulletins et revues comme celle de Borchardt (proche de la "gauche radicale") ;
- les délégués révolutionnaires (le plus important des groupes) rassemblant les représentants syndicaux des usines métallurgistes de Berlin et qui se situait politiquement entre le centre et Spartakus ;
- le groupe Spartakus ;
- et puis enfin le centre qui donnera naissance à l’USPD.
De plus, chacun des groupes ne représentera pas une entité homogène mais connaîtra des subdivisions en multiples tendances se chevauchant et s’entrecroisant, s’approchant et s’éloignant sans cesse. Toutefois l’axe principal de ces divisions restera toujours la régression vers la droite et l’évolution vers la gauche. Cela nous donne déjà une idée du bouillonnement qui se produit dans la classe ouvrière en Allemagne dès le début de la guerre (point critique de la période de décadence) et qui ira en s’accélérant au cours de celle-ci. Il est impossible dans les limites de cet article de donner des détails sur le développement de nombreuses grèves et manifestations contre la guerre en Allemagne. Aucun autre pays belligérant n’a connu un tel développement, même pas la Russie. Nous pouvons nous contenter de donner ici quelques points de référence, entre autres la répercussion politique de ce bouillonnement sur la fraction la plus droitière de la SD, la fraction parlementaire.
Le 4 août 1914, 94 sur 95 députés votent les crédits de guerre. Un seul vote contre, celui de Rühle, Karl Liebknecht, se soumettant à la discipline, vote également pour. En décembre 1914, à l’occasion d’un nouveau vote de crédits, Liebknecht rompt avec la discipline et vote contre.
En mars 1915, nouveau vote du budget y compris les crédits de guerre. "Seuls Liebknecht et Rühle voteront contre, après que trente députés, Haase et Ledebour (deux futurs dirigeants de l’USPD) en tête, eurent quitté la salle". (O.K. Flechtheim, Le parti communiste allemand sous la République de Weimar, Maspero, p. 38). Le 21 décembre 1915, nouveau vote de crédits au Reichstag, F. Geyer déclare au nom de vingt députés du groupe SD : "Nous refusons les crédits". "Lors de ce vote vingt députés refusèrent les crédits et vingt-deux autres quittèrent la salle" (Ibid.).
Le 6 janvier 1916, la majorité social-chauvine du groupe parlementaire exclut Liebknecht de ses rangs. Rühle se solidarise avec lui et est exclu également. Le 24 mars 1916, Haase rejette, au nom de la minorité du groupe SD au Reichstag, le budget d’urgence de l’État ; la minorité publie la déclaration suivante : "Le groupe parlementaire social-démocrate par 58 voix contre 33 et 4 abstentions nous a aujourd’hui enlevé les droits découlant de l’appartenance au groupe… Nous nous voyons contraints de nous grouper en une Communauté de travail social-démocrate".
Parmi les signataires de cette déclaration, nous trouvons les noms de la plupart des futurs dirigeants de l’USPD et notamment celui de Bernstein. La scission et l’existence désormais de deux groupes SD au Reichstag, un social-chauvin et l’autre contre la guerre, correspondent, à peu de chose près, à ce qui se passe dans le parti SD dans son ensemble, avec ses divisions et luttes de tendances acharnées, comme parmi la classe ouvrière.
Au mois de juin 1915 s’organise une action commune de toute l’opposition contre le comité central du parti. Un texte est diffusé sous forme de tract, portant la signature de centaines de permanents. Il y est dit en résumé : "Nous exigeons que le groupe parlementaire et la direction du parti dénoncent enfin l’Union sacrée et engagent sur toute la ligne la lutte de classe sur la base du programme et des décisions du parti, la lutte socialiste pour la paix" (Op. citée). Peu après est paru un Manifeste signé de Bernstein, Haase et Kautsky intitulé "‘L’impératif de l’heure’ dans lequel ils demandaient qu’on mette fin à la politique du vote des crédits." (Ibid.)
Suite à l’exclusion de Liebknecht du groupe parlementaire, "la direction de l’organisation SD de Berlin approuva par 41 voix contre 17 la déclaration de la minorité du groupe parlementaire. Une conférence réunissant 320 permanents du 8ème district électoral de Berlin approuva Ledebour." (Ibid.)
Sur le plan de la lutte des ouvriers on peut rappeler :
- 1915, quelques manifestations contre la guerre à Berlin groupant au plus 1000 personnes ;
- à l’occasion du 1er mai 1916, Spartakus groupe dans une manifestation 10 000 ouvriers des usines ;
- août 1916, suite à l’arrestation et la condamnation de K. Liebknecht pour son action contre la guerre, 55 000 métallurgistes de Berlin font la grève. Il y a également des grèves dans plusieurs villes de province.
Ce mouvement contre la guerre et contre la politique social-chauvine, va se poursuivre, s’élargir tout au long de la guerre et gagner de plus en plus les masses ouvrières, avec en leur sein une petite minorité de révolutionnaires (elle-même tâtonnante) et une forte majorité d’un courant centriste hésitant et allant se radicalisant. C’est ainsi qu’à la Conférence nationale de la SD, en septembre 1916, à laquelle participent minorité centriste et le groupe Spartakus, 4 orateurs déclaraient : "L’important n’était pas l’unité du parti mais l’unité dans les principes. Il fallait appeler les masses à gagner la lutte contre l’impérialisme et la guerre et imposer la paix en employant tous les moyens de force dont disposait le prolétariat." (Ibid.).
Le 7 janvier 1917 se tint une conférence nationale groupant tous les courants d’opposition à la guerre. Sur 187 délégués, 35 représentaient le groupe Spartakus. Une conférence qui adopte à l’unanimité un Manifeste… écrit par Kautsky et une résolution de Kurt Eisner. Les deux textes disaient : "Ce qu’elle demande (l’opposition), c’est une paix sans vainqueurs ni vaincus, une paix de réconciliation sans violence".
Comment expliquer que Spartakus vote une telle résolution, parfaitement opportuniste, pacifiste, lui qui, par la bouche de son représentant Ernst Meyer, "posa la question de l’arrêt des versements de cotisations de l’appartenance au parti" ?
Pour McIntosh, dans son simplisme, une telle question n’a pas de sens : la majorité de la social-démocratie étant devenue bourgeoise, le centrisme est donc aussi bourgeois, et Spartakus l’est également.
(…) Mais alors on peut se demander ce que faisaient les Bolcheviks et les Tribunistes de Hollande dans les Conférences de Zimmerwald et Kienthal, où, tout en proposant leur résolution de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, ils ont finalement voté les manifeste et résolution qui étaient également pour la paix sans annexion ni contribution ? Dans la logique de McIntosh, les choses sont ou toutes blanches ou toutes noires d’éternité et pour l’éternité. Il ne voit pas le mouvement et il voit encore moins le sens où va le mouvement. Heureusement que McIntosh n’est pas médecin car il serait un médecin de malheur pour qui un malade est d’avance condamné et déjà vu comme un cadavre.
Il faut encore insister sur le fait que ce qui n’est déjà pas valable pour une vie d’homme est une totale absurdité au niveau d’un mouvement historique, comme celui du prolétariat. Ici le passage de la vie à la mort ne se mesure pas en secondes ni en minutes mais en années. Ce n’est pas la même chose le moment où un parti ouvrier signe son arrêt de mort et sa mort effective, définitive. Cela est peut être difficile à comprendre pour un phraséologue radical, mais est tout-à-fait compréhensible pour un marxiste qui n’a pas l’habitude de quitter le bateau comme les rats dès que celui-ci commence à prendre l’eau. Les révolutionnaires savent ce que représente historiquement une organisation à qui la classe a donné le jour et, tant qu’il reste un souffle de vie, ils luttent pour la sauver, pour la garder à la classe. Une telle question n’existait pas, il y a encore quelques années, pour la CWO, elle n’existe pas pour un Guy Sabatier et autres phraséologues pour qui l’Internationale communiste, le parti bolchevique ont été de tout temps la bourgeoisie. Elle n’existe pas non plus pour McIntosh. Les révolutionnaires peuvent se tromper à un moment précis mais pour eux cette question est de la plus haute importance. Pourquoi cela ? Parce que les révolutionnaires ne constituent pas une secte de chercheurs mais sont une partie vivante d’un corps vivant qu’est le mouvement ouvrier, avec ses moments de hauts et de bas.
La majorité social-chauvine de la SD comprenait mieux qu’un McIntosh le danger que représentait ce courant d’opposition à l’Union sacrée et à la guerre et procédait, en toute urgence, à des exclusions massives. C’est à la suite de ces exclusions que s’est constitué le 8 avril 1917 l’USPD. C’est avec beaucoup de réserves et après beaucoup d’hésitation que Spartakus a donné son adhésion à ce nouveau parti en posant comme condition de se réserver une "entière liberté de critique et d’action indépendante". Liebknecht a, plus tard, caractérisé de la manière suivante les rapports entre le groupe Spartakus et l’USPD : "Nous avons adhéré à l’USPD pour le pousser en avant, l’avoir à portée de notre fouet, en arracher les meilleurs éléments." Que cette stratégie fut valable à ce moment-là, c’est plus que douteux, mais une chose est claire : une telle question pouvait se poser pour Luxemburg et Liebknecht parce qu’ils considéraient, avec raison, l’USPD comme un mouvement centriste dans le prolétariat et non comme un parti de la bourgeoisie.
Il ne faut pas oublier que sur les 38 délégués qui participaient à Zimmerwald, la délégation d’Allemagne est de dix membres sous la direction de Ledebour et se compose de 7 membres de l’opposition centriste, 2 de Spartakus et 1 de la gauche de Brême et, à la Conférence de Kienthal il y a, sur 43 participants, 7 délégués venant d’Allemagne dont 4 des centristes, 2 de Spartakus et 1 de la gauche de Brême. Spartakus dans l’USPD, gardait son entière indépendance et se comportait à peu près comme les Bolcheviks dans les Conférences de Zimmerwald et Kienthal.
On ne peut comprendre ce qu’était l’USPD centriste sans le situer dans le contexte d’un formidable mouvement de masses en luttes. En avril 1917 éclate une grève de masse qui englobe, rien qu’à Berlin, 300 000 ouvriers. Par ailleurs se produit la première mutinerie de marins. En janvier 1918, à l’occasion des pourparlers de paix de Brest-Litovsk, c’est une vague de grèves qu’on estime à 1 million d’ouvriers. L’organisation de la grève était entre les mains de délégués-révolutionnaires très proches de l’USPD (chose non moins étonnante est de voir Ebert et Scheidemann faisant partie du comité de grève). Au moment de la scission, certains évaluent les adhérents à la SD à 248 000 et 100 000 à l’USPD. En 1919 l’USPD comporte près d’un million d’adhérents et cela dans les grands centres industriels. Il est impossible de relater ici toutes les vicissitudes des évènements révolutionnaires en Allemagne de 1918. Rappelons seulement que le 7 octobre se décide la fusion entre Spartakus et la gauche de Brême. Liebknecht, qui vient d'être libéré, entre dans l’organisation des délégués révolutionnaires qui s’attache à la préparation d’un soulèvement armé pour le 9 novembre. Mais entretemps éclate le 30 octobre le soulèvement de Kiel. A bien des égards, le début de la révolution en Allemagne rappelle celle de février 1917. Tout particulièrement pour ce qui concerne l’immaturité du facteur subjectif, l’immaturité de la conscience dans la classe. Tout comme en Russie, les congrès des conseils donneront leur investiture à des "représentants" qui étaient les pires jusqu’auboutistes tout le long de la guerre ; Ebert, Scheidemann, Landsberg à qui on ajoute trois membres de l’USPD : Haase, Dittman et Barth. Ces derniers qui font partie de la droite centriste, avec tout ce que cela comporte de veulerie, de lâcheté, d’hésitation, vont servir de caution "révolutionnaire" à Ebert-Scheidemann, pour peu de temps (du 20/12 au 29/12 de 1919), mais suffisamment pour leur permettre d’organiser, avec l’aide des junkers prussiens et des corps francs, les massacres contre-révolutionnaires.
La politique de semi-confiance semi-méfiance dans ce gouvernement qui sera celle de la direction de l’USPD, ressemble étrangement à celle du soutien conditionnel au gouvernement de Kerensky par la direction du parti bolchevique jusqu’à mai 1917, jusqu’au triomphe des Thèses d’avril de Lénine. La grande différence, toutefois, ne réside pas tant dans la fermeté du parti bolchevique sous la direction de Lénine et de Trotsky que dans la force, l’intelligence d’une classe expérimentée, sachant ramasser toutes ses forces contre le prolétariat comme le fut la bourgeoisie allemande, et l’extrême sénilité de la bourgeoisie russe.
Pour ce qui concerne l’USPD, il fut écartelé, comme tout courant centriste, entre une tendance de droite cherchant à se réintégrer dans le vieux parti passé à la bourgeoisie et une tendance de plus en plus forte à la recherche du camp de la révolution. On trouve ainsi l’USPD aux côtés de Spartakus dans les journées sanglantes de la contre-révolution à Berlin en janvier 1919, comme on le trouvera dans les différents affrontements dans les autres villes, comme ce fut le cas en Bavière, à Munich. L’USPD, comme tout autre courant centriste, ne pouvait se maintenir devant les épreuves décisives de la révolution. Il était condamné à éclater, il éclata.
Dès son Deuxième Congrès (6 mars 1919), les deux tendances s’affrontent sur plusieurs questions (syndicalisme, parlementarisme) mais surtout sur la question d’adhérer à l’Internationale communiste. La majorité rejeta l’adhésion. La minorité allait cependant se renforçant, quoiqu’à la Conférence nationale qui se tint en septembre, elle n’ait pas réussi encore à conquérir la majorité. Au Congrès de Leipzig, le 30 novembre de la même année, la minorité gagne dans la question du programme d’action, adopté à l’unanimité, au principe de la dictature des soviets, et il est décidé d’engager des pourparlers avec l’IC. Au mois de juin 1920, une délégation se rend à Moscou pour entamer ces pourparlers et pour participer au Deuxième Congrès de l’IC.
Le CE de l’IC avait préparé à ce sujet un texte contenant, à l’origine, 18 conditions et qui fut renforcé en ajoutant encore 3 conditions. Ce sont les 21 conditions d’adhésion à l’Internationale communiste. Après de violentes discussions internes, c’est par une majorité de 237 voix contre 156 que le congrès extraordinaire d’octobre 1920 s’est enfin prononcé pour l’acceptation des 21 conditions et l’adhésion à l’IC.
McIntosh, et derrière lui JA, ont découvert en août 1984, la critique faite depuis toujours par la gauche de l’IC, d’avoir laissé trop larges les mailles du filet pour l’adhésion à l’Internationale. Mais comme toujours, la découverte fort tardive de nos minoritaires n’est qu’une caricature qui tourne à l’absurde. Aucun doute que les 21 conditions contenaient, en elles-mêmes, des positions erronées, non seulement vues à partir de 1984 mais déjà pour l’époque, et critiquées par la gauche. Cela prouve quoi ? Que l’IC était bourgeoise ? Ou bien que l’IC était pénétrée par des positions centristes sur bien des questions et cela dès son début ? L’indignation soudaine de nos minoritaires cache difficilement et leur ignorance de l’histoire qu’ils semblent découvrir aujourd’hui et l’absurdité de leur conclusion que le centrisme ne peut exister dans la période présente de la décadence.
Voilà nos minoritaires, qui font des concessions au conseillisme, devenus des puristes. Décidément ils ne craignent pas de se rendre ridicule en se revendiquant d’un parti communiste vierge et pur, un parti tombant du ciel ou sortant de la cuisse de Jupiter tout armé. Même myopes qu’ils sont et ne voyant pas très loin dans le temps, ils devraient au moins pouvoir voir et comprendre cette courte histoire qu’est celle du CCI. D’où venaient, donc les groupes qui ont fini par se regrouper dans le CCI ? Nos minoritaires n’ont d’ailleurs qu’à commencer par se regarder eux-mêmes et leur propre trajectoire politique. D’où venaient donc RI ou WR, ou la section de Belgique, des USA, d’Espagne, d’Italie, et de la Suède ??? Ne venaient-ils pas d’un marais confusionniste, anarchisant et contestataire ???
Il n’y aura jamais de mailles assez serrées pour nous donner la garantie absolue contre la pénétration des éléments centristes ou leur surgissement de l’intérieur. L’histoire du CCI -sans déjà parler de l’histoire du mouvement ouvrier- est là pour démontrer que le mouvement révolutionnaire est un processus de décantation incessant. Il suffit de regarder nos minoritaires pour se rendre compte de la somme de confusions qu’ils ont été capables d’apporter en une année.
Voilà que McIntosh a découvert que le flot de la première vague de la révolution a également charrié des Smeral, des Cachin, des Frossard et des Serrati. McIntosh a-t-il déjà vu de la fenêtre de son université ce qu’est un flot révolutionnaire ?
Pour ce qui concerne le PCF, McIntosh écrit aussi l’histoire à sa façon en disant par exemple que le parti adhère à l’IC groupé autour de Cachin-Frossard. Ne sait-il rien de l’existence du Comité de la 3ème Internationale groupé autour de Loriot et de Souvarine, en opposition au Comité de reconstruction de Faure et Longuet ? Frossard et Cachin zigzaguaient entre ces deux comités, pour se rallier à la fin à la résolution du Comité de la 3ème Internationale pour l’adhésion à l’IC. Au Congrès de Strasbourg en février 1920, la majorité est encore contre l’adhésion. Au Congrès de Tours, décembre 1920, la motion pour l’adhésion à l’IC obtient 3208 mandats, la motion de Longuet pour l’adhésion avec réserve 1022 et l’abstention (groupe Blum-Renaudel) 397 mandats.
Les mailles n’étaient-elles pas suffisamment serrées ? Certainement. N’empêche que c’est ainsi qu’on doit comprendre ce qu’est un flot montant de la révolution. Nous discutons sur le fait de savoir si les partis bolchevique, Spartakus, les partis socialistes qui ont constitué ou adhéré à l’IC étaient des partis ouvriers ou des partis de la bourgeoisie. Nous ne discutons pas sur leurs erreurs mais sur leur nature de classe, et les Mic-Mac d’Intosh ne nous sont d’aucune aide en la matière. De même que McIntosh ne sait pas voir ce qu’est un courant de maturation, qui va de l’idéologie bourgeoise vers la conscience de classe, il ne sait pas non plus ce qui le différencie d’un courant qui dégénère, c’est-à-dire qui va de la position de classe vers l’idéologie bourgeoise.
Dans sa vision d’un monde fixe, figé, le sens du mouvement n’a aucun intérêt ni aucune place. C’est pourquoi il ne saurait comprendre ce que veut dire aider le premier qui s’approche en le critiquant, et combattre sans pitié le second qui s’éloigne. Mais surtout, il ne sait pas distinguer quand le processus de la dégénérescence d’un parti prolétarien est définitivement achevé. Sans refaire toute l’histoire du mouvement ouvrier nous pouvons lui donner un point de repère : un parti est définitivement perdu pour la classe ouvrière quand il ne sort plus de son sein aucune tendance, aucun corps vivant (prolétarien). Ce fut le cas à partir de 1921 pour les partis socialistes, ce fut le cas au début des années 30 pour les partis communistes. C’est avec raison qu’on pouvait parler d’eux en terme de centrisme jusqu’à ces dates.
Et pour terminer, il faut retenir que la Nouvelle théorie de McIntosh, qui veut ignorer l’existence du centrisme en période de décadence, rappelle fort ces gens qui, au lieu de se soigner, optent pour ignorer ce qu’ils appellent une "maladie honteuse". On ne combat pas le centrisme en le niant, en l’ignorant. Le centrisme, comme toute autre plaie qui peut atteindre le mouvement ouvrier, ne peut être soigné en le cachant, mais en l’exposant, comme disait Rosa Luxemburg, en pleine lumière. La nouvelle théorie de McIntosh repose sur la crainte superstitieuse du pouvoir maléfique des mots : moins on parle de centrisme mieux on se porte. Pour nous, au contraire, on doit savoir connaître et reconnaître le centrisme, savoir dans quelle période, de flux ou de reflux, il se situe et comprendre dans quel sens il évolue. Surmonter et combattre le centrisme est en dernière analyse le problème de la maturation du facteur subjectif, de la prise de conscience de la classe.
MC (Décembre 1984)
Conscience et organisation:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud: de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970
- 2059 lectures
Dans l’article précédent sur le mouvement ouvrier en Afrique du Sud (Publié dans la Revue internationale n° 154), nous avons abordé l’histoire de l’Afrique du Sud en évoquant successivement la naissance du capitalisme, celle de la classe ouvrière, le système d’apartheid et les premiers mouvements de lutte ouvrière. Et nous avons terminé l’article en montrant que, suite à l’écrasement des luttes ouvrières des années 1920, la bourgeoisie (représentée alors par le Parti Travailliste et le Parti National afrikaner) parvint à paralyser durablement toutes les expressions de lutte de classe prolétarienne et qu’il fallut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale pour voir la classe ouvrière sortir de son profond sommeil. En clair, après l'écrasement de la grève insurrectionnelle de 1922 dans un terrible bain de sang et jusqu’à la fin des années 1930, le prolétariat sud-africain fut tétanisé et, de ce fait, laissa le terrain de la lutte aux partis et groupes nationalistes blancs et noirs.
Le présent article met en évidence l’efficacité redoutable contre la lutte de classe du système d’apartheid combiné à l’action des syndicats et des partis de la bourgeoisie et cela jusqu’à la fin des années 1960 où, face au développement inédit de la lutte de classe, la bourgeoisie dut "moderniser" son dispositif politique et remiser ce système. En d’autres termes, elle dut faire face au prolétariat sud-africain qui finit par reprendre ses luttes massivement en s’inscrivant ainsi dans les vagues de lutte qui marquèrent au niveau mondial la fin des années 1960 et le début des années 1970.
Pour évoquer cette période de luttes de la classe ouvrière, nous nous appuyons largement sur l’ouvrage Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, de Brigitte Lachartre 1, membre du Collectif de recherche et d’information sur l’Afrique australe - C.R.I.A.A.- le seul (à notre connaissance) qui se consacre véritablement à l’histoire des luttes sociales en Afrique du Sud.
Reprise éphémère de la lutte de classe durant la seconde boucherie de 1939-45
En fait, les préparatifs guerriers en Europe se traduisirent pour l’Afrique du Sud par l’accélération inattendue du processus de son industrialisation, les grands pays industriels constituant alors les principaux soutiens de l’économie sud-africaine: "(…) La période 1937-1945 fut marquée par une accélération brutale du processus industriel. L’Afrique du Sud, à l’époque, fut contrainte de développer ses propres industries de transformation étant donné la paralysie économique de l’Europe en guerre et ses exportations à travers le monde". (Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud)
Cela eut comme conséquence le recrutement massif d’ouvriers et l’augmentation des cadences de la production. Contre les cadences et la dégradation de ses conditions de vie, la classe ouvrière dut se réveiller brutalement en se lançant dans la lutte : "Pour les masses africaines, cette phase d’intensification industrielle se traduisit par une prolétarisation accélérée, encore accrue du fait qu’un quart de la population active blanche s’enrôlait alors dans le service militaire volontaire aux côtés des Alliés. Pendant cette période, les luttes ouvrières et les grèves aboutirent à des augmentations de salaires notables (13 % par an entre 1941 et 1944) et à une recrudescence du mouvement syndical africain. (…) Entre 1934 et 1945, on releva le chiffre record de 304 grèves dans lesquelles prirent part 58 000 Africains, métis et Indiens et 6 000 Blancs. En 1946, le syndicat des mineurs africains, organisation non reconnue légalement, déclencha une très importante vague de grèves à travers le pays qui fut réprimée dans le sang. Elle n’en avait pas moins réussi à mobiliser quelque 74 000 travailleurs noirs". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Dès lors, le régime sud-africain fut contraint de développer ses propres industries de transformation, étant entendu également qu’il devait remplacer une grande partie de la main-d’œuvre mobilisée dans la boucherie impérialiste. Cela signifie que l’Afrique du Sud avait déjà atteint, à ce moment-là, un certain niveau de développement technologique lui permettant de se passer (momentanément) de ses fournisseurs européens, ce qui fut un cas unique sur le continent noir.
Pour sa part, et de façon inattendue, la classe ouvrière put reprendre assez massivement son combat en réaction à la surexploitation liée à l’accélération des cadences. A travers un mouvement héroïque (dans un contexte de guerre où s’appliquait la loi martiale), elle put arracher des augmentations de salaire avant de se faire massacrer dans un bain de sang. Cette lutte défensive était cependant largement insuffisante pour influer positivement sur la dynamique de la lutte de classe, encore largement contenue par l’État bourgeois. En effet, celui-ci ne tarda pas à profiter du contexte guerrier pour renforcer son dispositif répressif et parvint finalement à infliger une lourde défaite à l’ensemble du prolétariat sud-africain. Cette défaite (comme celles subies précédemment) traumatisa pour longtemps la classe ouvrière et la plongea durablement dans l’inertie permettant ainsi à la bourgeoisie sud-africaine de consolider sa victoire sur le plan politique à travers en particulier l’officialisation du système d’apartheid. En clair, l’État sud-africain, qui était jusqu'alors dirigé par les Afrikaners après leur victoire aux élections législatives de 1948, décida de renforcer toutes les anciennes lois et mesures répressives 2 contre la masse prolétarienne en général. Ainsi, l’apartheid devint officiellement un système de gouvernance permettant de justifier et d’assumer ouvertement les actes les plus barbares contre la classe ouvrière dans ses diverses composantes ethniques et plus particulièrement à l’encontre des africains. Cela allait des "petites" vexations jusqu’aux pratiques les plus abjectes : toilettes séparées, cantines séparées, zones d’habitation séparées, bancs publics séparés, bus/taxis séparés, écoles séparées, hôpitaux séparés, etc. Et le tout se conclut par un article de loi visant à réprimer par l’emprisonnement quiconque se risquait à enfreindre ces monstrueuses lois. Et, effectivement, chaque année, plus de 300 000 personnes étaient arrêtées pour infraction aux lois abjectes. Ainsi, un ouvrier d’origine européenne risquait d’aller en prison s’il était surpris en train de boire un verre avec un noir ou un métis. Dans ce contexte où tout le monde risquait la prison, inutile d’envisager une discussion politique entre prolétaires d’ethnies différentes. 3
Cette situation pesa terriblement sur les capacités de lutte de la classe ouvrière dans son ensemble au point de la plonger à nouveau dans une période de "sommeil" (après celle des années 20) qui dura des années 1950 jusqu’au début des années 1970. Durant cette période, la lutte de classe était dévoyée principalement par les tenants de la lutte de "libération nationale" à savoir les partisans de l’ANC/PC, cause derrière laquelle ils entraîneront tant bien que mal les ouvriers sud-africains noirs jusqu’à la fin de l’apartheid.
Partis et syndicats détournent les luttes sur le terrain nationaliste
Partis et syndicats jouèrent un rôle de premier plan pour détourner systématiquement les luttes ouvrières sur le terrain du nationalisme blanc et noir. Il n’est pas nécessaire de faire un long développement sur le rôle qu‘a joué le Parti Travailliste contre la classe ouvrière, ceci étant évident du fait que, dès le lendemain de sa participation active à la boucherie mondiale de 1914-18, il se trouva au pouvoir pour mener ouvertement des violentes attaques contre le prolétariat sud-africain. D’ailleurs, à partir de ce moment-là, il cessa de revendiquer officiellement son appartenance "au mouvement ouvrier", ce qui ne l’empêchait pas de préserver ses liens avec les syndicats dont il était proche comme TUCSA. (Trade Union Confederation of South Africa). En outre, entre 1914 et la fin de l’apartheid, avant de se disloquer, il passait du gouvernement à l’opposition, et inversement, comme tout parti bourgeois "classique".
Pour plus de détail par rapport à l’ANC, nous renvoyons les lecteurs à l’article précédent de la série publié dans la Revue internationale n° 154. En fait, si nous l’évoquons ici, c’est surtout du fait de son alliance avec le PC et les syndicats qui lui permirent de jouer un double rôle d’encadrement et d’oppresseur de la classe ouvrière.
Quant au Parti Communiste, nous allons y revenir à propos d’une certaine opposition prolétarienne qu’il a dû rencontrer à ses débuts dans sa dérive nationaliste noire, en application des orientations de Staline et de la Troisième internationale en dégénérescence. Certes les informations en notre possession ne nous indiquent pas l’importance numérique ou politique de cette opposition prolétarienne au Parti communiste sud-africain, mais elle fut suffisamment forte pour attirer l’attention de Léon Trotski qui tenta de la soutenir.
Le rôle contre-révolutionnaire du Parti Communiste sud-africain sous l’impulsion de Staline
Le Parti Communiste sud-africain, en tant que "parti stalinisé", joua un rôle contre-révolutionnaire néfaste dans les luttes ouvrières dès le début des années 1930, alors que cet ancien parti internationaliste était déjà en proie à un processus de profonde dégénérescence. Après avoir participé aux combats pour la révolution prolétarienne au début de sa constitution dans les années 1920, le PC sud-africain fut très vite instrumentalisé par le pouvoir stalinien et, dès 1928, il exécuta docilement ses orientations contre-révolutionnaires notamment celles consistant à faire alliance avec la bourgeoisie noire. La théorie stalinienne du "socialisme en seul pays" s’accompagnait de l’idée suivant laquelle les pays sous-développés devaient obligatoirement passer par "une révolution bourgeoise" et que, dans cette optique, le prolétariat pouvait toujours lutter contre l’oppression coloniale mais pas question pour autant de lutter pour le renversement du capitalisme en vue d’instaurer un quelconque pouvoir prolétarien dans les colonies. Cette politique se traduisit concrètement, dès la fin des années 1920, par une "collaboration de classe" où le PC sud-africain fut d’abord la "caution prolétarienne" de la politique nationaliste de l’ANC avant de devenir définitivement son complice actif et ce jusqu’aujourd’hui. Ce qu’illustrent ces terribles paroles d’un secrétaire général du PC en s’adressant à Mandela : "Nelson(…) nous combattons le même ennemi (…), nous travaillons dans le contexte du nationalisme africain". 4
Une minorité internationaliste s’oppose à l’orientation nationaliste du PC sud-africain
Cette politique du PC sud-africain fut contestée par une minorité dont Trotski en personne tenta de soutenir l’effort mais, malheureusement, de façon erronée. En effet, au lieu de combattre résolument l’orientation nationaliste et contre-révolutionnaire préconisée par Staline en Afrique du Sud, Léon Trotski préconise en 1935 l’attitude suivante que les militants révolutionnaires doivent avoir vis-à-vis de l’ANC 5:
1. Les bolcheviks léninistes sont pour la défense du congrès (l’ANC), tel qu’il est, dans tous les cas où il reçoit des coups des oppresseurs blancs et de leurs agents chauvins dans les rangs des organisations ouvrières.
2. Les bolcheviks opposent, dans le programme du congrès, les progressistes et les tendances réactionnaires.
3. Les bolcheviks démasquent aux yeux des masses indigènes l’incapacité du congrès à obtenir la réalisation même de ses propres revendications, du fait de sa politique superficielle, conciliatrice, et lancent, en opposition au congrès, un programme de lutte de classe révolutionnaire.
4. S’ils sont imposés par la situation, des accords temporaires avec le congrès ne peuvent être admis que dans le cadre de tâches pratiques strictement définies, en maintenant la complète indépendance de notre organisation et notre totale liberté de critique politique.
C’est déconcertant de savoir que, malgré l’évidence du caractère contre-révolutionnaire de cette orientation stalinienne appliquée par le PC sud-africain vis-à-vis de l’ANC, Trotski chercha quand même à s’en accommoder par des détours tactiques. D’un côté il affirmait : "Les bolcheviks-léninistes sont pour la défense de l’ANC" et de l’autre : "Les bolcheviks démasquent aux yeux des masses indigènes l’incapacité du congrès à obtenir la réalisation même de ses propres revendications…".
Cela n’était rien d’autre que l’expression d’une politique d’accommodement et de conciliation avec une fraction de la bourgeoisie car, à ce moment-là, rien ne permettait d’entrevoir la moindre évolution possible de l’ANC vers une position de classe prolétarienne. Mais surtout, Trotski était incapable de voir le retournement du cours de la lutte de classe vers la contrerévolution qu’exprimait l’avènement du stalinisme.
On ne s'étonnera plus d'entendre le groupe trotskiste Lutte Ouvrière tenter (80 ans après), après avoir constaté le caractère erroné de l’orientation de Trotski, justifier cette orientation avec des contorsions typiquement trotskistes en disant, d’un côté : "La politique de Trotski n’a pas eu l’influence décisive mais il faut l’avoir à l’esprit …". D’autre côté, Lutte Ouvrière affirme que le PC sud-africain : "s’est mis entièrement au service de l’ANC et a continuellement cherché à en masquer le caractère bourgeois".
En effet, au lieu de dire simplement que la politique de Trotski en la matière était erronée et que le PC est devenu un parti bourgeois au même titre que l’ANC, LO fait des acrobaties hypocrites en cherchant à masquer la nature du parti stalinien sud-africain. Ce faisant LO tente de masquer son propre caractère bourgeois et des liens sentimentaux avec le stalinisme.
Le rôle de saboteurs des luttes des syndicats et la tentative d’un "syndicalisme révolutionnaire"
Il convient d’abord de dire que, de par leur rôle naturel de "négociateurs professionnels" et de "pacificateurs" des conflits entre la bourgeoisie et le prolétariat, les syndicats ne peuvent véritablement constituer des organes de lutte pour la révolution prolétarienne (marxiste), en particulier en période de décadence du capitalisme, comme l’illustre l’histoire de la lutte de classe depuis 1914.
Cependant, soulignons le fait que, avec la boucherie de 1914-18, des éléments ouvriers se réclamant de l’internationalisme prolétarien tentèrent de créer des syndicats révolutionnaires à l’instar des IWA (Industrial Workers of Africa), sur le modèle des IWW américains, ou encore de l’ICU (l’Industrial and Commercial Workers Union) : "(…) En 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : "Venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et les indigènes". Ce texte est publié par l’International Socialist League, une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains (…) et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du Parti Travailliste sud-africain et des syndicats de métiers." 6 Comptant, au début, surtout des militants blancs, l’ISL s’oriente très vite vers les ouvriers noirs, appelant dans son journal hebdomadaire l’Internationale, à "construire un nouveau syndicat qui surmonte les limites des métiers, des couleurs de peau, des races et du sexe pour détruire le capitalisme par un blocage de la classe capitaliste".
Comme le montre la citation ci-après, des minorités véritablement révolutionnaires ont bien tenté de créer des syndicats "révolutionnaires" dans le but de détruire le capitalisme et sa classe dominante. Signalons que L’ICU naquit en 1919 suite à une fusion avec les IWA et connut un développement fulgurant. Mais, malheureusement, ce syndicat abandonna rapidement le terrain de l’internationalisme prolétarien : "Ce syndicat grossit énormément à partir de 1924 et connait un pic de 100 000 membres en 1927, ce qui en fait la plus grosse organisation d’Africains jusqu’à l’ANC des années 1950. Dans les années 1930, l’ICU établit même des sections en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe avant de décliner progressivement. L’ICU n’est pas officiellement une organisation syndicaliste révolutionnaire. Elle est plus influencée par des idéologies nationalistes et traditionalistes que l’anticapitalisme, et elle développe une certaine forme de bureaucratie" 7.
Comme on le voit, le syndicalisme "révolutionnaire" ne put se développer longtemps en Afrique du Sud comme le prétendent ses partisans. En fait L’ICU était un syndicat certes "radical" et combatif qui, dans un premier temps, put préconiser l’unité de la classe ouvrière. Mais, avant même la fin des années 1920, il s’orienta vers la défense exclusive de la "cause noire" sous prétexte que les syndicats officiels (blancs), eux, ne défendaient pas les ouvriers indigènes. Et d’ailleurs, dans le même sens, un des dirigeants les plus influents de l’ICU, Clements Kadalie 8, rejeta catégoriquement la notion de "lutte de classe" et cessa d’intégrer les ouvriers blancs (dont des membres du PC sud-africain) dans son syndicat. Finalement l’ICU périt au début des années 1930 sous les coups de boutoir du pouvoir en place et par ses propres contradictions. Cependant, par la suite, nombre de ses dirigeants purent poursuivre leurs actions syndicales dans d’autres groupements connus pour leur nationalisme syndical africain, tandis que les autres éléments optant pour l’internationalisme furent marginalisés ou se dispersèrent dans la nature.
Les syndicats conçus selon les lois du régime d’apartheid
Comme tous les États, le régime d’apartheid éprouva le besoin de syndicats face à la classe ouvrière mais, dans ce cas, ceux-ci devaient être modelés selon les principes du système ségrégationniste : "(…) La population syndiquée sud-africaine est organisée dans des syndicats cloisonnés entre eux en fonction de la race de leurs membres. Une première distinction est officiellement imposée entre les syndicats reconnus, c'est-à-dire enregistrés au ministère du Travail, et les organisations ouvrières non reconnues par le gouvernement, c'est-à-dire qui ne jouissent pas du statut officiel de syndicat ouvrier. Ce premier clivage est issu, d’une part, de la loi sur le règlement des conflits du travail bantou (…), qui maintenant les Africains hors du statut d’"employé" ne leur reconnaît pas le droit de former des syndicats à part entière ; d’autre part, de la loi sur la réconciliation dans l’industrie (…) qui autorise blancs, métis et indiens à se syndiquer mais interdit cependant la création de nouveaux syndicats mixtes." (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Au premier abord, on peut voir dans la conception du syndicalisme de l’État sud-africain un cynisme certain et un racisme très primaire. Mais, au fond, le but caché était d’éviter à tout prix la prise de conscience chez les ouvriers (de toutes origines) que les luttes de résistance de la classe ouvrière relevaient fondamentalement des affrontements entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est-à-dire, les deux véritables classes antagoniques de la société. Quel est justement le meilleur instrument de cette politique bourgeoise sur le terrain ? C’est évidemment le syndicalisme. De là, toutes ces lois et réglementations sur les syndicats décidées par le pouvoir de l’époque en vue d’une meilleure efficacité de son dispositif anti-prolétarien. Reste que la fraction africaine du prolétariat fut la principale cible du régime oppresseur car plus nombreuse et plus combative, d’où l’acharnement dont le pouvoir bourgeois fit preuve à son égard : "Depuis 1950, les syndicats africains ont vécu sous la menace de la loi sur la répression du communisme, qui donne au gouvernement le pouvoir de déclarer toute organisation, y compris un syndicat africain (mais non les autres syndicats) "illégale" pour le motif qu’elle se livre à des activités propres à favoriser les objectifs du communisme. (…) La définition du communisme inclut, entre autres, les activités visant à provoquer un "changement industriel, social ou économique". Ainsi, une grève, ou toute action organisée par un syndicat pour mettre un terme au système des emplois réservés ou obtenir des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail, peut fort bien être déclarée favorable au "communisme" et servir d’excuse pour mettre le syndicat hors la loi". 9
En fait, pour le pouvoir sud-africain, derrière les luttes ouvrières il y a le spectre de la remise en cause de son système, qu'il identifie à la lutte pour le communisme. Une telle perspective est, on le sait, loin de correspondre aux possibilités de cette période de contre-révolution défavorable aux luttes de la classe ouvrière sur son propre terrain de classe et où la lutte pour le communisme est identifiée à celle pour la mise en place de régimes de type stalinien. Cela n'empêche que, même dans ces conditions, les régimes en place, quels qu'ils soient, sont confrontés à la nécessité de faire obstacle à la tendance spontanée des ouvriers à lutter pour la défense de leurs conditions de vie et de travail. Le système d'apartheid étendu aux syndicats constituant alors le meilleur moyen d'y faire face, tout syndicat ne se pliant pas à ses règles courrait le risque d'être mis hors la loi.
Les principaux syndicats existants jusqu’aux années 1970
Ils sont les suivants :
- les syndicats d’origine européenne : ils ont toujours suivi les orientations du pouvoir colonial, et en particulier ont soutenu les efforts de guerre en 1914-18 comme en 1939/45. De même qu’ils assumèrent, jusqu’à la fin du système d’apartheid et au-delà, leur rôle de "défenseurs" des intérêts exclusifs des ouvriers blancs, y compris lors qu’ils comptaient des ouvriers de couleur dans leurs rangs. Il s’agit, d’une part, de la Confédération Sud-africaine du Travail (South African Confederation of Labor), considérée comme la centrale ouvrière la plus raciste et la plus conservatrice du pays (proche du régime d’apartheid) et, d’autre part, Le Conseil des Syndicats Sud-Africain (Trade Union Confederation of South Africa) dont les liens de complicité avec le Parti Travailliste sont très anciens. La plupart des travailleurs de couleur (des indiens ou des métis comme définis par le régime mais ni des blancs ni des noirs) se trouvent pour leur part tantôt dans les syndicats mixtes (surtout des blancs mais aussi quelques métis) tantôt dans les syndicats de "couleur".
- les syndicats africains : ils sont plus ou moins fortement liés au PC et à l’ANC, se proclamant défenseurs des ouvriers africains ainsi que pour la libération nationale. Il s’agit du Congrès des Syndicats Sud-Africain (SACTU - South African Congress of Trade Unions), la Fédération des Syndicats Libres d’Afrique du Sud (FOFATSA) et le Syndicat National des Mineurs (NUM - National Union of Miners).
En 1974, on comptait 1 673 000 syndiqués organisés d’une part en 85 syndicats exclusivement blancs et d’autre part en 41 syndicats mixtes lesquels regroupaient au total 45 188 membres blancs et 130 350 de couleur. Mais, bien que minoritaires par rapport aux syndiqués de couleur, les syndiqués blancs étaient bien entendu plus avantagés et mieux considérés que ces derniers : "(…) Les syndicats de travailleurs blancs sont concentrés dans des secteurs économiques protégés de longue date par le gouvernement et réservés en priorité à la main-d’œuvre afrikaner, base électorale du parti au pouvoir. En effet, les six syndicats blancs les plus importants numériquement (…), sont implantés dans les services publics et municipaux, l’industrie du fer et de l’acier, l’industrie automobile et la construction mécanique, les chemins de fer et les services portuaires". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Avec ce type de dispositif syndical, on comprend mieux les difficultés de la classe ouvrière blanche à se sentir proche des autres fractions sœurs (noire, métisse et indienne) car les barrières d’acier mises en place par le système de séparation furent visiblement insurmontables pour envisager la moindre action commune entre prolétaires face au même exploiteur.
On recensait (en 1974) 1 015 000 syndiqués organisés, d’une part, en syndicats exclusivement de couleur et, d’autre part, en syndicats mixtes (c'est-à-dire tous les syndiqués à l'exclusion des noirs africains). "En effet, les syndicats blancs sont racialement homogènes, tandis que les syndicats de métis ou d’Asiatiques le sont véritablement devenus sous la contrainte du gouvernement nationaliste" (Brigitte Lachartre, Ibid.).
Dans la même période de référence (1974), les noirs africains représentaient 70 % de la population active et quelque 6 300 000 d’entre eux étaient affiliés à des syndicats non reconnus officiellement, tout en n’ayant pas le droit de s’organiser. Voilà encore une aberration du système d’apartheid avec sa bureaucratie d’un autre âge où l’État et les employeurs pouvaient se permettre d’employer des gens tout en leur refusant le statut d’employé mais en les laissant cependant créer leurs propres syndicats. Quel pouvait être donc le but de la manœuvre du pouvoir dans cette situation ?
Il est clair que la tolérance des organisations syndicales africaines en milieu ouvrier par le pouvoir n’était nullement en contradiction avec son objectif visant à contrôler et à diviser la classe ouvrière sur une base ethnique ou nationaliste. En effet il est plus facile de contrôler une grève encadrée par des organisations syndicales "responsables" (même si pas reconnues) que d’avoir affaire à un mouvement de lutte "sauvage" sans dirigeants identifiés d’avance. D’ailleurs, sur ce plan, le régime sud-africain ne faisait que suivre une "recette" qu’appliquent tous les États face au prolétariat combatif.
La lutte de libération nationale contre la lutte de classe
En réaction à l’instauration officielle de l’apartheid (1948), qui se traduisit par l’interdiction formelle des organisations africaines, le PC et l’ANC mobilisèrent leurs militants, y compris syndicaux, et se lancèrent dans la lutte armée. Dès lors, la terreur fut employée de part et d’autre, la classe ouvrière en subit les conséquences et, en particulier, ne put éviter d’être enrôlée par les uns et les autres. En clair, voilà la classe ouvrière dans son ensemble prise durablement en otage par les nationalistes de tous bords. "Entre 1956 et 1964, les principaux leaders de l’ANC, du PAC 10, du Parti communiste sud-africain avaient été arrêtés. Les interminables procès auxquels ils furent soumis se soldèrent par la détention à vie ou le bannissement renouvelé des principaux chefs historiques (N. Mandela, W. Sisulu, R. Fischer…) tandis que des peines de prison très lourdes frappaient l’ensemble des militants. Ceux qui purent échapper à la répression, se refugièrent au Lesotho, au Ghana, en Zambie, en Tanzanie, au Botswana. (…) Par ailleurs, des camps militaires regroupent dans les pays frontaliers de l’Afrique du Sud les réfugiés ou "combattants de la liberté" qui suivent un entraînement militaire et se tiennent prêts à intervenir. A l’intérieur du pays, la décennie 1960-1970 est celle du silence : la répression a fait taire l’opposition et seules les protestations de quelques organisations confessionnelles et étudiantes se font entendre. Les grèves se comptent sur les doigts de la main et pendant que les travailleurs noirs courbent l’échine, les chefs noirs fantoches, désignés par le gouvernement nationaliste, collaborent à la politique de divisions du pays". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
À travers ce propos il apparait clairement que le prolétariat sud-africain fut enchaîné, coincé entre la répression du pouvoir en place et l’impasse de la lutte armée lancée par les nationalistes africains. Cela justifie amplement la passivité dont la classe ouvrière fit preuve durant cette longue période allant globalement des années 1940 jusqu'à1970 (mis à part l’épisode des luttes éphémères durant la Seconde boucherie mondiale). Mais surtout, cette situation fut l’occasion pour les partis et les syndicats d’occuper intégralement le terrain idéologique en vue d’empoisonner la conscience de classe en s’efforçant de transformer systématiquement toute lutte de la classe ouvrière en une lutte de "libération" chez les uns et en défense des intérêts des "ouvriers blancs" chez les autres. Evidemment tout cela ne pouvait que satisfaire les objectifs de l’ennemi de la classe ouvrière à savoir le capital national sud-africain.
Reprise véritable de la lutte de classe: vagues de grève entre 1972 et 1975
Après une longue période d’apathie où elle fut silencieuse et prise en tenaille par le pouvoir d’apartheid et les tenants de la lutte de libération, la classe ouvrière finit fort heureusement par reprendre ses luttes (cf. Brigitte Lachartre) en Namibie (colonie d’alors de l’Afrique du Sud) en s’inscrivant ainsi dans le processus des vagues de lutte au niveau mondial marquant la fin des années 1960 et les années 1970.
L’exemple namibien
Comme en Afrique du Sud, la classe ouvrière en Namibie se trouva, d’un côté, sous la coupe sanglante du régime policier sud-africain, et de l’autre côté, bien encadrée par les partisans de la lutte de libération nationale (SWAPO - South-West African People's Organisation). Mais, contrairement à la classe ouvrière en Afrique du Sud bénéficiant d’une longue expérience de lutte, ce fut celle de Namibie qui n’en avait pas (à notre connaissance) qui ouvrit le "bal" des luttes des années 1970 : "Onze ans s’étaient écoulés depuis les derniers mouvements de masse africains. Le pouvoir blanc avait mis ce répit à profit pour consolider son plan de développement séparé. Sur le front social, le calme et la stabilité pouvaient être proclamés bien haut à travers le monde. Deux séries d’événements vinrent cependant troubler la "paix blanche" de l’Afrique du Sud et réveiller les inquiétudes : la première se produisit à la fin de 1971 en Namibie, territoire illégalement occupé par l’Afrique du Sud et qui est, depuis 1965, agité par la résistance de l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (S.W.A.P.O.) au gouvernement central de Pretoria. La seconde se déroula dans le courant de 1972 en Afrique du Sud même, sous forme de grèves spectaculaires lancées par les conducteurs de bus de Johannesburg. On attribue généralement à ces deux vagues de troubles un rôle détonateur par rapport aux événements qui se déclenchèrent dès les premiers jours de janvier 1973". (Brigitte Lachartre, ibid.)
La première grève démarra donc en Namibie, à Windhoek (la capitale) et dans sa banlieue proche, à Katutura, où 6 000 travailleurs décidèrent de partir en lutte contre l’oppression politique et économique exercée sur eux par le pouvoir sud-africain. Et 12 000 autres travailleurs répartis sur une douzaine de centres industriels ne tardèrent pas à suivre le même mot d’ordre de grève de leurs camarades de Katutura. Voilà donc 18 000 grévistes croisant les bras plusieurs jours après le début du mouvement, soit un tiers de la population active estimée alors à 50 000. Et, malgré les menaces de répression de l’État et le violent chantage du patronat, la combattivité ouvrière resta intacte : "Deux semaines après le début de la grève presque tous les grévistes furent renvoyés dans les réserves. Les employeurs leur firent savoir qu’ils réembaucheraient les Ovambos (nom ethnique des grévistes) disciplinés, mais chercheraient leur main-d’œuvre ailleurs si ceux-ci n’acceptaient pas les conditions posées. Devant la fermeté des travailleurs, le patronat lança de larges campagnes de recrutement dans les autres réserves du pays ainsi qu’au Lesotho et en République d’Afrique du Sud : il ne parvint pas à recruter plus de 1 000 nouveaux travailleurs et fut contraint de s’adresser aux ouvriers ovambos". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
En clair, devant la pugnacité des ouvriers, le patronat se mit à la manœuvre en cherchant à diviser les grévistes, mais il fut contraint de céder : "Les contrats de travail contre lesquels s’était organisée la grève, firent l’objet de quelques modifications ; l’agence de recrutement (la SWANLA - South-West African Native Labour Association) fut démantelée et ses fonctions dévolues aux autorités bantoues avec l’obligation de créer des bureaux de recrutement dans chaque Bantoustan ; les termes de "maîtres" et de "serviteurs" furent remplacés dans les contrats par ceux "d’employeurs" et "d’employés". (B. Lachartre, Ibid.)
Evidemment, vu tout ce qui restait dans l’arsenal du système d’apartheid appliqué au monde du travail, on peut dire que la victoire des grévistes ne fut pas décisive. Soit, mais une victoire hautement symbolique et prometteuse eut égard au contexte dans lequel se déroula le mouvement de grève : "L’ampleur des grèves fut telle qu’elle rendit impossible toute action punitive de style traditionnel de la part du gouvernement". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cela signifie que le rapport de forces commençait à évoluer en faveur de la classe ouvrière qui sut montrer avec détermination sa combativité et son courage face au pouvoir répressif. D’ailleurs l’expérience exemplaire du mouvement de lutte des ouvriers namibiens ne manqua pas de se répandre en Afrique du Sud même en s’y exprimant plus massivement encore.
Grèves et émeutes en Afrique du Sud entre 1972 et 1975
Après la Namibie, la classe ouvrière reprit sa lutte en Afrique du Sud courant 1972 où 300 conducteurs de bus à Johannesburg se mirent en grève, 350 à Pretoria, 2 000 dockers à Durban et 2 000 au Cap. Toutes ces grèves portèrent sur des revendications de salaire ou d’amélioration des conditions de travail. Et leur importance pouvait se mesurer à l’inquiétude de la bourgeoisie qui ne tarda pas à employer des moyens énormes pour venir à bout des mouvements : "La réaction du pouvoir et du patronat fut brutale et expéditive. Les 300 grévistes de Johannesburg furent arrêtés. Parmi ceux de Durban, 15 furent licenciés. Dans d’autres secteurs, à la Ferro Plastic Rubber Industries, ils furent pénalisés de 100 rands ou de 50 jours de prison pour arrêt de travail illégal. A Colgate-Palmolive (Boksburg) tout le personnel africain fut licencié. Dans une mine de diamants, les mineurs en grève furent condamnés à 80 jours de prison, leurs contrats annulés et ils furent renvoyés dans leurs réserves". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cette réaction très dure exprime très clairement l’inquiétude palpable de la classe dominante. Cependant la brutalité dont la bourgeoisie sud-africaine fit preuve s’accompagna d’une dose de réalisme car des augmentations de salaire furent accordées à certains secteurs grévistes en vue d’y favoriser la reprise du travail. Et comme le dit Brigitte Lachartre : "Mi-victoire, mi- défaite, les grèves de 1972 eurent principalement pour effet de surprendre les pouvoirs publics, qui plantèrent brutalement le décor, en refusant de négocier avec les travailleurs noirs, en faisant intervenir la police et en licenciant les grévistes. Quelques indications chiffrées permettent de mesurer l’ampleur des événements qui secouèrent le pays au cours des années suivantes : de sources différentes, elles ne concordent pas exactement et sont plutôt sous-estimées. Selon le ministère du Travail, il y eut 246 grèves en 1973, qui touchèrent 75 843 travailleurs noirs. De son côté, le ministère de la Police déclare avoir fait intervenir les forces de police sur le lieu de 261 grèves pour la même année. Pour leur part, les militants syndicalistes de Durban estiment à 100 000 le nombre des travailleurs noirs qui firent grève dans le Natal au cours des trois premiers mois de 1973. Pour 1974, le chiffre de 374 grèves est donné pour le seul secteur industriel et celui des grévistes aurait été de 57 656. La seule province du Natal connut officiellement, de juin 1972 à juin 1974, 222 arrêts de travail ayant affecté 78 216 travailleurs. À la mi-juin 1974, l’on avait dénombré 39 grèves dans la métallurgie, 30 dans le textile, 22 dans le vêtement, 18 dans la construction, 15 dans le commerce et la distribution. (…) Les grèves sauvages se multiplient. Durban compte 30 000 grévistes à la mi-février 73, et le mouvement se répand à travers tout le pays".
Comme on peut le voir, l’Afrique du Sud fut pleinement entraînée dans les vagues successives de lutte qui intervinrent à partir de la fin des années 1960 et qui signaient ainsi l’ouverture d’un cours au développement des affrontements de classe au niveau mondial. Nombre de ces mouvements de grève durent se heurter à la dure répression du pouvoir et des milices patronales et se soldèrent par des centaines de morts et de blessés dans les rangs ouvriers. C’est dire la hargne et l’acharnement des forces de l’ordre du capital sur les grévistes ne faisant que réclamer des dignes conditions d’existence. De ce fait, il faut souligner ici le courage et la combativité de la classe ouvrière sud-africaine (en particulier noire) qui partit généralement en lutte en étant solidaire et en s’appuyant sur sa propre conscience, comme l’illustre l’exemple suivant :
"La première manifestation de colère eut lieu dans une usine de matériel de construction (briques et tuiles) : la Coronation Brick and Tile Co, située dans la banlieue industrielle de Durban. 2 000 travailleurs, soit tout le personnel africain de l’entreprise, se mirent en grève le 9 janvier 1973 au matin. Ils demandent qu’on double leur salaire (qui s’élevait alors à 9 rands par semaine) puis qu’on le triple. Une augmentation avait été promise l’année précédente mais n’était pas encore intervenue."
"Les ouvriers de la première usine racontent comment débuta la grève : Ils furent réveillés par un groupe de camarades, vers trois heures du matin, qui leur dit de se réunir sur le terrain de football au lieu d’aller pointer au travail. Une sorte de délégation partit alors en direction des entrepôts des environs d’Avoca afin de demander aux autres ouvriers de les rejoindre au stade. C’est dans la bonne humeur que se déroula cette première phase de la grève et le mot d’ordre fut accueilli très favorablement. Personne ne passa outre. La main-d’œuvre d’Avoca se rendit au stade à travers la ville en deux colonnes et sans se soucier de la circulation très dense dans les rues de la ville à cette heure-là, ni des interdictions qu’elles étaient en train d’enfreindre. En franchissant les grilles du stade, tous chantaient : "Filumuntu ufesadikiza", qui signifie "l’homme est mort, mais son esprit est toujours vivant". (The Durban Strikes, cité par Brigitte Lachartre, Ibid.)
Nous assistons ici à une forme de lutte très différente dont la classe ouvrière fit preuve en se prenant ainsi en charge sans consulter personne, c'est-à-dire ni les syndicats ni d’autres "médiateurs sociaux", ce qui ne put que dérouter les employeurs. En effet, comme attendu, le PDG de l’entreprise déclara ne pas vouloir discuter avec les grévistes dans un stade de football mais qu’il serait prêt à négocier seulement avec une "délégation". Mais puisqu’un comité d’entreprise existait déjà, les ouvriers refusèrent tout net la formation d’une délégation en scandant "nos demandes sont claires, nous ne voulons pas de comité, nous voulons 30 rands par semaine". Dès lors le gouvernement sud-africain se mit à la manœuvre en envoyant les autorités zouloues (sinistres fantoches) "dialoguer" avec les grévistes alors que la police se tenait prête à tirer. Au final, les grévistes durent reprendre le travail sous la pression multiple et combinée des diverses forces du pouvoir en acceptant ainsi une augmentation de 2,077 rands après avoir refusé précédemment une de 1,50. Les ouvriers reprirent le travail avec un fort mécontentement car insatisfaits de la faible augmentation de salaire obtenue. Cependant, la presse ayant fait largement écho du mouvement, d’autres secteurs prirent immédiatement le relais en se lançant dans la lutte. "Deux jours plus tard, 150 ouvriers d’une petite entreprise de conditionnement de thé (T.W. Beckett) cessèrent le travail en réclamant une augmentation de salaire de 3 rands par semaine. La réaction de la direction fut d’appeler la police et de licencier ceux qui refusaient de reprendre le travail. Il n’y eut pas de négociations. L’un des employés déclara : "On nous donna 10 minutes pour nous décider". Une centaine d’ouvriers refusèrent de reprendre le travail. Quelques jours plus tard, la direction fit savoir qu’elle réembaucherait les ouvriers licenciés, mais au salaire précédent. Presque personne ne reprit son poste. Ce ne fut que trois semaines après le début de la grève que l’entreprise annonça qu’une augmentation de 3 rands était accordée à tous. La quasi-totalité des ouvriers fut réembauchés. (…) En même temps que cette grève se déroulait chez Beckett, les ouvriers africains de plusieurs entreprises d’entretien et de réfection de bateaux (J.H. Skitt and Co. Et James Brown and Hamer) cessèrent également le travail. (…) La grève dura plusieurs jours et une augmentation de 2 à 3 rands par semaine fut finalement accordée". (Propos tirés de The Durban Strike, cité par Brigitte Lachartre, Ibid.)
Un phénomène nouveau se produisait : une série de grèves qui se terminent par des vraies victoires car, devant le rapport de force imposé par les grévistes, le patronat (en compagnie de l’État) était contraint de céder aux revendications salariales des ouvriers. En ce sens, le plus illustratif de cette situation fut le cas de l’entreprise Beckett qui accorda une augmentation de 3 rands par semaine, c’est à dire la même somme que réclamaient ses employés, tout en étant contrainte de reprendre la quasi-totalité des ouvriers qu’elle venait de licencier. Un autre fait très remarquable fut la solidarité consciente dans la lutte entre ouvriers d’ethnies différentes, en l’occurrence Africains et Indiens. Ce magnifique geste illustre la capacité de la classe ouvrière à s’unir dans la lutte en dépit des multiples divisions institutionnalisées par la bourgeoisie sud-africaine et sciemment cautionnées et appliquées par les syndicats et les partis nationalistes. Par conséquent, au bout du compte, on peut parler d’une glorieuse victoire ouvrière sur les forces du capital. En effet, ce fut un succès apprécié comme tel par les ouvriers eux-mêmes, ce qui par ailleurs encouragea d’autres secteurs à se lancer dans la grève, par exemple le service public : "Le 5 février, fut engagée l’action la plus spectaculaire, mais aussi la plus grosse de tensions : 3 000 employés de la municipalité de Durban se mirent en grève dans les secteurs de la voirie, des égouts, de l’électricité, des abattoirs. Le salaire hebdomadaire de ce personnel s’élevait alors à 13 rands ; les revendications portaient sur le doublement de ce salaire. La contestation fit tache d’huile et bientôt ce furent 16 000 ouvriers qui refusèrent l’augmentation de 2 rands faite par le conseil municipal. A noter qu’Africains et Indiens agirent le plus souvent en étroite solidarité, bien que la municipalité ait renvoyé chez eux un grand nombre d’employés indiens, afin, fut-il déclaré qu’ils ne soient pas molestés et forcés à la grève par les Africains ! S’il est vrai qu’Africains et Indiens ont des échelles de salaires différentes, les écarts de salaires entre eux ne sont pas très importants et varient le plus souvent entre très bas et bas. D’autre part, si les Indiens ont le droit de grève – ce que les Africains n’ont pas - ce droit ne s’applique pas qu’à certains secteurs d’activités et qu’en de certaines circonstances. Or, dans les services publics, considérés comme "essentiels", la grève est interdite à tous de la même manière". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cette grève, qui voit une jonction dans la lutte entre les secteurs privé et public, constitue aussi un élément majeur exprimant très clairement le haut niveau atteint par la combativité et la conscience de classe du prolétariat sud-africain en ce début des années 1970. Ce d’autant plus que ces mouvements se déroulèrent comme toujours dans le même contexte de répression sanglante comme réponse automatique du régime ségrégationniste, notamment face à ceux considérés comme "illégaux". Et pourtant, en dépit de tout cela, la combativité restait intacte et même se développait : "La situation demeurait explosive : les travailleurs municipaux avaient refusé une augmentation de salaire de 15 % ; le nombre d’usines touchées par la grève augmentait encore et la plupart des ouvriers du textile n’avaient pas encore repris le travail. S’adressant aux grévistes de la municipalité, un des fonctionnaires les menaça de la force dont il était en droit d’user, puisque leur grève était illégale. (…) La foule se mit alors à lui lancer des quolibets et à lui enjoindre de descendre de son estrade. Tentant d’expliquer que le conseil municipal avait déjà accordé une augmentation de 15 %, il fut de nouveau interrompu par les ouvriers qui lui crièrent qu’ils voulaient 10 rands de plus. (…) L’atmosphère de ces meetings semble avoir été le plus souvent euphorique et les commentaires de la foule des grévistes plus cocasses que furieux. Les travailleurs donnaient l’impression de se soulager d’un poids qui les oppressait depuis longtemps. (…) Quant aux revendications formulées lors de ces manifestations, elles révèlent également cette excitation euphorique, car elles portaient sur des augmentations de salaires bien plus élevées que ce qui pouvait réellement être obtenu, allant parfois de 50 à 100 %".
On peut ici parler d’une classe ouvrière qui retrouve grandement sa conscience de classe et ne se contente plus d’augmentations de salaire mais devient plus exigeante par rapport au respect de sa dignité. Mais surtout, elle fait preuve de confiance en elle-même comme le montre l'épisode rapporté ci-dessus où les grèvistes se moquent ouvertement du représentant des forces de l’ordre venu les menacer. Bref, comme le dit l’auteur de cette citation, les ouvriers étaient bien euphoriques et loin d’être ébranlés par la répression policière de l’État. Au contraire, cette situation où le prolétariat sud-africain démontre sa confiance en lui-même, sa conscience de classe finit par semer désordre et panique au sein de la classe dominante.
La bourgeoisie réagit de façon désordonnée face aux grèves ouvrières
Evidemment, face à une vague de luttes d’une telle vigueur, la classe dominante ne put rester bras croisés. Mais visiblement les dirigeants du pays furent surpris par l’ampleur de la combativité et de la détermination des grévistes, d’où la dispersion et les incohérences des réactions des acteurs de la bourgeoisie.
En témoignent des déclarations de ceux-ci :
Le président de la république : "Des organisations subversives persistent dans leur volonté d’inciter des secteurs de la population à l’agitation. Leurs effets sont résolument contrés par la vigilance constante de la police sud-africaine. Les grèves sporadiques et les campagnes de protestation qui, à en croire certaines publications - organes du Parti communiste - sont organisées ou moralement soutenues par elles, n’ont abouti à aucun résultat significatif".
Le ministre du Travail : "Les grèves du Natal montrent, dans leur déroulement, qu’il ne s’agit pas d’un problème de salaires. (…) Tout indique qu’une action a été organisée et que les grévistes sont utilisés pour obtenir autre chose qu’une simple augmentation de salaire. L’action des ouvriers et leur mauvaise volonté à négocier montrent à l’évidence que l’agitation pour les droits syndicaux n’est pas la solution et que ce n’est qu’un écran de fumée qui cache bien autre chose…".
Un représentant du patronat : "Je ne sais pas qui le premier a eu l’idée de remplacer les grévistes par des détenus, mais cette solution mérite qu’on l’étudie. L’autre solution serait d’employer des Blancs, mais ils utilisent des pistolets à peinture, ce qui n’est guère praticable avec le vent qu’il fait. Quant aux prisonniers, on les utilise bien pour nettoyer le port et ses alentours…"
Un observateur à propos de l’attitude des syndicats face aux grèves : "Un autre aspect important de la situation sociale dans le pays fut particulièrement mis en lumière au cours de ces grèves : à savoir la perte d’influence considérable des syndicats officiels. Bien que des membres de tels syndicats se soient trouvés impliqués dans certaines de ces grèves, la plupart des organisations syndicales étaient conscientes que l’initiative était entièrement du côté des travailleurs africains non syndiqués et qu’il ne servait à rien de vouloir intervenir".
Cette série de réactions montre à l’évidence un sentiment de panique à tous les étages de l’État sud-africain et le phénomène est d’autant plus préoccupant pour la bourgeoisie que ces mouvements de grève furent déclenchés et souvent gérés par les ouvriers eux-mêmes, c'est-à-dire sans initiatives syndicales. Cette tentative d’autonomisation des luttes ouvrières explique très largement les divisions qui se manifestèrent ouvertement chez les tenants du pouvoir par rapport aux moyens à mettre en œuvre pour contrecarrer la dynamique de la classe ouvrière, comme l’illustre la citation suivante : "Les secteurs anglophones et internationaux du capital n’ont pas le même attachement aux doctrines racistes et conservatrices que les administrateurs de l’État. Pour eux, les concepts de productivité et de rentabilité priment – du moins au niveau du discours - sur l’idéologie officielle et les encombrantes législations sur la barrière de couleur (…). Les portes-parole les plus avancés du patronat dont Harry Oppenheimer - président de l’Anglo-Américan Corporation - est le chef de file, prône ainsi l’intégration progressive de la main-d’œuvre africaine dans les emplois qualifiés mieux rémunérés, l’amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers et mineurs noirs, ainsi que l’introduction, contrôlée et par étape, du syndicalisme africain". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Et, tirant les leçons des luttes ouvrières, ce grand patron (Oppenheimer) d’une des plus grandes sociétés diamantaires fut à l’initiative (avec d’autres) de la légalisation des syndicats africains afin de leur donner les moyens de mieux encadrer la classe ouvrière. Dans le même sens voici l’argumentaire d’un porte-parole du "Parti progressiste" allié proche du grand patron cité : "Les syndicats jouent un rôle important en ce qu’ils préviennent les désordres politiques, (…) qui, l’histoire le démontre suffisamment, succèdent la plupart du temps aux revendications d’ordre économique. Si l’on peut éviter ces désordres par le biais du syndicalisme et celui de négociations sur les salaires et les conditions de travail, l’on diminue d’autant les autres risques. Et ce n’est pas le syndicalisme qui risque d’aggraver la situation". Contrairement aux tenants de la "ligne dure" de l’apartheid, ce porte-parole de la bourgeoisie (qu’on peut qualifier d’"éclairé") voit bien l’importance du rôle que jouent les syndicats en faveur de la classe dominante en tant que forces d’encadrement de la classe ouvrière et de prévention des "risques" et des "désordres politiques".
La combativité ouvrière contraint la bourgeoisie à changer son dispositif législatif
Comme il fallait s’y attendre, en tirant les enseignements des vagues de lutte qui secouèrent le pays durant les premières années de 1970, la bourgeoisie sud-africaine ("éclairée") se devait de réagir en prenant une série de mesures en vue de faire face à la combativité montante d’une classe ouvrière prenant de plus en plus conscience de sa force et confiance en elle. "Les grèves de 1973 éclatèrent alors que les députés ouvraient la session parlementaire au Cap. Comme nous le rapportent les syndicalistes de Durban, des représentants des organisations d’employeurs et de Chambres de commerce se rendirent en délégation pour rencontrer le ministre du Travail afin de mettre en place les premiers pare-feu à l’agitation ouvrière. A cette occasion, les consultations État- patronat furent nombreuses et suivies ; les erreurs du passé ne furent pas répétées". (Brigitte Lachartre. Ibid)
En effet à l’issue d’une série de consultations entre l’État, les parlementaires et le patronat il fut décidé "d'assouplir" nombre de dispositifs répressifs en vue de prévenir les "grèves sauvages" en donnant ainsi plus de place aux syndicats africains afin qu'ils puissent assumer le "travail de contrôle" sur les ouvriers. Ce faisant la bourgeoisie sud-africaine devint plus "raisonnable" en tenant compte de l’évolution du rapport de forces imposée par la classe ouvrière à travers ses luttes massives.
Pour conclure provisoirement sur ces grandes vagues de grève, nous exposons les points de vue de Brigitte Lachartre (Ibid.) sur ces mouvements et celui d’un groupe de chercheurs de Durban, dont nous partageons pleinement l'essentiel concernant le bilan politique à tirer : "Le développement de la solidarité des travailleurs noirs au cours de l’action et la prise de conscience de leur unité de classe ont été soulignés par de nombreux observateurs. Cet acquis, non quantifiable, des luttes est considéré par eux comme le plus positif pour la poursuite de l’organisation du mouvement ouvrier noir."
Et selon l’analyse du groupe de chercheurs 11 cité par Brigitte Lachartre :
"Notons, par ailleurs, que la spontanéité des grèves fut une des raisons majeures de leur succès, comparée notamment avec les échecs relatifs des actions de masse menées par les Africains dans les années 50, dans une période d’activité politique pourtant intense. Il suffisait alors que les grèves soient visiblement organisées (…) pour que la police ait tôt fait de se saisir des responsables. A l’époque, les grèves telles qu’elles étaient organisées, constituaient une menace beaucoup plus grande pour le pouvoir blanc ; leurs exigences n’étaient pas négligeables et, du point de vue des Blancs, le recours à la violence apparaissait comme la seule issue possible.
Mais ce spontanéisme des grèves n’empêche pas que leurs revendications aient dépassé le cadre purement économique. Ces grèves étaient également politiques : le fait que les travailleurs demandaient le doublement de leur salaire n’est pas le signe de la naïveté ou de la stupidité des Africains. Il indique plutôt l’expression du rejet de leur situation et leur désir d’une société totalement différente. Les ouvriers retournèrent au travail avec quelques acquis modestes, mais ils ne sont pas plus satisfaits maintenant qu’ils l’étaient avant les grèves…"
Nous partageons plus particulièrement le dernier paragraphe de cette citation qui donne une conclusion cohérente à l’analyse globale du déroulement des luttes. En effet, comme le montrent ses diverses expériences, la classe ouvrière peut passer allègrement de la lutte économique à la lutte politique et vice versa. Mais retenons surtout l’idée suivant laquelle les grèves furent aussi très politiques. En effet, derrière les revendications économiques, la conscience politique de la classe ouvrière sud-africaine se développait et cela fut une source d’inquiétude pour la bourgeoisie sud-africaine. En d’autres termes, le caractère politique des vagues de grève des années 1972-1975 finit par provoquer des fissures sérieuses dans le système d’apartheid en obligeant les appareils politiques et industriels du capital à revoir leur dispositif d’encadrement de la classe ouvrière. Cela donna lieu à un vaste débat au sommet de l’État sud-africain sur la question de l’assouplissement des dispositifs répressifs et plus généralement sur la démocratisation de la vie sociale visant notamment la légalisation des syndicats noirs. Et de fait, dès 1973 (l’année de puissants mouvements de grève), dix-sept nouveaux syndicats noirs furent créés ou légalisés venant s’ajouter aux treize qui existaient auparavant. Autrement dit, ce fut ce débat déclenché par les luttes ouvrières qui aboutit au processus de démantèlement progressif de l’apartheid mais toujours sous la pression des luttes ouvrières. En clair en créant ou renforçant les forces syndicales, la bourgeoisie voulut en faire des "pompiers sociaux" aptes à éteindre le feu des luttes ouvrières. Par exemple, tout en conservant le mode de canalisation classique des mouvements sociaux (le nationalisme, le racisme et le corporatisme), la bourgeoisie y ajouta un nouveau volet de type "démocratique" en accordant ou élargissant les "droits politiques" (droits associatifs sous contrôle) aux populations noires. Ce fut ce même processus qui permit l’arrivée de l’ANC au pouvoir. Pour autant, comme on le verra par la suite, le pouvoir sud-africain ne pourra jamais abandonner ses autres moyens répressifs les plus traditionnels contre la classe ouvrière, à savoir ses forces armées policières et militaires. Ceci sera illustré dans l’article suivant notamment à travers le grand mouvement de lutte de Soweto en 1976.
Lassou, juin 2015
1 Editions Syros, Paris 1977. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la simple lecture de l’ouvrage ne nous a pas permis de connaître réellement son auteur, ses influences politiques même si, au moment de la sortie de son livre, elle semble proche du milieu intellectuel de la gauche (voire l’extrême gauche) française, comme le suppose le propos suivant de son introduction : "(…) Qu’en dire à l’individu inquiet et conscient de la partie qui se joue en Afrique australe, au militant politique, syndicaliste, étudiant ? Lui parler des luttes qui s’y mènent, c’est, sans doute, ce qu’il attend. C’est aussi un moyen d’autant plus sûr d’attirer son attention qu’il lui sera démontré à quel point ces luttes sont proches de lui et combien leur issue dépend de la société à laquelle il appartient. C’est le choix qui a été fait ici : parler des luttes menées par le prolétariat noir au cours des dernières années. Non pas qu’il ne s’en produise pas d’autres à d’autres niveaux, et il en coûte de les passer sous silence (celles des intellectuelles de toutes races, des chrétiens progressistes…)."
Il se trouve que parmi les auteurs (chercheurs ou autres) que nous avons pu rencontrer dans nos recherches sur l’histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud, Brigitte Lachartre est la seule qui propose de se centrer sur la question des luttes ouvrières dans cette région en décrivant leur déroulement avec conviction et analyses détaillées. Au bout du compte, c’est pour cette raison que nous nous appuyons sur elle comme principale source documentaire. Bien entendu, le cas échéant, nous nous réservons le droit d’exprimer nos désaccords avec tel ou tel élément de ses points de vue.
2. Lois de 1924, promulguées par les Travaillistes et les Afrikaners alors au pouvoir.
3. Sur les difficultés "spécifiques" de la classe ouvrière blanche voir Revue internationale n° 154, chapitre "L’apartheid contre la lutte de classe", ou encore dans cet article, chapitre "La lutte de libération nationale contre la lutte de classe".
4. Voir Revue internationale n° 154.
5. Cercle Léon Trotski, Exposé du 29/01/2010, site Internet www.lutte-ouvrir [547]ère.org
6. Lucien van der Walt. Site Internet https://www.zabalaza.net [548]
7. Lucien van der Walt, Ibid.
9. Hepple A. Les travailleurs livrés à l’apartheid, cité par B. Lachartre, Ibid
10. Pan-Africanist Congress, une scission de l’ANC.
11. Auteurs de Durban Strikes 1973.
Géographique:
- Afrique du Sud [550]
Rubrique:
Revue Internationale 2016
- 1417 lectures
Revue Internationale n°156
- 1421 lectures
40 ans après la fondation du CCI, quel bilan et quelles perspectives pour notre activité ?
- 2657 lectures
"Le marxisme est une vision révolutionnaire du monde qui doit appeler à lutter sans cesse pour acquérir des connaissances nouvelles, qui n’abhorre rien tant que les formes figées et définitives et qui éprouve sa force vivante dans le cliquetis d’armes de l’autocritique et sous les coups de tonnerre de l’histoire." (Rosa Luxemburg, Critique des critiques)
Le CCI a tenu au printemps dernier son 21ème congrès. Cet événement coïncidait avec les 40 ans d'existence de notre organisation. De ce fait, nous avons pris la décision de donner à ce congrès un caractère exceptionnel avec comme objectif central de jeter les bases d'un bilan critique de nos analyses et de notre activité au cours de ces 4 décennies. Les travaux du congrès se sont donc attachés à identifier de la façon la plus lucide possible nos forces et nos faiblesses, ce qui était valable dans nos analyses et les erreurs que nous avons commises afin de nous armer pour les surmonter.
Ce bilan critique s’inscrit pleinement dans la continuité de la démarche qu’a toujours adoptée le marxisme tout au long de l’histoire du mouvement ouvrier. Ainsi, Marx et Engels, fidèles à une méthode à la fois historique et autocritique, ont été capables de reconnaître que certaines parties du Manifeste Communiste s’étaient avéré erronées ou étaient dépassées par l’expérience historique. C’est la capacité à faire la critique de leurs erreurs qui a toujours permis aux marxistes de réaliser des avancées théoriques et de continuer à apporter leur contribution à la perspective révolutionnaire du prolétariat. De la même façon que Marx a su tirer les leçons de l’expérience de la Commune de Paris et de sa défaite, la Gauche communiste d'Italie a été capable de reconnaitre la défaite profonde du prolétariat mondial à la fin des années 1920, de faire un "bilan" 1 de la vague révolutionnaire de 1917-23 et des positions programmatiques de la Troisième Internationale. C’est ce bilan critique qui lui a permis, malgré ses erreurs, d'accomplir des avancées théoriques inestimables tant sur le plan de l’analyse de la période de contre-révolution que sur le plan organisationnel en comprenant le rôle et les tâches d’une fraction au sein d'un parti prolétarien dégénérescent et comme pont vers un futur parti quand le précédent a été gagné par la bourgeoisie.
Ce Congrès exceptionnel du CCI s’est tenu dans le contexte de notre dernière crise interne qui avait donné lieu à la tenue d’une conférence internationale extraordinaire il y a un an 2. C’est avec le plus grand sérieux que toutes les délégations ont préparé ce Congrès et se sont inscrites dans les débats avec une compréhension claire des enjeux et de la nécessité, pour toutes les générations de militants, d'engager ce bilan critique des 40 ans d’existence du CCI. Pour les militants (et notamment les plus jeunes) qui n’étaient pas encore membres du CCI lors de sa fondation, ce Congrès, et ses textes préparatoires, leur ont permis d’apprendre de l’expérience du CCI tout en participant activement aux travaux du Congrès en prenant position dans les débats.
Le bilan critique de notre analyse de la situation internationale
La fondation du CCI était une manifestation de la fin de la contre-révolution et de la reprise historique de la lutte de classe qui s’est illustrée notamment par le mouvement de Mai 68 en France. Le CCI est la seule organisation de la Gauche communiste à avoir analysé cet événement dans le cadre du resurgissement de la crise ouverte du capitalisme qui débute en 1967. Avec la fin des "30 glorieuses", et avec la course aux armements pendant la guerre froide, était de nouveau posée l’alternative "guerre mondiale ou développement des combats prolétariens". Mai 68 et la vague de luttes ouvrières qui s’est développée à l’échelle internationale a marqué l’ouverture d’un nouveau cours historique : après 40 ans de contre-révolution, le prolétariat relevait la tête et n’était pas prêt à se laisser embrigader dans une troisième guerre mondiale, derrière la défense des drapeaux nationaux.
Le Congrès a souligné que le surgissement et le développement d’une nouvelle organisation internationale et internationaliste avait confirmé la validité de notre cadre d’analyse sur ce nouveau cours historique. Armé de ce concept (ainsi que de l’analyse que le capitalisme était entré dans sa période historique de décadence avec l’éclatement de la première guerre mondiale), le CCI a continué tout au long de son existence à analyser les trois volets de la situation internationale – l’évolution de la crise économique, de la lutte de classe et des conflits impérialistes – afin de ne pas tomber dans l’empirisme et de dégager des orientations pour son activité. Néanmoins, le Congrès s’est appliqué à faire l’examen le plus lucide possible des erreurs que nous avons commises dans certaines de nos analyses afin de nous permettre d'identifier l’origine de ces erreurs et donc d'améliorer notre cadre d'analyse.
Sur la base du rapport présenté sur l’évolution de la lutte de classe depuis 1968, le congrès a souligné qu'une des principales faiblesses du CCI, depuis ses origines, a été ce que nous avons appelé l’immédiatisme, c’est-à-dire une démarche politique marquée par l’impatience et qui se focalise sur les événements immédiats au détriment d'une vision historique ample de la perspective dans laquelle s'inscrivent ces événements. Bien que nous ayons identifié, à juste raison, que la reprise de la lutte de classe à la fin des années 1960 avait marqué l’ouverture d’un nouveau cours historique, la caractérisation de ce cours historique comme "cours vers la révolution" était erronée et nous avons dû la corriger en utilisant l’expression "cours aux affrontements de classe». Cette formulation plus appropriée n'a pas cependant, du fait d'une certaine imprécision, fermé la porte à une vision schématique, linéaire de la dynamique de la lutte de classe avec une certaine hésitation en notre sein à reconnaitre les difficultés, les défaites et les périodes de recul du prolétariat.
L’incapacité de la bourgeoisie à embrigader la classe ouvrière des pays centraux dans une troisième guerre mondiale ne signifiait pas que les vagues internationales de luttes qui se sont succédées jusqu’en 1989 allaient se poursuivre de façon mécanique et inéluctable jusqu’à l’ouverture d’une période révolutionnaire. Le congrès a mis en évidence que le CCI a sous-estimé le poids de la rupture de la continuité historique avec le mouvement ouvrier du passé et l’impact idéologique, au sein de la classe ouvrière, de 40 ans de contre-révolution, impact qui se manifeste notamment pas une méfiance, voire un rejet, des organisations communistes.
Le Congrès a souligné également une autre faiblesse du CCI dans ses analyses du rapport de forces entre les classes : la tendance à voir le prolétariat constamment "à l’offensive" dans chaque mouvement de lutte alors que ce dernier n’a mené jusqu’à présent que des luttes de défense de ses intérêts économiques immédiats (aussi importantes et significatives soient-elles) sans parvenir à leur donner une dimension politique.
Les travaux du congrès nous ont permis de constater que ces difficultés d’analyse de l’évolution de la lutte de classe ont eu pour soubassement une vison erronée du fonctionnement du mode de production capitaliste, avec une tendance à perdre de vue que le capital est d’abord un rapport social, ce qui signifie que la bourgeoisie est obligée de tenir compte de la lutte de classe dans la mise en œuvre de ses politiques économiques et de ses attaques contre le prolétariat. Le congrès a également souligné un certain manque de maîtrise par le CCI de la théorie de Rosa Luxemburg comme explication de la décadence du capitalisme. Suivant Rosa Luxemburg, le capitalisme a besoin, pour être en mesure de poursuivre son accumulation, de trouver des débouchés dans des secteurs extra capitalistes. La disparition progressive de ces secteurs condamne le capitalisme à des convulsions croissantes. Cette analyse a été adoptée dans notre plateforme (même si une minorité de nos camarades s’appuie sur une autre analyse pour expliquer la décadence : celle de la baisse tendancielle du taux de profit). Ce manque de maîtrise par le CCI de l’analyse de Rosa Luxemburg (développée dans son livre "L’accumulation du capital") s’est répercutée par une vision "catastrophiste", voir apocalyptique de l’effondrement de l’économie mondiale. Le Congrès a constaté que tout au long de son existence, le CCI n’a cessé de surestimer le rythme de développement de la crise économique. Mais ces dernières années, et notamment avec la crise des dettes souveraines, nos analyses avaient en arrière fond l’idée sous-jacente que le capitalisme pourrait s’effondrer de lui-même puisque la bourgeoisie est "dans l’impasse" et aurait épuisé tous les palliatifs qui lui ont permis de prolonger de façon artificielle la survie de son système.
Cette vision "catastrophiste" est due, en bonne partie, à un manque d’approfondissement de notre analyse du capitalisme d’État, à une sous-estimation des capacités de la bourgeoisie, que nous avions pourtant identifiées depuis longtemps, à tirer les leçons de la crise des années 1930 et à accompagner la faillite de son système par toutes sortes de manipulations, de tricheries avec la loi de la valeur, par une intervention étatique permanente dans l’économie. Elle est due également à une compréhension réductionniste et schématique de la théorie économique de Rosa Luxemburg avec l’idée erronée que le capitalisme aurait déjà épuisé toutes ses capacités d’expansion depuis 1914 ou dans les années 1960. En réalité, comme le soulignait Rosa Luxemburg, la catastrophe réelle du capitalisme se trouve dans le fait qu’il soumet l’humanité à un déclin, à une longue agonie en plongeant la société dans une barbarie croissante.
C’est cette erreur consistant à nier toute possibilité d’expansion du capitalisme dans sa période de décadence qui explique les difficultés qu’a eues le CCI à comprendre la croissance et le développement industriel vertigineux de la Chine (et d’autres pays périphériques) après l’effondrement du bloc de l’Est. Bien que ce décollage industriel ne remette nullement en question notre analyse de la décadence du capitalisme 3, la vision suivant laquelle il n’y aurait aucune possibilité de développement des pays du Tiers-Monde dans la période de décadence ne s’est pas vérifiée. Cette erreur, soulignée par le Congrès, nous a conduits à ne pas envisager le fait que la faillite du vieux modèle autarcique des pays staliniens pourrait ouvrir de nouveaux débouchés, jusqu’alors gelés, aux investissements capitalistes 4 (y compris l'intégration dans le salariat d’une masse énorme de travailleurs qui vivait auparavant en dehors des rapports sociaux directement capitalistes et qui ont été soumis à une surexploitation féroce).
Concernant la question des tensions impérialistes, le Congrès a mis en évidence que le CCI a développé en général un cadre d’analyse très solide que ce soit à l’époque de la guerre froide entre les deux blocs rivaux ou après l’effondrement de l’URSS et des régimes staliniens. Notre analyse du militarisme, de la décomposition du capitalisme et de la crise dans les pays de l’Est nous a permis de percevoir les failles qui allaient conduire à l’effondrement du bloc de l’Est. Le CCI a ainsi été la première organisation à avoir prévu la disparition des deux blocs, celui dirigé par l’URSS et celui dirigé par les États-Unis, de même que le déclin de l’hégémonie américaine et le développement de la tendance au "chacun pour soi" sur la scène impérialiste avec la fin de la discipline des blocs militaires. 5
Si le CCI a été en mesure d’appréhender correctement la dynamique des tensions impérialistes, c’est parce qu’il a pu analyser l’effondrement spectaculaire du bloc de l’Est et des régimes staliniens comme manifestation majeure de l’entrée du capitalisme dans la phase ultime de sa décadence : celle de la décomposition. Ce cadre d’analyse fut la dernière contribution que notre camarade MC6 a léguée au CCI pour lui permettre d’affronter une situation historique inédite et particulièrement difficile. Depuis plus de 20 ans, la montée du fanatisme et de l’intégrisme religieux, le développement du terrorisme et du nihilisme, la multiplication des conflits armés et leur caractère de plus en plus barbare, le resurgissement des pogroms (et, plus généralement, d'une mentalité de recherche de "boucs émissaires), ne font que confirmer la validité de ce cadre d’analyse.
Bien que le CCI ait compris comment la classe dominante a pu exploiter l’effondrement du bloc de l’Est et du stalinisme pour retourner cette manifestation de la décomposition de son système contre la classe ouvrière en déchainant ses campagnes sur la "faillite du communisme", nous avons largement sous-estimé la profondeur de leur impact sur la conscience du prolétariat et sur le développement de ses luttes.
Nous avons sous-estimé le fait que l’atmosphère délétère de la décomposition sociale (de même que la désindustrialisation et les politiques de délocalisation dans certains pays centraux) contribue à saper la confiance en soi, la solidarité du prolétariat et à renforcer la perte de son identité de classe. Du fait de cette sous-estimation des difficultés de la nouvelle période ouverte avec l’effondrement du bloc de l’Est, le CCI a eu tendance à garder l’illusion que l’aggravation de la crise économique et des attaques contre la classe ouvrière allait nécessairement, et de façon mécanique, provoquer des "vagues de luttes" qui vont de développer avec les mêmes caractéristiques et sur le même modèle que celles des années 1970-80. En particulier, bien qu’ayant salué à juste raison le mouvement contre le CPE en France et des Indignés en Espagne, nous avons sous-estimé les énormes difficultés auxquelles se confronte aujourd’hui la jeune génération de la classe ouvrière pour développer une perspective à ses luttes (notamment le poids des illusions démocratiques, la peur et le rejet du mot "communisme", le fait que cette génération n’a pas pu bénéficier de la transmission de l’expérience vivante de la génération de travailleurs, aujourd’hui retraités, qui avaient participé aux combats de classe des années 1970 et 1980). Ces difficultés n’affectent pas seulement la classe ouvrière dans son ensemble mais également les jeunes éléments en recherche qui veulent s’engager dans une activité politisée.
L’isolement et l’influence négligeable du CCI (comme de tous les groupes historiques issus de la Gauche communiste) dans la classe ouvrière depuis quatre décennies, et particulièrement depuis 1989, révèlent que la perspective de la révolution prolétarienne mondiale est encore très éloignée. Lors de sa fondation, le CCI n’imaginait pas que 40 ans plus tard, la classe ouvrière n’aurait toujours pas renversé le capitalisme. Cela ne signifie nullement que le marxisme se serait trompé et que ce système est éternel. La principale erreur que nous avons commise et celle d’avoir sous-estimé la lenteur du rythme de la crise aiguë du capitalisme qui a ressurgi à la fin de la période de reconstruction du second après-guerre de même que les capacités de la classe dominante à freiner et accompagner l’effondrement historique du mode de production capitaliste.
Par ailleurs, le Congrès a mis en lumière que notre dernière crise interne (et les leçons que nous en avons tirées), a permis au CCI de commencer à se réapproprier clairement un acquis fondamental du mouvement ouvrier qui avait été mis en lumière par Engels : la lutte du prolétariat contient trois dimensions. Une dimension économique, une dimension politique et une dimension théorique. C’est cette dimension théorique que le prolétariat devra développer dans ses luttes futures pour pouvoir retrouver son identité de classe révolutionnaire, résister au poids de la décomposition sociale et mettre en avant sa propre perspective de transformation de la société. Comme l’affirmait Rosa Luxemburg, la révolution prolétarienne est avant tout un vaste "mouvement culturel" car la société communiste n’aura pas pour objectif la seule satisfaction des besoins matériels vitaux de l’humanité, mais également la satisfaction de ses besoins sociaux, intellectuels et moraux. À partir de la prise de conscience de cette lacune dans notre compréhension de la lutte du prolétariat (révélant une tendance "économiciste" et matérialiste vulgaire), nous avons pu non seulement identifier la nature de notre dernière crise mais également réaliser que cette crise "intellectuelle et morale" que nous avions déjà examinée lors de notre conférence extraordinaire de 2014 7 dure en réalité depuis plus de 30 ans. Et cela du fait que le CCI a souffert d’un manque de réflexion et de discussions approfondies sur les racines de toutes les difficultés organisationnelles auxquelles il a été confronté depuis ses origines, et notamment depuis la fin des années 1980.
Le rôle du CCI comme "fraction d'une certaine façon"
Pour entamer un bilan critique des 40 ans d’existence du CCI, le Congrès a mis au centre de ses travaux la discussion non seulement d’un rapport d’activité générale mais aussi un rapport sur le rôle du CCI "en tant que fraction".
Notre organisation n’a jamais eu la prétention d’être un parti (et encore moins LE parti mondial du prolétariat).
Comme le soulignaient nos textes de fondation, "L’effort de notre courant pour se constituer en pôle de regroupement autour des positions de classe s’inscrit dans un processus qui va vers la formation du parti au moment des luttes intenses et généralisées. Nous ne prétendons pas être un "parti"" (Revue Internationale n° 1, "Bilan de la conférence internationale de fondation du CCI"). Le CCI doit encore faire un travail comportant de nombreuses similarités avec celui d'une fraction, même s’il n’est pas une fraction.
En effet, a surgi après une rupture organique avec les organisations communistes du passé et n’est pas issu d’une organisation pré-existante. Il n’y a donc aucune continuité organisationnelle avec un groupe particulier ou un parti. Le seul camarade (MC) qui venait d’une fraction du mouvement ouvrier issue de la 3ème Internationale, ne pouvait représenter la continuité d’un groupe, mais il était le seul "lien vivant" avec le passé du mouvement ouvrier. Parce que le CCI n’est pas enraciné ou sorti d’un parti qui avait dégénéré, trahi les principes prolétariens et était passé dans le camp du capital, il n’a pas été fondé dans le contexte d’un combat contre sa dégénérescence. La tâche première du CCI, du fait de la rupture de la continuité organique et de la profondeur de 40 ans de contre-révolution, était d’abord la réappropriation des positions des groupes de la Gauche communiste qui nous avaient précédés.
Le CCI devait donc se construire et se développer à l’échelle internationale en quelque sorte à partir de "zéro". Cette nouvelle organisation internationale devait apprendre "sur le tas" dans de nouvelles conditions historiques et avec une première génération de jeunes militants inexpérimentés, issue du mouvement estudiantin de Mai 68 et très fortement marquée par le poids de la petite bourgeoisie, de l’immédiatisme, de l’ambiance du "conflit des générations" et de la peur du stalinisme qui s’est particulièrement manifestée par une méfiance, dès le début, à l’égard de la centralisation.
Dès sa fondation, le CCI s’est réapproprié l’expérience des organisations du mouvement ouvrier du passé (notamment de la Ligue des communistes, de l’AIT, de Bilan, de la GCF) en se dotant de Statuts, de principes de fonctionnement qui font partie intégrante de sa plateforme. Mais contrairement aux organisations du passé, le CCI ne se concevait pas comme une organisation fédéraliste composée d’une somme de sections nationales, ayant chacune des spécificités locales. En se constituant d’emblée en organisation internationale et centralisée, le CCI se concevait comme un corps uni internationalement. Ses principes de centralisation étaient le garant de cette unité de l’organisation.
"Alors que pour Bilan et la GCF – étant donnée les conditions de la contre-révolution – il était impossible de grossir et de construire une organisation dans plusieurs pays, le CCI a entrepris la tâche de construire une organisation internationale sur la base de positions solides (…) En tant qu’expression du cours historique nouvellement ouvert à des affrontements de classe (…), le CCI a été international et centralisé internationalement dès le début, alors que les autres organisations de la Gauche communiste du passé étaient toutes confinées à un ou deux pays." (Rapport sur le rôle du CCI comme "fraction").
Malgré ces différences avec Bilan et la GCF, le Congrès a souligné que le CCI avait un rôle similaire à celui d’une fraction : celui de constituer un pont entre le passé (après une période de rupture) et le futur. "Le CCI se définit lui-même ni comme un parti, ni comme un ‘parti en miniature’, mais comme une ‘fraction d’une certaine façon’" (Rapport sur le rôle du CCI comme "fraction" présenté au Congrès). Le CCI devait être un pôle de référence, de regroupement international et de transmission des leçons de l’expérience du mouvement ouvrier du passé. Il devait aussi se garder de toute démarche dogmatique, en sachant faire une critique, quand c’était nécessaire, des positions erronées ou devenues obsolètes, pour aller au-delà et continuer à faire vivre le marxisme.
La réappropriation des positions de la Gauche communiste dans le CCI a été entreprise relativement rapidement même si son assimilation a été marquée dès le début par une grande hétérogénéité. "Réappropriation ne voulait pas dire que nous étions arrivés à la clarté et à la vérité une fois pour toute, que notre plateforme était devenue ‘invariante’ (…) Le CCI a modifié sa plateforme au début des années 1980 après un débat intense" (Ibid.). C’est sur la base de cette réappropriation que le CCI a pu faire des élaborations théoriques à partir de l’analyse de la situation internationale (par exemple, la critique de la théorie de Lénine des "maillons faibles" après la défaite de la grève de masse en Pologne en 1980 8, l’analyse de la décomposition comme phase ultime de la décadence du capitalisme annonçant l’effondrement de l’URSS) 9.
Dès le début, le CCI a adopté la démarche de Bilan et la GCF qui ont insisté tout au long de leur existence sur la nécessité d’un débat international (même dans les conditions de répression, du fascisme et de la guerre) visant à la clarification des positions respectives des différents groupes en s’engageant dans des polémiques sur les questions de principe. Tout de suite après la fondation du CCI en janvier 1975, nous avons repris cette méthode en engageant de nombreux débats publics et polémiques, non pas en vue d’un regroupement précipité mais pour favoriser la clarification.
Depuis le début de son existence, le CCI a toujours défendu l’idée qu’il existe un "milieu politique prolétarien" délimité par des principes et s’est attaché à jouer un rôle dynamique dans le processus de clarification au sein de ce milieu.
La trajectoire de la Gauche communiste d'Italie a été marquée, du début à la fin, par des combats permanents pour la défense des principes du mouvement ouvrier et du marxisme. Cela a été également une préoccupation permanente du CCI tout au long de son existence que ce soit dans les débats polémiques à l’extérieur ou dans les combats politiques que nous avons dû mener à l’intérieur de l’organisation, en particulier lors de situations de crise.
Bilan et la GCF étaient convaincus que leur rôle était également la "formation des cadres". Bien que ce concept de "cadres" soit très contestable et puisse prêter à confusion, leur principale préoccupation était parfaitement valable : il s’agissait de former la future génération de militants en lui transmettant les leçons de l’expérience historique afin qu’elle puisse reprendre le flambeau et poursuivre le travail de la génération précédente.
Les fractions du passé n’ont pas disparu uniquement à cause du poids de la contre-révolution. Leurs analyses erronées de la situation historique ont également contribué à leur disparition. La GCF s’est dissoute suite à l’analyse, qui ne s’est pas vérifiée, de l’éclatement imminent et inéluctable d’une 3ème guerre mondiale. Le CCI est l’organisation internationale qui a la plus longue durée de vie de l’histoire du mouvement ouvrier. Il existe encore, 40 ans après sa fondation. Nous n’avons pas été balayés par nos différentes crises. Malgré la perte de nombreux militants, le CCI a réussi à maintenir la plupart de ses sections fondatrices et à constituer de nouvelles sections permettant la diffusion de notre presse dans différentes langues, pays et continents.
Cependant, le Congrès a mis en évidence, de façon lucide, que le CCI est encore sous le poids du fardeau des conditions historiques de ses origines. Du fait de ces conditions historiques défavorables, il y a eu en notre sein une génération "perdue" après 1968 et une génération "manquante" (à cause de l’impact prolongé des campagnes anti-communistes après l’effondrement du bloc de l’Est). Cette situation a constitué un handicap pour consolider l’organisation dans son activité sur le long terme. Nos difficultés ont encore été aggravées depuis la fin des années 1980 par le poids de la décomposition qui affecte l’ensemble de la société, y compris la classe ouvrière et ses organisations révolutionnaires.
De la même façon que Bilan et la GCF ont eu la capacité de mener le combat "contre le courant", le CCI, pour pouvoir assumer son rôle de pont entre le passé et le futur, doit aujourd’hui développer ce même esprit de combat en sachant que nous sommes également à "contre-courant", isolés et coupés de l’ensemble de la classe ouvrière (comme les autres organisations de la Gauche communiste). Même si nous ne sommes plus dans une période de contre-révolution, la situation historique ouverte depuis l’effondrement du bloc de l’Est et les très grandes difficultés du prolétariat à retrouver son identité de classe révolutionnaire et sa perspective, (de même que toutes les campagnes bourgeoises pour discréditer la Gauche communiste) a renforcé cet isolement. "Le pont auquel nous devons contribuer sera celui qui passe au-dessus de la génération ‘perdue’ de 1968 et au-dessus du désert de la décomposition vers les futures générations" (Ibid.).
Les débats du Congrès ont souligné que le CCI, au fil du temps (et notamment depuis la disparition de notre camarade MC qui est survenue peu après l'effondrement du stalinisme), a grandement perdu de vue qu’il doit continuer le travail des fractions de la Gauche communiste. Cela s’est manifesté par une sous-estimation que notre tâche principale est celle de l’approfondissement théorique 10 (qui ne doit pas être laissé à quelques "spécialistes») et de la construction de l’organisation à travers la formation de nouveaux militants en leur transmettant la culture de la théorie. Le Congrès a fait le constat que le CCI a échoué à transmettre aux nouveaux camarades, au cours des 25 dernières années, la méthode de la Fraction. Au lieu de leur transmettre la méthode de construction sur le long terme d’une organisation centralisée, nous avons tendu à leur transmettre la vision du CCI comme un "mini parti" 11 dont la tâche principale serait l’intervention dans les luttes immédiates de la classe ouvrière.
À l’époque de la fondation du CCI, une responsabilité immense reposait sur les épaules de MC qui était le seul camarade qui pouvait transmettre à une nouvelle génération la méthode du marxisme, de construction de l’organisation, de défense intransigeante de ses principes. Il y a aujourd’hui au sein de l’organisation beaucoup plus de militants expérimentés (et qui étaient présents lors de la fondation du CCI), mais il existe toujours un danger de "rupture organique" étant donné nos difficultés à faire ce travail de transmission.
En fait, les conditions qui ont présidé à la fondation du CCI ont constitué un énorme handicap pour la construction de l’organisation sur le long terme. La contre-révolution stalinienne a été la plus longue et la plus profonde de toute l’histoire du mouvement ouvrier. Jamais auparavant, depuis la Ligue des Communistes, il n’y avait eu de discontinuité, de rupture organique entre les générations de militants. Il y a toujours eu un lien vivant d’une organisation à l’autre et le travail de transmission de l’expérience n’a jamais reposé sur les épaules d’un seul individu. Le CCI est la seule organisation qui ait connu cette situation inédite. Cette rupture organique qui s'étend sur plusieurs décennies constituait une faiblesse très difficile à surmonter et elle a été encore aggravée par la résistance de la jeune génération issue de Mai 68 à "apprendre" de l’expérience de la génération précédente. Le poids des idéologies de la petite bourgeoisie en révolte, du milieu estudiantin contestataire et fortement marqué par le "conflit des générations" (du fait que la génération précédente était justement celle qui avait vécu au plus profond de la contre-révolution) a renforcé encore le poids de la rupture organique avec l’expérience vivante du mouvement ouvrier du passé.
Évidemment, la disparation de MC, au tout début de la période de décomposition du capitalisme, ne pouvait que rendre encore plus difficile la capacité du CCI à dépasser ses faiblesses congénitales.
La perte de la section du CCI en Turquie a été la manifestation la plus évidente de ces difficultés à transmettre à de jeunes militants la méthode de la Fraction. Le Congrès a fait une critique très sévère de notre erreur consistant à avoir intégré de façon prématurée et précipitée ces ex-camarades alors qu’ils n’avaient pas réellement compris les Statuts et les principes organisationnels du CCI (avec une très forte tendance localiste, fédéraliste, consistant à concevoir l’organisation comme une somme de sections "nationales" et non comme un corps uni et centralisé à l’échelle internationale).
Le Congrès a également souligné que le poids de l’esprit de cercle (et des dynamiques de clans) 12 qui fait partie des faiblesses congénitales du CCI, a constitué un obstacle permanent à son travail d’assimilation et de transmission des leçons de l’expérience du passé aux nouveaux militants.
Les conditions historiques dans lesquelles le CCI a vécu ont changé depuis sa fondation. Pendant les premières années de notre existence, nous pouvions intervenir dans une classe ouvrière qui était en train de mener des luttes significatives. Aujourd’hui, après 25 ans de quasi-stagnation de la lutte de classe au niveau international, le CCI doit maintenant s’attacher à une tâche semblable à celle de Bilan à son époque : comprendre les raisons de l’échec de la classe ouvrière à retrouver une perspective révolutionnaire près d’un demi-siècle après la reprise historique de la lutte de classe à la fin des années 1960.
"Le fait que nous soyons presque seuls aujourd’hui à examiner des problèmes colossaux peut préjuger des résultats, mais non de la nécessité d’une solution." (Bilan n°22, septembre 1935, "Projet de résolution sur les problèmes des liaisons internationales").
"Ce travail ne doit pas porter seulement sur les problèmes que nous avons besoin de résoudre aujourd’hui pour établir notre tactique mais sur les problèmes qui se poseront demain à la dictature du prolétariat" (Internationalisme n°1, janvier 1945, "Résolution sur les tâches politiques")
La nécessité d’une "renaissance" morale et culturelle
Les débats sur le bilan critique des quarante ans d’existence du CCI nous ont obligés à prendre la mesure du danger de sclérose et de dégénérescence qui a toujours menacé les organisations révolutionnaires. Aucune organisation révolutionnaire n’a jamais été immunisée contre ce danger. Le SPD (Parti Social-Démocrate d'Allemagne) a été gangréné par l’opportunisme, jusqu’à une remise en cause totale des fondements du marxisme, en grande partie parce qu’il avait abandonné tout travail théorique au profit des taches immédiates visant à gagner de l’influence dans les masses ouvrières à travers ses succès électoraux. Mais le processus de dégénérescence du SPD a commencé bien avant cet abandon des tâches théoriques. Il a commencé avec la destruction progressive de la solidarité entre les militants. Du fait de l’abolition des lois antisocialistes (1878-1890) et de la légalisation du SPD, la solidarité entre les militants qui était une exigence au cours de la période précédente n’était plus une évidence puisqu’ils ne risquaient plus d’être soumis à la répression et à la clandestinité. Cette destruction de la solidarité (permise grâce aux conditions "confortables" de la démocratie bourgeoisie) a ouvert la voie à une dépravation morale croissante au sein du SPD qui était pourtant le parti phare du mouvement ouvrier international et qui s'est manifesté, par exemple, par le colportage des ragots les plus nauséabonds visant la représentante la plus intransigeante de son aile gauche, Rosa Luxemburg. 13 C’est cet ensemble de facteurs (et pas seulement l’opportunisme et le réformisme) qui a ouvert les vannes d’un long processus de dégénérescence interne jusqu’à l’effondrement du SPD en 1914. 14 Pendant longtemps, le CCI n’avait abordé la question des principes moraux que d’un point de vue empirique, pratique, notamment lors de la crise de 1981 lorsque nous avons été confrontés, pour la première fois, à des comportements de voyous avec le vol de notre matériel par la tendance Chénier15. Si le CCI n’avait pas pu aborder cette question d’un point de vue théorique, c’est essentiellement parce qu’il existait un rejet et une certaine "phobie" du terme "morale" lors de la fondation du CCI. La jeune génération issue du mouvement de Mai 68 ne voulait pas (contrairement à MC) que le mot "morale" figure dans les Statuts du CCI (alors que l’idée d’une morale prolétarienne était présente dans les Statuts de la GCF). Cette aversion pour la "morale" était encore une manifestation de l’idéologie et de la démarche la petite bourgeoisie estudiantine de l’époque.
C’est seulement lors de la répétition, lors de la crise de 2001, des comportements de voyous de la part des ex-militants qui allaient constituer la FICCI que le CCI a compris la nécessité d’une réappropriation théorique des acquis du marxisme sur la question de la morale. Il aura fallu plusieurs décennies pour que nous commencions à réaliser la nécessité de combler cette faille. Et c’est à partir de notre dernière crise que le CCI a commencé une réflexion pour mieux comprendre ce que voulait dire Rosa Luxemburg lorsqu’elle affirmait que "le parti du prolétariat est la conscience morale de la révolution".
Le mouvement ouvrier dans son ensemble a négligé cette question. Le débat à l’époque de la Deuxième Internationale n’a jamais été suffisamment développé (notamment sur le livre de Kautsky "Éthique et conception matérialiste de l’Histoire") et la perte morale a été un élément décisif dans sa dégénérescence. Bien que les groupes de la Gauche communiste aient eu le courage de défendre pratiquement les principes moraux prolétariens, ni Bilan, ni la GCF n’ont traité de cette question de façon théorique. Les difficultés du CCI sur ce plan doivent donc être vues à la lumière des insuffisances du mouvement révolutionnaire au cours du 20ème siècle.
Aujourd’hui, le risque de dégénérescence morale des organisations révolutionnaires est aggravé par les miasmes de la putréfaction et de la barbarie de la société capitaliste. Cette question ne concerne pas seulement le CCI mais aussi les autres groupes de la Gauche communiste.
Après notre dernière Conférence extraordinaire qui s’était attachée à identifier la dimension morale de la crise du CCI, le Congrès s’est donné comme objectif de discuter de sa dimension intellectuelle. Tout au long de son existence, le CCI n’a cessé de signaler régulièrement ses difficultés sur le plan de l’approfondissement des questions théoriques. La tendance à perdre de vue le rôle que doit jouer notre organisation dans la période historique présente, l’immédiatisme dans nos analyses, les tendances activistes et ouvriéristes dans notre intervention, le mépris pour le travail théorique et de recherche de la vérité ont constitué le terreau pour le développement de cette crise.
Notre sous-estimation récurrente de l’élaboration théorique (et particulièrement sur les questions organisationnelles) trouve ses sources dans les origines du CCI : l’impact de la révolte estudiantine avec sa composante académiste (de nature petite-bourgeoise) à laquelle s’est opposée une tendance activiste "ouvriériste" (de nature gauchisante) qui confondait anti-académisme et mépris de la théorie. Et cela dans une atmosphère de contestation infantile de l’"autorité" (représentée par le "vieux" MC). À partir de la fin des années 1980, cette sous-estimation du travail théorique de l’organisation a été alimentée par l’ambiance délétère de la décomposition sociale qui tend à détruire la pensée rationnelle au profit de croyances et préjugés obscurantistes, qui substitue la "culture du ragot" à la culture de la théorie. 16 La perte de nos acquis (et le danger de sclérose qu’elle comporte) est une conséquence directe de ce manque de culture de la théorie. Face à la pression de l’idéologie bourgeoise, les acquis du CCI (que ce soit sur le plan programmatique, de nos analyses ou organisationnels) ne peuvent se maintenir que s’ils sont enrichis en permanence par la réflexion et le débat théorique.
Le Congrès a souligné que le CCI est toujours affecté par son "péché de jeunesse", l’immédiatisme, qui nous a fait perdre de vue, de façon récurrente, le cadre historique et à long terme dans lequel s’inscrit la fonction de l’organisation. Le CCI a été constitué par le regroupement de jeunes éléments qui se sont politisés au moment d’une reprise spectaculaire des combats de classe (en Mai 68). Beaucoup d’entre eux avaient l’illusion que la révolution était déjà en marche. Les plus impatients et immédiatistes se sont démoralisés et ont abandonné leur engagement militant. Mais cette faiblesse s’est également maintenue parmi ceux qui sont restés dans le CCI. L’immédiatisme continue à nous imprégner et s’est manifesté en de nombreuses occasions. Le Congrès a pris conscience que cette faiblesse peut nous être fatale car, associée à la perte des acquis, au mépris de la théorie, elle débouche inévitablement sur l’opportunisme, une dérive qui vient toujours saper les fondements de l’organisation.
Le Congrès a rappelé que l’opportunisme (et sa variante, le centrisme) résulte de l’infiltration permanente de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise au sein des organisations révolutionnaire nécessitant une vigilance et un combat permanents contre le poids de ces idéologies. Bien que l’organisation des révolutionnaires soit un "corps étranger", antagonique au capitalisme, elle surgit et vit au sein de la société de classes et est donc en permanence menacée par l’infiltration des idéologies et pratiques étrangères au prolétariat, par des dérives remettant en cause les acquis du marxisme et du mouvement ouvrier. Au cours de ces 40 années d’existence, le CCI a dû constamment défendre ses principes et combattre en son sein, à travers des débats difficiles, toutes ces idéologies qui se sont manifestées, entre autres, par des déviations gauchistes, modernistes, anarcho-libertaires, conseillistes.
Le Congrès s’est penché également sur les difficultés du CCI à surmonter une autre grande faiblesse de ses origines : l’esprit de cercle et sa manifestation la plus destructrice l’esprit de clan. 17 Cet esprit de cercle constitue, comme le révèle toute l’histoire du CCI, un des poisons les plus dangereux pour l’organisation. Et cela pour différentes raisons. Il porte en lui la transformation de l’organisation révolutionnaire en simple regroupement d’amis, dénaturant ainsi sa nature politique comme émanation et instrument du combat de la classe ouvrière. À travers la personnalisation des questions politiques, il sape la culture du débat et la clarification des désaccords à travers la confrontation, cohérente et rationnelle, des arguments. La constitution de clans ou de cercles d’amis s’affrontant à l’organisation ou à certaines de ses parties détruit le travail collectif, la solidarité et l’unité de l’organisation. Du fait qu’il est alimenté par des démarches émotionnelles, irrationnelles, par des rapports de force, des animosités personnelles, l’esprit de cercle s’oppose au travail de la pensée, à la culture de la théorie au profit de l’engouement pour les ragots, les commérages "entre amis" et la calomnie, sapant ainsi la santé morale de l’organisation.
Le CCI n’a pas réussi à se débarrasser de l’esprit de cercle malgré tous les combats qu’il a menés au cours de ses quarante années d’existence. La persistance de ce poison s’explique par les origines du CCI qui s’est constitué à partir de cercles et dans une ambiance "familialiste" ou les affects (sympathies ou antipathies personnelles) prennent le pas sur la nécessaire solidarité entre les militants luttant pour la même cause et rassemblés autour d’un même programme. Le poids de la décomposition sociale et la tendance au "chacun pour soi", aux démarches irrationnelles, a encore aggravé cette faiblesse originelle. Et surtout, l’absence de discussions théoriques approfondies sur les questions organisationnelles n’a pas permis à l’organisation dans son ensemble de surmonter cette "maladie infantile" du CCI et du mouvement ouvrier. Le Congrès a souligné (en reprenant le constat déjà fait par Lénine en 1904 dans son ouvrage "Un pas en avant, deux pas en arrière") que l’esprit de cercle est véhiculé essentiellement par la pression de l’idéologie de la petite bourgeoisie.
Pour affronter toutes ces difficultés, et face à la gravité des enjeux de la période historique actuelle, le Congrès a mis en évidence que l’organisation doit développer un esprit de combat contre l’influence de l’idéologie dominante, contre le poids de la décomposition sociale. Cela signifie que l’organisation révolutionnaire doit lutter en permanence contre le routinisme, la superficialité, la paresse intellectuelle, le schématisme, développer l’esprit critique en identifiant avec lucidité ses erreurs et insuffisances théoriques.
Dans la mesure où "la conscience socialiste précède et conditionne l’action révolutionnaire de la classe ouvrière" (Internationalisme, "Nature et fonction du parti politique du prolétariat"), le développement du marxisme est la tâche centrale de toutes les organisations révolutionnaires. Le Congrès a dégagé comme orientation prioritaire pour le CCI, le renforcement collectif de son travail d’approfondissement, de réflexion en se réappropriant la culture marxiste de la théorie dans tous nos débats internes.
En 1903, Rosa Luxemburg déplorait ainsi l’abandon de l’approfondissement de la théorie marxiste : "C’est seulement dans le domaine économique qu’il peut être plus ou moins question chez Marx d’une construction parfaitement achevée. Pour ce qui est, au contraire, de la partie de ses écrits qui présente la plus haute valeur, la conception matérialiste, dialectique de l’histoire, elle ne reste qu’une méthode d’enquête, un couple d’idées directrices générales, qui permettent d’apercevoir un monde nouveau (…) Et pourtant, sur ce terrain aussi, à part quelques petites recherches, l’héritage de Marx est resté en friche. On laisse rouiller cette arme merveilleuse. La théorie même du matérialisme historique est encore aujourd’hui aussi schématique, aussi peu fouillée que lorsqu’elle nous est venue des mains de son créateur. (…) Penser que la classe ouvrière, en pleine lutte, pourrait, grâce au contenu même de sa lutte de classe, exercer à l’infini son activité créatrice dans le domaine théorique, serait se faire illusion." ("Arrêt et progrès du marxisme")
Le CCI est aujourd’hui dans une période de transition. Grace au bilan critique qu'il a engagé, à sa capacité à examiner ses faiblesses, à reconnaître ses erreurs, il est en train de faire une critique radicale de la vision de l’activité militante que nous avions jusqu’à présent, des rapports entre les militants et des militants à l’organisation, avec comme ligne directrice la question de la dimension intellectuelle et morale de la lutte du prolétariat. C’est donc dans une véritable "renaissance culturelle" que nous devons nous engager pour pouvoir continuer à "apprendre" afin d’assumer nos responsabilités. C’est un processus long et difficile, mais vital pour l’avenir.
La défense de l’organisation face aux attaques contre le CCI
Tout au long de son existence, le CCI a dû mener des combats permanents pour la défense de ses principes, contre la pression idéologique de la société bourgeoise, contre les comportements anti-prolétariens ou les manœuvres d’aventuriers sans foi ni loi. La défense de l’organisation est une responsabilité politique et aussi un devoir moral. L’organisation révolutionnaire n’appartient pas aux militants, mais à l’ensemble de la classe ouvrière. C’est une émanation de sa lutte historique, un instrument de son combat pour le développement de sa conscience en vue de la transformation révolutionnaire de la société.
Le Congrès a porté l’insistance sur le fait que le CCI est un "corps étranger" au sein de la société, antagonique et ennemi du capitalisme. C’est justement pour cela que la classe dominante s’intéresse de près à nos activités depuis le début de notre existence. Et cette réalité n’a rien à voir avec de la paranoïa ou la "théorie du complot". Les révolutionnaires ne doivent pas avoir la naïveté des ignorants de l’histoire du mouvement ouvrier et encore moins céder aux chants de sirène de la démocratie bourgeoise (et de sa "liberté d’expression"). Si aujourd’hui, le CCI n’est pas soumis à la répression directe de l’État capitaliste, c’est parce que nos idées sont très minoritaires et ne représentent aucun danger immédiat pour la classe dominante. Tout comme Bilan et la GCF, nous nageons "à contre-courant". Cependant, même si le CCI n’a aujourd’hui aucune influence directe et immédiate dans le cours des luttes de la classe ouvrière, en diffusant ses idées, il sème les graines pour le futur. C’est pour cela que la bourgeoisie est intéressée à la disparition du CCI qui est la seule organisation internationale centralisée de la Gauche communiste ayant des sections dans différents pays et continents.
C’est aussi ce qui attise la haine des éléments déclassés 18 qui sont toujours à l’affût des "signes annonciateurs" de notre disparition. La classe dominante ne peut que jubiler de voir toute une constellation d’individus se réclamant de la Gauche communiste s’agiter autour du CCI (à travers des blogs, sites, forum Internet, Facebook et autres réseaux sociaux) pour colporter des ragots, des calomnies contre le CCI, des attaques ordurières et des méthodes policières ciblant, de façon répétée et ad nauseam, certains de nos militants.
Le Congrès a souligné que la recrudescence des attaques contre le CCI de ce milieu parasite 19, qui cherche à récupérer et dénaturer le travail militant des groupes de la Gauche communiste, est une manifestation de la putréfaction de la société bourgeoise.
Le Congrès a pris toute la mesure de la dimension nouvelle qu’a prise le parasitisme depuis le début de la période de décomposition. Son objectif, avoué ou non, vise aujourd’hui non seulement à semer le trouble et la confusion, mais surtout à stériliser les forces potentielles qui pourraient se politiser autour des organisations historiques de la Gauche communiste. Il vise à constituer un "cordon sanitaire" (notamment en agitant le spectre du stalinisme qui sévirait encore à l’intérieur du CCI !) pour empêcher les jeunes éléments en recherche de se rapprocher de notre organisation. Ce travail de sape vient compléter aujourd’hui les campagnes anticommunistes déchainées par la bourgeoisie lors de l’effondrement des régimes staliniens. Le parasitisme est le meilleur allié de la bourgeoisie décadente contre la perspective révolutionnaire du prolétariat.
Alors que le prolétariat a d’énormes difficultés à retrouver son identité de classe révolutionnaire et à renouer avec son propre passé, les calomnies, les attaques et la mentalité nauséabonde des individus se réclamant de la Gauche communiste et qui dénigrent le CCI ne peuvent que faire le jeu et défendre les intérêt de la classe dominante. En assumant la défense de l’organisation, nous ne défendons pas notre "chapelle". Il s’agit pour le CCI de défendre les principes du marxisme, de la classe révolutionnaire et de la Gauche communiste qui risquent d’être engloutis par l’idéologie du "no future" que le parasitisme draine avec lui.
Le renforcement de la défense publique et intransigeante de l’organisation est une orientation que le Congrès a dégagée. Le CCI a parfaitement conscience que cette orientation peut conduire momentanément à ne pas être compris, a été critiqué pour son manque de "fair play", et donc à un isolement encore plus grand. Mais le pire serait de laisser le parasitisme faire son travail destructeur sans réagir. Le Congrès a mis en avant que, sur ce plan là aussi, le CCI doit avoir le courage de "nager contre le courant", comme il a eu le courage de faire une critique implacable de ses erreurs et difficultés pendant ce Congrès et d’en rendre compte publiquement.
"Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre (…) Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait "pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau"" (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie)
CCI (décembre 2015)
1 Bilan était, entre 1933 et 1938, le nom de la publication en langue française de la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie devenue, en 1935, la Fraction italienne de la Gauche communiste.
2 Voir notre article "Conférence internationale extraordinaire du CCI : la "nouvelle" de notre disparition est grandement exagérée! [552]" (Revue Internationale n° 153) ()
3 Voir notamment notre article "Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l’Est [553]"
4 Cette analyse fait l'objet à l'heure actuelle d'une discussion et d'un approfondissement au sein de notre organisation.
5 Voir notamment notre article "Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos [554]" dans la Revue Internationale n° 61
6 MC (Marc Chirik) était un militant de la Gauche communiste né à Kichinev (Bessarabie) en 1907 et décédé à Paris en 1990. Son père était rabbin et son frère ainé secrétaire du parti bolchevique de la ville. C’est à ses côtés que Marc a assisté aux révolutions de février et octobre 1917. En 1919, pour échapper aux pogroms antijuifs des armées blanches roumaines, toute la famille émigre en Palestine et Marc, âgé d’à peine 13 ans, devient membre du Parti communiste de Palestine fondé par ses frère et sœurs plus âgés. Très vite, il entre en désaccord avec la position de l’Internationale communiste de soutien aux luttes de libération nationale ce qui lui vaut une première exclusion de celle-ci en 1923. En 1924, alors que certains membres de la fratrie reviennent en Russie, Marc et un de ses frères viennent vivre en France. Marc entre dans le PCF où, très vite, il mène le combat contre sa dégénérescence et dont il est exclu en février 1928. Membre pendant un temps de l’Opposition de Gauche internationale animée par Trotski, il engage le combat contre la dérive opportuniste de celle-ci et participe en novembre 1933, en compagnie de Gaston Davoust (Chazé), à la fondation de l’Union Communiste qui publie l’Internationale. Au moment de la Guerre d’Espagne, ce groupe adopte une position ambigüe sur la question de l’antifascisme. Après avoir mené le combat contre cette position, MC rejoint, début 1938, la Fraction italienne de la Gauche communiste avec laquelle il était en contact et qui défend une position parfaitement prolétarienne et internationaliste sur cette question. Peu après, il engage un nouveau combat contre les analyses de Vercesi, principal animateur de cette organisation, qui considère que les différents conflits militaires qui se déroulent à l’époque ne sont pas des préparatifs d’une nouvelle guerre mondiale mais qu’ils ont pour but d’écraser le prolétariat afin de l’empêcher de se lancer dans une nouvelle révolution. De ce fait le déclenchement de la guerre mondiale en septembre 1939 créée une débandade au sein de la Gauche italienne. Vercesi théorise une politique de retrait politique pendant la période de guerre alors que Marc regroupe dans le Sud de la France les membres de la Fraction qui refusent de suivre Vercesi dans son retrait. Dans les pires conditions qui soient, Marc et un petit noyau de militants poursuivent le travail mené par la Fraction italienne depuis 1928 mais en 1945, apprenant la constitution en Italie du Partito comunista internazionalista qui se réclame de la Gauche communiste italienne, la Fraction décide son autodissolution et l’intégration individuelle de ses membres dans le nouveau parti. Marc, en désaccord avec cette décision, qui va à l’encontre de toute l’orientation qui avait distingué la Fraction italienne auparavant, rejoint la Fraction française de la Gauche communiste (dont il inspirait déjà les positions) qui deviendra, peu après, la Gauche communiste de France (GCF). Ce groupe va publier 46 numéros de sa revue Internationalisme, poursuivant la réflexion théorique menée par la Fraction auparavant, notamment en s'inspirant des apports de la Gauche communiste fermano-hollandaise. En 1952, considérant que le monde s'acheminait vers une nouvelle guerre mondiale dont l'Europe serait à nouveau le principal champ de bataille, ce qui aurait menacé de destruction les minuscules forces révolutionnaires ayant subsisté, la GCF décide la dispersion de plusieurs de ses militants sur d'autres continents, Marc allant vivre au Venezuela. C'était là une des principales erreurs commises par la GCF et par MC dont la conséquence fut la disparition formelle de l'organisation. Cependant, dès 1964, Marc regroupe autour de lui un certain nombre de très jeunes éléments avec qui il va former le groupe Internacionalismo. En mai 1968, dès qu'il apprend le déclenchement de la grève généralisée en France, Marc se rend dans ce pays pour recontacter ses anciens camarades et il joue un rôle décisif (avec un élément qui avait été membre d'Internacionalismo au Venezuela) dans la formation du groupe Révolution Internationale qui va impulser le regroupement international dont sera issu, en janvier 1975, le Courant communiste international. Jusqu'à son dernier souffle, en décembre 1990, Marc Chirik va jouer un rôle essentiel dans la vie du CCI, notamment dans la transmission des acquis organisationnels de l'expérience passée du mouvement ouvrier et dans ses avancées théoriques. Pour plus d'éléments sur la biographie de MC, voir nos articles dans les numéros 65 [555] et 66 [556] de la Revue Internationale.
7 Voir notre article sur cette conférence extraordinaire dans la Revue Internationale n° 153
8 Voir nos documents publiés dans la Revue Internationale : "Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière [557]" (Revue n° 26); "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe [402]" (Revue n° 31); "Débat : a propos de la critique de la théorie du 'maillon le plus faible' [558]" (Revue n° 37).
9 Voir dans la Revue Internationale n° 62, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [200]", point 13
10 Cela ne signifie nullement que cet approfondissement ne soit pas d'actualité lors d'une période révolutionnaire ou de mouvements importants de la classe ouvrière où l'organisation peut exercer une influence déterminante sur le cours des combats de celle-ci. Par exemple, Lénine a rédigé son ouvrage théorique le plus important, L'État et la révolution au cours même des événements révolutionnaires de 1917. De même, Marx a publié Le Capital, en 1867, alors que depuis septembre 1864 il était pleinement engagé dans l'action de l'AIT.
11 Cette notion de "mini parti" ou "parti en miniature" contient l'idée que même dans les périodes où la classe ouvrière ne mène pas des combats d'envergure une petite organisation révolutionnaire pourrait avoir un impact du même type (à une échelle plus réduite) qu'un parti au plein sens du terme. Une telle idée est en contradiction totale avec l'analyse développée par Bilan qui souligne la différence qualitative fondamentale entre le rôle d'un parti et celui d'une fraction. Il faut noter que la Tendance communiste internationaliste, qui pourtant se réclame de la Gauche communiste italienne, n'est pas claire sur cette question puisque sa section en Italie continue aujourd'hui de s'appeler "Partito comunista internazionalista".
12 Sur cette question, voir en particulier notre texte "La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI [559]" publié dans la Revue Internationale n° 109, et plus particulièrement le point 3.1.e, Les rapports entre militants.
13 Ces campagnes abjectes contre Rosa Luxemburg constituaient, en quelque sorte, les préparatifs de son assassinat sur ordre du gouvernement dirigé par le SPD lors de la semaine sanglante à Berlin en janvier 1919 et plus globalement les appels au pogrom contre les spartakistes lancés par ce même gouvernement.
14 Voir notre article "Le chemin vers la trahison de la Social-démocratie allemande [560]" dans le numéro spécial de la Revue Internationale consacré à la Première Guerre mondiale
15 Sur "l’affaire Chénier" voir notre article de la Revue Internationale n° 28 "Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire [561]", notamment les parties "Les difficultés organisationnelles" et "Les récents événements".
16 "Les différents éléments qui constituent la force du prolétariat se heurtent directement aux diverses facettes de cette décomposition idéologique :- l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le "chacun pour soi", la "débrouille individuelle" ; - le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société ;
- la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le "no future" ;
- la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque." (Revue Internationale n° 62, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [200]", point 13).
17 Voir la note 12.
18 Voir notre texte "Construction de l'organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme [562]" (et notamment le point 20) publié dans la Revue Internationale n° 94
19 Voir nos "Thèses sur le parasitisme", cf. note précédente.
Vie du CCI:
Rubrique:
Rapport sur la lutte de classe 2015
- 1812 lectures
Dès ses origines, le CCI a toujours cherché à analyser la lutte de classe dans son contexte historique. L'existence même de notre organisation est le produit non seulement des efforts des révolutionnaires du passé et de ceux qui ont assumé rôle de pont entre une génération de révolutionnaires et l'autre mais, aussi, du changement du cours historique, ouvert par la résurgence du prolétariat au niveau mondial après 1968 ; celui-ci avait mis fin aux "quarante années de contre-révolution" qui avaient suivi les dernières ondes de la grande vague révolutionnaire de 1917-27. Mais aujourd'hui, quarante autres années après sa fondation, le CCI se trouve face à la tâche de réexaminer tout le corpus de travail considérable qu'il a effectué par rapport à la réapparition historique de la classe ouvrière et aux immenses difficultés que celle-ci rencontre sur la voie de son émancipation.
Ce rapport ne constitue que le début de cet examen. Il n'est pas possible de revenir en détail sur les luttes elles-mêmes ni sur les différentes analyses qui en ont été faites par les historiens ou par d'autres éléments du milieu prolétarien. Nous devons nous limiter à ce qui constitue, déjà, une tâche assez importante : examiner comment le CCI lui-même a analysé le développement de la lutte de classe dans ses publications, principalement dans son organe théorique international, la Revue internationale, qui contient globalement la synthèse des discussions et des débats qui ont animé notre organisation au cours de son existence.
La reprise historique du prolétariat
Avant le CCI, avant Mai 1968, les signes d'une crise de la société capitaliste apparaissaient déjà : sur le plan économique, les problèmes des devises américaine et britannique ; sur le plan socio-politique, les manifestations contre la Guerre au Viêtnam et contre la ségrégation raciale aux États-Unis ; sur le plan de la lutte de classe, les ouvriers chinois se rebellaient contre la prétendue "révolution culturelle", les grèves sauvages éclataient dans les usines automobile américaines, etc. (voir par exemple l'article de Accion proletaria, publié dans World Revolution n°15 et 16, qui parle d'une vague de luttes ayant débuté en réalité en 1965). Tel est le contexte dans lequel Marc Chirik (MC) 1 et ses jeunes camarades au Venezuela établirent le pronostic souvent cité (par nous au moins) : "Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement conscients et sûrs, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de 1'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise". "Et nous sommes sûrs également que le processus inverse de développement de la combativité de la classe, qu'on vit actuellement de façon générale, va conduire la classe ouvrière à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois." (Internacionalismo n°8, "1968: une nouvelle convulsion du capitalisme commence")
Ici réside toute la force de la méthode marxiste héritée de la Gauche communiste : une capacité à discerner les changements majeurs dans la dynamique de la société capitaliste, bien avant qu'ils soient devenus trop évidents pour pouvoir être niés. Et ainsi MC, qui avait passé la plus grande partie de sa vie militante dans l'ombre de la contre-révolution, fut capable d'annoncer le changement du cours historique : la contre-révolution était finie, le boom d'après-guerre touchait à sa fin et la perspective était à une nouvelle crise du système capitaliste mondial et à la résurgence de la lutte de classe prolétarienne.
Mais il y avait une faiblesse-clé dans la formulation utilisée pour caractériser ce changement de cours historique qui pouvait donner l'impression que nous entrions déjà dans une période révolutionnaire – en d'autres termes une période où la révolution mondiale était à l'ordre du jour à court terme, comme elle l'était en 1917. L'article ne dit évidemment pas que la révolution est au coin de la rue et MC avait appris la vertu de la patience dans les circonstances les plus éprouvantes. Pas plus qu'il ne commit la même erreur que les Situationnistes qui pensaient que Mai 1968 constituait vraiment le début de la révolution. Mais cette ambiguïté allait avoir des conséquences pour la nouvelle génération de révolutionnaires qui allaient constituer le CCI. Pendant la plus grande partie de son histoire par la suite, même après avoir reconnu l'inadéquation de la formulation "cours à la révolution" et l'avoir remplacée par "cours aux affrontements de classe" lors de son 5e Congrès, le CCI allait souffrir en permanence d'une tendance à sous-estimer à la fois la capacité du capitalisme à se maintenir malgré sa décadence et sa crise ouverte, et la difficulté de la classe ouvrière à surmonter le poids de l'idéologie dominante, de se constituer en tant que classe sociale avec sa propre perspective.
Le CCI s'est constitué en 1975 sur la base de l'analyse selon laquelle une nouvelle ère de luttes ouvrières s'était ouverte, engendrant également une nouvelle génération de révolutionnaires dont la tâche première était de se réapproprier les acquis politiques et organisationnels de la Gauche communiste et de travailler au regroupement à l'échelle mondiale. Le CCI était convaincu qu'il avait un rôle unique à jouer dans ce processus, se définissant comme l' "axe" du futur parti communiste mondial. ("Rapport sur la question de l'organisation de notre courant international", Revue internationale n°1)
Cependant, la vague de luttes inaugurée par le mouvement massif en France en mai-juin 1968 était plus ou moins terminée quand le CCI s'est formé puisque, globalement, on la voit se dérouler de 1968 à 1974, même si d'importantes luttes aient eu lieu en Espagne, au Portugal, en Hollande, etc. en 1976-77. Comme il n'y a pas de lien mécanique entre la lutte immédiate et le développement de l'organisation révolutionnaire, la croissance relativement rapide du début du CCI se poursuivit malgré le reflux. Mais ce développement était toujours profondément influencé par l'atmosphère de Mai 1968 lorsqu'aux yeux de beaucoup, la révolution avait semblé presque à portée de main. Rejoindre une organisation qui était ouvertement pour la révolution mondiale ne semblait pas à l'époque être un pari particulièrement téméraire.
Ce sentiment que nous vivions déjà dans les derniers jours du capitalisme, que la classe ouvrière développait sa force de façon presque exponentielle, était renforcé par une caractéristique du mouvement de la classe à l'époque où il n'y avait que de courtes pauses entre ce qu'on identifiait comme des "vagues" de lutte de classe internationale.
La deuxième vague, 1978-81
Parmi les facteurs que le CCI a analysés dans le reflux de la première vague, il y a la contre-offensive de la bourgeoisie qui avait été surprise en 1968 mais avait rapidement développé une stratégie politique ayant pour but de dévoyer la classe et de lui offrir une fausse perspective. C'était l'objectif de la stratégie de "la gauche au pouvoir" qui promettait la fin rapide des difficultés économiques qui étaient encore relativement légères à l'époque.
La fin de la première vague coïncida en fait plus ou moins avec le développement plus ouvert de la crise économique après 1973, mais ce fut cette évolution qui créa les conditions de nouvelles explosions de mouvements de classe. Le CCI analysa le début de "la deuxième vague" en 1978, avec la grève des chauffeurs routiers, le Winter of Discontent ("l'hiver du mécontentement") et la grève des sidérurgistes en Grande-Bretagne, la lutte des ouvriers du pétrole en Iran qui fut organisée dans des shoras ("conseils"), de vastes mouvements de grève au Brésil, la grève des dockers de Rotterdam avec son comité de grève indépendant, le mouvement combattif des ouvriers sidérurgistes à Longwy et Denain en France et, par-dessus tout, l'énorme mouvement de grève en Pologne en 1980.
Ce mouvement qui partit des chantiers navals de Gdansk fut une claire expression du phénomène de la grève de masse et nous permit d'approfondir notre compréhension de ce phénomène en revenant sur l'analyse qu'avait faite Rosa Luxemburg après les grèves de masse en Russie ayant culminé dans la révolution de 1905 (voir par exemple l'article "Notes sur la grève de masse", Revue internationale n°27). Nous avons vu dans la réapparition de la grève de masse le point le plus haut de la lutte depuis 1968, qui répondait à beaucoup de questions qui s'étaient posées dans les luttes précédentes, en particulier sur l'auto-organisation et l'extension. Nous défendions alors – contre la vision d'un mouvement de classe condamné à tourner en rond jusqu'à ce que "le parti" soit capable de le diriger vers le renversement révolutionnaire – que les luttes ouvrières suivaient une trajectoire, qu'elles tendaient à avancer, à tirer des leçons, à répondre à des questions posées dans les luttes précédentes. Par ailleurs, nous avons été capables de voir que la conscience politique des ouvriers polonais était en retard sur le niveau de la lutte. Ils formulaient des revendications générales qui allaient au-delà de questions simplement économiques, mais la domination du syndicalisme, de la démocratie et de la religion était très forte et tendait à déformer toute tentative d'avancer sur le terrain explicitement politique. Nous avons vu aussi la capacité de la bourgeoisie mondiale à s'unir contre la grève de masse en Pologne, en particulier via la création de Solidarnosc.
Mais nos efforts pour analyser les manœuvres de la bourgeoisie contre la classe ouvrière ont aussi donné naissance à une tendance très fortement empirique, marquée par "le bon sens commun", le plus clairement exprimée par le "clan" Chénier (voir note 3). Lorsque nous avons observé la stratégie politique de la bourgeoisie à la fin des années 1970 – stratégie de la droite au pouvoir et de la gauche dans l'opposition dans les pays centraux du capitalisme - nous avons dû approfondir la question du machiavélisme de la bourgeoisie. Dans l'article de la Revue internationale n° 31 sur la conscience et l'organisation de la bourgeoisie, nous examinions comment l'évolution du capitalisme d'État avait permis à cette classe de développer activement des stratégies contre la classe ouvrière. Dans une grande mesure, la majorité du mouvement révolutionnaire avait oublié que l'analyse marxiste de la lutte de classe est une analyse des deux classes principales de la société, pas seulement des avancées et des reculs du prolétariat. Ce dernier n'est pas engagé dans une bataille dans le vide mais il est confronté à la classe la plus sophistiquée de l'histoire qui, malgré sa fausse conscience, a montré une capacité à tirer des leçons des événements historiques, surtout quand il s'agit de faire face à son ennemi mortel, et est capable de manipulations et de tromperies sans fin. Examiner les stratégies de la bourgeoisie était une donnée évidente pour Marx et Engels, mais nos tentatives de poursuivre cette tradition ont souvent été rejetées par beaucoup d'éléments comme relevant de la "théorie du complot" alors qu'eux-mêmes étaient "ensorcelés" par l'apparence des libertés démocratiques.
Analyser le "rapport de force" entre les classes nous amène également à la question du cours historique. Dans la même Revue internationale où a été publié le premier texte le plus important sur la gauche dans l'opposition (Revue n°18, 2e trimestre 1979, qui contient les textes du 3e Congrès du CCI) et en réponse aux confusions des Conférences internationales et dans nos propres rangs (par exemple la tendance RC/GCI 2 qui annonçait un cours à la guerre), nous avons publié une contribution cruciale sur la question du cours historique qui était une expression de notre capacité de poursuivre et développer l'héritage de la Gauche communiste. Ce texte s'attache à réfuter certaines des idées fausses les plus communes dans le milieu révolutionnaire, en particulier l'idée empirique qu'il n'est pas possible pour les révolutionnaires de faire des prévisions générales sur le cours de la lutte de classe. Contre une telle vision, le texte réaffirme que la capacité de définir une perspective pour le futur – et pas seulement l'alternative générale socialisme ou barbarie – est l'une des caractéristiques du marxisme et l'a toujours été. Plus particulièrement, le texte insiste sur le fait que les marxistes ont toujours fondé leur travail sur leur capacité à comprendre le rapport de forces particulier entre les classes dans une période donnée, comme nous l'avons vu précédemment dans la partie de ce rapport sur la "reprise historique du prolétariat. De même, le texte montre que l'incapacité à saisir la nature du cours avait amené des révolutionnaires dans le passé à commettre des erreurs sérieuses (par exemple, les désastreuses aventures de Trotsky dans les années 1930).
Une extension de cette vision agnostique du cours historique a été le concept, défendu en particulier par le BIPR (Bureau International pour le Parti Révolutionnaire qui deviendra plus tard la TCI – Tendance Communiste Internationaliste – dont il sera question dans la suite de cet article), d'un cours "parallèle" vers la guerre et vers la révolution : “D'autres théories ont également surgi plus récemment suivant lesquelles "avec l'aggravation de la crise du capitalisme, ce sont les deux termes de la contradiction qui se renforcent en même temps : guerre et révolution ne s'excluraient pas mutuellement mais avanceraient de façon simultanée et parallèle sans qu'on puisse savoir laquelle arriverait à son terme avant l'autre". L'erreur majeure d'une telle conception est qu'elle néglige totalement le facteur lutte de classe dans la vie de la société, tout comme la conception développée par la Gauche italienne [la théorie de l’économie de guerre] pêchait par une surestimation de l'impact de ce facteur. Partant de la phrase du Manifeste communiste suivant laquelle "l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte de classes", elle en faisait l'implication mécanique à l'analyse du problème de la guerre impérialiste en considérant celle-ci comme une réponse à la lutte de classe sans voir, au contraire, qu'elle ne pouvait avoir lieu qu'en l'absence de celle-ci ou grâce à sa faiblesse. Mais pour fausse qu'elle fût, cette conception se basait sur un schéma correct, l'erreur provenant d'une délimitation incorrecte de son champ d'application. Par contre, la thèse du ‘parallélisme et de la simultanéité du cours vers la guerre et la révolution’ fait carrément fi de ce schéma de base du marxisme car elle suppose que les deux principales classes antagonistes de la société puissent préparer leurs réponses respectives à la crise du système – la guerre impérialiste pour l'une et la révolution pour l'autre – de façon complètement indépendante l'une de l'autre, du rapport entre leurs forces respectives, de leurs affrontements. S'il ne peut même pas s'appliquer à ce que détermine toute l'alternative historique de la vie de la société, le schéma du Manifeste communiste n'a plus de raison d'exister et on peut ranger tout le marxisme dans un musée au rayon des inventions ‘farfelues’ de l'imagination humaine”.3
Bien qu'il ait fallu quatre ans avant que nous changions de façon formelle la formule "cours à la révolution", avant tout parce qu'elle contenait l'implication d'une sorte de progrès inévitable et même linéaire vers des confrontations révolutionnaires, nous avions compris que le cours historique n'était ni statique, ni prédéterminé, mais qu'il était sujet aux changements dans l'évolution du rapport de forces entre les classes. D'où notre "slogan" au début des années 1980 en réponse à l'accélération tangible des tensions impérialistes (en particulier l'invasion de l'Afghanistan par la Russie et la réponse qu'elle avait provoquée de la part de l'Occident) : les Années de Vérité. Vérité non seulement dans le langage brutal de la bourgeoisie et de ses nouvelles équipes de droite mais vérité également dans le sens où l'avenir même de l'humanité allait se décider. Il est certain qu'il y a des erreurs dans ce texte, en particulier l'idée de "la faillite totale" de l'économie et d'une "offensive" prolétarienne déjà existante, quand les luttes ouvrières étaient encore nécessairement sur un terrain fondamentalement défensif. Mais le texte montrait une réelle capacité de prévision, non seulement parce que les ouvriers polonais nous ont rapidement offert une claire preuve que le cours à la guerre n'était pas ouvert et que le prolétariat était capable de fournir une alternative mais, aussi, parce que les événements de 1980 se sont avérés décisifs, même si ce n'était pas de la façon dont nous l'avions envisagé au départ. Les luttes en Pologne ont été un moment clé dans un processus menant à l'effondrement du bloc de l'Est et à l'ouverture définitive de la phase de décomposition, l'expression de l'impasse sociale dans laquelle aucune classe n'était capable de mettre en avant son alternative historique.
La "deuxième vague" a aussi été la période pendant laquelle MC nous a exhortés à "descendre du balcon" et à développer la capacité à participer aux luttes, à mettre en avant des propositions concrètes pour l'auto-organisation et l'extension comme, par exemple, pendant la grève des sidérurgistes en France. Ceci donna lieu à un certain nombre d'incompréhensions, par exemple la proposition de distribuer un tract appelant les ouvriers des autres secteurs à rejoindre la marche des sidérurgistes à Paris a été considérée comme une concession au syndicalisme parce que cette marche était organisée par les syndicats. Mais la question qui se posait n'était pas abstraite – dénoncer les syndicats en général - il fallait montrer comment, dans la pratique, les syndicats s'opposaient à l'extension de la lutte et pousser en avant les tendances à remettre en cause les syndicats et à prendre en main l'organisation de la lutte. Que cela était une possibilité réelle, l'écho que certaines de nos interventions dans des meetings massifs formellement appelés par les syndicats ont reçu, comme à Dunkerque, le montre. La question des "groupes ouvriers" qui naissaient de ces luttes fut posée également.4 Mais tout cet effort d'intervention active dans les luttes a eu également un aspect "négatif", l'apparition de tendances immédiatistes et activistes qui réduisaient le rôle de l'organisation révolutionnaire à apporter une assistance pratique aux ouvriers. Dans la grève des dockers de Rotterdam, nous avons joué un rôle de "porteurs d'eau" pour le comité de grève, ce qui donna lieu à une contribution extrêmement importante de MC5 qui établit de façon systématique comment le passage de l'ascendance à la décadence avait apporté de profonds changements dans la dynamique de la lutte de classe prolétarienne et donc à la fonction première de l'organisation révolutionnaire qui ne pouvait plus se considérer comme "l'organisateur" de la classe, mais comme une minorité lucide qui fournit une direction politique. Malgré cette clarification vitale, une minorité de l'organisation tomba encore plus dans l'ouvriérisme et l'activisme, caractérisés par l'opportunisme envers le syndicalisme manifesté dans le clan Chénier qui voyait les comités de grève syndicaux de la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne comme des organes de classe, tout en refusant en même temps de reconnaître la signification historique du mouvement de Pologne. Le texte de la Conférence extraordinaire de 1982 sur la fonction de l'organisation identifiait beaucoup de ces erreurs.6
La deuxième vague de luttes a touché à sa fin avec la répression en Pologne et cela a aussi accéléré le développement d'une crise dans le milieu révolutionnaire (la rupture des conférences internationales, la scission dans le CCI 7, l'effondrement du PCI : voir les Revue internationale n°28 et 32). Mais nous avons continué à développer notre compréhension théorique, en particulier en soulevant la question de la généralisation internationale comme prochaine étape de la lutte, et par le débat sur la critique de la théorie du maillon faible (voir Revue n°31 et 37). Ces deux questions, qui sont liées entre elles, font partie de l'effort pour comprendre la signification de la défaite en Pologne. A travers ces discussions nous avons vu que la clé de nouveaux développements majeurs de la lutte de classe mondiale – que nous définissions non seulement en termes d'auto-organisation et d'extension, mais de généralisation et de politisation internationales - résidait en Europe occidentale. Les textes sur la généralisation et d'autres polémiques réaffirmaient aussi que ce n'était pas la guerre qui constituait les meilleures conditions pour la révolution prolétarienne, comme la plupart des groupes de la tradition de la Gauche italienne continuaient à le défendre, mais la crise économique ouverte ; et c'était précisément cette perspective qui avaient été ouverte après 1968. Finalement, à la suite de la défaite en Pologne, certaines analyses clairvoyantes sur la rigidité sous-jacente des régimes staliniens furent mises en avant dans des articles tels que "La crise économique en Europe de l'Est et les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat" dans la Revue internationale n°34. Ces analyses furent la base de notre compréhension des mécanismes de l'effondrement du bloc de l'Est après 1989.
1983-1988 : La troisième vague
Une nouvelle vague de luttes fut annoncée par les grèves du secteur public en Belgique et confirmée au cours des années suivantes par la grève des mineurs en Grande-Bretagne, les luttes des travailleurs des chemins de fer et de la santé en France, des chemins de fer et de l'éducation en Italie, des luttes massives en Scandinavie, en Belgique de nouveau en 1986, etc. Quasiment chaque numéro de la Revue internationale de cette période comporte un article éditorial sur la lutte de classe et nous avons publié les différentes résolutions des congrès sur la question. Il est certain que nous tentions de situer ces luttes dans un contexte historique plus large. Dans les Revue internationale n°39 et 41, nous avons publié des articles sur la méthode nécessaire pour analyser la lutte de classe, cherchant à répondre à l'empirisme et au manque de cadre dominant dans le milieu qui pouvait passer d'une grande sous-estimation à des exagérations soudaines et absurdes. Le texte de la Revue n°41 en particulier réaffirmait certains éléments fondamentaux sur la dynamique de la lutte de classe – son caractère irrégulier, fait de "vagues", provenant du fait que la classe ouvrière est la première classe révolutionnaire à être une classe exploitée et qu'elle ne peut avancer de victoire en victoire comme la bourgeoisie mais doit passer par un processus de douloureuses défaites qui peuvent être le tremplin de nouvelles avancées de la conscience. Ce contour en dents de scie de la lutte de classe est encore plus prononcé dans la période de décadence de sorte que, pour comprendre la signification d'une explosion particulière de luttes de classe, nous ne pouvons l'examiner isolément comme une "photographie" : nous devons la situer dans une dynamique plus générale qui nous ramène à la question du rapport de forces entre les classes et du cours historique.
Au cours de la même période s'est développé le débat sur le centrisme par rapport au conseillisme qui, dans un premier temps, s'est posé sur le plan théorique – le rapport entre conscience et lutte ainsi que la question de la maturation souterraine de la conscience (voir l'article à ce sujet dans la Revue internationale n°43). Ces débats ont permis au CCI de faire une critique importante de la vision conseilliste selon laquelle la conscience ne se développe qu'au moment des luttes ouvertes et d'élaborer la distinction entre deux dimensions de la conscience : celle de son extension et celle de sa profondeur ("la conscience de – ou dans – la classe et la conscience de classe", une distinction qui fut immédiatement considérée comme "léniniste" par la future tendance FECCI). La polémique avec la CWO sur la question de la maturation souterraine notait des similarités entre les visions conseillistes de notre "tendance" et la vision de la CWO qui, à ce moment-là, défendait ouvertement la théorie kautskyste de la conscience de classe (comprise comme importée de l'extérieur à la classe ouvrière par les intellectuels bourgeois). L'article cherchait à avancer dans la vision marxiste des rapports entre l'inconscient et le conscient tout en faisant la critique de la vision de la CWO relevant du "bon sens" commun.
Il est un autre domaine dans lequel la lutte contre le conseillisme n'avait pas été menée jusqu'au bout : tout en reconnaissant en théorie que la conscience de classe peut se développer en dehors des périodes de lutte ouverte, il y avait une tendance de longue date à espérer que, néanmoins, du fait que nous ne vivions plus dans une période de contre-révolution, la crise économique provoquerait des sauts soudains dans la lutte de classe et la conscience de classe. La conception conseilliste d'un lien automatique entre la crise et la lutte de classe revenait ainsi par la fenêtre et, depuis lors, elle est revenue souvent nous hanter, y compris dans la période qui a suivi le crash de 2008.
Un prolétariat à l'offensive ? Les difficultés de la politisation
Appliquant l'analyse que nous avions développée dans le débat sur le maillon faible, nos principaux textes sur la lutte de classe dans cette période reconnaissent l'importance d'un nouveau développement de la lutte de classe dans les pays centraux d'Europe. Les "Thèses sur la lutte de classe [563]" (1984) publiées dans la Revue internationale n°37 soulignent les caractéristiques de cette vague :
"Les caractéristiques de la vague présente, telles qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes, tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats,
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes,
- développement progressif, au sein de l'ensemble du prolétariat, de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes,
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de l'aptitude à leur auto-organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications et qui s'est réalisé une nouvelle fois dans les affrontements de ces derniers mois." (Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe)
Le plus important de ces "pièges et mystifications" fut le déploiement du syndicalisme de base contre les vraies tendances à l'auto-organisation des ouvriers, une tactique assez sophistiquée capable de créer des coordinations prétendument antisyndicales qui, en réalité, servaient de dernier rempart du syndicalisme. Mais tout en n'étant en aucune façon aveugles vis-à-vis des dangers auxquels était confrontée la lutte de classe, les Thèses, comme le texte sur les Années de Vérité, contenaient toujours la notion d'une offensive du prolétariat et prévoyaient que la troisième vague atteindrait un niveau supérieur aux précédentes, ce qui impliquait qu'elle atteindrait nécessairement le stade de la généralisation internationale.
Le fait que le cours soit à des confrontations de classe n'implique pas que le prolétariat soit déjà à l'offensive : jusqu'à la veille de la révolution, ses luttes seront essentiellement défensives face aux attaques incessantes de la classe dominante. De telles erreurs étaient le produit d'une tendance de longue date à surestimer le niveau immédiat de la lutte de classe. C'était souvent en réaction à l'incapacité du milieu prolétarien à voir plus loin que le bout de son nez, thème souvent développé dans nos polémiques et, aussi, dans la Résolution sur la situation internationale du 6e Congrès du CCI en 1985, publiée dans la Revue internationale n°44, qui contient un long passage sur la lutte de classe. Cette partie est une excellente démonstration de la méthode historique du CCI pour analyser la lutte de classe, une critique du scepticisme et de l'empirisme qui dominaient le milieu, et elle identifie aussi la perte des traditions historiques et la rupture entre la classe et ses organisations politiques comme les faiblesses clé du prolétariat. Mais, rétrospectivement, elle insiste trop sur la désillusion envers la gauche et en particulier envers les syndicats, et sur la croissance du chômage comme facteurs potentiels de radicalisation de la lutte de classe. Elle n'ignore pas les aspects négatifs de ces phénomènes mais ne voit pas comment, avec l'arrivée de la phase de décomposition, le désillusionnement passif vis-à-vis des anciennes organisations ouvrières et la généralisation du chômage, en particulier parmi les jeunes, pourraient devenir de puissants éléments de démoralisation du prolétariat et saper son identité de classe. Il est également parlant, par exemple, qu'en 1988 (Revue internationale n°54), nous continuions à publier une polémique sur la sous-estimation de la lutte de classe dans le camp prolétarien. Les arguments sont corrects en général mais ils montrent aussi le manque de conscience de ce qui se profilait – l'effondrement des blocs et le reflux le plus long que nous ayons connu.
Mais, vers la fin des années 1980, il est devenu clair, pour une minorité d'entre nous au moins, que le mouvement en avant de la lutte de classe qui avait été analysé dans tant d'articles et de résolutions au cours de cette période, s'enlisait. Il y eut un débat à ce sujet au 8e Congrès du CCI (Revue internationale n°59), en particulier par rapport à la question de la décomposition et de ses effets négatifs sur la lutte de classe. Une partie considérable de l'organisation voyait la "troisième vague" se renforcer sans cesse et l'impact de certaines défaites était sous-estimé. Cela avait été le cas notamment pour la grève des mineurs en Grande-Bretagne dont la défaite n'arrêta pas la vague mais qui eut un effet à long terme sur la confiance de la classe ouvrière en elle-même et pas seulement dans ce pays, tout en renforçant l'engagement de la bourgeoisie dans le démantèlement des "vieilles" industries. Le 8e Congrès fut aussi celui où fut émise l'idée que, désormais, les mystifications bourgeoises "ne duraient pas plus que trois semaines".
La discussion sur le centrisme envers le conseillisme avait soulevé le problème de la fuite du prolétariat vis-à-vis de la politique mais nous ne fumes pas capables d'appliquer cette question à la dynamique du mouvement de classe, en particulier à la question de son manque de politisation, de sa difficulté à développer une perspective même lorsque les luttes étaient auto-organisées et montraient une tendance à s'étendre. Nous pouvons même dire que le CCI n'a jamais développé une critique adéquate de l'impact de l'économisme et de l'ouvriérisme dans ses propres rangs, le menant à sous-estimer l'importance des facteurs qui poussent le prolétariat au-delà des limites du lieu de travail et des revendications économiques immédiates.
Ce n'est qu'avec l'effondrement du bloc de l'Est que nous avons vraiment pu saisir tout le poids de la décomposition et que nous avons prévu alors une période de nouvelles difficultés pour le prolétariat (Revue internationale n°60). Ces difficultés dérivaient précisément de l'incapacité de la classe ouvrière à développer sa perspective, mais allaient être activement renforcées par la vaste campagne idéologique de la classe dominante sur le thème de "la mort du communisme" et de la fin de la lutte de classe.
La période de décomposition
Suite à l'effondrement du bloc de l'Est, confrontée au poids de la décomposition et des campagnes anti-communistes de la classe dominante, la lutte de classe a subi un reflux qui s'est avéré très profond. Malgré quelques expressions de combattivité au début des années 1990 et de nouveau à la fin de celles-ci, le reflux devait persister au siècle suivant, tandis que la décomposition avançait de façon visible, (exprimée le plus clairement dans l'attaque des Twin Towers et les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak qui l'ont suivie). Face à l'avancée de la décomposition, nous avons été obligés de réexaminer toute la question du cours historique dans un rapport pour le 14e Congrès (publié dans la Revue internationale n°107 [564]). D'autres textes notables sur ce thème ont été produits : "Pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme" dans les Revue n°103 [232] et 104 [234] et la Résolution sur la situation internationale du 15e Congrès du CCI [480] (2003), Revue n°113).
Le rapport sur le cours historique de 2001 après avoir réaffirmé les acquis théoriques des révolutionnaires du passé et notre propre cadre tel qu'il est développé dans le document du 3e Congrès, est centré sur les modifications apportées par l'entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition, où la tendance à la guerre mondiale est contrecarrée non seulement par l'incapacité de la bourgeoisie à mobiliser le prolétariat mais, aussi, par la dynamique centrifuge du "chacun pour soi" qui impliquait des difficultés grandissantes pour la reformation de blocs impérialistes. Cependant, comme la décomposition contient le risque d'une descente graduelle dans le chaos et la destruction irrationnelle, elle crée d'immenses dangers pour la classe ouvrière et le texte réaffirme le point de vue des Thèses d'origine selon lequel la classe pourrait être graduellement écrasée par l'ensemble de ce processus au point de ne plus être capable de se dresser contre la marée de la barbarie. Le texte tente aussi de distinguer entre les événements matériels et idéologiques impliqués dans le processus de "broyage" : les éléments idéologiques émergeant spontanément du sol du capitalisme en déclin et les campagnes consciemment orchestrées par la classe dominante, comme la propagande sans fin sur la mort du communisme. En même temps, le texte identifiait des éléments matériels plus directs comme le démantèlement des anciens centres industriels qui avaient souvent été au cœur de la combattivité ouvrière au cours des précédentes vagues de luttes (les mines, la sidérurgie, les docks, les usines automobile, etc.). Mais, tandis que ce nouveau rapport ne cherchait pas à masquer les difficultés qu'affrontait la classe, il examinait les signes de reprise de la combattivité et les difficultés persistantes de la classe dominante à entraîner la classe ouvrière dans ses campagnes guerrières et concluait que les potentialités de revitalisation de la lutte de classe étaient toujours intactes ; et cela allait se confirmer deux ans après, dans les mouvements sur les "réformes des retraites" en Autriche et en France (2003).
Dans le rapport sur la lutte de classe dans la Revue internationale n°117 [302], nous identifions un tournant, une reprise de la lutte manifestée dans ces mouvements sur les retraites et dans d'autres expressions. Cela se confirma dans de nouveaux mouvements en 2006 et en 2007 comme lors du mouvement contre le CPE en France et dans les luttes massives dans l'industrie textile et dans d'autres secteurs en Égypte. Le mouvement des étudiants en France fut en particulier un témoignage éloquent de l'existence d'une nouvelle génération de prolétaires confrontée à un avenir très incertain (voir les "Thèses sur le mouvement des étudiants en France [148]" dans la Revue n°125 et aussi l'éditorial de ce même numéro). Cette tendance fut confirmée par la suite par la "jeunesse" en Grèce en 2008-2009, la révolte étudiante en Grande-Bretagne en 2010 et, par-dessus tout, par le printemps arabe et les mouvements des Indignados et d'Occupy en 2011-2013 qui ont donné lieu à plusieurs articles de la Revue internationale, en particulier celui de la Revue n°147 [565]. Il y eut clairement des acquis dans ces mouvements – l'affirmation de la forme assemblée, un engagement plus direct envers des questions politiques et morales, un clair sens internationaliste, éléments sur la signification desquels nous reviendrons plus tard. Dans notre rapport au BI plénier d'octobre 2013, nous avons critiqué le rejet économiste et ouvriériste de ces mouvements et la tentative de voir le cœur de la lutte de classe mondiale dans les nouvelles concentrations industrielles d'Extrême-Orient. Mais nous n'avons pas caché le problème fondamental révélé dans ces révoltes : la difficulté pour leurs jeunes protagonistes de se concevoir comme faisant partie de la classe ouvrière, l'énorme poids de l'idéologie de la citoyenneté et donc du démocratisme. La fragilité de ces mouvements fut clairement indiquée au Moyen-Orient où nous avons pu voir depuis lors de claires régressions de la conscience (comme en Egypte et en Israël) et, en Libye et en Syrie, une chute quasi immédiate dans la guerre impérialiste. Il y a eu d'authentiques tendances à la politisation dans ces mouvements puisqu'ils ont posé des questions profondes sur la nature même du système social existant et, comme lors des précédents surgissements dans les années 2000, ils produisirent une minuscule minorité d'éléments en recherche mais, au sein de cette minorité, il existait une immense difficulté à aller vers un engagement militant révolutionnaire. Même lorsque ces minorités semblaient avoir échappé aux chaînes les plus évidentes de l'idéologie bourgeoise se décomposant, elles les ont souvent rencontrées sous des formes plus subtiles et plus radicales qui sont cristallisées dans l'anarchisme, la théorie de la "communisation" et des tendances similaires, toutes fournissant une preuve supplémentaire que nous avions tout-à-fait raison de voir "le conseillisme comme le plus grand danger" dans les années 1980 puisque tous ces courants échouent précisément sur la question des instruments politiques de la lutte de classe et, avant tout, l'organisation révolutionnaire.
Un bilan complet de ces mouvements (et de nos discussions à ce sujet) n'a pas encore été fait et on ne peut le faire ici. Mais il semble que le cycle de 2003-2013 touche à sa fin et que nous sommes face à une nouvelle période de difficultés 8. C'est particulièrement évident au Moyen-Orient où les protestations sociales ont rencontré la répression la plus rude et la barbarie impérialiste ; et cette involution terrible ne peut qu'avoir un effet déprimant sur les ouvriers du monde entier. De toute façon, si nous nous rappelons notre analyse du développement inégal de la lutte de classe, le reflux après ces explosions est inévitable et, pour quelque temps, cela tendra à exposer plus la classe à l'impact nocif de la décomposition.
La sous-estimation de l'ennemi
“... Selon les rapports, vous avez dit que j'avais prévu l'effondrement de la société bourgeoise en 1898. Il y a une légère erreur quelque part. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous pourrions peut-être prendre le pouvoir d'ici 1898. Si cela n'arrive pas, la vieille société bourgeoise pourrait encore végéter un moment, pourvu qu'une poussée de l'extérieur ne fasse pas s'effondrer toute la vieille bâtisse pourrie. Un vieil emballage moisi comme ça peut survivre à sa mort intérieure fondamentale encore quelques décennies si l'atmosphère n'est pas troublée” (Engels à Bebel, 24-26 octobre 1891).
Dans ce bref passage, l'erreur est si évidente qu'il n'est pas nécessaire de la commenter : l'idée de la classe ouvrière venant au pouvoir en 1898 était une illusion probablement générée par la croissance rapide du parti social-démocrate en Allemagne. Une dérive réformiste se mélange à un optimisme exagéré et à une impatience qui, dans le Manifeste communiste, avaient donné lieu à la formulation selon quoi "la chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont inévitables" (et peut-être pas si loin). Mais à côté de cela, il y a une idée très valable : une société condamnée par l'histoire peut encore maintenir son "vieil emballage moisi" longtemps après que le besoin de la remplacer ait surgi. En fait non des décennies mais un siècle après la Première Guerre mondiale, nous voyons la sinistre détermination de la bourgeoisie de maintenir son système en vie quel qu'en soit le prix pour l'avenir de l'humanité.
La plupart de nos erreurs des quarante dernières années semblent résider dans la sous-estimation de la bourgeoisie, de la capacité de cette classe à maintenir son système pourri et donc de l'immensité des obstacles auxquels fait face la classe ouvrière pour assumer ses tâches révolutionnaires. Pour faire le bilan des luttes de 2003-2013, ce doit être un élément-clé.
Le rapport pour le 21e Congrès de la section en France en 2014 [566] réaffirme l'analyse du tournant : les luttes de 2003 ont soulevé la question-clé de la solidarité et le mouvement de 2006 contre le CPE en France fut un mouvement profond qui prit la bourgeoisie par surprise et la força à reculer car il posait le réel danger d'une extension aux travailleurs actifs. Mais à sa suite, il y a eu tendance à oublier la capacité de la classe dominante à récupérer de tels chocs et à renouveler son offensive idéologique et ses manœuvres, en particulier quand il s'agit de restaurer l'influence des syndicats. Nous avons vu cela en France dans les années 1980 avec le développement des coordinations et nous l'avons vu à nouveau en 1995 mais, comme le souligne le rapport du dernier Congrès de la section en France, nous l'avons oublié dans nos analyses des mouvements en Guadeloupe et dans les luttes sur les retraites en 2010 qui ont effectivement épuisé le prolétariat français et l'ont empêché d'être réceptif au mouvement en Espagne l'année suivante. Et de nouveau, malgré notre insistance passée sur l'énorme impact des campagnes anti-communistes, le rapport à ce Congrès suggère également que nous avons trop rapidement oublié que les campagnes contre le marxisme et contre le communisme ont toujours un poids considérable sur la nouvelle génération qui est apparue pendant la précédente décennie.
Certaines autres faiblesses au cours de cette période commencent seulement à être reconnues.
Dans nos critiques de l'idéologie des "anticapitalistes" des années 1990, avec leur insistance sur la mondialisation comme étant une phase totalement nouvelle dans la vie du capitalisme – et des concessions faites dans le mouvement prolétarien à cette idéologie, en particulier par le BIPR qui semblait mettre en question la décadence – nous n'avons pas reconnu les éléments de vérité au cœur de cette mythologie : que la nouvelle stratégie de "la mondialisation" et le néo-libéralisme ont permis à la classe dominante de résister aux récessions des années 1980 et même à ouvrir de vraies possibilités d'expansion dans des zones où les anciennes divisions entre blocs et les modèles économiques semi-autarciques avaient érigé de considérables barrières au mouvement du capital. L'exemple le plus évident de ce développement est évidemment la Chine dont nous n'avons pas pleinement anticipé la montée au statut de "superpuissance", bien que depuis les années 1970 et la rupture entre la Russie et la Chine nous ayons toujours reconnu que c'était une sorte d'exception à la règle de l'impossible "indépendance" par rapport à la domination des deux blocs. Nous avons donc été en retard pour comprendre l'impact qu'allait avoir sur le développement global de la lutte de classe l'émergence de ces énormes concentrations industrielles dans certaines de ces régions.. Les raisons théoriques sous-jacentes de notre incapacité à prévoir la montée de la Nouvelle Chine devront être recherchées plus en profondeur dans les discussions sur notre analyse de la crise économique.
De façon peut-être plus significative, nous n'avons pas investigué de façon adéquate le rôle joué par l'effondrement de beaucoup d'anciens centres de combattivité de classe dans les pays centraux en sapant l'identité de classe. Nous avons eu raison d'être sceptiques envers les analyses purement sociologiques de la conscience de classe mais le changement de composition de la classe ouvrière dans les pays centraux, la perte des traditions de lutte, le développement des formes de travail les plus atomisées, ont certainement contribué à l'apparition de générations de prolétaires qui ne se voient plus comme partie de la classe ouvrière, même quand ils s'engagent dans la lutte contre les attaques de l'État, comme on l'a vu pendant les mouvements des Occupy et des Indignados en 2011-2013. Particulièrement important est le fait que l'échelle des "délocalisations" qui ont eu lieu dans les pays occidentaux résultait souvent de défaites majeures – les mineurs en Grande-Bretagne, les sidérurgistes en France à titre d'exemple. Ces questions, bien que soulevées dans le rapport de 2001 sur le cours historique, n'ont pas vraiment été traitées et ont été reposées dans le rapport de 2013 sur la lutte de classe. C'est là un retard très important et nous n'avons toujours pas incorporé ce phénomène dans notre cadre, ce qui requerrait certainement une réponse aux tentatives erronées de courants comme les autonomistes et la TCI pour théoriser la "recomposition" de la classe ouvrière.
En même temps, la prévalence du chômage à long terme ou de l'emploi précaire a exacerbé la tendance à l'atomisation et à la perte de l'identité de classe. Les luttes autonomes des chômeurs, capables de se relier aux luttes des ouvriers actifs, furent bien moins significatives que nous l'avions prévu dans les années 1970 et 1980 (cf. Les "Thèses sur le chômage [567]" dans la Revue internationale n°14 ou la Résolution sur la situation internationale du 6e Congrès du CCI évoquée plus haut) et de nombreux chômeurs et employés précaires sont tombés dans la lumpenisation, la culture de bandes ou les idéologies politiques réactionnaires. Les mouvements des étudiants en France en 2006 et les révoltes sociales vers la fin de la décennie du nouveau siècle commencèrent à apporter des réponses à ces problèmes, offrant la possibilité d'intégrer les chômeurs dans les manifestations de masse et les assemblées de rue, mais c'était toujours dans un contexte où l'identité de classe est encore très faible.
Notre principale insistance pour expliquer la perte de l'identité de classe a porté sur le plan idéologique, soit en tant que produit immédiat de la décomposition (chacun-pour-soi, culture de bande, fuite dans l'irrationalité, etc.) ou bien par l'utilisation délibérée des effets de la décomposition par la classe dominante – de façon la plus évidente, les campagnes sur la mort du communisme mais, aussi, l'assaut idéologique au jour le jour des médias et de la publicité autour de fausses révoltes, l'obsession du consumérisme et des célébrités, etc. C'est évidemment vital mais, d'une certaine façon, nous n'avons fait que commencer à investiguer comment ces mécanismes idéologiques opèrent au niveau le plus profond – une tâche théorique clairement posée par les "Thèses sur la morale" 9 et dans nos efforts pour développer et appliquer la théorique marxiste de l'aliénation.
L'identité de classe n'est pas, comme la TCI l'a parfois défendu, une sorte de sentiment simplement instinctif ou à demi-conscient qu'auraient les ouvriers, qu'il faudrait distinguer de la véritable conscience de classe préservée par le parti. Elle est elle-même une partie intégrante de la conscience de classe, fait partie du processus où le prolétariat se reconnaît en tant que classe distincte avec un rôle et un potentiel uniques dans la société capitaliste. De plus, elle n'est pas limitée au domaine purement économique mais dès le début comportait un puissant élément culturel et moral : comme Rosa Luxemburg l'écrivait, le mouvement ouvrier ne se limite pas à une question de "couteau et de fourchette" mais est "un grand mouvement culturel". Le mouvement ouvrier du 19e siècle a donc incorporé non seulement les luttes pour les revendications économiques et politiques immédiates mais aussi l'organisation de l'éducation, des débats sur l'art et sur la science, des activités de sport et de loisir, etc. Le mouvement fournissait tout un milieu dans lequel les prolétaires et leurs familles pouvaient s'associer en dehors des lieux de travail, renforçant la conviction que la classe ouvrière était le véritable héritier de tout ce qui était sain dans les précédentes expressions de la culture humaine. Ce genre de mouvement de la classe ouvrière a atteint son summum dans la période de la social-démocratie mais c'était aussi les prémisses de sa chute. Ce qui fut perdu dans la grande trahison de 1914, ce fut non seulement l'Internationale et les anciennes formes d'organisation politique et économique mais, aussi, un milieu culturel plus vaste qui ne survécut que dans la caricature constituée par les "fêtes" des partis staliniens et gauchistes. 1914 constitua donc le premier de toute une série de coups contre l'identité de classe au cours du siècle passé : la dissolution politique de la classe dans la démocratie et dans l'antifascisme dans les années 1930 et 1940, l'assimilation du communisme au stalinisme, la rupture de la continuité organique avec les organisations et les traditions du passé apportée par la contre-révolution : bien avant l'ouverture de la phase de décomposition, ces traumatismes pesaient déjà lourdement sur la capacité du prolétariat à se constituer en classe avec un réel sens de lui-même en tant que force sociale portant en lui "la dissolution de toutes les classes". Ainsi, toute investigation du problème de la perte de l'identité de classe devra revenir sur l'ensemble de l'histoire du mouvement ouvrier et ne pas se restreindre aux dernières décennies. Même si c'est dans les dernières décennies que le problème est devenu si aigu et si menaçant pour l'avenir de la lutte de classe, c'est seulement l'expression concentrée de processus qui ont une histoire bien plus longue.
Pour revenir au problème de notre sous-estimation de la classe dominante : la culmination de notre sous-estimation de longue date de l'ennemi - et qui constitue aussi la plus grande faiblesse de nos analyses - a été atteinte après le crash financier de 2007-08, quand est revenue au premier plan une ancienne tendance à considérer que la classe dominante au centre du système aurait plus ou moins épuisé toutes les options, que l'économie aurait atteint une impasse totale. Ceci ne pouvait qu'augmenter les sentiments de panique, exacerber l'idée souvent non exprimée et tacite selon laquelle la classe ouvrière et le minuscule mouvement révolutionnaire étaient face à leur dernière chance, ou avaient déjà "raté le coche". Certaines formulations sur la dynamique de la grève de masse avaient nourri cet immédiatisme. En réalité, nous n'avions pas tort de voir des "germes" de la grève de masse dans le mouvement des étudiants en France en 2006, ou dans d'autres comme celui des sidérurgistes en Espagne la même année, celui d'Egypte en 2007, au Bangladesh ou ailleurs. Notre erreur réside dans le fait d'avoir pris la graine pour la fleur et de ne pas avoir compris que la période de germination ne pouvait qu'être longue. Il est clair que ces erreurs d'analyse étaient très liées aux déformations activistes et opportunistes de notre intervention au cours de cette période, bien que ces erreurs doivent également être comprises dans la discussion plus large de notre rôle comme organisation (voir le texte sur le travail de la fraction).
La dimension morale de la conscience de classe
"Si le propriétaire de la force de travail a travaillé aujourd'hui, il doit pouvoir recommencer demain dans les mêmes conditions de vigueur et de santé. Il faut donc que la somme des moyens de subsistance suffise pour l'entretenir dans son état de vie normal.
Les besoins naturels, tels que nourriture, vêtements, chauffage, habitation, etc., diffèrent suivant le climat et autres particularités physiques d'un pays. D'un autre côté le nombre même de soi-disant besoins naturels, aussi bien que le mode de les satisfaire, est un produit historique, et dépend ainsi, en grande partie, du degré de civilisation atteint. Les origines de la classe salariée dans chaque pays, le milieu historique où elle s'est formée, continuent longtemps à exercer la plus grande influence sur les habitudes, les exigences et par contrecoup les besoins qu'elle apporte dans la vie. La force de travail renferme donc, au point de vue de la valeur, un élément moral et historique, ce qui la distingue des autres marchandises." (Marx, Le Capital, volume I, chapitre 6).
Aborder Le Capital sans vraiment saisir que Marx cherche à comprendre le fonctionnement de rapports sociaux particuliers qui sont le produit de milliers d'années d'histoire et qui, comme d'autres rapports sociaux, sont condamnés à disparaître, c'est se trouver ensorcelé par la vision réifiée du monde que l'étude de Marx a pour but de combattre. Cette démarche affecte tous les marxologues intellectuels, qu'ils se considèrent comme de confortable professeurs ou des communistes ultra-radicaux, qui tendent à analyser le capitalisme comme un système auto-suffisant, aux lois éternelles, opérant de la même façon dans toutes les conditions historiques, pendant la décadence du système comme dans son ascendance. Mais les remarques de Marx sur la valeur de la force de travail nous ouvrent les yeux sur ce point de vue purement économique sur le capitalisme et montrent en quoi les facteurs "historiques et moraux" jouent un rôle crucial dans la détermination d'un fondement "économique" de cette société : la valeur de la force de travail. En d'autres termes, contrairement aux affirmations de Paul Cardan (alias Castoriadis, le fondateur du groupe Socialisme ou Barbarie) pour qui Le Capital était un livre sans lutte de classe, Marx défend que l'affirmation de la dignité humaine par la classe exploitée - la dimension morale par excellence – ne peut pas, par définition, être retranchée d'un examen scientifique de la façon dont opère le système capitaliste. Dans la même phrase, Marx répond aussi à ceux qui le considèrent comme un relativiste moral, comme un penseur qui rejette toute morale comme étant des phrases creuses et hypocrites provenant de telle ou telle classe dominante.
Aujourd'hui, le CCI est obligé d'approfondir sa compréhension de l' "élément historique et moral" dans la situation de la classe ouvrière – historique non seulement dans le sens des luttes des 40 dernières années ou des 80 ou des 100 dernières années, ou même depuis les tout premiers mouvements des ouvriers à l'aube du capitalisme, mais dans le sens de la continuité et de la rupture entre les luttes de la classe ouvrière et celles des précédentes classes exploitées et, au-delà de cela, avec toutes les tentatives précédentes de l'espèce humaine pour surmonter les entraves à la réalisation de ses vraies potentialités, pour libérer "ses facultés qui sommeillent", comme Marx définit la caractéristique centrale du travail humain en soi. C'est là que l'histoire et l'anthropologie se rejoignent et parler d'anthropologie, c'est parler de l'histoire de la morale. D'où l'importance des "Thèses sur la morale" et de la discussion de celles-ci.
En extrapolant à partir des Thèses, nous pouvons noter certains moments-clés qui marquent la tendance à l'unification de l'espèce humaine : le passage de la horde au communisme primitif plus large, l'avènement de "l'âge axial" en lien avec la généralisation naissante des rapports marchands qui ont vu l'émergence de la plupart des religions du monde, expressions dans l'"esprit" de l'unification d'une humanité qui ne pouvait cependant pas être unie en réalité ; l'expansion globale du capitalisme ascendant qui, pour la première fois, tendait à unifier l'humanité sous le règne il est vrai brutal d'un mode de production unique ; la première vague révolutionnaire qui contenait la promesse d'une communauté humaine matérielle. Cette tendance a reçu un terrible coup avec le triomphe de la contre-révolution et ce n'est pas par hasard si, à la veille de la guerre la plus barbare de l'histoire, Trotski en 1938 pouvait déjà parler de "crise de l'humanité". Il est clair qu'il avait à l'esprit comme preuve de cette crise la Première Guerre mondiale, la Russie stalinienne, la Grande Dépression et la marche vers la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était peut-être par-dessus tout l'image de l'Allemagne nazie (même s'il ne vécut pas pour être témoin des expressions les plus horribles de ce régime barbare) qui confirmait cette idée, celle que l'humanité elle-même était soumise à un test, parce qu'ici avait lieu un processus sans précédent de régression au sein de l'un des berceaux de la civilisation bourgeoise : la culture nationale qui avait donné naissance à Hegel, Beethoven, Goethe succombait maintenant à la domination des voyous, des occultistes et des nihilistes, motivés par un programme qui cherchait à mettre un point final à toute possibilité d'une humanité unifiée.
Dans la décomposition, cette tendance à la régression, ces signes que l'ensemble du progrès de l'humanité jusqu'à présent s'effondre sur lui-même, est devenue "normalisée" sur la planète. Ceci s'exprime avant tout dans le processus de fragmentation et de chacun pour soi : l'humanité, à un stade où la production et la communication sont plus unifiés que jamais, est en danger de se diviser et de se sous-diviser en nations, régions, religions, races, gangs, tout cela accompagné d'une régression tout aussi destructrice au niveau intellectuel avec la montée de nombreuses formes de fondamentalisme religieux, de nationalisme et de racisme. La montée de l'État islamique fournit un résumé de ce processus à l'échelle historique : là où par le passé l'Islam fut le produit d'une avancée morale et intellectuelle à travers et au-delà de toute la région, aujourd'hui l'Islamisme, sous sa forme sunnite comme sous sa forme chiite, est une pure expression de négation de l'humanité – de pogromisme, de misogynie et d'adoration de la mort.
Clairement, ce danger de régression contamine le prolétariat lui-même. Des parties de la classe ouvrière en Europe par exemple, ayant vu la défaite de toutes les luttes des années 1970 et 1980 contre la décimation de l'industrie et des emplois, sont ciblées avec succès par des partis racistes qui ont trouvé de nouveaux boucs-émissaires à accuser pour leur misère – les vagues d'immigrants vers les pays centraux, fuyant le désastre économique, écologique, militaire de leurs régions. Ces immigrants sont généralement plus "visibles" que ne l'étaient les Juifs dans l'Europe des années 1930, et ceux d'entre eux qui adoptent la religion musulmane peuvent se lier directement aux forces engagées dans les conflits impérialistes de leurs pays d' "accueil". Cette capacité de la droite plutôt que de la gauche à pénétrer des parties de la classe ouvrière (en France par exemple, d'anciens "bastions" du Parti communiste sont tombés dans le giron du Front National) est une expression significative d'une perte d'identité de classe : là où par le passé on pouvait voir les ouvriers perdre leurs illusions dans la gauche du fait de l'expérience du rôle qu'elle jouait dans le sabotage de leurs luttes, aujourd'hui l'influence déclinante de cette gauche est plus un reflet du fait que la bourgeoisie a moins besoin de forces de mystification prétendant agir au nom de la classe ouvrière parce que cette dernière est carrément moins capable de se voir comme une classe. Cela reflète aussi l'un des conséquences les plus significatives du processus global de décomposition et du développement inégal de la crise économique mondiale : la tendance de l'Europe et de l'Amérique du Nord à devenir des îlots de "santé" relative dans un monde devenu fou. L'Europe en particulier ressemble de plus en plus à un bunker aux stocks garnis se défendant contre des masses désespérées cherchant refuge contre une apocalypse générale. La réponse de "bon sens commun" de tous les assiégés, quelle que soit la rudesse du régime au sein du bunker, est de resserrer les rangs et de s'assurer que les portes du bunker sont soigneusement fermées. L'instinct de survie devient alors totalement séparé de tout sentiment ou de toute impulsion morale.
Les crises de "l'avant-garde" doivent aussi être situées au sein de ce processus d'ensemble : l'influence de l'anarchisme sur les minorités politisées générées par les luttes de 2003-13, avec sa fixation sur l'immédiat, le lieu de travail, la "communauté" ; la montée de l'ouvriérisme à la Mouvement communiste et son pôle opposé, la tendance "communisatrice" qui rejette la classe ouvrière come sujet de la révolution ; le glissement vers la banqueroute morale au sein de la Gauche communiste elle-même que nous analyserons dans d'autres rapports. Bref, l'incapacité de l'avant-garde révolutionnaire à saisir la réalité de la régression à la fois morale et intellectuelle balayant le monde et de lutter contre.
Le cours historique
En réalité, la situation apparaît très grave. Cela a-t-il encore un sens de parler d'un cours historique vers les confrontations de classe ? La classe ouvrière aujourd'hui est aussi éloignée dans le temps de 1968 que 1968 l'était des débuts de la contre-révolution et, de plus, sa perte d'identité de classe signifie que la capacité à se réapproprier les leçons des luttes qui ont pu avoir lieu au cours des décennies précédentes a diminué. En même temps, les dangers inhérents au processus de décomposition – d'un épuisement graduel de la capacité du prolétariat à résister à la barbarie du capitalisme – ne sont pas statiques mais tendent à s'amplifier au fur et à mesure que le système social capitaliste s'enfonce plus profondément dans le déclin.
Le cours historique n'a jamais été déterminé pour toujours et la possibilité de confrontations de classe massives dans les pays-clés du capitalisme n'est pas une étape préétablie dans le voyage vers le futur.
Néanmoins nous continuons à penser que le prolétariat n'a pas dit son dernier mot, même quand ceux qui prennent la parole n'ont pas tellement conscience de parler pour le prolétariat.
Dans notre analyse des mouvements de classe de 1968-89, nous avions noté l'existence de certains hauts moments qui fournissaient une inspiration pour les luttes futures et un instrument pour mesurer leur progrès. Ainsi l'importance de 1968 en France soulevant la question d'une nouvelle société ; des luttes en Pologne en 1980 qui réaffirmaient les méthodes de la grève de masse ; de l'extension et de l'auto-organisation de la lutte, etc. Dans une grande mesure, ce sont des questions restées sans réponse. Mais nous pouvons aussi dire que les luttes de la dernière décennie ont également connu des points hauts, avant tout parce qu'elles ont commencé à poser la question-clé de la politisation que nous avons identifiée comme une faiblesse centrale des luttes du cycle précédent. De plus, ce qu'il y a de plus important dans ces mouvements – comme celui des étudiants en France en 2006 ou la révolte des Indignados en Espagne – c'est d'avoir posé beaucoup de questions montrant que, pour le prolétariat, la politique ce n'est pas "de savoir s'il faudrait garder ou faire sortir l'équipe gouvernementale", mais le changement des rapports sociaux ; que la politique du prolétariat concerne la création d'une nouvelle morale opposée à la vision du monde du capitalisme où l'homme est un loup pour l'homme. À travers leur "indignation" contre le gâchis de potentiel humain et le caractère destructeur du système actuel ; de par leurs efforts pour gagner les secteurs les plus aliénés de la classe ouvrière (l'appel des étudiants français à la jeunesse des banlieues) ; par le rôle d'avant-garde joué par les jeunes femmes, par leur démarche envers la question de la violence et la provocation policière, dans le désir pour le débat passionné dans les assemblées et l'internationalisme naissant de tant de slogans du mouvement 10, ces mouvements ont porté un coup à l'avancée de la décomposition et ont affirmé qu'y céder passivement n'était pas du tout la seule possibilité, qu'il était toujours possible de répondre au no-future de la bourgeoisie avec ses attaques incessantes contre la perspective du prolétariat par la réflexion et le débat sur la possibilité d'un autre type de rapports sociaux. Et, dans la mesure où ces mouvements étaient eux-mêmes forcés de s'élever à un certain niveau, de poser des questions sur tous les aspects de la société capitaliste - économiques, politiques artistiques, scientifiques et environnementaux - ils nous ont donné une idée de la façon dont un nouveau "grand mouvement culturel" pourrait réapparaître dans les feux de la révolte contre le système capitaliste.
Il y a certainement eu des moments où nous avons eu tendance à être emportés par l'enthousiasme pour ces mouvements et à perdre de vue leurs faiblesses, renforçant nos tendances à l'activisme et à des formes d'intervention qui n'étaient pas guidées par un point de départ théorique clair. Mais nous n'avons pas eu tort, en 2006 par exemple, de déceler des éléments de la grève de masse dans le mouvement contre le CPE. Il est certain que nous avons tendu à voir cela d'une manière immédiatiste plutôt que dans une perspective à long terme mais il n'y a pas à mettre en question le fait que ces révoltes ont réaffirmé la nature sous-jacente de la lutte de classe en décadence : des luttes qui ne sont pas organisées à l'avance par des organes permanents mais qui tendent à s'étendre à toute la société, qui posent le problème de nouvelles formes d'auto-organisation, qui tendent à intégrer la dimension politique à la dimension économique.
Evidemment la grande faiblesse de ces luttes fut que, dans une grande mesure, elles ne se considéraient pas comme prolétariennes, comme des expressions de la guerre de classe. Et si cette faiblesse n'est pas surmontée, les points forts de tels mouvements tendront à devenir des points faibles : les préoccupations morales dériveront vers une vague forme d'humanisme petit-bourgeois qui tombe facilement dans les politiques démocratiques et "citoyennes" – c'est-à-dire ouvertement bourgeoises ; les assemblées deviendront de simples parlements de rue où les débats ouverts sur les questions fondamentales sont remplacées par les manipulations des élites politiques et des revendications qui limitent le mouvement à l'horizon de la politique bourgeoise. Et ceci fut évidemment le destin des révoltes sociales de 2011-2013.
Il est nécessaire de lier la révolte de rue à la résistance des travailleurs actifs, aux divers produits du mouvement de la classe ouvrière ; de comprendre que cette synthèse ne peut que se baser sur une perspective prolétarienne pour l'avenir de la société et que celle-ci, à son tour, implique que l'unification du prolétariat doit inclure la restauration du lien entre la classe ouvrière et les organisations de révolutionnaires. Telle est la question non répondue, la perspective non assumée, posée non seulement par les luttes des dernières années mais aussi par toutes les expressions de la lutte de classe depuis 1968.
Contre le bon sens commun de l'empirisme qui ne peut voir le prolétariat que lorsqu'il apparaît à la surface, les marxistes reconnaissent que le prolétariat est comme Albion, le géant endormi de Blake dont le réveil mettra le monde sens dessus dessous. Sur la base de la théorie de la maturation souterraine de la conscience, que le CCI est plus ou moins le seul à défendre, nous reconnaissons que le vaste potentiel de la classe ouvrière reste pour sa plus grande partie caché et même les révolutionnaires les plus clairs peuvent facilement oublier que cette "faculté qui sommeille" peut avoir un impact énorme sur la réalité sociale même lorsqu'apparemment, elle s'est retirée de la scène. Marx fut capable de voir dans la classe ouvrière la nouvelle force révolutionnaire dans la société sur la base de ce qui pouvait sembler constituer des preuves bien maigres comme quelques luttes des tisserands en France qui n'avaient pas encore complètement dépassé le stade artisanal de développement. Et malgré les immenses difficultés auxquelles est confronté le prolétariat, malgré toutes nos surestimations des luttes et nos sous-estimations de l'ennemi, le CCI voit encore assez d'éléments dans les mouvements de classe au cours des 40 dernières années pour conclure que la classe ouvrière n'a pas perdu sa capacité d'offrir à l'humanité une nouvelle société, une nouvelle culture et une nouvelle morale.
Poser les questions en profondeur
Ce Rapport est déjà bien plus long que prévu et même, il s'est souvent limité à poser des questions plutôt qu'à y répondre. Mais nous ne cherchons pas des réponses immédiates ; notre but est de développer une culture théorique où chaque question est examinée avec profondeur, en la reliant aux trésors intellectuels du CCI, à l'histoire du mouvement ouvrier et aux classiques du marxisme comme guides indispensables dans l'exploration de problèmes nouveaux soulevés par la phase finale du déclin du capitalisme. Une question-clé implicitement soulevée dans ce Rapport – dans sa réflexion sur l'identité de classe ou sur le cours historique – est la notion même de classe sociale et le concept de prolétariat comme classe révolutionnaire de cette époque. Le CCI a fait d'importantes contributions dans ce domaine – en particulier "Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire" dans les Revue n°73 [237] et 74 [311] et "Pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme" dans les Revue n°103 [232] et 104, les deux articles cherchant à répondre aux doutes au sein du mouvement politique prolétarien sur la possibilité même de la révolution. Il est nécessaire de revenir à ces articles mais, aussi, aux textes et aux traditions marxistes sur lesquels ils se basent, tout en testant en même temps nos arguments à la lumière de l'évolution réelle du capitaliste et de la lutte de classe dans les dernières décennies. Il est clair qu'un tel projet ne peut être entrepris qu'à long terme. Il en va de même pour d'autres aspects du Rapport qui n'ont pu qu'être effleurés, comme la dimension morale de la conscience de classe et son rôle essentiel dans la capacité de la classe ouvrière à surmonter le nihilisme et le manque de perspective inhérents au capitalisme dans sa phase de décomposition, ou la nécessité d'une critique très détaillée des différentes formes d'opportunisme qui ont affecté à la fois l'analyse de la lutte de classe par le CCI et son intervention, en particulier les concessions au conseillisme, à l'ouvriérisme et à l'économisme.
Peut-être que l'une des faiblesses qui apparaît le plus clairement dans le Rapport est notre tendance à sous-estimer les capacités de la classe dominante à maintenir son système en déclin, à la fois sur le plan économique (élément qui doit être développé dans le Rapport sur la crise économique) et sur le plan politique à travers sa capacité à anticiper et à dévoyer le développement de la conscience dans la classe à travers toute une panoplie de manœuvres et de stratagèmes. Le corollaire de cette faiblesse de notre part est que nous avons été trop optimistes sur la capacité de la classe ouvrière de contrer les attaques de la bourgeoisie et d'avancer vers une claire compréhension de sa mission historique – une difficulté qui est aussi reflétée dans le développement souvent extrêmement lent et tortueux de l'avant-garde révolutionnaire. C'est une caractéristique des révolutionnaires d'être impatients de voir la révolution : Marx et Engels considéraient que les révolutions bourgeoises de leur époque pourraient être rapidement "transformées" en révolution prolétarienne ; les révolutionnaires qui ont constitué l'IC étaient confiants que les jours du capitalisme étaient comptés ; notre propre camarade MC espérait qu'il vivrait assez pour voir le début de la révolution. Pour les cyniques et les colporteurs du bon vieux sens commun, c'est parce que la révolution et la société sans classe sont au mieux des illusions et des utopies, aussi on peut tout aussi bien les attendre pour demain ou pour dans cent ans. D'un autre côté, pour les révolutionnaires, cette impatience de voir l'aube de la nouvelle société est le produit de leur passion pour le communisme, une passion qui "ne repose nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde" mais sont simplement "l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classes existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux" (Le Manifeste communiste). Evidemment la passion doit aussi être guidée et parfois tempérée par l'analyse la plus rigoureuse, la capacité la plus sérieuse de tester, vérifier et d'autocritiquer ; et c'est ce que nous cherchons à faire en premier lieu pour le 21e Congrès du CCI. Mais, pour citer Marx encore une fois, une telle autocritique "n'est pas une passion de la tête mais la tête de la passion."
1 Pour une présentation du militant MC voir la note 6 de l'article "Quel bilan et quelles perspectives pour notre activité ?" du présent numéro de la Revue internationale.
2 Pour davantage d'information sur cette tendance, lire notre article de la Revue internationale n ° 109 "La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI [559]".
3 "Le cours historique [568]", dans la Revue internationale n°18.
4 Cf. “L’organisation du prolétariat en dehors des périodes de luttes ouvertes (groupes, noyaux, cercles. Etc.) [569]” dans la Revue internationale n°21.
5 Cf. “La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme [570]” dans la Revue internationale n°23.
6 Cf. “Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire [571]” dans la Revue internationale n°29.
7 Pour davantage d'information sur cette scission voir notre article de la Revue internationale n ° 109, "La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI [559]", dont le passage suivants est extrait : "Lors de la crise de 1981, il s'était développé (avec la contribution de l'élément trouble Chénier, mais pas seulement) une vision qui considérait que chaque section locale pouvait avoir sa propre politique en matière d'intervention, qui contestait violemment le Bureau international (BI) et son Secrétariat (SI) (auxquels on reprochait notamment leur position sur la gauche dans l'opposition et de provoquer une dégénérescence stalinienne) et qui, tout en se réclamant de la nécessité des organes centraux, leur attribuait un rôle de simple boîte aux lettres".
8 Cette question est encore en discussion dans le CCI.
9 Un document interne encore en discussion dans l'organisation.
10 Nous pouvons parler de l'expression ouverte de solidarité entre les luttes aux Etats-Unis et en Europe et ceux du Moyen-Orient, en particulier en Égypte ou les slogans du mouvement en Israël définissant Netanyahou, Moubarak et Assad comme le même ennemi.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Rubrique:
Rapport sur le rôle du CCI en tant que "Fraction"
- 1877 lectures
(1e partie : La notion de Fraction dans l'histoire du mouvement ouvrier)
Comme il est dit dans l’article "40 ans après la fondation du CCI - Quel bilan et quelles perspectives pour notre activité ?", le 21e congrès du CCI a adopté un rapport sur le rôle du CCI en tant que "Fraction". Ce rapport comportait deux parties, une première partie présentant le contexte de ce rapport ainsi qu’un rappel historique de la notion de "Fraction" et une seconde partie analysant concrètement la façon dont notre organisation s’était acquittée de sa responsabilité. Nous publions ci-dessous la première partie de ce rapport qui présente un intérêt général au-delà des questions auxquelles est spécifiquement confronté le CCI.
Le 21e congrès international va mettre au centre de ses préoccupations un bilan critique des 40 années d’existence du CCI. Ce bilan critique concerne :
- les analyses générales élaborées par le CCI (Cf. les 3 rapports sur la situation internationale) ;
- la façon dont le CCI a joué son rôle en vue de participer à la préparation du futur parti.
La réponse à cette deuxième question suppose évidemment que soit bien défini le rôle qui incombe au CCI dans la période historique actuelle, une période où les conditions n'existent pas encore pour le surgissement d'un parti révolutionnaire, c'est-à-dire d'une organisation ayant une influence directe sur le cours des affrontements de classe :
"On ne peut étudier et comprendre l'histoire de cet organisme, le Parti, qu'en le situant dans le contexte général des différentes étapes que parcourt le mouvement de la classe, des problèmes qui se posent à elle, de l'effort de sa prise de conscience, de sa capacité à un moment donné de répondre de façon adéquate à ces problèmes, de tirer les leçons de son expérience et d'en faire un nouveau tremplin pour ses luttes à venir.
S'ils sont un facteur de premier ordre du développement de la classe, les partis politiques sont donc, en même temps, une expression de l'état réel de celle-ci à un moment donné de son histoire." (Revue Internationale n° 35, "Sur le parti et ses rapports avec la classe", point 9)
"Tout au long de son mouvement, la classe a été soumise au poids de l'idéologie bourgeoise qui tend à déformer, à corrompre les partis prolétariens, à dénaturer leur véritable fonction. À cette tendance, se sont opposées les fractions révolutionnaires qui se sont donné pour tâche d'élaborer, de clarifier, de préciser les positions communistes. C'est notamment le cas de la Gauche Communiste issue de la 3ème Internationale : la compréhension de la question du Parti passe nécessairement par l'assimilation de l'expérience et des apports de l'ensemble de cette Gauche Communiste Internationale.
Il revient cependant à la Fraction italienne de la Gauche Communiste le mérite spécifique d'avoir mis en évidence la différence qualitative existant dans le processus d'organisation des révolutionnaires selon les périodes : celle de développement de la lutte de classe et celle de ses défaites et de ses reculs. La FIGC a dégagé avec clarté, pour chacune des deux périodes, la forme prise par l'organisation des révolutionnaires et les tâches correspondantes : dans le premier cas la forme du parti, pouvant exercer une influence directe et immédiate dans la lutte de classe ; dans le second cas, celle d'une organisation numériquement réduite, dont l'influence est bien plus faible et peu opérante dans la vie immédiate de la classe. À ce type d'organisation, elle a donné le nom distinctif de Fraction qui, entre deux périodes de développement de la lutte de classe, c'est-à-dire deux moments de l'existence du Parti, constitue un lien et une charnière, un pont organique entre l'ancien et le futur Parti." (Ibid., point 10)
Nous sommes amenés à nous poser un certain nombre de questions à ce propos :
- que recouvrait cette notion de fraction aux différents moments de l'histoire du mouvement ouvrier ?
- dans quelle mesure le CCI peut-il être considéré comme une "fraction" ?
- quelles sont les tâches d'une fraction qui restent valables pour le CCI et quelles sont celles qui ne sont pas de son ressort ?
- quelles tâches particulières incombent au CCI et qui n'étaient pas celles des fractions ?
Dans la première partie de ce rapport, nous allons aborder essentiellement le premier de ces 4 points afin d'établir un cadre historique à notre réflexion et nous permettre de mieux aborder la seconde partie du rapport qui se propose de répondre à la question centrale évoquée plus haut : quel bilan peut-on tirer sur la façon dont le CCI a joué son rôle en vue de participer à la préparation du futur parti ?
Pour examiner cette notion de Fraction aux différents moments de l'histoire du mouvement ouvrier, qui a permis à la Fraction italienne d'élaborer son analyse, nous allons distinguer 3 périodes :
- l'enfance du mouvement ouvrier : la Ligue des communistes et l'AIT ;
- l'âge de sa maturité : la 2e Internationale ;
- la "période des guerres et des révolutions" (suivant l'expression employée par l'Internationale communiste).
Mais, pour commencer, il peut être utile de faire un très court rappel sur l'histoire des partis du prolétariat puisque la question de la Fraction revient, fondamentalement, à poser la question du Parti, ce dernier constituant, en quelque sorte, le point de départ et le point d'arrivée de la Fraction.
1) La notion de Parti dans l'histoire du mouvement ouvrier
La notion de parti a été élaborée progressivement, tant théoriquement que pratiquement, au cours de l'expérience du mouvement ouvrier (Ligue des communistes, AIT, partis de la 2e internationale, partis communistes).
La Ligue, qui est une organisation clandestine, appartient encore à la période des sectes :
"À l’aube du capitalisme moderne, dans la première moitié du 19e siècle, la classe ouvrière encore dans sa phase de constitution menant des luttes locales et sporadiques ne pouvait donner naissance qu’à des écoles doctrinaires, à des sectes et des ligues. La Ligue des Communistes était l’expression la plus avancée de cette période en même temps que son Manifeste et son Appel de "prolétaires de tous les pays, unissez-vous", elle annonçait la période suivante." ("Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat", point 23, Internationalisme n° 38, octobre 1948)
L'AIT a eu justement pour rôle le dépassement des sectes, permettant un large rassemblement des prolétaires européens et une décantation par rapport à de nombreuses confusions qui pesaient sur leur conscience. En même temps, avec sa composition hétéroclite (syndicats, coopératives, groupes de propagande, etc.) elle n'était pas encore un parti au sens que cette notion a acquise par la suite au sein et grâce à la 2e Internationale.
"La première Internationale correspond à l’entrée effective du prolétariat sur la scène des luttes sociales et politiques dans les principaux pays d’Europe. Aussi groupe-t-elle toutes les forces organisées de la classe ouvrière, ses tendances idéologiques les plus diverses. La première Internationale réunit à la fois tous les courants et tous les aspects de la lutte ouvrière contingente : économiques, éducatifs, politiques et théoriques. Elle est au plus haut point L’ORGANISATION UNITAIRE de la classe ouvrière, dans toute sa diversité.
La Deuxième Internationale marque une étape de différenciation entre la lutte économique des salariés et la lutte politique sociale. Dans cette période de plein épanouissement de la société capitaliste, la Deuxième Internationale est l’organisation de la lutte pour des réformes et des conquêtes politiques, l’affirmation politique du prolétariat, en même temps qu’elle marque une étape supérieure dans la délimitation idéologique au sein du prolétariat, en précisant et élaborant les fondements théoriques de sa mission historique révolutionnaire." (Ibid.)
C'est au sein de la Deuxième Internationale que s'est opérée clairement la distinction entre l'organisation générale de la classe (les syndicats) et son organisation spécifique chargée de défendre son programme historique, le parti. Une distinction qui était bien claire lorsqu'a été fondée la 3e Internationale au moment où la révolution prolétarienne était, pour la première fois, à l'ordre du jour de l'histoire. Pour l'IC, l'organisation générale de la classe n'est plus constituée, dans cette nouvelle période, par les syndicats (qui, de toutes façons ne regroupent pas l'ensemble du prolétariat) mais par les conseils ouvriers (même s'il subsiste dans l'IC des confusions sur la question syndicale et sur celle du rôle du parti).
Malgré toutes les différences entre ces quatre organisations, il y a un point commun entre elles : elles ont un impact sur le cours de la lutte de classe et c'est en ce sens qu'on peut leur attribuer le nom de "parti".
Cet impact est encore faible pour la Ligue des communistes lors des révolutions de 1848-49 où elle agit principalement comme aile gauche du mouvement démocratique. Ainsi, la Neue Rheinische Zeitung dirigée par Marx, et qui a une certaine influence en Rhénanie et même dans le reste de l'Allemagne, n'est pas directement l'organe de la Ligue mais se présente comme "Organe de la Démocratie". Comme le note Engels : "(…) la Ligue, une fois que les masses populaires se furent mises en mouvement, s'avéra bien trop faible comme levier." ("Quelques mots sur l'histoire de la Ligue des communistes", novembre 1885). Une des causes importantes de cette faiblesse réside dans la faiblesse même du prolétariat en Allemagne où la grande industrie n'a pas encore pris son essor. Cependant, le même Engels relève que "La Ligue était incontestablement la seule organisation révolutionnaire qui eût de l'importance en Allemagne". L'impact de l'AIT est bien plus important puisque celle-ci devient une "puissance" en Europe. Mais c'est surtout la 2e Internationale (en fait à travers les différents partis qui la composent) qui peut, pour la première fois dans l'histoire, revendiquer une influence déterminante dans les masses ouvrières.
2) La notion de Fraction à l'aube du mouvement ouvrier
La question s'est posée déjà au temps de Marx mais a revêtu une importance bien plus grande par la suite : que devient le parti lorsque l'avant-garde qui défend le programme historique de la classe ouvrière, la révolution communiste, n'a pas la possibilité d'avoir un impact immédiat sur les luttes de classe du prolétariat ?
À cette question, l'histoire a donné différentes réponses. La première réponse est celle de la dissolution du parti lorsque les conditions de son existence ne sont plus présentes. Ce fut le cas de la Ligue et de l'AIT. Dans les deux cas, Marx et Engels ont joué un rôle décisif dans cette dissolution.
C'est ainsi qu'en novembre 1852, après le procès des communistes de Cologne qui venait ponctuer la victoire de la contre-révolution en Allemagne, ils ont appelé le Conseil central de la Ligue à prononcer la dissolution de celle-ci. Il vaut la peine de souligner que la question de l'action de la minorité révolutionnaire dans une période de réaction avait déjà été soulevée dès l'automne 1850 au sein de la Ligue. Au milieu de l'année 1850, Marx et Engels avaient constaté que la vague révolutionnaire refluait du fait de la reprise de l'économie :
"Étant donné cette prospérité générale dans laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent aussi abondamment que le permettent les conditions bourgeoises, on ne saurait parler de véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans les périodes où ces deux facteurs, les forces productives modernes et les formes de production bourgeoises entrent en conflit les uns avec les autres." (Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue, fascicules V et VI)
Ils sont conduits à combattre la minorité immédiatiste de Willich-Schapper qui veut continuer à appeler les ouvriers à l'insurrection malgré le recul :
"Lors du dernier débat sur la question 'de la position du prolétariat allemand dans la prochaine révolution', des membres de la minorité du Conseil central ont exprimé des points de vue qui sont en contradiction directe avec l'avant-dernière circulaire, voire avec le Manifeste. Ils ont substitué à la conception internationale du Manifeste une conception nationale et allemande, en flattant le sentiment national de l'artisan allemand. À la place de la conception matérialiste du Manifeste, ils ont une conception idéaliste : au lieu de la situation réelle, c'est la volonté qui devient la force motrice de la révolution. Tandis que nous disons aux ouvriers : il vous faut traverser quinze, vingt, cinquante ans de guerres civiles pour changer les conditions existantes et vous rendre aptes à la domination sociale, ils disent au contraire : nous devons immédiatement arriver au pouvoir, ou bien nous pouvons aller nous coucher ! À la manière dont les démocrates utilisent le mot 'peuple', ils utilisent le mot 'prolétariat', comme une simple phrase. Pour réaliser cette phrase, il faudrait proclamer prolétaires tous les petits-bourgeois, c'est-à-dire représenter la petite bourgeoisie, et non le prolétariat. À la place du développement historique réel, il faudrait mettre la phrase 'révolution'". (Intervention de Marx à la réunion du Conseil central de la Ligue du 15 septembre 1850, marxists.org)
De même, au congrès de la Haye de 1872, Marx et Engels soutiennent la décision de transférer le Conseil Général à New York afin de le soustraire à l'influence des tendances bakouninistes qui gagnent en influence à un moment où le prolétariat européen a subi une importante défaite avec l'écrasement de la Commune de Paris. Ce déplacement hors d'Europe du Conseil Général signifie la mise en sommeil de l'AIT qui prélude à sa dissolution. Cette dissolution devient effective à la conférence de Philadelphie en juillet 1876.
D'une certaine façon, la dissolution du parti lorsque les conditions ne permettent plus son existence était bien plus facile dans le cas de la Ligue et de l'AIT que par la suite. La Ligue était une petite organisation clandestine (sauf au moment des révolutions de 1848-49) qui n'avait pas pris une place "officielle" dans la société. Concernant l'AIT, sa disparition formelle ne signifiait pas pour autant que disparaissaient toutes ses composantes. C'est ainsi que les Trade unions anglais ou le parti ouvrier allemand ont survécu à l'AIT. Ce qui avait disparu, c'était le lien formel existant entre ses différentes composantes.
Les choses sont différentes par la suite. Les partis ouvriers ne disparaissent plus mais ils passent à l'ennemi. Ils deviennent des institutions de l'ordre capitaliste ce qui confère aux éléments révolutionnaires une responsabilité différente de celle qu'ils avaient lors des premières étapes du mouvement ouvrier.
Lorsque la Ligue a été dissoute, il n'a pas subsisté la moindre organisation formelle en charge de constituer un pont vers le nouveau parti qui devrait surgir à un moment ou à un autre. Marx et Engels estiment d'ailleurs que le travail d'élaboration et d'approfondissement théorique constitue la première priorité au cours de cette période et comme, à ce moment-là, ils sont pratiquement les seuls à maîtriser la théorie qu'ils ont élaborée, ils n'ont pas besoin d'une organisation formelle pour faire ce travail. Cela dit, un certain nombre d'anciens membres de la Ligue sont restés en contact entre eux, notamment dans l'émigration en Angleterre. On assiste même à la réconciliation, en 1856, entre Marx et Schapper. En septembre 1864, c'est Eccarius, ancien membre du Conseil central de la Ligue, et qui a des liens étroits avec le mouvement ouvrier anglais, qui demande que Marx soit présent à la tribune du célèbre meeting du 28 septembre à Saint-Martin's Hall où est décidée la fondation de l'Association Internationale des Travailleurs.1 Et c'est ainsi, également, qu'on va retrouver dans le Conseil général de l'AIT un nombre significatif d'anciens membres de la Ligue : Eccarius, Lessner, Lochner, Pfaender, Schapper et, bien sûr, Marx et Engels.
Lorsque l'AIT disparait, il subsiste, comme on l'a vu, des organisations qui vont être à l'origine de la fondation de la 2e internationale, notamment le parti allemand issu de l'unification de 1875 (SAP) dont la composante d'Eisenach (Bebel, Liebknecht) était affiliée à l'AIT.
Il faut faire ici une remarque concernant le rôle que se donnaient ces deux premières organisations lorsqu'elles se sont constituées. Dans le cas de la Ligue, il est clair dans le Manifeste que la perspective est celle de la révolution prolétarienne à assez court terme. C'est à la suite de la défaite des révolutions de 1848-49 que Marx et Engels comprennent que les conditions historiques n'en sont pas encore mûres. De même, au moment de la fondation de l'AIT, il existe l'idée d'une "émancipation des travailleurs" (suivant le terme de ses statuts) à court ou moyen terme (malgré la diversité des visions que recouvrait cette formule pour les différentes composantes de l'Internationale : mutuellisme, collectivisme, etc.). La défaite de la Commune de Paris a mis en évidence une nouvelle fois l'immaturité des conditions pour le renversement du capitalisme, d'autant plus que dans la période qui suit on assiste à un épanouissement considérable du capitalisme avec notamment la constitution de la puissance industrielle de l'Allemagne qui dépasse celle de l'Angleterre au début du 20e siècle.
3) Les fractions dans la 2e internationale2
Au cours de cette période d'épanouissement du capitalisme, alors que la perspective révolutionnaire reste éloignée, les partis socialistes acquièrent une importance majeure au sein de la classe ouvrière (particulièrement en Allemagne, évidemment). Cet impact croissant, alors que l'état d'esprit de la majorité des ouvriers n'est pas révolutionnaire, est lié au fait que les partis socialistes, non seulement affichent dans leur programme la perspective du socialisme, mais défendent aussi, au quotidien, le "programme minimum" de réformes au sein de la société capitaliste. C'est d'ailleurs cette situation qui conduit à l'opposition entre ceux pour qui "Le but final, quel qu’il soit, n’est rien, le mouvement est tout" (Bernstein) et ceux pour qui "Le but final du socialisme est le seul élément décisif distinguant le mouvement socialiste de la démocratie bourgeoise et du radicalisme bourgeois, le seul élément qui, plutôt que de donner au mouvement ouvrier la vaine tâche de replâtrer le régime capitaliste pour le sauver, en fait une lutte de classe contre ce régime, pour l’abolition de ce régime." "Pour la social-démocratie, lutter à l’intérieur même du système existant, jour après jour, pour les réformes, pour l’amélioration de la situation des travailleurs, pour des institutions démocratiques, c’est la seule manière d’engager la lutte de classe prolétarienne et de s’orienter vers le but final, c’est-à-dire de travailler à conquérir le pouvoir politique et à abolir le système du salaire." (Rosa Luxemburg dans la préface de Réforme sociale ou Révolution) En fait, malgré le rejet officiel des thèses de Bernstein par la SPD et par l'Internationale socialiste, cette vision devient en réalité majoritaire au sein du SPD (et particulièrement dans l'appareil) et au sein de l'Internationale.
"L’expérience de la Deuxième Internationale confirme l’impossibilité de maintenir au prolétariat son parti dans une période prolongée d’une situation non révolutionnaire. La participation finale des partis de la Deuxième Internationale à la guerre impérialiste de 1914 n’a fait que révéler la longue corruption de l’organisation. La perméabilité et pénétrabilité, toujours possibles, de l’organisation politique du prolétariat par l’idéologie de la classe capitaliste régnante, prennent dans des périodes prolongées de stagnation et de reflux de la lutte de classe, une ampleur telle que l’idéologie de la bourgeoisie finit par se substituer à celle du prolétariat, qu’inévitablement le parti se vide de son contenu de classe primitif pour devenir l’instrument de classe de l’ennemi." ("Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat", point 12)
C'est dans ce contexte que, pour la première fois, surgissent de véritables fractions. La première fraction est celle des bolcheviks qui, après le congrès de 1903 du POSDR, entreprend la lutte contre l'opportunisme, d'abord sur les questions d'organisation puis sur les questions de tactique face aux tâches du prolétariat dans un pays semi-féodal comme la Russie. Il faut noter que, jusqu'en 1917, même si la fraction bolchevique et la fraction menchevique menaient leur politique de façon indépendante, elles appartenaient formellement au même parti, le POSDR.
Le courant marxiste qui s'est développé autour de l'hebdomadaire De Tribune (dirigé par Wijnkoop, Van Raveysten et Ceton mais auquel collaboraient notamment Gorter et Pannekoek) a engagé à partir de 1907 un travail similaire dans le SDAP, le parti hollandais. Ce courant a mené le combat contre la dérive opportuniste au sein du parti représentée principalement par la fraction parlementaire et Troelstra qui, dès le congrès de 1908, propose d'interdire De Tribune. Troelstra aura finalement gain de cause lors du congrès extraordinaire de Deventer (13-14 février 1909) qui décide la suppression de De Tribune et exclut ses trois rédacteurs du parti. Cette politique, qui visait à séparer les "chefs" tribunistes des sympathisants de ce courant provoque en fait une vive réaction de ces derniers. En fin de compte, cette politique d'exclusion de Troelstra, celle du Bureau international de l'IS qui est sollicité pour un arbitrage mais qui est dominé par les réformistes, mais aussi la volonté de rupture des trois rédacteurs (volonté que Gorter ne partage pas3) conduit les "tribunistes" à fonder en mars un nouveau parti, le SDP (Parti social-démocrate). Ce parti, jusqu'à la guerre mondiale, restera très minoritaire, avec une influence électorale insignifiante, mais il bénéficie du soutien de la Gauche au sein de l'Internationale, et notamment des bolcheviks, ce qui lui permet, en fin de compte, d'être réintégré dans l'IS en 1910 (après un premier refus par le BSI en novembre 1909) et d'envoyer des délégués (un mandat contre 7 au SDAP) aux congrès internationaux de 1910 (Copenhague) et 1912 (Bâle). Au cours de la Guerre, à laquelle la Hollande ne participe pas mais qui pèse considérablement sur la classe ouvrière (chômage, approvisionnement, etc.) le SDP gagne en influence, y compris sur le plan électoral, par sa politique internationaliste et de soutien aux luttes ouvrières. Finalement, le SDP prendra le nom de Parti communiste des Pays-Bas (CPN) en novembre 1918, avant même la fondation du Parti Communiste d'Allemagne (KPD).
Le 3ème courant qui a joué un rôle de fraction décisif dans un parti de la 2ème Internationale est celui qui allait justement former le KPD. Dès le 4 août au soir, après le vote unanime des crédits de guerre par les députés socialistes au Reichstag, un certain nombre de militants internationalistes se retrouvent dans l'appartement de Rosa Luxemburg pour définir les perspectives de lutte et les moyens de regrouper tous ceux qui, dans le parti, combattent la politique chauvine de la direction et de la majorité. Ces militants sont unanimes pour estimer qu'il faut mener ce combat AU SEIN du parti. Dans de nombreuses villes, la base du parti dénonce le vote des crédits de guerre par la fraction parlementaire. Même Liebknecht est critiqué pour avoir voté le 4 août, par discipline, son soutien. Lors du 2e vote, le 2 décembre, Liebknecht est le seul à voter contre et il est rejoint par Otto Rühle lors des 2 votes suivants, puis par un nombre croissant de députés. Dès l'hiver 1914-1915, des tracts clandestins sont distribués (notamment celui intitulé "L'ennemi principal est dans notre propre pays"). En avril 1915 est publié le premier et unique numéro de Die Internationale dont la vente s'élève à 5000 exemplaires dès le premier soir et qui donne son nom au Gruppe Internationale, animé notamment par Rosa Luxemburg, Jogiches, Liebknecht, Mehring, Clara Zetkin. Dans la clandestinité, soumis à la répression4 ce petit groupe, qui prend le nom de "Groupe Spartacus" puis de "Ligue Spartacus", anime le combat contre la guerre et le gouvernement de même que contre la droite et le centre de la social-démocratie. Il n'est pas seul dans ce combat puisque d'autres groupes, notamment à Hambourg et Brême (où se trouvent Pannekoek, Radek et Frölich) défendent une politique internationaliste avec encore plus de clarté que les spartakistes. Début 1917, lorsque la direction du SPD exclut les oppositionnels pour stopper le progrès de leurs positions au sein du parti, ces groupes poursuivent leur activité de façon autonome alors que les spartakistes poursuivent un travail de fraction au sein de l'USPD centriste. Finalement, ces différents courants se regroupent lors de la constitution du KPD le 31 décembre 1918, mais il est clair que ce sont les spartakistes qui constituent l'axe du nouveau parti.
C'est avec un certain retard sur le mouvement ouvrier en Russie, Hollande et Allemagne que se constitue une fraction de Gauche en Italie. Il s'agit, évidemment, de la "Fraction abstentionniste" qui se regroupe autour du journal Il Soviet publié à Naples par Bordiga et ses camarades à partir de décembre 1918 et qui se constitue formellement en fraction au congrès du PSI en octobre 1919. Pourtant, depuis 1912, au sein de la Fédération des jeunes socialistes et dans la fédération de Naples du PSI, Bordiga a animé un courant révolutionnaire intransigeant. Ce retard s'explique en partie par le fait que Bordiga, mobilisé, ne peut intervenir dans la vie politique avant 1917 mais surtout par le fait que, au moment de la guerre, la direction du parti est entre les mains de la gauche, suite au congrès de 1912, qui a expulsé la droite réformiste et celui de 1914 qui a expulsé les francs-maçons. Avanti, le journal du PSI, est dirigé par Mussolini qui, à ces congrès, a présenté les motions d'exclusion. Celui-ci profite de cette position pour publier le 18 octobre 1814 un éditorial intitulé "De la neutralité absolue à la neutralité active et agissante" qui se prononce pour l'entrée en guerre de l'Italie au côté de l'entente. Il est évidemment limogé de son poste mais à peine un mois après, il publie Il Popolo d'Italia grâce aux subsides apportés par le député socialiste Marcel Cachin (futur dirigeant du PCF) pour le compte du gouvernement français et de l'Entente. Il est exclu du PSI le 29 novembre. Par la suite, même si la situation dominée par la Guerre mondiale pousse à la décantation entre une Gauche, une Droite et un Centre, la direction du parti oscille entre droite et gauche, entre prises de positions "maximalistes" et prises de position réformistes. "C'est seulement en cette année 1917, qu'au congrès de Rome se cristallisèrent nettement les tendances de droite et de gauche. La première obtint 17 000 voix contre 14 000 pour la seconde. La victoire de Turati, Treves, Modigliani, au moment où se développait la révolution russe accéléra la formation d'une Fraction intransigeante révolutionnaire à Florence, Milan, Turin et Naples." (Notre livre, La Gauche communiste d'Italie). Ce n'est qu'à partir de 1920, sous l'impulsion de la révolution en Russie, de la formation de l'IC (qui lui apporte son soutien) et aussi des grèves ouvrières en Italie, notamment à Turin, que la Fraction abstentionniste gagne en influence dans le parti. Elle entre aussi en contact avec le courant regroupé autour du journal Ordine Nuovo, animé par Gramsci, même s'il existe d'importants désaccords entre les deux courants (Gramsci est favorable à la participation aux élections, il défend une sorte de syndicalisme révolutionnaire et hésite à rompre avec la droite et le centre en se constituant en fraction autonome). "En octobre 1920, à Milan, se formait la Fraction communiste unifiée qui rédigeait un Manifeste appelant à la formation du parti communiste par l'expulsion de l'aile droite de Turati ; elle renonçait au boycottage des élections en application des décisions du IIe congrès du Komintern". (Ibid.) C'est à la Conférence d'Imola, en décembre 1920 qu'est décidé le principe d'une scission : "notre œuvre de fraction est et doit être terminée maintenant (…) immédiate sortie du parti et du congrès (du PSI) dès lors que le vote nous aura donné la majorité ou la minorité. Il s'ensuivra… la scission d'avec le Centre." (Ibid.) Au congrès de Livourne qui s'ouvre le 21 janvier, "la motion d'Imola obtient le tiers de votes des adhérents socialistes : 58 783 sur 172 487. La minorité quitte le congrès et décide de siéger comme Parti communiste d'Italie, section de l'Internationale communiste. (…) Avec fougue, Bordiga concluait, juste avant de sortir du congrès : 'Nous emportons avec nous l'honneur de votre passé'." (Ibid.)
Cet examen (très rapide) du travail des principales fractions qui se sont constituées au sein des partis de la seconde Internationale permet de définir un premier rôle qui incombe à une fraction : défendre au sein du parti en dégénérescence les principes révolutionnaires :
- d'abord pour gagner un maximum de militants à ces principes et exclure du parti les positions de droite et du centre ;
- ensuite pour se transformer en nouveau parti révolutionnaire lorsque les circonstances le demandent.
Il faut noter que pratiquement tous les courants de Gauche ont eu pour souci de rester le plus longtemps possible au sein du parti. Les seules exceptions sont celles des tribunistes (mais Gorter et Pannekoek ne partageaient pas cette précipitation) et des "gauches radicales" animées par Radek, Pannekoek et Frölich qui, après l'expulsion en 1917 des opposants au sein du SPD, refusent d'entrer dans l'USPD (contrairement aux Spartakistes). La séparation de la Gauche d'avec le vieux parti qui a trahi résultait, soit de son exclusion, soit de la nécessité de fonder un parti capable de se porter à l'avant-garde de la vague révolutionnaire.
Il faut noter aussi que l'action de la Gauche n'est pas condamnée à rester minoritaire au sein du parti dégénérescent : au Congrès de Tours du Parti socialiste français, la motion de la Gauche appelant à l'adhésion à l'IC est majoritaire. C'est pour cela que le Parti communiste qui est fondé à ce moment-là conserve le journal L'Humanité fondé par Jaurès. Il conserve aussi, malheureusement, le secrétaire général du PS, Frossard, qui devient pour un certain temps le nouveau principal dirigeant du PC.
Une dernière remarque : cette capacité de la fraction de Gauche à constituer d'emblée le nouveau parti n'a été possible que parce qu'il s'est écoulé peu de temps (3 ans) entre la trahison avérée du vieux parti et le surgissement de la vague révolutionnaire. Par la suite, la situation sera bien différente.
4) Les fractions issues de l'Internationale communiste
L'Internationale communiste est fondée en mars 1919. À cette époque, il existe très peu de partis communistes constitués (les partis communistes de Russie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Pologne et quelques autres de moindre importance). Et pourtant, dès ce moment-là, on a déjà vu surgir une première fraction "de Gauche" (qui se proclame comme telle) au sein du principal parti communiste, celui de Russie (qui n'a pris le nom de communiste qu'en mars 1918, lors du 7e congrès du POSDR) ; il s'agit du courant regroupé, au début 1918, autour du journal Kommunist et animée par Ossinsky, Boukharine, Radek et Smirnov. Le désaccord principal de cette fraction vis-à-vis de l'orientation suivie par le parti concerne la question des négociations de Brest-Litovsk. Les "Communistes de Gauche" sont opposés à ces négociations et préconisent la "guerre révolutionnaire", "l'exportation" de la révolution vers d'autres pays au bout des fusils. Mais, en même temps, cette fraction entreprend une critique des méthodes autoritaires du nouveau pouvoir prolétarien et insiste sur la plus large participation des masses ouvrières à ce pouvoir, des critiques qui sont assez proches de celles de Rosa Luxemburg (Cf. "La révolution russe"). La signature de la paix de Brest-Litovsk va sonner la fin de cette fraction. Par la suite, Boukharine va être un représentant de l'aile droite du parti, mais certains éléments de cette fraction, tel Ossinsky, vont appartenir à des fractions de gauche qui vont surgir plus tard. Ainsi, alors qu'en Europe occidentale certaines des fractions au sein des partis socialistes qui allaient former les partis communistes ne sont pas encore constituées (la Fraction abstentionniste animée par Bordiga ne se constitue qu'en décembre 1918), les révolutionnaires de Russie engagent déjà le combat (évidemment de façon très confuse) contre des dérives qui affectent le parti communiste dans leur pays. Il est intéressant de remarquer (même s'il n'y a pas lieu ici d'analyser ce phénomène) que, sur toute une série de questions, les militants de Russie ont fait figure de précurseurs tout au long du début du 20e siècle : constitution de la fraction bolchevique après le 2e congrès du POSDR, clarté face à la guerre impérialiste en 1914, animation de la Gauche de Zimmerwald, nécessité de fonder une nouvelle internationale, fondation du premier parti communiste en mars 1918, impulsion et orientation politique du 1er congrès de l'IC. Et cette "précocité" se retrouve même dans la formation de fractions au sein du parti communiste. En fait, de par son rôle particulier de premier (et seul) parti communiste à accéder au pouvoir, le parti de Russie est aussi le premier à subir la pression de l'élément principal qui va signer sa perte (outre, évidemment, la défaite de la vague révolutionnaire mondiale), son intégration au sein de l'État. De ce fait, les résistances prolétariennes, aussi confuses qu'elles fussent, à ce processus de dégénérescence du parti ont commencé beaucoup plus tôt qu'ailleurs.
Par la suite, le parti russe verra surgir un nombre significatif d'autres courants "de Gauche" :
- en 1919 le groupe du "Centralisme Démocratique" formé autour d'Ossinsky et de Sapronov qui combat le principe de "la direction unique" dans l'industrie et défend le principe collectif ou collégial comme étant "l'arme la plus efficace contre la départementalisation et l'étouffement bureaucratique de l'appareil d'État" (Thèses sur le principe collégial et l'autorité individuelle) ;
- en 1919, encore, beaucoup de membres du "Centralisme démocratique" étaient ainsi engagés dans "l'Opposition militaire", qui s'était formée pendant une brève période en mars 1919 pour lutter contre la tendance à modeler l'Armée rouge suivant les critères d'une armée bourgeoise classique.
Pendant la période de la guerre civile, les critiques envers la politique menée par le parti se font beaucoup plus rares du fait de la menace des armées blanches qui pèse sur le nouveau régime mais dès que celle-ci prend fin avec la victoire de l'Armée Rouge sur les Blancs, elles reprennent de plus belle :
- au début 1921, à l'occasion du 10e congrès du parti et du débat sur la question syndicale, il se forme "l'Opposition ouvrière" animée par Chliapnikov, Medvedev (tous deux ouvriers métallurgistes) et, surtout, Alexandra Kollontaï, rédactrice de la Plate-forme, qui veut confier aux syndicats le rôle de la gestion de l'économie (à l'image des syndicalistes révolutionnaires) en lieu et place de la bureaucratie d'État5. Suite à l'interdiction des fractions lors de ce congrès (qui se tient au moment-même de l'insurrection de Cronstadt) l'Opposition ouvrière se dissout et, par la suite, Kollontaï sera une fidèle de Staline ;
- à l'automne de 1921 s'est constitué le groupe de "La Vérité ouvrière", surtout composée d'intellectuels adeptes du "Proletkult" à l'image de son principal animateur, Bogdanov et qui, en même temps qu'il dénonce, avec les autres courants d'opposition, la bureaucratisation du parti et de l'État, adopte une position semi-menchevique considérant que les conditions de la révolution prolétarienne n'étaient pas mûres en Russie mais que les conditions avaient été créées pour un fort développement de celle-ci sur des bases capitalistes modernes (une position qui sera celle du courant "conseilliste" par la suite) ;
- c'est en 1922-23 que se constitue le "Groupe ouvrier" animé par Gabriel Miasnikov, un ouvrier de l'Oural, qui s'était distingué dans le parti bolchevik en 1921, quand, tout de suite après le 10e congrès, il avait réclamé "la liberté de la presse, des monarchistes aux anarchistes inclus". Malgré les efforts de Lénine pour le dissuader de mener un débat sur cette question, Miasnikov refuse de reculer et il est expulsé du parti au début de 1922. Avec d'autres militants d'origine ouvrière, il fonde "le Groupe Ouvrier du parti communiste russe (bolchevik)" lequel distribue son Manifeste au 12e congrès du PCR. Ce groupe commence à faire du travail illégal parmi les ouvriers du parti ou non et semble avoir été présent de façon significative dans la vague de grèves de l'été 1923, en appelant à des manifestations de masses et en essayant de politiser un mouvement de classe essentiellement défensif. Cette activité dans ces grèves convainc le Guépéou que le groupe constitue une menace et ses dirigeants, dont Miasnikov, sont emprisonnés. L'activité de ce groupe se poursuit de façon clandestine en Russie (y compris en déportation) jusqu'à la fin des années 1920 quand Miasnikov réussit à sortir du pays et participe à la publication à Paris de "L'Ouvrier communiste" qui défend des positions proches de celles du KAPD.
De tous les courants qui ont mené le combat contre la dégénérescence du Parti bolchevique, c'est certainement le "Groupe ouvrier" qui est le plus clair politiquement. Il est très proche du KAPD (qui publie ses documents et avec qui il est en contact). Surtout, ses critiques à la politique suivie par le Parti se basent sur une vision internationale de la révolution, contrairement à celles des autres groupes qui se polarisent uniquement sur des questions de démocratie (dans le Parti et dans la classe ouvrière) et de gestion de l'économie. C'est pour cela qu'il rejette les politiques de front unique des 3e et 4e congrès de l'IC, alors que le courant trotskiste continue à se revendiquer des 4 premier congrès. Il faut noter qu'il existe des discussions (notamment en déportation) entre l'aile gauche du courant trotskiste et les éléments du Groupe ouvrier.
De tous les courants de Gauche qui ont surgi au sein du parti bolchevique, le Groupe ouvrier est probablement le seul qui s'apparente à une fraction conséquente. Mais la terrible répression que Staline déchaîne contre les révolutionnaires (et à côté de laquelle la répression tsariste fait pâle figure) lui ôte toute possibilité de se développer. Finalement, Miasnikov décide de revenir en Russie après la 2de Guerre mondiale. Comme c'était prévisible, il disparaît aussitôt ce qui prive les faibles forces de la Gauche communiste d'un de ses combattants les plus valeureux.
Le combat des fractions de Gauche dans les autres pays que la Russie a nécessairement pris des formes différentes mais, si on revient sur les trois autres partis communistes dont la fondation a été évoquée plus haut, on constate que c'est aussi très tôt que les courants de Gauche engagent le combat bien que sous des formes différentes.
Lors de la fondation du parti communiste d'Allemagne, les positions de la Gauche sont majoritaires. Sur la question syndicale, Rosa Luxemburg, qui a rédigé le programme du KPD et le présente au Congrès, est très claire et catégorique : "(… les syndicats) ne sont plus des organisations ouvrières mais les protecteurs les plus solides de l'État et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats. Nous sommes d'accord sur ce point." Sur la question parlementaire, contre la position des Spartakistes (Rosa Luxemburg, Liebknecht, Jogiches, etc.), le congrès rejette la participation aux élections qui doivent se tenir peu après. Après la disparition de ces militants (tous assassinés) la nouvelle direction (Levi, Brandler) semble, dans un premier temps, faire des concessions à la gauche (qui reste majoritaire) sur la question syndicale mais, dès août 1919 (conférence de Francfort du KPD), Levi, qui veut se rapprocher de l'USPD, se prononce pour un travail dans le parlement aussi bien que dans les syndicats et, au congrès d'Heidelberg, en octobre, il réussit, grâce à une manœuvre, à faire exclure la gauche antisyndicale et antiparlementaire pourtant majoritaire. Les militants exclus refusent majoritairement de former immédiatement un nouveau parti car ils sont contre la scission et ils espèrent réintégrer le KPD. Ils sont soutenus fermement par les militants de gauche hollandais (notamment Gorter et Pannekoek) qui jouissent à ce moment-là d'une forte autorité au sein de l'IC et qui impulsent l'orientation du Bureau d'Amsterdam nommé par l'Internationale pour prendre en charge le travail en direction de l'Europe occidentale et de l'Amérique. Ce n'est que 6 mois plus tard (les 4 et 5 avril 1920), devant le refus du congrès du KPD de février 1920 de réintégrer les militants exclus et aussi devant l'attitude conciliatrice de ce parti envers le SPD lors du Putsch de Kapp (13-17 mars) que ces militants fondent le KAPD (Parti communiste ouvrier d'Allemagne). Leur démarche est confortée par le soutien du Bureau d'Amsterdam lequel a organisé en février une conférence internationale où les thèses de la Gauche ont triomphé (sur les questions syndicale, parlementaire et sur le rejet du tournant opportuniste de l'IC manifestée notamment par la demande que les communistes anglais entrent dans le Labour)6. Le nouveau parti bénéficie du soutien de la minorité de gauche (animée par Gorter et Pannekoek) du parti communiste des Pays-Bas (CPN) qui publie dans son journal le programme du KAPD adopté par son congrès de fondation. Cela n'empêche pas Pannekoek de faire un certain nombre de critiques à ce parti (lettre du 5 juillet 1920), notamment à propos de sa position envers les "Unionen" (mise en garde contre toute concession au syndicalisme révolutionnaire) et surtout de la présence dans ses rangs du courant "National bolchevik" qu'il considère comme une "aberration monstrueuse". À ce moment-là, sur toutes les questions essentielles auxquelles se confronte le prolétariat mondial (questions syndicale, parlementaire, du parti7, de l'attitude envers les partis socialistes, de la nature de la révolution en Russie, etc.) la Gauche hollandaise (et particulièrement Pannekoek) qui inspire la majorité du KAPD, se situe à la toute avant-garde du mouvement ouvrier.
Le congrès du KAPD qui se tient du 1er au 4 août se prononce en faveur de ces orientations : les "national-bolcheviks" quittent le parti à ce moment-là et, quelques mois plus tard, c'est le tour des éléments fédéralistes qui sont hostiles à l'appartenance à l'IC. Pour sa part, Pannekoek, Gorter et le KAPD sont résolus à rester au sein de l'IC pour mener le combat contre la dérive opportuniste qui gagne de plus en plus. C'est pour cette raison que le KAPD envoie 2 délégués en Russie, Jan Appel et Franz Jung, en vue du 2e congrès de l'IC qui doit se tenir à Moscou à partir du 17 juillet 1920 8 mais sans nouvelles d'eux, il envoie 2 autres délégués, dont Otto Rühle, qui, au vu de la situation catastrophique dont souffre la classe ouvrière et du processus de bureaucratisation de l'appareil gouvernemental, décident de ne pas participer au Congrès malgré le fait que celui-ci leur ait proposé d'y défendre leurs positions et d'y avoir voix délibérative. C'est en vue de ce congrès que Lénine rédige "La maladie infantile du communisme". Il faut noter que dans cette brochure, Lénine écrit que : "l'erreur représentée par le doctrinarisme de gauche dans le mouvement communiste est, à l'heure présente, mille fois moins dangereuse et moins grave que l'erreur représentée par le doctrinarisme de droite".
Aussi bien du côté de l'IC et des bolcheviks que du côté du KAPD, la volonté existe que ce dernier soit intégré dans l'Internationale, et donc dans le KPD, mais le regroupement de ce dernier avec la Gauche de l'USPD en décembre 1920 pour former le VKPD, regroupement auquel étaient hostiles tous les courants de gauche de l'IC, barre la route à cette possibilité. Le KAPD acquiert néanmoins le statut de "parti sympathisant de l'IC", disposant d'un représentant permanent dans son Comité exécutif, et il envoie des délégués à son 3e congrès en juin 1921. Entretemps, cependant, cette communauté de travail s'est fortement altérée suite notamment à "l'action de mars" (une "offensive" aventuriste promue par le VKPD) et à la répression de l'insurrection de Cronstadt (que la Gauche a soutenue dans un premier temps croyant que cette insurrection était effectivement l'œuvre des Blancs comme le prétendait la propagande du gouvernement soviétique). En même temps, la direction de droite du PCN (Wijnkoop est appelé le "Levi hollandais"), qui a la confiance de Moscou, entreprend une politique d'exclusions anti statutaire des militants de la Gauche. Finalement, ces militants vont fonder en septembre un nouveau parti, le KAPN, sur le modèle du KAPD.
La politique de Front unique adoptée lors du 3e congrès de l'IC ne fait qu'aggraver les choses de même que l'ultimatum adressé au KAPD de fusionner avec le VKPD. En juillet 1921, la direction du KAPD, avec le soutien de Gorter, adopte une résolution coupant les ponts avec l'IC et appelant à la constitution d'une "Internationale communiste ouvrière", et cela deux mois avant le congrès du KAPD prévu en septembre. C'était de toute évidence une décision totalement précipitée. À ce congrès, la question de la fondation d'une nouvelle internationale est discutée (les militants de Berlin, et notamment Jan Appel, y sont opposés) et le congrès décide finalement de créer un Bureau d'information en vue d'une telle constitution. Ce Bureau d'information agit comme si la nouvelle internationale avait déjà été formée alors que sa conférence constitutive n'a eu lieu qu'en avril 1922. À ce moment-là, le KAPD a connu une scission entre, d'une part, la "tendance de Berlin", majoritaire et qui est hostile à la formation d'une nouvelle internationale, et la "tendance d'Essen" (qui rejette les luttes salariales). Seule cette dernière participe à cette conférence qui compte cependant sur la présence de Gorter, rédacteur du programme de la KAI (Internationale Communiste Ouvrière, nom de la nouvelle internationale). Les groupes participants sont en petit nombre et représentent des forces très limitées : outre la tendance d'Essen, il y a le KAPN, les communistes de Gauche bulgares, le Communist Workers Party (CWP) de Sylvia Pankhurst, le KAP d'Autriche, qualifié de "village Potemkine" par le KAPD de Berlin. Finalement, cette "Internationale" croupion va disparaître avec la disparition ou le retrait progressif de ses constituants. C'est ainsi que la tendance d'Essen connaît de multiples scissions et que le KAPN se désagrège, d'abord par l'apparition en son sein d'un courant qui se rattache à la tendance de Berlin, hostile à la formation de la KAI, puis par des luttes intestines d'ordre clanique plus que principielles.
En fait, l'élément essentiel qui permet d'expliquer l'échec piteux et dramatique de la KAI est constitué par le reflux de la vague révolutionnaire qui avait servi de tremplin à la fondation de l'IC :
"L'erreur de Gorter et de ses partisans de proclamer artificiellement la KAI, alors que subsistaient dans l'IC des fractions de gauche qui auraient pu être regroupées au sein d'un même courant communiste de gauche international, a été très lourde pour le mouvement révolutionnaire. (…) Le déclin de la révolution mondiale, très net en Europe à partir de 1921, ne permettait guère d'envisager la formation d'une nouvelle Internationale. En croyant que le cours était toujours à la révolution, avec la théorie de la "crise mortelle du capitalisme", les courants de Gorter et d'Essen avaient une certaine logique dans la proclamation de la KAI. Mais les prémisses étaient fausses." (Notre livre, La Gauche hollandaise, Chapitre V.4.d)
La déconfiture finale du KAPD et du KAPN illustre de façon saisissante la nécessité qu'ont les révolutionnaires d'avoir la vision la plus claire possible de l'évolution du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie.
Si c'est avec beaucoup de retard que la Gauche germano-hollandaise a pris conscience du reflux de la vague révolutionnaire9, ce ne fut pas le cas pour les Bolcheviks et les dirigeants de l'Internationale communiste ni, non plus, pour la Gauche communiste d'Italie. Mais les réponses que les uns et les autres ont apportées à cette situation étaient radicalement différentes :
- pour les bolcheviks et la majorité de l'IC, il fallait "aller aux masses" puisque les masses ne venaient plus à la révolution, ce qui se traduisait par une politique de plus en plus opportuniste, notamment envers les partis socialistes et les courants "centristes" ainsi qu'envers les syndicats ;
- pour la Gauche italienne, au contraire, il fallait continuer à faire preuve de la même intransigeance qui avait caractérisé les bolcheviks au cours de la guerre et jusqu'à la fondation de l'IC ; il était hors de question d'essayer de prendre des raccourcis vers la révolution en négociant les principes et en atténuant leur tranchant ; de tels raccourcis constituaient le chemin le plus sûr vers la défaite.
En réalité, le cours opportuniste qui a affecté l'IC, dès le 2e congrès mais surtout à partir du 3e, et qui remettait en cause la clarté et l'intransigeance affirmée à son 1er congrès, exprimait, non seulement les difficultés rencontrées par le prolétariat mondial à poursuivre et renforcer son combat révolutionnaire, mais aussi la contradiction insoluble dans laquelle s'enfonçait le parti bolchevique qui dirigeait de fait l'IC. D'un côté, ce parti se devait d'être le fer de lance de la révolution mondiale après l'avoir été dans la révolution en Russie. Il avait d'ailleurs toujours affirmé que cette dernière n'était qu'une toute petite étape de la première et il était bien conscient qu'une défaite du prolétariat mondial signifiait la mort de la révolution en Russie. D'un autre côté, en tant que détenteur du pouvoir dans un pays, il était soumis aux exigences propres à la fonction d'un État national notamment celle d'assurer la "sécurité" extérieure et intérieure, c'est-à-dire de mener une politique extérieure conforme aux intérêts de la Russie et une politique intérieure garantissant la stabilité du pouvoir. En ce sens, la répression des grèves de Petrograd et l'écrasement sanglant de l'insurrection de Cronstadt en mars 1921 étaient le pendant d'une politique de "main tendue", sous couvert de "Front unique", vers les partis socialistes dans la mesure où ces derniers pouvaient exercer une pression sur les gouvernements pour orienter leur politique extérieure dans un sens favorable à la Russie.
L'intransigeance de la Gauche communiste italienne, laquelle dirigeait de fait le PCI (les "Thèses de Rome" adoptées par son 2e congrès en 1922 ont été rédigées par Bordiga et Terracini) s'est notamment exprimée, et de façon exemplaire, face à la montée du fascisme en Italie suite à la défaite des combats de 1920. Sur le plan pratique, cette intransigeance se manifestait par un total refus de nouer des alliances avec des partis de la bourgeoisie (libéraux ou "socialistes) face à la menace fasciste : le prolétariat ne pouvait combattre le fascisme que sur son propre terrain, la grève économique et l'organisation de milices ouvrières d'autodéfense. Sur le plan théorique, on doit à Bordiga la première analyse sérieuse (et qui reste toujours valable) du phénomène fasciste, une analyse qu'il a présentée devant les délégués du 4e congrès de l'IC en réfutation de l'analyse faite par cette dernière :
- "Le fascisme n'est pas le produit des couches moyennes et de la bourgeoisie agraire. Il est la conséquence de la défaite qu'a subie le prolétariat, laquelle a jeté les couches petites-bourgeoises indécises derrière la réaction fasciste." (La Gauche communiste d'Italie, chapitre I)
- "Le fascisme n'est pas une réaction féodale. Il est né dans les grandes concentrations industrielles comme Milan…" (Ibid.) et a reçu le soutien de la bourgeoisie industrielle.
- "Le fascisme ne s'oppose pas à la démocratie. Les bandes armées sont un complément indispensable quand 'l'État ne suffit plus à défendre le pouvoir de la bourgeoisie'" (Ibid.)
Cette intransigeance s'est exprimée aussi à l'égard de la politique de Front unique, de "main tendue" envers les partis socialistes et son corollaire, le mot d'ordre de "Gouvernement ouvrier" lequel "revient à nier en pratique le programme politique du communisme, c'est-à-dire la nécessité de préparer les masses à la lutte pour la dictature du prolétariat". (Citation de Bordiga dans La Gauche communiste d'Italie)
Elle s'est exprimée également à propos de la politique de l'IC visant à fusionner les PC et les courants de gauche des partis socialistes ou "centristes" qui, en Allemagne, a conduit à la formation du VKPD et qui, en Italie, s'est traduite par l'entrée en août 1924 de 2000 "terzini" (partisans de la 3e Internationale) dans un parti qui ne comptait plus que 20 000 membres du fait de la répression et de la démoralisation.
Elle s'est enfin exprimée envers la politique de "bolchevisation" des PC à partir du 5e congrès de l'IC en juillet 1924, une politique combattue également par Trotski et qui, à grands traits, consistait à renforcer la discipline dans les partis communistes, une discipline bureaucratique destinée à faire taire les résistances contre sa dégénérescence. Cette bolchevisation consistait aussi à promouvoir un mode d'organisation des PC à partir des "cellules d'usine" ce qui polarisait les ouvriers sur les problèmes qui se posaient dans "leur" entreprise au détriment, évidemment, d'une vision et d'une perspective générales du combat prolétarien.
Alors que la Gauche est encore largement majoritaire au sein du parti, l'IC impose une direction de droite (Gramsci, Togliatti) qui soutient sa politique, une opération qui est facilitée par l'emprisonnement de Bordiga entre février et octobre 1923. Pourtant, à la conférence clandestine du PCI de mai 1924 les thèses présentées par Bordiga, Grieco, Fortichiari et Repossi, et qui sont très critiques envers la politique de l'IC, sont approuvées par 35 secrétaires de fédération sur 45 et par 4 secrétaires interrégionaux sur 5. C'est en 1925 que se déchaîne au sein de l'IC la campagne contre les oppositions, à commencer par l'Opposition de Gauche" menée par Trotski. "En mars-avril 1925, l'Exécutif élargi de l'IC mit à l'ordre du jour l'élimination de la tendance 'bordiguiste' à l'occasion du 3e congrès du PCd'I. Il interdit la publication de l'article de Bordiga favorable à Trotski. La bolchevisation de la section italienne commença par la destitution de Fortichiari de son poste de secrétaire fédéral de Milan. Alors, soudainement, en avril, la Gauche du parti, avec Damen, Repossi, Perrone et Fortichiari fonda un "Comité d'entente (…) afin de coordonner une contre-offensive. La direction de Gramsci attaqua violemment le 'Comité d'entente' en le dénonçant comme 'fraction organisée'. En fait, la Gauche ne voulait pas se constituer encore en fraction : elle ne tenait pas à fournir un prétexte à son expulsion, alors qu'elle demeurait encore majoritaire dans le parti. Au début, Bordiga se refusa d'adhérer au Comité, ne voulant pas briser le cadre de la discipline imposée. C'est en juin seulement qu'il se rallia aux vues de Damen, Fortichiari et Repossi. Il fut chargé de rédiger une 'Plate-forme de la gauche' qui est la première démolition systématique de la bolchevisation." (Ibid.)
"Sous la menace d'exclusion, le 'Comité d'entente' dut se dissoudre… C'était le commencement de la fin de la Gauche italienne comme majorité." (Ibid.)
Au congrès de janvier 1926, qui se tient à l'étranger du fait de la répression fasciste, la Gauche présente les "Thèses de Lyon" qui ne recueillent que 9,2% des voix : la politique menée, en application des consignes de l'IC, de recrutement intensif d'éléments jeunes et peu politisés a donné ses fruits… Ces thèses de Lyon vont orienter la politique de la Gauche italienne dans l'émigration.
Bordiga va mener un dernier combat lors du 6e Exécutif élargi de l'IC de février-mars 1926. Il dénonce la dérive opportuniste de l'IC et évoque la question des fractions, sans pourtant en envisager l'actualité immédiate, affirmant que "l'histoire des fractions est l'histoire de Lénine" ; elles ne sont pas une maladie, mais le symptôme de cette maladie. Elles sont une réaction de "défense contre les influences opportunistes".
Dans une lettre à Karl Korsch, en septembre 1926, Bordiga écrivait : "Il ne faut pas vouloir la scission des partis et de l'Internationale. Il faut laisser s'accomplir l'expérience de la discipline artificielle et mécanique en respectant cette discipline jusque dans ses absurdités de procédure tant que cela sera possible, sans jamais renoncer aux positions de critique idéologique et politique et sans jamais se solidariser avec l'orientation dominante. (…) D'une façon générale, je pense que ce qui doit être mis aujourd'hui au premier plan, c'est, plus que l'organisation et la manœuvre, un travail préalable d'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale, basée sur les expériences éloquentes qu'a connues le Komintern. Comme ce point est loin d'être réalisé, toute initiative internationale apparait difficile." (Cité dans La Gauche communiste d'Italie)
Ce sont là aussi des bases sur laquelle va finalement se constituer la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie et qui va tenir sa première conférence en avril 1928 à Pantin, dans la banlieue de Paris. Elle compte alors 4 "fédérations" : Bruxelles, New York, Paris et Lyon avec des militants aussi au Luxembourg, à Berlin et à Moscou.
Cette conférence adopte à l'unanimité une résolution définissant ses perspectives dont voici des extraits :
- "Se constituer en fraction de gauche de l'Internationale communiste.
- (…)
- Publier un bimensuel qui s'appellera Prometeo.
- Constituer des groupes de gauche qui auront pour tâche la lutte sans merci contre l'opportunisme et les opportunistes. (…)
- S'assigner comme but immédiat :
- La réintégration de tous les expulsés de l'Internationale qui se réclament du Manifeste communiste et acceptent les thèses du IIe Congrès mondial.
- La convocation du VIe Congrès mondial sous la présidence de Léon Trotski.
- La mise à l'ordre du jour au VIe Congrès mondial de l'expulsion de l'Internationale de tous les éléments qui se déclarent solidaires avec les résolutions du XVe congrès russe."
Comme on le voit :
- la Fraction ne se conçoit pas comme "italienne" mais comme fraction de l'IC ;
- elle considère qu'il existe encore une vie prolétarienne dans celle-ci et qu'on peut encore la sauver ;
- elle estime que le parti russe doit se soumettre aux décisions du Congrès de l'IC et "faire le ménage dans ses rangs" en expulsant tous ceux qui ont ouvertement trahi (comme ce fut déjà le cas auparavant envers les autres partis de l'Internationale) ;
- elle ne se donne pas pour tâche l'intervention parmi les ouvriers en général mais en priorité parmi les militants de l'IC.
La Fraction va alors entreprendre un travail remarquable jusqu'en 1945, un travail poursuivi et complété par la GCF jusqu'en 1952. Nous avons déjà souvent évoqué ce travail dans nos articles, textes internes et discussions et il n'y a pas lieu d'y revenir ici.
Une des contributions essentielles de la Fraction italienne, et qui est au cœur du présent rapport, va être justement l'élaboration de la notion de Fraction sur la base de toute l'expérience du mouvement ouvrier. Cette notion est déjà définie, à grands traits, au début du rapport. En outre, dans une annexe, nous portons à la connaissance des camarades une série de citations de textes de la Fraction italienne et de la GCF permettant de se faire une idée plus précise de cette notion. Aussi, nous nous contenterons ici de redonner un extrait de notre presse où la notion de Fraction avait été définie ("La fraction italienne et la gauche communiste de France", Revue Internationale n° 90) :
"La minorité communiste existe en permanence comme expression du devenir révolutionnaire du prolétariat. Cependant l'impact qu'elle peut avoir sur les luttes immédiates de la classe est étroitement conditionné par le niveau de celles-ci et du degré de conscience des masses ouvrières. Ce n'est que dans des périodes de luttes ouvertes et de plus en plus conscientes du prolétariat que cette minorité peut espérer avoir un impact sur ces luttes. Ce n'est que dans ces circonstances qu'on peut parler de cette minorité comme d'un parti. En revanche, dans les périodes de recul historique du prolétariat, de triomphe de la contre-révolution, il est vain d'espérer que les positions révolutionnaires puissent avoir un impact significatif et déterminant sur l'ensemble de la classe. Dans de telles périodes, le seul travail possible, et il est indispensable, est celui d'une fraction : préparer les conditions politiques de la formation du futur parti lorsque le rapport de forces entre les classes permettra à nouveau que les positions communistes aient un impact dans l'ensemble du prolétariat." (Extrait de la note 4)
"La Fraction de Gauche se forme à un moment où le parti du prolétariat tend à dégénérer victime de l'opportunisme, c'est-à-dire de la pénétration en son sein de l'idéologie bourgeoise. C'est la responsabilité de la minorité qui maintient le programme révolutionnaire que de lutter de façon organisée pour faire triompher celui-ci au sein du parti. Soit la Fraction réussit à faire triompher ses principes et à sauver le parti, soit ce dernier poursuit son cours dégénérescent et il finit alors par passer avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie. Le moment du passage du parti prolétarien dans le camp bourgeois n'est pas facile à déterminer. Cependant, un des indices les plus significatifs de ce passage est le fait qu'il ne puisse plus apparaître de vie politique prolétarienne au sein du parti. La fraction de Gauche a la responsabilité de mener le combat au sein du parti tant que subsiste un espoir qu'il puisse être redressé : c'est pour cela que dans les années 1920 et au début des années 1930, ce ne sont pas les courants de gauche qui ont quitté les partis de l’IC mais ils ont été exclus, souvent par des manœuvres sordides. Cela dit, une fois qu'un parti du prolétariat est passé dans le camp de la bourgeoisie, il n'y a pas de retour possible. Nécessairement, le prolétariat devra faire surgir un nouveau parti pour reprendre son chemin vers la révolution et le rôle de la Fraction est alors de constituer un "pont" entre l'ancien parti passé à l'ennemi et le futur parti dont elle devra élaborer les bases programmatiques et constituer l'ossature. Le fait qu'après le passage du parti dans le camp bourgeois il ne puisse exister de vie prolétarienne en son sein signifie aussi qu'il est tout à fait vain, et dangereux, pour les révolutionnaires de pratiquer "l'entrisme" qui constituait une des "tactiques" du trotskisme et que la Fraction a toujours rejeté. Vouloir entretenir une vie prolétarienne dans un parti bourgeois, et donc stérile pour les positions de classe, n'a jamais eu comme autre résultat que d'accélérer la dégénérescence opportuniste des organisations qui s'y sont essayées et non de redresser en quoi que ce soit ce parti. Quant au "recrutement" que ces méthodes ont permis, il était particulièrement confus, gangrené par l'opportunisme et n'a jamais pu constituer une avant-garde pour la classe ouvrière.
En fait, une des différences fondamentales entre la Fraction italienne et le trotskisme réside dans le fait que la Fraction, dans la politique de regroupement des forces révolutionnaires, mettait toujours en avant la nécessité de la plus grande clarté, de la plus grande rigueur programmatique, même si elle était ouverte à la discussion avec tous les autres courants qui avaient engagé le combat contre la dégénérescence de l'IC. En revanche, le courant trotskiste a essayé de constituer des organisations de façon précipitée, sans une discussion sérieuse et une décantation préalables des positions politiques, misant essentiellement sur des accords entre "personnalités" et sur l'autorité acquise par Trotski comme un des principaux dirigeants de la révolution de 1917 et de l'IC à son origine."
Ce passage évoque les méthodes du courant trotskiste que nous n'avons pas, faute de place, évoqué plus haut. Mais il est significatif que deux des caractéristiques de ce courant, avant qu'il ne rejoigne le camp bourgeois, sont les suivantes :
- à aucun moment il n'a intégré dans ses conceptions la notion de Fraction ; pour lui, on passait d'un parti à un autre, et si dans les périodes de recul de la classe, les révolutionnaires étaient une petite minorité, il fallait considérer que leur organisation était un "parti en petit", une notion qui était apparue au sein même de la Fraction italienne au milieu des années 30, et qui est celle aujourd'hui de la TCI puisque sa principale composante se nomme Partito comunista internazionalista ;
- Trotski (mais il n'était pas le seul) n'a absolument pas compris l'ampleur de la contre-révolution à tel point qu'il a considéré les grèves de mai-juin 1936 en France comme le "début de la révolution". En ce sens, la notion de cours historique (rejetée également par la TCI) est essentielle et constitutive de celle de Fraction.
La volonté de clarté qui a toujours animé la Gauche italienne comme condition fondamentale pour remplir sa tâche est évidemment inséparable de la préoccupation pour la théorie et de la nécessité permanente d'être capable de remettre en cause des analyses et des positions qui semblaient définitives.
5) En guise de conclusion
Pour conclure cette partie du rapport, il nous faut très brièvement revenir sur la trajectoire des courants qui sont sortis de l'IC et dont nous avons plus haut évoqué uniquement l'origine.
Le courant issu de la Gauche germano-hollandaise s'est maintenu même après la disparition du KAPD et du KAPN. Son principal représentant était le GIK (Groupe des communistes internationalistes) en Hollande, un groupe qui avait une influence en dehors de ce pays (par exemple Living Marxism animé par Paul Mattick aux États-Unis). Durant l'un des moments les plus tragiques et critiques des années 1930, la Guerre d'Espagne, ce groupe a défendu une position parfaitement internationaliste, sans aucune concession à l'antifascisme. Il a animé la réflexion des communistes de Gauche y compris de Bilan (qui reprend la position de Rosa Luxemburg et de la Gauche allemande sur la question nationale) de même que celle de la GCF qui a rejeté la position classique de la Gauche italienne sur les syndicats pour reprendre celle de la Gauche germano-hollandaise. Cependant, ce courant a adopté deux positions qui allaient lui être fatales (et qui n'étaient pas celles-du KAPD) :
- l'analyse de la Révolution de 1917 comme bourgeoise ;
- le rejet de la nécessité du parti.
Cela l'a conduit à rejeter dans le camp bourgeois toute une série d'organisations prolétariennes du passé, à rejeter, en fin de compte, l'histoire du mouvement ouvrier et les leçons qu'elle pouvait apporter pour le futur.
Cela l'a conduit également à s'interdire tout rôle de fraction puisque la tâche de cette dernière est de préparer un organisme dont le courant conseilliste ne veut pas, le parti.
En conséquence de ces deux faiblesses, il s'interdisait de jouer un rôle significatif dans le processus qui conduira au futur parti, et donc à la révolution communiste, même si les idées conseillistes continuent à avoir une influence sur le prolétariat.
Un dernier point introductif à la 2e partie du rapport : peut-on considérer le CCI comme une fraction ? La réponse saute aux yeux, évidemment non puisque notre organisation, à aucun moment, ne s'est constituée au sein d'un parti prolétarien. Mais cette réponse, elle avait déjà été donnée au début des années 50 par le camarade MC dans une lettre aux autres camarades du groupe Internationalisme :
“La Fraction était une continuation organique, directe, parce qu’elle n’existait que pour un temps relativement court. Souvent elle continuait à vivre au sein de l’ancienne organisation jusqu’au moment de la rupture. Sa rupture équivalait souvent à sa transformation en nouveau Parti (exemple de la fraction Bolchevique et du Spartakusbund, comme presque toutes les fractions de gauche de l’ancien Parti). Cette continuation organique est aujourd’hui quasiment inexistante. (…) Parce que la Fraction n’avait pas à répondre à des problèmes fondamentalement nouveaux comme le pose notre période de la crise permanente et de l’évolution vers le capitalisme d’État et ne se trouvait pas disloquée en une poussière de petites tendances, elle était plus ancrée en ses principes révolutionnaires acquis qu’appelée à formuler de nouveaux principes, elle avait plus à maintenir qu’à construire. Pour cette raison et pour celle de sa continuité organique directe dans un laps de temps relativement court, elle était le nouveau Parti en gestation. (…)
[Le groupe], s’il a comme tâches en partie celles de la Fraction, à savoir: réexamen de l’expérience, formation des militants, a en plus celle de l’analyse de l’évolution nouvelle et la perspective nouvelle, et en moins celle de reconstruire le programme du futur Parti. Il n’est qu’un apport à cette reconstruction, comme il n’est qu’un élément du futur Parti. Sa fonction dans son apport programmatique est partielle du fait de sa nature organisationnelle”.
Aujourd'hui, au moment des 40 ans du CCI, c'est la même démarche que nous devons avoir en nous rappelant ce que nous écrivions à l'occasion de ses 30 ans :
"La capacité du CCI à faire face à ses responsabilités tout au long de ses trente années d'existence, nous la devons en très grande partie aux apports de la Fraction italienne de la Gauche communiste. Le secret du bilan positif que nous tirons de notre activité au cours de cette période, c'est dans notre fidélité aux enseignements de la Fraction et, plus généralement, à la méthode et à l'esprit du marxisme qu'elle s'était pleinement appropriés." ("Les trente ans du CCI : s'approprier le passé pour construire l'avenir", Revue Internationale n° 123).
1 Il faut noter que, d'après une lettre de Marx à Engels envoyée peu après ce meeting, Marx avait accepté l'invitation d'Eccarius parce que cette fois l'affaire lui paraissait sérieuse contrairement aux tentatives précédentes de constituer des organisations auxquelles il avait été invité et qu'il estimait artificielles.
2 Dans cette partie, de même que dans la partie suivante, nous nous penchons sur les fractions ayant surgi dans quatre partis différents, ceux de Russie, de Hollande, d'Allemagne et d'Italie sans nous intéresser aux partis de deux pays majeurs, la Grande-Bretagne et la France. En réalité, dans ces derniers partis, il n'a pas existé de fractions de Gauche dignes de ce nom du fait, en particulier, de l'extrême faiblesse de la pensée marxiste en leur sein. Ainsi, en France, la première réaction organisée contre la Première guerre mondiale ne provient pas d'une minorité au sein du Parti socialiste mais d'une minorité au sein de la centrale syndicale CGT, le noyau autour de Rosmer et Monatte qui a publié La Vie ouvrière.
3 "J'ai continuellement dit contre la rédaction de De Tribune : nous devons tout faire pour attirer les autres vers nous, mais si cela échoue après que nous nous soyons battus jusqu'au bout et que tous nos efforts aient échoué, alors nous devons céder [c'est-à-dire accepter la suppression de De Tribune]." (Lettre de Gorter à Kautsky, 16 février 1909). "Notre force dans le parti peut grandir ; notre force en dehors du parti ne pourra jamais croître." (Intervention de Gorter au congrès de Deventer). (D'après l'article "La gauche hollandaise (1900-1914) : Le mouvement 'Tribuniste' 3ème partie", Revue Internationale n° 47)
4 Parmi les nombreux militants frappés par la répression, on peut signaler Rosa Luxemburg qui passe une bonne partie de la guerre en prison, Liebknecht qui est d'abord mobilisé puis enfermé en forteresse après avoir pris la parole pour dénoncer la guerre et le gouvernement dans la manifestation du 1er mai 1916 ; même Mehring, âgé de plus de 70 ans, est emprisonné.
5 Les deux autres positions sont celle de Trotski qui veut intégrer les syndicats dans l'État afin d'en faire des organes d'encadrement des ouvriers (sur le modèle de l'Armée Rouge) pour une plus grande discipline au travail et de Lénine qui, au contraire, estime que les syndicats doivent jouer un rôle dans la défense des ouvriers contre l'État qui connait de "fortes déformations bureaucratiques".
6 Suite au "danger" que le Bureau d'Amsterdam ne constitue un pôle de regroupement de la Gauche au sein de l'IC, le Comité Exécutif de celle-ci annonce par radio sa dissolution le 4 mai 1920.
7 À cette époque, la Gauche hollandaise et Pannekoek sont particulièrement clairs pour combattre la vision développée par Otto Rühle qui rejette la nécessité du parti à l'image de la position qui sera plus tard celle des conseillistes… et de Pannekoek.
8 On connait de quelle façon ces délégués sont parvenus en Russie (alors que la guerre civile et le "cordon sanitaire" rend quasiment impossible un accès par voie terrestre) : ils ont détourné un navire marchand jusqu'à Mourmansk.
9 Dans ses derniers écrits, à la veille de sa mort, Gorter fait la preuve qu'il a compris ses propres erreurs et il incite ses camarades à en faire autant et à en tirer les leçons (Voir La gauche hollandaise, fin du chapitre V.4.d)
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Personnages:
- Marc Chirik [572]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [487]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Résolution sur la situation internationale 2015
- 1299 lectures
Se baser fermement sur les acquis du mouvement ouvrier
1. En faisant un bilan de ses analyses de la situation internationale au cours des 40 dernières années, le CCI peut s’inspirer de l’exemple du Manifeste Communiste de 1848, la première déclaration ouverte du courant marxiste dans le mouvement ouvrier. Les acquis du Manifeste sont bien connus : l’application de la méthode matérialiste au processus historique, montrant la nature transitoire de toutes les formations sociales ayant existé jusque-là ; la reconnaissance que, alors que le capitalisme jouait encore un rôle révolutionnaire en unifiant le marché mondial et en développant les forces productives, ses contradictions inhérentes, qui se manifestaient dans les crises répétées de surproduction, indiquaient que lui aussi n’était qu’une étape transitoire dans l’histoire humaine ; l’identification de la classe ouvrière comme fossoyeur du mode de production bourgeois ; la nécessité pour la classe ouvrière de hisser ses luttes au niveau de la prise de pouvoir politique pour établir les fondements d’une société communiste ; le rôle nécessaire d’une minorité communiste, en tant que produit et facteur actif dans la lutte de classe du prolétariat.
2. Ces pas en avant sont encore une partie fondamentale du programme communiste aujourd’hui. Mais Marx et Engels, fidèles à une méthode qui est à la fois historique et autocritique, ont été capables par la suite de reconnaître que certaines parties du Manifeste avaient été dépassées, ou démenties, par l’expérience historique. Ainsi, à la suite des événements de la Commune de Paris en 1871, ils en conclurent que la prise du pouvoir par la classe ouvrière impliquait la destruction et non pas la conquête de l’État bourgeois existant. Et longtemps avant, dans les débats de la Ligue des Communistes qui suivirent la défaite des révolutions de 1848, ils réalisèrent que le Manifeste s’était trompé en estimant que le capitalisme s’était déjà engagé dans une impasse fondamentale et qu’il pourrait y avoir une transition rapide de la révolution bourgeoise à la révolution prolétarienne. Contre la tendance hyper-activiste autour de Willich et Schapper, ils mettaient en avant la nécessité pour les révolutionnaires de développer une réflexion beaucoup plus profonde sur les perspectives d’une société capitaliste encore ascendante. Cependant, en reconnaissant ces erreurs, ils ne remettaient pas en question leur méthode sous-jacente – ils y revenaient plutôt pour donner aux acquis programmatiques du mouvement des fondements plus solides.
3. La passion du communisme, le désir brûlant de voir la fin de l’exploitation capitaliste, ont fréquemment conduit les communistes à tomber dans des erreurs semblables à celles de Marx et Engels en 1848. L’éclatement de la Première Guerre mondiale, et l’immense soulèvement révolutionnaire qu’elle provoqua dans les années 1917-20, ont été vus de façon correcte par les communistes comme une preuve définitive que le capitalisme était entré dans une nouvelle époque, l’époque de son déclin, et donc l’époque de la révolution prolétarienne. La révolution mondiale avait d’ailleurs été mise à l’ordre du jour par la prise du pouvoir par le prolétariat de Russie en octobre 1917. Mais l’avant-garde communiste de l’époque a aussi tendu à sous-estimer les énormes difficultés auxquelles se confrontait le prolétariat dont la confiance en soi et la boussole morale avaient subi un coup sévère du fait de la trahison de ses vieilles organisations ; un prolétariat qui était épuisé par des années de massacre impérialiste et sur lequel pesait encore fortement le réformisme et des influences opportunistes qui avaient grandi dans le mouvement ouvrier au cours des trois décennies précédentes. La réponse de la direction de l’Internationale Communiste à ces difficultés a été de tomber dans de nouvelles versions de l’opportunisme qui visaient à gagner de l’influence au sein des masses, comme la "tactique" de front unique avec des agents avérés de la bourgeoisie actifs au sein de la classe ouvrière. Ce tournant opportuniste a fait surgir des réactions saines des courants de gauche au sein de l’Internationale, en particulier les gauches italienne et allemande, mais elles se confrontaient elles-mêmes à des obstacles considérables pour comprendre les nouvelles conditions historiques. Dans la Gauche allemande, ces tendances qui avaient adopté la théorie de la "crise mortelle" se sont méprises en voyant le début de la décadence du capitalisme. Alors que cette décadence devait se comprendre comme toute une période de crises et de guerres – elle signifiait pour ces courants que le système se heurtait à un mur et serait totalement incapable de récupérer. Un résultat de cette analyse a été le déclenchement d’actions aventuristes qui visaient à provoquer le prolétariat pour qu’il assène un coup mortel au capitalisme ; un autre en a été l’instauration d’une "Internationale communiste ouvrière" éphémère, suivie par une phase "conseilliste", un abandon croissant de la notion même de parti de classe.
4. L’incapacité de la majorité de la Gauche allemande à répondre au reflux de la vague révolutionnaire a été un élément crucial de désintégration de la plupart de ses expressions organisées. À la différence de la Gauche allemande, la Gauche italienne a été capable de reconnaître la défaite profonde subie par le prolétariat mondial à la fin des années 1920 et de développer les réponses théoriques et organisationnelles exigées par la nouvelle phase de la lutte de classe, lesquelles étaient incluses dans le concept d’un changement dans le cours de l’histoire, dans la formation de la Fraction, et dans l’idée de faire un "bilan" de la vague révolutionnaire et des positions programmatiques de l’Internationale Communiste. Cette clarté a permis à la Fraction italienne de faire des avancées théoriques inestimables, en défendant en même temps des positions internationalistes quand, tout autour d’elle, on succombait à l’antifascisme et à la marche vers la guerre. Cependant, même la Fraction n’était pas immunisée contre les crises et les régressions théoriques ; en 1938, la revue Bilan a été renommée Octobre en anticipant une nouvelle vague révolutionnaire qui résulterait de la guerre imminente et de la "crise de l’économie de guerre" qui s’ensuivrait. Dans la période d’après-guerre, la Gauche Communiste de France – qui était née en réaction à la crise de la Fraction pendant la guerre et à la précipitation immédiatiste qui avait conduit à former le Parti Communiste Internationaliste en 1943, qui avait été capable, dans une période très fructueuse entre 1946 et 1952, de faire la synthèse des meilleures contributions des gauches italienne et allemande et de développer une meilleure compréhension de l’adoption par le capitalisme de formes totalitaires et étatiques – s’était elle-même désagrégée à cause d’une compréhension erronée de la période après-guerre, en prévoyant à tort l’éclatement imminent d’une troisième guerre mondiale.
5. En dépit de ces erreurs sérieuses, la démarche fondamentale de Bilan et de la GCF restaient valables, et ont été indispensables pour la formation du CCI au début des années 1970. Le CCI s’est formé sur la base de tout un ensemble d’acquis clefs de la Gauche communiste : pas seulement les positions de classe telles que l’opposition aux luttes de libération nationale et à toutes les guerres capitalistes, la critique des syndicats et du parlementarisme, la reconnaissance de la nature capitaliste des partis "ouvriers" et des pays "socialistes" mais aussi :
- l’héritage organisationnel développé par Bilan et la GCF, en particulier leur distinction entre fraction et parti, et la critique tant des conceptions conseillistes que des conceptions substitutionnistes du rôle de l’organisation ; et de plus, la reconnaissance des questions du fonctionnement et du comportement militant en tant que question politique à part entière ;
- un ensemble d’éléments indispensables donnant à la nouvelle organisation une perspective claire pour la période qui s’ouvrait devant elle, en particulier : la notion de cours historique et l’analyse du rapport de forces global entre les classes, le concept de décadence capitaliste et des contradictions économiques du système qui s’approfondissent ; la dérive vers la guerre et la constitution de blocs impérialistes ; le rôle essentiel du capitalisme d’État dans la capacité du système à maintenir son existence malgré son obsolescence historique.
La compréhension de la période historique
6. La question de la capacité du CCI de reprendre et de développer l’héritage organisationnel de la Gauche communiste est traitée dans d’autres rapports pour le 21ème congrès. Cette résolution se concentre sur les éléments qui guident notre analyse de la situation internationale depuis nos origines. Et là, il est clair que le CCI n’a pas simplement hérité des acquis du passé mais a été capable de les développer de nombreuses façons :
- Armé du concept de cours historique, le CCI a été capable de reconnaître que les événements de mai-juin 1968 en France, et la vague internationale de luttes qui a suivi, annonçaient la fin de la période de contre-révolution et l’ouverture d’un nouveau cours à des affrontements de classe massifs ; il a donc été capable de continuer à analyser l’évolution du rapport de forces entre les classes, les avancées réelles et les reculs du mouvement de classe, dans ce cadre global et historique, évitant ainsi de répondre de façon purement empirique à chaque épisode de la lutte classe internationale.
- En se fondant sur sa théorie de la décadence capitaliste, les groupes qui se sont rassemblés pour former le CCI avaient aussi compris que cette vague de lutte n’était pas, contrairement à la théorie des situationnistes, provoquée par l’ennui de la société de consommation, mais par le retour de la crise ouverte du système capitaliste. Tout au long de son existence, le CCI a donc continué à suivre le cours de la crise économique et à pointer son approfondissement inexorable.
- En comprenant que la réapparition de la crise économique pousserait les puissances mondiales capitalistes à entrer en conflit et à préparer une nouvelle guerre mondiale, le CCI a reconnu la nécessité de poursuivre son analyse du rapport de forces entre les blocs impérialistes et entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, dont la résistance à la crise économique dressait une barrière contre la capacité du système à déclencher un holocauste généralisé.
- Avec sa conception du capitalisme d’État, le CCI a été en mesure de fournir une explication cohérente de la nature à long terme de la crise qui est apparue à la fin des années 60, et qui a vu la bourgeoisie utiliser toutes sortes de mécanismes (nationalisations, privatisations, recours massif au crédit…) pour manipuler le fonctionnement de la loi de la valeur et donc atténuer ou retarder les effets les plus explosifs de la crise économique. De ce fait même, le CCI a été capable de voir à quel point la bourgeoisie dans sa phase décadente a utilisé sa position dans l’État pour faire toutes sortes de manœuvres (sur le terrain électoral, des actions syndicales, des campagnes idéologiques, etc.) pour dévoyer la lutte de classe et faire obstacle au développement de la conscience de classe. Et c’est ce même cadre théorique qui a permis au CCI de montrer les raisons sous-jacentes de la crise dans les pays soi-disant "socialistes" et de l’effondrement du bloc russe après 1989.
- En s’appuyant à la fois sur son concept de cours historique et sur son analyse de l’évolution des conflits impérialistes et de la lutte classe, le CCI a été la seule organisation prolétarienne à comprendre que l’effondrement du vieux système des blocs était le produit d’un blocage historique entre les classes et qu’il marquait l’entrée du capitalisme dans une phase nouvelle et finale de sa décadence - la phase de décomposition - qui à son tour créait de nouvelles difficultés pour le prolétariat et de nouveaux dangers pour l’humanité.
7. A côté de cette capacité à s’approprier et à développer les acquis du mouvement ouvrier passé, le CCI comme toutes les organisations révolutionnaires précédentes, est aussi soumis à de multiples pressions exercées par l’ordre social dominant, et donc aux formes idéologiques que ces pressions engendrent – par-dessus tout, l’opportunisme, le centrisme et le matérialisme vulgaire. En particulier, dans ses analyses de la situation mondiale, il a été la proie de l’impatience et de l’immédiatisme que nous avons identifiés dans les organisations du passé et qui relèvent, en partie, d’une forme mécanique de matérialisme. Ces faiblesses se sont aggravées dans l’histoire du CCI, du fait des conditions dans lesquelles il était né, puisqu’il souffrait de la rupture organique avec les organisations du passé, de l’impact de la contre-révolution stalinienne qui a introduit une vision fausse de la lutte et de la morale prolétariennes et de l’influence puissante de la révolte petite bourgeoise des années 1960 – la petite bourgeoisie, en tant que classe sans avenir historique, étant presque par définition l’incarnation de l’immédiatisme. De plus, ces tendances ont été exacerbées dans la période de décomposition qui est à la fois le produit et un facteur actif de la perte de perspective pour le futur.
La lutte de classe
8. Depuis le début, le danger d’immédiatisme s’est exprimé dans l’évaluation que le CCI faisait du rapport de forces entre les classes. Tout en identifiant correctement la période après 1968 comme la fin de la contre-révolution, sa caractérisation du nouveau cours historique comme "cours à la révolution" impliquait une montée linéaire et rapide des luttes immédiates jusqu’au renversement du capitalisme, et même après que cette formulation ait été corrigée, le CCI a conservé la vision que les vagues de luttes qui se sont suivies entre 1978 et 1989, malgré des reculs temporaires, représentaient une offensive semi-permanente du prolétariat. Les immenses difficultés de la classe pour passer du mouvement défensif à la politisation de ses luttes, et au développement d’une perspective révolutionnaire n’étaient pas suffisamment mises en lumière et analysées. Même si le CCI a été capable de reconnaître le début de la décomposition et le fait que l’effondrement des blocs impliquait un profond recul de la lutte de classe, nous étions toujours fortement influencés par l’espoir que l’approfondissement de la crise économique ramènerait les "vagues" de lutte des années 70 et 80 ; alors que nous avions considéré avec raison qu’il y avait eu un tournant dans le recul après 2003, nous avons souvent sous-estimé les énormes difficultés auxquels se confrontait la jeune génération de la classe ouvrière pour développer une perspective claire à ses luttes, un facteur qui affecte à la fois la classe ouvrière dans son ensemble et ses minorités politisées. Les erreurs d’analyse ont aussi alimenté certaines démarches fausses et même opportunistes dans l’intervention dans les luttes et la construction de l’organisation.
9. Si la théorie de la décomposition (qui était en fait le dernier legs du camarade MC au CCI) a donc été un guide indispensable et fondamental pour comprendre la période actuelle, le CCI a souvent bataillé pour comprendre toutes ses implications. C’est vrai en particulier quand il a fallu expliquer et reconnaître les difficultés de la classe ouvrière depuis les années 1990. Alors que nous étions capables de voir comment la bourgeoisie a utilisé les effets de la décomposition pour monter d’énormes campagnes idéologiques contre la classe ouvrière - la plus notable, le déluge de mensonges sur la "mort du communisme" après l’effondrement du bloc de l’Est – nous n’avons pas suffisamment examiné en profondeur à quel point le processus même de la décomposition tendait à saper la confiance en soi et la solidarité du prolétariat. De plus, nous avons éprouvé des difficultés pour comprendre l’impact sur l’identité de classe de la destruction des vieilles concentrations ouvrières dans certains pays centraux du capitalisme et leur relocalisation dans des nations antérieurement "sous-développées". Alors que nous avions au moins une compréhension partielle de la nécessité pour le prolétariat de politiser ses luttes pour résister à la décomposition, c’est seulement très tard que nous avons commencé à saisir que, pour le prolétariat, retrouver son identité de classe et adopter une perspective politique comporte une dimension morale et culturelle vitale.
La crise économique
10. C’est probablement dans le domaine du suivi de la crise économique que se sont exprimées de la façon la plus évidente les difficultés du CCI ; en particulier :
- Au niveau le plus général, une tendance à tomber dans une vision réifiée de l’économie capitaliste, comme une machine qui serait uniquement gouvernée par des lois objectives, faisant écran à la réalité que le capitalisme est d’abord et avant tout un rapport social et que les actions des êtres humains - sous la forme de classes sociales - ne peuvent jamais être complètement absentes lorsqu’on analyse le cours de la crise économique. C’est particulièrement vrai à l’époque du capitalisme d’État dans laquelle la classe dominante est confrontée en permanence à la nécessité d’intervenir dans l’économie et même de s’opposer à ses lois "immanentes", alors qu’en même temps, elle est obligée de prendre en compte le danger de la lutte de classe comme un élément de sa politique économique.
- Une compréhension réductionniste de la théorie économique de Rosa Luxemburg, issue d’une fausse extrapolation selon laquelle le capitalisme aurait déjà épuisé toutes les possibilités d’expansion depuis 1914 (ou même dans les années 60). En réalité, quand elle a exposé sa théorie en 1913, elle reconnaissait qu’il y avait encore de très grandes régions à économie non capitaliste qui restaient à être exploitées, même s’il était de moins en moins possible que cela ait lieu sans conflit direct entre puissances impérialistes ;
- La reconnaissance du fait réel qu’avec la réduction de ces champs pour son expansion, le capitalisme était de plus en plus contraint de recourir au palliatif de la dette est devenue quelques fois une explication passe-partout qui ne revenait pas sur la question sous-jacente du crédit dans l’accumulation du capital ; plus grave, l’organisation a de manière répétée prédit que les limites de la dette avaient déjà été atteintes ;
- Tous ces éléments faisaient partie d’une vision de l’effondrement automatique du capitalisme qui est devenue prédominante à l’époque du "credit crunch" (la crise du crédit) de 2008. Plusieurs rapports internes ou articles dans notre presse ont proclamé que le capitalisme était totalement à court d’options et se dirigeait vers une sorte de paralysie économique, un effondrement brutal. En réalité, comme Rosa elle-même le soulignait, la catastrophe réelle du capitalisme consiste dans le fait qu’elle soumet l’humanité à un déclin, une agonie à long terme, plongeant la société dans une barbarie croissante, que la "fin" du capitalisme ne sera pas une crise purement économique mais se jouera inévitablement sur le terrain du militarisme et de la guerre, sauf si elle est consciemment provoquée par la révolution prolétarienne (et à la prévision de Rosa, nous devons aussi ajouter la menace croissante d’une dévastation écologique, laquelle accélèrera certainement la tendance à la guerre). Cette idée d’un effondrement soudain et complet oublie aussi nos propres analyses sur la capacité de la classe dominante, par le biais du capitalisme d’État, de prolonger son système par toutes sortes de manipulations politiques et financières ;
- Le déni, dans certains de nos textes clefs, de toute possibilité d’expansion du capitalisme dans sa phase décadente a aussi rendu difficile pour l’organisation d’expliquer la croissance vertigineuse de la Chine et d’autres "nouvelles économies" dans la période qui a suivi la chute des vieux blocs. Alors que ces développements ne remettent pas en question, comme beaucoup l’ont dit, la décadence du capitalisme et en sont d’ailleurs une claire expression, ils sont allés à l’encontre de la position selon laquelle dans la période de décadence, il n’y a strictement aucune possibilité d’un décollage industriel dans des régions de la "périphérie". Alors que nous avons été capables de réfuter certains des mythes les plus faciles sur la "globalisation" dans la phase qui a suivi l’effondrement des blocs (mythes colportés par la droite qui y voyait un nouveau et glorieux chapitre dans l’ascendance du capitalisme, comme par la gauche qui s’en est servie pour une revitalisation des vieilles solutions nationalistes et étatiques), nous n’avons pas été capables de discerner le cœur de la vérité dans la mythologie mondialiste : que la fin du vieux modèle autarcique ouvrait de nouvelles sphères aux investissements capitalistes, y compris l’exploitation d’une nouvelle source énorme de forces de travail prélevée en dehors des rapports sociaux directement capitalistes.
- Ces erreurs d’analyse sont associées au fait que l’organisation a rencontré des difficultés considérables pour développer sa compréhension de la question économique de manière authentiquement associée. Une tendance à voir les questions économiques comme relevant de la sphère "d’experts" est devenue visible dans le débat sur "les 30 Glorieuses" dans la première décennie du 21ème siècle. Bien que le CCI ait certainement eu besoin de comprendre et d’expliquer pourquoi il avait rejeté l’idée que la reconstruction des économies mises en pièce par la guerre explique en elle-même la survie du système en décadence, en pratique ce débat a été une tentative ratée d’affronter le problème. Ce débat n’a pas été bien compris ni dedans ni en dehors de l’organisation et nous a laissé déboussolés théoriquement. Cette question doit être recadrée en relation avec toute la période de décadence afin de clarifier le rôle de l’économie de guerre et la signification de l’irrationalité de la guerre dans la décadence.
Les tensions impérialistes
11. Dans le domaine des tensions impérialistes, le CCI a en général un cadre d’analyse vraiment solide, qui montre les différentes phases de confrontation entre les blocs dans les années 70 et 80 ; et bien qu’ayant été quelque peu "surpris" par l’effondrement brutal du bloc de l’Est et de l’URSS après 1989, il avait déjà développé les outils théoriques pour analyser les faiblesses inhérentes aux régimes staliniens ; en liant cela à sa compréhension de la question du militarisme et au concept de décomposition qu’il avait commencé à élaborer dans la dernière moitié des années 80, le CCI a été le premier dans le milieu prolétarien à prévoir la fin du système des blocs, le déclin de l’hégémonie américaine et le développement très rapide du "chacun pour soi" au niveau impérialiste. Tout en restant conscients que la tendance à la formation de blocs impérialistes n’avait pas disparu après 1989, nous montrions les difficultés auxquelles faisait face même le candidat le plus vraisemblable au rôle de tête de bloc contre les États-Unis, l’Allemagne nouvellement réunifiée, difficulté à être un jour capable d’assumer son ambition impérialiste. Cependant, nous avons été moins capables de prévoir la capacité de la Russie de ré-émerger en tant que force qui compte sur la scène mondiale, et plus important, nous avons beaucoup tardé à voir la montée de la Chine en tant que nouvel acteur significatif dans les rivalités entre grandes puissances qui se sont développées dans les deux ou trois dernières décennies – un échec étroitement connecté à notre problème de reconnaissance de la réalité de l’avancée économique de la Chine.
Améliorer la maitrise de perspectives qui restent valables
12. L’existence de toutes ces faiblesses, prises dans leur ensemble, ne doit pas être un facteur de découragement, mais un stimulus pour entreprendre un programme de développement théorique qui rendra le CCI capable d’approfondir sa vision de tous les aspects de la situation mondiale. Le début d’un bilan critique des 40 dernières années entrepris dans les rapports du congrès, les tentatives d’aller aux racines de notre méthode d’analyse de la lutte de classe et de la crise économique, la redéfinition de notre rôle en tant qu’organisation dans la période de décomposition capitaliste - tout cela est le signe annonciateur d’une réelle renaissance culturelle dans le CCI. Dans la période à venir, le CCI devra aussi revenir sur des questions théoriques fondamentales telles que la nature de l’impérialisme et de la décadence de façon à fournir le cadre le plus solide à nos analyses de la situation internationale.
13. Le premier pas dans le bilan critique de 40 ans d’analyse de la situation mondiale est de reconnaitre nos erreurs et de commencer à creuser jusqu’au fond quelles sont leurs origines. Il serait donc prématuré d’essayer de prendre en compte toutes leurs implications dans l'analyse de la situation actuelle du monde et de ses perspectives. Néanmoins, nous pouvons dire qu’en dépit de nos faiblesses, les fondamentaux de nos perspectives restent valides ;
- Au niveau de l’économie, il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que la crise économique continue à s’approfondir et, bien qu’il n’y ait pas d’apocalypse finale, qu’il y aura des phases marquées par des convulsions graves secouant le système jusqu’à son cœur, ainsi que la poursuite de la situation de précarité et de chômage endémique qui pèse déjà lourdement sur la classe ouvrière.
- Nous ne pouvons certainement pas sous-estimer la résilience de ce système et la détermination de la classe dominante à le maintenir en marche en dépit de son obsolescence historique, mais comme nous l’avons toujours dit, les remèdes mêmes que le capital utilise contre sa maladie mortelle, tout en amenant un répit à court terme, tendent à rendre le patient encore plus malade à long terme.
- Au niveau des tensions impérialistes, nous voyons actuellement une réelle accélération du chaos militaire, notablement en Ukraine, au Moyen Orient, en Afrique et dans la Mer de Chine, qui porte avec lui la menace croissante d’un "retour de manivelle" dans les pays centraux (comme les récents massacres à Paris et à Copenhague). La scène des conflits impérialistes devient plus grande et les alliances qui se sont formées pour les mener aussi, comme nous pouvons le voir dans le cas du conflit entre la Russie et "l’Ouest" à propos de l’Ukraine, ou dans la coopération croissante entre Russie et Chine autour des conflits au Moyen Orient et ailleurs. Mais ces alliances restent très contingentes et ne présentent pas les conditions pour évoluer en blocs stables. Le principal danger auquel est confrontée l’humanité n’est pas celui d’une guerre mondiale classique mais celui d’une dégénérescence des conflits régionaux en une spirale incontrôlable de destruction.
Les prémices de cette spirale sont déjà discernables et elles ont les conséquences les plus négatives pour le prolétariat, dont les fractions "périphériques" sont directement mobilisées ou massacrées dans les conflits actuels et dont les fractions centrales se trouvent dans l’incapacité de réagir à la barbarie croissante, ce qui renforce la tendance à tomber dans l’atomisation et le désespoir. Mais malgré tous les dangers bien réels que fait courir la marée montante de la décomposition, le potentiel de la classe ouvrière pour répondre à cette crise sans précédent de l’humanité n’a pas été épuisé comme l’ont indiqué les meilleurs moments du mouvement étudiant en France en 2006 ou les révoltes sociales de 2011, dans lesquels le prolétariat, sans même se reconnaître comme classe, a montré des signes évidents de sa capacité à s’unifier au-delà de toutes ses divisions, dans les rues et dans les assemblées générales. Par-dessus tout, les jeunes prolétaires engagés dans ces mouvements, dans la mesure où ils ont commencé à défier la brutalité des rapports sociaux capitalistes et à poser la question d’une nouvelle société, ont fait les premiers pas timides vers la réaffirmation que la lutte de classe n’est pas qu’une lutte économique mais une lutte politique, et que son but ultime reste ce que soulignait de façon si audacieuse le Manifeste de 1848 : l’établissement de la dictature du prolétariat et l’inauguration d’une nouvelle culture humaine.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Rubrique:
Revue Internationale n°157
- 2022 lectures
L'été 2016 a été marqué par des signes d’instabilité croissante et imprévisible à l'échelle mondiale, ce qui confirme que la classe capitaliste rencontre des difficultés croissantes pour se présenter comme le garant de l'ordre et du contrôle politique. Le coup d'État manqué en Turquie et la vague de répression qui s’est ensuivie, une place stratégique vital dans l'arène impérialiste mondiale ; le contrecoup du chaos au Moyen-Orient sous la forme d'attentats terroristes en Allemagne et en France ; les secousses politiques intenses provoquées par le résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne et les perspectives épouvantables qui se dessinent avec la candidature présidentielle de Trump aux États-Unis : tous ces phénomènes, pleins de dangers pour la classe dominante, ne sont pas moins menaçants pour la classe ouvrière et ils constituent un défi majeur pour les minorités révolutionnaires dans notre classe afin de développer une analyse cohérente capable de balayer le brouillard idéologique obscurcissant ces événements.
Il n’est pas possible, dans ce numéro de la Revue internationale, de couvrir tous les éléments de la situation mondiale. En ce qui concerne le coup d'État en Turquie, en particulier, nous voulons prendre le temps de discuter de ses implications et de travailler sur un cadre d’analyse clair. Pour le moment, nous avons l'intention de nous concentrer sur une série de questions qui nous semblent être encore plus urgentes à clarifier : les implications du "Brexit" et de la candidature Trump ; la situation nationale en Allemagne, en particulier les problèmes créés par la crise européenne des réfugiés; et le phénomène social commun à tous ces développements : la montée du populisme.
Nous avons-nous-même pris du retard à reconnaître la signification du mouvement populiste. C'est pourquoi le texte sur le populisme présenté dans ce numéro est une contribution individuelle, écrite pour stimuler la réflexion et la discussion dans le CCI (et au-delà nous espérons). Il fait valoir que le populisme est le produit d'une impasse qui se trouve au cœur de la société ; même si l'État bourgeois produit des fractions et des partis qui tentent de chevaucher ce tigre, le résultat du référendum sur l'Union Européenne au Royaume-Uni et l'ascension de Trump dans le Parti républicain aux États-Unis démontrent que ce n'est pas une mince affaire et que cela peut même aggraver les difficultés politiques de la classe dirigeante 1.
Le but de cet article sur le Brexit et les élections présidentielles aux États-Unis est d'appliquer les idées du texte sur le populisme à une situation concrète. Il veut aussi corriger une idée présente dans plusieurs articles publiés sur notre site que le référendum sur le Brexit constituerait quelque chose comme un succès pour la démocratie français 2 ou que la montée du populisme aujourd'hui "renforce la démocratie" 3.
Nous publions également un article historique sur la question nationale, en se concentrant sur le cas de l'Irlande 4. Nous les avons choisis non seulement à cause du centenaire de l’insurrection de Dublin en 1916, mais parce que cet événement (et l'histoire ultérieure de l'Armée Républicaine Irlandaise) a été l'un des premiers signes clairs que la classe ouvrière ne pouvait plus faire alliance avec des mouvements nationalistes ou intégrer des revendications "nationales" dans son programme ; et parce qu'aujourd'hui, face à une nouvelle vague de nationalisme dans les centres du système capitaliste, la nécessité pour les révolutionnaires d'affirmer que la classe ouvrière n'a pas de patrie est plus urgente que jamais. Comme le pose le rapport sur la situation nationale allemande, surmonter les limites de la nation est le défi impressionnant posé au prolétariat face au capitalisme mondialisé et aux fausses alternatives du populisme : "Aujourd’hui, avec la mondialisation contemporaine, une tendance historique objective du capitalisme décadent atteint son plein développement : chaque grève, chaque acte de résistance économique des ouvriers quelque part dans le monde, se trouvent immédiatement confrontés à l’ensemble du capital mondial, toujours prêt à retirer la production et l'investissement et à produire ailleurs. Pour le moment, le prolétariat international a été tout à fait incapable de trouver une réponse adéquate, ou même d'entrevoir à quoi pourrait ressembler une telle réponse. Nous ne savons pas s’il réussira à le faire finalement. Mais il parait clair que le développement dans cette direction prendrait beaucoup plus de temps que la transition des syndicats à la grève de masse. D’un côté, la situation du prolétariat dans les vieux pays centraux du capitalisme – ceux, comme l’Allemagne, au "sommet" de la hiérarchie économique – devrait devenir beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd’hui. D’un autre côté, le pas requis par la réalité objective - lutte de classe internationale consciente, la "grève de masse internationale" - est beaucoup plus exigeant que le pas des syndicats à la grève de masse dans un pays. Car il oblige la classe ouvrière à remettre en question, non seulement le corporatisme et le localisme, mais aussi les principales divisions de la société de classes, souvent vieilles de plusieurs siècles voire même de plusieurs millénaires, comme la nationalité, la culture ethnique, la race, la religion, le sexe, etc. C'est un pas beaucoup plus profond et plus politique".
CCI, août 2016
1 Maîtriser l'analyse du populisme est un objectif que se donne le CCI, et non pas quelque chose que nous aurions déjà pleinement réalisé. À titre d'exemple, nous pouvons citer quelques-unes des formulations dans l'article de titre actuel sur notre site Web, "UE, Brexit, populisme: contre le nationalisme sous toutes ses formes". Bien que l'article dénonce correctement le poison idéologique propagé par les partis populistes et démagogues, certains passages donnent l'impression que le phénomène du populisme est identique à ses expressions politiques les plus évidentes, et est donc quelque chose de totalement contrôlé par l'État capitaliste dans ses attaques idéologiques contre la classe ouvrière.
4 Un second article n'a pu, faute de place, être publié dans cette revue. Il peut néanmoins être lu dans la Revue internationale sur notre site.
Des revers pour la bourgeoisie qui ne présagent rien de bon pour le prolétariat
- 2943 lectures
Il y a plus de trente ans, dans les "Thèses sur la décomposition" (THESES : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [200]) 1, nous avions dit que la bourgeoisie aurait de plus en plus de mal à contrôler les tendances centrifuges de son appareil politique. Le référendum sur le "Brexit" en Grande-Bretagne et la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis en constituent une illustration. Dans les deux cas, des aventuriers politiques sans scrupules de la classe dominante se servent de la "révolte" populiste de ceux qui ont souffert le plus des bouleversements économiques des trente dernières années pour leur propre auto-glorification.
Le CCI n’a tenu compte que tardivement de la montée du populisme et de ses conséquences. C’est pourquoi nous publions maintenant un texte général sur le populisme 2 qui est toujours en cours de discussion au sein de l’organisation. L’article qui suit tente d’appliquer les principales idées de ce texte de discussion aux situations spécifiques de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans une situation mondiale en pleine évolution, il n’a aucune prétention à être exhaustif, mais nous espérons qu’il apportera matière à réflexion et à discussion ultérieure.
Le référendum qui devint incontrôlable
La perte de contrôle par la classe dominante n’a jamais été plus évidente que dans le spectacle de désordre chaotique que nous a offert le référendum sur l’Union européenne en Grande-Bretagne et ses suites. Jamais auparavant, la classe capitaliste britannique n’avait à ce point perdu le contrôle du processus démocratique, jamais auparavant ses intérêts vitaux n’ont été autant à la merci d’aventuriers comme Boris Johnson 3 ou Nigel Farage. 4
Le manque général de préparation aux conséquences d’un Brexit éventuel est une indication de la confusion au sein de la classe dominante britannique. Quelques heures seulement après l'annonce du résultat, les principaux porte-paroles du Leave devaient expliquer à leurs supporters que les 350 millions de livres sterling qu’ils avaient promis d’allouer au NHS 5 si le vote Brexit l’emportait –un chiffre placardé sur tous les autobus de leur campagne– n’étaient en fait qu’une sorte de "faute de frappe". Quelques jours plus tard, Farage a démissionné de son poste de dirigeant de UKIP, laissant tout le pétrin du Brexit entre les mains des autres Leavers ("Sortants") ; Guto Harri, ancien chef de la communication de Boris Johnson, déclarait qu’en fait, "le cœur (de Johnson) n’y était pas" (dans la campagne pour le Brexit), et il y a fort à croire que le soutien de Johnson au Brexit n’était qu’une manœuvre opportuniste et intéressée dans le but de booster sa tentative de s’emparer de la direction du Parti conservateur contre David Cameron ; Michael Gove 6, qui a géré la campagne de Johnson pendant le référendum et devait gérer ensuite sa campagne pour le poste de Premier Ministre (et par ailleurs avait plusieurs fois fait connaître son propre manque d’intérêt pour ce travail), a poignardé Johnson dans le dos, deux heures seulement avant l’échéance de dépôt des candidatures, en se présentant lui-même au prétexte que son ami de toujours, Johnson, n’avait pas les capacités pour remplir la fonction ; Andrea Leadsom 7 s’est lancée dans la course à la direction du Parti conservateur en tant que Leaver convaincue –alors qu’elle avait déclaré trois ans auparavant qu’une sortie de l’UE serait "un désastre" pour la Grande-Bretagne. Le mensonge, l’hypocrisie, la fourberie– rien de tout cela n’est nouveau dans l’appareil politique de la classe dominante, bien sûr. Mais ce qui frappe, au sein de la classe dominante la plus expérimentée du monde, est la perte de tout sens de l’État, de l’intérêt national historique qui prime sur l’ambition personnelle ou les petites rivalités de cliques. Pour trouver un épisode comparable dans la vie des classes dominantes anglaises, il faudrait remonter à la Guerre des Deux-Roses 8 (comme Shakespeare l’a dépeinte dans sa vie de Henry VI), le dernier souffle d’un ordre féodal décadent.
Le manque de préparation de la part du patronat financier et industriel aux conséquences d’une victoire du Leave est tout aussi frappant, surtout étant donné le nombre d'indications selon lesquelles le résultat serait "la chose la plus incertaine qu’on aurait jamais vu de sa vie" (si on peut se permettre de citer le Duc de Wellington après la bataille de Waterloo) 9. L’effondrement de 20 %, puis de 30 %, de la livre sterling par rapport au dollar montre que le résultat "Brexit" n’était pas attendu –et n'avait pas affecté le cours de la livre avant le référendum. On nous a servi le spectacle peu édifiant d’une ruée vers la sortie de la part de banques et d’entreprises cherchant à s’installer, ou carrément déménager, à Dublin ou Paris. La décision rapide de George Osborne 10 de réduire la taxe sur les entreprises à 15 % est clairement une mesure d’urgence pour retenir les entreprises en Grande-Bretagne, dont l’économie est l’une des plus dépendantes du monde des investissements étrangers.
L'Empire contre-attaque
Tout cela étant dit, la classe dominante britannique n’est pas KO. Le remplacement immédiat de Cameron au poste de Premier Ministre (ce qui n’était pas, à l’origine, prévu avant septembre) par Theresa May –une politicienne solide et compétente qui avait fait campagne discrètement pour le Remain ("Rester")– et la démolition par la presse et par les députés conservateurs de ses rivaux, Gove et Leadsom, démontre une capacité réelle de réagir rapidement et de manière cohérente de la part de fractions étatiques dominantes de la bourgeoisie.
Fondamentalement, cette situation est déterminée par l’évolution du capitalisme mondial et par le rapport de forces entre les classes. Elle est le produit d'une dynamique plus générale vers la déstabilisation des politiques bourgeoises cohérentes dans la phase actuelle du capitalisme décadent. Les forces motrices derrière cette tendance vers le populisme ne font pas l'objet de cet article : elles sont analysées dans la "Contribution sur la question du populisme" mentionnée plus haut. Mais ces phénomènes généraux prennent une forme concrète sous l’influence d’une histoire et de caractéristiques nationales spécifiques. De fait, le Parti conservateur a toujours eu une aile "eurosceptique" qui n’a jamais vraiment accepté l’appartenance de la Grande-Bretagne à l’UE et dont les origines peuvent se définir comme suit :
La position géographique de la Grande-Bretagne (et de l’Angleterre avant elle) au large des côtes européennes a toujours fait que la Grande-Bretagne a pu se tenir à distance des rivalités européennes d’une façon qui n’était pas possible pour les États continentaux ; sa taille relativement petite, son inexistence en tant que puissance militaire terrestre, ont fait qu’elle n’a jamais pu espérer dominer l’Europe, comme l’a fait la France jusqu’au XIXe siècle ou l’Allemagne depuis 1870, mais ne pouvait défendre ses intérêts vitaux qu’en jouant les principales puissances les unes contre les autres et en évitant tout engagement auprès d'aucune d’entre elles.
La situation géographique de l'île et son statut de première nation industrielle du monde ont déterminé la montée de la Grande-Bretagne comme impérialisme mondial maritime. Depuis le XVIIe siècle au moins, les classes dominantes britanniques ont développé une vision mondiale qui, encore une fois, leur permet de garder une certaine distance par rapport à la politique purement européenne.
Cette situation changea radicalement suite à la Seconde Guerre mondiale, d’abord parce que la Grande-Bretagne ne pouvait plus maintenir son statut de puissance mondiale dominante, ensuite parce que la technologie militaire (forces aériennes, missiles à longue portée, armes nucléaires) faisait que l’isolement vis-à-vis de la politique européenne n’était plus possible. L’un des premiers à reconnaître ce changement de situation fut Winston Churchill qui, en 1946, appela à la formation des "États-Unis d’Europe", mais sa position n’a jamais été réellement acceptée au sein du Parti conservateur. L’opposition à l’appartenance à l’UE 11 est allée en grandissant au fur et à mesure que l’Allemagne s’est renforcée, surtout depuis que l’effondrement de l’URSS et la réunification allemande en 1990 ont augmenté de façon considérable le poids de l’Allemagne en Europe. Pendant la campagne du référendum, Boris Johnson a fait scandale en comparant la domination allemande au projet hitlérien, mais cela n’avait rien d’original. Les mêmes sentiments, pratiquement avec les mêmes mots, furent exprimés en 1990 par Nicholas Ridley, alors ministre du gouvernement Thatcher. C’est un signe de la perte d’autorité et de discipline dans l’appareil politique d’après-guerre : alors que Ridley fut contraint de quitter immédiatement le gouvernement, Johnson, lui, est devenu membre du nouveau cabinet.
L’ancien statut de première puissance mondiale de la Grande-Bretagne –et la perte de celui-ci– a un impact psychologique et culturel profondément ancré dans la population britannique (y compris dans la classe ouvrière). L’obsession nationale vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale –la dernière fois que la Grande-Bretagne a pu donner l’impression d’agir comme puissance mondiale indépendante– l’illustre à la perfection. Une partie de la bourgeoisie britannique et, encore plus, de la petite-bourgeoisie, n’a toujours pas compris que le pays n’est aujourd’hui qu’une puissance de deuxième, voire de troisième ordre. Beaucoup de ceux qui ont fait campagne pour le Leave semblaient croire que, si la Grande-Bretagne était libérée des "chaînes" de l’UE, le monde entier accourrait acheter des marchandises et des services britanniques –un fantasme qui risque de coûter fort cher à l’économie du pays.
Ce ressentiment et cette colère contre le monde extérieur du fait de la perte de ce statut de puissance impériale sont comparables au sentiment d’une partie de la population américaine face à ce qu’elle perçoit aussi comme la perte de statut des États-Unis (un thème constant des appels de Donald Trump à "faire en sorte que l’Amérique soit de nouveau grande") et leur incapacité à imposer leur domination comme ils ont pu le faire pendant la Guerre froide.
Le référendum : une concession au populisme
Boris Johnson et ses bouffonneries populistes ont été plus spectaculaires, et plus médiatisées, que le personnage de David Cameron, "vieille école", issu de la haute société et "responsable". Mais, en réalité, Cameron est une meilleure indication du degré auquel la désagrégation affecte la classe dominante. Johnson a pu être le principal acteur, mais c’est Cameron qui a fait la mise en scène en utilisant la promesse d’un référendum au profit de son parti, pour gagner les dernières élections parlementaires de 2015. De par sa nature, un référendum est plus difficile à contrôler qu’une élection parlementaire : de ce fait il constitue toujours un pari. 12 Comme un joueur pathologique de casino, Cameron s’est montré parieur récidiviste, d’abord avec le référendum sur l’indépendance écossaise (qu’il a gagné de justesse en 2014), ensuite avec celui sur le Brexit. Son parti, le Parti conservateur, qui s’est toujours présenté comme le meilleur défenseur de l’économie, de l’Union 13 et de la défense nationale, a fini par mettre les trois éléments en péril.
Étant donné la difficulté à manipuler les résultats, les plébiscites sur des questions qui concernent des intérêts nationaux importants représentent en général un risque inacceptable pour la classe dominante. Selon la conception et l’idéologie classiques de la démocratie parlementaire, même sous sa forme décadente de faux-semblant, de telles décisions sont censées être prises par des "représentants élus", conseillés (et mis sous pression) par des experts et des groupes d’intérêts –et non pas par la population dans son ensemble. Du point de vue de la bourgeoisie, c’est une pure aberration de demander à des millions de personnes de décider de questions complexes, telles le Traité constitutionnel de l’UE de 2004, alors que la masse des électeurs ne voulait, voire ne pouvait, ni lire ni comprendre le texte du traité. Pas étonnant alors que la classe dominante ait si souvent obtenu le "mauvais" résultat dans les référendums à propos de tels traités (en France et aux Pays-Bas en 2005, en Irlande au premier referendum sur le Traité de Lisbonne en 2008). 14
Au sein de la bourgeoisie britannique, il y a ceux qui semblent espérer que le gouvernement May réussira le même coup que les gouvernements français et irlandais après leur référendum raté à propos des traités constitutionnels, et qu’il pourra tout simplement ignorer ou contourner le résultat du référendum. Cela nous semble improbable, du moins à court terme, non pas que la bourgeoisie britannique soit plus ardente "démocrate" que ses comparses mais, justement, parce qu’elle a compris que le fait d’ignorer l’expression "démocratique" de la "volonté du peuple" ne fait qu’accréditer les thèses populistes et les rend plus dangereuses.
La stratégie de Theresa May jusqu'ici a donc été de faire contre mauvaise fortune bon cœur en empruntant le chemin du Brexit et en attribuant à trois des Leavers les plus connus la responsabilité de ministères en charge de la tâche complexe du désengagement de la Grande-Bretagne de l'UE. Même la nomination du clown Johnson comme Ministre des Affaires étrangères –accueillie à l’étranger avec un mélange d’horreur, d’hilarité et d’incrédulité– fait sans doute partie de cette stratégie plus vaste. En mettant Johnson sur la sellette des négociations pour quitter l’UE, May s’assure que la "grande gueule" des Leavers soit discréditée par les conditions probablement très défavorables, et qu’il ne puisse jouer le franc-tireur depuis la ligne de touche.
La perception, en particulier de la part de ceux qui votent pour les mouvements populistes en Europe ou aux États-Unis, selon laquelle tout le processus démocratique est une "arnaque" parce que l’élite ne tient pas compte des résultats inopportuns, constitue une vraie menace pour l’efficacité de la démocratie elle-même comme système de domination de classe. Dans la conception populiste de la politique, "la prise de décision directement par le peuple lui-même" est censée contourner la corruption des représentants élus par les élites politiques établies. C’est pourquoi en Allemagne de tels référendums sont exclus par la constitution d’après-guerre, suite à l’expérience négative de la République de Weimar et à leur utilisation dans l’Allemagne nazie. 15
L’élection sortie de piste
Si le Brexit a été un référendum hors de contrôle, la sélection de Trump comme candidat aux présidentielles américaines de 2016 est une élection "sortie de piste". Au départ, personne n’avait pris sa candidature au sérieux : le favori était Jeb Bush, membre de la dynastie Bush, choix préféré des notables républicains et, en tant que tel, capable d’attirer des soutiens financiers importants (ce qui est toujours une considération cruciale dans les élections américaines). Mais, contre toute attente, Trump a triomphé dans les premières primaires et a gagné État après État. Bush s’est éteint comme un pétard mouillé, les autres candidats n’ont jamais été plus que des outsiders et les chefs du Parti républicain se sont trouvés confrontés à la réalité désagréable que le seul candidat ayant une chance de battre Trump était Ted Cruz, un homme considéré par ses collègues au Sénat comme aucunement digne de confiance, uniquement un peu moins égoïste et intéressé que Trump lui-même.
La possibilité que Trump batte Clinton est en soi un signe du degré auquel la situation politique est devenue insensée. Mais déjà sa candidature a répandu une onde de choc à travers tout le système d’alliances impérialistes. Depuis 70 ans, les États-Unis ont été les garants de l’alliance de l’OTAN dont l’efficacité dépend de l’inviolabilité du principe de défense réciproque : une attaque contre l’un est une attaque contre tous. Quand un président américain en puissance met en question l’Alliance nord-atlantique ainsi que la volonté des États-Unis d’honorer ses obligations d’allié –comme Trump l’a fait en déclarant qu’une réponse américaine à une attaque russe contre les États baltes dépendrait, à son avis, du fait que ces derniers aient "payé leur ticket d’entrée"– cela donne froid dans le dos à toutes les bourgeoisies est-européennes directement confrontées à l’État mafieux de Poutine, sans parler des pays asiatiques (le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines) qui font confiance aux États-Unis pour les défendre contre le dragon chinois. Presque aussi alarmant est la forte possibilité que Trump ne sache tout simplement pas ce qui se passe, comme l’a suggéré son affirmation selon laquelle il n’y aurait pas de troupes russes en Ukraine (apparemment il ne sait pas que la Crimée est toujours officiellement considérée par tout le monde, sauf par les Russes, comme faisant partie de l’Ukraine).
Mieux encore, Trump a salué le fait que les services russes aient piraté les systèmes informatiques du Parti démocrate et a plus ou moins invité Poutine à faire pire. Il est difficile de dire si cela nuira à Trump, mais cela vaut la peine de rappeler que, depuis 1945, le Parti républicain est farouchement antirusse, est favorable à des forces armées puissantes et à une présence militaire massive à travers le monde, peu importe le coût (c’est l’augmentation colossale des dépenses militaires sous Reagan qui avait vraiment fait exploser le déficit budgétaire).
Ce n’est pas la première fois que le Parti républicain présente un candidat que sa direction considère comme dangereusement extrémiste. En 1964, Barry Goldwater gagna les primaires grâce au soutien de la droite religieuse et de la "coalition conservatrice" -précurseur du Tea Party actuel. À tout le moins son programme était cohérent : réduction drastique du champ d’action du gouvernement fédéral, en particulier de la sécurité sociale, puissance militaire et préparation si nécessaire à l’utilisation d’armes nucléaires contre l’URSS. C’était un programme classique très à droite mais qui ne correspondait pas du tout aux besoins du capitalisme d’État américain, et Goldwater finit par subir une défaite cuisante aux élections, en partie du fait que la hiérarchie du Parti républicain ne l’avait pas soutenu.Trump n’est-il qu’un Goldwater bis ? Pas du tout, et les différences sont instructives. La candidature de Goldwater représentait une prise en main du Parti républicain par le "Tea Party" de l‘époque ; celui-ci fut marginalisé pendant des années à la suite de la défaite électorale écrasante de Goldwater. Ce n’est un secret pour personne qu’au cours des deux dernières décennies, cette tendance a fait son retour et a fait une tentative plus ou moins réussie de prendre le contrôle du GOP 16. Cependant, ceux qui soutenaient Goldwater étaient, dans le sens le plus vrai du terme, "une coalition conservatrice" ; ils représentaient une véritable tendance conservatrice aux États-Unis, dans une Amérique en train de connaître de profonds changements sociaux (le féminisme, le Mouvement pour les Droits civiques, le début d’une opposition à la guerre au Vietnam et l’effondrement des valeurs traditionnelles). Bien que beaucoup de "causes" du Tea Party soient les mêmes que celles de Goldwater, le contexte ne l’est pas : les changements sociaux auxquels Goldwater s’opposait ont eu lieu, et le Tea Party n’est pas tant une coalition de conservateurs qu’une alliance réactionnaire hystérique.
Ceci créé des difficultés croissantes pour la grande-bourgeoisie qui n’a cure de ces questions sociales et "culturelles" et, fondamentalement, a des intérêts dans la force militaire américaine et le libre commerce dont elle tire ses profits. C’est devenu un truisme de dire que quiconque se présente aux primaires républicaines doit s’avérer "irréprochable" sur toute une série de questions : l’avortement (il faut être "pour la vie"), le contrôle des armes (il faut être contre), le conservatisme fiscal et des impôts plus bas, contre l’Obamacare (c’est du socialisme, il doit être aboli : en fait, Ted Cruz avait justifié en partie sa candidature par le battage fait autour de son obstruction à l’Obamacare au Sénat), le mariage (une institution sacrée), contre le Parti démocrate (si Satan avait un parti, ce serait lui). Aujourd’hui, en l’espace de quelques mois, Trump a éviscéré le Parti républicain. C’est un candidat sur qui "on ne peut pas compter" concernant l’avortement, le contrôle des armes, le mariage (lui-même marié trois fois) et qui, dans le passé, a donné de l’argent au diable lui-même, Hillary Clinton. De plus, il propose d’augmenter le salaire minimum, veut maintenir au moins en partie l’Obamacare, veut revenir à une politique étrangère isolationniste, laisser le déficit budgétaire s’envoler et expulser 11 millions d’immigrants illégaux dont le travail bon marché est vital pour les affaires.
Comme les conservateurs en Grande-Bretagne avec le Brexit, le Parti républicain –et potentiellement toute la classe dominante américaine– s’est retrouvé avec un programme complètement irrationnel du point de vue des intérêts de classe impérialistes et économiques.
Les implications
La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c’est que le Brexit et la candidature de Trump ouvrent une période d’instabilité croissante à tous les niveaux : économique, politique et impérialiste. Sur le plan économique, les pays européens –qui représentent, ne l’oublions pas, une partie importante de l’économie mondiale et le plus grand marché unique– connaissent déjà une fragilité : ils ont résisté à la crise financière de 2007-08 et à la menace d’une sortie de la Grèce de la zone Euro, mais ils n’ont pas surmonté ces situations. La Grande-Bretagne reste l’une des principales économies européennes et le long processus pour se défaire de ses liens avec l’Union européenne contiendra beaucoup d’imprédictibilité, ne serait-ce que sur le plan financier : personne ne sait, par exemple, quel effet aura la Brexit sur la City de Londres, centre européen majeur pour les banques, les assurances et les actions boursières. Politiquement, le succès du Brexit ne peut qu’encourager et apporter plus de crédit aux partis populistes du continent européen : l’an prochain ont lieu les élections présidentielles en France où le Front national de Marine Le Pen, parti populiste et anti-européen, est maintenant le plus grand parti politique en termes de voix. Les gouvernements des principales puissances d’Europe sont partagés entre le désir que la séparation de la Grande-Bretagne se fasse en douceur et aussi facilement que possible, et la peur que toute concession à celle-ci (comme par exemple l’accès au marché unique en même temps que des restrictions sur le mouvement des populations) donne des idées à d’autres, notamment à la Pologne et à la Hongrie. Il est pratiquement certain que la tentative de stabiliser la frontière sud-est de l’Europe en intégrant des pays de l’ex-Yougoslavie va être stoppée. Ce sera plus difficile pour l’Union européenne de trouver une réponse unifiée au "coup d’État démocratique" d’Erdogan en Turquie et à son utilisation des réfugiés syriens comme pions dans un vil jeu de chantage.
Bien que l’Union européenne n’ait jamais été elle-même une alliance impérialiste, la plupart de ses membres sont également membres de l’OTAN. Tout affaiblissement de la cohésion européenne rend donc probable un effet destructeur sur la capacité de l’OTAN à contrer la pression russe sur son flanc oriental, déstabilisant encore plus l’Ukraine et les États baltes. Ce n’est un secret pour personne que la Russie finance depuis un certain temps le Front national en France et qu’elle utilise, sinon finance, le mouvement PEGIDA en Allemagne. Le seul qui sorte gagnant du Brexit est en fait Vladimir Poutine.
Comme on l’a dit plus haut, la candidature de Trump a déjà affaibli la crédibilité des États-Unis. L’idée de Trump comme président ayant le doigt posé sur le bouton nucléaire est, il faut le dire, une perspective effrayante 17. Mais comme nous l’avons dit de nombreuses fois, l’un des principaux éléments de la guerre et de l'instabilité aujourd’hui est la détermination des États-Unis à maintenir leur position impérialiste dominante contre tout nouveau venu, et cette situation restera inchangée quel que soit le président.
“Rage against the machine”18
Boris Johnson et Donald Trump ont plus en commun qu’une "grande gueule". Ce sont tous deux des aventuriers politiques, dénués de tout principe et de tout sens de l’intérêt national. Tous deux sont prêts à toutes les contorsions pour adapter leur message à ce que leur audience veut entendre. Leurs bouffonneries sont enflées par les médias jusqu’à ce qu’elles semblent plus vraies que nature mais, en réalité, ce sont des non-entités, rien que les porte-paroles au moyen desquels les perdants de la mondialisation hurlent leur rage, leur désespoir et leur haine des riches élites et des immigrants qu’ils tiennent pour les responsables de leur misère. C’est ainsi que Trump s’en tire avec les arguments les plus outrageux et contradictoires : ses supporters s’en fichent tout simplement, il dit ce qu’ils veulent entendre.
Cela ne veut pas dire que Johnson et Trump sont pareils, mais ce qui les distingue a moins à voir avec leur caractère personnel qu’avec les différences entre les classes dominantes auxquelles ils appartiennent : la bourgeoisie britannique a joué un rôle majeur sur la scène mondiale depuis des siècles tandis que la phase de "flibustier" égocentrique et effrontée de l’Amérique n’a véritablement pris fin qu’avec la défaite que Roosevelt a imposée aux isolationnistes et l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Des fractions importantes de la classe dominante américaine restent profondément ignorantes du monde extérieur, sont dans un état, on est presque tenté de dire, d'adolescence attardée.
Les résultats électoraux ne seront jamais une expression de la conscience de classe, néanmoins ils peuvent nous donner des indications quant à l’état du prolétariat. Que ce soit le référendum sur le Brexit, le soutien à Trump aux États-Unis, au Front national de Marine Le Pen en France, ou aux populistes allemands de PEGIDA et d'Alternative für Deutschland, tous les chiffres concordent pour suggérer que là où ces partis et mouvements gagnent le soutien des ouvriers, c’est parmi ceux qui ont souffert le plus des changements opérés dans l’économie capitaliste au cours des quarante dernières années, et qui ont fini par conclure –de façon pas tout à fait déraisonnable après des années de défaites et d’attaques sans fin contre leurs conditions d’existence par des gouvernements de gauche comme de droite– que le seul moyen de faire peur à l’élite dirigeante est de voter pour des partis qui sont de toute évidence irresponsables, et dont la politique est un anathème pour cette même élite. La tragédie, c’est que ce sont précisément ces ouvriers qui ont été parmi les plus massivement engagés dans les luttes des années 1970.
Un thème commun aux campagnes du Brexit et de Trump est que "nous" pouvons "reprendre le contrôle". Peu importe que ce "nous" n’ait jamais eu de contrôle réel sur sa vie ; comme un habitant de Boston en Grande-Bretagne le disait : "nous voulons simplement que les choses redeviennent ce qu’elles étaient". Quand il y avait des emplois, et des emplois avec des salaires décents, quand la solidarité sociale dans les quartiers ouvriers n’avait pas été brisée par le chômage et l’abandon, quand le changement apparaissait comme quelque chose de positif et avait lieu à une vitesse raisonnable.
Sans aucun doute, il est vrai que le vote Brexit a provoqué une atmosphère nouvelle et déplaisante en Grande-Bretagne, dans laquelle les gens ouvertement racistes se sentent plus libres de sortir du bois. Mais beaucoup –probablement la grande majorité– de ceux qui ont voté Brexit ou Trump pour arrêter l’immigration ne sont pas franchement racistes, ils souffrent plutôt de xénophobie : peur de l'étranger, peur de l’inconnu. Et cet inconnu, c’est fondamentalement l’économie capitaliste elle-même, qui est mystérieuse et incompréhensible parce qu’elle présente les rapports sociaux dans le processus de production comme s’ils étaient des forces naturelles, aussi élémentaires et incontrôlables que le temps qu’il fait mais dont les effets sur la vie des ouvriers sont encore plus dévastateurs. C’est une ironie terrible, dans cette époque de découvertes scientifiques où plus personne ne pense que le mauvais temps est causé par des sorcières, que des gens soient prêts à croire que leurs malheurs économiques proviennent de leurs compagnons d'infortune que sont les immigrants.
Le danger qui est devant nous
Au début de cet article, nous nous sommes référés à nos "Thèses sur la décomposition", rédigées il y a pratiquement trente ans, en 1990. Nous conclurons en les citant :
"(…) il importe d'être particulièrement lucide sur le danger que représente la décomposition pour la capacité du prolétariat à se hisser à la hauteur de sa tâche historique (…)
Les différents éléments qui constituent la force du prolétariat se heurtent directement aux diverses facettes de cette décomposition idéologique :
l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le "chacun pour soi", la "débrouille individuelle";
le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société;
la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le "no future";
la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque."
Nous sommes concrètement face à ce danger aujourd’hui.
La montée du populisme est dangereuse pour la classe dominante parce qu’elle menace sa capacité à contrôler son appareil politique et à maintenir la mystification démocratique, qui est l’un des piliers de sa domination sociale. Mais elle n’offre rien au prolétariat. Au contraire, c’est précisément la faiblesse du prolétariat, son incapacité à offrir une autre perspective au chaos menaçant le capitalisme, qui a rendu possible la montée du populisme. Seul le prolétariat peut offrir une voie de sortie à l’impasse dans laquelle la société se trouve aujourd’hui et il ne sera pas capable de le faire si les ouvriers se laissent prendre par les chants de sirènes de démagogues populistes qui promettent un impossible retour à un passé qui, de toutes façons, n’a jamais existé.
Jens, août 2016.
1 Republiées en 2001 dans la Revue internationale n° 107
2Voir ce numéro de la Revue internationale.
3Boris Johnson, membre du Parti conservateur et ancien maire de Londres. Un des principaux porte-paroles du "Leave" (c’est-à-dire "quitter", dénomination de la campagne pour sortir de l’UE).
4Nigel Farage, dirigeant du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (United Kingdom Independence Party – UKIP). UKIP est un parti populiste fondé en 1991 et qui fait campagne principalement sur les thèmes de la sortie de l’UE et l’immigration. Paradoxalement, il a 22 membres au Parlement européen ce qui en fait le principal parti britannique représenté au Parlement.
5NHS : National Health Service – la sécurité sociale britannique.
6Membre du Parti conservateur et Ministre de la Justice dans le gouvernement Cameron.
7Membre du Parti conservateur et Ministre de l’Énergie dans le gouvernement Cameron. Aujourd’hui Secrétaire d’État à l’Environnement.
8Guerre civile entre clans aristocratiques de York et Lancastre pendant le XVe siècle en Angleterre.
9Il est vrai que le Trésor britannique et les instances de l’UE ont fait quelques efforts pour préparer un "Plan B” en cas de victoire du Brexit. Néanmoins, il est clair que ces préparatifs furent inadéquats et, surtout, que personne ne s’attendait à ce que le Leave gagne au référendum. Ceci était même vrai pour le camp du Leave lui-même. Il semblerait que Farage ait concédé la victoire au Remain à une heure la nuit du référendum, pour découvrir à son grand étonnement le matin suivant que le Remain avait perdu.
10Membre du Parti conservateur et Ministre des Finances dans le gouvernement Cameron.
11La Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne (CEE) sous un gouvernement conservateur en 1973. L’adhésion fut confirmée par un référendum appelé en 1975 par un gouvernement travailliste.
12Cela vaut la peine de rappeler que Margaret Thatcher est restée plus de dix ans au pouvoir sans avoir jamais gagné plus de 40 % des voix lors des élections parlementaires.
13C’est à dire l’Union, au sein du Royaume-Uni, de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.
14 À la suite de résultats contraires à leur volonté, les gouvernements européens ont laissé tomber le Traité constitutionnel, tout en en gardant l’essentiel, en modifiant tout simplement les accords existants via le Traité de Lisbonne de 2007.
15Il faut ici faire une distinction concernant les référendums : dans des États comme la Suisse ou la Californie, ils font partie d’un processus historiquement établi.
16Grand Old Party (le "Grand Vieux Parti"), nom familier pour désigner le Parti républicain, remontant au XIXe siècle.
17 L’une des raisons de la défaite de Goldwater est qu’il avait déclaré être prêt à utiliser l’arme nucléaire. La campagne de Johnson en réponse au slogan de Goldwater : "In your heart, you know he’s right" ("Dans ton cœur, tu sais qu’il a raison") avait pour slogan : "In your guts, you know he’s nuts" ("Par instinct, tu sais qu’il est fou").
18 Groupe de rap américain connu pour ses prises de position anarchisantes et anti-capitaliste. Le titre est ironique.
Géographique:
- Grande-Bretagne [154]
Personnages:
- Donald Trump [577]
- Theresa May [578]
- Boris Johnson [579]
- Hillary Clinton [580]
- Michael Gove [581]
Récent et en cours:
- Brexit [582]
- Candidature Trump [583]
Questions théoriques:
- Populisme [584]
Rubrique:
Contribution sur le problème du populisme, juin 2016
- 1922 lectures
L'article qui suit est un document en cours de discussion dans le CCI, écrit en Juin de cette année, quelques semaines avant le référendum "Brexit" au Royaume-Uni. L'article Des revers pour la bourgeoisie qui ne présagent rien de bon pour le prolétariat [585] de ce numéro de la Revue est une tentative d'appliquer les idées présentées dans cet article aux situations concrètes posées par le résultat du référendum et par la candidature de Trump aux États-Unis.
Nous sommes actuellement les témoins d'une vague de populisme politique dans les vieux pays centraux du capitalisme. Dans des États où ce phénomène s’est développé depuis plus longtemps, comme en France ou en Suisse, les populistes de droite sont devenus le plus important parti politique au niveau électoral. Mais ce qui est plus frappant aujourd’hui est l'ancrage du populisme dans des pays qui, jusqu'à présent, étaient connus pour leur stabilité politique et l'efficacité de la classe dominante : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Dans ces pays, ce n'est que très récemment que le populisme a réussi à avoir un impact direct et sérieux.
Le surgissement actuel du populisme
Aux États Unis, l'appareil politique a initialement fortement sous-estimé la candidature de Donald Trump aux élections présidentielles pour le Parti républicain. Sa candidature a, au départ, rencontré une opposition plus ou moins ouverte de la part de la hiérarchie de l'appareil du parti et de la droite religieuse. Tous ont été pris de court par le soutien populaire qu'il a reçu à la fois dans la Bible Belt (zones des États-Unis et du Canada dans lesquelles le fondamentalisme protestant est largement répandu) et dans les vieux centres industriels urbains, en particulier de la part de parties de la classe ouvrière "blanche". La campagne médiatique qui s’est ensuivie, menée entre autres par le Wall Street Journal et les oligarchies médiatiques et financières de la côte Est, et qui avait pour dessein de réduire le succès de Trump, n'a fait qu'augmenter sa popularité. La ruine partielle de couches importantes des classes moyennes et aussi ouvrière, dont beaucoup ont perdu leurs économies et même leurs maisons lors des crashs financiers et immobiliers de 2007-2008, a provoqué l'indignation contre le vieil appareil politique qui était intervenu rapidement pour sauver le secteur bancaire, abandonnant à leur destin les petits épargnants qui avaient essayé de devenir propriétaires de leur logement.
Les promesses faites par Trump de soutenir les petits épargnants, de maintenir les services de santé, de taxer la bourse et les grandes entreprises financières et d’empêcher l’immigration que des parties de la population pauvre redoutent, voyant dans les immigrés des concurrents potentiels, ont trouvé un écho à la fois chez les fondamentalistes religieux chrétiens et, plus à gauche, chez des électeurs traditionnellement démocrates qui, il y a quelques années à peine, n'auraient jamais imaginé voter pour un tel homme politique.
Presque un demi-siècle de "réformisme" politique bourgeois, au cours duquel les candidats de gauche - au niveau national, municipal ou local, dans les partis ou dans les syndicats - ont été élus sur leurs prétentions de défendre les intérêts des travailleurs et ont à la place toujours défendu ceux du capital, a préparé le terrain pour que "l'homme de la rue", comme on dit en Amérique, envisage de soutenir un multimillionnaire comme Trump, avec le sentiment que lui, au moins, ne peut pas être "acheté" par la classe dominante.
En Grande Bretagne, la principale expression du populisme pour le moment ne semble s’incarner ni dans un candidat particulier, ni dans un parti politique (bien que le UKIP de Nigel Farage soit devenu un acteur majeur sur la scène politique), mais dans la popularité de la proposition de quitter l'Union Européenne et de le décider par referendum. Le fait que la plus grande partie du courant dominant du monde des finances (City of London) et de l'industrie britannique s’y oppose, a, dans ce cas aussi, tendu à accroître la popularité du "Brexit" dans des parties importantes de la population. L’un des moteurs de ce courant d'opposition, en plus du fait qu’il représente les intérêts particuliers de certaines parties de la classe dominante plus étroitement liées aux anciennes colonies (le Commonwealth) qu'à l'Europe continentale, semble être qu’il marche sur les plates-bandes des nouveaux mouvements populistes de droite. Peut-être que des gens comme Boris Johnson et autres défenseurs du "Brexit" dans le Parti conservateur seront, dans le cas d’un "exit", ceux qui auront à sauver ce qui peut être sauvé en tentant de négocier une sorte de statut d'association étroite avec l'Union Européenne, probablement sur le type de celui de la Suisse (qui adopte en général la réglementation de l'UE sans avoir son mot à dire dans sa formulation).
En Allemagne où, après la Deuxième Guerre mondiale, la bourgeoisie a toujours réussi jusqu'à présent à empêcher l'établissement de partis parlementaires à la droite de la Démocratie Chrétienne, un nouveau mouvement populiste est apparu sur la scène, à la fois dans la rue (Pegida) et au niveau électoral (Alternative für Deutschland) non pas en réponse à la crise "financière" de 2007/08 (dont l'Allemagne est sortie relativement indemne) mais à la suite de la "crise de l'Euro" qu’une partie de la population a appréhendée comme une menace directe envers la stabilité de la monnaie européenne commune et donc pour l’épargne de millions de gens.
Mais à peine cette crise était-elle désamorcée, au moins pour le moment, qu’a eu lieu une arrivée massive de réfugiés, provoquée en particulier par la guerre civile et impérialiste en Syrie et par le conflit avec l'État Islamique au nord de l'Irak. Cette situation a redonné de l’élan à un mouvement populiste qui commençait à faiblir. Bien qu'une majorité importante de la population soutienne encore la Wilkommenskultur ("culture de l'accueil") de la chancelière Merkel et de beaucoup de leaders de l'économie allemande, les attaques contre les asiles pour réfugiés se sont multipliées dans beaucoup d'endroits en Allemagne, tandis que dans des parties de l'ancienne RDA, un véritable esprit de pogrom s'est développé.
Le point atteint par la montée du populisme, en lien avec le discrédit du système politique des partis établis est illustré par les dernières élections présidentielles en Autriche, dont le deuxième tour a mis en présence un candidat des Verts et un de la droite populiste, tandis que les principaux partis, les sociaux-démocrates et les démocrates-chrétiens, qui ont régné sur le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont subi tous deux une débâcle électorale sans précédent.
A la suite des élections en Autriche, les observateurs politiques en Allemagne ont conclu que poursuivre la coalition actuelle entre démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates à Berlin après les prochaines élections générales favoriserait probablement encore plus la montée du populisme. De toute façon, que ce soit à travers la Grande Coalition entre droite et gauche (ou la "cohabitation" comme en France), ou à travers l'alternance entre gouvernements de gauche et de droite, après presqu'un demi-siècle de crise économique chronique et environ 30 ans de décomposition du capitalisme, de grandes parties de la population ne croient plus qu'il y ait une différence significative entre les partis établis de gauche et de droite. Au contraire, ces partis sont vus comme une sorte de cartel qui défend ses propres intérêts, et ceux des très riches, aux dépens de ceux de l’ensemble de la population et de ceux de l'État. Comme la classe ouvrière, après 1968, n'a pas réussi à politiser ses luttes et à effectuer des avancées significatives dans le développement de sa propre perspective révolutionnaire, aujourd’hui cette désillusion attise surtout les flammes du populisme.
Dans les pays industrialisés occidentaux, en particulier après le 11 septembre aux États-Unis, le terrorisme islamiste est devenu un autre facteur d’accélération du populisme. À l’heure actuelle, cela pose un problème à la bourgeoisie, en particulier en France qui est une nouvelle fois devenue la cible de ce type d’attaques. L’un des motifs de l’État d’urgence et du langage guerrier tenu par François Hollande est la nécessité de contrer la montée continue du Front national après les récentes attaques terroristes ; le président français a cherché à se présenter comme le leader d’une coalition internationale présumée contre l’État islamique. La perte de confiance de la population dans la détermination et la capacité de la classe dominante à protéger ses citoyens sur le plan sécuritaire (et pas seulement économique) est l’une des causes de la vague actuelle de populisme.
Les racines du populisme de droite contemporain sont donc multiples et varient d’un pays à l’autre. Dans les anciens pays staliniens d’Europe de l’Est, il semble lié à l’arriération et à l’esprit de clocher de la vie politique et économique sous les régimes précédents, ainsi qu’à la brutalité traumatisante du passage à un style de vie capitaliste occidental plus efficace après 1989.
Dans un pays aussi important que la Pologne, la droite populiste est déjà au gouvernement, tandis qu’en Hongrie (un des centres de la première vague révolutionnaire du prolétariat en 1917-23), le régime de Viktor Orbán pousse plus ou moins à des attaques pogromistes et les protège.
Plus généralement, les réactions contre la "mondialisation" constituent un facteur majeur de la montée du populisme. En Europe occidentale, la mauvaise humeur "contre Bruxelles" et l’Union européenne constitue depuis longtemps l’aliment de base de ces mouvements. Mais aujourd’hui, la même atmosphère s’exprime aux États-Unis où Trump n’est pas le seul politicien qui menace d’abandonner les accords commerciaux de libre échange TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en cours de négociation entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Il ne faut pas confondre cette réaction à la "mondialisation" avec ce que proposent des représentants de gauche comme ATTAC qui demandent une sorte de correctif néo-keynésien aux excès (réels) du néo-libéralisme. Alors que ces derniers avancent une politique économique alternative cohérente et responsable pour le capital national, la critique des populistes représente plus une sorte de vandalisme politique et économique du type de ce qui s’était déjà en partie manifesté lors du rejet du Traité de Maastricht lors des référendums en France, aux Pays-Bas et en Irlande.
La possibilité de participation au gouvernement du populisme contemporain et le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat
Les partis populistes sont des fractions bourgeoises, des parties de l'appareil capitaliste d'État totalitaire. Ce qu'ils répandent, c'est l'idéologie et le comportement bourgeois et petit-bourgeois, le nationalisme, le racisme, la xénophobie, l'autoritarisme, le conservatisme culturel. Comme tels, ils représentent un renforcement de la domination de la classe dominante et de son État sur la société. Ils élargissent le champ du système des partis de la démocratie et augmentent sa puissance de feu idéologique. Ils revitalisent les mystifications électorales et l'attrait pour le vote, à la fois à travers les électeurs qu'ils mobilisent et ceux qui se mobilisent pour voter contre eux. Bien qu'ils soient en partie le produit de la désillusion croissante envers les partis traditionnels, ils peuvent aussi contribuer à renforcer l'image de ces derniers qui, à la différence des populistes, peuvent se présenter comme étant plus humanitaires et plus démocratiques. Dans la mesure où leur discours ressemble à celui des fascistes des années 30, leur surgissement tend à donner une nouvelle vie à l'antifascisme. C'est particulièrement le cas en Allemagne où l'arrivée au pouvoir du parti "fasciste" a conduit à la plus grande catastrophe dans l'histoire de la nation, avec la perte de presque la moitié de son territoire et de son statut comme puissance militaire majeure, la destruction de ses villes et les dommages quasiment irréparables pour son prestige international par la perpétration de crimes qui sont les pires de l'histoire de l'humanité.
Néanmoins, et comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, surtout dans les vieux pays du cœur du capitalisme, les fractions dirigeantes de la bourgeoisie ont fait de leur mieux pour limiter la montée du populisme et, en particulier, pour empêcher sa participation au gouvernement. Après des années de luttes défensives sur son terrain de classe pour la plupart sans succès, il semble que certains secteurs de la classe ouvrière aujourd'hui peuvent avoir le sentiment qu’ils peuvent exercer plus de pression et faire plus peur à la classe dominante en votant pour le populisme de droite qu'avec les luttes ouvrières. La base de cette impression est que "l'establishment" réagit réellement de façon alarmée au succès électoral des populistes. Pourquoi cette réticence face à "l'un des leurs" ?
Jusqu'à maintenant, nous avons eu tendance à supposer que c'est surtout le cas à cause du cours historique (c’est-à-dire le fait que la présente génération du prolétariat n’a pas subi de défaite). Aujourd'hui, il est nécessaire de réexaminer ce cadre de façon critique face au développement de la réalité sociale.
Il est vrai que la mise en place de gouvernements populistes en Pologne et en Hongrie est relativement insignifiante si on la compare à ce qui se passe dans les vieux pays occidentaux du cœur du capitalisme. Plus significatif, cependant, est que ce développement n'a pas mené pour le moment à un conflit majeur entre la Pologne et la Hongrie d’une part, et l'OTAN et l'UE de l’autre. Au contraire, l'Autriche, avec un chancelier social-démocrate, après avoir imité au début la Wilkommenskultur d'Angela Merkel au cours de l'été 2015, a bientôt suivi l'exemple de la Hongrie en érigeant des barrières à ses frontières. Et le premier ministre hongrois est devenu un partenaire de discussion favori de la CSU bavaroise qui fait partie du gouvernement Merkel. Nous pouvons parler d'un processus d'adaptation mutuelle entre des gouvernements populistes et de grandes institutions intra-étatiques. Malgré leur démagogie anti-européenne, il n'y a pas de signe, pour le moment, que ces gouvernements populistes veuillent faire sortir la Pologne ou la Hongrie de l'UE. Au contraire, ce qu’ils propagent actuellement, c'est la diffusion du populisme au sein de l'UE. Ce que cela signifie, en termes d'intérêts concrets, c'est que "Bruxelles" devrait moins interférer dans les affaires nationales, tout en continuant à transférer les mêmes subventions, ou même plus, à Varsovie et Budapest. Pour sa part, l'UE s'adapte à ces gouvernements populistes qui sont quelquefois loués pour leur "contribution constructive" au cours de sommets complexes tenus par l'UE. Et, tout en insistant sur le maintien d'un certain minimum de "conditions démocratiques", Bruxelles s'est abstenue pour le moment d'appliquer à ces pays quelque sanction que ce soit dont elle les avait menacés.
En ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, l'Autriche, on doit le rappeler, était déjà pionnière, ayant inclus une fois dans un gouvernement de coalition le parti de Jörg Haider comme partenaire minoritaire. Le but poursuivi – celui de discréditer le parti populiste en lui faisant assumer la responsabilité d’assurer le fonctionnement de l'État – avait été en partie atteint. Temporairement. Aujourd’hui au niveau électoral, le FPÖ est plus fort que jamais et a presque remporté les dernières élections présidentielles. Bien sûr en Autriche, le président joue un rôle principalement symbolique. Mais ce n’est pas le cas en France, la seconde puissance économique et la seconde concentration du prolétariat en Europe de l’Ouest continentale. La bourgeoisie mondiale attend avec anxiété la prochaine élection présidentielle dans ce pays où le FN est le parti dominant électoralement.
Beaucoup d’experts de la bourgeoisie ont déjà conclu de ce qui paraît être un échec du Parti républicain aux États-Unis à empêcher la candidature de Trump que, tôt ou tard, la participation des populistes aux gouvernements occidentaux deviendra inévitable et qu’il vaudrait mieux commencer à se préparer à une telle éventualité. Ce débat est une première réaction à la reconnaissance du fait que les tentatives faites jusqu’à maintenant pour exclure ou limiter le populisme ont non seulement atteint leurs limites mais ont même commencé à produire l’effet contraire.
La démocratie est l’idéologie qui convient le mieux aux sociétés capitalistes développées et l’arme la plus importante contre la conscience de classe du prolétariat. Mais aujourd’hui, la bourgeoisie est confrontée au paradoxe selon lequel, en continuant à garder à distance des partis qui ne respectent pas ses règles démocratiques du "politiquement correct", elle risque sérieusement de porter atteinte à sa propre image démocratique. Comment justifier de maintenir indéfiniment dans l’opposition des partis pour qui vote une partie significative de la population, même la majorité finalement, sans se discréditer et s’empêtrer dans des contradictions d’arguments inextricables ? De plus, la démocratie n’est pas qu’une idéologie mais aussi un moyen très efficace de la domination de classe –notamment parce qu’elle est capable de reconnaître les nouveaux élans qui viennent de la société dans son ensemble et de s’y adapter.
C’est dans ce cadre que la classe dominante aujourd’hui pose la perspective de la possibilité d’une participation populiste dans le gouvernement, en lien avec le rapport de force actuel entre la bourgeoisie et le prolétariat. Les tendances actuelles indiquent que la grande bourgeoisie elle-même ne pense pas qu’une telle option soit exclue du fait que la classe ouvrière n’est pas défaite.
Pour commencer, une telle éventualité ne signifierait pas l’abolition de la démocratie parlementaire bourgeoise comme ce fut le cas en Italie, en Allemagne ou en Espagne dans les années 1920-30 après la défaite du prolétariat. Même en Europe de l’Est aujourd’hui, les gouvernements populistes de droite existants n’ont pas tenté de mettre les autres partis hors la loi, ni d’établir un système de camps de concentration. De telles mesures ne seraient d’ailleurs pas acceptées par la génération actuelle de travailleurs, en particulier dans les pays de l’Ouest, et peut être en Pologne ou en Hongrie non plus.
De plus, cependant et par ailleurs, la classe ouvrière, bien que non défaite définitivement et historiquement, est affaiblie à l’heure actuelle au niveau de sa conscience de classe, de sa combativité et de son identité de classe. Le contexte historique de cette situation est avant tout la défaite de la première vague révolutionnaire à la fin de la Première Guerre mondiale, et la profondeur et la longueur de la contre-révolution qui l’a suivie.
Dans ce contexte, la première cause de cet affaiblissement est l’incapacité de la classe, pour le moment, de trouver une réponse adéquate, dans ses luttes défensives, à la phase actuelle de gestion capitaliste d’État, celui de la "mondialisation". Dans leurs luttes défensives, les ouvriers ressentent à juste titre qu’ils sont immédiatement confrontés à l’ensemble du capitalisme mondial parce qu’aujourd’hui, ce ne sont pas seulement le commerce et les affaires mais, aussi et pour la première fois, la production qui est mondialisée, et que la bourgeoisie peut répondre rapidement à toute résistance prolétarienne à l’échelle nationale ou locale en transférant la production ailleurs. Cet instrument apparemment tout-puissant pour discipliner le travail ne peut être effectivement combattu que par la lutte de classe internationale, un niveau de combat que la classe est encore incapable d’atteindre dans un futur prévisible.
La deuxième cause de cet affaiblissement est l’incapacité de la classe de continuer à politiser ses luttes après l’élan initial de 1968/69.Ce qui en a résulté, c’est l’absence de développement de toute perspective de vie meilleure ou de société meilleure : la phase actuelle de décomposition. Et l’effondrement des régimes staliniens en Europe de l’Est en particulier a paru confirmer l’impossibilité d’une alternative au capitalisme.
Pendant une courte période, peut être de 2003 à 2008, il y a eu de premiers signes, ténus, à peine visibles, d’un début de processus nécessairement long et difficile de récupération par le prolétariat des coups qu’il avait subis. En particulier, la question de la solidarité de classe, notamment entre générations, a commencé à être mise en avant. Le mouvement anti-CPE de 2006 a été le point culminant de cette phase, parce qu’il a réussi à faire reculer la bourgeoisie française, et parce que l’exemple de ce mouvement et de ses succès a inspiré des secteurs de la jeunesse dans d’autres pays européens, y compris en Allemagne et en Grande-Bretagne. Cependant ces premiers germes fragiles d’une reprise prolétarienne possible se sont aussitôt figés du fait d’une troisième série d’événements négatifs d’importance historique dans la période d’après 1968, et qui ont représenté un troisième revers majeur pour le prolétariat : la calamité économique de 2007/2008, suivie par la vague actuelle de réfugiés de guerre et d’autres migrants –la plus grande depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
La spécificité de la crise de 2007/08 est qu’elle a commencé comme une crise financière aux proportions énormes. Le résultat est que pour des millions d’ouvriers, l’un de ses pires effets, dans certains cas même le principal, n’a pas été la diminution de salaires, les hausses d’impôts, ni les licenciements massifs imposés par les employeurs ou par l’État, mais la perte de leurs maisons, de leurs économies, de leurs assurances, etc. Ces pertes, au niveau financier, se présentent comme celles de citoyens de la société bourgeoise, elles ne sont pas spécifiques à la classe ouvrière. Leurs causes restent peu claires, favorisant la personnalisation et la théorie du complot.
La spécificité de la crise des réfugiés est qu’elle a lieu dans le contexte de la "Forteresse Europe" (et de la Forteresse nord-américaine). À la différence des années 1930, depuis 1968 la crise mondiale du capitalisme a été accompagnée par une gestion capitaliste d’État internationale sous la direction de la bourgeoisie des vieux pays capitalistes. En conséquence, après presqu’un demi-siècle de crise chronique, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord apparaissent toujours comme des havres de paix, de prospérité et de stabilité, au moins en comparaison avec "le monde extérieur". Dans un tel contexte, ce n’est pas seulement la peur de la concurrence des immigrants qui alarme des parties de la population mais, aussi, la peur que le chaos et l’anarchie, perçus comme venant de l’extérieur, gagnent via les réfugiés le monde " civilisé ". Au niveau actuel d’extension de la conscience de classe, il est trop difficile pour la plupart des travailleurs de comprendre que tout à la fois la barbarie chaotique à la périphérie du capitalisme et son intrusion, de façon toujours plus proche, dans les pays centraux, sont eux-mêmes le produit du capitalisme mondial et des politiques des pays capitalistes dirigeants.
Ce contexte de crise "financière", de "crise de l’Euro", puis de crise des réfugiés a, pour le moment, étouffé dans l’œuf les premiers pas embryonnaires vers un renouveau de solidarité de classe. C’est pourquoi peut-être, au moins en partie, la lutte des Indignados, bien qu’elle ait duré plus longtemps et ait semblé, sous certains aspects, se développer plus en profondeur que le mouvement anti-CPE, n’a pas réussi à stopper les attaques en Espagne, et a pu être aussi facilement exploitée par la bourgeoisie pour créer un nouveau parti politique de gauche : Podemos.
Le principal résultat, au niveau politique, de cette nouvelle poussée de désolidarisation, depuis 2008 jusqu’à maintenant, a été le renforcement du populisme. Ce dernier n’est pas seulement un symptôme d’un affaiblissement supplémentaire de la conscience de classe et de la combativité prolétariennes, mais constitue lui-même un facteur actif de cet affaiblissement. Pas seulement parce que le populisme fait du chemin dans les rangs du prolétariat. En fait, les secteurs centraux de la classe résistent encore fortement à cette influence, comme l’illustre l’exemple allemand. Mais aussi parce que la bourgeoisie profite de cette hétérogénéité de la classe pour diviser encore plus le prolétariat et semer la confusion en son sein. Aujourd’hui, on semble se rapprocher d’une situation qui, à première vue, présente certaines similitudes avec les années 1930. Bien sûr, le prolétariat n’a pas été défait politiquement et physiquement dans un pays central, comme cela avait eu lieu en Allemagne à l’époque. En conséquence, l’anti-populisme ne peut pas jouer exactement le même rôle que celui de l’antifascisme dans les années 1930. Il semble aussi que ce soit une caractéristique de la période de décomposition que de telles fausses alternatives elles-mêmes apparaissent avec des contours moins fortement dessinés qu’auparavant. Néanmoins, dans un pays comme l’Allemagne, où il y a huit ans, les premiers pas dans la politisation d’une petite minorité de la jeunesse en recherche s’étaient faits sous l’influence du mot d’ordre "À bas le capitalisme, la nation et l’État", aujourd’hui cette politisation se fait à la lumière de la défense des réfugiés et de la Wilkommenskultur contre les néo-nazis et la droite populiste.
Dans l’ensemble de la période post-1968, le poids de l’antifascisme était au moins atténué par le fait que, concrètement, le danger fasciste résidait dans le passé ou était représenté par des extrémistes de droite plus ou moins marginalisés. Aujourd’hui, la montée du populisme de droite en tant que phénomène potentiellement de masse, donne à l’idéologie de la défense de la démocratie une cible nouvelle, beaucoup plus tangible et importante, contre laquelle elle peut mobiliser.
Nous conclurons cette partie en disant que la croissance actuelle du populisme et de son influence sur l’ensemble de la politique bourgeoise, est aussi rendue possible par la faiblesse actuelle du prolétariat.
Le débat actuel au sein de la bourgeoisie sur la montée du populisme
Bien que le débat au sein de la bourgeoisie sur la façon de traiter le populisme qui ressurgit, ne fasse que commencer, nous pouvons déjà mentionner certains des paramètres mis en avant. Si nous regardons le débat en Allemagne –le pays où la bourgeoisie est peut-être la plus sensibilisée et la plus vigilante sur de telles questions– nous pouvons identifier trois aspects.
Premièrement : que c’est une erreur pour les "démocrates" d’essayer de combattre le populisme en adoptant son langage et ses propositions. Selon cette argumentation, c’est cette "copie" des populistes qui explique en partie le fiasco du parti au gouvernement aux dernières élections en Autriche, et qui permet d’expliquer l’incapacité des partis traditionnels en France à stopper l’avancée du FN. Les électeurs populistes, disent les tenants de ce point de vue, préfèrent l’original à la copie. Au lieu de faire des concessions, disent-ils, il est nécessaire de mettre l’accent sur les antagonismes entre "le patriotisme constitutionnel" et le "nationalisme chauvin", entre l’ouverture cosmopolite et la xénophobie, entre la tolérance et l’autoritarisme, entre la modernité et le conservatisme, entre l’humanisme et la barbarie. Selon cette ligne d’argumentation, les démocraties occidentales aujourd’hui sont assez "mûres" pour s’arranger avec le populisme moderne en maintenant une majorité pour la "démocratie", si elles mettent en avant leurs positions de manière "offensive". C’est par exemple la position de l’actuelle chancelière allemande Angela Merkel.
Deuxièmement, on insiste sur le fait que l’électorat doit pouvoir de nouveau faire la différence entre la droite et la gauche, et qu’il faut corriger l’impression d’un cartel de partis établis. Nous supposons que cette idée est déjà le motif de la préparation, au cours des deux dernières années, par la coalition CDU-SPD, d’une future coalition possible entre la Démocratie chrétienne et les Verts après les nouvelles élections générales. L’abandon du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, annoncée non au Japon mais en Allemagne, et le récent soutien euphorique des Verts à la Wilkommenskultur vis-à-vis des réfugiés, associée non pas au SPD mais à Angela Merkel, ont été jusqu’à présent les principaux pas de cette stratégie. Cependant, l’ascension électorale rapide et inattendue de l’AfD menace aujourd’hui la réalisation d’une telle stratégie (la tentative récente de faire revenir le FDP libéral au parlement pourrait être une réponse à ce problème, puisque ce parti pourrait à l’occasion rejoindre une coalition "Noir-Vert"). Dans l’opposition, le SPD, le parti qui a dirigé en Allemagne "la révolution néolibérale" avec son agenda 2010 sous Shröder, pourrait alors adopter une posture plus à "gauche". A l’opposé des pays anglo-saxons, où c’est la droite conservatrice de Thatcher et Reagan qui a imposé les mesures "néolibérales", dans beaucoup de pays européens du continent, c’est la gauche (en tant que partis les plus politiques, responsables et disciplinés) qui a dû participer ou même assumer leur mise en œuvre.
Aujourd’hui, cependant, il est devenu évident que la nécessaire étape de mondialisation néolibérale s’est accompagnée d’excès qui devront être corrigés tôt ou tard. Ça a été le cas en particulier après 1989, quand l’effondrement des régimes staliniens a paru confirmer de manière écrasante toutes les thèses ordo-libérales sur l’inadaptation de la bureaucratie capitaliste d’État pour faire tourner l’économie. Certains représentants sérieux de la classe bourgeoise soulignent de plus en plus certains de ces excès. Par exemple, il n’est absolument pas indispensable pour la survie du capitalisme qu’une minuscule fraction de la société possède presque toute la richesse. Cela peut faire des dégâts non seulement socialement et politiquement mais, aussi, économiquement, puisque les très riches, au lieu de partager la part du lion de leurs richesses, sont avant tout concernés par la préservation de leurs valeurs, augmentant donc la spéculation et freinant le pouvoir d’achat solvable. Il n’est pas non plus absolument nécessaire pour le capitalisme que la concurrence entre États capitalistes prenne une forme si drastique qu’aujourd’hui de réduction des impôts et des budgets étatiques, au point que l’État ne puisse plus assurer les investissements nécessaires. En d’autres termes, l’idée est que, grâce à un retour possible à une sorte de correction néo-keynésienne, la gauche, soit sous sa forme traditionnelle ou via de nouveaux partis comme Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne, pourrait regagner une certaine base matérielle pour se présenter comme alternative à la droite ordo-libérale conservatrice.
Il est important de noter cependant que les réflexions d’aujourd’hui dans la classe dominante sur un rôle possible futur de la gauche ne sont pas en premier lieu inspirées par la peur (dans l’immédiat) de la classe ouvrière. Au contraire, beaucoup d’éléments de la situation actuelle dans les principaux centres capitalistes indiquent que le premier aspect qui détermine la politique de la classe dominante est à présent le problème du populisme.
Le troisième aspect est que, tout comme les Tories britanniques autour de Boris Johnson, la CSU, le parti "frère" de la CDU de Merkel, pense que des parties de l’appareil traditionnel du parti devraient elles-mêmes appliquer des éléments de la politique populiste. Nous devons noter que la CSU n’est plus l’expression de l’arriération bavaroise traditionnelle, petite-bourgeoise. Au contraire, à côté de la province contiguë du sud, le Bade-Würtemberg, aujourd’hui la Bavière est économiquement la partie la plus moderne de l’Allemagne, la colonne vertébrale de ses industries high-tech et d’exportation, la base productive de compagnies telles que Siemens, BMW ou Audi.
Cette troisième option dont Munich fait la propagande entre bien sûr en contradiction avec la première dont nous avons parlé, proposée par Angela Merkel, et le cœur actuel des confrontations entre les deux partis n’est pas qu’une manœuvre électorale ni le produit des différences (réelles) entre des intérêts économiques particuliers mais, aussi, des différences de démarche. Au vu de la détermination actuelle de la chancelière à ne pas changer d’esprit, certains représentants de la CSU ont même commencé à "penser tout haut" à présenter leurs propres candidats dans d’autres parties de l’Allemagne contre la CDU aux nouvelles élections générales.
L’idée de la CSU, comme celle de parties des conservateurs anglais, est que, s’il est devenu inévitable, d’une certaine manière, que soient prises des mesures populistes, c’est mieux qu’elles soient appliquées par un parti expérimenté et responsable. De cette façon, de telles mesures souvent irresponsables pourraient d’une part au moins être limitées et, d’autre part, être compensées par des mesures auxiliaires.
Malgré les frictions réelles entre Merkel et Seehofer, comme entre Cameron et Johnson, nous ne devons pas négliger l’élément de division du travail entre eux (une partie, défendant les valeurs démocratiques "de façon offensive", l’autre reconnaissant la validité de "l’expression démocratique de citoyens en colère").
De toute façon, dans son ensemble, ce que ce discours illustre, c’est que les fractions dirigeantes de la bourgeoisie commencent à se réconcilier avec l’idée de politiques gouvernementales populistes d’un certain type et dans une certaine mesure, comme les conservateurs Brexit ou la CSU les mettent déjà partiellement en pratique.
Populisme et décomposition
Comme nous l’avons vu, il y a eu et il subsiste une très grande réticence vis-à-vis du populisme de la part des principales fractions de la bourgeoisie en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Quelles en sont les causes ? Après tout, ces mouvements ne remettent en question, en aucune manière, le capitalisme. Rien de ce dont ils font la propagande n’est étranger au monde bourgeois. À la différence du stalinisme, le populisme ne remet même pas en question les formes actuelles de propriété capitaliste. C’est un mouvement "oppositionnel" bien sûr. Mais dans un certain sens, le stalinisme et la social-démocratie l’ont aussi été, sans que cela ne les empêche pour autant d’être des membres responsables de gouvernements des États capitalistes dirigeants.
Pour comprendre cette réticence, il est nécessaire de reconnaître la différence fondamentale entre le populisme actuel et la gauche du capital. La gauche, même quand elle ne vient pas d’anciennes organisations du mouvement ouvrier (les Verts, par exemple), bien qu’elle puisse être le meilleur représentant du nationalisme et celle qui peut le mieux mobiliser le prolétariat pour la guerre, fonde son pouvoir d’attraction sur la propagande des anciens idéaux du mouvement ouvrier ou sur leur contrefaçon ou, au moins, sur ceux de la révolution bourgeoise. En d’autres termes, aussi chauvine et même antisémite qu’elle puisse être, elle ne renie pas en principe la "fraternité de l’humanité" ni la possibilité d’améliorer l’état du monde dans son ensemble. En fait, même les radicaux néo-libéraux les plus ouvertement réactionnaires affirment poursuivre ce but. C’est nécessairement le cas. Dès l’origine, la prétention de la bourgeoisie à être la digne représentante de la société dans son ensemble a toujours été fondée sur cette perspective. Cela ne signifie en rien que la gauche du capital, en tant que partie de cette société pourrissante, ne diffuse pas également un poison raciste, antisémite tout à fait analogue à celui des populistes de droite !
En revanche, le populisme personnifie la renonciation à un tel "idéal". Ce qu’il propage, c’est la survie de certains aux dépens des autres. Toute son arrogance tourne autour de ce "réalisme" dont il est si fier. En tant que tel, c’est le produit du monde bourgeois et de sa vision du monde –mais avant tout de sa décomposition.
En second lieu, la gauche du capital propose un programme économique, politique et social plus ou moins cohérent et réaliste pour le capital national. En revanche, le problème avec le populisme politique n’est pas qu’il ne fasse pas de propositions concrètes, mais qu’il propose une chose et son contraire, une politique aujourd’hui, une autre demain. Au lieu d’être une alternative politique, il représente la décomposition de la politique bourgeoise.
C’est pourquoi, au moins au sens où le terme est utilisé ici, cela a peu de sens de parler de l’existence d’un populisme de gauche, comme une sorte de pendant au populisme de droite.
Malgré des similitudes et des parallèles, l’histoire ne se répète jamais. Le populisme d’aujourd’hui n’est pas la même chose que le fascisme des années 1920 et 1930. Cependant, le fascisme d’alors et le populisme d’aujourd’hui ont, d’une certaine manière, des causes similaires. En particulier, ils sont tous les deux l’expression de la décomposition du monde bourgeois. Avec l’expérience historique du fascisme et, surtout, du national-socialisme derrière lui, la bourgeoisie des vieux pays capitalistes centraux a une conscience aiguë de ces similitudes et du danger potentiel qu’elles représentent pour la stabilité de l’ordre capitaliste.
Parallèles avec la montée du national-socialisme en Allemagne
Le fascisme en Italie et en Allemagne avait en commun le triomphe de la contre-révolution et le délire de la dissolution des classes dans une communauté mystique après la défaite préalable (surtout grâce aux armes de la démocratie et de la gauche du capital) de la vague révolutionnaire. En commun aussi, leur contestation ouverte du découpage impérialiste et l’irrationalité de beaucoup de leurs buts de guerre. Mais malgré ces similitudes (sur la base desquelles Bilan a été capable de reconnaître la défaite de la vague révolutionnaire et le changement de cours historique, ouvrant la possibilité pour la bourgeoisie de mobiliser le prolétariat dans la guerre mondiale), il est utile –de façon à mieux comprendre le populisme contemporain– d’étudier de plus près certaines des spécificités des développements historiques en Allemagne à l’époque, y compris là où elles différaient du fascisme italien beaucoup moins irrationnel.
Premièrement, l’ébranlement de l’autorité établie des classes dominantes, et la perte de confiance de la population dans sa direction politique, économique, militaire, idéologique et morale traditionnelle, étaient beaucoup plus profonds que partout ailleurs (excepté en Russie), puisque l’Allemagne était la grande perdante de la Première Guerre mondiale et en est sortie dans un état d’épuisement économique, financier et même physique.
Deuxièmement, en Allemagne, beaucoup plus qu’en Italie, une réelle situation révolutionnaire avait eu lieu. La façon dont la bourgeoisie a été capable d’étouffer dans l’œuf, à un stade précoce, ce potentiel, ne doit pas nous faire sous-estimer la profondeur de ce processus révolutionnaire, ni l’intensité des espérances et des attentes qu’il avait éveillées et qui l’avaient accompagné. Il a fallu presque six ans, jusqu’en 1923, à la bourgeoisie allemande et mondiale pour liquider toutes les traces de cette effervescence. Aujourd’hui, il nous est difficile d’imaginer le degré de déception causé par cette défaite et l’amertume qu’elle a laissée dans son sillage. La perte de confiance de la population dans sa propre classe dominante fut ainsi rapidement suivie par la désillusion encore plus cruelle de la classe ouvrière à l’égard de ses (anciennes) organisations (social-démocratie et syndicats), et par la déception vis-à-vis du jeune KPD et de l’Internationale communiste.
Troisièmement, les calamités économiques ont joué un rôle beaucoup plus central dans la montée du national-socialisme que ça n’a été le cas pour le fascisme en Italie. L’hyperinflation de 1923 en Allemagne (et ailleurs en Europe centrale) a sapé la confiance dans la monnaie en tant qu’équivalent universel. La Grande Dépression qui a commencé en 1929 n’a donc eu lieu que 6 ans après le traumatisme de l’hyperinflation. Non seulement la Grande Dépression a frappé en Allemagne une classe ouvrière dont la conscience de classe et la combativité avaient déjà été écrasées, mais la façon dont les masses, intellectuellement et émotionnellement, ont fait l’expérience de ce nouvel épisode de crise économique, était dans une certaine mesure modifiée, pré-formatée pourrait-on dire, par les événements de 1923.
Les crises, celles du capitalisme décadent en particulier, affectent tous les aspects de la vie économique (et sociale). Ce sont des crises de (sur)production –de capital, de marchandises, de force de travail– et d’appropriation et de "distribution" -spéculations financière et monétaire et crash inclus. Mais, à la différence des manifestations de la crise plus centrées sur le lieu de la production, telles que les licenciements et les réductions de salaire, les effets négatifs sur la population au niveau financier et monétaire sont beaucoup plus abstraits et obscurs. Cependant, leurs effets peuvent être tout aussi dévastateurs pour des parties de la population, tout comme leurs répercussions peuvent même être plus mondiales et se répandre encore plus vite que celles qui ont lieu plus directement sur le lieu de production. En d’autres termes, alors que ces dernières manifestations de la crise tendent à favoriser le développement de la conscience de classe, celles qui proviennent plutôt des sphères financières et monétaires tendent à faire le contraire. Sans l’aide du marxisme, il n’est pas facile de saisir les liens réels entre, par exemple, un crash financier à Manhattan et le défaut de paiement d’une assurance ou même d’un État sur un autre continent. De tels systèmes d’interdépendance spectaculaires, créés aveuglément entre pays, populations, classes sociales, qui fonctionnent dans le dos des protagonistes, mènent facilement à la personnalisation et à la paranoïa sociale. Le fait que l’accentuation récente de la crise ait aussi été une crise financière et des banques, liée à des bulles spéculatives et à leur explosion, n’est pas que de la propagande bourgeoise. Le fait qu’une fausse manœuvre spéculative à Tokyo ou à New York puisse déclencher la faillite d’une banque en Islande, ou ébranler le marché de l’immobilier en Irlande, n’est pas de la fiction mais une réalité. Seul le capitalisme crée une telle interdépendance de vie et de mort entre des gens qui sont complètement étrangers les uns aux autres, entre des protagonistes qui ne sont même pas conscients de l’existence des uns ni des autres. Il est extrêmement difficile pour les êtres humains de supporter de tels niveaux d’abstraction, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement. Une façon d’y faire face est la personnalisation, ignorant le mécanisme réel du capitalisme : ce sont les forces du mal qui planifient délibérément de nous nuire. Il est d’autant plus important de comprendre aujourd’hui cette distinction entre les différentes sortes d’attaques, que ce ne sont plus principalement la petite bourgeoisie ou ce qu’on appelle les classes moyennes qui perdent leurs économies comme en 1923, mais des millions de travailleurs qui possèdent ou essaient de posséder leur propre logement, d’avoir des économies, des assurances, etc..
En 1923, la bourgeoisie allemande, qui planifiait déjà de mener la guerre contre la Russie, s’est trouvée confrontée à un national-socialisme qui était devenu un véritable mouvement de masse. Dans une certaine mesure, la bourgeoisie était piégée, prisonnière d’une situation qu’elle avait grandement contribué à créer. Elle aurait pu opter pour s’engager dans la guerre sous un gouvernement social-démocrate, avec le soutien des syndicats, dans une coalition possible avec la France ou même la Grande Bretagne, même en tant que partenaire secondaire au début. Mais cela aurait entraîné une confrontation ou, au moins, la neutralisation du mouvement NS, qui non seulement était devenu trop grand à manipuler mais regroupait aussi cette partie de la population qui voulait la guerre. Dans cette situation, la bourgeoisie allemande a commis l’erreur de croire qu’elle pouvait instrumentaliser le mouvement NS à son gré.
Le national-socialisme n’était pas simplement un régime de terreur de masse exercée par une petite minorité sur le reste de la population. Il avait sa propre base de masse. Ce n’était pas qu’un instrument du capital qui s’imposait sur la population. C’était aussi son contraire : un instrument aveugle des masses atomisées, écrasées et paranoïaques qui voulaient s’imposer au capital. Le national-socialisme fut donc préparé, dans une grande mesure, par la perte profonde de confiance de grandes parties de la population dans l’autorité de la classe dominante et dans sa capacité à faire fonctionner efficacement la société et à fournir un minimum de sécurité physique et économique à ses citoyens. Cet ébranlement de la société jusqu’à ses fondations avait été inauguré par la Première Guerre mondiale et avait été exacerbé par les catastrophes économiques qui suivirent : l’hyperinflation qui était le résultat de la guerre mondiale (du côté des perdants), et la Grande Dépression des années 1930. L’épicentre de cette crise était constitué par les trois empires – l’allemand, l’austro-hongrois, le russe –, les trois s’étant effondrés sous les coups de la guerre (perdue) et de la vague révolutionnaire.
À la différence de la Russie où au début la révolution fut victorieuse, en Allemagne et dans l’ancien empire austro-hongrois, la révolution a échoué. En l’absence d’une alternative prolétarienne à la crise de la société bourgeoise, un grand vide s’ouvrit, dont le centre était l’Allemagne et, disons, l’Europe continentale au nord du bassin méditerranéen, mais avec des ramifications à l’échelle mondiale, engendrant un paroxysme de violence et de pogromisation, centré sur les thèmes de l’antisémitisme et de l’antibolchevisme, culminant dans "l’holocauste" et le début d’une liquidation massive de populations entières, en particulier dans les territoires de l’URSS occupés par les forces allemandes.
La forme prise par la contre-révolution en Union Soviétique a joué un rôle important dans le développement de cette situation. Bien qu’il n’y ait plus rien eu de prolétarien dans la Russie stalinienne, l’expropriation violente de la paysannerie en particulier (la "collectivisation de l’agriculture" et la "liquidation des koulaks") n’a pas seulement terrifié les petits propriétaires et les petits épargnants dans le reste du monde, mais aussi beaucoup de grands propriétaires. Cela a été le cas notamment en Europe continentale où ces propriétaires (qui pouvaient inclure les modestes propriétaires de leur propre logement), laissés sans protection contre le "bolchevisme" dont ils n’étaient pas séparés par la mer ou l’océan (à la différence de leur homologues anglais ou américains), avaient peu de confiance dans les régimes "démocratiques" ou "autoritaires" européens instables qui existaient au début des années 1930, pour les protéger contre l’expropriation par la crise ou par le "bolchevisme juif".
Nous pouvons conclure de cette expérience historique que, si le prolétariat est incapable de mettre en avant son alternative révolutionnaire au capitalisme, la perte de confiance dans la capacité de la classe dominante de "faire son boulot" conduit finalement à une révolte, une protestation, une explosion d’une toute autre sorte, une protestation qui n’est pas consciente mais aveugle, orientée non pas vers le futur mais vers le passé, qui n’est pas basée sur la confiance mais sur la peur, non sur la créativité mais sur la destruction et la haine.
Une seconde crise de confiance dans la classe dominante aujourd’hui
Le processus que nous venons de décrire était déjà la décomposition du capitalisme. Et c’est plus que compréhensible que beaucoup de marxistes et d’autres observateurs ingénieux de la société dans les années 1930 se soient attendus à ce que cette tendance submerge rapidement le monde entier. Mais comme cela s’est avéré, ce n’était que la première phase de cette décomposition, pas encore sa phase terminale.
Avant tout, trois facteurs d’importance historique mondiale ont fait reculer cette tendance à la décomposition.
Premièrement, la victoire de la coalition anti-Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a considérablement rehaussé le prestige de la démocratie "occidentale" et, en particulier, celui du modèle américain d’une part, et celui du modèle du "socialisme en un seul pays" de l’autre.
Deuxièmement, le "miracle économique" d’après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans le bloc de l’Ouest.
Ces deux facteurs étaient du fait de la bourgeoisie. Le troisième a été du fait de la classe ouvrière : la fin de la contre-révolution, le retour de la lutte de classe au centre de la scène de l’histoire, et avec lui, la réapparition (cependant confuse et éphémère) d’une perspective révolutionnaire. La bourgeoisie, pour sa part, a répondu à ce changement de situation non seulement avec l’idéologie du réformisme mais, aussi, par des concessions et des améliorations matérielles réelles (temporaires bien sûr). Tout cela a renforcé, chez les travailleurs, l’illusion que la vie pouvait s’améliorer.
Comme nous le savons, ce qui a mené à la phase actuelle de décomposition a été essentiellement le blocage entre les deux classes principales, l’une incapable de déclencher une guerre généralisée, l’autre incapable de se diriger vers une solution révolutionnaire. Avec l’échec de la génération de 1968 à politiser plus ses luttes, les événements de 1989 ont inauguré alors, à l’échelle mondiale, la phase actuelle de décomposition. Mais il est très important de comprendre cette phase non comme quelque chose de stagnant mais comme un processus. 1989 a avant tout marqué l’échec de la première tentative du prolétariat de redévelopper sa propre alternative révolutionnaire. Après 20 ans de crise chronique et de détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière et de la population mondiale dans son ensemble, le prestige et l’autorité de la classe dominante se sont aussi érodés, mais pas au même degré. Au tournant du millénaire, il y avait encore d’importantes contre-tendances qui rehaussaient la réputation des élites bourgeoises dirigeantes. Nous en mentionnerons trois ici.
Premièrement, l’effondrement du bloc de l’Est stalinien n’a pas du tout endommagé l’image de la bourgeoisie de ce qui était auparavant le bloc de l’Ouest. Au contraire, ce qui a semblé réfuté, c’était la possibilité d’une alternative au "capitalisme démocratique occidental". Bien sûr, une partie de l’euphorie de 1989 s’est bien vite dissipée sous l’effet de la réalité, comme l’illusion d’un monde plus pacifique. Mais il est vrai que 1989 a au moins écarté l’épée de Damoclès d’une menace permanente d’annihilation mutuelle dans une troisième guerre mondiale. Également, après 1989, à la fois la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide qui a suivi entre l’Est et l’Ouest ont pu rétrospectivement être présentées de façon crédible comme ayant été le produit de l’"idéologie" et du "totalitarisme" (donc la faute du fascisme et du "communisme"). Au niveau idéologique, c’est une très bonne fortune pour la bourgeoisie occidentale que le nouveau rival impérialiste -plus ou moins ouvert- des États-Unis aujourd’hui ne soit plus l’Allemagne (désormais elle-même "démocratique") mais la Chine "totalitaire" et que beaucoup des guerres régionales contemporaines et d’attaques terroristes puissent être attribuées au "fondamentalisme religieux".
Deuxièmement, l’étape actuelle de "mondialisation" du capitalisme d’État, déjà introduite au préalable, a rendu possible, dans le contexte post 1989, un développement réel des forces productives dans ce qui avait été jusqu’à maintenant des pays périphériques du capitalisme. Bien sûr, les États des BRIC, par exemple, ne constituent en rien un modèle de mode de vie pour les ouvriers dans les vieux pays capitalistes. Mais d’un autre côté, ils créent l’impression d’un capitalisme mondial dynamique. Il faut noter, au vu de l’importance de la question de l’immigration pour le populisme aujourd’hui, que ces pays sont vus à ce niveau comme apportant une contribution à la stabilisation de la situation, puisqu’ils absorbent des millions de migrants qui se seraient autrement déplacés vers l’Europe et l’Amérique du Nord.
Troisièmement, le développement réellement époustouflant au niveau technologique, qui a "révolutionné" la communication, l’éducation, la médecine, la vie quotidienne dans son ensemble, a de nouveau créé l’impression d’une société pleine d’énergie (justifiant, en passant, notre compréhension que la décadence du capitalisme ne signifie pas l’arrêt des forces productives, ni une stagnation technologique).
Ces facteurs (et il y en a probablement d’autres), bien qu’incapables d’empêcher la phase actuelle de décomposition (et avec elle déjà, un premier développement du populisme), ont encore réussi à atténuer certains de ses effets. En revanche, le renforcement de ce populisme aujourd’hui indique que nous pourrions nous approcher de certaines limites de ces effets modérateurs, peut-être même en ouvrant ce que nous pourrions appeler une seconde étape dans la phase de décomposition. Cette deuxième étape, dirions-nous, est caractérisée chez de plus en plus grandes parties de la population par une perte grandissante de confiance dans la volonté ou dans la capacité de la classe dominante de les protéger. Un processus de désillusion qui, au moins pour le moment, n’est pas prolétarien, mais profondément antiprolétarien. Derrière les crises de la finance, de l’Euro et des réfugiés, qui sont plus des facteurs déclenchant que les causes profondes, cette nouvelle étape est bien sûr le résultat des effets cumulés, sur des décennies, de facteurs plus profonds. D’abord et avant tout, l’absence de perspective révolutionnaire prolétarienne. De l’autre côté (celui du capital), il y a une crise économique chronique mais, aussi, les effets du caractère de plus en plus abstrait du mode de fonctionnement de la société bourgeoise. Ce processus, inhérent au capitalisme, a connu une grave accélération au cours des trois dernières décennies, avec la réduction brutale, dans les vieux pays capitalistes, de la force de travail industrielle et manuelle, et de l’activité physique en général, du fait de la mécanisation et des nouveaux media tels que les ordinateurs personnels et Internet. Parallèlement à cela, le moyen d’échange universel a été largement transformé de métal et papier en monnaie électronique.
Populisme et violence
À la base du mode de production capitaliste, il y a une combinaison très spécifique de deux facteurs : les mécanismes économiques ou "lois" (le marché) et la violence. D’un côté : la condition de l’échange d’équivalents est le renoncement à la violence -l’échange à la place du vol. De plus, le travail salarié est la première forme d’exploitation où l’obligation de travailler, et la motivation dans le processus du travail lui-même, constituent essentiellement une force économique plutôt que directement physique. De l’autre côté : dans le capitalisme, tout le système d’échange d’équivalent est basé sur un échange "originel" non équivalent –la séparation violente des producteurs des moyens de production (l’"accumulation primitive") qui est la condition du système salarié et qui est un processus permanent dans le capitalisme puisque l’accumulation elle-même est un processus plus ou moins violent (voir L’Accumulation du Capital, Rosa Luxembourg). Cette permanence de la présence des deux pôles de cette contradiction (violence et renoncement à la violence), de même que l’ambivalence que cela crée, imprègne l’ensemble de la vie de la société bourgeoise. Elle accompagne tout acte d’échange, dans lequel l’option alternative du vol est toujours présente. D’ailleurs, une société fondée radicalement sur l’échange, et donc sur le renoncement à la violence, doit renforcer ce renoncement par la menace de la violence, et pas seulement la menace –ses lois, son appareil de justice, sa police, ses prisons, etc. Cette ambiguïté est toujours présente en particulier dans l’échange entre le travail salarié et le capital, dans lequel la coercition économique est complétée par la force physique. Elle est spécifiquement présente partout où l’instrument par excellence de la violence dans la société est directement impliqué : l’État. Dans ses relations avec ses propres citoyens (coercition et extorsion) et avec les autres États (guerre), l’instrument de la classe dominante pour supprimer le vol et la violence chaotique est lui-même, en même temps, le voleur généralisé, sanctifié.
Un des points de focalisation de cette contradiction et de cette ambigüité entre la violence et son renoncement dans la société bourgeoise réside dans chacun de ses sujets individuels. Vivre une vie normale, fonctionnelle, dans le monde actuel, exige le renoncement à une pléthore de besoins corporels, émotionnels, intellectuels, moraux, artistiques et créatifs, à tout un monde. Dès que le capitalisme mûri est passé de l’étape de la domination formelle à la domination réelle, ce renoncement n’a plus été imposé principalement par la violence externe. D’ailleurs, chaque individu est plus ou moins consciemment confronté à un choix, soit celui de s’adapter au fonctionnement abstrait de cette société, soit celui d’être un "loser", un perdant, qui peut finir dans le caniveau. La discipline devient l’autodiscipline, mais de telle façon que chaque individu devient celui-là même qui réprime ses propres besoins vitaux. Bien sûr, ce processus d’autodiscipline contient aussi un potentiel pour l’émancipation, pour l’individu et surtout pour le prolétariat dans son ensemble (en tant que classe autodisciplinée par excellence) de devenir le maître de son propre destin. Mais pour le moment, dans le fonctionnement "normal" de la société bourgeoise, cette autodiscipline est essentiellement l’internalisation de la violence capitaliste. Parce que c’est le cas, en plus de l’option prolétarienne de transformation de cette autodiscipline en moyen de la réalisation, de revitalisation des besoins humains et de créativité, il y a aussi, en veille, une autre option, celle de la redirection aveugle de la violence internalisée vers l’extérieur. La société bourgeoise a toujours besoin d’offrir un "outsider" afin de maintenir l’(auto)-discipline de ceux qui soi-disant lui appartiennent. C’est pourquoi la ré-externalisation de la violence par les sujets de la société bourgeoise s’oriente "spontanément" (c’est-à-dire est prédisposée ou "formatée" dans ce sens) contre de tels outsiders (pogromisation).
Quand la crise ouverte de la société capitaliste atteint une certaine intensité, quand l’autorité de la classe dominante s’est détériorée, quand les sujets de la société bourgeoise commencent à douter de la capacité et de la détermination des autorités à faire leur travail et, en particulier, à les protéger contre un monde de dangers, et quand une alternative –qui ne peut être que celle du prolétariat– manque, des parties de la population commencent à protester et même à se révolter contre l’élite dominante, mais non dans le but de mettre ses règles en cause, mais pour la forcer à protéger ses propres citoyens "respectueux des lois" contre les "outsiders". Ces couches de la société subissent la crise du capitalisme comme un conflit entre ses deux principes sous-jacents : entre le marché et la violence. Le populisme est l’option de la violence pour résoudre les problèmes que le marché ne peut résoudre, et même pour résoudre les problèmes du marché lui-même. Par exemple, si le marché mondial de la force de travail menace d’engloutir le marché du travail des vieux pays capitalistes de la vague de ceux qui n’ont rien, la solution est d’ériger des barrières et de poster aux frontières une police qui puisse tirer sur quiconque essaie de les franchir sans permission.
Derrière la politique populiste d’aujourd’hui, se cache la soif de meurtre. Le pogrom est le secret de son existence.
Steinklopfer, 8 juin 2016
Personnages:
- Donald Trump [577]
- Angela Merkel [586]
Récent et en cours:
- réfugiés [587]
- Brexit [582]
- Indignados [588]
- Wilkommenskultur [589]
Questions théoriques:
- Populisme [584]
Rubrique:
Rapport sur la situation en Allemagne
- 1064 lectures
La conférence commune des sections du CCI en Allemagne et en Suisse et du noyau en Suède qui s'est tenue en mars 2016 a adopté, entre autres documents, un rapport sur la situation nationale en Allemagne que nous publions ici. Le rapport ne prétend pas être complet. Il se concentre sur un minimum de points sur lesquels nous pensons qu’il est particulièrement important de réfléchir et de discuter à l’heure actuelle. Puisque ces aspects en général ont pour point de départ les événements dramatiques de la situation actuelle, nous ajoutons au rapport la présentation faite à la conférence et qui est en partie consacrée à une actualisation du rapport. Les commentaires critiques envers le rapport et la présentation faits au cours du débat qui s'est ensuivi sont ajoutés à la présentation en tant que notes de bas de page. Au vu de l'importance des développements dans ce qui est aujourd'hui le pays le plus central du capitalisme européen, nous espérons que ces textes pourront être une contribution positive à la nécessaire réflexion, du point de vue du prolétariat, sur la situation mondiale présente.
La compétitivité du capital allemand aujourd'hui
Comme l’État-nation allemand ne s’est pas constitué avant 1870, et a pris du retard pour se joindre au partage impérialiste du monde, il ne s’est jamais établi lui-même comme une puissance coloniale ou financière dominante. La base principale de sa puissance économique était et reste son industrie et sa force de travail hautement performantes. Alors que l'Allemagne de l'Est (la vieille République démocratique allemande, RDA) a pris du retard du point de vue économique en devenant une partie du bloc de l’Est, l’Allemagne de l’Ouest de l'après Seconde Guerre mondiale a été capable de construire sur cette base et même de la renforcer. En 1989, l’Allemagne de l’Ouest était devenue la principale nation exportatrice du monde, avec le déficit d’État le plus bas de toutes les puissances dominantes. Malgré des hauts niveaux de salaire comparativement aux autres nations, son économie était extrêmement compétitive. Elle a aussi bénéficié, économiquement, des possibilités du marché mondial ouvertes par son appartenance au bloc de l’Ouest, et pour avoir un budget militaire réduit en tant que principale perdante des deux guerres mondiales.
Aux niveaux politique et territorial, l’Allemagne a ensuite beaucoup profité de la chute du bloc de l’Est en 1989, en absorbant l’ex-RDA. Mais économiquement, l’absorption rapide de cette zone, qui était désespérément en retard par rapport aux standards internationaux, a aussi représenté un fardeau considérable, surtout financièrement. Un fardeau qui menaçait la compétitivité de la nouvelle et plus grande Allemagne. Pendant les années 1990, elle a perdu du terrain sur les marchés mondiaux, alors que les niveaux de déficit du budget de l’État commençaient à se rapprocher de ceux des autres puissances dominantes.
Aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, l’Allemagne a plus que regagné le terrain perdu. C’est le deuxième exportateur mondial, juste derrière la Chine. L’année dernière, le budget d’État affichait un surplus de 26 milliards d’Euros. La croissance, à 1,7%, a été modérée, mais c'est malgré tout une réussite pour un pays hautement développé. Le chômage officiel a chuté à son plus bas niveau depuis la réunification. La politique visant à conserver une production industrielle hautement développée basée en Allemagne-même a, jusqu’à maintenant, été un succès.
Bien sûr, en tant que vieux pays industriel, le socle de ce succès est une composition organique élevée du capital, le produit d'au moins deux siècles d'accumulation. Mais, dans ce contexte, les qualifications et compétences élevées de sa population sont décisives pour son avantage concurrentiel. Avant la Première Guerre mondiale, l’Allemagne était devenue le principal centre du développement scientifique et de ses applications à la production. Avec la catastrophe du national-socialisme et de la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu cet avantage et n’a montré aucun signe de récupération depuis. Ce qui reste néanmoins est son savoir-faire dans le processus de production lui-même. Depuis la disparition de la Hanse 1, l’Allemagne n’a jamais été une puissance maritime durable et dominante. Quoique longtemps une économie essentiellement paysanne, son sol, en général, est moins fertile que celui de la France, par exemple. Ses avantages naturels reposent sur sa situation géographique au cœur de l’Europe et ses métaux précieux exploités déjà durant le Moyen Âge. De tout cela ont surgi une grande aptitude au travail et à la coopération entre artisans et industriels, et un savoir-faire développé et transmis de génération en génération. Bien que sa révolution industrielle ait largement bénéficié de grandes ressources en charbon, la disparition d’industries lourdes depuis les années 1970 jusqu’à nos jours a montré que ce n'est pas là que résidait le cœur de l’ascendant économique de l'Allemagne, mais dans son efficacité dans la production de moyens de production et, plus généralement, dans la transformation de travail vivant en travail mort. Aujourd’hui, l’Allemagne est le principal producteur dans le monde de machines complexes. Ce secteur est la colonne vertébrale de son économie, plus que le secteur automobile. En arrière-plan de cette force, il y a aussi le savoir-faire de la bourgeoisie qui, déjà pendant l’ascendance du capitalisme, s’est essentiellement concentrée sur ses activités économiques et industrielles, puisqu’elle était plus ou moins exclue des positions de pouvoir politique et militaire par la caste des propriétaires terriens prussiens (les Junkers). La passion pour l’ingénierie que cette bourgeoisie a développé continue à s’exprimer non seulement dans l'industrie des machines-outils, encore souvent basée sur des unités de taille moyenne gérées par des familles, mais aussi dans la capacité particulière de la classe dominante dans son ensemble à faire tourner l’industrie allemande entière comme si c’était une seule machine. L’interconnexion complexe et hautement efficace de toutes les différentes unités de production et de distribution est un des principaux avantages du capital national allemand.
Face au poids mort de l’économie de la RDA en faillite, le tournant dans la récupération de son avantage concurrentiel a été atteint dans la première décennie du siècle présent. Deux facteurs ont été décisifs. Au niveau organisationnel, toutes les compagnies les plus importantes, mais aussi les fabriques moyennes de machines (Maschinenbau), ont commencé à produire et à œuvrer à une échelle mondiale, créant des réseaux de production tous centrés sur l’Allemagne elle-même. Au niveau politique, sous la direction du SPD (social-démocrate), les attaques contre les salaires et les prestations sociales (dénommées "Agenda 2010") ont été si radicales que le gouvernement français a même accusé l’Allemagne de dumping salarial.
Ce tournant a été favorisé par trois éléments majeurs du contexte économique global, qui se sont avérés être particulièrement favorables pour l’Allemagne.
D’abord, la transition du modèle keynésien au modèle communément appelé "néo-libéral" de capitalisme d'État, favorisant davantage les économies orientées vers l’exportation. Tout en participant fortement à l’ordre économique keynésien dominant le bloc de l'Ouest après 1945, le "modèle" ouest-allemand a été dès le début influencé par les idées "ordolibérales" 2 (Ludwig Erhard, l'école de Fribourg), et n’a jamais développé le type d'"Étatisme" qui continue à handicaper la compétitivité de la France aujourd’hui.
Deuxièmement, la consolidation de la coopération économique européenne après la chute du mur de Berlin (création de l'Union européenne, de l'union monétaire Euro). Bien qu’impulsée en partie pour des motifs politiques, essentiellement impérialistes (le désir de ses voisins de garder le "contrôle" de l’Allemagne), au niveau économique, l'Allemagne, en tant que concurrent le plus fort, a été le principal bénéficiaire de l'UE et de l'union monétaire. La crise financière et la crise de l’Euro après 2008 ont confirmé que les principaux pays capitalistes avaient toujours la capacité de repousser les pires effets de la crise sur leurs rivaux plus faibles. Les différents plans internationaux et européens de sauvetage, comme ceux de la Grèce par exemple, ont essentiellement servi au soutien des banques allemandes (et françaises) aux dépens des économies "secourues".
Troisièmement, la proximité géographique et historique de l’Europe de l’Est a contribué à faire de l’Allemagne le principal bénéficiaire de la transformation de celle-ci par la conquête de marchés auparavant hors de portée, y compris les vestiges extra-capitalistes. 3
Le rapport entre puissance économique et militaire de l'impérialisme allemand
Pour illustrer l’importance des conséquences de cette force compétitive à d’autres niveaux, nous voulons examiner maintenant le lien avec la dimension impérialiste. Après 1989, l’Allemagne a pu mettre en avant ses intérêts impérialistes avec une plus grande détermination et une plus grande indépendance. Des exemples en sont ses initiatives, sous Helmut Kohl, pour encourager l’éclatement de la Yougoslavie (commencées avec la reconnaissance diplomatique de l'indépendance des États de Croatie et de Slovénie), et le refus, sous Gerhard Schröder, de soutenir la seconde guerre d’Irak. Au cours des 25 dernières années, il y a certes eu des avancées au niveau impérialiste. Par-dessus tout, tant la "communauté internationale" que la population en Allemagne se sont accoutumées aux interventions militaires allemandes à l’étranger. La transition d’une armée de conscrits à une armée de métier a été faite. L’industrie d’armement allemande a accru sa part du marché mondial. Néanmoins, au plan impérialiste, elle n'a pas été capable de regagner autant de terrain qu'au plan économique. La difficulté à trouver suffisamment de volontaires pour l’armée reste sans solution. Par-dessus tout, l’objectif de modernisation technique des forces armées et d’accroissement, significatif de leur mobilité et de leur puissance de feu, n’a pas du tout été atteint.
En fait, pendant toute cette période après 1989, l’objectif de la bourgeoisie allemande n’a jamais été d’essayer, à court ou moyen terme, de "poser sa candidature" au leadership d'une tête de bloc potentielle opposée aux États-Unis. Au niveau militaire, cela aurait été impossible, étant donnés la puissance militaire écrasante des États-Unis et le statut actuel de l’Allemagne en tant que "géant économique mais nain militaire". Toute tentative de le faire aurait aussi conduit ses principaux rivaux européens à se liguer contre elle. Au niveau économique, supporter le poids de ce qui aurait été un programme énorme de réarmement aurait ruiné la compétitivité d’une économie qui luttait déjà contre le fardeau financier de la réunification - et aurait également fait courir le risque de confrontations avec la classe ouvrière.
Mais cela ne signifie en rien que Berlin ait renoncé à ses ambitions de regagner son statut, au moins de puissance militaire européenne dominante. Au contraire, depuis les années 1990, l’Allemagne suit une stratégie à long terme visant à augmenter son pouvoir économique comme base pour une renaissance militaire ultérieure. Alors que l’ex-URSS a fourni l'illustration qu’une puissance militaire ne peut se maintenir sur le long terme sans une base économique équivalente, plus récemment la Chine confirme l’autre face de la même pièce : une ascension économique peut préparer une ascension militaire ultérieure.
Une des clefs d’une telle stratégie à long terme est la Russie, mais aussi l’Ukraine. Au niveau militaire, ce sont les États-Unis, et pas l’Allemagne, qui ont le plus profité de l’extension de l’OTAN vers l’Est (en fait l’Allemagne a essayé d’empêcher certaines étapes de ce recul de la Russie). Par contre, c’est surtout au niveau économique que l’Allemagne espère profiter de toute cette zone. À la différence de la Chine, la Russie est incapable, pour des raisons historiques, d’organiser sa propre modernisation économique. Avant que le conflit ukrainien n’ait commencé, le Kremlin avait déjà décidé de tenter cette modernisation en coopération avec l’industrie allemande. En fait, un des principaux avantages de ce conflit pour les États-Unis est qu’il bloque (via l’embargo contre la Russie) cette coopération économique. Là réside aussi une des principales motivations de la chancelière allemande Merkel (et du président français Hollande, son partenaire subalterne dans cette affaire) pour prendre en charge la médiation entre Moscou et Kiev. En dépit de l’état actuellement de désolation de l’économie russe, la bourgeoisie allemande est toujours convaincue que la Russie serait capable de financer elle-même une telle modernisation. Le prix du pétrole ne restera pas toujours aussi bas qu’aujourd'hui, et la Russie recèle aussi beaucoup de métaux précieux à vendre. De plus, l’agriculture russe doit toujours être remaniée sur une base capitaliste moderne (c’est encore plus vrai pour l’Ukraine qui – malgré le désastre de Tchernobyl – a toujours certaines des terres les plus fertiles de la planète). Dans la perspective à moyen terme de disettes et de prix croissants des produits agricoles, de telles zones agricoles peuvent gagner une importance économique et même stratégique considérable. La crainte des États-Unis, que l’Allemagne puisse profiter de l’Est de l’Europe pour accroître encore son poids politique et économique relatif dans le monde et réduire quelque peu celui de l'Amérique en Europe, n'est donc pas infondée.
Un exemple de comment l’Allemagne utilise déjà avec succès sa force économique à des fins impérialistes est celui des réfugiés syriens. Même si elle le voulait, ce serait très difficile pour l’Allemagne de participer directement aux bombardements actuels en Syrie, du fait de sa faiblesse militaire. Mais comme, en raison de son chômage relativement bas, elle peut absorber une partie de la population syrienne sous la forme de l'afflux actuel de réfugiés, elle a gagné un moyen alternatif d'influencer la situation sur place, surtout après la guerre.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les États-Unis, en particulier, cherchent actuellement à utiliser des moyens juridiques pour refréner la puissance économique de leur concurrent allemand, par exemple en traînant Volkswagen ou la Deutsche Bank devant les tribunaux et en les menaçant de milliards de dollars d'amendes.
Les difficultés de la classe ouvrière
L’année 2015 a été le témoin d’une séries de grèves, surtout dans les transports (DB - chemins de fer allemands, Lufthansa) et chez les employés des crèches. Il y a eu aussi des mouvements plus locaux mais significatifs comme celui de l’hôpital de la Charité à Berlin, où infirmiers et patients ont été solidaires. Tous ces mouvements ont été très sectoriels et très isolés, se focalisant parfois en partie sur la fausse alternative entre grands syndicats et petits syndicats corporatistes, brouillant la nécessité d'une auto-organisation autonome des ouvriers. Bien que tous les syndicats aient organisé les grèves de façon à causer le maximum de tracas au public, la tentative d’éroder la solidarité, au moins sous la forme de la sympathie du public envers les grévistes, n’a réussi qu’en partie. L’argument qui accompagnait les revendications dans le secteur des jardins d’enfants, par exemple, et selon lequel le régime de salaires particulièrement bas dans des professions traditionnellement féminines devait prendre fin, tout en contribuant à l’isolement de cette grève, a été populaire au sein de la classe dans son ensemble, qui a semblé reconnaître que cette "discrimination" était surtout un moyen de diviser les ouvriers.
C’est assurément un phénomène inhabituel que partout dans l’Allemagne contemporaine, les grèves aient joué un rôle si important dans les médias en 2015. Ces grèves, tout en donnant la preuve d’une combativité et d’une solidarité toujours existante, ne sont cependant pas les signes d’une vague ou d’une phase de lutte prolétarienne qui se poursuivrait. Elles doivent être comprises, en partie au moins, comme une manifestation de la situation économique particulière de l’Allemagne telle que nous l’avons décrite plus haut. Dans ce contexte de chômage relativement bas et de manque de main d’œuvre qualifiée, la bourgeoisie elle-même met en avant l’idée que, après des années de salaires en baisse inaugurées sous Schröder (ils ont baissé plus radicalement que presque partout ailleurs en Europe occidentale), les employés devraient être enfin "récompensés" pour leur "sens du réalisme". Le nouveau gouvernement de Grande coalition des chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates a lui-même donné le ton, en introduisant finalement (en tant qu'un des derniers pays en Europe à le faire) une loi sur le salaire minimum de base et en augmentant quelques prestations sociales. Dans l’industrie automobile, par exemple, les grandes entreprises, en 2015, ont payé des primes (qu’ils ont appelées "participation aux bénéfices") allant jusqu’à 9.000 Euros par ouvrier. C’était d’autant plus possible que la modernisation de l’appareil productif a été si efficace que – au moins pour le moment – l'avantage concurrentiel allemand repose beaucoup moins sur des salaires bas qu’il y a une décennie.
En 2003, le CCI a analysé la lutte de classe internationale, débutant avec les protestations envers les attaques contre les retraites en France et en Autriche, comme un tournant (non spectaculaire, presque imperceptible) vers un mieux pour la lutte de classe, essentiellement à cause d’un début de reconnaissance par la génération actuellement au travail (pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale) que ses enfants n’auront pas de meilleures, mais de pires conditions de vie qu'elle-même. Cela a conduit aux premières expressions significatives de solidarité entre générations dans les luttes ouvrières. Cette évolution s’est exprimée sur le "lieu de production" plus au niveau de la conscience que de la combativité dans la mesure où la crainte du chômage et la précarité croissante du travail constituent des facteurs d'intimidation pour entrer en grève. En Allemagne même, la réponse initiale des chômeurs à l’Agenda 2010 (les "manifestations du lundi") s’est aussi bien vite essoufflée. Mais par ailleurs, une nouvelle génération, qui ne subit pas encore directement le joug du travail salarié, a commencé à descendre dans la rue (étant souvent rejointe par les employés précaires), pour exprimer non seulement sa propre colère et sa préoccupation pour l'avenir, mais aussi (plus ou moins consciemment) en rapport avec la classe dans son ensemble. Ces manifestations, s’étendant à des pays comme la Turquie, Israël et le Brésil, mais atteignant leur point culminant dans le mouvement anti-CPE en France et les Indignados en Espagne, ont même trouvé un écho, petit, faible mais cependant significatif, dans le mouvement des étudiants et des élèves en Allemagne. Celles-ci n'ont pas encore été accompagnées par la cristallisation d’une nouvelle génération de révolutionnaires mais par ses précurseurs potentiels.
En Allemagne, cela s’est exprimé dans un mouvement modeste mais combatif des Occupy, plus ouvert qu’avant aux idées internationalistes. Le mot d’ordre des premières manifestations Occupy était : "À bas le capital, l’État et la nation". Pour la première fois depuis des décennies en Allemagne, une politisation débutait donc, qui ne semblait pas être dominée par l’idéologie antifasciste et de libération nationale. Cela avait lieu en réponse à la crise financière de 2008 suivie par la crise de l’Euro. Certaines de ces petites minorités commençaient à penser que le capitalisme était au bord de l'effondrement. L’idée a commencé à se développer que s’il s’avérait que Marx avait raison sur la crise du capitalisme, il pourrait bien avoir raison aussi sur la nature révolutionnaire du prolétariat. Un espoir grandissait, celui que les attaques massives à l’échelle internationale se confrontent rapidement à une vague également massive de lutte de classe internationale. "Athènes aujourd’hui – Berlin demain - solidarité internationale contre le capital" est devenu le nouveau slogan.
La bourgeoisie, en réussissant à mettre fin à cette phase de la lutte de classe, n'a pas infligé une défaite historique au prolétariat, mais a réussi à briser, pour le moment, l’ouverture politique entamée en 2003. Ce qui a commencé comme crise américaine des subprimes a constitué une menace bien réelle pour la stabilité de l’architecture financière internationale. Le danger était pressant. Il n’y avait pas le temps pour d'interminables négociations entre gouvernements sur comment y faire face. La banqueroute de Lehman Brothers a eu l’avantage d’obliger les gouvernements dans tous les pays industrialisés à prendre des mesures immédiates et radicales pour sauver la situation (comme l’a écrit plus tard le Herald Tribune : "s'il n’était pas arrivé, l'effondrement de Lehman aurait dû être inventé"). Mais elle a aussi eu des avantages à un autre niveau : contre la classe ouvrière. Pour la première fois peut-être, la bourgeoisie mondiale a répondu à une crise majeure, aiguë, de son système, non pas en minimisant mais en exagérant son importance. On a raconté aux ouvriers du monde qu’à moins qu’ils n’acceptent immédiatement les attaques massives, les États, et avec eux les organismes de retraite et les fonds d’assurance, feraient faillite, les économies privées fondraient comme neige au soleil. Cette offensive de terreur idéologique ressemblait à la stratégie militaire de "choc et stupeur" employée par les États-Unis dans la seconde guerre d'Irak, visant à paralyser, traumatiser et désarmer l’adversaire. Et cela a fonctionné. En même temps, la base objective était présente pour ne pas attaquer tous les secteurs centraux du prolétariat mondial simultanément, puisque de larges secteurs de la classe ouvrière aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Europe du Sud ont beaucoup plus souffert qu’en Allemagne, en France et ailleurs en Europe du nord-ouest.
Le second chapitre de cette offensive de terreur et de division a été la crise de l’Euro, quand le prolétariat européen a été divisé avec succès entre nord et sud, entre les "fainéants de grecs" et les "allemands nazis et arrogants". Dans ce contexte, la bourgeoisie avait un autre atout dans la manche : le succès économique de l’Allemagne. Mêmes les grèves de 2015, et plus généralement les augmentations récentes de salaires et de prestations sociales dans ce pays, ont toutes été utilisées pour marteler le message, sur place comme auprès du prolétariat européen tout entier, que faire des sacrifices face à la crise finit par payer.
Ce message, selon lequel la lutte ne paye pas, a été en plus souligné par le fait que, dans les pays où la stabilité politique et économique est particulièrement fragile et la classe ouvrière plus faible, les mouvements de protestation de la jeune génération ("le Printemps arabe") n’ont réussi qu’à susciter de nouvelles vagues de répression ou des guerres intestines civiles et impérialistes. Tout cela a renforcé le sentiment d’impuissance et de manque de perspective dans la classe dans son ensemble.
Le non-effondrement du capitalisme et l’échec du prolétariat européen à s’opposer aux attaques massives ont aussi pesé sur les précurseurs d’une nouvelle génération de minorités révolutionnaires. L’augmentation de réunions publiques et de manifestations qui a caractérisé cette phase en Allemagne a fait place à une réelle phase de démoralisation. Depuis lors, d’autres manifestations ont eu lieu – contre "PEGIDA" 4, le TTIP 5, la technologie génétique ou la surveillance d’Internet – mais dénuées de toute critique plus fondamentale du capitalisme en tant que tel.
Et depuis l’été 2015, après les offensives autour des crises financière et de l’Euro, une autre offensive idéologique a eu lieu autour de la crise actuelle des réfugiés. Celle-ci est aussi utilisée au maximum par la classe dominante contre tout développement de la réflexion au sein du prolétariat. Mais plus que la propagande bourgeoise, la vague de réfugiés elle-même porte un coup supplémentaire aux premiers germes d'une récupération de la conscience de classe depuis le choc de 1989 ("la mort du communisme"). Le fait que des millions de gens de la "périphérie" du capitalisme risquent leur vie pour pouvoir entrer en Europe, en Amérique du Nord, et dans d’autres "forteresses" ne peut que, pour le moment, renforcer l’impression que c’est un privilège de vivre dans les parties développées du monde et que la classe ouvrière au centre du système, en l’absence de toute alternative au capitalisme, pourrait, après tout, avoir quelque chose à défendre au sein du capitalisme. De plus, la classe dans son ensemble, dépouillée pour le moment de son propre héritage politique, théorique et culturel, tend à voir les causes de cette migration désespérée non au sein du capitalisme, non en lien avec les contradictions centrées sur les pays démocratiques, mais dans une absence ou un manque de capitalisme et de démocratie dans les zones de conflit.
Tout ceci a conduit à un retrait accru tant de la combativité que de la conscience au sein de la classe.
Le problème du populisme politique
Bien que le phénomène de terreur de droite envers les étrangers et les réfugiés ne soit pas nouveau en Allemagne, en particulier depuis la réunification et surtout (quoique pas seulement) dans ses nouvelles provinces de l’Est, jusqu’à maintenant l'essor d’un mouvement politique populiste stable en Allemagne avait été empêché par la classe dominante elle-même avec succès. Mais dans le contexte de la crise de l’Euro, dont la phase aiguë a duré jusqu’à l’été 2015, et de la "crise des réfugiés" qui l'a suivie, un nouveau regain de populisme politique a eu lieu. Cela s’est manifesté principalement sur trois plans : la poussée électorale de "l'Alternative pour l’Allemagne" (Alternative für Deutschland, AfD), qui s’est originellement constituée en opposition aux plans de sauvetage grecs, et sur la base d’une vague opposition à la monnaie commune européenne ; un mouvement de protestation populiste de droite centré sur les "manifestations du lundi" à Dresde ("PEGIDA") ; une nouvelle recrudescence du terrorisme de droite envers les réfugiés et les étrangers, comme "l'Organisation clandestine nationale-socialiste" (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU).
De tels phénomènes ne sont pas nouveaux sur la scène politique allemande. Mais jusqu’à maintenant, la bourgeoisie avait toujours réussi à les empêcher d'aboutir à toute espèce de présence stable et parlementaire. Durant l’été 2015, il semblait que les secteurs dominants allaient y parvenir encore une fois. L’AfD avait été privée de son thème (la crise "grecque") et de certaines de ses ressources financières, et avait subi sa première scission. Mais ensuite, le populisme a fait son retour – encore plus fort qu’avant – grâce à la nouvelle vague d’immigration. Et puisque cette question de l’immigration risque de jouer un rôle plus ou moins dominant dans un avenir proche, la possibilité augmente pour que l’AfD s’établisse comme composante nouvelle et plus durable du paysage politique.
La classe dominante est capable d’utiliser tout cela pour rendre son jeu électoral plus intéressant, pour stimuler les idéologies démocratique et antifasciste, et aussi pour répandre la division et la xénophobie. Néanmoins, tout ce processus ne correspond pas directement à ses intérêts de classe, ni n’est en mesure d’être complètement contrôlé.
La crise de l’Euro et ses effets sur la scène politique allemande illustrent qu’il existe un lien étroit entre l’accentuation de la crise globale du capitalisme et l’avancée du populisme. La crise économique ne fait pas qu’augmenter l’insécurité et la peur, en intensifiant la lutte pour la survie. Elle attise aussi les flammes de l’irrationalité. L’Allemagne, économiquement parlant, aurait le plus à perdre de tout affaiblissement de la cohésion de l’UE et de l’Euro. Des millions d’emplois sont directement ou indirectement dépendants des exportations et du rôle que joue l’UE pour l’Allemagne dans ce contexte. Dans un tel pays, c’est d'autant plus irrationnel de mettre en question l’UE, l’Euro, l’orientation du marché mondial dans son ensemble. À ce niveau, ce n’est par hasard si l’apparition récente de tels mouvements xénophobes a été suscitée par des inquiétudes sur la stabilité de la nouvelle monnaie européenne.
La rationalité est d'une importance vitale, bien qu'elle ne soit pas la seule, pour l'entendement humain. La rationalité se centre sur l’élément de calcul dans la pensée. Comme cela inclut la capacité de calculer ses propres intérêts objectifs, c’est un élément indispensable, non seulement de la société bourgeoise, mais aussi de la lutte prolétarienne de libération. Historiquement, elle est apparue et s’est développée dans une large mesure sous l’impulsion de l’échange d’équivalents. Comme, sous le capitalisme, l’argent développe pleinement son rôle en tant qu’équivalent universel, la monnaie et la confiance qu’elle inspire jouent un rôle majeur dans le "formatage" de la rationalité dans la société bourgeoise. La perte de confiance dans l’équivalent universel est par conséquent une des principales sources d’irrationalité dans la société bourgeoise. C’est pourquoi les crises monétaires et les périodes d’hyperinflation sont particulièrement dangereuses pour la stabilité de cette société. L’inflation de 1923 en Allemagne a ainsi été l’un des facteurs les plus importants préparant le triomphe du national-socialisme dix ans plus tard.
La vague actuelle de réfugiés et d'immigrants, par ailleurs, fait ressortir et illustre un autre aspect du populisme : l’accentuation de la concurrence entre les victimes du capitalisme et la tendance à l’exclusion, la xénophobie, la bouc-émissarisation. La misère sous le règne du capitalisme engendre une triade de destructions : premièrement, l’accumulation d'agressivité, de haine, de méchanceté, et une envie de destruction et d’autodestruction ; deuxièmement, la projection de ces pulsions antisociales sur d’autres (hypocrisie morale) ; troisièmement, le fait de diriger ces pulsions non contre la classe dominante, qui apparaît comme trop puissante pour être défiée, mais contre les classes et les couches sociales apparemment plus faibles. Ce "complexe" à trois facettes fleurit par conséquent surtout en l’absence de lutte collective du prolétariat, quand les sujets individuels se sentent impuissants face au capital. Le point culminant de cette triade aux racines du populisme est le pogrome. Bien que l'agressivité populiste s’exprime aussi contre la classe dominante, ce qu’elle lui demande, haut et fort, c’est protection et faveurs. Ce qu’elle souhaite est que la bourgeoisie, soit élimine ce qu’elle voit comme ses rivaux menaçants, soit tolère qu’elle commence à le faire elle-même. Cette "révolte conformiste", une caractéristique permanente du capitalisme, devient aiguë face à la crise, la guerre, le chaos, l’instabilité. Dans les années 1930, le cadre de son développement était la défaite mondiale historique du prolétariat. Aujourd’hui, le cadre est l’absence de toute perspective : la phase de décomposition.
Comme cela a déjà été développé par le CCI dans ses Thèses sur la décomposition, une des bases sociales et matérielles du populisme est le processus de déclassement, la perte de toute identité de classe. Malgré la robustesse économique du capital national allemand et sa pénurie de main d’œuvre qualifiée, il existe une partie importante de la population allemande aujourd’hui qui, bien qu’au chômage, n’est pas réellement un facteur actif de l’armée industrielle de réserve (prête à prendre les emplois des autres et par conséquent exerçant une pression à la baisse sur les salaires), mais qui appartient plutôt à ce que Marx appelait la couche des Lazare de la classe ouvrière. Du fait de problèmes de santé, ou de l'incapacité à supporter le stress du travail capitaliste moderne et de la lutte pour l’existence, ou du manque de qualifications appropriées, ce secteur est "inemployable" du point de vue capitaliste. Au lieu de faire pression sur les niveaux de salaire, ces couches font augmenter la facture totale des salaires pour le capital national à cause des prestations dont ils vivent. C’est aussi ce secteur qui ressent le plus les réfugiés comme des rivaux potentiels aujourd’hui.
Au sein de ce secteur, il existe deux groupes importants de la jeunesse prolétarienne, dont certaines parties peuvent être enclines à la mobilisation en tant que chair à canon pour les cliques bourgeoises mais aussi en tant que protagonistes actifs de pogroms. Le premier est composé d’enfants de la première ou deuxième génération d'ouvriers immigrés (Gastarbeiter). L’idée originelle était que ces ouvriers immigrés ne resteraient pas quand on n'aurait plus besoin d’eux et, surtout, qu’ils n’amèneraient pas leur famille avec eux ou ne fonderaient pas de famille en Allemagne. Le contraire a eu lieu et la bourgeoisie n’a pas fait d’effort particulier pour éduquer les enfants de ces familles. Le résultat aujourd’hui est que, parce que les emplois non qualifiés ont été dans une grande mesure "exportés" vers ce qu'il était d'usage d'appeler les "pays du tiers-monde", une partie de cette jeunesse prolétarienne est condamnée à vivre des allocations de l’État, à n’être jamais intégrée dans le travail associé. L’autre groupe est composé d’enfants des licenciements massifs et traumatisants en Allemagne de l’Est après la réunification. Une partie d'entre eux, des Allemands plus que des immigrants, qui n’a pas été élevée pour être au niveau du standard "occidental" hautement compétitif de capitalisme, et qui n’a pas osé aller en Allemagne de l’Ouest pour trouver un travail après 1989 comme l'ont fait les plus intrépides, a rejoint cette armée de gens qui vivent d’allocations. Ces secteurs en particulier sont vulnérables à la lumpenisation, la criminalisation et aux formes décadentes, xénophobes de politisation.
Quoique le populisme soit le produit de son système, la bourgeoisie ne peut ni produire, ni faire disparaître ce phénomène à volonté. Mais elle peut le manipuler à ses propres fins, et encourager ou décourager son développement à un degré plus ou moins grand. En général, elle fait les deux. Mais cela aussi n’est pas facile à maîtriser. Même dans le contexte du capitalisme d’État totalitaire, il est difficile pour la classe dominante d’arriver à maintenir une cohérence dans une telle situation. Le populisme lui-même est profondément enraciné dans les contradictions du capitalisme. L'accueil des réfugiés aujourd’hui, par exemple, repose sur les intérêts objectifs d'importants secteurs du capitalisme allemand. Les avantages économiques sont mêmes plus apparents que les avantages impérialistes. C’est pourquoi les dirigeants de l’industrie et le monde des affaires sont les partisans les plus enthousiastes de la "culture de l’accueil" en ce moment. Ils estiment que l’Allemagne aurait besoin d’un afflux d’environ un million de personnes chaque année dans la période à venir, au vu de la pénurie prévue de main d’œuvre qualifiée et surtout de la crise démographique causée par le taux de natalité invariablement bas du pays. Et les réfugiés des guerres et d’autres catastrophes s’avèrent souvent être des ouvriers particulièrement assidus et disciplinés, prêts non seulement à travailler pour des bas salaires, mais aussi à prendre des initiatives et des risques. De plus, l’intégration de nouveaux venus de "l'extérieur", et l’ouverture culturelle que cela demande, est en elle-même une force productive (et aussi une force potentielle pour le prolétariat, bien sûr). Un succès ultérieur de l’Allemagne à ce niveau pourrait être un avantage de plus sur ses concurrents européens.
Cependant, l’exclusion est, en même temps, le revers de la médaille de la politique d’inclusion de Merkel. L’immigration requise aujourd’hui n’est plus celle d’une main d’œuvre non qualifiée des générations Gastarbeiter, maintenant que les emplois sans qualification ont été concentrés à la périphérie du capitalisme. Les nouveaux migrants doivent arriver avec de hautes qualifications, ou au moins la volonté de les acquérir. La situation actuelle demande une sélection beaucoup plus organisée et impitoyable que par le passé. Du fait de ces besoins contradictoires d’inclusion et d’exclusion, la bourgeoisie encourage simultanément l’ouverture et la xénophobie. Elle répond aujourd’hui à ce besoin par une division du travail entre droite et gauche, y compris au sein du parti chrétien-démocrate de Merkel et de son gouvernement de coalition avec le SPD. Mais derrière les dissonances actuelles entre les différents groupes politiques à propos de la question des réfugiés, il n’y a pas seulement une division du travail mais aussi des soucis et des intérêts différents. La bourgeoisie n’est pas un bloc homogène. Alors que ces parties de la classe dominante et de l’appareil d’État les plus proches de l’économie poussent à l’intégration, l'ensemble de l’appareil de sécurité est horrifié par l’ouverture des frontières par Merkel à l'été 2015 et par le nombre de personnes qui arrivent depuis lors, à cause de la perte de contrôle sur ceux qui pénètrent sur le territoire de l’État à laquelle cela a temporairement mené. De plus, au sein de l’appareil répressif et judiciaire, il y a inévitablement ceux qui sympathisent avec l’extrême droite et la protègent du fait d’une obsession partagée de la loi et de l’ordre, du nationalisme, etc.
En ce qui concerne la caste politique elle-même, il n’y a pas seulement ceux qui (selon l’humeur dans leur circonscription électorale) flirtent avec le populisme par opportunisme. Il y en a aussi beaucoup qui partagent cette mentalité. À tout cela, nous pouvons ajouter les contradictions du nationalisme lui-même. Comme tous les États bourgeois modernes, l’Allemagne a été fondée sur la base de mythes à propos d'une histoire, d'une culture et même d'un sang partagés. Dans ce contexte, même la plus puissante bourgeoisie ne peut pas inventer et réinventer à volonté des définitions différentes de la nation pour les adapter à ses intérêts changeants. Pas plus qu'elle n'aurait nécessairement un intérêt objectif à le faire, puisque les vieux mythes nationalistes sont toujours essentiels et sont un levier puissant du "diviser pour régner" à l’intérieur, et de mobilisation pour soutenir les agressions impérialistes à l’extérieur. Ainsi, il ne va pas encore de soi aujourd’hui qu’un noir ou un musulman puissent être "Allemand".
La classe dominante allemande face à la "crise des réfugiés"
Dans le contexte de décomposition et de crise économique, le principal moteur du populisme en Europe ces dernières décennies a été le problème de l’immigration. Aujourd’hui, ce problème est devenu plus aigu du fait de l'exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cet afflux est-il apparemment bien plus un problème politique en Europe que dans des pays comme la Turquie, la Jordanie ou même le Liban qui reçoivent des contingents beaucoup plus grands ? Dans les vieux pays capitalistes, les coutumes précapitalistes d’hospitalité et les structures sociales et économiques de subsistance qui les accompagnent se sont beaucoup plus radicalement atrophiées. Il y a aussi le fait que ces migrants viennent d'une culture différente. Bien sûr, ce n’est pas un problème en soi, au contraire. Mais le capitalisme moderne en fait un problème. En Europe occidentale en particulier, l’État-providence est l’organisateur principal de l’aide et de la cohésion sociales. C’est cet État qui est supposé accueillir les réfugiés. Cela place déjà ces derniers en concurrence avec les pauvres "indigènes" pour les emplois, le logement et les prestations sociales.
Jusqu’à maintenant, du fait de sa relative stabilité économique, politique et sociale, l’immigration, et avec elle le populisme, ont causé moins de problème en Allemagne que dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest. Mais dans la situation actuelle, la bourgeoisie allemande est de plus en plus confrontée à ce problème, non seulement chez elle mais aussi dans le contexte de l’Union européenne.
En Allemagne-même, la montée du populisme de droite dérange ses projets d’intégrer une partie des immigrants. C'est un problème réel puisque, jusqu’à maintenant, toutes les tentatives de relever le taux de natalité "à domicile" ont échoué. La terreur de droite altère aussi la réputation du pays à l’étranger – un point très sensible au vu des crimes de la bourgeoisie allemande pendant la première moitié du XXème siècle. L’établissement de l’AfD en tant que force parlementaire stable pourrait compliquer la formation de futurs gouvernements. Au niveau électoral, c’est actuellement surtout un problème pour la CDU/CSU, le parti gouvernemental dominant, qui jusqu’à maintenant, sous Merkel, a été capable d’attirer à la fois les électeurs sociaux-démocrates et conservateurs, consolidant ainsi sa position dominante vis-à-vis du SPD.
Mais c’est par-dessus tout au niveau de l’Europe que le populisme menace aujourd’hui les intérêts de l’Allemagne. Le statut de l’Allemagne, en tant qu’acteur mondial économique et, à un moindre degré, politique, dépend dans une large mesure de l’existence et de la cohérence de l’UE. L’arrivée au gouvernement de partis populistes, plus ou moins anti-européens, en Europe de l’Est (c’est déjà le cas en Hongrie et en Pologne) et surtout en Europe de l’Ouest, tendrait à gêner cette cohésion. C’est en particulier pourquoi Merkel a déclaré que la question des réfugiés était celle qui "décidera du destin de l’Allemagne". La stratégie de la bourgeoisie allemande vis-à-vis de cette question est une tentative de transformer, au niveau européen, la migration plus ou moins chaotique de la période de l'après-guerre et de la décolonisation en une immigration au mérite, hautement sélective, plus sur le modèle canadien ou australien. La fermeture plus efficace des frontières externes de l’UE est une des préconditions pour la transformation proposée d’une immigration illégale en une immigration légale. Cela impliquerait aussi l’établissement de quotas annuels d’immigration. Au lieu de payer des sommes abominables pour passer clandestinement dans l’Union Européenne, les migrants seraient encouragés à "investir" dans leur propre qualification de façon à accroître leurs chances d’accès légal. Au lieu de partir pour l’Europe de leur propre initiative, ces réfugiés acceptés seraient transportés vers des lieux d’accueil et d’emploi déjà prévus pour eux. L’autre face de cette pièce est que les immigrants non désirés seraient arrêtés aux frontières, ou brutalement et rapidement expulsés s’ils ont déjà réussi à y accéder. Cette conversion des frontières de l’UE en sas de sélection (un processus déjà en cours) est présentée comme un projet humanitaire visant à réduire le nombre de noyades en Méditerranée qui, en dépit de toutes les manipulations des médias, est devenu une source de déshonneur moral pour la bourgeoisie européenne. À travers son insistance sur une solution européenne plutôt que nationale, l’Allemagne assume ses responsabilités vis-à-vis de l’Europe capitaliste, soulignant en même temps sa revendication de leadership politique du vieux continent. Son objectif n’est rien de moins que de désamorcer la bombe à retardement de l’immigration, et avec elle du populisme politique, dans l’UE.
Ce fut dans ce contexte que le gouvernement Merkel, durant l’été 2015, a ouvert les frontières allemandes aux réfugiés. À ce moment-là, les réfugiés syriens, qui jusqu’alors étaient prêts à rester en Turquie orientale, ont commencé à perdre l’espoir de retourner chez eux et sont ainsi partis, en masse, vers l’Europe. En même temps, le gouvernement turc décidait, pour faire du chantage à l’UE qui bloquait la candidature d’Ankara à l'entrée en Europe, de ne pas empêcher leur départ. Dans cette situation, la fermeture des frontières allemandes aurait créé un entassement de centaines de milliers de réfugiés dans les Balkans, une situation chaotique et presque incontrôlable. Mais en levant temporairement le contrôle de ses frontières, Berlin a suscité un nouveau flux de migration de gens désespérés qui ont soudainement (mal) compris qu’ils étaient invités en Allemagne. Tout cela montre la réalité d’un moment de perte potentielle de contrôle de la situation.
Du fait de la manière radicale avec laquelle elle s’est identifiée à "son" projet, les chances de succès de la "solution européenne" proposée par Merkel se détérioreraient considérablement si elle échouait à être réélue en 2017. Un des principaux points de la campagne de réélection de Merkel semble être économique. Confrontée au ralentissement actuel de la croissance en Chine et en Amérique, l’économie allemande orientée vers les exportations se dirigerait normalement vers la récession. Un accroissement des dépenses d’État et de l’activité de construction "pour les réfugiés" pourrait éviter une telle éventualité jusqu'aux élections.
À la différence des années 1970 (quand dans nombre des principaux pays occidentaux les partis capitalistes de gauche sont venus au gouvernement : "la gauche au pouvoir") ou des années 1980 ("la gauche dans l’opposition"), la stratégie gouvernementale et le "jeu" électoral actuels en Allemagne sont déterminés à un degré bien moindre par la menace plus immédiate de la lutte de classe et beaucoup plus que par le passé par les problèmes d’immigration et de populisme.
Les réfugiés et la classe ouvrière
La solidarité avec les réfugiés exprimée par une partie importante de la population en Allemagne, bien qu’exploitée au maximum par l’État pour promouvoir l'image d’un nationalisme allemand humain, ouvert sur le monde, a été spontanée et, au début, "auto-organisée". Encore aujourd’hui, plus de six mois après le début de la crise actuelle, la gestion étatique de l’afflux s'effondrerait sans les initiatives de la population. Il n’y a rien de prolétarien dans ces activités en elles-mêmes. Au contraire, ces gens font en partie le travail que l’État est incapable de faire ou ne veut pas faire, souvent encore sans aucune rétribution. Pour la classe ouvrière, le problème central est que cette solidarité ne peut avoir lieu actuellement sur un terrain de classe. Pour le moment, elle revêt un caractère très apolitique, déconnecté de toute opposition explicite à la guerre impérialiste en Syrie par exemple. Tout comme les "ONG" et toutes les différentes organisations "critiques" de la société civile (inexistante en réalité), ces structures ont plus ou moins été immédiatement transformées en appendices de l’État totalitaire.
Mais en même temps, ce serait une erreur de ne prendre simplement cette solidarité que pour de la charité. D’autant plus que cette solidarité s’est exprimée vis-à-vis d’un afflux de rivaux potentiels sur le marché du travail et autres aspects. En l’absence de traditions précapitalistes d’hospitalité dans les vieux pays capitalistes, le travail associé et la solidarité du prolétariat sont la principale base sociale, matérielle, d'une telle solidarité plus généralement ressentie. Son esprit dans l'ensemble n’a pas été celui "d’aider les pauvres et les faibles", mais celui de coopération et de créativité collective. Sur le long terme, si la classe commence à retrouver son identité, sa conscience et son héritage, cette expérience actuelle de solidarité peut être intégrée dans l’expérience de la classe et sa recherche de perspective révolutionnaire. Parmi les ouvriers en Allemagne aujourd’hui, au moins potentiellement, les pulsions de solidarité expriment une certaine lueur de mémoire et de conscience de classe, rappelant qu’en Europe aussi, l'expérience de la guerre et des déplacements massifs de population n'est pas très ancienne, et que le manque de solidarité face à cette expérience pendant la période de contre-révolution (avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale) ne devrait pas se répéter aujourd’hui.
Le pôle opposé au populisme dans le capitalisme n’est pas la démocratie et l’humanisme mais le travail associé – le principal contrepoids à la xénophobie et au pogromisme. La résistance à l’exclusion et à la bouc-émissarisation a toujours été un moment permanent et essentiel de la lutte prolétarienne de tous les jours. Il peut y avoir aujourd'hui les prémices d’un très obscur tâtonnement vers une reconnaissance que les guerres et autres catastrophes qui obligent les gens à fuir font partie des séparations violentes au travers desquelles, dans un processus permanent, est constitué le prolétariat. Et que le refus de ceux qui ont tout perdu de rester docilement là où la classe dominante veut qu’ils restent, leur refus de renoncer à la recherche d’une vie meilleure, sont des moments constitutifs de la combativité prolétarienne. La lutte pour sa mobilité, contre le régime de discipline capitaliste, est un des plus vieux moments de la vie du travail salarié "libre".
La mondialisation et la nécessité d’une lutte internationale
Dans la partie sur le bilan de la lutte de classe, nous avons dit que les grèves de 2015 en Allemagne étaient plus une expression d’une situation économique nationale temporaire et favorable qu’une indication d’une combativité plus généralisée à l’échelle européenne ou internationale. Il reste donc vrai qu’il est devenu de plus en plus difficile pour la classe ouvrière de défendre ses intérêts immédiats par des actions de grèves ou d’autres moyens de lutte. Cela ne signifie pas que les luttes économiques ne soient plus possibles ou aient perdu de leur pertinence (comme la dénommée tendance d’Essen du KAPD l’avait erronément conclu dans les années 1920). Au contraire, cela signifie que la dimension économique de la lutte de classe renferme une dimension politique beaucoup plus directe que dans le passé – une dimension qu’il est extrêmement difficile d’assumer.
Les récentes résolutions de congrès du CCI ont à juste titre identifié un des facteurs objectifs qui inhibe le développement de luttes de défense des intérêts économiques immédiats : le poids intimidant du chômage de masse. Mais ce n’est pas le seul, et même pas la principale cause économique de cette inhibition. Un facteur plus fondamental réside dans ce qu’on appelle la mondialisation - la phase actuelle du capitalisme d’État totalitaire - et le cadre qu’il donne à l’économie mondiale.
La mondialisation du capitalisme global n’est pas, en elle-même, un phénomène nouveau. Nous le trouvons déjà à la base du premier secteur hautement mécanisé de la production capitaliste : l’industrie textile en Grande-Bretagne, centre d’un triangle lié à l'enlèvement d'esclaves en Afrique et à leur travail dans des plantations de coton aux États-Unis. En termes de marché global, le niveau de mondialisation atteint avant la Première Guerre mondiale n’a plus été rejoint avant la fin du XXème siècle. Néanmoins, au cours des trois dernières décennies, cette mondialisation a acquis une nouvelle qualité surtout à deux niveaux : dans la production et dans la finance. Le schéma de la périphérie du capitalisme fournissant de la main d’œuvre bon marché, des produits de plantations agricoles et des matières premières pour les pays industriels de l’hémisphère nord a été, sinon entièrement remplacé, du moins en grande partie modifié par des réseaux globaux de production, toujours centrés sur des pays plus dominants, mais où les activités industrielle et de service prennent place dans le monde entier. Dans ce corset "ordolibéral", la tendance est à ce qu'aucun capital national, aucune industrie, aucun secteur ou aucune affaire ne puisse plus être en mesure de s’exempter de la concurrence internationale directe. Il n’y a presque rien qui soit produit n’importe où dans le monde qui ne puisse être produit ailleurs. Chaque État-nation, chaque région, chaque ville, chaque quartier, chaque secteur de l’économie sont condamnés à se concurrencer pour attirer des investissements globaux. Le monde entier est envoûté, comme s’il était condamné à attendre le salut de l’arrivée de capital sous la forme d’investissements. Cette phase du capitalisme n’est en aucune façon un produit spontané, mais un ordre étatique introduit et imposé surtout par les vieux États-nations bourgeois dominants. Un des buts de cette politique économique est d’emprisonner la classe ouvrière du monde entier dans un monstrueux système disciplinaire.
À ce niveau, nous pouvons peut-être diviser l’histoire des conditions objectives de la lutte de classe, très schématiquement, en trois phases. Durant l’ascendance du capitalisme, les ouvriers étaient confrontés d'abord et avant tout à des capitalistes individuels, et pouvaient donc s’organiser plus ou moins efficacement dans des syndicats. Avec la concentration du capital dans les mains de grandes entreprises et de l’État, ces moyens de lutte établis ont perdu de leur efficacité. Chaque grève était maintenant directement confrontée à l’ensemble de la bourgeoisie, centralisée dans l’État. Il a fallu du temps au prolétariat pour trouver une réponse efficace à cette nouvelle situation : la grève de masse de l’ensemble du prolétariat à l'échelle d’un pays tout entier (Russie, 1905), qui contient déjà en son sein la potentialité de la prise de pouvoir et de l’extension à d'autres pays (première vague révolutionnaire déclenchée par l’Octobre rouge). Aujourd’hui, avec la mondialisation contemporaine, une tendance historique objective du capitalisme décadent atteint son plein développement : chaque grève, chaque acte de résistance économique des ouvriers quelque part dans le monde, se trouvent immédiatement confrontés à l’ensemble du capital mondial, toujours prêt à retirer la production et l'investissement et à produire ailleurs. Pour le moment, le prolétariat international a été tout à fait incapable de trouver une réponse adéquate, ou même d'entrevoir à quoi pourrait ressembler une telle réponse. Nous ne savons pas s’il réussira à le faire finalement. Mais il parait clair que le développement dans cette direction prendrait beaucoup plus de temps que la transition des syndicats à la grève de masse. D’un côté, la situation du prolétariat dans les vieux pays centraux du capitalisme – ceux, comme l’Allemagne, au "sommet" de la hiérarchie économique – devrait devenir beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd’hui. D’un autre côté, le pas requis par la réalité objective - lutte de classe internationale consciente, la "grève de masse internationale" - est beaucoup plus exigeant que le pas des syndicats à la grève de masse dans un pays. Car il oblige la classe ouvrière à remettre en question, non seulement le corporatisme et le localisme, mais aussi les principales divisions de la société de classes, souvent vieilles de plusieurs siècles voire même de plusieurs millénaires, comme la nationalité, la culture ethnique, la race, la religion, le sexe, etc. C'est un pas beaucoup plus profond et plus politique.
En réfléchissant à cette question, nous devrions prendre en considération que les facteurs qui empêchent le développement par le prolétariat de sa propre perspective révolutionnaire ne résident pas seulement dans le passé, mais aussi dans le présent ; qu'ils n’ont pas seulement des causes politiques mais aussi économiques (plus exactement : économico-politiques).
Présentation du rapport (mars 2016)
Au moment de la crise financière de 2008, il y avait au sein du CCI une tendance à une sorte de "catastrophisme" économique, dont une des expressions était l'idée, mise en avant par certains camarades, que l'effondrement de pays capitalistes centraux comme l'Allemagne aurait pu être alors à l'ordre du jour. Une des raisons pour faire de la force économique et de la compétitivité relatives de l'Allemagne un axe de ce rapport est le souhait de contribuer à surmonter de telles faiblesses. Mais nous voulons également imposer l'esprit de nuance contre la pensée schématique. Parce que le capitalisme lui-même a un mode abstrait de fonctionnement (basé sur l'échange d'équivalents), il existe une tendance compréhensible mais malsaine à voir les questions économiques de manière trop abstraite, par exemple en jugeant de la force économique relative des capitaux nationaux uniquement en termes très généraux (tels que le taux de composition organique du capital, l'abondance de main-d’œuvre nécessaire à la production, la mécanisation, comme mentionnés dans le rapport), en oubliant que le capitalisme est une relation sociale entre êtres humains, et par-dessus tout entre classes sociales.
Nous devrions clarifier un point : quand le rapport dit que la bourgeoisie américaine use de moyens juridiques (les amendes contre Volkswagen et d'autres) pour contrer la concurrence allemande, l'intention n'était pas de donner l'impression que les États-Unis n'ont pas de forces économiques propres à jeter dans la balance. Par exemple, les États-Unis devancent actuellement l'Allemagne dans le développement des voitures électriques et sans conducteur, et une des hypothèses qui circule sur les médias sociaux sur le soi-disant scandale Volkswagen (que l'information sur la manipulation des mesures d'émission par cette entreprise pourrait avoir fuité de l'intérieur de la bourgeoisie allemande vers les autorités américaines pour obliger l'industrie automobile allemande à rattraper son retard sur ce plan) n'est pas totalement invraisemblable.
Sur la façon dont la crise des réfugiés est utilisée à des fins impérialistes, il est nécessaire d'actualiser le rapport. Actuellement, tant la Turquie que la Russie font un usage massif de la situation critique des réfugiés pour faire chanter le capital allemand et affaiblir ce qui reste de cohésion européenne. La façon dont Ankara laisse les réfugiés aller vers l'ouest est déjà mentionnée dans le rapport. Le prix de la coopération turque sur cette question ne se limitera pas à plusieurs milliards d'Euros. Quant à la Russie, elle a récemment été accusée par une série d'ONG et d'organisations d'aide aux réfugiés de bombarder délibérément des hôpitaux et des zones résidentielles dans des villes syriennes dans le but de déclencher de nouveaux départs de réfugiés. Plus généralement, la propagande russe utilise systématiquement la question des réfugiés pour attiser les flammes du populisme politique en Europe.
En ce qui concerne la Turquie, elle exige non seulement de l'argent mais aussi l'accélération de l'accès sans visa de ses citoyens en Europe et des négociations en vue de l'admission dans l'UE. De l'Allemagne, elle exige également la cessation de l'aide militaire aux unités kurdes en Irak et en Syrie.
Pour la chancelière Merkel, la plus éminente partisane d'une plus étroite collaboration avec Ankara sur la question des réfugiés, et qui est une atlantiste plus ou moins fervente (pour elle, la proximité avec les États-Unis est un moindre mal comparé à la proximité avec Moscou), ceci est un problème moins important qu'il ne l'est pour d'autres membres de son propre parti. Comme le rapport l'a déjà mentionné, Poutine avait planifié la modernisation de l'économie russe en étroite collaboration avec l'industrie allemande, en particulier avec son secteur de l'ingénierie qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est principalement localisé dans le sud de l'Allemagne (y compris Siemens, autrefois basé à Berlin et maintenant à Munich, qui semble avoir été désigné pour jouer un rôle central dans cette "opération russe"). C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre le lien entre la critique persistante de la "solution européenne" (et "turque") soutenue par Merkel à la crise des réfugiés de la part du parti compagnon de la CDU, la CSU bavaroise, et la spectaculaire visite semi-officielle des dirigeants du parti bavarois à Moscou au point culminant de cette controverse 6. Cette fraction préférerait collaborer avec Moscou plutôt qu'avec Ankara. Paradoxalement, les plus forts soutiens de la chancelière sur cette question aujourd'hui ne se trouvent pas à l'intérieur de son propre parti, la CDU, mais chez son partenaire de coalition, le SPD, et dans l'opposition parlementaire. Nous pouvons l'expliquer en partie par une division du travail au sein de la démocratie chrétienne au pouvoir, son aile droite essayant (pour le moment sans grand succès) d'empêcher ses électeurs conservateurs de passer chez les populistes (AfD). Mais il y a aussi des tensions régionales (depuis la Seconde Guerre mondiale, bien que le gouvernement ait été à Bonn et la capitale financière à Francfort, la vie culturelle de la bourgeoisie allemande était principalement concentrée à Munich. C'est seulement récemment que celle-ci a commencé à être de nouveau attirée par Berlin, suivant le déménagement du gouvernement dans cette ville).
En lien avec les vagues actuelles d'immigration, il n'y a pas seulement un antagonisme au sein de l'Europe, bien sûr, mais aussi une collaboration et une division du travail, par exemple entre les bourgeoisies allemande et autrichienne. En initiant la "fermeture de la route des Balkans", l'Autriche a rendu Berlin moins unilatéralement dépendant de la Turquie pour la rétention des réfugiés, renforçant ainsi en partie la position de Berlin dans les négociations avec Ankara 7.
Alors qu'une partie importante du monde des affaires a soutenu la "politique de l'accueil" de Merkel envers les réfugiés l'été dernier, c'était loin d'être le cas parmi les organes de sécurité de l'État, qui étaient absolument horrifiés par cet afflux plus ou moins contrôlé et déclaré dans le pays. Ils ne lui ont toujours pas pardonné pour cela. Le gouvernement français et les autres gouvernements européens n'étaient pas moins sceptiques. Ils sont tous convaincus que des rivaux impérialistes du monde islamique utilisent la crise des réfugiés pour faire entrer clandestinement des djihadistes en Allemagne, d'où ils peuvent partir rejoindre la France, la Belgique, etc. En fait, les agressions criminelles de la nuit du Nouvel An à Cologne ont déjà confirmé que même les bandes criminelles exploitent les procédures d'asile pour placer leurs membres dans les grandes villes européennes. Nul besoin d'être prophète pour prévoir qu'une nouvelle montée en puissance de la police et des services secrets en Europe sera l'un des principaux résultats des développements actuels 8.
Le rapport établit une relation entre crise économique, immigration et populisme politique. Si nous ajoutons le rôle grandissant de l'antisémitisme, le parallèle avec les années 1930 devient particulièrement frappant. Mais il est intéressant, dans cette relation, d'examiner comment la situation en Allemagne aujourd'hui illustre aussi les différences historiques. Le fait qu'il n'y ait pas de preuve formelle, pour le moment, que les sections centrales du prolétariat soient défaites, désorientées et démoralisées comme elles l'étaient il y a 80 ans est la différence la plus importante, mais pas la seule. La politique économique favorisée par la grande bourgeoisie aujourd'hui est la mondialisation, pas l'autarcie, ni le protectionnisme prôné par les populistes "modérés". Ceci évoque un aspect du populisme contemporain encore peu développé dans le rapport : l'opposition à l'Union Européenne. Cette dernière est, sur le plan économique, un des instruments de la mondialisation actuelle. En Europe, elle est même devenue son principal emblème. Par exemple, les négociations sur l'accord commercial TTIP entre l'Amérique du Nord et l'Europe, qui_ profite à la grande industrie et à l'agro-industrie aux dépens des petits fermiers et producteurs dans des régions comme les États du "groupe de Visegrad" (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie), font partie du contexte de la formation, récemment, de gouvernements populistes en Europe du centre-est.
En ce qui concerne la situation du prolétariat, le souci exprimé à la fin du rapport est que nous ne devrions pas seulement regarder les causes résidant essentiellement dans le passé (telles que la contre-révolution qui a suivi la défaite de la Révolution russe et mondiale à la fin de la Première Guerre mondiale) pour expliquer les difficultés de la classe ouvrière à développer politiquement sa lutte dans une direction révolutionnaire après 1968. Tous ces facteurs issus du passé, et qui sont tous des explications profondément justes, n'ont néanmoins empêché ni Mai 68 en France ni l'Automne chaud 1969 en Italie. Nous ne devrions pas non plus partir du principe que le potentiel révolutionnaire exprimé à cette époque, de manière embryonnaire, était voué à l'échec dès le début. Les explications basées unilatéralement sur le passé mènent à une sorte de fatalisme déterministe. Sur le plan économique, ce qu'on appelle communément la mondialisation est un instrument capitaliste d'État, économique et politique, que la bourgeoisie a trouvé pour stabiliser son système et pour contrer la menace prolétarienne, un instrument face auquel le prolétariat, à son tour, devra trouver une réponse. C'est pourquoi les difficultés de la classe ouvrière ces 30 dernières années à développer une alternative révolutionnaire sont intimement liées à la stratégie politico-économique de la bourgeoisie, incluant sa capacité à différer dans le temps une catastrophe (Kladderadatsch) économique pour la classe ouvrière - et ainsi la menace de guerre de classe - dans les vieux centres du capitalisme mondial.
1 La Ligue hanséatique était une alliance commerciale et industrielle en Allemagne du nord qui domina le commerce baltique durant le Moyen Âge et le début de la période moderne.
2 L'ordolibéralisme est une variante allemande de libéralisme politico-économique qui met l'accent sur le besoin pour l'État d'intervenir en faisant en sorte que le marché libre produise à un niveau proche de ses potentialités économiques.
3 Selon Rosa Luxemburg, les zones extra-capitalistes sont centrées sur une production non encore directement basée sur l'exploitation du travail salarié par le capital, que ce soit une économie de subsistance ou une production pour le marché par des producteurs individuels. Le pouvoir d'achat de tels producteurs contribue à rendre possible le déroulement de l'accumulation du capital. Le capitalisme mobilise et exploite aussi la force de travail et les "matières premières" (c'est-à-dire les richesses naturelles) en provenance de ces zones.
4 Les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident.
5 TTIP : en français, "Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement". C'est la proposition d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis.
6 Lors de la conférence, la discussion a aussi fait justement remarquer que la formulation du rapport selon laquelle le monde des affaires en Allemagne soutient, comme un seul homme, la politique de Merkel concernant les réfugiés, est très schématique et comme telle incorrecte. Même le besoin de ressources fraîches en main-d’œuvre par les employeurs varie beaucoup d'un secteur à l'autre.
7 Bien que cette convergence d'intérêts entre Vienne et Berlin, comme souligné dans la discussion, soit temporaire et fragile.
8 L'infiltration djihadiste et la probabilité croissante d'attaques terroristes sont une réalité. Mais cette situation et d'autres sont ainsi utilisées par la classe dominante comme moyen pour créer une atmosphère de peur, de panique et de suspicion permanentes, antidotes à la réflexion critique et à la solidarité au sein de la population ouvrière.
Géographique:
- Allemagne [247]
Personnages:
- Angela Merkel [586]
- Pegida [590]
Récent et en cours:
Rubrique:
L’insurrection de Dublin en 1916 et la question nationale
- 3302 lectures
Il y a cent ans, à Pâques 1916, une poignée de nationalistes irlandais s'emparait de positions stratégiques dans le centre de Dublin et déclarait l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis de l'empire britannique et la création d'une République d'Irlande. Ils réussirent à tenir quelques jours avant d'être écrasés par les forces armées britanniques, qui n'ont pas hésité à bombarder la ville en utilisant les canons de la marine. Parmi ceux qui furent exécutés sommairement après la défaite de l'Insurrection de Pâques, il y avait le grand révolutionnaire James Connolly, l'un des leaders les plus connus de la classe ouvrière en Irlande qui avait fait participer sa milice ouvrière dans la révolte aux côtés des volontaires irlandais nationalistes.
Tout au long de la seconde moitié du 19ème siècle, le soutien à la cause de l'indépendance nationale irlandaise et polonaise avait été une donnée du mouvement ouvrier européen. La tragédie de l'Irlande et la croyance de Marx dans la nécessité de l'indépendance irlandaise ont été utilisées maintes et maintes fois pour justifier le soutien à un certain nombre de mouvements de "libération nationale" contre les puissances impérialistes aussi bien anciennes que nouvelles. Mais le déclenchement de la guerre mondiale en 1914 devait consacrer la prise en compte de changements de la situation mondiale invalidant les anciennes positions. Comme nos prédécesseurs de la Gauche communiste de France le posent : "Seule l'action basée sur les données les plus récentes, en continuel enrichissement, est révolutionnaire. Par contre, l'action faite sur la base d'une vérité d'hier, mais déjà, périmée aujourd'hui, est stérile, nuisible et réactionnaire" 1
Lorsque James Connolly fut exécuté, Sean O’Casey 2 déclara que le mouvement ouvrier avait perdu un dirigeant et que le nationalisme irlandais avait gagné un martyr.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment un internationaliste convaincu et inébranlable comme Connolly a-t-il pu remettre son sort entre les mains du patriotisme ? Nous n’examinerons pas ici l’évolution de son attitude en 1914 : ce sujet est traité dans un article publié dans World Revolution en 1976 3 , qui est toujours valable. Nous ne chercherons pas non plus à démontrer sa profonde hostilité envers le nationalisme interclassiste : les paroles mêmes de Connolly, reproduites dans un article de notre s site,4 sont suffisamment claires. Ici notre objectif est plutôt d’examiner la pensée de Connolly dans le contexte du socialisme international de son époque et la manière dont a évolué l’attitude du mouvement ouvrier sur "la question nationale" entre la vague de soulèvements qui a balayé l’Europe en 1848 et l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914.
Les événements de 1848 – comme Marx allait le montrer plus tard - avaient une double nature. D’une part, c’était des mouvements nationaux démocratiques ayant pour objectif d’unifier des "nations" morcelée en une multitude de petits fiefs et royaumes à demi féodaux : c’était le cas en particulier de l’Allemagne et de l’Italie. D’autre part, ces événements virent, à Paris en particulier, la naissance du prolétariat industriel qui apparaissait pour la première fois sur la scène de l’histoire en tant que force politique indépendante 5. Il n’est donc pas surprenant que 1848 ait posé la question de l’attitude que la classe ouvrière devait adopter sur la question nationale.
C’est en 1848 que parut Le Manifeste communiste où était exposé clairement et sans équivoque le principe internationaliste comme fondement du mouvement ouvrier : "Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. (…) Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! "
Tel est donc le principe général : les ouvriers ne peuvent être divisés par des intérêts nationaux, ils doivent s’unir au-delà des frontières : "[L’] action commune [du prolétariat], dans les pays civilisés tout au moins, est une des premières conditions de son émancipation" (Ibid.) Mais comment mettre en pratique ce principe ? Dans l’Europe du milieu du 19e siècle, il était clair pour Marx et Engels que pour être à même de prendre le pouvoir, le prolétariat devait d’abord devenir une force politique et sociale majeure et que cela dépendait du développement des rapports sociaux capitalistes. Ce développement requérait le renversement de l’aristocratie féodale, la destruction des particularismes féodaux et l’unification de "grandes nations historiques" (cette expression est d'Engels) en vue de créer le vaste marché intérieur dont le capitalisme avait besoin pour se développer et, ce faisant, de développer le nombre, la force et l’organisation de la classe ouvrière.
Pour Marx et Engels, et en général pour le mouvement ouvrier à l'époque, l’unité nationale, la suppression des privilèges féodaux et le développement de l’industrie ne pouvaient avoir lieu qu'à travers un mouvement démocratique : la liberté de la presse, l’accès à l’éducation, le droit d’association – ce sont des revendications démocratiques, dans le cadre de l’État-nation et qui sont impossibles en dehors de lui. Dans quelle mesure ces conditions étaient nécessaires, cela est discutable. Après tout, le développement industriel du 19ème siècle ne se limite pas aux démocraties comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Les régimes autocratiques comme la Russie tsariste ou le Japon sous la Restauration Meiji ont également connu un progrès industriel surprenant au cours de la même époque. Cela dit, le développement de la Russie et du Japon est demeuré essentiellement dépendant de celui des pays démocratiques les plus avancés, et il est significatif que le régime réactionnaire autocratique prussien Junker qui dominait l'Allemagne ait été contraint de respecter un certain nombre de libertés démocratiques.
Ces revendications démocratiques servaient également l'intérêt de la classe ouvrière et étaient importantes pour elle. Comme le dit Engels, elles donnent à la classe ouvrière "un espace" pour respirer et se développer. La liberté d'association a facilité l'organisation contre l'exploitation capitaliste. La liberté de la presse a facilité la possibilité pour les travailleurs de s'informer, de se préparer politiquement et culturellement pour la prise du pouvoir. Parce qu’il n’était pas encore prêt à faire sa propre révolution, le mouvement ouvrier partageait alors les buts immédiats d’autres classes et il existait une forte tendance à identifier la cause du prolétariat, à celle du progrès, de l’unité nationale et du combat pour la démocratie. Voici un extrait d’une intervention de Marx en 1848 lors d’un meeting à Bruxelles qui célébrait le deuxième anniversaire du soulèvement de Cracovie (Pologne) : "La révolution de Cracovie a donné un exemple glorieux à toute l’Europe en identifiant la cause de la nationalité à la cause de la démocratie et à l’affranchissement de la classe opprimée (…) Elle trouve la confirmation de ses principes en Irlande où le parti étroitement national est descendu dans la tombe avec O’Connell et où le nouveau parti national est avant tout réformateur et démocratique" 6
Cependant, la lutte pour l’unité et l’indépendance nationales n’était aucunement considérée comme un principe universel. Ainsi Engels écrivait en 1860 dans The Commonwealth : "Ce droit à l’indépendance politique des grandes subdivisions nationales d’Europe, reconnu par la démocratie européenne, ne pouvait qu’être également reconnu par la classe ouvrière en particulier. En fait, ce n’était rien de plus que reconnaître dans d’autres grandes communautés nationales ayant une grande vitalité le même droit à une existence nationale distincte que les travailleurs de chaque pays réclamaient pour eux-mêmes. Mais cette reconnaissance, et la sympathie vis-à-vis de ces aspirations nationales, se restreignaient aux grandes nations d’Europe, historiquement bien définies ; il y avait l’Italie, la Pologne, l’Allemagne, la Hongrie" 7. Engels continue : "Il n’y a pas de pays d’Europe où il n’y ait pas différentes nationalités sous le même gouvernement. Les Celtes des Highlands et les Gallois se différencient sans aucun doute par la nationalité des Anglais, mais il n’est venu à l’idée de personne de désigner comme nations ces restes de peuples disparus depuis longtemps, pas plus que les habitants celtiques de la Bretagne en France". Engels établit clairement une différence entre "le droit à l’existence nationale des peuples historiques d’Europe" et celle des "nombreux petits vestiges de peuples qui, après avoir joué un rôle sur la scène de l'histoire pendant une période plus ou moins longue, ont finalement été absorbés par les nations puissantes dont la plus grande vitalité leur a permis de surmonter les plus grands obstacles."
L'Irlande était-elle un cas particulier ?
Le rejet d'un principe national s'appliquant à toutes les nationalités amène naturellement à se poser la question suivante : en quoi l'Irlande est-elle est un cas particulier ? Pourquoi Marx et Engels n'ont-ils pas défendu l'idée que l'Irlande soit simplement absorbée par la Grande-Bretagne comme condition de son développement industriel ?
Car il ne fait pas de doute que, à leurs yeux, l'Irlande constituait un "cas particulier" d'une signification particulière. À un moment donné, Marx alla jusqu'à défendre que l'Irlande fût la clé de la révolution en Angleterre tout comme l'Angleterre était la clé de la révolution en Europe.
Il existait deux raisons à cela. D'abord, Marx était convaincu que la spoliation brutale de la paysannerie irlandaise par les propriétaires terriens anglais "absents" 8 constituait l'un des principaux facteurs qui maintenaient en place la classe aristocratique réactionnaire et barrait la voie du progrès démocratique et économique.
L'autre raison, et sans doute la plus importante, était le facteur moral. La domination par l'Angleterre d'une Irlande réticente et le traitement des Irlandais, en particulier des ouvriers irlandais, comme une sous-classe esclave, n'étaient pas seulement injustes et offensants, cela corrompait moralement les ouvriers anglais eux-mêmes. Comment la classe ouvrière anglaise pourrait-elle se soulever contre l'ordre existant si elle restait complice de sa propre classe dominante dans l'oppression nationale des Irlandais ? Tel était le raisonnement de Marx. De plus, tant que les Irlandais étaient privés de leur dignité nationale, il ne manquerait jamais de prolétaires irlandais prêts à s'engager au service de l'armée anglaise et à participer à l'écrasement des révoltes des ouvriers anglais – comme Connolly allait le montrer plus tard.
Cette insistance sur l'indépendance irlandaise s'étendit à la Première Internationale – comme Engels le défendit en 1872 : "Lorsque les membres de l'Internationale appartenant à une nation conquérante demandent à ceux appartenant à une nation opprimée, non seulement dans le passé, mais encore dans le présent, d'oublier leur situation et leur nationalité spécifiques, d' "effacer toutes les oppositions nationales", etc., ils ne font pas preuve d'internationalisme. Ils défendent tout simplement l'assujettissement des opprimés en tentant de justifier et de perpétuer la domination du conquérant sous le voile de l'internationalisme. En l'occurrence, cela ne ferait que renforcer l'opinion, déjà trop largement répandue parmi les ouvriers anglais, selon laquelle, par rapport aux Irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d'aristocratie, comme les blancs des États esclavagistes américains se figuraient l'être par rapport aux noirs.
Dans un cas comme celui des Irlandais, le véritable internationalisme doit nécessairement se fonder sur une organisation nationale autonome : les Irlandais, tout comme les autres nationalités opprimées, ne peuvent entrer dans l'Association ouvrière internationale qu'à égalité avec les membres de la nation conquérante et en protestant contre cette oppression. En conséquence, les sections irlandaises n'ont pas seulement le droit mais encore le devoir de déclarer dans les préambules à leurs statuts que leur première et plus urgente tâche, en tant qu'Irlandais, est de conquérir leur propre indépendance nationale." 9
Pour l'essentiel, c'est la même logique qui amena Lénine à insister pour que le programme du Parti bolchevique inclue le droit des nations à l'auto-détermination : c'était la seule voie, de son point de vue, pour que le rejet par le Parti du "chauvinisme grand-russe" soit rendu explicite et sans équivoque – l'équivalent parmi les ouvriers de Russie des sentiments de supériorité des ouvriers anglais envers les Irlandais.
L'unité nationale au sein de frontières nationales définies, la démocratie, le progrès et les intérêts de la classe ouvrière : tout cela était considéré alors comme évoluant dans la même direction. Même Marx – qu'on ne peut pas soupçonner de fantasmes sentimentaux – a envisagé, peut-être dans des moments d'optimisme imprudent, la possibilité que les ouvriers prennent le pouvoir par la voie électorale dans des pays comme la Grande-Bretagne, la Hollande ou les États-Unis. Mais à aucun moment l'unité nationale ni, en fait, la démocratie n'ont été considérées comme le but final elles étaient des principes simplement contingents sur le chemin du but : "Les ouvriers n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"
Le problème de tels principes contingents est qu'ils peuvent être figés en principes abstraits et invariants tels qu'ils n'expriment plus la dynamique d'avancée d'un réel développement historique mais, au contraire, tirent en arrière ou pire, se transforment activement en obstacles. Ceci, comme nous allons le voir, est ce qui est arrivé à la perspective du mouvement socialiste sur la question nationale à la fin du 19e siècle. Mais d'abord, arrêtons-nous brièvement sur la façon dont Connolly exprimait concrètement les idées dominantes de la Deuxième Internationale.
Bien qu'il ait passé quelques années aux États-Unis où il avait rejoint les IWW 10, Connolly est resté avant tout un socialiste irlandais. Il épousa les méthodes du syndicalisme industriel, contre le syndicalisme étroit des corporations, se joignit à Jim Larkin pour construire le Irish Transport & General Workers Union (ITGWU) et joua un rôle clé dans la grande grève et le lock-out de Dublin en 1913. Mais même à cette époque, aux États-Unis, Connolly fut successivement membre du Socialist Labor Party de Daniel De Leon et du Socialist Party of America et il est juste de dire qu'il consacra sa vie à construire une organisation politique socialiste en Irlande. Il aurait probablement envisagé cette organisation comme étant marxiste si mettre une étiquette théorique sur une organisation l'avait intéressé. Il est certain que son Irish Socialist Republican Party 11 était reconnu en tant que délégation irlandaise de plein droit lors du Congrès de 1900 de la Deuxième Internationale. Mais on n'a quasiment aucune information à partir des écrits de Connolly sur le fait qu'il ait connu ou pris part aux débats de l'Internationale, sur la question nationale en particulier : c'est d'autant plus étonnant qu'il s'était appliqué à apprendre à lire l'allemand assez couramment.
Connolly croyait que le socialisme ne pourrait pour ainsi dire que grandir sur un terrain national. En fait, sa grande étude Labour in Irish History est partiellement dédiée à montrer que le socialisme émerge naturellement des conditions irlandaises ; il souligne en particulier les écrits de William Thompson dans les années 1820 qu'il considère, à juste titre dans une certaine mesure, comme l'un des précurseurs de Marx dans l'identification du travail comme étant la source du capital et du profit.12
Il n'est donc pas surprenant de voir Connolly défendre dans un article de 1909 dans The Irish Nation intitulé "Sinn Fein, socialism and the nation" le rapprochement entre "les membres du Sinn Fein qui sympathisent avec le socialisme" et "les socialistes qui réalisent que le mouvement socialiste doit s'appuyer sur les conditions historiques et actuelles du pays dans lequel ils agissent et en tirer son inspiration, et ne se perdent pas simplement dans un 'internationalisme' abstrait (qui n'a aucun rapport avec le véritable internationalisme du mouvement socialiste)." Dans le même article, Connolly s'oppose aux socialistes qui "observant que ceux qui parlent le plus fort sur "l'Irlande comme nation" sont souvent ceux qui broient sans pitié les pauvres, s'emportent le plus fort contre le nationalisme et, tout en s'opposant à l'oppression en tous temps, s'opposent aussi aux révoltes nationales pour l'indépendance nationale" ainsi qu'à ceux qui "principalement recrutés parmi les ouvriers des villes du Nord-Est en Ulster, ont été sevré de la domination des capitalistes et des propriétaires terriens Tory et de l'Ordre d'Orange, par les idées socialistes et la lutte des classes, mais à qui le nationalisme irlandais ne leur offre rien d'autre qu'un drapeau vert alors que le English Independent Labour Party a offert des mesures pratiques pour les soulager de l'oppression capitaliste… et qui donc vont naturellement là où ils imaginent qu'ils connaîtront un soulagement." (traduit par nous)
Identifier la classe ouvrière avec la nation pouvait, de façon plausible, prétendre se revendiquer de Marx et Engels. Après tout, on peut lire dans Le Manifeste que : "Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore par-là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot." Et on trouve la même idée dans les écrits de Kautsky de 1887 : "Comme pour les libertés bourgeoises, les prolétaires doivent prendre fait et cause pour l'unité et l'indépendance de leur nation face aux éléments réactionnaires, particularistes, comme face aux éventuelles attaques de l'extérieur. (…) Dans l'Empire romain décadent, les antagonismes sociaux s'étaient tant accrus et le processus de décomposition de la nation romaine, si l'on peut la désigner comme telle, était devenu si intolérable que nombreux étaient ceux à qui l'ennemi du pays, le barbare germanique, apparaissait comme un sauveur. On n'en est pas encore là à présent, du moins dans les États nationaux. Et nous ne croyons pas non plus qu'on en arrive là du côté du prolétariat. Certes, l'antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat ne cesse de croître mais simultanément le prolétariat est de plus en plus le noyau de la nation, par le nombre, l'intelligence, et les intérêts du prolétariat et ceux de la nation ne cessent de converger davantage. Une politique hostile à la nation serait donc pur suicide de la part du prolétariat."13
Rétrospectivement, il est facile de voir la trahison de 1914 – la défense de la "culture" allemande contre la barbarie tsariste – derrière cette identification de la nation et du prolétariat. Mais la rétrospective ne peut être d'aucun secours dans le moment présent et le fait est que le mouvement marxiste à la fin du 19e siècle a en grande partie échoué dans la réévaluation de son point de vue sur la question nationale face à la réalité changeante.
Pendant quarante ans, le mouvement socialiste n'a pas vraiment mis en question l'hypothèse optimiste du Manifeste selon laquelle "Déjà les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent". À un certain niveau cela était vrai - nous allons y revenir - puisque dans les années 1890 la "question nationale" allait se trouver au premier plan de la scène politique comme jamais auparavant, précisément en raison de l'expansion phénoménale des rapports sociaux capitalistes et de la production industrielle. Avec le développement des conditions modernes de production, de nouvelles bourgeoisies nationales avec les aspirations nationales modernes apparaissaient en Europe centrale et orientale. Le débat qui en résultait sur la question nationale a pris une nouvelle importance, surtout pour la social-démocratie russe à l'égard de la Pologne et de l'Empire austro-hongrois, à l'égard des aspirations nationales des Tchèques et une multitude de peuples slaves plus petits.
La critique de l'État-nation par Luxemburg
Au cours des trente dernières années du 19e siècle, la façon dont se posait la question nationale devait donc changer.
D'abord, comme Luxemburg l'a démontré dans La question nationale et l'autonomie 14, une fois que la classe bourgeoise a conquis son marché intérieur, elle doit nécessairement devenir un État impérialiste conquérant. Plus encore, dans la phase impérialiste du capitalisme, tous les États sont contraints de chercher par des moyens impérialistes à se faire une place sur le marché mondial. Répondant au postulat de Kautsky d'un capitalisme évoluant vers un "super-État" unique, Luxemburg écrit : "Le 'meilleur' État national n'est qu'une abstraction qu'on peut facilement décrire et définir théoriquement mais qui ne correspond pas à la réalité (…). Le développement du grand État qui constitue la caractéristique saillante de l'époque moderne et qui s'impose par les progrès du capitalisme condamne d'emblée toute la masse des mini et micro nationalités à la faiblesse politique". 15 "Affirmer qu'un État-nation indépendant est, après tout, la meilleur garantie de l'existence et du développement nationaux suppose de manier une conception de l'État-nation comme s'il s'agissait d'un concept parfaitement abstrait. Considéré uniquement du point de vue national, comme manifestation et incarnation de la liberté et de l'indépendance, l'État-nation n'est qu'un résidu de l'idéologie décadente de la petite bourgeoisie d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie – de tout l'Europe centrale dans la première moitié du 19e siècle. C'est un slogan appartenant à la panoplie du libéralisme bourgeois décati " 16 (…) "Les États-nations, même sous la forme de républiques ne sont pas le produit ou l'expression de la "volonté du peuple" comme l'affirme la phraséologie de la théorie libérale et le répète celle de l'anarchisme. Les États-nations sont aujourd'hui les mêmes outils et formes de pouvoir de classe que l'étaient les États précédent, non nationaux et, comme eux, ils aspirent à la conquête. Les États-nations ont les mêmes tendances à la conquête, belliqueuses, oppressives – en d'autres termes des tendances à devenir "non-nationaux". C'est pourquoi se développent constamment parmi les États nationaux des querelles et des conflits d'intérêt et même si aujourd'hui, par miracle, tous les États devenaient nationaux ils offriraient dès le lendemain la même image de guerre, de conquête et d'oppression" 17
Pour les petites nationalités, cela voulait inévitablement dire que la seule "indépendance" nationale possible était de se détacher de l'orbite d'un État impérialiste plus puissant et s'attacher à un autre. Nulle part ceci ne s'est plus clairement illustré que dans les négociations que les Irish Volunteers (précurseurs de l'IRA) ont mené avec l'impérialisme allemand par l'intermédiaire de l'organisation irlandaise aux États-Unis, Clan na Gael, avec Roger Casement qui agit comme ambassadeur auprès de l'Allemagne18. Casement semblait penser que 50 000 troupes allemandes étaient nécessaires pour un soulèvement victorieux, mais c'était évidemment hors de question sans une victoire allemande décisive sur mer. La tentative de débarquer une cargaison de fusils en provenance d'Allemagne à temps pour le soulèvement de 1916 se termina en fiasco mais elle est restée une accusation accablante de la préparation du nationalisme irlandais pour participer à la guerre impérialiste.
Abandonnant l'analyse marxiste de classe sur la guerre impérialiste comme produit du capitalisme quelles que soient les nations, Connolly abandonna également la position de l'indépendance de la classe ouvrière vis-à-vis des capitalistes. On peut voir jusqu'où il est allé dans cette direction à travers la naïveté coupable de sa description idyllique d'une "Allemagne pacifique" combinée avec une attaque à moitié raciste contre les ouvriers anglais "à moitié éduqués" : "Basant ses efforts industriels sur une classe ouvrière éduquée, [la nation allemande] est parvenue dans les ateliers à des résultats auxquels la classe ouvrière d'Angleterre à demi éduquée ne pourrait qu'aspirer. Cette classe ouvrière anglaise entraînée à une servilité d'esclave envers les méthodes empiriques et sous des directeurs mariés à des processus traditionnels se voyant graduellement surclassés par un nouveau rival au service duquel ont été enrôlés les scientifiques les plus instruits coopérant avec les ouvriers les plus éduqués (…). Il était déterminé que, puisque l'Allemagne ne pouvait pas être battue économiquement dans une juste concurrence, elle devait l'être injustement en organisant contre elle une conspiration militaire et navale (…) Cela voulait dire en appeler aux forces des puissances barbares afin d'écraser et d'entraver le développement des puissances industrielles pacifiques." 19 On se demande ce que les dizaines de milliers d'Africains massacrés lors du soulèvement de Herero en 190420, ou encore les habitants de Tsingtao annexé l'arme au poing par l'Allemagne en 1898 auraient pensé des "puissances pacifiques" de l'industrie allemande.
Non seulement les "États nationaux" tendent inévitablement à devenir des États impérialistes et conquérants comme le démontre Luxemburg, ils deviennent également moins "nationaux" comme résultat du développement industriel et de l'émigration de la force de travail de la campagne dans les nouvelles villes industrielles. Dans le cas de la Pologne, en 1900, non seulement le "Royaume de Pologne" (c'est-à-dire la partie de la Pologne qui avait été incorporée au 18e siècle dans l'Empire russe) s'industrialisait rapidement, mais également les régions ethniquement polonaises sous domination allemande21 (la Haute Silésie) et austro-hongroise (Silésie de Cieszyn). De plus, les régions industrielles étaient moins polonaises du point de vue ethnique : les ouvriers de la grande ville d'industrie textile de Lodz étaient principalement d'origine polonaise, allemande et juive avec quelques autres nationalités incluant l'Angleterre et la France. En Haute Silésie, les ouvriers étaient allemands, polonais, danois, ukrainiens, etc. Lorsque Marx appelait à l'indépendance nationale de la Pologne comme rempart contre l'absolutisme tsariste, il n'existait quasiment pas de classe ouvrière polonaise ; désormais, l'attitude des socialistes polonais envers la nation polonaise était devenue une question aigüe et mena à une scission entre le Parti socialiste polonais (Polska Partia Socjalistyczna ou PPS) à droite et la Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie (SDKPiL) à gauche.
Pour le PPS, l'indépendance polonaise signifiait la séparation de la Pologne d'avec la Russie mais, aussi, l'unification des parties de la Pologne historique alors sous domination allemande ou autrichienne, où les ouvriers polonais travaillaient côte à côte avec les allemands (et d'autres nationalités). En effet, le PPS considérait que la révolution prolétarienne dépendait de la "solution" de la "question nationale" – ce qui ne pouvait, comme le disait Luxemburg, que mener à la division au sein de la classe ouvrière organisée en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Au mieux, ce serait un dévoiement, au pire une destruction de l'unité ouvrière.
Pour Luxemburg et pour le SDKPiL, au contraire, toute résolution de la question nationale dépendait de la prise du pouvoir par la classe ouvrière internationale.22 Le seul moyen pour les ouvriers de s'opposer à l'oppression nationale était de rejoindre les rangs de la social-démocratie internationale :en mettant fin à toute oppression, la social-démocratie mettrait également fin à l'oppression nationale : "Non seulement [le Congrès de Londres de 1896] a clairement posé la question polonaise sur le même plan que la situation de tous les peuples opprimés, il a en même temps appelé les ouvriers de tous ces peuples à rejoindre les rangs du socialisme international comme seul remède à l'oppression nationale, plutôt que de tenter ici et là la restauration d'États capitalistes indépendants dans plusieurs pays : c'est la seule façon d'accélérer l'introduction d'un système socialiste qui, en abolissant les oppressions de classe, supprimera toutes les formes d'oppression une fois pour toutes, y compris sous leurs formes nationales."
Quand Luxemburg a entrepris de s'opposer au nationalisme polonais du PPS au sein de la Deuxième Internationale, elle était tout à fait consciente de s'en prendre à une "vache sacrée" du mouvement socialiste et démocratique : "Le socialisme polonais occupe – ou, en tous cas, a occupé – une place unique dans ses rapports avec le socialisme international, une position qui remonte directement à la question nationale polonaise."23 Mais comme elle l'a dit et démontré très clairement, défendre à la lettre en 1890 le soutien apporté par Marx) l'indépendance de la Pologne en 1848, ce n'était pas seulement refuser de reconnaître que la réalité sociale a changé mais c'est aussi transformer le marxisme lui-même, faire d'une méthode vivante d'investigation de la réalité un dogme quasi- religieux desséché.
En fait, Luxemburg est allée plus loin que cela et considérait que Marx et Engels avaient traité la question polonaise essentiellement comme un problème de "politique étrangère" pour la démocratie révolutionnaire et le mouvement ouvrier : "Même au premier coup d'œil, ce point de vue [c’est-à-dire la position de Marx sur la Pologne] révèle un manque éblouissant de relation interne avec la théorie sociale du marxisme. En ne réussissant pas à analyser la Pologne et la Russie comme des sociétés de classe avec leurs contradictions économiques et politiques en leur sein, en les regardant non du point de vue du développement historique mais comme si elles connaissaient des conditions fixes, absolues en tant qu'unités indifférenciées et homogènes, ce point de vue va à l'encontre de l'essence même du marxisme." C'est comme si la Pologne - et bien sûr la Russie aussi - pouvait en quelque sorte être considérée comme “externe” au capitalisme.
Le développement des rapports sociaux capitalistes a eu essentiellement le même effet en Irlande qu'en Pologne. Bien que l’Irlande ait été avant tout un pays d'émigration, la classe ouvrière irlandaise n'était aucunement homogène : au contraire, la région ayant l'industrie la plus développée était Belfast (l'industrie textile et les chantiers navals Harland and Wolff) où les ouvriers étaient issus de la population celte catholique, qui parlait parfois le gaëlique, et des descendants des Protestants, des Ecossais et des Anglais qui avaient été "établis" en Irlande (grâce à la déportation violente de la population d'origine) par Oliver Cromwell et ses successeurs. Et cette classe ouvrière avait déjà commencé à montrer la voie de la seule solution possible à la "question nationale" en Irlande, en unifiant ses rangs dans les grèves massives à Belfast en 1907. Les ouvriers irlandais étaient présents dans toutes les régions industrielles majeures de Grande-Bretagne, en particulier autour de Glasgow et de Liverpool.
La question morale que Marx avait posée – le problème du sentiment de supériorité des ouvriers anglais envers les Irlandais – ne se limitait plus à l'Irlande et aux Irlandais : le besoin constant du capital d'absorber plus de force de travail entrainait des migrations massives des économies agricoles vers les régions nouvellement industrialisées, tandis que l'expansion de la colonisation européenne amenait les ouvriers européens à entrer en contact avec les Asiatiques, les Africains, les Indiens… sur toute la planète. Nulle part l'immigration n'était plus importante que dans la puissance capitaliste constituée par les États-Unis qui connaissaient non seulement un énorme afflux d'ouvriers en provenance de toute l'Europe, mais aussi de la force de travail bon marché en provenance du Japon et de la Chine et, évidemment, la migration des ouvriers noirs des champs de coton du Sud arriéré vers les nouveaux centres industriels du Nord : le legs de l'esclavage et des préjugés racistes constituent encore "une plaie ouvert" (pour utiliser une expression de Luxemburg) en Amérique aujourd'hui. Inévitablement, ces vagues de migration apportèrent avec elles les préjugés, les incompréhensions, le rejet… toute la dégradation morale que Marx et Engels avaient notée dans la classe ouvrière anglaise se reproduisit encore et encore. Plus la migration mélange les populations d'origine différente, inévitablement l'idée "d'indépendance nationale" comme solution au préjugé devenait de plus en plus absurde. D'autant plus que parmi les facteurs qui sous-tendent tous ces préjugés, il en existe un, universel et bien plus ancien que tout préjugé national, qui traverse le cœur de la classe ouvrière : la supposition irréfléchie de la supériorité des hommes sur les femmes. Marx et Engels avaient identifié là un problème réel, un problème crucial même. S'il devait ne pas être résolu, il affaiblirait mortellement la lutte d'une classe dont les seules armes sont son organisation et sa solidarité de classe. Mais il pourrait et ne pourra être résolu qu'à travers l'expérience du travail et de la vie ensemble, à travers la solidarité mutuelle imposée par les exigences de la lutte de classe.
Qu'est-ce qui a amené James Connolly à finir sa vie en se trouvant dans une contradiction aussi flagrante avec l'internationalisme qu'il avait toujours défendu ? Mis à part les faiblesses inhérentes à sa vision de la question nationale qu'il partageait avec la majorité de la Deuxième Internationale, il est aussi possible – bien qu'il s'agisse de pure spéculation de notre part – que sa confiance dans la classe ouvrière ait été brisée par deux défaites majeures : celle de la grève de Dublin de 1913 et l'échec abject des syndicats britanniques à donner à l'ITGWU le soutien adéquat et, par-dessus tout, actif ; et la désintégration de l'Internationale elle-même face au test de la Première Guerre mondiale. Si tel a été le cas, nous pouvons seulement dire que Connolly a tiré des conclusions fausses. L'échec de la grève de Dublin, produit de l'isolement des ouvriers irlandais, a montré non pas que les ouvriers irlandais devaient chercher le salut dans la nation irlandaise mais, au contraire, que les limites de la petite Irlande ne pouvaient plus contenir la bataille entre le capital et le travail qui se menait maintenant sur une scène bien plus vaste ; et la révolution russe, un an seulement après l'écrasement du soulèvement de Pâques, devait montrer que la révolution ouvrière, non l'insurrection nationale, était le seul espoir de mettre fin à la guerre impérialiste et à la misère de la domination capitaliste.
Jens, avril 2016
1Lire à ce sujet l'article Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - La conception du chef génial [594] Revue Internationale n° 33.
2 Sean O’Casey était écrivain et un des plus grands dramaturges de la langue anglaise au 20e siècle. Né dans une famille pauvre protestante de Dublin, il rejoint d’abord la Ligue Gaélique en 1906 avant d’adhérer au mouvement ouvrier. Il est un des fondateurs de l'Irish Citizen Army mais rompt avec Connolly en refusant tout soutien au nationalisme irlandais. Cf. notre article Sean O’Casey et le soulèvement nationaliste irlandais de Pâques en 1916 [595]
3 Republié dans World Revolution 373 et sur notre site en anglais [596].
5Tout du moins en Europe continentale. En fait, le prolétariat était déjà apparu en tant que tel en Grande-Bretagne d’abord avec le mouvement Luddite, puis le mouvement chartiste.
6 https://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/bestand/kmh-bak-2291.pdf [598]. Traduit par nous.
7 https://www.marxists.org/history/etol/newspape/ni/vol10/no07/engels.htm [599]. Traduit par nous.
8 Un des facteurs de l’arriération de la société irlandaise était le fait qu’une grande partie du territoire appartenait à des seigneurs rentiers anglais qui n’avaient cure d'entretenir les exploitations agricoles et encore moins d'investir dans celles-ci, mais se préoccupaient uniquement d'empocher la rente la plus élevée possible.
10 Industrial Workers of the World, syndicaliste révolutionnaire.
11 Connolly est l'un des fondateurs de l'ISRP en 1896. Bien qu'il n'ait probablement jamais compté plus de 80 membres, il eut de l'influence dans la politique socialiste irlandaise par la suite, défendant le principe d'une république d'Irlande avec le Sinn Fein. Le parti vécut jusqu'en 1904 et publia la Workers'Republic.
12 "Si nous devions tenter d'évaluer ce qu'ont apporté Thompson et Marx, nous ne leur ferions pas justice en les opposant, ni en faisant l'apologie de Thompson en vue de rabaisser Marx, comme certains Critiques de Marx sur le continent ont cherché à la faire. Au contraire, nous devons dire que les positions respectives de ce génie irlandais et de Marx peuvent être comparées aux relations historiques entre les évolutionnistes pré-darwiniens et Darwin ; de même que Darwin a systématisé toutes les théories de ses prédécesseurs et a passé sa vie à accumuler les faits pour établir son point de vue et le leur, de même Marx a découvert la véritable ligne de la pensée économique déjà indiquée et a utilisé son génie, sa connaissance et sa recherche encyclopédiques pour l'établir sur des fondements inébranlables. Thompson a balayé les fictions économiques maintenues par les économistes orthodoxes et acceptées par les Utopistes selon lesquelles le profit venait de l'échange et a déclaré qu'il venait de la soumission du travail et de l'appropriation qui en résultait, par les capitalistes et les propriétaires terriens, des fruits du travail des autres. (…) Toute la théorie de la guerre de classe n'est qu'une déduction de ce principe. Mais, bien que Thompson ait reconnu cette guerre de classe comme un fait, il ne l'a pas considérée comme un facteur, comme le facteur de l'évolution de la société vers la liberté. C'est ce qu'a fait Marx et, à notre avis, là réside sa gloire principale et suprême." Labour in Irish History, traduit de l'anglais par nous.
Marx citait toujours scrupuleusement ses sources et accordait du crédit aux penseurs l’ayant précédé. Il cite en effet le travail de Thompson dans le premier tome du Capital, dans le chapitre sur "La division du travail et la manufacture".
13 Die moderne Nationalität, Neue Zeit V, 1887, traduit in Les marxistes et la question nationale, Ed. L'Harmattan, p.125
14 Edition Le temps des cerises
15 La question nationale et l'autonomie. Chapitre "Le droit des nations à l'autodéterminaton". P 40.
16 La question nationale et l'autonomie. Chapitre l'Etat-Nation et le prolétariat. P. 75
17 Idem. P. 77.
18 Voir Ireland since the Famine par FSL Lyons, Fontana Press, pp 340,350
19 Extrait d'un article intitulé "La guerre à la nation allemande [601]" paru dans le journal The Irish Worker. Traduit par nous.
20 Aujourd'hui en Namibie, alors appelé le Damaraland. Un témoin oculaire a rapporté une défaite des Hereros : "J'étais présent quand les Hereros furent battus lors d'une bataille près de Waterberg. Après la bataille, tous les hommes, les femmes et les enfants qui sont tombés entre les mains des Allemands, blessés ou non, ont été mis à morts sans merci. Puis les Allemands ont poursuivi ceux qui restaient et tous ceux qu'ils ont rencontrés sur leur chemin ou dans les prés ont été abattus. La masse des hommes Hereros n'avait pas d'armes et était incapable d'offrir une résistance quelconque. Ils tentaient seulement de partir avec leur bétail." Le haut commandement allemand était tout-à-fait conscient des atrocités et les approuvait.
21 Luxemburg était elle-même très demandée par le SPD allemand comme l'un de ses rares, et certainement meilleurs, orateurs et agitateurs en langue polonaise.
22 Il faudrait peut-être souligner - même si cela dépasse le cadre de cette courte étude - qu'il y avait beaucoup de désaccords et d'incertitudes sur ce qui est identifié sous le terme "nation". Était-ce la langue (comme Kautsky le soutenait), ou était-ce une "identité culturelle" plus vaguement définie comme le pensait Otto Bauer? La question reste valable - et ouverte - à ce jour.
23 Cette citation et celles qui suivent sont tirées de la Préface écrite par Luxembourg à La question polonaise et le mouvement socialiste : celle-ci était un recueil de documents du Congrès de Londres de la 2e Internationale de 1896, où Luxembourg s’opposa avec succès à la tentative du PPS de faire de l’indépendance et de l’unification polonaise, une revendication concrète et immédiate de l’Internationale.
Conscience et organisation:
Personnages:
- James Connolly [602]
Evènements historiques:
- Dublin 1916 [603]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [604]
Rubrique:
IRA: Soldats de l'impérialisme
- 1494 lectures
L'article que nous republions ici est d'abord paru dans World Revolution n° 21 en 1978. Dans le premier paragraphe, il établit le cadre dans lequel les luttes "libération nationale" doivent être considérées : "Les "petites nations" comme l'Irlande, qui voulaient arracher quelque chose pour elles-mêmes, devaient essayer d'exploiter pour leurs propres intérêts le conflit entre les grandes puissances impérialistes". Cette réalité a été identifiée par les révolutionnaires à l'époque de l'insurrection de Pâques, en 1916. Trotsky (dans Nashe Slovo du 4 Juillet 1916) a souligné l'importance militaire de l'Irlande par rapport à l'impérialisme britannique :"une Irlande "indépendante" ne pouvait exister que comme avant-poste d'un État impérialiste hostile à la Grande-Bretagne".
Une telle dépendance est reconnue dans la Proclamation lue au début de l'insurrection lorsqu'il est dit que les nationalistes irlandais ont été "pris en charge par leurs enfants exilés en Amérique et par les alliés courageux en Europe". Ceci est une référence aux fonds reçus de partisans aux États-Unis et les livraisons d'armes en provenance d'Allemagne. La "lutte nationale" avait besoin de soutiens impérialistes.
Pour en savoir plus sur le fond des événements de 1916 voir l'article précédant de cette Revue, L’insurrection de Dublin en 1916 et la question nationale [605].
L'article de 1978 retrace l'évolution de la situation nationale et plus particulièrement le rôle de l'IRA jusqu'au début des années 1970. Si, après presque 40 ans, nous pouvons voir que certaines formulations n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, le cadre général est toujours valide. Et ces formulations posent encore des questions importantes.
Par exemple, le texte parle de "la chute de l'unionisme". Il est vrai que le Parlement unioniste dominé par l'Irlande du Nord a été aboli au début des années 1970, les unionistes pro-britanniques ont néanmoins continué à exister comme force politique jusqu'à aujourd'hui. Mais l'essentiel de leurs positions a changé, surtout après l'accord du Vendredi Saint de 1998.
Le texte dit que "l'IRA ne va pas disparaître". Ceci apparaît contradictoire avec la déclaration de l'IRA de 2005 où elle annonce mettre fin à la lutte armée et selon laquelle ses objectifs seraient poursuivis par des moyens politiques. Cependant, l'aile politique de l'IRA, le Sinn Féin, joue maintenant un rôle de premier plan dans la direction de l'Irlande du Nord, partageant le pouvoir avec les unionistes et constituant ainsi un pilier fondamental de l'appareil politique de l'État capitaliste. Que l'article identifie à tort le républicanisme stalinien comme une force pour l'avenir ne fait qu'illustrer ce fait que l'issue des conflits au sein de la bourgeoisie ne peut être prévue dans les moindres détails. Nous pouvons aussi ajouter que la branche armée du républicanisme n’a pas disparu, même si elle a pris la forme d’une rupture dissidente de l’IRA.
Un autre aspect problématique de l'analyse (qui ne se limite pas à l'Irlande) peut être vu dans l'idée que les difficultés de l'économie irlandaise sont dues au "fait que le marché mondial est déjà divisé entre les grandes puissances capitalistes, et surtout parce que le système capitaliste lui-même empêche un développement mondial des forces productives." La division du marché mondial entre les différents capitaux nationaux n’est pas figée. Au cours des 20 dernières années, par exemple, nous avons constaté un recul de la position relative de l'économie japonaise et des avancées du capitalisme chinois. Cela ne veut pas dire que la décennie de croissance du tigre celtique aurait pu être maintenue, mais que, dans la compétition entre les différents capitaux, la possibilité d'avancées et de reculs de ceux-ci n'est pas exclue. En outre, il y a dans le passage cité l'idée implicite qu'il ne reste pas de possibilités pour l'expansion du capitalisme. Ceci est quelque chose qui a marqué d'autres textes au cours de l'histoire du CCI.
Par-dessus tout, l'article tape juste lorsqu'il se termine avec l’affirmation que seule la guerre de classe est en mesure de s'opposer aux attaques du capitalisme et de ses mobilisations pour la guerre impérialiste.
L'Insurrection de Pâques 1916, typiquement petite bourgeoise dans son désespoir - son héroïsme étant un produit de pur désespoir - a ouvert une nouvelle période de crise sociale et politique en Irlande. Du fait de la brutalité avec laquelle la bourgeoisie britannique a écrasé le soulèvement de Pâques, et également de l'attitude relativement désintéressée et même hostile des travailleurs irlandais (à l'époque, leurs oreilles résonnent encore du son de la défaite de la vague de grèves en 1913) vis-à-vis des objectifs des classes dirigeantes en Irlande, l'histoire avait montré à la bourgeoisie irlandaise qu'était terminée l'ère où la révolution bourgeoise en Irlande était encore possible. La réalité de la Grande Guerre fut la nouvelle partition violente du monde entre les puissances impérialistes en crise. Les "petites nations" comme l'Irlande, qui voulaient arracher quelque chose pour elles-mêmes, devaient essayer d'exploiter pour leurs propres intérêts les conflits entre les grandes puissances impérialistes. Ainsi, après 1916, la politique du Sinn Fein 1 a tourné autour de la lutte pour obtenir l'admission à la conférence de paix d'après-guerre entre grandes puissances, dans l'espoir d'obtenir le soutien américain pour l'indépendance irlandaise contre la Grande-Bretagne. De même, le soi-disant "Mouvement travailliste irlandais" a envoyé des délégués à la misérable conférence de réconciliation social-démocrate à Berne 2, afin de gagner le soutien à la cause irlandaise de la part des bouchers qui en sont les meilleurs avocats en Europe.
Si la Grande-Bretagne avait perdu la guerre, cela aurait pu être une autre histoire mais, étant donnée la situation d'alors, les nationalistes irlandais ont été incapables de persuader quiconque. Leurs fractions les plus radicales étaient soit restées à l'écart de la guerre, soit avaient tenté d'obtenir l'appui de l'impérialisme allemand. Elles se retrouvèrent les mains vides.
Les développements intervenus dans le monde pendant et immédiatement après la guerre avaient ébranlé l'économie irlandaise. La concentration massive du capital et sa centralisation sous la direction de l'État en temps de guerre en Grande-Bretagne et en Europe, la crise économique grave qui a suivi la guerre et le démantèlement de l'économie de guerre, menaçaient de ruine et d'éliminer la petite bourgeoisie liée à la manufacture dans le sud de l'Irlande. Ce fut la lutte désespérée pour la survie de ces couches usées confrontées avec les convulsions d'un capitalisme mondial lui-même agonisant, qui a donné naissance à cet avorton impérialiste remarquable - l'État libre d'Irlande. Dans cette atmosphère, la bourgeoisie du Sud a pu mobiliser la petite bourgeoisie urbaine et rurale pour une guérilla contre les forces britanniques. Cela est devenu ce qui est connu comme étant la guerre d'Indépendance (1919 à 1921).
Pendant cette période, les nationalistes ont façonné le noyau d'un État séparé, basé sur les critères les plus modernes : doté d'un parlement, d'une force de police, de tribunaux, de prisons, et - bien sûr – d'une armée. L'Armée Républicaine Irlandaise (Irish Republican Army)) était basée sur les Brigades Volontaires de 1916, mais était bien disciplinée et fermement attachée au cadre du nouvel État, lui-même constituant un rempart de l'ordre capitaliste. L'IRA est entrée dans le monde avec le sang du prolétariat ruisselant sur ses mains. Dans le Sud et le Sud-Ouest, elle n'a pas hésité à intervenir contre les travailleurs en grève (voir l'article "James Connolly and Irish nationalism [596]" – "James Connolly et le nationalisme irlandais"). Dans les villes, elle brutalisait la population civile, à l'image de ce qu'infligeaient les Black and Tans britanniques 3.
La partition
Au bord de la défaite, les nationalistes furent contraints de signer un traité avec la Grande-Bretagne en 1921 à travers lequel l'indépendance formelle de l'Irlande était accordée. Cependant, le pays devait être partagé, les comtés industriels du Nord-Est ayant leur propre parlement régional et conservant des liens privilégiés avec la Grande-Bretagne.
L'acceptation du traité faillit provoquer un coup d'État militaire. Cela n'a pas eu lieu mais il en est résulté, au sein du gouvernement et de l'armée dans le Sud, une scission avec les extrémistes républicains qui étaient désireux d'obtenir plus de la Grande-Bretagne 4. Et bien que des tentatives aient été faites pour réunifier l'IRA dans le but de lancer une attaque contre l'Irlande du Nord, face à l'impossibilité évidente d'une telle entreprise, l'État libre a glissé dans un combat de factions bourgeoises encore plus sauvage que la "guerre d'indépendance". Ce conflit prit fin avec la victoire, dans le Sud, des forces en faveur du traité (soutenues par la Grande-Bretagne).
Ces événements nous montrent non seulement le caractère absolument antiprolétarien de "l'indépendance et l'unité irlandaises" dans l'époque actuelle, de même que son impossibilité objective. Avant 1916, les unionistes d'Ulster et les nationalistes irlandais du Sud ont été enrôlés dans des groupements armés rivaux et la constitution d'armées paramilitaires. Dans le Nord, Craig - le leader unioniste - avait généreusement envoyé les travailleurs d'Ulster à la boucherie impérialiste afin de montrer son amour du roi et du pays. Mais les unionistes étaient préparés, même si cela en est resté au niveau de parades militaires, pour résister à toute tentative de Londres de subordonner, de quelque manière que soit, leurs intérêts au contrôle de la bourgeoisie irlandaise du Sud. L'industrie de l'Ulster vivait et produisait pour le marché britannique et mondial. Elle n'avait aucun intérêt à soutenir l'économie agricole irlandaise stagnante, ou à devenir la victime des politiques protectionnistes du Sud.
Le développement économique de l'Irlande
En Irlande, seule l'Ulster a participé à la révolution industrielle britannique. Sur le plan politique et économique, seule la bourgeoisie britannique qui avait le contrôle de l'ensemble de l'île aurait pu être capable d'industrialiser le sud de l'Irlande. Mais, dans le Royaume-Uni, l'Irlande a assumé le rôle de fournisseur à bas coûts de produits agricoles et de force de travail. Si la République d'Irlande se trouve exactement dans la même situation aujourd'hui, alors ceci est le résultat non pas de "700 ans de trahisons" - mais du fait que le marché mondial est déjà divisé entre les grandes puissances capitalistes, et surtout parce que le système capitaliste lui-même constitue une entrave au développement mondial des forces productives. Il ne s'agit donc pas d'une simple question irlandaise : nous vivons dans un monde qui s'enfonce dans la faim et la misère, qui nous entraine vers l'autodestruction nucléaire si la résolution de la crise actuelle du capitalisme est laissée à l'initiative de la bourgeoisie.
L'hostilité entre le Nord et le Sud
L'hostilité dramatique entre le Nord et le Sud de l'Irlande reflète les objectifs impérialistes antagonistes entre la bourgeoisie en Ulster et celle du Sud. Face à un marché mondial qui se rétrécit, ces visées politiques ne pouvaient pas être conciliées. Mais ce conflit avait un aspect "positif" pour le capitalisme en Irlande. Les maîtres des ateliers de misère de Belfast, et l'Armée républicaine des propriétaires de Dublin, ont l'assurance que les travailleurs sont pris dans le feu croisé entre eux. Dans les centres industriels du Nord, les ghettos protestants et catholiques sont destinés à entrer en concurrence les uns contre les autres pour quelque emplois, les salaires et le logement misérables. Intimidée ou mobilisée ou derrière l'orange et le vert 5, la solidarité de classe des travailleurs a trouvé face à elle la tyrannie des pogromes. À Belfast, la vague de grèves prolétarienne de 1919 fut rapidement suivie par orgies sanglantes, motivées par le meurtre par l'IRA de travailleurs protestants, et prises en charge par les Volontaires de Carson en Ulster. Plus de soixante morts dans cette vague de barbarie. Dans les années 1930, les gangs républicains et unionistes firent montre de la même suspicion et hostilité face à la lutte unie des travailleurs sans emploi à Belfast.
L'Irlande du Sud sous De Valera
Grâce à la guerre civile, l'aile de l'IRA qui était en faveur du traité s'était imposée comme l'armée officielle de l'État dans le Sud. Peu de temps après, De Valera et ses partisans se sont éloignés de l'IRA extrémiste et ont fondé un parti politique, le Fianna Fail, pour représenter les républicains radicaux au Parlement. Face à l'effondrement économique mondial de 1929, De Valera est arrivé au pouvoir à travers les élections de 1932, armé d'un protectionnisme de fortune et d'un programme capitaliste d'État. Sa victoire électorale devait beaucoup à l'appui que lui avait donné l'IRA. Cependant, bien que les républicains aient pris des mesures radicales pour consolider le capital national en Irlande du Sud, ils ont été incapables de stimuler la croissance industrielle. Leur "guerre économique" avec la Grande-Bretagne n'a fait que conduire au chaos dans le secteur agricole vital orienté vers l'exportation. Mais, malgré le fiasco de cette politique, nous pouvons voir comment les républicains se sont imposés au cours de cette période comme les dirigeants naturels du capital irlandais. Dans les années 1930, De Valera a été en mesure d'utiliser toute la force de l'État – et celle de l'IRA - pour écraser les Fascistes de Blueshirts de O'Duffy essentiellement pro-britanniques. C'est le moment où les rebelles de l'IRA affluèrent dans les rangs des forces de sécurité officielles de l'État et de la police secrète pour lutter contre la menace fasciste. Et quand les Blueshirts ont entrainé les agriculteurs à ne pas verser la rente au gouvernement en vue d'amener De Valera à appeler à cesser la "guerre économique" avec la Grande-Bretagne, ce sont les hommes armés républicains qui ont confisqué le bétail de ces agriculteurs pour le vendre aux enchères.
La "guerre économique" était une réponse désespérée au rétrécissement du marché mondial, après la Grande Crise. Elle ne constituait, ni ne prétendait constituer, une menace pour le contrôle économique de la Grande-Bretagne sur l'Irlande. Et cela, en dépit de la nostalgie actuelle qu'ont les gauchistes irlandais de cette période. Entre 1926 et 1938, le taux de croissance économique en Irlande du Sud avait été d'environ 1% par an. Dans les années de guerre, il avait été nul. Par nécessité, cette politique a dû être abandonnée avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, Londres était prête à faire des concessions dans la période immédiate d'avant-guerre. Chamberlain, quand ce fut nécessaire, évacua les bases navales en Irlande. Plus tard, Churchill allait offrir l'unification de l'Irlande à la bourgeoisie du Sud en échange d'un soutien plus ouvert que la neutralité de la République pendant la Première Guerre. L'idée de placer les industries de guerre de l'Ulster dans le cocon de la neutralité irlandaise semblait tentant pour la bourgeoisie du Sud. Mais comme toujours, l'intransigeance des unionistes d'Ulster - qui tiraient profit de l'économie de guerre britannique - barrait la route à cette solution.
L'héritage de 1916
"La haine de la Grande-Bretagne" a pu être la force qui animait les "hommes de 1916". Mais pour l'IRA, et pour le républicanisme de De Valera, cet héritage a davantage été utilisé comme thème de propagande pour leur régime et comme un moyen de recrutement pour gagner du soutien. Leur but, après tout, n'a jamais été de briser l'impérialisme britannique, ce qui (en dehors du fait que cela était impossible à cette époque) serait revenu à tuer la poule aux œufs d'or pour ce qui les concernait. Le réel but historique mondial des forces bourgeoises derrière la prétendue Révolution irlandaise était soit de cajoler soit de forcer le gouvernement britannique afin qu'il donne aux patrons Unionistes de l'Ulster le coup de pied dans les dents qu'ils avaient mérité. Et la Grande-Bretagne était la seule dans la région qui soit assez forte pour le faire 6. Les républicains ont estimé que s'ils pouvaient réunir le Nord industriel avec le Sud agricole, ils auraient des tracteurs pour labourer leurs champs. Ils pourraient alors espérer se remplumer en envahissant le marché britannique. Le plan était de concilier les intérêts impérialistes de l'Irlande du sud et de la Grande-Bretagne aux dépens de l'Ulster. Cette grande stratégie expansionniste des républicains a été appelée "l'unification de l'Irlande".
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a semblé modifier cette situation. Il a fait miroiter aux républicains la possibilité de vraiment renverser les unionistes eux-mêmes, et de chasser les Britanniques hors de l'Irlande dans le sillage de l'impérialisme allemand. La campagne 1939 de bombardement de l'Angleterre (qui a impliqué l'assassinat des travailleurs britanniques) a été suivie par les plans d'action farfelus élaborés par les antifascistes de l'IRA et le gouvernement nazi en Allemagne 7. Cependant, la bourgeoisie allemande n'a jamais sérieusement envisagé une campagne irlandaise, si bien que l'IRA n'a réussi qu'à provoquer de nouvelles vagues de répression de la part du Fianna Fail contre elle-même. S'en prenant à un ami politique indésirable, le gouvernement démocratique de Dublin n'a jamais hésité à utiliser les camps de concentration et l'assassinat ouvert dans ses mesures répressives contre l'IRA pendant les années 1930 et 1940. Tout comme aujourd'hui, le gouvernement démocratique en Irlande organise une terreur systématique au service de la défense des libertés bourgeoises et civiles même si elle se répand en des flots de larmes pour les victimes des campagnes de terreur à plus petite échelle de l'IRA.
La pulvérisation de l'IRA
Dans les années 1960, l'IRA a été militairement pulvérisée dans le Nord et dans le Sud. Elle avait perdu tout soutien parmi les travailleurs "catholiques", qui précédemment avaient constitué une source importante de chair à canon. Elle a ensuite défendu un programme capitaliste d'État radical pour regagner du soutien et, de ce fait, a commencé à se pencher vers le bloc impérialiste russe. L'économie de l'Irlande du Sud, attardée, avait dû lever ses barrières protectionnistes afin de bénéficier du boom d'après-guerre. Mais avec la fin de la période de reconstruction après 1965, la République d'Irlande s'est trouvée de plus en plus dépendante de ses voisins plus puissants. Si son économie voulait éviter l'effondrement face à la crise économique mondiale, elle devait alors s'intégrer plus étroitement dans le bloc occidental dans son ensemble. Peu après, l'Irlande est entrée dans la CEE.
L'IRA, sauveurs potentiel de la nation, a répondu à la crise - et à la combativité alarmante de la classe ouvrière dans le Sud - en se tournant vers le stalinisme. Mais ce basculement en douceur à gauche s'est trouvé brutalement interrompu par les événements d'Irlande du Nord après 1969. La caste industrielle de l'Ulster, la perdante dans la lutte pour la survie économique, étaient devenue un obstacle réel à la gestion politique et économique de la crise politique par la Grande-Bretagne. La bourgeoisie était consciente qu'elle devait transformer le tas d'ordures unioniste. Mais quand elle a essayé d'y toucher, elle l'a trouvé grouillant de rats en colère. À ce stade, avec les unionistes qui résistaient à toutes les réformes, le gouvernement de Dublin est intervenu, d'abord par son soutien au mouvement des droits civiques dans le Nord et, d'autre part, en proposant de soutenir l'IRA du Nord dans une nouvelle campagne. Mais ce soutien n'a été donné que conditionnellement. L'IRA du Nord devait accepter de se séparer de la direction de l'IRA de l'Irlande du Sud.
Ces mesures ont conduit rapidement à une scission au sein de l'IRA. D'une part Les Provisoires, des gangs meurtriers de droite nationaliste basés dans les ghettos d'Ulster, et d'autre part les staliniens "non-sectaires" du Commandement du Sud, qui comprenaient les officiels. À la suite de son habile manœuvre, le gouvernement de Dublin espérait atteindre deux choses :
1. La préparation de la poussée militaire nécessaire pour renverser les unionistes, le principal obstacle à "l'unification irlandaise".
2. L'affaiblissement de ses adversaires staliniens de l'IRA dans le Sud.
Mais même sans entrer dans le cours des événements récents en Ulster, il est clair que la partie antiprolétarienne jouée par l'IRA dans cet holocauste sanglant marque la continuation de ses traditions bourgeoises. Elle a joué son rôle, sans aucun doute, dans la chute de l'unionisme. En même temps, elle a elle-même reçu une sévère raclée. Malgré la poursuite des attentats à la bombe et des fusillades sauvages, ce sont les forces de sécurité britanniques et Irlandaises - les maîtres des rues et des camps de concentration, les anti-terroristes armés - qui seront les principales forces essayant de contenir le mouvement révolutionnaire du prolétariat sur les îles. Mais, même battue, il est possible que l'IRA ne disparaisse pas, qu'elle reste le symbole vivant d'un impérialisme irlandais frustré. Et en particulier, dans sa forme stalinienne, elle aura un rôle important à jouer dans la lutte à venir contre les travailleurs.
Divisé et démoralisé par plus de cinquante ans de contrerévolution, le prolétariat d'Ulster s'est lui-même trouvé entraîné, dans les ghettos en 1969, à la recherche de la sécurité là où il n'était pas possible de la trouver. Il doit maintenant émerger pour répondre aux attaques incessantes du capitalisme que la crise économique aggrave. Et aussi gigantesque que soit cette tâche, il n'y a pas d'autre issue. Comme militants de la classe ouvrière, nous dénonçons les mensonges cyniques de la bourgeoisie irlandaise et britannique sur les réconciliations et sur un "règlement démocratique". Et nous appelons le prolétariat – du nord et du sud - à reprendre la guerre de classe.
Krespel (décembre 1978)
1 Sinn Fein (nous seuls) : parti politique républicain irlandais. Fondé en 1902 par Arthur Griffith, il est passé sous la direction de De Valera en 1917. Après la "guerre d'indépendance" de 1919 à 1921, une scission a eu lieu en 1922, Griffith et Michael Collins acceptant la partition et la création de l'État irlandais libre, De Valera en opposition avec eux formant un autre parti, le Fianna Fail.
2 La Conférence de Berne en 1920 regroupait tous les partis "socialistes", comme le Parti travailliste indépendant de Grande-Bretagne qui avait rompu avec la 2ème Internationale quand elle capitula face l'effort de guerre, mais qui refusa de se joindre à l'Internationale communiste. L'Internationale communiste avait dénoncé cette initiative comme étant une tentative de ressusciter la 2ème Internationale dans l'esprit sinon dans le nom.
3 "Black and Tans" (ainsi nommés pour la couleur de leurs uniformes). Combattants engagés par le gouvernement britannique dès 1920 afin d'aider la police royale irlandaise et l'armée britannique à lutter contre les indépendantistes.
4 Afin d'obtenir mieux, De Valera agissant pour les extrémistes avait même suggéré que la Grande-Bretagne devait déclarer une "doctrine Monroe" concernant l'Irlande, en garantissant que le peuple d'Irlande serait le seul à avoir le droit de décider de son propre destin.
5 Les couleurs respectives de l'Ordre d'Orange et des républicains.
6 Il y avait essentiellement deux tendances politiques impliquées ici, représentées par le Fianna Fail espérant manœuvrer, et l'IRA espérant forcer la bourgeoisie britannique à restituer l'Ulster.
7 A un moment - en 1942 - l'IRA a demandé "Que comme un prélude à une coopération entre Óglaigh noh-Eireann et le gouvernement allemand, le gouvernement allemand déclare explicitement son intention de reconnaître le Gouvernement provisoire de la République d'Irlande (ie. IRA) comme étant le gouvernement de l'Irlande dans toutes les négociations d'après-guerre concernant l'Irlande".
Géographique:
- Irlande [606]
Personnages:
- Eamonn de Valera [607]
- Sinn Fein [608]
Evènements historiques:
- Guerre civile irlandaise [609]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [604]
Rubrique:
Revue Internationale numéro spécial: l'impérialisme en Orient
- 818 lectures
Depuis un bon nombre d'années déjà, il est devenu évident que la montée de la Chine en tant que puissance économique et militaire pose des questions de fond pour l'analyse de la situation mondiale. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer un numéro spéciale de le Revue internationale à une analyse de l'impérialisme d'Orient depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, afin de situer les évènements d'aujourd'hui dans leur contexte historique.
Cette étude fut publiée en anglais en 2012, et certains des questions posées ont été dépassées depuis par la réalité concrète. Cela n'empêche pas les analyses historiques et actuelles de rester largement valables.
Le capitalisme ascendant : avant la Première Guerre mondiale
- 1230 lectures
Rubrique:
Japon: une nouvelle force capitaliste apparaît
- 1099 lectures
Entre le milieu du 17e siècle et celui du 19e, le Japon s’est isolé du reste du monde. Aucun étranger n’a alors le droit d’entrer dans le pays, aucun japonais n’est autorisé à le quitter sans permission, le commerce avec les autres pays est limité à quelques très rares ports. Même s’il existe une faible dynamique, très limitée, de développement d’un marché au sein du pays, la vraie rupture historique se produira lorsque le pays, après presque deux siècles d’isolement volontaire, s’ouvri par la force au capitalisme. Comme Marx et Engels l’ont analyfsé dans le Manifeste Communiste de 1848, "à la place de l’isolement d’autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations… Sous peine de mort, elle (la bourgeoisie) force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production" (premier chapitre : Bourgeois et Prolétaires).
En 1835, rapidement après que la première guerre de l’opium ait ravagé la Chine, des navires de guerre américains (États-Unis) apparaissent pour la première fois dans les eaux japonaises et imposent surtout le libre commerce. La résistance japonaise contre la pénétration de commerçants étrangers persistant, des bateaux hollandais, français et anglais bombardent la côte japonaise. Après cette agression militaire unie, qui montre qu’à cette époque, les nations capitalistes étrangères peuvent encore œuvrer ensemble à l’ouverture du Japon, la classe dominante japonaise renonce à toute résistance aux capitalistes étrangers et commence rapidement à introduire de profonds changements politiques et économiques.
Au Japon, l’ordre féodal-absolutiste désuet du shogunat de Tokugawa (la famille féodale régnante) est remplacé par un État très uni sous le gouvernement de l’empereur Mikado en 1868. "Le capitalisme n’y est pas parvenu au pouvoir parce qu’une bourgeoisie en ascension avait vaincu la classe féodale par une lutte révolutionnaire, mais parce qu’une classe féodale s’était transformée en une bourgeoisie"1. Bien qu’il y ait "des forces pour un changement de l’absolutisme féodal vers le capitalisme, [elles étaient] trop faibles pour entraîner une révolution".2. Elles ont dû s’appuyer sur l’ouverture au capitalisme de "l’extérieur". Les sages-femmes qui aident à l’accouchement du capitalisme au Japon sont les capitalistes étrangers qui donnent un grand élan à la bourgeoisie japonaise montante.
La transition entre société féodale et bourgeoise ne s’accompagne pas d’une révolution politique. À la différence de la plupart des pays européens, où le capital privé joue un rôle de locomotive dans l’économie et où le libéralisme propage une politique de laisser-faire, au Japon, c’est l’État japonais qui va jouer un rôle dominant dans l’avancée du capitalisme. En 1868, l’empereur nomme la première commission au plan. La classe dominante japonaise commence à étudier systématiquement les conditions du fonctionnement capitaliste dans les autres pays, avec pour objectif de les copier et de les appliquer aussi efficacement que possible.3
Quelques bateaux seulement auront suffi pour que les nations capitalistes étrangères réalisent leur pénétration au Japon. À la différence des autres pays d’Extrême-Orient, le Japon n’est pas occupé ; aucune armée étrangère n'est stationnée sur les îles.
En même temps, comme le Japon est un groupe d’îles presque sans matière première, il doit s’approvisionner en ces matières auprès d’autres pays. Le pays le plus près du Japon est la Corée – derrière laquelle il y a la région Mandchoue de la Chine et de la Russie. Au sud, il y a une autre île, Taiwan. Alors que la plupart des États européens ont dû rapidement diriger leur fièvre de conquêtes vers des régions très lointaines (souvent sur d’autres continents comme en Afrique, Asie, Amérique du Sud), le Japon a trouvé sa zone d’expansion dans la région immédiate. Dix ans seulement après avoir été ouvert par les capitalistes étrangers, le Japon s’attaque à Taiwan. En 1874, le Japon occupe la pointe sud de Formose.4 Mais ce premier gros effort pour s’étendre alarme l’Angleterre et la Chine qui envoient 11 000 soldats dans la partie sud de Taiwan. À cette époque, le Japon n’a pas encore une puissance militaire suffisante pour s’engager dans un combat plus large et se retire donc de Taiwan.
Peu après, le Japon commence à orienter ses ambitions vers la Corée. En 1855, le Japon et la Chine signent un traité, selon lequel aucun pays n’enverra de troupes en Corée sans l’assentiment des autres pays. Afin de sortir de cette impasse"" temporaire, le Japon décide de construire une flotte apte à contrôler la mer de Chine.
Comme nous le verrons, le Japon a engagé une première guerre avec la Chine en 1894 et dix ans après avec la Russie, en 1904. En gros, donc, à peine quatre décennies après que le capitalisme se soit installé au Japon, ce pays est entré en guerre avec deux de ses rivaux dans la région.
Ne subissant aucune entrave de la part d’une puissance coloniale dominante, le Japon en est rapidement devenu une, et même s’il est arrivé tard sur le marché mondial, il devient rapidement la principale force dans la région, et devenir le principal rival des autres puissances présentes dans la région.
En conséquence, ses dépenses militaires sont constamment en augmentation. À la fin du XIXème siècle, le Japon commence à financer son armée avec des emprunts alimentés par des fonds anglais et américains. 50 % des prêts étrangers vont dans la guerre et l’armement. Les dépenses gouvernementales triplent entre 1893 et 1903, et doublent de nouveau au cours de la guerre russo-japonaise de 1905. Sa flotte moderne est composée de bateaux de guerre fabriqués en Grande-Bretagne, ses canons sont fabriqués par la firme allemande de Krupp. Quand le Japon vainc la Chine dans la guerre de 1894, cela lui permet d’imposer un poids financier énorme à son voisin, le forçant à payer 360 millions de yens, dont une grande partie ne servira qu’à financer un programme guerrier de développement de l’armement. La dette nationale s’élève de 235 millions de yens en 1893, à 539 millions en 1903, pour grimper en flèche à 2,592 millions de yens en 1913, résultat d’une grande émission d’obligations pour la guerre.5
Le Japon devient ainsi le plus gros requin impérialiste dans la région déjà dans la période ascendante du capitalisme. Ce pays n’aurait pas pu accéder à cette position dominante sans le rôle central de l’État et de ses orientations militaires.
1Anton Pannekoek, Les conseils ouvriers, vol II, Livre 4, “L’impérialisme japonais”, p103, Ed Spartacus
2Pannekoek, op.cit., p103
3Il n’y avait presque pas d’industrie privée pendant cette première phase du capitalisme japonais. Le premier ministère de l’industrie est fondé en 1870. Au début des années 1870, la monnaie papier est introduite en 1872, la première ligne de chemin de fer s’ouvre entre Tokyo et Yokohama (c’est à dire 40 ans après les premières lignes en Grande Bretagne). Les routes du pays, qui étaient barrées par les potentats provinciaux, s’ouvrent au trafic général. Les octrois sont abolis. En 1869, les quatre classes (Samouraïs, paysans, commerçants et artisans) sont toutes déclarées égales, les différences d’habillement entre les classes sont abolies, les paysans peuvent cultiver ce qu’ils choisissent. Pour plus d’informations, voir : Anton Pannecoek : Les Conseils Ouvriers.
4L’île de Taiwan était connu, pour les européens, sous le nom de Formose, du portugais Ilha Formosa, “ la belle isle ”.
5"En conséquence surtout de la guerre sino-japonaise, et d’un armement croissant et d’entreprise coloniale qui suivent son éveil, les dépenses du gouvernement national triplent entre 1893 et 1903. Elles ont encore plus que doublé au cours de la guerre russo-japonaise (…) Pour financer ce fardeau, les impôts sont progressivement augmentés. L’indemnité de 360 millions de yens obtenue de la Chine en 1895 est aussi largement utilisée pour financer un programme de développement de l’armement entre les guerres. Ces ressources s’avèrent néanmoins inadéquates, d'où le recours à de vastes emprunts. La dette nationale va s’élever de 325 millions de yens en 1893 à 539 millions en 1903. Elle grimpe ensuite en flèche à 2592 millions de yens en 1913…50 % environ du budget total du gouvernement en 1913 est consacré à l’armée et à la marine, au service des pensions militaires et des dettes de guerre… En fait, les dépenses militaires "extraordinaires" causées par la guerre avec la Russie sont largement assumées au moyen d'emprunts à Londres et à Paris. Avant la guerre, (i.e., en 1903), le total des prêts nationaux japonais provenant de l’étranger ne s’élève qu’à 98 millions de yens. À la fin de 1913, ils vont monter jusqu’à 1525 millions (…). Les prêts étrangers ont un effet inflationniste dans le pays." (William Lockwood, The Economic Development of Japan, p. 35. Princeton, 1954).Voir aussi: W.W. Lockwood, The state and economic enterprise in Japan, Princeton, 1969).
Géographique:
- Japon [164]
Chine: une société en décomposition grande ouverte à l’opium et à la guerre
- 1391 lectures
Quand le capitalisme pénètre ces pays, la Chine aussi bien que le Japon sont gouvernés par des dynasties déclinantes. Comme au Japon, le mode local de production en Chine est incapable de concurrencer le capitalisme. La dynastie mandchoue n’est pas capable au niveau commercial, et encore moins au niveau militaire, de résister à la pénétration capitaliste étrangère. Comme au Japon, la marche triomphante du capitalisme n’a pas été imposée par une classe capitaliste commerçante à l’intérieur du pays, mais le capitalisme a été en grande partie imposé de l’extérieur.
Dans le cadre de cet article, nous n’avons pas la place d’entrer dans les détails des raisons de la profonde stagnation de la société chinoise. Dans les années 1850, Marx et Engels commencèrent à analyser les racines profondes de ce phénomène : "La Chine, un de ces empires asiatiques vacillant, qui l’un après l’autre tombent sous l’emprise de l’esprit d’entreprise du courant européen, était si faible, si désagrégée, qu’elle n’avait même pas la force de se sortir de la crise d’une révolution populaire, si bien qu’une vive indignation s’est transformée en maladie chronique et probablement incurable, un empire si décomposé qu’il en était presque incapable de gouverner son propre peuple ou d’offrir une quelconque résistance à ses agresseurs étrangers."1.
Dans son œuvre, Marx, afin de comprendre les raisons pour lesquelles les grandes civilisations non-européennes n’avaient pas évolué vers le capitalisme, a mis en avant le concept d’un mode asiatique de production.2
Deux guerres de l’opium ont joué un rôle crucial dans l’ouverture de la Chine au capitalisme.
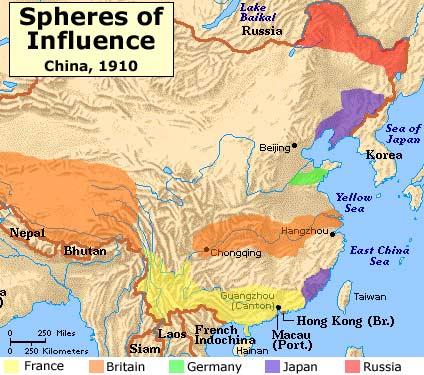 Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.
Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.
Le pays européen le plus avancé, l’Angleterre (rejointe plus tard par la France) a utilisé la résistance de la classe dominante chinoise à "l’invasion" massive d’opium comme prétexte pour envoyer des troupes. L’Angleterre, la nation "la plus civilisée" de l’occident devient le plus grand trafiquant d’opium et utilise la prohibition de la drogue par les autorités chinoises pour déclencher deux guerres.
Dans les deux guerres de l’opium (1839-42 ; 1856-60), l’Angleterre (avec la France à ses côtés dans la deuxième guerre) inflige une défaite militaire écrasante aux troupes chinoises, accompagnée d’une série de massacres.
Le résultat de la victoire militaire écrasante de l’Angleterre dans la première guerre de l’opium, fut qu’on lui accordât des concessions sur Hong Kong et cinq zones commerciales le long de la côte. Mais la seconde guerre de l’opium entraîne déjà un changement qualitatif. À cette époque ce que tous les pays européens recherchent avant tout sont de nouveaux marchés pour les produits manufacturés en Europe. Le résultat de la seconde guerre est donc d’ouvrir la Chine non seulement à l’opium mais surtout aux produits commerciaux européens.
"L’isolement complet a été la première condition de la préservation de la Chine antique. Cet isolement ayant pris fin brutalement grâce à l’Angleterre, la dissolution dut suivre aussi sûrement que celle d’une momie soigneusement préservée dans un cercueil hermétiquement scellé quand elle est mise à l’air libre.".3 Marx ajoutait: “nous n’entendons rien au sujet du commerce illicite d’opium, qui alimente chaque année le trésor britannique aux dépens de la vie humaine et de la morale".4
Comme partout, l’imposition du capitalisme s’accompagne de violence. "Chacun des plus de quarante ports affermés chinois (treaty-ports) a été acheté par des flots de sang, des massacres et des ruines".5 Les capitalistes étrangers (sous le mot d’ordre du libre-échange et accompagnés par l’opium et la guerre) abolissent les restrictions de la Chine gouvernée par les Mandchous pour permettre le développement capitaliste. À la différence du Japon, qui lui aussi a été ouvert violemment au capitalisme par les pays capitalistes étrangers, mais qui n’a jamais été occupé ou entraîné dans une série de guerres, la Chine va être divisée entre sphères d’influence.
Pendant la période 1860/70, tous les morceaux épars de l’empire chinois sont saisis par des puissances étrangères. Vers la fin du 19ème siècle, la Chine a perdu toute l’Indochine au profit de la France, la Birmanie à celui de la Grande-Bretagne, la Corée à celui du Japon, tous les territoires au nord du fleuve Amour vont à la Russie, le Tibet à la Grande-Bretagne, la Mandchourie est disputée par la Russie au Japon. Pour la Chine elle-même, ce n’est pas mieux que si elle avait été annexée.
A la fin du 19ème siècle, la Grande-Bretagne contrôle fortement toute la vallée du Yangtsé (le Fleuve Bleu), le centre de la vie économique de la Chine, la France s’approprie le Hunan, l’Allemagne s’empare de Shantung et de Tsingtao. Les États-Unis ne demandent aucune concession mais ils soutiennent "la “politique de la porte ouverte”" vis-à-vis de la Chine.
Il se développe au sein de la Chine une sorte "de imperium in imperio", (d’empire dans l’empire) sous la forme de colonies étrangères. De petites parties du territoire chinois prennent la forme d’autant d’avant-postes de l’impérialisme.
Alors que l’Inde est sous la seule coupe britannique (les anglais ayant battu les français en 1757), la Chine devient rapidement une sorte de colonie de l’impérialisme international, avec différents pays essayant d’en prendre des morceaux. Mais à cause de la présence de tant d’aspirants, la possibilité d’annexion de la Chine par n’importe quelle puissance à elle seul est alors hors de question et la colonisation de la Chine prend la forme de différentes "sphères d’influence". La résistance à l’annexion, en Chine et hors de la Chine, ne peut plus venir de la Chine elle-même, son annexion formelle est bloquée par la rivalité entre les puissances impérialistes.
Ainsi, jusqu’au début des années 1890, la division du territoire chinois en zones d’influence a pu se passer sans grand problème entre les rivaux européens. Cependant, lorsque le niveau des rivalités impérialistes, spécialement entre les pays européens, a atteint de nouvelles proportions et que ceux-ci ont tourné leur attention de l’Afrique en faveur de l’Europe et de l’Asie, le niveau de rivalités en Extrême-Orient prend une forme qualitativement nouvelle. Alors que les pays capitalistes étrangers ont imposé le capitalisme en Chine, le développement de celui-ci est en même temps entravé parce que ces mêmes puissances sont surtout intéressées à piller et à vendre leurs marchandises aux dépens des concurrents chinois. Elles freinent le développement d’une industrie chinoise autonome, barrant la route à toute réelle industrialisation. Ainsi, alors qu’aucune fraction de la classe dominante chinoise n’est capable d'impulser un développement capitaliste, les compagnies étrangères, à la fin du 19ème siècle, contrôlent presque la totalité de l’économie chinoise.
1Le succès de la politique russe en Extrême Orient. 1858, Marx-Engels Werke 12, p. 622 (la traduction est de nous).
2L’analyse des sociétés précapitalistes a été entreprise dans plusieurs textes par Marx et Engels. Comme leurs investigations évoluaient, leurs concepts ont aussi graduellement changé. Pour une analyse plus détaillé voir :Perry Anderson dans ‘Lineages of the Absolutist State’", Londres, 1974. Voir aussi Revue Internationale n°135, "Quelle méthode scientifique pour comprendre l’ordre social existant, les conditions et les moyens de son dépassement ? (II)" pour une discussion sur cette question.
3Marx, “Revolution in China and Europe”, 14/6/1853, New York Daily Tribune (la traduction est de nous)
4 “English cruelties in China”, écrit le 22/03/1857, publié le10/04/1857.
5Rosa Luxembourg, L’accumulation du capital, “ Les conditions historiques de l’accumulation ”
Géographique:
- Chine [610]
La révolte des Taiping – la bourgeoisie incapable de faire sa révolution
- 2054 lectures
Sur fond des résultats démoralisants de la guerre de l’opium, d’un ordre social en faillite, de révoltes paysannes contre la famine et le fardeau intolérable des impôts, d’une faillite irréversible de la machine d’État et de la pénétration de compagnies capitalistes étrangères, les paysans aussi bien que d’importantes factions des classes possédantes, qui n’avaient aucune allégeance vis-à-vis de la dynastie mandchoue au pouvoir, se lancent dans une révolte en 1850 – connue aujourd’hui sous le nom de révolte des Taiping.
 Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.
Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.
Souvent à l’instigation de sociétés secrètes, les révoltes commencent dans le sud du pays pour se répandre plus au nord. Le mouvement reçoit rapidement le soutien de centaines de milliers de paysans et d’opposants à la dynastie mandchoue. Un État séparé est même créé en 1851 – Taiping Tienkuo ("l’empire céleste de la paix") dont Hong Xiuquan est proclamé "empereur céleste". Ce mouvement établit une monarchie avec une coloration fortement théocratique, dirigée contre le pouvoir et les privilèges de l’aristocratie terrienne. Exprimant les aspirations de la paysannerie à lutter contre son exploitation, l’abolition de la propriété privée est déclarée, seuls les entreprises financières et les silos à grains collectifs sont autorisés, la propriété commune de la terre est proclamée, la terre cultivable est collectivisée et n’est plus considérée comme propriété privée, les impôts sont diminués, l’égalité de hommes et des femmes proclamée, le bandage des pieds interdit, le choix du mari ou de la femme devient libre, la consommation d’opium, de tabac et d'alcool interdite. Les artisans produisent des articles qui sont distribués sous le contrôle de l’État.
En 1852/53, le régime Taiping fait avancer rapidement ses troupes au Hunan et conquiert Nankin, proclamant cette ville capitale de leur État, qu’ils gardent de 1853 à 1864. Les rebelles Taiping lèvent une armée de plus de 50 000 soldats qui contrôle de vastes régions du sud et du sud-est de la Chine. Cependant, en 1864, l’édifice Taiping s’effondre. Plus de 20 millions de personnes sont tuées dans une série de guerres sanglantes,. Les troupes anglaises et françaises jouent un rôle décisif dans l’écrasement du mouvement par la dynastie mandchoue. Le communiste indien, M. N. Roy mentionne à juste titre certaines des raisons de la défaite quand il écrit : "la faiblesse du mode de production capitaliste, l’immaturité aboutissant à une absence pratique du prolétariat, qui provenait aussi du développement inadéquat du mode de production capitaliste et enfin l’intervention étrangère – tout cela a contribué à la défaite du premier grand mouvement qui tendait objectivement à la création d’une Chine moderne. ” 1. Roy voyait cependant un trop grand potentiel révolutionnaire dans ce mouvement. Dans un article précédent de la Revue internationale 2, nous avons traité des limites du mouvement Taiping, sur lesquelles nous ne revenons pas ici en détail.
Marx fit l’analyse suivante du mouvement et de ses limites : "Ce qui est original dans cette révolution chinoise, c’est son sujet. Ils ne savaient pas quelle était leur tâche, sinon changer de dynastie. Ils n’avaient pas de mots d’ordre. Ils sont une abomination encore plus grande pour les masses populaires que pour les anciens dirigeants. Leur destin semble n’avoir été rien de plus que de s’opposer à la stagnation conservatrice avec un règne de destruction grotesque et répugnant dans sa forme, une destruction sans base nouvelle ou en rien constructive. (…) La révolte Taiping est le produit d’une vie sociale fossilisée".3. Incapable de se débarrasser du poids de l’ordre social pourrissant, incapable de transformer la pénétration du capitalisme imposé par les pays étrangers en un puissant pour un développement capitaliste plus large, la classe dominante en Chine ne pouvait pas faire une révolution bourgeoise qui aurait pavé la route d’un développement sans entrave du capitalisme. La Chine a été transformée en handicapée au 19ème siècle – laissant le pays avec des chaînes qu’il allait traîner jusqu’au 20ème siècle.
1Roy, Revolution and counter-revolution in China, New Delhi, 1946.
2Revue Internationale, n° 81 et 84, "Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste"
3Marx, 7/7/1862, dans Die Presse, "On China" (la traduction est de nous).
Géographique:
- Chine [610]
Evènements historiques:
- Révolte des Taiping [611]
La révolte des Boxer de 1900: un prétexte à l’intervention étrangère
- 1187 lectures
L’écrasement de la révolte Taiping a conduit à une aggravation drastique de la situation des paysans. Un ensemble de problèmes économiques contribuèrent à l’explosion de ce qui est connu comme la révolte des Boxers : l'accroissement du poids des impôts, la détérioration des conditions de vie de millions de paysans et artisans (contraints de rejoindre les villes n'ayant pourtant qu’un très faible développement industriel) , comme conséquence de l’importance croissante de l'importation de marchandise étrangères.
 En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.
En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.
Quand toutes les missions étrangères sont menacées par les pilleurs, les impérialistes étrangers unissent leurs forces pour réprimer le mouvement. En même temps, cette intervention commune pose la question d’un ordre hiérarchique parmi les impérialistes, parce qu’il est clair que la puissance qui prendrait la tête de la répression du soulèvement pourrait devenir la force dominante à Beijing. La bousculade pour être à la tête de la répression du mouvement révèle un nouveau niveau qualitatif des rivalités inter-impérialistes.
Comme Rosa Luxembourg dans Réforme ou Révolution l’avait déjà dit en 1889: "Si actuellement, la Chine devient le lieu de conflits menaçants, pour le capitalisme européen, la lutte n’est pas seulement pour la conquête de la Chine mais fait complètement partie des antagonismes entre pays européens qu’ils ont "transférés" en Chine et qui explosent maintenant sur le sol chinois".1
La Grande-Bretagne veut que le Japon prenne la tête parce qu’elle espère que le Japon fera contrepoids à la Russie. La Russie s’oppose fortement à l’intervention japonaise. À la fin, la Russie a accepté la proposition allemande d’une intervention conduite par les allemands, puisque ni la Grande-Bretagne ni le Japon n’auraient été d’accord pour une direction russe.
Mais avant que les troupes allemandes n’atteignent Beijing, les troupes russes ont déjà commencé (et presque complètement achevé) le massacre. La Russie a donc utilisé la révolte des Boxers comme un levier pour accroître son influence en Chine. En octobre 1900, la Russie occupe toute la Mandchourie, de façon à contrer l’influence croissante des puissances européennes occidentales en Chine. Mais la Russie est incapable de bloquer la pénétration des puissances européennes et du Japon. Face au danger de voir la Chine découpée en morceaux par les puissances européennes, en particulier face aux efforts de la Russie pour se saisir de grandes parties de la zone nord de la Chine, l’Allemagne et la Grande-Bretagne négocient en août 1900 dans le but de maintenir l’intégrité territoriale de ce pays et le principe de la "porte ouverte" sur celui-ci. La Grande-Bretagne espère utiliser les allemands contre la Russie en Mandchourie, l’Allemagne en retour vise à pousser la Grande-Bretagne et le Japon dans les hostilités contre la Russie. La présence de la Russie s’accroissant, le Japon et la Grande-Bretagne signent une alliance en juin 1902, avec l’objectif de limiter la menace russe. Alors que tous les États européens s’accordent sur la proposition des États-Unis d’une "porte ouverte" sur la Chine, la Russie, qui a beaucoup à perdre dans cette proposition, vote contre. Aussitôt après, les États-Unis rejoignent l’alliance anglo-nipponne contre la Russie. Une des caractéristiques permanentes de la situation depuis le début du 20ème siècle est donc l’opposition des États-Unis au renforcement de la Russie ou du Japon. Ils se sont toujours posés en «défenseur" de pays faibles (la Chine dans ce cas) pour empêcher la Russie ou le Japon de devenir trop puissant.
En ce qui concerne la Chine, à la suite de l’écrasement de la révolte des Boxers, les capitalistes étrangers contraignent l’État chinois à payer 450 millions de taels de "compensation" aux pays étrangers, alors qu'ils l’avaient déjà forcé au paiement d’une somme de 200 millions de taels au Japon après la défaite chinoise dans la guerre contre le Japon en 1894.
En 1911, l’empereur de Chine est déposé et la première république chinoise proclamée. Formellement, la bourgeoisie s’empare du gouvernement pour régner sur le pays. Mais bien qu’une république bourgeoise soit proclamée, cela ne signifie pas que le pays ait accompli une révolution bourgeoise, menant à la formation d’une nation capable d’être concurrentielle sur le marché mondial. En réalité, un puissant développement industriel ne démarre pas. En lieu et place de la constitution d’une nation "unie", des tendances centrifuges prennent le dessus, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article.
Quoique formellement au pouvoir, la bourgeoisie n’est plus une classe révolutionnaire. Incapable d’engager le pays dans une grande industrialisation, la classe dominante ne peut que pousser l’ensemble de la nation dans la guerre et la destruction.
1Rosa Luxembourg, Réforme ou Révolution, chapitre sur les politiques douanières et le militarisme. Ce passage n’apparaît dans aucune des traductions en anglais ou en français que nous avons pu consulter, ni même dans la version allemande publiée sur marxists.org. Il n’est reproduit que dans la version définitive de ses œuvres complète : Gesammelte Werke, premier tome, p. 397.
Géographique:
- Chine [610]
Evènements historiques:
- Révolte des Boxers [612]
Le Conflit en Corée
- 891 lectures
A l’époque où le capitalisme européen et américain commence à pénétrer au Japon et en Chine, ces pays capitalistes tentent aussi d’entrer en Corée.
Le développement de la Corée est sous beaucoup d’aspects parallèle à celui de la Chine et du Japon. En Corée, comme au Japon, tout contact avec les occidentaux est source de danger. Seules les relations avec la Chine sont permises au milieu du 19ème siècle. Jusqu’au milieu des années 1850, les seuls étrangers présents en Corée sont les missionnaires. Quand les nations capitalistes ont commencé à se montrer dans la région, toute exaction coréenne contre des citoyens étrangers a été prise comme prétexte pour imposer leur présence par la force. C’est ainsi qu’en 1866, des missionnaires français ayant été tués en Corée, la France y envoie quelques bateaux militaires mais les troupes françaises sont battues. En 1871, les États-Unis envoient plusieurs navires remonter le fleuve Taedong jusqu’à Pyongyang, mais ceux-ci sont aussi défaits.
Cependant, à cette époque, les pays européens ou les États-Unis ne sont pas encore déterminés à occuper la Corée.
Les États-Unis sont encore sous le choc de la Guerre civile (1861-1865) et l’expansion du capitalisme vers l’ouest est encore en pleine action ; l’Angleterre est occupée à juguler les révoltes en Inde et concentre ses forces (avec la France) sur la pénétration en Chine. La Russie est encore en train de coloniser la Sibérie. Ainsi, tandis que les pays européens concentrent leurs forces sur la Chine et d’autres régions du monde, le Japon saisit l’occasion et commence rapidement à œuvrer pour que la Corée s’ouvre à ses produits.
Le Japon, par une démonstration de force, s’arrange pour obtenir un traité ouvrant trois ports coréens aux commerçants japonais. De plus, le Japon, de façon à contrecarrer l’influence chinoise "reconnaît" la Corée comme un pays indépendant. L’empire chinois déclinant ne peut rien faire d’autre que d’encourager la Corée à chercher la protection d’un troisième État pour résister à la pression japonaise. Les États-Unis sont parmi les premiers pays à reconnaître la Corée comme État indépendant en 1882. En 1887, les forces coréennes, pour la première fois se tournent vers les États-Unis pour demander "leur soutien contre des forces étrangères", i.e. le Japon, la Russie et la Grande-Bretagne.
Les exportations du Japon s’accroissant, le Corée devient de plus en plus dépendante du commerce avec ce pays. 90 % des exportations de la Corée vont vers le Japon au milieu des années 1890, plus de 50 % de ses importations proviennent du Japon.
L’afflux de produits étrangers inondant ce pays à dominante paysanne contribue largement à ruiner beaucoup de paysans. La paupérisation des campagnes est un des facteurs qui provoque un fort ressentiment anti-étranger.
 Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.
Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.
Les forces antiféodales et les paysans dominent le mouvement qui met en avant un mélange de revendications nationalistes, religieuses et sociales.
Des dizaines de milliers de paysans combattent avec des armes primitives contre les dirigeants locaux. La classe dominante féodale vacillante, se sentant menacée par le mouvement Tonghak et incapable de l’écraser seule, fait appel aux forces japonaises et chinoises pour l’aider à réprimer le mouvement.
La mobilisation pour la répression du mouvement Tonghak par les forces chinoises et japonaises leur sert de tremplin pour la lutte pour le contrôle de la Péninsule coréenne. La Chine et le Japon s’affrontent pour la première fois dans l’histoire moderne – non pas sur le contrôle de leur propre territoire mais sur celui de la Corée.
En juillet 1894, le Japon déclare à la Chine une guerre qui durera six mois. La plupart des combats ont lieu en Corée, bien que le principal objectif stratégique du Japon n’ait pas été le seul contrôle de la Corée mais ait inclus aussi celui de la péninsule chinoise Liaodong d’importance stratégique dans la mer de Chine.
Les troupes japonaises poussent l’armée chinoise de Corée, occupent Port-Arthur (une ville portuaire de la péninsule de Liaodong dans la mer de Chine), puis la péninsule de Liaodong, la Mandchourie – et commencent à se diriger vers Beijing. Face à la nette supériorité japonaise, le gouvernement chinois demande aux États-Unis de négocier une trêve.
Le résultat de la guerre est que la Chine doit concéder au Japon la péninsule de Liaodong, Port-Arthur, Dairen, Taiwan, et les îles Pescadores, accepter un paiement compensatoire de 200 millions de taels (360 millions de yens) et ouvrir les ports chinois au Japon. Le paiement "compensatoire" chinois devra alimenter le budget militaire japonais, parce que la guerre a coûté très cher au Japon, environ 200 millions de yens, soit trois fois le budget annuel du gouvernement. Ce paiement "compensatoire" va par ailleurs assécher encore plus les ressources de la Chine.
Mais déjà alors, à la suite de la première victoire éclatante des japonais, les requins impérialistes européens s’opposent à ce que la victoire japonaise ne soit trop écrasante. Ils ne veulent pas que soient concédés au Japon trop d’avantages stratégiques. Dans une "triple intervention", la Russie, la France et l'Allemagne s’opposent à l’occupation de Port-Arthur et de Liaodong. En 1885, le Japon renonce à Liaodong. Toujours sans allié à cette époque, le Japon doit se retirer (le traité anglo-nippon ne sera signé qu’en 1901). Au début, la France et la Grande-Bretagne souhaitent accorder des prêts à la Chine mais la Russie ne veut pas que la Chine devienne trop dépendante de ses rivaux européens et fait ele-même une offre de prêt Jusqu’en 1894, la Grande-Bretagne avait été la force étrangère dominante dans la région, en particulier en Chine et en Corée, mais jusque-là, la Grande-Bretagne avait considéré que la Russie constituait le plus grand danger dans la région.
Alors que la victoire militaire nippone sur la Chine a fait que les autres puissances impérialistes voyait dans le Japon un rival important en Orient, il est frappant que le principal champ de bataille de la première guerre entre la Chine et le Japon s’est trouvé en Corée.
Les raisons sont évidentes : entourée par la Russie, la Chine, et le Japon, la situation géographique de la Corée en fait un tremplin pour toute expansion d’un de ces pays vers un autre. La Corée se trouve prise inextricablement en tenailles entre l’empire insulaire du Japon et les deux empires continentaux de la Russie et de la Chine. Qui contrôle la Chine contrôle en puissance trois mers : celle du Japon, celle de la Chine orientale, et la Mer jaune. Sous le contrôle d’un pays, la Corée pouvait servir de couteau dans le dos des autres. Depuis les années 1890, la Corée est la cible des ambitions impérialistes des principales puissances de la région, bien qu’au départ seuls la Russie, la Chine et le Japon y prirent une part active, avec le soutien ou l’opposition des puissances européennes et des Etats-Unis qui agissaient dans l’ombre. Même si la partie nord du pays contient des réserves de matières premières importantes, c’est surtout sa situation stratégique qui en fait une telle plaque tournante de l’impérialisme dans la région.Depuis le 19ème siècle, pour le Japon qui apparaît comme la puissance impérialiste dominante en Extrême-Orient, la Corée est devenue le pont vital vers la Chine.
La guerre entre Chine et Japon pour la Corée va porter un grand coup à la classe dominante chinoise, et constituer en même temps un stimulus important des appétits impérialistes de la Russie.
Cependant, il est impossible de limiter le cadre de ce conflit à ces seuls deux rivaux parce qu’en réalité, il est l’illustration de l’accroissement général des tensions impérialistes.
Les principaux gains du Japon sur le territoire chinois – par exemple la péninsule Liaodong – sont immédiatement remis en cause par un groupe de puissances impérialistes. En 1899, la Grande-Bretagne renforce sa position en Chine (Hong Kong, Wehaiwei, les îles qui gardent les voies maritimes vers Beijing), garde le monopole sur la vallée du Yangtsé ; la Russie s’empare de Port-Arthur (voir plus loin) et Tailenwan (Dairen, Dalny), s’enracine en Mandchourie et en Mongolie ; l’Allemagne prend la Baie de Kaochow et Shantung, la France acquiert des privilèges spéciaux dans la Province du Hunan. "La guerre chinoise est le premier événement dans l’ère du monde politique dans lequel tous les Etats civilisés sont impliqués et à cette avancée de la réaction internationale, de la Sainte Alliance, aurait du répondre une protestation des partis ouvriers unis d’Europe". 1
La guerre sino-japonaise de 1884 pousse en fait tous les principaux rivaux impérialistes en Europe et en Extrême-Orient à entrer en conflit les uns avec les autres – un processus qui s’accélère dès qu’un autre requin impérialiste apparaît en Extrême-Orient.
1Rosa Luxembourg, dans une allocution à une conférence du parti à Mainz en septembre 1900, dans Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, vol 1/1, p 801 (traduit par nous).
Géographique:
- Corée du Sud [613]
Evènements historiques:
- Révolte Tonghak [614]
L’avancée de l’impérialisme russe
- 1791 lectures
Les menées expansionnistes de la Russie la conduisent en Asie Centrale et en Extrême Orient. À l’ouest, ses rivalités avec l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne s’aiguisent autour de la Mer Noire, elle s’affronte à l’empire ottoman (dans la guerre de Crimée en 1854-56, elle avait déjà affronté la Grande-Bretagne et la France), en Asie centrale, elle se dispute avec la Grande-Bretagne (L’Angleterre avait mené deux guerres en Afghanistan : en 1839-42 et en 1878-80, pour repousser l’influence russe hors de ce pays). En Extrême-Orient, elle entre surtout en conflit avec le Japon et la Grande-Bretagne en particulier – qui est la force impérialiste européenne dominante en Extrême-Orient.
Mais l’expansion de la Russie dans le dernier quart du 19ème siècle ne fait que cristalliser une tendance générale des nations capitalistes à conquérir de nouveaux territoires et de nouveaux marchés sur la terre entière.
En 1844, la France occupe l’Annam (Vietnam) et impose un blocus à l’isle de Taiwan ; la Grande-Bretagne annexe la Birmanie en 1885 ; la conférence de Berlin enregistre le dépeçage de l’Afrique en 1885.
En ce qui concerne l’Extrême-Orient, un nouveau niveau qualitatif est atteint dans cette zone de conflits avec l’apparition de la Russie. Avec la Russie en tant que pays européen défiant directement la domination croissante du Japon, on voit que chaque mouvement de celle-ci provoque toute une chaîne de réalignements chez les rivaux européens, en fonction de leurs rivalités ou d’une alliance possible avec elle.1
A la suite de l’ouverture du canal de Suez en 1869, et avec l’importance grandissante de l’ Extrême-Orient pour les rivaux impérialistes européens, la Russie met en œuvre la construction de la voie du Transsibérien en 1891. Incapable de financer ce projet gigantesque toute seule, elle emprunte du capital français. Le Japon, qui vise à s’étendre en Chine et en Corée, craint que toute avancée de la Russie à l’est mette en danger sa position.
La Russie met ses griffes sur l’ Extrême-Orient. Bénéficiant de l’affaiblissement de la Chine dans ses guerres avec le Japon en 1884, la Russie signe un traité secret avec la Chine en 1896, prétendant agir comme force protectrice contre le Japon. En 1898, la Russie s’empare de Port-Arthur.
Pour contrecarrer l’avancée de la Russie et ses manœuvres en Extrême-Orient et en Asie centrale, la Grande-Bretagne propose à la Russie de se répartir la Chine et l’empire ottoman – la Russie refuse.
Comme la rivalité entre Grande-Bretagne et Russie ne peut trouver de solution, la Russie doit essayer "d’apaiser" le Japon tant qu’elle peut. À la suite de l’échec de l’arrangement entre Russie et Grande-Bretagne, la Russie essaie de négocier avec le Japon différentes zones d’influence.
En 1902, les négociations entre le Japon et la Russie sur leurs zones respectives d’influence commencent. Au fond, la Russie propose de laisser les mains libres au Japon en Corée, pourvu qu’il n’utilise pas la péninsule comme base pour des opérations militaires. La Russie propose même que le territoire au nord du 38ème parallèle en Corée soit déclaré zone neutre, dans laquelle aucun pays ne serait autorisé à stationner des troupes, tandis qu’elle réclame le contrôle de la Mandchourie et d’autres zones frontière de la Chine (presqu’un demi-siècle plus tard, le pays sera divisé par ce même 38ème parallèle dans la guerre de Corée de 1953). Le Japon propose à la Russie de prendre le contrôle de la Corée et de lui permettre de prendre en charge la protection des voies de chemin de fer (seulement !) en Mandchourie, mais sans que ne lui soit donné un contrôle territorial.
Les négociations montrent qu’il est devenu impossible pour la Russie et le Japon d’essayer de se répartir leurs zones d’intérêt sans guerre.
Le Japon cherche des alliés. Le 30 janvier 1902, le Japon et la Grande-Bretagne signent un traité. Ils reconnaissent le droit du Japon et de la Grande-Bretagne d’intervenir dans les affaires chinoises et coréennes, se promettent d’être neutres si une des parties est en guerre dans sa zone d’intérêt et de se soutenir en cas de guerre contre d’autres pays. Ce traité entre la Grande-Bretagne et le Japon conduit le Japon à croire qu’il peut déclarer la guerre à la Russie avec l’espoir qu’aucun autre pays ne soutiendra la Russie puisqu’en arrière-plan, il y a la menace de la Grande-Bretagne. Le gouvernement allemand assure le gouvernement japonais qu’en cas de guerre entre Russie et Japon, l’Allemagne restera neutre. L’Allemagne espère que si la Russie commence une guerre en orient, cela laissera à l’Allemagne plus de place pour manœuvrer contre la France – une alliée de la Russie – et la Grande-Bretagne.
En traitant amplement et dans les détails ces stratégies compliquées, nous avons voulu montrer le développement de rivalités militaires extrêmement complexes et fortement imbriquées, si bien qu’il devient clair que, si un des principaux antagonistes intentait quelque chose, toute une réaction en chaîne se déclencherait chez les rivaux. Tous les pays ne faisaient pas que se positionner mais étaient aussi impliqués dans l’éclatement d’une guerre larvée.
1Pendant la première phase d’expansion de la Russie vers l’orient, i.e. pendant la première moitié du 19ème siècle et même jusque dans les années 1870, la division de nouveaux territoires pouvaient se faire au moyen de la vente et de l'achat de nouveaux territoires. Par exemple, la Russie vendit l’Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars US en 1867. En 1881 la Russie vend à la Chine ce qui deviendra sa province la plus occidentale, la Xinjiang, qu’elle avait saisie auparavant.
Géographique:
- Chine [610]
- Corée du Sud [613]
- Japon [164]
Evènements historiques:
- Guerre russo-japonaise [615]
La guerre russo-japonaise de 1904-1905: prélude à la Première Guerre mondiale
- 1671 lectures
À la suite du refus de la Russie d’accepter les revendications du Japon sur la Corée, le 8 février 1904, le Japon attaque la flotte russe à Port-Arthur et Tchemulpo.
La guerre russo-japonaise présente certaines des caractéristiques des guerres de la période de décadence.1 La première guerre du 20ème siècle entre deux grandes puissances conduit à une mobilisation inouïe des deux pays – impliquant de nouveaux niveaux de ressources humaines, économiques et militaires :
la guerre assèche les finances du pays vainqueur, engendrant un tombereau de dettes pour le Japon. Les dépenses du gouvernement font plus que doubler pendant la guerre, son budget présente un déficit gigantesque ;
Dans le pays vaincu, la Russie, la guerre met le feu au soulèvement prolétarien de 1905, montrant que seul le prolétariat peut constituer un verrou à la guerre. Rosa Luxembourg concluait au congrès de Stuttgart de la IIème Internationale en 1907, "Mais la révolution russe (de 1905) ne surgissait pas seulement de la guerre, elle a aussi servi à interrompre la guerre. Autrement le tsarisme aurait sûrement continué la guerre." " ;2
Même si le Japon est capable d’arracher des gains substantiels de territoire à la Russie, la nouvelle situation atteinte au tournant du siècle montre qu’aucun pays ne peut s’enrichir lui-même aux dépens d’un perdant sans interférer avec les intérêts impérialistes des autres rivaux.
10 ans avant la Première Guerre mondiale, le Japon triomphe sur la Russie, confirmant sa position dominante en Extrême-Orient et produisant une forte riposte de ses rivaux impérialistes.
 La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.
La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.
Les conséquences de la guerre russo-japonaise vont bien au-delà des deux pays belligérants.
Les États-Unis, qui juste un demi-siècle plus tôt (le milieu des années 1850) avaient été le fer de lance de l’ouverture du Japon au capitalisme, commencent à se confronter au Japon qui leur dispute la position dominante dans le Pacifique et l’Extrême-Orient.
Alors qu’après la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon, """" l'intervention conjointe de la France, l’Allemagne et la Russie avait empêché les conquêtes "excessives" du Japon, cette fois, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui s’opposent à une victoire trop éclatante et à un trop grand renforcement des positions japonaises.
Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne soutenaient le Japon au début de la guerre, ils retirent lui leur soutien financier vers la fin de la guerre pour faire pression sur lui, les États-Unis considèrant de plus en plus ce pays comme leur principal rival en Extrême-Orient. Quand les États-Unis soutiennent le "traité de paix" russo-japonais, qui admet l’hégémonie japonaise en Corée, le Japon doit concéder aux États-Unis leur droit d’intervention aux Philippines. En même temps, les États-Unis considèrent que le contrôle japonais sur la Corée est un moyen d’empêcher une nouvelle expansion russe vers l’orient. Les États-Unis sont encore "à la traîne" des pays européens dans leurs conquêtes impérialistes du 19ème siècle, parce qu’ils sont toujours occupés à favoriser l’expansion du capitalisme dans leur propre pays, dans sa partie occidentale, et sont arrivés "tard" dans la répartition du gâteau en Extrême-Orient. Le premier "gain" des États-Unis est les Philippines qu’ils arrachent à l’Espagne en 1898 dans la première guerre menée pendant cette période pour le repartage des conquêtes existantes (c’est la première guerre que les États-Unis mènent hors de leur propre territoire). Pendant cette période, les États-Unis annexent Hawaï et prennent le contrôle de l’atoll de Wake et de l’île de Guam dans le Pacifique.
Alors que les pays européens et le Japon apparaissent comme les "agresseurs" de la Chine, les États-Unis peuvent prétendre agir en tant que ses "défenseurs".
1 La guerre a duré 18 mois. Les principales zones de batailles furent Port Arthur, la voie de chemin de fer et la route menant à Mukden et Liaoyang. Au siège de Port Arthur, plus de 60 000 soldats japonais moururent. la plus grande bataille fut celle pour Mukden, du 23 février au 16 mars 1905 – plus de 750 000 soldats étaient engagés dans la bataille. Plus de 40 000 soldats japonais moururent. C’était à la fois une bataille navale et une guerre entre armées territoriales. La Russie envoya une grande partie de sa flotte (40 navires) de la Mer baltique en octobre 1904 qui longea la côte africaine pour arriver dans les eaux chinoises, mais les navires russes n’arrivèrent qu’en mai 1905 dans les eaux Extrême-Orientales. Dans une grande bataille navale, la marine japonaise bien préparée infligea à la Russie une défaite écrasante dans laquelle la plupart des bateaux russes furent coulés par les forces japonaises. La Russie dut concéder le sud de Sakhaline, la Mandchourie du sud et la Corée au Japon. Le Japon reçut Port-Arthur et Dairen. En conséquence, le Japon pouvait déclarer 5 ans plus tard, que la Corée était sa colonie.
2Discours prononcé dans la commission sur le Militarisme et les Conflits internationaux Gesammelte Werke, volume 2, page 236 (traduit par nous).
3Rosa Luxembourg, Gesammelte Werke, vol. 1, p.364, 13.3.1899 (traduit par nous). La ‘Question orientale’ était une expression qui désignait les rivalités inter-impérialistes autour de l’Empire ottoman en déliquescence
Géographique:
- Chine [610]
- Russie [616]
- Corée du Sud [613]
- Japon [164]
Evènements historiques:
- Guerre russo-japonaise [615]
Le capitalisme en déclin: l’Extrême-Orient devient un champ de bataille
- 847 lectures
En réexaminant le développement du Japon, de la Chine et de la Corée au 19ème siècle, nous pouvons voir que tous ces pays ont été ouverts au capitalisme par la force. Le capitalisme n’est pas venu de l’intérieur, mais il a été "importé" de l’extérieur. À la différence de beaucoup de pays européens, dans lesquels une classe révolutionnaire bourgeoise avait été capable de briser les chaînes du féodalisme, il n’y pas eu de telles révolutions bourgeoises réalisées par la bourgeoisie locale.
Bien que ces trois pays aient été ouverts par des capitalistes étrangers pendant la même période du 19ème siècle, ils ont suivi des chemins différents.
Le Japon est le seul pays à devenir rapidement une puissance capitaliste indépendante. Aussitôt après avoir été ouvert par le capitalisme étranger, le Japon commence à son tour à agir comme une force capitaliste en quête de nouveaux marchés et de zones de contrôle dans les régions voisines. En quelques décennies, le Japon devient la grande puissance régionale. À la différence de la Chine et de la Corée, le Japon entreprend d’accumuler rapidement du capital. Tout en n’étant pas handicapé dans son développement capitaliste comme ses voisins le sont par les pays étrangers, le rôle dominant du militarisme et de l’État est une caractéristique typique du développement de ce pays. Même si le Japon, très semblable à l’Allemagne en ce sens, est arrivé "tard" sur le marché mondial, à la différence de cette dernière qui a eu à se mesurer aux puissances impérialistes déjà "établies", il n’est pas pour autant un "démuni". C’est le premier pays dans la région à établir sa zone d’influence dans la "ruée vers les colonies" (en établissant son contrôle sur la Corée, des parties de la Mandchourie et le Taiwan). Le Japon a été impliqué et triomphant dans toutes les grandes guerres au moyen Orient – avec la Chine en 1894, avec la Russie en 1905 – et il a aussi été le grand gagnant régional de la Première Guerre mondiale bien que n’étant pas directement impliqué. Le Japon a donc pu grimper au "sommet" de l’échelle de l’impérialisme régional avant la Première Guerre mondiale, occupant cette position aux dépens des autres rivaux.
La Chine était gouvernée par une dynastie déclinante jusqu’à l’arrivée du capitalisme, qui là aussi a été "implanté" de l’extérieur. Alors que la classe dominante chinoise était incapable de déclencher un puissant développement capitaliste, les capitalistes étrangers – tout en ouvrant le pays au capitalisme – ont imposé de sérieuses limites au développement du capital national. Ainsi, au 19ème siècle déjà, le pays, qui présentait toutes les caractéristiques d’un développement "handicapé", a été mis en pièces par les puissances impérialistes étrangères. Comme nous le verrons plus tard, la Chine devait garder ces caractéristiques tout au long du 20ème siècle. Alors que le Japon était une force impérialiste dominante en expansion, la Chine était devenue la zone la plus disputée par les puissances impérialistes européennes et japonais.
La Corée, pour sa part, ouverte aussi par les capitalistes étrangers, est devenue la cible principale de l’impérialisme japonais. Étant un couloir d’invasion pour les appétits de tous ses voisins, elle fut condamnée à souffrir du fait de cette constellation géostratégique spécifique. Depuis que le capitalisme s’est implanté en Extrême-Orient, la Corée est devenue un champ de bataille permanent du combat entre rivaux régionaux et internationaux. Depuis 1905, la Corée a été disputée principalement par la Chine, le Japon et la Russie ; depuis le début de la décadence capitaliste, comme nous le verrons quand nous aborderons l’histoire du 20ème siècle, la Corée est restée une cible militaire et stratégique importante pour tous les pays impérialistes en Extrême-Orient.
Le quatrième rival dans la région, la Russie, dans son expansion vers l’ Extrême-Orient, tout en défendant ses propres intérêts impérialistes dans la région, a entraîné avec elle tout un troupeau de rivaux européens.
Pendant une période initiale de 2 ou 3 décennies, l’ouverture de l’ Extrême-Orient au capitalisme se déroule sous des conditions dans lesquelles les grandes puissances européennes et les États-Unis ne s’affrontent pas encore les uns aux autres, parce qu’il y a encore assez de "place pour l’expansion". La situation change, car la course aux colonies touche à sa fin et ce qui reste ne peut qu’être partagé avec un rival ou en gagnant quelque chose aux dépens d’autres. Les guerres entre la Chine et le Japon en 1894 et entre la Russie et le Japon en 1905 ont démontré qu’il était devenu impossible que tous les pays puissent avoir "une part du gâteau", mais que le partage était achevé et qu’une nouvelle distribution ne serait possible qu’au prix d’une guerre.
Trois ans avant l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg notait déjà : "au cours des dernières quinze années, il y a eu la guerre entre le Japon et la Chine en 1895, qui était le prélude à une période de politique mondiale en Extrême-Orient. En 1898, la guerre entre l’Espagne et les États-Unis, en 1899-1902, la guerre des Boers avec l’engagement de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud, en 1900 l’expédition vers la Chine des grandes puissances européennes, en 1904, la guerre russo-japonaise, en 1904-1907 la guerre allemande contre les Hereros en Afrique, en 1908 l’intervention militaire russe en Perse, en ce moment (1911), l’intervention militaire française au Maroc, sans parler des escarmouches coloniales incessantes en Asie et en Afrique. Ces simples faits montrent que pendant les quinze dernières années, il n’y a eu presque aucune année sans guerre.1".
Les rivalités impérialistes ont pu être maintenues dans certaines limites jusqu’au début du 20ème siècle. Mais quand les antagonismes se sont aiguisés à l’échelle planétaire, les rivalités mondiales se sont aussi manifestées en Extrême-Orient. La guerre de 1905 entre la Russie et le Japon annonce la Première Guerre mondiale et toutes les guerres qui suivront au 20ème siècle.
Au tournant du 20ème siècle, l’ Extrême-Orient fait l’expérience du remaniement de la hiérarchie impérialiste. Après 1905, le Japon se hisse au sommet de l’ordre hiérarchique impérialiste dans la région mais il est déjà contesté par les deux géants impérialistes : les États-Unis et la Grande Bretagne. Les États-Unis commencent juste après à "contenir" le Japon – au début grâce à la politique de "des arrangements" (tel que celui sur les Philippines pour reconnaître les intérêts japonais en Corée) – plus tard, comme dans la Première Guerre mondiale, en rentrant en guerre l’un contre l’autre.
Le développement du capitalisme au 19ème siècle en Extrême-Orient illustre donc combien le changement qualitatif qui se produit au tournant du 19-20ème siècle représente une nouvelle époque dans le développement global du capitalisme.
Il n’y a plus de révolution bourgeoise à l’ordre du jour, la bourgeoisie au moyen orient est devenue aussi réactionnaire qu’ailleurs. Le système capitaliste va montrer toutes ses contradictions en Extrême-Orient, précipitant cette partie du globe très peuplée dans une série de guerres et de destruction.
1‘L’Utopie de la Paix’, Gesammelte Werke Volume 2, p.496, Leipziger Volkszeitung (traduit par nous).
Géographique:
- Chine [610]
- Russie [616]
- Corée du Sud [613]
- Japon [164]
La route vers la deuxième guerre mondiale
- 771 lectures
Géographique:
- Asie [617]
La position impérialiste du Japon
- 705 lectures
La constellation impérialiste en Extrême-Orient a subi de profonds changements à la fin de la Première Guerre mondiale.
A la fin de la guerre, les principaux rivaux du Japon ne sont plus les puissances européennes mais les États-Unis.
Le Japon a été un des principaux bénéficiaires de la Première Guerre sans avoir jamais été impliqué à une grande échelle dans les combats. À la différence des autres États vainqueurs en Europe (Grande-Bretagne, France), qui ont dû payer cher leur victoire, le Japon n’est pas été ruiné par la guerre. Le Japon au contraire se débrouille pour améliorer substantiellement sa position – d’abord il accélère son industrialisation, en second lieu, il améliore sa position sur le marché aux dépens de ses rivaux européens et devient un grand fournisseur d’armes. Ses importations et ses exportations triplent pendant la Première Guerre mondiale, la production d’acier et de béton double ; de grands progrès dans les équipements chimiques et électrotechniques sont réalisés et le Japon réussit à effacer ses dettes à l’étranger pendant la guerre – dettes qu’il avait "contractées" du fait de la guerre contre la Russie en 1905. Il devient une nation créditrice. Il agrandit aussi sa marine de commerce et devient une grande nation de construction navale, multipliant par 8 sa capacité de production.
Cependant, dès que la guerre prend fin en 1918, le boom prend fin et le Japon se retrouve confronté à une grave crise économique.
Au niveau impérialiste, le Japon renforce ses positions surtout par rapport à la Chine et aux dépens de l’autre pays vaincu, l'Allemagne, mais également aux dépens de ses autres rivaux impérialistes européens, qui sont touchés de plein fouet par le carnage guerrier en Europe. Après avoir occupé la Corée en 1909, le Japon espère devenir la puissance impérialiste incontestée en Chine aussi.
Déjà dans les premières semaines après l’éclatement de la guerre en 1914, le Japon s’empare de la position allemande de Tsingtao en Chine et occupe les possessions allemandes dans le Pacifique (les îles Marshall et Caroline), ce qu’il voit comme contrepoids à la présence américaine à Hawaï, aux Philippines et sur l’île de Guam.
Comme la Russie disparaît de la scène impérialiste, le Japon essaie de revendiquer la position dominante en Chine. Dès que les pays impérialistes déclenchent une offensive contre-révolutionnaire contre le bastion prolétarien en Russie en 1918, le Japon est le premier pays à participer à l’invasion et le dernier pays à quitter le territoire sibérien en 1922. Au lieu d’envoyer 7000 soldats comme demandé par les États-Unis, le Japon en envoie 72 000, dévoilant ouvertement ses appétits impérialistes à l’égard de la Russie.
A la suite de l’émergence du Japon comme le grand bénéficiaire de la guerre, les États-Unis essaient de limiter sa puissance militaire.
Tandis que les pays européens désarment en partie après la Première Guerre mondiale, le Japon ne réduit pas significativement ses dépenses militaires. Entre 1888 et 1938, ses dépenses militaires totales correspondent alors à 40-50 % du budget national. 1
Toutefois, alors que le Japon est un "vainqueur" de la Première Guerre mondiale, il n’a pas pour autant été capable d'effectuer de grandes conquêtes territoriales au cours de celle-ci. N’étant toutefois pas un "sans rien" (puisque la Corée est sous son contrôle depuis 1909), il a une forte tentation de remettre en cause le statu quo dans la région et d’essayer de s’étendre du côté du continent asiatique.
Tandis que les tensions impérialistes en Europe régressent après la Première Guerre mondiale, en grande partie à cause de la vague de luttes révolutionnaires, elles évoluent différemment en Extrême-Orient.
Une fois de plus, le Japon va affronter la Russie dès que cette dernière réapparaît sur la scène comme puissance impérialiste (voir plus loin). Le Japon occupe la Mandchourie et proclame la fondation d’un nouvel État – le Mandchoukouo. La création de ce nouvel État, qui n’était rien d’autre qu’un vassal du plus grand requin impérialiste dans la région, signifie surtout que la Japon a sous la main un tremplin pour une expansion ultérieure vers la Chine du Sud.
1Lockwood, Economic Development of Japan, p.292.
Géographique:
- Japon [164]
Chine: la descente dans le chaos militariste
- 961 lectures
Nous avons vu plus haut que la bourgeoisie chinoise avait été incapable de préparer la voie à la modernisation capitaliste. Bien que la république chinoise ait été proclamée en 1911 et la dynastie mandchoue chassée, aucun gouvernement bourgeois central fort n’avait pu être constitué. Cette faiblesse historique de la bourgeoisie chinoise signifie que la Chine va décliner, dans un cours sans fin à la militarisation, même si au début les puissances étrangères ne sont pas directement impliquées dans l’escalade militaire. Mais la Chine devient le berceau d’un nouveau phénomène - les seigneurs de guerre – qui va imprimer sa marque tout au long du 20ème siècle.
L'entrée en scêne des seigneurs de guerre
Confrontées à un gouvernement central de plus en plus impuissant, certaines provinces déclarent leur indépendance vis à vis de Beijing après 1915. Dans la plupart des provinces, les seigneurs de guerre deviennent la force dominante.
Ils tirent leur revenus de l'extorsion (par la force) d’impôts sur le dos principalement des paysans, du banditisme et du développement du commerce de l’opium. Ce n’est pas par hasard si le trafic de drogue, qui a été réprimé plus d’un demi-siècle auparavant, réapparaît alors. La production d’opium avait presque été stoppée en 1916, mais les seigneurs de guerre attribuent de vastes étendues de terre à la culture de l’opium ; ils instituent un "impôt sur la paresse" pour les fermiers qui ne plantent pas d’opium. L’impôt sur la terre est multiplié par 5 ou 6 par les seigneurs de guerre et beaucoup d’impôts sont collectés en avance – dans certaines régions, des décennies à l’avance. Les seigneurs de guerre recrutent un grand nombre de soldats dans la paysannerie et parmi les éléments lumpenisés. Avec la désintégration de la dynastie et la fragmentation de la Chine au début du 20ème siècle, un nombre croissant de pauvres et de paysans sans terre, perdus dans une masse errante, commencent à s’enrôler dans les armées professionnelles des seigneurs de guerre régionaux. La plupart de ces soldats sont incontrôlables car la plupart d’entre eux, sans travail et affamés, se battent sans autre raison que l’argent. En conséquence, beaucoup de ces soldats changent de camp ou s’enfuient pendant les batailles. C’est pourquoi, il faut sans arrêt recruter des soldats, souvent par la force. À la même époque, dans beaucoup de régions, les paysans sont contraints de s’affilier à des sociétés secrètes pour se protéger contre les troupes qui maraudent.
Du fait qu’il n’y a pas d’État, pas de nation avec un gouvernement central à sa tête capable de défendre l’unité nationale, chaque seigneur de guerre peut revendiquer son territoire. Mais en même temps, ils ne cherchent pas à se séparer de "l’empire" chinois, ni à créer une nouvelle nation. Généralement, ils ne sont pas liés à un secteur particulier de la société, ni particulièrement impliqués dans la défense de tel ou tel secteur de l’économie. Ce sont des "parasites" classiques, se nourrissant sur la population sans aucune base idéologique, ethnique ou religieuse spéciale. Les objectifs de leurs opérations militaires ne sont pas plus l’extension la plus large possible de leur aire de domination que la recherche de nouveaux marchés ou le pillage des matières premières. Dans un certain sens, ils font des guerres "improvisées" et pillent le pays. En conséquence, le commerce se restreint. Le système des transports souffre énormément, pas seulement des ravages directs de la guerre, mais parce qu’il doit charrier beaucoup de troupes et à cause du paiement de taxes spéciales aux militaires.
Toutes les ressources de la société sont absorbées par la militarisation. La saisie dictatoriale fréquente de biens, la gestion irresponsable de l’argent par les seigneurs de guerre (quand ils ont besoin d’argent pour financer leurs légions de soldats, ils impriment autant de monnaie qu’ils veulent) représentent un terrible fardeau sur l’économie. En bref, cela révèle un pur processus de décomposition, un pourrissement sur pied de la société. C’est l’expression de l’incapacité de la bourgeoisie nationale d’unifier le pays. La fragmentation du pays en tout un tas de fiefs (des unités plus petites), qui sont sous le contrôle de seigneurs de guerre pillards, représente un handicap gigantesque au développement des forces productives ; cela montre aussi que la libération nationale en Chine n’est plus à l’ordre du jour, parce que le nation ne peut plus être un cadre adéquat au développement des forces productives.
Même si pendant la Première Guerre mondiale, les impérialistes étrangers ont essayé d’influencer et vaincre les différents seigneurs de guerre, les guerres menées par les seigneurs de guerre locaux ne sont pas encore dominées par la rivalité entre les requins étrangers.
Le résultat désastreux de la politique du Comintern.
En 1915, la province du sud, le Hunan, déclare son indépendance, et entre 1916 et 1918, une polarisation croissante entre seigneurs de guerre du nord et du sud conduit à une vague de conflits militaires. Ensuite, quand la Première Guerre mondiale prend fin en 1918 en Europe, la Chine est démantelée par les régimes militaires rivaux au point qu’il n’y a plus d’autorité capable de subordonner tous les rivaux et de créer une structure politique unifiée et centralisée. L’État national doit être aboli complètement si la société veut éviter de tomber dans le militarisme et le chaos. Comme le reconnaissait l’Internationale Communiste dans son Manifeste de 1919 : "L'État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives"
Mais si l’Internationale Communiste était vraiment claire sur la nécessité d’abolir tous les États, cette vision devint plus fumeuse par la suite. Plus la révolution recule, et plus le Comintern fait des efforts désespérés pour obtenir un soutien à la révolution isolée en Russie, et met en pratique une politique opportuniste. Au 4ème Congrès mondial en 1922, le Comintern fait de la propagande pour un front uni entre certains partis communistes et ce qu’il appelle l’aile "gauche" ou "démocrate" de leurs bourgeoisies respectives. En Chine, le parti Communiste Chinois (PCC), en accord avec le Comintern en 1922, déclare dans son "Premier Manifeste du PCC sur la situation actuelle" (10 juin 1922) : "Nous saluons une guerre pour assurer le triomphe de la démocratie, pour renverser les militaires…La tâche urgente du prolétariat est d’agir en commun avec le parti démocrate pour établir un front uni pour la révolution démocratique… Ce combat sur un large front uni est une guerre pour libérer le peuple chinois de son double joug – le joug des étrangers et le joug du puissant militarisme dans notre pays."1.
Cette orientation, la création d’une coalition de forces bourgeoises et prolétaires pour mener une guerre contre le capital étranger rencontre une forte opposition des forces de la Gauche Communiste.2
La marche vers le Front unique du Parti Communiste Chinois, (PCC) est un désastre pour la classe ouvrière car il oblige les travailleurs à se soumettre au Kuomintang3 (KMT) et contribue au triomphe de ce dernier en tant que force dominante de la bourgeoisie chinoise.
Comme nous l’avons rapporté dans d’autres articles de notre presse, l’expérience de la vague de luttes en 1925-27 montre que la politique de front unique imposée par le Comintern pave le chemin d’un niveau de militarisation encore plus élevé.
Alors qu’en Europe, deux décennies séparent la fin de la Première Guerre mondiale du début de la deuxième (annoncée par la Guerre d’Espagne en 1936), la Chine continue sa descente irrésistible dans le militarisme, immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. À partir du début des années 1920, une série de guerres entre différents seigneurs de guerre continuent à ravager le pays. Les effectifs des troupes régulières passent de 500 000 en 1916 à deux millions en 1928. Le nombre de gens armés augmente, chaque défaite d’une armée conduisant à une explosion du nombre de bandits.
Parmi les forces de la bourgeoisie chinoises, le KMT est la plus cohérente et la plus déterminée dans sa défense des intérêts du capital national. Le parti de Chiang Kai Shek ne peut que poursuivre les essais d’unification du pays par la voie militaire. Avec le soutien du PCC, au printemps 1926, Chiang Kai Shek organise une expédition militaire pour éradiquer les différents seigneurs de guerre féodaux dans le centre et le nord de la Chine. Au printemps 1927, tandis qu’une grande vague de grèves secoue la ville chinoise la plus importante, Shanghai, le KMT, la force qui pendant des années a été saluée par le Comintern comme "parti démocratique" avec qui la classe ouvrière devait lutter pour une "révolution démocratique", montre son vrai visage. Le KMT supervise le massacre de milliers d’ouvriers à Shanghai et à Nankin. Le premier gouvernement dirigé par le KMT – connu comme premier "gouvernement national" - s’installe à Nankin le 18 avril 1927. Ce premier gouvernement d’une Chine "unifiée" n’a pu se hisser au pouvoir que par un massacre de la classe ouvrière. Mais même si le gouvernement de Nankin représente le plus haut degré de centralisation du capital national depuis 1911, le militarisme ne cesse pas. Parce que, bien que l’unité de la Chine ait été formellement établie autour du gouvernement de Nankin en 1928, le gouvernement central est forcé de continuer sans interruption son combat contre les seigneurs de guerre – parce que ceux-ci n’ont été éliminés ni dans le nord ni dans d’autres régions, même après la formation du gouvernement central de Nankin.
Le premier programme gouvernemental de la Chine unifiée : plus de militarisation
Même si la période après 1928 n’est pas marquée par des guerres de même ampleur et intensité que les guerres précédentes, les années suivantes voient cependant nombre de campagnes militaires qui ensanglantent le pays. Par exemple :
1929 : Des tentatives pour démanteler les armées pléthoriques échouent ; l’insurrection de l’armée du Kwangsi et une révolte dans le Hunan sont réprimées ;
1930 : Une guerre sanglante impliquant un million d’hommes éclate dans la Chine du Nord, de mars à septembre 1930. Entre 1931 et1935, plusieurs campagnes sont menées contre les troupes du Parti Communiste.
Même si le règne des seigneurs de guerre s’éteint lentement au début des années 30, une réelle unification du pays n’est jamais achevée et, plus le gouvernement centralisé gagne, plus le régime se militarise. Le poids des conflits armés dans une société peut être mesuré à l’aune des dépenses militaires gouvernementales qui, en Chine, ne tombent jamais en dessous de 44 % du budget de l’État entre 1926 et 1934.
La population civile – otage de tous les rivaux
A la suite de l’offensive des troupes du gouvernement de Nankin contre les forces du PCC, certaines forces de l’armée rouge, 90 000 hommes mal équipés, sont poursuivis à travers le pays dans ce qui fut appelé par la suite la "Longue Marche". Seulement 7000 soldats de l’armée rouge atteigneront la région reculée du Yunnan au nord-est du Shaanxi. Dans cette guerre entre deux forces "inégales", le PCC a appliqué systématiquement une tactique militaire qui allait marquer les conflits militaires pendant depuis le 20ème siècle. ""Incapable de lever une "armée permanente régulière", avec l’équipement complet d’une armée financée et entretenue par l’État et son gouvernement, les forces de l’Armée Rouge commencent à développer une guerre de guérilla. Quoique dans les guerres précédentes du 19ème siècle, il y ait eu certaines activités partisanes limitées, ce phénomène prend une nouvelle proportion dans le maelström chinois.
L’Armée Rouge transforme les civils en bouclier humain, i.e. en cibles pour protéger le mouvement des soldats de l’armée régulière. En même temps, la terreur brutale exercée sur les paysans et l’extorsion d’impôts faramineux par le gouvernement de Nankin forcent des millions de paysans soit à abandonner leurs terres et à fuir, soit à se précipiter dans les bras de l’Armée Rouge. Ils deviennent de la chair à canon pour les deux antagonistes. La guerre commence à ravager de façon presque permanente, non seulement les grandes villes mais le pays tout entier.
La guerre fait rage
Soutenir la guerre ""juste"" de la Chine c’est aujourd’hui se lier avec les impérialismes anglais, américain, français : c’est travailler pour l’Union Sacrée au nom d’un ""demain révolutionnaire"" qui sera illustré - comme en Espagne - par des monceaux de cadavres ouvriers et le triomphe de ""l’ordre"".
Des deux côtés des fronts il y a une bourgeoisie rapace, dominatrice et qui ne vise qu’à faire massacrer les prolétaires : des deux côtés des fronts il y a des prolétaires conduits à l’abattoir. Il est faux, archi-faux de croire qu’il existe une bourgeoisie avec laquelle les, ouvriers chinois peuvent, même provisoirement, faire un "bout de chemin ensemble" alors que seul l’impérialisme japonais doit être abattu pour permettre aux ouvriers chinois de lutter victorieusement pour la révolution. Partout l’impérialisme mène la danse et la Chine n’est que le jouet des autres impérialismes. Pour entrevoir le chemin des batailles révolutionnaires il faut que les ouvriers chinois et japonais trouvent le chemin de classe qui les conduira les uns vers les autres : la fraternisation devant cimenter leur assaut simultané contre leurs propres exploiteurs….
Seules, les fractions de la Gauche Communiste Internationale seront opposées à tous les courants traîtres et opportunistes et brandiront hardiment le drapeau de la lutte pour la révolution. Seules, elles lutteront pour la transformation de la guerre impérialiste qui ensanglante l’Asie en une guerre civile des ouvriers contre leurs exploiteurs : fraternisation des ouvriers chinois et japonais ; destruction des fronts de la "guerre nationale" ; lutte contre le Kuomintang, lutte contre l’impérialisme japonais, lutte contre tous les courants qui agissent parmi les ouvriers pour la guerre impérialiste. (Journal de la Gauche Italienne, Bilan, n° 44, octobre 1937, p. 1475)
La guerre héroïque de la mystification maoïste est en réalité le fléau d’une guerre "mobile avec ses millions de réfugiés et sa politique de la terre brûlée.
Plus les tensions impérialistes s’aiguisent internationalement, plus la Chine est impliquée dans celes-ci. À cette époque, quand à l’intérieur de la Chine les expéditions militaires contre les différents seigneurs de guerre continuent après 1928, le premier grand clash avec un pays étranger se produit avec la Russie en 1928/29. À peine installé à Nankin, le "gouvernement central" réclame et occupe les chemins de fer dans le nord de la Mandchourie, jusque-là sous contrôle russe. Dans une première confrontation violente entre la Russie stalinienne et ses rivaux impérialistes en Extrême-Orient, la Russie mobilise 134 000 soldats et réussit à défaire les troupes chinoises, qui ne peuvent offrir grande résistance du fait de la dispersion de leurs forces dans les combats contre différents seigneurs de guerre.
Toutefois, le principal antagonisme se développe entre la Chine et le Japon. En 1931/32, le Japon occupe la Mandchourie et proclame le nouvel État du Manchoukuo. Début 1932, le Japon attaque et bombarde Shanghai. À ce moment là – i.e . après que le Japon ait occupé la Mandchourie – le gouvernement dirigé par le KMT continue sa politique consistant à essayer d’éliminer les autres seigneurs de guerre et surtout le Parti Communiste. C’est seulement en 1937, une fois que le Japon a commencé à étendre la guerre de Mandchourie à la Chine, que la bourgeoisie chinoise s’unifie et met de côté temporairement ses rivalités – mais cette unification ne peut être que celle d’un front uni dans la guerre contre le Japon.
La nécessité de développer un "front de guerre uni" contre le Japon signifie aussi que la bourgeoisie chinoise doit se repositionner dans ses rapports avec les impérialistes étrangers.
Jusqu’en 1937, chaque aile de la bourgeoisie chinoise a des orientations différentes en politique étrangère. Alors que le PCC penche pour la Russie stalinienne et reçoit un soutien de Moscou, le KMT compte sur l’aide de l’Allemagne et d’autres États. Chiang Kaï Chek lui-même, qui a eu le soutien du Comintern dégénérescent et du stalinisme montant jusqu’en 1927, essaie d’éviter une confrontation frontale avec le Japon. En 1930, il signe une "trêve" de facto avec le Japon, dans le seul but d’avoir le champ libre pour attaquer les troupes du Parti Communiste. Mais avec l’avancée des troupes japonaises du Mandchoukuo vers Beijing et Shanghai en 1937, Chiang doit laisser tomber son alliance avec l’Allemagne – laquelle est en train de faire alliance avec le Japon. Les rivalités impérialistes au niveau planétaire obligent chaque rival local à choisir ses alliés et la marche historique à la guerre au niveau mondial va aussi déterminer les antagonismes en Extrême-Orient. 4
1‘First Manifesto of the CCP on the Current Situation’"", 10 juin 1922, dans Conrad Brandt, Benjamin Schwarz et John K. Fairbanks, A documentary History of chinese communism, New York, Atheneum, 1971, pp 61-63. La traduction est de nous.
2Voir "Chine 1928-1949 : Maillon dans la chaîne de la guerre impérialiste", Revues internationales, N°81, 84, 94
3Le Kuomintang (Parti nationaliste chinois) fut fondé en 1912 dans le but de renverser la dynastie Qing régnante et d’établir une république. Son premier président était Sun Yat-Sen, un des principaux figures du mouvement chinois républicain à la fin du 19e et le début du 20e siècle. Après sa mort en 1925, la direction passa à Chiang Kai-shek qui entreprit une campagne militaire, avec l’aide du pouvoir soviétique, afin de renverser le gouvernement des seigneurs de guerre installés à Beijing, ainsi que les divers seigneurs de guerre régionaux. La campagne fut une réussite, et le KMT prit Beijing en 1928 ; le peu après, le capitale fut transféré à Nanking.
4En 1921 déjà, l’Allemagne avait commencé à fournir des armes à la Chine. Des armes de tout type étaient requises pour les guerres chinoises continuelles. La plupart des armes allemandes qui arrivèrent en Chine au début des années 20 provenaient clairement des stocks que l’Allemagne avait cachés aux inspecteurs d’armes de Versailles. Un chef d’État-major avant Ludendorff – Max Bauer – devint conseiller militaire de Chiang Kaï Chek en 926. En 1928, alors que l’armée chinoise avait quelques 2,25 millions d’hommes en armes, le conseiller militaire allemand Bauer recommanda à la Chine de ne garder qu’une petite armée essentielle et d’intégrer le reste des soldats dans les milices. Les conseillers militaires allemands entraînaient une armée centrale de 80 000 hommes, qui bientôt s’élargit à 300 000. Dans la bataille de Shanghai, en 1937, les conseillers militaires allemands portaient des uniformes chinois et dirigeaient les troupes chinoises jusque sur les lignes de front japonaises. Les conseillers militaires allemands recommandèrent à Chiang de mener une guerre d’usure contre le Japon et d’utiliser des tactiques de la guérilla contre l’armée japonaise. Ce n’est qu’à l’été 1938 que les conseillers militaires allemands furent rappelés de Chine, une fois que le régime nazi eut choisi de travailler à une alliance avec le Japon. Juste avant que les conseillers allemands ne s’en aillent, Chiang avait signé un traité engageant les conseillers allemands à entraîner toute l’armée chinoise jusqu’en 1940. (German Military Mission to China,1927-38.Arvo L. Vecamer, voir aussi: https://www.feldgrau.com/china.html [618])
Géographique:
- Chine [610]
La guerre entre la Chine et le Japon: l’autre grand théâtre de guerre dans la deuxième guerre mondiale
- 898 lectures
La guerre sino-japonaise: l'opportunisme
"Dans ma déclaration à la presse bourgeoise, je disais que c’est un devoir pour toutes les organisations ouvrières en Chine de participer activement et de combattre sur le front dans la guerre contre le Japon, sans renoncer en aucune manière en quoique ce soit à leur programme et à leur autonomie. Mais c’est du ‘patriotisme social’ - crient les Eiffelistes (le Grupo de Trabajodores Marxistas/ Communismo). C’est une capitulation devant Chiang Kaï Chek ! C’est abandonner le principe de la lutte de classe ! "Pendant la guerre impérialiste, le bolchevisme faisait de la propagande pour le défaitisme révolutionnaire. Dans le cas de la guerre civile en Espagne et de la guerre sino-japonaise, nous sommes face à des guerres impérialistes. (…) Sur la guerre chinoise, nous prenons la même position. Le seul salut pour les ouvriers et les paysans en Chine est de combattre en tant que force autonome contre les deux armées, contre l’armée chinoise aussi bien que contre l’armée japonaise"". Ces quelques lignes des documents des Eiffelistes du 1 septembre 1937 nous permettent déjà de conclure : soit ils sont des traîtres, soit des idiots complets… La Chine est un pays semi-colonial qui, - sous nos yeux – est en train d’être transformé en pays colonial par le Japon. Dans le cas du Japon, c’est combattre une guerre impérialiste réactionnaire. Dans le cas de la Chine, c’est se battre dans une guerre progressiste de libération… Le patriotisme japonais est le visage horrible du banditisme international. Le patriotisme chinois est légitime et progressiste." (Lettre à Diego de Rivera, dans Trotsky on China, p. 547, Trotsky, Werke Hambourg 1990) (Notre traduction).
La guerre entre les deux pays allait être une des guerres les plus sanglantes, les plus destructrices et les plus longues du 20ème siècle. Tandis que lors de la Première Guerre mondiale l’Extrême-Orient avait été épargnée une escalade militaire, dans la Deuxième il devient le second plus grand théâtre de guerre.1
Dans la première phase, entre 1937 et 1941, la guerre est plus ou moins "limitée" au combat entre le Japon et la Chine principalement soutenue par la Russie. La deuxième phase commence en 1941, quand un nouveau front s’ouvre entre le Japon et les États-Unis. Quand le Japon commence à occuper la Chine, l’armée espère faire un grand coup et tout avoir sous son contrôle en quelques mois. C’est le contraire qui se produit. En août 1937 le Japon déclenche une bataille massive avec plus d’un demi-million de soldats engagés dans les combats pour la ville de Shanghai. D’autres grandes batailles suivent autour de Wuhan et en décembre 1937 à Nankin. Il est estimé qu’entre août 1937 et novembre 1938 seulement, quelques deux millions de chinois et environ 500 000 soldats japonais tombent au combat.
Malgré leurs lourdes pertes, l’armée japonaise se révèle incapable de mettre à genou les troupes chinoises. Entre octobre 1938 et l’attaque de Pearl Harbour, (le 7 décembre 1941), la guerre en Chine "stagne. Le Japon ne fait que gérer certaines enclaves qui correspondent à 10 % du territoire. De plus, le gouvernement japonais perd le contrôle financier des dépenses (la part de l’armement dans le budget grimpe de 31 % en 1931-32 à 47 % en 1936-37, et à la fin des années 30, les dépenses d’armement montent à 70 % du budget).
Plus la stratégie militaire japonaise devient désespérée, plus elle se sert de la terreur, avec le mot d’ordre : "tuez, brûlez, pillez autant que vous pouvez".
Quand les troupes japonaises entrent dans la ville de Nankin en 1937, elles commettent un des plus affreux massacresde la guerre : dans cette seule ville, environ 300 000 personnes sont tuées, dans un carnage sans pitié. Les troupes chinoises, en retour, mènent des attaques de partisans et la politique de la terre brûlée.
Pendant la guerre avec le Japon, la bourgeoisie chinoise ne réussit à établir qu’un "Front unique" très fragile. Même si, à la suite des attaques japonaises contre la Chine en 1937, elle avait resserré les rangs, en janvier 1941, les troupes nationalistes du KMT et les armées maoïstes s’affrontent de nouveau. Au cours du développement de la guerre, les forces de l’Armée Rouge – après beaucoup d’avancées et de retraites – deviennent dominante, inversant rapport de force existant au début du conflit.
Ainsi, après 1941, suite à des décennies de guerres répétées en Chine, à quatre ans de guerres plus ou moins bilatérales entre la Chine et le Japon, le conflit en Asie connaît alors une escalade dans une confrontation générale dans toute l’Asie. Entre 1941 et 1945, la guerre implique tous les pays d’ Extrême-Orient et aussi l’Australie.
Au début, le Japon gagne rapidement certaines positions – après sa victoire éclatante à Pearl Harbour. En quelques mois, le Japon conquiert de vastes régions du Sud-est asiatique. Ses troupes occupent les colonies britanniques de Hong Kong et de Singapore, de grandes parties des Philippines, débarquent dans les Indes hollandaises (plus tard, l’Indonésie) et pénètrent en Birmanie. En 100 jours, ils atteignent les côtes australiennes et indiennes2.
1Les conquêtes japonaises en Asie du Sud-Est ont exigé un énorme tribut en vies humaines. La bataille aux Philippines a été une des plus sanglantes. Par exemple, quelques 80 000 soldats japonais moururent dans la bataille pour l’île de Leyte, 190 000 dans la bataille pour Luzon, , la défense d’Okinawa a coûté la vie à 110 000 soldats japonais, l’armée US a perdu quelques 50 000 soldats dans la seule conquête d’Okinawa.
2Dans beaucoup de pays, le Japon a essayé d’attirer dans son orbite les défenseurs locaux de "l’indépendance nationale" au sein des colonies britanniques et hollandaises. Ainsi, en Inde, le Japon obtient le soutien des nationalistes indiens qui voulaient se séparer de leur puissance coloniale britannique. Le régime nazi allemand était parvenu à recruter des nationalistes au Moyen Orient pour son offensive, l’impérialisme japonais se présentait comme une force de "libération" du colonialisme anglais.
Géographique:
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [619]
- Guerre sino-japonaise [620]
- Massacre de Nankin [621]
Une spirale destructrice
- 737 lectures
Pour la première fois, les USAÉtats-Unis utilisent des bombes au napalm contre les régions habitées au Japon. Le 9-10 mars 1945, le raid de bombardiers sur Tokyo coûte la vie à 130 000 personnes, détruit 267 000 constructions sur une superficie surface de 41 mille105 kilomètres carrés, et plus d’un million de gens personnes se retrouvent sans abri. La deuxième ville du Japon, Osaka, est bombardée depuis le 13 mars jusqu’au dernier jour de la guerreet, : quelques 10 000 personnes périssent et environ 100 000 maisons sont détruites. Globalement, plus de 600 000 constructions seront détruites au Japon en quatre séries de bombardements. En juin 1945 – deux mois avant que les bombes atomiques ne soient envoyées – environ 50 % des maisons à Kobe et Tokyo étaient en ruine. La même politique de terre brûlée est appliquée à Nagoya, Osaka et Kawasaki.
A la fin de la guerre, plus de deux millions de maisons sont détruites et quelques 13 millions de personnes sans abris du seul fait des bombes au napalm. Alors que les États-Unis ont tenté de justifier leur attaque barbare avec l'arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki, présentées comme des exceptions visant à sauver la vie de milliers de soldats américains, en réalité, les bombes atomiques sur ces deux villes ne représentent que le point culminant de toute une spirale de destructions et d’annihilation, qui, de plus, va conduire dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale à l'édification systématique d’un arsenal nucléaire1
Le bilan de la guerre 1937-1945 est particulièrement désastreux pour les deux principales puissances en Asie, la Chine et le Japon.
La guerre a coûté la vie à 15-20 millions de personnes dans les deux pays. Le Japon, le pays qui a déclenché la guerre, est le grand perdant et en sort complètement ruiné et militairement paralysé. C’est la première fois, depuis des siècles, que la guerre fait rage sur le territoire japonais. Le Japon perd toutes ses conquêtes (de ses colonies, la Corée et la Mandchourie, jusqu’à ses conquêtes de guerre éphémères dans le Sud Est asiatique). À la différence de l’Allemagne, le Japon n’est pas divisé en plusieurs zones d’occupation : la principale raison étant que le conflit entre les États-Unis et l’URSS a déjà pris des proportions beaucoup plus vastes en Orient qu’en Europe, quelques mois avant que la guerre ne s’arrête en mai 1945. La plupart des villes japonaises sont détruites, la population meurt de faim, et une bonne partie de la flotte est coulée ou endommagée. Pendant la guerre, le Japon a perdu environ 1200 bateaux de commerce (ce qui correspond à 63 % du tonnage commercial). En résumé, le pays est "amputé".
Ayant perdu le contrôle de la spirale de guerre, le Japon doit se soumettre à la domination américaine et est occupé pour la première fois. Il perd son statut de première puissance impérialiste dans la région.
Les destructions en Chine sont tout autant dévastatrices. Paradoxalement, la Corée, la colonie japonaise, est largement épargnée par les hostilités, mais seulement pour devenir un nouveau théâtre de guerre quelques années plus tard.
1"Le vaisseau amiral USS Indianapolis américain, qui avait transporté la première bombe atomique dans le Pacifique avant qu’elle ne soit jetée sur Hiroshima, fut coulé par les torpilles japonaises. Alors que la majorité de l’équipage survécut, quelques 600 marines – s’accrochant à leurs bateaux de sauvetage une fois que le bateau se fut retourné – furent tués par les requins. Désastre nucléaire pour la population de Hiroshima ! Mort par les requins pour les soldats US qui transportaient la bombe !" (Andrew West, Campaigns of World War II, The Pacific War, London, 2000).
Géographique:
- Japon [164]
Evènements historiques:
La Seconde Guerre mondiale se termine, la guerre froide commence
- 1251 lectures
Une fois la guerre en Europe finie en mai 1945, et le butin en Europe partagé entre les vainqueurs, la bataille pour la domination de l’Asie commence. Déjà, quand la bataille touche à sa fin en Europe, 3 zones de conflits deviennent immédiatement des champs de bataille en Asie orientale.
La première zone de conflit concerne celle où le Japon était dominant. Il est évident que l’effondrement du régime militaire japonais et son élimination de la Chine et de la Corée laissent une place vide, ce qui ne peut qu’aiguiser les appétits de tous les gangsters impérialistes.
Le premier pays à tenter sa chance et à occuper ce "vide" est la Russie qui, presque quatre décennies plus tôt, dans la guerre de 1904-1905, avait subi une grosse défaite contre le Japon. Cependant, dans une première phase, c'est_à-dire après l’attaque japonaise de Pearl Harbour en décembre 1941, (et aussi plus tard, fin 1944/début 1945, au moment de la Conférence de Yalta tenue en février 1945) les États-Unis pensent encore que, la bataille avec le Japon ayant atteint une intensité inouïe en Extrême-Orient, ils auront besoin de la chair à canon russe pour la bataille finale avec le Japon. Bien qu’économiquement très affaiblie et ayant perdu plus de 20 millions de morts dans la guerre, l’URSS a été capable de se renforcer sur l’échiquier impérialiste À la Conférence de Yalta, l’URSS réclame la Mandchourie, l’archipel des Kouriles, Sakhaline, et la Corée au nord du 38ème parallèle, ainsi que les ports chinois de Dalian et Lüshün (appelé Port-Arthur quand il était occupé par les russes) qui deviendront des bases navales russes. Le régime de Staline vise directement le Japon. La Russie cherche de nouveau à étendre sa domination en Extrême-Orient. La guerre tirant à sa fin en Europe, les intérêts stratégiques de la Russie changent. La Russie a bénéficié du carnage entre la Chine et le Japon et plus tard, de la guerre entre le Japon et les États-Unis. Pendant la guerre, le Japon étant prisonnier de sa guerre avec la Chine et les États-Unis, il n’allait pas être capable d’attaquer la Russie en Sibérie, comme les nazis allemands l’avaient poussé à faire. Comme la Russie et le Japon partagent l’intérêt commun de protéger leurs arrières de toute agression (la Russie voulant éloigner le Japon, l’allié de son ennemi, l’Allemagne; le Japon voulant le maintien de la Russie, alliée des États-Unis, dans une position de neutralité), les deux pays pratiquent une politique "de non-agression" l’un vis-à-vis de l’autre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais vers la fin de 1944-1945, quand la fin de la guerre en Europe est en vue, les États-Unis poussent la Russie à prendre part à la tempête sur le Japon. Staline s’arrange même pour arracher un soutien militaire et logistique américain pour armer et transporter les troupes russes à l’est.
A Yalta, l’URSS et les États-Unis sont encore d’accord : Une fois la guerre terminée en Europe, l’URSS recevra sa part après la défaite du Japon. Cependant, une fois la guerre terminée en Europe, qui voit la Russie comme grand vainqueur obtenant de vastes parties de l’Europe de l’est et la partie est de l’Allemagne, l’impérialisme américain change sa stratégie afin d’éviter une participation russe à la fin de la guerre contre le Japon.
L’impérialisme russe, cependant, persiste et signe et mobilise une armée d’un million et demi de soldats, plus de 5000 chars, et 3800 avions dans les cents jours après la fin de la guerre en Allemagne1. Ses troupes traversent la Chine du Nord et occupent un territoire de la taille de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Pologne réunies. La Russie déclare la guerre au Japon le 9 août, le jour où les États-Unis lancent la première bombe atomique sur Hiroshima et, le 10 août, les troupes russes prennent d’assaut la Corée occupée par les japonais, avançant rapidement jusqu‘au 38ème parallèle, jusqu'au nord de Séoul. Les troupes russes deviennent la force d’occupation de grandes parties de la Chine et de la Corée du Nord et se mobilisent pour un débarquement au Japon. Les États-Unis voient alors leurs positions menacées.
Bien que le Japon ait été substantiellement affaibli par les bombardements incessants d’avant août 1945, et alors que certaines parties de la bourgeoisie japonaise aient essayé d’établir une trêve, les États-Unis décident de lancer les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : elles sont destinées non pas tant à la défaite d’un Japon déjà à genoux, mais surtout à servir d’avertissement envers la Russie dans la nouvelle polarisation entre les deux grands blocs impérialistes, russe et américain.
Ainsi, le premier grand choc, quoiqu’indirect, entre la Russie et les États-Unis se produit à cause du Japon. Mais un second théâtre de confrontation se prépare déjà : la bataille pour la Chine où l’écroulement de la domination japonaise aiguise l’appétit de tous les gangsters impérialistes.
1"La défaite de l’armée russe en 1904 avait laissé des souvenirs amers dans le cœur de notre peuple. C’était une tache sur notre nation. Notre peuple a attendu, croyant qu’il devrait un jour défaire le Japon et laver cette tâche. Notre génération d’anciens a attendu 40 ans que ce jour arrive." (cité par Jörg Friedrich,Yalu : An den Ufern des dritten Weltkrieges (à la veille de la 3e guerre mondiale), Berlin, 2007).
Evènements historiques:
- Yalta [624]
Corée: de sa libération en tant que colonie au plongeon dans la guerre et la division
- 824 lectures
Deux guerres pour le contrôle de la péninsule coréenne ont déjà été menées au tournant du 20ème siècle. La Chine et le Japon s’y affrontent en 1894 ; en 1904, la Russie et le Japon entrent en guerre pour la domination de la Corée et de la Mandchourie. Staline, à la Conférence de Yalta en 1945, insiste pour que la Corée soit divisée au niveau du 38ème parallèle, i.e. une division entre nord et sud que la Russie réclamait déjà en 1904 avant d’être éjectée de la région par l’impérialisme japonais.
Auparavant, en août 1945, la Russie occupe la Corée jusqu’au 38ème parallèle juste au nord de Séoul. Cette configuration durera de 1945 à 1950, c'est-à-dire pendant la période de la guerre en Chine. Cependant, la formation de la République Populaire chinoise ajoute un nouvel élément au panier de crabes impérialistes. Après avoir reçu le feu-vert des russes, Kim Il Sung,1 qui s’est battu pour eux pendant la Seconde Guerre mondiale, passe à l’offensive au-delà du 38ème parallèle avec l’espoir de rejeter, par une attaque éclair, les forces américaines du territoire coréen.
La guerre se développe en quatre phases :
dans un premier temps, les troupes nord coréennes fondent sur Séoul le 25 juin 1950. En septembre 1950, toute la Corée du Sud a été conquise par la Corée du Nord, seule la région autour de la ville de Pusan résiste à l’offensive nord-coréenne et à un siège sanglant, et reste dans les mains sud-coréennes.
Dans une seconde phase – à la suite de la mobilisation massive de troupes sous direction américaine – Séoul est repris le 27 septembre. Les troupes des Nations Unies conduites par les États-Unis continuent leur offensive vers le Nord et, à fin novembre 1950, occupent Pyongyang et atteignent le Yalou, frontière entre la Chine et la Corée ;
Dans une troisième phase, la Chine entre ouvertement dans la guerre avec l’envoi de millions de "volontaires" chinois qui se battront du côté nord coréen. Le 4 janvier 1951, Séoul est repris par les troupes chinoises et nord coréennes (avec une mobilisation de 400 000 soldats chinois et de 100 000 soldats nord-coréens)
Suite à une nouvelle contrattaque, Séoul retombe dans les mains américaines en mars 1951. Entre le printemps 1951 et la fin de la trêve (27 juillet 1953), le front ne bouge presque plus. La guerre tombe rapidement dans une impasse et il n’y aura pas de victoires majeures pendant deux ans.
Cette guerre est une confrontation horrifiante entre les deux superpuissances et devient l’une des plus meurtrières et destructrices de la période de la guerre froide.
Pendant la guerre, les États-Unis testent toutes sortes d’armes (par exemple, les armes chimiques, Anthrax et napalm). L’intensité des destructions est telle que presque toutes les villes attaquées sont rasées jusqu’au sol ; par exemple, les deux capitales, Séoul et Pyongyang sont toutes les deux écrasées sous les bombardements américains. Le commandement américain dit : "nous ne pouvons plus penser à bombarder une quelconque ville en Corée du Nord, il n’y a presque plus de maison qui tienne debout". Les forces aériennes ont pour ordre de "détruire tous les moyens de communication et toute installation, usine, ville et village". Dans l’espace d’une année, presque tout le pays est réduit à des ruines par les bombardements. Aucun camp ne réussit à imposer ses objectifs militaires. La guerre se répand rapidement mais il faudra des années pour arriver à une trêve. Au niveau militaire, la guerre finit où elle a commencé, la frontière (telle qu’elle avait été établie avant le déclenchement de la guerre) ne bouge pas.
On estime à environ deux millions le nombre des morts en Corée du Nord et à un million au Sud. Le Général Curtis Le May, qui dirigea le bombardement de Tokyo en 1945, fit ce bilan : "nous avons détruit chaque ville en Corée du Nord et certaines en Corée du Sud aussi. Sur une période de trois ans à peu près, nous avons tué 20 % de la population de Corée, soit du fait de la guerre, soit à cause de la famine et du manque d’abri".2
La Corée du Nord perd 11 % de sa population, avec un tribut élevé de morts dans la population civile. L’armée nord-coréenne perd quelques 500 000 soldats (tués, blessés, disparus), l’armée chinoise déplore environ 900 000 victimes, l’armée sud coréenne à peu près 300 000 et les États-Unis subissent le quatrième plus grand nombre de victimes de leur histoire ; 142 000 soldats au total périssent.
Cette guerre voit la première apparition de l’impérialisme chinois. La Chine, qui a été dépendante des ventes d’armes russes, essaie en même temps de compenser les limites de son arsenal d’armes par l’emploi presque illimité de chair à canon humaine. Mao ne cache pas les ambitions et le cynisme de son régime, quand il déclare en 1952 : "la guerre a été une grande expérience et un apprentissage pour nous… Ces exercices sont mieux que n’importe quelle académie militaire. Si nous continuons à combattre une autre année, nous aurons alors réussi à ce que toute nos troupes se familiarisent avec la guerre".3 Même quand la guerre touche à sa fin, en 1953, la Chine prépare sa sixième offensive contre les États-Unis. En octobre 1951 déjà, la Chine avait mobilisé 1,5 millions de soldats, et le pays consacrait la moitié de son budget étatique à la guerre.
En octobre 1951, les États-Unis durent quadrupler leurs dépenses militaires pour couvrir les coûts croissant de la guerre.
Les deux côtés sont prêts à jeter dans la balance tout leur poids économique et militaire. Staline, Mao, Chiang et Truman avaient tous fait un front contre le Japon 6 ans avant seulement, au temps de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre de Corée, ils cherchaient tous les moyens possibles de s’annihiler les uns les autres. Les autorités militaires américaines envisagèrent un bombardement nucléaire sur 24 villes chinoises, parmi les cibles programmées il y avait Shanghai, Nankin, Beijing, Mukden.
Depuis lors, le pays a été une zone de conflit permanent, au niveau le plus élevé de militarisation. La Corée du Sud est soutenue par les États-Unis pour qui ce pays est une importante tête de pont. À l’image du Japon, la Corée du Sud fut rapidement reconstruite avec l’aide américaine.
Le Nord, qui est à la fois une zone tampon mais aussi une tête de pont importante pour menacer le Japon, est un point crucial pour les stratégies impérialistes de la Chine et de la Russie. Reconstruite sur le modèle stalinien, la partie nord présente de nombreuses similitudes avec les ex-régimes de l’Est européens. Quoique plus développée économiquement que le Sud avant 1945, et plus riche en matières premières et ressources énergétiques, le Nord montre une arriération similaire – typique des régimes étouffés par le militarisme et gouvernés par une clique stalinienne. Tout comme l’union Soviétique, la Corée du Nord est incompétitif sur le marché mondial et ne survit que grâce à une militarisation à outrance. Pratiquement ses seules exportations sont les armements.
La fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée a laissé la Chine continentale, le Japon et la péninsule coréenne en ruines. La guerre a ravagé de grandes régions de l’Asie. Une des conséquences de la création d’une nouvelle constellation impérialiste dans la guerre froide a de plus été que deux pays, la Chine et la Corée, ont été divisés en deux parties (la République Populaire de Chine et la République de Chine sur Taiwan, la Corée du Nord et du Sud), chacune étant alliée de l’un des deux blocs. Le Japon et la Corée du Sud, qui avaient été détruits par la guerre ont tous les deux reçu rapidement des fonds américains pour accélérer leur reconstruction de façon à devenir des appuis militaires et économiques solides pour les États-Unis dans leur confrontation avec leur rival russe et ses alliés.
1Kim Il Sung, né à Pyongyang mais dont la famille s’installe en Mandchourie, entre dans le mouvement de résistance contre l’occupation japonaise et y participe à la guérilla. Lorsque les japonais décident de liquider la guérilla une fois pour toutes, Kim est le seul dirigeant qui survit l’assaut : il est obligé de se retirer en Russie où lui et ses hommes intègrent l’Armée rouge russe. Il deviendra par la suite des évènements le premier dirigeant de la Corée du Nord.
2Jörg Friedrich, Yalu, p. 425. Notre traduction.
3Jörg Friedrich, Yalu, p. 516. Notre traduction.
Géographique:
- Corée du Sud [613]
Evènements historiques:
- Guerre de Corée [625]
La République Populaire de Chine: un nouveau monstre impérialiste et militariste
- 720 lectures
Durant la Seconde guerre mondiale, alors qu'une alliance des États-Unis, de l’URSS et des deux factions rivales de la bourgeoisie chinoise, le Kuomintang et l’Armée Rouge dirigée par les Maoïstes, se battent contre le Japon, Mao propose ses "bons services" aux États-Unis, vantant ses troupes comme étant des alliées plus déterminées et plus capables (une opinion partagée par plusieurs envoyés américains auprès de l’Armée rouge).
Quand la guerre cesse avec le Japon, le conflit au sein de la bourgeoisie chinoise éclate de nouveau au grand jour – alimenté par les appétits impérialistes de la Russie et des États-Unis. Après 1945, les États-Unis, qui ont soutenu le Front Unique Chinois contre le Japon, se mobilisent pour soutenir le KMT. Dans un premier temps, à la suite de la reddition du Japon, les États-Unis rapatrient, grâce à leurs moyens logistiques, environ un million de soldats japonais de la Chine au Japon (à peu près un cinquième de toute l’armée japonaise), pour que les soldats japonais ne tombent pas aux mains des Russes.
A la suite de cette opération de sauvetage des troupes japonaises, entre octobre et décembre 1945, un demi-million de soldats du Kuomintang sont aussi aéroportés par les troupes américaines du sud-ouest au nord de la Chine et vers les centres côtiers.
Comme nous l’avons montré plus haut, le Front Unique entre l’Armée Rouge stalinienne et les forces du KMT est vraiment précaire, déchiré par des conflits répétés et des confrontations directes. Le Japon s’est battu contre deux ailes rivales du capital chinois qui sont constamment à couteaux tirés. Une fois l’ennemi commun - l’impérialisme japonais – disparu, l’antagonisme entre les deux factions chinoises en conflit explose en guerre ouverte en juin 1946. une nouvelle guerre succède à celle de huit ans contre le Japon. Avec quelques trois millions de soldats de son côté au début du conflit, le KMT affiche au début une supériorité numérique sur l’Armée Rouge. De plus, il bénéficie d’un soutien massif des États-Unis. À l’inverse, la Russie, qui revient en force sur le front impérialiste en Asie orientale en août 1945, et occupe la Mandchourie que le Japon a dû abandonner, ne peut dans la première phase fournir autant de matériel (surtout militaire) aux troupes de l’Armée Rouge. Au contraire, du fait de son manque de ressources, la Russie démantèle les équipements locaux et les rapatrie chez elle.
Sur fond d’effondrement économique, largement dû à une économie de guerre incessante (80-90 % du budget alloué à l’armée), le KMT perd une grande partie de ses soutiens et beaucoup de soldats changent de camp. Entre 1937 et 1945, la création monétique est multipliée par 500. Après 1945, sous l’impact de la guerre économique, l’hyper-inflation continue, paupérisant la classe ouvrière et les paysans qui se détournent massivement du KMT.
Après presque 3 ans de combats continuels, l’Armée Rouge parvient à infliger une défaite cuisante aux troupes du KMT. Deux millions au moins de soldats du KMT, et de ceux qui le soutenaient, s’échappent vers l’île de Taiwan.
En octobre 1949, les troupes de Mao déclarent que la Chine continentale est un État indépendant. La République Populaire est proclamée. Cependant, il ne s’agit pas d’une révolution socialistemais du triomphe militaire d’une aile de la bourgeoisie chinoise (soutenue par la Russie) sur une autre aile du capital chinois (soutenue par les États-Unis). La nouvelle République Populaire s’érige sur les ruines d’un pays qui est passé par 12 ans de guerre – précédés par trois décennies de conflits entretenus par des seigneurs de guerre insatiables. Comme tant d’autres "nouveaux" États fondés au 20ème siècle, elle se fonde sur une division en deux parties, Taiwan et la Chine "continentale", entraînant un antagonisme permanent qui va perdurer jusqu’à nos jours.
Ravagée par des décennies d’économie de guerre, soutenue non par un pays techniquement supérieur, les États-Unis, mais par la Russie qui a, comme en Europe de l’Est, pillé les matières premières et démantelé les équipements en Mandchourie et ne peut pas offrir le même soutien matériel, la République Populaire sera marquée par une grande arriération.
A peine finie la guerre en Chine en 1949, la guerre entre la Corée du nord et du sud éclate.
Géographique:
- Chine [610]
Evènements historiques:
- Kuomintang défaite [626]
- Guerre civile en Chine [627]
L'impérialisme en Asie au 21ème siècle
- 2224 lectures
Géographique:
- Chine [610]
- Corée du Sud [613]
- Inde [628]
- Japon [164]
- Pakistan [629]
- Philippines [630]
- Asie [617]
- Australasie [631]
Rubrique:
L'impérialisme en Asie au 21ème siècle - Introduction
- 1968 lectures
Au cours de la première moitié de 2012, plusieurs essais, réussis ou non, de missiles à longue portée, effectués par la Corée (du Nord comme du Sud), la Chine, l’Inde et le Pakistan ont ouvert les yeux sur les ambitions de tous les plus grands pays d’Asie. En même temps, des commandes gigantesques de bateaux de guerre reflètent la militarisation en cours en haute mer,1 dans les océans qui baignent l’Asie. En fait, tous les pays asiatiques ont été forcés de se positionner par rapport aux nouvelles puissances "émergentes", la Chine et l’Inde. Leurs ambitions et la stratégie américaine de créer un contrepoids à la Chine ont déclenché une course aux armements dans tous les pays d’Asie.
 Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.
Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.
Le poids global de l’Asie dans la production mondiale revient aux normes historiques avant le développement du capitalisme européen. Entre le 11ème et le 17ème siècle, la Chine avait la plus grande flotte du monde. Jusqu’au 18ème siècle, la Chine était en avance sur l’Europe au niveau technologique dans beaucoup de domaines. En 1750, la part mondiale de la Chine dans les produits manufacturés était de presque 1/3 alors que l’Europe n’en était encore qu’à 1/4. Mais l’expansion des puissances capitalistes en Chine et en Inde au 19ème siècle a signifié pour ces deux pays2 un "déclassement" et leur part relative dans la production mondiale déclinait.
Aujourd’hui, la Chine est de retour sur la scène. Son "retour" peut-il se passer d’une "manière harmonieuse" et "pacifique" comme le proclament ses dirigeants?
Tous les pays d’ Extrême-Orient3 dépendent largement des voies maritimes des trois goulots d’étranglement : la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca (entre la Malaisie, Singapour, l’Indonésie) et le détroit d’Ormuz (entre l'Iran et Dubaï). "Plus de la moitié du tonnage annuel de la flotte marchande mondiale passe par les détroits de Malacca, Sunda et Lombok (Indonésie) et la plus grande partie continue vers la Mer de Chine du Sud. Le trafic de pétroliers passant par le détroit de Malacca pour gagner la Mer de Chine du Sud est plus de trois fois celui du canal de Suez et bien 5 fois plus grand que le trafic dans le canal de Panama. Pratiquement, tout le fret qui passe par les détroits de Malacca et Sunda, doit passer à proximité des Iles Spratly." 4
90 % du pétrole importé par le Japon passe par la Mer de Chine du Sud. Presque 80 % du pétrole de la Chine passe par le détroit de Malacca. Pour le moment, les États-Unis contrôlent la plupart de ces passages obligés. En tant que puissance émergente, la Chine trouve cette situation insupportable –parce que leur contrôle par une seule puissance telle que les États-Unis pourrait étrangler la Chine.
Alors que le premier grand conflit impérialiste du 20ème siècle a pris place entre deux puissances asiatiques (la guerre russo-japonaise de 1905), les principales batailles de la Première Guerre mondiale ont eu lieu en Europe et les champs de bataille en Asie étaient très marginaux, la Seconde Guerre mondiale a aspiré beaucoup plus l’Asie dans la destruction générale et une puissance asiatique en était un des principaux participants. Quelques-unes des batailles les plus féroces et les plus sanglantes ont eu lieu en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le continent européen était divisé par le "rideau de fer", établi au sein de l’Europe centrale au travers de l’Allemagne divisée, l’Asie faisait l’expérience de la division de quatre pays en deux parties : Corée, Chine, Vietnam (réuni depuis) et Inde. Alors que le "rideau de fer" en Europe était détruit en 1989, les divisions en Asie ont continué à exister, chacune d’elles entraînant des conflits permanents et créant des zones frontières parmi les plus militarisées (Corée du Nord/Corée du Sud, République Populaire de Chine/Taiwan, Pakistan/Inde). Mais maintenant, ce ne sont pas seulement les conflits entre pays divisés qui continuent à alimenter les tensions impérialistes, ce sont surtout l’apparition d’un nouveau challenger, la Chine, et les réactions des pays voisins et de la superpuissance rivale, les États-Unis, qui aggravent les tensions.
1 Cela se réfère à la notion de marine de haute mer (les "eaux bleues" en anglais, c’est à dire en eaux profondes), un terme plutôt imprécis qui désigne en général une marine de guerre capable d’assurer le pouvoir dans les eaux internationales en dehors de ses propres eaux côtières.
2L’Inde n’était pas un pays au 19ème siècle bien sûr. D’ailleurs, on ne peut pas dire que l’Inde comme unité politique ait existé avant le Raj britannique.
3Le terme « Extrême-Orient » est bien sur complètement euro-centriste. Pour les États-Unis, les région est le « Far ouest » alors que pour les pays asiatiques eux-mêmes la région est évidemment centrale. Nous utiliserons donc ce terme uniquement par convention et facilité d’écriture.
4https://globalsecurity.org/military/world/war/spratly-ship.htm [632] et https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shipping_routes_red_black.png [633]
Géographique:
Asie 1945 -1989
- 854 lectures
Alors que la confrontation entre les pays du bloc russe et le bloc américain était au centre de la guerre froide après 1945, c’est une spécificité de la Chine d’avoir rompu avec les deux blocs leaders de l’époque, les États-Unis et la Russie. Les rivalités impérialistes en Orient n’ont donc jamais été limitées au conflit entre les deux blocs, mais depuis sa "libération" du colonialisme japonais, la Chine a montré une tendance à défier tous les autres pays et à essayer "de s’en sortir toute seule". Quand la confrontation Est-Ouest a pris fin en 1989, les germes de l’exacerbation d’une nouvelle confrontation entre Chine et États-Unis, qui avait été "freinée" entre 1972 et 1989, réapparaissaient. Dans le contexte d’un chaos général sur la scène impérialiste, l’émergence économique de Chine sonne nécessairement le réveil de nouvelles confrontations militaires avec les États-Unis.
Le développement de l’impérialisme en Asie a été marqué par une spécificité de l’Inde et de la Chine.
La Chine est entrée dans la période de l'après-guerre dévastée par le militarisme : l’intervention répétée de l’impérialisme occidental pendant le 19ème siècle, l’effondrement du pouvoir d’État central et la montée de celui des seigneurs de guerre, l’invasion japonaise et plus de dix ans de guerre amère et barbare, ensuite la guerre civile entre le Kuomingtang et l’Armée Rouge, jusqu’à ce que le Parti Communiste de Chine (PCC) s’empare du pouvoir en 1949. Tout cela laissait le pays dans un état d’arriération économique extrême (rendu encore plus catastrophique par l’essai de rattraper le monde développé pendant le "Grand Bond en Avant") et faible militairement, dépendante du simple poids du nombre dans une armée de paysans pauvrement armés. Dans le cas de l’Inde, dont l’économie était aussi arriérée par rapport à ses concurrents étrangers, à cause d’une longue période de colonialisme, la nouvelle classe dirigeante qui a pris le pouvoir après l’indépendance en 1947 a encore aggravé cette situation du fait de sa politique semi-isolationniste. L’Inde et la Chine se sont coupées, à des degrés différents, du marché mondial. Ainsi, le stalinisme sous sa forme spécifique de maoïsme en Chine, le "semi-isolationnisme" sous la forme spécifique du "ghandisme" en Inde, ont été des chaînes historiques, ce qui signifie que les deux rivales ont entamé leur émergence à partir d’un niveau très bas de développement. Cela rend d’autant plus frappante la détermination de la classe dominante chinoise à adapter ses forces de façon conséquente, avec une vision à long terme, pour défier les États-Unis.
Après 1989, un changement de la hiérarchie impérialiste en Asie a pris place : globalement, la Chine et l’Inde ont été en progression, le Japon en déclin relatif, alors que la Russie, après avoir presque disparu de la scène mondiale après l’implosion de l’URSS fait une sorte de comeback. La position de la seule superpuissance restante, les États-Unis, s’est affaiblie, non seulement en Asie mais dans le monde entier. Les États-Unis se battent maintenant avec énergie pour maintenir leur supériorité en Asie.
La situation en Asie est dominée par un réseau complexe d’alliances mouvantes et de contre-alliances. Chaque État essaie de se défendre des ambitions de ses rivaux, alors que tous veulent limiter la domination de la Chine sans devenir de simples marionnettes de la seule puissance capable de faire face à la Chine : les États-Unis. Ce réseau d’alliances se voit dans toutes les zones de conflit de la Corée du Nord via Taiwan, la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca, l’Océan Indien, jusqu’au Golfe Persique et au Moyen Orient.
Géographique:
- Asie [617]
Les ambitions impérialistes de la Chine dans la continuité de décennies de militarisme
- 1005 lectures
La République Populaire de Chine (RPC) a été fondée sur la base d’une partition entre la République Populaire de Chine et Taiwan –chacun étant soutenu par un bloc (l’URSS et les États-Unis respectivement). L’histoire de la République Populaire a été marquée depuis sa fondation par une série de conflits militaires avec ses voisins.
1952 : la Chine est largement impliquée dans la guerre de Corée. C’était le premier gros choc dans la région, entre les États-Unis d’un côté, l’Union soviétique et la Chine de l’autre ;
1950-51 : les troupes chinoises occupent le Tibet. Entre 1950 et 1959, il y a eu des combats incessants entre l’armée chinoise et la guérilla tibétaine ;
1958 : la Chine bombarde les Iles Quemoy et Matsu de Taiwan ;
1962 : la Chine est engagée dans un conflit frontalier avec l’Inde dans l’Himalaya. Depuis lors, la Chine a été un défenseur inébranlable du Pakistan dans son bras de fer avec l’Inde ;
1963-1964 : après avoir été des alliés durant plus d’une douzaine d’années, la Chine et l’Union Soviétique se séparent. Alors que l’Union Soviétique est engagée dans une course aux armements avec le bloc dirigé par les États-Unis, survient une confrontation entre la Chine et l’URSS. En mars 1969, un sérieux affrontement se produit sur la rivière Ussuri, avec des douzaines de soldats russes tués ou blessés. En 1972, 44 divisions soviétiques stationnent sur les 7000 km de frontière avec la Chine (alors que la Russie en a "seulement" 31 stationnées en Europe). Un quart de l’aviation soviétique est transférée à la frontière orientale. En 1964, les États-Unis avaient encore envisagé la possibilité d’une attaque nucléaire –avec la Russie – contre la Chine. En 1969, les Russes prévoyaient encore d’envoyer des missiles nucléaires sur la Chine1. Le conflit entre les États-Unis et la Chine commence à perdre de l’importance début 1970. Après une longue guerre sanglante pour essayer d’empêcher le Sud Vietnam de tomber aux mains des Russes, en 1972, les États-Unis réussissent à "neutraliser" la Chine, alors que la confrontation entre Chine et Russie continue et prend la forme de guerres "par procuration". Ensuite, entre 1975 et 1979, juste après la fin de la guerre au Vietnam, une première guerre par procuration se déclenche entre le Vietnam (soutenu par la Russie) et le Cambodge (soutenu par la Chine), d’autres suivent, en particulier en Afrique ;
1979 : la Chine mène une guerre désastreuse de 16 jours avec le Vietnam, dans laquelle les deux belligérants ont mobilisé en tout plus d’un million de soldats et qui a fait des dizaines de milliers de victimes. L’armée chinoise étale de manière criante ses faiblesses. En 1993, elle abandonne la tactique de "guerre du peuple" ou de la "guerre d’usure", basée sur le sacrifice d’un nombre infini de soldats. L’adaptation à la guerre dans des conditions "high tech" commence après cette expérience.
Quand l’Union soviétique envahit l’Afghanistan, en décembre 1979, la RPC devient membre d’une alliance tripartie avec les États-Unis et le Pakistan, pour soutenir la résistance armée afghane islamiste à l’occupation soviétique (1979-1989). La Chine reçoit des équipements militaires des États-Unis pour se défendre contre des attaques soviétiques. L’Armée de Libération Populaire chinoise entraîne et soutient les Moujahidins afghans pendant la guerre de l’Union soviétique en Afghanistan2.
Ainsi, pendant les 4 premières décennies de l’existence de la République Populaire de Chine, le pays est rentré en conflit et a mené des guerres avec presque tous les pays voisins : Union Soviétique, Corée et États-Unis, Japon, Taiwan, Vietnam, Inde. Et pendant de nombreuses années de la guerre froide, la Chine a été simultanément en conflit avec les deux blocs dominants. Sur les 14 nations qui ont des frontières avec la Chine, dix ont connu des conflits frontaliers marquants avec elle. Ainsi, l’exacerbation actuelle des tensions, en particulier avec les États-Unis, n’est pas un phénomène nouveau, c’est dans la continuité de décennies de conflits. Cependant, au cours des dernières années, une nouvelle polarisation sur la Chine se développe.
Alors que pendant des décennies, la RPC a massé ses troupes à la frontière russe, concentré ses forces pour la protection de sa côte, et s’est tenue prête à mener une guerre avec Taiwan, au début des années 1990, la RPC commence à s’adapter à la nouvelle situation mondiale créée par l’effondrement de l’URSS.
Géographique:
- Chine [610]
- Russie [616]
- Vietnam [636]
- Corée du Sud [613]
La Chine s’oriente vers la mer
- 741 lectures
La politique de Beijing durant les vingt dernières années a poursuivi différents objectifs :
de développer une stratégie à long terme pour opérer en haute mer, combinée à des efforts pour acquérir ou développer des armes pour le cyberespace et l’espace et renforcer la puissance de frappe et le niveau de l'aviation. Le but à long terme est d’empêcher les États-Unis d’être la force dominante dans le Pacifique –les militaires appellent ça une capacité "anti-accès/interdiction de zone". L’idée est d’utiliser des attaques au sol ciblées, et des missiles anti-navires, une flotte croissante de sous-marins modernes, des armes cybernétiques et anti-satellites pour détruire ou endommager de loin les équipements militaires d’autres nations. Cet objectif marque un tournant par rapport à la politique qui consistait à concevoir l'essentiel de la modernisation de l’Armée de Libération Populaire dans le but de s’emparer de Taiwan. Alors que, historiquement, le but de conquérir Taiwan et d’agir comme une force côtière qui défend son rivage avec une certaine vision "continentale" était la principale orientation stratégique, la stratégie de la Chine aujourd’hui est d’aller "plus" au large. Cette attitude plus assurée a été influencée par la crise du détroit de Taiwan dans les années 1995-96 qui a vu deux porte-avions US humilier Beijing dans ses eaux territoriales. La Chine investit énormément dans des "capacités asymétriques" dans le dessein d’amoindrir la capacité jadis écrasante des États-Unis à propulser sa puissance dans la région. La Chine vise donc à devenir capable de déclencher des attaques qui désorganisent les bases américaines dans le Pacifique Occidental et de repousser les porte-avions américains au-delà de ce qu’elle appelle la "première chaîne d’îles", délimitant la Mer Jaune, la Mer de Chine du Sud et la Mer de Chine Orientale à l’intérieur d’un arc allant des Aléoutiennes au nord jusqu’à Bornéo au sud. Dans le Pacifique occidental, cela voudrait dire cibler ou mettre en péril les porte-avions américains et ses bases aériennes à Okinawa, en Corée du Sud et même à Guam. Depuis la deuxième guerre mondiale, les alliés des américains dans la région Pacifique de l’Asie ont compté sur le parapluie US pour leur sécurité. Mais maintenant, "croire que les navires de surface des États-Unis et de leurs alliés peuvent opérer en toute sécurité partout dans le Pacifique occidental n’est plus valable" dit un rapport américain. Les groupes de choc de porte-avions, dit aussi ce rapport, devient "de plus en plus vulnérables" à la surveillance et à l’armement chinois jusqu’à 1200 miles nautiques de la côte chinoise1
En même temps, la Chine veut montrer qu’elle est présente aux passages obligés, ce qui veut dire étendre sa présence en Mer de Chine du sud et dans l’Océan Indien. Incapable d’arracher des territoires à ses voisins au nord, à l’est et à l’ouest, elle doit concentrer ses forces sur l’affirmation de sa présence dans la Mer de Chine du Sud et dans l’Océan Indien (défense des mers lointaines) et vers le Moyen Orient. Cela signifie surtout qu’elle doit "déstabiliser", saper la position toujours dominante des États-Unis en haute mer. Tout en revendiquant une position dominante dans la Mer de Chine du Sud, elle a commencé à construire un "collier de perles" autour de l’Inde et à s’infiltrer au Moyen Orient.
1 https://www.fpif.org/articles/asias_mad_arms_race [637]
Géographique:
- Chine [610]
Un "collier de perles" mortel
- 1202 lectures
En plus des liens étroits de longue date avec les régimes du Pakistan et du Myanmar, la Chine a développé une stratégie dite du "collier de perles", en établissant des bases et en tissant des liens diplomatiques. Quelques exemples :
un accord militaire avec la Cambodge a été signé ;
la construction d’un canal à travers l’isthme de Kra en Thaïlande va être financée. Le canal doit faire 102 km de long et 500 mètres de large et va relier l’Océan Indien à la côte Pacifique de la Chine – un projet à l’échelle du canal de Panama. Il pourrait faire basculer les rapports de force en Asie en faveur de la Chine en donnant à sa flotte militaire et commerciale un accès facile à un vaste continuum océanique s’étirant de l’Afrique de l’Est au Japon et à la péninsule coréenne. Ce projet de canal met en question la position de Singapour en tant que principal port de la région et permettrait aux navires chinois d’éviter le détroit de Malacca. Cela a une forte signification stratégique pour le déploiement de la flotte, et remet fortement en question la position prédominante actuelle de l’Inde dans le golfe du Bengale1 ;
Construction d’infrastructures stratégiques au Tibet et au Myanmar ;
Développement d’installations portuaires à Sittwe, Myanmar ;
Installations de services de renseignements électroniques sur des îles dans le golfe du Bengale ;
Ventes de navires lance-missiles au Bangladesh et aide au développement de son port en mer profonde à Chittagong, au Bangladesh ;
Aide militaire étendue au Sri Lanka. La Chine a aidé le Sri Lanka à gagner la guerre contre les Tigres Tamouls en 2009, elle a aussi investi dans le développement du port à Hambantota ;
Construction d’une base navale à Marao aux Maldives ;
Etablissement aux Seychelles de sa première base militaire à l’étranger ;
Construction du port de Gwadar au Pakistan. L’engagement de la Chine dans la construction du port en eau profonde de Gwadar sur la côte sud-ouest du Pakistan a été, en particulier, suivi avec une grande attention à cause de sa position stratégique, à 70 km environ de la frontière iranienne et 400 km à l’est du détroit d’Ormuz – la principale route d’approvisionnement en pétrole. On a dit que çà donnerait à la Chine "un poste d’écoute" d’où elle pourrait surveiller l’activité navale US dans le Golfe Persique et l’activité indienne dans la mer d’Arabie ;
Participation à mission anti-pirates dans le Golfe d’Aden.
 La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.
La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.
En tant que puissance émergente, la Chine réclame plus de poids et d’influence, mais cela ne peut être qu’aux dépens des autres pays, en particulier, au détriment des États-Unis. C’est ce qui polarise toute la situation régionale. Les pays sont poussés vers la Chine ou dans les bras des États-Unis, qu’ils le veuillent ou non.
La classe dominante en Chine veut nous faire croire que l’ascension de Beijing se veut pacifique, que la Chine n’a aucune intention expansionniste, qu’elle sera une sorte différente de grande puissance. La réalité dans les 20 dernières années, c’est que la montée de la Chine est inséparable de ses ambitions impérialistes et militaires croissantes. Il est certainement impensable pour le moment que la Chine puisse défaire les États-Unis ou se mettre à la tête d’un nouveau bloc chinois. Cependant, alors que le principal impact de l’ascension de la Chine a été de saper la supériorité américaine, ses ambitions ont déclenché une nouvelle course aux armements. De plus, le poids accru de la Chine au niveau mondial a encouragé la tête de l’ex-bloc déclinant, la Russie, à se positionner aux côtés de la Chine dans beaucoup de conflits avec les États-Unis (par exemple en Syrie, Iran) et à soutenir (ouvertement ou de façon cachée) tous ces régimes qui sont dénoncés par les États-Unis comme des États "voyous" (Corée du Nord, Iran) ou qui sont des "États défaillants" comme le Pakistan. Bien que la Russie ne soit pas non plus intéressée à voir la Chine devenir trop forte, et que Moscou ne veuille pas devenir un vassal de la Chine, la Russie a l’impression d’avoir une nouvelle marge de manœuvre en agissant avec la Chine contre les États-Unis. La Russie a ainsi fait plusieurs exercices militaires avec la Chine dans la Mer Jaune.
Géographique:
- Chine [610]
- Vietnam [636]
- Corée du Sud [613]
- Japon [164]
- Australasie [631]
La course aux armements entre la Chine et ses rivaux
- 1055 lectures
Depuis 1989, le budget militaire a augmenté en moyenne de 12,9 % par an, selon GlobalSecurity.org, et c’est maintenant le second budget le plus élevé sur la planète. Le budget global des États-Unis pour la sécurité nationale –ne prenant pas en compte les différentes guerres dans lesquelles Washington est impliqué– s’élève à un peu plus de 800 milliards de dollars, encore que quelques estimations le chiffrent à plus de mille milliards de dollars. Le groupe de recherche globale IHS a prévu que les dépenses militaires de Beijing verraient doubler leur chiffre de 2011, 119.8 milliards de dollars US pour atteindre 238.2 milliards en 2015. Cela dépasse les sommes dépensées par les 12 marchés clefs de la défense de la région, y compris le Japon et l’Inde. En 2011, les dépenses militaires étaient plus élevées de 80 % que celles du Japon et de 200 % que celles de l’Inde. Le budget militaire de la Chine en 2011 était 2,5 fois plus grand qu’en 2001 et a doublé tous les 5 ans. Le budget militaire de la Chine représente 30 % du total des budgets militaires en Asie, bien que selon les officiels de la défense occidentale, ces totaux n’incluent pas les importations d’armes. En réalité, le budget militaire global est donc beaucoup plus élevé. Si les prévisions se réalisent, les dépenses militaires de la Chine vont dépasser le montant réuni des dépenses militaires des 8 principaux membres de l’OTAN, États Unis non compris. Alors qu’en 2000, le budget militaire des États-Unis était encore 20 fois plus élevé que celui de la Chine, en 2011/2012, le rapport est de 7,11
Les efforts de modernisation de la Chine ont été principalement axés sur l’augmentation de ses capacités balistiques, en mettant au point par exemple des fusées à plus longue portée, et sur l’accroissement de ses capacités de guerre cybernétique. La flotte chinoise est aujourd’hui considérée comme la troisième du monde derrière les États-Unis et la Russie. Le nombre de fantassins dans l’Armée Populaire de Libération a été réduit alors que les troupes dans la marine, les forces aériennes et dans le second corps d’artillerie –qui entretient les missiles nucléaires chinois– ont augmenté.
Alors que la Chine a connu des taux de croissance très élevés, souvent à deux chiffres, le taux de croissance de son budget militaire a été encore plus rapide. L’armée chinoise est certainement partie d’un niveau très bas car la majorité de ses forces était des forces terrestres, mal équipées et vues en grande partie comme de la chair à canon pour les grandes batailles terrestres. Les militaires chinois ont peu d’expérience de combats. Ils n’ont pas été engagés dans un conflit depuis 1979 quand ils se sont fait botter les fesses par le Vietnam. Au contraire, les troupes américaines ont combattu, se sont modernisées, ont adapté leur armement et leurs tactiques de façon constante –en développant leurs capacités antisatellites, des missiles balistiques contre les navires, des missiles de croisière, des capacités pour mener une cyberguerre. La capacité de l’Armée Populaire de Libération (APL) à mener des opérations conjointes et complexes dans un environnement hostile n’a pas été testée. Les missiles et les forces sous-marines chinoises représenteraient une menace pour les porte-avions américains près des côtes de la Chine, mais pas plus loin, au moins pendant un certain temps. Apprendre à utiliser dans les batailles toutes ces armes nouvellement acquises prendra probablement des années. Néanmoins, le projet d’armement ambitieux et la stratégie d’expansion de la Chine ont amené les États-Unis à percevoir ce pays comme un pays parmi "les puissances majeures et émergentes" qui a "le plus grand potentiel pour concurrencer militairement" les États-Unis. Même si, selon le Pentagone, les militaires chinois sont "encore à des décennies de posséder une pleine capacité de combattre et de défaire un adversaire moderne au-delà des frontières de la Chine", des leaders aux États-Unis mettent en garde : "l’armée chinoise grossit et se modernise". "Nous devons être vigilants. Nous devons être forts. Nous devons nous préparer à affronter tout défi. Mais la clef pour cette région va être de développer une nouvelle ère de coopération défensive entre nos pays, ceux qui partagent le fardeau de la sécurité pour faire avancer la paix." (Le secrétaire de la Défense US, Panetta)2
La construction du "collier de perles" et la présence croissante de la Chine dans le Pacifique, ont pour conséquence que tous les pays voisins sont obligés d’adapter leur plans militaires. Quelques exemples :
-
Le Japon qui avait ses armes dirigées principalement contre l’Union Soviétique a changé pour les orienter plus sur la Chine. Malgré les effets de la crise économique, le Japon a planifié de dépenser 284 milliards de dollars entre 2011 et 2015 -entre autres, en déployant plus de missiles Patriot US, et en fournissant plus de navires de haute mer à la Marine. Le Japon et la Chine sont actuellement en bisbille à propos d’une île située entre les deux pays (en japonais, Ile Senkaku, en chinois, Ile Dianoyu), un groupe d’îlots rocheux à limite du plateau continental à environ 100 miles au nord-est de Taiwan3
-
En 2006, la Corée du Sud a entamé un programme à 15 ans de modernisation militaire qui va coûter environ 5,5 milliards de dollars, dont un tiers est prévu pour l’achat d’armes. En 2012, des missiles de croisière ont été testés, avec une portée de 930 miles, donc capables d’atteindre n’importe quel lieu en Corée du Nord. Au vu des derniers clashes avec la Corée du Nord, l’argent disponible pour acheter des armes supplémentaires a été augment4.
-
L’Australie a augmenté son budget militaire. Elle a donné son accord pour l’arrivée de 2500 soldats US en plus et la permission de construire une nouvelle base US dans le pays.
1 Sources: defensetech.org/2011/05/19/pla-chinese-military-doesntcompare-to-u-s-military.
csis.org/press/csis-in./panetta-outlines-us-military-strategy-asia
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm [639]
Shen Dingli in Le Monde Diplomatique, May 2012
Géographique:
- Chine [610]
La Mer de Chine méridionale, premier maillon d’une série de conflits
- 998 lectures
"[La Mer de Chine du Sud] renferme non seulement du pétrole et des sources de gaz situées près de pays grands consommateurs d’énergie, mais elle est aussi la deuxième voie de navigation du monde en terme de trafic qui relie l’Asie du Nord Est et le Pacifique occidental à l’Océan Indien et au Moyen Orient, en la traversant. Plus de la moitié du tonnage mondial du transport maritime passe par la Mer de Chine Méridionale chaque année. Plus de 80 % du pétrole pour le Japon, la Corée du Sud et Taiwan passe par cette région.
Jose Almonte, ancien conseiller pour la sécurité nationale dans le gouvernement philippin, parle sans fard de l’importance stratégique de cette région. La grande puissance qui contrôle la Mer de Chine méridionale exercera sa domination à la fois sur la péninsule et l’archipel de l’Asie du Sud Est, et jouera un rôle décisif dans l’avenir du Pacifique occidental et de l’Océan Indien – de même que sur les voies de navigation stratégiques pour le pétrole du Moyen Orient"1
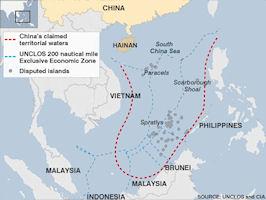 La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.
La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.
Les conflits entre les États côtiers pour la domination de cette zone sont très anciens. La Chine et le Vietnam se sont affrontés, en 1978, pour contrôler les Iles Spratly (le Vietnam qui était soutenu par Moscou à cette époque les réclamait) ; le leader chinois, Deng Tsiao Ping, a alors averti Moscou que la Chine était préparée à une guerre à grande échelle contre l’URSS). La position plus agressive de la Chine vis-à-vis de cette zone a pris un tournant après 1991. À cette époque, la Chine a pris les premières mesures pour s’installer dans la Mer de Chine du Sud et remplir le vide créé par le retrait des forces US des Philippines en 1991). La Chine a réaffirmé ses revendications "historiques" et fondées en rien sur le droit légal international, sur toutes les petites îles, y compris les archipels Paracels et Spratly et sur 80 % des eaux le long de la ligne en neuf traits,2 sur la carte de la mer de Chine du sud. Malgré des négociations, aucune solution n’a été trouvée pour les deux grands groupes d’îles –les Paracels (ou Xisha et Zhongsha) à propos desquelles la Chine a encore eu des conflits militaires avec le Vietnam en 1988 et 1992. Ces îles peuvent être utilisées comme bases aériennes et navales pour des services de renseignements et de surveillance ainsi que des activités de reconnaissance, et en tant qu’argument de base pour revendiquer la partie la plus profonde de la Mer de Chine du Sud pour les sous-marins chinois équipés de missiles balistiques et d’autres navires. On dit que la Chine construit une base de missiles terre-mer dans la province de Guangdong au sud de la Chine, avec des missiles capables d’atteindre le Vietnam et les Philippines. Cette base est considérée comme le fruit d’un effort pour donner du poids aux revendications territoriales chinoises sur de grandes zones de la Mer de Chine du Sud revendiquées par les pays voisins et pour faire face aux porte-avions américains qui patrouillent actuellement sans problème dans cette zone. La Chine a même déclaré la zone comme étant d’un "intérêt fondamental" pour elle, mettant la zone marine au même niveau de signification que le Tibet et Taiwan pour la Chine.
La Mer de Chine du Sud est la zone la plus fragile, la plus instable -parce que la Chine n’y est en concurrence avec aucun de ses grands rivaux. Elle fait face à nombre de petits pays plus faibles –Vietnam, Philippines, Brunei, Malaisie, Singapour, Indonésie– qui sont tous trop petits pour se défendre seuls. En conséquence tous ces pays voisins sont obligés de chercher l’aide d’un plus grand allié. Cela veut dire d’abord et avant tout les États-Unis, mais aussi le Japon et l’Inde qui ont offert leur "protection" à ces États. Ces deux derniers pays ont participé, par exemple, à plusieurs manœuvres avec le Vietnam et Singapour.
Une des principales cibles de cette course aux armements qui s’est déclenchée en Asie se trouve dans les pays de la Mer de Chine du sud. Bien que le Vietnam n’ait pas les moyens militaires et financiers pour s’aligner sur la Chine, il a acheté des armes à des compagnies européennes et russes –y compris des sous-marins. Les importations d’armes augmentent en Malaisie. Entre 2005 et 2009, ce pays a multiplié ses importations d’armes par 7 par rapport à la période couvrant les 5 années précédentes. La petite Cité-État de Singapour, qui planifie d’acquérir deux sous-marins, est maintenant parmi les dix premiers importateurs d’armes mondiaux. L’Australie planifie de dépenser au moins 279 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années dans des nouveaux sous-marins, destroyers et avions de combat. L’Indonésie veut acquérir des missiles à longue portée. Les Philippines dépensent presque 1 milliard de dollars pour un nouvel avion et des radars. La Chine a environ 62 sous-marins maintenant, et en attend 15 autres dans les prochaines années. L’Inde, la Corée du Sud et le Vietnam vont acquérir 6 nouveaux sous-marins chacun en 2020. Les plans de l’Australie sont d’en ajouter 12 dans les 20 ans à venir. Singapour, l’Indonésie et la Malaisie en ajoutent deux chacun. Toutes ensemble, ces acquisitions constituent une des plus grandes accumulations de sous-marins depuis les années du début de la guerre froide. On s’attend à ce que les nations asiatiques achètent jusqu’à 111 sous-marins dans les 20 prochaines années.3
1 https://www [643]. Japanfocus.org/-Suisheng-Zao/2978
3 www.wsj.com [645], February 12, 2011.
Géographique:
- Vietnam [636]
- Chine [610]
- Philippines [630]
Un autre point chaud: l’Océan Indien
- 815 lectures
Il n’y a pas que le Pacifique et la Mer de Chine Méridionale qui soient le théâtre de rivalités impérialistes, l’Océan Indien est aussi devenu une zone où se déploient toutes les rivalités.
Les voies maritimes dans l’Océan Indien sont considérées comme les plus importantes stratégiquement dans le monde – selon le "Journal de la région de l’Océan Indien", plus de 80 % du commerce maritime du pétrole transite par des goulots d’étranglement dans l’Océan Indien, avec 40 % passant par le détroit d’Ormuz, 35 % par le détroit de Malacca et 8 % par le détroit de Bab-el-Mandeb. La moitié des porte-containers du monde naviguent sur cette route maritime vitale. Mais il ne s’agit pas seulement de voies maritimes et de commerce. Plus de la moitié des conflits armés dans le monde se situent actuellement dans la région de l’Océan Indien. En plus d’être le théâtre des ambitions impérialistes de la Chine et de l’Inde, il y a le danger d’une confrontation nucléaire entre Inde et Pakistan, les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, le conflit permanent autour de l’Iran, le terrorisme islamiste, la fréquence croissante des actes de piraterie dans et autour de la Corne de l’Afrique et des conflits dus à la diminution des ressources halieutiques.
En fait, l’Océan Indien est une "interface" cruciale entre la vieille zone de tensions impérialistes au Moyen Orient, et celle où les tensions sont en train de croître en Asie du Sud Est, dans la Mer de Chine méridionale et dans tout le Pacifique. Bien qu’il y ait des spéculations sur la possibilité que l’Océan Indien puisse receler 40 % de la production mondiale de pétrole, et qu’il y a eu des explorations pétrolières récentes dans les mers de l’Inde, du Sri Lanka et du Myanmar, l’importance de cet océan s’est surtout accrue depuis que le déclin relatif de la puissance des États-Unis dans la région a laissé un vide qui est de plus en plus rempli par la Chine et l’Inde.
Il n’y pas que la Chine qui essaie de renforcer sa présence dans l’Océan Indien. Le Japon est prêt à participer aux efforts pour contenir la Chine et a promis au Myanmar, à la Thaïlande, au Vietnam, Laos et Cambodge, 7,18 milliards de dollars d’aide au développement dans les trois prochaines années pour contribuer à la construction d’infrastructure, y compris un train à grande vitesse, un port et des projets d’adductions d’eau. Mais c’est surtout le plus grand pays du littoral de l’Océan Indien, l’Inde, qui a traditionnellement une vision stratégique orientée vers le territoire, qui a été obligée de contrer la pénétration de la Chine dans l’Océan Indien. Il y a beaucoup en jeu pour l’Inde : elle importe quelques 70 % de son pétrole et de son gaz dont environ les deux-tiers sont acheminés via l’Océan Indien. L’Inde est le quatrième plus grand consommateur de pétrole du monde et dépend des cargaisons de brut en provenance des pays du Moyen Orient, y compris l’Arabie Saoudite et l’Iran. Elle importe aussi de grandes quantités de charbon d’Indonésie et d’Australie. Cette dépendance et le rôle crucial des voies maritimes le long de ses côtes ont rendu l’Inde très vulnérable côté mer. Bien sûr, l’émergence de l’Inde en tant que nouvel acteur régional a accru ses appétits impérialistes.
Géographique:
L’Inde - fermement sous l’emprise du cancer militariste
- 1494 lectures
Historiquement, l’Inde a été considérée comme le joyau de la couronne par le colonialisme britannique. Quand, après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants coloniaux anglais n’ont plus été en mesure de la contrôler, ils l’ont divisée. Presque en même temps que la Corée et la Chine, l’ancien Raj a aussi été divisé en deux parties –le Pakistan dominé par les musulmans, et l’Inde multi-religieuse à majorité Hindou1. Les deux pays sont engagés dans une guerre froide permanente avec 4 guerres intenses depuis lors. Dès que l’indépendance a été déclarée en 1947, un conflit militaire a éclaté entre eux pour le contrôle du territoire contesté et stratégiquement vital du Cachemire. Le Pakistan a occupé un tiers du Cachemire, l’Inde en a occupé les trois cinquième (une partie du Cachemire est toujours occupée par la Chine). Dans la guerre indo-pakistanaise de 1965, l’Inde a attaqué le Pakistan sur tous les fronts à la suite de tentatives de troupes pakistanaises de s’infiltrer dans la partie du Cachemire contrôlée par l’Inde.
La guerre indo-pakistanaise de 1971 s’est menée sur la question de l’autonomie au Pakistan oriental, l’Inde a battu le Pakistan de façon décisive, ce qui a eu pour résultat la création du Bangladesh (note)2
En 1999, le Pakistan et l’Inde ont eu des accrochages frontaliers pendant 11 semaines dans la province septentrionale disputée du Cachemire. Ces dernières années, des attaques terroristes répétées -soutenues par le Pakistan- ont contribué à maintenir l’inimitié entre ces deux puissances nucléaires.
A l’époque de l’indépendance de l’Inde, la classe dominante indienne était encore capable de se tenir en dehors de la confrontation entre le bloc dirigé par les États-Unis et le bloc de l’Est dirigé par l’URSS. L’Inde a pris part à la création du Mouvement des non-alignés, fondamentalement parce que les principaux fronts de la confrontation entre les deux blocs était en Europe et en Asie du Sud Est (cf. la Guerre de Corée). En tant que membre des nations non-alignées3, l’Inde s’est coupée du soutien militaire des États-Unis, et a été forcée de se tourner vers la Russie pour les fournitures et équipements militaires et même pour certains investissements industriels, bien que le pays n’ait jamais fait partie du bloc russe. Cependant, la tentative de l’Inde de se tenir à l’écart de la confrontation Est-Ouest n’a pas empêché un clash avec la Chine et, en 1962, ces deux pays se sont engagés dans une courte guerre sur la frontière de l’Himalaya. La guerre a convaincu les militaires indiens de se réorienter sur la fabrication d’armes et d’améliorer les relations avec les États-Unis.
L’Inde fait face à deux ennemis jurés –le Pakistan et la Chine, cette dernière soutenant fortement le Pakistan. Malgré de nombreux efforts diplomatiques, les disputes sur la frontière entre l’Inde et la Chine n’ont pas disparu. L’Inde affirme que la Chine occupe plus de 36 000 km² du territoire indien dans l’Aksai Chin, le long de sa frontière au nord du Cachemire (communément appelé le secteur occidental) tandis que la Chine réclame plus 88 000 km² de l’État indien Arunachadal Pradesh (communément appelé le secteur oriental), au nord est. L’Inde héberge aussi depuis longtemps le Dalaï Lama et environ 100 000 réfugiés tibétains qui se sont enfuis après que la Chine ait annexé le Tibet en 1950. Ces dernières années, la Chine a aussi intensifié ses constructions militaires le long de la frontière indienne, en particulier au Tibet. Par exemple, l’aviation de l’Armée Populaire de Libération a établi au moins quatre bases aériennes au Tibet et 3 dans le sud de la Chine, capables de monter des opérations contre l’Inde.4
A l’exception des britanniques, tous ceux qui ont régné sur l’Inde avaient une vision orientée surtout sur le territoire. Depuis l’indépendance de l’Inde, les plus grands conflits dans lesquels le pays a été impliquée ou qui ont éclaté dans la région, (Afghanistan, Irak, Iran) ont eu lieu sur terre, sans grandes batailles en mer. Le développement rapide de la puissance navale indienne est un phénomène récent qui ne peut donc s’expliquer que par la confrontation générale qui se dessine en Asie. Après avoir fixé son regard surtout sur une menace du Pakistan et de la Chine sur son flanc nord-est, l’Inde fait maintenant face à un nouveau défi –défendre ses positions dans l’Océan Indien.5
Il n’est donc pas étonnant que l’Inde ait commandé à la Russie environ 350 tanks T-90S et quelques 250-300 avions de combat et qu'elle ait décidé de produire à peu près 1000 tanks en Inde même.6
Pour faire face à la stratégie chinoise du "collier de perles", la marine indienne a accru ses moyen maritimes en acquérant des porte-avions, des tankers et des bateaux pour le transport de troupes. Dans la prochaine décennie, l’Inde prévoit d’ajouter 100 nouveaux bateaux de guerre à sa force navale. L’Inde a maintenant la cinquième flotte du monde. Alors que ce pays continue à moderniser ses forces terrestres, et a besoin de garder des milliers de soldats mobilisés à ses frontières avec le Pakistan, l’armée chinoise a mis plus l'effort sur ses navires de haute mer et sur l’accroissement de ses capacités balistiques "hors zone".
L'Inde étant inférieure à la Chine sur le plan militaire et économique, l’expansion chinoise dans l’Océan Indien l'a obligée à chercher un allié dont les intérêts sont aussi opposés à ceux de la Chine. D’où la convergence d’intérêts entre les États-Unis et l’Inde. Il est révélateur que l’Inde, qui a pu dans les années 1950 rester en dehors de la zone des conflits majeurs entre l’Est et l’Ouest, soit poussée maintenant à une lutte de pouvoir avec la Chine et forcée de se rapprocher des États-Unis. L’Inde fait déjà annuellement plus de manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis que n’importe quel pays dans le monde. Malgré de fortes hésitations dans certaines parties de la classe dominante indienne, qui se méfient des États-Unis après tant d’années de liens étroits avec l’Union Soviétique, l’Inde et les États-Unis sont condamnés à un "partenariat". Les États-Unis n’ont d’autre choix que de favoriser la modernisation et l’armement de l’Inde. Dans ce contexte, ils ont tacitement ou directement soutenu les pas en avant qu’a fait l’Inde pour développer une puissance nucléaire –ce qui ne peut être vu, à la fois par le Pakistan et la Chine, que comme une menace directe.

"Avant tout, le raisonnement géostratégique d’une alliance entre les États-Unis et l’Inde est l’encerclement ou le "containment" de la République Populaire de Chine. L’Inde peut être le seul contre-poids à la Chine dans la région. L’autre raisonnement ou l’intention présidant à une telle coopération est la neutralisation de la Russie comme acteur en Asie Centrale et la sécurisation des ressources énergétiques à la fois pour l’Inde et pour les États-Unis. Les États-Unis ont aussi utilisé l’Inde dans le but d’essayer d’isoler l’Iran."7
Comme beaucoup de pays d’Asie du Sud-Est et comme la Chine, l’Inde a aussi intensifié sa course aux armements. Le budget de la défense, qui est en gros de 3,2 milliards de dollars en 2011 s’est accru de 151 % au cours de la dernière décennie. Les dépenses de l’Inde pour la défense vont augmenter de 17 % au cours de l’exercice financier 2012-2013. Le gouvernement prévoit que les dépenses militaires vont augmenter de 8,3 % par an dans les prochaines années. Les importations des principales armes se sont accrues de 38 % entre 2002-2006 et 2007-2011. L’Inde a dépensé quelques 12,7 milliards de dollars en armes, 80 % provenant de la Russie, entre 2007 et 2011, selon le SIPRI8.
L’Inde a établi des postes d’écoute au nord de Madagascar, aux Seychelles et sur l’Ile Maurice ; fin 2009, elle a réussi à coopter les Maldives comme participant au commandement de sa flotte du Sud. L’Inde a établi sa première base militaire en terre étrangère, à Ayni au Tadjikistan. Dans ce contexte, les derniers essais de missiles à longue portée font partie de la stratégie globale de l’impérialisme indien.
Le pays a commencé à développer des relations économiques et surtout militaires plus étroites avec la Japon et le Vietnam. L’Inde a fait du renforcement de ses liens avec le Japon une priorité, en accroissant les contacts au niveau militaire, la coopération au niveau maritime, les rapports commerciaux et les investissements. Tokyo, en retour, a engagé 4,5 milliards de dollars en prêts bonifiés dans la construction de la voie ferrée destinée au transport entre Delhi et Mumbai. Une déclaration commune sur la sécurité a été signée en 2008 avec le Japon, qui stipule que leur partenariat est "un pilier essentiel pour la future architecture de la région" 9 Le Japon a participé à plusieurs reprises à des manœuvres navales aux Malabar dans l’Océan Indien. Non seulement l’Inde se sent particulièrement menacée, par la connexion entre Chine et Pakistan, elle est aussi alarmée par le soutien financier et militaire grandissant de la Chine au Sri Lanka stratégiquement important. L’attitude du régime au Myanmar, qui pendant des années a eu des liens privilégiés avec la Chine, est un autre facteur d’incertitude. L’Inde est donc confrontée à la fois sur ses frontières à l’ouest, au nord, au sud et à l’est et le long de ses côtes à une pression croissante de la Chine. Comme on l’a dit plus haut, l’armée indienne est bloquée par la défense permanente de ses frontières terrestres. La Chine fait des incursions périodiques dans l’État indien du nord, l’Arunachal Pradesh, qui a une frontière avec le Tibet et est revendiqué par Beijing comme étant sien. La Chine, pour contrer le soutien des États-Unis à la puissance nucléaire indienne, a vendu deux nouveaux réacteurs nucléaires au Pakistan. De plus, l’Armée Populaire de Libération est présente dans les zones du Cachemire administrées par le Pakistan de l’Azad Kashmir et du Giltit-Baltistan. Avec la Chine qui contrôle déjà un cinquième de Jammu et du Cachemire, l’armée indienne est face à la réalité d’une présence chinoise des deux côtés, est et ouest, de la fragile région du Cachemire.
Comme nous le verrons plus loin, les intérêts antagoniques dans l’Océan Indien et la stratégie d’armement et de recherche d’alliés recèlent beaucoup d’éléments imprévisibles. Par exemple, début 2008, l’Inde a lancé un satellite espion israélien (TechSAR/Polaris) dans l’espace. Le satellite israélien semblait principalement viser l’Iran. Israël fournit l’Inde en technologie électronique de pointe et il y a des indications qui montrent une coopération plus étroite entre les États-Unis, l’Inde et Israël10 Dans ce contexte de tensions croissantes en Asie, l’Inde fait partie d’un ensemble naval majeur qui va de la côte de l’Afrique de l’Est et de la Mer d’Arabie jusqu’aux rivages de l’Océanie. À côté des flottes américaines et des alliés des États-Unis dans l’OTAN, les flottes de l’Iran, de l’Inde, de la Chine, du Japon, et de l’Australie ont étendu leur présence, avec la justification des problèmes réels causés par les actes de pirateries, en tant que11 Du point de vue international, cela montre le contraste entre d'une part les vieux pays industriels, asphyxiés par le poids croissant de la crise économique, qui ont été forcés de réduire ou de geler leurs dépenses militaires et, d'autre part tous les pays émergents en Asie qui accroissent leurs budgets d’armement. Selon les dernières données fournies par le SIPRI, les 5 plus grands importateurs d’armes en 2007-2011 sont tous des États asiatiques. L’Inde est celle qui reçoit le plus d’armes dans le monde, représentant 10 % du total des armes importées, suivie par la Corée (6 %), le Pakistan (5 %), la Chine (5 %) et Singapour (4 %). 30 % du volume des importations internationales d’armes sont à destination de ces cinq pays, selon le SIPRI. Cette constitution simultanée d’un armement moderne dans la région du Pacifique asiatique et dans l’Asie du Sud-est se fait à une échelle et à une vitesse jamais vues depuis la course aux armements de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union Soviétique.
Alors que les tensions grandissent en Asie orientale et en Asie du Sud Est, l’escalade récente des tensions au Moyen Orient fait que, très vraisemblablement, toute aggravation des conflits au Moyen-Orient et dans la région va avoir des répercussions importantes sur les constellations impérialistes en Asie.
1 La partition a été une des plus grandes opérations de l’histoire de purification ethnique, déplaçant jusqu’à 10 millions de personnes et faisant jusqu’à un million de morts.
3 Le Mouvement des Non-Alignés a été fondé en 1961 à Belgrade, par les dirigeants de la Yougoslavie, l’Egypte, l’Inde et l’Indonésie. Il essayait de créer un espace entre les deux blocs en jouant l’un contre l’autre. Sa marge de manœuvre peut être évaluée d’après le fait que le Cuba de Castro – à l’époque dépendant de la Russie pour sa survie – en était aussi un membre.
4 https://blogs.reuters.com/india-expertzone/2011/07/19/the-china-challeng... [647] -relations/
6 Source : https://www.defense [649] industrydaily.com/indian-army-wants-to-add-another-1000-190-tanks-by-2020-updated-02697/
7 Voir : https://www.globalresearch.ca/geo-strategic-chessboard-war-between-india... [650], Geostrategic chessboard : War between India and China ? by Mahdi Darius Nazemroaya, October 2009.
8 Stokholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org.media/pressreleases/rise-in-international-arms-tra... [651]
Géographique:
- Inde [628]
Le point chaud le plus ancien et le danger de contagion en Orient
- 839 lectures
Pendant les soixante dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre de conflits et de guerres sans fin (Israël-Palestine, Afghanistan, Irak, Iran et maintenant la Syrie). Jusqu’à récemment, l’Asie de l’Est et du Sud-Est n’avait jamais été fortement impliquée dans ces conflits. Mais les rivalités entre les plus grandes puissances asiatiques et les antagonismes entre la Chine et les États-Unis se font de plus en plus sentir également dans les différents conflits au Moyen Orient.
Le Pakistan est courtisé à la fois par les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont besoin du Pakistan pour contrer les différentes variétés de terrorisme qui opèrent dans ce pays et en Afghanistan. Cependant, les factions de la classe dominante au Pakistan ne veulent pas toutes être soumises aux États-Unis. L’engagement du Pakistan dans les guerres américaines déstabilise encore plus le pays (par exemple, les récentes frappes aériennes au Pakistan révèlent la nouvelle stratégie "frapper et tuer", visant les "terroristes" et qui embrasent des régions encore plus grandes du pays). Cette déstabilisation œuvre de plusieurs façons contre la Chine qui, elle, veut un Pakistan fort contre l’Inde.
En ce qui concerne l’Afghanistan, l’Inde a participé aux côtés des forces dirigées par les américains à la mise en place d’un "dispositif de sécurité" en Afghanistan, sous les yeux méfiants de la Chine. Beijing a, de son côté, signé des contrats économiques majeurs avec Kaboul.
L’aggravation du conflit autour de l’Iran a de grandes implications sur les rivalités en Asie. Alors que l’Iran jusqu’en 1978-79 était un avant-poste important du bloc américain contre la Russie, une fois le régime du Shah explosé et le pouvoir pris par les Mollahs, un fort anti-américanisme s’est développé. Plus l’hégémonie américaine faiblissait, plus l’Iran pouvait prétendre être une puissance régionale. Le défi iranien vis-à-vis des États-Unis devait inévitablement recevoir le soutien de la Chine. Au niveau économique, la Chine a bénéficié de l’espace laissé vacant par les sanctions imposées à l’Iran : elle est maintenant le plus grand partenaire commercial de l’Iran. Alors que Beijing s’engage de plus en plus économiquement avec l’Iran, la présence de l’Inde diminue. Elle craint d’être marginalisée en Iran au profit de la Chine, alors même que 12 % de sa consommation de Pétrole est importé d’Iran (le deuxième plus grand fournisseur après l’Arabie Saoudite) elle.
Bien que l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite soient des ennemis jurés, et malgré le soutien de la Chine au régime de Téhéran, la Chine a signé un pacte de coopération sur l’énergie nucléaire civile avec l’Arabie Saoudite, un pays qui fournit presque un cinquième de son pétrole à la Chine. La Chine est contrainte d’éviter les antagonismes avec ses fournisseurs importants de pétrole. C’est une expression de la pratique diplomatique versatile chinoise dans la région, qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quels que soient les antagonismes existant les différents "partenaires". La démarche de la Chine pour maintenir un équilibre dans ses liens avec l’Iran et les États arabes du Golfe, limite les choix économiques et militaires de l’Inde, parce que les saoudiens ont aussi établi des liens spéciaux avec le Pakistan, dont ils ont financé et encouragé le programme nucléaire pendant des années. Il est plausible que le Pakistan puisse secrètement transférer la technologie nucléaire à l’Arabie Saoudite –ce qui doit être vu comme une grande menace pour l’Iran et l’Inde. Cependant, d’autres facteurs rendent la constellation encore plus compliquée et contradictoire1
L’Iran a beaucoup d’ennemis dans la région. Par exemple, l’Arabie Saoudite, lourdement armée (qui projette d’acheter 600-800 tanks allemands et qui a signé récemment un contrat gigantesque pour 130 avions de combat avec les États-Unis)2, et l’Irak, contre qui il a mené une guerre pendant 8 ans dans les années 1980. Israël se sent vulnérable face à une attaque de missiles (nucléaires ?) iraniens et fait fortement pression sur les États-Unis pour frapper militairement les supposés sites nucléaires. Toute escalade autour de l’Iran va donc vraisemblablement créer de grands bouleversements entre les rivaux de l’Iran et ses défenseurs.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, tout conflit au Moyen Orient favorise le retour sur la scène de l’ex-leader de bloc, la Russie. En se liguant avec la Chine, la Russie s’oppose fortement à toute intervention militaire contre l’Iran, et fait tout ce qu’elle peut pour saper la stratégie américaine. La Chine et la Russie, toutes deux, doivent protéger l’Iran de la pression américaine, parce que si le régime de Téhéran tombait, cela renforcerait la position américaine au Moyen Orient et non seulement menacerait, la fourniture de pétrole à la Chine, mais encore affaiblirait la présence stratégique tant de la Russie et que de la Chine dans la région.
Le blocage de la situation impérialiste en Syrie pendant l’été 2012 ne peut se comprendre sans prendre en compte les manœuvres secrètes et la présence non dissimulée de la Chine, de la Russie et de l’Iran dans le conflit. Sans le soutien de ces trois puissances, les pays occidentaux –malgré leurs différences et d’autres facteurs qui les font hésiter– auraient pu être tentées d’intervenir militairement beaucoup plus rapidement.
Les liens chaotiques et contradictoires résultant des rivalités impérialistes au Moyen-Orient, où les conflits entre la puissance régionale, l’Iran, (appuyé par la Chine et la Russie) et les États-Unis (appuyés par Israël, l’Inde, l’Arabie Saoudite), de même que les tensions croissantes entre les puissances rivales locales auront des conséquences imprévisibles, non seulement sur les rivalités entre l’Inde et la Chine, mais à l'échelle de la planète toute entière.
Alors que les tensions au Moyen-Orient sont au centre de l’arène des rivalités impérialistes depuis plusieurs décennies, les tensions en Extrême-Orient et en Asie du Sud prennent rapidement leur élan. Bien qu’une escalade immédiate des rivalités culminant dans une guerre ouverte en Extrême-Orient ne paraisse pas une perspective immédiate, parce que nous sommes seulement au début de cette course, le renforcement militaire permanent et irréversible fait pressentir pour l'avenir un nouveau niveau de destruction.
Géographique:
- Afghanistan [656]
- Syrie [657]
- Arabie Saoudite [658]
- Pakistan [629]
- Asie [617]
- Moyen Orient [167]
Les conséquences du militarisme
- 1694 lectures
En Asie, ce ne sont pas des puissances secondaires qui se font face mais les deux puissances les plus peuplées du monde : la Chine et l’Inde. En même temps, les plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, qui sont plus dépendantes l’une de l’autre que jamais, au niveau économique et financier, sont engagées dans une course aux armements. La zone de conflits concerne quelques-unes des voies maritimes les plus importantes du monde et il y a le risque, à long terme, d’un embrasement de l’Extrême-Orient jusqu’au Moyen-Orient, avec des répercussions imprévisibles sur toute l’économie mondiale. Alors qu'à l'occasion de la Première Guerre mondiale, les principales batailles avaient pris place en Europe et seulement très marginalement en Asie, un siècle plus tard, aujourd’hui, toute l’Asie avec ses deux océans et ses voies maritimes cruciales, s’est engouffrée dans la spirale mortelle. La capacité de destruction atteinte éclipse la puissance des bombes atomiques jetées sur Hiroshima et Nagasaki. Plus de 60 ans plus tard, en plus des États-Unis, une demi-douzaine de pays dans la région ont des armes nucléaires ou cherchent à en avoir : la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l’Iran, la Russie1.
Les États-Unis, la seule superpuissance restante dans le monde, se sentent très menacés par l’émergence de la Chine. Ceci les a forcé à réorienter leur stratégie militaire. Alors que jusqu’à maintenant 40 % de la flotte américaine opérait dans l’Océan Atlantique, Washington projette de déployer 60 % de la flotte américaine en Asie. La récente décision du président Obama de faire "pivoter" la puissance américaine vers l’Orient a conduit au redéploiement de 60 % de la flotte américaine dans le Pacifique. Les États-Unis doivent nécessairement faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encercler la Chine et donc s’adapter en conséquence au niveau militaire. Dans un certain sens, cette confrontation est une question de vie ou de mort pour les États-Unis.2
En mars 1946, Winston Churchill a fait son fameux discours sur le "rideau de fer" en décrivant la domination soviétique en Europe de l’Est : l’expression est entrée dans le langage commun durant les 43 années qui ont suivi, jusqu’à l’effondrement en 1989 du bloc formé autour de l’URSS. Un mois seulement avant (février 1946), George Kennan (basé à l’ambassade américaine à Moscou) faisait ses propositions de "containment" de l’URSS –propositions qui allaient constituer la base de la politique américaines vis-à-vis de l’impérialisme russe. Ces deux moments clefs illustrent une caractéristique importante de l’impérialisme dans le capitalisme décadent, à savoir la formation de blocs impérialistes qui est basée dans une grande mesure pas tant sur des intérêts communs que sur une peur commune de la menace du rival. Le bloc des Alliés, qui s’est confronté à l’Axe germano-italo-japonais n’a réellement commencé à exister qu’en 1941 –l’année où Roosevelt a signé l’accord Lend-Lease qui garantissait la fourniture d’armes à la Grande-Bretagne, et où la Russie entrait en guerre à la suite de son invasion par l’Allemagne (Opération Barbarossa) et l’ouverture de la guerre dans le Pacifique à la suite de l’attaque de Pearl Harbour par le Japon.
Le bloc Allié n’a duré que 11 ans et a fini d’exister avec l’anéantissement de l’Allemagne nazie et de l’Axe, alors que ce qui devenait à l'ordre du jour était une nouvelle confrontation entre un bloc russe basé sur l’occupation militaire de ses voisins (renforcée par une invasion quand nécessaire : Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968) et un bloc américain essentiellement basé sur la crainte commune de l’URSS. Quand la désintégration de l’URSS a mis fin à la guerre froide avec une claire victoire de l'impérialisme américain, le ciment qui avait assuré la cohésion du bloc américain a disparu et ce dernier s’est disloqué.
Les États-Unis restent la puissance dominante de manière écrasante dans le monde, avec un budget militaire global plus grand que celui des dix plus grandes puissances combinés (45 % des dépenses militaires mondiales). Néanmoins, la montée en puissance régionale de la Chine représente une réelle menace potentielle pour ses voisins : le facteur "peur commune" est plus fort que les vieilles inimitiés et pousse à des séries d’alliances et de rapprochements visant à limiter la puissance chinois3. En clair, il y a deux pôles puissants dans la région –la Chine et les États-Unis– et les autres pays tendent à graviter autour de ces pôles.
Certaines de ces alliances sont apparemment stables : l’alliance de la Chine avec le Pakistan et la Corée du Nord, le regroupement Inde-Japon-États-Unis. En dehors de cela, il y a un paysage changeant de rivalités régionales : le Vietnam et les Philippines craignent la Chine mais ont leurs propres conflits territoriaux dans la Mer de Chine méridionale ; le Cambodge a une histoire compliquée de conflits avec le Vietnam. L’Indonésie a peur des ingérances australiennes depuis l’indépendance du Timor Oriental ; le Sri Lanka et le Bangladesh ont des raisons de craindre une Inde super puissante, et ainsi de suite. L’alliance de la Russie avec la Chine dans sa confrontation avec les États-Unis à propos de la Syrie et de l’Iran, de la Corée du Nord, est essentiellement une opportunité essentiellement régionale4.
 Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.
Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.
Parmi toutes ces dépendances, celles entre la Chine et les États-Unis sont les plus fortes. La Chine détient plus d’obligations américaines que n’importe quel pays dans le monde (1,15 milliards de dollars), situation grâce à laquelle le capital américain a été capable de financer son déficit budgétaire astronomique, lui permettant ainsi de repousser les effets de la crise et bien sûr de financer son appareil militaire. En même temps, la Chine a besoin des États-Unis en tant que marché pour l’exportation de ses marchandises. Et pourtant les deux pays se considèrent l’un l’autre comme les principaux rivaux du monde, nécessitant qu'ils se mobilisent l'un contre l'autre. Les pays côtiers de la Mer de Chine du Sud dépendent tous de la Chine en tant que marché pour leurs produits et des investissements chinois dans leur économie, et la Chine a besoin tout autant de ces pays comme fournisseurs de matière première et comme marché.
Il est sûrement absurde d’imaginer que des pays aussi dépendants les uns des autres s’engagent dans une confrontation militaire qui nuirait autant à leurs propres intérêts.
De telles idées ne sont pas nouvelles, d’ailleurs elles datent du début du 20ème siècle quand le danger d’une confrontation impérialiste était une question immédiate et brûlante. Sans son étude de l’impérialisme de 1902, l’économiste anglais John Hobson dénonçait l’impérialisme comme étant le fruit de la domination économique du capital financier et pensait que le développement d’une véritable et vigoureuse démocratie pouvait agir comme antidote à ses dangers. En 1909, le futur prix Nobel, Norman Angell, un autre économiste britannique, publiait Europe’s optical illusion (L’illusion d’optique de l’Europe) dans lequel il démontrait que l’interdépendance économique des puissances européennes faisait que la guerre impérialiste entraînerait une ruine mutuelle, et était donc une entreprise irrationnelle.
Hobson et Angell posaient en effet la question d’un possible impérialisme "pacifique" ou d’un capitalisme débarrassé de ses défauts impérialistes. Des conceptions similaires ont fait leur chemin dans le mouvement ouvrier avant 1914 : Kautsky imaginait l’émergence d’une alliance générale "super impérialiste" des grandes puissances, dont les prémisses, pensait-il, pouvaient se trouver dans la coopération entre les puissances européennes (avec le Japon et les États-Unis) pour écraser la rébellion des Boxers en Chine.
Lénine répond sans ménagement à Kautsky et Hobson dans "L’impérialisme, stade suprême du capitalisme" : Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste (…) quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les guerres et, à leur tour, naissent de la guerre; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale"5 Dans un certain sens, Lénine et Angell avaient cependant une vision correcte : Angell montrait que la guerre dans l’économie capitaliste avancée ne pouvait mener qu’à la catastrophe alors que Lénine (comme Luxembourg l’avait fait avant lui) démontrait que le conflit impérialiste était malgré tout inhérent au capitalisme "à l’agonie" (pour employer l’expression de Lénine).
La situation en Asie du Sud-Est offre une illustration frappante de cette double réalité. Les plus petits pays de la région dépendent tous économiquement les uns des autres et de la Chine et cependant tous voient dans leur grand voisin, la Chine, une menace majeure et dépensent des sommes d’argent pharamineuses pour s’armer contre elle ! Pourquoi la Chine suscite-t-elle cet antagonisme de tous ces pays à son égard bien qu’elle soit dépendante d’eux économiquement et financièrement ? Pourquoi tant de bourgeoisies nationales se tournent vers les États-Unis en quête "d’aide", sachant qu’elles courent le risque d’un chantage de la part de ce pays ? Cela nous amène à la question plus profonde de pourquoi une dérive permanente vers le militarisme ? La question militaire "s’impose" d’elle-même –apparemment même contre la volonté de certaines factions de la classe dominante de ces pays.
Le fond du problème est que l’émergence économique d’un pays doit nécessairement s’accompagner d’une puissance militaire. Une simple compétitivité économique, aussi grande soit-elle, n’est pas suffisante à long terme. Chaque pays doit avoir accès à des matières premières, bénéficier des meilleurs flux de marchandises, c'est-à-dire assurer la libre circulation de ses voies maritimes et autres moyens de transport. Aucun pays, qu’il soit "déclinant" ou "émergent", qu'il soit un "perdant" ou un "gagnant" ne peut échapper à cette tendance inhérente au capitalisme.
Quand le capitalisme était encore dans sa phase ascendante, en expansion sur tout le globe terrestre, cette situation pouvait mener à des tensions, voire à des conflits (entre la Grande-Bretagne et la France pendant la guerre américaine d’indépendance ou en Inde par exemple6. Aujourd’hui, la situation est très différente : la planète toute entière est morcelée entre les différentes puissances impérialistes, grandes et petites, et la montée d’une puissance ne peut se faire qu’aux dépens d’une autre –il n’y a pas de situation "tout le monde est gagnant"
Ce n’est pas vrai seulement au niveau de la prospérité économique et de l’équipement militaire. L’activité humaine est aussi déterminée par des facteurs moins tangibles –qui n’en font pas pour autant moins partie de la base matérielle. Dans les affaires internationales, le prestige national est aussi important que la possession d’une puissance militaire, car le prestige d’une nation rend la force de sa menace convaincante, lui donnant le pouvoir (pour utiliser une expression favorite de la diplomatie britannique) de "boxer dans une catégorie supérieure à la sienne propre". L’empire byzantin a survécu longtemps après le déclin de sa puissance militaire, en partie grâce au prestige de sa richesse et au nom de Rome. Plus près de nous, d’abord les bolcheviks et ensuite –après la défaite de la révolution russe– les gouvernants staliniens de l’URSS, ont énormément surestimé la puissance de l’empire britannique gravement affaibli par la Première Guerre mondiale. Même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pensé pendant un moment qu’ils pouvaient laisser les armées anglaises défendre le front contre l’URSS en Europe, tel était le pouvoir persistant du mythe impérial britannique. 7
La capacité de faire de grandes manifestations extravagantes est cruciale pour le prestige –d’où les dépenses colossales d’au moins 16 milliards de dollars pour les Jeux Olympiques de 2008 à Beijin8. Plus importante malgré tout est la capacité à exercer une domination militaire, spécialement dans sa propre zone immédiate.
Ainsi, au commencement de l’époque impérialiste, çà a été la puissance montante , l’Allemagne, qui a commencé à défier l’impérialisme britannique dominant en mettant en œuvre (en 1889) un plan ambitieux d’expansion navale destiné explicitement à concurrencer la puissance de la Flotte Royale. C’était, et ce ne pouvait être perçu par la Grande-Bretagne que comme une menace mortelle sur ses voies maritimes et son commerce, dont le pays était et est complètement dépendant.
Le parallèle avec la situation d’aujourd’hui est frappant, jusque dans les protestations des puissances impérialistes quant à leurs intentions pacifiques. Le Chancelier von Bülow parlait ainsi en 1900 : "J’ai expliqué (…) que j’entends par une politique mondiale simplement le soutien et la mise en œuvre des tâches issues de l’expansion de notre industrie, de notre commerce, de la puissance de travail, de l’activité et de l’intelligence de notre peuple. Nous n’avions aucune intention de mener une politique d’expansion agressive. Nous voulions seulement protéger les intérêts vitaux que nous avons acquis dans le monde dans le cours naturel des événements"9. Et maintenant, c’est Hu Jin Tao en 2007 : "le gouvernement et le peuple chinois voudront toujours brandir le drapeau de la paix, du développement et de la coopération, développer une politique étrangère indépendante pour la paix, la sauvegarde des intérêts chinois en termes de souveraineté, sécurité et développement, et défendre ses buts en politique étrangère de maintenir la paix mondiale et de promouvoir un développement commun (…) La Chine s’oppose au terrorisme, à l’hégémonisme et aux politiques de pouvoir sous quelque forme que ce soit, et ne s’engage pas dans la course aux armements ou ne représente une menace militaire pour d’autres pays, et ne cherchera jamais l’hégémonie ni ne s’engagera dans l’expansion10.
Comme nous l’avons montré dans cet article, la Chine s’est engagée dans un vaste programme de réarmement et d’expansion de sa flotte avec le but de dominer son "chapelet d’îles intérieures". Malgré toutes les protestations des dirigeants chinois, cette politique menace inévitablement l’ensemble des positions américaines dans le Pacifique et met en danger, non seulement le transport maritime et le commerce des États-Unis, mais aussi leur prestige et leur crédibilité, en tant qu’allié de pays du Sud-Est asiatique qui se sentent aussi menacés par la montée de la Chine, en particulier le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines. Que les États-Unis soient conscients de cette menace, la "réorientation" par Obama de la puissance militaire américaine vers le Pacifique le démontre clairement. Presque 100 ans après la Première Guerre mondiale, le capitalisme n’a pas changé de nature : la compétition capitaliste dans la phase décadente représente plus que jamais une menace mortelle pour la survie de l’humanité. La responsabilité de la classe ouvrière mondiale, la seule puissance capable d’arrêter la guerre impérialiste n’a jamais été aussi grande11.
Dv/Jens, novembre 2012
2 Voir Le Monde Diplomatique, mars 2012, Michael Klare
3 Le cas du Vietnam illustre la tendance : le Vietnam, qui a été colonisé par la France et a subi les tapis de bombes de toutes sortes des États-Unis pendant plus d’une décennie, confronté au nouveau géant, la Chine, a commencé à chercher du soutien auprès des États-Unis et a, par exemple, ouvert son port à Cam Ranh Bay aux navires étrangers, poussant d’autres pays (en particulier les États-Unis, l’Inde, le Japon) à développer plus de muscles contre la Chine. L’histoire d’amour soudaine de la Junte au pouvoir au Myanmar avec la « démocratie », après des années passées sous l’aile de la Chine, peut aussi être vue comme une tentative de conquérir le soutien américain et occidental contre son voisin superpuissant.
4 Les différents regroupements autour de la Chine et des États-Unis, à la différence du vieux système des blocs, restent pour le moment en grande partie une affaire régionale, malgré les intérêts de la Chine en Afrique et au Moyen-Orient et la nervosité des puissances européennes confrontées à l’ours russe.
5 Chapitre "La critique de l'impérialisme". https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm [314]
6 On pourrait penser que les guerres napoléoniennes, qui ont duré pendant 20 ans, sont en contradiction avec cela. Cependant, ces dernières doivent plutôt être vues probablement comme une continuation de la révolution française et du renversement révolutionnaire du féodalisme en Europe, plutôt que comme une guerre entre puissances capitalistes, même si elles en contiennent inévitablement quelques aspects.
7 Nous avons déjà soulevé ce point dans un article sur le programme spatial Apollo (https://en.internationalism.org/icconline/2009/10/apollo-11-lunar-landing [659])
8 Ce n’est pas nouveau : on pourrait faire remonter une « histoire du prestige » au moins aussi loin qu’aux cérémonies de potlatch des tribus indiennes nord-américaines, sinon plus loin encore.
9 Cité dans EJ Hobshawn, L’Age de l’Empire, éditions Cardinal, p. 302
10 Cité par Xinhua : https://news.xinhuanet.com/english/2007-10/15/content_6884160.htm [660]
11 Une analyse de la lutte de classe en Chine est en dehors du sujet de cet article, mais nous pouvons dire que la classe dominante chinoise est consciente de la menace qui vient "d’en bas" : le budget pour la sécurité intérieure de la Chine a récemment dépassé, pour la première fois, les dépenses militaires lorsque Beijing a intensifié la surveillance et la répression. En 2012, la Chine dépense 111,4 milliards de dollars pour la sécurité publique, ce qui inclut la police et les forces sécuritaires d’État – une somme qui officiellement excède même le budget de la défense. Voir https://www.reuters.com/articles/2012/03/05/us-china-parliament-security... [661].
Revue Internationale 2017
- 972 lectures
Revue Internationale n°158
- 1019 lectures
Russie 1917 et la mémoire révolutionnaire de la classe ouvrière
- 1409 lectures
Pour tous ceux qui considèrent encore que le dernier espoir de l'humanité est le renversement révolutionnaire du capitalisme mondial, il est impossible de saluer le début de l'année 2017 sans rappeler qu'il s'agit du 100e anniversaire de la révolution russe. Et nous savons aussi que tous ceux qui martèlent l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'ordre social actuel le rappelleront à leur manière.
Beaucoup d'entre eux vont, bien sûr, ignorer cet événement historique ou minimiser son importance en nous disant que ce n'est que de l'histoire ancienne. Tout aurait changé depuis - et à quoi bon parler d'une révolution de la classe ouvrière alors que la classe ouvrière n'existe plus ou qu'elle est tellement dégradée que le terme de révolution ouvrière peut même être assimilé à des votes de protestation en faveur du Brexit ou de Trump dans les vieux centres industriels décimés par la mondialisation ?
Ou, si l'on se souvient du bouleversement qui secoua le monde en 1917, dans la majorité des cas on le dépeint comme une sorte de conte d'horreur, mais avec une "morale" bien définie : voici ce qui arrive quand on défie le monde, si on tombe dans l'illusion qu'une forme sociale plus élevée est possible. On obtient quelque chose de bien pire. On obtient la terreur, les Goulags, l'État totalitaire omniprésent. Cela a commencé avec Lénine et sa bande fanatique de bolcheviks dont le coup d'État en octobre 1917 a tué la démocratie naissante en Russie, et il a fini avec Staline, avec toute la société transformée en un camp de travail forcé. Et puis tout s'est effondré, ce qui a démontré une fois pour toutes qu'il est impossible d'organiser la société moderne autrement que par les méthodes du capitalisme.
Nous n'avons pas l'illusion qu'il sera facile d'expliquer, en 2017, ce que signifie vraiment la révolution russe. Nous sommes dans une période d'extrême difficulté pour la classe ouvrière et ses petites minorités révolutionnaires, une période dominée par le sentiment de désespoir et la perte de toute perspective pour l'avenir, par le sinistre développement du nationalisme et du racisme qui sert à diviser les rangs de la classe ouvrière, par la démagogie haineuse des populistes de droite et de gauche, par des appels tapageurs pour défendre la "démocratie" contre ce nouvel autoritarisme.
Mais c'est aussi un moment pour rappeler le travail de nos ancêtres politiques, les fractions communistes de gauche qui ont survécu aux terribles défaites des mouvements révolutionnaires déclenchés par les événements de Russie en 1917 et qui ont essayé de comprendre la dégénérescence et la disparition même des partis communistes qui s'étaient constitués pour ouvrir la voie à la révolution. Résistant à la fois à la terreur ouverte de la contre-révolution sous ses formes staliniennes et fascistes et aux tromperies plus voilées de la démocratie, les courants communistes de gauche les plus lucides, tels que ceux groupés autour des revues Bilan dans les années 1930 et Internationalisme dans les années 1940, ont entrepris l'énorme tâche de tirer le "bilan" de la révolution. D'abord et avant tout, contre tous ses dénigreurs, ils ont réaffirmé ce qui avait été essentiel et positif dans la révolution russe. En particulier, ils ont mis en évidence :
que la révolution "russe" n'avait de sens qu'en tant que première victoire de la révolution mondiale et que son seul espoir était l'extension du pouvoir prolétarien au reste du globe ;
qu'elle a confirmé la capacité de la classe ouvrière de démanteler l'État bourgeois et de créer de nouveaux organes de pouvoir politique (notamment les soviets ou conseils de délégués ouvriers) ;
qu'elle a démontré la nécessité d'une organisation politique révolutionnaire défendant les principes de l'internationalisme et de l'autonomie de la classe ouvrière.
En même temps, les révolutionnaires des années 1930 et 1940 ont entrepris l'analyse douloureuse des erreurs coûteuses commises par les bolcheviks face à une situation sans précédent pour tout parti ouvrier, en particulier :
la tendance croissante du parti à se substituer aux soviets, et la fusion du parti avec l'État soviétique, qui sapaient à la fois le pouvoir des soviets et la capacité du parti à défendre les intérêts de classe des travailleurs, même face au nouvel État ;
le recours à la "Terreur rouge" en réponse à la Terreur blanche de la contre-révolution - processus qui a conduit les bolcheviks à s'impliquer dans la répression des mouvements de la classe ouvrière et des organisations prolétariennes ;
La tendance à voir le capitalisme d'État comme une étape de transition vers le socialisme, et même comme étant identique au socialisme.
Le CCI, depuis sa fondation, a tenté de poursuivre ce travail pour tirer les leçons de la révolution russe et de la vague révolutionnaire internationale de 1917-1923. Au fil des ans, nous avons réalisé une série d'articles et de brochures traitant de cette époque absolument vitale de l'histoire de notre classe. Durant l'année en cours et au-delà, nous veillerons à ce que ces textes soient davantage accessibles à nos lecteurs en compilant un dossier à jour de nos articles les plus importants sur la révolution russe et la vague révolutionnaire internationale. C'est ainsi que dès le mois de février, nous allons mettre en évidence les articles correspondant le plus directement au développement chronologique du processus révolutionnaire ou qui contiennent des réponses aux questions les plus importantes posées par les attaques de la propagande bourgeoise ou encore par les discussions dans et autour du milieu politique prolétarien. Ce mois-ci, nous allons mettre en première page de notre site un article écrit en 1997 sur la révolution de février. Il sera suivi d'articles sur les thèses d'avril de Lénine, les journées de juillet, l'insurrection d'octobre, etc. Et nous avons l'intention de maintenir ce processus sur une longue période, précisément parce que le drame de la révolution et de la contre-révolution a duré pendant un certain nombre d'années et ne s'est nullement limité à la Russie, mais a eu des échos à travers le monde, de Berlin à Shanghai, de Turin à la Patagonie, et de la zone industrielle de la Clyde en Grande-Bretagne à Seattle aux États-Unis.
Dans le même temps, nous chercherons à ajouter à cette collection de nouveaux articles traitant de questions que nous n'avons pas encore examinées en profondeur (comme l'assaut de la classe dominante contre la révolution à cette époque, le problème de la "Terreur rouge", etc.) ; articles qui répondent aux campagnes actuelles du capitalisme dirigées contre la mémoire révolutionnaire de la classe ouvrière ; et des articles qui examineront les conditions actuelles de la révolution prolétarienne - ce qu'elles ont en commun avec l'époque de la révolution russe, mais aussi et surtout les changements importants intervenus au cours des cent dernières années.
Le but de cette entreprise éditoriale n'est pas simplement de "célébrer" ou de "commémorer" des événements historiques passés depuis longtemps. Il est de défendre l'idée que la révolution prolétarienne est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1917. Face aux horreurs de la Première Guerre impérialiste mondiale, les révolutionnaires de l'époque conclurent que le capitalisme était entré dans son époque de déclin, mettant l'humanité face l'alternative socialisme ou barbarie ; et les horreurs encore plus grandes - symbolisées par des noms comme Auschwitz et Hiroshima - qui ont suivi la défaite de la première tentative de révolution socialiste ont confirmé avec force le diagnostic des révolutionnaires. Un siècle plus tard, le fait que le capitalisme existe encore constitue une menace mortelle pour la survie même de l'humanité.
Écrivant depuis sa cellule en 1918, à la veille de la révolution en Allemagne, Rosa Luxemburg a exprimé sa solidarité fondamentale avec la révolution russe et le parti bolchevik, malgré toutes ses critiques très sérieuses des erreurs des bolcheviks, en particulier la politique de la terreur rouge. Ses paroles sont aussi pertinentes pour notre propre avenir que pour l'avenir qui a été le sien propre :
"Ce qui importe, c'est de distinguer dans la politique des bolcheviks l'essentiel de l'accessoire, la substance de l'accident. Dans cette dernière période, où nous sommes à la veille des luttes décisives dans le monde entier, le problème le plus important du socialisme est précisément la question brûlante du moment : non pas telle ou telle question de détail de la tactique, mais la capacité d'action du prolétariat, la combativité des masses, la volonté de réaliser le socialisme. Sous ce rapport, Lénine, Trotsky et leurs amis ont été les premiers qui aient montré l'exemple au prolétariat mondial; ils sont jusqu'ici encore les seuls qui puisent s'écrier avec Hutten : "J'ai osé !"
C'est là ce qui est essentiel, ce qui est durable dans la politique des bolcheviks. En ce sens, il leur reste le mérite impérissable d'avoir, en conquérant le pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l'exemple au prolétariat international, et fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de comptes final entre le Capital et le Travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Et c'est dans ce sens que l'avenir appartient partout au "bolchevisme""1.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
L'élection de Trump et le délitement de l'ordre capitaliste mondial
- 998 lectures
Que peut attendre le monde de la nouvelle administration Trump aux États-Unis ? Alors que dans le monde entier les élites politiques traditionnelles affichent consternation et anxiété, le gouvernement russe et les populistes de droite en Amérique et dans toute l'Europe voient l'histoire prendre leur parti. Et alors que des entreprises d'envergure mondiale (telles que celles de l'industrie automobile) craignent maintenant des représailles si elles ne produisent pas aux États-Unis, les Bourses et les instituts économiques, qui étaient initialement confiants, s'attendant à une augmentation de la croissance pour les États-Unis et même pour l'économie mondiale sous Trump. Quant à Monsieur le Président en personne, il est régulièrement en contradiction non seulement avec sa propre nouvelle administration mais aussi avec lui-même. L'OTAN, le libre-échange ou l'Union européenne peuvent être qualifiés d'"essentiels" dans une phrase et d'"obsolètes" dans la suivante.
Au lieu de participer à cette tentative de voir dans une boule de cristal ce que sera la politique de l'État américain dans un avenir proche, nous essaierons ici tout d'abord d'analyser pourquoi Trump a été élu Président alors que les élites politiques traditionnelles établies n'en voulaient pas. De cette contradiction entre ce que Trump représente et les intérêts de la classe dominante américaine comme un tout, nous espérons poser des bases plus solides afin de donner quelques premières indications de ce qui peut être attendu de cette présidence, sans tomber dans une spéculation excessive.
Le dilemme du Parti républicain
Ce n'est pas un secret que Donald Trump est considéré comme un corps étranger dans le Parti républicain qui l'a investi pour l'élection à la Maison Blanche. Il n'est ni assez religieux ou conservateur pour les fondamentalistes chrétiens qui jouent un rôle si important dans ce parti. Ses propositions de politique économique, telles qu'un programme d'infrastructure organisé par l'État, le protectionnisme ou le remplacement de "l'Obamacare" par une assurance sociale pour tous et étatisée, sont des anathèmes pour les néo-libéraux qui ont toujours de l'influence dans les cercles républicains, comme c'est aussi le cas dans le Parti Démocrate. Ses plans de rapprochement avec la Russie de Poutine l'opposent au lobby de l'armée et du renseignement, très puissant tant dans le Parti républicain que dans le Parti démocrate.
La candidature de Trump à la présidence a été rendue possible par une révolte sans précédent des membres et des sympathisants républicains contre leurs leaders. Les autres candidats, qu'ils soient venus du clan Bush, des évangélistes chrétiens, des néo-libéraux ou du mouvement Tea Party, avaient tous été discrédités par leur participation ou leur soutien à l'administration de George W. Bush qui a précédé celle d'Obama. Le fait que, face à la crise économique et financière de 2007-08, un président républicain n'ait rien fait pour aider des millions de petits propriétaires effectifs ou potentiels - qui dans de nombreux cas avaient perdu en même temps leur emploi, leur maison et leurs économies - alors qu'il renflouait des banques avec de l'argent public, était impardonnable pour les électeurs républicains traditionnels. De plus, aucun des autres candidats n'avait autre chose à proposer, sur le plan économique, que de poursuivre ce qui n'avait pas pu empêcher le désastre de 2008.
En fait, la rébellion des électeurs républicains traditionnels s'est dirigée non seulement contre leur direction, mais aussi contre certaines des "valeurs" traditionnelles du parti. Ainsi, la candidature de Trump n'a pas seulement été rendue possible, elle a été pratiquement imposée à la direction du parti. Bien sûr, celle-ci aurait pu l'empêcher - mais seulement au risque de s'éloigner d'une grande partie de sa base voire même de diviser le parti. Ceci explique pourquoi les tentatives de contrecarrer Trump n'ont été que timides et inefficaces. Finalement, le "Grand Old Party" a été obligé d'essayer de conclure un "marché" avec l'intrus de la côte est.
Le dilemme du Parti démocrate
Une révolte similaire a eu lieu au sein du Parti démocrate. Après huit années d'Obama, la croyance dans le fameux "oui nous pouvons" ("oui nous pouvons" améliorer la vie de la population dans son ensemble) avait sérieusement décliné. Le leader de cette rébellion était Bernie Sanders qui se dit lui-même "socialiste". Tout comme Trump du côté républicain, Sanders était un nouveau phénomène dans l'histoire moderne des démocrates. Non que les "socialistes" en tant que tels soient un corps étranger au sein de ce parti. Mais ils en font partie en tant que minorité parmi d'autres, qui soulignent les revendications de pluralité multiculturelle au sein de ce parti. Ils sont considérés comme éléments étrangers quand ils revendiquent le droit de présenter leur candidature au Bureau ovale. Que ce soit sous Bill Clinton ou Barack Obama, les présidents démocrates contemporains ont combiné une touche de protection sociale avec des politiques économiques fondamentalement néo-libérales. Une politique économique étatique directement interventionniste à caractère fortement "keynésien" (telle que celle de F.D. Roosevelt avant et pendant la Seconde Guerre mondiale) est aujourd'hui un anathème tant pour la direction démocrate que la direction républicaine. Ceci explique pourquoi Sanders n'a jamais fait secret du fait que ses politiques sont plus proches sur certaines questions de celles de Trump qu'elles ne le sont de celles d'Hillary Clinton. Après l'élection de Trump, Sanders lui a immédiatement apporté son soutien dans la mise en œuvre de son projet d'"assurance pour tous".
Cependant, contrairement à ce qui s'est produit chez les républicains, la révolte dans le Parti démocrate a été écrasée avec succès et Clinton investie sans encombre à la place de Sanders. Cela a réussi non seulement parce que le Parti démocrate est le mieux organisé et contrôlé des deux partis mais aussi parce que l'élite de ce parti avait été moins discréditée que son équivalent républicain.
Mais paradoxalement, ce succès de la direction du parti n'a fait que paver le chemin de sa défaite aux élections présidentielles. En éliminant Sanders, les démocrates ont écarté le seul candidat qui avait de bonnes chances de battre Trump. Le Parti démocrate a réalisé trop tard que Trump serait l'adversaire, et qu'il avait sous-estimé son potentiel électoral. Il a aussi sous-estimé le degré de discrédit d'Hillary Clinton elle-même. Cela était surtout dû à son image de représentante de "Wall Street", des "oligarchies financières de la côte est" - communément vues comme les principaux "coupables" et en même temps les principaux bénéficiaires de la crise financière. En fait, elle avait fini par être identifiée à la catastrophe de 2008 presque autant que la direction républicaine elle-même. La suffisance arrogante de l'élite démocrate et son aveuglement envers la colère et le ressentiment populaires montants devaient caractériser l'ensemble de la campagne électorale de Clinton. Un exemple de cela a été sa dépendance unilatérale aux médias de masse les plus traditionnels, alors que l'équipe de campagne de Trump utilisait à fond les possibilités offertes par les nouveaux médias.
Parce qu'ils n'ont pas voulu de Sanders, ils ont eu Trump à la place. Même pour ceux qui, au sein de la bourgeoisie américaine, avaient une profonde aversion pour une phase d'expérimentation économique néo-keynésienne, Sanders aurait sans aucun doute été le moindre mal. Sanders, tout comme Trump, voulait ralentir le processus de ce qu'on nomme "mondialisation". Mais il aurait agi avec modération et avec un bien plus grand sens des responsabilités. Avec Trump, la classe dominante de la première puissance mondiale ne peut même pas être sûre de ce qui va se passer.
Le dilemme des partis politiques établis
Les États-Unis sont un pays fondé par des colons et peuplé par des vagues d'immigration. L'intégration des différents groupes et intérêts ethniques et religieux dans une seule nation est la tâche en constante évolution historique du système constitutionnel et politique existant. Un défi particulier pour ce système est l'implication des leaders des différentes communautés immigrées dans le gouvernement, puisque chaque nouvel vague d'immigration commence en bas de l'échelle sociale et doit "gravir les échelons". Le prétendu melting-pot américain est en réalité un système hautement compliqué de coexistence (pas toujours) pacifique entre différents groupes.
Historiquement, à côté des institutions telles que les organisations religieuses, la formation d'organisations criminelles a été un moyen éprouvé pour les groupes exclus d'avoir accès au pouvoir. La bourgeoisie américaine a une longue expérience dans l'intégration du meilleur de la pègre dans les échelons supérieurs. C'est une saga familiale souvent répétée : le père gangster, le fils avocat ou politicien, le petit-fils ou la petite-fille philanthrope et mécène. L'avantage de ce système était que la violence sur laquelle elle reposait n'était pas ouvertement politique. Cela la rendait compatible avec le système étatique bipartite existant. Vers quel bord allaient les votes italiens, irlandais ou juifs dépendait de cet assortiment donné et de ce que Trump appellerait les "services" que les républicains et les démocrates offraient aux différents intérêts communautaires et particuliers. En Amérique, on doit constamment s'occuper de ces assortiments entre communautés, et pas seulement de ceux entre les différentes industries ou branches de l'économie par exemple.
Mais ce processus d'intégration politique essentiellement non-partisan, compatible avec la stabilité des appareils partisans, commença à faiblir pour la première fois face aux revendications des Noirs américains. Ces derniers étaient originellement venus en Amérique non en tant que colons mais en tant qu'esclaves. Ils ont dû pleinement subir depuis le début le racisme capitaliste moderne. Pour qu'une élite noire puisse avoir accès à l'égalité bourgeoise devant la loi ainsi qu'au pouvoir et aux privilèges, des mouvements ouvertement politiques devaient être créés. Sans Martin Luther King, le Mouvement des droits civiques mais aussi une violence d'un nouveau genre - les émeutes dans les ghettos noirs durant les années 1960 et les Black Panthers - la présidence Obama n'aurait pas pu exister. L'élite dominante établie a réussi à relever ce défi en associant le Mouvement des droits civiques au Parti démocrate. Mais de cette manière, la distinction existante entre les différents groupes ethniques et les partis politiques était remise en question. Le vote noir allait régulièrement au Parti démocrate. Au début, les républicains furent capables de développer un contrepoids à cette situation en obtenant une part plus ou moins stable du vote latino (d'abord et avant tout de la communauté des exilés cubains). Quant au vote "blanc", il continuait à aller d'un bord à l'autre en fonction des propositions faites. Cela jusqu'aux élections de 2016.
Un des facteurs qui a amené Trump à la Maison Blanche a été l'alliance électorale qu'il a faite avec différents groupes de "suprémacistes blancs". Contrairement au racisme à l'ancienne du Ku Klux Klan avec sa nostalgie du système esclavagiste qui régnait dans les États du sud jusqu'à la Guerre de Sécession, la haine de ces nouveaux courants se dirige contre les pauvres, qu'ils soient noirs ou hispaniques, urbains ou ruraux, stigmatisés comme criminels et parasites sociaux. Bien que Trump lui-même ne soit peut-être pas un raciste de ce type, ces suprémacistes blancs modernes ont créé une sorte de bloc électoral en sa faveur. Pour la première fois, des millions d'électeurs blancs ont voté non selon les recommandations de "leurs" différentes communautés, et pas pour l'un ou l'autre des partis, mais pour quelqu'un qu'ils voyaient comme le représentant d'une communauté "blanche" plus large. Le processus sous-jacent est celui d'une "communautarisation" croissante de la vie politique bourgeoise américaine. Un pas supplémentaire dans la ségrégation du soi-disant melting-pot.
Le dilemme de la classe dominante américaine et le "Rendre sa grandeur à l'Amérique" de Trump
Le problème de tous les candidats républicains qui ont essayé de s'opposer à Trump, et ensuite celui d'Hillary Clinton, était non seulement qu'ils n'étaient pas convaincants mais aussi qu'ils ne semblaient pas vraiment convaincus eux-mêmes. Tout ce qu'ils pouvaient proposer n'était que différentes variantes de "la routine habituelle". Avant tout, ils n'avaient aucune alternative au "Rendre sa grandeur à l'Amérique" de Trump. Derrière ce slogan, il n'y a pas seulement une nouvelle version du vieux nationalisme. L'américanisme de Trump est d'un nouveau genre. Il contient le clair aveu que l'Amérique n'est plus aussi "grande" qu'elle l'a été. Économiquement, elle a été incapable d'empêcher la montée de la Chine. Militairement, elle a subi une série de revers plus ou moins humiliants : Afghanistan, Irak, Syrie. L'Amérique est une puissance en déclin, même si elle reste économiquement et surtout militairement et technologiquement de loin le pays dominant. Mais pas seulement. L'Amérique n'est pas une exception dans un monde florissant par ailleurs. Son déclin en est venu à symboliser celui du capitalisme comme un tout. Le vide créé par l'absence de toute alternative en provenance des élites établies a contribué à donner sa chance à Trump.
Non pas que l'Amérique n'ait déjà tenté de réagir face à son déclin historique. Certains des changements annoncés par Trump ont déjà été initiés préalablement, en particulier sous Obama. Ils incluent une plus grande priorité pour la zone Pacifique, économiquement et surtout militairement, de sorte que les "partenaires" européens de l'OTAN ont été appelés à supporter une charge plus grande qu'auparavant au sein de cette institution. Au niveau économique ils concernent une politique économique plus dirigée par l'État afin de gérer la crise de 2008 et ses conséquences. Mais cela ne peut que ralentir le présent déclin, alors que Trump prétend être capable de l'inverser.
Face à ce déclin et aussi aux divisions croissantes de classe, raciales, religieuses et ethniques, Trump veut unifier la nation capitaliste derrière sa classe dominante au nom d'un nouvel américanisme. Les États-Unis, selon Trump, sont devenus la principale victime du reste du monde. Il prétend que, alors que les États-Unis ont épuisé leurs ressources ainsi qu'eux-mêmes à maintenir l'ordre mondial, tous les autres ont profité de cet ordre aux dépens du "propre pays de Dieu". Ici, les trumpistes ne pensent pas seulement aux Européens ou aux Est-Asiatiques qui inondent le marché américain de leurs produits. Un des principaux "exploiteurs" des États-Unis, selon Trump, est le Mexique qu'il accuse d'exporter son surplus de population dans le système d'aide sociale américain tout en développant en même temps sa propre industrie à un point tel que sa production automobile est en train de dépasser celle de son voisin du nord.
Cela équivaut à une forme nouvelle et virulente de nationalisme, rappelant le nationalisme allemand "opprimé" après la Première Guerre mondiale et le Traité de Versailles. L'orientation de cette forme de nationalisme n'est plus de justifier l'imposition d'un ordre mondial par l'Amérique. Cette orientation est de remettre soi-même en question l'ordre mondial existant.
La roulette russe de Trump
Mais la question que le monde se pose est si Trump a une véritable offre politique en réponse au déclin de l'Amérique. Sinon, si son alternative est purement idéologique, il est peu probable qu'il dure très longtemps. Trump n'a certainement aucun programme cohérent pour son capital national. Personne n'est plus clair à ce sujet que Trump lui-même. Sa politique, a-t-il déclaré à maintes reprises, est de faire des "affaires juteuses" pour l'Amérique (et pour lui-même), dès que l'opportunité se présente. Le nouveau programme pour le capital américain est, semblerait-il, Trump lui-même : un homme d'affaires à la tête de l'État, amoureux du risque et qui a fait faillite plusieurs fois.
Mais cela ne signifie pas nécessairement que Trump n'a aucune chance d'au moins ralentir le déclin de l'Amérique. Il pourrait réussir au moins partiellement - mais seulement s'il est chanceux. Ici nous abordons le cœur du trumpisme. Le nouveau président, qui veut diriger le premier État du monde comme s'il s'agissait d'une entreprise capitaliste, est prêt, pour poursuivre ses objectifs, à prendre des risques incalculables - risques qu'aucun politicien bourgeois conventionnel dans sa position ne voudrait prendre. Si ça marche, cela peut se révéler être au bénéfice du capitalisme américain aux dépens de ses rivaux, mais sans trop de dégâts pour le système comme un tout. Mais si ça tourne mal, les conséquences peuvent être catastrophiques pour le capitalisme américain et mondial.
Nous pouvons déjà donner trois exemples du type de politiques risquées dans lesquelles Trump veut se lancer. Une d'entre elles est sa politique de chantage protectionniste. Son but n'est pas de mettre fin à l'actuel ordre économique mondial (la "mondialisation") mais d'obtenir un meilleur accord pour l'Amérique au sein de cet ordre. Les États-Unis sont le seul pays dont le marché intérieur est si grand qu'il peut menacer ses rivaux avec des mesures protectionnistes d'une telle ampleur. Le summum de rationalité de la politique de Trump est son calcul que les dirigeants politiques de ses principaux rivaux sont moins fous que lui, c'est-à-dire qu'ils ne se risqueront pas dans une guerre commerciale protectionniste. Mais si ces mesures devaient entraîner une réaction en chaîne incontrôlable, le résultat pourrait en être une fragmentation du marché mondial comparable à ce qui s'est produit durant la Grande Dépression des années 1930.
Le second exemple est celui de l'OTAN. Déjà l'administration Obama avait commencé à mettre sous pression les "partenaires" européens pour qu'ils s'impliquent davantage dans l'alliance en Europe et au-delà. La différence consiste dans le fait que Trump, maintenant, est prêt à menacer d'abandonner ou de mettre sur la touche l'OTAN si la volonté de Washington n'est pas suivie. Ici encore, Trump joue avec le feu, puisque l'OTAN est d'abord et avant tout un instrument pour sécuriser la présence de l'impérialisme américain en Europe.
Notre dernier exemple est le projet de Trump d'un "grand deal" avec la Russie de Poutine. Un des principaux problèmes de l'économie russe aujourd'hui est qu'elle n'a pas vraiment achevé la transformation d'un régime sous direction stalinienne en un ordre capitaliste fonctionnant correctement. Cette transformation était, durant une première phase, entravée par la priorité du régime de Poutine d'empêcher que des matières premières stratégiquement importantes ou l'industrie de l'armement soient raflées par du capital étranger. Le nécessaire processus de privatisation a été fait sans enthousiasme, de manière à ce qu'une large part de l'industrie russe fonctionne toujours sur la base d'une allocation administrative des ressources. Durant une seconde phase, le plan de Poutine était de s'atteler à la privatisation et à la modernisation de l'économie en collaboration avec la bourgeoisie européenne, et en premier lieu avec l'Allemagne. Mais ce plan a été contrecarré avec succès par Washington, essentiellement à travers sa politique de sanctions économiques contre la Russie. Bien que la raison de ces sanctions ait été la politique d'annexion de Moscou envers l'Ukraine, celles-ci avaient aussi pour but d'empêcher un renforcement des économies de la Russie et de l'Allemagne à la fois.
Mais ce succès - peut-être la principale réussite de la présidence Obama en Europe - a des conséquences négatives pour l'économie mondiale comme un tout. L'établissement d'une réelle propriété privée en Russie créerait un ensemble de nouveaux acteurs économiques solvables qui pourraient se porter garants pour les emprunts contractés sur la terre, les matières premières, etc. Au vu des difficultés économiques actuelles de l'économie mondiale, alors que même en Chine la croissance ralentit, le capitalisme peut-il se permettre de renoncer à de telles "affaires" ?
Non, selon Trump. Son idée est que ce n'est pas à l'Allemagne ou à l'Europe, mais à l'Amérique elle-même, de devenir le "partenaire dans la transformation" voulue par Poutine. Selon Trump (qui bien sûr souhaite aussi faire lui-même des affaires lucratives), la bourgeoisie russe, qui est à l'évidence incapable de s'atteler toute seule à sa modernisation, peut choisir entre trois partenaires possibles, le troisième étant la Chine. Puisque cette dernière est la plus grande menace pour l'Amérique, il est vital que Washington, et non Pékin, assume ce rôle.
Cependant, aucun des projets de Trump n'a provoqué autant que celui une telle résistance acharnée au sein de la classe dominante américaine. Toute la période entre l'élection de Trump et sa prise de fonction a été dominée par les tentatives conjointes de la "communauté du renseignement", les principaux médias et l'administration Obama de saboter le rapprochement envisagé avec Moscou. Sur ce sujet, tous ces acteurs estiment que les risques que Trump veut prendre sont trop élevés. Même s'il est vrai que le principal adversaire actuellement est la Chine, une Russie modernisée constituerait néanmoins un danger additionnel considérable pour les États-Unis. Après tout, la Russie est (aussi) une puissance européenne et l'Europe est toujours le cœur de l'économie mondiale. Et la Russie a toujours le deuxième plus important arsenal nucléaire derrière les États-Unis. Un autre problème possible est que, si les sanctions économiques contre la Russie étaient levées, le sphinx du Kremlin, Vladimir Poutine, serait tout-à-fait capable de se montrer plus malin que Trump en réintroduisant les Européens dans ses plans (dans le but de limiter sa dépendance de l'Amérique). La bourgeoisie française, par exemple, se prépare déjà à cette éventualité : deux des principaux candidats aux prochaines élections présidentielles en France (Fillon et Le Pen) ne font pas mystère de leur sympathie pour la Russie.
Pour le moment, l'issue de ce dernier conflit au sein de la bourgeoisie américaine reste ouverte. Jusque-là, l'argument de Trump reste unilatéralement économique (mais il n'est pas du tout exclu qu'il puisse étendre son aventurisme vers une politique de provocation militaire contre Pékin). Mais ce qui est vrai est qu'une réponse efficace sur le long terme à l'adversaire chinois doit comporter une forte composante économique, et ne peut seulement se situer au niveau militaire. Il existe deux domaines en particulier dans lesquels l'économie américaine doit supporter une plus lourde charge que la Chine, et que Trump devrait essayer de "rationaliser". L'un d'entre eux est l'énorme budget militaire. Sur cet aspect, la politique envers la Russie a aussi une dimension idéologique, depuis que ces dernières années l'idée que Poutine veuille rétablir l'Union soviétique a été une des principales justifications données pour la persistance à un niveau astronomique des dépenses de "défense".
L'autre budget que Trump veut réduire significativement est le budget de l'aide sociale. Ici, en attaquant la classe ouvrière, il peut cependant compter sur le soutien de la classe dominante comme un tout.
La promesse de violence de Trump
À côté d'une attitude d'aventurisme irresponsable, l'autre trait majeur du trumpisme est la menace de violence. Une de ses spécialités est de menacer les entreprises opérant à l'international de représailles si elles ne font pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, dit-il, ce sont des "emplois pour les travailleurs américains". Sa façon de harceler les grandes entreprises en tweetant a aussi pour but d'impressionner tous ceux qui vivent dans la peur constante, du fait que leur existence dépend des caprices de telles compagnies géantes. Ces ouvriers sont invités à s'identifier à sa force, qui est prétendument à leur service parce qu'ils sont de bons, obéissants et honnêtes Américains qui veulent travailler dur pour leur pays.
Durant sa campagne électorale, Trump a dit à son adversaire Hillary Clinton qu'il voulait la "mettre sous les verrous". Plus tard, il a déclaré qu'il ferait preuve de clémence envers elle - comme si la question de savoir quand d'autres politiciens se retrouvent en prison dépendait de ses propres caprices personnels. Une telle clémence n'est pas à prévoir pour les immigrants illégaux. Déjà Obama en a expulsé plus que tout autre président américain avant lui. Trump veut les emprisonner deux années avant de les expulser. La promesse d'une effusion de sang est le chiffon rouge avec lequel il attire la multitude croissante de ceux qui, dans cette société, sont incapables de se défendre mais ont soif de vengeance. Les gens qui viennent à ses meetings pour protester contre lui, il les fait tabasser sous les yeux des téléspectateurs. On a fait comprendre aux femmes, aux étrangers, aux soi-disant asociaux qu'ils devraient s'estimer chanceux de n'être exposés qu'à sa violence verbale. Non seulement il veut faire construire un mur pour empêcher les Mexicains d'entrer mais il promet aussi qu'ils le paieront eux-mêmes. À l'exclusion est ajoutée l'humiliation.
Ces menaces étaient évidemment un calcul dans la campagne électorale démagogique de Trump, mais en prenant ses fonctions il n'a pas perdu de temps pour faire passer une série de "faits accomplis" dans le but de prouver que, contrairement à d'autres politiciens, il allait faire ce qu'il avait promis. L'expression la plus spectaculaire de cette attitude - qui a causé un conflit énorme à la fois dans la bourgeoisie et dans la population en général - a été son "interdiction des musulmans", suspendant le droit des voyageurs d'un nombre soigneusement sélectionné de pays à majorité musulmane d'entrer ou de rentrer aux États-Unis. Ceci est avant tout une déclaration d'intention, un signe de sa volonté de cibler des minorités et d'associer l'Islam en général avec le terrorisme, malgré toutes ses dénégations du fait que ces mesures visent spécifiquement les musulmans.
Ce dont l'Amérique a besoin, dit Trump au monde, c'est de plus d'armes et de torture. Notre civilisation bourgeoise moderne ne manque pas de tels voyous et brutes vantardes, tout comme elle admire et acclame ceux qui prennent pour eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent obtenir aux dépens des autres. Ce qui est nouveau est que des millions de gens, dans un des pays les plus modernes du monde, veulent d'un tel voyou comme chef d'État. Trump, comme son modèle et éventuel ami Poutine, sont populaires non pas en dépit mais en raison de leur brutalité.
Dans le capitalisme, il y a toujours deux alternatives possibles : l'échange d'équivalents ou le non-échange d'équivalents (le vol). On peut ou non donner à quelqu'un d'autre un équivalent de ce qu'on reçoit. Pour que le marché fonctionne, ses sujets doivent renoncer à la violence dans la vie économique. Ils le font sous la menace de représailles, telles que la prison, mais aussi sur la promesse que leur renoncement leur rapportera un avantage à long terme en sécurisant leur existence. Cependant, il n'en demeure pas moins que la base de la vie économique dans le capitalisme est le vol, la plus-value que les capitalistes obtiennent du surtravail non-payé des travailleurs salariés. Ce vol a été légalisé sous la forme de la propriété privée capitaliste des moyens de production ; ceci est imposé chaque jour par l'État, qui est l'appareil d'État de la classe dominante. L'économie capitaliste requiert un tabou de la violence sur la place du marché. Achat et vente sont supposés être des actions pacifiques - y inclus l'achat et la vente de force de travail : les ouvriers ne sont pas des esclaves. Dans les circonstances "normales", les travailleurs sont prêts à vivre plus ou moins en paix sous de telles conditions, bien qu'ils réalisent qu'il existe une minorité refusant de faire la même chose. Cette minorité est composée du milieu criminel, qui vit du vol, et de l'État, qui est le plus grand de tous les voleurs, tant au détriment de sa "propre" population (les impôts) qu'au détriment des autres États (la guerre). Et bien que l'État réprime les criminels en défense de la propriété privée, aux échelons supérieurs, les grands gangsters et l'État voleur tendent à collaborer plutôt qu'à s'opposer. Mais quand le capitalisme ne peut plus offrir de façon crédible ne serait-ce que l'illusion d'une possible amélioration des conditions de vie à la société dans son ensemble, la conformité de la société dans son ensemble vis-à-vis de sa propre norme commence à vaciller.
Aujourd'hui nous sommes entrés dans une période (ressemblant beaucoup à celle des années 1930) où de larges secteurs de la société se sentent dupés et ne croient plus que leur renonciation à la violence soit payante. Mais ils demeurent intimidés par la menace de répression, par le statut illégal du monde criminel. Cela se produit lorsque le désir de faire partie de ceux qui peuvent voler sans crainte devient politique. L'essence de leur "populisme" est l'exigence que la violence contre certains groupes soit légalisée, ou au moins non-officiellement tolérée. Dans l'Allemagne de Hitler, par exemple, le cours à la guerre mondiale était une manifestation "normale" de l'"État voleur", partagée par la Russie de Staline, l'Amérique de Roosevelt, etc. Ce qui était nouveau dans le national-socialisme était le vol systématique, organisé par l'État, d'une partie de sa propre population. Bouc-émissarisation et pogroms furent légalisés. L'Holocauste ne fut pas en premier lieu le produit de l'histoire de l'antisémitisme ou du nazisme. Il fut le produit du capitalisme moderne. Le vol devient la perspective économique alternative pour des secteurs de la population sombrant dans la barbarie. Mais cette barbarie est celle du système capitaliste lui-même. La criminalité fait autant partie de la société bourgeoise que la Bourse. Le vol et l'achat-vente sont les deux pôles de la société moderne avancée basée sur la propriété privée. La profession de voleur ne peut être abolie qu'en abolissant la société de classes. Quand le vol commence à remplacer l'achat-vente, c'est en même temps l'autoréalisation et l'autodestruction de la civilisation bourgeoise. En l'absence d'alternative, d'une perspective révolutionnaire communiste, l'envie d'exercer la violence contre les autres grandit.
Le poisson pourrit par la tête
Qu'arrive-t-il lorsque des parties de la classe dominante elle-même, suivies par certaines couches intermédiaires de la société, commencent à perdre confiance dans la possibilité de croissance soutenue pour l'économie mondiale ? Ou lorsqu'elles commencent à perdre l'espoir de pouvoir bénéficier elles-mêmes d'une quelconque croissance éventuelle ? En aucun cas elles ne voudront renoncer à leurs aspirations à une (plus grande) part de richesse et de pouvoir. Si la richesse disponible ne devait plus croître, elles peuvent toujours se battre pour obtenir une plus grande part aux dépens des autres. Là réside le lien entre la situation économique et la soif grandissante de violence. La perspective de la croissance commence à être remplacée par la perspective du vol et du pillage. Si des millions de travailleurs illégaux étaient expulsés, selon cette logique, il y aurait plus d'emplois, de logements, de protection sociale pour ceux qui restent. La même chose s'applique à tous ceux qui vivent du système des aides sociales sans rien débourser pour elles. Quant aux minorités ethniques, certaines d'entre elles ont des entreprises qui pourraient passer dans d'autres mains. Cette façon de penser remonte des profondeurs de la "société civile" bourgeoise.
Toutefois, selon une vieille expression, le poisson pourrit par la tête. C'est d'abord et avant tout l'État et l'appareil économique de la classe dominante elle-même qui produisent cette putréfaction. Le diagnostic des médias capitalistes est que la présidence de Trump, la victoire du Brexit en Grande-Bretagne, la montée du "populisme" de droite en Europe, sont le résultat d'une protestation contre la "mondialisation". Mais ceci est vrai uniquement si la violence est comprise comme l'essence de cette protestation et si la mondialisation n'est pas seulement comprise en tant qu'option économique parmi d'autres, mais en tant que terme désignant les moyens extrêmement violents par lesquels un capitalisme en déclin s'est maintenu en vie ces dernières décennies. Le résultat de cette gigantesque offensive économique et politique de la bourgeoisie (une sorte de guerre de la classe capitaliste contre le reste de l'humanité et contre la nature) s'est soldé par des millions de victimes, pas seulement parmi les populations ouvrières du globe mais également au sein de l'appareil de la classe dominante elle-même. C'est ce dernier aspect notable qui, de par son étendue, est absolument sans précédent dans l'histoire moderne. Sans précédent aussi est le degré auquel des parties de la bourgeoisie américaine et son appareil d'État lui-même ont été victimes de cette dévastation. Et ceci est vrai même si les États-Unis ont été le principal instigateur de cette politique. C'est comme si la classe dominante était obligée de couper des parties de son propre corps dans le but de sauver le reste. Des secteurs entiers de l'industrie nationale ont cessé leur activité parce que leurs produits pouvaient être fabriqués moins cher ailleurs. Non seulement ces industries elles-mêmes ont dû mettre la clé sous la porte, mais des parties entières du pays ont été dévastées au passage : régions et administrations, succursales locales des chaînes de distribution et des banques, sous-traitants, entreprises locales du bâtiment, etc. ont toutes été anéanties. Parmi les victimes figurent non seulement les travailleurs, mais aussi les grandes et les petites entreprises, les fonctionnaires et les dignitaires locaux. Contrairement aux ouvriers qui ont perdu leurs moyens de subsistance, ces victimes - bourgeois et petits-bourgeois - ont perdu leur pouvoir, leurs privilèges et leur statut social.
Ce processus a eu lieu, plus ou moins radicalement, dans tous les anciens pays industriels au cours des trois dernières décennies. Mais aux États-Unis, il y a eu, en outre, une sorte de tremblement de terre au sein de l'armée et de ce qu'on appelle l'appareil de renseignement. Sous Bush Jr. et Rumsfeld, des parties des forces armées et de sécurité et même des services de "renseignement" ont été "privatisées" - mesures qui ont coûté leurs emplois à de nombreux dirigeants de haut rang. De plus, le "renseignement" devait faire face à la concurrence des médias modernes tels que Google ou Facebook qui, à certains égards, sont aussi bien informés et aussi importants pour l'État que la CIA ou le FBI. Au cours de ce processus, l'équilibre des forces au sein de la classe dirigeante a changé, y compris au niveau économique, où les secteurs du crédit et de la finance ("Wall Street") et les nouvelles technologies ("Silicon Valley") ne sont pas seulement parmi les principaux bénéficiaires de la "mondialisation" mais aussi parmi ses principaux protagonistes.
Par opposition à ces secteurs, qui ont soutenu la candidature d'Hillary Clinton, les partisans de Donald Trump ne doivent pas être recherchés dans des fractions économiques spécifiques, bien que ses partisans les plus forts se trouvent parmi les dirigeants des anciennes industries qui ont tant décliné ces dernières décennies. Ils se trouvent plutôt ici et là, dans tout l'État et l'appareil économique du pouvoir. Ils étaient les tireurs isolés nourrissant, depuis derrière les coulisses, le feu croisé contre Clinton en tant que candidate présumée de "Wall Street". Ils comprenaient des magnats des affaires, des publicistes frustrés et des dirigeants du FBI. Pour ceux d'entre eux qui ont perdu espoir de devenir "grands" à nouveau, leur soutien à Trump était avant tout une sorte de vandalisme politique, une vengeance aveugle contre l'élite dirigeante.
Ce vandalisme se manifeste aussi dans la volonté de fractions importantes de la classe dirigeante - surtout celles liées aux industries du pétrole, du gaz et du charbon – de soutenir le rejet massif des connaissances scientifiques expliquant le changement climatique dont Trump a écarté l'idée comme étant un canular inventé par les Chinois. Ceci est une autre manifestation du fait que des parties importantes de la bourgeoisie ont tellement perdu toute vision d'un futur pour l'humanité qu'elles sont ouvertement prêtes à mettre leurs marges bénéficiaires ("nationales") au-dessus de toute considération pour le monde naturel, minant la base fondamentale de toute vie sociale humaine. La guerre contre la nature qui a été considérablement intensifiée par l'ordre mondial "néo-libéral" sera menée encore plus impitoyablement par Trump et ses comparses vandales.
Ce qui est arrivé est très grave. Alors que les principales fractions de la bourgeoisie américaine adhèrent encore à l'ordre économique mondial existant et veulent s'engager dans son maintien, le consensus à ce sujet au sein de la classe dirigeante dans son ensemble a commencé à s'effriter. C'est d'abord parce qu'une partie croissante de la bourgeoisie ne semble plus se soucier de cet ordre mondial. C'est en second lieu parce que les fractions dirigeantes ont été incapables d'empêcher l'arrivée d'un candidat de ces "desperados" à la Maison Blanche. L'érosion à la fois de la cohésion de la classe dominante et de son contrôle sur son propre appareil politique n'aurait pu se manifester plus clairement. Depuis sa victoire de la Seconde Guerre mondiale, la bourgeoisie américaine a pris le relais de son homologue britannique dans le rôle de chef de file de la gestion de l'économie mondiale dans son ensemble. En général, la bourgeoisie de la première puissance économique mondiale est la mieux placée pour assumer ce rôle. D'autant plus lorsque, comme les Etats-Unis, elle dispose de la force militaire pour donner à son autorité un poids supplémentaire. Il est remarquable qu'aujourd'hui, ni les Etats-Unis, ni leur prédécesseur Britannique, ne peuvent assumer ce rôle - et pour la même raison essentiellement. C'est le poids du populisme politique qui fait sortir Londres des institutions économiques européennes. Ce fut un signe de désespoir quand, au début de la nouvelle année, le Financial Times, l'une des voix importantes de la City de Londres, a appelé la chancelière allemande Angela Merkel à assumer la direction mondiale. Trump, en tout cas, semble peu disposé et incapable d'assumer ce rôle, et il n'y a aucun autre leader mondial pour le moment qui pourrait le remplacer. Une phase dangereuse est à venir pour le système capitaliste et pour l'humanité.
L'affaiblissement de la résistance de la classe ouvrière
L'affaiblissement du principe de solidarité indique clairement que la victoire de Trump n'est pas que le résultat d'une perte de perspective par la classe capitaliste, mais aussi par la classe ouvrière. Sinon beaucoup moins de travailleurs seraient influencés négativement par ce qu'on appelle le populisme. Il est significatif, par exemple, qu'avec des millions de travailleurs blancs, de nombreux latinos semblent également avoir voté pour Trump, en dépit de ses diatribes contre eux. Beaucoup parmi ceux qui étaient les derniers à avoir accès à la "patrie de Dieu", précisément parce qu'ils ont peur d'être parmi les premiers à être expulsés, ont été attirés en pensant qu'ils seraient plus en sécurité si la porte était fermement fermée derrière eux.
Qu'est-il arrivé à la classe ouvrière, à sa perspective révolutionnaire, à son identité de classe et à ses traditions de solidarité ? Il y a plus d'un demi-siècle, la classe ouvrière faisait son retour sur la scène de l'histoire, surtout en Europe (mai 1968 en France, automne 1969 en Italie, 1970 en Pologne, etc.) mais aussi plus globalement. Dans le "Nouveau Monde", cette renaissance de la lutte des classes s'était manifestée en Amérique latine (surtout en Argentine en 1969), mais aussi en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. Il y avait deux expressions principales de cette résurgence. L'une consistait en un développement de grèves sauvages à grande échelle et d'autres luttes, souvent radicales, sur un terrain économique, pour des revendications de la classe ouvrière. L'autre expression consistait en la réapparition de minorités politisées parmi la nouvelle génération attirée par la politique prolétarienne révolutionnaire. Particulièrement importante était la tendance à développer une perspective communiste contre le stalinisme, plus ou moins clairement reconnu comme contre-révolutionnaire. Le retour au premier plan des luttes ouvrières, l'identité de classe et la solidarité, une perspective révolutionnaire prolétarienne, vont de pair. Dans les années 1960 et 70, probablement plusieurs millions de jeunes dans les vieux pays industriels ont été politisés de cette manière constituant ainsi un espoir d'humanité et une force pour le réaliser.
Outre les souffrances de la classe ouvrière, les deux questions les plus brûlantes à l'époque aux États-Unis étaient la guerre du Vietnam (le gouvernement américain avait d'ailleurs introduit la conscription obligatoire) et l'exclusion raciste et la violence contre les Noirs. À l'origine, ces questions étaient au moins en partie des facteurs supplémentaires de politisation et de radicalisation. Cependant, dépourvus de toute expérience politique propre, dépourvus d'une orientation venue d'une génération plus ancienne politisée au sens prolétarien, les nouveaux militants nourrissaient d'énormes illusions sur les possibilités d'une transformation sociale rapide. En particulier, les mouvements de classe de l'époque étaient encore trop faibles pour obliger le gouvernement soit à mettre fin à la guerre du Vietnam, soit à protéger les noirs et les autres minorités contre le racisme et la discrimination (contrairement au mouvement révolutionnaire de 1905 en Russie, par exemple, qui incluait la révolte contre la guerre russo-japonaise ainsi que la protection des Juifs en Russie contre les pogroms). Alors qu'au sein de la bourgeoisie américaine se développaient des fractions qui, dans son propre intérêt de classe, voulaient mettre fin à l'engagement au Vietnam et permettre à une bourgeoisie noire américaine de partager son pouvoir, beaucoup de ces jeunes militants se sont retrouvés dans la politique bourgeoise, tournant ainsi le dos à la classe ouvrière. D'autres, tout en voulant rester attachés à la cause des travailleurs mais qui débordaient d'impatience, se sont présentés comme candidats de gauche aux élections des Etats ou se sont engagés dans les syndicats dans l'espoir de réaliser quelque chose d'immédiat et tangible pour ceux qu'ils prétendaient représenter. Des espoirs qui furent invariablement déçus. Les ouvriers ont développé une hostilité de plus en plus ouverte envers ces gauchistes qui, de plus en plus souvent, se discréditaient eux-mêmes ainsi que la réputation de la révolution par leur identification avec des régimes brutaux, contre-révolutionnaires, essentiellement staliniens, et par leur approche bourgeoise manipulatrice de la politique. Quant à ces militants eux-mêmes, ils développèrent à leur tour une hostilité envers la classe ouvrière qui refusait de les suivre - une hostilité qui se transformait souvent en haine. Tout cela représentait une destruction à grande échelle de l'énergie politique révolutionnaire. C'était une tragédie de presque toute une génération de la classe ouvrière qui avait pourtant débuté de façon aussi prometteuse. Ce qui advint ensuite ce fut l'effondrement du stalinisme en 1989 (incompris et dénaturé car présenté comme l'effondrement du communisme et du marxisme) et la fermeture de toutes les industries traditionnelles dans les vieux pays capitalistes (mal comprise et présentée comme correspondant à la disparition de la classe ouvrière dans cette partie du monde). Dans ce contexte (comme l'a souligné par exemple le sociologue français Didier Eribon), la gauche politique (qui, selon le CCI, est la gauche du capital, une partie de l'appareil de la classe dominante) a été parmi les premiers courants à déclarer la disparition de la classe ouvrière. Il est révélateur que, lors de la récente campagne électorale aux Etats-Unis, le candidat des démocrates (qui prétendait représenter le "travail organisé") n'a jamais fait référence à la classe ouvrière, alors que le multimillionnaire Donald Trump le faisait constamment. En fait, une de ses principales promesses électorales était d'empêcher "l'extinction" de la "classe ouvrière" américaine (comprise comme étant seulement "les cols bleus"). Sa classe ouvrière est une partie essentielle de la nation américaine, et elle correspond à un rêve capitaliste: patriotique, travailleuse, obéissante.
La disparition de l'avant-scène, pour le moment, de l'identité de la classe ouvrière et de sa solidarité est une catastrophe pour le prolétariat et pour l'humanité. Face à l'incapacité actuelle de l'une ou l'autre des deux grandes classes de la société moderne de présenter une perspective crédible propre, l'essence même de la société bourgeoise apparaît plus clairement à la lumière du jour: la désolidarisation. Le principe de solidarité qui est le filet de sécurité, plus ou moins de toutes les sociétés précapitalistes fondées sur l'économie naturelle plutôt que sur le "marché", est remplacé par le filet de sécurité de la propriété privée - pour ceux qui en disposent. Dans la société bourgeoise, il faut pouvoir s'aider soi-même, et pour cela les moyens ne sont pas la solidarité, mais la solvabilité et l'assurance. Pendant des décennies, dans les principaux pays industriels, l'État providence - bien que faisant partie intégrante de l'économie du crédit et des assurances - a été utilisé pour cacher cette élimination de la solidarité de l'agenda social. Aujourd'hui, le rejet de la solidarité n'est pas non seulement caché, mais il gagne du terrain.
Le défi pour la classe ouvrière
Les manifestations de millions de personnes, principalement des femmes, partout aux États-Unis, contre le nouveau président, le lendemain de son investiture, ont montré clairement qu'une grande partie de la population active de l'Amérique ne soutient ni Trump ni la tendance qu'il défend. Cependant, loin de réussir à s'opposer au nationalisme de Trump, ces manifestations tendent à répondre à Trump sur son propre terrain en affirmant: "Nous sommes la véritable Amérique".
Ces manifestations montrent en effet que la politique populiste d'exclusion et de recherche de boucs émissaires n'est pas le seul danger pour la classe ouvrière. Cette jeune génération qui exprime sa protestation, si elle ne suit pas Trump, risque néanmoins de tomber dans le piège de la défense de la société bourgeoise "démocratique" et "libérale". Les fractions dirigeantes de la bourgeoisie seraient ravies d'obtenir le soutien des secteurs les plus intelligents et les plus généreux de la classe ouvrière pour défendre la version actuelle d'un système d'exploitation qui, même sans "populisme", est depuis longtemps devenu une menace pour l'existence de notre espèce et qui, de plus, est lui-même le producteur du "populisme" qu'il veut garder sous contrôle. Il est indéniable qu'aujourd'hui, pour de nombreux travailleurs, en l'absence d'une alternative révolutionnaire en laquelle ils peuvent avoir confiance, un Obama, Sanders ou Angela Merkel peuvent apparaître comme un moindre mal par rapport à un Trump, Farage, Le Pen ou "l'Alternative für Deutschland". Mais en même temps, ces travailleurs se sentent également indignés par ce que la "société libérale" a imposé à l'humanité au cours des dernières décennies. L'antagonisme de classe demeure.
Il convient également de souligner que la résistance au sein de la classe ouvrière au populisme n'est pas en soi une preuve que ces travailleurs suivent les libéraux bourgeois et sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts de classe. Des millions de travailleurs au cœur du système mondialisé de production sont avant tout très conscients que leur existence matérielle dépend d'un système mondial de production et d'échange et qu'il ne peut y avoir de retour à une division du travail plus locale. Ils sont également conscients que ce que Marx appelle la "socialisation" de la production (le remplacement de l'individu par le travail associé) leur apprend à collaborer entre eux à l'échelle mondiale et que c'est seulement à une telle échelle que les problèmes actuels de l'humanité peuvent être surmontés. Dans la situation historique actuelle, en l'absence d'identité de classe et de lutte pour une société sans classes, le potentiel révolutionnaire de la société contemporaine se réfugie pour l'instant dans des conditions "objectives" : la persistance des antagonismes de classe ; le caractère inconciliable des intérêts de classe ; la collaboration mondiale des prolétaires dans la production et la reproduction de la vie sociale. Seul le prolétariat a un intérêt objectif et une capacité objective à résoudre la contradiction entre la production mondiale et l'appropriation privée et nationale de la richesse par les États. Puisque l'humanité ne peut pas retourner à une production marchande locale, elle ne peut aller de l'avant qu'en abolissant la propriété privée, en mettant le processus de production international à la disposition de l'humanité tout entière.
Sur cette base objective, les conditions subjectives de la révolution peuvent encore se rétablir, notamment par le retour de la lutte économique du prolétariat à une échelle importante et par le développement d'une nouvelle génération de minorités politiques révolutionnaires avec l'audace nécessaire de reprendre maintenant plus que jamais la cause de la classe ouvrière, et de le faire avec la profondeur nécessaire pour convaincre le prolétariat de sa propre mission révolutionnaire.
Steinklopfer (fin janvier 2017)
Géographique:
- Etats-Unis [664]
Personnages:
- Donald Trump [577]
Récent et en cours:
- élections aux États-Unis [665]
Rubrique:
Du mouvement de Soweto en 1976 à l’arrivée au pouvoir de l’ANC en 1993
- 1413 lectures
Dans le précédent article sur le mouvement ouvrier en Afrique du Sud (publié dans la Revue internationale n° 155), nous avons mis en évidence l’efficacité contre la lutte de clase du système d’apartheid combiné à l’action des syndicats et des partis et ce jusqu’à la fin des années 1960 où, face à un développement inédit de la lutte de classe, la bourgeoisie dut "moderniser" son dispositif politique et remiser ce système. Autrement dit, elle dut faire face au prolétariat sud-africain qui, à travers des luttes massives s’inscrivait dans les vagues de lutte qui marquèrent au niveau mondial la fin des années 1960 et le début des années 1970.
Dans cette introduction nous voulons attirer d’emblée l’attention du lecteur sur l’importance des questions qu’il traite. Si, face à de nouveaux mouvements sociaux, la bourgeoisie sud-africaine s’appuie sur ses armes traditionnelles les plus barbares - ses forces policières et militaires - la dynamique de la confrontation entre les classes porte en elle des développements inédits dans ce pays. La classe ouvrière n’y avait jamais encore fait preuve d’une telle combativité et d’un tel développement de sa conscience ; face à une bourgeoisie qui, elle non plus, n’avait jamais à ce point sophistiqué ses manœuvres, notamment en ayant largement recours à l’arme du syndicalisme de base animé par l’extrême gauche du capital. Dans cet affrontement entre les deux véritables classes historiques, la détermination du prolétariat ira jusqu’à provoquer objectivement le démantèlement du système d’apartheid se traduisant par la réunification de toutes les fractions de la bourgeoisie en vue de faire front face à la déferlante de la lutte de classe ouvrière.
Avant cela, suite à la vague de luttes qui marqua la période de 1973/1974 1, on assista en 1976 à un vigoureux prolongement de cet épisode de lutte : le soulèvement de la jeunesse scolarisée. En juin de cette année-là, quelques dix mille jeunes descendirent dans la rue pour protester contre l’enseignement obligatoire en afrikaans et plus généralement contre les mauvaises conditions de vie imposées par le système d’apartheid. Un mouvement de jeunes aussitôt suivi par la mobilisation des milliers d’adultes, ouvriers actifs et chômeurs. Durement secoué par cette formidable flamme prolétarienne, le pouvoir répondit, comme de coutume, en lâchant ses chiens sanguinaires – les forces de répression - sur les protestataires et massacrant des centaines de manifestants dont des enfants :
"Depuis les grandes grèves de 1973-74, un autre front de lutte s’est ouvert en Afrique du Sud : celui des écoliers et des étudiants noirs dont la colère a explosé en juin 1976 à Soweto. Depuis, l’insurrection populaire n’a guère connu d’accalmie. La violente répression policière (500 morts environ dans la seule cité de Soweto, des centaines d’autres à travers tout le pays, des milliers de blessés) a soudé l’ensemble du peuple noir dans ce combat commun.
Parmi les jeunes à l’origine du mouvement populaire, beaucoup sont tombés sous les balles de la police au cours des manifestations non violentes ou lors de raids de milices civiles dans les quartiers noirs. Les adultes, frappés par le courage et la détermination de la jeune génération, se sont joints à elle, et ont suivi les mots d’ordre lancés par ses porte-parole : des grèves ouvrières et le boycottage des transports ont été organisés à plusieurs reprises dans les cités noires de Johannesburg et du Cap. Ils ont été massivement suivis, y compris par les populations métisses de la province du Cap. Aux destructions de bâtiments scolaires, de débits de boisson, d’administrations et de moyens de transport qui ont marqué tout le début de la révolte populaire, ont fait suite des campagnes plus orchestrées, mais tout aussi suivies. Boycottage des cours et des examens jusqu’à la libération de jeunes emprisonnés, deuil général en mémoire aux victimes de la répression, boycottage des débits de boisson, des grands magasins, des fêtes de Noel". 2
Nous sommes ici en présence d’un grand mouvement insurrectionnel prolétarien contre la misère générale imposée par une des formes les plus brutales du capitalisme, à savoir à savoir l’apartheid. Un soulèvement de dignité de la part de la jeunesse faisant écho à la reprise de la lutte de classe internationale marquée par les grandes grèves ouvrières du début des années 1970 dans divers pays du monde. Un mouvement qui a fini par s’étendre dans les grandes zones industrielles du pays entraînant et mêlant dans un même combat ouvriers et populations de tous âges. Bien entendu face à une lutte de cette ampleur avec une colère prolétarienne déferlante tendant à ébranler le système, le pouvoir barbare ne put cacher son affolement et répondit par la terreur sanglante, quitte à susciter l’indignation générale dans le pays et amplifier la colère et la mobilisation de toute la population de Soweto et au-delà. Des ouvriers, des chômeurs et des familles avec enfants rejoignirent le combat des jeunes scolarisés et subirent eux aussi les matraques et les balles des forces de l’ordre à l’origine des milliers de victimes dans leurs rangs.
Mais la sauvagerie des tueries ne fit que radicaliser le mouvement qui se maintient jusqu’en 1977 avec des grèves et des manifestations massives et tendit surtout à se politiser en suscitant un foisonnement d’innombrables comités de lutte dits "civics" 3 constitués majoritairement par des travailleurs (syndiqués ou pas), des chômeurs, des jeunes et leurs parents.
"Les civics se sont rapidement développées au Cap à la fin des années soixante-dix. Elles prolongèrent d’une certaine manière les formes d’organisation au sein des townships qui étaient apparues au cours des mouvements de juin 1976 dans le Transvaal. Il y a pratiquement autant d’histoires spécifiques qu’il y a eu d’organisations puisque celles-ci naissaient très souvent à partir des besoins particuliers d’un township ou d’un quartier. Beaucoup ont pu apparaître sous la forme de comités de lutte soit pour le boycott des transports en commun contre une augmentation des tarifs, soit pour un boycott des loyers contre l’augmentation de ceux-ci. Certaines ont pris la forme de comités politiques traitant de tous les problèmes de la communauté. Le mouvement fut infiniment diversifié : les associations cultuelles, religieuses, de jeunesse, d’étudiants ou de lycéens, des parents d’élèves, furent progressivement assimilées à la notion de "civics". Il n’y avait donc pas simplement un comité par quartier ou par township ; il y avait un croisement complexe des appartenances militantes et des terrains d’intervention" 4.
Voilà un puissant mouvement social qui cristallisa à un haut niveau certaines des caractéristiques de la vague de luttes à l’échelle internationale. En effet, il est remarquable de voir que la forte combativité de la classe ouvrière qui se traduisit par des grèves massives s’exprima également par une forte volonté d’auto-organisation qui explique l’extraordinaire multiplication des "civics". À notre connaissance ce fut la première fois qu’on assista, avec cette ampleur, en Afrique du Sud (et sur le continent africain), à de telles formes d’auto-organisation, où plusieurs années durant la vie sociale des quartiers était littéralement l’affaire des habitants eux-mêmes qui débattaient de tous les sujets et prenaient en charge tous les problèmes les concernant. Ce fut là l’aspect le plus inquiétant pour la bourgeoisie qui voyait son autorité lui échapper "sauvagement". Certes on peut noter que quelques comités prirent, ici ou là, un caractère interclassiste ou une connotation religieuse, particulièrement à mesure que les forces bourgeoises (syndicats, partis, églises, etc.) y s’infiltraient. Cependant, il doit être clair que les "civics", en dépit de l’hétérogénéité idéologique qui les caractérisaient, étaient fondamentalement le produit d’une authentique lutte de classe prolétarienne. Par ailleurs, l’aspect auto-organisation du soulèvement de Soweto montre un pas supplémentaire par rapport à la politisation qui avait caractérisé le prolétariat sud-africain lors du puissant mouvement de luttes des années 1973/1974, particulièrement en termes de solidarité et d’unité dans le combat de classe. Dès lors on peut établir un lien évident de continuité entre les deux mouvements de lutte, le deuxième prenant le relais du premier pour aller plus loin dans le développement de la conscience de classe, comme l’illustre la citation suivante relative au bilan de la vague de luttes précédente :
"Le développement de la solidarité des travailleurs noirs au cours de l’action et la prise de conscience de leur unité de classe ont été soulignés par de nombreux observateurs. Cet acquis, non quantifiable, des luttes est considéré par eux comme le plus positif pour la poursuite de l’organisation du mouvement ouvrier noir. (…) Ces grèves étaient également politiques : le fait que les travailleurs demandaient le doublement de leur salaire n’est pas le signe de la naïveté ou de la stupidité des Africains. Il indique plutôt l’expression du rejet de leur situation et leur désir d’une société totalement différente. Les ouvriers retournèrent au travail avec quelques acquis modestes, mais ils ne sont pas plus satisfaits maintenant qu’ils l’étaient avant les grèves". (Brigitte Lachartre, Ibid.) De ce fait, on peut en déduire qu’un grand nombre des acteurs des grèves de 1973/74 ont ensuite été partie prenante du mouvement insurrectionnel de Soweto au sein duquel, grâce à leur expérience acquise précédemment, ils purent jouer un rôle déterminant quant à sa radicalisation et sa politisation. De telles potentialités pour le développement de la combativité de la combativité et de la conscience ne pouvaient que faire trembler la bourgeoisie qui, d’ailleurs, dut en prendre pleinement conscience y compris au niveau inter-impérialiste.
Les grandes puissances impérialistes s’en mêlèrent
En effet, le mouvement de Soweto se prolongea par des grèves et des manifestations jusqu’en 1977 où la répression policière fit encore un grand nombre de victimes dont le jeune adolescent Steve Biko, militant du mouvement de la "Conscience Noire". L’assassinat de ce jeune dans les locaux de la police redynamisa les luttes et amplifia les manifestations d’indignation, la victime devenait ainsi un "martyre" de l’apartheid, notamment aux yeux de tous les défenseurs de la "cause noire" et au-delà dans le monde. Ainsi, en Afrique comme en Amérique et surtout en Europe où l’on assista à de nombreuses manifestations contre le régime d’apartheid pilotées notamment par les syndicats et les partis de gauche, l’on put lire (en France) des slogans tels que ceux-ci : "Contre les relations amicales (tourisme, sport, culture) franco-sud-africaines ; contre l’émigration française en Afrique du Sud ; contre les livraisons d’armes et de technologie en Afrique du Sud ; contre les importations de produits sud-africains, etc.". (B. Lachartre, Ibid.)
Conscient de l’intensification du mouvement avec notamment la radicalisation de la jeunesse prolétarienne de Soweto, le bloc impérialiste de l’OTAN accentua la pression sur son allié sud-africain (y compris sur le plan économique en allant jusqu’au boycott de produits sud-africains) pour éviter la déstabilisation politique qui menaçait à terme. Mais surtout pour faire face à l’exploitation idéologique des événements par le bloc russe qui, non content d’armer et de financer l’ANC, se mit également à instrumentaliser ouvertement les diverses manifestations de par le monde contre le régime d’apartheid. C’est dans ce contexte que les responsables sud-africains finirent par accepter les "conseils" de leurs parrains occidentaux en prenant conscience des risques encourus. Ainsi, on put voir même chez les dirigeants sud-africains les plus radicaux un changement de ton ou de tactique envers les grévistes :
"À moins que nous ne réussissions à créer une classe moyenne forte parmi les Noirs, nous aurons de sérieux problèmes." (Botha, ministre de la défense,). "On doit donner suffisamment aux Noirs pour qu’ils croient au développement séparé (expression pudique pour désigner le système de l’apartheid) et qu’ils veillent bien protéger ce qu’ils possèdent des agitateurs. Rien ne nous arrivera si nous donnons à ces gens suffisamment pour qu’ils aient peur de perdre ce qu’ils ont… Une personne heureuse ne peut devenir communiste." (Kruger, ministre de la police et de la justice).
Dès lors le gouvernement de Pretoria décida de faire un certain nombre de concessions allant dans le sens des revendications des jeunes en lutte, par exemple en retirant ainsi sa loi visant à imposer aux élèves africains l’enseignement en afrikaans et en levant également l’interdiction pour les habitants de Soweto de posséder ou de construire leurs propres maisons tout en se voyant reconnaître des droits associatifs impliquant l’existence d’organisations syndicales et politiques.
A dire vrai, le capital sud-africain (son secteur le plus "éclairé") n’avait pas attendu le mouvement de Soweto pour commencer à mettre en place ses orientations visant à assouplir le régime d’apartheid pour mieux contrecarrer les luttes ouvrières :
"La société avait bougé. Le système, n’était, à nouveau, plus à l’abri d’une déstabilisation. Le gouvernement et le patronat sud-africains allaient donc procéder à quelques rectifications, de manière à encadrer aussi bureaucratiquement que possible les évolutions sociopolitiques. Le Bantu Labour Regulation Act de 1973 compléta ainsi l’arsenal des réglementations du travail. Il instaura deux types de comités d’usines : Des comités d’entreprise (working committee) composés uniquement des représentants des travailleurs ; Le comité de liaison (liaison committee) était composé de représentants de l’employeur et des employés, en nombre égal (…) Et l’Urban Training Project joua le jeu et chercha à utiliser ces comités d’usine pour stabiliser les syndicats qu’il coordonnait". (Claude Jacquin, Ibid.)
La mise en place de ce dispositif bien avant l’éclatement du mouvement de révolte de Soweto exprimait clairement la volonté de la bourgeoisie sud-africaine de prendre en compte l’évolution de la situation dont le contrôle tendait à lui échapper. En effet, en tirant les leçons de la première vague de luttes des années 1972-74, elle dut prendre nombre de mesures audacieuses dont les principales visaient à donner plus de "pouvoir" aux syndicats africains en augmentant largement leur nombre et en élargissant les "droits" dans le but affiché d’éviter les "désordres politiques" 5. Il se trouve cependant que cela restait largement insuffisant pour empêcher le développement des luttes, comme l’a montré le mouvement de Soweto.
La lutte de classe prolétarienne ébranla le système d’apartheid
Dans le but manifeste de contrer la lutte de classe prolétarienne, le pouvoir sud-africain entreprit un grand virage en décidant d’instaurer de nouvelles orientations politiques visant ni plus ni moins au démantèlement (progressif) du système d’apartheid, ce qui signifie la dissolution des barrières raciales et l’intégration des mouvements nationalistes noirs dans le jeu politique (démocratique). Bref, pour en arriver là, le régime d’apartheid avait déjà dû être sérieusement ébranlé dans ses fondements.
En d’autres termes, au milieu des années 1970 tout change du fait de l’irruption de la lutte de classe, la bourgeoisie n’étant jusqu’alors pas vraiment inquiétée par la question sociale :
"Les événements de Soweto, de juin 1976, allaient confirmer le changement politique en cours dans le pays. La révolte des jeunes du Transvaal s’ajouta à la renaissance du mouvement ouvrier noir pour déboucher sur les grands mouvements sociaux et politiques des années quatre-vingt. Après les grèves de 1973, les affrontements de 1976 ferment ainsi la période de la défaite". (C. Jacquin, Ibid.)
Il s’agit là d’un véritable retournement de situation dans la mesure où l’apartheid fut conçu avant tout contre la lutte de classe en ayant pour but d’éviter la manifestation concrète d’une classe ouvrière multiraciale6 la ségrégation en matière d’attribution de "droits/privilèges" à des fractions de la classe ouvrière. Autrement dit, la théorie de la prétendue "suprématie" des Blancs sur les Noirs se traduisit concrètement par des emplois (qualifiés) et d’autres avantages réservés exclusivement aux ouvriers d’origine européenne, tandis que leurs camarades africains, indiens et métis devaient se contenter de conditions de travail, de rémunération et d’existence nettement plus défavorables 7. Ce faisant le régime d’apartheid parvint à corrompre une bonne partie de la classe ouvrière d’origine européenne en la faisant adhérer volontairement ou passivement à son système ségrégationniste. Et tout cela se solda par la très longue période (entre 1940 et 1980) de division du prolétariat sud-africain ainsi entravé dans sa capacité à développer des luttes à même de gêner la bonne marche du capitalisme.
Un tournant historique du système d’apartheid
Mais ce retournement de situation se traduisit aussi par un rapprochement entre les fractions de la bourgeoisie issues des deux anciennes puissances coloniales à savoir britannique et hollandaise qui, face à la montée en puissance du prolétariat, tendirent à l’unité de toutes les composantes ethniques, décidèrent d’oublier leur haine et divergences idéologiques ancestrales pour s’unir derrière le capital national sud-africain comme un tout.
Il s’agissait donc d’un tournant véritablement historique dans la vie de la bourgeoisie sud-africaine en général et au sein de la fraction afrikaner en particulier. En effet, depuis la terrible "guerre des Boers" 8 de 1899/1902, opposant Afrikaners et Britanniques, où les seconds écrasèrent les premiers, la haine entre les descendants des colons venus des deux anciennes puissances coloniales restait visible jusqu’à la veille de la fin de l’apartheid, alors même qu’elles durent gouverner ensemble le pays à plusieurs reprises. Une fraction importante des Afrikaners rêvait depuis longtemps de prendre sa revanche sur l’empire britannique, comme l’illustrèrent le fait que durant la Seconde Guerre mondiale une bonne partie des dirigeants afrikaners (notamment militaires) manifestèrent ouvertement leur soutien au régime hitlérien qui fut leur référence idéologique ainsi que la décision du pouvoir afrikaner de quitter le Commonwealth et de changer l’ancien nom du pays (Union Sud-Africaine) en le remplaçant par son appellation actuelle.
Pour aborder ce grand tournant historique qu’a constitué le démantèlement de l’Apartheid, le capital sud-africain a pu trouver un allier stratégique de taille, à savoir le syndicalisme, mais d’un nouveau genre, en l’occurrence le "syndicalisme radical" de "base" (comme on le verra plus loin), seul capable, à ses yeux, d’endiguer les vagues de lutte qui le menaçaient de plus en plus dangereusement. Et cette fois-ci, compte tenu de l’importance des enjeux de l’époque, ce furent tous les principaux acteurs décisifs de la bourgeoisie sud-africaine qui assumèrent clairement cette nouvelle orientation y compris donc les dirigeants afrikaners, à savoir les tenants de l’apartheid les plus réactionnaires, pour ne pas dire fascisants (à l’instar de Botha, Kruger, etc.). De même, comme on le verra plus loin, ce furent ces derniers en compagnie de De Klerk (ancien président) qui téléguidèrent directement le processus de négociation avec l’ANC de Mandela en vue de la dislocation du système d’apartheid.
Pour sauver son système la bourgeoisie accoucha de nouveaux syndicats
Face à l’effondrement de tous les anciens appareils syndicaux provoqué par le feu des luttes des années 1970 et ce malgré le renforcement par l’État de leurs moyens d’action, la bourgeoisie décida alors de recourir carrément à ce que l’on appelle un "syndicalisme de base" ou "shop-stewards", prenant la forme de nouveaux syndicats "combatifs" se voulant "indépendants vis-à-vis des grandes centrales syndicales".
"(…) Durant les années soixante-dix, plusieurs courants syndicaux se sont développés et se sont différenciés sur fond de reprise des conflits sociaux. Leurs histoires s’entremêlent au rythme des scissions et des unifications. Trois projets syndicaux se sont ainsi développés sur la base de quelques postulats politiques et idéologiques distincts.
Le premier s’est constitué (ou reconstitué) autour de la tradition syndicale du South African Congress of Trade Unions (SACTU) et de son lien à l’African National Congress (ANC). Le second s’est formé à partir de la nouvelle mouvance Black Consciousness (Mouvement de la Conscience noire). Il formera notamment le Concil of Union of South Africa (CUSA). Le dernier, enfin, est apparu de manière originale, sans lien apparent avec un courant politique connu. Il a donné naissance, en 1979, à la Federation of South African Trade Unions (FOSATU)". (C. Jacquin, Ibid.)
Il s’agit là d’une recomposition radicale du dispositif syndical ayant pour objectif de neutraliser les luttes ouvrières au moyen de nouveaux instruments, à défaut de pouvoir les empêcher. Mais ce que cela montre d’abord c’est que le pouvoir dirigeant sud-africain était parfaitement conscient du danger que représentait le développement de la lutte de classe à partir de 1973 jusqu’au mouvement de Soweto en 1976 et au-delà. Il fit le constat que le système d’apartheid dans toutes ses formes n’était plus adapté à la montée de la combativité ouvrière s’accompagnant d’une prise de conscience grandissante de la part du prolétariat sud-africain. En clair, le pouvoir bourgeois dut prendre acte du fait que le système de syndicalisation basé sur la division des travailleurs selon leurs origines ethniques n’était plus adapté et que les grands appareils syndicaux, comme TUCSA (Trade UNION Council of South Africa) n’étaient plus crédibles auprès des ouvriers combatifs notamment de la jeune génération. D’où l’émergence de ces nouveaux syndicats appelés à jouer le rôle d’un syndicalisme de "base", de "combat", "indépendant" vis-à-vis des appareils syndicaux. Le passage suivant (C. Jacquin) relatif à la FOSATU (Federation of South Africa Trade Unions) est éloquent quant à la réalité de ces nouveaux syndicats :
"(…) Notre étude est particulièrement consacrée à ce courant syndical(FOSATU) qui s’est formé à partir de réseaux d’intellectuels et d’étudiants, eux-mêmes produits d’une phase spécifique de l’évolution socio-économique du pays.
(…) Ainsi, en à peine dix ans, un groupe d’intellectuels (majoritairement blancs) et d’ouvriers noirs aura créé une forme nouvelle d’organisation syndicale. Il se présentera d’abord comme un point de référence indépendant de l’ANC et radicalement opposé au Parti communiste. Il dirigera une grande partie des mouvements grévistes des années 1980".
Voilà un groupement syndical très "radical" et "critique" vis-à-vis des appareils syndicaux et politiques, mais aussi d’une grande singularité par rapport à ce que fut le système d’apartheid en étant capable de réunir ensemble blancs et noirs, ouvriers et intellectuels, opposants politisés radicaux de diverse obédience, bref un nouvel appareil syndical appelé à jouer un grand rôle dans la vie politique sud-africaine. Tout comme c’était le cas pour la bourgeoisie des grands pays industriels européens, face à la radicalisation de la lutte ouvrière, le capital sud-africain s’est vu contraint de recourir au "syndicalisme de base" 9. De même, comme en Europe, dans ces "syndicats radicaux" se trouvait en général un grand nombre de gauchistes, à l’instar de la FOSATU dirigée plus ou moins ouvertement par des éléments proches du "Unity Movement", c'est-à-dire des trotskistes. Nous y reviendrons plus loin. Comment les nouveaux syndicats de base, une fois formés, vont accomplir leur sale besogne à la tête ou à l’intérieur des mouvements de lutte de Soweto ?
Les luttes de Soweto empoisonnées par les syndicats et les confusions idéologiques du prolétariat
Comme on pouvait s’y attendre, les concessions du pouvoir ne purent calmer véritablement le mouvement de Soweto, au contraire elles ne firent que le radicaliser mais parvinrent aussi à diviser ses acteurs aussi bien en milieu scolaire que chez les ouvriers. Par exemple, certaines organisations voulaient se satisfaire plus ou moins des concessions du gouvernement alors que d’autres à l’apparence plus radicale en demandaient plus. En fait il s’agit là d’un partage des tâches type du travail de division des syndicats. En effet, outre la FOSATU (parmi les nouveaux syndicats radicaux), le "Black Allied Worker Union- B.A.W.U." (Syndicat des travailleurs noirs réunis) joua un rôle important. Créé en 1973 dans la foulée des grandes grèves de Johannesburg, il militait pour le regroupement exclusif des travailleurs noirs de toutes catégories et de toutes branches industrielles.
"(…) Ses buts étaient principalement : "d’organiser et d’unifier les travailleurs noirs en un mouvement ouvrier puissant, capable d’obtenir le respect et la reconnaissance de fait des employeurs et du gouvernement ; d’améliorer les connaissances des travailleurs par des programmes éducatifs généraux et spécialisés, afin de promouvoir leurs qualifications ; de représenter les travailleurs noirs et leurs intérêts dans le monde du travail". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Donc un syndicat créé exclusivement par et pour les travailleurs noirs d’où son opposition à tous les autres syndicats, (même ceux qui n’étaient noirs qu’à 99 %). Mais l’orientation de ce syndicat fut particulièrement pernicieuse car elle donnait l’impression de faire de la "ségrégation positive" en prétendant remplir des objectifs légitimes, par exemple l’amélioration des connaissances des travailleurs noirs, ou encore promouvoir leurs qualifications. Et ce faisant il put "séduire" un grand nombre d’ouvriers à conscience de classe limitée. Autrement dit, il existait et agissait fatalement comme un obstacle à l’unité dans la lutte entre ouvriers de toutes origines ethniques. D’ailleurs pour enfoncer le clou, le B.A.W.U. se dirigea aussitôt vers le "Mouvement de la conscience noire" :
"Cette position reflète l’attitude générale des diverses organisations qui composent le Mouvement de la conscience noire, celle, en particulier, des étudiants noirs (South African Students Organisation- S.A.S.O.- qui s’est séparée de l’Union nationale des étudiants sud-africains (N.U.S.A.S.) afin, selon ses militants, d’échapper au paternalisme dont font preuve tous les Blancs quels qu’ils soient vis-à-vis des Noirs". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Ainsi des groupements en milieu étudiant adoptèrent ouvertement et sans difficulté l’orientation du syndicat B.A.W.U, c'est-à-dire devinrent ouvertement racistes et jouèrent le même rôle de division des rangs ouvriers que les syndicats blancs les plus racistes. En clair on est loin de la défense des intérêts communs du prolétariat sud-africain, et même de ceux de la fraction noire de la classe ouvrière. Et effet, derrière ce regroupement ou alliance entre ouvriers et étudiants on constate surtout la nocivité de la question raciale surtout quand celle-ci se décline en termes de "conscience noire" supposé s’opposer à la "conscience blanche" ou tout simplement à la conscience de classe prolétarienne. Ce alors même que les conditions étaient largement réunies pour l’unité dans la lutte comme l’ont montré les mouvements de grève qui se déroulaient dans le pays où de nombreux secteurs ouvriers combattaient sur des revendications de classe et non de race ce qui par ailleurs fit souvent leurs succès. De plus, aux difficultés de l’alliance entre ouvriers et étudiants liées à la division raciale et syndicale s’ajoutèrent le corporatisme et l’esprit petit bourgeois des intellectuels fortement présents dans ce mouvement de luttes. De ce fait, malgré la forte dynamique créée par la reprise générale de la lutte au début des années 1970, la combativité des ouvriers et de la jeunesse de Soweto fut détournée sur une voie sans issue ; le mouvement fut détourné et divisé par les rivalités entre cliques ethniques, corporatistes et petites bourgeoises, ce qui finit par étouffer toute tentative d’orientation purement prolétarienne de la lutte.
"(…) Un des aspects importants et non des moins surprenants de la création des syndicats africains du Natal, est le rôle qu’y jouèrent des groupes d’universitaires, étudiants ou enseignants de race blanche. L’importance du rôle de la poignée d’intellectuels qui s’engagea à fond auprès des travailleurs africains ne signifie pas que l’Université sud-africaine soit l’avant- garde de la contestation et du combat pour la libération des masses noires. Loin de là. Le conservatisme et le racisme de la jeunesse afrikaner, l’insouciance des étudiants anglophones et le corporatisme des intellectuels de métier sont la règle générale. Quant aux étudiants noirs, après s’être volontairement écartés des organisations étudiantes blanches (en 1972), il semble que leur combat pour leur propre survie en tant que groupe et leur participation au Mouvement de la conscience noire aient accaparé la totalité de leur force militante". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
En clair, dans ces conditions l’avant-garde véritablement prolétarienne ne pouvait guère se mettre en avant, car ficelée et encadrée assez tôt, tantôt par les syndicalistes nationalistes ou racistes, tantôt par les factions corporatistes de la petite bourgeoisie intellectuelle téléguidée sournoisement par divers groupes politiques comme le PC, l’ANC et des éléments gauchistes. Dès lors on voit mieux les limites du développement de la conscience de classe notamment chez les jeunes de Soweto dont cette lutte fut leur première expérience en tant que membres de la classe prolétarienne.
L’ANC détourne la lutte de la jeunesse de Soweto vers la lutte armée impérialiste
Après s’être infiltré dans les divers organes de lutte de la jeunesse ouvrière de Soweto, l’ANC étendit son contrôle sur un grand nombre de jeunes radicaux issus des "civics" et parvint à les enrôler dans la lutte armée en les expédiant dans les camps d’entraînement militaire situés dans les pays voisins. L’ANC visait notamment ceux des éléments les plus actifs du mouvement de Soweto qui cherchaient à échapper à la répression policière du pouvoir sud-africain en leur promettant une sordide "formation" pour mieux lutter contre le régime d’apartheid. Et une fois sur place, nombreux jeunes critiques étaient systématiquement punis par l’emprisonnement voire par la mort.
"Ceux des soldats de l’ANC mal à l’aise avec cette politique n’avaient pas le droit de la discuter au nom de la discipline. En 1983, l’ANC qui participait à la guerre civile angolaise, envoyait des soldats contestataires y compris pour s’en débarrasser. Et quand les centaines de survivants qui revinrent se mutinèrent l’année suivante, ils furent réprimés. Pour cela il existait au Mozambique un camp-prison de l’ANC, celui de Quatro, où la torture était utilisée contre les opposants internes récalcitrants." 10
En clair, avant même d’arriver au pouvoir, l’ANC se comportait déjà comme bourreau de la classe ouvrière. Mais ce que le groupe trotskiste Lutte Ouvrière ne dit pas c’est que le parti de Mandela était impliqué dans la guerre en Angola dans les années 1980 pour le compte de l’ex-bloc impérialiste russe d’où le soutien qu’il recevait des pays voisins (opposants du bloc de l’OTAN) à savoir le Mozambique, l’Angola, le Zimbabwe, etc. C’était l’époque où l’ANC et le PC articulaient leur lutte de "libération nationale" avec les confrontations entre puissances impérialistes des deux blocs (Est/Ouest) en s’appuyant clairement sur le soutien de Moscou. De même, pendant qu’il brisait militairement les luttes à l’intérieur, le pouvoir sud-africain jouait à l’extérieur, en Afrique australe, le rôle de "gendarme délégué" du bloc impérialiste occidental, d’où son engagement militaire, tout comme ses rivaux, dans la guerre en Angola et dans d’autres pays voisins.
De la FOSATU au COSATU, le syndicalisme sud-africain au service du capital national
Depuis l’entrée du capitalisme en décadence (marquée par le premier conflit impérialiste mondial de 1914), partout le syndicalisme a cessé d’être un véritable organe de lutte pour la classe ouvrière, pire encore, il est devenu un instrument contre-révolutionnaire au service de l’État capitaliste. C’est d’ailleurs ce qu’a illustré l’histoire de la lutte des classes en Afrique du Sud 11. Mais l’étude de l’histoire du syndicalisme incarné par la FOSATU (Federation of South African Trade Unions) et le COSATU (Congress of South African Trade Unions) va nous montrer la puissance d’un syndicalisme nouveau capable de peser simultanément sur le prolétariat d’une grande combativité et sur le régime d’apartheid d’un autre âge. En effet, la FOSATU fit usage de son "génie" pernicieusement efficace au point de se faire entendre simultanément par l’exploité et l’exploiteur en parvenant ainsi à "gérer" astucieusement les conflits entre les deux véritables protagonistes, mais au service, en dernière analyse de la bourgeoisie. De même, la confédération joua un rôle de "facilitateur" à la "transition pacifique" entre le "pouvoir blanc" et le "pouvoir noir" se concrétisant par l’instauration d’un gouvernement d’"union nationale".
Naissance et caractéristiques de la FOSATU
Fondée en 1979, elle était le fruit d’une recomposition syndicale faisant suite à la disparition ou à l’auto- dissolution des principaux anciens syndicats dans la foulée des vigoureux mouvements de grève de 1973 qui secouèrent fortement le pays tout entier.
Ce nouveau courant syndical a donné naissance aux plus importants syndicats de l’industrie (hormis celui des mines), comme par exemple, l’automobile, la métallurgie, la chimie, le textile, etc. L’année même où était fondée la FOSATU, l’État sud-africain lui facilitait la tâche en décidant d’accorder le titre d’"employé 12" à tous les Noirs y compris ceux des Bantoustans, suivis quelque temps après par les travailleurs africains venus des pays voisins. Cela constituait un formidable encouragement à la syndicalisation des travailleurs de tous les secteurs du pays, ce dont la FOSATU put bénéficier amplement par la suite pour construire son propre "projet de développement".
"Il (ce courant syndical) a développé au début des années quatre-vingt un projet syndical original et ce, à partir d’une conception explicitement indépendante des principales forces politiques ; il s’est formé à partir de réseaux d’intellectuels et d’étudiants, eux-mêmes produits d’une phase spécifique de l’évolution socio-économique du pays ; il correspondait à une véritable mutation sociale et économique du pays et a accompagné la transformation progressive de l’organisation du marché du travail." (C. Jacquin, Ibid.)
Ce fut donc dans ce contexte que ce courant syndical se propulsa en se voulant à la fois "gauche syndicale" et "gauche politique" et que nombre de ses dirigeants furent influencés par l’idéologie trotskiste et stalinienne critique, comme on peut le lire ainsi :
"Vers la fin des années vingt, aussi des militants adhérant aux critiques trotskistes se détachaient du Parti communiste. Certains d’entre eux furent dirigeants d’un mouvement assez large dans les années quarante, portant le nom de Unity Movement. Par ailleurs, un syndicaliste de renom dans les années trente et quarante, Max Gordon, était trotskiste.
Ce courant s’est fragmenté et fortement affaibli à la fin des années cinquante. Mais il existe toujours au Cap, dans les années soixante-dix, une forte implantation de ces groupes, principalement parmi les enseignants métis.
(…) Au cours des entretiens faits au Cap, en 1982 et en 1983, nous avions pu vérifier que le dirigeant du syndicat des travailleurs municipaux, John Erentzen, avait été membre du Unity Movement. Marcel Golding, avant d’entrer dans la direction syndicale des mineurs et d’en devenir l’un des dirigeants, a fait partie d’un groupe d’étude d’orientation trotskiste".
"(…) Alec Elwin (premier secrétaire de la FOSATU) se dit influencé au départ par les français Althusser et Poulantzas. Il mentionne l’importance pour des gens comme lui du débat qui existait dans la Grande Bretagne des années soixante-dix sur la question des shop-stewards, c'est-à-dire des délégués d’atelier et de l’organisation à la base. Un autre facteur important pour cette génération d’intellectuels radicaux est constitué par l’apport d’une analyse marxiste rénovée de l’apartheid (par des personnes comme Martin Legassick) dans des rapports aux relations de production capitaliste. Ainsi se dégageait progressivement une théorie alternative à celle du parti communiste." (C. Jacquin, Ibid.)
A travers ces citations on voit clairement le rôle joué historiquement 13 par le courant trotskiste ou sa "nébuleuse" dans les syndicats en général et dans le syndicalisme de base en particulier. En effet, on a vu précédemment que le courant trotskiste était partie prenante de la formation des nouveaux syndicats radicaux dans la foulée des luttes des années 1970. Dans ce cadre, il convient de souligner une facette spécifique de l’apport du trotskisme à la contre-révolution, à savoir "l’entrisme 14" dans les partis sociaux-démocrates (et dans les syndicats). En clair, il s’agit d’entrer (clandestinement) dans ces organisations bourgeoises pour soi-disant s’emparer (le moment venu) de leur direction (en vue de la révolution). En effet, cette pratique est en soi anti-prolétarienne et exprime un clair mépris de la classe ouvrière au nom de laquelle ses auteurs (masqués) prétendent agir. 15 Une autre conséquence de cette pratique est qu’elle est impossible d’identifier formellement les "entristes", de connaître ainsi, même approximativement, le nombre des dirigeants de la FOSATU qui furent sous l’influence trotskiste à un moment ou un autre de leurs parcours au sein des syndicats sud-africains.
On peut affirmer ici l’idée suivant laquelle, les dirigeants de la "gauche syndicale" incarnée par la FOSAT/COSATU furent marqués par diverses influences idéologiques bourgeoises : allant du trotskisme à la social-démocratie en passant par le stalinisme, le syndicalisme "Solidarnosc" (en Pologne), le "Parti des travailleurs" de Lula (Brésil), au gré des opportunités et obstacles à la réalisation de leur fumeux "projet syndical".
"En octobre 1983 le journal "Fosatu work news" publia un article en double page centrale sur Solidarnosc et la Pologne. Le fil conducteur est assez semblable à ce que des dirigeants de la FOSATU pouvaient penser des processus sud-africains : croissance industrielle, peu d’amélioration du statut social ouvrier, répression, exigence du contrôle, différenciation interne dans le syndicat et évolution du groupe Walesa… Et l’article se termine par : "la lutte des travailleurs polonais constitue une inspiration pour tous les autres travailleurs en lutte". (…) En 1985, les numéros 39 et 40 publiaient un long article reportage sur le Parti des travailleurs du Brésil(PT)". (C. Jacquin, Ibid.)
A travers cette citation, on peut voir clairement certaines similitudes de la démarche entre la FOSATU et les syndicats respectifs de Walesa et de Lula, notamment en termes de mode préparatoire en vue d’accéder au plus haut sommet de l’État.
Ainsi armée de son expérience de manœuvrière politico-syndicale acquise dans les luttes des années 1970/1980, la FOSATU pouvait sans risque majeur se mettre ouvertement au service du capital national sud-africain en profitant de son "aura" pour œuvrer à la constitution d’un nouveau syndicalisme débarrassé des anciens appareils syndicaux archaïques issus de l’apartheid, en faisant prévaloir sa fumeuse doctrine syndicale s’appuyant essentiellement sur les ouvriers d’industrie comme l’indiquait le texte de son premier congrès :
"La fédération sera essentiellement constituée de syndicats de branches industrielles dans la mesure où c’est, dans le cadre des structures industrielles existantes, le meilleur moyen de favoriser l’unité ouvrière et l’intérêt des travailleurs et dans la mesure aussi où c’est le meilleur moyen de nous concentrer sur les domaines des préoccupations ouvrières. Ceci, cependant, ne reflète pas un soutien aux actuels rapports industriels. (…) l’absence de division raciale (non-racialism), contrôle ouvrier (workers control), syndicats de branches, organisation à la base, solidarité ouvrière internationale, unité syndicale". (C. Jacquin, Ibid.)
Si l’on situe ce positionnement politico-syndical de la FOSATU dans le contexte de l’apartheid, on peut comprendre la relative facilité avec laquelle la fédération a pu attirer nombre d’ouvriers combatifs ou conscients de la nécessité de leur unité dans la lutte par de-là les frontières ethniques. En clair, elle se servit particulièrement de son "image combative" aux yeux d’un grand nombre d’ouvriers durant les luttes des années 1970/1980 pour gagner leur confiance, d’où d’ailleurs son statut de premier syndicat dans le secteur industriel. Avec son appareil de "syndicalisme combatif" bien organisé elle entra en discussions avec tous les autres syndicats ayant gardé une influence en vue de les fédérer mais non sans grosses difficultés, notamment avec ceux d’entre eux sous contrôle de l’ANC/PC. Elle dut buter aussi sur l’hostilité ou les réticences d’autres courants syndicaux en son propre sein avant de les convaincre ou les marginaliser, à l’instar du syndicat des mineurs (NUM) ou de certains syndicats proches de la mouvance de la "Conscience noire".
La FOSATU se prépare à intégrer les grands appareils politiques
À l’origine (1979), la FOSATU était composée de trois syndicats enregistrés (légalement) et de neuf syndicats non enregistrés 16, ce qui veut dire que la seconde catégorie était dominante et son poids se reflétait dans les choix idéologiques et stratégiques de la fédération. Ce jusqu’au moment où la FOSATU décida d’amorcer un virage vers son intégration institutionnelle, c'est-à-dire en devenant de plus en plus l’interlocuteur du pouvoir (certes tout en restant "radical").
"Le débat sur l’enregistrement prit la forme d’une vive polémique contre les syndicats de la FOSATU qui étaient enregistrés. L’attaque vint de la GWU (pro Conscience noire) et, de manière bien plus virulente, de la part de la SAAWU (pro ANC). Les arguments étaient à peu près similaires : perte d’indépendance vis-à-vis de l’État et entrave à un véritable fonctionnement démocratique pour les syndicats qui devaient se plier aux contraintes du contrôle officiel, etc.
(…) D’autres débats furent menés au cours des négociations. Et ce fut la forme de la future Confédération qui préoccupa le plus la direction de la FOSATU. Il fallait convaincre que le modèle de la FOSATU était le mieux adapté avec ses sections syndicales d’entreprise, ses syndicats par branche industrielle, structures régionales (inter- professionnelles, dirons-nous selon la terminologie du syndicalisme français), sa démocratie à la base fondée sur des shop-stewards, etc.
(…) La direction de la FOSATU finit par convaincre la majorité de ses partenaires sur ces questions proprement syndicales. Mais il est important de signaler ici que le processus unitaire vers la fondation du COSATU se clarifia finalement quand la SAAWU changea de position, à notre avis, après que les directions en exil de l’ANC et du Parti communiste aient elles-mêmes décidé de modifier leur attitude. Et aussi quand la NUM, le syndicat des mines membre du CUSA et de très loin son principal affilié, décida, en décembre 1984, de rompre avec sa fédération et de participer pleinement et jusqu’au bout au lancement du COSATU 17". (C. Jacquin, Ibid.)
En clair, en intégrant en son sein le syndicat des mines (NUM) la FOSATU s’imposa définitivement dans les secteurs décisifs de l’économie du pays et devint dès ce moment-là le partenaire obligé du pouvoir en place. Elle renforça ainsi son contrôle sur les secteurs les plus combatifs de la classe ouvrière et dès lors elle prit l’initiative de fédérer les principales centrales syndicales avec succès.
Voilà un parcours remarquable de la FOSATU qui réussit, de main de maître, à fédérer les principaux syndicats influents dans une grande confédération à l’échelle du pays débouchant sur la création du Congress of South African Trade Union (COSATU).
Une fois de plus la FOSATU montre par là son "génie politique" et son savoir-faire au plan organisationnel en passant d’une opposition radicale de gauche à une union avec les grands appareils bureaucratiques nationalistes dans le but évident d’accéder au pouvoir bourgeois et ce sans réaction ouvrière (ouverte) hostile à sa démarche. En fait on remarquera que ces "messieurs rabatteurs" de la classe ouvrière (vers les appareils bourgeois de gauche) durent procéder méthodiquement par étapes. Premier temps : en optant pour un "radicalisme" syndical et politique de gauche pour mieux séduire les ouvriers combattifs ; deuxième temps : en procédant à l’unification des appareils syndicaux et troisième temps : en favorisant la constitution d’un large front syndical et politique en vue de gouverner "sagement" le pays postapartheid.
Certes, pour l’unité syndicale et politique, le COSATU ne put intégrer deux courants proches de la mouvance "Conscience noire" et du PAC 18. Tous deux ayant préféré rester dans l’opposition avec leur propre fédération unitaire : National Council of Trade Unions (NACTU). De même n’y figuraient pas d’autres petits syndicats blancs ou corporatistes. Cependant ces derniers n’avaient pas d’influence décisive sur l’organisation des luttes, comparé au COSATU.
Toujours est-il que celui-ci est sur les rails, c’est à travers lui que les dirigeants de l’ex-FOSATU vont poursuivre leur "mission syndicale" jusqu’aujourd’hui en jouant leur rôle de gestionnaire (responsable) du capital sud-africain, en tant que ministres ou grands patrons d’entreprises.
Le contrôle des comités de lutte (civics) enjeu d’âpres luttes d’appareils syndicaux/politiques
En se généralisant et en prenant en charge dans la durée (globalement entre 1976 et 1985) toute la vie sociale des principaux quartiers des villes industrielles, les civics finirent par devenir l’enjeu central de tous les organes de pouvoir en Afrique du Sud. En d’autres termes, leur contrôle provoqua d’âpres empoignades entre brigands syndicaux/politiques.
"L’un des grands problèmes auquel dut faire face le nouveau mouvement syndical fut singulièrement celui du développement d’une autre forme d’organisation de la population noire, les CIVICS, ou community associations. Sous ce vocable ont été souvent regroupés toutes formes associatives se développant au niveau des townships.
Un travail considérable reste à faire sur ces mouvements car ils n’ont pas bénéficié de la même attention que les syndicats de la part des chercheurs.
(…) Il semble que le développement des CIVICS se soit surtout fait au départ au Cap sous l’impact des deux courants politiques concurrents à l’époque dans cette région : Celui de la gauche politique indépendante (la nébuleuse politique héritière du "Unity Mouvement") et celui lié ou influencé par l’ANC. Les réseaux d’associations se divisèrent selon les sympathies politiques. C’est ainsi qu’au Cap les militants du Unity Movement formèrent avec les associations qu’ils contrôlaient la Federation of Cap Civic Associations et que les militants de l’ANC et du Parti communiste formèrent de leur côté le Cape Area Housing Action Committee (CAHAC). Cette cartélisation s’accentua par la suite au plan national avec, en plus, l’activité propre du parti Azapo (héritier du Mouvement de la Conscience Noire) et celles des militants et sympathisants du PAC (Pan-Africanist Congress). Au milieu des années quatre-vingt la plupart des courants politiques apparaissaient ainsi publiquement sous la bannière des regroupements des CIVICS qu’ils contrôlaient". (C. Jacquin, Ibid.)
On ne peut que partager l’avis de l’auteur de la citation selon lequel les "CIVICS" n’ont pas bénéficié de la même attention que les syndicats de la part des chercheurs et qu’un important travail reste à faire sur ces mouvements. Ceci étant dit, l’autre élément majeur à souligner c’est le terrible acharnement dont les vautours syndicaux et politiques firent preuve pour neutraliser les organisations issues des luttes insurrectionnelles de Soweto. En effet, pour rattraper le mouvement don elles ne furent pas les initiatrices, toutes ces forces bourgeoises procédèrent par noyautage et diverses manœuvres sordides en vue de saborder les divers comités sous l’appellation "CIVICS" et parvinrent finalement à les contrôler et à s’en servir comme instruments de lutte d’influence en vue d’accéder au pouvoir. Ainsi, en 1983, on constata une série de manifestations et de grèves mobilisant de plus en plus de monde en particulier autour de Soweto, mais aussi dans d’autres régions. Ce fut le moment choisi par l’ANC pour accentuer son contrôle sur les mouvements sociaux en créant un organisme qui se nomma "United Democratic Front (Front démocratique uni)», une espèce de "forum" ou un simple "filet " dans lequel le parti de Mandela réussit à enfermer nombre de "CIVICS". De même que les rivaux de l’ANC ne tardèrent pas à répliquer en lui disputant la chasse aux mêmes groupes autonomes et, d’ailleurs, non sans violence criminelle de part et d’autre.
"(…) Des polémiques de plus en plus violentes se développèrent au rythme des grands conflits sociaux. Une grève générale, un stay-away local ou régional, voire un boycott des commerces tenus par des Blancs, s’adressent indistinctement aux employés des usines et à la population des townships. Dans ces régions comme celles de Port Elizabeth ou de East-London, où l’on comptait déjà à cette époque au moins 50 % de chômeurs il n’était pas possible d’organiser des mouvements de cette ampleur sans s’appuyer sur la complémentarité des CIVICS et des syndicats. Chaque partie affichait évidemment une telle conviction unitaire. Mais les enjeux politiques étaient tels que chacune cherchait à exercer une pression hégémonique sur l’autre. Il y eut toutes sortes de conflits y compris entre des associations contrôlées par l’AZAPO (Organisation du Peuple d’Azanie) et certains syndicats.
(…) Les exemples abondent des cas de violences physiques. Les dirigeants de la FOSATU se plaignaient que, par l’absence de réelle centralisation, des groupes de jeunes, liés aux CIVICS, s’en prenaient parfois à des travailleurs effectuant normalement leur travail. C’est ainsi que des chauffeurs d’autobus ont pu être attaqués, voire tués, par des jeunes ne comprenant pas, ou simplement ignorant l’opposition syndicale à tel ou tel appel". (C. Jacquin, Ibid.)
En résumé, voilà comment les "CIVICS" ont été sabordés par les diverses forces syndicales, nationalistes et démocrates se disputant leur contrôle. En d’autres termes, on voit là que l’ANC et ses rivaux n’hésitèrent pas à dresser nombre de jeunes à s’entretuer ou à attaquer et à tuer des ouvriers actifs comme des conducteurs de bus. Et ce pour le plus grand bien de l’ennemi commun, à savoir le capital national. Certes, en la matière, c’est l’ANC qui frôla le summum des crimes commis contre la jeunesse de Soweto pour avoir embrigadé dans un camp impérialiste un grand nombre d’anciens membres des "CIVICS" et les avoir envoyé au massacre pour la dite "libération nationale" (cf. chapitre précédent).
Retour sur les grèves sur fond de récession économique
En 1982/83, contre les mesures d’austérité appliquées par le gouvernement, des grèves éclatèrent dans beaucoup de secteurs, en particulier dans les mines et dans l’automobile, mobilisèrent des dizaines de milliers d’ouvriers, affectant ainsi fortement les usines Général Moteurs, Ford, Volkswagen, etc. En effet, comme beaucoup d’autres pays de cette époque, l’Afrique du Sud fut frappée par la crise économique qui la plongea profondément dans la récession.
"La récession qui s’ouvre en 1981-82 est marquée par l’essoufflement de tout un système y compris sur le plan institutionnel. Entre 1980 et 1985, les faillites d’entreprise augmentèrent de 500%. Le taux d’escompte passa de 9,5% à 17% au cours de l’année 1981 ; il atteint 18% en 1982 et 25% en août 1985. En 1982, le pays bénéficiait encore d’une entrée nette de 662 millions de rands ; en 1983, ce fut au contraire un déficit de 93 millions de rands. Le rand qui valait 1,09 dollar américain en 1982, valait moins de 0,37 dollar à la fin de 1985. Le total des investissements passa de 2.346 millions de rands en 1981 à 1.408 millions en 1984. Cette même année, la dette extérieure atteint 24,8 milliards de dollars, dont 13 milliards à court terme. La production manufacturière baissa en volume, les coûts salariaux augmentèrent, le chômage crût, le volume des exportations diminua". (C. Jacquin, Ibid.)
Face à l’ampleur de la récession le gouvernement sud-africain dut prendre des mesures draconiennes contre les conditions de vie de la classe ouvrière, c'est-à-dire des licenciements massifs et baisses de salaires, etc. De son côté, malgré son énorme affaiblissement résultant principalement des luttes de cliques menées sur son dos par l’ANC et ses concurrents, la classe ouvrière ne put rester bras croisés et se devait donc de partir en lutte en montrant, une fois de plus, que sa combativité restait intacte. A ce propos, comme exemple éclairant, on peut prendre l’année1982 où la plupart des conflits portaient sur des revendications de salaires (170), suivis par les problèmes de licenciements et de réduction d’effectifs (56), alors que les conflits pour la reconnaissance d’un syndicat ne purent entraîner que 12 grèves. Ce dernier aspect est important car il signifie que les ouvriers ne ressentaient manifestement pas le besoin de se syndiquer pour entrer en lutte.
Toujours est-il que dans la période de 1982/1983 l’Afrique du Sud fut marquée par une augmentation ininterrompue des grèves. Dans ce cadre, il convient de noter une fois de plus le rôle anti-ouvrier du syndicalisme radical :
"Ce sont les syndicats de la FOSATU qui totalisent le plus de grèves à leur actif, et notamment ceux de la métallurgie et de l’automobile. Ce sont donc dans les régions où ces industries sont particulièrement présentes que l’on enregistre alors le plus de conflits. La région de l’Eastern-Cap, notamment les villes de Port Elisabeth et d’Uitenhage connaissent les taux les plus élevés de grèves : 55.150 grévistes dans cette région, en 1982, dont 51.740 grévistes pour l’industrie automobile. C’est dans l’East Rand que se concentrent le plus de mouvements dans la métallurgie : 40 pour un total de 13.884 grévistes. Ces chiffres peuvent être comparés aux 30.773 grévistes pour toute la région de Johannesburg, tous secteurs confondus(…) De telles comparaisons permettent de mesurer ce que pouvaient être, à cette époque, le poids relatif de la FOSATU dans l’ensemble du mouvement syndical indépendant…". (C. Jacquin, Ibid.) Même particulièrement encadrée, la classe ouvrière demeure pugnace et lutte sur un terrain de classe en refusant de subir sans réaction les attaques économiques de la bourgeoisie. Bien entendu, il est clairement perceptible que les ouvriers en lutte étaient fortement sous contrôle du syndicalisme notamment de base, se plaçant à la tête du mouvement pour en prendre le contrôle et finir par saborder les grèves avant qu’elles ne compromettent les intérêts du capital national sud-africain. Dans ce sens, il est remarquable de savoir qu’au cours des mouvements de grève (1982), aucun rôle ne fut attribué aux "CIVICS", au contraire tout fut l’affaire des syndicats, en particulier la FOSATU, qui put s’appuyer sur ses organisations de base radicalisées pour faire prévaloir la suprématie de sa "combativité" et dissuader toute tentative d’organisation autonome en dehors des appareils constitués comme interlocuteurs de l’État.
En 1984-85, d’importantes grèves éclatèrent au Transvaal/Port-Elisabeth mobilisant des dizaines de milliers d’ouvriers et parmi la population en mêlant des revendications multiples (salaires, éducation, logement, droit de vote, etc.). En effet, parallèlement aux grèves des mineurs et celles d’autres salariés, des commerces appartenant aux blancs et les transports publics furent boycottés activement, de même que des milliers de jeunes refusèrent de servir dans l’armée.
Face aux mouvements de contestation, le pouvoir sud-africain répondit en tendant une "petite carotte" d’une main et un "gros bâton" de l’autre. Ainsi il décida, d’un côté, d’accorder aux citoyens de couleur (indiens et métis) et aux Noirs le droit d’élire leurs propres députés ou représentants municipaux issus de leurs communautés. Et de l’autre côté, sa seule réponse aux revendications salariales et aux conditions de vie des protestataires, fut l’instauration l’état d’urgence. Et ce fut l’occasion de s’acharner sur les grévistes qu’il accusa de mener des "grèves politiques" pour mieux justifier sa répression barbare qui déboucha sur le licenciement de 20 000 mineurs et à l’assassinat d’un grand nombre d’ouvriers et l’emprisonnement de milliers d’autres.
1986/1990, grèves sur fond de grandes manœuvres politiques au sein de la bourgeoisie
À dire vrai, entre 1982 et 1987 le pays connaissait une augmentation ininterrompue des grèves, des manifestations et des affrontements meurtriers avec les forces de l’ordre.
"Le 9 août 1987 la NUM déclencha une grève dans les mines. 95% des syndiqués consultés, selon la loi, avaient voté en faveur de la grève. Celle-ci toucha toutes les mines où la NUM était implantée, soit 28 mines d’or et 18 mines de charbon. Ce conflit a été, et de loin, la plus longue grève des mines sud-africaines (le conflit de 1946 avait duré 5 jours), elle dura 21 jours et représenta 5, 25 millions de journées de débrayage. (…) La NUM jeta toutes ses forces dans cette bataille qui fut son plus grand défi depuis sa création en 1982. Elle revendiquait 30% d’augmentation des salaires, une prime de risque, un capital de 5 ans de salaire donné aux familles des mineurs morts par accident au lieu de deux années auparavant, 30 jours de congés payés et le 16 juin, anniversaire des révoltes de Soweto, désigné comme jour férié payé.
Les compagnies minières perdirent 17 millions de rands dans ce conflit mais ne cédèrent sur pratiquement rien. La coordination de la Chambre de des mines s’avéra efficace. Les directions restaient d’une extrême fermeté à commencer par celle de l’Anglo America 19"(C. Jaquin, Ibid.).
Une fois de plus la classe ouvrière fait preuve de combativité exemplaire même si cela ne suffit évidemment pas à faire reculer la bourgeoisie qui refusa de céder sur les principales revendications des grévistes. D’ailleurs, le patronat et l’État savaient pouvoir compter sur le contrôle des ouvriers par des syndicats, certes "radicaux" mais très "responsables" quand il s’agit de préserver les intérêts du capital national. Et pourtant, malgré cela, la classe ouvrière refusa d’abdiquer en reprenant le combat massivement dès l’année suivante, en 1988, où l’on compta jusqu’à 3 millions de grévistes pour une grève de trois jours, du 6 au 8 juin de cette année-là.
Mais, sur le plan politique, l’événement le plus marquant de cette période des années 1980 se produisit 1986. C’est l’année où commença à se concrétiser le vrai tournant politique qui sonna la fin du régime d’apartheid incarné principalement par les Afrikaners qui en faisait leur mode de gouvernement. En effet, après avoir réglé définitivement la "question syndicale" en intégrant dans le giron de l’État les principaux syndicats (cf. le cas de la FOSATU/COSATU), le pouvoir en place d’alors décida de mettre en œuvre le volet politique de sa réforme constitutionnelle. Dans ce cadre, des rencontres furent organisées (en secret) entre les dirigeants blancs sud-africains 20 et les responsables de l’ANC y compris Mandela qui, depuis sa prison, put recevoir régulièrement entre 1986 et 1990 des émissaires du gouvernement afrikaner en vue de la reconstruction du pays sur de nouvelles bases non raciales et en accord avec les intérêts du capital national. Les tractations entre les nationalistes africains et le gouvernement sud-africain se poursuivirent jusqu’en 1990, l’année de la libération de Mandela et de la fin de l’apartheid, la levée de l’interdiction du PC sud-africain et de l’ANC. Il va sans dire que le contexte international y fut pour quelque chose.
D’un côté, la chute du mur de Berlin annonçait l’effondrement soudain et brutal du principal allié de l’ANC/PC, le bloc soviétique ainsi qu’une perte de prestige pour le "modèle soviétique" que l’ANC avait adopté jusque-là ; ceci oblige alors l’ANC à revoir son attitude "anti-impérialiste" d’antan. D’un autre côté, la disparition du bloc soviétique faisait que la perspective de l’arrivée de l’ANC au pouvoir ne représentait plus aucun danger, sur le plan impérialiste, pour la bourgeoisie sud-africaine pro-occidentale. Et cela éclaire l’annonce par le président sud-africain, Frederick De Klerk, en février 1990, devant le parlement, de sa décision de légalisation de l’ANC, du PC et de toutes les organisations interdites, dans une perspective de négociation globale. Voici quels furent les arguments justifiant sa décision :
"La dynamique en cours dans la politique internationale a également créé de nouvelles opportunités pour l’Afrique du Sud. D’importants progrès ont été faits, entre autres choses, dans nos contacts extérieurs, particulièrement là où il y avait auparavant des limitations d’ordre idéologique. (…) L’écroulement du système économique en Europe de l’Est constitue aussi un signal (…) Ceux qui cherchent à imposer à l’Afrique du Sud un tel système en faillite devraient s’engager dans une révision totale de leur point de vue."
Et de fait, "ceux qui cherchaient à imposer à l’Afrique du Sud un tel système en faillite" (la coalition qui gouvernent l’Afrique du Sud aujourd’hui) décidèrent alors de s’engager effectivement dans une révision totale de leur point de vue en entrant définitivement dans les rangs des gestionnaires du capital national, à commencer par le COSATU.
"Début 1990 le débat sur la charte ouvrière dans le COSATU tourne définitivement à l’élaboration d’un ensemble de droits élémentaires (…) accompagnant les propositions constitutionnelles de l’ANC. Il n’est plus question d’un "programme politique" quel qui soit (…) ;
- Au cours de l’année 1990, des figures nationalistes de la NUMSA (syndicats affilié au COSATU) adhèrent au Parti communiste. Entre autres cas, Moses Mayekiso est élu membre de la direction provisoire du parti à nouveau légal ;
- En juillet 1991 le quatrième congrès du COSATU confirme une alliance entre le syndicat des mineurs(NUM) et celui de la métallurgie-automobile (NUMSA). Ils totalisent à eux deux 1000 délégués sur les 2.500 présents ;
(…) L’un des textes votés à ce congrès syndical dit : "Nous sommes partisans de former nos membres et de les encourager pour qu’ils rejoignent l’ANC et le Parti communiste". (C. Jacquin, Ibid.)
Dès lors ce fut toute la bourgeoisie sud-africaine qui s’engagea unie dans une nouvelle ère dite "démocratique" et bien entendu on invita toute la population notamment la classe ouvrière à s’unir derrière les nouveaux dirigeants en vue de la construction de l’Etat multiracial démocratique et, dès lors, la "fête" put commencer.
"La cooptation ne fait que commencer mais, déjà, il n’y a pas une seule grande entreprise qui ne cherche un certain nombre de cadres de l’ANC à intégrer à sa direction. Une véritable "génération Mandela" est ainsi absorbée dans les structures publiques ou privées perdant rapidement toute fidélité aux anciennes doctrines. L’appel à la "société civile" est devenu la clef de voûte de tous les discours afin de faire le pont entre le mouvement social encore fort et les arrangements au sommet. Mais pour qui se rappelle les thèmes politiques des années quatre-vingt il ne fait aucun doute que le glissement terminologique n’est pas de simple forme". (C. Jacquin, Ibid.)
En définitif, de par sa nature de classe bourgeoise, la gauche politico-syndicale ne pouvait absolument pas aller à l’encontre du système capitaliste, et ce en dépit son verbiage ultra radical et ouvriériste anticapitaliste prétendument pour la "défense de la classe ouvrière". Au bout du compte, la gauche syndicale s’avère comme étant un simple et redoutable rabatteur des ouvriers vers la gauche du capital. Mais sa contribution principale fut incontestablement le fait d’avoir réussi à construire sciemment le piège "démocratique/unité nationale" dans lequel la bourgeoisie put entraîner la classe ouvrière. D’ailleurs, en profitant de ce climat d’"euphorie démocratique", résultant largement de la libération de Mandela et compagnie en 1990, le pouvoir central dut s’appuyer sur son "nouveau mur syndical" que constitue le COSATU et son "aille gauche" pour dévoyer systématiquement les mouvements de lutte sur des revendications d’ordre "démocratique", "droits civiques", "égalités raciales", etc. Et ce quand bien même des ouvriers partaient en grève sur des revendications salariales ou visant à améliorer leurs conditions de vie. Et de fait, entre 1990 et 1993 où d’ailleurs un gouvernement d’ "union nationale de transition" fut formé, les grèves et les manifestations se faisaient rares ou restaient sans effets sur le nouveau pouvoir. D’autant moins qu’au poison des illusions démocratiques s’ajouta une terrible tragédie au sein de la classe ouvrière noire quand, en 1990, les troupes de Mandela et celles du chef zoulou Buthelezi s’affrontèrent militairement pour le contrôle des populations des townships. Ce conflit dura quatre ans et fit plus de 14 000 morts et des destructions massives d’habitations ouvrières. Pour les révolutionnaires marxistes cette lutte sanglante entre cliques nationalistes noires ne fit que confirmer, une fois de plus, la nature bourgeoise (et arriérée) de ces brigands qui exprimaient ainsi leur empressement à accéder aux commandes de l’État pour prouver définitivement leur aptitude à gérer les intérêts supérieurs du capital sud-africain. D’ailleurs, tel était l’objectif central du projet de la bourgeoisie quand elle décida le processus qui aboutit au démantèlement de l’apartheid et à la "réconciliation nationale" entre toutes ses fractions qui s’entretuaient sous l’apartheid.
Ce projet sera mis en œuvre fidèlement par Mandela et l’ANC entre1994 et 2014, y compris en massacrant nombre d’ouvriers résistant à l’exploitation et à la répression.
Lassou, septembre 2016
1 Nous parlons souvent des années "73/74" puis 76 sans évoquer formellement 1975. En effet cette année-là connut moins de luttes et apparut comme un moment de "pause" avant la "tempête de Soweto".
2 Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Editions Suros, 1977.
3 Civics ou CBO (Community Based Organisations) : "associations populaires, souvent sur la base géographique d’un quartier ou d’une rue, dont les membres organisent eux-mêmes le fonctionnement et décident des objectifs". Cette définition est extraite de l’ouvrage La figure ouvrière en Afrique du Sud, Karthala, 2008.
4 Claude Jacquin, Une Gauche syndicale en Afrique du Sud (en 1978-1993), Editions l’Harmattan, 1994. L’auteur cité est journaliste et chercheur spécialiste des nouveaux syndicats sud-africains. Nous serons amenés dans la suite du texte à le citer à nouveau lorsqu'il rapporte des éléments pertinents permettant ce comprendre la réalité de la situation. Ce n'est pas pour autant que nous adhérons à son point de vue et nous signalerons des réserves que nous pouvons avoir avec certains de ses propos.
5 Selon l’expression d’un dirigeant sud-africain cité dans l’article "De la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970" dans la Revue internationale n° 155.
6 Voir l’article "De la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale", Revue internationale n° 154, sur le fondement de l’apartheid et ses méfaits sur la lutte de classe ouvrière.
7 En fait, les premières mesures discriminatoires furent instaurées en Afrique du Sud par le gouvernement travailliste en 1924 où siégeaient des Afrikaners.
8 Voir Revue internationale n° 154, "De la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale", sur ce conflit (qui fit des centaines de milliers de victimes) et ses répercussions dans les relations entre les deux anciennes puissances coloniales.
9 Voir la brochure du CCI Les syndicats contre la classe ouvrière, qui aborde largement la question du "syndicalisme de base" et sa nature.
10 "L’Afrique du Sud : de l’apartheid au pouvoir de l’ANC [666]", Cercle Léon Trotsky.
11 Voir l’article de la Revue internationale n° 154 "De la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale" et le n°155 "De la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970".
12 Sous l’apartheid un sud-africain noir, s’il avait travaillé durant des décennies dans le pays n’était pas considéré comme étant "employé", car le terme était réservé aux "ayant –droits", c'est-à-dire essentiellement les travailleurs blancs (et dans une moindre mesure travailleurs métis et indiens).
13 Voir à ce propos la Revue internationale, n° 154 "De la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale" et le n° 155 "De la Seconde Guerre mondiale" au milieu des années 1970".
14 L’entrisme dans les partis de gauche (PS/PC) fut théorisé par Léon Trotski dans les années 1930, pour plus de développement voir la brochure du CCI Le trotskisme contre la classe ouvrière.
15 Ce n’est certainement pas un accident que beaucoup de ces dirigeants de base (y compris Marcel Golding) ont quitté le syndicalisme à la fin du régime d’apartheid pour devenir des riches hommes d’affaires ou politiciens influents (nous y reviendrons dans le prochain article).
16 Selon l’apartheid, les syndicats enregistrés sont les syndicats reconnus par l’État, tandis que ceux non enregistrés sont tolérés jusqu’à certaine limite mais pas reconnus par la loi.
17 La NUM fut créée en 1982. Elle annonçait 20 000 membres en 1983, puis 110.000 en 1984. Au départ elle était hostile aussi à son enregistrement par l’Etat.
18 PAC : Pan-Africanist Congress, une scission de l’ANC dans les années 1950, parti ultra nationaliste (noir).
19 Cette compagnie dont le Patron (Oppenheimer) fut l’un des les plus grands soutiens à la syndicalisation des Africains, se montre ici particulièrement féroce face aux revendications des salariés (syndiqués ou pas).
20 Une délégation du patronat sud-africain se rendit en Zambie en 1986 pour y rencontrer la direction de l’ANC. Puis des échanges de courriers se développèrent entre 1986/1990 entre Mandela et Botha le chef d’Etat de l’Afrique du Sud, puis avec De Klerk qui lui succéda en 1989. E le tout déboucha sur la libération du dirigeant de l’ANC en 1990, ce qui annonça ainsi la fin de l’apartheid.
Géographique:
- Afrique du Sud [550]
Rubrique:
La signification fondamentale de la révolution russe
- 1014 lectures
La révolution russe est sans conteste le fait le plus considérable de la guerre mondiale. La façon dont elle a éclaté, son radicalisme sans exemple, son action durable, tout cela réfute admirablement l'argument à l'aide duquel la social-démocratie allemande s'est efforcée, dès le début, de justifier la campagne de conquêtes de l'impérialisme allemand, à savoir la mission réservée aux baïonnettes allemandes de renverser le tsarisme et de délivrer ses peuples opprimés. Les dimensions formidables prises par la révolution en Russie, l'action profonde par laquelle elle a bouleversé toutes les valeurs de classe, développé tous les problèmes économiques et sociaux, et, par une marche conséquente, avec, pour ainsi dire, la fatalité d'un processus logique, elle est passée du premier stade de la république bourgeoise à des stades de plus en plus élevés - le renversement du tsarisme n'étant plus dans ce processus qu'un court épisode, presque une bagatelle - tout cela montre, clair comme le jour, que l'affranchissement de la Russie ne fut pas l'œuvre de la guerre et de la défaite militaire du tsarisme, des "baïonnettes allemandes dans des poings allemands", comme disait Kautsky [667], mais qu'elle avait en Russie même des racines profondes. Ce n'est pas l'aventure guerrière de l'impérialisme allemand, sous l'écusson idéologique de la social-démocratie allemande, qui a provoqué la révolution en Russie. Elle n'a fait au contraire que l'interrompre pour quelque temps, à ses débuts, après la première vague des années 1911-1913, et lui créer ensuite les conditions les plus difficiles et les plus anormales.
Mais pour tout observateur qui réfléchit, ce cours des choses est un argument de plus contre la théorie, défendue par Kautsky et tout le parti social-démocrate allemand, d'après laquelle la Russie, pays économiquement arriéré, en majeure partie agricole, ne serait pas encore mûre pour la révolution sociale. Cette théorie, qui n'admet comme possible en Russie qu'une révolution bourgeoise, d'où découle par conséquent, pour les socialistes de ce pays, la nécessité de collaborer avec le libéralisme bourgeois, est aussi celle de l'aile opportuniste du mouvement ouvrier russe, des mencheviks dirigés par Dan et Axelrod [668]. Les uns et les autres, les opportunistes russes comme les opportunistes allemands, s'accordent entièrement, dans cette façon de comprendre la révolution russe, avec les socialistes gouvernementaux d'Allemagne. D'après eux la Révolution russe n'aurait pas dû dépasser le stade que l'impérialisme allemand, dans l'imagination de la social-démocratie, posait comme noble but à la guerre, à savoir le renversement du tsarisme. Si elle est allée au-delà, si elle s'est posé comme tâche la dictature du prolétariat, cela a été, selon cette doctrine, une simple faute de l'aile radicale du mouvement ouvrier russe, des bolcheviks; et tous les déboires que la révolution a connus par la suite, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, ne sont que la conséquence de cette erreur. Théoriquement, cette doctrine, que le Vorwärts présente comme le fruit de la pensée "marxiste", aboutit à cette originale découverte "marxiste" : que la révolution socialiste est une affaire nationale et pour ainsi dire domestique, de chaque Etat en particulier. Dans la vapeur bleue de ce schéma abstrait, un Kautsky sait naturellement décrire en détail les relations économiques mondiales du capital, qui font de tous les Etats modernes un organisme indivisible. Mais la Révolution russe - fruit de l'entrelacement des relations internationales et de la question agraire - ne peut aboutir dans le cadre de la société bourgeoise.
Pratiquement, cette doctrine tend à écarter la responsabilité du prolétariat international, en premier lieu du prolétariat allemand, en ce qui concerne le sort de la Révolution russe, à nier, en un mot, les connexions internationales de cette révolution. En réalité, ce qu'ont démontré la guerre et la Révolution russe, ce n'est pas le manque de maturité de la Russie, mais l'incapacité du prolétariat allemand à remplir sa mission historique; et faire ressortir ce fait avec toute la netteté désirable est le premier devoir d'une étude critique de la Révolution russe. En misant sur la révolution mondiale du prolétariat, les bolcheviks ont précisément donné le témoignage le plus éclatant de leur intelligence politique, de leur fidélité aux principes et de la hardiesse de leur politique. C'est en cela que se manifestent les progrès formidables réalisés par le développement capitaliste au cours de la dernière décennie. La révolution de 1905-1907 ne trouva qu'un faible écho en Europe. C'est pourquoi elle ne pouvait être qu'un début. La suite et la fin en étaient liées au développement européen.
Il est clair que seule une critique approfondie, et non pas une apologie superficielle, peut tirer de tous ces événements les trésors d'enseignement qu'ils comportent. Ce serait en effet une folie de croire qu'au premier essai d'importance mondiale de dictature prolétarienne, et cela dans les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer, au milieu du désordre et du chaos d'une conflagration mondiale, sous la menace constante d'une intervention militaire de la part de la puissance la plus réactionnaire d'Europe, et en face de la carence complète du prolétariat international, ce serait une folie, dis-je, de croire que, dans cette première expérience de dictature prolétarienne réalisée dans des conditions aussi anormales, tout ce qui a été fait ou n'a pas été fait en Russie ait été le comble de la perfection. Tout au contraire, la compréhension la plus élémentaire de la politique socialiste et de ses conditions historiques nécessaires obligent à admettre que, dans des conditions aussi défavorables, l'idéalisme le plus gigantesque et l'énergie révolutionnaire la plus ferme ne peuvent réaliser ni la démocratie ni le socialisme, mais seulement de faibles rudiments de l'une et de l'autre.
Bien comprendre ce fait, avec toutes ses conséquences profondes, est un devoir élémentaire pour les socialistes de tous les pays. Car ce n'est qu'à une telle compréhension amère qu'on peut mesurer toute la responsabilité du prolétariat international en ce qui concerne le sort de la Révolution russe. D'autre part, ce n'est que de cette manière qu'apparaît l'importance décisive de l'action internationale de la révolution prolétarienne - comme une condition essentielle, sans laquelle les plus grands efforts et les plus sublimes sacrifices du prolétariat dans un seul pays doivent inévitablement tomber dans un tourbillon de contradictions et d'erreurs.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que c'est avec les plus grandes hésitations que Lénine et Trotsky, les cerveaux éminents qui dirigent la révolution russe, ont fait plus d'un pas décisif sur leur chemin épineux, semé de pièges de toutes sortes, et que rien ne saurait être plus éloigné de leur esprit que de voir l'Internationale accepter comme un modèle suprême de politique socialiste, ne laissant place qu'à l'admiration béate et à l'imitation servile, tout ce qu'ils ont dû faire ou ne pas faire sous la contrainte et dans le tumulte des événements.
Ce serait une erreur de craindre qu'un examen critique des voies suivies jusqu'ici par la révolution russe soit de nature à ébranler le prestige du prolétariat russe, dont le fascinant exemple pourrait seul triompher de l'inertie des masses ouvrières allemandes. Rien de plus faux. Le réveil de la combativité révolutionnaire du prolétariat allemand ne saurait être provoqué, conformément aux méthodes de la social-démocratie allemande de bienheureuse mémoire, par des moyens de suggestion collective, par la foi aveugle en quelque autorité infaillible, que ce soit celle de ses propres "instances" ou celles de l'"exemple russe". Ce n'est pas en créant un enthousiasme artificiel, mais, au contraire, uniquement en lui faisant comprendre la terrible gravité, la complexité des tâches à accomplir, en développant sa maturité politique et sa capacité de jugement, que la social-démocratie, pendant de longues années, et sous les prétextes les plus divers, s'est efforcée d'étouffer systématiquement, que l'on pourra mettre le prolétariat allemand en mesure de remplir sa mission historique. Se livrer à une étude critique de la révolution, sous tous ses aspects, c'est le meilleur moyen d'éduquer la classe ouvrière, tant allemande qu'internationale, en vue des tâches que lui impose la situation présente.
Rosa Luxembourg
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [70]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [669]
Personnages:
- Rosa Luxemburg [451]
Rubrique:
Les années 1950 et 60: Damen, Bordiga et la passion du communisme
- 1695 lectures
Avant de faire une incursion dans les tentatives de l'anarchisme espagnol pour établir le "communisme libertaire" pendant la guerre d'Espagne de 1936-39, nous avions publié la contribution de la Gauche communiste de France sur "l'État dans la période de transition" 1, un texte basé sur les acquis des fractions de gauche italiennes et belges durant les années 1930, et qui constituait déjà, à plusieurs égards, une avancée par rapport à leurs propres conceptions. La GCF était l'expression d'une certaine résurgence des organisations politiques prolétariennes dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale mais, au début des années 1950, le milieu prolétarien a été confronté à une grave crise alors qu'il devenait de plus en plus évident que la défaite profonde subie par la classe ouvrière n'avait pas été effacée par la guerre - au contraire, la victoire de la démocratie sur le fascisme avait encore aggravé la désorientation du prolétariat. Un long chemin était encore à parcourir avant que finisse la contre-révolution qui avait commencé dans les années 1920.
Dans notre livre La Gauche hollandaise, en particulier le chapitre 11, "Le Communistenbond Spartacus et le courant "conseilliste" (1942-1950)", nous avons examiné les développements importants qui ont eu lieu dans une partie de la gauche communiste hollandaise : la tentative du Communistenbond Spartacus d'ouvrir des discussions avec d'autres courants (tels que la GCF) et de se réapproprier certaines des anciennes positions du KAPD - ce qui constituait une distanciation vis-à-vis de ses idées antipartis développées dans les années 1930. Cependant, ces progrès étaient fragiles et les idées essentiellement anarchistes qui avaient été adoptées par la majorité de la gauche germano-hollandaise en réaction à la dégénérescence du bolchevisme revinrent bientôt en force, contribuant ainsi à un long processus de dispersion avec des groupes essentiellement locaux axés sur les luttes immédiates des travailleurs.
En 1952, la GCF éclatait : en partie à cause d'une prévision erronée concernant le cours historique, conduisant à la conclusion qu'une troisième guerre mondiale était imminente et au départ au Venezuela de Marc Chirik, le membre le plus influent du GCF ; et également en raison d'une combinaison de tensions personnelles et de divergences politiques non exprimées. Marc a lutté contre ces difficultés dans une série de "lettres de loin", dans lesquelles il a également tenté de décrire les tâches des organisations révolutionnaires dans les conditions historiques de l'époque, mais il a été incapable de mettre un terme à la désintégration du groupe. Certains de ses anciens membres ont rejoint le groupe Socialisme ou Barbarie autour de Cornelius Castoriadis, dont nous reparlerons dans un article ultérieur.
La même année, une scission majeure eut lieu entre les deux grandes tendances au sein du Parti Communiste Internationaliste en Italie - tendances qui existaient plus ou moins depuis le début, mais qui avaient été en mesure d'établir une sorte de Modus Vivendi alors que le parti se trouvait dans une phase euphorique de croissance. Alors que le recul de la lutte des classes était devenu de plus en plus évident et confrontée à la démoralisation de nombreux travailleurs qui avaient adhéré au Parti sur une base militante superficielle, l'organisation était inévitablement obligée de réfléchir à ses tâches et à son orientation future.
Les années 1950 et le début des années 60 constituèrent donc une autre période sombre pour le mouvement communiste qui faisait face à un véritable prolongement de la profonde contre-révolution qui s'était abattue sur la classe ouvrière dans les années 1930 et 40, mais cette fois dominée par l'image d'un capitalisme triomphant qui semblait avoir surmonté - peut-être définitivement - la crise catastrophique des années 1930. Ce fut le triomphe, en particulier, du capital américain, de la démocratie, d'une économie qui était passée assez rapidement de l'austérité d'après-guerre au boom de la consommation de la fin des années 1950 et du début des années 60. Certes, cette période "glorieuse" avait sa part d'ombre, en particulier la confrontation incessante entre les deux géants impérialistes avec sa prolifération des guerres locales et la menace globale d'un holocauste nucléaire. Parallèlement à cela, dans le bloc "démocratique", il y avait un véritable essor de la paranoïa vis-à-vis du communisme et de la subversion, illustrée par les chasses aux sorcières du Maccarthisme aux États-Unis. Dans cette atmosphère, les organisations révolutionnaires, là où il en existait, ont vu leur taille se réduire encore, et être encore plus isolées qu'elles ne l'avaient été dans les années 1930.
Cette période a ainsi marqué une rupture profonde dans la continuité du mouvement qui avait ébranlé le monde au lendemain de la Première Guerre mondiale, affectant même les courageuses minorités qui avaient résisté à l'avance de la contre-révolution. Comme le boom économique s'est maintenu, l'idée même que le capitalisme était un système transitoire, condamné par ses propres contradictions internes, paraissait beaucoup moins évidente qu'elle ne l'avait été dans les années 1914-1945, lorsque le système semblait être pris dans une succession de catastrophes gigantesques. Peut-être le marxisme lui-même avait-il échoué ? Ce fut clairement le message délivré par un certain nombre de sociologues et d'autres penseurs professionnels bourgeois, et de telles idées allaient bientôt pénétrer le mouvement révolutionnaire lui-même, comme nous l'avons vu dans notre récente série sur la décadence 2.
Malgré tout, la génération de militants qui avait été forgée par la révolution ou la lutte contre la dégénérescence des organisations politiques qu'elle avait fait surgir n'avait pas tout-à-fait disparu. Certaines des figures clés de la gauche communiste étaient restées actives après la guerre et dans la période de reflux des années 1950 et 60, et pour elles, malgré tout, la perspective du communisme était loin d'être morte et enterrée. Pannekoek, bien que n'étant plus rattaché à une organisation, publia son livre sur les conseils ouvriers et leur rôle dans la construction d'une nouvelle société 3; et jusque dans sa vieillesse, il est resté en contact avec un certain nombre de groupes qui sont apparus après la guerre, comme Socialisme ou Barbarie. Les militants qui avaient rompu avec le trotskisme pendant la guerre, comme Castoriadis et Munis, ont maintenu une activité politique et ont tenté d'esquisser une vision de ce qui se trouvait au-delà de l'horizon capitaliste. Et Marc Chirik, bien que "non organisé" depuis plus d'une décennie, n'avait en rien abandonné la pensée et la réflexion révolutionnaires ; quand il est revenu à la vie militante organisée au milieu des années 60, il avait précisé son point de vue sur un certain nombre de questions, notamment pas la moindre d'entre elles, les problèmes de la période de transition.
Nous reviendrons sur les écrits de Castoriadis, Munis et Chirik dans des articles à venir. Nous pensons qu'il est valable de parler de leurs contributions individuelles, même si le travail qu'ils ont effectué l'a été presque toujours été dans le contexte d'une organisation politique. Un militant révolutionnaire n'existe pas comme un simple individu, mais dans le cadre d'un organisme collectif qui, au bout du compte, est engendré par la classe ouvrière et sa lutte pour prendre conscience de son rôle historique. Un militant est par définition quelqu'un qui lui-même est engagé dans la construction et la défense d'une organisation politique. Mais - et là, comme nous le verrons ci-dessous, nous nous séparons des conceptions développées par Bordiga – une organisation révolutionnaire saine n'est pas celle dans laquelle l'individu sacrifie sa personnalité et abandonne ses facultés critiques ; au contraire, elle vise à exploiter plutôt qu'à supprimer l'individualité de différents camarades. Dans une telle organisation, il y a la place pour les contributions théoriques particulières de différents camarades et, bien sûr, pour le débat autour des objections soulevées par les militants individuels. Ainsi, comme nous l'avons constaté tout au long de cette série, l'histoire du programme communiste est non seulement l'histoire des luttes de la classe ouvrière, des organisations et des courants qui ont tiré les leçons de ces luttes et à partir desquelles un programme cohérent a été élaboré, mais aussi des militants individuels qui ont ouvert la voie dans ce processus d'élaboration.
Damen, et Bordiga en tant que militants révolutionnaires
Dans cet article, nous revenons au travail de la gauche communiste italienne qui, avant la guerre, sous la forme de la Fraction en exil, avait fait une contribution irremplaçable à notre compréhension des problèmes de la transition du capitalisme au communisme. Cette contribution avait également été construite sur les fondements marxistes élaborés par le courant de gauche en Italie au cours de la phase précédente, la phase de la Première Guerre impérialiste mondiale et de la vague révolutionnaire d'après-guerre ; et après la Deuxième Guerre impérialiste, l'héritage théorique de la gauche italienne n'avait pas disparu malgré les erreurs et les schismes qui affectaient le Parti Communiste Internationaliste. Si nous examinons la question de la période de transition ou d'autres questions, à travers toute cette période, il est impossible d'ignorer l'interaction et souvent l'opposition des deux principaux militants de ce courant : Onorato Damen et Amadeo Bordiga.
Pendant les jours de tempête de la guerre et de la révolution de 1914 à 1926, Damen et Bordiga ont démontré très clairement une capacité à s'opposer à l'ordre dominant, ce qui est la marque d'un militant communiste. Damen a été emprisonné pour agitation contre la guerre ; Bordiga a lutté sans relâche pour développer le travail de sa fraction au sein du Parti socialiste, pour faire pression pour une scission avec l'aile droite et les centristes et la formation d'un parti communiste sur des principes solides. Lorsque la nouvelle Internationale communiste elle-même a pris un cours opportuniste au début des années 1920, Bordiga était de nouveau sur la ligne de front de l'opposition à la tactique du Front uni et à la "bolchevisation" des PC ; à la réunion du Comité exécutif de l'IC à Moscou en 1926, il a eu l'immense courage de se lever et, face à Staline, de le dénoncer comme le fossoyeur de la révolution. Cette même année, Bordiga a lui-même été arrêté et exilé à l'île d'Ustica 4. Damen, quant à lui, a également été actif dans la résistance aux tentatives de l'IC visant à imposer sa politique opportuniste au parti italien, lequel avait initialement été dominé par la gauche. Avec Forticiari, Repossi et d'autres, il a formé le Comitato di Intesa en 1926 5. Au cours de la période fasciste, il a traversé plus d'un épisode de confinement et d'exil, mais il n'a pas été réduit au silence, prenant la tête d'une révolte des prisonniers dans Pianosa.
À ce stade, cependant, une différence dans l'attitude des deux militants devait avoir des conséquences à très long terme. Bordiga, placé en résidence surveillée et obligé d'abjurer toute activité politique (comme les fascistes semblaient doux alors !), évitait tout contact avec ses camarades et se concentrait entièrement sur son travail d'ingénieur. Il a reconnu que la classe ouvrière avait subi une défaite historique, mais n'en a pas tiré la même conclusion que les camarades qui formaient la Fraction en exil. Ces derniers avaient compris qu'il était plus que jamais nécessaire de maintenir une activité politique organisée, même si cela ne pouvait plus prendre la forme d'un parti. Ainsi, au moment de la formation de la Fraction italienne, et tout au long de la décennie très fertile qui a suivi, Bordiga a été entièrement coupé de ses développements théoriques 6. Damen, quant à lui, a maintenu des contacts et a regroupé un certain nombre de camarades de la Fraction à leur retour en Italie avec l'idée de contribuer à la formation du parti. Ces militants comptaient entre autres Stefanini, Danielis et Lecci, qui étaient restés fidèles aux positions essentielles de la Fraction, tout au long des années 1930 et de la guerre. En 1943, le Partito Comunista Internazionalista (PCInt) était proclamé dans le nord de l'Italie 7; il a ensuite été "refondé" en 1945, suite à un regroupement un peu hâtif avec des éléments autour de Bordiga dans le sud de l'Italie 8.
En conséquence, le parti unifié, formé autour d'une plate-forme écrite par Bordiga, était dès le début un compromis entre deux tendances. Celle autour Damen, était beaucoup plus claire sur de nombreuses positions de classe de base en grande mesure liées aux développements entrepris par la Fraction - par exemple, l'adoption explicite de la théorie de la décadence du capitalisme et le rejet de la position de Lénine sur l'autodétermination nationale.
En ce sens - et nous n'avons jamais caché notre critique de l'opportunisme profond qui sous-tendait la formation du parti dès le début - la tendance "Damen" a montré une capacité à assimiler certaines des avancées programmatiques les plus importantes faites par la Fraction italienne en exil, et même à adopter une position plus élaborée sur certaines des questions clés soulevées en son sein. Ce fut le cas avec la question syndicale : au sein de la Fraction, cette question avait donné lieu à un débat non résolu dans lequel Stefanini avait été le premier à défendre l'idée que les syndicats étaient déjà intégrés à l'État capitaliste. Bien qu'on ne puisse pas dire que la position de la tendance Damen était déjà complètement cohérente sur la question syndicale, elle était certainement plus claire que ce qui était devenu le point de vue dominant "bordiguiste" après la scission de 1952.
Ce processus de clarification a également englobé les tâches du parti communiste dans la révolution prolétarienne. Comme nous l'avons vu dans les articles précédents de la série 9, en dépit de quelques références persistantes au sujet du parti exerçant la dictature du prolétariat, la Fraction avait pour l'essentiel dépassé cette position en insistant sur le fait qu'une leçon clé de la révolution russe était que le parti ne devrait pas s'identifier à l'État de transition. La tendance Damen est allée encore plus loin et a précisé que la tâche du parti n'était pas d'exercer le pouvoir. Sa plate-forme de 1952, par exemple, affirme que "Jamais et sous aucun prétexte le prolétariat doit se départir de son rôle dans la lutte. Il ne doit pas déléguer son rôle historique à d'autres ou transférer son pouvoir à d'autres - même pas à son propre parti politique".
Comme nous le montrons dans notre livre La Gauche communiste italienne, ces idées étaient liées de façon tout à fait logique à certains développements sur la question de l'État : "Beaucoup plus hardie est la position que prend le parti internationaliste sur la question de l'État dans la période de transition, visiblement influencé par Bilan et Octobre. Damen et ses camarades rejettent l'assimilation de la dictature du prolétariat à celle du parti, et face à "l'État prolétarien" préconisent dans les conseils la démocratie la plus large. Ils n'écartent pas l'hypothèse, vérifiée à Kronstadt, d'affrontements entre "l'État ouvrier" et le prolétariat, dans lequel cas le parti communiste se retrouverait aux côtés de ce dernier : "La dictature du prolétariat ne peut en aucun cas se réduire à la dictature du parti, même s'il s'agit du parti du prolétariat, intelligence et guide de l'État prolétarien. L'État et le parti au pouvoir, en tant qu'organes d'une telle dictature, portent en germe la tendance au compromis avec le vieux monde, tendance qui se développe et se renforce, comme l'expérience russe l'a montré, par l'incapacité momentanée de la révolution dans un pays donné à s'élargir, en soudant d'autres pays au mouvement insurrectionnel. Notre parti devra : a) éviter de devenir l'instrument de l'État ouvrier et de sa politique ; défendre les intérêts de la révolution même dans les affrontements avec L'État ouvrier ; b) éviter de se bureaucratiser, en faisant de son centre directif, comme de ses centres périphériques un champ de manœuvre pour le carriérisme révolutionnaire ; c) donc éviter que sa politique de classe soit pensée et réalisée avec des critères formalistes et administratifs."" 10
Cependant, la vision la plus cruciale de la Fraction - la notion même de fraction, c'est-à-dire la forme et la fonction de l'organisation révolutionnaire dans une période de défaite de la lutte des classe, a été entièrement perdue dans la tendance Damen, comme ce fut aussi le cas concernant la notion connexe de cours historique, c'est-à-dire la nécessité de comprendre le rapport global de force entre les classes qui peut subir des modifications profondes durant l'époque de la décadence du capitalisme. Incapables de faire une réelle critique de l'erreur capitale de 1943 - la constitution d'un "parti" dans un seul pays dans une période de profonde contre-révolution - les Damenistes ont aggravé l'erreur en théorisant que le parti est une nécessité permanente et même une réalité permanente. Ainsi, malgré le rétrécissement rapide à un "mini-parti", s'est maintenu dans celui-ci l'accent original du regroupement de 1943-45 visant à la construction d'une présence au sein de la classe ouvrière et à donner à ses luttes une direction décisive, au prix de ce qui était vraiment nécessaire : la priorité de la clarification théorique sur les besoins et les possibilités de la période.
La tendance opposée autour de figures comme Bordiga et Maffi était, en général, beaucoup plus confuse au sujet des positions les plus importantes de la classe ouvrière. Bordiga ignorait plus ou moins les acquis de la Fraction et préconisait un retour aux positions des deux premiers congrès de la Troisième Internationale qui, pour lui, étaient fondés sur "la restauration" du programme communiste par Lénine. Une suspicion extrême vis-à-vis "d'innovations" opportunistes au marxisme (qui, il est vrai, commençaient à prospérer sur le sol de la contre-révolution) l'a conduit à la notion de programme "invariant" qui avait été celé dans la pierre en 1848 et qu'il suffisait de déterrer alors qu'il avait périodiquement été enterré par les opportunistes et les traîtres 11. Comme nous l'avons souvent souligné, cette notion d'invariance est basée sur une géométrie très "variable", de sorte que, par exemple, Bordiga et ses disciples pouvaient à la fois affirmer que le capitalisme était entré dans son époque de guerres et de révolutions (une position fondamentale de la Troisième Internationale) et aussi polémiquer contre la notion de déclin qu'ils estimaient fondée sur une idéologie pacifiste et gradualiste. 12
Cette remise en cause de la décadence a eu des répercussions importantes quand il s'est agi d'analyser la nature de la révolution russe (définie comme une révolution double, pas différemment de la vision conseilliste), et en particulier quand il s'est agi de caractériser les luttes de libération nationale qui se multipliaient dans les anciennes colonies. Mao, au lieu d'être vu pour ce qu'il était, une expression de la contre-révolution stalinienne et un véritable produit de décomposition capitaliste, a été salué comme un grand révolutionnaire bourgeois dans le moule de Cromwell. Plus tard, les bordiguistes devaient fournir le même type d'appréciation des Khmers rouges au Cambodge, et cette incompréhension profonde de la question nationale allait causer des ravages dans le parti bordiguiste à la fin des années 1970, avec un nombre important d'éléments qui abandonnaient l'internationalisme.
Sur la question du parti et des erreurs des bolcheviks dans le fonctionnement de l'État soviétique, ce fut comme si la Fraction n'avait jamais existé. Le parti prend le pouvoir, investit la machine d'État, impose la terreur rouge sans pitié ... même les nuances importantes de Lénine sur la nécessité pour la classe ouvrière de se méfier du danger que l'État de transition devienne une machine bureaucratique et s'autonomise semblent avoir été oubliées. Comme nous le soutenons dans un article précédent de cette série 13, la contribution de Bordiga la plus importante sur les leçons de la révolution russe dans la période de l'après Seconde Guerre mondiale, "Force, violence et la dictature dans la lutte des classes" (1946), contient assurément quelques idées sur le problème de la dégénérescence, mais son antidémocratisme plutôt dogmatique ne lui permettait cependant pas de reconnaître le problème du parti et de l'État se substituant au prolétariat.14
Cependant, même si la tendance Bordiga n'a également jamais mis en cause ouvertement la formation du parti en 1943, elle a été en mesure de comprendre que l'organisation était entrée dans une période beaucoup plus difficile et que des tâches différentes étaient à l'ordre du jour. Bordiga avait, dans un premier temps, été sceptique quant à la formation du parti. Sans montrer la moindre compréhension de la notion de fraction - en effet, il avait plutôt enterré sa propre expérience de travail de fraction avant la Première Guerre mondiale avec ses théorisations ultérieures sur le parti formel et le parti historique 15 - il avait une certaine compréhension du fait que le simple maintien d'une routine de l'intervention dans la lutte immédiate n'était pas la voie à suivre, et qu'il était essentiel de revenir aux fondements théoriques du marxisme. Ayant rejeté la contribution de la Fraction et d'autres expressions de la gauche communiste, ce travail n'a pas été terminé, ni même entrepris en ce qui concerne les positions programmatiques clés. Mais en ce qui concerne certaines questions théoriques plus générales, et en particulier celles relatives à la nature de la future société communiste, il nous semble que, pendant cette période, c'est Bordiga, plutôt que les "Damenistes", qui nous a laissé l'héritage le plus important.
La passion pour le communisme: la défense par Bordiga des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844
Le livre Bordiga et la passion du communisme, une collection d'écrits assemblés par Jacques Camatte en 1972, est le meilleur témoignage de la profondeur des réflexions de Bordiga sur le communisme, en particulier à travers deux grands exposés présentés lors des réunions du parti en 1959-60, qui sont dédiés aux Manuscrits économiques et politiques de 1844 de Marx : "Commentaires des Manuscrits de 1844 (1959-1960)", et "Tables immuables de la théorie communiste".
Voici comment Bordiga situe les Manuscrits de 1844 dans le corpus des écrits de Marx ! "Un autre lieu commun très vulgaire est que Marx est hégélien dans les écrits de jeunesse, que c'est seulement après qu'il fut théoricien du matérialisme historique, et que, plus vieux, il fut un vulgaire opportuniste. C'est une tâche de l'école marxiste révolutionnaire de rendre manifeste à tous les ennemis (qui ont le choix de tout prendre ou de tout rejeter) le monolithisme de tout le système depuis sa naissance jusqu'à la mort de Marx et même après lui (concept fondamental de l'invariance, refus fondamental de l'évolution enrichissante de la doctrine du parti)."("Commentaires …" p. 120).
Ici, nous avons à la fois dans un seul paragraphe les forces et les faiblesses de l'approche de Bordiga. D'une part, la défense intransigeante de la continuité de la pensée de Marx et la répudiation de l'idée que les Manuscrits de 1844 sont le produit d'un Marx qui était encore essentiellement idéaliste et hégélien (ou au moins Feuerbachien), une idée qui a été attribuée en particulier à l'intellectuel stalinien Althusser que nous avons déjà critiquée dans les articles précédents de cette série 16
Pour Bordiga, Les Manuscrits de 1844, avec leur exposé profond de l'aliénation capitaliste, et leur description inspirante de la société communiste qui la dépassera, indiquent déjà que Marx avait effectué une rupture qualitative avec les formes les plus avancées de la pensée bourgeoise. En particulier, Les Manuscrits de 1844, qui contiennent une grande partie consacrée à la critique de la philosophie hégélienne, sont la démonstration qu'ont lieu exactement à la même période l'assimilation complète de Hegel par Marx en matière de dialectique, sa rupture avec Hegel - ce qui signifiait renverser sa dialectique, "la remettre sur ses pieds" - et l'adoption d'une vision communiste du monde. Bordiga souligne en particulier le rejet par Marx du point de départ du système hégélien : l'individu avec un grand 'I'. "Ce qui est clair, c'est que pour Marx, l'erreur de Hegel est de faire reposer tout son colossal édifice spéculatif, avec son formalisme rigoureux, sur une base abstraite, la "conscience". Comme Marx le dira tant de fois, c'est de l'être qu'il faut partir, et non de la conscience qu'il a de lui-même. Hegel se renferme, dès le départ dans le vain dialogue éternel entre le sujet et l'objet. Son sujet est le "moi" entendu dans un sens absolu... " ("Commentaires …" p119).
D'autre part, il est évident que pour Bordiga Les Manuscrits de 1844 fournissent des preuves pour sa théorie de l'invariance du marxisme, une idée dont nous pensons qu'elle est contredite par le développement réel du programme communiste que nous avons tracé tout au long de cette série. Mais nous reviendrons sur cette question plus tard. Ce que nous partageons avec la vision de Bordiga à propos des Manuscrits de 1844 est, avant tout, la centralité de la conception de Marx de l'aliénation, non seulement dans Les Manuscrits de 1844 mais également dans l'ensemble de son œuvre ; nous partageons également un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la conception de Bordiga de la dialectique de l'histoire de même qu'une vision exaltée du communisme qui, encore une fois, n'a jamais été répudiée par Marx dans son travail ultérieur (qu'il a au contraire, à notre avis, enrichie).
La dialectique de l'histoire
Les références de Bordiga à la notion d'aliénation dans Les Manuscrits de 1844 révèlent toute sa vision de l'histoire, car il insiste sur le fait que "le plus haut degré de l'aliénation de l'homme est atteint à l'époque capitaliste actuelle" ("Commentaires …" p. 124). Sans abandonner l'idée que l'émergence et le développement du capitalisme, et la destruction de l'ancien mode féodal d'exploitation, constituent une condition préalable à la révolution communiste, il méprise le progressisme facile de la bourgeoisie qui vante sa supériorité sur les modes de production antérieurs et leurs moyens d'appréhender le monde. Il suggère même que la pensée bourgeoise est d'une certaine manière vide en comparaison avec les points de vue précapitalistes tant tournés en dérision. Pour Bordiga, le marxisme a démontré que "… vos remontrances sont de vides et inconsistants mensonges, beaucoup plus caractérisés et plus nets que ne le sont les opinions plus anciennes de la pensée humaine que, vous, bourgeois, croyez avoir, pour toujours, submergées sous la fatuité de votre rhétorique illuministe." ("Commentaires …" p168). Par conséquent, même lorsque bourgeoisie et prolétariat formulent leur critique de la religion, il y a encore une rupture entre les deux points de vue de classe : "… que même dans les cas (non généraux) où les idéologues de la bourgeoisie moderne ont osé rompre ouvertement avec les principes de l'église chrétienne, nous, marxistes, nous ne définissons pas cette superstructure, l'athéisme, comme une plate-forme commune à la bourgeoisie et au prolétariat" ("Commentaires …" p. 117).
Avec de telles affirmations, Bordiga semble être en phase avec certains des critiques "philosophiques" du marxisme de la Deuxième Internationale (et, par extension, de la philosophie officielle de la Troisième), tels que Pannekoek, Lukacs et Korsch qui ont rejeté l'idée selon laquelle, tout comme le socialisme est la prochaine étape logique dans l'évolution historique qui ne nécessiterait que la "prise en charge" de l'État capitaliste et de l'économie, le matérialisme historique serait alors tout simplement la prochaine étape dans la progression du matérialisme bourgeois classique. Une telle vision est basée sur une sous-estimation profonde de l'antagonisme entre les conceptions bourgeoises et prolétariennes du monde, de la nécessité inévitable d'une rupture révolutionnaire avec les formes anciennes. Il y a continuité, bien sûr, mais elle est tout sauf progressive et pacifique. Cette façon d'aborder le problème est tout à fait conforme à l'idée que la bourgeoisie ne peut que voir le monde social et naturel à travers le prisme déformant de l'aliénation qui, sous son règne, a atteint son stade "suprême".
Le slogan "Contre l'immédiatisme" figure plus d'une fois dans les sous-titres de ses contributions. Pour Bordiga, il était essentiel d'éviter toute appréhension étroite du moment présent de l'histoire, et de regarder au-delà du capitalisme, vers l'arrière et vers l'avant. À l'époque actuelle, la pensée bourgeoise est peut-être plus immédiatiste que jamais, plus que jamais fixée sur le particulier, ici et maintenant, à court terme, car elle vit dans la peur mortelle que le fait de regarder la société actuelle avec l'œil de l'histoire permette de discerner sa nature transitoire. Mais Bordiga développe également une polémique contre les "grands écrits" classiques de la bourgeoisie dans sa période la plus optimiste : non pas à cause de leur grandeur, mais parce que le récit de la bourgeoisie déforme l'histoire véritable. Tout comme le passage de la pensée bourgeoisie à la pensée prolétarienne n'est pas qu'un pas en avant, l'histoire en général n'est pas une ligne droite allant de l'obscurité à la lumière, mais elle est une expression de la dialectique du mouvement : "le progrès de l'humanité et du savoir du tourmenté homo sapiens n'est pas continu, mais advient par de grands élans isolés parmi lesquels s'insèrent de sinistres et obscurs plongeons dans des formes sociales dégénérant jusqu'à la putréfaction" ("Commentaires …" p. 168). Ce n'est pas une formulation accidentelle : à un autre endroit du même texte, il dit "Les conceptions banales des idéologies dominantes voient ce chemin comme une ascension continue et constante ; le marxisme ne partage pas cette vision, et définit une série alternante de montées et de descentes, entrecoupées par de violentes crises" ("Commentaires …" p. 152). C'est là une réponse très claire, pourrait-on penser, à ceux qui rejettent le concept de l'ascendance et de la décadence des modes de production successifs.
La vision dialectique de l'histoire voit le mouvement comme résultant du conflit - souvent violent - des contradictions. Mais elle contient aussi la notion de spirale et de "retour à un niveau supérieur". Ainsi, le communisme de l'avenir est, dans une mesure importante, un retour de l'homme à lui-même, comme dit Marx dans les Manuscrits de 1844, car il est non seulement une rupture avec le passé, mais une synthèse de tout ce qui était humain en son sein : "l'homme retourne à lui-même et en lui-même non tel qu'il était parti à l'origine de sa longue histoire, mais disposant finalement de toutes les perfections d'un développement immense, mêmes acquises dans la forme de toutes les techniques, coutumes, religions, philosophies successives dont les côtés utiles étaient - s'il est permis de nous exprimer ainsi - captés dans la zone d'aliénation" ("Commentaires …" p. 125).
Un exemple plus concret de cela est donné dans un court article sur les habitants de l'île de Janitzio au Mexique 17, écrit en 1961, et inclus dans la collection de Camatte. Bordiga développe l'idée que "dans le communisme naturel et primitif" l'individu, toujours lié à ses frères humains dans une vraie communauté, ne connait pas la peur de la mort telle qu'elle a émergé avec l'atomisation sociale engendrée par la propriété privée et de la société de classes ; et cela nous donne une indication que dans le communisme de l'avenir, où le destin de l'individu sera lié à celui de l'espèce, la crainte de la mort personnelle de même que "tout culte de la vie et de la mort" seront dépassés. Bordiga confirme ainsi sa continuité avec ce fil central de la tradition marxiste qui affirme que, dans un certain sens, "les membres des sociétés primitives furent plus proches de l'essence humaine" ("Tables immuables …" p. 175) – et que le communisme du passé lointain peut aussi être compris comme préfiguration du communisme de l'avenir 18.
Ce que le communisme n'est pas
La défense par Bordiga des Manuscrits de 1844 est, dans une large mesure, une longue diatribe contre l'imposture du "socialisme vrai" dans les pays du bloc de l'Est, qui avait acquis un nouveau souffle de vie dans le sillage de la "guerre antifasciste" de 1939-45. Son attaque a été conçue à deux niveaux : la négation et l'affirmation ; négation de la revendication que ce qui existait dans les régimes soviétiques et similaires avait quelque chose à voir avec la conception de Marx du communisme, d'abord et avant tout sur le plan économique ; affirmation des caractéristiques fondamentales des relations de production communistes.
Selon une version d'une blague répandue dans l'ancienne URSS, un instructeur de l'école du parti donne une leçon à des membres du Jeune Komsomol sur la question clé suivante : Y-aura-t-il de l'argent dans le communisme ? : "Historiquement, camarades, il y a trois positions sur cette question. Il y a celle de la déviation proudhonienne-boukharinienne de droite : sous le communisme, tout le monde aura de l'argent. Ensuite, il y a celle de la déviation ultragauche infantile : sous le communisme, personne n'aura d'argent. Quelle est alors la position dialectique du marxisme-léninisme ? C'est très clair : sous le communisme, certaines personnes auront de l'argent, et d'autres n'en auront pas".
Que Bordiga ait connu ou non cette blague, sa réponse aux staliniens dans ses "Commentaires des manuscrits de 1844" va dans le même sens. Une préface à l'une des éditions staliniennes des Manuscrits de 1844 souligne que le texte de Marx contient une polémique contre la théorie de Proudhon des salaires égaux, ce qui implique que, pour le marxisme vrai pratiqué en URSS, sous le socialisme il doit y avoir des salaires inégaux. Mais, dans la section qui suit intitulée "Travail salarié ou socialisme", Bordiga souligne que dans les Manuscrits de 1844, ainsi que dans d'autres ouvrages tels que Misère de la philosophie et Le Capital, Marx "réfute la vacuité proudhonienne qui conçoit un socialisme conservant les salaires comme les conserve la Russie. Marx ne tape pas sur la théorie de l'égalité mais sur celle du salaire. Même si on veut le niveler, le salaire est la négation du socialisme. Mais non nivelé, il est à plus forte raison la négation du socialisme" ("Commentaires …" p. 129).
Et la section suivante est intitulée "Soit l'argent soit le socialisme" : tout comme le travail salarié persiste en URSS, il doit en être de même de son corollaire : la domination des rapports humains par la valeur d'échange, et donc par l'argent. Revenant sur la critique profonde de l'argent comme une expression de l'aliénation entre les êtres humains, que Marx, citant Shakespeare et Goethe, a développée dans les Manuscrits de 1844 et revenant au Capital, Bordiga insiste sur ce fait que "les sociétés où l'argent circule sont des sociétés de propriété privée ; elles restent dans la préhistoire barbare de l'espèce humaine …" ("Commentaires …" p. 137).
Bordiga, en fait, démontre que les staliniens ont plus en commun avec le père de l'anarchisme qu'ils veulent l'admettre. Proudhon, dans la tradition d'un "communisme brut" que Marx reconnaît déjà comme réactionnaire au point que lui-même a embrassé le communisme, envisage une société dans laquelle le "… le 'revenu annuel' fût socialement divisé en parties égales entre tous les membres de la société, devenus tous ouvriers salariés" (p. 132). En d'autres termes, ce type de communisme ou socialisme était celui dans lequel la misère de la condition prolétarienne a été généralisée plutôt que supprimée, et dans laquelle la "société" devient elle-même le capitaliste. Et en réponse à ceux - non seulement les staliniens, mais aussi leurs apologistes de gauche, les trotskystes - qui niaient que l'URSS pourrait être une forme de capitalisme parce qu'elle s'était (plus ou moins) débarrassée des propriétaires individuels de capital, Bordiga répond: "La question de savoir où sont les capitalistes n'a pas de sens. La réponse est écrite depuis 1844: la société est un capitaliste abstrait"("Commentaires …" p. 132).
La cible de la polémique dans ces essais ne se limite pas aux défenseurs manifestes de l'URSS. Si le communisme abolit la valeur d'échange, c'est parce qu'il a abolit toutes les formes de propriété 19 - non seulement la propriété d'État comme dans le programme du stalinisme, mais aussi la version anarchosyndicaliste classique (que Bordiga attribue également au groupe contemporain Socialisme ou Barbarie avec sa définition du socialisme comme étant la gestion de la production par les ouvriers) : "la terre aux paysans et les usines aux ouvriers et de semblables et piteuses parodies similaires du magnifique programme du parti communiste révolutionnaire" ("Tables immuables …" p. 178). Dans le communisme, l'entreprise individuelle doit être abolie en tant que telle. Si l'entreprise continue à être la propriété de ceux qui y travaillent, ou même de la communauté locale autour d'elle, elle n'a pas été vraiment socialisée, et les relations entre les différentes entreprises autogérées doivent nécessairement être fondées sur l'échange de marchandises. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous nous pencherons sur la vision du socialisme développée par Castoriadis et le groupe Socialisme ou Barbarie.
Comme Trotsky dans les passages visionnaires à la fin de Littérature et Révolution 20- qui, en 1924, n'avait certainement pas eu connaissance des Manuscrits de 1844 - Bordiga s'élève alors de la sphère de la négation du capitalisme et de son aliénation, à une insistance sur ce que le socialisme n'est pas, et à l'affirmation positive de ce à quoi l'humanité ressemblera dans les stades supérieurs de la société communiste. Les Manuscrits de 1844, comme nous l'avons souligné dans un article au début de cette série 21, sont remplis de passages décrivant la façon dont les rapports entre les êtres humains et entre l'humanité et la nature seront transformés sous le communisme, et Bordiga cite abondamment les plus importants de ces passages dans ses deux textes, plus particulièrement là où ils traitent de la transformation des rapports entre les hommes et les femmes, et où ils insistent sur le fait que la société communiste permettra l'émergence d'un stade supérieur de la vie consciente.
La transformation des relations entre les sexes
Tout au long des Manuscrits de 1844, Marx répudie le "communisme vulgaire" qui, tout en attaquant la famille bourgeoise, continue de considérer la femme comme un objet et spécule sur une future "communauté des femmes". Contre ce "communisme vulgaire", Bordiga cite Marx mettant en évidence en quoi l'humanisation du rapport entre l'homme et la femme constitue un révélateur de l'avancée réelle de l'espèce. Mais en même temps, sous le capitalisme, la femme et le rapport entre les sexes, resteront prisonniers des rapports marchands.
Après avoir repris la pensée de Marx sur ces questions, Bordiga fait une digression momentanée sur le problème de la terminologie, de la langue.
"En citant ces passages, il est nécessaire d'adopter tour à tour le mot homme et le mot mâle dans la mesure où le premier mot indique tous les membres de l'espèce ... Quand on fit il y a un demi-siècle une enquête sur le féminisme dans les sociétés de propriété, l'estimable marxiste Filippo Turati répondit ces seuls mots : la femme ... est homme. Cela voulait dire : elle le sera dans le communisme, mais pour votre société bourgeoise c'est est un animal, un objet". ("Commentaires …" p. 150)
Le féminisme une déviation bourgeoise ? Cette position est fortement rejetée par ceux qui estiment qu'il peut y avoir un "féminisme socialiste" ou un "anarchoféminisme". Mais du point de vue de Bordiga, le féminisme a un point de départ bourgeois parce qu'il vise à "l'égalité" des sexes à l'intérieur des rapports sociaux existants ; et cela conduit logiquement à la revendication que les femmes devraient être "aussi" capables que les hommes de combattre dans les armées impérialistes ou de monter dans l'échelle sociale en devenant chefs d'entreprise et chefs d'État.
Le communisme n'a pas besoin de l'additif du féminisme ou même du "féminisme socialiste" pour avoir été, dès le début, un défenseur de la solidarité des hommes et des femmes à l'instant présent, mais cela ne peut être réalisé que dans la lutte de classes, dans la lutte contre l'oppression et l'exploitation capitaliste et pour la création d'une société dans laquelle la "forme originelle de l'exploitation" - celle de la femme par l'homme - ne sera plus possible. Plus que cela : le marxisme a aussi reconnu que la femelle de l'espèce - en raison de sa double oppression et de son sens moral plus avancé (lié notamment à son rôle historique dans l'éducation des enfants) - est souvent à l'avant-garde de la lutte, par exemple dans la révolution de 1917 de Russie, qui a commencé avec des manifestations de femmes contre la pénurie de pain, ou plus récemment dans les grèves massives en Egypte en 2007. En effet, selon l'école anthropologique de Chris Knight, Camilla Power et d'autres, qui se revendique de la tradition marxiste dans l'anthropologie, la morale féminine et la solidarité ont joué un rôle crucial dans l'émergence même de la culture humaine, dans la "révolution humaine" primitive 22. Bordiga est en accord avec cette façon de voir les choses comme il le montre dans la section des "Commentaires des Manuscrits …" intitulée "L'amour, besoin de tous", alors qu'il fait valoir que la fonction passive assignée aux femmes est un pur produit des rapports de propriété et que, en fait, "l'amour étant, selon la nature, le fondement de la reproduction de l'espèce, la femme est le sexe actif et les formes monétaires, envisagées d'après ce critère, se révèlent contre nature" ("Commentaires …" p. 156). Et il poursuit avec un résumé de la façon dont l'abolition des rapports marchands transformera cette relation: "Dans le communisme non monétaire, l'amour aura, en tant que besoin, le même poids et le même sens pour les deux sexes et l'acte qui le consacre réalisera la formule sociale que le besoin de l'autre homme est mon besoin d'homme, dans la mesure où le besoin d'un sexe se réalise comme un besoin de l'autre sexe".
Bordiga explique ensuite que cette transformation sera basée sur les changements matériels et sociaux introduits par la révolution communiste: "On ne peut pas proposer cela uniquement en tant que rapport moral fondé sur un certain mode de rapport physique, parce que le passage à la forme supérieure s'effectue dans le domaine économique : les fils et leur charge ne concernent pas les deux parents qui s'unissent mais la communauté." C'est là l'étape à partir de laquelle l'humanité future sera en mesure de franchir les limites imposées par la famille bourgeoise.
La vie consciente à un autre niveau
Dans un article précédent de cette série 23, nous avons fait valoir que certains passages des Manuscrits de 1844 n'ont de sens que si nous les considérons comme des anticipations d'une transformation de la conscience, d'un nouveau mode d'être que les rapports sociaux communistes rendront possibles. L'article examinait longuement le passage du chapitre "Propriété privée et communisme" où Marx parle de la façon dont la propriété privée (comprise dans son sens le plus large) a servi à limiter les sens humains, à entraver - ou, pour utiliser un terme plus précis de la psychanalyse, réprimer – l'expérience sensuelle humaine ; par conséquent, le communisme apportera avec lui "l'émancipation des sens", un nouveau rapport corporel et mental avec le monde qui peut être comparé à l'état d'inspiration vécu par les artistes dans leurs moments les plus créatifs.
Vers la fin du texte de Bordiga "Tables immuables …" il y a une section intitulée "À bas la personnalité : voilà la clef". Nous aborderons plus tard cette question de la "personnalité", mais nous voulons d'abord examiner la façon dont Bordiga, dans sa façon d'interpréter les Manuscrits de 1844, envisage la modification de la conscience humaine dans le futur communiste.
Il commence par affirmer que, dans le communisme, on sera "sorti de la tromperie millénaire de l'individu seul face au monde naturel stupidement appelé externe par les philosophes. Externe à quoi ? Externe au moi, ce déficient suprême ; externe à l'espèce humaine, on ne peut plus l'affirmer, parce que l'homme espèce est interne à la nature, il fait partie du monde physique". Et il poursuit en disant que "dans ce texte puissant, l'objet et le sujet deviennent, comme l'homme et la nature, une seule et même chose. Et même tout est objet : l'homme sujet "contre nature" disparaît avec l'illusion d'un moi singulier" ("Tables immuables …" p. 191).
Il ne peut ici que faire référence au passage du chapitre "Propriété privée et communisme" où Marx dit "… à mesure que partout dans la société la réalité objective devient pour l'homme la réalité des forces humaines essentielles, la réalité humaine et par conséquent la réalité de ses propres forces essentielles, tous les objets deviennent pour lui l'objectivation de lui-même, les objets qui confirment et réalisent son individualité, ses objets, c'est-à-dire qu'il devient lui-même objet" 24
Bordiga continue : "Nous avons que lorsque d'individu il devient d'espèce, l'esprit, pauvre absolu, se dissout dans la nature objective. Aux cerveaux individuels, misérables machines passives, on a substitué le cerveau social. De plus Marx a, avec le sens humain collectif, dépassé les sens corporels singuliers" ("Tables immuables …" p. 191). Et il continue à citer les Manuscrits de 1844 sur l'émancipation des sens, en insistant que celle-ci aussi indique l'émergence d'une sorte de prise de conscience collective – ce que l'on pourrait appeler un passage du "sens commun" de l'ego isolé à la communisation des sens.
Que faisons-nous de ces conceptions ? Avant de les rejeter comme de la science-fiction, il faut se rappeler que, dans la société bourgeoise en particulier, bien que nous prenions souvent l'ego comme étant le centre absolu de notre être ("Je pense, donc je suis"), il y a aussi une longue tradition de pensée qui insiste sur le fait que l'ego est seulement une réalité relative, au mieux une partie spécifique de notre être. Ce point de vue est incontestablement au cœur de la théorie psychanalytique, pour laquelle l'ego adulte n'émerge qu'à travers un long processus de répression et de division entre la partie consciente et la partie inconsciente de nous-mêmes – ce qui, en outre, constitue le "siège unique de l'anxiété" 25 parce que, pris comme il est entre les exigences de la réalité extérieure et les pulsions inassouvies enfouies dans l'inconscient, l'ego est constamment préoccupé par son propre renversement ou son extinction.
C'est également une perspective qui a été mise en avant dans un certain nombre de traditions "mystiques" à l'est et à l'ouest, même si elle a probablement été développée de la façon la plus cohérente par la philosophie indienne, et surtout par le bouddhisme avec sa doctrine du "anatta" - l'impermanence du soi séparé. Mais toutes ces traditions ont tendance à s'accorder qu'il est possible, en pénétrant directement l'inconscient, de dépasser la conscience quotidienne de l'ego - et donc le tourment de l'anxiété perpétuelle. Dépouillées des distorsions idéologiques qui accompagnent inévitablement ces traditions, leurs idées les plus lucides soulèvent la possibilité que les êtres humains sont capables d'atteindre un autre type de conscience dans lequel le monde autour de nous n'est plus considéré comme un autre hostile, et où l'essentiel de la prise de conscience se déplace - non seulement intellectuellement, mais également à travers une expérience directe et très corporelle - depuis l'atome isolé jusqu'au point de vue de l'espèce - en fait, plus encore que le point de vue de l'espèce, à savoir la nature - un univers en évolution°- qui devient consciente d'elle-même.
Il est difficile de lire les passages ci-dessus de Bordiga et de conclure qu'il parle de quelque chose de totalement différent. Et il est important de noter que Freud, dans les parties introductives à Malaise dans la civilisation, a reconnu la réalité du "sentiment océanique", cette expérience d'unité érotique avec le monde, mais il ne pouvait la concevoir que comme une régression à l'état infantile antérieure à l'émergence de l'ego. Cependant, dans la même section du livre, il accepte également la possibilité que les techniques mentales du yoga peuvent ouvrir la porte à des "états archaïques, depuis longtemps ensevelis, de la vie psychique". La question théorique que cela nous pose - et peut-être celle d'une investigation pratique qui est posée aux générations futures - est de savoir si les techniques séculaires de la méditation ne peuvent conduire qu'à une régression, à un effondrement dans le passé, dans l'unité indifférenciée de l'animal ou du nourrisson ; ou bien si elles peuvent faire partie d'un "retour dialectique vers la conscience", d'une exploration consciente de notre propre esprit. Dans cette optique, les cas de "sentiment océanique" lorsqu'ils se produisent concernent non seulement le passé infantile, mais aussi l'horizon d'une conscience humaine plus avancé et plus universelle. C'était certainement le point de vue adopté par Erich Fromm dans son étude Bouddhisme Zen et psychanalyse, par exemple lorsqu'il écrit à propos de ce qu'il appelle "l'état de dé-refoulement" qu'il définit comme "un état où l'on retrouve cette emprise sur la réalité immédiate et non déformée, cette simplicité et cette spontanéité de l'enfance. Mais comme ce retour à l'innocence se produit après avoir passé par le processus de l'aliénation, du développement de l'intellect, il se place à un niveau supérieur. Retourner à l'innocence n'est possible après qu'après avoir perdu son innocence" 26.
Contre la destruction de l'environnement
Mais les écrits théoriques de Bordiga au cours de cette période ne posent pas seulement la question du rapport de l'homme avec la nature à ce niveau très "philosophique". Bordiga a également soulevé cette question dans ses réflexions perspicaces sur les catastrophes capitalistes et le problème de l'environnement. En écrivant sur les catastrophes contemporaines comme l'inondation de la vallée du Pô en 1957 et le naufrage du paquebot Andrea Doria l'année précédente, Bordiga met à profit ses connaissances de spécialiste comme ingénieur et surtout son profond rejet du progrès bourgeois en montrant comment sa volonté d'accumuler contient les germes de ces catastrophes et, finalement, de la destruction du monde naturel lui-même 27. Bordiga est particulièrement véhément dans ses articles sur la frénésie d'urbanisation qu'il pouvait déjà discerner dans la période de reconstruction d'après-guerre, dénonçant l'entassement des êtres humains dans des espaces urbains de plus en plus limités et la philosophie qui va avec, le "verticalisme" dans la construction. Il fait valoir que cette réduction des êtres humains au niveau de fourmis est un produit direct des besoins de l'accumulation et sera inversée dans le communisme futur, réaffirmant la revendication de Marx et Engels pour surmonter la séparation entre ville et campagne: "Quand, après avoir écrasé par la force cette dictature chaque jour plus obscène, il sera possible de subordonner chaque solution et chaque plan à l'amélioration des conditions du travail vivant, en façonnant dans ce but ce qui est du travail mort, le capital constant, l'infrastructure que l'espèce homme a donnée au cours des siècles et continue de donner à la croûte terrestre, alors le verticalisme brut des monstres de ciment sera ridiculisé et sera supprimé, et dans les immenses étendues d'espace horizontal, les villes géantes une fois été dégonflées, la force et l'intelligence de l'animal-homme tendront progressivement à rendre uniforme sur les terres habitables la densité de la vie et celle de travail ; et ces forces seront désormais en harmonie, et non plus farouchement ennemies comme dans la civilisation difforme d'aujourd'hui, où ils ne sont réunies que par le spectre de la servitude et de la faim" 28. Il est également intéressant de noter que lorsque Bordiga, en 1952, a formulé une sorte de "programme révolutionnaire immédiat 29, il a inclus les revendications pour mettre un terme à ce qu'il a déjà vu comme l'engorgement inhumain et le rythme de vie provoqués par l'urbanisation capitaliste (un processus qui a atteint depuis lors des niveaux beaucoup plus élevés en irrationalité). Ainsi, le septième point des neuf que comporte ce programme appelle à "l'Arrêt de la construction d'habitations et de lieux de travail à la périphérie des grandes villes et même des petites, comme mesure d'acheminement vers une répartition uniforme de la population sur tout le territoire. Réduction de l'engorgement, de la rapidité et du volume de la circulation en interdisant celle qui est inutile" (dans un futur article nous avons l'intention de revenir sur les autres revendications de ce "programme" car elles contiennent un certain nombre de formulations qui peuvent, à notre avis, être fortement critiquées).
Il est intéressant de noter que, quand vient le moment de démontrer pourquoi tout ce que l'on appelle le progrès de la ville capitaliste n'a rien de cela, Bordiga a recours à un concept de décadence qu'il tend à jeter par la fenêtre dans d'autres polémiques - par exemple dans le titre "Le sinistre roman noir de la décadence sociale moderne" 30. Un tel terme est par ailleurs tout à fait conforme à l'idée générale de l'histoire que nous avons relevée ci-dessus, où les sociétés peuvent "dégénérer au point de putréfaction" et passer par des phases d'ascension et de déclin. C'est comme si Bordiga, une fois retiré du monde "étroit" de la confrontation des positions politiques, et obligé de revenir aux bases de la théorie marxiste, n'avait pas d'autre choix que de reconnaître que le capitalisme, comme tous les modes de production antérieurs, doit également entrer dans une époque de déclin ; et que nous sommes depuis longtemps dans cette époque, quelles que soient les merveilles de la croissance du capitalisme en décadence qui étouffent l'humanité et qui menacent son avenir.
Le problème avec "l'invariance"
Nous devons maintenant revenir à la notion de Bordiga selon laquelle les Manuscrits de 1844 fournissent des preuves pour sa théorie de "l'invariance du marxisme". Nous avons fait valoir à plusieurs reprises que cela est une conception religieuse. Dans une polémique cinglante 31 avec le groupe bordiguiste qui publie Programma Comunista, Mark Chirik a noté la similitude réelle entre le concept bordiguiste de l'invariance et l'attitude islamique de soumission à une doctrine immuable.
La cible de cet article était principalement, il est vrai, les épigones de Bordiga, mais que dit Bordiga lui-même au sujet de la relation entre le marxisme et les sources de la doctrine de "l'invariance" dans le passé ? Dans un texte fondateur intitulé précisément "L'invariance historique du marxisme", il écrit :
"Bien que le patrimoine théorique de la classe ouvrière révolutionnaire ne soit plus une révélation, un mythe, une idéologie idéaliste comme ce fut le cas pour les classes précédentes, mais une "science" positive, elle a toutefois besoin d'une formulation stable de ses principes et de ses règles d'action, qui joue le rôle et possède l'efficacité décisive qu'ont eu dans le passé les dogmes, les catéchismes, les tables, les constitutions, les livres-guides tels que les Védas, le Talmud, la Bible, le Coran ou la Déclaration des droits de l'homme. Les profondes erreurs, dans la substance ou dans la forme, contenues dans ces recueils ne leur ont rien ôté de leur énorme force organisatrice et sociale - d'abord révolutionnaire, puis contre-révolutionnaire, en succession dialectique - et même ce sont souvent ces "écarts" qui y ont précisément contribué". 32
Dans ses "Commentaires …", Bordiga était déjà conscient de l'accusation que de telles idées le ramenaient à une vision religieuse du monde :
"Quand, à un certain point, notre banal contradicteur (qui ne sait que rabâcher, sans originalité et sans vie, d'anciennes inepties que notre doctrine a, depuis longtemps, liquidées en puisant à la seule source dans laquelle, à certains moments, la vie porte sur son cours torturé le souffle original et nouveau ; et c'est mourir que de le perdre au moment de son irruption) nous dira que nous construisons ainsi notre mystique, se posant lui, le pauvre, comme l'esprit qui a dépassé tous les fidéismes et les mystiques, nous tournera en dérision en nous traitant de prosternés devant les tables mosaïques, ou talmudiques, de la Bible, ou du Coran, des évangiles ou des catéchismes, nous lui répondrons que même avec ça il ne nous a pas induits à prendre la position de ·défense requise à l'inculpé et même en mettant à part l'utilité de causer des ennuis au philistin de tout temps renaissant - nous lui répondrons également que nous n'avons pas de motifs de considérer comme une offense l'affirmation qu'on peut encore attribuer à notre mouvement - tant qu'il n'a pas triomphé dans la réalité (qui précède dans notre méthode toute conquête ultérieure de la conscience humaine) - une mystique et, si l'on veut, un mythe.
Le mythe, dans ses formes innombrables, ne fut pas un délire des esprits qui avaient leurs yeux physiques fermés à la réalité - naturelle et humaine de façon inséparable comme chez Marx - mais c'est une étape irremplaçable dans l'unique voie de conquête réelle de la conscience …" ("Commentaires …" p. 169).
Bordiga a raison de considérer que la pensée mythique a en effet été une "étape irremplaçable" dans l'évolution de la conscience humaine, et que la Bible, le Coran ou la Déclaration des droits de l'homme ont été, à un certain stade de l'histoire, véritablement des produits révolutionnaires. Il est également juste de reconnaître que l'adhésion à ces "tables de la loi" est devenue contre-révolutionnaire, à une autre étape de l'histoire. Mais si elle est devenue contre-révolutionnaire dans de nouvelles circonstances historiques c'est précisément du fait de la conception selon laquelle elles étaient immuables et inchangeables. L'Islam, par exemple, estime sa révélation plus pure que celle de la Torah juive, car soutient-il, alors que cette dernière a été soumise à la révision et à la rédaction ultérieure, pas un seul mot du Coran n'a été modifié à partir du moment où l'ange Gabriel l'a dicté à Mahomet. La différence entre le point de vue marxiste du programme communiste et le mythe ou le dogme religieux est que le marxisme voit ses concepts comme le produit historique des êtres humains et donc qu'ils sont soumis à la confirmation ou l'infirmation à travers le développement historique ou l'expérience, et non pas comme la révélation, une fois pour toutes, d'une source surhumaine. En effet, il insiste sur le fait que les révélations mythiques ou religieuses sont elles-mêmes des produits de l'histoire humaine, et donc limitées dans leur portée et leur clarté, même à leurs plus hauts points de réalisation. En acceptant l'idée que le marxisme est lui-même une sorte de mythe, Bordiga perd de vue la méthode historique qu'il est capable d'utiliser si bien ailleurs.
Bien sûr, il est vrai que le programme communiste lui-même n'est pas infiniment malléable et qu'il possède un noyau immuable de principes généraux tels que la lutte des classes, la nature transitoire des sociétés de classes, la nécessité de la dictature du prolétariat et le communisme. En outre, il y a un sens dans lequel ce schéma général peut apparaître comme un éclair d'inspiration. Ainsi Bordiga peut écrire:
"Une nouvelle doctrine ne peut apparaître à un moment quelconque de l'histoire. Il y a certaines époques de l'histoire, bien caractéristiques - et même rarissimes - où elle peut apparaître, comme un faisceau de lumière éblouissante, et si l'on n'a pas reconnu ce moment crucial et fixé la terrible lumière, il est vain de recourir ensuite aux bouts de chandelle avec lesquels le pédant universitaire ou le combattant de peu de foi tentent d'éclairer leur chemin." 33
Très probablement Bordiga a en tête la période incroyablement riche des travaux de Marx qui a donné naissance aux Manuscrits de 1844 et à d'autres textes fondamentaux. Mais Marx ne considérait pas ces textes comme ses derniers mots sur le capitalisme, la lutte des classes, ou le communisme. Même si, à notre avis, il n'a jamais abandonné le contenu essentiel de ces écrits, il les considérait comme des "premières ébauches" qui devaient être mises au point et auxquelles il fallait donner une base plus solide par d'autres recherches, en lien étroit avec l'expérimentation pratique / théorique réalisée par le mouvement réel du prolétariat.
Bordiga, dans les "Commentaires…" (Page 161) souligne également un passage spécifique des Manuscrits de 1844 qui viendrait prouver leur invariance. Dans ce passage, Marx écrit que "Le mouvement entier de l'histoire est donc, d'une part, l'acte de procréation réel de ce communisme - l'acte de naissance de son existence empirique - et, d'autre part, il est pour sa conscience pensante, le mouvement compris et connu de son devenir" 34
Et Bordiga ajoute que le sujet de cette conscience ne peut pas être le philosophe individuel : il ne peut être que le parti de classe du prolétariat mondial. Mais si, comme le dit Marx, le communisme est le produit de l'ensemble du mouvement de l'histoire, alors il doit avoir commencé à émerger bien avant l'apparition de la classe ouvrière et de ses organisations politiques, de sorte que la source de cette conscience doit être plus ancienne que la conscience elle-même - tout comme, dans la société capitaliste, le communisme est également plus vaste que les organisations politiques de la classe, même si ces dernières sont généralement son expression la plus avancée. En outre, étant donné que le communisme ne peut devenir clair pour lui-même, "compris et connu" que lorsqu'il devient le communisme prolétarien, c'est assurément une preuve supplémentaire que le communisme et la conscience communiste sont quelque chose qui évolue, qui n'est pas statique, mais est un processus en devenir - et donc ne peut pas être invariant.
Individu et espèce
La critique de l'individualisme a une longue histoire dans le marxisme, qui remonte aux critiques de Hegel par Marx, et en particulier à leur assaut contre Max Stirner ; et en argumentant contre le point de vue philosophique du penseur isolé, Bordiga est sur un terrain solide, citant la remarque tranchante de L'Idéologie allemande sur Saint Max dont "la philosophie se trouve dans la même relation à l'étude du monde réel que la masturbation à l'amour sexuel". Et comme nous l'avons vu, l'idée que l'ego est dans un certain sens une construction illusoire a aussi une longue histoire. Mais Bordiga va plus loin que cela. Comme nous l'avons également vu, la partie des "Tables immuables …" que nous citions plus haut, où Bordiga prédit que l'humanité communiste sera en mesure d'accéder à une sorte d'espèce ou de conscience cosmique, est intitulée "À bas la personnalité, c'est la clé". C'est comme si Bordiga voulait que l'être humain soit fondu dans l'espèce plutôt que réalisé à travers elle.
L'expérience d'un état de conscience qui va au-delà de l'ego a tendance à être une expérience de pointe plutôt qu'un état permanent, mais en tout cas, elle ne supprime pas nécessairement la personnalité. On pourrait dire que, dans l'avenir, cette forme de la personnalité en tant que masque, en tant que sorte de propriété privée, de face extérieure à l'illusion d'un moi absolu sera peut-être transcendée. Mais la nature elle-même a besoin de diversité pour pouvoir aller de l'avant, ce qui n'est pas moins vrai pour la société humaine. Même les bouddhistes ne prétendent pas que l'illumination fait disparaître l'individu. Il y a une histoire zen qui raconte comment un étudiant, approchant son professeur après avoir entendu que ce dernier avait atteint le "satori", le flash de l'éclair d'illumination, demande au maître "comment vous sentez-vous d'être illuminé ?" Ce à quoi maître répond" : "aussi misérable que d'habitude."
Et dans la même partie des "Tables immuables …", Bordiga cite la "splendide expression" des Manuscrits de 1844 qui dit que l'humanité est un être qui souffre, et que s'il ne souffre pas, il ne peut pas connaître la joie. Cet être charnel, mortel, être humain individu existera toujours dans le communisme, qui, pour Marx est "la seule société dans laquelle le développement original et libre des individus n'est pas un vain mot cesse d'être une simple phrase" (Idéologie allemande, "Le communisme comme tâche humaine". Ed La pléiade, p. 1321)
Ce sont bien sûr des questions pour l'avenir lointain. Mais les soupçons de Bordiga sur la personnalité individuelle ont des implications beaucoup plus immédiates sur la question de l'organisation révolutionnaire.
Nous savons que Bordiga a fait une critique acerbe du fétichisme bourgeois de la démocratie, parce que cette dernière est basée sur la notion fausse du citoyen isolé et sur le fondement réel d'une société atomisée par l'échange des marchandises. Les idées qu'il a développées dans le principe démocratique et ailleurs nous permettent de mettre en lumière la vacuité fondamentale des structures les plus démocratiques de l'ordre capitaliste. Mais il arrive un moment dans la pensée de Bordiga où il perd de vue ce qui était authentiquement "progressiste" dans la victoire de l'échange des marchandises sur toutes les formes plus anciennes de la société : la possibilité de critique, la pensée individuelle sans laquelle la "science positive" - que Bordiga revendique encore comme étant le point de vue du prolétariat - n'auraient pas vu le jour. Appliquée à la conception de Bordiga du parti, cette manière de penser conduit à la notion d'organisation "monolithique", "anonyme" et même "totalitaire" - termes qui ont tous été utilisés et approuvés dans les canons bordiguistes. Elle conduit à théoriser la négation de la pensée individuelle et donc des divergences internes et des débats. Et comme avec tous les régimes totalitaires, il y a toujours au moins une personne qui devient tout sauf anonyme - qui devient l'objet d'un culte de la personnalité. Et ceci est précisément ce qui a été justifié dans le Parti communiste Internationaliste dans la période d'après-guerre par ceux qui ont vu dans Bordiga le "leader brillant", le génie qui pourrait trouver des réponses à tous les problèmes théoriques posés à l'organisation (même quand il n'était pas membre du parti). C'est cette façon aberrante de penser qui est attaquée dans l'article de la GCF "Contre la conception du chef génial" 35
La contribution de Bordiga
Nous avons parfois critiqué l'idée de Bordiga qu'un révolutionnaire est quelqu'un pour qui la révolution est déjà arrivée. Dans la mesure où elle implique l'inévitabilité du communisme, ces critiques sont valables. Mais il y a aussi quelque chose de vrai dans l'affirmation de Bordiga. Les communistes sont ceux qui représentent l'avenir dans le présent, comme le pose le Manifeste communiste, et en ce sens ils mesurent le présent - et le passé - à la lumière de la possibilité du communisme. "La passion pour le communisme" de Bordiga - son insistance sur la démonstration de la supériorité du communisme sur tout ce que la société de classe et le capitalisme avait engendré - lui a permis de résister aux fausses visions du progrès capitaliste et "socialiste" qui ont été serinées à la classe ouvrière durant les années 1950 et 60 et, peut-être plus important encore, de démontrer dans la pratique que le marxisme n'est en fait pas un dogme invariant, mais une théorie vivante, car il n'y a aucun doute que les contributions de Bordiga sur le communisme enrichissent notre compréhension de celui-ci.
Plus tôt dans cet article nous nous sommes référés à la nécrologie de Damen de 1970, qui visait à évaluer la contribution politique globale de Bordiga. Damen commence par la liste de toutes les choses "que nous devons à Bordiga", par-dessus tout l'immense contribution qu'il a faite dans sa période "classique" sur la théorie de l'abstentionnisme et la relation entre le parti et la classe. Mais, comme nous l'avons vu, c'est à juste titre qu'il n'épargne aucune critique à Bordiga concernant son retrait de l'activité politique entre la fin des années 1920 et le début des années 1940, son refus de se prononcer sur tous les drames économiques et politiques qui emplissent cette période. En examinant son retour à la vie politique à la fin de la guerre, Damen est encore cinglant sur les ambiguïtés de Bordiga concernant la nature capitaliste de l'URSS. Il aurait pu aller encore plus loin en montrant comment le refus de Bordiga de reconnaître les acquis de la Fraction a conduit à une claire régression politique sur des questions clés telles que la question nationale, les syndicats et le rôle du parti dans la dictature du prolétariat. Mais ce qui manque dans le texte de Damen est une évaluation de la contribution réelle à notre compréhension du communisme que Bordiga a entreprise dans ses dernières années - une contribution que la gauche communiste doit encore assimiler, notamment parce qu'elle a, par la suite, été reprise par d'autres aux programmes douteux, tels que le courant "communisateur" (dont Camatte a été l'un des pères fondateurs), qui l'ont utilisée pour produire des résultats que Bordiga lui-même aurait certainement désavoués. Mais cela exigera un autre article, et avant cela, nous voulons nous pencher sur les autres "théories de la révolution prolétarienne" qui ont été élaborées dans les années 50, 60 et 70.
C D Ward
1 "Après la Seconde Guerre mondiale: débats sur la manière dont les ouvriers exerceront le pouvoir après la révolution". https://fr.internationalism.org/icconline/201401/8873/apres-seconde-guerre-mondiale-debats-maniere-dont-ouvriers-exerceront-pouvoir [670]
2 Revue internationale n° 147. "Décadence du capitalisme : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme". https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [286]
3 https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1936/00/pannekoek_19360000.htm [671]. Voir aussi l'article référencé dans la note 1.
4 À Ustica, il a rencontré Gramsci qui avait joué un rôle central pour imposer la ligne de l'IC dans le parti italien en écartant Bordiga du leadership. À ce moment, Gramsci était déjà malade et, en dépit de leurs divergences considérables, Bordiga n'a pas hésité à prendre la défense de ses besoins de base et de travailler avec lui à la formation d'un cercle éducatif marxiste.
5 Cette plateforme a été récemment republiée en anglais sous forme d'une brochure de la Tendance Communiste Internationaliste. https://www.leftcom.org/en/adverts/2011-11-01/the-platform-of-the-committee-of-intesa-of-1925-is-now-available-once-again [672]
6 Les problèmes pratiques auxquels Bordiga a été confronté au cours de cette période étaient incontestablement considérables : il était suivi par deux agents de police partout où il allait. Néanmoins, il y a eu un aspect volontaire dans la démarche d'isolement de Bordiga vis-à-vis de ses camarades et de Damen. Une sorte de nécrologie, écrite peu après la mort de Bordiga en 1970, est très critique concernant son comportement politique : "Son comportement politique, son refus constant de prendre une attitude politiquement responsable, doivent être pris en compte au regard de ce climat particulier. Ainsi, de nombreux événements politiques, dont certains d'une grande importance historique, comme le conflit Trotsky-Staline et le stalinisme lui-même ont été dédaigneusement ignorés et sont restés sans réaction de sa part. Il en allait de même concernant notre Fraction à l'étranger, en France et en Belgique, concernant l'idéologie et la politique du parti de Livourne, la Seconde Guerre mondiale et, enfin, l'alignement de l'URSS avec le front impérialiste. Pas un mot, pas une ligne de la part de Bordiga ne sont apparus tout au long de cette période historique qui était d'une dimension plus vaste et complexe que la Première Guerre mondiale". https://www.leftcom.org/en/articles/2011-01-21/amadeo-bordiga-beyond-the-myth-and-the-rhetoric-0 [673]. (Traduit par nous). Une étude des "années d'obscurité" de Bordiga a été publiée en italien par Arturo Peregalli et Sandro Saggioro, intitulée Amadeo Bordiga. - La sconfitta e gli anni Oscuri (1926-1945). Edizioni Colibri, Milan, Novembre 1998.
7 Lire à ce propos deux articles de la Revue internationale, respectivement les numéros 36 et 90,"Le deuxième congrès du parti communiste internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948)" ; https://fr.internationalism.org/rinte36/pci.htm [251] et "Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, I - La fraction italienne et la gauche communiste de France" ; https://fr.internationalism.org/rinte90/bipr.htm [674].
8 Voir l'article suivant de la Revue internationale n° 36, Le deuxième congrès du parti communiste internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948). https://fr.internationalism.org/rinte36/pci.htm [251]
9 Voir en particulier dans la Revue internationale n° 127, l'article "Les années 1930 : le débat sur la période de transition". https://fr.internationalism.org/rint127/communisme_periode_de_transition.html [176]
10 La Gauche communiste d'Italie. Chapitre "Le Partito Comunista Internazionalista d'Italie". P 220. Ces aperçus sur les dangers potentiels émanant de l'État "prolétarien" semblent avoir été perdus, à en juger par la surprise exprimée par le délégué du PCInt / Battaglia Comunista, lors du deuxième congrès du CCI, après avoir pris connaissance d'une proposition de résolution sur l'État de la période de transition qui était basée sur les acquis de la Fraction et de la GCF. Cette résolution a finalement été adoptée lors du Troisième Congrès: https://fr.internationalism.org/rint11/periode_de_transition.htm [269]. Voir aussi la Revue internationale n° 47, "La période de transition : polémique avec le PCInt Battaglia Comunista". https://fr.internationalism.org/rinte47/polem.htm [675].
11 Dans sa préface à Russie et Révolution dans la Théorie Marxiste (Éditions Spartacus 1975), Jacques Camatte montre que le Bordiga des années révolutionnaires après la Première Guerre mondiale ne défendait pas la notion d'invariance, se référant notamment pour cela au premier article de la collection, "Les leçons de l'histoire récente", qui fait valoir que le mouvement réel du prolétariat peut enrichir la théorie, et qui critique ouvertement certaines des idées de Marx sur la démocratie et quelques-unes des prescriptions tactiques du Manifeste communiste : "le système du communisme critique doit naturellement être compris en liaison avec l'intégration de l'expérience historique postérieure au Manifeste et à Marx, et, s'il le faut, dans un sens opposé à certaines comportements tactiques de Marx et d'Engels qui se sont révélés être erronés". (p. 71)
12 Lire dans la Revue Internationale n°147, "Décadence du capitalisme : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme". https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom... [286].
13 Lire l'article : "Après la Seconde Guerre mondiale: débats sur la manière dont les ouvriers exerceront le pouvoir après la révolution". https://fr.internationalism.org/icconline/201401/8873/apres-seconde-guer... [670].
14 Comme souligné dans un récent article de C Derrick Varn sur le blog Symptomatic Commentary, "The brain of society: notes on Bordiga, organic centralism, and the limitations of the party form" (), Bordiga semblait réticent à abandonner la notion de parti non seulement se maintenant durant la phase la phase supérieure du communisme mais également y agissant comme l'incarnation du cerveau social. https://symptomaticcommentary.wordpress.com/2014/08/19/the-brain-of-society-notes-on-bordiga-organic-centralism-and-the-limitations-of-the-party-form/ [676].
15 Amadeo Bordiga. 1965. "Considérations sur l'activité organique du parti lorsque la situation générale est historiquement défavorable". https://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/consid%C3%A9rati... [677]
16 Voir en particulier dans la Revue internationale n° 70, " Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle. L'aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation ". https://fr.internationalism.org/rinte70/communisme.htm [678] ; dans la Revue internationale n° 75 "L'étude du Capital et des fondements du communisme".
17 Intitulé, "À Janitzio, ils n'ont pas peur de la mort."
18 Voir également un article précédent de la Revue internationale n° 81 dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle. Marx de la maturité : communisme du passe, communisme de l'avenir". https://fr.internationalism.org/rinte81/comm.htm [679].
19 Une exposition assez claire de la conception de Bordiga du socialisme peut être trouvée dans un article d'Adam Buick du Parti socialiste de Grande-Bretagne qui, malgré ses nombreux défauts, a toujours très bien compris que le socialisme signifie l'abolition du travail salarié et de l'argent. https://libcom.org/library/bordigism-adam-buick [680]
20 Voir dans la Revue internationale n° 111, dans la série "Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire", l'article "Trotski et la "culture prolétarienne"".
21 Voir dans la série "Le communisme une nécessité matérielle", l'article de la Revue internationale n° 71, "Le communisme : véritable commencement de la société humaine" ; https://fr.internationalism.org/rinte71/communisme.htm [681].
22 Lire dans la Revue internationale n° 150, "Le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la culture [386]" et dans la Revue internationale n° 151, l'article "le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la solidarité" ; https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201304/6967/a-propos-du-livre-communisme-primitif-nest-plus-ce-quil-etait-ii-co [682].
23 Revue internationale n° 71. https://fr.internationalism.org/rinte71/communisme.htm; [683]
24 Manuscrits économiques et politiques de 1844. "Propriété privée et communisme". 3. https://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/manuscrits_1844/Manuscri... [684]
25 Freud, New Introductory Lectures, London 1973, p 117. Notre traduction.
26 Erich Fromm, Bouddhisme Zen et psychanalyse, 1960, chapitre "Dé-refoulement et illumination". Éditions Quadrige / PUF. Fromm, un descendant de l'école de Francfort qui a également beaucoup écrit sur les premiers écrits de Marx, considère aussi que le véritable but de la psychanalyse (qui ne pourrait être atteint à grande échelle que dans une "société saine"), n'est pas seulement de soulager les symptômes névrotiques ou de subordonner les instincts au contrôle intellectuel, mais de rendre l'inconscient conscient et d'accéder ainsi à la vie non réprimée. Il définit ainsi la méthode de la psychanalyse par rapport à cet objectif : "elle examine le développement psychique d'un individu depuis son enfance et s'efforce de faire revivre en lui les premières afin de l'aider à expérimenter ce qui est, pour le moment, maintenant refoulé. Elle procède en découvrant pas à pas les illusions sur le monde qui habitent l'individu, pour diminuer les distorsions parataxiques et les intellectualisations aliénantes. L'individu qui suit ce processus, en devenant de moins en moins un étranger à lui-même, devient moins de moins en moins étranger au monde ; puisqu'il est entré en contact avec son univers intérieur, il est entré en contact avec l'univers extérieur. La fausse conscience disparaît, et avec elle la polarité conscient-inconscient" (Chapitre "Dé-refoulement et illumination". Ailleurs (un peu avant le passage cité), il compare cette méthode avec celle du Zen, qui utilise différents moyens, mais aussi passe par une série de petites réalisations ou "satoris" vers un niveau qualitativement plus élevé d'être dans le monde.
27 Voir la collection Murdering the Dead : Amadeo Bordiga sur le capitalisme et d'autres catastrophes, Antagonisme Press, Revue 2001. Voir aussi notre article sur les inondations en Grande-Bretagne qui se penche sur la notion de Bordiga du rôle de la destruction dans l'accumulation capitaliste: http: //en.internationalism. org / Révolution Inte / 201403/9567 / inondation-forme-choses-vient
28 Espèce Humaine et Croûte Terrestre, Petite Bibliothèque Payot, p168
29 Le programme révolutionnaire immédiat. https://www.sinistra.net/lib/upt/prolac/muue/muueapebuf.html [685].
31 Revue internationale n°°14. "Une caricature de parti : le parti bordiguiste". https://fr.internationalism.org/rinte14/pci.htm [687].
32 "L'invariance historique du Marxisme". https://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qioe/qioennobef.html [688].
33 Idem.
34 Manuscrits économiques et politiques de 1844. Propriété privée et communisme. 1.
35 Lire dans la Revue internationale n° 33, l'article "Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - La conception du chef génial" ; https://fr.internationalism.org/rint33/Internationalisme_chef_genial.htm [594]
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [434]
Personnages:
- Amadeo Bordiga [689]
- Onorato Damen [690]
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [691]
- Bordiguisme [692]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [693]
Rubrique:
Revue Internationale n°159
- 824 lectures
Présentation de la Revue internationale n° 159
- 545 lectures
Ce numéro de la Revue internationale rassemble quatre documents qui expriment nos préoccupations actuelles concernant la situation mondiale et notre rôle en son sein en tant que révolutionnaires.
Pour commencer, une nouvelle prise de position sur la Catalogne. Elle n'est pas la première de notre part sur les évènements récents comme les lecteurs de nos publications, surtout sur notre site web, l'auront remarqué. En octobre 2017, nous avons distribué un tract "Confrontations en Catalogne: la démocratie et la Nation sont le passé réactionnaire, le prolétariat est l'avenir [695]", traduit en différentes langues. Un certain nombre d'autres articles ont paru, notamment sur notre page en langue espagnole, mais ces événements devront être suivis de près dans la période à venir et cette prise de position ne sera certainement pas la dernière.
Le mouvement indépendantiste en Catalogne est en contradiction directe avec la gestion "rationnelle" de l'État capitaliste et de l'économie au niveau de la Catalogne, de l'Espagne et de l'Union européenne. Les seuls dans les rangs de la bourgeoisie mondiale qui pourraient bénéficier d'un nouvel approfondissement de ce processus seraient des Poutine, rivaux d'une UE forte dans la compétition inter impérialiste mondiale. Mais l'aspect qui doit nous préoccuper le plus, c'est l'impact de ces événements sur le prolétariat. La fièvre nationaliste autour de "l'indépendance" de la Catalogne est un coup dur contre la classe ouvrière non seulement de cette région, mais aussi sur le plan international, étant donné l'importance mondiale de la lutte des classes en Espagne.
Nous voyons que beaucoup de ceux qui ont participé à la révolte des Indignados en 2011 -un mouvement qui s'est orienté vers l'internationalisme, vers les principes prolétariens– abandonnent aujourd'hui toute idée de lutte contre le capitalisme et se joignent aux manifestations en faveur ou contre l'indépendance. Les familles prolétariennes sont déchirées entre ceux qui soutiennent Puigdemont ou d'autres fractions de la cause catalane et ceux qui, soutenant les "Españolistas", pensent que l'Espagne doit rester un seul pays. Et où sont les internationalistes? Ils sont actuellement une minorité assiégée, mais il est plus que jamais nécessaire qu'ils parlent haut et fort.
Le deuxième article porte sur la vie de la bourgeoisie de la puissance économique et militaire la plus puissante, les États-Unis, qui se trouvent au cœur du désordre mondial grandissant. L'analyse qu'il développe fait partie d'une analyse de la classe dirigeante dans les principaux pays occidentaux. L'article souligne les grandes difficultés de la classe dirigeante aux Etats-Unis après presque un an de présidence Trump. Un chapitre important de cet article est consacré aux relations entre les deux anciens leaders de bloc et au rôle que la Russie joue aujourd'hui dans les options stratégiques américaines. Ces analyses doivent être considérées comme une continuation de l'orientation décidée lors du 21ème congrès international en 2015 d'analyser de manière critique la situation internationale, sans exclure une réflexion autocritique sur les erreurs que nous avons pu commettre à ce niveau dans le passé (cf. dans la Revue Internationale 156 : "40 ans après la fondation du CCI, quel bilan et quelles perspectives pour notre activité ? [696]").
Le troisième texte de la présente revue est notre "Manifeste sur la révolution d'Octobre 1917 en Russie", un siècle après la première révolution prolétarienne réussie. Nous l'avons publié en ligne en octobre et nous avons organisé une série de réunions publiques sur ce sujet. Tout d'abord, nous devons défendre le caractère internationaliste de la révolution d'Octobre appartenant à un mouvement de classe mondiale contre le capitalisme. Sans ce point de référence, et sans un examen courageux de toutes les erreurs commises et des faiblesses rencontrées, une nouvelle tentative ne pourra pas être victorieuse à l'avenir. La révolution russe fait partie de notre histoire, de l'histoire du prolétariat, malgré sa dégénérescence et les atrocités commises en son nom par la suite. Le Manifeste ne répond pas seulement aux campagnes bourgeoises actuelles, mais tire aussi les leçons et essaie de donner des indications pour la perspective du communisme d'aujourd'hui. Bien que la révolution ne se soit pas propagée au monde entier et que le processus soit resté isolé et donc sans perspective réelle de vaincre le capitalisme, "l’insurrection d’Octobre est encore à ce jour le point le plus élevé atteint par la lutte de classe prolétarienne – une expression de sa capacité à s'organiser à grande échelle, consciente de ses objectifs, confiante dans son rôle de prise en main de la vie sociale. C'était l’anticipation de ce que Marx appelait "la fin de la préhistoire", de toutes les conditions dans lesquelles l’humanité est à la merci de forces sociales inconscientes ; l’anticipation d’un futur dans lequel, pour la première fois, l’humanité fera sa propre histoire selon ses propres besoins et ses propres desseins".
Le dernier texte de cette revue est la "Résolution sur la lutte de classes internationale", un document du dernier congrès international du CCI au printemps 2017.
Avec cette analyse globale de la situation, nous commençons à rendre compte des résultats de notre congrès, qui a traditionnellement pour tâche fondamentale de décider des orientations générales de nos activités pour la période à venir. L'analyse de la situation mondiale en est un élément crucial.
La résolution est centrée sur la situation sociale, le rapport de forces entre les deux principales classes de la société capitaliste actuelle - la bourgeoisie et le prolétariat. Près de trois décennies après l'effondrement de l'ancien système des blocs et le début de ce que nous appelons la période de décomposition du capitalisme, nous essayons toujours de mieux comprendre les défis auxquels les révolutionnaires sont confrontés aujourd'hui, d'affiner nos concepts du cours historique et de la décomposition : "Les mouvements de classe qui ont surgi dans les pays avancés après 1968 marquaient la fin de la contre-révolution, et la résistance maintenue de la classe ouvrière constituait un obstacle à la "solution" de la bourgeoisie à la crise économique : la guerre mondiale. Il était possible de définir cette période comme un "cours à des affrontements de classe massifs", et d’insister sur le fait qu’un cours à la guerre ne pouvait s’ouvrir sans une défaite directe d’une classe ouvrière insurgée. Dans la nouvelle phase, la désintégration des deux blocs impérialistes a éliminé la guerre mondiale de l’ordre du jour indépendamment du niveau de la lutte de classe. Mais cela signifiait que la question du cours historique ne pourrait plus être posée dans les mêmes termes. L’incapacité du capitalisme à dépasser ses contradictions signifie toujours qu’il ne peut offrir à l’humanité qu’un futur de barbarie, dont on peut déjà préfigurer les contours dans une combinaison infernale de guerres locales et régionales, de désastres écologiques, de pogromes et de violence sociale fratricide. Mais à la différence de la guerre mondiale, qui requiert une défaite physique directe tout autant qu’idéologique de la classe ouvrière, cette "nouvelle" descente dans la barbarie opère de manière plus lente, plus insidieuse, qui peut embrigader graduellement la classe ouvrière et la rendre incapable de se reconstituer en tant que classe. Le critère pour évaluer l’évolution du rapport de force entre les classes ne peut plus être celui d’empêcher la guerre mondiale, et est devenu en général, plus difficile à prévoir."(Résolution point 11)
De quels critères avons-nous besoin aujourd'hui pour évaluer correctement l'équilibre des forces de classe ?
- La capacité de la classe ouvrière à résister à la politique d'austérité de la bourgeoisie et le degré de solidarité développé dans ses rangs sont indubitablement des facteurs pertinents pour une telle évaluation.
- Mais il y a aussi la question des perspectives. Si le prolétariat n'est pas capable de se percevoir comme une classe distincte et de développer une perspective allant au-delà de la société existante qui nous soumet à la logique aliénée du profit pour le profit, il n'y a pas d'avenir à rechercher - et cet état d'esprit affecte la capacité de résistance du prolétariat. "Après 1989, avec l'effondrement des régimes "socialistes", un facteur qualitatif nouveau a surgi : l'impression de l'impossibilité d'une société moderne non basée sur des principes capitalistes. Dans ces circonstances, il est bien plus difficile pour le prolétariat de développer, non seulement sa conscience et son identité de classe, mais aussi ses luttes économiques défensives, dans la mesure où la logique des besoins de l'économie capitaliste pèse beaucoup plus si elle semble n'avoir aucune alternative." (Point 13)
- Plus précisément, la résolution souligne les effets pernicieux de la perte de solidarité dans les rangs du prolétariat : "Plus particulièrement, nous voyons la montée du phénomène de bouc-émissarisation, une façon de penser qui accuse les personnes – sur lesquelles on projette tout le mal du monde – de tout ce qui va mal dans la société. De telles idées ouvrent la porte au pogrom. Aujourd’hui, le populisme est la manifestation la plus frappante, mais loin d’être la seule, de ce problème, qui tend à imprégner tous les rapports sociaux. Au travail et dans la vie quotidienne de la classe ouvrière, de façon croissante, il affaiblit la coopération, renforce l'atomisation et le développement de la méfiance mutuelle et du mobbing." (Point 20)
Nous ne pensons pas que le point de non-retour a été franchi, que la classe ouvrière dans les centres de l'essor historique du capitalisme mondial, et avec elle la masse gigantesque du prolétariat en Chine, ont été vaincues. Nous voyons encore dans cette situation qu’il existe un potentiel pour le développement de ce que nous appelons la dimension politico-morale de la lutte prolétarienne : "l'émergence d'un rejet profond du mode de vie existant de la part de secteurs plus larges de la classe." (Point 24)
Cette situation difficile a également une conséquence sur nos tâches en tant que minorité de la classe. Les minorités révolutionnaires sont un produit de la classe et ont un rôle spécifique - à l'heure actuelle, elles constituent un pont organisationnel entre les luttes révolutionnaires du passé et celles de l'avenir, même si, entre les deux, la distance est énorme.
Novembre 2017
Catalogne, Espagne - Les prolétaires n'ont pas de patrie !
- 948 lectures
La Catalogne, Barcelone en particulier, est un de ces lieux inscrits dans la mémoire du prolétariat espagnol et mondial. Les luttes, les victoires et les défaites de la classe ouvrière dans ce territoire ont marqué l’histoire de notre classe. Aussi, dans la situation présente, le CCI, par cet article et d’autres qui l’ont précédé dans notre presse territoriale, veut alerter notre classe face au danger d’être entrainée peu ou prou par la bagarre nationaliste qui s’y déroule. Elle n’en sortirait pas indemne.
De l’espoir du Mouvement des Indignés en 2011…
C’est au même endroit et avec à peine quelques années de distance, qu’on a pu assister à deux scénarios sociaux non seulement différents mais complètement opposés.
Barcelone, quelques jours après le 15 mai 2011 : lors du mouvement des Indignés, la Place de Catalogne est une ruche de réunions et d'assemblées ; il y a plus de 40 commissions qui abordent des questions qui vont de la catastrophe environnementale à la solidarité avec les luttes en Grèce contre les coupes sociales. Il n’y a pas un seul drapeau. Par contre, il y a partout des bibliothèques improvisées avec des livres apportés par des anonymes et à la disposition de tous, pour élargir la vision du mouvement, et partout sont présentes l'indignation et la profonde inquiétude face au sombre avenir que la survie de ce système entraîne pour l'humanité tout entière. Ces mêmes places, à Barcelone ou ailleurs en Espagne, dans le sillage du mouvement initié à la Puerta del Sol de Madrid, voient des gens de tout âge, de toutes langues, de toutes conditions, se réunir et débattre, avec du respect et un sens de l'écoute. Vers les assemblées convergent, jour après jour, des manifestations ouvrières, des manifestations contre les coupes budgétaires dans les soins de santé, des délégations des quartiers cherchant la solidarité des personnes présentes pour essayer d'arrêter l’énième expulsion, etc. Les assemblées agissent comme un cerveau collectif qui essaie de relier les différentes expressions de la lutte à la recherche d'une cause commune unificatrice. "Nous sommes antisystème parce que ce système est inhumain", voilà ce qui est fièrement proclamé. Mais le mouvement subit une répression impitoyable[1], on dénonce cette violence mais aussi "celle d’un salaire mensuel de 600 euros".
…à l’arriération et l'hystérie nationaliste en 2017
Et voilà que dans ces mêmes rues, aujourd'hui à Barcelone et dans la région, des centaines de milliers de personnes manifestent "pour l'indépendance de la Catalogne". Mais ces manifestations-là sont instrumentalisées, elles ne peuvent constituer qu’une masse de manœuvre qui obéit à des actions convoquées par de sombres "cerveaux de l'ombre", pour des actions qui ont un sens incompréhensible pour les figurants d'une pièce écrite par d'autres. C'est ce qui est arrivé à ceux qui ont reçu les coups de matraques de la police, en défendant les urnes lors du référendum du 1er octobre, qui ont vu comment, dans les jours qui ont suivi la tenue du référendum, ses propres organisateurs ayant après-coup relativisé la tenue même de la consultation en la réduisant à un acte purement "symbolique". Ou ceux qui se sont laissés emporter par l'euphorie du "Nous sommes déjà une République" après la pantomime de proclamation de ladite République catalane le 27 octobre. Il s’agissait, comme les dirigeants indépendantistes l'ont affirmé par la suite, d’un acte virtuel, et "symbolique". À l’extrême opposé du mouvement du 15 Mai en 2011, pour se joindre à de tels actes nationalistes, l’esprit critique est évidemment de trop. Il suffit d’avoir en tête un "discours national" bien mitonné. Ceci est le propre de tout nationalisme, mais dans le cas de la Catalogne et d’autres contrées "sans État", ce discours est un pataquès où tout est mélangé dans des esprits conditionnés pour qu’aucune critique ne puisse se faire jour. Ainsi on se revendique d’une Arcadie mythifiée, une patrie catalane qui n’a jamais existé. Dans ce processus, un ennemi est nécessaire et ce ne peut-être que l’Etat central et ses vestiges soi-disant "fascistes". Et un bouc-émissaire : les "Espagnols" en général et tout ce qui y ressemble, qui seraient la cause de toutes les souffrances de cette société; et ainsi on est prêt à répondre au quart de tour aux appels faits par les réseaux sociaux pour marcher, tête baissée et yeux fermés, aux côtés des exploiteurs catalans, des Catalans corrompus, des corps de répression de la police catalane, des "ultras catalanistes" qui passent leur temps à pointer du doigt et à intimider les "autres" (dans le cas présent, ceux qui se montrent tièdes vis-à-vis d’un "anti-espagnolisme" obligatoirement viscéral). Et c'est ce même mode opératoire ignoble qui est suivi par d’autres manifestants qui, dans les jours qui suivent, défilent dans ces mêmes rues, à leur tour "contre l'indépendance de la Catalogne". Cette fois, le paradis perdu usurpé est celui de la "coexistence pacifique de tous les Espagnols". Cette fois-ci, les boucs émissaires coupables de la misère ou de l'incertitude sur l'avenir sont "ceux qui enfreignent la loi" ou "ceux qui veulent briser l'Espagne". Et voilà ces manifestants qui marchent aussi coude à coude avec une cohorte similaire d'exploiteurs, de corrompus et d’organes répressifs, avec aussi leurs "ultras espagnolistes", dans une logique de persécution et d'intimidation violente plus ou moins ouverte contre les autres[2].
Deux options opposées et antagoniques pour l'avenir de la société
Entre le mouvement des Indignés de 2011 et les récentes orgies patriotardes catalanes ou espagnoles, il y a une frontière de classe et un gouffre dans les perspectives. Le premier, malgré ses énormes difficultés indéniables, était l’expression d’une classe - le prolétariat - qui porte avec elle le projet d’une transformation sociale à l'échelle planétaire, en quête d'une explication cohérente des origines des problèmes qui affectent le monde entier, créant la base pour une véritable unification de toute l'humanité et en surmontant ainsi les divisions de classe, de race, de culture, etc. C'était donc un mouvement fondé sur la recherche d'une solution révolutionnaire pour l'avenir de la société, libérant l'humanité des chaînes de l'exploitation. Les orgies patriotardes, par contre, sont basées sur des réminiscences, des atavismes, de tout un passé mythifié et mystificateur. Non seulement cela, mais elles justifient et approfondissent la division et le rabaissement de frères de classe en nationalistes des deux bords. Leur perspective n'est pas celle d'une avancée révolutionnaire, mais d'un recul réactionnaire dans un passé clos, plein de méfiance et de peur. Le facteur qui les nourrit n'est pas la recherche d'une nouvelle organisation sociale fondée sur la satisfaction des besoins de tous, mais la décomposition du vieil ordre social qui règne sur la base du "chacun pour soi".
Comment en est-on arrivés là ?
Les uns et les autres donnent des explications circonstancielles et locales. Selon les nationalistes catalans, on assisterait à une résurgence des vestiges franquistes qui ont perduré en Espagne après la transition démocratique. Selon les nationalistes espagnols, la dérive indépendantiste serait une sorte de fuite en avant pour cacher les turpitudes d'un régime de corruption mis en place dans les administrations catalanes depuis des décennies. Le principal démenti de ces balivernes justificatives est le comportement même des acteurs de ce processus. Pendant des décennies, le principal parti de la Généralité (l'administration autonome catalane), anciennement connue sous le nom de CiU et aujourd'hui PDeCat[3], a fondé son hégémonie sur un régime clientéliste et corrompu. Mais cela n’a pas empêché les gouvernements espagnols successifs, de gauche comme de droite, de payer le soutien de ce parti au gouvernement central au moyen d'une juteuse compensation à la charge du budget de l'État. Et de leur côté, les nationalistes catalans n'ont jamais fait la fine bouche avec ces "résidus du franquisme" de l'État espagnol dont ils parlent, en passant des accords avec le PP[4], puis avec Zapatero[5] (les gouvernements tripartites d'ERC et d'Iniciativa[6] - qui sont maintenant des soutiens communs de la maire de Barcelone). Lorsque le PdeCat est retourné à la tête de la Généralité en 2010, le nouveau président, Artur Mas[7], n'a pas hésité à compter sur le PP pour mener un programme d'austérité implacable contre les conditions de vie de la population qui inspirera plus tard Mariano Rajoy[8] lui-même.
Les causes historiques
C'est pourquoi nous pouvons dire que l'explication de la dérive séparatiste en Catalogne ne trouve pas ses origines dans des facteurs de l'évolution historique spécifique de la Catalogne ou de l'Espagne, mais dans les conditions historiques mondiales, dans l'entrée de l'ensemble du capitalisme mondial dans sa phase finale de décomposition sociale.
Le marxisme n’a jamais nié l'existence des facteurs particuliers dans l'évolution du capitalisme dans chaque pays. En particulier, dans le cas des séparatismes en Espagne, se dressant comme une barrière réactionnaire supplémentaire face à la nécessité du prolétariat de se voir comme une classe indivisible, il a reconnu le poids d'un développement déséquilibré entre les zones plus ouvertes au commerce et à l'industrie, et les autres plus enfermées dans l'isolement et incapables de rattraper leur retard[9]. Mais le marxisme explique aussi que ces conflits locaux et ces contradictions évoluent en étant conditionnés par le cours du capitalisme à l'échelle mondiale. Cela est particulièrement évident dans le cas du nationalisme. Si, aux XVIIIe et XIXe siècles, la formation de certaines nouvelles nations pouvait représenter une avancée décisive pour la démolition des structures féodales et le développement de forces productives, une fois que le capitalisme a atteint la fin de son stade ascendant au début du XXe siècle, la "libération nationale" devient un mythe nettement réactionnaire, désormais au service de l'encadrement de la population et de la classe révolutionnaire en particulier, pour et dans la guerre impérialiste[10]. C'est pourquoi les vrais révolutionnaires ont toujours dénoncé le caractère anti-prolétarien des séparatismes en Espagne, comme défenseurs outranciers de l'exploitation et ennemis déclarés de la classe ouvrière, ainsi que le prolétariat de Catalogne, l'un des plus anciens du mouvement ouvrier mondial, a pu le constater à maintes reprises.
L'histoire du prolétariat en Catalogne aux prises avec le nationalisme
Ce n'est pas un hasard si Barcelone a été le théâtre de la première grève générale sur le territoire espagnol en 1855. C’est un produit de l’industrialisation précoce de la Catalogne. Pas de hasard, non plus, si cette ville fut le siège du Congrès des Travailleurs de la Région Espagnole, qui en 1870 constitua la base de la Première Internationale en Espagne[11]. Ce n'est pas une simple coïncidence si, contre les manifestations les plus avancées de la lutte des classes, comme la grève de "La Canadiense" à Barcelone en 1919, la bourgeoisie catalane a déployé, en 1920-1922, le pistolerisme patronal contre les grèves et les militants d'organisations anarcho-syndicalistes[12]. Ce n'est pas un hasard si, pour cette raison, le nationalisme catalan (sous la direction de Francisco Cambó), avec les secteurs les plus arriérés de l'armée espagnole, a été le principal promoteur de la dictature de Primo de Rivera (1923-1930). Ce n'est pas non plus par hasard si c’est la Généralité catalane (Companys avec le soutien des staliniens, et la complicité de la CNT elle-même) qui est devenue un bastion de l'État républicain espagnol poussant – par la mystification et la force des armes - les ouvriers à abandonner la lutte de classe, contre l'exploitation, et à rejoindre les front militaires de la guerre entre le camp fasciste et le camp démocratique, aussi bourgeois l'un que l'autre, et préfigurant ainsi les camps de la Deuxième boucherie impérialiste mondiale. Il n'est pas fortuit que la Généralité catalane ait été chargée de la mission criminelle de détruire par le sang et le feu la tentative du prolétariat de Barcelone en mai 1937, la dernière tentative du prolétariat de combattre sur son propre terrain de classe contre les exploiteurs de tous les camps et de toutes les patries[13], avant d'être enfermé dans la confrontation inter-impérialiste.
Ce n'est pas non plus un hasard si ce sont les ouvriers de Catalogne, arrivés parfois des régions les plus arriérées d’Espagne, qui, dans les années 1970, ont transformé leurs luttes (le Baix Llobregat en 1973, SEAT en 1975) en véritables phares pour la lutte de la classe ouvrière de l’Espagne entière. La classe ouvrière en Catalogne, par son propre développement et son expérience accumulée, est un maillon important de ce caractère associé de la production de toute la richesse sociale que le prolétariat international incarne et qui se heurte à l’appropriation privée et nationale de cette richesse. Dans la région de Barcelone, on trouve des travailleurs de plus de soixante nationalités, des ingénieurs stagiaires américains aux travailleurs immigrés sub-sahariens. Tous font partie intégrante et fondamentale de la même classe ouvrière mondiale, même si l’idéologie capitaliste, surtout à travers ses forces d’extrême-gauche, s’efforce d’insuffler le sentiment d’appartenance "nationale" ou "régionale" dans les rangs du prolétariat pour justement désagréger son unité de la classe.[14]
Quel enjeu pour le prolétariat en Catalogne comme pour le prolétariat mondial ?
Aujourd'hui, c'est tout ce potentiel accumulé au cours des décennies de lutte ouvrière qui est menacé par l'avancée de la décomposition sociale capitaliste. Cela ne veut pas du tout dire qu’on soit déjà dans une situation sociale dans laquelle les ouvriers sont prêts à se soumettre au rôle de chair à canon, dans les querelles entre les différentes bandes de la classe exploiteuse, ce qui correspondrait à un triomphe complet de l'alternative bourgeoise à la crise historique du capitalisme. Ceci est illustré dans la situation actuelle de la Catalogne par le fait que les travailleurs ne suivent pas du tout avec enthousiasme les appels aux grèves générales "pour l'indépendance", mais cela ne veut pas dire, pour autant, que les travailleurs aient la conscience de représenter une alternative pour l'avenir de l'humanité, qui puisse bannir la guerre de tous contre tous que le capitalisme en décomposition porte dans ses entrailles.
Particulièrement déroutantes pour la conscience de la classe ouvrière, les alternatives qui postulent qu'il y aurait une solution "rationnelle" à ces tensions au sein de la classe exploiteuse, alors que l'avancée de la décomposition capitaliste pousse à l'enracinement parmi la population des solutions "populistes" de plus en plus irrationnelles, qui vont de la sortie de l'Union européenne (que proposent, par exemple la CUP ou des secteurs de Podemos[15]), à la soumission totale à l’État espagnol, comme le défendent les partis "constitutionalistes". Le nationalisme et la violence finissent nécessairement par se rencontrer. L'illusion d'une "révolution du sourire", revendiquée par certains partisans du séparatisme catalan, comme le rêve de cette vie "normalisée" présentée comme une alternative par le bloc espagnoliste, sont une pure fiction mystificatrice. Comme nous l'avons déjà souligné dans notre article "Pays de l'Est : la barbarie nationaliste [697]" (Revue internationale n° 62) Pays de l'Est : la barbarie nationaliste: "Toute forme, toute expression de nationalisme, fût-il grand ou petit, porte obligatoirement et fatalement la marque de l'agression, de la guerre, du "tous contre tous", de l'exclusivisme et de la discrimination."
L'alternative du prolétariat mondial est une perspective complètement différente pour l'humanité. Comme nous le soulignions dans cet article sur la barbarie nationaliste : "La lutte du prolétariat a donné lieu au dépassement des divisions de nature nationale, ethnique, religieuse et linguistique, avec lesquelles le capitalisme - poursuivant le travail d'oppression des modes de production antérieurs - a tourmenté l'humanité. Dans le corps commun de la lutte unie pour les intérêts de classe, ces divisions disparaissent de manière naturelle et logique. La base commune, ce sont les conditions d’exploitation qui, partout, ne font qu’empirer avec la crise mondiale, l’intérêt commun est l'affirmation de leurs besoins en tant qu'êtres humains contre les besoins inhumains et de plus en plus despotiques de la marchandise et l'intérêt national."
Ce qui est en jeu aujourd'hui dans la situation du prolétariat mondial en Catalogne, c'est que la classe révolutionnaire mette en avant la défense des intérêts de l'humanité dans son ensemble, mette en avant sa solidarité de classe internationale contre la désagrégation sociale que le capitalisme en décadence favorise.
Face à la recherche d'un refuge dans de fausses identités locales ou régionales, dans la vision d’un futur enchaîné au carcan étriqué du "chacun pour soi" au détriment des autres, du pessimisme social croissant, s’impose, au contraire, la confiance dans les valeurs de l’association ouvrière internationale contre les divisions nationales, la conscience que la barbarie qu’annonce le monde actuel est le résultat de l'inhumanité de la soumission de la planète aux lois capitalistes de la loi de la valeur et de la concurrence. Avant tout, il incombe aux groupes qui revendiquent d’être à l'avant-garde de la classe ouvrière de dénoncer tous les pièges qui divisent notre classe et, surtout, ceux qui tentent de justifier leur soutien à l'une ou l'autre fraction de la classe exploiteuse parce que l’une ou l’autre serait "moins répressive" ou plus favorables aux intérêts de la lutte pour la libération du prolétariat. Si l'alternative révolutionnaire mondiale du prolétariat finalement échouait, la perspective serait celle d'une guerre de tous contre tous, où il sera difficile de distinguer quelle fraction sera la plus cruelle et plus inhumaine en imposant sa propre survie au détriment du reste de la race humaine.
Lorsque la police a essayé de démolir les camps du mouvement du 15 Mai à Barcelone en 2011, un cri s'est élevé :"Nous sommes tous Barcelone". Il a été entendu dans toutes les places et toutes les manifestations, et nulle part plus bruyamment qu'à la Puerta del Sol de Madrid. La recrudescence du nationalisme en Catalogne est un coup porté non seulement contre le prolétariat de Barcelone, mais aussi contre le prolétariat de toute l'Espagne - puisque dans tout le pays, les prolétaires ont été entraînés dans des mobilisations pour ou contre l'unité de l'État espagnol. Ce poison a également touché les nombreux immigrants espagnols qui travaillent actuellement dans d'autres pays européens, où il y a eu de petites mais significatives manifestations autour du même thème. Et ce coup porté au prolétariat espagnol est aussi un coup porté au prolétariat mondial tout entier, précisément à cause de la profondeur des traditions révolutionnaires du prolétariat en Espagne. Comme toujours, la solidarité avec les travailleurs d'Espagne ne peut que résider dans le développement de la lutte internationale des classes.
Valerio, 5 décembre 2017
[1] Le 27 mai 2011, la police catalane chargea brutalement, suivant les ordres du gouvernement nationaliste catalan en lien étroit avec le ministère de l’intérieur espagnol pour essayer de "nettoyer" la place de Catalogne. Il y a eu plus de 100 blessés.
[2] Ce climat de recherche de tous les maux de la société dans l’autre moitié de la population avait déjà été encouragé lors des mobilisations contre les attentats terroristes du 17 aout à Barcelone. Lire dans Acción Proletaria: de septembre 2017 "Atentados terroristas en Cataluña: la barbarie imperialista del capitalismo en descomposición [698]".
[3] Convergence et Union (CiU) était une coalition de la droite catalane qui a gouverné la région depuis la "transition démocratique" (1978) avec quelques intermèdes de gauche. Il y avait deux composantes : l’une plutôt nationaliste et l’autre plutôt autonomiste, mais toutes deux favorables au pacte avec le pouvoir central et surtout solidement unies dans des combines clientélistes qui ont fait de CiU l’un des partis le plus corrompus d’Espagne. La coalition a disparu et les plus nationalistes, aujourd’hui séparatistes, ont fondé le Parti Démocrate Européen de Catalogne (PDECat), avec Puigdemont à sa tête.
[4] Parti Populaire, celui de Rajoy, qui gouverne aujourd’hui en Espagne, un autre champion de la corruption.
[5] Chef du gouvernement espagnol socialiste (2004-2011). Après avoir minimisé la crise économique des années 2008, il mit en place des mesures anti-ouvrières qui ont ouvert la voie à leur approfondissement brutal par le gouvernement de Rajoy.
[6] Le gouvernement catalan (2003-2010) formé par la "gauche" : PS, ERC (Gauche Républicaine de Catalogne) et une coalition, Iniciativa, incluant le parti stalinien et les Verts.
[7] A. Mas a été président de la Généralité entre 2010 et2016. Après avoir fait basculer la droite vers l’indépendantisme, il organisa le premier referendum pour l’indépendance. C’est Carles Puigdemont qui lui a succédé.
[8] Chef de la droite et du gouvernement espagnol. Il a mis en place l’article 155 de la constitution pour prendre directement en charge la Généralité catalane, destituant ses ministres, en emprisonnant certains. Le président Puigdemont s’est réfugié en Belgique.
[9] Cela est à son tour le résultat, comme l’avait clarifié Marx, du caractère exceptionnel des conditions du développement du capitalisme en Espagne qui a eu pendant des siècles tout un monde où investir ses capitaux sans avoir besoin d’engager une modification généralisée de ses structures féodales et une industrialisation dans la "mère patrie". Nous avons résumé l’analyse des séparatismes en Espagne dans un article récent, L’imbroglio catalan montre l’aggravation de la décomposition capitaliste [699].
[10] Lire notre brochure Nation ou classe et aussi notre dénonciation du caractère réactionnaire de la revendication du “droit des peuples à l’autodétermination” dans nos articles “Les révolutionnaires face à la question nationale”, Revue Internationale nº 34 et 42.
[11] Le territoire du Congrès (la "région espagnole" et absolument pas la "nation catalane") est une indication du climat internationaliste qui était mis en avant dans ces premiers pas du mouvement ouvrier, qui voyait dans chaque territoire une région de l’humanité libérée à l’échelle planétaire.
[12] Ce qui fait croître encore plus l’indignation qu’on ressent quand on voit ceux qui se proclament les héritiers de la "Rosa de Foc" ("Rose de feu", le nom que les anarchistes donnaient à la Barcelone des années 1920-30, tant s’y étaient multipliés les incendies sociaux), faire aujourd’hui des courbettes devant ceux qui luttent contre "l’oppression nationale de la Catalogne".
[13] Nous encourageons vivement la lecture de notre brochure avec les textes de la Gauche Communiste sur la guerre d’Espagne : "1936: Franco y la República masacran al proletariado".
[14] La campagne menée actuellement par les formations d’extrême-gauche du capital - les CUP ou Podemos- sur l’identification de l’intérêt social avec l’intérêt national est l’héritière, avec un ton encore plus aberrant si cela est possible, de la campagne déployée dans les années 1970 et 80 par leurs géniteurs staliniens pour subordonner les luttes contre l’exploitation aux consignes de la "Liberté démocratique" ou du "Statut d’Autonomie" pour la Catalogne.
[15] CUP : Candidature d’Unité Populaire : regroupement d’anciens gauchistes de tout poil et d’anarchistes tendance "municipaliste", se disant "anticapitalistes". C’est l’extrême-gauche du nationalisme catalan, soutien critique et "social" des partis nationalistes. Ils avaient réussi à imposer à la droite catalaniste le retrait d’Artur Mas, trop clientéliste et corrompu. Ils sont les animateurs principaux des CDR (Comités de défense de la République), de création récente et en lien avec d’autres institutions "culturelles", convoquées à coups de réseaux sociaux pour faire la traque, tels des brigades de choc du nationalisme, à tout ce qu’ils considèrent comme "espagnoliste". Sur Podemos, on peut lire "Podemos : des habits neufs au service de l’empereur capitaliste [700]". C’est un parti national espagnol avec des "franchises" régionales. Celle de la Catalogne avec ses alliés (dont la maire de Barcelone) ne sait pas très bien sur quel nation danser, ils sont cependant favorables à un référendum avec l’accord du pouvoir central.
Les États-Unis au cœur du désordre mondial grandissant
- 878 lectures
L’année dernière, les "élites" dominantes du capitalisme mondial ont été choquées par l’issue du referendum au Royaume-Uni sur l’appartenance des Britanniques à l’Union Européenne (avec le "Brexit"), et par le résultat des élections présidentielles aux États-Unis (avec le Président Trump). Dans les deux cas, les résultats obtenus ne correspondaient pas aux intentions, ni aux intérêts des fractions dirigeantes de la classe bourgeoise. Nous allons donc examiner une série d’éléments qui sont reliés entre eux dans le but de faire un premier bilan de la situation politique aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans le sillage de ces événements. [1] Pour élargir l’angle d’attaque de notre examen, nous développerons aussi une analyse de la politique de la classe dominante dans les deux principaux pays d’Europe continentale : la France et l’Allemagne. En France, les élections présidentielles et législatives ont eu lieu au début de l’été 2017. En Allemagne, les élections générales au Bundestag ont eu lieu en septembre. La bourgeoisie des deux pays était obligée de réagir à ce qui s’est passé en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et elle a réagi.
En choisissant de nous concentrer sur ces quatre pays, ces chapitres n’essaieront pas de faire une analyse de la vie politique de la bourgeoisie dans deux pays, la Russie et la Chine, qui jouent un rôle clef dans la constellation des puissances capitalistes impérialistes, aujourd’hui. Une étude de leur situation reste à faire. Ceci étant dit, nous devons dire que toutes deux, la Russie et la Chine, jouent un rôle extrêmement important dans notre analyse de la situation politique des quatre pays capitalistes centraux "de l’Ouest" qu’on doit examiner dans ces chapitres. Nous nous concentrerons aussi sur la vie politique des classes dominantes, sans entrer dans celle du prolétariat. Ici encore, il est clair que la situation actuelle pose une série de questions et de défis à la classe ouvrière que les organisations révolutionnaires doivent prendre à bras le corps et contribuer à clarifier, ce que nous essaierons de faire dans des articles à venir. Pour le moment, nous recommandons aux lecteurs de consulter la "Résolution sur la lutte de classe internationale [701]" de notre dernier congrès international, publiée également dans ce numéro de la Revue Internationale.
Le fondement historique de ces développements politiques réside dans un processus plus profond : la décomposition de l’ordre social capitaliste qui s’accélère. Nous recommandons vivement que la lecture de cet article et des suivants soit accompagnée d’une lecture ou d’une relecture de nos "Thèses sur la décomposition [200]" publiées dans la Revue Internationale n° 107, disponibles sur notre site. Pour nous, la situation actuelle est une grande confirmation de ce que nous avions souligné dans ce texte écrit il y a plus d’un quart de siècle. En particulier, l’examen concret de la situation actuelle confirme que c’est d’ailleurs la classe dominante elle-même qui est la première et la plus affectée par cette décomposition de son système, et que (sauf face à une menace prolétarienne) la bourgeoisie a de plus en plus de difficultés à maintenir son unité politique et sa cohésion.
(Steinklopfer, 23.08.17et réactualisé.)
[1] Ces chapitres qui sont conçus pour être lus comme une unité ont été d’abord écrits pendant l’été 2017 après les élections générales en Grande-Bretagne et les présidentielles et les législatives en France, mais avant les élections au Bundestag en Allemagne. Pour plusieurs raisons, ce travail n’a pu être publié à l’époque. Quelques mises à jour et corrections ont été faites, mais nous avons choisi de ne pas changer la section sur l’Allemagne où la situation même après les élections reste extrêmement incertaine. Voir notre analyse sur les élections en Allemagne [702]. Cela a aussi été écrit avant la dernière crise dans les rapports entre les États-Unis et la Corée du Nord et entre les États-Unis et l’Iran sur les problèmes des programmes atomiques et de fusées de ce que Washington appelle "les États-voyous". Pour la crise avec Corée du Nord, voir notre article "Menace de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis : c'est le capitalisme qui est irrationnel [703] "
Personnages:
- Donald Trump [577]
Récent et en cours:
- Brexit [582]
Trump et la guerre commerciale globale qui s’intensifie
- 571 lectures
En réaction à l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les médias du reste du monde et les porte-paroles du "libéralisme" en Amérique même ont donné une image sinistre d’une planète bientôt plongée par Trump dans les affres d’une catastrophe protectionniste telle que celle qui s’était déjà produite après 1929. Il était affirmé que le protectionnisme était le programme du "populisme" politique en général et de Donald Trump en particulier. À ce moment-là déjà, dans notre article sur le populisme et sur l’élection de Trump, nous disions qu’un programme économique particulier (protectionniste ou autre) n’est pas une caractéristique majeure du populisme de droite. Au contraire, ce qui caractérise cette sorte de populisme, au niveau économique, est le manque de tout programme cohérent. Soit ces partis n’ont que peu ou rien à dire sur les questions économiques, soit – comme dans le cas de Trump – ils veulent une chose un jour et son contraire le lendemain. Bien que Trump au pouvoir ait déjà fait la preuve de son penchant pour "l’unilatéralisme" en menaçant ou en commençant à retirer les États-Unis de deux des plus importants accords commerciaux : celui de NAFTA (avec l’Amérique du Nord) et le TPP (avec l’Asie, sans la Chine). Dans le premier cas, cela reste une menace à laquelle vont s’opposer beaucoup de compagnies américaines importantes. Dans le second cas, l’accord réel n’a jamais été signé, si bien qu’un retrait formel des États-Unis n’est pas nécessaire. En même temps, Trump a suspendu les négociations sur le TTIP (Traité de Libre Echange Transatlantique) avec l’Union Européenne – mais son intention en procédant de la sorte reste peu claire. Selon ses propres propos, son but est d’imposer "un meilleur traité" pour l’Amérique. Jetant tout le poids des États-Unis pour faire pression sur les autres, Trump joue avec des enjeux importants, comme nous avions prévu qu’il le ferait. Le résultat reste, lui, imprévisible. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’au niveau de la politique économique, les classes dominantes des autres pays ont profité de la rhétorique protectionniste de Trump pour blâmer unilatéralement les États-Unis pour ce qui est, d’abord et avant tout, un produit du capitalisme global. Ce dont nous avons été témoins récemment, ce n’est rien de moins qu’une étape qualitativement nouvelle de la vie économique ou de la lutte à mort entre les puissances capitalistes dominantes – quelque chose qui a déjà commencé avant que Trump ne devienne président. Et, en même temps que les autres gouvernements font à voix haute des déclarations "en défense du libre-échange" contre Trump, en réalité, ils ont tous adopté sa rhétorique contre le dumping et pour "le libre, mais aussi équitable, échange". Jadis un slogan des ONG, "le commerce équitable", est aujourd’hui le cri de guerre de la lutte économique bourgeoise. Le protectionnisme n’est ni nouveau, ni le monopole des États-Unis. Il fait partie de la compétition capitaliste, et il est pratiqué par tous les pays.
Le protectionnisme formel du marché n’est cependant qu’une des formes que prend le conflit. Une autre est l’arme des sanctions. Les sanctions économiques contre Moscou, surtout promues par les États-Unis, sont presqu’autant dirigées contre l’économie européenne que contre la Russie. En particulier, le renouvellement de ces sanctions et leur intensification (imposées par une coalition de Démocrates et de Républicains, contre la volonté du président), mettent ouvertement en question les arrangements de l’Europe de l’Ouest avec la Russie sur les nouveaux oléoducs et pipelines, et cela a provoqué une avalanche de protestations, surtout en Allemagne. Sous Obama déjà, la bourgeoisie américaine avait aussi commencé à poursuivre légalement en justice les compagnies allemandes qui opéraient aux États-Unis, comme la Deutsche Bank et Volkswagen. Il ne serait pas exagéré de parler d’une guerre commerciale offensive des Américains contre l’Allemagne, d’abord et avant tout contre son industrie automobile. Nous ne doutons pas une minute que les gens de VW ou Mercedes soient coupables de toutes les saloperies dont ils ont été accusés (centrées sur la falsification des contrôles de pollution). Mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle ils sont poursuivis, et la preuve en est que d’autres "coupables" n’ont été que peu affectés par les procédures légales.
Bien que Trump, à la différence de son prédécesseur, n’ait pas pris de telles mesures pour le moment, il continue à menacer massivement, pas tant l’Europe, mais surtout la Chine. De son point de vue, il a de bonnes raisons de le faire. Au niveau économique déjà, la Chine est actuellement en train de faire surgir deux menaces gigantesques pour les intérêts des États-Unis. La première d’entre elles est la soi-disant nouvelle Route de la Soie, un programme d’infrastructure massive visant à relier l'Asie du Sud-est, le Moyen Orient, l’Afrique et l’Europe à la Chine grâce à un vaste système de trains modernes, d’autoroutes, de ports et d’aéroports, par terre et par mer. Pékin a déjà promis mille milliards de dollars pour cela, le programme le plus ambitieux pour des infrastructures dans l’histoire jusqu’à nos jours. La seconde menace est que la Chine (mais aussi le Japon) a commencé à retirer des capitaux des États-Unis et de la zone dollar et à établir des accords bilatéraux avec d’autres gouvernements (les États qu’on appelle les BRICS, mais aussi le Japon et la Corée du Sud) pour accepter des paiements dans toutes les autres monnaies[1], au lieu de payer en dollars. Bien qu’il y ait évidemment des limites objectives au niveau jusqu’auquel peuvent aller la Chine et le Japon sans se créer eux-mêmes des problèmes, ces mouvements représentent une grave menace pour les États-Unis : "tôt ou tard, le marché de la monnaie reflètera le rapport de force dans le commerce international – signifiant un ordre multipolaire avec trois centres de pouvoir. Dans un futur prévisible, le dollar devra partager son rôle dominant avec l’Euro et le Yuan chinois. (…) Cela n’affectera pas que l’économie et le secteur social, mais aussi l’armement militaire de la puissance mondiale" 5. Cela risque d’ailleurs de saper, sur le long terme, la supériorité militaire écrasante des États-Unis, la suprématie écrasante du dollar comme la monnaie du commerce mondial finance actuellement à un degré considérable leur gigantesque machine militaire et leur dette d’État. Bien que les États-Unis et l’Union Européenne menacent tous deux la Chine de nouveaux droits de douane pour répondre à ce qu’ils appellent le dumping chinois, ce à quoi ils veulent avant tout arriver, c’est que Pékin soit dépouillé de son statut, dans les institutions économiques internationales, de "pays en voie de développement" (qui donne à la Chine beaucoup de possibilités légales de protéger son propre marché). L’élément dans le programme économique de Trump, qui a cependant le plus impressionné la classe dominante, pas seulement aux États-Unis, est sa "réforme des impôts" planifiée. Le Frankfurter Allgmeine Zeitung en Allemagne a déclaré que cela constituerait – si cela devait se réaliser – rien de moins qu’une "révolution des impôts"[2]. Son idée principale n’est pas nouvelle en elle-même, mais va dans la même direction que des "réformes" semblables dans l’ère "néo-libérale" : celle de taxer autant que possible la consommation plutôt que la production. Comme tout le monde paie la taxe à la consommation, de tels transferts constituent une espèce de suppression d’impôts pour les propriétaires des moyens de production. Convaincus que les États-Unis sont le seul grand pays où un tel système de taxation pourrait être imposé d’une façon réellement radicale, Trump espère, en rendant la production aux États-Unis virtuellement libre d’impôts, ramener at home les compagnies américaines, leurs quartiers généraux étant actuellement dans des endroits comme Dublin ou Amsterdam, mais aussi la production à l’étranger, et devenir plus attractive pour les investisseurs et les producteurs étrangers. Cela semble surtout être la contre-offensive que Donald Trump a en tête dans l’étape actuelle de l’économie de guerre.
Sur le plan économique, Trump n’est rien d’autre qu'en opposition à la politique "néolibérale" dont il se réclame parfois. S’il a un but, celui de son gouvernement de milliardaires ressemble plus au "parachèvement" de la "révolution néolibérale". Derrière la rhétorique de son conseiller précédent, Steve Bannon, sur la "destruction de l’État", se cache l’État néolibéral, une forme particulièrement brutale et puissante de capitalisme d’État. Mais le problème de l’administration Trump aujourd’hui n’est pas seulement que son programme économique se contredit. C’est aussi que ces éléments de son programme qui pourraient être des plus utiles à la bourgeoisie américaine sont vraiment peu certains d’être mis en œuvre. La raison en est le chaos dans l’appareil politique de la première classe dominante du monde.
[1] Josef Braml : Trump’s Amerika, page 211. Braml Work for the German Society for Foreign Policy. (DGAP)
[2] Frankfurter Allgemeine Zeitung 02.04.2017. Le journal FAZ est un des porte-paroles dominants de la bourgeoisie allemande.
Géographique:
- Etats-Unis [664]
Personnages:
- Donald Trump [577]
La crise politique de la bourgeoisie américaine
- 696 lectures
Aujourd’hui, il y a dans le bureau ovale un président qui voudrait gérer le pays comme une simple entreprise capitaliste et qui semble n’avoir aucune compréhension de choses comme l’État et l’habileté politique ou la diplomatie. C’est en soi un signe clair de la crise politique dans un pays comme les États-Unis. Depuis 2010, la vie politique de la bourgeoisie aux États-Unis a été caractérisée par une tendance de tous les principaux protagonistes à se bloquer les uns les autres. Les Républicains radicaux ont retardé le plan budgétaire de la présidence Obama, par exemple, à un tel niveau que, à des moments critiques, l’État a été sur le point d’être incapable de payer même les salaires de ses employés. L’obstruction mutuelle entre le président et le Congrès, entre les Républicains et les Démocrates, et au sein des deux partis (en particulier, au sein du premier) a atteint un niveau tel que cela a commencé à handicaper gravement la capacité des États-Unis à remplir leur rôle de maintenir un minimum d’ordre au capitalisme global. Un exemple de cela en est la réforme des structures du Fond Monétaire International (FMI), qui devenait nécessaire pour répondre au poids croissant des BRICS en particulier (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) dans l’économie mondiale. Le président Obama reconnaissait que, si les institutions économiques internationales, inspirées par les États-Unis et sous leur conduite, devaient continuer à accomplir leur fonction de donner certaines "règles du jeu" à l’économie mondiale, il n’y avait aucun moyen d’éviter de donner aux "pays émergents" plus de droits et de votes en leur sein. Mais cette restructuration a été bloquée par le Congrès américain pendant pas moins de cinq ans. En conséquence, la Chine a pris l’initiative de créer la dite Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII). Pire encore, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de participer à la BAII (mars 2015). Un pas majeur a été fait dans la création d’une architecture institutionnelle alternative, dirigée par les Chinois, pour l‘économie mondiale. L’opposition en Amérique n’a même pas eu de succès en empêchant la "réforme" du FMI.
Donald Trump souhaitait mettre fin à cette tendance à une paralysie rampante du système de pouvoir américain en détruisant le pouvoir de l’establishment, des "élites" établies, en particulier au sein des partis politiques eux-mêmes. Il est évident que cet establishment n’a aucune intention de rendre son pouvoir. Le résultat de la présidence de Trump, au moins jusqu’à maintenant, a transformé cette tendance au blocage en une crise à grande échelle de l’appareil politique américain. Une furieuse lutte de pouvoir s’est enclenchée entre les trumpistes et leurs opposants, entre le président et le système judiciaire, entre le Maison Blanche et les parti politiques, au sein du parti Républicain lui-même – que Trump a plus ou moins kidnappé en tant que moyen de sa candidature présidentielle – et même dans l’entourage du président lui-même. Une lutte de pouvoir qui se mène aussi dans les media : CNN et la presse de la côte Est contre Breitbart et Fox News. Les tribunaux et les municipalités bloquent la politique de Trump en matière d’immigration. Sa "réforme de la santé" pour remplacer celle d’Obama manque de soutien dans son "propre" camp républicain. Les fonds pour construire son mur contre le Mexique n’ont pas été alloués. Même sa politique étrangère est ouvertement contestée, en particulier, son intention de faire une "bonne affaire" avec la Russie. Le président frustré, agissant par coups de tête, branché sur Twitter, a licencié des membres éminents de sa propre équipe les uns après les autres. En même temps, pas à pas, l’opposition construit un mur pare-feu autour de et contre lui, constitué de campagnes médiatiques, d’investigations et de la menace de poursuite, et même de destitution (impeachment). Sa capacité de gouverner le pays, et même sa santé mentale, sont mises en question publiquement. Ce développement n’est pas spécifique aux États-Unis. Au cours des deux dernières années, par exemple, on a vu une série de manifestations massives contre la corruption, que ce soit en Amérique latine (au Brésil par exemple), en Europe (Roumanie) ou en Asie (Corée du Sud). Ce sont des protestations, non contre l’État bourgeois, mais contre l’idée que l’État bourgeois fait correctement son travail (et bien sûr, il y a des protestations contre certaines factions – souvent à l’avantage d’une autre faction). En réalité, ladite corruption n‘est qu’un symptôme de problèmes plus profonds. La gestion permanente, non seulement de l’économie, mais de l’ensemble de la société bourgeoise par l’État, est un produit de la décadence du capitalisme, l’époque globale inaugurée par la Première Guerre mondiale. Le déclin du système nécessite un contrôle permanent de l’État avec une tendance de plus en plus totalitaire : le capitalisme d’État. Sous sa forme actuelle, l’appareil capitaliste d’État, y compris l’administration, le processus de prise de décisions et les partis politiques, est un produit des années 1930 et/ou de la période après Deuxième Guerre mondiale. En d’autres termes, tout cela existe depuis des décennies. Au cours du temps, la tendance innée à l’inertie, à l’inefficacité, à l’affirmation de l’intérêt personnel et à l'autoperpétuation devient de plus en plus marquée. Cela vaut aussi pour la "classe politique", avec une tendance croissante des politiciens et des partis politiques et d’autres institutions à préserver leurs propres intérêts acquis, au détriment de ceux du capital national dans son ensemble. Le "néolibéralisme" s’est en partie développé pour répondre à ce problème. Il essayait de rendre les bureaucraties plus efficaces en introduisant des éléments de compétition économique directe dans leur mode de fonctionnement. Mais sur beaucoup de plans, le système "néolib" a aggravé le mal qu’il voulait soigner. La volonté de faire des économies dans le fonctionnement de l’État a fait naître un nouvel appareil gigantesque, celui de ce qu'on appelle le lobbysmelobbyisme. En dehors de ce système de lobbies, s’est développé en retour la sponsorisation, de groupes ou d’individus privés, de ce qu’on appelle aux États-Unis les Comités d’Action Politique (CAP) : "think tanks", instituts politiques et soi-disant mouvements de base. En mars 2010, la Cour d’appel américaine garantissait le droit à des fonds illimités pour de tels organismes. Depuis lors, des groupes privés puissants ont de plus en plus exercé une influence directe sur la politique nationale. Un exemple en est le vote de la "Grover Norquist Initiative" (vote d’une motion lancée par le Républicain Grover Norquist) qui a réussi à obtenir une large majorité de Républicains à la Chambre des députés pour jurer publiquement et solennellement que jamais plus n'aurait lieu de vote en faveur d’augmentations d’impôts. Un autre exemple en est l’institut Cato et le Mouvement Tea Party sponsorisés par les frères Koch (des magnats du pétrole). L’exemple le plus pertinent, peut-être, dans le contexte actuel, est celui de Robert Mercer (appartenant à une espèce de droite équivalente à celle du "libéral" George Soros), apparemment un brillant mathématicien, qui a utilisé ses talents en mathématiques pour devenir un des leaders milliardaires en fonds spéculatifs et pour créer un puissant instrument d’investigation et de manipulation de l’opinion publique appelé Cambridge Analytica. Ce dernier institut, avec sa chaîne d'information Breitbart axée sur la supériorité de la race blanche, a probablement eu un rôle décisif dans la victoire à la présidence de Donald Trump, et a aussi été impliqué dans des manipulations d’opinions pour un résultat pro-Brexit dans le référendum au Royaume-Uni[1].
L’indication la plus claire du fait que l’obstruction mutuelle au sein de la classe dominante a franchi un nouveau pas qualitatif – celle d’une crise politique à grande échelle – est que, bien plus que dans les années passées, l’orientation impérialiste et la stratégie militaire de la superpuissance sont elles-mêmes devenues la principale pomme de discorde et des sujets donnant prise au blocage de l’État.
[1] Pour une analyse plus détaillée des contradictions entre la politique de Trump et les intérêts de la principale fraction de la bourgeoisie américaine, voir notre article "L'élection de Trump et le délitement de l'ordre capitaliste mondial [704]" de la Revue internationale n° 158, qui développe aussi le contexte du déclin global des États-Unis et le cancer du militarisme qui se développe toujours et qui pèse sur son économie.
Géographique:
- Etats-Unis [664]
Personnages:
- Donald Trump [577]
Récent et en cours:
- Tea Party [705]
Les États-Unis et la question russe
- 659 lectures
Une des particularités des élections présidentielles américaines de 2016 a été (comme dans les "républiques bananières" proverbiales) qu’aucun des deux candidats n’acceptait sa défaite. Trump l’avait déjà annoncé avant le jour de l’élection, mais sans dire ce qu’il ferait dans le cas d’une défaite. En ce qui concerne Hillary Clinton, au lieu de blâmer qui que ce soit d’autre pour sa défaite (elle-même par exemple)[1], elle avait décidé d'en attribuer la responsabilité à Vladimir Poutine. En même temps, une grande partie de l’establishment politique américain a repris ce thème, si bien que le "Russia-gate" est devenu le principal instrument d’opposition à l’administration Trump au sein de la classe dominante américaine. Comme le monde entier le sait maintenant, les connexions de Trump avec la Russie remontent à l’année 1987, quand Moscou était encore la capitale de l’URSS et "l’Empire du Mal" aux yeux des États-Unis. Selon un film documentaire récent, sur ZDF, la deuxième chaine d’État en Allemagne[2], c’était la connexion russe de Trump, notamment ses liens d'affaires avec la pègre russe, qui a (peut-être plusieurs fois) sauvé Trump de la faillite. En tout cas, l’idée centrale des investigations contre Trump à propos de la Russie, c’est que la personne qui est devenue président des États-Unis dépend du Kremlin et est peut être l’objet de chantage de la part de ce dernier. Ce qui est surtout vrai, c’est que les trumpistes voulaient et veulent toujours changer radicalement la politique des États-Unis avec la Russie, faire une "une bonne affaire" avec Poutine.
Il est nécessaire, ici, de rappeler brièvement l’histoire des relations Amérique-Russie depuis l’effondrement de l’Union Soviétique.
Pendant les jours grisants de la "victoire" américaine dans la guerre froide, il y avait dans la classe dominante américaine un sentiment très fort que son ancien rival en tant que superpuissance pourrait devenir une espèce d’État vassal et, surtout, la source d’abondants profits. Le premier président russe, Boris Eltsine, se reposait sur des conseillers américains ("néolib") dans le processus de conversion du système stalinien existant en "économie de marché". Le résultat a été un désastre économique. En ce qui concerne les conseillers américains "experts", leur principale préoccupation était de faire passer autant que possible la fabuleuse richesse en matières premières de la Russie sous contrôle américain. La présidence d’Eltsine (1991-1999), un gouvernement de type mafieux, était plus ou moins prête à vendre les ressources du pays au meilleur offrant. L’administration qui lui a succédé, celle de Vladimir Poutine, bien qu’elle ait d’excellents rapports avec le milieu russe, s’est rapidement avérée être un régime d’une toute autre sorte, gérée par des bureaucrates des services secrets déterminés à défendre l’indépendance de la mère-patrie Russie et à garder ses richesses pour eux-mêmes. Ce fut donc Poutine qui a empêché la prise de contrôle américaine sur l’économie russe. Cette perte sérieuse a correspondu à un déclin plus global de l’autorité américaine, déclin qui voyait la plupart de ses anciens alliés, et même un certain nombre de puissances secondaires dépendantes, commencer à contester l’hégémonie de la seule superpuissance mondiale restante.
Depuis l’ascendance de Poutine, les soi-disant "néocons", les instituts et les think-tanks "conservateurs" et ouvertement belliqueux aux États-Unis, ont perpétuellement plaidé pour un "changement de régime" à Moscou. Une fois de plus, la Russie sous Poutine est devenue une espèce "d’empire du mal" pour la propagande guerrière de l’impérialisme américain. Malgré le changement abrupt dans la politique américaine de la Russie sous Poutine, la politique américaine est restée vis-à-vis de la Russie, jusqu’en 2014, fondamentalement la même. Son axe principal était l’encerclement de la Fédération de Russie, d’abord et avant tout avec le déploiement de l’OTAN de plus en plus près du cœur de la Russie. Avec l’intégration des anciens pays baltes de l’URSS dans l’OTAN, la machine militaire américaine s’est retrouvée à encercler l’enclave russe de Kaliningrad, à une distance presque accessible à pied des faubourgs de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie. Cependant, quand Washington a offert à deux anciennes composantes de l’Union Soviétique de devenir membre de l’OTAN – l’Ukraine et la Géorgie –, ce sont d’autres "partenaires" de l’OTAN qui l’en ont empêché, en particulier l’Allemagne, qui a réalisé que cette étape allait vraisemblablement provoquer une espèce de réaction militaire de Moscou.
Les "partenaires" occidentaux ont d’ailleurs été d’accord sur une procédure plus subtile : l’Union Européenne a offert à l’Ukraine un accord de "libre échange". Mais comme l’Ukraine avait déjà un accord similaire avec la Fédération de Russie, les conséquences de l’arrangement entre Bruxelles et Kiev allaient être que les marchandises européennes, via l’Ukraine, pourraient entrer librement en Russie. Bruxelles a cependant délibérément exclu Moscou de ses négociations avec Kiev. La réaction de Moscou à cet arrangement entre Bruxelles et Kiev ne s’est donc pas fait attendre : l’Ukraine devait choisir entre un marché partagé avec l’UE, ou avec la Russie. Il est apparu une situation qui menait à une confrontation ouverte entre forces "pro-occidentales" et "pro-russes" en Ukraine. À l’époque, le Vieux Grand manitou de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, disait à CNN que le changement de régime à Kiev était une espèce de répétition générale de ce qui arriverait à Moscou. [3] Mais il s’est alors produit quelque chose que personne à Washington ne semble avoir prévu : une contre-offensive militaire russe. Ses trois principales composantes étaient le mouvement séparatiste soutenu par Moscou en Ukraine orientale, l’annexion de la péninsule de Crimée sur la côte de la Mer Noire ukrainienne, et l’intervention militaire de la Russie en Syrie. Il est apparu une nouvelle situation, dans laquelle la cohérence et l’unité de la politique américaine vis-à-vis de la Russie ont commencé à s’effriter.
Un accord pouvait encore avoir lieu à Washington sur l’étranglement économique de la Russie, vu comme une réponse adéquate à la contre-offensive de Moscou. Les trois piliers de cette politique – encore en place – sont : des sanctions économiques : l'affaiblissement du secteur énergétique russe en maintenant le prix du pétrole et du gaz aussi bas que possible sur le marché mondial ; enfin, l’intensification de la course aux armements avec une Russie qui était économiquement incapable de tenir la cadence. Mais, à partir de 2014, il y a eu des dissensions croissantes sur la manière dont l’Amérique devait répondre à la Russie au niveau militaire. Une faction dure a surgi, qui devait soutenir Hillary Clinton à l’élection présidentielle de 2016. Un de ses représentants était le commandant en chef des forces de l’OTAN en Europe, Philip Breedlove. En novembre 2014, et de nouveau en mars 2015, Breedlove a répandu ce qui allait s’avérer être une fake-news, que l’armée russe avait envahi l’est de l’Ukraine. Cela ressemblait à une tentative de créer un prétexte pour une intervention de l’OTAN en Ukraine. Le gouvernement allemand était tellement alarmé qu’à la fois la chancelière Merkel et le ministre des affaires étrangères Steinmeier ont condamné publiquement ce qu’ils appelaient "la propagande dangereuse" du commandant de l’OTAN.[4] Breedlove, évidemment, n’engendrait pas l’amour, mais la guerre. Selon la revue allemande Cicero (04.03.16), Breedlove a aussi proposé au Congrès américain d’attaquer Kaliningrad, le port russe situé sur la mer Baltique, en guise de réponse adéquate à l’agression russe plus au sud. Il n’était pas le seul à partager cette manière de voir. L’agence Associated Press a rapporté que le Pentagone était en train d’envisager l’usage de l’arme atomique contre la Russie. Et, lors d’une conférence de l’Association de l’Armée américaine en octobre 2016, des généraux américains disaient qu’une guerre avec la Russie et même la Chine, était "presque inévitable".[5] Ces déclarations étaient extrêmes, mais elles montrent la force inébranlable de la position "antirusse" au sein des cercles militaires américains. Alarmé par cette escalade, celui qui avait été en dernier à la tête de l’État de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a écrit une contribution pour le Time Magazine (27.01.17), titrée "Il semble que le monde se prépare à la guerre", dans laquelle il voulait mettre en garde contre le danger d’une catastrophe nucléaire en Europe. Gorbatchev ne réagissait pas moins qu’à une idée qui était de plus en plus mise en avant par les think-tanks conservateurs aux États-Unis : que les risques imposés par un conflit nucléaire avec la Russie étaient devenus calculables et pouvaient être "minimisés" - au moins pour les États-Unis. Selon cette "école de pensée", un tel conflit ne serait pas déclaré mais se développerait à partir de la "guerre hybride" (Breedlove) avec la Russie, dans laquelle les distinctions entre les affrontements armés, la guerre conventionnelle et la guerre nucléaire s'estompent. C’est en réponse à une telle "pensée à haute voix" à Washington que le Kremlin a "assuré" le monde entier que la capacité de frappe nucléaire russe était encore telle que, non seulement Berlin, mais Washington aussi seraient "rasés jusqu’au sol" si l’OTAN attaquait la Russie. [6]
Face à cette considération croissante de l’option militaire contre la Russie, l’opposition s’est développée non seulement au sein de l’OTAN mais aussi au sein de la classe dominante américaine. Le sommet de l’OTAN de septembre 2014 au Pays de Galles a rejeté la proposition d’intervenir militairement en Ukraine et a abandonné, au moins temporairement, l'idée que Kiev devienne un membre de l’OTAN. Et à partir de ce moment, Barack Obama, tant qu’il a été en place, tout en contribuant à la modernisation des forces armées ukrainiennes, a toujours rejeté un engagement militaire américain direct dans ce pays. Mais la réaction la plus importante politiquement à la situation avec la Russie au sein de la bourgeoisie américaine a été celle de Donald Trump. Pour comprendre comment dans ce contexte, une nouvelle position sur la politique vis-à-vis de la Russie en est arrivée à être formulée dans la bourgeoisie américaine, il faut garder à l’esprit que la Russie n’a pas la même signification pour les États-Unis qu’elle avait il y a un quart de siècle, pendant "la période de lune de miel" entre Bill Clinton et Boris Eltsine. À cette époque, l’objectif principal de la politique russe de l’Amérique était la Russie elle-même, le contrôle de ses ressources. Aujourd’hui, le contrôle américain de la Russie serait plus un moyen d’un nouveau dessein : l’encerclement militaire du nouvel ennemi n°1 qui est la Chine. Dans ce contexte qui a changé, Donald Trump pose une question très simple au reste de sa classe : si la Chine est maintenant notre principal ennemi, pourquoi n’essayons-nous pas de gagner Moscou à une alliance contre la Chine ? La Russie n’est ni l’amie naturelle de la Chine, ni l’ennemi naturel des États-Unis.
La question qui pour le moment présente le plus d’intérêt pour le "courant dominant" de la bourgeoisie américaine (en particulier les supporters d’Hillary Clinton), est cependant différente : est-ce que le Kremlin a eu une influence sur l’issue des dernières élections présidentielles ? Répondre à cette question n’est pas difficile en fait. Poutine a non seulement influencé les élections, il a même contribué à créer au sein de la bourgeoisie américaine un groupe ouvert à conclure des arrangements avec Moscou. Les principaux moyens qu’il a utilisés dans ce but ont été des plus légitimes dans la société bourgeoise : la proposition de traités d’affaires. Par exemple, l’arrangement proposé à Exxon Oil et à son président, Rex Tilllerson – maintenant secrétaire d’État (ministère des affaires étrangères) – est estimé à 500 milliards de dollars. Nous pouvons donc comprendre comment, après tous les discours de la bourgeoisie au cours des dernières décennies sur les sources d’énergie fossile qui appartiennent au passé, il y a un gouvernement à Washington aujourd’hui avec une surreprésentation de l’industrie pétrolière et même du charbon : ce sont les parties de l’économie à qui la Russie peut le plus offrir.
Bien que Trump ait apparemment réussi à convaincre Henry Kissinger de sa proposition (Kissinger est devenu un conseiller de Trump et un avocat de la "détente" avec la Russie), il est très loin d’avoir convaincu la majorité des gros bonnets qui lui sont opposés. Une des raisons en est que, ce que Dwight Eisenhower, dans son discours d’adieu en tant que président des États-Unis (17.02.1961) appelait le "complexe militaro-industriel", se sent menacé dans son existence par un traité possible avec la Russie. C’est parce que la Russie, pour le moment, continue à être la principale justification du maintien d’un appareil aussi gigantesque. À la différence de la Russie, la Chine, au moins pour le moment, bien qu’étant une puissance atomique, n’a pas un tel assemblage de missiles nucléaires intercontinentaux menaçant directement les plus grandes villes des États-Unis.
[1] Son mari, l’ex-président Bill Clinton, aurait été furieux de l'incompétence avec laquelle sa campagne avait été gérée.
[2] ZDF Zoom : Gefärhrliche Verbindungen – Trump und seine Geselschäftspartner ("Connexions dangereuses – Trump et ses partenaires en affaires") de Johannes Hano et Alexander Sarovic.
[3] Youtube, 17.08.2015.
[4]Der Spiegel, 07.03.2015. "NATO Oberbefehlshaber Breeedlove irritiert die Allierten". (OTAN, le commandant en chef irrite les alliés.)
[5] Wolfgang Bittner : Die Eroberung Europas durch die États-Unis (La Conquête de l’Europe par les États-Unis), page 151.
[6] Youtube, 05.02.2015
Géographique:
- Russie [616]
- Etats-Unis [664]
Personnages:
- Donald Trump [577]
- Poutine [706]
Grande-Bretagne : la classe dominante divisée
- 581 lectures
En Grande-Bretagne, le premier ministre Theresa May a avancé les élections à juin 2017, dans le but de donner une plus grande majorité à son Parti Conservateur avant d’entrer dans la phase de négociations des conditions dans lesquelles le pays va quitter l’Union Européenne. Mais à la place, elle a perdu la majorité qu’elle avait, se rendant elle-même dépendante du soutien des unionistes protestants de l’Ulster (Irlande du Nord) du DUP (Parti unioniste nord-irlandais). Le seul succès du premier ministre à ces élections a été que le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP, la ligne dure des "brexiteurs" à la droite du Parti Conservateur) n’est plus représenté au parlement. Malgré cela, la dernière débâcle électorale des conservateurs a clairement mis en évidence que le problème fondamental reste irrésolu – le problème qui, il y a un an, rendait possible que le referendum sur l’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union Européenne ait produit un résultat – le "Brexit" - qu’une majorité des élites politiques n’avait pas voulu. Ce problème est la profonde division au sein des Conservateurs – un des deux principaux partis étatiques en Grande-Bretagne. Quand la Grande-Bretagne a adhéré à ce qui était alors la "communauté européenne", au début des années 1970, les Conservateurs (Tories) étaient déjà divisés sur cette question. Un fort ressentiment contre "l’Europe" n’a jamais été surmonté dans les rangs des Conservateurs. Dans les années récentes, ces tensions intérieures au Parti se sont développées en luttes ouvertes pour le pouvoir, qui ont de plus en plus entravé la capacité du parti à gouverner. En 2014, le premier ministre Tory, David Cameron, a réussi à mettre en échec les nationalistes écossais en organisant un referendum sur l’indépendance de l’Ecosse et en gagnant une majorité pour le maintien de l’Ecosse dans le Royaume-Uni. Enhardi par ce succès, Cameron a tenté de réduire au silence les opposants à l’adhésion britannique à l’Union Européenne de la même manière. Mais cette fois, il avait sérieusement mal calculé les risques. Le référendum a eu comme résultat une petite majorité pour quitter l’UE, alors que Cameron avait fait campagne pour rester. Un an plus tard, les Tories sont plus divisés que jamais sur cette question. Sauf qu’aujourd’hui, le conflit n’est plus entre être membre ou non de l’UE, mais de savoir si le gouvernement va adopter une attitude "souple" ou "dure" dans les négociations des conditions à la sortie de la Grande-Bretagne. Bien sûr, ces divisions au sein des partis politiques sont des émanations de tendances plus profondes au sein de la société capitaliste, l’affaiblissement de l’unité et de la cohésion nationale dans la phase de sa décomposition.
Pour comprendre pourquoi la classe dominante en Grande-Bretagne est aussi divisée sur ces questions, il est important de rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, Londres était le fier souverain de l’empire le plus grand et le plus étendu dans l’histoire humaine. C’est grâce à ce passé doré que la haute société britannique est encore aujourd’hui la classe dominante la plus riche en Europe occidentale. [1] Et, alors qu’un bourgeois allemand moyen s’engage traditionnellement dans une entreprise industrielle, son homologue, bourgeois britannique moyen, va vraisemblablement posséder une mine en Afrique, une ferme en Nouvelle-Zélande, un ranch en Australie, et/ou une forêt au Canada (pour ne pas citer des biens immobiliers et des actions aux États-Unis) du fait d’un héritage familial. Bien que l’Empire britannique et même le Commonwealth britannique appartiennent au passé, ils jouissent d’une "vie après la mort" très tangible. Les "dominions blancs" (qui ne sont plus appelés ainsi à l’heure actuelle), le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande partagent encore formellement avec la Grande-Bretagne le même monarque à la tête de l’État. Ils partagent aussi par exemple (de même qu’avec une autre ancienne colonie de la couronne : les États-Unis) une coopération privilégiée entre leurs services secrets. Nombreux sont ceux dans la classe dominante de ces pays qui ont le sentiment de toujours appartenir, sinon à la même nation, au moins à la même famille. D’ailleurs, ils sont souvent reliés entre eux par les mariages, par des partages de la même propriété et par des intérêts d’affaires. Quand la Grande-Bretagne, en 1973, sous le premier ministre conservateur Heath a rejoint ce qui était alors le "Marché commun" européen, ce fut un choc et même une humiliation pour des parties de la classe dominante britannique que leur pays ait été obligé de réduire ou même de rompre ses relations privilégiées avec leurs anciennes "colonies de la couronne". Tous les ressentiments accumulés pendant des décennies sur la perte de l’Empire britannique ont commencé, et continué, à se décharger contre "Bruxelles". Un ressentiment qui allait vite être accru par le courant néolibéral (très important en Grande-Bretagne depuis l’époque de Margaret Thatcher jusqu’à maintenant) pour qui la "bureaucratie monstrueuse" de Bruxelles était un anathème. Un ressentiment partagé par la classe dominante dans les anciens dominions tels que Rupert Murdoch, le milliardaire australien des médias, aujourd’hui un des "Brexiteurs" les plus fanatiques. Mais au-delà de la force de ces liens ancestraux, il était assez humiliant qu’une Grande-Bretagne qui autrefois "régnait sur les flots" ait les mêmes droits de vote en Europe que le Luxembourg ou que la tradition de la loi romaine règne dans les institutions européennes continentales et l’emporte sur la vieille loi anglo-saxonne.
Mais tout cela ne veut pas dire que les "Brexiteurs" ont, ou aient jamais eu, un programme cohérent pour quitter l’Union Européenne. La résurrection de l’Empire, ou même du Commonwealth dans sa forme originelle, est clairement impossible. La motivation de beaucoup des dirigeants du Brexit, à part le ressentiment, et même une certaine perte de vue de la réalité, est le carriérisme. Boris Johnson, par exemple, le leader de la fraction "Brexit" des Tories l’année dernière, semblait encore plus surpris et consterné que son opposant, le leader du Parti, David Cameron, quand il a entendu les résultats du referendum. Son but ne semblait pas, en fait, être le Brexit, mais de remplacer Cameron à la tête du parti.
Le fait est que ce soit les conservateurs, plus que le Labour, qui sont autant divisés sur cette question est également un produit de l’histoire. Le capitalisme en Grande-Bretagne a triomphé, non pas grâce à l’élimination, mais à travers l’embourgeoisement de l’aristocratie : les grands propriétaires terriens sont devenus eux-mêmes des capitalistes. Mais leurs traditions orientaient plus leurs intérêts dans le capitalisme vers la propriété de terres, de biens immobiliers et de matières premières que vers l’industrie. Comme ils possédaient déjà plus ou moins l’ensemble de leur propre pays, leur appétit pour les profits capitalistes est devenu un des principaux moteurs de l’expansion britannique au-delà des mers. Plus grand devenait l’empire, plus cette couche de propriétaires de terre et de biens immobiliers pouvait prendre le dessus sur la bourgeoisie industrielle (cette partie qui avait été initialement la pionnière de la première "révolution industrielle" dans l’histoire). Et tandis que le Labour, de par à son lien étroit avec les syndicats, est traditionnellement plus proche du capital industriel, les grands propriétaires terriens et de biens immobiliers tendent à se rassembler dans les rangs des Tories. Bien sûr, dans le capitalisme moderne, la vieille distinction entre capital industriel, foncier, marchand et financier, tend à s’atténuer du fait de la concentration du capital et de la domination de l’État sur l’économie. Néanmoins, les traditions différentes, tout autant que les différents intérêts qu’elles expriment encore partiellement, mènent toujours leur propre vie.
Aujourd’hui, il y a un risque de paralysie partielle du gouvernement. Les deux ailes du Parti Conservateur (qui se présentent actuellement comme les partisans d'un Brexit "dur" contre un Brexit "mou"), sont plus ou moins prêtes à faire tomber le premier ministre May. Mais, au moins pour le moment, aucune des deux fractions ne semble oser donner le premier coup, si grande est la peur d’élargir le fossé au sein de ce parti. Si le parti conservateur s’avérerait incapable de résoudre rapidement ce problème, d’importantes fractions de la bourgeoisie britannique pourraient commencer à penser à l’alternative d’un gouvernement travailliste. Immédiatement après le Brexit, le Labour s’est présenté dans un état encore pire que le parti conservateur, si cela est possible. La fraction parlementaire "modérée" était mécontente de la rhétorique de gauche du leader de son parti, Jeremy Corbyn - dont ils avaient le sentiment qu’il repoussait les électeurs - et de son refus de s’engager lui-même en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’UE. Ils semblaient aussi prêts à faire tomber leur leader. En même temps, Corbyn les a impressionnés par sa capacité à mobiliser les jeunes électeurs dans les élections récentes. D’ailleurs, si l’incendie tragique de Grenfell Tower (dont la population tient le gouvernement conservateur pour responsable) avait eu lieu avant les élections, au lieu de juste après, il n’est pas interdit de penser que Corbyn serait maintenant premier ministre à la place de May. En l’état actuel des choses, Corbyn a déjà commencé à se préparer à gouverner en laissant tomber certaines de ses revendications les plus "extrêmes", telles que l’abolition des sous-marins Trident dotés de têtes nucléaires qui sont en cours de modernisation.
[1] Des magazines tels que Fortune publient des données annuelles sur les banques, les compagnies, les familles et les individus les plus riches du monde
Géographique:
- Grande-Bretagne [154]
Personnages:
- Theresa May [578]
Récent et en cours:
- Brexit [582]
France : Macron sauve les meubles dans l’intérêt de la bourgeoisie nationale – mais pour combien de temps ?
- 556 lectures
En France, Emmanuel Macron et son nouveau mouvement "La République En Marche" (LREM) ont remporté de façon spectaculaire les élections présidentielles et les élections législatives (au parlement) de l’été 2017. Cette victoire du meilleur candidat possible pour battre le populisme en France a été le produit de sa capacité à recueillir un large soutien autour de cet objectif dans la bourgeoisie française, la bureaucratie de l’Union Européenne et de la part de personnages politiques influents comme Angela Merkel. Le Front National (FN), le principal parti "populiste" du pays, n’a eu aucune chance au deuxième tour des élections présidentielles contre Macron. Plombée par l’arriération de ses origines, en particulier par la domination du clan Le Pen, la double défaite électorale du FN l’a plongée dans une crise ouverte. Dans un éditorial de première page sur la situation, sous le titre "La France tombe en morceaux", le quotidien suisse souvent astucieux, le Neue Zürcher Zeitung écrit que : "le système de partis français tombe en morceaux". Cette analyse a été publiée le 4 février 2017, bien avant que la victoire de Macron puisse détourner l’attention de l’effritement des partis établis. Si, comme nous l’avons vu, le parti Républicain aux États-Unis a été pris en otage par Donald Trump et si le parti conservateur en Grande Bretagne est divisé, en France, deux des principaux partis établis sont en train de patauger. Le parti conservateur "Les Républicains" n’a remporté que 22% des votes, tandis que le Parti socialiste (PS) a fait encore moins bien, n’obtenant que 5,6% aux élections législatives. Au préalable, aucun des deux candidats de ces deux partis n’avait réussi à se qualifier pour le second tour des élections présidentielles (où étaient opposés les deux candidats qui avaient remporté le plus de voix au premier tour). Au lieu de cela, la candidate populiste spectaculairement incompétente, Marine Le Pen, a perdu contre la nouvelle star montante Macron, qui n’avait même pas un parti derrière lui.
Au début de la campagne présidentielle, la plupart des experts s’attendaient à un combat entre le président en place à cette époque, François Hollande du PS, et, à droite, Alain Juppé, un modernisateur, très prisé par des courants importants au sein de la bourgeoisie française. Cinq ans avant, François Hollande devenait président, après avoir été nommé par le parti socialiste, dans une primaire hautement médiatisée, une procédure d’élection du candidat présidentiel par chaque parti sur le modèle américain. Les Républicains, pensant que ce qui avait marché pour les socialistes ne pouvaient être un échec pour eux, ont décidé de faire leur propre "primaire". En faisant cela, ils perdaient le contrôle du processus de nomination. À la place de Juppé, ou d’un autre candidat plus ou moins solide, François Fillon a été nommé. Bien que favori du vote catholique et de parties de la haute société très conservatrice, il était clair pour une partie importante de la bourgeoisie française que Fillon n’était en aucune façon assuré de la victoire contre Marine Le Pen s’il se qualifiait pour le deuxième tour. Mais si le jugement politique n’était pas une qualité particulière du candidat Fillon, son entêtement l’était. Malgré le scandale dirigé contre lui, Fillon a refusé de démissionner et les LR sont restés coincés avec leur candidat "canard boiteux". Du côté des socialistes, le président en exercice Hollande renonçait à une deuxième candidature au vu de l’absence de soutien des électeurs comme à l’intérieur de son parti. En ce qui concerne le premier ministre sous Hollande, Manuel Valls, il échouait à la primaire du parti, dans laquelle, pour protester contre la direction, la base nommait à la place le candidat à peine connu mais réputé plus à gauche, Benoît Hamon.
La perte de contrôle des partis établis a été une occasion pour Emmanuel Macron. Ce dernier s’était déjà fait la main en tant que réformateur économique et politique quand il avait servi de conseiller au premier gouvernement dirigé par le PS sous la présidence de Hollande, et ensuite en tant que membre du second gouvernement dirigé par Valls. À cette époque, son but semble d’avoir été de démarrer un processus de modernisation économique en France, quelque chose dans la ligne de "l’Agenda 2010" de Gerhard Schröder en Allemagne. Mais Macron n’est pas resté longtemps au gouvernement, réalisant bien vite qu’à la différence du SPD en Allemagne, le parti socialiste n’était pas assez fort, pas assez discipliné et uni pour faire passer un tel programme.
Au début de 2017, le capitalisme français a vu surgir une situation très dangereuse pour lui. Confronté à l’incompétence des principaux partis établis, le danger d’une victoire électorale du Front National ne pouvait plus être écarté. Ses idées de faire sortir la France de la zone Euro étaient en contradiction flagrante avec les intérêts des fractions dominantes du capital français. Face à ce danger, ce fut Macron qui a sauvé la situation. Il l’a fait, dans une grande mesure, en utilisant la méthode du populisme contre les populistes.
D’abord, Macron a réussi à voler un des thèmes courants favoris des populistes : celui de la faillite historique de la droite et de la gauche traditionnelles parce qu’elles ont été trop occupées à s’opposer l’une à l’autre idéologiquement et dans leurs luttes de pouvoir, pour bien servir la "cause de la nation". Mais Macron n’a pas seulement adopté ce langage, il l’a mis en pratique en recrutant délibérément des soutiens et des supporters à la fois de gauche et de droite pour son nouveau mouvement "En marche". Son affirmation de ne servir "ni la gauche ni la droite, mais seulement la France" l’a aidé à désarmer politiquement Marine Le Pen. Il a même été capable de présenter le FN comme appartenant lui-même à "l’establishment", comme un parti de droite depuis longtemps.
En second lieu, Macron a répondu au dégoût général croissant vis-à-vis des partis existants en mettant en avant, non pas un parti, mais un mouvement et surtout en se mettant en avant … lui-même. Ce faisant, il prenait en considération une mode de plus en plus grande au sein de parties de la société bourgeoise : l’aspiration à l’autorité d’un leader fort. Si un politicien "irresponsable" comme Trump pouvait avoir du succès avec cette tactique, pourquoi pas Macron (qui se voit comme hautement responsable !) ? Au lieu de prendre en otage un ou deux des principaux partis établis, Macron a incité, de l’extérieur, à une sorte de mutinerie dans les partis et à la défection dans chacun d’entre eux. En tant que tel, il a sérieusement contribué à faire des dégâts dans ces partis. Selon une théorie du sociologue allemand Max Weber (1864-1920), la "direction charismatique" est une des trois formes de la domination bourgeoise. Dans la période après Deuxième Guerre mondiale, en France, il y a une tradition : celle du Général de Gaulle (1890-1970) qui en 1958, "a sauvé" une nation qui était dans les affres de la guerre d’Algérie. Ce faisant, De Gaulle a modifié la structure de la Constitution nationale et de la politique des partis d’une façon qui, à long terme, s’est avérée n’être ni particulièrement efficace, ni stable.
Mais Macron ne s’inscrit pas seulement la tradition de De Gaulle. Il est aussi l’expression d’une nouvelle tendance dans la bourgeoisie en réponse à la montée du "populisme". Aux élections du printemps de cette année, aux Pays-Bas, le premier ministre en exercice, Mark Rutte, décrivait la victoire électorale des partis "pro-Euro et pro-UE" sur l’enfant terrible du populisme de droite, Geert Wilders, comme la victoire du "bon" populisme sur le "mauvais". En Autriche, dans une tentative de contrer le FPÖ populiste, l’ÖVP conservateur, pour la première fois, est allé dans la campagne électorale, non pas sous son propre nom, jadis prestigieux, mais en tant que "liste électorale de Sebastian Kurz – ÖVP". En d’autres termes, le parti avait décidé de se cacher derrière le nom du jeune vice-chancelier dont on comptait sur le "charisme" et d’un ministre des affaires étrangères qui avait récemment menacé de mobiliser les tanks sur la frontière avec l’Italie contre les réfugiés.
En troisième lieu, Macron a suivi l’exemple de la chancelière allemande, Angela Merkel, en défendant ouvertement le "projet européen". Alors que les partis établis sapaient leur crédibilité en adoptant la rhétorique anti-européenne du FN, tout en continuant en réalité à maintenir l’adhésion de la France à l’Union Européenne, à la zone Euro et à la "zone Schengen". Cette position claire contribuait à rappeler à une société bourgeoise en désordre que le capital français est un des principaux bénéficiaires de ces institutions européennes.
Comme De Gaulle dans les années 1940 et 1950, Macron a été un coup de chance pour la bourgeoisie française aujourd’hui. C’est en grande partie grâce à lui que la France a évité d’atterrir dans une impasse politique similaire à celles où se trouvent actuellement ses homologues américain et britannique. Mais le succès à plus long terme de cette opération de sauvetage est tout, sauf garanti. En particulier, s’il arrivait quelque chose à Macron, ou si sa réputation politique s’altérait gravement, sa République en Marche risque de tomber en morceaux. C’est le handicap caractéristique de la "direction charismatique". Il en va de même pour la nouvelle star politique de l’opposition de gauche française : Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à répondre à la désagrégation de la gauche bourgeoise traditionnelle (les partis socialistes et communistes comme le trotskisme) en créant un mouvement de gauche autour de lui, d’une manière qui ressemble de façon frappante à celle de Macron lui-même. Mélenchon n’a pas perdu de temps pour jouer son rôle : canaliser le mécontentement prolétarien face aux attaques économiques à venir dans les impasses de la bourgeoisie. Quasiment du jour au lendemain, la division du travail entre les deux M, Macron et Mélenchon, est devenue un des axes de la politique de l’État français. Mais là encore, le mouvement autour de Mélenchon reste instable pour le moment, avec un risque d’éclatement si son leader chancelle.
Géographique:
- France [707]
Personnages:
- Marine Le Pen [708]
- Emmanuel Macron [709]
L’Allemagne entre la Russie et les États-Unis
- 488 lectures
Les élections générales en Allemagne sont prévues pour la mi-septembre. L’Allemagne a aussi vu la montée d’un parti populiste d’opposition de droite, "l’Alliance pour l’Allemagne" (AfD). Mais bien qu’il semble que ce parti puisse entrer vraisemblablement pour la première fois au parlement national, le Bundestag, il a peu de chance pour le moment de mettre à mal les plans des principales fractions de la bourgeoisie allemande, politiquement et économiquement relativement stables. La campagne électorale actuelle de la chancelière Merkel nous en dit beaucoup sur la situation du capitalisme allemand. Son mot d’ordre est : stabilité. Sans utiliser les mêmes mots, sa démarche semble inspirée par celle d’après-guerre de son prédécesseur, le chancelier démocrate- chrétien, Konrad Adenauer, qui jadis faisait campagne avec la devise "pas d’expériences nouvelles". Dans les circonstances présentes, "pas d’expériences nouvelles" est l’expression de la compréhension que l’Allemagne a d’elle-même comme étant plus ou moins le seul havre de stabilité politique parmi les puissances majeures du monde occidental actuellement. Mais derrière cette fixation sur la stabilité, il y a aussi une alarme croissante. La principale source de consternation de la classe dominante allemande, ce sont les États-Unis. Nous avons déjà mentionné les menaces protectionnistes de Trump. Il y aussi son retrait unilatéral de l’accord de Paris sur le climat, et en particulier, l’offensive américaine contre l’industrie automobile allemande qui a commencé sous l’administration Obama. Mais la menace contre les intérêts de l’impérialisme allemand ne se limite pas aux questions économiques ou environnementales. Elle concerne d’abord et avant tout les questions militaires et soi-disant de sécurité. Une brève récapitulation historique est ici nécessaire.
Sous le règne de la coalition "Vert-Rouge", dirigée par les sociaux-démocrates de Gerhard Schröder (1998-2005), l’Allemagne s’était rapprochée de la Russie de Poutine, en développant des projets communs pour l’énergie, et en rejoignant Moscou (et Paris) dans le refus de soutenir la guerre de George W. Bush en Irak. La successeuse de Schröder, Merkel, comme beaucoup de politiciens de l’ancienne Allemagne de l’Est (RDA), une "atlantiste" loyale, a modifié cette orientation en réaffirmant le "partenariat" avec l’Amérique comme pierre angulaire de la politique étrangère allemande. Sous Obama, Washington a offert à Berlin le rôle de bras droit des États-Unis en Europe. L’Allemagne était appelée à assumer une plus grande partie du travail de l’OTAN en Europe, permettant à l’Amérique de se concentrer d'avantage sur l’Extrême-Orient et son principal rival, la Chine. En retour, pour ce rehaussement de statut, Merkel devait abandonner "le rapport spécial" avec Moscou que Schröder avait inauguré. Mais en même temps, Washington réassurait Berlin qu’il "n’abandonnait pas l’Europe à son destin", en modernisant la présence militaire américaine en Allemagne, y compris au niveau militaire. Mais sous la surface, déjà pendant le second mandat d’Obama, des tensions sont apparues entre Berlin et Washington. C’est devenu visible pendant la "crise des réfugiés" de l’été 2015. Les appels de la bourgeoisie allemande à un soutien américain ont été négligés de manière presque démonstrative. Ce que demandait Berlin n’était pas que les États-Unis accueillent des Syriens ou d’autres réfugiés, mais qu’ils interviennent politiquement et même militairement de manière à tenter de stabiliser la situation en Syrie, Lybie et ailleurs dans le bassin méditerranéen. Mais Washington n’a rien fait en ce sens. Au contraire, Obama a affirmé de façon répétée que la "crise des réfugiés était seulement le problème de l’Europe". Mais c’est surtout sur la politique à l’égard de la Russie que les rapports entre Berlin et Washington sont devenus de plus en plus conflictuels. L’Allemagne sous Merkel a soutenu et soutient encore la politique de l’OTAN d’encerclement de la Russie et espère, en tant que bras droit de l’Amérique, être un de ses principaux bénéficiaires. Mais elle s’est opposée et s’oppose à la stratégie américaine (dont Hillary Clinton était la championne, bien plus que Barak Obama) de remplacer le gouvernement Poutine à Moscou. D’ailleurs, sur cette question, l’opposition au sein de la bourgeoisie européenne s’amplifie, même si elle ne s’exprime pas toujours ouvertement.[1] Après la chute de la coalition "Rouge-Vert" de Schröder, la fraction de la bourgeoisie allemande qui a des liens étroits avec la Russie n’a ni disparu, ni n’est restée inactive. En particulier, avec la formation du gouvernement de la Grande Coalition entre les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates il y a 4 ans, les "amis de Poutine" au sein du SPD sont revenus au pouvoir. On peut parler d’une certaine division du travail entre les fractions de Merkel et de Schröder, et c’est probablement plus astucieux et plus favorable aux intérêts allemands, si les amis de Schröder ne jouent que le rôle de partenaires mineurs dans le gouvernement (comme c’est le cas actuellement). Mais il y a aussi eu des activités en coulisses de cette fraction. Selon les premiers résultats des investigations publiques sur les connexions de la Russie avec Trump aux États-Unis, la Deutsche Bank a joué un rôle central en encourageant les affaires et d’autres transactions entre Trump et "l’oligarchie russe". Elle préfère voir Poutine soutenu plutôt que renversé par "l’Occident". On sait aussi que des parties de l’industrie allemande ont généreusement contribué à la campagne électorale de Trump.
***Et c’est un secret de Polichinelle que l’un des bastions de la fraction Schröder-Gabriel [2] en Allemagne est la province de Basse-Saxe et la firme Volkswagen que cet État provincial possède et exploite en partie. Avec cet éclairage, on peut mieux comprendre que les procès contre Volkswagen et la Deutsche Bank aux États-Unis ne sont pas motivés qu’économiquement, mais surtout politiquement, et pourquoi, sept semaines avant les élections générales nationales, une lutte de pouvoir s’est instaurée en Basse-Saxe (et chez Volkswagen) mettant fin à la coalition Rouge-Vert à Hanovre. Bien qu’elle ne partage pas nécessairement ses orientations, la chancelière Merkel a, dans une certaine mesure, toléré les activités de cette autre fraction et a essayé de bénéficier de ses liens à la fois avec Poutine et Trump. Aujourd’hui cependant, les "faucons" antirusses à Washington font monter la pression non seulement sur Trump, mais aussi sur le gouvernement Merkel. La réponse de Merkel a été typiquement à double face. D’un côté, elle maintient ses contacts avec les trumpistes. De l’autre, elle maintient le nouveau leadership américain à une distance démonstrative en public. Il y a peu de pays en Europe occidentale où la critique de la nouvelle administration à Washington soit aussi ouverte et sévère, et autant partagée par l’ensemble de la classe politique qu’en Allemagne. De pair avec Erdogan, Trump a éclipsé Poutine en tant que "méchant" comme cible favorite des médias allemands. Nous sommes en droit de conclure que la bourgeoisie allemande a d'avantage profité des mauvaises manières politiques et autres déclarations à l’emporte-pièce dans le camp de Trump, pour prendre des distances politiques avec les États-Unis à un degré où, dans d’autres circonstances, cela aurait provoqué un scandale international. Dans ces circonstances, la pression exercée par Washington (accrue par Trump) sur les "partenaires" européens de l’OTAN – l’Allemagne en particulier - pour qu’ils augmentent leur budget militaire est en réalité plus que bienvenue (même si beaucoup de politiciens affirment le contraire en public). Berlin a déjà mis en œuvre cette augmentation. Le projet est d’augmenter les dépenses militaires des 1,2% actuels du PIB allemand à 2% en 2024 – presque le double du taux actuel. Si c’était conforme à la demande de Trump de 3% du PIB, l’Allemagne aurait le plus gros budget militaire des États européens (au moins 70 milliard par an). De plus, l’Allemagne a récemment changé officiellement sa "doctrine de défense". Après la fin de la Guerre froide, il avait été officiellement déclaré que l’Allemagne et l’Europe occidentale n’étaient plus sous menace militaire directe. Aujourd’hui, cette doctrine a été révisée, établissant que la "défense du territoire" est une fois de plus le principal but de la Bundeswehr. Avec cette nouvelle doctrine, l’État allemand ne réagit pas qu’à la contre-offensive récente de la Russie en Ukraine et en Syrie, mais aussi aux craintes grandissantes à l’égard de la stabilité politique de la Russie, et du chaos qui pourrait s’y développer. L’Allemagne profite aussi du "Brexit" pour accroître la militarisation des structures de l’Union Européenne et manifester une certaine indépendance vis-à-vis de l’OTAN (chose que la Grande-Bretagne était capable d’empêcher tant qu’elle était un membre actif de l’UE). Sous le mot d’ordre de "guerre au terrorisme", et "guerre à l’entrée illégale d’immigrants", l’UE a déclaré ne plus être seulement une union économique ou politique, mais aussi (et même "par-dessus tout" selon Merkel et Macron) une "union sécuritaire".
[1] Par exemple, lors d’un symposium à Berlin, cet été, organisé par le Neue Zürcher Zeitung, il était mis en avant que le principal danger pour la stabilité de l’Europe n’est pas le régime de Poutine, mais l’effondrement possible du régime de Poutine.
[2] Schröder est officiellement sur la liste du personnel du projet de pipeline allemand avec Gazprom russe. Gabriel, qui en est venu récemment à prôner une "solution fédérale" au conflit en Ukraine peu différente de celle dont Moscou fait la propagande, est le nouveau ministre des affaires étrangères d’Allemagne.
Le tandem franco-germanique
- 498 lectures
La bourgeoisie allemande a été parmi les toutes premières à reconnaître le talent et le potentiel politiques d’Emmanuel Macron. Dès le début de la campagne électorale française, une grosse partie de la classe politique en Allemagne et presque l’ensemble des médias soutenaient vigoureusement sa candidature. Evidemment, la bourgeoisie allemande ne dispose que de moyens limités pour influencer directement une élection française. En France, le grand public ne suit ni les médias allemands, ni ce qu’y disent les politiciens. Mais "l’élite politique" française prend nécessairement note de ce qui est dit ou fait de l’autre côté du Rhin. Avec sa position claire en sa faveur, la bourgeoisie allemande a contribué à convaincre les sphères influentes proches du pouvoir en France que Macron était un homme politique capable et sérieux. Ce soutien des Allemands à Macron n’était pas seulement motivé par la volonté d’arrêter Marine Le Pen, et de sauver l’Union Européenne. Macron a aussi été le seul candidat présidentiel à faire du renouveau du tandem franco-germanique un des points centraux de son programme électoral.
Macron a pris cet axe Paris-Berlin très au sérieux. Selon lui, la France n’est pas encore capable d’assumer son rôle dans une telle "alliance", parce qu’elle n’a pas encore résolu ses problèmes économiques. Il n’y a qu’une France revivifiée économiquement, dit-il, qui pourrait représenter quelque chose de similaire à un partenaire égal de l’Allemagne. Il voit sa perte relative de compétitivité économique comme la principale menace de la stature de la France dans sa capacité à jouer un rôle dans "la cour des grands" à une échelle internationale. Pour cette raison, Macron pose l’acceptation de son programme économique comme condition de la constitution d’un axe solide avec l’Allemagne. En posant les choses en ces termes, il a formulé un programme d’action qui peut apparaître à première vue souhaitable et réaliste pour la classe dominante de son pays. Il présente sa "réforme" comme la condition du maintien de la gloire impérialiste de la France, et en même temps, comme quelque chose de souhaitable et de réalisable – parce que ce sera soutenu par l’Allemagne. Par la même occasion, il a formulé un objectif à la fois souhaitable et réalisable pour la classe dominante allemande. Que ce soit vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis des États-Unis, Berlin a besoin de l’appui de Paris. Pour l’obtenir, Berlin devra soutenir la "modernisation" économique de la France.
L’insistance de Macron sur son programme économique comme étant la condition de tout le reste ne signifie pas qu’il a une vision économique limitée des problèmes auxquels la France est confrontée. Selon une ancienne analyse d’un de ses prédécesseurs en tant que président français, Valery Giscard d’Estaing, le principal problème économique de la France n’est pas son appareil industriel et agricole, qui est en grande partie hautement et efficacement compétitif, mais son appareil politique arriéré, et le rapport bureaucratique, rigide, qui lie la politique à son économie (le "système étatique" existant en France, qu’Helmut Schmidt et d’autres dirigeants allemands ont critiqué depuis des décennies). Macron veut faire face à ce problème aujourd’hui. À sa façon, un peu comme Trump aux États-Unis, il veut "bousculer" les vieilles élites. Mais il doit aussi surmonter la résistance possible de la classe ouvrière française. Que Macron soit capable ou non d’imposer ses attaques contre les conditions de vie et de travail du prolétariat français, pourrait bien décider du sort de l’expérience d’En Marche et de la présidence de Macron, pouvant se solder par un succès comme par un échec.
Chaque fois que Macron parle du tandem franco-germanique, alors qu’il mentionne toujours ces dimensions politiques et économiques, il insiste sur le fait que cela doit être vu, d’abord et avant tout, comme une question militaire (une question de "sécurité"). En réalité, l’axe dont parlent Macron et Merkel n’est pas une alliance impérialiste stable, comme c’était encore possible dans les conditions de la Guerre froide. Cela ressemble plus à un arrangement fondé sur une plus grande détermination à défendre une politique commune de certains pays de l’UE –exprimée par la réaction au Brexit– et à diminuer la dépendance vis-à-vis des États-Unis en réaction aux "positions" de Trump. L’association entre l’Allemagne et la France dans un tandem dirigeant de l’UE est rendue possible par la complémentarité entre ces deux pays. La France est la puissance militaire dominante en Europe, sur le même pied que la Grande-Bretagne, et réellement plus forte que l’Allemagne, et pas seulement du fait qu’elle possède l’arme nucléaire. La codirection avec la France pourrait bénéficier à l’Allemagne en lui conférant une crédibilité politique et diplomatique plus grande. Par ailleurs, la France pourrait attendre des retombées positives d’une alliance avec le leader économique de l’Europe, principalement une contre-tendance au déclin économique et politique qu’elle subit. Et plus. L’existence d’une telle codirection présente l’avantage de susciter moins de craintes chez les autres partenaires de l’UE qu’une Allemagne qui en assume à elle seule le leadership.
Les premières consultations gouvernementales franco-germaniques après l’élection de Macron ont décidé, entre autres, de la mise en chantier d’un avion de combat commun pour remplacer à la fois l’Eurofighter et le Rafale ; le renforcement de "Frontex" contre les réfugiés et la mise en place d’un registre commun d’entrée et de sortie dans l’UE ; sous la direction de l’Allemagne, le développement, avec l’Italie et l’Espagne, d’un drone militaire européen ; de nouveaux investissements dans des tanks modernes, dans la technologie spatiale et des bateaux de guerre. Le "ministre des affaires étrangères" de l’UE, Mogherini, s’est joint à Merkel et Macron pour déclarer une "alliance européenne pour la zone du Sahel". L’Allemagne a déclaré sa volonté, "en principe", d’accroitre ses investissements privés et publics en Europe et d’apporter son soutien financier aux missions militaires françaises actuelles en Afrique. Tout cela derrière le mot d’ordre : "Protéger l’Europe".
Géographique:
- Allemagne [247]
Personnages:
- Angela Merkel [586]
- Emmanuel Macron [709]
En guise de conclusion
- 439 lectures
L’œil du cyclone du capitalisme en décomposition est aujourd’hui le pays central du système bourgeois : les États-Unis. Le triomphe électoral d’un président qui personnifie la vague populiste a déjà démontré à quel point cette émergence est contraire aux intérêts "rationnels" du capital national et des factions de la bourgeoisie qui les représentent le mieux (au niveau sécuritaire, militaire, diplomatique et politique) qui ont le plus le sens des "besoins de l’État". Là, la tendance dominante à présent est clairement l’intensification des tensions et même une impasse authentique au sein de la classe dominante. Mais, précisément parce que les États-Unis sont si centraux pour le monde capitaliste, la pression sur la bourgeoisie américaine s’accroît chaque jour pour essayer de trouver une solution à cette situation difficile. Mais comment ? Pour le moment, il ne semble pas que l’administration Trump soit capable d’imposer sa politique – la résistance au sein de la classe dominante semble être trop forte. Une autre possibilité est que les trumpistes cèdent et adoptent tacitement la politique de leurs opposants (ou au moins, se montrent plus enclins à des compromis). Bien qu’il y ait des signes dans ce sens, il y a aussi des signes qui vont aussi dans le sens contraire. L’option la plus en discussion est "l’impeachment" du président. L’inconvénient de cette méthode, qui vise à écarter Trump du bureau ovale, est qu’elle menace de devenir une procédure politique, légalement compliquée et qui s’éternise. D’autres options, prometteuses d’une résolution plus rapide du problème, sont sans aucun doute sur la table aussi, même si elles ne sont pas discutées aussi librement : l’une d’entre elles est de faire reconnaître et déclarer le président "dément", donc incapable. Il est aussi possible que Trump (ou quelqu’un d’autre) essaie de sortir de l’impasse avec des aventures militaires à l’étranger. Un des avantages de la "guerre contre le terrorisme" menée par George W. Bush était qu’il permettait à son gouvernement, au moins temporairement, d’unifier la classe dominante derrière lui, et d’imposer de grandes parties de son programme "néo-conservateur". Aujourd’hui, des pays comme la Corée du Nord ou l’Iran offrent des cibles tentantes pour de telles opérations, puisqu’elles sont étroitement liées, non seulement à la Russie, mais aussi à la Chine. S’il y a une chose sur laquelle la bourgeoisie américaine est d’accord, c’est que Pékin est le principal rival aujourd’hui.
Steinklopfer, 23.08.17et réactualisé.
22ème congrès du CCI : Résolution sur la lutte de classe internationale
- 854 lectures
1. L’élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, qui a suivi de près les résultats inattendus du referendum au Royaume-Uni sur l’Union Européenne, a créé une vague de malaise, de peur, mais aussi de questionnement dans le monde. Comment "nos" dirigeants, ceux qui sont supposés être en charge de l’ordre mondial actuel, ont-ils pu laisser arriver de telles choses – une tournure des événements qui semble aller contre les intérêts "rationnels" de la classe capitaliste ? Comment s’est-il fait qu’un fier-à-bras, un voyou, un arnaqueur narcissique qui raconte n’importe quoi, soit maintenant à la tête de l’État le plus puissant du monde ? Et plus important : qu’est-ce que ça nous enseigne sur vers quoi va le monde aujourd’hui ? Sommes-nous en train de plonger dans une crise de civilisation, ou même de l’humanité elle-même? Ce sont des questions auxquelles les révolutionnaires doivent donner des réponses claires et convaincantes.
Un siècle de lutte classe
2. Dans notre vision, la condition réelle de la société humaine ne peut être comprise qu’en la regardant du point de vue de la lutte de classe, de la classe exploitée de cette société, le prolétariat, qui n’a pas intérêt à cacher la vérité et dont la lutte l'oblige à surmonter toutes les mystifications du capitalisme en vue de le renverser. Il n’est possible, également, de comprendre les événements "actuels", immédiats ou localux qu’en les situant dans un cadre historique mondial. C'est là l'essence de la méthode marxiste. C’est pour cette raison, et pas simplement parce que 2017 est le centenaire de la révolution en Russie, que nous commençons par revenir un siècle en arrière ou plus pour comprendre l’époque historique au sein de laquelle les développements les plus récents de la situation mondiale ont eu lieu : celle du déclin ou décadence du mode capitaliste de production.
La révolution en Russie a été la réponse de la classe ouvrière aux horreurs de la première guerre impérialiste mondiale. Comme ce fut affirmé par l'Internationale communiste en 1919, cette guerre a marqué le commencement de la nouvelle époque, la fin de la période ascendante du capitalisme, de la première grande explosion de "globalisation" capitaliste parce qu’elle entrait en collision avec les barrières que posait la division du monde entre États nationaux rivaux : "l'époque des guerres et des révolutions". La capacité de la classe ouvrière de renverser l'État bourgeois dans tout un pays et de se doter d'un parti politique capable de la guider vers la "dictature du prolétariat" montrait que la perspective d'abolir la barbarie capitaliste était une possibilité et une nécessité historiques.
Plus encore, le Parti bolchevique qui, en 1917, était à l’avant-garde du mouvement révolutionnaire, a su voir que la prise du pouvoir par les conseils ouvriers en Russie ne pouvait se maintenir que si c’était le premier assaut d’une révolution mondiale naissante. La révolutionnaire allemande, Rosa Luxemburg, a également compris que si le prolétariat mondial ne répondait pas au défi posé par l’insurrection d’Octobre, et ne mettait pas fin au système capitaliste, l’humanité serait plongée dans une époque de barbarie croissant, une spirale de guerres et de destruction qui mettrait danger la civilisation humaine.
Avec la révolution mondiale en vue, et avec la nécessité de créer pour le prolétariat un pôle de référence alternatif à la Social-Démocratie désormais contre-révolutionnaire, le Parti bolchevique a pris la tête de la création de l'Internationale communiste dont le premier congrès s'est tenu à Moscou en 1919. Les nouveaux partis communistes, particulièrement ceux en Allemagne et en Italie, étaient les fers de lance de l'extension de la révolution prolétarienne vers l'Europe de l'Ouest.
3. La révolution en Russie a bien sûr été l’étincelle d’une série de grèves de masse à l’échelle du monde et de soulèvements qui ont contraint la bourgeoisie à mettre fin à la boucherie impérialiste, mais la classe ouvrière internationale n’a pas été capable de prendre le pouvoir dans d’autres pays, à part quelques tentatives limitées dans le temps en Hongrie et dans quelques villes allemandes. Confrontée cependant à la plus grande menace de son fossoyeur potentiel, la classe dirigeante a été capable de surmonter ses rivalités les plus aiguës pour s’unir contre la révolution prolétarienne : en isolant le pouvoir des soviets en Russie par le blocus, l’invasion et le soutien à la contre-révolution armée, en se servant des partis ouvriers sociaux-démocrates et des syndicats, qui avaient déjà démontré leur loyauté au capital en participant à l’effort de guerre impérialiste, pour infiltrer ou neutraliser les conseils ouvriers en Allemagne et les dévoyer vers un accommodement avec le nouveau régime bourgeois "démocratique". Mais la défaite de la révolution n’a pas seulement démontré la capacité à gouverner d’une nouvelle classe dirigeante réactionnaire qui s'est maintenue; elle a aussi résulté de l’immaturité de la classe ouvrière qui a été forcée de faire une transition rapide de ses luttes pour des réformes à la lutte pour la révolution, alors qu'elle portait encore en elle beaucoup d’illusions profondes sur la possibilité d’améliorer le régime capitaliste grâce au vote démocratique, à la nationalisation des industries clefs ou à la gratuité des avantages sociaux pour les couches les plus pauvres de la société. De plus, la classe ouvrière a été gravement traumatisée par les horreurs de la guerre, dans laquelle la fine fleur de la jeunesse avait été décimée, et en est sortie avec de profondes divisions entre ouvriers des nations "victorieuses" et "vaincues".
En Russie, le parti bolchevique, confronté à l’isolement, à la guerre civile, et à l’effondrement économique, et plus encore, impliqué dans l’appareil de l’État soviétique, a fait une série d’erreurs désastreuses qui l’ont de plus en plus conduit à des conflits violents avec la classe ouvrière, notablement la politique de la "terreur rouge" qui impliquait la suppression des manifestations et des organisations politiques, culminant dans l’écrasement de la révolte de Cronstadt en 1921, quand cette dernière réclamait la restauration du pouvoir authentique des soviets qui avait existé en 1917. Au niveau international, l’Internationale Communiste, qui était aussi de plus en plus liée aux besoins de l’État soviétique plutôt qu'à ceux de la révolution mondiale, a commencé à recourir à des politiques opportunistes qui ont sapé sa clarté originelle, comme la tactique du front unique adoptée en 1922.
Cette dégénérescence a suscité l'émergence d'une opposition de Gauche importante, notamment dans les partis allemand et italien. Et c'est à partir de cette dernière que la Fraction italienne a été capable, à la fin des années 1920, de dégager les leçons de la défaite finale de la révolution.
4. La défaite de la vague révolutionnaire mondiale a donc confirmé les mises en garde des révolutionnaires en 1917-18 à propos des conséquences d’un tel échec : un nouvel enfoncement dans la barbarie. La dictature du prolétariat en Russie, a non seulement dégénéré, mais s’est transformée en dictature capitaliste contre le prolétariat, un processus qui a été confirmé (alors qu’il avait déjà commencé avant) par la victoire de l’appareil stalinien avec sa doctrine du "socialisme dans un seul pays". La "paix" mise en place pour en finir avec la menace de la révolution a rapidement mené à de nouveaux conflits impérialistes qui ont été accélérés et intensifiés par l’éclatement de la crise de surproduction en 1929, un signe supplémentaire du fait que l’expansion du capital entrait en collision avec ses propres limites. La classe ouvrière dans les pays centraux du système, spécialement aux États-Unis et en Allemagne, a pleinement subi les coups de la dépression économique, mais ayant tenté et échoué de faire la révolution une décennie avant, c’était fondamentalement une classe défaite, malgré certaines expressions réelles de résistance de classe, comme aux États-Unis et en Espagne. Elle a donc été incapable de s’opposer à une nouvelle marche vers la guerre mondiale.
5. La fourche de la contre révolution avait trois dents principales : le stalinisme, le fascisme, la démocratie, chacune d’entre elles a laissé des profondes cicatrices dans la psyché de la classe ouvrière.
La contre-révolution a atteint sa plus grande profondeur dans les pays où la flamme révolutionnaire s’était élevé le plus haut. Mais partout, confrontée à la nécessité d’exorciser le spectre prolétarien, pour faire face à la plus grande crise économique de son histoire, et pour préparer la guerre, le capitalisme a pris une forme toujours plus totalitaire, pénétrant par tous les pores de la vie sociale et économique. Le régime stalinien donnait le ton : une économie de guerre complète, la répression de tous les dissidents, des taux d’exploitation monstrueux, un vaste camp de concentration. Mais le pire legs du stalinisme – de son vivant tout autant que des décennies après son effondrement – est qu’il a pris le masque du véritable héritier de la révolution d’octobre. La centralisation du capital dans les mains de l’État a été vendue au monde comme du socialisme, l’expansion impérialiste comme de l’internationalisme prolétarien. Bien que, dans les années où la révolution d’octobre était encore un souvenir vivant, beaucoup d’ouvriers aient continué à croire au mythe de la mère patrie socialiste, beaucoup plus s’étaient détournés de toute idée de révolution avec les révélations successives de la véritable nature du régime stalinien. Les dégâts qu’a faits le stalinisme à la perspective du communisme, à l’espérance que la révolution de la classe ouvrière puisse inaugurer une forme supérieure d’organisation sociale, sont incalculables, et pas moins parce que le stalinisme n’est pas tombé du ciel sur le prolétariat mais a été rendu possible par la défaite internationale du mouvement de classe et surtout la dégénérescence de son parti politique. Après la trahison traumatisante des partis sociaux-démocrates en 1914, pour la seconde fois, en l’espace de moins de 20 ans, les organisations que la classe ouvrière avait travaillé puissamment à créer et à défendre ont trahi et son devenues son pire ennemi. Pouvait-il y avoir un plus grand coup porté à la confiance en lui du prolétariat, à sa conviction dans la possibilité d’amener l’humanité à un niveau de vie sociale plus élevé ?
Le fascisme, initialement un mouvement d’exclus des classes dominantes et moyennes, et même de renégats du mouvement ouvrier, a pu être adopté par les factions les plus puissantes du capital allemand et italien parce qu’il coïncidait avec leurs besoins : achever l’écrasement du prolétariat et la mobilisation pour la guerre. Il s’était spécialisé dans l’utilisation de techniques "modernes" pour déchaîner les sombres forces de l’irrationalité qui reposent sous la surface de la société bourgeoise. Le nazisme, en particulier, le produit d’une défaite beaucoup plus dévastatrice de la classe ouvrière en Allemagne, a atteint de nouveaux niveaux dans l’irrationalité, en étatisant et industrialisant le pogrom médiéval et en conduisant les masses démoralisées dans une marche folle vers leur autodestruction. La classe ouvrière, dans son ensemble, n’a pas succombé à une quelconque croyance positive dans le fascisme –au contraire, elle était beaucoup plus vulnérable au leurre de l’antifascisme, qui était le principal cri de ralliement de la guerre à venir. Mais l’horreur sans précédent des camps de la mort nazis n’en a pas moins été, que le goulag stalinien, un coup porté à la confiance dans le futur de l’humanité –et donc à la perspective du communisme.
La démocratie, la forme dominante de la domination bourgeoisie dans les pays industriels avancés, s’est présentée comme l’opposante à ces formations "totalitaires" - ce qui ne l’empêchait pas de soutenir le fascisme quand il achevait le mouvement ouvrier révolutionnaire, ou en s’alliant avec le régime stalinien dans la guerre contre l’Allemagne d’Hitler. Mais la démocratie s’est avérée être une forme beaucoup plus intelligente et durable de totalitarisme que le fascisme, qui s’est effondré dans les décombres de la guerre, ou le stalinisme qui (à l’exception notable de la Chine et du régime atypique de la Corée du Nord) allait tomber sous le poids de la crise économique et de son incapacité à être compétitif sur le marché mondial, dont il avait essayé de contourner les lois par décret d’État.
Les gestionnaires du capitalisme démocratique ont aussi été forcés par la crise du système d’utiliser l’État et le pouvoir du crédit pour faire plier les forces du marché, mais ils n’ont pas été obligés d’adopter la forme extrême de centralisation de haut en bas des régimes du bloc de l’Est, imposée par une situation de faiblesse matérielle et stratégique. La démocratie a survécu à ses rivaux et est devenue la seule option dans les pays centraux capitalistes d’occident. Jusqu’à aujourd’hui, c'est choquant de remettre en question la nécessité d’avoir soutenu la démocratie contre le fascisme durant la 2ème Guerre Mondiale, et ceux qui disent que derrière la façade démocratique il y a la dictature de la classe dominante sont rejetés comme étant des théoriciens du complot. Déjà, pendant les années 1920 et 1930, le développement des media de masse dans les démocraties constituait un modèle pour la diffusion de la propagande officielle qui faisait envie à un Goebbels, tandis que la pénétration des rapports marchands dans les sphères des loisirs et de la vie de famille, introduite par le capitalisme américain, fournissait un canal plus subtil à la domination totalitaire du capital que le simple recours aux mouchards et à la terreur sans fard.
6. Contrairement aux espoirs de la minorité révolutionnaire très réduite qui maintenait des positions internationalistes pendant les années 1930 et 1940, la fin de la guerre n’a pas conduit à un nouveau surgissement révolutionnaire. Au contraire, ce fut la bourgeoisie, avec Churchill à l’avant-garde, qui a tiré les leçons de 1917 et détruit dans l’œuf toute possibilité de révolte prolétarienne, avec son tapis de bombes sur les villes allemandes et sa politique de "laisser les italiens mariner dans leur propre jus", lors du resurgissement de grèves massives au Nord de l’Italie en 1943. La fin de la guerre a donc approfondi la défaite de la classe ouvrière. Et, de nouveau contrairement aux attentes de beaucoup de révolutionnaires, la guerre n’a pas été suivie par une nouvelle dépression économique et une nouvelle marche à la guerre mondiale, même si les antagonismes impérialistes entre "blocs victorieux" subsistaient comme une menace permanente pesant sur l’humanité. La période post-guerre a vu, à la place, une phase de réelle expansion des rapports capitalistes sous le leadership américain, même si une partie du marché mondial (le bloc russe et la Chine) tentait de se fermer à toute pénétration de capital occidental. La poursuite de l’austérité et de la répression dans le bloc de l’Est a provoqué des révoltes ouvrières importantes (Allemagne de l’Est, 1953 ; Pologne et Hongrie, 1956), mais à l’ouest, après quelques expressions de mécontentement, comme les grèves de 1947 en France, il y a eu une atténuation graduelle de la lutte de classe, à un point tel que les sociologues ont pu commencer à théoriser "l’embourgeoisement" de la classe ouvrière, conséquence de l’expansion du consumérisme et du développement de l’État Providence. Et d’ailleurs, ces deux aspects du capitalisme après 1945 ont constitué un poids supplémentaire important affectant la possibilité de la classe ouvrière de se reconstituer en force révolutionnaire : le consumérisme atomise la classe ouvrière, et répand l’illusion que chacun peut atteindre le paradis de la propriété individuelle ; le providentialisme – qui a souvent été introduit par les partis de gauche et présenté comme une conquête de la classe ouvrière, est un instrument encore plus significatif du contrôle capitaliste. Il sape la confiance de la classe ouvrière en elle-même et la rend dépendante de la bienveillance de l’État ; et plus tard, dans une phase d’immigration massive, son organisation par l’État-nation allait signifier que la question de l’accès aux soins, aux logements, et autres prestations deviendrait un puissant facteur de bouc-émissarisation des immigrés et de divisions dans la classe ouvrière. En même temps, de pair avec la disparition apparente de la lutte de classe dans les années 1950 et 1960, le mouvement politique révolutionnaire s’était réduit au plus grand isolement de son histoire.
7. Certains de ces révolutionnaires qui ont maintenu une activité pendant cette période noire, ont commencé à dire que le capitalisme avait, grâce à une gestion bureaucratique étatique, appris à contrôler les contradictions économiques analysées par Marx. Mais d’autres, plus clairvoyants, comme le groupe Internationalismo au Venezuela, ont reconnu que les vieux problèmes – les limites du marché, la tendance à la chute du taux de profit – ne pouvaient être conjurés, et que les difficultés financières subies à la fin des années 1960, marquaient une nouvelle phase de crise économique ouverte. Ils ont aussi salué la capacité d’une nouvelle génération de prolétaires de répondre à la crise par la réaffirmation de la lutte de classe – une prédiction amplement confirmée par le formidable mouvement de mai 1968 en France, et la vague de luttes internationales qui a suivi, qui ont démontré que les décennies de contre-révolution arrivaient à leur fin, et que la lutte du prolétariat devenait un obstacle à l'ouverture par la nouvelle crise d'un cours à la guerre mondiale.
8. Le surgissement prolétarien de la fin des années 60 et du début des années 70, avait été précédé par une fermentation politique croissante au sein de larges couches de la population dans les pays capitalistes avancés et, en particulier, chez les jeunes. Aux États-Unis, les manifestations contre la guerre au Vietnam et la ségrégation raciale, les mouvements chez les étudiants en Allemagne qui manifestaient un intérêt pour une démarche plus théorique de l’analyse du capitalisme contemporain ; en France, l’agitation des étudiants contre la guerre au Vietnam et le régime répressif dans les universités ; en Italie, les "opéraïstes" ou tendances autonomes qui réaffirmaient l’inévitabilité de la lutte de classe quand les sages sociologues proclamaient qu’elle était obsolète. Partout, une insatisfaction grandissante vis-à-vis de la vie déshumanisée présentée comme le fruit délicieux de la prospérité économique d’après-guerre. Une petite minorité, portée par le surgissement des luttes combatives en France et dans d’autres pays industriels, a pu participer à la formation d’une avant-garde politique consciente, internationaliste, et pas moins parce qu’une minorité en son sein avait commencé à redécouvrir la contribution de la Gauche Communiste.
9. Comme nous ne le savons que trop, le rendez-vous entre la minorité et le mouvement de classe plus large n’a eu lieu qu’épisodiquement pendant les mouvements de la fin des années 60 et début 70. C’était en partie le résultat du fait que la minorité politisée était lourdement dominée par une petite bourgeoisie mécontente : le mouvement étudiant, en particulier, n’avait pas cette forte composante prolétarienne qui est apparue du fait des changements dans l’organisation du capitalisme au cours des quelques décennies suivantes. Et malgré des mouvements de classe puissants dans le monde, malgré de sérieuses confrontations entre les ouvriers et les forces de contrôle en leur sein – syndicats et partis de gauche – la majorité des luttes de classe sont restées des luttes défensives et n’ont que rarement posé directement des questions politiques. De plus, la classe ouvrière a été confrontée à des divisions importantes dans ses rangs comme classe mondiale : le "rideau de fer" entre l’Est et l’Ouest, et les divisions entre les travailleurs soi-disant "privilégiés" des centres du capital et les masses déshéritées dans les anciennes zones coloniales. Tandis que la maturation d’une avant-garde politique était freinée par une vision d’une révolution immédiate, et des pratiques activistes, typiques de l’impatience petite bourgeoise, qui ne réussissaient pas à saisir le caractère à long terme du travail révolutionnaire et le niveau gigantesque des tâches théoriques auquel faisait face la minorité politisée. La prédominance de l’activisme a rendu de grandes parties de la minorité vulnérable à la récupération par le gauchisme ou, quand les luttes ont faibli, à la démoralisation. En même temps, ceux qui rejetaient le gauchisme étaient souvent entravés par des notions conseillistes qui rejetaient l’ensemble du problème de la construction de l’organisation. Cependant, une petite minorité a été capable de surmonter ces obstacles et de se réapproprier la tradition de la Gauche communiste, initiant une dynamique de croissance et de regroupement qui s’est maintenue au cours des années 1970, mais qui a connu sa fin au début des années 1980, marquée symboliquement par l’arrêt des Conférences Internationales. L’échec des luttes de cette période à atteindre un plus haut niveau politique, à jeter les graines de ce qui, dans les rues et les réunions de 1968 avait posé le problème du remplacement du capitalisme à l’Est et à l’Ouest par une nouvelle société, allait avoir des conséquences très significatives dans la décennie suivante.
Néanmoins, cet énorme poussée d’énergie prolétarienne "n’était pas seulement à bout de souffle", mais a requis un effort concerté de la classe dominante pour la dévoyer, la faire dérailler, et la réprimer. Fondamentalement, cela eut lieu au niveau politique, en utilisant au maximum les forces de la gauche capitaliste et les syndicats qui ont eu une influence considérable dans la classe ouvrière. Que ce soit par la promesse d’élire des gouvernements de gauche, ou par une stratégie plus tardive de "gauche dans l’opposition" couplée au développement du syndicalisme radical au cours des deux décennies qui ont suivi 1968, l’instrumentalisation des organes que les ouvriers voyaient dans une certaine mesure comme leurs était indispensable à l’encadrement des luttes de la classe. En même temps, la bourgeoisie tirait tous les avantages qu'elle pouvait des changements structurels que lui imposait la crise mondiale: d'une part, l'introduction de changements technologiques qui ont remplacé la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée dans des industries comme les docks, l'automobile et l'imprimerie; d'autre part, le mouvement vers la "mondialisation" du processus de production, qui a décimé des réseaux industriels entiers dans les vieux centres du capital et déplacé la production vers les régions périphériques où la main-d'œuvre était incomparablement moins chère et les profits beaucoup plus importants. Ces changements dans la composition de la classe ouvrière dans le cœur du capitalisme, qui touchaient souvent des secteurs qui avaient été au centre de la lutte dans les années 70 et au début des années 80, devinrent des facteurs supplémentaires dans l'atomisation de la classe et la destruction de son identité de classe.
10. Malgré certaines pauses, la dynamique de lutte enclenchée en 1968 s’est maintenue au cours des années 70. Le point culminant dans la maturation de la capacité du prolétariat de s’auto-organiser et d’étendre sa lutte fut atteint dans les grèves de masse en Pologne en 1980. Cependant, ce zénith a aussi marqué le début d’un déclin. Bien que les grèves en Pologne aient révélé l’interaction classique entre revendications économiques et politiques, à aucun moment, les ouvriers en Pologne n’ont posé le problème d’une nouvelle société. Sous cet aspect, les grèves étaient "en dessous" du mouvement de 68, quand l’auto-organisation était encore quelque peu embryonnaire, mais qui fournissait un contexte à un débat beaucoup plus radical sur la nécessité de la révolution sociale. Le mouvement en Pologne, à quelques exceptions près très limitées, considérait "l’occident libre" comme la société alternative qu’il voulait, l’idéal de gouvernements démocratiques, les "syndicats libres", et tout le reste. En occident même, il y avait eu quelques expressions de solidarité avec les grèves en Pologne, et à partir de 1983, face à une crise économique qui s’approfondissait rapidement, nous avons vu une vague de luttes qui étaient de plus en plus simultanées et globales dans leur ampleur ; dans un grand nombre de cas, elles montraient un conflit croissant entre travailleurs et syndicats. Mais la juxtaposition des luttes dans le monde ne signifiait pas automatiquement qu’il y avait une conscience de la nécessité de l’internationalisation consciente de la lutte, ni que la confrontation avec les syndicats, qui font bien sur partie de l’État, impliquait une politisation du mouvement dans le sens d’une prise de conscience que l’État doit être renversé, ni une capacité grandissante de mettre en avant une perspective pour l’humanité. Même encore plus que dans les années 1970, les luttes des années 80 dans les pays avancés sont restées sur le terrain des revendications sectorielles, et en ce sens, sont restées vulnérables au sabotage par les formes radicales de syndicalisme. L’aggravation des tensions impérialistes entre les deux blocs au cours de cette période a certainement fait naître une préoccupation croissante envers la menace de guerre, mais cela a été largement dévoyé vers des mouvements pacifistes qui empêchaient effectivement le développement d’une connexion consciente entre résistance économique et danger de guerre. En ce qui concerne les petits groupes de révolutionnaires qui maintenaient une activité organisée pendant cette période, bien que capables d’intervenir plus directement dans certaines initiatives de la classe ouvrière, ils allaient, à un niveau plus profond, à contre-courant face à la méfiance de la "politique" qui prévalait dans la classe ouvrière dans son ensemble - et ce fossé grandissant entre la classe et la minorité politique a lui-même été un facteur supplémentaire de l’incapacité de la classe à développer sa propre perspective.
L’impact de la décomposition.
11. La lutte en Pologne, et sa défaite, allaient s’avérer fournir un résumé du rapport de force global entre les classes. Les grèves ont clairement indiqué que les ouvriers d’Europe de l’Est n’étaient pas prêts à combattre dans une guerre au nom de l'empire russe, et cependant, ils n’étaient pas capables d’offrir une alternative révolutionnaire à la crise du système qui s’approfondissait. D’ailleurs, l’écrasement physique des ouvriers polonais a eu des conséquences politiques extrêmement négatives dans toute cette région pour la classe ouvrière absente en tant que classe dans les soulèvements qui ont initié la disparition des régimes staliniens, et de ce fait vulnérable à une vague sinistre de propagande nationaliste qui est personnifiée aujourd’hui dans les régimes autoritaires qui règnent en Russie, Hongrie et Pologne. La classe dominante stalinienne, incapable de traiter la crise et la lutte de classe sans répression brutale, a montré qu’elle manquait de flexibilité politique pour s’adapter aux circonstances historiques changeantes. Ainsi, en 1980-1981, la scène était déjà préparée pour l’effondrement du bloc de l’Est dans son ensemble, marquant une nouvelle phase dans le déclin historique du capitalisme. Mais cette nouvelle phase, que nous définissons comme celle de la décomposition du capitalisme, a ses origines dans un blocage beaucoup plus ample entre les classes. Les mouvements de classe qui ont surgi dans les pays avancés après 1968 marquaient la fin de la contre-révolution, et la résistance maintenue de la classe ouvrière constituait un obstacle à la "solution" de la bourgeoisie à la crise économique : la guerre mondiale. Il était possible de définir cette période comme un "cours à des affrontements de classe massifs", et d’insister sur le fait qu’un cours à la guerre ne pouvait s’ouvrir sans une défaite directe d’une classe ouvrière insurgée. Dans la nouvelle phase, la désintégration des deux blocs impérialistes a éliminé la guerre mondiale de l’ordre du jour indépendamment du niveau de la lutte de classe. Mais cela signifiait que la question du cours historique ne pourrait plus être posée dans les mêmes termes. L’incapacité du capitalisme à dépasser ses contradictions signifie toujours qu’il ne peut offrir à l’humanité qu’un futur de barbarie, dont on peut déjà préfigurer les contours dans une combinaison infernale de guerres locales et régionales, de désastres écologiques, de pogromes et de violence sociale fratricide. Mais à la différence de la guerre mondiale, qui requiert une défaite physique directe tout autant qu’idéologique de la classe ouvrière, cette "nouvelle" descente dans la barbarie opère de manière plus lente, plus insidieuse, qui peut embrigader graduellement la classe ouvrière et la rendre incapable de se reconstituer en tant que classe. Le critère pour évaluer l’évolution du rapport de force entre les classes ne peut plus être celui d’empêcher la guerre mondiale, et est devenu en général, plus difficile à prévoir.
12. Dans la phase initiale de la renaissance du mouvement communiste après 1968, la thèse de la décadence du capitalisme avait gagné de nombreux adeptes et fournissait le socle programmatique d’une gauche communiste revivifiée. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : la majorité des nouveaux éléments qui cherchent dans le communisme une réponse aux problèmes auxquels est confrontée l’humanité trouvent toutes sortes de raisons pour résister au concept de décadence. Et quand on en arrive à la notion de décomposition, que nous défendons, comme phase finale du déclin du capitalisme, le CCI semble plus ou moins être seul. D’autres groupes acceptent l’existence des principales manifestations de la nouvelle période – la mêlée générale inter-impérialiste, le retour d’idéologies profondément réactionnaires comme le fondamentalisme religieux, et le nationalisme rampant, la crise dans les rapports entre l’homme et le monde naturel – mais peu d’entre eux tirent la conclusion que cette situation dérive d’une impasse dans le rapport de force entre les classes ; peu d'entre eux également sont d’accord que tous ces phénomènes sont des expressions d’un changement qualitatif dans la décadence du capitalisme, de toute une phase ou période qui ne peut se renverser que par la révolution prolétarienne. Cette opposition au concept de décomposition prend souvent la forme de diatribes contre les tendances "apocalyptiques" du CCI, puisque nous en parlons comme de la phase terminale du capitalisme, ou contre notre "idéalisme" puisque, bien que nous voyions les conséquences à long terme de la crise économique comme un facteur clef de la décomposition, nous ne voyons pas simplement les facteurs économiques comme l’élément décisif dans l’entrée dans cette nouvelle phase. Derrière ces objections, il y a un échec de la compréhension du fait que le capitalisme, comme dernière société de classe dans l’histoire, est voué à cette espèce d’impasse historique, du fait que, à la différence des sociétés de classe antérieures, lorsqu'elles entraient en déclin, le capitalisme ne peut pas donner naissance en son sein à un nouveau mode de production plus dynamique, alors que la seule voie vers une forme supérieure de vie sociale doit être construite, non pas sur le produit automatique de lois économiques, mais sur un mouvement conscient de l’immense majorité de l’humanité, qui est par définition la tâche la plus difficile jamais entreprise dans l’histoire.
13. La décomposition était le produit du blocage de la bataille entre les deux principales classes. Mais elle s’est aussi révélée comme un facteur actif dans les difficultés croissantes de la classe ouvrière depuis 1989. Les campagnes très bien orchestrées sur la mort du communisme qui ont accompagné la chute du bloc russe – qui montrait la capacité de la classe dominante d’utiliser les manifestations de la décomposition contre les exploités – ont été un élément très important dans le travail de sape de la confiance en soi de la classe et de sa capacité à réaffirmer sa mission historique. Le communisme, le marxisme, la lutte de classe même ont été déclarés dépassés, rien de plus que de l’histoire morte. Mais les effets négatifs énormes et durables des événements de 1989 sur la conscience, la combativité et l'identité de classe du prolétariat ne sont pas seulement le résultat de la gigantesque campagne anti-communiste. L'efficacité de cette campagne doit elle-même être expliquée. Elle ne peut être comprise que dans le contexte du développement spécifique de la révolution et de la contre-révolution depuis 1917. Avec l'échec de la contre-révolution militaire contre l'URSS elle-même et, en même temps, la défaite de la révolution mondiale, a émergé une constellation complètement inattendue, sans précédent : celle d'une contre-révolution venant de l'intérieur d'un bastion prolétarien, et d'une économie capitaliste en Union soviétique sans aucune classe capitaliste historiquement développée. Ce qui en a résulté, ce n'est nullement l'expression d'une nécessité historique plus élevée, mais une aberration historique : la direction d'une économie capitaliste par une bureaucratie d'État bourgeois contre-révolutionnaire, une bureaucratie totalement non qualifiée et non adaptée à une telle tâche. Bien que l'économie à direction stalinienne se soit montrée efficace pour l'URSS dans l'épreuve de la seconde guerre mondiale, elle a échoué complètement, au long terme, à générer un capital national compétitif.
Bien que les régimes staliniens aient été des formes particulièrement réactionnaires de la société bourgeoise décadente, non pas une rechute dans un quelconque type de régime féodal ou despotique, ils n'étaient en aucun sens du terme des économies capitalistes "normales". Avec son effondrement, le stalinisme a rendu un dernier service à la classe dominante. Par-dessus tout, les campagnes sur la mort du communisme ont semblé trouver une confirmation dans la réalité elle-même. Les déviations du stalinisme par rapport à un capitalisme fonctionnant correctement étaient si graves et considérables, qu'il semblait effectivement ne pas être capitaliste aux yeux de la population. Avant cela, et aussi longtemps qu'il avait été capable de se maintenir, il semblait prouver que des alternatives au capitalisme sont possibles. Même si cette alternative particulière au capitalisme était tout sauf attirante pour la majorité des ouvriers, son existence, néanmoins laissait une brèche potentielle dans l'armure idéologique de la classe dominante. La résurgence de la lutte de classe dans les années 1960 fut capable de tirer profit de cette brèche pour développer la vision d'une révolution qui serait à la fois anticapitaliste et antistalinienne et basée, non sur une bureaucratie d'État ou sur un parti-État, mais sur les conseils ouvriers. Si, durant les années 1960 et 1970, la révolution mondiale était vue par beaucoup comme une utopie irréalisable, un songe-creux, c'était le résultat de l'immense pouvoir de la classe dominante ou de ce qui était considéré comme la marque égoïste et destructive inhérente à notre espèce. Cependant, de tels sentiments de désespoir pouvaient trouver, et trouvaient quelquefois un contrepoids dans les luttes massives et la solidarité du prolétariat. Après 1989, avec l'effondrement des régimes "socialistes", un facteur qualitatif nouveau a surgi : l'impression de l'impossibilité d'une société moderne non basée sur des principes capitalistes. Dans ces circonstances, il est bien plus difficile pour le prolétariat de développer, non seulement sa conscience et son identité de classe, mais aussi ses luttes économiques défensives, dans la mesure où la logique des besoins de l'économie capitaliste pèse beaucoup plus si elle semble n'avoir aucune alternative.
En ce sens, bien qu'il ne soit certainement pas nécessaire que toute la classe ouvrière devienne marxiste, ou développe une claire vision du communisme, pour faire une révolution prolétarienne, la situation immédiate de la lutte de classe est considérablement altérée, dépendant du fait si oui ou non de larges secteurs de la classe voient le capitalisme comme pouvant être remis en question.
14. Mais, œuvrant d’une façon plus sournoise, l’avancée de la décomposition en général et "en elle-même" a érodé dans la classe ouvrière son identité de classe et sa conscience de classe. C’était particulièrement évident chez les chômeurs de longue durée ou les couches employées à temps partiel "laissées pour compte" par les changements structuraux introduits dans les années 1980 : Alors que dans le passé, les chômeurs avaient été à l’avant-garde des luttes ouvrières, dans cette période, ils étaient beaucoup plus vulnérables à la lumpenisation, au gangstérisme et à la diffusion d’idéologies comme le djihadisme ou le néofascisme. Comme le CCI l’avait prévu dans la période immédiatement après les événements de 89, la classe allait entrer dans une longue période de recul. Mais la longueur et la profondeur de ce recul se sont même avérées plus grandes que ce à quoi nous nous étions attendus. D’importants mouvements d’une nouvelle génération de la classe ouvrière en 2006 (le mouvement anti-CPE en France) et entre 2009 et 2013 dans de nombreux pays à travers le monde (Tunisie, Égypte, Israël, Grèce, États-Unis, Espagne…) en même temps qu’une certaine résurgence d’un milieu intéressé par les idées communistes, ont rendu possible de penser que la lutte de classe allait de nouveau, une fois de plus, occuper le centre de la scène, et qu’une nouvelle phase du développement du mouvement révolutionnaire allait s’ouvrir. Mais de nombreux développements au cours de la dernière décennie ont justement montré à quel point les difficultés auxquelles sont confrontées la classe ouvrière et son avant-garde sont profondes.
15. Les luttes autour de 2011 étaient explicitement liées aux effets de la crise économique qui s’approfondissait, leurs protagonistes se référant souvent, par exemple, à la précarité de l’emploi et au manque d'opportunités pour les jeunes, même après plusieurs années d’études universitaires. Mais il n’y a pas de lien automatique entre l’aggravation de la crise économique et le développement qualitatif de la lutte de classe – une leçon essentielle des années 1930, quand la Grande Dépression a eu tendance à mener à plus de démoralisation, dans une classe qui était déjà défaite. Et, étant données les longues années de recul et de désorientation qui l’ont précédé, le tremblement de terre financier de 2007-2008, allait avoir un impact largement négatif sur la conscience du prolétariat.
Un élément important à cet égard a été la prolifération du système de crédit lui-même, qui avait été au cœur de l’expansion économique des années 1990 et 2000 mais dont les contradictions intrinsèques accéléraient maintenant le crash. Ce processus de "financiarisation" opérait alors non seulement au niveau des grandes institutions financières mais aussi de la vie de millions de travailleurs. À ce niveau, la situation est très différente de celle des années 1920 et 1930, quand pour la plus grande partie, les soi-disant classes moyennes (petits propriétaires, professions libérales, etc.) mais pas les ouvriers, avaient des économies à perdre ; et quand la protection de l’État suffisait à peine à empêcher les prolétaires de mourir de faim. Si, d’un côté, la situation matérielle immédiate de beaucoup de travailleurs dans de tels pays est donc toujours moins dramatique qu’il y a 8 ou 9 décennies, par ailleurs, des millions de travailleurs, précisément dans de tels pays, se retrouvent dans un pétrin qui n’existait que très peu dans les années 1930 : ils sont devenus des débiteurs, souvent à un niveau important. Pendant le 19ème siècle, et encore dans une grande mesure avant 1945, les seuls qui faisaient crédit aux travailleurs étaient le bar local, le café et l’épicerie. Les travailleurs devaient avoir recours à leur solidarité de classe dans les moments d’épreuves particulières. Faire crédit aux prolétaires a commencé à grand échelle avec les crédits au logement et à la construction, mais a ensuite explosé dans les dernières décennies avec le développement du crédit à la consommation à l’échelle des masses. Le développement toujours plus raffiné, rusé et perfide de cette économie de crédit pour une grande partie de la classe ouvrière, a eu des conséquences extrêmement négatives pour la conscience de classe prolétarienne. L’expropriation du revenu de la classe ouvrière par la bourgeoisie est cachée et apparaît incompréhensible quand elle prend la forme d’une dévaluation de l'épargne, de la faillite des banques ou des régimes d’assurance, ou la confiscation de la propriété de la maison sur le marché. La précarité croissante des assurances de "l’État Providence" et de leur financement, facilite la division des travailleurs entre ceux qui paient pour ces systèmes publics, et ceux qui en bénéficient sans avoir payé d’équivalent. Et le fait que des millions de travailleurs soient tombés dans l’endettement, est un moyen nouveau, supplémentaire et puissant pour discipliner le prolétariat.
Même si le résultat du crash a été l’austérité pour la plupart et un transfert encore plus éhonté de richesse au profit d'une petite minorité, le résultat global du crash n’a pas été d’aiguiser ou de développer une compréhension du fonctionnement du système capitaliste : le ressentiment contre l’inégalité croissante a été dans une grande mesure dirigé contre "l’élite urbaine corrompue", un thème qui est devenu le principal fonds de commerce du populisme de droite. Et même quand la réaction à la crise et aux injustices qui y sont liées ont fait naître des formes plus prolétariennes de lutte, comme le mouvement Occupy aux États-Unis, ces dernières étaient dans une très grande mesure plombées par une tendance à faire porter le chapeau aux banquiers cupides ou même à des sociétés secrètes qui ont délibérément manigancé le crash pour renforcer leur contrôle sur la société.
16. La vague révolutionnaire de 1917-1923, comme les mouvements insurrectionnels précédents de la classe ouvrière, (1871, 1905) avaient été déclenchés par une guerre impérialiste, conduisant les révolutionnaires en pointe à considérer que la guerre provoquait les conditions les plus favorables à la révolution prolétarienne. En réalité, la défaite de la vague révolutionnaire a montré que la guerre pouvait créer des divisions profondes dans la classe, en particulier entre les prolétaires des nations "victorieuses" et ceux des nations "vaincues". De plus, comme l’ont démontré les événements à la fin de la 2ème Guerre Mondiale, la bourgeoisie a tiré les leçons nécessaires de ce qui est arrivé en 1917, et a montré sa capacité à limiter les possibilités de réactions prolétariennes à la guerre impérialiste, notamment en développant des stratégies et des formes de technologie militaire qui rendent la fraternisation entre armées opposées de plus en plus difficile.
Contrairement aux promesses de la classe dominante occidentale après la chute du bloc impérialiste russe, la nouvelle phase historique qui s'ouvrait n'était en aucune façon une époque de paix et de stabilité mais de la propagation du chaos militaire, de guerres de plus en plus insolubles qui ont ravagé des pans entiers de l’Afrique et du Moyen Orient et ont même frappé aux frontières de l’Europe. Mais tandis que la barbarie qui se déployait en Irak, Afghanistan, Rwanda et maintenant Yémen et Syrie, a certainement suscité l’horreur et l’indignation de sections notables du prolétariat mondial – y compris dans les centres capitalistes où la bourgeoisie a été directement impliquée dans ces guerres – les guerres de la décomposition n’ont que très rarement donné naissance à des formes prolétariennes d’opposition. Dans les pays les plus directement affectés, la classe ouvrière a été trop faible pour s’organiser contre les gangsters militaires locaux et leurs sponsors impérialistes. C’est flagrant dans la guerre actuelle en Syrie, qui a non seulement vu un carnage sans merci de la population par les bombardements aériens et autres, surtout par les forces officielles de l’État, mais aussi le dévoiement d’un mécontentement social initial par la création de fronts militaires et l’embrigadement des opposants au régime dans une myriade de gangs armés, chacun plus brutal que l’autre. Dans les centres capitalistes, de tels scénarios épouvantables ont surtout engendré des sentiments de désespoir et d’impuissance – notamment parce qu’il peut sembler que toute tentative de se rebeller contre le système actuel ne peut qu’aboutir à une situation encore pire. Le triste sort du "printemps arabe" a pu être utilisé facilement contre la possibilité de révolution. Mais le démembrement sauvage de pays tout entiers à la périphérie de l’Europe a, au cours des dernières années, commencé à avoir un effet boomerang sur la classe ouvrière au centre du système. Ceci peut être résumé en deux questions : d’un côté, le développement de plus en plus chaotique à l’échelle mondiale d’une crise des réfugiés qui est vraiment planétaire dans son étendue, et de l’autre, le développement du terrorisme.
17. Le moment déclencheur de la crise des réfugiés en Europe, a été l’ouverture des frontières de l’Allemagne (et de l’Autriche) aux réfugiés de la "route des Balkans" à l’été 2015. Les motifs de cette décision de la chancelière Merkel étaient doubles. D’abord, la situation économique et démographique en Allemagne (une industrie florissante confrontée à la perspective d'une pénurie de main d'œuvre qualifiée et "motivée".). Deuxièmement, le danger de l’effondrement l'ordre public en Europe du Sud-Est du fait de la concentration de centaines de milliers de réfugiés dans des pays incapables de les gérer.
La bourgeoisie allemande avait cependant mal calculé les conséquences de sa décision unilatérale sur le reste du monde, en particulier en Europe. Au Moyen Orient et en Afrique, des millions de réfugiés et d’autres victimes de la misère capitaliste ont commencé à faire des plans pour gagner l’Europe, l’Allemagne en particulier. En Europe, les règles de l’UE, telles que "Schengen" ou le "Pacte de Dublin pour les réfugiés" a fait du problème de l’Allemagne celui de l’Europe dans son ensemble. Un des premiers résultats de cette situation, en conséquence, a été une crise de l’Union Européenne – peut être la plus grave de son histoire jusqu’à ce jour.
L’arrivée de tant de réfugiés en Europe a rencontré au début une vague spontanée de sympathie au sein de larges secteurs de la population – un élan qui est encore fort dans des pays comme l’Italie ou l’Allemagne. Mais cet élan a très vite été étouffé par une réaction xénophobe en Europe orchestrée non seulement par les populistes mais aussi par les forces de sécurité et les défenseurs professionnels de la loi et de l’ordre bourgeois, qui étaient alarmés par l’afflux soudain et incontrôlé de personnes non identifiées. La peur d’une arrivée d’agents terroristes allait de pair avec la crainte que l’arrivée de tant de musulmans ne renforce le développement des sous-communautés d’immigrants au sein de l’Europe, qui ne s’identifient pas à l’État nation du pays où ils vivent. Ces peurs se sont encore renforcées avec l’accroissement d’attaques terroristes en France, Belgique, Allemagne. En Allemagne même, il y a eu un net accroissement des attaques terroristes de droite contre les réfugiés. Dans des parties de l’ancienne RDA, une véritable atmosphère de pogrom s’est développée. En Europe de l’ouest dans son ensemble, après la crise économique, la "crise des réfugiés" est devenue le second facteur (accru par le terrorisme fondamentaliste) attisant les flammes du populisme de droite.
Comme la crise économique après 2008 avait créé de graves divisions au sein de la bourgeoisie sur la meilleure façon de gérer l’économie mondiale, l’été 2015 a marqué le début de la fin de son consensus sur l’immigration. La base de cette politique jusqu’à maintenant avait été le principe de la frontière semi-perméable. Le mur contre le Mexique que veut construire Donald Trump existe déjà, tout comme celui qui entoure l’Europe (également sous la forme de bateaux militaires de patrouille et de prisons dans les aéroports). Mais le but des murs actuels est de ralentir et de réguler l’immigration, pas de l’empêcher. Faire rentrer illégalement des immigrés les criminalise, les obligeant ainsi à travailler pour un salaire de misère dans des conditions abominables sans aucun droit aux avantages sociaux. De plus, en obligeant les gens à risquer leur vie pour obtenir l'admission, le régime frontalier devient une sorte de mécanisme de sélection barbare, où seuls passent les plus audacieux, déterminés et dynamiques.
L’été 2015 marque en fait le début de l’effondrement du système d’immigration existant. Le déséquilibre entre le nombre sans cesse croissant de ceux qui cherchent à rentrer d’un côté et la demande faiblissante de force de travail dans le pays où ils entrent de l’autre, (l’Allemagne constituant une exception) est devenu intenable. Et comme d’habitude, les populistes ont une solution facile à portée de main : la frontière semi-perméable doit être rendue imperméable, quel que soit le niveau de violence requis. Là, de nouveau, ce qu’ils proposent semble très plausible du point de vue bourgeois. Elle n'équivaut à rien d'autre que l’application de la logique des "communautés fermées" à l’échelle de pays entiers.
Là de nouveau, les effets de cette situation pour la conscience de la classe ouvrière sont, pour le moment, très négatifs. La chute du bloc de l’est était présentée comme le triomphe ultime du capitalisme démocratique occidental. Face à cela, il y avait l’espoir, du point de vue du prolétariat, que la crise de la société capitaliste, à tous les niveaux, allait contribuer à la fin à ternir cette image du capitalisme comme le meilleur système possible. Mais aujourd’hui – et malgré le développement de la crise – le fait que des millions de gens (pas seulement des réfugiés) soient prêts à risquer leur vie pour avoir accès aux vieux centres capitalistes que sont l’Europe et l’Amérique du Nord, ne peut que renforcer l’impression que ces zones sont (au moins comparativement), sinon un paradis, au moins des îlots de prospérité et stabilité relative.
A la différence d’avec l’époque de la Grande Dépression des années 1930, quand l’effondrement de l’économie mondiale était centré sur les États-Unis et l’Allemagne, aujourd’hui, grâce à une gestion globale capitaliste d’État, les pays capitalistes centraux semblent être vraisemblablement les derniers à s’effondrer. Dans ce contexte, une situation qui ressemble à celle d’une forteresse assiégée s’est créée en particulier (mais pas seulement) en Europe et aux États Unis. Le danger est réel que la classe ouvrière dans ces zones, même si elle n’est pas mobilisée activement derrière l’idéologie de la classe dominante, cherche la protection de ses "propres" exploiteurs ("l’identification avec l’agresseur" pour utiliser un terme psychologique) contre ce qui est perçu comme étant un danger commun venant de l’extérieur.
18. Le "contrecoup" des attaques terroristes résultant des guerres au Moyen Orient a commencé bien avant la crise actuelle des réfugiés. Les attaques d’Al-Qaïda contre les Twin Towers en 2001, suivies d’autres atrocités dans les transports à Madrid et à Londres, montraient déjà que les principaux États capitalistes allaient récolter ce qu’ils avaient semé en Afghanistan et Irak. Mais la série plus récente de meurtres attribués à l’État Islamique en Allemagne, France, Belgique, Turquie, aux États-Unis, et ailleurs, bien qu’ayant souvent apparemment un caractère plus amateur et même de hasard, dans lequel il devient de plus en plus difficile de distinguer un "soldat" terroriste entraîné d’un individu isolé et perturbé, et se produisant en conjonction avec la crise des réfugiés, a encore intensifié les sentiments de méfiance et de paranoïa dans la population, l’amenant à se tourner vers l’État pour demander sa protection vis-à-vis d’un "ennemi de l’intérieur" informe et imprévisible. En même temps, l’idéologie nihiliste de l’État Islamique et de ses émules offre un court moment de gloire aux jeunes immigrants rebelles qui ne voient pas de futur pour eux dans les semi-ghettos des grandes villes occidentales. Le terrorisme qui, dans la phase de décomposition, est de plus en plus devenu un moyen de faire la guerre entre États et proto-États, rend beaucoup plus difficile l’expression de l’internationalisme.
19. La montée actuelle du populisme a donc été alimentée par ces différents facteurs – la crise économique de 2008, l’impact de la guerre, du terrorisme, et de la crise des réfugiés – et apparaît comme une expression concentrée de la décomposition du système, de l’incapacité de l’une et l’autre des principales classes de la société à offrir une perspective pour le futur à l’humanité. Du point de vue de la classe dominante, cela signifie l'épuisement du consensus "néo-libéral" qui avait permis au capitalisme de se maintenir et même d’élargir l’accumulation depuis le début de la crise économique ouverte dans les années 1970, et en particulier, de l’épuisement des politiques keynésiennes qui avaient prédominé dans le boom d’après-guerre. Dans le sillage du crash de 2008, qui avait déjà élargi l’immense décalage de prospérité entre les rares très riches et la grande majorité, la dérégulation et la globalisation, de même que la "libre circulation" du capital et du travail dans un cadre inventé par les États les plus puissants du monde, ont été remis en question par une partie croissante de la bourgeoisie, dont la droite populiste est typique, même si elle peut simultanément mélanger néo-libéralisme et néo-keynésianisme dans le même discours de campagne. L’essence de la politique populiste est la formalisation politique, administrative et judiciaire de l’inégalité de la société bourgeoise. Ce que la crise de 2008 a contribué en particulier de mettre en évidence, c’est que cette égalité formelle est le véritable fondement d’une inégalité sociale plus éclatante que jamais. Dans une situation dans laquelle le prolétariat est incapable de mettre en avant sa solution révolutionnaire – l’instauration d’une société sans classe – la réaction populiste est de vouloir remplacer la pseudo-égalité hypocrite existante par un système "honnête" et ouvert de discrimination légale. C’est le creuset de la "révolution conservatrice" que plaide le conseiller en chef du président Trump, Steve Bannon.
Une première indication de ce que veulent dire des slogans tels que "l’Amérique d’abord" est donnée par le programme électoral "la France d’abord" du Front National. Il propose de privilégier les citoyens français, au niveau des emplois, de l’impôt et des avantages sociaux, par rapport aux ressortissants d’autres pays de l’Union Européenne, qui, à leur tour, seraient prioritaires par rapport aux autres étrangers. Il existe un débat similaire en Grande-Bretagne sur la question de savoir si, après Brexit, les citoyens de l'UE devraient bénéficier d'un statut intermédiaire entre les nationaux et les autres étrangers. Au Royaume Uni, l’argument principal émis en faveur du Brexit n’était pas une objection à la politique commerciale de l’UE ou un quelconque élan protectionniste britannique à l’égard de l’Europe continentale, mais la volonté politique de "reconquérir la souveraineté nationale" en ce qui concerne l’immigration et le marché national de la main d’œuvre. La logique de cette argumentation est que, en l’absence d’une perspective de croissance à plus long terme pour l’économie nationale, les conditions de vie des autochtones ne peuvent être plus ou moins stabilisées que par une discrimination à l'encontre de tous les autres.
20. Au lieu d’être un antidote au reflux long et profond de la conscience de classe, de l’identité de classe et de la combativité après 1989, la prétendue crise financière et de l’Euro a eu l’effet opposé. En particulier, les effets pernicieux de la perte de solidarité dans les rangs du prolétariat se sont considérablement accrus. Plus particulièrement, nous voyons la montée du phénomène de bouc-émissarisation, une façon de penser qui accuse les personnes – sur lesquelles on projette tout le mal du monde – de tout ce qui va mal dans la société. De telles idées ouvrent la porte au pogrom. Aujourd’hui, le populisme est la manifestation la plus frappante, mais loin d’être la seule, de ce problème, qui tend à imprégner tous les rapports sociaux. Au travail et dans la vie quotidienne de la classe ouvrière, de façon croissante, il affaiblit la coopération, et renforce l'atomisation, et le développement de la méfiance mutuelle et du mobbing.
Le mouvement ouvrier marxiste a depuis longtemps défendu les visions théoriques qui contribuent à faire contrepoids à cette tendance. Les deux visions les plus essentielles étaient les suivantes : a) que dans le capitalisme, l’exploitation est devenue impersonnelle, puisqu’elle fonctionne selon les "lois" du marché (loi de la valeur), les capitalistes eux-mêmes étant obligés de se soumettre à ces lois ; b) malgré ce caractère de machine, le capitalisme est un rapport social entre classes, puisque ce "système" est basé et maintenu par un acte de volonté de l’État bourgeois (la création et le renforcement de la propriété privée capitaliste) ; la lutte de classe n’est donc pas personnelle mais politique. Au lieu de combattre des personnes, elle lutte contre un système et la classe qui l’incarne pour transformer les rapports sociaux. Ces visions n’ont jamais immunisé même les couches les plus conscientes du prolétariat contre la bouc–émissarisation. Mais elle le rend plus résilient. Cela explique en partie pourquoi, même au cœur de la contre-révolution, y compris en Allemagne, le prolétariat a résisté à l’explosion d’antisémitisme, d'avantage et plus longtemps que d’autres parties de la société. Ces traditions prolétariennes ont continué à avoir des effets positifs, même quand les ouvriers ne se sont plus identifié de manière consciente au socialisme. La classe ouvrière reste donc la seule véritable barrière à l'extension de ce type de poison, même si certaines de ses parties ont été sérieusement affectées.
21. Tout cela a entraîné un changement dans la disposition politique de la société bourgeoise dans son ensemble ; laquelle, cependant, n’est pas du tout pour le moment en faveur du prolétariat. Dans des pays comme les États-Unis ou la Pologne, où les populistes sont maintenant au gouvernement, les manifestations importantes dans les rues ont surtout défendu la démocratie capitaliste existante et sa réglementation "libérale". Une autre question qui mobilise les masses est la lutte contre la corruption, au Brésil, en Corée du Sud, en Roumanie ou en Russie. Le mouvement des "5 étoiles" en Italie est principalement animé par la même question. La corruption, endémique dans le capitalisme, prend des proportions épidémiques dans sa phase terminale. Dans la mesure cela nuit à la productivité et à la compétitivité, ceux qui luttent contre elles sont les meilleurs défenseurs des intérêts du capital national. Les quantités de drapeaux nationaux brandis lors de telles manifestations ne sont pas le fruit du hasard. Il y a aussi un renouveau de l’intérêt dans le processus électoral bourgeois. Certaines parties de la classe ouvrière sont en proie à voter pour les populistes, sous l’influence du repli de la solidarité, ou comme une sorte de protestation contre la classe politique établie. L'un des obstacles au développement de la cause de l’émancipation est aujourd’hui l’impression qu’ont ces travailleurs qu’ils peuvent davantage ébranler et faire pression sur la classe dominante au moyen d'un vote pour les populistes plutôt que par la lutte prolétarienne. Mais le danger le plus grand, peut-être, est que les secteurs les plus modernes et globalisés de la classe, au cœur du processus de production, puissent, par indignation contre la vile exclusion prônée par le populisme, ou à partir d’une compréhension plus ou moins claire que ce courant met en danger la stabilité de l’ordre existant, tomber dans le piège de la défense du régime capitaliste démocratique régnant.
22. La montée du populisme et de l’anti-populisme présente certaines similitudes avec les années 1930, quand la classe ouvrière a été prise entre dans le cercle vicieux du fascisme et de l’antifascisme. Mais malgré ces similitudes, la situation historique actuelle n’est pas la même que dans les années 1930. À cette époque, le prolétariat en Union Soviétique et en Allemagne avait subi non seulement un revers politique mais aussi une défaite physique. À l’opposé, la situation aujourd’hui n’est pas une situation de contre-révolution. Pour cette raison, la probabilité que la classe dominante tente d’imposer une défaite physique au prolétariat n'est à l'heure actuelle que très faible. Il y a une autre différence avec les années 1930 : l'adhésion idéologique des prolétaires au populisme ou à l'anti-populisme n'est nullement définitive. Beaucoup d'ouvriers qui, aujourd'hui, votent pour un candidat populiste peuvent, du jour au lendemain, se retrouver en lutte aux côtés de leurs frères de classe, et la même chose vaut pour les ouvriers entraînés dans des manifestations antipopulistes. La classe ouvrière aujourd’hui, surtout dans les vieux centres du capitalisme, n’est pas prête à sacrifier sa vie pour les intérêts de la nation, malgré l’influence grandissante du nationalisme sur certains secteurs de la classe, ni n’a perdu la possibilité de combattre pour ses intérêts propres et ce potentiel continue à affleurer , même si c’est de façon beaucoup plus dispersée et éphémère que pendant la période 68-69 et celle entre 2006 et 2013. En même temps, un processus de réflexion et de maturation au sein d’une minorité du prolétariat se poursuit en dépit des difficultés et des reculs, et cela, en retour reflète un processus plus souterrain qui a lieu au sein de couches plus larges du prolétariat.
Dans ces conditions, la tentative de terroriser la classe serait potentiellement dangereuse et très probablement contre-productive. Elle pourrait fortement éroder chez les ouvriers les illusions qui existent sur le capitalisme démocratique, qui constituent un des plus importants avantages idéologiques des exploiteurs.
Pour toutes ces raisons, il est beaucoup plus dans l’intérêt de la classe capitaliste d'utiliser les effets négatifs de la décomposition et l’impasse du capitalisme, contre la classe ouvrière.
1917, 2017 et la perspective du communisme.
23. Un des principales lignes d’attaque de la bourgeoisie "libérale" contre la révolution d’octobre 1917 a été, et continuera à être, les prétendus contrastes entre les espérances démocratiques du soulèvement de février, et le "coup d’État" d’octobre des Bolcheviks, qui a plongé la Russie dans le désastre et la tyrannie. Mais la clef pour comprendre la révolution d’octobre est qu’elle se fondait sur la nécessité de casser le front de guerre impérialiste, qui était maintenu par toute les factions de la bourgeoisie et notamment son aile "démocratique", et donc donner le premier coup de la révolution mondiale. C’était la première réponse claire du prolétariat mondial à l’entrée du capitalisme dans son époque de déclin, et c’est à ce niveau surtout qu’octobre 1917, loin de constituer une relique des temps ancien, est le poteau indicateur du futur de l’humanité.
Aujourd’hui, après tous les contrecoups qu’elle a subis de la part de la bourgeoisie mondiale, la classe ouvrière semble très éloignée de la reconquête de son projet révolutionnaire. Et, pourtant : "dans un sens, la question du communisme est au cœur même de la situation difficile de l’humanité aujourd’hui. Il domine la situation mondiale sous la forme du vide qu’il a créé par son absence". (Rapport sur la situation mondiale). Les multiples actes de barbarie des 20e et 21e siècles, d'Hiroshima et Auschwitz à Fukushima et Alep, sont le lourd prix que l’humanité a payé pour l’échec de la révolution communiste au cours de toutes ces décennies ; et si, en ce temps avancé de la décadence de la civilisation bourgeoise, les espoirs de transformation révolutionnaire étaient définitivement brisés, les conséquences pour la survie de la société seraient encore plus graves. Et cependant, nous sommes convaincus que ces espoirs sont toujours vivants, toujours fondés sur des possibilités réelles.
D’un côté, ils sont fondés sur la possibilité et la nécessité objectives du communisme, qui est contenue dans le clash qui s’accentue entre les forces de production et les rapports de production. Ce clash est devenu plus aigu précisément parce que le capitalisme décadent en décomposition, en opposition avec les sociétés de classe antérieures qui ont subi toute une période de stagnation, n’a pas arrêté son expansion globale et sa pénétration de tous les pores de la vie sociale. On peut voir cela à plusieurs niveaux :
Dans la contradiction entre le potentiel contenu dans la technologie moderne et son utilisation actuelle dans le capitalisme : le développement de la technologie de l’information et de l’intelligence artificielle, qui pourraient être utilisées pour contribuer à libérer l‘humanité du travail fastidieux et raccourcir énormément la journée de travail, a conduit à la suppression d’emplois d’un côté, et à prolonger la journée de travail de l’autre.
Dans la contradiction entre le caractère associé à l’échelle mondiale de la production capitaliste et la propriété privée qui, d’un côté, met en lumière la participation de millions de prolétaires dans la production de la richesse sociale et son appropriation par une petite minorité dont l’arrogance et le gaspillage deviennent un affront aux conditions de vie qui stagnent ou carrément à l’appauvrissement que vit la grande majorité. Le caractère objectivement global de l’association du travail s’est accru de manière spectaculaire dans les dernières décennies, en particulier, avec l’industrialisation de la Chine et d’autres pays d’Asie. Ces nouveaux bataillons prolétariens, qui se sont souvent montré extrêmement combatifs, constituent potentiellement une grande source nouvelle de force pour la lutte de classe globale, même si le prolétariat d’Europe occidentale reste la clef de la maturation politique de la classe ouvrière vis à vis d’une confrontation révolutionnaire avec le capital.
Dans la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur d’échange qui s’exprime surtout dans la crise de surproduction et tous les moyens qu’utilise le capitalisme pour la surmonter, en particulier, le recours massif à la dette. La surproduction, cette absurdité intrinsèque au capitalisme, met en évidence en même temps la possibilité de l’abondance et l’impossibilité d’y arriver sous le capitalisme. Un exemple de développement technologique met encore en évidence cette absurdité : Internet a rendu possible de distribuer toutes sortes de biens gratuitement (musique, livres, films, etc.) et cependant, le capitalisme, à cause du besoin de maintenir le système de profit, a dû créer une énorme bureaucratie pour s’assurer qu’une telle libre distribution demeure restreinte ou n’opère principalement que comme un forum faisant de la publicité pour des marchandises. De plus, la crise de surproduction se traduit par des attaques continuelles contre le niveau de vie de la classe ouvrière et l'appauvrissement de la masse de l'humanité.
Dans la contradiction entre l’expansion globale du capital, et l’impossibilité d’aller au-delà de l’État-nation. La place particulière de la globalisation qui a commencé dans les années 1980, nous a plus que jamais rapproché du point prédit par Marx dans les Grundrisse : "l’universalité vers laquelle il tend irrésistiblement rencontre des barrières dans sa nature même, qui, à une certaine étape de son développement, lui permettront d’être reconnu comme étant lui-même la plus grande barrière à cette tendance, et conduira donc à partir de là à son propre dépassement"1. Cette contradiction, bien sûr, pouvait déjà être perçue par les révolutionnaires au temps de la première guerre mondiale, puisque la guerre elle-même était la première expression claire qu’alors que l’État nation se survivait à lui-même, le capitalisme ne pouvait pas réellement aller au-delà. Et aujourd’hui, nous savons que la disparition – en fait la chute – du capital ne prendra pas une forme purement économique : plus il se rapproche d’une impasse économique, plus grande sera sa dérive vers "la survie" au détriment des autres par des moyens militaires. La belligérance ouvertement nationaliste des Trump, Poutine, et autres signifie que la globalisation capitaliste, loin d’unifier l’humanité, nous pousse toujours plus près de l’autodestruction, même si la descente aux enfers ne prendra plus nécessairement la forme d’une guerre mondiale.
Dans la contradiction entre la production capitaliste et la nature, qui était considérée comme un "cadeau gratuit" depuis les débuts du capitalisme (Adam Smith) et qui a atteint des niveaux sans précédent dans la phase de décomposition. Cela s’exprime de la façon la plus évidente dans le vandalisme ouvert de ceux qui nient le changement climatique et qui sont au contrôle aux États-Unis et dans la montée de leur ennemi juré, la Chine, où la recherche frénétique de croissance à tout prix a donné le jour à des villes où l’air n’est pas respirable, en plus du danger d’envol du réchauffement global, et - dans une combinaison bizarre de superstition antique et de capitalisme moderne gangster – qui a accéléré la destruction complète en Afrique et ailleurs, d’espèces, prisées pour les vertus curatives magiques de leurs cornes ou de leurs peaux. Le capitalisme ne peut exister sans cette manie de croissance mais il est incompatible avec la santé de l’environnement naturel dans lequel vit et respire l’humanité. La perpétuation même du capital menace donc l’existence de l’espèce humaine, et pas seulement au niveau militaire mais aussi au niveau de ses rapports avec la nature.
L’aiguisement insupportable des contradictions citées ci-dessus les mène toutes à une seule solution : la production mondiale associée pour l’usage et pas pour le profit, une association pas seulement entre êtres humains mais une association entre êtres humains et la nature. Peut-être que la plus grande expression de ce potentiel aujourd’hui – pour cette transformation- est-elle donc qu’au sein des secteurs les plus modernes et les plus centraux du prolétariat mondial, la jeune génération, bien que de plus en plus consciente de la gravité de la situation historique, ne partage plus la désespérance du "no future" des décennies précédentes. Cette confiance est fondée sur la reconnaissance de la productivité associée de chacun : sur le potentiel représenté par le progrès scientifique et technique, sur "l’accumulation" de connaissances et des moyens d’y accéder, et sur la croissance d’une compréhension plus profonde et plus critique de l’interaction entre l’humanité et le reste de la nature. En même temps, cette partie du prolétariat – comme nous l’avons vu dans les mouvements, en Europe occidentale en 2011, qui à leur point culminant ont brandi le slogan de "révolution mondiale" - est beaucoup plus consciente du caractère international de l’association du travail aujourd’hui, et donc plus capable de saisir les possibilités de l’unification internationale des luttes.
Mais l’unification globale du prolétariat est une solution que le capital doit éviter à tout prix, même quand il doit adopter des moyens qui montrent les limites inhérentes à la production pour l’échange. Le développement du capitalisme d’État dans l’époque de décadence est, en un sens, une sorte de recherche désespérée d’une façon de maintenir une société unie par des moyens totalitaires, une tentative de la classe dominante d’exercer son contrôle sur la vie économique dans une période où le développement des "lois naturelles" du système le pousse vers son propre effondrement.
24. Alors que le capitalisme ne peut conjurer la nécessité du communisme, nous savons que le nouveau mode de production ne peut surgir automatiquement, mais requiert l’intervention consciente de la classe révolutionnaire, le prolétariat. En dépit des difficultés extrêmes auxquelles est confrontée la classe aujourd’hui, de son incapacité apparente à faire resurgir sa "propriété" du projet communiste, nous avons déjà souligné nos raisons pour insister sur le fait que ce renouveau, cette reconstitution du prolétariat en classe pour le communisme, est encore possible aujourd’hui. Parce que, de la même manière que le capitalisme ne peut conjurer la nécessité objective du communisme, il ne peut supprimer entièrement les aspirations subjectives à une nouvelle société, ou la recherche de la compréhension de comment y arriver, au sein de la classe de l’association, le prolétariat.
La mémoire de ce que signifiait réellement l’octobre rouge et bien sur la mémoire que la révolution allemande et la vague révolutionnaire mondiale déclenchée par octobre se sont produites ne peuvent entièrement disparaître. Cela a été, pour ainsi dire, réprimé, mais tous les souvenirs réprimés sont destinés à réapparaître quand les conditions sont mures. Et il y a toujours, au sein de la classe ouvrière, une minorité qui a maintenu et élaboré l’histoire réelle et ses leçons à un niveau conscient, prête à fertiliser la réflexion de la classe quand elle redécouvrira la nécessité de donner un sens à sa propre histoire.
La classe ne peut atteindre ce niveau de recherche à une échelle de masse sans passer par la dure école des luttes pratiques. Ces luttes, en réponse aux attaques croissantes du capital, sont la base de granite du développement de la confiance en soi et de la solidarité sans limite qui sont générées par la réalité du travail associé.
Mais l’impasse atteinte dans les batailles économiques, purement défensives, du prolétariat depuis 1968 demande aussi, d’un côté, une lutte théorique, une recherche pour comprendre son passé "en profondeur" et son futur possible, une recherche qui ne peut que conduire à la nécessité pour le mouvement de classe de passer du local et du national à l’universel, de l’économique au politique, de la défensive à l’offensive. Alors que la lutte immédiate de la classe est plus ou moins un fait de la vie dans le capitalisme, il n’y a aucune garantie que ce pas suivant, vital, soit fait. Mais elle se manifeste, peu importe jusqu'à quel point avec ses limitations et confusions, par les luttes de la génération actuelle de prolétaires, surtout dans des mouvements comme celui des Indignados en Espagne qui était d’ailleurs une expression d’indignation authentique contre le système tout entier, - un système "obsolète" comme le proclamaient les manifestants sur leurs banderoles - d’un désir de comprendre comment fonctionne ce système, et ce qui pourrait le remplacer, et en même temps, de découvrir les moyens organisationnels qui peuvent être employés pour s’échapper des institutions de l’ordre existant. Ces moyens n’étaient pas essentiellement nouveaux : la généralisation des assemblées de masse, l’élection de délégués mandatés, c’était un écho bien clair de l'époque de soviets en 1917. C’était une claire démonstration du travail en profondeur de la "vieille taupe" dans les soubassements de la vie sociale.
Cela donnait aussi un premier aperçu d'un potentiel pour un développement de ce qu'on peut appeler la dimension politique-morale de la lutte prolétarienne : l'émergence d'un profond rejet du mode de vie et de comportement existant de la part de plus larges secteurs de la classe. L'évolution de ce moment est un facteur très important dans la préparation et la maturation à la fois de luttes massives sur un terrain de classe et d'une perspective révolutionnaire.
En même temps, l’échec du mouvement des Indignados à restaurer une réelle identité de classe souligne la nécessité de lier cette politisation naissante dans la rue et sur les places, à la lutte économique, au mouvement sur les lieux de travail, où la classe ouvrière a encore son existence la plus distincte. Le futur révolutionnaire ne repose pas sur une "négation" de la lutte économique comme le proclament les modernistes, mais sur une véritable synthèse des dimensions politiques et économiques du mouvement de classe, comme c’est observé et défendu dans Grève de masse de Luxemburg.
25. En développant cette capacité de voir le lien entre les dimensions politiques et économiques des luttes, les organisations politiques communistes ont un rôle indispensable à jouer, et c’est pourquoi la bourgeoisie fera tout ce qu’elle peut pour discréditer le rôle du parti bolchevik en 1917, en le présentant comme une conspiration de fanatiques et d’intellectuels intéressés seulement à s’approprier le pouvoir. La tâche de la minorité communiste n’est pas de provoquer les luttes ou de les organiser à l’avance, mais d’intervenir en leur sein pour éclaircir les méthodes et les buts du mouvement.
La défense de l'Octobre rouge exige aussi, bien sûr, la démonstration que le stalinisme, loin de représenter une quelconque continuité avec lui, était la contre-révolution bourgeoise contre lui. Cette tâche est d'autant plus nécessaire aujourd'hui face au poids des idées que l'effondrement du stalinisme aurait prouvé l'infaisabilité économique du communisme. Les effets négatifs de ce poids sur les minorités politiques en recherche – le milieu instable entre la gauche communiste et la gauche du capital – est considérable. Alors qu'avant 1989, des idées confuses mais manifestement anticapitalistes, par exemple de la variété conseilliste ou autonomiste, étaient relativement influentes dans de tels cercles, il y a eu depuis une avancée importante des conceptions basées sur la formation de réseaux d'échange mutuel au niveau local, sur la préservation et l'extension d'aires d'économies de subsistance ou sur les "communes" existant encore. L'avancée de telles idées indique que même les secteurs les plus politisés du prolétariat aujourd'hui sont souvent incapables de même imaginer une société au-delà du capitalisme. Dans ces circonstances, un des facteurs nécessaires préparant l'émergence d'une future génération de révolutionnaires est que les minorités révolutionnaires existant aujourd'hui exposent de la manière la plus profonde et convaincante (sans tomber dans l'utopisme) pourquoi aujourd'hui le communisme est non seulement une nécessité, mais aussi une possibilité très réelle et faisable.
Étant donnée la nature réduite et dispersée de la gauche communiste aujourd’hui, et les difficultés énormes auxquelles est confronté un plus large milieu d’éléments en recherche de clarté politique, il est évident qu’une distance énorme devra être parcourue entre le petit mouvement révolutionnaire actuel et toute capacité future d’agir comme une avant-garde authentique dans des mouvements de classe massifs. Les révolutionnaires et les minorités politisées ne sont pas simplement des produits passifs de cette situation, puisque leurs propres confusions contribuent à aggraver encore plus la désunion et la désorientation. Mais fondamentalement, la faiblesse de la minorité révolutionnaire est une expression de la faiblesse de la classe dans son ensemble, et il n’y a pas de recettes organisationnelles ou de mots d’ordre activistes qui soient capables d’y remédier.
Le temps n’est plus en faveur de la classe ouvrière, mais elle ne peut pas être plus rapide que son ombre. Elle est bien sur contrainte de récupérer beaucoup de ce qu’elle a perdu pas seulement depuis 1917, mais aussi des luttes de 1968-89. Pour les révolutionnaires, cela exige un travail patient, à long terme, d’analyse du mouvement réel de la classe et des perspectives révélées par la crise du mode de production capitaliste ; et sur la base de cet effort théorique, de fournir des réponses aux questions posées par ces éléments qui se rapprochent des positions communistes. L’aspect le plus important de ce travail est qu’il doit être vu comme une partie de la préparation politique et organisationnelle du futur parti, quand les conditions objectives et subjectives viendront de nouveau poser le problème de la révolution. En d’autres termes, les tâches de l’organisation révolutionnaire aujourd’hui sont semblables à celles d’une fraction communiste, comme cela a été élaboré très lucidement par la fraction Italienne de la gauche Communiste dans les années 1930.
1Cahier IV, Le chapitre sur le capital.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [211]
Conscience et organisation:
Rubrique:
Revue Internationale 2018
- 752 lectures
Revue Internationale n°160
- 1307 lectures
Revue Internationale n°160 - Présentation
- 61 lectures
Ce numéro de la Revue internationale est consacré à trois thèmes principaux : la présence croissante de la guerre, notamment au Moyen-Orient, cinquante ans après Mai 68 et la révolution d'Octobre.
Les articles sur 1917/18 et 1968 commémorent ces moments importants de la vie de notre classe, il y a respectivement un siècle et un demi-siècle. Ils visent à répondre à la propagande de la classe dirigeante dans la période actuelle et à sa déformation de l'histoire de la classe ouvrière. En même temps, nous revenons sur ces événements parce qu'ils sont fondamentaux pour comprendre la situation mondiale actuelle et les énormes difficultés auxquelles nous sommes confrontés : le manque de confiance du prolétariat dans ses propres forces, le manque de perspective globale orientée vers une nouvelle société sans exploitation et sans échange de marchandises. Avec les articles sur la propagation des guerres et l'accroissement de la barbarie, ils font partie de notre tentative d'analyser la réalité contemporaine, les dangers auxquels nous sommes confrontés et les obstacles à une nouvelle entreprise révolutionnaire.
Le premier article, "Moyen-Orient : le capitalisme est une menace croissante pour l'humanité", est une évaluation concrète de l'évolution de la situation dans cette zone de guerre permanente depuis des décennies, dans le cadre de notre analyse de l'impérialisme et de la décomposition. Le rôle accru de la Russie dans la région qui "s'engage en effet dans une contre-offensive, une réponse à la menace d'étranglement par les États-Unis et ses alliés" est un élément particulièrement important de ces changements.
Le troisième article, le "Rapport sur les tensions impérialistes (novembre 2017)", fait partie d'un bilan critique de nos analyses, en particulier au cours des 30 dernières années, depuis le début de la période de décomposition. Il donne une vision plus large de l'évolution des tensions impérialistes, à la fois géographiquement et pour l'ensemble de la période historique. Bien que nous ayons eu raison de dire, peu après l'effondrement du bloc russe en 1989-91, que la reconstitution des blocs n'était pas à l'ordre du jour, le rapport affirme à juste titre que notre "prédiction" de 1991 selon laquelle "malgré son énorme recul, l'URSS ne pourra plus jamais jouer un rôle majeur sur la scène internationale" et qu'elle est "condamnée à revenir à une "position de troisième rang" n'a pas été réellement confirmée. En effet, "la Russie n'est certainement pas redevenue un challenger mondial face aux États-Unis, mais elle joue un rôle non négligeable en tant que "fauteur de troubles", ce qui est typique de la décomposition. (....), Nous avons sans doute sous-estimé les ressources d'un impérialisme dos au mur, doté d'un arsenal militaire considérable, prêt à défendre ses intérêts bec et ongles."
Les deux articles sur les tensions impérialistes mettent en évidence la difficulté croissante des États-Unis et de son gouvernement actuel à contrôler la situation, et la montée constante de la Chine sur la scène mondiale, en tant que principal rival des États-Unis. Cette analyse comprend également un examen des tensions au sein de l'Union Européenne, portant précisément sur l'orientation d’une politique envers la Russie.
Le deuxième article de cette Revue, "Cinquante ans depuis Mai 68", commence par une présentation de différents articles qui ont été publiés sur notre site web ou dont la rédaction est prévue, et se poursuit avec l'article "L'enfoncement dans la crise économique depuis 50 ans" - le premier de trois articles qui passent en revue les 50 dernières années à la lumière de nos conclusions sur la signification des événements de Mai 68. Cet article d'ouverture est consacré au développement de la crise économique. En 1969, nous avons dit que les sources de prospérité et de plein emploi au cours des 20 années précédentes étaient proches de l'épuisement ("Comprendre Mai", Révolution internationale n°2, republiée sur notre site web). La prédiction s'est avérée exacte. Dans les années 1970, le consensus keynésien de l'après-guerre a été confronté à des difficultés croissantes, qui se sont traduites par une inflation croissante et des attaques contre le niveau de vie des travailleurs, en particulier sur les salaires qui avaient augmenté régulièrement pendant la période de prospérité de l'après-guerre. L'article montre aussi la justesse de l'analyse de 1969 sur la capacité du capitalisme d'État "d'atténuer temporairement les expressions les plus frappantes de la crise". Dans la phase suivante, sous la bannière du "néolibéralisme", l'État a eu tendance à déléguer nombre de ses fonctions au secteur privé, dans le but d'accroître l'avantage concurrentiel et de mobiliser au maximum tous les capitaux disponibles.
Le quatrième article, "La bourgeoisie mondiale contre la révolution d'Octobre" est une réponse aux mensonges que les médias bourgeois ont répandus sur les événements d'il y a cent ans. Pourquoi, tous les dix ans, dénigrent-ils constamment l'un des épisodes les plus précieux de l'histoire de la lutte du prolétariat ? Parce que la bourgeoisie sait très bien que la classe qui n'a pas réussi à renverser le système capitaliste il y a cent ans existe encore aujourd'hui - de même que la promesse encore inachevée d'un monde meilleur. L'article donne une image détaillée de la période qui a suivi l'insurrection victorieuse, avec l'ultimatum allemand à Brest-Litovsk, les forces alliées attaquant le pouvoir soviétique de toutes parts, l'étranglement économique - tout cela combiné réussissant à isoler le bastion révolutionnaire en Russie du reste du prolétariat mondial.
L'image de cette terrible période qui a favorisé la dégénérescence du parti bolchévique et la révolution elle-même est complétée par le dernier article de cette Revue, "Emma Goldman et la Révolution russe - une réponse tardive à une anarchiste révolutionnaire". Jusqu'en février 1918, Emma Goldman a parcouru l'Amérique pour défendre les bolcheviks, comme incarnant en pratique l'esprit de la révolution, malgré leur engagement envers la théorie marxiste. L'article se concentre sur les expériences d'Emma Goldman à partir de 1920 en Russie, alors que ses observations sur la réalité concrète de l'État décrivent très précisément comment celui-ci se développe de plus en plus et commence inexorablement à tout absorber. Témoin de l'écrasement sanglant du soviet de Cronstadt par un parti bolchevique qui s'était identifié à la machine d'État, elle combat avec véhémence l'idée que la fin justifie les moyens, mais tombe beaucoup trop dans la facilité en critiquant ce qu'elle appelle le jésuitisme des bolcheviks "depuis le début", ce qui est en totale contradiction avec leur propre histoire. Cette contribution n'est pas seulement une nouvelle tentative de retracer ces moments cruciaux de l'histoire révolutionnaire sans crainte de la vérité, mais aussi une continuation de notre débat avec les anarchistes internationalistes sur les leçons que le prolétariat devrait tirer de cette tragédie.
La rédaction (05/06/2018)
Moyen-Orient : le capitalisme est de plus en plus une menace pour l’humanité
- 376 lectures
Il y a quelques mois, le monde semblait faire un pas vers une confrontation nucléaire autour de la Corée du Nord, avec les menaces de Trump de réagir par "le feu et la colère" et les fanfaronnades du "dirigeant suprême" de la Corée du Nord sur ses capacités de représailles. Aujourd’hui, les dirigeants de Corée du Nord et du Sud se serrent la main en public et nous promettent des avancées réelles vers la paix. Trump tiendra sa réunion en face à face avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.
Il y a seulement quelques semaines, on parlait d‘une troisième guerre mondiale qui éclaterait à partir de la guerre en Syrie, et dernièrement, c'est Trump qui avertissait la Russie que la riposte par ses missiles intelligents était imminente en représailles à l’attaque de Douma par des armes chimiques. Les missiles ont été lancés, aucune unité militaire russe n’a été touchée, et c’est comme si nous revenions au massacre "normal" sous sa forme quotidienne en Syrie.
Puis Trump en a remis une couche en annonçant que les États-Unis se retireraient du "Bad Deal" (mauvais accord) qu'Obama avait conclus avec l'Iran au sujet de son programme d'armement nucléaire. Cela a immédiatement créé des divisions entre les États-Unis et d'autres puissances occidentales qui considèrent que l'accord avec l'Iran fonctionnait, et qui font maintenant face à la menace de sanctions américaines si elles continuent à commercer ou à coopérer avec l'Iran. Et au Moyen-Orient même, l'impact n'a pas été moins immédiat : pour la première fois, une salve de missiles a été lancée contre Israël par les forces iraniennes en Syrie, et pas seulement par leur représentant local, le Hezbollah. Israël - dont le Premier ministre Netanyahou avait peu auparavant déclamé sa tirade sur les violations iraniennes du traité nucléaire - a réagi impitoyablement avec sa rapidité habituelle, frappant un certain nombre de bases iraniennes dans le sud de la Syrie.
Entre-temps, la récente déclaration de Trump de soutien à Jérusalem en tant que "nouvelle" capitale d'Israël a enflammé l'atmosphère en Cisjordanie occupée, en particulier à Gaza, où le Hamas a encouragé les manifestations "martyres" et, en une seule journée sanglante, Israël, enhardi par cette initiative, a répondu en massacrant plus de 60 manifestants (dont huit âgés de moins de 16 ans), blessant plus de 2 500 autres personnes, atteintes par des tireurs d'élite ou des tirs d’armes automatiques, des éclats d'obus de sources inconnues ou encore après avoir inhalé des gaz lacrymogènes pour avoir commis le "crime" de s'être approchées des clôtures frontalières et, dans certains cas, pour possession de pierres, de lance-pierres et de bouteilles d'essence attachées à des cerfs-volants.
Il est facile de céder à la panique dans un monde qui paraît de plus en plus hors de contrôle et de se rassurer lorsque la cause de nos peurs s'éloigne ou que les champs de bataille meurtriers disparaissent des agendas de l'actualité. Mais pour comprendre les dangers réels relatifs au système actuel et à ses guerres, il est nécessaire de prendre du recul, de considérer le déroulement des événements à l’échelle historique et mondiale.
Dans la Brochure de Junius [448], rédigée en prison en 1915, Rosa Luxemburg écrivait que la guerre mondiale signifiait que la société capitaliste sombrait déjà dans la barbarie : "le triomphe de l’impérialisme conduit à la destruction de la culture, sporadiquement pendant une guerre moderne, et pour toujours, si on laisse la période des guerres mondiales qui vient juste de s’ouvrir, suivre son cours détestable jusqu’à ses conséquences ultimes".
La "prévision" historique de Luxemburg a été reprise par l’Internationale Communiste fondée en 1919 : si la classe ouvrière ne renversait pas un système capitaliste qui est désormais entré dans une époque de déclin, la "Grande guerre" serait suivie par des guerres encore plus vastes, plus destructrices et plus barbares, mettant en danger la survie même de la civilisation. Et cela s’est effectivement avéré exact : la défaite de la vague révolutionnaire mondiale qui s’était déclenchée en réaction à la Première Guerre mondiale a ouvert la porte à un second conflit, encore plus cauchemardesque. Et après six ans d'une boucherie, dans laquelle les populations civiles ont été la cible première, l’envoi de bombes atomiques par les États-Unis contre le Japon a donné une forme concrète au danger auquel les futures guerres mèneraient l’humanité.
Pendant les quatre décennies suivantes, nous avons vécu sous l’ombre menaçante d’une troisième guerre mondiale entre des blocs qui dominaient la planète et qui possédaient l’arme nucléaire. Mais bien que la menace ait été sur le point de devenir une réalité comme pendant la crise de Cuba en 1962 par exemple – l’existence même des blocs américain et russe a imposé une sorte de discipline à la tendance naturelle du capitalisme à la guerre de chacun contre tous. C'est un facteur restreignant la possibilité que les conflits locaux – qui étaient généralement des batailles par procuration entre les blocs – ne se développent en dehors de tout contrôle. Un autre élément était le fait que, à la suite de la reprise à l’échelle mondiale de la lutte de classe après 1968, la bourgeoisie n'était pas assurée de pouvoir contrôler la classe ouvrière et de l'enrégimenter pour la guerre.
En 1989-1991, le bloc russe s’est effondré, confronté à l’encerclement croissant des États-Unis et à la faillite de son modèle de capitalisme d’État qui prévalait alors pour tenter de s’adapter désespérément aux nécessités de la crise économique mondiale. Les hommes d’État du camp américain victorieux se vantaient face à l’ennemi "soviétique" hors course, de nous faire entrer dans une nouvelle "ère de prospérité et de paix". En ce qui nous concerne, en tant que révolutionnaires, nous insistions sur le fait que le capitalisme n’en resterait pas moins impérialiste, pas moins militariste, et que la marche à la guerre inscrite dans la nature même du système prendrait une forme plus chaotique et moins prévisible.[1] Et cela aussi s’est avéré correct. Il est important de comprendre que ce processus, cette plongée dans le chaos militaire a empiré au cours des trois dernières décennies.
La montée en puissance de nouveaux challengers
Dans les premières années de cette nouvelle phase, la superpuissance américaine, consciente que la disparition de son ennemi russe allait provoquer des tendances centrifuges dans son propre bloc, a été encore capable d’exercer une certaine discipline sur ses anciens alliés. Durant la Première Guerre du Golfe, par exemple, ses subordonnés antérieurs (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Japon, etc.) ont non seulement rejoint ou soutenu la coalition dirigée par les États-Unis contre Saddam, mais celle-ci a également été épaulée par Gorbatchev en Russie et le régime syrien. Très vite cependant, des fissures ont commencé à apparaître : la guerre dans l’ex-Yougoslavie a vu la Grande Bretagne, l’Allemagne et la France prendre des positions qui, souvent, s’opposaient directement aux intérêts des États-Unis, et dix ans plus tard, la France, l’Allemagne et la Russie se sont ouvertement opposées à l’invasion américaine de l’Irak en 2003.
"L’indépendance" des anciens alliés occidentaux des États-Unis n’a jamais atteint le stade de constitution d’un nouveau bloc impérialiste opposé à Washington. Mais au cours des derniers 20 ou 30 ans, nous avons vu émerger une nouvelle puissance qui pose un défi plus marqué aux États-Unis : la Chine, dont la croissance économique surprenante s’est accompagnée d’une influence impérialiste allant s’élargissant, pas seulement en Extrême-Orient, mais à travers les terres d’Asie jusqu’au Moyen-Orient et en Afrique. La Chine a en effet montré sa capacité de mettre en œuvre une stratégie à long terme pour assouvir ses ambitions impérialistes – comme le montre la construction patiente de la "nouvelle route de la soie" vers l’ouest et la construction graduelle de bases militaires dans la mer de Chine.
Même si, à l'heure actuelle, les initiatives diplomatiques nord et sud-coréennes comme le sommet américano-coréen annoncé donnent l'impression que la "paix" et le "désarmement" peuvent être négociés, et que la menace de destruction nucléaire peut être contrecarrée par des "dirigeants qui reviennent à la raison", les tensions impérialistes entre les États-Unis et la Chine continueront à dominer les rivalités dans la région, et tout mouvement futur autour de la Corée sera en dernière analyse déterminé par cet antagonisme. Ainsi, la bourgeoisie chinoise s'est engagée dans une offensive mondiale à long terme, sapant non seulement les positions des États-Unis mais aussi celles de la Russie et d'autres pays en Asie centrale et en Extrême-Orient ; mais en même temps, les interventions russes en Europe de l'Est et au Moyen-Orient ont mis les États-Unis face au dilemme d'avoir à affronter deux rivaux présentant des niveaux de puissance différents et dans des régions différentes. Les tensions entre la Russie et un certain nombre de pays occidentaux, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont augmenté de manière très visible ces derniers temps. Ainsi, à côté de la rivalité déjà existante entre les États-Unis et leur plus sérieux challenger mondial, la contre-offensive russe est devenue un défi direct supplémentaire face à l'autorité des États-Unis.
Il est important de comprendre que la Russie s'engage effectivement dans une contre-offensive, une réponse à la menace d'étranglement par les États-Unis et ses alliés. Le régime de Poutine, avec sa confiance dans la rhétorique nationaliste et la force militaire héritée de l’ère "soviétique", n’ a pas été que le produit d’une réaction contre la politique économique de l’Occident de spoliation des biens de la Fédération de Russie durant les premières années de son existence, mais aussi, de façon plus importante, contre la continuation et même l’intensification de l’encerclement de la Russie qui avait commencé pendant la Guerre froide. La Russie a été privée de ses anciennes frontières protectrices à l’ouest par l’extension de l’UE et de l’OTAN à la majorité des États européens de l’Est. Dans les années 1990, avec sa politique brutale de terre brûlée en Tchétchénie, elle a montré comment elle allait réagir à toute velléité d’indépendance au sein de la Fédération elle-même. Depuis lors, elle a étendu sa politique à la Géorgie (2008) et à l’Ukraine (depuis 2014) – des États qui ne faisaient pas partie de la Fédération mais risquaient de devenir des foyers d’influence occidentale sur ses frontières septentrionales. Dans les deux cas, Moscou a utilisé les forces séparatistes locales, tout autant que ses forces militaires à peine déguisées, pour contrer les régimes pro-occidentaux.
Ces actions avaient déjà aiguisé les tensions entre la Russie et les États-Unis qui ont réagi en imposant des sanctions économiques à la Russie, plus ou moins soutenues par les autres États occidentaux malgré les différences qu’ils avaient avec les États-Unis au sujet de la politique russe et généralement basées sur leurs intérêts économiques particuliers (c’est particulièrement vrai pour l’Allemagne). Mais l’intervention de la Russie en Syrie qui a suivi a porté ces conflits à un autre niveau.
Le maelstrom moyen-oriental
En fait, la Russie a toujours soutenu le régime d’Assad en Syrie avec des armes et des conseillers. La Syrie a été depuis longtemps son dernier avant-poste au Moyen-Orient à la suite du déclin de l’influence de l’URSS en Libye, en Égypte et ailleurs. Le port syrien de Tartous est absolument vital pour ses intérêts stratégiques ; c’est son principal débouché en Méditerranée, et elle a toujours voulu y maintenir sa flotte. Mais, confrontée à la menace d’une défaite du régime d’Assad par les forces rebelles, et par l’avancée vers Tartous des forces de l’État Islamique, la Russie a fait le grand pas d’engager ouvertement ses troupes et sa flotte de guerre aérienne au service du régime d’Assad, ne montrant aucune hésitation à prendre part au ravage quotidien de villes et de faubourgs tenus par les rebelles, au prix fort du massacre des populations civiles.
Mais les États-Unis également ont ostensiblement disposé des forces en Syrie, en réponse à la montée de l’État Islamique. Et ils n’ont pas fait mystère de leur soutien aux rebelles anti-Assad - y compris l’aile djihadiste qui a été au service de la montée de l’État Islamique. Ainsi, le potentiel pour une confrontation directe entre forces russes et américaines existe dans cette région depuis un certain temps. Les deux réponses militaires américaines à l’utilisation probable d’armes chimiques par le régime ont plus ou moins un caractère symbolique, et pas des moindres parce que l’utilisation d’armes "conventionnelles" par le régime a de loin tué beaucoup plus de civils que l’utilisation de dérivés chlorés ou d’autres agents chimiques. Il y a des signes très forts que les militaires américains ont freiné Trump et se sont assurés qu’un grand soin serait apporté à ne frapper que des installations du régime d'Assad et pas les troupes russes.[2] Mais cela ne signifie pas que le gouvernement américain, ou le gouvernement russe, puissent éviter des confrontations plus directes entre eux à l’avenir ; les forces qui travaillent en faveur de la déstabilisation et du désordre sont simplement trop profondément enracinées et elles se révèlent avec de plus en plus de virulence.
Pendant les deux guerres mondiales, le Moyen-Orient a été un important, mais toutefois secondaire, théâtre de conflit : son importance stratégique s’est accrue avec le développement de ses immenses réserves de pétrole dans la période après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1948 et 1973, la principale scène de confrontations militaires a été la succession de guerres entre Israël et les États arabes voisins, mais ces guerres tendaient à être de courte durée et leur issue profitait largement au bloc américain. C’était une expression de la "discipline" imposée sur les puissances de deuxième et troisième rang par le système des blocs impérialistes. Mais, même pendant cette période, il y avait des signes d'une tendance plus centrifuge – très notablement la longue "guerre civile" au Liban et la "révolution islamique" qui sapaient la domination américaine en Iran, précipitant le déclenchement de la guerre Iran-Irak dans les années 1980 (dans laquelle les pays occidentaux ont surtout soutenu Saddam en tant que contrepoids à l’Iran).
La fin définitive du système des blocs a profondément accéléré ces forces centrifuges, et la guerre en Syrie les a portées à un sommet. Ainsi, en Syrie, ou autour, on peut voir qu’un certain nombre de batailles contradictoires ont lieu :
- Entre l’Iran et l’Arabie Saoudite : souvent sous le couvert de l’idéologie de la scission Sunnites-Chiites, les milices du Hezbollah du Liban, soutenues par l'Iran, ont joué un rôle clef dans la consolidation du régime d’Assad, en particulier contre les milices djihadistes soutenues par l’Arabie Saoudite et le Qatar (qui ont entre eux leur propre conflit séparé). L’Iran a été le plus grand bénéficiaire de l’invasion de l’Irak par les États-Unis, qui a conduit à la désintégration virtuelle de ce pays et à l’imposition d’un gouvernement pro-Iran à Bagdad. Ses ambitions impérialistes se sont manifestées par la suite dans la guerre au Yémen, scène d’une guerre brutale par procuration entre l’Iran et l’Arabie Saoudite (laquelle n'a cessé d'être soutenue par l’armée britannique[3]) ;
- Entre Israël et l’Iran : les récentes frappes aériennes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie s'inscrivent dans la continuité directe d'une série de raids visant à affaiblir les forces du Hezbollah dans ce pays. Il semble qu'Israël continue d'informer la Russie à l'avance de ces raids et, d'une manière générale, cette dernière ferme les yeux, bien que le régime de Poutine ait commencé à les critiquer plus ouvertement. Mais rien ne garantit que le conflit entre Israël et l'Iran n'aille pas au-delà de ces réponses contrôlées. Le "vandalisme diplomatique" de Trump à l'égard de l'accord nucléaire iranien alimente à la fois la position agressivement anti-iranienne du gouvernement Netanyahou et l'hostilité de l'Iran à l'égard du "régime sioniste" qui, il ne faut pas l'oublier, maintient depuis longtemps ses propres armes nucléaires au mépris des accords internationaux. Entre-temps, la récente déclaration de soutien de Trump à Jérusalem en tant que capitale d'Israël a mis le feu aux poudres en Cisjordanie occupée, et en particulier à Gaza, où les troupes israéliennes ont tué un certain nombre de manifestants aux barrières frontalières ;
- Entre la Turquie et les Kurdes qui ont établi des enclaves dans le nord de la Syrie. : la Turquie a secrètement soutenu l’État Islamique dans la lutte pour le Rojava, mais est intervenue directement contre l’enclave d’Afrin. Les forces kurdes, cependant, en tant que barrage le plus fiable au déploiement de l’État Islamique, ont été solidement soutenues par les États-Unis, même si ces derniers pourraient hésiter à les utiliser pour contrer directement les avancées militaires de l'impérialisme turc. En outre, les ambitions de la Turquie de jouer à nouveau un rôle de premier plan dans la région et au-delà l'ont non seulement entrainée dans un conflit avec les pays de l'OTAN et de l'UE, mais ont également renforcé les efforts de la Russie, malgré la rivalité de longue date de la Turquie avec le régime d’Assad.
- Le tableau du chaos s’est encore assombri avec la montée de nombreux gangs armés qui peuvent faire des alliances avec des États particuliers mais qui ne leur sont pas nécessairement subordonnés. L’État Islamique est l’expression la plus évidente de cette nouvelle tendance au brigandage et à l’existence de "seigneurs de guerre", mais n’est en rien la seule.
L’impact de l’instabilité politique
Nous avons déjà vu comment les déclarations impétueuses de Trump ont rendu encore plus imprévisible en général la situation au Moyen-Orient. Elles sont symptomatiques de profondes divisions au sein de la bourgeoisie américaine. Le président est actuellement l'objet d'investigation par l’appareil de sécurité en recherche de preuves de l’implication de la Russie (via ses techniques avancées de guerre cybernétique, les irrégularités financières, le chantage, etc.) dans la campagne électorale de Trump et jusqu’à récemment encore, Trump ne faisait guère mystère de son admiration pour Poutine, reflétant une possible option en faveur d’une alliance avec la Russie pour faire contrepoids à la montée de la Chine. Mais l’antipathie vis-à-vis de la Russie au sein de la bourgeoisie américaine est très enracinée et, quels que soient ses motifs personnels (comme la revanche ou le désir de prouver qu’il n’est pas un larbin des Russes), Trump a aussi été obligé de hausser le ton et de diriger son discours contre la Russie ; l’accession au pouvoir de Trump étant plutôt une preuve de la montée du populisme et de la perte croissante de contrôle de la bourgeoisie sur son propre appareil politique, expressions politiques directes de la décomposition sociale. Et de telles tendances dans l’appareil politique ne peuvent qu'accroître le développement de l'instabilité au niveau impérialiste, là où elle est la plus dangereuse.
Dans un contexte aussi volatil, il est impossible d’écarter le danger d’agissements soudains irrationnels et agressifs. La classe dominante n’a pas encore sombré dans la démence suicidaire : elle comprend encore que le déchaînement de son arsenal nucléaire court le risque de détruire le système capitaliste lui-même. Et pourtant, il serait insensé de compter sur le bon sens des gangs impérialistes qui dirigent actuellement la planète - même s'ils font actuellement des recherches sur la manière dont les armes nucléaires pourraient être utilisées pour gagner une guerre.
Comme Luxemburg insistait en 1915, la seule alternative à la destruction de la culture par l’impérialisme est "la victoire du socialisme, c'est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un "ou bien - ou bien" encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient."
La phase actuelle de décomposition capitaliste, de développement du chaos impérialiste, est le prix payé par l’humanité pour l’incapacité de la classe ouvrière à réaliser les espoirs de 1968 et de la vague internationale de luttes de classe qui a suivi : une lutte consciente pour la transformation socialiste du monde. Aujourd’hui, la classe ouvrière se trouve confrontée à la marche en avant de la barbarie, prenant la forme d’une multitude de conflits impérialistes, de désintégration sociale, et de ravage écologique. Et - à la différence de 1917-1918, quand la révolte des ouvriers a mis fin à la guerre - il est beaucoup plus difficile de s’opposer à ces formes de barbarie. Elles sont certainement à leur plus haut niveau dans des régions où la classe ouvrière a peu de poids social – la Syrie en étant l’exemple le plus évident, mais même dans des pays comme la Turquie, où la question de la guerre se pose à une classe ouvrière qui a une longue tradition de luttes, il y a peu de signes d’une résistance directe à l’effort de guerre. En ce qui concerne la classe ouvrière dans les pays centraux, ses luttes contre ce qui est maintenant une crise économique plus ou moins permanente sont actuellement à un niveau très faible, elles n’ont pas d'effet direct sur les guerres qui, bien que situées géographiquement à la périphérie de l’Europe, ont un impact de plus en plus grand – et principalement négatif – sur la vie sociale, à travers la montée du terrorisme, de la répression et des manipulations cyniques concernant la question des réfugiés[1].
Mais la guerre de classe est loin d’être finie. Ici et là, elle donne des signes de vie : dans les manifestations et les grèves en Iran, qui ont montré une réaction déterminée contre les aventures militaristes de l’État ; dans la lutte au sein du secteur de l’éducation au Royaume-Uni et aux États-Unis : par le mécontentement croissant vis-à-vis des mesures d’austérité gouvernementales en France et en Espagne. Cela reste, évidemment, bien en dessous du niveau requis pour répondre à la décomposition de l’ordre social tout entier, mais la lutte défensive de la classe ouvrière contre les effets de la crise économique reste toujours la base indispensable d’une remise en question plus profonde du système capitaliste.
Amos
[1] Voir en particulier notre texte d’orientation : "Militarisme et décomposition [401]" dans la Revue Internationale n° 64, 1991.
[2] "Le secrétaire de la défense américain, James Mattis, a réussi à freiner le président sur l’extension des frappes aériennes en Syrie… C'est Jim Mattis qui a sauvé la mise. Le secrétaire de la défense américain, chef du Pentagone et amiral en retraite a la réputation d’être un dur. Son ancien surnom était « Chien fou ». Quand la pression est montée en Syrie la semaine dernière, ce fut Mattis – et pas le département d’Etat ni le Congrès – qui s’est dressé devant un Donald Trump qui réclamait du sang par ses abois. Mattis a dit à Trump, en effet, que la troisième guerre mondiale n’allait pas se déclencher sous son patronage. Alors que les frappes aériennes ont commencé tôt le samedi, Mattis avait l'air plus président que le président. Le régime d’Assad, disait-il, a "de nouveau défié les normes des peuples civilisés …en utilisant des armes chimiques pour assassiner des femmes, des enfants et d’autres innocents. Nous et nos alliés trouvons ces atrocités inexcusables". À la différence de Trump, qui a utilisé un discours télévisé pour fustiger la Russie et son président, Wladimir Poutine, dans des termes hautement personnels et émotionnels, Mattis a gardé l’œil sur le ballon. Les États-Unis attaquent les capacités d’armement chimique de la Syrie, et c’est pour cela, a-t-il dit, ni plus ni moins, que les frappes aériennes ont lieu. Mattis a eu aussi un message plus rassurant pour Moscou : "je veux souligner que ces frappes sont dirigées contre le régime syrien … Nous sommes allés très loin pour éviter des victimes civiles et étrangères". En d’autres termes, les troupes et les installations russes au sol n’étaient pas une cible. De plus les attaques n’auraient lieu qu’une fois. Rien d’autre ne suivrait".( Simon Tisdall [712], The Guardian 15 avril 2018)
[4] Pour une évaluation générale de l’état de la lutte de classe, voir la résolution du 22ème congrès sur la lutte de classe internationale [701] dans la Revue Internationale n° 159.
Géographique:
- Moyen Orient [167]
Rubrique:
Cinquante ans depuis Mai 68
- 942 lectures
Les événements du printemps 68 ont revêtu, par leurs racines comme par leurs conséquences, une dimension internationale. Ils avaient pour soubassement les conséquences sur la classe ouvrière des premières morsures de la crise économique mondiale qui réapparaissait après plus d'une décennie de prospérité capitaliste.
Après des décennies d'écrasement, de soumission et de désorientation, en mai 1968 la classe ouvrière revenait par la grande porte sur la scène de l'histoire. Si l'agitation estudiantine qui se développait en France depuis le début du printemps et avant elle des luttes ouvrières radicales qui avaient eu lieu depuis 1967, avaient déjà modifié l'ambiance sociale du pays, l'entrée massive en lutte de la classe ouvrière (10 millions de grévistes) bouleversa tout le paysage social.
Assez rapidement, d'autres secteurs nationaux de la classe ouvrière mondiale allaient entrer à leur tour dans la lutte. Après l'immense grève de Mai 1968 en France, les luttes en Argentine (le Cordobazo), "l'automne chaud" italien et bien d'autres luttes dans différents pays du monde venaient faire la preuve que le prolétariat mondial était sorti de la période de contre-révolution. Contrairement à la crise de 1929, celle qui était en train de se développer n'allait pas déboucher sur la guerre mondiale mais sur un développement des combats de classe qui allaient empêcher la classe dominante d'apporter sa réponse barbare aux convulsions de son économie.
C'est pour célébrer l'anniversaire de cet évènement considérable que nous publions sur notre site internet un dossier constitué des principaux articles que le CCI a écrit sur cet évènement :
- "Comprendre Mai", dans Révolution Internationale n° 2 (ancienne série) - 1969 [714], qui en particulier, polémique avec les situationnistes qui déniaient à l'époque le retour de la crise économique dans l'ensemble des causes du surgissement du mouvement;
- "Mai 68 et la perspective révolutionnaire", Revue internationale n° 133 (Le mouvement étudiant dans le monde dans les années 1960 [17]) et 134 (Fin de la contre-révolution, reprise historique du prolétariat mondial [715]), qui entre dans le détail des événements eux-mêmes et examine leur importance historique.
Nous commençons également à publier une série de trois articles relatifs à un bilan de la période écoulée depuis 1968, avec le souci d'examiner dans quelle mesure les conclusions que nous avons tirées sur le sens de mai 68 ont été vérifiées par l'histoire. Le premier ("L'enfoncement dans la crise économique") porte sur le cours suivi par l'aggravation de la crise économique et les deux suivants porteront respectivement sur la dynamique de la lutte de classe et le développement du milieu révolutionnaire
******
L'enfoncement dans la crise économique [716]
Il y a cinquante ans, Mai 68, 2ème partie - Les avancées et les reculs de la lutte de classe depuis 1968 [717]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [41]
Approfondir:
- Mai 1968 [718]
Rubrique:
L'enfoncement dans la crise économique
- 320 lectures
Dans le numéro 2 de Révolution Internationale (RI), publié en 1969, il y a un article appelé "Comprendre mai [714]" écrit par Marc Chirik, qui était revenu de plus d’une décennie d’exil au Venezuela pour prendre une part active aux "événements de mai 68 en France"[1].
Cet article était une réponse polémique à la brochure "Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations [719]", publié par l’Internationale Situationniste (IS). Tout en reconnaissant que l’IS avait d’ailleurs pris une part active dans le mouvement de mai-juin, il démontait sa prétention quasi illimitée et imbue d’elle-même, qui l’amenait à la conclusion franchement substitutionniste que "l’agitation déclenchée en janvier 1968 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des Enragés, devait entraîner, sous cinq mois, une quasi-liquidation de l’État". Et que "jamais une agitation entreprise par un si petit nombre d’individus n’a entraîné, en si peu de temps, de telles conséquences."
Les bases matérielles de la révolution prolétarienne
Mais le cœur de la polémique de RI portait sur les conceptions sous-jacentes qui constituaient la base de cette exaltation des minorités "exemplaires" -leur rejet des bases matérielles de la révolution prolétarienne. L’article de Marc conclut d’ailleurs que le volontarisme et le substitutionnisme de l’IS étaient une conséquence logique du rejet de la méthode marxiste qui établit que les actions spontanées de masse de la classe ouvrière sont étroitement en lien avec la situation objective de l’économie capitaliste.
Ainsi, contre l’idée de l’IS que les "événements révolutionnaires" de mai-juin ont éclaté contre un capitalisme qui "fonctionnait bien", et qu’il n’y avait "aucune tendance à la crise économique" dans la période allant jusqu’à l’explosion, Marc a démontré que le mouvement avait été précédé par une menace croissante de chômage et des baisses de salaire - signes que la "glorieuse" prospérité de la période d’après-guerre arrivait à son terme. Et ces signes ne se limitaient pas à la France mais s’exprimaient sous des formes différentes dans le monde "développé", en particulier dans la dévaluation de la livre sterling et dans la crise du dollar aux États-Unis. Il soulignait que celles-ci n’étaient d’ailleurs que des signes et des symptômes, que "ce n’est pas la crise économique ouverte, d’abord parce que ce n’est que le début, et ensuite parce que dans le capitalisme actuel, l’État dispose de tout un arsenal de moyens lui permettant d’intervenir afin de pallier et partiellement, d’atténuer momentanément les manifestations les plus frappantes de la crise."
En même temps, tout en rejetant l’idée anarchiste (et situationniste) que la révolution est possible à tout moment, l’article affirme aussi que la crise économique est une condition nécessaire mais pas suffisante pour la révolution, que de profonds changements dans la conscience subjective des masses ne sont pas automatiquement produits par le déclin de l’économie, contrairement à ce qu’affirmaient les staliniens en 1929 qui déclaraient imminente l'ouverture d'une "troisième période" de la révolution à la suite du crash, alors qu'en réalité la classe ouvrière subissait la défaite la plus profonde de son histoire (dont le stalinisme était, bien sûr, à la fois un produit et un facteur actif).
Mai 68 n’était donc pas encore la révolution, mais signifiait que la période de contre-révolution qui avait suivi la défaite de la première vague révolutionnaire mondiale arrivait à son terme. "Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant se détériorant." L’article ne va pas plus loin dans l’examen des événements réels de 68 : ce n’est pas son but. Mais il donne certaines indications sur les conséquences de la fin de la contre-révolution (une période que Marc a vécu du début à la fin) sur le futur développement de la lutte de classe. Cela signifiait que la nouvelle génération de la classe ouvrière se libérait de beaucoup des mystifications qui avaient emprisonné cette dernière pendant la période précédente, surtout du stalinisme et de l’antifascisme, et bien que la crise qui se manifestait de nouveau allait pousser le capitalisme vers une autre guerre mondiale, aujourd’hui, à la différence de 1930, "le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystification capables de mobiliser les masses et de les jeter dans le massacre. Le mythe russe s’écroule, le faux dilemme "démocratie bourgeoise" contre "totalitarisme" est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu’elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses."
De plus, comme l’a souligné la série d‘articles écrits en 2008 dans la Revue Internationale (n° 133 et 135), "Mai 68 et la perspective révolutionnaire"[2], Mai 68 était plus qu’une réaction purement défensive devant la situation économique qui se détériorait, il a aussi donné lieu à une intense fermentation politique, à d’innombrables débats sur la possibilité d’une nouvelle société, à des tentatives sérieuses de jeunes éléments politisés - ouvriers tout autant qu’étudiants – de découvrir les traditions révolutionnaires du passé. Cette dimension du mouvement était surtout ce qui faisait revivre la perspective de la révolution, pas en tant que possibilité immédiate ou à court terme, mais comme produit historique de toute une période de résurgence de lutte de classe. Le produit plus immédiat de cet intérêt nouvellement trouvé dans la politique révolutionnaire a été la constitution d’un nouveau milieu politique prolétarien, y compris le groupe qui allait former le CCI au milieu des années 70.
La question que nous voulons soulever ici, cependant, est de savoir si, cinquante ans plus tard, les prédictions contenues dans l’article de Marc se sont avérées correctes ou bien insuffisantes.
50 ans de crise économique
La majorité des courants marxistes dans les premières décennies du 20ème siècle considéraient que la Première Guerre Mondiale représentait le tournant définitif de l’ère dans laquelle les rapports capitalistes de production avaient constitué "des formes de développement" des forces productives, vers une ère dans laquelle les forces productives deviennent des entraves à ce développement. Cela s’était concrétisé, au niveau économique, par la transformation des crises cycliques de surproduction qui avaient caractérisé le 19ème siècle, en un état chronique de crise économique accompagné par une militarisation permanente de l’économie et une spirale de guerres barbares. Cela ne signifiait pas, comme le pensaient certains des marxistes dans la période révolutionnaire qui a suivi la guerre de 1914-18, que le capitalisme était entré dans une "crise mortelle" dont il ne pourrait en aucune manière récupérer. Au sein d’une période globale de déclin, il y a encore des récupérations, une expansion dans de nouvelles zones précédemment hors du système capitaliste, et des avancées réelles dans la sophistication des forces productives. Mais la tendance de fond était à ce que la crise économique ne soit plus un orage passager, mais une maladie chronique, permanente, qui rentre dans des phases aiguës à certains moments. Cela devenait déjà clair avec la crise des années 30 : l’idée que "laisser faire", en comptant sur la main invisible du marché permettrait naturellement à l’économie de se rétablir - la réponse initiale des secteurs de la bourgeoisie les plus traditionnels - a dû laisser la place à une politique plus ouvertement interventionniste de l’État – qui a été typique du New Deal aux États-Unis, et de l’économie de guerre nazie en Allemagne. Et ce fut surtout cette dernière qui a révélé, dans une période de défaite de la classe ouvrière, le réel secret des mécanismes qui avaient permis d'atténuer la crise aigüe des années 30 : la préparation d’une seconde guerre impérialiste.
Notre article déclarait en 1969 le retour de la crise ouverte et cela s'est confirmé au cours des quelques années qui ont suivi, avec le choc de la soi-disant "crise du pétrole" de 1973-74 et les difficultés croissantes du consensus keynésien d’après-guerre, avec pour conséquences une montée de l’inflation et des attaques contre les conditions de vie des ouvriers, en particulier les salaires qui s’étaient régulièrement élevés pendant la période de prospérité d’après-guerre. Mais, comme nous l’avons montré dans notre article "30 ans de crise économique ouverte du capitalisme"[3] écrit en 1999, la tendance à la crise ouverte devenant un trait permanent du capitalisme décadent, celle-ci s'est avérée encore plus évidente dans toute la période depuis 1968 ; aujourd’hui, ce qu’il nous faut faire, c’est un article sur "50 ans de crise économique ouverte". Notre article de 1999 suit le cours de la crise au travers de l’explosion du chômage qui a suivi la mise en œuvre du "Thachérisme" et des "Reaganomics" au début des années 80 : le crash financier de 1987 ; la récession au début des années 90 ; les convulsions des Tigres et Dragons en Extrême Orient, de la Russie et du Brésil en 1997-98. Une version actualisée prendrait en compte d’autres récessions au tournant du millénaire, et bien sûr, le dit crash financier ou resserrement du crédit de 2007. L’article de 1999 souligne les principaux traits de l’économie dominée par la crise pendant ces décennies : la croissance sans entrave de la spéculation, du fait que l’investissement dans des activités productives génère de moins en moins de profit ; la désindustrialisation de zones entières des vieux centres capitalistes parce que le capital a été attiré par des sources de force de travail moins chère dans les pays "en développement" ; et à la base d'une grande partie à la fois de la croissance et des chocs financiers de toute cette période, la dépendance incurable du capital à la dette. Il montre que la crise du capitalisme ne s'évalue pas qu'au moyen des chiffres du chômage des taux de croissance, mais aussi à travers ses ramifications sociales, politiques et militaires. C’est ainsi que la crise économique mondiale du capitalisme a été un facteur décisif de la chute du bloc de l’Est en 1989-91, de l’intensification des tensions impérialistes et de l’exacerbation de la guerre et du chaos, surtout dans les zones les plus faibles du système global. Dans notre actualisation nécessaire, nous chercherions aussi à montrer le lien entre la concurrence accrue exigée par la crise et la mise à sac accélérée de l’environnement naturel, dont les conséquences (pollution, changement climatique, etc.) ont déjà un impact direct sur les populations dans le monde. En bref : le caractère prolongé de la crise ouverte du capitalisme dans les cinq dernières décennies, avec les deux classes majeures antagoniques de la société – la bourgeoisie et le prolétariat – qui sont l'une et l'autre incapables d’aller vers leur solution propre – la guerre mondiale ou la révolution – est à la base d’une nouvelle phase terminale de la décadence du capitalisme, sa phase de décomposition généralisée.
Evidemment, la dynamique de cette période n’a pas été celle d'un long déclin ou même un état permanent de stagnation, et la classe dominante a toujours utilisé au mieux dans sa propagande les différentes reprises et mini booms qui ont eu lieu dans les pays plus avancés au cours des années 1980, 90 et 2000, tandis que, pour beaucoup de ses porte-paroles, la montée impressionnante de l’économie chinoise en particulier, est la preuve matérielle que le capitalisme est loin d’être un système sénile. Mais les bases fragiles, limitées et temporaires de ces reprises dans les centres établis du système ont clairement été mises en lumière par l’énorme crash financier de 2007, qui montrait à quel point la croissance capitaliste reposait sur les sables mouvants de la dette illimitée. Ce phénomène est aussi un élément ayant participé de la montée de la Chine, même si la croissance de cette dernière a une base plus substantielle que "la récupération par vampirisation", les "reprises sans emplois", et "les reprises sans augmentation de salaire" que nous avons vues dans économies occidentales. Mais en dernière analyse, la Chine ne peut pas échapper aux contradictions du système global ; d’ailleurs l’échelle vertigineuse de son expansion a le potentiel de rendre les futures crises mondiales de surproduction encore plus destructrices. En prenant du recul par rapport aux cinq dernières décennies, il devient évident que nous ne parlons pas d’un cycle d’expansion et de récession comme au 19ème siècle, quand le capitalisme était réellement un système dans la fleur de l'âge, mais d’une seule crise économique mondiale prolongée, expression elle-même d’une obsolescence sous-jacente du mode de production. L’article de 1969, armé de cette compréhension de la nature historique du capitalisme, était capable de diagnostiquer la signification réelle des petits signes de mauvaise santé économique que les docteurs situationnistes ont si facilement écartés.
Le développement du capitalisme d’État
En prenant ainsi du recul, nous pouvons aussi apprécier la justesse de l’affirmation de l’article selon laquelle "dans le capitalisme actuel, l'État dispose de tout un arsenal de moyens lui permettant d'intervenir afin de pallier et partiellement, d'atténuer momentanément les manifestations les plus frappantes de la crise."
La principale raison pour laquelle cette crise a trainé si longtemps et a souvent été si difficile à percevoir, c’est précisément la capacité de la classe dominante à contenir et retarder les effets des contradictions du système. La classe dominante, depuis les années 68, n’a pas fait la même erreur que ceux qui faisaient l’apologie du "laisser faire" dans les années 1930. Au lieu de cela, une bourgeoisie plus ancienne et plus expérimentée a maintenu et renforcé l’interférence du capitaliste d’Etat dans l’économie qui avait permis de répondre à la crise dans les années 1930 et avait contribué à soutenir le boom d’après-guerre. Ce fut encore évident avec les premières réponses keynésiennes au réveil de la crise, qui ont souvent pris la forme de nationalisations et de manipulations financières directes de l’Etat ; et malgré tout le rideau de fumée idéologique, cela a continué, bien que sous forme altérée, durant l’époque des "Reaganomics" et du "néo-libéralisme", où l’État a eu tendance à déléguer beaucoup de ses fonctions au secteur privé dans le but d’accroître la productivité et l’avantage concurrentiel.
L’article de 1999 explique comment ce rapport révisé entre État et économie a opéré : "Le mécanisme d'"ingénierie financière" est le suivant. D'un côté, l'État émet des bons et des obligations pour financer ses déficits énormes et toujours croissants qui sont souscrits par les marchés financiers (banques, entreprises et particuliers). D'un autre côté, il pousse les banques à chercher sur le marché le financement de leurs prêts, recourant, à leur tour, à l'émission de bons et obligations et à des augmentations de capital (émission d'actions). Il s'agit d'un mécanisme hautement spéculatif qui consiste à essayer de tirer profit du développement d'une masse croissante de capital fictif (plus-value immobilisée incapable d'être investie dans un nouveau capital).
De cette manière, les fonds privés tendent à peser beaucoup plus que les fonds publics dans le financement de la dette (publique et privée).
Ceci signifie moins une diminution du poids de l'État (comme le proclament les "libéraux") qu'une réponse aux nécessités chaque fois plus écrasantes de financement (et particulièrement de liquidités immédiates) qui obligent à une mobilisation massive de tous les capitaux disponibles".
La crise du crédit de 2007 est peut-être la démonstration la plus claire que le remède le plus universel adopté par le système capitaliste – le recours à la dette – dans les quelques dernières décennies a aussi empoisonné le patient, ne retardant l’impact immédiat de la crise qu’en provoquant de futures convulsions à un niveau encore plus élevé. Mais cela montre aussi, en dernière analyse, que ce traitement a été la politique systématique de l’État capitaliste. La mine d’or du crédit qui a alimenté le boom de l’immobilier avant 2007, si souvent reproché aux banquiers cupides, était en réalité une politique décidée et soutenue aux plus hauts échelons du gouvernement, exactement comme c’est le gouvernement qui a dû intervenir pour consolider les banques et l’ensemble de l’édifice financier vacillant dans le sillage du crash. Le fait qu’ils aient fait cela en s’endettant encore plus, et même en imprimant de l’argent de façon éhontée ("quantitative easing" - assouplissement quantitatif) est une preuve de plus que le capitalisme ne peut que réagir à ses contradictions qu’en les rendant pires.
C’est une chose de montrer que nous avions raison de prévoir la réapparition de la crise économique ouverte en 1969, et de donner un cadre pour expliquer pourquoi cette crise serait une affaire au long cours. C’est une tâche plus difficile de montrer que notre prédiction d’une reprise de la lutte de classe internationale s’est aussi confirmée. Nous dédierons donc une deuxième partie de cet article à ce problème, tandis qu’une troisième partie analysera ce qu’il est advenu du nouveau mouvement révolutionnaire qui est né à partir des événements de mai-juin 1968.
Amos
[1] Voir aussi notre courte biographie de Marc [556] pour avoir une meilleure idée d’un aspect de cette "participation active" au mouvement. "Il a alors l'occasion de manifester un des traits de son caractère qui n'a rien à voir avec celui d'un "théoricien en chambre" : présent sur tous les lieux où vit le mouvement, dans les discussions mais aussi dans les manifestations, il passe une nuit entière derrière une barricade bien décidé, avec un groupe déjeunes éléments, à "tenir jusqu'au matin" face à la police... comme l'avait fait la petite chèvre de Monsieur Seguin race au loup dans le conte d'Alphonse Daudet." Revue Internationale n °67, 1991.
Rapport sur les tensions impérialistes (Novembre 2017)
- 282 lectures
Le rapport que nous publions ci-dessous a été présenté et discuté au sein d'une réunion internationale du CCI (au mois de novembre 2017) destinée à faire le point sur l'évolution des grandes tendances présidant à l'évolution des tensions impérialistes. Pour ce faire, il s’appuie sur les textes et rapports où ces tendances avaient été analysées et discutées en profondeur au sein de notre organisation, à savoir le texte d’orientation (TO) "Militarisme et décomposition [401]" de 1991 (publié dans la Revue internationale n° 64, 1e trimestre 1991) et le rapport du 20e Congrès International [722] (Revue internationale n° 152, 2e sem. 2013).
Depuis l'écriture de ce dernier rapport, il s'est produit une série d'évènements majeurs de l'aggravation des tensions impérialiste au Moyen-Orient. Tout d'abord l'incursion militaire directe de la Turquie en Syrie le 20 janvier dernier pour affronter les troupes kurdes basées dans la région d'Afrin, dans le Nord de la Syrie. Cette intervention, qui s'effectuait avec l'accord au moins tacite de la Russie, est lourde de futures confrontation militaires, en particulier avec les États-Unis, alliés dans cette région aux forces kurdes de l’YPG, et de déchirements au sein de l'OTAN dont sont membres la Turquie et les États-Unis. Ensuite intervenait la frappe militaire en Syrie des États-Unis (appuyés par la Grande-Bretagne et la France) prenant pour cible des sites présumés de fabrication d'armes chimiques et significative de l'accroissement direct des tensions entre les États-Unis et la Russie. Plus récemment encore, la décision de Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien constitue un facteur d'attisement des tensions entre Israël et l'Iran mais aussi de déstabilisation au niveau mondial, la décision américaine ayant été condamnée par une grande majorité de pays. Tout ceci illustre le risque d'escalade incontrôlée et d'embrasement au Moyen-Orient et le fait que, comme le développe notre article du même nom, "Le capitalisme est de plus en plus une menace pour l’humanité [723]".
(14/05/2018).
* * *
Ces quatre dernières années, depuis la tenue de notre 20e congrès international, les rapports impérialistes ont connu des développements majeurs : la guerre en Syrie et le combat contre l'État Islamique, l’intervention russe en Ukraine, la crise des réfugiés et les attentats en Europe, le Brexit et la pression du populisme, l’élection de Trump aux États-Unis et les accusations d’immixtion de la Russie dans la campagne électorale (Russiagate), les tensions entre les États-Unis et la Chine face aux provocations de la Corée du Nord, l’opposition entre l’Arabie Saoudite et l’Iran (expliquant les pressions exercées par ce premier pays sur le Qatar), le coup d’État manqué contre Erdogan et la répression en Turquie, le conflit autour de l'autonomie kurde, la flambée du nationalisme entre la Catalogne et l’Espagne, etc. Il est donc important d'évaluer dans quelle mesure ces événements sont en continuité avec nos analyses générales de la période mais aussi quelles sont les orientations nouvelles qu’ils révèlent ?
Pour ce faire, il est crucial, comme le pose d’emblée le texte d’orientation TO "Militarisme et décomposition" d’utiliser la méthode adéquate pour appréhender une situation qui est inédite :
- "Contrairement au courant bordiguiste, le CCI n'a jamais considéré le marxisme comme une "doctrine invariante", mais bien comme une pensée vivante pour laquelle chaque événement historique important est l'occasion d'un enrichissement. En effet, de tels événements permettent, soit de confirmer le cadre et les analyses développés antérieurement, venant ainsi les conforter, soit de mettre en évidence la caducité de certains d'entre eux, imposant un effort de réflexion afin d'élargir le champ d'application des schémas valables auparavant mais désormais dépassés, ou bien, carrément, d'en élaborer de nouveaux, aptes à rendre compte de la nouvelle réalité. Il revient aux organisations et aux militants révolutionnaires la responsabilité spécifique et fondamentale d'accomplir cet effort de réflexion en ayant bien soin, à l'image de nos aînés comme Lénine, Rosa Luxemburg, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste Internationale (Bilan), la Gauche Communiste de France, etc., d'avancer à la fois avec prudence et audace :
- en s'appuyant de façon ferme sur les acquis de base du marxisme ;
- en examinant la réalité sans œillères et en développant la pensée sans "aucun interdit, non plus qu'aucun ostracisme" (Bilan).
En particulier, face à de tels événements historiques, il importe que les révolutionnaires soient capables de bien distinguer les analyses qui sont devenues caduques de celles qui restent valables, afin d'éviter un double écueil : soit s'enfermer dans la sclérose, soit "jeter le bébé avec l'eau du bain".
La mise en pratique de cette approche, imposée il est vrai par la réalité du moment, a constitué la base de notre capacité d’analyse des évolutions fondamentales sur le plan impérialiste ces 26 dernières années.
Dans cette perspective, le présent rapport propose trois niveaux d’appréhension des événements récents afin de situer leur importance par rapport à nos cadres d’analyse :
- 1. Dans quelle mesure s’accordent-ils avec le cadre d’analyse développé après l’implosion du bloc de l’Est ? Nous rappellerons à ce propos les axes d’analyse principaux du TO "Militarisme et décomposition"
- 2. Dans quelle mesure s’inscrivent-ils dans les orientations majeures des tensions impérialistes au niveau mondial, telles qu’elles ont été décrites dans le rapport du 20e Congrès International ?
- 3. Quelles sont les évolutions marquantes qui caractérisent le développement des tensions impérialistes aujourd’hui ?
Les orientations du TO de 1991
Ce texte présente le cadre d’analyse pour comprendre la question de l’impérialisme et du militarisme dans la période de décomposition. Il avance deux orientations fondamentales pour la caractérisation de l’impérialisme dans la période actuelle :
- Dans la phase de décomposition du capitalisme, du fait de la disparition des blocs impérialistes, l’impérialisme et le militarisme deviennent encore plus barbares et chaotiques.
- La reconstitution de blocs impérialistes n’est pas à l’ordre du jour.
La disparition des blocs ne remet pas en cause la réalité de l’impérialisme et du militarisme
Au contraire, ceux-ci deviennent plus barbares et chaotiques : "En effet, ce n'est pas la constitution de blocs impérialistes qui se trouve à l'origine du militarisme et de l'impérialisme. C'est tout le contraire qui est vrai : la constitution des blocs n'est que la conséquence extrême (qui, à un certain moment peut aggraver les causes elles-mêmes), une manifestation (qui n'est pas nécessairement la seule) de l'enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme et la guerre. (…) La fin des blocs ne fait qu'ouvrir la porte à une forme encore plus barbare, aberrante et chaotique de l'impérialisme".
Cela s’exprime en particulier par le déchaînement des appétits impérialistes tous azimuts et la multiplication des tensions et conflits : "La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. (…) du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible".
De même on assiste au développement du "chacun pour soi" et, en corollaire, des tentatives de contenir le chaos, qui sont tous les deux des facteurs d’aggravation de la barbarie guerrière : "le chaos régnant déjà dans une bonne partie du monde et qui menace maintenant les grands pays développés et leurs rapports réciproques, (…) face à la tendance au chaos généralisé propre à la phase de décomposition, et à laquelle l'effondrement du bloc de l'Est a donné un coup d'accélérateur considérable, il n'y a pas d'autre issue pour le capitalisme, dans sa tentative de maintenir en place les différentes parties d'un corps qui tend à se disloquer, que l'imposition du corset de fer que constitue la force des armes. En ce sens, les moyens mêmes qu'il utilise pour tenter de contenir un chaos de plus en plus sanglant sont un facteur d'aggravation considérable de la barbarie guerrière dans laquelle est plongé le capitalisme".
Le TO souligne donc de manière centrale qu’il y a une tendance historique au "chacun pour soi", à l’affaiblissement du contrôle des États-Unis sur le monde, en particulier sur leurs ex-alliés, et à une tentative de leur part sur le plan militaire, où ils ont une supériorité énorme, de maintenir leur statut en imposant leur contrôle sur ces mêmes alliés.
La reconstitution de blocs n’est pas à l’ordre du jour
Le caractère de plus en plus barbare et chaotique de l’impérialisme en période de décomposition est une entrave majeure à la reconstitution de nouveaux blocs : "l'exacerbation de ces deux derniers [le militarisme et l’impérialisme] dans la phase actuelle de vie du capitalisme constitue, de façon paradoxale, une entrave majeure à la reformation d’un nouveau système de blocs prenant la suite de celui qui vient de disparaître. (…) Le fait même que la force des armes soit devenue - comme le confirme la guerre du Golfe - un facteur prépondérant dans la tentative de la part des pays avancés pour limiter le chaos mondial, constitue une entrave considérable à cette tendance. (…) La reconstitution d'un nouveau couple de blocs impérialistes, non seulement n'est pas possible avant de longues années, mais peut très bien ne plus jamais avoir lieu."
Les États-Unis sont les seuls à pouvoir jouer le gendarme du monde. Les seuls autres candidats possibles au leadership d’un bloc sont l’Allemagne et le Japon : "(…) le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre États n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire".
Par ailleurs, L’URSS ne pourra jamais reconquérir un rôle de challenger : "(…) il est hors de question, par exemple, que la tête du bloc qui vient de s'effondrer, l'URSS, puisse un jour reconquérir une telle place."
Ici aussi, l’analyse reste exacte pour l’essentiel : après vingt-cinq ans en période de décomposition, aucune perspective de reconstitution de blocs ne se dessine.
En conclusion, le cadre et les deux axes principaux présentés dans le TO ont largement été confirmés et restent profondément valables.
Une réflexion plus poussée s’impose cependant concernant certaines composantes de l’analyse
Le rôle des États-Unis comme seul gendarme du monde a fort évolué au cours de ces 25 années : c’est une des questions centrales qui sera approfondie plus avant dans ce rapport. Cependant, le TO met en évidence une orientation qui s’est concrétisée au-delà des prévisions de 1991 : le fait que l'action des États-Unis allait créer encore plus de chaos. Ceci est magistralement illustré par le développement du terrorisme d’aujourd'hui, conséquence essentiellement de la politique des États-Unis en Irak, et accessoirement de l’intervention franco-britannique en Lybie.
De plus, nous pouvons dire aujourd’hui que l’analyse surestimait le rôle potentiel attribué au Japon et même à l’Allemagne. Le Japon a pu renforcer son armement et a gagné plus d'autonomie dans certains secteurs, mais cela n’est en rien comparable à une tendance à la formation de bloc car le Japon a dû se soumettre à la protection américaine face à la Corée du Nord et surtout à la Chine. La potentialité subsiste pour l’Allemagne sans s’être réellement renforcée durant ces 25 ans. L'Allemagne a gagné plus de poids, joue un rôle prépondérant et même dirigeant en Europe, mais, sur plan militaire, elle reste toujours un nain, même si (a contrario du Japon) elle fait participer ses troupes dans le plus de 'mandats' militaires possibles de l'ONU. Par contre, la période a vu l’émergence de la Chine comme nouvelle puissance ascendante, rôle que nous avons largement sous-estimé dans le passé.
Par ailleurs, pour la Russie enfin, l’analyse reste fondamentalement correcte, dans le sens aussi que sa position de chef de bloc en 1945 était déjà un "accident de l’histoire". Mais les prédictions qu’elle "ne pourra jouer, malgré ses arsenaux considérables, de rôle majeur sur la scène internationale" et qu’elle "est condamnée à retrouver la place de troisième ordre" ne se sont pas vraiment concrétisées : la Russie n'est certes pas redevenue un challenger mondial des États-Unis mais elle joue un rôle non négligeable en tant que "fauteur de trouble", typique de la décomposition, exacerbant par ses interventions militaires et ses alliances le chaos partout dans le monde (elle a engrangé certains succès comme en Ukraine et en Syrie, a renforcé sa position envers la Turquie et l’Iran et a développé une coopération avec la Chine). Nous avons sans doute sous-estimé à ce niveau les ressources d’un impérialisme aux abois, prêt à tout pour défendre becs et ongles ses intérêts.
Les analyses du rapport du 20e congrès du CCI (2013)
S’inscrivant dans le cadre d’un impérialisme de plus en plus barbare et chaotique et de l’impasse croissante de la politique des États-Unis, qui ne fait qu’exacerber la barbarie guerrière (axes du rapport du 19e congrès du CCI[1]), le rapport met en avant quatre orientations dans le développement des confrontations impérialistes qui concrétisent et complètent pour l’essentiel les axes du TO de 1991.
- L’accroissement du "chacun pour soi", qui se traduisait en particulier par une multiplication tous azimuts des ambitions impérialistes. Ceci s’exprime concrètement par :
- (a) le danger de confrontations guerrières et l’instabilité croissante des États au Moyen-Orient, qui, en contraste avec la première guerre du Golfe de 1991, suscitée par les États-Unis et menée par une coalition internationale sous leur direction, mettent en évidence l’extension terrifiante du chaos ;
- (b) la montée en puissance de la Chine et l’exacerbation des tensions en Extrême-Orient. L’analyse du rapport corrige partiellement la sous-estimation du rôle de la Chine dans nos analyses antérieures. Cependant, malgré la mise en évidence d’une expansion économique impressionnante, d’une puissance militaire croissante et d’une présence de plus en plus marquée dans les confrontations impérialistes, le rapport affirme que la Chine ne dispose pas des capacités industrielles et technologiques suffisantes pour s’imposer comme tête d’un bloc pour constituer le challenger des États-Unis sur un plan mondial.
- L’impasse croissante de la politique de gendarme mondial des États-Unis, en particulier en Afghanistan et en Irak entraîne une fuite dans la barbarie guerrière. "L’échec cuisant des interventions en Irak et en Afghanistan a affaibli le leadership mondial des États-Unis. Même si la bourgeoisie américaine sous Obama, en choisissant une politique de retraite contrôlée d’Irak et d’Afghanistan, a su réduire l’impact de la politique catastrophique menée par Bush, elle n’a pas pu en inverser la tendance et cela a entraîné sa fuite en avant dans la barbarie guerrière. L’exécution de Ben Laden a exprimé une tentative des États-Unis de réagir à ce recul de leur leadership et a souligné leur supériorité technologique et militaire absolue. Cependant, cette réaction ne remettait pas en question la tendance de fond à l’affaiblissement."
- Une tendance s’affirme à l’extension explosive des zones d’instabilité permanente et de chaos : "(…) sur des pans entiers de la planète, de l’Afghanistan jusqu’en Afrique, à un point tel que certains analystes bourgeois, tels le français Jacques Attali, parlent carrément de "somalisation’ du monde".
- La crise de l’euro (avec les PIGS : Portugal, Irlande, Grèce et Espagne) accentue les tensions entre États européens et les tendances centrifuges au sein de l’UE : "D’autre part, la crise et les mesures drastiques imposées poussent vers un éclatement de l’UE et un rejet de la soumission au contrôle d’un pays quelconque, c’est-à-dire poussent vers le "chacun pour soi". La Grande-Bretagne refuse radicalement les mesures de centralisation proposées et dans les pays du sud de l’Europe, un nationalisme antiallemand croît. Les forces centrifuges peuvent aussi impliquer une tendance à la fragmentation d’États, à travers l’autonomisation de régions comme la Catalogne, l’Italie du nord, la Flandre ou l’Écosse. (…) Ainsi, la pression de la crise, à travers le jeu complexe des forces centripètes comme centrifuges, accentue le processus de désagrégation de l’UE et exacerbe les tensions entre États."
Les quatre orientations majeures de la situation, développées dans le rapport, restent également valables. Elles mettent déjà bien en évidence que la tension entre d’une part le "chacun pour soi" et d’autre part les tentatives pour contenir le chaos, mise en évidence dans le TO de 1991, tend de plus en plus à déboucher sur une situation chaotique de plus en plus explosive.
Le développement général de l’instabilité dans les rapports impérialistes
Depuis le rapport de 2013, les événements confirment le glissement des rapports impérialistes vers des tensions tous azimuts et un chaos de moins en moins contrôlable. Mais surtout, la situation est marquée par son caractère hautement irrationnel et imprédictible, lié à l’impact des pressions populistes et, en particulier, au fait que la première puissance mondiale est dirigée aujourd’hui par un président populiste aux réactions imprévisibles. Une approche de plus en plus à court-terme de la bourgeoisie et une forte imprédictibilité des politiques qui en découlent marquent avant tout la politique du gendarme américain, mais aussi la politique des autres puissances impérialistes majeures, le développement des conflits dans le monde et l’accroissement des tensions en Europe.
Le déclin de la superpuissance américaine et la crise politique au sein de la bourgeoisie de ce pays
L’arrivée au pouvoir de Donald Trump, surfant sur une vague populiste, a eu trois conséquences majeures.
La première concerne l'imprévisibilité des décisions et l'incohérence de la politique étrangère des États-Unis. Les agissements de ce président populiste et de son administration, tels la dénonciation des traités transpacifique et transatlantique, de l’accord sur le climat, la remise en question de l’OTAN et du traité nucléaire avec l’Iran, le soutien inconditionnel à l’Arabie Saoudite, la surenchère belliciste avec la Corée du Nord ou les tensions avec la Chine, sapent les bases des politiques et des accords internationaux, qui avaient été défendus par les différentes administrations américaines précédentes. Ses décisions imprévisibles, ses menaces et ses coups de poker ont pour effets de saper la fiabilité des États-Unis comme allié et d’accentuer le déclin de la seule superpuissance.
Ainsi, les rodomontades, les coups de bluff et les brusques changements de position de Trump non seulement ridiculisent les États-Unis mais mènent au fait que de moins en moins de pays leur font confiance.
De même, bien que la bourgeoisie américaine sous Obama, en choisissant une politique de retraite contrôlée en Irak et en Afghanistan, ait su réduire l’impact de la politique catastrophique menée par Bush, elle n’a pas pu en inverser la tendance et l’impasse de la politique américaine est accentuée de manière éclatante à travers les agissements de l’administration Trump. Lors du G 20 de 2017 à Hambourg, l’isolement des États-Unis était évident sur la question du climat, de la guerre commerciale. Par ailleurs, l’engagement russe en Syrie pour sauver Assad a fait reculer les États-Unis et renforce le poids de la Russie au Moyen-Orient, en particulier en Turquie et en Iran, tandis que les États-Unis n’ont pu contenir l’émergence de la Chine du statut d’outsider au début des années 1990 vers celui d’un challenger sérieux qui se présente comme le champion de la mondialisation.
Le risque de déstabiliser la situation mondiale et d'augmenter les crispations impérialistes n'a jamais été aussi fort, comme on le voit avec la Corée du Nord ou l’Iran : la politique américaine est plus que jamais un facteur direct d’aggravation du chaos sur un plan global.
La deuxième conséquence de l'arrivée de Trump au pouvoir est l'ouverture d'une crise politique majeure au sein de la bourgeoisie américaine. Le besoin constant d’essayer de cadrer l’imprévisibilité des décisions présidentielles mais surtout les soupçons que le succès électoral de Trump serait largement dû à des soutiens provenant de Russie (Russiagate), un fait totalement inacceptable du point de vue de la bourgeoisie américaine, mettent en évidence une situation politique particulièrement délicate et une difficulté à contrôler le jeu politique.
La lutte incessante pour “cadrer” le président se joue à plusieurs niveaux : pression exercée par le Parti Républicain (échec des votes sur la suppression de l'Obamacare, opposition aux plans de Trump par ses ministres (Le ministre de la Justice J. Sessions qui refuse de démissionner ou les ministres des Affaires étrangères et de la Défense qui "nuancent" les propos de Trump), lutte pour la prise de contrôle du staff de la Maison Blanche par les "généraux" (Mc Master, Mattis). Toutefois, ce cadrage n’empêche pas les "dérapages", comme lorsque Trump conclut en septembre un deal avec les Démocrates pour contourner l’opposition des Républicains à l’augmentation du plafond de la dette.
Quelle que soit l'orientation impérialiste de la bourgeoisie américaine envers la Russie, sur laquelle des divergences peuvent aussi exister entre factions de la bourgeoisie américaine, (comme nous allons le voir), le scandale du Russiagate est gravissime avec l’accusation d’immixtion de la Russie dans la campagne présidentielle américaine et la connexion de Trump avec la mafia russe. En effet, pour la première fois, un président américain est élu avec le soutien de la Russie, ce qui est inacceptable pour intérêts de la bourgeoisie américaine. Si les enquêtes devaient confirmer les accusations, elles ne pourraient que mener à une procédure d’impeachment à l'encontre de Trump.
Et enfin, la dernière conséquence de l'arrivée de Trump au pouvoir est le développement des tensions quant aux options pour l’impérialisme américain. En effet, la question des liens avec la Russie est aussi l’objet de confrontations entre clans au sein de la bourgeoisie américaine. Comme le challenger principal est aujourd’hui la Chine, un rapprochement avec l’ancienne tête du bloc rival et puissance militaire importante est-il acceptable pour la bourgeoisie américaine en vue de contenir le chaos, le terrorisme et la poussée chinoise ? L’Amérique peut-elle contribuer à la réémergence de sa rivale de la Guerre Froide et accepter de négocier un compromis avec elle dans certains domaines ? Cela permettrait-il de contenir les ambitions chinoises et de frapper un coup contre l’Allemagne ? Au sein de l’administration Trump, les partisans d’un rapprochement sont nombreux, comme les ministres Tillerson aux Affaires étrangères et Ross au Commerce et aussi le beau-fils du président, Jared Kushner. De larges parties de la bourgeoisie américaine ne semblent toutefois pas disposées à faire des concessions sur ce plan (en particulier au sein de l’armée, des services secrets, du parti démocrate). Dans ce cadre, les investigations concernant le Russiagate, impliquant la possibilité de manipulation et de chantage d’une présidence américaine par un ennemi extérieur, sont largement exploitées par ces factions pour rendre tout rapprochement avec la Russie totalement inacceptable.
La crise du gendarme américain exacerbe encore l’accroissement du "chacun pour soi" des autres puissances impérialistes et l’imprédictibilité des relations entre elles
Les orientations protectionnistes de Trump et la sortie des États-Unis de divers accords internationaux amènent divers puissances, surtout européennes et asiatiques, à renforcer leurs liens – sans exclure totalement pour le moment les États-Unis –, à exprimer leur désir de devenir plus indépendantes des États-Unis et à défendre leurs intérêts propres. Cela est apparu clairement à travers la collaboration entre l’Allemagne et la Chine lors du dernier G20 à Hambourg et cette collaboration entre pays européens et asiatiques se manifeste aussi dans la conférence sur le climat de Bonn qui vise à concrétiser les objectifs délimités à Paris.
La position de retrait des États-Unis exacerbe le "chacun pour soi" chez les autres grandes puissances : nous avons déjà évoqué l’agressivité impérialiste de la Russie qui lui a permis de regagner des points sur le champ de bataille impérialiste planétaire (Ukraine, Syrie). En ce qui concerne la Chine, nous sous-estimions encore dans rapport du 20e congrès international à la fois la rapidité de la modernisation économique et la stabilité politique interne dans ce pays qui semble s’être fortement renforcée sous Xi. La Chine se présente aujourd’hui comme le défenseur de la globalisation face au protectionnisme américain et comme un pôle de stabilité planétaire face à l’instabilité de la politique de ce pays, tout en développant une stratégie militaire visant à augmenter sa présence militaire en dehors de la Chine (Mer de Chine du Sud).
Ce développement du "chacun pour soi" peut aller de pair avec la mise en place d’alliances circonstanciées (Chine et Allemagne pour orienter le G20, le tandem franco-allemand pour renforcer la coopération militaire en Europe, Chine et Russie par rapport à l’Iran), mais celles-ci restent fluctuantes et ne peuvent être considérées comme des bases pour l’émergence de véritables blocs. Considérons sur ce plan l’exemple de l’alliance entre la Chine et la Russie. Les deux puissances partagent des intérêts communs, par exemple face aux États-Unis en Syrie et en Iran, ou en Extrême-Orient (Corée du Nord) face aux États-Unis et au Japon. Elles ont d’ailleurs effectué des manœuvres militaires communes dans les deux régions. La Russie est devenue un gros fournisseur d'énergie à la Chine, réduisant ainsi sa dépendance envers l’Ouest, tandis que cette dernière livre massivement des biens de consommation et effectue des investissements en Sibérie. Cependant, la Russie ne veut pas devenir le subordonné d’un puissant voisin dont elle est en train de devenir dépendante à un niveau inconnu auparavant. De plus, les deux pays sont également concurrents en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et dans la péninsule indienne : le projet chinois de la nouvelle "route de la soie" va directement à l’encontre des intérêts russes, tandis que la Russie resserre ses liens avec l’Inde, l’adversaire central de la Chine en Asie (avec le Japon). Enfin, le rapprochement de la Chine avec l’UE, et en particulier avec l’Allemagne, constitue une menace mortelle pour la Russie qui se trouverait prise en tenaille entre la Chine et l’Allemagne.
L’extension des zones de guerre, d’instabilité et de chaos
Face à l’explosion du "chacun pour soi", les tentatives pour "maintenir en place les différentes parties d’un corps qui tend à se disloquer" apparaissent de plus en plus vaines, tandis que l’instabilité des rapports impérialistes rend imprévisible l’extension des foyers de tensions.
La défaite de l'État islamique ne réduira pas l’instabilité et le chaos : les confrontations entre milices kurdes et armée turque en Syrie, entre unités kurdes et armée irakienne et milices chiites pro-iraniennes à Kirkouk en Irak, sont annonciatrices de nouvelles batailles sanglantes dans la région. Le positionnement de la Turquie, qui occupe une place clé dans la région, est à la fois capitale pour l’évolution des tensions et pleine de menaces pour la stabilité même du pays. La Turquie a des ambitions impérialistes importantes dans la région, non seulement en Syrie ou en Irak, mais aussi dans l’ensemble des pays musulmans, de la Bosnie au Qatar, du Turkménistan à l’Egypte, et elle joue pleinement sa propre carte impérialiste : d’une part, son statut de membre de l’OTAN est largement ‘instable’, vu ses rapports tendus avec les États-Unis et la majorité des pays d’Europe de l’Ouest, membres de l’OTAN, vu aussi les tensions avec l’UE concernant les réfugiés et les relations conflictuelles avec la Grèce ; d’autre part, elle tend actuellement à se rapprocher de la Russie et même de l’Iran, un concurrent impérialiste direct sur la scène du Moyen-Orient, tout en s’opposant à l’Arabie Saoudite (refus de retirer ses troupes déployées dans une base turque au Qatar). En même temps, la lutte pour le pouvoir à l’intérieur du pays s’exacerbe avec un positionnement de plus en plus dictatorial d’Erdogan et la reprise de la guérilla kurde. Sur ce plan, le refus des États-Unis d’extrader Gülen mais aussi le soutien, l’armement et l’entraînement des milices kurdes en Irak par les États-Unis sont lourds de menaces quant au développement du chaos à l’intérieur même de la Turquie.
L’imprévisibilité de l’évolution de certains foyers de tensions est particulièrement évidente concernant la Corée du Nord. Si la toile de fond du conflit est la confrontation de plus en plus manifeste entre la Chine et les États-Unis, un certain nombre de caractéristiques rendent l’issue de la situation particulièrement incertaine :
- l’idéologie d’État de forteresse assiégée en Corée du Nord, prônant comme priorité absolue l’armement atomique contre une attaque certaine des Américains et des Japonais et montrant aussi une grande méfiance envers les "amis" chinois ou russes (méfiance basée sur certaines expériences des partisans coréens lors de la Seconde Guerre mondiale), fait que le contrôle de la Chine sur la Corée du Nord est limité ;
- - le coup de poker de Trump, menaçant la Corée du Nord de destruction totale, pose la question de sa crédibilité. Cela mènera d’une part à un réarmement accéléré du Japon (déjà annoncé par le premier ministre japonais, Shinzô Abe) ; mais d’autre part, le déséquilibre dans l’armement atomique entre les États-Unis et la Corée du Nord (situation différente de "l’équilibre de la terreur" entre les États-Unis et l’URSS lors de la Guerre Froide) et la sophistication des armes atomiques de "petite portée" n’exclut pas la menace d’une utilisation unilatérale de celles-ci par les États-Unis, ce qui serait un pas qualitatif important de la descente dans la barbarie.
Bref, la zone de guerre, de décomposition d’États et de chaos sanglant tend à s’étendre toujours plus, allant de l’Ukraine au Soudan du Sud, du Nigéria au Moyen-Orient, du Yémen à l’Afghanistan, de la Syrie à la Birmanie et à la Thaïlande. Il faut relever, sur ce plan également, une extension de zones de chaos en Amérique latine : la déstabilisation politique et économique croissante du Venezuela, le chaos politique et économique au Brésil, la déstabilisation du Mexique si la politique protectionniste de Trump envers ce pays se confirme. À cela, il faut ajouter le développement en extension du terrorisme et sa présence dans la réalité quotidienne en Europe, aux États-Unis, etc. La zone de chaos qui s’étend sur la planète laisse de moins en moins de possibilités de reconstruction aux populations concernées, même partielle (alors que c’était encore envisageable en Bosnie ou au Kosovo), comme l’illustre l’échec de la politique de reconstruction et de rétablissement des structures étatiques en Afghanistan.
Le développement des tensions en Europe
Ce facteur, déjà potentiellement présent dans le rapport du 20e congrès (cf. point 4.2.), s’est spectaculairement accentué ces dernières années. Avec le Brexit, l’UE est entrée dans une zone de grande turbulence, tandis que, sous le couvert de la protection des citoyens et la lutte contre le terrorisme, les budgets de la police et de l’armée connaissent une hausse sensible en Europe de l’Ouest et, encore plus, en Europe de l'Est.
Sous la pression des mesures économiques, de la crise des réfugiés, des attaques terroristes et surtout des victoires électorales de mouvements populistes, les fractures au sein de l’Europe se multiplient et les oppositions s’exacerbent : pressions économiques de l’UE sur la Grèce et l’Italie, résultat du référendum sur le Brexit, pression du populisme sur la politique européenne (Pays-Bas, Allemagne) et victoires de celui-ci dans les pays de l’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et récemment la Tchéquie), tensions internes en Espagne avec la "crise catalane". Un démembrement progressif de l’UE à travers par exemple "une Europe à plusieurs vitesses", comme semble le prôner actuellement le duo franco-allemand, devrait provoquer une intensification marquée des tensions impérialistes en Europe.
Le rapport entre le populisme (contre les "élites" et leur conception cosmopolite, mondialiste, et pour le protectionnisme) et le nationalisme a été mis en évidence par le discours de Trump en septembre à l’ONU : "le nationalisme sert un intérêt international : si chaque pays songe en premier lieu à lui-même, les choses s’arrangeront d’elles-mêmes pour le monde". Cette glorification exacerbée du "chacun pour soi" ("America first" de Trump) pèse lourdement sur le conflit catalan. Sur l’arrière-fond de la crise de l’euro et de l’austérité drastique qui s’en est suivi, on assiste à une interaction dramatique du populisme et du nationalisme: d’un côté, une partie de la moyenne et petite bourgeoisie catalane qui "ne veut plus payer pour l’Espagne" ou encore les provocations de la coalition catalaniste de Puigdemont dominée par la gauche et confrontée à sa propre perte de crédibilité au pouvoir ; et du côté "espagnoliste" de l'État central, la fuite en avant dans la surenchère nationaliste du premier ministre espagnol Rajoy face à la crise du Partido Popular, empêtré dans de nombreuses affaires de corruption.
"Le militarisme et la guerre constituent une donnée fondamentale de la vie du capitalisme depuis l'entrée de ce système dans sa période de décadence. (…) En réalité, si l'impérialisme, le militarisme et la guerre s'identifient à ce point à la période de décadence, c'est que cette dernière correspond bien au fait que les rapports de production capitalistes sont devenus une entrave au développement des forces productives : le caractère parfaitement irrationnel, sur le plan économique global, des dépenses militaires et de la guerre ne fait que traduire l'aberration que constitue le maintien de ces rapports de production" (TO Militarisme et décomposition). Le degré de chaos impérialisme et de barbarie guerrière, allant bien au-delà de ce qu’on aurait pu imaginer il y a 25 ans, traduit bien l’obsolescence du système et la nécessité impérieuse de son renversement.
Sur l’arrière-fond de la crise de l’euro et de l’austérité drastique qui s’en est suivi, on assiste à une interaction dramatique du populisme et du nationalisme: d’un côté, une partie de la moyenne et petite bourgeoisie catalane qui "ne veut plus payer pour l’Espagne" ou encore les provocations de la coalition catalaniste de Puigdemont dominée par la gauche et confrontée à sa propre perte de crédibilité au pouvoir ; et du côté "espagnoliste" de l'État central, la fuite en avant dans la surenchère nationaliste du premier ministre espagnol Rajoy face à la crise du Partido Popular, empêtré dans de nombreuses affaires de corruption.
CCI (Novembre 2017)
[1] Ce rapport n'a pas été publié dans notre presse. Cependant le lecteur pourra se reporter à la partie Tensions impérialistes de la résolution sur la situation internationale [724] adoptée à ce congrès.
Rubrique:
La bourgeoisie mondiale contre la révolution d’Octobre (Première partie)
- 398 lectures
Comme nous pouvions nous y attendre, les porte-voix de la bourgeoisie ne sont pas restés insensibles au centenaire de la révolution d’Octobre 17. Comme à chaque décade, le mensonge et le mépris ont animé les articles de journaux, les documentaires et les prises de paroles télévisées qui se sont succédé pendant plusieurs semaines. Sans grande originalité, intellectuels et universitaires nous ont ressassé l’histoire d’un coup d’État réalisé par une poignée d’hommes au service d’un chef névrosé, avide de pouvoir et motivé par la vengeance personnelle.[1] Ainsi, la lutte pour une société sans classes sociales et sans exploitation de l’homme par l’homme n’aurait été que le cache sexe d’une entreprise volontairement totalitaire qui puiserait son origine dans la pensée de Marx elle-même[2].
Il serait inutile de chercher un semblant d’honnêteté auprès de ces chiens de garde de la démocratie et du mode de production capitaliste. Mais si cet événement semble être à classer dans les archives de l’histoire, pourquoi s’acharner à le déformer chaque dix ans avec autant de morgue ? Pourquoi la bourgeoisie s’emploie-t-elle autant à dénigrer l’un des épisodes les plus précieux de l’histoire de la lutte du prolétariat ? Contrairement au discours qu’elle peut diffuser dans ses médias, la bourgeoisie sait trop bien que la classe qui a failli renverser son monde il y a cent ans existe toujours. Elle sait aussi que son monde est encore plus mal en point qu’en 1917. Et sa survie dépend de sa capacité à utiliser intelligemment et sans faillir les armes à sa disposition afin d’éviter un nouvel octobre qui pourrait, cette fois-ci, voir aboutir le but historique de la classe ouvrière.
Très vite, la bourgeoisie a compris le danger que pouvait faire peser la révolution en Russie sur l’ordre social mondial. Ainsi, après s’être entretuées pendant quatre années, les principales puissances de l’époque firent cause commune afin d’endiguer la vague prolétarienne qui menaçait de submerger une société qui n’avait plus rien à offrir à l’humanité, sinon la guerre.
A contre-courant de l’histoire "officielle" selon laquelle la révolution d’Octobre 17 contenait en germe les marques de sa dégénérescence, cet article vise à mettre en évidence que l’isolement du prolétariat russe est avant tout à mettre au crédit de la coordination des gouvernements bourgeois afin d’assumer cette guerre de classes dont l’issue s’avéra déterminante pour le cours de l’histoire. Il s’agira également de montrer que de 1917 à aujourd’hui, les différentes fractions de la classe dominante ont usé de toutes les armes à leur disposition pour d'abord entraver et réprimer la Révolution, ensuite dévoyer et dénigrer sa mémoire et ses leçons.
La provocation des Journées de Juillet
En juin 1917, face à la poursuite de la guerre et du programme impérialiste du gouvernement provisoire, le prolétariat réagit vivement. Durant l’énorme manifestation du 18 juin à Petrograd, les mots d’ordre internationalistes des bolcheviks sont pour la première fois majoritaires. Dans le même temps, l’offensive militaire russe se termine dans un fiasco puisque l’armée allemande perce le front en plusieurs endroits. La nouvelle de l’échec de l’offensive arrive dans la capitale et attise le feu révolutionnaire. Pour faire face à cette situation très tendue, apparaît l’idée de provoquer une révolte prématurée à Petrograd, d’y écraser les ouvriers et les bolcheviks puis de faire endosser la responsabilité de l’échec de l’offensive militaire au prolétariat de la capitale qui aurait donné "un coup de poignard dans le dos" à ceux qui étaient au front. Pour cela, la bourgeoisie provoque plusieurs incidents afin de pousser les ouvriers à la révolte dans la capitale. La démission de quatre ministres du parti Cadet du gouvernement et la pression de l’Entente sur le gouvernement provisoire devaient pousser les mencheviks et les SR à se rallier au gouvernement bourgeois[3]. Ce qui n’allait faire que relancer les revendications pour le pouvoir immédiat aux soviets. De plus, la menace d’envoyer au front les régiments de la capitale accrut le mécontentement des soldats qui entreprirent de mener un soulèvement armé contre le gouvernement provisoire. La manifestation du 3 juillet aurait pu s’avérer catastrophique pour la suite de la révolution si le parti bolchevik n’avait pas réussi à calmer l’ardeur des masses en les empêchant de s’affronter prématurément aux troupes gouvernementales. Dans ces jours cruciaux, le parti a su rester fidèle au prolétariat en le détournant du piège tendu par la bourgeoisie. Mais ces provocations furent bien peu au regard de la répression et de la campagne de calomnies auxquelles furent confrontés les bolcheviks dans les jours suivants. Tout comme aujourd’hui, les bolcheviks furent affublés des pires accusations. Agents allemands payés par le Kaiser, tireurs isolés faisant feu sur les troupes entrant dans Petrograd. Tous les moyens étaient bons pour discréditer le parti aux yeux des ouvriers de la capitale. Ce n’est que par le déploiement d’une énorme énergie et grâce à un grand discernement politique que les bolcheviks purent défendre leur honneur. Si les Journées de Juillet ont révélé le rôle indispensable du parti, elles ont aussi permis de dévoiler la véritable nature des mencheviks et des SR. En effet, leur soutien au gouvernement bourgeois en ces journées cruciales[4] fut la cause de leur discrédit auprès des masses. Ainsi, comme l’écrit Lénine, "une nouvelle phase commence. La victoire de la contre-révolution déclenche la déception au sein des masses vis-à-vis des partis socialistes-révolutionnaire et menchevik, et ouvre la voie au ralliement de celles-ci à la politique qui soutient le prolétariat"[5].
La bourgeoisie tente d’empêcher la révolution prolétarienne
Dans un entretien accordé au journaliste et militant socialiste John Reed quelque temps avant la prise du palais d’hiver, Rodzianko, le "Rockfeller" russe déclarait que "la Révolution est une maladie. Tôt ou tard, les puissances étrangères devront intervenir, comme on interviendrait pour guérir un enfant malade et lui apprendre à marcher".[6]
Cette intervention ne tarda pas. Très vite, les diplomates des grandes puissances bourgeoises tentèrent de se mettre d’accord avec la bourgeoisie russe afin de régler cette question au plus vite. Pour le chef de l’Intelligence Service britannique en Russie, Sir Samuel Hoare, la meilleure solution restait l’instauration d’une dictature militaire. L’Union des officiers de l’armée et de la flotte proposait la même solution. Comme l’exprimait le ministre des Cultes Kartachev, membre du Parti cadet : "Celui qui ne craindra pas d’être cruel et brutal prendra le pouvoir dans ses mains." [7]
Déjà, la tentative de coup d’Etat de Kornilov[8] en août 1917 fut appuyée par Londres et Paris. Et l’échec de cette première tentative contre-révolutionnaire fut loin de décourager la bourgeoisie mondiale. Désormais, pour les Alliés, il s’agissait d’arrêter l’influence grandissante des bolcheviks dans les rangs du prolétariat de Russie. Le 3 novembre, une conférence secrète des militaires alliés en Russie se tint dans le bureau du chef de la Croix-Rouge, le colonel Thompson. Face au "péril bolchevik", le général américain Knox propose tout simplement de s’emparer des bolcheviks et de les fusiller.[9] Mais le 7 novembre, le comité militaire révolutionnaire s’empare du Palais d’Hiver et le pouvoir est remis au soviet de Petrograd. Désormais, pour la bourgeoisie mondiale, l’intervention militaire reste la seule option. D’autant plus que l’écho de la révolution se fait entendre dans toute l’Europe.
D’emblée, le IIe Congrès des Soviets adopta le décret sur la paix qui proposait à tous les belligérants une paix immédiate et sans annexion. Mais cet appel ne trouva aucune réponse auprès des puissances alliées qui souhaitaient faire durer le conflit dans l’attente d’une aide américaine. Pour les Empires Centraux, la libération du front de l’Est leur permettait de se réorganiser avant l’entrée en guerre des Etats-Unis. Une trêve de trois semaines est ainsi signée à Brest-Litovsk, le 22 novembre, avec l’état- major autrichien et allemand. Des négociations s’ouvrent le 9 décembre entre les deux parties. Mais ce même jour, la bataille de Rostov-sur-le-Don opposant les gardes rouges aux armées blanches sonne l’ouverture de la guerre civile.[10] Après la prise de pouvoir, l’épreuve la plus dure se dressait désormais devant le prolétariat de Russie. Dans l’attente d’une extension de la révolution dans le reste de l’Europe, il fallait se préparer à affronter les forces contre-révolutionnaires de l’intérieur bien appuyées par les grandes puissances.
Le début de la guerre civile et de l’encerclement
La contre-révolution s’organisa véritablement dans les jours qui suivirent les élections à l’Assemblée constituante marquées par une majorité hostile au gouvernement des Soviets. À la fin du mois de novembre, les généraux Alexeiev, Kornilov et Dénikine et le cosaque Kalédine constituèrent l’armée des Volontaires dans le sud de la Russie. Au début, celle-ci était composée d’environ 300 officiers. Cette armée fut la première expression de la réaction militaire de la bourgeoisie russe. Pour son financement, "la ploutocratie de Rostov-sur-le-Don leva six millions et demie de roubles, celle de Novotcherkassk environ deux millions". Constituée d’officiers favorables à une restauration de la monarchie, elle détenait "en germe un caractère de classe", ajoute le général russe Dénikine.[11]
Le gouvernement des Soviets ne pouvait laisser se structurer l’armée contre-révolutionnaire sans réagir. Il était nécessaire que la révolution se renforce sur le plan militaire. Le 28 janvier 1918, le Conseil des Commissaires du peuple adopta un décret prévoyant de transformer la garde rouge [12] en une Armée Rouge ouvrière et paysanne constituée "des éléments les plus conscients et les mieux organisés des classes laborieuses". Mais l’organisation de cette armée demeura une tâche difficile. En effet, faute de pouvoir trouver un encadrement communiste compétent, Trotski recruta dans le corps des officiers de l’armée tsariste. En ce début de 1918, le rapport de force n’est guère en faveur de la Russie des soviets. L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie profitent du délitement de l’armée puis de sa démobilisation le 30 janvier pour mettre fin à l’armistice signée quelques semaines auparavant. Dans un radiogramme paru le 19 février dans la Pravda, le Conseil des commissaires du peuple proteste "à propos de l’offensive lancée par le gouvernement allemand contre la République Soviétique de Russie qui avait proclamé la fin de l’état de guerre et commencé à démobiliser l’armée sur tous les fronts. Le gouvernent ouvrier et paysan de la Russie pouvait d’autant moins s’attendre à une semblable attitude que l’armistice n’a été dénoncé par aucune des parties contractantes ni directement ni indirectement, ni le 10 février, ni à aucun autre moment comme les deux parties y étaient cependant tenues par l’accord du 2 décembre 1917." [13]
En fait, l’Allemagne prétexta l’indépendance de l’Ukraine pour passer à l’offensive avec l’assentiment de la Rada, le gouvernement ukrainien bourgeois. Il s’en suivit une débandade de la garde rouge, racontée notamment par le bolchevik Primakov :
- "La retraite de la garde rouge ressembla à un grand exode. Près de cent mille gardes rouges, accompagnés de leurs familles, abandonnèrent l’Ukraine. Plusieurs dizaines de milliers d’autres se dispersèrent dans les villages, les hameaux, les forêts et les ravins de l’Ukraine. (...) Le lourd fardeau de la guerre, les violences des troupes d’occupation, la morgue des lieutenants allemands, l’impudence des haïdamak, la vengeance sanglante des grands propriétaires, la trahison de la Rada centrale, le pillage ouvert du pays ne firent qu’enflammer la haine populaire. On ne nommait plus le gouvernement de la Rada centrale que le gouvernement de la Trahison."[14]
C’est dans ce contexte très difficile qu’ont lieu les premières levées en masse de l’Armée Rouge alors que la question de la paix est de plus en plus pressante pour la survie de la révolution.
La paix de Brest-Litovsk et l’offensive militaire de la bourgeoisie
Si dans un premier temps, la République des Soviets, afin de gagner du temps, adopte la stratégie de "ni guerre, ni paix", le retard pris par la révolution européenne rend la signature de la paix inévitable, malgré les conditions honteuses imposées par les Empires Centraux qui amputaient la Russie d’une grande partie de son territoire. Nous savons que la question de la paix occasionna d’âpres débats au sein du parti bolchevik et des SR de gauche. Ce n’est pas le lieu de s’y attarder ici. Mais avec le recul, la position défendue par Lénine, acceptée lors du VIIe Congrès du Parti s’avéra la mieux adaptée à la situation.[15]
Dans les semaines et les mois qui suivent, la République des Soviets est encerclée de toutes parts. Des armées blanches se structurent dans plusieurs parties du pays. Partie de Samara, la légion tchécoslovaque mise sur pied par les puissances de l’Entente[16] sème la terreur tout le long de la ligne du Transsibérien dans les agglomérations importantes, ce qui facilite les soulèvements. Par la suite, les Anglo-américains débarquent à Mourmansk, les Blancs occupent le Sud de la Russie occidentale, les Allemands et les Autrichiens entrent dans la région du Don, des troupes japonaises débarquent à Vladivostok...
En ce début d’été 1918, la situation de la République des Soviets est devenue très préoccupante. Le 29 juillet, Lénine écrit : "Mourmansk, au Nord, le front tchécoslovaque à l’Est, le Turkestan, Bakou et Astrakhan au Sud-Est, nous voyons que presque tous les maillons de la chaîne forgée par l’impérialisme anglo-français se tiennent."
Nous voyons bien que l’engagement des puissances de l’Entente a été déterminant pour l’organisation de la contre-révolution. Un détail que nos bons démocrates préfèrent éluder. Au début de l’année 1919, environ 25 000 soldats britanniques, français, italiens, américains et serbes sont mobilisés entre Arkhangelsk et Mourmansk[17] dans un combat à mort contre "le péril bolchevik" qui continuerait à s’étendre "s’il n’était pas arrêté", comme l’indiquait Clémenceau.
Le témoignage d’un membre du corps expéditionnaire, Ralph Albertson, offre une image éloquente de la détermination et de la barbarie exercée par cette coalition anti-communiste : "Nous employions des obus à gaz contre les bolcheviks... Nous dressions toutes les embûches possibles quand nous évacuions les villages. Une fois, nous avons fusillé plus de trente prisonniers... Et quand nous avons pris le commissaire de Borok, un sergent m’a dit qu’il avait laissé son corps dans la rue, blessé par plus de seize coups de baïonnette. Nous avions pris Borok par surprise et le commissaire, un civil, n’avait pas eu le temps de prendre les armes... J’ai entendu un officier répéter à ses hommes qu’ils ne devaient pas faire de prisonniers, qu’ils devaient les tuer, même s’ils étaient désarmés... J’ai vu un prisonnier bolchevik désarmé, qui ne causait aucun ennui, abattu de sang-froid... Chaque nuit, un détachement d’incendiaires faisait des masses de victimes."[18]
La paix de Brest-Litovsk n’a fait qu’attiser la haine des différentes fractions contre-révolutionnaires mais aussi des S-R de gauche à l’égard des bolcheviks. La Russie des Soviets ressemble désormais à une forteresse assiégée où la faim "est aux portes de beaucoup de villes, villages, usines et fabriques", comme le relate Trotsky. L’alliance des Blancs et des puissances occidentales plongea la révolution dans une situation de survie permanente. D’ailleurs, dès le 15 mars 1918, les différents gouvernements de l’Entente, décident de ne pas accepter la paix de Brest-Litovsk et organisent l’intervention armée. Si, effectivement, les puissances de l’Entente interviennent directement en Russie, elles s’appuient sur la trahison du parti Socialiste-Révolutionnaire pour mener à bien la contre-révolution. Au mois de juin 1918, l’ancien assistant de Kerensky, le S-R Boris Savinkov, prévoit d’assassiner Lénine et Trotsky et de mener une insurrection à Rybinsk et Iaroslav, afin de permettre un débarquement des Alliés. Autrement dit, au vu de l’extrême faiblesse de l'armée rouge, il s’agissait de mener une grande offensive pour en finir une bonne fois pour toute avec la Révolution.
Comme le relate Savinkov, les Blancs espéraient "encercler la capitale avec les villes soulevées et, en utilisant le soutien des Alliés au nord et des Tchécoslovaques, qui venaient juste de s’emparer de Samara, sur la Volga, mettre les bolcheviks dans une situation difficile". Nous savons désormais, grâce à des mémoires publiés par plusieurs agents secrets étrangers, aux enquêtes parues dans la Pravda quelques années plus tard ainsi qu’aux sources diplomatiques, que l’Angleterre et la France furent à l’origine de ce complot. Les projets d’insurrections dans les villes autour de Moscou, les débarquements étrangers, l’offensive tchécoslovaque faisaient partie d’un seul et même plan orchestré par les militaires et les diplomates étrangers et exécuté par les dirigeants S-R farouchement opposés à la paix avec l’Allemagne et à l’extension de la révolution.[19]
Les légionnaires tchécoslovaques, pilotés par les Alliés, s’emparent de Samara le 8 juin puis assiègent Omsk. Un mois plus tard, ils s’emparent de Zlatooust dans l’Oural puis, quelques jours plus tard, ils approchèrent d’Ekaterinbourg où était internée la famille impériale. La libération de la famille impériale aurait pu permettre d’unifier des forces contre-révolutionnaires qui avaient bien du mal à régler leurs propres clivages et divergences. Les bolcheviks souhaitaient ne pas courir ce risque et décidèrent d’exécuter toute la famille. Cette décision, était motivée par la nécessité d’intimider l’ennemi et de lui montrer, comme l’écrit Trotsky des années plus tard, "qu’il n’y avait pas de retraite possible, que l’issue était la victoire totale ou la perte totale". Cela se retourna malgré tout contre les bolcheviks. En effet, l’exécution des enfants du tsar fut utilisée par la bourgeoisie internationale lors de ses campagnes de propagande afin de présenter les bolcheviks comme des barbares assoiffés de sang.
En juillet et août, l’offensive se poursuit, les Français et les Britanniques débarquent au nord, à Mourmansk. Ils installent un gouvernement "autonome". Les Turcs et les Anglais occupent l’Azerbaïdjan. Les Allemands entrent en Géorgie avec l’assentiment des mencheviks tandis que les légionnaires tchèques poursuivent leurs avancées vers l’ouest. Ces semaines s’avèrent déterminante pour la défense de la Révolution où sa survie s’est jouée à un fil. À Sviajsk, près de Kazan, après plusieurs jours de combats, l’état-major de la 5e armée, extrêmement affaibli, aurait pu être capturé avec ses principaux chefs militaires à commencer par Trotsky. Le manque de renseignements et les erreurs stratégiques des généraux blancs permit à Trotsky et ses hommes de s’en sortir. Vu l’extrême faiblesse du pouvoir des Soviets, l’arrestation de ses principaux chefs auraient porté un coup fatal au moral et à la détermination des troupes.
Au nord, les Britanniques prennent le commandement de toutes les armées de la région. Outre quatre ou cinq bataillons d’Anglais, les troupes se composaient de quatre ou cinq bataillons d’Américains, d’un bataillon de Français, de Polonais, d’Italiens et de formations mixtes.[20] Une armée russe est aussi organisée, mais reste sous le commandement et la supervision des Britanniques. Début août, cette armée du Nord, s’empare d’Arkhangelsk, renverse le soviet et met sur pied un gouvernement provisoire, composé de cadets et de S-R, contrôlé par le général britannique Pool.
Dans le même temps, la Commune de Bakou tombe à la mi-août face à l’offensive de l’armée turque, des moussavatistes (nationalistes azerbaïdjanais) et des régiments britanniques. Les vingt-six commissaires du peuple sont fusillés le 20 septembre 1918 par les Anglais.[21]
Les différentes fractions de la bourgeoisie russe profitent de ce contexte difficile pour déstabiliser le pouvoir des Soviets en fomentant des complots qui auraient pu s’avérer désastreux pour la révolution.
Le temps des complots.
Dès les mois de mai et juin 1918, s’était formé un bloc contre-révolutionnaire, allant des monarchistes à certains mencheviks et S-R. Tous ces partis s’étaient ralliés au "Centre national" créé à l’origine par les Cadets. Les principaux leaders du mouvement s’employaient à recueillir des informations politiques et militaires qu’ils transmettaient aux différentes armées blanches et entretenaient d’étroites relations avec les agents secrets anglais, français et américains. D’ailleurs, une conférence spéciale se réunit, en octobre 1918, composée des représentants des pays de l’Entente et du Centre national. La Tcheka réagit rapidement et se rendit compte de l’existence d’un centre unique de la contre-révolution.
Mais cela n’empêcha pas la mise en œuvre d’entreprises visant à déstabiliser la République des Soviets. Le 30 août, le chef de la Tcheka, Ouritsky, est assassiné par un S-R. Quelques heures plus tard, une tentative d’assassinat est perpétrée contre Lénine à la sortie de l’usine Michaelson. Mais ces deux événements ne sont qu’une petite partie d’une entreprise plus vaste qui visait à supprimer l’ensemble des principaux bolcheviks : "Le 15 août, Bruce Lockhart [un agent secret britannique] reçoit la visite d’un officier qui se présente comme étant le colonel Berzine, commandant de la garde lettone du Kremlin. Celui-ci lui tend une lettre de recommandation écrite par Cromey, attaché naval britannique à Petrograd. Berzine déclare que, bien qu’ayant soutenu les bolcheviks, les Lettons ne veulent pas combattre les Anglais qui ont débarqué à Arkhangelsk. Après en avoir discuté avec le Conseiller général en France, Groener, Lockhart met Berzine en relation avec Railey. Dans les derniers jours d’août, Groener préside une réunion secrète de certains représentants alliés. Elle se tient au consulat général des Etats-Unis. Railey et un autre agent de l’I.S, George Hill, ainsi que le correspondant du Figaro à Moscou, René Marchand, sont présents. Railey raconte dans ses mémoires qu’il fit savoir qu’il avait acheté Berzine pour deux millions de roubles. Il s’agissait de s’emparer d’un seul coup des dirigeants bolcheviks qui devaient prochainement assister à une session de leur Comité central. Les Anglais étaient en relations avec le général Ioudénitch et s’apprêtaient à lui fournir des armes et du matériel. (...) A la suite de l’assassinat d’Ouritski, la Tcheka, qui était sur les traces des comploteurs, avait pénétré à l’ex-ambassade britannique de Petrograd. Cromey avait tiré sur les policiers, tuant un commissaire et plusieurs agents. Il avait lui-même été abattu. L’attaché naval, lui aussi, était en train de brûler des papiers compromettants. Mais il en restait encore suffisamment pour éclairer la lanterne des enquêteurs. Railey, recherché activement, parvint cependant à s’enfuir. Au bout de plusieurs mois, il regagna Londres où il accusa René Marchand de l’avoir trahi... Quant à Berzine, la presse soviétique révéla par la suite qu’il avait indiqué à ses chefs que Bruce Lockhart et Railey lui avaient offert deux millions de roubles pour participer à l’assassinat des dirigeants soviétiques."[22]
L’arrestation de Bruce Lockhart conclut une enquête qui avait pleinement démontré la participation étrangère aux manigances des Blancs.[23]
Ce complot manqué fut malgré tout l’un des points culminants du danger contre-révolutionnaire. À ce stade, la chute de la République des Soviets semblait imminente. Devant une telle situation, la Terreur rouge fut décrétée le 6 septembre. Mais si cette mesure a été une erreur majeure[24], nous devons admettre qu’elle fut imposée par la force des choses, c’est à dire aux pratiques terroristes des puissances étrangères et des armées blanches.
"Sans l’aide des Alliés, il est impossible de libérer la Russie"
Officiellement, les gouvernements bourgeois sont intervenus en Russie en défense de la démocratie et du "péril bolchevik". En réalité, l’instauration de la démocratie était le dernier souci des puissances de l’Entente, avant tout déterminées à éviter l’extension de la vague révolutionnaire qui gagnait l’Allemagne à la fin de l’année 1918. Les bourgeoisies française, britannique et états-uniennes étaient prêtes à tout pour défendre leurs intérêts. Ainsi, dès le début de la guerre civile, les armées étrangères se comportèrent en véritables hordes sanguinaires, cherchant à instaurer ou soutenir des dictatures militaires dans la plupart des territoires repris à l’Armée Rouge. C’est par exemple ce qui se passe au début du mois de janvier 1919, quand le général Miller débarque à Arkhangelsk et se fait proclamer gouverneur général de la ville et ministre de la Guerre. Dirigeant une armée de 20 000 hommes, s’appuyant sur des paysans et pêcheurs monarchistes haineux à l’égard des communistes, il fit régner la terreur sur la région. L’ancien procureur de la province, Dobrovolsky raconte que "les partisans de Pinet étaient si féroces que le commandant du 8e régiment, le colonel B., décida d’éditer une brochure sur l’attitude humaine à avoir avec les prisonniers."[25]
Par ailleurs, les Alliés ne vont pas hésiter à soutenir directement les armées des principaux chefs Blancs partisans d’un pouvoir très autoritaire comme Dénikine et Koltchak. L’offensive que ce dernier mena de la Sibérie aux abords de Moscou à la fin de 1918 fut en grande partie réalisée avec un arsenal militaire offert par les principales puissances étrangères :
- "Les États-Unis livrent 600 000 carabines, plusieurs centaines de canons, plusieurs milliers de mitrailleuses, des munitions, des équipements, des uniformes, la Grande-Bretagne 200 000 équipements, 2000 mitrailleuses, 500 millions de cartouches. La France 30 avions et plus de 200 automobiles. Le Japon 70 000 carabines, 30 canons, 100 mitrailleuses, les munitions nécessaires et 120 000 équipements. Pour payer ces livraisons qui lui permettent d’équiper et d’armer plus de 400 000 hommes, Koltchak envoie à Hong-Kong 184 tonnes d’or du trésor, qui le lui ont remis."[26]
C’est à cette division militaire du travail entre les Alliés et les armées blanches que le prolétariat de Russie dut faire face durant toute l’année 1919. Lénine avait bien conscience de l’extrême fragilité du pouvoir des Soviets et c’est la raison pour laquelle il s’attacha à dénoncer la responsabilité des généraux tsaristes dans leurs combines avec les armées étrangères :
- "Koltchak et Dénikine sont les principaux et les seuls ennemis sérieux de la république des Soviets. S’ils n’avaient pas été aidés par l’Entente, ils se seraient effondrés depuis longtemps. Seule l’aide de l’Entente en fait une force. Cependant, ils sont obligés de tromper le peuple, de se faire passer de temps à autre pour des partisans de la "démocratie", de l’ "Assemblée constituante", de la "souveraineté du peuple", etc. Les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires s’y laissent volontiers prendre. Aujourd’hui, la lumière est faite quant à Koltchak. Des dizaines de milliers d’ouvriers fusillés. Même des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires. Les paysans de districts entiers, fouettés. Des femmes fouettées en public. Arbitraire absolu des officiers, des fils de hobereaux. Pillages sans fin. Telle est la vérité sur Koltchak et Dénikine."[27]
Cette grande alliance contre-révolutionnaire se fit encore plus vitale lorsqu’éclata la révolution allemande en décembre 1918. Comme le relatent les historiens américains M. Sayers et A. Khan dans La grande conspiration contre la Russie, "La raison du renoncement des Alliés à marcher sur Berlin, écrivent-ils, et à désarmer définitivement le militarisme allemand, réside dans la peur du bolchevisme chez les Alliés... Le commandant en chef allié, le maréchal Foch, a révélé dans ses Mémoires que, dès l’ouverture des négociations de paix, les porte-parole allemands évoquaient constamment "‘la menaçante invasion bolchevique de l’Allemagne'"...Wilson, de l’état-major général britannique, a raconté dans son ‘War Diary’ (journal de guerre) que, le 9 novembre 1918, deux jours avant la signature de l’armistice, ‘le cabinet s’est réuni cette nuit, de 6h30 à 8h, Lloyd George a lu deux télégrammes du Tigre (Clemenceau) dans lesquels il relatait l’entrevue de Foch avec les Allemands ; le Tigre redoute la chute de l’Allemagne et la victoire du bolchévisme dans ce pays : ‘Lloyd George m’a demandé si je souhaitais que cela arrivât ou si je ne préférais par un armistice. Sans hésitation, j’ai répondu : ‘Armistice. ‘ Tout le cabinet a été d’accord avec moi. Pour nous, le véritable danger n’est plus désormais les Allemands, mais le bolchévisme’."
La crainte d’une extension de la révolution dans l’ensemble de l’Europe aiguisait la détermination des puissances bourgeoises à mater définitivement le pouvoir des Soviets. Lors de la conférence de la paix, Clémenceau, se fit le plus farouche défenseur de cette politique : "Le danger bolchevique est très grand à l’heure présente ; le bolchévisme s’étend. Il a gagné les provinces baltes et la Pologne ; et, ce matin, nous avons reçu de très mauvaises nouvelles, car il s’étend à Budapest et à Vienne. L’Italie aussi est en danger. Le danger est probablement plus grand là qu’en France. Si le bolchévisme, après s’être étendu à l’Allemagne, devait traverser l’Autriche et la Hongrie et gagner l’Italie, l’Europe aurait à faire face à un très grand danger. C’est pourquoi il faut faire quelque chose contre le bolchévisme." Affirmant haut et fort, lors de cette conférence, le "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", la bourgeoisie ne laisserait pas le prolétariat mondial disposer de lui-même au risque de mettre en péril la société bourgeoise. Pour l’un ou l’autre camp, la clé de la victoire résidait dans l’extension ou l’isolement de la révolution. Aussi, la crainte de la bourgeoisie se mesure au degré de violence et d’atrocité auquel elle se livra en Russie, en Allemagne, en Hongrie et en Italie. Car derrière le voile des "droits de l’homme" se cache l’intérêt d’une classe dominante toujours décidée à user des pires procédés lorsqu’il s’agit de sa survie.
L’asphyxie économique
Les paroles fracassantes de Clémenceau (rapportées ci-dessus) permettent de comprendre son insistance pour décréter un blocus total de la Russie et mettre tout en œuvre pour que les États voisins restent hostiles à la République des Soviets.[28]
D’où aussi, la détermination avec laquelle fut combattue la vague révolutionnaire. Le retard du prolétariat européen et mondial à faire la révolution plongeait le prolétariat de Russie dans un isolement complet. La République des Soviets était désormais une "forteresse assiégée" tentant de résister à d’immenses difficultés. En 1919-1920, les effets des rationnements et de l’assujettissement de la production, appliqués au cours de la guerre mondiale, se faisaient encore sentir dans le pays. A cela, s’ajoutaient la dévastation de la guerre civile et le blocus économique imposés par les puissances démocratiques entre mars 1918 et le début de l’année 1920. Toutes les importations étaient bloquées, y compris les colis de solidarité envoyés par les prolétaires des autres pays. Les armées blanches et celles de l’Entente avaient mis la main sur le charbon d’Ukraine et le pétrole de Bakou et du Caucase ce qui engendra une pénurie de combustible. La totalité des combustibles qui parvenait dans les villes restait inférieur à 10% de ce qui était consommé avant la Première Guerre mondiale. La faim dans les villes était terrible, tout manquait. Les ouvriers de l’industrie lourde recevaient les rations de première catégorie qui ne dépassaient pas les 1900 calories.
Evidemment, cette situation avait également des répercutions sur l’état des soldats de l’Armée Rouge en proie à la faim, au froid et aux maladies. En octobre 1919, les troupes blanches de Ioudenitch menacent Petrograd. La brigade du commandant Kotovsky venue d’Ukraine est appelée en renfort. Le 4 novembre, Kotovsky adresse un rapport édifiant : "Une épidémie généralisée de typhus, la gale, l’eczéma, des maladies dues au froid à la suite du manque de linge et d’uniformes et de bains. Tout cela a mis sur les genoux de 75 à 85 % de notre effectif de vieux combattants qui sont, en chemin, restés dans les infirmeries et les hôpitaux." Face aux protestations de certains régiments, la brigade sera mise au repos. Cette situation s’avéra bien pire : "nous avons été confrontés à d’autres difficultés, écrit un soldat. L’épidémie de typhus s’est déchainée, et des maladies dues au refroidissement ont ravagé la brigade. Les soldats et les commandants vivaient dans des baraquements non chauffés et recevaient des rations de famine : 200 grammes de ‘soukhari’ (une sorte de pain grillé) et 300 grammes de chou. Ca faisait mal au cœur de voir nos chevaux mourir par manque de fourrage."[29] Trotsky dépeint en des termes très sombres l’apparence de ces mêmes troupes sensées défendre le principal bastion du prolétariat russe : "Les ouvriers de Petrograd n'avaient pas alors bonne mine : le teint terreux parce qu'ils ne mangeaient pas à leur faim, des vêtements en loques, des bottes trouées, souvent dépareillées."
Après 1921, la pénurie se poursuit et les rationnements étaient toujours aussi drastiques, "la ration de pain noir n'est encore que de 800 grammes pour les travailleurs des entreprises à feu continu et de 600 grammes pour les travailleurs de choc. La ration baisse jusqu'à 200 grammes pour les porteurs de la "carte B" (les chômeurs). Le hareng, qui, en d'autres circonstances, avait déjà permis de sauver la situation, manquait complètement. Les patates parvenaient gelées aux villes, à cause de l'état lamentable des chemins de fer (à peu près 20 % de leur potentiel d'avant-guerre). Au début du printemps 1921, une famine atroce ravagea les provinces orientales et la région de la Volga. On comptait alors, d'après les statistiques reconnues par le congrès des Soviets, entre 2 et 2,7 millions de nécessiteux, qui souffraient de la faim, du froid, des épidémies de typhus ([20]), de diphtérie, grippe, etc."[30]
Dans les usines, la surexploitation des ouvriers n’empêcha pas la baisse de la production. La sous-alimentation et le chaos économique poussaient une partie d’entre eux à migrer vers la campagne, d’autres fuyaient les grandes entreprises pour aller dans de petits ateliers rendant le troc plus facile. Dans ces conditions, il fut décidé de mettre en œuvre la Nouvelle Politique Economique (NEP), qui mit un frein à l'étatisation de la production.
La guerre civile laisse derrière elle un pays totalement exsangue. Près de 980 000 morts dans les rangs de l’Armée Rouge, aux alentours de 3 millions au sein des populations civiles. La famine, déjà présente, s’amplifie lors de l’été 1921 avec la terrible sécheresse qui se répand dans tout le bassin de la Volga.
Même si, face au développement des mutineries et du "danger" révolutionnaire sur leur propre territoire, les puissances étrangères ont dû retirer leurs troupes au cours de l’année 1920 et si les armées contre-révolutionnaires n’ont jamais été véritablement en mesure de reprendre le pouvoir, tellement gangrénées par les querelles internes, le manque de discipline et l’absence de coordination, la bourgeoisie mondiale est néanmoins parvenue à stopper la vague révolutionnaire qui avait éclos après quatre années de guerre impérialiste. L’isolement total de la Russie des Soviets signera l’arrêt de mort de la révolution et la plongée dans sa dégénérescence[31].
Comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article, c’est dans ce contexte que la social-démocratie puis le stalinisme portèrent le coup de grâce à la Révolution d’Octobre et à son héritage.
(À suivre)
Narek, le 8 avril 2018.
[1] C’est plus ou moins en ces termes que Stéphane Courtois nous décrit la personnalité et les aspirations de Lénine lors une émission de radio.
[2] Un propos exprimé par Thierry Wolton sur le plateau de l’émission 28 minutes sur la chaîne Arte le 17 octobre 2017.
[3] L’article de Lénine, "A quoi pouvaient s’attendre les Cadets en se retirant du ministère", écrit dès le 3 juillet, montre la clarté des bolcheviks sur cet épisode.
[4] Tout particulièrement dans la répression de la manifestation du 3 juillet.
[5] Lénine, "Sur les illusions constitutionnelles".
[6] Cité dans Pierre Durant, Les sans-culottes du bout du monde. 1917-1921, Editions du Progrès, 1977.
[7] Jean-Jacques Marie, La guerre civile russe. 1917-1922. Armées paysannes rouges, blanches et vertes, Editions autrement, 2005.
[8] Pour des informations complémentaires sur le coup d'État de Kornilov, se reporter à la Brochure du CCI, Octobre 17, début de la révolution mondiale. Le développement du mouvement de février à octobre 1917 [725]
[9] Pierre Durant, Op. cit.
[10] Jean-Jacques Marie, Op. cit.
[11] Cité dans Jean-Jacques Marie, Op. cit.
[12] Si nous pensons qu'en de telles circonstances la constitution d'une armée rouge était effectivement nécessaire, nous considérons cependant que la dissolution de la garde rouge, organe spécifique de l'armement du prolétariat, était une erreur revenant à désarmer la classe révolutionnaire.
[13] "Projet de radiogramme au gouvernement du Reich allemand" rédigé par Trotsky in Lénine, Œuvres choisies, Editions du Progrès, Moscou, 1968.
[14] Cité dans Jean-Jacques Marie, Op. cit.
[15] Pour plus de détails sur cette question, voir "Brest-Litovsk : gagner du temps pour la Révolution mondiale [726]", Révolution Internationale n°48.
[16] Voir Jean-Jacques Marie, La Guerre des Russes Blancs, 1917-1920, Tallandier, 2017.
[17] Pierre Durant, Op. cit. p. 191.
[18] Cité dans Pierre Durant, Op. cit. p. 190.
[19] Pierre Durant, Op. cit. p. 89.
[20] Jean-Jacques Marie, Op. cit, p. 79.
[21] Ibid, p. 81.
[22] Ibid, pages 116-117.
[23] Pierre Durand, Op. cit.
[24] Tout comme Rosa Luxemburg, le CCI rejette la notion de Terreur rouge : "Même s’il était nécessaire de répondre fermement aux complots contre-révolutionnaires de l’ancienne classe dominante et de créer un organe spécial visant à les réprimer, la Tcheka, cet organe a rapidement échappé au contrôle des Soviets et a eu tendance à être infecté par la corruption morale et matérielle de l’ancien ordre social". Manifeste sur la Révolution d’Octobre 1917 en Russie [727].
[25] Cité dans Jean-Jacques Marie, La guerre civile russe, Op. cit. p. 94.
[26] Cité dans Jean-Jacques Marie, Op. cit. p. 99.
[27] "Tous contre Dénikine". Lettre du comité central du parti communiste de Russie aux organisations du parti;
[28] Jean Jacques Marie, La guerre des Russes blancs, Op. cit., p. 436.
[29] Cité dans Jean Jacques Marie, La Guerre civile, Op. cit. p. 164.
[30] Brochure du CCI, Octobre 17, début de la révolution mondiale. L'isolement c'est la mort de la révolution [728]
[31] Voir à ce sujet : "La dégénérescence de la révolution russe", Revue Internationale, n°3.
Personnages:
- Lénine [729]
- Trotsky [730]
- Kornilov [731]
- Dénikine [732]
- Kerensky [733]
- Boris Savinkov [734]
- Clémenceau [735]
- Lloyd George [736]
Rubrique:
Réponse tardive à une anarchiste révolutionnaire Emma Goldman et la Révolution russe
- 593 lectures
Nous publions ici une réponse à l'analyse qu'Emma Goldman (1869-1940) a rédigée dans les premières années qui ont suivi la Révolution d'Octobre 1917. Après son expulsion des États-Unis en janvier 1920, elle a passé deux ans en Russie, puis a publié trois livres[1] : "Je pensais et je pense encore aujourd'hui que le problème russe est beaucoup trop compliqué pour être expédié en quelques formules superficielles" écrivait-elle dans l'introduction de son premier livre. Nous répondons à Emma Goldman parce qu'elle était une figure centrale du mouvement ouvrier révolutionnaire aux États-Unis à l’époque de la Première Guerre mondiale. En raison de sa détermination à défendre une position clairement internationaliste contre la guerre, elle a été surnommée "Emma la Rouge - la femme la plus dangereuse d'Amérique" par la classe dominante américaine. Mais il y a deux autres raisons d'examiner plus en détail les positions de Goldman. D'une part, son influence importante dans le milieu anarchiste et anarchosyndicaliste jusqu'à nos jours - la ""Rosa Luxemburg des anarchistes" - et d'autre part parce que son analyse précoce du devenir de la Révolution russe et des problèmes rencontrés par celle-ci témoigne d'une grande honnêteté et responsabilité. Aujourd'hui encore, les efforts de Goldman constituent une contribution précieuse à la compréhension de la dégénérescence de la Révolution russe, même si nous ne partageons pas du tout certaines de ses positions.
Goldman, anarchiste d'origine russe, a été inspirée par les théories de l'influente autorité anarchiste Pierre Kropotkine, mais a défendu une position anarcho-syndicaliste dans ses activités. Elle a clairement rejeté le marxisme comme orientation politique et théorique. Ce qui a distingué Goldman de Kropotkine, c'est sa détermination, aux côtés de Malatesta, Berkman et d'autres, en février 1915, à prendre fermement position contre le 'Manifeste des Seize', par lequel Kropotkine et d'autres anarchistes se sont abaissés à l'affligeante approbation de la Première Guerre mondiale. Goldman défendit une position clairement internationaliste condamnant toute participation, soutien ou tolérance à la guerre pour former ainsi un point de référence internationaliste aux États-Unis.
Notre préoccupation dans cet article sera d'examiner le postulat politique de départ de Goldman vis-à-vis de la Révolution russe, ses expériences et ses conclusions. Pour anticiper : les observations de Goldman, étayées par un profond instinct prolétarien, ses avancées marquantes, doivent de notre point de vue être distinguées de certaines de ses conclusions politiques centrales. Afin de permettre un aperçu suffisant de la position de Goldman, il est nécessaire d'insérer de longues citations. Comme il n'est pas possible d'aborder tous les aspects de son analyse, nous sommes contraints d'opérer une sélection et de préconiser la lecture directe de ses écrits sur la Révolution russe et son autobiographie.
Goldman était constamment préoccupée par deux questions : la fusion des bolcheviks avec l'appareil d'État et ses conséquences, et son propre et douloureux déchirement concernant le moment qui lui permettrait ou même l'obligerait à exposer ses critiques envers les bolcheviks - ce qu'elle finit par effectuer après des mois de douloureuses hésitations. Nous ne pouvons pas aborder ici d'autres préoccupations politiques de Goldman, comme la "terreur rouge", la Tcheka, Brest-Litovsk, le mouvement de Makhno en Ukraine, la Rastvojartska (la réquisition implacable de la nourriture chez la paysannerie, ce qui inclut donc aussi la relation entre la classe ouvrière et les paysans), la situation catastrophique de l'enfance[2] (une question dont elle s'occupait naturellement énormément...) ou sa position vis–à-vis des conseils ouvriers. Cependant, ses expériences et ses analyses du soulèvement de Cronstadt en mars 1921 sont importantes car cela signifia la rupture de Goldman avec les bolcheviks.
"La vérité sur les bolcheviks"
L'éclatement de la Révolution d'Octobre la remplit d'un grand enthousiasme : "De novembre 1917, jusqu'à février 1918, tandis que j'étais libre sous caution pour mon attitude contre la guerre, j'ai parcouru l'Amérique pour défendre les bolcheviks. J'ai publié une brochure pour expliquer la Révolution russe et justifier les bolcheviks. Je les ai défendus comme incarnant en pratique l'esprit de la révolution, malgré leur marxisme théorique."[3]
En 1918, dans la revue anarchiste Mother Earth, elle publie un article intitulé "La Vérité sur les bolcheviks": "La révolution russe ne signifie rien si elle ne libère pas la terre et ne détrône pas le propriétaire terrien, le capitaliste, après avoir chassé le tsar. Ceci explique le fondement historique de l’action des bolcheviks, leur justification sociale et économique. Les bolcheviks ne sont puissants que parce qu’ils représentent le peuple. Dès qu’ils ne défendront plus ses intérêts, ils devront partir, tout comme le gouvernement provisoire et Kerenski ont dû le faire. Car le peuple russe ne sera satisfait que lorsque la terre et les moyens de subsistance deviendront la propriété des enfants de la Russie. Sinon le bolchevisme disparaîtra. Pour la première fois depuis des siècles, les Russes ont décidé qu’ils devaient être écoutés, et que leurs voix allaient atteindre non pas le cœur des classes dirigeantes — ils savent qu’elles n’en ont pas — mais celui des peuples du monde, y compris le peuple américain. C’est là que résident l’importance capitale, le sens fondamental de la Révolution russe, révolution symbolisée par les bolcheviks. (...) Les bolcheviks sont venus pour défier le monde. Celui-ci ne pourra plus jamais se reposer dans sa vieille indolence sordide. Il doit accepter le défi. Il l’a déjà accepté en Allemagne, en Autriche et en Roumanie, en France et en Italie, et même aux États-Unis Comme une lumière soudaine, le bolchevisme se répand dans le monde entier, éclairant la Grande Vision, la réchauffant pour lui permettre de naître -la Nouvelle Vie de la fraternité humaine et du bien-être social."[4]
Le point de vue de Goldman sur les bolcheviks en 1918 était tout sauf négatif. Au contraire, sa défense de la Révolution russe et des bolcheviks a été une réponse hautement responsable à la campagne de mensonges de la bourgeoisie américaine et à son rôle dans la campagne brutale coordonnée au niveau international contre la Russie révolutionnaire. Sa critique radicale après deux ans en Russie a toujours été motivée par l'intention de défendre la Révolution d'Octobre contre les ennemis extérieurs, ainsi que contre la dégénérescence interne ; c’était la principale préoccupation de ses activités et de ses écrits.
Enthousiasme et déception
Deux brèves citations illustrent de façon impressionnante le changement dans l'évaluation que Goldman fait de l'évolution de la situation en Russie. Elle décrit son arrivée à Petrograd en janvier 1920 avec des termes exubérants : "Russie soviétique! Terre sacrée, peuple magique! Tu incarnes l'espoir de l'humanité, sa rédemption. Je suis venue me mettre à ton service, Matuschka chérie! Prends moi dans tes bras, laisse-moi m'intégrer en toi, mêler mon sang au tien, trouver une place dans ta lutte héroïque"[5]
Mais ensuite, deux ans plus tard, en guise de description finale de son séjour en Russie, nous trouvons ce qui suit: "1er décembre 1921! Dans le train, mes rêves écrasés, ma foi brisée, j'ai le cœur lourd comme une pierre, Matuschka Rossiya [Mère Russie] saigne par mille plaies béantes, sa terre est jonchée de cadavres. Je me cramponne à la barre de la fenêtre glacée et serre les dents pour ne pas sangloter." [6]
"Cela faisait juste un an et onze mois que j'avais posé le pied sur ce que j'avais pensé être la terre promise. Mon cœur était lourd de la tragédie de la Russie. Une pensée se détachait en puissant relief: je devais hausser la voix contre les crimes commis au nom de la Révolution. Je serais entendue indépendamment de l'ami ou de l'ennemi." [7]
Que s'est-il donc passé entre son arrivée en 1920 et son départ deux ans plus tard ? Sa déception était-elle exclusivement le résultat d'une attente naïve désormais rattrapée par la réalité ? Nous reviendrons sur cette deuxième question à la fin de l'article.
L'encerclement de la révolution russe
Goldman accorde à juste titre une grande importance à la question de l'encerclement de la Révolution russe qui a été, selon elle, une cause réelle des difficultés des premières années du pouvoir soviétique. Mais, comme nous le signalons plus loin, elle parle peu de son isolement politique du fait que le prolétariat mondial n'a pas été capable de prendre le pouvoir dans d'autres pays alors que c'était la question essentielle et qui n'a pas permis que des erreurs importantes du pouvoir bolchevique ne puissent être corrigées.
Dans son livre Le déclin de la Révolution russe écrit en 1922, Goldman souligne d'emblée comment l'encerclement de la Russie a étouffé la révolution et que la situation d'une guerre mondiale a créé les pires conditions pour la révolution.
"La marche contre la Russie commençait. Les interventionnistes massacraient des millions de Russes, le blocus affamait et souffrir du froid des femmes et des enfants par centaines de milliers. La Russie devenait une vaste région sauvage où régnaient l’agonie et le désespoir. La Révolution russe était attaquée et le régime bolchevique incommensurablement renforcé. C’est le résultat net de quatre ans de conspiration des impérialistes contre la Russie."[8]
La guerre coordonnée à l'échelle internationale contre la Russie a entraîné une asphyxie brutale. Ce serait une base tout à fait erronée que de ne pas prendre en compte cette tragique situation dans l’analyse de la dégénérescence et de l'échec de la Révolution russe ; Goldman l'évoque constamment dans ses expériences personnelles. Par exemple, elle décrit la terrible situation résultant de l'impitoyable affamement de la Russie et ses conséquences pour des millions d'enfants en 1920-21, une situation encore aggravée par les manigances de nombreux bureaucrates d'État pour s'enrichir. Dans cette affaire, Goldman, en dépit de toutes les critiques sévères qu'elle leur adresse, défend les efforts des bolcheviks pour améliorer la situation des enfants :
"C’est vrai que les bolcheviks ont tenté là le maximum en ce qui concerne l’enfant et l’éducation. C’est aussi vrai que s’ils n’ont pas réussi à parer aux besoins des enfants de Russie, la faute en incombe beaucoup plus aux ennemis de la révolution russe qu’à eux. L’intervention et le blocus ont pesé plus lourdement sur les frêles épaules d’enfants innocents et de malades. Mais même dans des conditions plus favorables, le monstre bureaucratique "frankensteinien" de l’État bolchevique ne pouvait pas décevoir les meilleures intentions et paralyser l’effort suprême fait par les communistes en faveur de l’enfance et de l’éducation. (…) De plus en plus, j’en venais à voir que les bolcheviks essayaient de faire tout ce qu’ils pouvaient pour les enfants mais que leurs efforts étaient réduits à néant par la bureaucratie parasite que l’État avait créée."[9]
Ainsi, concrètement, décrit-elle ce que l'on appelait les "Âmes mortes"[10] : des noms fictifs d’enfants ou déjà décédés inscrits sur les listes des ayants droit en produits alimentaires par la bureaucratie inférieure. Les bureaucrates ont détourné ces aliments obtenus par la fraude pour leur propre consommation ou pour les revendre à leur compte. Tout cela au détriment de centaines de milliers d'enfants affamés, victimes les plus vulnérables face à l’asphyxie causée par le blocus international !
On ne peut pas reprocher à Goldman d'avoir analysé le déclin de la Révolution russe sans tenir compte de la situation déterminante et mortelle de son isolement en Russie. Elle a également tenté, comme il ressort clairement des citations de ses textes, d'établir une distinction entre les bolcheviks et la bureaucratie d'État, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Sa faiblesse réside plutôt dans l'absence d'une analyse claire du fait que la guerre et le blocus contre la Russie n'ont été possibles que parce que la classe ouvrière, justement en Europe occidentale, a progressivement été battue, en particulier en Allemagne. La classe ouvrière en Europe de l'Ouest, et aussi aux États-Unis, a été confrontée à une bourgeoisie beaucoup plus expérimentée et à des appareils d'État plus sophistiqués qu'en Russie. Mais ce n'est pas seulement la défaite de la vague révolutionnaire internationale qui a produit la situation désespérée de la Russie, mais aussi le retard de la classe ouvrière internationale par rapport à la Russie.
En Allemagne, la tentative de révolution ne commença que plus d'un an après Octobre 1917, ce qui laissa pendant un long moment libre cours à la stratégie d'isolement de la Russie, comme le montrent les mois qui ont suivi les négociations de Brest-Litovsk. La prise du pouvoir par le prolétariat dans les États centraux de l'Europe occidentale aurait été le seul moyen de briser l'étranglement de la Révolution russe et de mettre un coup d'arrêt aux interventions armées. Il n'est possible de comprendre les racines de la défaite de la Révolution russe qu'en examinant précisément le rapport de forces international entre le prolétariat et la bourgeoisie. C'est un aspect qui n'apparaît que ponctuellement dans les écrits de Goldman, à peine développé, et qui laisse l'impression que le sort de la révolution a été scellé principalement sur le sol russe.
L'isolement et l'asphyxie de la Russie après Octobre 1917 n'expliquent en aucun cas tous les aspects de la dégénérescence interne, qui a finalement été l'expérience la plus traumatisante pour la classe ouvrière, ni ne doivent non plus servir de justification à la dégénérescence interne. En ce qui concerne le problème des erreurs catastrophiques des bolcheviks, dont en particulier leur politique d'identification à l'appareil d'État, il est crucial de voir que cela n'aurait pu être corrigé que sous l'influence d'une classe ouvrière révolutionnaire victorieuse dans d'autres pays, ce qui tragiquement n'a pas été le cas.[11]
En y regardant de plus près, il y a une contradiction dans les thèses centrales de Goldman sur la relation entre la situation internationale et les causes de la dégénérescence de la Révolution russe. D'une part, elle écrit : "Toutes mes observations et mes études au cours des deux ans m’avaient éclairée sur le fait que le peuple russe, s’il n’avait pas été continuellement menacé de l’extérieur, aurait vite compris le danger de l’intérieur et aurait su comment faire face à ce danger." D'un autre côté, cependant : "s’il y a jamais eu un doute sur ce qui représente le plus grand danger pour une révolution – les attaques de l’extérieur ou la paralysie du peuple en son sein – l’expérience russe devrait complètement lever ce doute. La contre-révolution soutenue par l’argent, les hommes et les munitions des Alliés, a totalement échoué."[12]
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'isolement de la Russie ne doit en aucun cas servir d'excuse à des erreurs. Mais Goldman tire une conclusion curieuse dans laquelle elle contredit "ses observations et ses études", citées précédemment : le salut de la révolution aurait dépendu essentiellement des forces et de la politique de la classe ouvrière en Russie, la situation internationale devenant pour elle un facteur beaucoup plus secondaire. Goldman développe ici une logique qui nous rappelle celle de Voline sans toutefois aller aussi loin[13]: elle présente la défaite des forces contre-révolutionnaires alliées comme la preuve que les menées contre-révolutionnaires avaient constitué un obstacle parfaitement surmontable pour la révolution, ce qui est d'un simpliste choquant quand on sait les dommages considérables occasionnés par cette confrontation sanglante[14], dont la mort de dizaines de milliers de révolutionnaires déterminés, et que Goldman elle-même a bien décrits. Ces révolutionnaires conscients tombés au combat qui s'étaient volontairement rendus par milliers sur le front, auraient probablement pu s'opposer de quelque manière à la contre-révolution interne.
Les deux facteurs, l'isolement et l'étranglement d'une part et, d'autre part, les erreurs des bolcheviks se renforcèrent mutuellement. La principale différence entre eux était que la guerre contre la Russie était évidente pour tous, alors que la dégénérescence de l'intérieur s'amorçait de façon beaucoup plus masquée pour devenir au final le traumatisme du siècle pour la classe ouvrière internationale. Les conclusions de Goldman constituent en substance un moyen répandu pour prendre en compte à la fois la question de la contre-révolution extérieure et celle de la dégénérescence contre-révolutionnaire de l'intérieur, un problème auquel tous les révolutionnaires des années 1920 ont été confrontés.
La guerre ne crée pas les meilleures conditions pour la révolution
L'une des contributions remarquables de Goldman à la compréhension de la défaite de la Révolution russe est sa réflexion sur les conditions de la révolution pendant et après une guerre, même si nous ne partageons pas sa conclusion: "Peut-être le sort de la Révolution russe était-il déjà décidé à sa naissance. La révolution a suivi une guerre de quatre ans, une guerre qui a privé la Russie de ses meilleurs hommes, a versé leur sang dans des torrents et dévasté tout le pays. Dans de telles circonstances, il aurait été compréhensible que la révolution n'ait pas pu rassembler la force nécessaire pour résister à l'impact furieux du reste du monde." [15]
Ici, elle souligne à juste titre le résultat direct de la guerre et répond aux idées fausses et schématiques selon lesquelles la crise aggravant automatiquement la guerre et la guerre renforçant automatiquement la conscience de la classe ouvrière, la révolution pourrait ainsi éclater. Goldman souligne que c'est fondamentalement la révolution qui a pâti de l'épuisement en Russie résultant de la guerre même. Mais l'idée que le sort de la révolution pouvait quelque part être "déjà fixé à sa naissance" constitue une approche fataliste.
Il y avait à prendre en compte un facteur important potentiel qui ne s'est pas réalisé. La Première Guerre mondiale prit fin en novembre 1918, un an après Octobre 1917. Comme nous l’avons déjà souligné, le seul espoir d'Octobre était que la révolution déferle le plus rapidement possible dans d'autres pays et, surtout, en une vague révolutionnaire rapide en Europe de l'Ouest. C'était une perspective historiquement possible et la classe ouvrière n'avait d'autre choix que d'engager la lutte dans cette direction.
La guerre s'est terminée avec des pays vainqueurs et des pays vaincus. Si la défaite ébranle les gouvernements vaincus et peut, par conséquent, favoriser leur affaiblissement et les dynamiques révolutionnaires, il n'en est rien pour les gouvernements victorieux qui sortent au contraire renforcés. Dans les États vainqueurs, alors que la classe ouvrière avait été douloureusement entraînée à la boucherie par la bourgeoisie quatre ans durant, c'est cependant l'aspiration à la paix et à la tranquillité qui domine et sape considérablement les possibilités d'impulsions révolutionnaires du prolétariat en France, Angleterre, Belgique, Hollande et Italie. Ce n'est pas seulement le rapport de force entre les États impérialistes qui était différent après la guerre, mais aussi l'état d'esprit des masses qui se trouvaient ainsi divisées en fonction de leur appartenance à un pays vainqueur ou vaincu. Goldman soulève le problème de la guerre qui crée des mauvaises conditions pour la révolution, mais elle le réduit essentiellement au seul cas de la Russie elle-même
Quelles possibilités de changements après une révolution ?
Quelles possibilités de changements existait-il en Russie, à une époque d'encerclement total et de famine? Dans le camp des anarchistes, il y avait des opinions très différentes à ce sujet. Mais ce qui était significatif, c'était la grande attente d'améliorations immédiates, indispensables dans la vie quotidienne, et surtout au niveau des mesures économiques et de la réorganisation de fond en comble de la production, Quelles étaient les attentes de Goldman à ce moment-là, à peine deux ans après Octobre 1917 ? S'attendait-elle à son arrivée en Russie en janvier 1920 à trouver une société qui réponde déjà aux besoins humains ? Lors de sa première rencontre avec Maxime Gorki, dans un train pour Moscou, elle lui déclara : "J'espère que vous croyez que moi, une anarchiste, je n'ai jamais pensé naïvement qu'on construirait l'anarchisme sur les ruines fumantes de la vieille Russie."[16]
Elle décrit les conversations avec Alexandre Berkman, son plus proche compagnon politique et personnel depuis des décennies, de la façon suivante : "Il écarta toutes les accusations proférées (contre les bolcheviks) en les mettant sur le compte d'individus aigris et inefficaces. Les anarchistes de Petrograd étaient comme beaucoup de militants dans nos rangs aux États-Unis qui ne faisaient rien et critiquaient tout le temps, disait-il. Peut-être avaient-ils été naïfs au point de s'attendre à ce que l'anarchisme émerge du jour au lendemain des ruines de l’autocratie et des erreurs du gouvernement provisoire"[17] Goldman n’a pas jugé la Révolution russe à l'aune d'une mesure naïve exclusivement fondée sur l'amélioration immédiate des conditions de vie et de l'économie.[18]
Sur la question des possibilités immédiates d'un bouleversement social dans l'intérêt de la classe ouvrière et d'autres couches opprimées, comme les millions de paysans en Russie, Goldman place à nouveau son point de vue dans un cadre qui n'ignore pas la situation internationale. Elle n'hésitait pas non plus à défendre les efforts des bolcheviks (comme nous l'avons vu en ce qui concerne la situation des enfants qui exigeait une action immédiate et drastique) et à critiquer sévèrement les positions des autres anarchistes. Goldman ne s'est pas soumise à la loi du silence et au rejet de toute critique mutuelle au sein du camp anarchiste. Nous ne savons pas quels arguments elle a employés envers les anarchistes impatients qui n'attendaient que le bouleversement immédiat de la société. Mais ces controverses entre anarchistes montrent qu'il n’y avait pas d'anarchisme homogène en Russie pendant la révolution.
La question des mesures immédiates possibles pour soulager rapidement les souffrances était d'une importance capitale pour la classe ouvrière et la paysannerie dans son ensemble, et n’était pas seulement un thème des parties les plus impatientes de l'anarchisme, chez lesquelles cette question était souvent le critère unique déterminant leur attitude envers les bolcheviks. Pour la classe ouvrière, la révolution ne possède pas une logique historique abstraite. Après des décennies d'exploitation brutale et avoir enduré les souffrances de la boucherie de la guerre mondiale de 1914-1918, les grands espoirs d'un lever de soleil à l'horizon de la vie étaient plus que compréhensibles et appropriés. Ils ont constitué une force motrice importante de la conviction révolutionnaire et la combativité qui ont permis Octobre. Compte tenu de la réalité immédiate d'étranglement de la Russie révolutionnaire, de la faim et de la guerre contre les armées blanches, le soleil attendu ne s'est pas levé à l'horizon. L'asphyxie et la démoralisation pesaient lourdement sur la classe ouvrière. Dans cette situation presque désespérée, Goldman adopta une attitude responsable de patience et de persévérance qui, dans la défaite progressive de la vague révolutionnaire mondiale après la guerre, et pour tous les révolutionnaires, ne pouvait être maintenue qu'avec une volonté et une clarté politique énormes.
Les bolcheviks et l'appareil d’État : le naufrage du marxisme ?
Dans son analyse de la dynamique de l'appareil étatique en pleine croissance après Octobre, Goldman a été totalement fidèle à sa propre idée selon laquelle le problème russe était beaucoup trop compliqué pour être expédié en quelques paroles superficielles. Elle accorde une grande attention à cette question et se distingue par des observations et des réflexions précises. Néanmoins, bon nombre de ses conclusions ne peuvent absolument pas être partagées ! Ses écrits contiennent des contradictions sur la question des rapports entre les bolcheviks et l'appareil d’État en plein développement.
En 1922, elle n'est pas encore en mesure de faire une analyse approfondie et avec recul, comme cela a été possible à la fin des années 1920 et au début des années 1930 lorsque la Gauche Communiste Italienne se fixa cette tâche. Il ne fait aucun doute que certains principes anarchistes sur la question de l'État dominent fortement son analyse et les conclusions qui en découlent.
Il est d'abord indispensable de présenter largement la vision de Goldman sur la question : "Les sept premiers mois de mon séjour en Russie m'avaient presque détruite. J'étais arrivée avec tant d'enthousiasme au cœur, complètement animée par le désir passionné de me lancer dans le travail et d'aider à défendre la cause sacrée de la révolution. Mais ce que j'ai trouvé en Russie m'a dépassée. Je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. La roue de la machine d'État socialiste est passée sur moi et a paralysé mon énergie. La misère et l'affliction terribles du peuple, le manque de préoccupation pour ses désirs et ses besoins, les persécutions et les oppressions, rendaient ma vie insupportable. Était-ce la révolution qui avait transformé les idéalistes en bêtes sauvages ? Si tel était le cas, les bolcheviks n'étaient que des pions aux mains d'un destin inévitable. Ou était-ce la nature froide, impersonnelle de l'État, qui avait, par des moyens ignobles, exploité à fond la révolution et la conduisait maintenant à coups de fouet sur des voies qui étaient indispensables à l’État? Je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions - du moins pas en juillet 1920." [19]
"En Russie, cependant, les syndicats ne représentent les besoins des travailleurs, ni dans un sens conservateur ni dans un sens révolutionnaire. Ce qu’ils sont réellement, c’est l’auxiliaire obéissant et militarisé de l'État bolchevique. Ils sont "l’École du communisme", comme l’affirmait Lénine dans ses thèses sur le rôle des syndicats. Mais ils ne sont même pas ça. Une école suppose la libre expression et l'initiative de l'étudiant, tandis que les syndicats en Russie ne sont que des casernes pour l’armée de la force de travail mobilisée, forcée d’adhérer sous la contrainte du fouet du conducteur de l'État."[20]
"Je suis certaine que ni Lounacharski ni Gorki ne le savaient pas (l’emprisonnement d’enfants par la Tcheka). Mais là réside la malédiction du cercle vicieux : il rend impossible à ceux qui sont à la tête de savoir ce que fait l’essaim dans la ruche de leurs subordonnés (…) Lounacharski connait-il de tels cas ? Est-ce que les communistes dirigeants savent ? Certains sans doute savent. Mais ils sont trop occupés par " d'importantes affaires d’État". Ils sont devenus insensibles à toutes ces "broutilles". Ils sont donc, eux aussi, pris dans le cercle vicieux, dans la machinerie de l’administration bolchevik. Ils savent que l’adhésion au parti masque une multitude de péchés." [21]
Et concernant les rapports entre l'appareil d'État et ses bureaucrates : "Dans le village où il [Kropotkine] avait vécu, près de Dmitrov, il y avait plus de fonctionnaires bolcheviques qu'il n'en existât jamais durant le règne des Romanov. Tous ces gens vivaient aux frais des masses. Ils étaient des parasites sur le corps social, et Dmitrov était seulement un petit exemple de ce qui se passait partout en Russie. Aucun individu particulier n'en était la cause : c'était plutôt l'État qu'ils avaient créé, qui discréditait chaque idéal révolutionnaire, étouffait toute initiative et mettait une prime à l'incompétence et au gaspillage."[22]
Les observations de Goldman sur la réalité concrète de l'État décrivent très précisément comment celui-ci se développe de plus en plus et commence inexorablement à tout absorber. C'est sa grande qualité que de dépeindre une perception détaillée de la "vie quotidienne" de l'appareil bureaucratique et sa profonde contradiction avec les intérêts de la classe ouvrière et des autres classes exploitées. En 1922, ses descriptions étaient pleinement pertinentes face à toutes les glorifications qui circulaient dans le mouvement ouvrier international sur la situation en Russie et face à l'aveuglement devant les grands problèmes auxquels la Russie était confrontée. Il ne fait aucun doute que les efforts de Goldman pour mettre en garde contre le danger de l'État à mesure qu'il se développait en Russie étaient précieux à cette époque, même si son analyse constituait plutôt un état des lieux et une première ébauche.
Mais quelles conclusions en tire-t-elle ? "Ce serait une erreur de supposer que l'échec de la Révolution était dû entièrement au caractère des bolcheviks. Fondamentalement, c'était le résultat des principes et des méthodes du bolchevisme. C'était l'esprit et les principes autoritaires de l'État qui étouffèrent les aspirations libertaires et libératrices. N'importe quel autre parti politique aurait été en charge du gouvernement en Russie que le résultat aurait été essentiellement identique. Ce n'est pas tellement les bolcheviks qui ont tué la Révolution russe mais plutôt l'idée bolchevique. C'était le marxisme, quelque peu modifié en un gouvernementalisme étriqué et fanatique (...) J'ai prouvé plus loin que c'est non seulement le Bolchevisme qui a échoué, mais le marxisme lui-même. C'est-à-dire, l'IDÉE D'ÉTAT, le principe autoritaire, qui a montré sa banqueroute par l'expérience de la Révolution russe. Si je devais résumer toute mon argumentation en une phrase, je devrais dire : la tendance intrinsèque de l'État est de se concentrer, de se rétrécir et de monopoliser toutes les activités sociales ; la nature de la Révolution est au contraire, de se développer, de s'élargir, et de se disséminer en cercles de plus en plus larges. En d'autres termes, l'État est institutionnel et statique ; la Révolution est fluide et dynamique. Ces deux tendances sont incompatibles et se détruisent mutuellement. L'idée d'État a tué la Révolution russe et elle doit avoir le même résultat sur toute autre révolution, à moins que l'idée libertaire ne règne. (...) La cause principale de la défaite de la Révolution russe se trouve beaucoup plus en profondeur. Elle doit être trouvée dans l'ensemble de la conception socialiste de la Révolution elle-même."[23]
"Et tandis que les ouvriers et les paysans russes mettaient leur vie en jeu si héroïquement, cet ennemi intérieur gagnait encore plus de pouvoir. Lentement mais surement, les bolcheviks construisaient un État centralisé qui a détruit les Soviets et écrasé la Révolution, un État que nous pouvons maintenant facilement comparer, au niveau de la bureaucratie et du despotisme, à n’importe quel État des grandes puissances du monde."[24]
"Les politiques marxistes des bolcheviks, les tactiques d'abord prônées comme indispensables à la vie de la Révolution pour ensuite être rejetées comme nuisibles après avoir causé misère, méfiance et antagonisme, ont été les facteurs qui ont lentement sapé la foi du peuple dans la révolution" [25]
La thèse de Goldman est la suivante : le marxisme, en raison de la politique des bolcheviks à l'égard de l'État suite à la révolution, s'avère inutilisable. Contrairement aux secteurs de l'anarchisme viscéralement anti-organisationnel, Goldman n'a jamais défendu la position que les problèmes des bolcheviks résultaient fondamentalement de la solidité organisationnelle de leur parti politique. Elle a plutôt rejeté leur politique concrète. Elle a tout à fait raison sur deux points lorsqu'elle dit que l'État est par nature "institutionnel et statique." Elle se réfère ici manifestement à l'expérience concernant l'État bourgeois et sa nature avant la révolution. La position de Goldman n'est pas exclusivement émotionnelle, comme certains anarchistes le lui ont constamment reproché à l'époque, mais est basée sur l'expérience historique. L'État dans le féodalisme et le capitalisme est par essence effectivement complètement statique et, de surcroît, défendant inconditionnellement les intérêts et le pouvoir de la classe dirigeante; il est ouvertement réactionnaire. Deuxièmement, nous partageons le point de vue selon lequel le problème n'était pas celui des personnalités individuelles dans les rangs bolcheviques, mais l'énorme confusion au sein du parti concernant l'État après la révolution, laquelle ne faisait en fait que refléter l'immaturité du mouvement ouvrier à cette époque sur la question de l'État.
Même après une révolution prolétarienne mondiale (ce qui n'a jamais été le cas à l'époque de la Révolution russe, qui est restée largement limitée à la Russie), le "semi-État" nécessaire mais limité à des fonctions minimales, subordonné aux conseils ouvriers reste dans son essence toujours conservateur et statique; et ne constitue en aucun cas une force motrice pour l'établissement d'une société communiste, ni n'est un organe de la classe ouvrière. Comme l'a décrit la Gauche Communiste italienne : "L'État, malgré l'adjectif "prolétarien" reste un organe de coercition, il reste en opposition permanente et aiguë avec la réalisation du programme communiste, il est en quelque sorte la révélation de la persistance du danger capitaliste pendant toutes les phases de la vie et de l'évolution de la période transitoire.""[26] Par conséquent, il est absolument faux de parler d'un "État prolétarien" comme d'un organe de la révolution, comme le prétendaient les trotskystes à l'égard de la Russie, mais aussi le courant bordiguiste en ce qui concerne l'analyse théorique de la période de transition. Une telle idée est complètement inapte à saisir le danger que recèle l'identification des conseils ouvriers et du parti politique avec l'appareil d'État - comme cela s'est tragiquement produit en Russie.
Pour éviter tout faux débat, une remarque est nécessaire : Goldman parle souvent d'un "État centralisé" construit par les bolcheviks. Mais ceci non pas parce qu'elle était partisane du concept fédéraliste, comme Rudolf Rocker qui prônait le principe d'une lutte de classe extrêmement fédéraliste.[27] Le terme "centraliste" utilisé par Goldman était plutôt une caractérisation de l'appareil d'État impénétrable, inerte, corrompu et hiérarchique en Russie, qui a saboté la mise en œuvre même des plus petites mesures en faveur de la classe ouvrière et des autres couches opprimées de la société, comme la paysannerie.
Mais le test de la révolution signe-t-il la faillite du marxisme, comme Goldman le prétend ? Et l'anarchisme a-t-il au contraire été confirmé par la Révolution russe ? Si l'on veut comprendre les événements autour de la Révolution russe, le type d'approche consistant à s'ériger en arbitre à l'égard de deux courants politiques historiques sur le "terrain de jeu de la Révolution" pour donner un vainqueur et un perdant, n'est guère utile.
Nous ne pouvons pas aborder tous les aspects de la dégénérescence tragique du parti bolchevique et de la Révolution russe dans cette réponse, comme nous l'avons déjà fait dans de nombreux textes du CCI. Mais nous devons répondre à Goldman sur le prétendu naufrage du marxisme dans son ensemble. Le parti bolchevique a dégénéré, ce qui s'est clairement exprimé par sa fusion avec l'appareil d'État, c'est un fait - mais le marxisme n'a pas failli.
Comment Goldman explique-t-elle avec sa méthode le fait que face à la question de la guerre, c'est précisément au sein du mouvement ouvrier marxiste et sur la base de son héritage historique, que les positions internationalistes les plus claires et les plus déterminées ont émergé, telles qu'elles se sont incarnées à la Conférence de Kienthal de 1916 ? Et tout cela avec une organisation marxiste, les bolcheviks, comme fer de lance contre le réformisme qui s'était agenouillé face à la question de la guerre.
Comment explique-t-elle, à l'aide de cette méthode, le fait, comme cela a été mentionné au début de cet article et correctement dénoncé par Goldman, qu'au sein de l'anarchisme et même autour de la figure la plus centrale de l'anarchisme à l'époque, Kropotkine, une tendance est apparue qui a abandonné les principes internationalistes et l'a ouvertement proclamé dans un manifeste - un dévoiement qui a suscité une grande incertitude, des tensions et une résistance dans les rangs anarchistes ? Selon la méthode de Goldman, l'anarchisme aurait ici fait naufrage, puisque l'internationalisme venait d'être jeté par-dessus bord par ses représentants les plus influents. Comme dans le mouvement ouvrier marxiste, une vive confrontation s'est produite face au test de la guerre, et une partie déterminée dont Goldman faisait également partie, a combattu tout soutien à l'un ou l'autre des deux camps impérialistes en présence.
Il serait absolument faux d'affirmer que l'anarchisme dans son ensemble a fait faillite en 1914. Au contraire, c'est justement parce qu'une sévère décantation au sein de l'anarchisme et du mouvement ouvrier marxiste a eu lieu, qu'il fut possible que, dans la lutte contre la guerre et en Octobre 1917, les anarchistes internationalistes révolutionnaires combattent côte à côte avec le marxisme révolutionnaire. Si le positionnement nécessaire entre la guerre et la révolution a effectivement produit un résultat, c'est bien, tout autant chez les marxistes que chez les anarchistes, la détermination à défendre de façon conséquente et intransigeante l'internationalisme et les intérêts de la classe ouvrière.
Et ce n'est pas tout. Comment Goldman explique-t-elle avec son approche et la thèse de la faillite du marxisme le fait que les bolcheviks, une organisation de tradition marxiste, ont été capables en 1917 avec les Thèses d'Avril formulées par ses représentants les plus déterminés d'apporter la clarté contre les confusions démocratiques existant encore dans la classe ouvrière russe ?
C'est un fait que la majorité des bolcheviks se sont progressivement éloignés de l'esprit de la Révolution d'Octobre, lui ont tourné le dos. En s'identifiant avec l'appareil d'État et en prenant des mesures répressives contre ceux qui formulaient des critiques, ils se sont enfermés dans la croyance absurde qu'ils pouvaient sauver la révolution et sont devenus l'incarnation de la contre-révolution de l'intérieur. Mais ce n'est pas la totalité des bolcheviks qui s'est engagée dans cette voie, car il y eut différentes réactions organisées au sein du parti face à ces signes de dégénérescence.
Goldman décrit sa grande sympathie et sa proximité envers l'un de ces groupes d'opposition au sein du Parti bolchévique, l'" Opposition ouvrière " autour de Kollontaï et Chliapnikov. Manifestement, le marxisme a été capable de produire une opposition révolutionnaire militante, ce que Goldman a expressément salué. D'autre part, elle décrit (et plus largement encore son compagnon politique Alexander Berkman) les tendances organisées au sein de l'anarchisme en Russie, les dits "anarchistes de Soviets", qui soutenaient ouvertement la politique des bolcheviks, et ce, même en 1920 lorsque la terreur de la Tcheka[28] s'était déjà installée. Elle écrit aussi ce qui suit en toute honnêteté : ""Malheureusement, mais c'était inévitable dans ces circonstances, quelques esprits mauvais trouvèrent une entrée dans les troupes anarchistes - débris rejetés sur le rivage par la marée révolutionnaire. (...) Le pouvoir corrompt, et les anarchistes ne sont pas une exception."[29] Donc, si nous suivons la méthode de Goldman, l'anarchisme a-t-il aussi échoué dans son intégralité à cause de tels faits ? Une telle conclusion serait erronée de notre point de vue. Son approche et sa conclusion ne tiennent pas compte de tous les débats d'après Octobre 1917 au sein du soi-disant "marxisme failli".
La question de l'État après la révolution n'a pas été résolue au sein du mouvement ouvrier de l'époque. Cela est valable également pour les anarchistes. Une raison essentielle en était l'absence d'une expérience historique concrète telle qu'elle est apparue en Russie après 1917. L'isolement insurmontable de la Révolution russe et l'obligation d'en défendre le territoire ont brutalement et rapidement renforcé l'étouffement de la révolution et sa dégénérescence, l'État et le parti bolchevique "fusionnés" devenant un facteur actif de cette dynamique.
Même la référence politique de Goldman, le "Père Kropotkine", comme le nommait son entourage politique, n'était pas lui non plus en mesure de répondre dans son livre L'État - Son rôle historique aux questions du rôle et de la fonction de l'État après une révolution. Le rejet radical de l'État par la grande majorité des anarchistes sur la base d'une méfiance instinctive, provenait de l'expérience d'une confrontation brutale avec l'État sous le féodalisme et l'appareil d'État capitaliste ; il exigeait à juste titre la destruction de l'État bourgeois par la révolution prolétarienne, comme cela a été défendu par Lénine dans son livre L'État et la Révolution. Même s'il faut reconnaître ce mérite au mouvement anarchiste, une conception fausse dominait néanmoins dans ses rangs : l'organisation de la société, immédiatement après la révolution par les conseils ouvriers, les syndicats et les coopératives. Un tel scénario pousse irrémédiablement les organes de défense des intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière, les conseils ouvriers, et qui constituent l'élément dynamique de la société, à fusionner avec l'organisme en charge de la gestion de la société (que nous appelons un État de transition[30] réduit et contrôlé). Ce faisant, les conseils ouvriers ne peuvent que perdre leur autonomie par rapport à ce dernier (ce qui qui signifie que la classe ouvrière perd son autonomie de classe) et deviennent eux-mêmes un rouage de la bureaucratie. Nous trouvons aussi cette position chez Goldman, même si ce n'est que sous une forme implicite et non développée.
Revenons à la question du prétendu naufrage du marxisme. La plupart des anarchistes ont critiqué les développements tragiques en Russie. Mais l'anarchisme n'a pas été confirmé in corpore dans la Révolution russe, tout comme le marxisme n'a pas échoué dans son ensemble. Il y avait sans aucun doute deux idées fausses chez les bolcheviks au sujet de la relation entre les conseils ouvriers, le parti et l'État. À l'époque de la Révolution russe dominait la conception de l'unité entre le parti et l'appareil d'État, et du parti qui, aux côtés des conseils ouvriers, devait être impliqué dans l'exercice du pouvoir. La conception dominante était qu'une minorité au sein de la classe ouvrière, son parti, serait appelée, en raison de la confiance de celle-ci à son endroit, à prendre le pouvoir au nom même de la classe ouvrière. Ce point de vue exprimait clairement l'immaturité existante sur la question de l'État après la révolution.
A travers leurs conceptions sur l'État postrévolutionnaire et leur relation avec celui-ci, les bolcheviks ont été happés dans une spirale tragique, qui, dans la situation d'isolement complet de la révolution, a vu une conception fausse devenir une tragédie. Bien que les bolcheviks n'aient jamais ouvertement rejeté le principe de la prise du pouvoir par les conseils ouvriers, l'un des premiers signes de la dégénérescence a été dépossession progressive des conseils ouvriers de leur contrôle du pouvoir, processus dans lequel les bolcheviks ont joué un rôle décisif.
Ce n'est pas un constat fataliste, mais un fait historique que de dire que c'est l'expérience tragique de la Révolution russe qui a clarifié toutes ces questions. Le seul salut ne pouvait venir que de l'extension internationale de la Révolution sur la base de la vitalité des Conseils. Cela aurait également démenti tout déterminisme rétrospectif selon lequel le sort de la Révolution russe était déjà scellé à sa naissance. Mais vouloir sauver la révolution avec "l'arme d'un État fort" comme les bolcheviks commencèrent à le mettre en œuvre était une impossibilité pure et simple.
Goldman tire une conclusion statique de la réalité de la domination croissante de l'appareil d'État après Octobre et du processus de dégénérescence. C'est une faiblesse de sa méthode qui ne tient pas compte de la lutte dans les rangs marxistes contre la dynamique de domination de l'État ; pas plus qu'elle ne tient compte des énormes difficultés que cette situation a générées parmi les anarchistes, même si cela figure en détail dans ses observations. Cette faiblesse s'ajoute à sa conception selon laquelle les bolcheviks - en tant que partie du marxisme, et pour cette raison même - étaient dès le début condamnés à l'échec à cause leur but suprême, celui de s'emparer du pouvoir comme le prétendaient tous les détracteurs du parti bolchevique. Il semble que, selon Goldman, ce serait la simple existence des positions marxistes qui auraient décidé du sort de la révolution. Dans sa conclusion sur la question de l'État, elle nie aussi expressément le fait qu'il s'agissait d'un processus de dégénérescence résultant du contexte mondial, plutôt que d'une question "réglée" dès le départ. Avec sa proclamation de "l'échec du marxisme" dans l'expérience de la Révolution russe, elle cède beaucoup trop à la facilité, ce qui l'amène finalement à une autre thèse.
"La fin justifie les moyens" et Kronstadt : la rupture avec les bolcheviks
L'une des thèses de Goldman où elle va le plus loin dans la critique est la suivante : "Les bolcheviks sont l’ordre des jésuites dans l’église marxiste. Ce n’est pas qu’ils ne soient pas sincères en tant qu’hommes, ou que leurs intentions soient mauvaises. C’est leur marxisme qui a déterminé leur politique et leurs méthodes. Les moyens mêmes qu’ils ont employés ont détruit la réalisation de leur but. Le communisme, le socialisme, l’égalité, la liberté, - toutes choses pour lesquelles les masses russes ont enduré un tel martyr – ont été discréditées et salies par leur tactique, par leur devise jésuitique selon laquelle la fin justifie les moyens (…) Mais Lénine est un jésuite perspicace et subtil ; il s’est joint au cri de guerre : "'Tout le pouvoir aux Soviets !' Quand lui et ses disciples jésuites ont été solidement en selle, le démantèlement des Soviets a commencé. Aujourd’hui, ils sont comme chaque chose en Russie - un fantôme dont l’intérieur a été complètement écrasé. (…) Certainement, Lénine se repent souvent. Au congrès communiste de toutes les Russie, il s’est avancé avec 'mea culpa'. 'J’ai péché'. Une fois un jeune communiste m’a dit : je ne serais pas surpris si Lénine déclarait un jour que la révolution d’Octobre était une erreur." [31]
Oui, les objectifs des bolcheviks, le communisme, le socialisme, l'égalité, la liberté, dont Goldman ne nie pas ici qu'ils furent les véritables buts des bolcheviks, n'ont pas pu être réalisés. À d'autres endroits de ses écrits sur la Russie, elle décrit comment elle a été confrontée à la question pleine d'espoir et posée à maintes reprises par de nombreux dirigeants bolcheviques : "La Révolution en Allemagne et aux États-Unis arrive-t-elle bientôt ?", même de la part de Lénine lors d'une rencontre avec Goldman. Les bolcheviks avec lesquels elle en a parlé espéraient vivement recevoir une réponse positive de sa part, elle qui était bien au fait de la situation aux États-Unis. Il était évident, d'après ses descriptions, que les bolcheviks vivaient dans la peur permanente de l'isolement et escomptaient désespérément les moindres signes de développement révolutionnaire dans d'autres pays. Elle fournit elle-même la preuve que dans les rangs du Parti bolchévique, qui était tout sauf homogène, l'espoir d'une révolution mondiale a continué à vivre dans un contexte de dégénérescence de plus en plus évident. Et donc pas seulement l'avidité pour le pouvoir en Russie, comme elle se risque à l'avancer avec l'idée du "jésuitisme" des bolcheviks.
Les préoccupations de Goldman tournaient autour de la contradiction entre les objectifs initiaux des bolcheviks et leurs politiques et méthodes concrètes. Cela la conduisit à une rupture définitive après la répression sanglante du soulèvement de Cronstadt en mars 1921, menée sous la bannière du sauvetage de la révolution et où l'usage brutal de la violence au sein de la classe ouvrière a été employé, ce qui est en contradiction criante avec les principes communistes. Son expérience avec la Tcheka a également joué un rôle décisif dans sa rupture avec les bolcheviks.
La méthode selon laquelle la fin justifie les moyens doit être combattue avec véhémence par la classe ouvrière. C'est l'honnêteté de Goldman de ne pas cacher ses propres hésitations à ce sujet. Mais ses descriptions réfutent précisément la thèse selon laquelle la pensée des bolcheviks est celle des "jésuites du marxisme", qui ne reculent devant rien dans la poursuite de leurs buts, et qu'il y aurait ici une différence fondamentale entre les bolcheviks et l'anarchisme.
Comment cette question s'est-elle posée chez les anarchistes ? Elle décrit ses discussions avec Berkman sur la question des moyens légitimes pour défendre la révolution : "C’était absurde de dénoncer les bolcheviks pour les mesures drastiques qu’ils employaient, préconisait Sascha. Comment allaient-ils libérer la Russie de l’étranglement de la contre-révolution et du sabotage? Pour autant qu’il ait été concerné, il ne pensait pas qu’il y ait de méthode trop dure pour traiter cela. La nécessité révolutionnaire justifiait toutes les mesures, même si nous ne les aimons pas. Tant que la révolution était en péril, ceux qui visaient à la saper devaient payer pour çà. Mon vieux copain était comme toujours un cœur simple et clairvoyant. J’étais d’accord avec lui; mais les rapports répugnants de mes camarades continuaient à me déranger." [32]
Ce débat avec Berkman s'est poursuivi de la manière la plus tranchante : "Pendant des heures, il argumentait contre mon " impatience" et mon jugement déficient sur des questions de grande portée, mon approche diplomatique de la révolution. J’avais toujours, disait-il, dévalorisé le facteur économique en tant que cause principale des maux capitalistes. Pouvais-je ne pas voir maintenant que la nécessité économique était la raison même qui forçait la main des soviets qui tenait la barre? Le danger venant de l’extérieur qui se prolongeait, l’indolence naturelle de l’ouvrier russe et son échec à augmenter la production, le manque d’instruments les plus nécessaires pour les paysans, et leur refus qui en résultait de nourrir les villes, ont obligé les bolcheviks à prendre des mesures désespérées. Evidemment, il tenait ces méthodes comme contre-révolutionnaires et vouées à ne pas aboutir. Il était cependant ridicule de suspecter des hommes comme Lénine ou Trotsky de trahir délibérément la révolution. Pourquoi auraient ils dédié leurs vies à cette cause, auraient ils subi la persécution, la calomnie, la prison, et l’exil pour leur idéal. Ils ne pouvaient pas revenir là-dessus à ce point-là."[33]
Pour la classe ouvrière, les moyens utilisés ne doivent pas être en contradiction avec ses objectifs fondamentaux.[34] Cependant, nous rejetons l'affirmation selon laquelle seul le marxisme, et en particulier les bolcheviks, seraient vulnérables à la pénétration de l'idéologie de la classe dominante en adoptant des moyens contraires au but du communisme. Les discussions décrites par Goldman sont caractéristiques du fait que l'anarchisme a toujours eu d'énormes difficultés à cet égard. Un exemple de l'utilisation de moyens qui contredisent le but de beaucoup d'anarchistes est l'attentat de Fanny Kaplan contre Lénine le 30 août 1918, justifié par la prétendue trahison de la révolution par Lénine. Vu la longue tradition d'assassinats de représentants du régime tsariste haïs, qui a exposé les anarchistes à une répression brutale, une partie de l'anarchisme russe a eu recours à ce que l'on appelle la "propagande par le fait" en ayant recours à des "moyens justifiés par la fin". Y compris en prenant pour cible des combattants de la classe ouvrière, comme le montre l'attentat contre Lénine !
Il ne s'agit pas de pleurer les figures haïes du tsarisme ciblées par les méthodes d'une partie de l'anarchisme russe, lesquelles exprimaient une compréhension réductrice du féodalisme, identifié à des individus. Mais, comme Berkman le défendait justement face à Goldman, ce système ne reposait pas sur la malveillance d'individus, mais sur des fondements sociaux et économiques en contradiction avec les besoins des classes exploitées. La "propagande par le fait", la violence individuelle contre les représentants haïs du féodalisme, conçue comme une "étincelle pour la réflexion" exprimaient également une fausse conception du développement de la conscience de classe, puisque ces méthodes ne démontrent en aucune façon la nécessité d'une lutte solidaire en tant que classe dans son ensemble contre les fondements de l'exploitation.
Il est compréhensible que Goldman se soit engagée en faveur de Kaplan en tant que prisonnière, vu que celle-ci a été torturée par la Tcheka. Elle n'a elle-même pas appelé à utiliser les mêmes méthodes que Kaplan. Mais pourquoi dans cette situation n'a-t-elle pas osé faire un pas de plus et formuler une critique envers les méthodes "jésuites" dans les rangs de l'anarchisme, plutôt que de circonscrire celle-ci aux bolcheviks ?
Goldman a beaucoup souffert de l'exécution en septembre 1921 par la Tcheka d'amis d'anarchistes tels que Fanya Baron, avec l'approbation de Lénine. Bien que Lénine ait été l'une des personnalités les plus déterminées et les plus claires de la Révolution d'Octobre, de telles mesures sont inacceptables. Goldman a développé une antipathie de plus en plus forte, en particulier envers Trotski et Lénine, les décrivant comme des jésuites intelligents et rusés.[35]
La Tcheka, devenue incontrôlable, a entrepris des exécutions pour intimider, des prises d'otages pour arracher des informations et la torture. Ceci, souvent contre les groupes d'opposition politique issus des rangs des bolcheviks eux-mêmes, contre les anarchistes, mais aussi contre les travailleurs qui participaient à des grèves. La critique par Goldman des condamnations à mort de prisonniers - des individus sans défense - qu'il s'agisse de membres d'organisations contre-révolutionnaires bourgeoises, de criminels et de membres des armées blanches emprisonnés, est absolument justifiée, car de telles mesures n'étaient pas seulement des actes de violence dénués de sens, mais aussi l'expression d'une attitude basée sur l'idée que les personnes ne peuvent changer leurs opinions, leur comportement et leurs positions politiques et doivent donc, en un mot, être liquidés.[36]
Au sein des bolcheviks, la lutte contre l'oppression des voix de l'opposition dans le parti et la classe ouvrière commença dès 1918. Bien que Goldman elle-même ait été témoin de débats et de l'existence de positions différentes parmi les bolcheviks, elle dresse un tableau trop simpliste afin de pouvoir condamner ces derniers comme "Jésuites du marxisme", comme s'ils étaient forgés d'un seul bloc, ce qui n'a jamais correspondu à la réalité. Le problème central était le dérapage que constituait une approche militariste des problèmes politiques au lieu de faire appel à la conscience de la classe ouvrière, à laquelle succombait la majorité des bolcheviks en croyant faussement sauver la révolution assiégée. Mais cela ne correspond en rien à une soif du pouvoir prétendument enracinée dans le parti bolchevique.
Le marxisme n'a jamais défendu le principe selon lequel la fin justifie les moyens; cela n'a jamais été principe ou une pratique des bolcheviks avant et pendant la Révolution d'Octobre. La répression de Cronstadt, cependant, point culminant tragique d'une répression croissante, a montré à quel point la dégénérescence avait déjà progressé, quelles formes elle prenait et quelle logique l'animait, car sa justification politique contenait en fait l'idée du but (la "cohésion de fer" de la Russie contre les attaques internationales) justifiant les moyens (une répression sanglante).
Les expériences personnelles et absolument démoralisantes de Goldman à Cronstadt conduisirent à la rupture avec les bolcheviks et marquèrent un tournant. Dans les derniers jours avant l'écrasement des marins, soldats et ouvriers de Cronstadt, elle faisait partie d'une délégation (comprenant en plus d'elle, Perkus, Pertrowski, Berkman) qui tenta de négocier avec l'Armée rouge. "Kronstadt cassa le dernier fil qui m'avait retenue aux bolcheviks. Le massacre honteux qu'ils avaient perpétré parlait contre eux plus éloquemment que tout autre chose. Quelque prétention qu'ils eussent pu revendiquer de leur passé, les bolcheviks avaient maintenant prouvé eux-mêmes qu'ils étaient les ennemis les plus pernicieux de la révolution. Je ne pouvais continuer plus loin avec eux.""[37]
Cronstadt a été une terrible tragédie, une erreur tragique bien plus qu'une simple "erreur".
L'écrasement de Cronstadt avec plusieurs milliers de prolétaires morts (des deux côtés !) était basé sur une évaluation absolument fausse du caractère de ce soulèvement par les dirigeants bolcheviques qui a pu avoir plusieurs causes : le fait que la bourgeoisie internationale ait saisit perfidement cette occasion pour déclarer hypocritement sa "solidarité" avec les insurgés ; également la peur panique que Cronstadt passe dans le camp de la contre-révolution ou soit même déjà une expression de la contre-révolution. Goldman répond correctement à ces deux aspects. Dans son autobiographie datant de 1931, elle n'est cependant pas en mesure de tirer la leçon la plus importante de la tragédie de Cronstadt, comme d'ailleurs l'ensemble de la Gauche marxiste au moment de la répression qu'elle soutint généralement, à l'exception notable toutefois de Miasnikov qui s'y opposa dès le début. Même avec le recul du temps, elle ne sera pas en mesure de comprendre, contrairement à certains courants de la Gauche communiste, que la violence au sein de la classe ouvrière doit être inflexiblement rejetée et que ceci doit représenter un principe. [38]
Comme pour la question de l'État, Goldman tombe beaucoup trop dans la facilité sur la question du prétendu "jésuitisme des bolcheviks depuis le début". Elle déclare les bolcheviks jésuites, ce qui est en totale contradiction avec leur histoire. Le dynamisme de la majorité des bolcheviks, qui n'ont pas hésité à utiliser la violence à Cronstadt en 1921 comme moyen présumé de lutte de classe, n'était nullement "leur tradition" mais plutôt, comme on l'a vu l'expression de leur processus de dégénérescence progressive.
Au lieu d'examiner fondamentalement la question à laquelle tous les révolutionnaires sans exception faisaient face, à savoir quels moyens peuvent être utilisés dans la lutte de classe et dans la révolution, l'étiquette de "jésuite" que Goldman attribua à la légère aux bolcheviks, était plutôt un obstacle à la compréhension de la dégénérescence de la révolution en tant que processus.
Le silence ou la critique?
Une question traverse comme un fil rouge les écrits de Goldman sur la Russie : quand était-il justifié de formuler une critique ouverte à l'égard des bolcheviks ? Elle décrit avec une grande indignation une rencontre avec des anarchistes à Petrograd :
"Ces charges et ces dénonciations tombaient sur moi comme des coups de marteau et me mettaient groggy. J’écoutais, toute tendue nerveusement, à peine capable de comprendre clairement ce que j’entendais, et ne réussissant pas à saisir tout ce que çà signifiait. Ce ne pouvait être vrai – cette accusation monstrueuse (…). Les hommes dans cette salle lugubre devaient être fous, pensais-je, pour raconter des histoires aussi impossibles et absurdes, iniques pour condamner les communistes pour les crimes dont ils devaient savoir qu’ils étaient dus au gang contre-révolutionnaire, au blocus et aux généraux blancs qui attaquaient la révolution. J’affirmais ma conviction dans la discussion, mais ma voix était noyée sous les ricanements de dérision et les sarcasmes."[39]
Comme pour la question des changements à attendre immédiatement après la révolution, la consternation de Goldman face aux positions des autres anarchistes montre que l'anarchisme était tout sauf homogène, surtout en ce qui concerne l'attitude envers les bolcheviks. L'anarchisme en Russie s'était à nouveau divisé en différents camps[40]. Les passages suivants des écrits de Goldman témoignent une fois de plus de son attitude responsable de ne pas passer sous silence ses propres incertitudes, mais ils montrent aussi l'évolution de son attitude envers les bolcheviks :
"Combien je pouvais comprendre l'attitude de mes amis ukrainiens! Ils avaient énormément souffert ces dernières années : ils avaient vu les grands espoirs de la Révolution écrasés et la Russie détruite sous le talon de l'État bolchevique. Pourtant, je ne pouvais exaucer leurs vœux. J'avais toujours foi dans les bolcheviks, dans leur sincérité révolutionnaire et leur intégrité. De plus, j'estimais que, tant que la Russie était attaquée de l'extérieur, je ne pouvais pas m'exprimer par la critique. Je n'ajouterais de l’essence à jeter sur les feux de la contre-révolution. Je devais donc garder le silence, et me tenir aux côtés des bolcheviks en tant que défenseurs organisés de la Révolution. Mais mes amis russes méprisaient ce point de vue. Je confondais le Parti communiste avec la Révolution, disaient-ils ; ils n’avaient pas le même état d’esprit ; au contraire, ils y étaient opposés, même comme face à des ennemis."[41]
"Aux premières nouvelles de la guerre avec la Pologne, j’ai mis de côté mon attitude critique et offert mes services comme infirmière au front (…). Mais il (Sorin) n’a jamais transmis ma demande. Bien entendu, cela n'a aucune incidence sur ma détermination à aider le pays, à quelque titre que ce soit. Rien ne semblait aussi important juste alors (…) Je ne niais pas les services rendus par Makhno à la révolution, dans la lutte contre les armées blanches, ni le fait que son armée dissidente était un mouvement de masse spontané des travailleurs. Je ne pensais pas, cependant, que les anarchistes avaient quelque chose à gagner en déployant une activité militaire ou que notre propagande dépendait de conquête politique ou militaire propre. Mais c’était à côté de la plaque. Je n’étais pas en position de me joindre à leur travail, et ce n’était plus non plus une question de bolcheviks. J’étais prête à admettre franchement que je m’étais gravement trompée quand j’avais défendu Lénine et son parti comme vrais champions de la révolution. Mais je ne voulais pas m’engager dans une opposition active contre eux tant que la Russie était encore attaquée par des ennemis extérieurs."[42]
"J'étais d'une manière accablante consciente de ma grand dette envers les ouvriers d'Europe et d'Amérique : je devrais leur dire la vérité sur la Russie. Mais comment m'exprimer au dehors, alors que le pays était encore assiégé sur plusieurs fronts ? Cela signifierait travailler pour la Pologne et pour Wrangel. Pour la première fois de ma vie, je m'abstenais d'exposer les graves maux sociaux dont j’étais témoin. C'était comme si je trahissais la confiance des masses, en particulier celle des ouvriers américains, dont j'estimais chèrement la foi."[43]
"J’ai trouvé nécessaire de garder le silence tant que les forces impérialistes coalisées se jetaient à la gorge de la Russie (…) Maintenant, cependant, le temps du silence est révolu. Cela signifie donc que je raconte mon histoire. Je ne suis pas ignorante des difficultés auxquelles je vais me confronter. Je sais que je serai déformée par les réactionnaires, les ennemis de la Révolution russe, et aussi bien excommuniée par ses soi-disant amis, qui persistent à confondre le parti au gouvernement de la Russie avec la Révolution. Il est donc nécessaire que j’établisse clairement ma position vis-à-vis des deux."[44]
D'autres révolutionnaires à l'époque, comme Rosa Luxemburg, ont très tôt formulé des critiques envers les bolcheviks, même s'ils exprimaient à ces derniers toute leur solidarité et défendaient le rôle décisif qu'ils avaient joué dans la Révolution russe. Rosa Luxemburg a écrit sa brochure - La Révolution russe - en 1918 au même moment où Goldman publiait l'article "La Vérité sur les Bolcheviks" dans Mother Earth avec un enthousiasme exubérant. L'exemple de Rosa Luxemburg montre combien il était difficile de prendre la décision de publier ses propres critiques au bon moment, et toujours avec la préoccupation de ne pas porter un coup à la révolution. Dans son texte écrit dans la prison de Moabit, Luxemburg a exprimé une critique à l'égard des bolcheviks où il s'agissait, par la clarification des problèmes posés en Russie, de leur apporter un soutien solidaire : "Lénine-Trotski se prononcent au contraire pour la dictature d'une poignée de personnes, c'est-à-dire pour la dictature selon le modèle bourgeois. (...) Mais cette dictature doit être l'œuvre de la classe et non d'une petite minorité dirigeante, au nom de la classe, autrement dit, elle doit sortir pas à pas de la participation active des masses, être sous leur influence directe, soumise au contrôle de l'opinion publique, produit de l'éducation politique croissante des masses populaires. Et c'est certainement ainsi que procéderaient les bolcheviks, s'ils ne subissaient pas l'effroyable pression de la guerre mondiale, de l'occupation allemande, de toutes les difficultés énormes qui s'y rattachent, qui doivent nécessairement défigurer toute politique socialiste animée des meilleures intentions et s'inspirant des plus beaux principes. (...) Le danger commence là où, faisant de nécessité vertu, ils créent une théorie de la tactique que leur ont imposée ces conditions fatales, et veulent la recommander au prolétariat international comme le modèle de la tactique socialiste." (La Révolution russe [663])
Luxemburg ne s'est pas abstenue de la critique. Pourquoi Goldman n'a-t-elle pas suivi l'exemple de Rosa Luxemburg alors que, dans ses écrits, elle a à plusieurs reprises exprimé sa tristesse suite à l'assassinat de Luxemburg en janvier 1919 dont elle connaissait les positions ? Pourquoi dans sa brochure Le déclin de la Révolution russe n'a-t-elle jamais fait référence à la critique de Luxemburg, écrite trois ans auparavant ? La raison en est simple : elle ne la connaissait pas. En effet, le texte de Luxemburg a été victime de l'énorme peur de "poignarder la révolution dans le dos" et de faire le jeu de la bourgeoisie en émettant des critiques. La publication de la critique des bolcheviks de Luxemburg, qu'elle voulait divulguer immédiatement après sa rédaction, a été délibérément empêchée par ses amis politiques les plus proches et n'a eu lieu que quatre ans plus tard, en 1922. [45]
Malheureusement, Goldman n'a donc pas eu l'occasion de s'inspirer de la critique de Luxemburg à l'égard des bolcheviks. Son emballement à l'arrivée en Russie est compréhensible au vu des horreurs dans lesquelles la Guerre mondiale avait plongé l'humanité. La Russie soviétique! Terre sacrée de Goldman et sa totale désillusion ultérieure est aussi un exemple que l'euphorie est la plupart du temps condamnée à une grande déception. Il n'est pas surprenant que 13 ans plus tard, elle récuse comme "naïve" sa défense initiale des bolcheviks.
Luxemburg ne fut jamais encline à l'emballement politique et formula sa critique sur la base des premières expériences des mois qui ont suivi Octobre 1917, concluant par les fameux mots que l'avenir appartient au bolchevisme. Goldman a écrit sa critique trois ans plus tard, en se basant sur sa propre expérience relative à une phase ultérieure de la révolution en Russie, après que les conseils ouvriers eussent été dépossédés de leur pouvoir, à l'époque du déchainement de la violence de la Tcheka et de l'identification inéluctable du parti bolchevique avec l'appareil d'État. Néanmoins, elle nourrissait de grands espoirs : "Lénine et ses disciples sentent le danger. Leurs attaques contre l'opposition ouvrière et la persécution des anarcho-syndicalistes continuent d'augmenter fortement et avec force. L'étoile de l'anarcho-syndicalisme s'élèvera-t-elle vers l'Est ? Qui sait ?, la Russie est la terre des miracles."[46] Quelle aurait été l'analyse de Luxemburg à la fin de 1921, après l'irruption d'une dégénérescence manifeste et après Cronstadt ? Malheureusement, cela ne peut que demeurer qu'à l'état d'hypothèse.
Goldman oscillait entre le silence et son "Je dois élever la voix contre les crimes perpétrés au nom de la révolution". Mais comment cela devait-il se produire ? Au cours de son séjour en Russie, le journal bourgeois World de New York lui a demandé à plusieurs reprises de publier des articles sur la Russie. Goldman refusa d'abord, après de dures discussions avec Berkman, qui était strictement contre une telle démarche, avec l'argument que tout ce qui était publié dans la presse bourgeoise ne pouvait qu'être au service de la contre-révolution et proposait de produire ses propres tracts pour les distribuer aux ouvriers. Quelques semaines après que Goldman eut quitté la Russie à la fin de 1921, elle permit à World de publier ses textes.
"J'écris que je préfère exprimer mon opinion dans la presse ouvrière libérale des États-Unis et serais plus encline à donner mes articles gratuitement que de les laisser au New York World ou à des publications similaires. (....) Alors que je connaissais la vérité, devais-je la supprimer et me taire ? Non, j'ai dû protester, j'ai dû crier qu'une énorme fraude prétendait au droit d'être une vérité, même si cela devait être dans la presse bourgeoise."[47]
Si Goldman a hésité pendant des mois en Russie à rendre publiques ses critiques parce qu'elle ne voulait pas "poignarder la révolution dans le dos". Et à cause de cette décision irréfléchie, on lui jeta la pierre de différentes parts : "Mes accusateurs communistes n’étaient pas les seuls à crier: "Crucifiez!" Il y avait aussi des voix anarchistes dans le chœur. Ce sont les mêmes personnes qui m'avaient combattue à Ellis Island, à Buford et pendant la première année en Russie, parce que j'avais refusé de condamner les bolcheviks jusqu'à ce que j'aie l'occasion d’expérimenter leur projet. Quotidiennement, les nouvelles de Russie sur la persécution politique continue renforçaient chaque fait que j’avais décrit dans mes articles et mes livres. Il était compréhensible que les communistes aient fermé les yeux sur la réalité, mais de la part de ceux qui se disaient anarchistes, c'était méprisable, surtout après le traitement que Mollie Steimer avait subi en Russie après avoir si courageusement défendu le régime des Soviets en Amérique".[48]
L'accusation de traitrise de la part de certaines parties du mouvement ouvrier américain a en grande partie privé son analyse et ses réflexions de l'attention et la reconnaissance qu'elles méritaient. Mais dans un monde où deux classes se font face de façon absolument antagoniste, c'est un acte désespéré, qu'elle critique elle-même et explique par le fait qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'est en effet extrêmement dangereux que de vouloir utiliser un instrument de la bourgeoisie, quel qu'il soit, même ponctuellement, comme moyen pour faire entendre la parole de la classe ouvrière. Quel dommage qu'une aussi ferme militante soit tombée dans ce piège !
Ce que Goldman et Rosa Luxemburg ont en commun, c'est sans aucun doute l'énorme volonté de comprendre les problèmes de la Révolution russe, de défendre le caractère révolutionnaire d'Octobre 1917 et de ne pas céder sans critique à la situation dramatique. Goldman n'a jamais accepté la méthode tactique de considérer les bolcheviks simplement comme un "moindre mal" pour ne les soutenir seulement que tant que durerait la guerre contre les armées blanches. Une position ouvertement défendue en Russie par l'anarchiste Machajaski dans la revue The workers revolution.
Exprimer une critique ouverte à la politique des bolcheviks était dès le départ moins risqué en dehors de la Russie qu'en Russie même. Mais les doutes de Goldman ne découlaient pas de la peur ou de mesures répressives à son encontre. En raison de son statut de révolutionnaire américaine bien connue, elle bénéficiait d'une protection beaucoup plus grande que d'autres immigrants révolutionnaires. Même si elle n'a pas caché sa sympathie à l'Opposition Ouvrière et s'est engagée en faveur des anarchistes incarcérés (par exemple lors de sa prise de parole aux funérailles de Kropotkine), elle n'a été mise que sous surveillance "douce" par la Tcheka, afin de l'intimider.
Ses critiques auraient-elles détruit l'exemple lumineux de la Révolution d'Octobre au sein de la classe ouvrière internationale ? Certainement pas. L'alternative ne se posait pas dans les termes "soit se taire, soit dénoncer les bolcheviks". Une critique politique mature de la politique bolchévique de l'époque constituait alors au contraire un soutien à l'ensemble de la vague révolutionnaire internationale. La classe ouvrière est la classe de la conscience, et non de l'action irréfléchie. Par conséquent, la critique de ses propres actions et des erreurs commises est un héritage du mouvement ouvrier, qui devait être maintenu, même en des temps aussi dramatiques. Cela ne fait pas partie de la nature de la classe ouvrière que de dissimuler ses problèmes, contrairement à la bourgeoisie. Comme le montre le texte de Luxemburg, la critique des bolcheviks ne doit pas se limiter à l'indignation mais aussi faire preuve de maturité en vue de soutenir la lutte contre la dégénérescence de la révolution. Ce fut ultérieurement l'un des critères de la Gauche Communiste italienne que de s'abstenir d'exprimer des analyses et des critiques hâtives ne permettant pas de tirer des leçons.
L'analyse de Goldman sur la Révolution russe allait au-delà de la simple indignation. Mais à différents endroits, avec sa caractérisation de Lénine et de Trotski comme de "rusés jésuites ", elle manifeste un glissement dans une méthode de critique qui se fixe sur des personnes charismatiques, laquelle ne saurait être justifiée par la grande influence que celles-ci avaient sur la politique des bolcheviks. Lénine ne personnifie pas la dévitalisation des Conseils et leur fusion avec l'État, pas plus que Trotski ne personnifie l'écrasement de Cronstadt.
Goldman développa plus tard la position vis-à-vis de Trotski selon laquelle ses actes - en particulier Cronstadt - auraient fait de lui un pionnier du stalinisme.[49] L'usage de la violence, qu'il avait assumée en tant que commandant de l'Armée rouge à Cronstadt, ne relevait pas de penchants personnels mais de la mise en œuvre d'une décision par le pouvoir bolchevique comme un tout et, rappelons-le à nouveau, soutenue à l'époque par presque toute la gauche marxiste. L'erreur tragique de Cronstadt est l'illustration à la fois d'une immaturité du mouvement ouvrier sur la question de la violence (pas de violence au sein de la classe ouvrière) et du cours dégénérescent de la révolution en Russie, qui aboutira plus tard à la politique ouvertement contre-révolutionnaire du socialisme en un seul pays et à l'avènement de Staline comme chef de file de la contre-révolution mondiale. Quelles qu'aient été les insuffisances de la dénonciation politique par Trotsky du stalinisme et de son appareil de répression organisé, visant l'écrasement physique et idéologique complet de la classe ouvrière, elle a néanmoins exprimé une réaction prolétarienne face à ceux-ci.
La valeur de l'analyse de Goldman réside dans le fait d'avoir soulevé les questions centrales face auxquelles se trouvait la Révolution russe. Les contradictions dans son analyse et ses conclusions que nous ne partageons absolument pas ne sont pas une raison de rejeter en bloc ses efforts ou de les ignorer. Au contraire, elles sont l'expression de l'énorme difficulté de produire une analyse complète du problème russe dès 1922. Elle n'était pas seule dans ce cas. Il lui revient le mérite d'avoir rejeté la fusion avec l'appareil d'État, la prise du pouvoir par le parti ou la répression de Cronstadt.
En ce sens, elle a apporté une importante contribution à la classe ouvrière, ce qui doit être salué mais aussi critiqué. Goldman n'a jamais prétendu qu'Octobre 1917 était la naissance du stalinisme ultérieur, comme le font encore aujourd'hui les campagnes mensongères de la classe dirigeante, mais a obstinément défendu la Révolution d'Octobre.
Mario (7.1.2018)
[1] Le déclin de la Révolution russe (1922), sa première et plus complète analyse ; Ma désillusion en Russie (1923/24) ; Gelebtes Leben [Living my life] (1931), chapitre 52.
[2] C'est un sujet qui la préoccupait beaucoup, ce qui se comprend vu que la situation des enfants était catastrophique. Dans cette situation de misère généralisée, ayant perdu un parent ou les deux, à la guerre souvent, ils étaient les plus vulnérables en particulier face aux petits bureaucrates déshumanisés sans scrupules ni morale. Peut-être était-elle plus sensible à cette situation alors qu'elle-même était infirmière et qu'elle avait eu l'occasion de visiter des institutions "modèles" pour enfants.
[3] Ma désillusion en Russie [737].
[4] La vérité sur les bolcheviks [738], traduit par Yves Coleman pour la revue "Sans patrie ni frontières" n°1 - Septembre-Octobre 2002.
[5] L'Epopée d'une anarchiste, Ed. Complexe, p. 211.
[6] L'Epopée d'une anarchiste, ibid, p. 298.
[7] Ma désillusion en Russie [737].
[8] Préface, Le déclin de la Révolution russe.
[9] Der Niedergang der Russischen Revolution, Kapitel Die Lage des Kindes in Russland.
[10] Titre du célèbre livre de Nicolas Gogol de 1842. Les méthodes et le parasitisme de la bureaucratie étatique sont la copie conforme de certaines techniques d'enrichissement personnel sous le féodalisme.
[11] Voir notre article : La dégénérescence de la révolution russe [739].
[12] Le déclin de la Révolution russe, chapitre "Les forces qui ont réprimé la révolution".
[13] Voline (W.M. Eichenbaum) La Révolution inconnue, chapitre "La Contre-révolution". Voline va même jusqu' à prétendre que l'intervention internationale contre la Russie a été la plupart du temps présentée de façon exagérée et transformée en légende colportée par les bolcheviks de par le monde.
[14] Voire à ce sujet notre article, dans cette même Revue internationale n°160 "La bourgeoisie mondiale contre la révolution d’Octobre [740]".
[15] Le déclin de la révolution russe, chapitre "Les forces qui ont réprimé la révolution".
[16] L'Epopée d'une anarchiste, Ed. Complexe, p. 221.
[17] L'Epopée d'une anarchiste, Ed. Complexe, p.217.
[18] Nous pensons également que, sur ce plan, les possibilités sont effectivement limitées même si certaines mesures doivent être mises en œuvre immédiatement et avec détermination après la prise de pouvoir par les conseils ouvriers. Comme par exemple, l'interdiction du travail des enfants et de toute forme de travail forcé ou de prostitution. La période de transition couvre l'ensemble de la période depuis la prise de pouvoir par les conseils ouvriers jusqu'à l'extinction de l'État. Durant cette période un ensemble de mesures devront être prises en vue de supprimer les rémunérations salariales et leur forme argent, de socialiser la consommation et la satisfaction des besoins (transports, loisirs, repos, etc.). Lire à ce propos notre article Problèmes de la période de transition [741] dans la Revue internationale n° 1. Bien que les mesures à prendre immédiatement après la révolution soient nécessairement limitées certaines doivent cependant être prises immédiatement et avec détermination. Par exemple le transport gratuit, le logement immédiat des personnes sans domicile dans des bâtiments publics inutiles ou de riches demeures, etc.... Mais également l'interdiction du travail des enfants et de toute forme de travail forcé ou de prostitution.
[19] Le déclin de la révolution russe, chapitre "Ma visite à Pierre Kropotkine".
[20] Le déclin de la révolution russe, chapitre "Les syndicats en Russie".
[21] Le déclin de la Révolution russe, chapitre "La situation de l'enfant en Russie".
[22] Ma désillusion en Russie [737], chapitre "Une autre visite à Peter Kropotkin".
[23] Ma désillusion en Russie [737], Postface.
[24] Le déclin de la Révolution russe, Introduction.
[25] Idem, chapitre "Les forces qui ont vaincu la révolution".
[26] Octobre n°2, mars 1938, "La question de l'État"
[27] Rudolf Rocker, Über das Wesen des Föderalismus im Gegensatz zum Zentralismus, 1922.
[28]Goldman décrit très bien la Tcheka avec les mots suivants : "À l’origine, la Tcheka était contrôlée par le commissariat à l’Intérieur, les Soviets et le comité central du Parti Communiste. Graduellement, elle devint l’organisation la plus puissante en Russie. Ce n’était pas simplement un État dans l’État, c’était un État au-dessus de l’État. L’ensemble de la Russie était couvert, jusqu’au village le plus reculé, par un réseau de tchekas". Le déclin de la Révolution russe ; "la Tcheka".
[29] Ma désillusion en Russie [737].
[30] Voir notre brochure La période de transition. [742]
[31] Le déclin de la Révolution russe, chapitres "Les forces qui ont réprimé la révolution" et "Les Soviets". L'ordre des Jésuites est généralement utilisé comme symbole d'une politique obsédée par le pouvoir et impitoyable suivant la devise "La fin justifie les moyens".
[32] Living my life, chapitre 52.
[33] Idem.
[34] Voir notre article Terreur, terrorisme et violence de classe [743]. Revue internationale n° 15.
[35] Voline est même allé jusqu'à qualifier Lénine et Trotski de réformistes brutaux qui n'avaient jamais été révolutionnaires et qui utilisaient des méthodes bourgeoises. La Révolution Inconnue, Chapitres "L'État bolchevik" et "La contre-révolution".
[36] Cette question est traitée en détail dans le livre La face morale de la révolution (1923), écrit par le Commissaire du Peuple à la Justice jusqu'en mars 1918, Isaak Steinberg.
[37] Ma désillusion en Russie, chapitre "Cronstadt".
[38] Voir à ce propos: 1921 Comprendre Cronstadt [133], Revue Internationale n° 104.
[39] Living my life, chapitre 52.
[40] Au printemps 1918, la question des relations avec les bolcheviks a fortement polarisé le milieu anarchiste (déjà historiquement divisé en pan-anarchistes, anarchistes individualistes, anarcho-syndicalistes et anarcho-communistes, dont les démarcations sont également difficiles à définir). La question de la violence ou l'analyse du caractère de la Révolution d'Octobre y ont joué un rôle secondaire. Du soutien ouvert apporté aux bolcheviks (de la part des "anarchistes de soviets") à l'idée des bolcheviks traîtres à la révolution qu'il faut combattre par la force, on trouvait toutes sortes de positions intermédiaires. Voir Paul Avrich : Les Anarchistes russes, éd. Maspéro (1979), chapitre "Les Anarchistes et le régime bolchevique".
[41] Ma désillusion en Russie, chapitre "Dans Charkov".
[42] Living my life, chapitre 52.
[43] Ma désillusion en Russie, chapitre "De retour à Petrograd".
[44] Der Niedergang der Russischen Revolution, Préface.
[45] Paul Frölich, l'un de ses compagnons politiques, décrit dans la biographie qu'il consacre à Luxembourg Gedanke und Tat de 1939 ce légendaire déroulement des faits : "C'est Paul Levi qui publia "La Révolution russe" au cours de l'année 1922 (donc après la brochure de Goldman) après avoir rompu avec le KPD. Levi affirma que Leo Jogiches (qui s'était opposé à la publication, avec l'argument qu'entre-temps Luxembourg avait changé d'avis) avait détruit le manuscrit. J.P. Nettl affirme de manière crédible que c'est Levi lui-même qui a exercé de fortes pressions sur Luxembourg pour qu'elle ne publie pas le texte, avec l'argument que la bourgeoisie allait en abuser contre les bolcheviks. Il est clair que le texte de Luxemburg n'a pas sombré accidentellement dans la tourmente de la révolution en Allemagne, mais au contraire a été évité dans la "tourmente de la confusion" sur la nécessité d'une critique ouverte !"
[46] Le déclin de la Révolution russe, chapitre "Les syndicats en Russie".
[47] Living my life, chapitre 49.
[48] Ibid., chapitre 54.
[49]Trotski proteste beaucoup trop, juillet 1938.
Personnages:
- Voline [744]
- Lounacharski [745]
- Gorki [746]
- Rudolf Rocker [747]
- Kollontaï [748]
- Chliapnikov [749]
- Berkman [750]
- Fanny Kaplan [751]
- Fanya Baron [752]
- Perkus [753]
- Pertrowski [754]
- Sorin [755]
- Makhno [756]
- Wrangel [757]
- Rosa Luxemburg [451]
- Lénine [729]
- Mollie Steimer [758]
- Machajaski [759]
- Trotski [760]
- Pierre Kropotkine [761]
- Paul Frölich [762]
- Paul Levi [763]
- J.P. Nettl [764]
Rubrique:
Revue Internationale n°161
- 199 lectures
Présentation de la Revue n° 161
- 140 lectures
Il y cent ans, nous étions au cœur de la vague révolutionnaire mondiale, plus précisément de la révolution en Allemagne, un an après la prise du pouvoir politique par le prolétariat en Russie, en octobre 1917. De la même manière que nous avons salué ce dernier évènement dans notre presse en lui dédiant un Manifeste[1], nous voulons attirer l'attention de nos lecteurs sur la révolution en Allemagne, au sujet de laquelle nous publions un article dans ce numéro de la Revue internationale, "Révolution en Allemagne : il y a 100 ans, le prolétariat faisait trembler la bourgeoisie". À son tour, cette fraction du prolétariat mondial s'élançait à l'assaut du ciel, lavant dans sa lutte de classe solidaire et héroïque les souillures et infamies de la boucherie impérialiste, pour en finir avec la barbarie capitaliste. Comme en Russie, elle avait fait surgir des conseils ouvriers, organes d'unification de tous les ouvriers et de la future prise du pouvoir politique. Alors qu'elle éclate dans le pays le plus industrialisé du monde capitaliste, avec la classe ouvrière la plus nombreuse, la révolution en Allemagne constitue potentiellement une possibilité de rompre l'isolement du pouvoir prolétarien en Russie et d'extension de la révolution à l'Europe. La bourgeoisie ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle met fin à la guerre impérialiste en signant l'armistice du 11 novembre 1918 alors que, justement, la poursuite de celle-ci constituait un facteur de radicalisation des masses, de démystification de toutes les fractions de la bourgeoisie, les plus "à gauche" en particulier, comme cela avait été les cas en Russie dans les mois qui suivirent la révolution de février 1917. De plus, alors que la plupart des fractions de droite de l'appareil d'État étaient en pleine dislocation du fait du désastre militaire, la bourgeoisie allemande a su tout miser sur la social-démocratie traître pour affaiblir et écraser la révolution et la classe ouvrière en Allemagne. C'est un enseignement fondamental pour la révolution du futur, laquelle trouvera sur son chemin toutes les fractions de la gauche et de l'extrême gauche du capital qui feront tout pour défaire le prolétariat. Le CCI a dédié de nombreux articles à la révolution en Allemagne dont deux séries que nous recommandons à nos lecteurs[2].
L'échec de la révolution en Allemagne signait celui de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elle ouvrait une profonde période de contre-révolution, laissant libre cours au déchainement de la barbarie capitaliste, avec en particulier la Deuxième Guerre mondiale qui a battu tous les sinistres records de barbarie de la Première Guerre. Mais à la différence de celle-ci, le prolétariat, écrasé physiquement et idéologiquement, n'a pas été capable de se manifester sur son terrain de classe à travers des soulèvements révolutionnaires. Si bien que le recul dans sa conscience s'est encore approfondi durant deux décennies, jusqu'à ce que les évènements de Mai 1968 viennent témoigner d'une modification profonde de l'ambiance sociale. De nouvelles générations de prolétaires, n'ayant pas comme leurs aînés été exposées au rouleau-compresseur de la contre-révolution et aiguillonnées par les premières manifestations de la crise ouverte du capitaliste, n'hésitaient pas à remettre en cause l'encadrement des luttes par les partis staliniens et les syndicats. Ainsi, le prolétariat reprenait enfin le chemin du développement de sa lutte et de sa conscience. Dans ce numéro, nous publions un article "À propos de nos réunions publiques sur le cinquantenaire de Mai 68, Mai 68 a-t-il vraiment signifié la fin de près d'un demi-siècle de contre-révolution ?" au sein duquel nous argumentons notre réponse affirmative à la question posée. L'écriture de cet article avait plus particulièrement été motivée par une double difficulté que nous avons pu constater chez beaucoup de participants aux réunions publiques du CCI sur le cinquantenaire de Mai 1968. D'une part, "la connaissance insuffisante de ce qu'a été la période de contre-révolution mondiale ouverte avec la défaite de la première vague révolutionnaire, et de ce fait une difficulté à saisir vraiment ce que veut dire une telle période pour la classe ouvrière et sa lutte". D'autre part, une difficulté à appréhender la dynamique d'ensemble de la période ouverte avec Mai 68, du fait de manifestations bien réelles de la barbarie capitaliste et de la décomposition de cette société, qui parfois rendent plus difficiles de saisir la persistance de la lutte de classe et les possibilités futures de son développement.
En fait, avec cette Revue, nous poursuivons un travail de bilan de l'évolution de la société depuis Mai 1968, initié dans le numéro précédent et au sein duquel nous avons publié un article faisant le point sur l'évolution et l'aggravation de la crise économique depuis 1968, "Cinquante ans depuis Mai 1968, l'enfoncement dans la crise économique". Comme nous l’avions souligné en conclusion de cet article, "C’est une chose de montrer que nous avions raison de prévoir la réapparition de la crise économique ouverte en 1969, et de donner un cadre pour expliquer pourquoi cette crise serait une affaire au long cours. C’est une tâche plus difficile de montrer que notre prédiction d’une reprise de la lutte de classe internationale s’est aussi confirmée." C'est à cette tâche qu'est consacré le deuxième article de la série "Cinquante ans depuis Mai 1968, les avancées et les reculs de la lutte de classe", publié dans ce numéro. Pour la période allant de 1968 à la fin des années 1980, concernant l'évolution du rapport de force entre les classes, l'article met en évidence "20 ans de lutte qui avaient empêché la marche à la guerre, et qui d’ailleurs avaient vu des développements importants de la conscience de classe", mais qui n'avaient cependant pas permis à la classe ouvrière de "développer la perspective de la révolution, de poser sa propre alternative politique à la crise du système". Durant ces vingt années, "La bourgeoisie n’avait pas infligé une défaite historique décisive à la classe ouvrière, et n’était pas capable de la mobiliser pour une nouvelle guerre mondiale". Il en est résulté une sorte de blocage historique entre les classes où, privé de toute issue mais toujours enfoncé dans une crise économique de longue durée, le capitalisme commençait à pourrir sur pied, et cette pourriture affectait la société capitaliste à tous les niveaux. Ce diagnostic avait été puissamment confirmé par l’effondrement du bloc de l’Est qui, en retour, avait considérablement accéléré le processus de décomposition à l’échelle mondiale.
Dans son sillage, les campagnes de la bourgeoisie mondiale sur la mort du communisme, sur l’impossibilité pour la classe ouvrière de proposer une alternative viable au capitalisme, ont porté d’autres coups à la capacité de la classe ouvrière internationale – en particulier dans les pays centraux du système – à engendrer une perspective politique. Si bien qu'il en a résulté une situation de profond recul de la lutte de classe. Dans les trois dernières décennies, le recul de la conscience dans la classe ouvrière n’a pas seulement continué, mais s’est approfondi, causant une espèce d’amnésie vis-à-vis des acquis et des avancées de la période 1968-1989, alors que l'ambiance sociale de décomposition et d'extension de la barbarie guerrière sur la planète constitue un contexte très défavorable. Les périls pour l'humanité n'ont jamais été aussi grands : "Le déclin du capitalisme et la décomposition amplifient certainement la menace que la base objective d’une nouvelle société puisse être définitivement détruite si la décomposition avance au-delà d’un certain point". Il faut leur faire face lucidement : "Nous devons faire face à la réalité de toutes ces difficultés et en dégager les conséquences politiques pour la lutte pour changer la société." La classe ouvrière n'a pas dit son dernier mot : "Mais, dans notre vision, alors que le prolétariat ne peut éviter la dure école des défaites, les difficultés croissantes et même des défaites partielles ne sont pas encore parvenus au point de signifier une défaite historique de la classe et la disparition de la possibilité du communisme … même dans sa dernière phase, le capitalisme produit encore les forces qui peuvent être employées pour le renverser . Dans les termes du Manifeste Communiste de 1848, "ce que produit, par-dessus tout, la bourgeoisie, c’est son propre fossoyeur"".
Dans le cadre de notre suivi de l'évolution des tensions impérialistes, nous publions un rapport sur la situation impérialiste adopté en juin 2018. Depuis lors, les évènements ont très clairement confirmé une idée principale de ce rapport, à savoir que les États-Unis sont devenus le principal propagateur de la tendance au "chacun pour soi" au niveau mondial, au point de détruire les instruments de son propre "ordre mondial". Une expression en a été la visite de Trump en Europe, pour le sommet de l'OTAN en juin 2018[3]. À cette occasion, il a proféré des menaces le mettant en conflit direct avec ceux qui, jusqu’à présent, ont défendu les intérêts impérialistes mondiaux du capital américain. En effet, selon les menaces en question, si les "alliés" européens n’augmentaient pas leurs budgets militaires en fonction des exigences américaines, les États-Unis pourraient faire cavalier seul, voire quitter l’OTAN. Dans le même temps, les résultats du sommet de l’OTAN n’ont pu que renforcer la détermination des pays membres européens à augmenter leurs dépenses militaires et … à gagner plus de marge de manœuvre en dehors de la zone de contrôle des États-Unis. Les ultimatums de Trump ont été un prétexte bienvenu pour accélérer ce processus, renforçant les ambitions européennes de développer de nouvelles structures militaires au sein de l’UE ou à l’extérieur, en particulier entre la France et l’Allemagne, mais aussi avec le Royaume-Uni (indépendamment du Brexit). Dans ce même rapport, nous écrivons également à propos des États-Unis : "Leur alliance apparemment paradoxale avec Israël et l’Arabie Saoudite conduit à une nouvelle configuration des forces au Moyen-Orient (avec un rapprochement croissant entre la Turquie, l’Iran et la Russie) et accroît le danger d’une déstabilisation générale de la région, d’affrontements plus nombreux entre les principaux requins et de guerres sanglantes plus étendues". C'est ce que vient de confirmer avec éclat la crise ouverte par l'assassinat dans le consulat saoudien à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Français, Allemands, Américains, tous mettant un "empressement" très différent à soutenir Ankara, ajusté à leurs propres intérêts impérialistes et économiques immédiats. De même, "la montée des leaders forts et de la rhétorique belliqueuse" dont il est question dans ce rapport a également connu une nouvelle expression dans l'élection récente d'un président d'extrême-droite, Bolsonaro, lors des récentes présidentielles au Brésil.
Nous republions l'article "Salut à Socialisme ou Barbarie" venant du n° 43, juin / juillet 1949 d'Internationalisme, qui est la prise de position de ce groupe face au premier numéro de la revue Socialisme ou Barbarie. Cette publication est effectuée dans le cadre de la première partie d'un article de notre revue, "Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme" de la série "Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire". En fait, la Fraction française de la Gauche Communiste Internationale, et par la suite la Gauche Communiste de France, étaient vivement intéressées à discuter avec tous les groupes prolétariens internationalistes qui avaient survécu à la guerre. En dépit de sa caractérisation du trotskisme officiel comme appendice du stalinisme, Internationalisme était ouvert à la possibilité que des groupes émergeant du trotskisme - à condition qu'ils aient rompu totalement avec ses positions et pratiques contre-révolutionnaires (abandon de l'internationalisme mais aussi parce que sa vision de la transformation sociale demeurait fermement dans les limites du capitalisme) pouvaient évoluer dans une direction positive.
Cet article d'Internationalisme est un bon exemple de la méthode employée par la GCF dans ses relations avec les rescapés du naufrage du trotskisme dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale : un accueil fraternel envers un nouveau groupe que la GCF reconnaît comme appartenant clairement au camp révolutionnaire, en dépit des nombreuses différences dans la méthode et la vision des deux groupes. Mais sans illusion et avec la claire conscience que le lourd héritage du trotskisme continuerait de peser négativement pendant très longtemps sur les éléments concernés, et pourrait même être fatal si n'intervenait pas une remise en cause profonde de leurs origines. Cette démarche, qui demeure tout à fait valable aujourd'hui, est aussi celle du CCI. La deuxième partie de cet article peut déjà être lue sur notre site. Elle traite spécifiquement des cicatrices que laisse le trotskisme sur ceux qui, après l'avoir quitté, se situent véritablement du côté de la révolution prolétarienne, comme ce fut le cas pendant un certain temps seulement pour Castoriadis et toute sa vie, par la suite, pour Munis.
La rédaction (02 11 2018)
[1] "Manifeste du courant communiste international sur la révolution d’octobre 1917 en Russie", Revue internationale n° 159.
[2] "Il y a 90 ans, la révolution allemande" : série de 5 articles, dont le premier fut publié dans le n° 133 de la Revue et le dernier dans le n° 137 ; "Révolution allemande" : série de 13 articles, dont le premier fut publié dans le n° 81 de la Revue et le dernier dans le n° 99.
[3] À ce sujet, lire l'article de notre site "Trump en Europe : une expression du capitalisme dans la tourmente".
Révolution en Allemagne - Il y a 100 ans, le prolétariat faisait trembler la bourgeoisie
- 229 lectures
Un tel titre peut paraître bien curieux aujourd’hui tant cet immense événement historique est tombé totalement dans l’oubli. La bourgeoisie est parvenue à l’effacer de la mémoire ouvrière. Pourtant, en 1918, tous les regards sont bien tournés vers l’Allemagne, des regards emplis d’espoir pour le prolétariat, d’épouvante pour la bourgeoisie.
La classe ouvrière vient de prendre le pouvoir en Russie ; c’est Octobre 1917, les soviets, les bolcheviks, l’insurrection... Or, comme l’écrit Lénine : "La Révolution russe n'est qu’un détachement de l’armée socialiste mondiale, et le succès et le triomphe de la révolution que nous avons accomplie dépendent de l'action de cette armée. C’est un fait que personne parmi nous n'oublie (…). Le prolétariat russe a conscience de son isolement révolutionnaire, et il voit clairement que sa victoire a pour condition indispensable et prémisse fondamentale, l’intervention unie des ouvriers du monde entier." ("Rapport à la Conférence des comités d’usines de la province de Moscou", 23 juillet 1918).
L’Allemagne est le verrou entre l’Est et l’Ouest. Une révolution victorieuse ici, alors s’ouvre la porte de la lutte de classe au reste du vieux continent, l’embrasement révolutionnaire en Europe. Aucune des bourgeoisies ne veut voir ce verrou "tomber". C’est pour cela que la classe dominante va concentrer sur elle toute sa haine comme ses pièges les plus sophistiqués : la révolution du prolétariat en Allemagne était l’enjeu majeur pour la réussite ou l’échec de la révolution mondiale débutée en Russie.
La force de la classe ouvrière
1914. La guerre mondiale éclate. S’en suivent quatre années, durant lesquelles le prolétariat endure la pire boucherie de l’histoire de l’humanité : les tranchées, les gaz, la faim, les millions de morts... Quatre années durant lesquelles les syndicats et la social-démocratie profitent de leur glorieux passé prolétarien - qu'ils trahirent en 1914 en soutenant l'effort de guerre de la bourgeoisie - et de la confiance que leur accordent les ouvriers au nom de ce même passé pour leur imposer les pires sacrifices et justifier l’effort de guerre.
Mais durant ces quatre années, la classe ouvrière développe aussi peu à peu sa lutte. Dans toutes les villes, les grèves et les troubles dans l'armée ne cessent de se multiplier. Évidemment, en face, la bourgeoisie ne reste pas inerte, elle riposte même férocement. Les meneurs dans les usines, mouchardés par les syndicats, sont arrêtés. Des soldats sont exécutés pour indiscipline ou désertion.
1916. Le 1er mai, Karl Liebknecht scande : "A bas la guerre ! A bas le gouvernement !" Rosa Luxemburg est incarcérée, tout comme d'autres révolutionnaires : Meyer, Eberlein, Mehring[1] (alors âgé de 70 ans !). Karl Liebknecht[2] est envoyé sur le front. Mais cette répression ne suffit pas à faire taire le mécontentement… au contraire ! L’agitation gronde toujours plus dans les usines.
1917. Les syndicats sont de plus en plus critiqués. Apparaissent les Obleute, délégués d’usines, constitués essentiellement de délégués syndicaux de "base" ayant rompu avec les directions des centrales. Surtout les ouvriers en Allemagne sont inspirés par le courage de leurs frères de classe de l’Est, le souffle de la révolution d’Octobre se fait de plus en plus sentir.
1918. La bourgeoisie allemande est consciente du danger, elle sait que l’enlisement dans la guerre doit absolument cesser. Mais la partie la plus arriérée de la classe dominante, issue de l’aristocratie, et notamment l’aristocratie militaire, ne comprend pas la manœuvre et ses enjeux politiques, refusant tout accord de paix et toute défaite. Concrètement, en novembre, les officiers de la marine, basés à Kiel, refusent de se rendre sans combattre, préférant mourir "pour l’honneur"… avec leurs soldats bien évidemment ! Les marins se mutinent sur plusieurs navires, et sur plusieurs également flottent et sur plusieurs également flotte le drapeau rouge. Ordre est alors donné aux navires "non gangrenés" de tirer. Les mutins capitulent, refusant de retourner les armes contre leurs frères et sœurs de classe. Ils s’exposent ainsi à la sentence de mort. Par solidarité avec les condamnés, une vague de grève se propage, elle touche les marins puis les ouvriers de Kiel. S’inspirant de la révolution d’Octobre, la classe ouvrière prend ses luttes en main et crée les premiers conseils de marins et d’ouvriers. La bourgeoisie en appelle alors à l’un de ses chiens de garde les plus fidèles : la social-démocratie. Ainsi, Gustav Noske, dirigeant du SPD, spécialiste de la question militaire et du "maintien du moral des troupes" (sic !), est envoyé sur place pour calmer et étouffer le mouvement. Mais il arrive trop tard, les conseils de soldats propagent leurs revendications : un mouvement spontané gagne d’autres villes portuaires, puis les grands centres ouvriers de la Ruhr et de Bavière. L’extension géographique des luttes est en marche. Noske ne peut plus agir frontalement. Le 7 novembre, le conseil ouvrier de Kiel appelle à la révolution, proclamant : "Le pouvoir est entre nos mains". Le 8 novembre, pratiquement tout le nord-ouest de l’Allemagne est aux mains de conseils ouvriers. Dans le même temps, en Bavière et en Saxe, les événements poussent à la démission des petits seigneurs locaux. Dans toutes les villes de l’empire, de Metz à Berlin, se répandent les conseils ouvriers.
C’est précisément la généralisation de ce mode d’organisation politique, véritable moteur du combat de classe, qui fait trembler la bourgeoisie. L’organisation de la classe en conseils ouvriers avec des représentants élus, responsables devant l’assemblée et révocables à tout instant est un mode d’organisation extrêmement dynamique. Il n’est rien de moins que l’expression d’un véritable processus révolutionnaire. C’est le lieu où toute la classe ouvrière, de manière unitaire, débat de sa lutte et de la prise en main de la société, de la perspective révolutionnaire. Avec l’expérience de 1917, la bourgeoisie l’a d’ailleurs trop bien compris. C’est pourquoi elle va s’atteler à pourrir de l’intérieur ces conseils ouvriers, en profitant des illusions encore très grandes de la classe ouvrière envers son ancien parti, le SPD. Noske est élu à la tête du conseil ouvrier de Kiel. Cette faiblesse de notre classe aura des conséquences tragiques pour les semaines à venir.
Mais pour l’heure, au matin du 9 novembre 1918, la lutte poursuit son développement. À Berlin, les ouvriers se mobilisent et passent devant les casernes pour rallier les soldats à leur cause et devant les prisons pour libérer leurs frères de classe. La bourgeoisie est alors consciente que la paix doit être immédiate et que le régime du Kaiser doit tomber. Elle a tiré les leçons des erreurs de la bourgeoisie russe. Le 9 novembre 1918 Guillaume II est destitué. Le 11 novembre, l’armistice est signé.
La lutte des ouvriers en Allemagne a précipité la fin de la guerre, mais c’est bien la bourgeoisie qui signe le traité de paix et qui va se servir de cet événement pour œuvrer contre la révolution.
Le machiavélisme de la bourgeoisie
Voici un très bref résumé de l’état du rapport de force au début de la guerre civile en novembre 1918 :
- D’un côté, la classe ouvrière est extrêmement combative. Elle a su étendre les conseils ouvriers à l’ensemble du pays avec une très grande rapidité. Mais elle est pétrie d’illusions sur son ancien parti, le SPD ; elle laisse même ces traîtres aux plus hautes responsabilités au sein de ses conseils, comme Noske à Kiel. Les organisations révolutionnaires, les Spartakistes et les différents groupes de la gauche révolutionnaire, mènent le combat politique, ils assurent leur rôle d’orientation des luttes, ils mettent en avant la nécessité de jeter un pont vers la classe ouvrière en Russie, ils démasquent les manœuvres et le travail de sabotage de la bourgeoisie, ils reconnaissent le rôle fondamental des conseils ouvriers.
- De l’autre côté, la bourgeoisie allemande, une bourgeoisie extrêmement expérimentée et organisée, est consciente de l’efficacité entre ses mains de l’arme du SPD. Tirant les leçons des événements en Russie, elle a clairement identifié le danger que représentaient la poursuite de la guerre et l’apparition de conseils ouvriers. Tout le travail de sape du SPD va donc être de s’immiscer dans le processus révolutionnaire en dévoyant la lutte vers la démocratie bourgeoise. Pour ce faire, la bourgeoisie va attaquer sur tous les fronts : de la propagande calomnieuse à la répression la plus féroce en passant par les multiples provocations.
Le SPD reprend donc à son compte le mot d’ordre de la révolution : "fin de la guerre" tout en prônant "l’unité du parti" et va faire oublier son rôle prépondérant dans la marche à la guerre. En signant le traité de paix, le SPD exploite les faiblesses du prolétariat, utilise le poison démocratique et met de côté ce qu’il y avait pour lui de plus insupportable pour les ouvriers : la guerre et ses désastres, la famine. Pour enfoncer un peu plus le clou, la social-démocratie trouve un bouc-émissaire de circonstance tout désigné : l’aristocratie militaire et la monarchie.
Mais le plus grand danger pour la bourgeoisie demeure les conseils et le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux soviets" venu de Russie. La révocabilité des délégués posait un réel problème à la bourgeoisie, car elle permettait aux conseils de se renouveler et de se radicaliser constamment. Les conseils sont donc assaillis par les représentants fidèles du SPD, surfant sur les illusions sur ce vieux parti "ouvrier" encore existantes. Les conseils sont gangrenés de l’intérieur, vidés de leur substance, par des dirigeants du SPD connus (Noske à Kiel, Ebert à Berlin) ou non. Le poison démocratique y est déversé, au travers notamment du soutien au projet d'élection d'une assemblée constituante. L’objectif est clair : neutraliser les conseils ouvriers en éliminant leur caractère révolutionnaire. Le congrès national des conseils tenu à Berlin le 16 décembre 1918 en est le plus bel exemple :
- les délégués représentant des soldats sont surreprésentés par rapport aux délégués ouvriers, lesquels étaient en général bien plus à gauche que les soldats (1 délégué pour 100 000 soldats dans le premier cas, 1 pour 200 000 habitants dans le second) ;
- l’accès au congrès est interdit à la délégation russe. Exit l’internationalisme !
- l’accès au congrès est interdit aux non-ouvriers, c’est à dire que chaque membre apparaît sous sa profession. Ainsi, les membres de la Ligue Spartakus ne sont pas autorisés à rentrer (notamment Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht). Exit la gauche révolutionnaire ! Même sous la pression de quelques 250 000 manifestants, le congrès ne fléchira pas !
Le système de conseils est une agression au capitalisme et à son fonctionnement démocratique. La bourgeoisie en est pleinement consciente. C’est pourquoi elle agit ainsi, de l’intérieur. Mais elle sait aussi que le temps ne joue pas en sa faveur et que l’image du SPD s’étiole. La révocabilité des délégués élus est un danger trop important pour le SPD qui tente de garder le contrôle de la situation. Il a donc dû précipiter les événements, tandis que le prolétariat avait besoin de temps pour mûrir, pour se développer politiquement.
Parallèlement à ces manœuvres idéologiques, le lendemain du 9 novembre, Ebert et le SPD passent des accords secrets avec l’armée pour écraser la révolution. Ils multiplient les provocations, mensonges et calomnies pour mener à l’affrontement militaire. Mensonges et calomnies, notamment à l’encontre du Spartakusbund qui "assassine, pille, et appelle les ouvriers à verser encore leur sang…" Ils appellent au meurtre de Liebknecht et Luxemburg. Ils créent une "armée blanche" : les Freikorps, ou corps francs, composés de soldats brisés et traumatisés par la guerre qui ne connaissent plus que la haine aveugle comme seul exutoire.
A partir du 6 décembre 1918, de vastes offensives contre-révolutionnaires sont lancées :
- attaque contre le QG du journal de Spartakus : Die Rote Fahne (Le drapeau rouge),
- tentatives d’arrestation des membres de l’organe exécutif des conseils ouvriers,
- tentative d’assassinat de Karl Liebknecht,
- systématiques escarmouches lors des manifestations ouvrières
- campagne médiatique de calomnies et offensive militaire contre la division de la marine du peuple, Volksmarinedivision, composée de marins armés qui avaient marché depuis les ports de la côte sur la capitale pour répandre la révolution et agissant pour sa défense.
Mais loin d’effrayer le prolétariat en marche, cela ne fait que renforcer la colère des ouvriers et armer les manifestations pour répondre à la provocation. La réponse est : solidarité de classe, entraînant derrière elle, le 25 décembre 1918, la manifestation la plus massive depuis le 9 novembre ! Cinq jours plus tard est fondé à Berlin le KPD, Parti communiste d’Allemagne.
Face à ces échecs, la bourgeoisie apprend et s’adapte vite. Dès la fin décembre 1918, elle comprend que s’attaquer de front aux grandes figures révolutionnaires la dessert et renforce la solidarité de classe. Elle décide alors d’accentuer les rumeurs et les calomnies, évite les confrontations armées directes et manœuvre autour de personnages moins connus. Elle cible alors le préfet de police de Berlin Emil Eichhorn qui avait été élu à la tête d’un comité de soldats sur Berlin. Ce dernier est démis de ses fonctions par le gouvernement bourgeois le 4 janvier. Ceci est aussitôt ressenti comme une agression par les ouvriers de la ville. Le prolétariat berlinois réagit massivement le 5 janvier 1919 : 150 000 personnes sont dans la rue, ce qui surprend même la bourgeoisie. Mais cela ne va pas empêcher la classe ouvrière de tomber dans le piège de l’insurrection prématurée. Tandis que le mouvement n’est pas suivi ailleurs en Allemagne où Eichhorn n’est pas connu, et face à l’euphorie du moment, le comité révolutionnaire provisoire[3] dont Pieck et Liebknecht, décide le soir même de lancer l’insurrection armée, allant à l’encontre des décisions du congrès du KPD. Les conséquences de cette improvisation sont dramatiques : descendus massivement dans la rue, les ouvriers restent là, sans instructions, sans objectif précis et dans la plus grande confusion. Pire, les soldats refusent de prendre part à l’insurrection, ce qui signe son échec. Devant cette erreur d’analyse et la situation très dangereuse qui en découle, Rosa Luxemburg et Leo Jogiches défendent la seule position valable pour éviter un bain de sang : poursuivre la mobilisation en armant le prolétariat et en appelant celui-ci à encercler les casernes jusqu’à ce que les soldats se mobilisent en faveur de la révolution. Cette position est argumentée par l’analyse juste que si le rapport de force politique n’est pas en faveur du prolétariat en Allemagne, début janvier 1919, le rapport de force militaire est lui en faveur de la révolution (au moins à Berlin).
Mais au lieu de chercher à armer les ouvriers, le "comité provisoire" commence à négocier avec le gouvernement qu’il vient de déclarer déchu. Dès lors, le temps ne joue plus en faveur du prolétariat, mais en faveur de la contre-révolution.
Le 10 janvier 1919, le KPD demande à Liebknecht et Pieck de démissionner. Mais le mal est fait. Il s’ensuit la "semaine sanglante", ou "semaine Spartakus". Le "putsch communiste" est déjoué "par les héros de la liberté et de la démocratie". La terreur blanche s’installe. Les corps-francs pourchassent les révolutionnaires dans toute la ville et les exécutions sommaires deviennent systématiques. Le soir du 15 janvier, Rosa Luxembourg et Liebknecht sont kidnappés par la milice, puis aussitôt assassinés. En mars 1919, ce sera au tour de Leo Jogiches et de centaines de militants de la gauche révolutionnaire.
Les illusions démocratiques de la classe ouvrière et les faiblesses du KPD
A quoi est du cet échec dramatique ? Les événements de janvier 1919 contiennent à eux seuls tous les facteurs ayant conduit à la défaite de la révolution : d’une part une bourgeoisie intelligente à la manœuvre, et d’autre part une classe ouvrière encore illusionnée par la social-démocratie et un parti communiste insuffisamment organisé, malgré les efforts pour lui donner des bases programmatiques solides. Effectivement, le KPD est assez désorienté, trop jeune (beaucoup de jeunes camarades le constituent, les plus vieux ayant disparu avec la guerre ou la répression), inexpérimenté, manquant d'unité, ne parvenant pas à donner des orientations claires à la classe ouvrière.
Contrairement aux bolcheviks qui avaient une continuité historique depuis 1903, et l’expérience de la révolution de 1905 et des conseils ouvriers, la gauche révolutionnaire allemande très minoritaire au sein du SPD doit faire face à la trahison de celui-ci en août 1914, et ensuite construire en toute hâte un parti, dans le feu des événements. Le KPD est fondé le 30 décembre 1918 à partir du Spartakusbund et des Communistes internationaux d'Allemagne (IKD). Lors de cette conférence, la majorité des délégués se prononcent très clairement contre la participation aux élections bourgeoises et rejettent les syndicats. Mais la question organisationnelle est largement sous- estimée. La question du parti n’est pas comprise à la hauteur des enjeux du moment.
Cette sous-estimation va amener la prise de décision de l’insurrection armée par Liebknecht et d'autres camarades sans attendre une nouvelle analyse du parti, sans méthode d’analyse claire de l'évolution du rapport de force. La centralisation des décisions fait défaut. C’est bien, en fin de compte, l’inexistence préalable d’un parti mondial (l’IC ne sera fondée que deux mois plus tard, en mars 1919) qui se reflète dans l’impréparation du KPD dans un tel contexte qui va conduire à ce drame. En quelques heures, le rapport de force s’est inversé : le temps était venu pour la bourgeoisie de répandre sa terreur blanche.
Pour autant, les grèves ne s’arrêtent pas. De janvier à mars 1919, la grève de masse émerge de façon spectaculaire. Mais en même temps la bourgeoisie continue son sale travail : exécutions, rumeurs, calomnies… la terreur écrase le prolétariat petit à petit. Tandis qu’en février des grèves massives émergent partout en Allemagne, le prolétariat berlinois, le cœur de la révolution, n’est plus capable de suivre, assommé par sa défaite de janvier. Lorsque, enfin, il se met en marche, il est trop tard. Les luttes à Berlin et dans le reste de l’Allemagne ne parviendront pas à s’unir. Dans le même temps, le KPD "décapité" est contraint à l’illégalité. Ainsi, dans les vagues de grèves de février à avril 1919, il ne peut jouer le rôle déterminant qui lui incombe. Sa voix est quasiment étouffée par le capital. Si le KPD avait eu la possibilité de démasquer la provocation de la bourgeoisie, lors de la semaine de janvier, et d’empêcher que les ouvriers ne tombent dans ce piège, le mouvement aurait sûrement connu une toute autre issue.. Partout on fait la chasse aux "communistes". Les communications entre ce qui reste des organes centraux et les délégués locaux ou régionaux du KPD sont plusieurs fois rompues. Lors de la conférence nationale du 29 mars 1919, on fait le constat que "les organisations locales sont submergées d’agents-provocateurs".
En conclusion
La révolution en Allemagne, c’est avant tout le mouvement de grève de masse du prolétariat, qui s’est étendu géographiquement, qui a opposé la solidarité ouvrière à la barbarie capitaliste, qui s’est réapproprié les leçons d’Octobre 1917 et qui s’est organisé en conseils ouvriers. La révolution en Allemagne, c’est aussi la leçon de la nécessité d’un Parti communiste international centralisé, avec des bases organisationnelles et programmatiques claires, sans lesquelles le prolétariat ne pourra pas déjouer le machiavélisme de la bourgeoisie. Mais la révolution en Allemagne, c’est aussi la capacité des bourgeoisies à s’unir contre le prolétariat avec son arsenal de manœuvres, mensonges et manipulations de tous ordres. C’est la puanteur d’un monde à l’agonie qui refuse de s’éteindre. C’est le piège mortel des illusions sur la démocratie. C’est la destruction acharnée de l’intérieur des conseils ouvriers. Bien que les événements de 1919 aient été décisifs, les braises encore ardentes de la révolution en Allemagne ne s'éteignirent pas avant plusieurs années. Mais à l'échelle de l'histoire, les conséquences de cette défaite furent dramatiques pour l'humanité : la montée du nazisme en Allemagne, du stalinisme en Russie, la marche vers la Seconde Guerre mondiale sous la bannière de l'antifascisme. Ces événements cauchemardesques peuvent tous être imputés à l'échec de la vague révolutionnaire, entre 1917 et 1923, qui avait ébranlé l'ordre bourgeois sans pouvoir le renverser une fois pour toutes. Voilà ce qu’est pour nous la révolution en Allemagne en 1918, une source d’inspiration et de leçons pour les luttes futures du prolétariat. Car comme l’a écrit Rosa Luxemburg, la veille de son assassinat par la soldatesque de la social-démocratie : "Que nous enseigne toute l’histoire des révolutions modernes et du socialisme ? La première flambée de la lutte de classe en Europe s’est achevée par une défaite. Le soulèvement des canuts de Lyon, en 1831, s’est soldé par un lourd échec. Défaite aussi pour le mouvement chartiste en Angleterre. Défaite écrasante pour la levée du prolétariat parisien au cours des journées de juin 1848. La Commune de Paris enfin a connu une terrible défaite. La route du socialisme (à considérer les luttes révolutionnaires) est pavée de défaites. (…) Où en serions-nous aujourd’hui sans toutes ces "défaites", où nous avons puisé notre expérience, nos connaissances, la force et l’idéalisme qui nous animent ? Aujourd’hui, (…) nous sommes campés sur ces défaites et nous ne pouvons renoncer à une seule d’entre elles, car de chacune nous tirons une portion de notre force, une partie de notre lucidité. (…) Les révolutions (…) ne nous ont jusqu’ici apporté que défaites, mais ces échecs inévitables sont précisément la caution réitérée de la victoire finale. À une condition il est vrai ! Car il faut étudier dans quelles conditions la défaite s’est chaque fois produite (…) "L’ordre règne à Berlin !", sbires stupides ! Votre "ordre" est bâti sur le sable. Dès demain la révolution "se dressera de nouveau avec fracas" proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi : J’étais, je suis, je serai !".
CCI, 29 octobre 2018
[1] Tous trois firent partie de la minorité du SPD qui refusa les crédits de guerre et rejoignirent la ligue spartakiste.
[2] Avec Rosa Luxemburg, l'un des deux dirigeants les plus connus et persécuté de la ligue spartakiste.
[3] Le 5 janvier, les revolutionäre Obleutes, les membres de la direction de l'USPD du Grand Berlin, Liebknecht et Pieck du Parti communiste se réunirent à la préfecture pour discuter de comment poursuivre l'action (…) les représentants des ouvriers révolutionnaires instituèrent un comité révolutionnaire provisoire de 52 membres chargé de diriger le mouvement révolutionnaire et d'assumer en cas de nécessité toutes les fonctions gouvernementales et administratives. La décision de commencer la lutte pour tenter de renverser le gouvernement fut prise lors de cette réunion malgré six voix contre. (D'après "Révolution et contre-révolution en Allemagne", Paul Frölich)
Approfondir:
- Révolution Allemande [766]
Analyse de l'évolution récente des tensions impérialistes (juin 2018)
- 162 lectures
Nous publions ci-dessous un rapport sur la situation impérialiste adopté par l'organe central du CCI lors d'une réunion en juin 2018. Depuis lors, les événements entourant la visite de Trump en Europe ont très clairement confirmé les idées principales de ce rapport, en particulier l'idée que les États-Unis sont devenus le principal propagateur de la tendance du "chacun pour soi" au niveau mondial, au point de détruire les instruments de son propre "ordre mondial" (Voir notre article "Trump en Europe")
Questions théoriques:
- Impérialisme [767]
Trump en Europe : une expression du capitalisme dans la tourmente
- 55 lectures
Les événements entourant la visite de Trump en Europe ont très clairement confirmé les idées principales du rapport sur les tensions impérialistes (Juin 2018), en particulier l'idée que les États-Unis sont devenus le principal propagateur de la tendance du "chacun pour soi" au niveau mondial, au point de détruire les instruments de son propre "ordre mondial"
Le sommet de l'OTAN de juillet à Bruxelles a été marqué par les demandes bruyantes et menaçantes du président américain Trump pour que les membres européens de l'OTAN augmentent aussi rapidement et massivement que possible leurs budgets militaires -d'abord à 2 % et même à 4 %, un montant que les États-Unis déclarent dépenser depuis un certain temps.
La protestation de Trump selon laquelle le niveau gigantesque des dépenses militaires américaines constitue un fardeau terrible pour l'économie américaine et sa compétitivité ne correspond pas une fausse nouvelle. Le financement d'une machine militaire présente sur tous les continents et le coût économique des fiascos américains en Afghanistan et en Irak étouffent l'économie américaine. C'est le produit inévitable du cancer du militarisme. Et pourtant, le budget courant des Etats-Unis a alloué à nouveau une part beaucoup plus importante aux dépenses d'armement que les années précédentes - et cette orientation a été poussée à la fois par le Parti démocratique et les républicains[1]... Ainsi, malgré l'avertissement que la spirale des coûts du militarisme mine la performance globale de l'économie américaine, tôt ou tard, la pulsion militariste oblige tous les gouvernements du monde à sacrifier toujours plus de ressources et de dépenses pour cet insatiable Moloch. Le fait que les entreprises d'armement en tirent de magnifiques profits n'empêche pas l'affaiblissement de l'économie dans son ensemble. L'exemple de la Russie dans les années 70 et 80 est un avertissement : le poids écrasant de son secteur militaire, la course aux armements impossible à gagner avec les Etats-Unis, a été un facteur clé dans l'effondrement du régime stalinien dans son ensemble.
En même temps, les menaces de Trump selon lesquelles si les "alliés" européens n'augmentent pas leurs budgets militaires en fonction des exigences américaines, les États-Unis pourraient faire cavalier seul, voire quitter l'OTAN, le mettent en conflit direct avec ceux qui, jusqu'à présent, ont défendu les intérêts impérialistes mondiaux du capital américain.
Il y a certainement une logique dans l'antipathie de Trump pour l'OTAN, qui est à bien des égards un vestige de la période des blocs et dont le rôle dans le monde multipolaire d'aujourd'hui est devenu de plus en plus incertain.
A l'époque de la guerre froide, l'OTAN était l'instrument central d'un bloc militaire avec les Etats-Unis à sa tête, ce qui lui permettait d'imposer ses propres décisions et une discipline à l'échelle du bloc. Mais même après l'effondrement du bloc russe en 1989-1991, l'OTAN a continué à servir de structure de pouvoir dominée par les Etats-Unis, un moyen de préserver l'hégémonie mondiale américaine et de s'opposer aux tendances centrifuges de ses anciens alliés. En particulier, l'OTAN a été utilisée pour installer plus de troupes en Europe centrale et orientale, faisant avancer l'offensive américaine contre la Russie. Et l'OTAN sert toujours de bouclier contre la Russie aux yeux de plusieurs pays d'Europe de l'Est.
Bien sûr, en dessous de tout cela, les tendances à la progression du "chacun pour soi", à l'augmentation des tensions entre les Etats-nations, ont contribué à affaiblir de façon constante et irréversible la domination américaine sur l'OTAN et ses anciens alliés. Mais les menaces de Trump de se retirer de l'OTAN sont toujours en conflit direct avec les intérêts de l'aile militaire américaine, qui ne veut pas abandonner ce qui reste de la position encore dominante des Etats-Unis au sein de l'OTAN, et encore moins abandonner complètement l'OTAN. Cette faction de la classe dirigeante comprend que le maintien de l'hégémonie américaine est plus qu'un problème économique. Le sommet de l'OTAN et les menaces de Trump révèlent la réalité des effets du cancer du militarisme, mais aussi le fait que la classe dirigeante américaine est profondément divisée sur ses orientations militaires.
Dans le même temps, les résultats du sommet de l'OTAN n'ont pu que renforcer la détermination des pays membres européens à augmenter leurs dépenses militaires et à gagner plus de marge de manœuvre en dehors de la zone de contrôle des Etats-Unis. Les ultimatums de Trump ont été un prétexte bienvenu pour accélérer ce processus, renforçant les ambitions européennes de développer de nouvelles structures militaires au sein de l'UE ou à l'extérieur, en particulier entre la France et l'Allemagne, mais aussi avec le Royaume-Uni (indépendamment de Brexit). Nous voyons donc que le poids global du militarisme ne s'affaiblit pas : lorsque les anciennes structures de pouvoir militaire s'érodent, cela ne fait que créer de nouvelles tensions et de nouvelles alliances militaires, aussi éphémères soient-elles. Comme pour tout gang, lorsque le grand chef est affaibli ou renversé, les gangsters de deuxième ordre forment généralement de nouvelles alliances avant de commencer à s'attaquer les uns aux autres.........
Immédiatement après le sommet de l'OTAN, Trump a effectué une brève visite au Royaume-Uni, dont la politique, a-t-il observé, est "quelque peu tourmentée". Il a ensuite accentué le tourment en semblant miner les efforts de Theresa May pour bricoler un accord Brexit, déclarant qu'elle n'avait pas fait ce qu'il lui avait dit de faire et que l'accord avec l'UE qu'elle proposait exclurait un accord commercial avec les États-Unis – alors que précédemment il avait fait l'éloge de Boris Johnson, le rebelle du cabinet, en disant qu'il ferait un "grand premier ministre". Un retour en arrière furieux de Trump lors de la conférence de presse à Chequers où il se tenait aux côtés de May, n'a pu rattraper les dommages déjà causés. Et après avoir défini l'UE comme un "ennemi" juste avant son sommet avec Poutine, l'attitude de ce président "perturbateur" à l'égard de l'UE - laquelle avait été créé dans le bloc occidental et que les Etats-Unis ont continué à soutenir dans l'ordre mondial post-89 - va clairement de pair avec son approche de l'OTAN.
Puis vint le sommet Trump-Putin à Helsinki. Celui-ci a montré avant tout que la classe dirigeante américaine a à sa tête un président qui agit de plus en plus seul ou qui n'insiste que sur des intérêts très spécifiques, en particulier des calculs économiques à court terme. Au lieu d'être une force centralisatrice dirigeant les forces militaires et de sécurité, il agit non seulement sans les consulter, mais il a même exprimé une plus grande foi dans les paroles de Poutine que dans celles de son appareil de sécurité en ce qui concerne l'ingérence russe dans les élections américaines. Il est évident que Trump est devenu plus imprévisible que jamais, et les corrections ridicules de ses déclarations les plus farfelues ne peuvent cacher le véritable bourbier dans lequel se trouve la classe dirigeante américaine.
De la même manière que son attitude au sommet de l'OTAN a montré les divisions au sein de la classe dirigeante, le fiasco de la rencontre avec Poutine met en lumière des conflits de plus en plus profonds entre l'appareil militaire/sécurité et la Maison Blanche, entre certaines branches de l'industrie et des ailes importantes de l'Etat. L'opposition aux ambitions impérialistes russes est profondément ancrée dans la politique impérialiste américaine depuis 1945 et n'a fait que se renforcer avec la politique étrangère agressive de Poutine. L'idée que Trump, et avec lui certaines factions de la classe dirigeante, pourraient être prêts à conclure toutes sortes d'accords avec Poutine, ou même agir comme ses valets, est une source d'inquiétude considérable dans les factions les plus établies de la classe dirigeante américaine, qui ne sont pas convaincues par l'argument selon lequel les Etats-Unis pourraient s'allier utilement avec la Russie contre la menace plus grande que constitue la Chine et comme contrepoids à l'UE.
Lorsque Trump est arrivé au Royaume-Uni, il a été "accueilli" par des dizaines, voire des centaines de milliers de manifestants, irrités par ses déclarations racistes sur l'immigration, son admission ouverte d'abus sexuels, ses louanges pour le "bon peuple" de la droite fasciste. Mais ces manifestations étaient très clairement sur un terrain bourgeois, notamment parce qu'elles étaient ouvertement encouragées par des porte-parole de la classe dirigeante comme The Guardian et le Evening Standard. Ils se sont surtout concentrés sur l'individu Trump : sa peau orange, sa coiffure, ses petites mains et son petit pénis, le fait éclairant qu'une signification de "trump" est "pet". Le problème avec tout cela est que cela cache ce qui est vraiment en jeu dans la situation. Tout comme il y a dix ans, les banquiers étaient tenus responsables d'une crise économique enracinée dans les contradictions impersonnelles du capital, Trump est aujourd'hui blâmé pour le chaos politique, économique et militaire croissant, alors qu'il n'est finalement que le produit de ce chaos, qui découle de la réalité sous-jacente que nous vivons à travers la désintégration et la décomposition d'un système social tout entier. Comme le disait l'une des pancartes de la manifestation de Londres : "Pouvons-nous laisser les gens intelligents diriger les choses maintenant ?". Mais remplacer Trump par un politicien plus intelligent et plus responsable n'empêchera pas le capitalisme de glisser dans l'abîme de la barbarie. Seule une lutte déterminée contre le capital mondial, une lutte visant à le renverser, peut offrir cet espoir à l'humanité.
DA, 24.7.18
[1] Le 16 mars 2017, le président Trump a présenté au Congrès sa demande de 639 milliards de dollars de dépenses militaires, soit une augmentation de 54 milliards de dollars ou encore 10 % - pour l'exercice 2018 ainsi que 30 milliards de dollars supplémentaires pour l'exercice 2017 qui se termine en septembre. Le Congrès a augmenté le budget à 696 milliards de dollars. Cette augmentation de 61 milliards de dollars correspond à l'ensemble du budget annuel militaire de la Russie, voire même le dépasse. C'est plus que ce que l'administration de Trump avait demandé à l'origine. Il rivalise avec deux grandes poussées de dépenses pendant l'administration du président George W. Bush, en 2003 et 2008, qui ont servi à financer la guerre en Irak. "Aujourd'hui, nous recevons le budget militaire le plus important de l'histoire, renversant de nombreuses années de déclin et de financement imprévisible", a déclaré le ministre de la défense Jim Mattis. https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/26/596129462/how-the-pent... [768]
Questions théoriques:
- Populisme [584]
Rapport sur les tensions impérialistes (Juin 2018)
- 104 lectures
Les principales orientations du rapport de novembre 2017 sur les tensions impérialistes [769] nous fournissent le cadre essentiel pour comprendre les développements actuels :
- la fin des deux blocs de la guerre froide ne signifiait pas la disparition de l'impérialisme et du militarisme. Bien que la formation de nouveaux blocs et l'éclatement d'une nouvelle guerre froide ne figurent pas à l'ordre du jour, des conflits ont éclaté dans le monde entier. Le développement de la décomposition a conduit à un déchaînement sanglant et chaotique de l'impérialisme et du militarisme ;
- l'explosion de la tendance au chacun pour soi a conduit à la montée des ambitions impérialistes des puissances de deuxième et troisième niveau, ainsi qu'à l'affaiblissement croissant de la position dominante des États-Unis dans le monde ;
- La situation actuelle se caractérise par des tensions impérialistes partout et par un chaos de moins en moins contrôlable, mais surtout par son caractère hautement irrationnel et imprévisible, lié à l'impact des pressions populistes, en particulier au fait que le pouvoir le plus fort du monde est aujourd'hui dirigé par un président populiste aux réactions capricieuses.
Dans la période récente, le poids du populisme est devenu de plus en plus tangible, exacerbant la tendance au "chacun pour soi" et l'imprévisibilité croissante des conflits impérialistes ;
- La remise en cause des accords internationaux, des structures supranationales (en particulier l'UE), de toute approche globale, rend les relations impérialistes plus chaotiques et accentue le danger d'affrontements militaires entre les requins impérialistes (Iran et Moyen-Orient, Corée du Nord et Extrême-Orient).
- Dans de nombreux pays, le rejet des élites politiques traditionnelles mondialisées va de pair avec le renforcement d'une rhétorique nationaliste agressive partout dans le monde (non seulement aux États-Unis avec le slogan "America First" de Trump et en Europe, mais aussi en Turquie ou en Russie par exemple).
Ces caractéristiques générales de l'époque trouvent aujourd'hui leur concrétisation dans une série de tendances particulièrement significatives.
1) La politique impérialiste américaine : du gendarme mondial au principal propagateur de chacun pour soi
L'évolution de la politique impérialiste américaine au cours des trente dernières années est l'un des phénomènes les plus significatifs de la période de décomposition : après avoir promis une nouvelle ère de paix et de prospérité (Bush Senior) au lendemain de l'implosion du bloc soviétique, après s'être battu contre la tendance au chacun pour soi, il est devenu aujourd'hui le principal propagateur de cette tendance dans le monde. L'ancienne tête de bloc et seule superpuissance impérialiste majeure qui reste après l'implosion du bloc de l'Est, qui depuis environ 25 ans agit en tant que gendarme du monde, luttant contre la propagation du chacun pour soi au niveau impérialiste, rejette aujourd'hui les négociations internationales et les accords globaux en faveur d'une politique de "bilatéralisme".
Un principe commun, visant à surmonter le chaos dans les relations internationales, est résumé dans la phrase latine suivante : "pacta sunt servanda" - les traités, les accords doivent être respectés. Si quelqu'un signe un accord mondial - ou multilatéral - il est censé le respecter, du moins en apparence. Mais les États-Unis, sous Trump, ont aboli cette conception : "Je signe un traité, mais je peux l'abolir demain". Cela s'est déjà produit avec le Pacte transpacifique (PPT), l'Accord de Paris sur les changements climatiques, le traité nucléaire avec l'Iran, l'accord final sur la réunion du G7 au Québec. Les États-Unis rejettent aujourd'hui les accords internationaux en faveur d'une négociation entre États, dans laquelle la bourgeoisie américaine imposera sans détour ses intérêts par le chantage économique, politique et militaire (comme on peut le voir aujourd'hui avec le Canada avant et après le G7 en ce qui concerne l'ALENA ou avec la menace de représailles contre les entreprises européennes qui investissent en Iran). Cela aura des conséquences énormes et imprévisibles pour le développement des tensions et des conflits impérialistes (mais aussi pour la situation économique du monde) dans la période à venir. Nous illustrerons cela par trois "points chauds" dans les affrontements impérialistes d'aujourd'hui :
- (1) Le Moyen-Orient : en dénonçant l'accord nucléaire avec l'Iran, les États-Unis s'opposent non seulement à la Chine et à la Russie, mais aussi à l'UE et même à la Grande-Bretagne. Leur alliance apparemment paradoxale avec Israël et l'Arabie Saoudite conduit à une nouvelle configuration des forces au Moyen-Orient (avec un rapprochement croissant entre la Turquie, l'Iran et la Russie) et accroît le danger d'une déstabilisation générale de la région, d'affrontements plus nombreux entre les principaux requins et de guerres sanglantes plus étendues.
- (2) Les relations avec la Russie : quelle est la position des États-Unis à l'égard de Poutine ? Pour des raisons historiques (l'impact de la période de la "guerre froide" et l'affaire russe qui a commencé avec les dernières élections présidentielles), il y a des forces puissantes dans la bourgeoisie américaine qui poussent à des confrontations plus dures avec la Russie, mais l'administration Trump, malgré la confrontation impérialiste au Moyen-Orient, ne semble toujours pas exclure une amélioration de la coopération avec la Russie : par exemple au dernier G7, Trump a suggéré de réintégrer la Russie dans le Forum des pays industriels.
- (3) Extrême-Orient : l'imprévisibilité des accords pèse particulièrement lourd dans les négociations avec la Corée du Nord : (a) Quelles sont les implications d'un accord entre Trump et Kim, si la Chine, la Russie, le Japon et la Corée du Sud ne sont pas directement impliqués dans la négociation de cet accord ? Cela a déjà fait surface lorsque Trump a révélé à Singapour, au grand désarroi de ses "alliés" asiatiques, qu'il avait promis d'arrêter les exercices militaires conjoints en Corée du Sud ; (b) si un accord peut être remis en question à tout moment par les États-Unis, jusqu'où Kim peut-il lui faire confiance ? (c) Dans ce contexte, la Corée du Nord et la Corée du Sud s'appuieront-elles totalement sur leur "allié naturel" et envisagent-elles une stratégie alternative ?
Bien que cette politique implique un développement énorme du chaos et de chacun pour soi, ainsi qu'un nouveau déclin des positions mondiales de la première puissance mondiale, il n'y a pas d'approche alternative tangible aux États-Unis. Après un an et demi d'enquête de Mueller et d'autres types de pressions contre Trump, il est peu probable que Trump soit démis de ses fonctions, entre autres parce qu'il n'y a pas d'autre force en vue. Le bourbier au sein de la bourgeoisie américaine se poursuit.
2) Chine : une politique visant à éviter une confrontation trop directe
La contradiction ne pouvait pas être plus frappante. Au moment même où les États-Unis de Trump dénoncent la mondialisation et reviennent aux accords "bilatéraux", la Chine annonce un vaste projet global, la "Nouvelle Route de la Soie", qui implique environ 65 pays sur trois continents, représentant 60% de la population mondiale et environ un tiers du PIB mondial, avec des investissements sur une période de 30 ans (2050 !) pouvant atteindre 1,2 trillions de dollars.
Depuis le début de sa réémergence, planifiée de la manière la plus systématique et à long terme, la Chine a modernisé son armée, en construisant un "collier de perles" - à commencer par l'occupation des récifs coralliens dans la mer de Chine méridionale et l'établissement d'une chaîne de bases militaires dans l'océan Indien. Mais pour l'instant, la Chine ne cherche pas la confrontation directe avec les États-Unis ; au contraire, elle prévoit de devenir l'économie la plus puissante du monde d'ici 2050 et vise à développer ses liens avec le reste du monde tout en essayant d'éviter les affrontements directs. La politique de la Chine est une politique à long terme, contrairement aux accords à court terme privilégiés par Trump. Elle cherche à développer son expertise et sa puissance industrielle, technologique et surtout militaire. À ce dernier niveau, les États-Unis ont encore une avance considérable sur la Chine.
Au moment même de l'échec du sommet du G7 au Canada (9 et 10 juin 2018), la Chine a organisé, à Quingdao, une conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai avec l'aide des présidents de la Russie (Poutine), de l'Inde (Modi), de l'Iran (Rohani) et des dirigeants du Belarus, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Tadjikistan et de la Kirghizie (20% du commerce mondial, 40% de la population mondiale). L'objectif actuel de la Chine est clairement le projet de la Route de la Soie – avec le but d'étendre son influence. Il s'agit d'un projet à long terme et une confrontation directe avec les États-Unis ne ferait que contrecarrer ces plans.
Dans cette perspective, la Chine usera de son influence pour faire pression en faveur d'un accord conduisant à la neutralisation de toutes les armes nucléaires dans la région coréenne (y compris les armes américaines), ce qui - à condition que les États-Unis l'acceptent - repousserait les forces américaines au Japon et réduirait la menace immédiate sur le nord de la Chine.
Cependant, les ambitions de la Chine conduiront inévitablement à une confrontation avec les objectifs impérialistes non seulement des États-Unis mais aussi d'autres puissances, comme l'Inde ou la Russie :
- une confrontation croissante avec l'Inde, l'autre grande puissance en Asie, est inévitable. Les deux puissances ont commencé à renforcer massivement leurs armées et se préparent à une aggravation des tensions à moyen terme ;
- dans cette perspective, la Russie se trouve dans une situation difficile : les deux pays coopèrent mais, à long terme, la politique de la Chine ne peut conduire qu'à une confrontation avec la Russie. La Russie a repris l'initiative ces dernières années au niveau militaire et impérialiste, mais son retard économique n'a pas été surmonté, au contraire : en 2017, le PIB russe (Produit Intérieur Brut) n'était que de 10% supérieur au PIB du Benelux !
- Enfin, il est probable que les sanctions économiques de Trump et les provocations politiques et militaires forceront la Chine à affronter plus directement les États-Unis à court terme.
3) La montée des leaders forts et de la rhétorique belliqueuse
L'exacerbation de la tendance de chacun pour soi au niveau impérialiste et la concurrence croissante entre les requins impérialistes donnent naissance à un autre phénomène significatif de cette phase de décomposition : l'arrivée au pouvoir de "leaders forts" avec un langage radical et une rhétorique nationaliste agressive.
L'arrivée au pouvoir d'un "leader fort" et une rhétorique radicale sur la défense de l'identité nationale (souvent combinée avec des programmes sociaux en faveur des familles, des enfants, des retraités) est typique des régimes populistes (Trump, bien sûr, mais aussi Salvini en Italie, Orbán en Hongrie, Kaczynski en Pologne, Babiš en République tchèque, ....) mais c'est aussi une tendance plus générale dans le monde entier, non seulement dans les puissances les plus fortes (Poutine en Russie) mais aussi dans les pays impérialistes secondaires comme la Turquie (Erdogan), l'Iran, l'Arabie Saoudite (avec le " coup d'État " du prince Mohammed Ben Salman). En Chine, la limitation de la présidence de l'État à deux périodes de cinq ans a été supprimée de la Constitution, de sorte que Xi Jinping s'impose comme un "leader à vie", le nouvel empereur chinois (étant président, chef du parti et de la commission militaire centrale, ce qui ne s'est jamais produit depuis Deng Xiaoping). Les slogans "démocratiques" ou le maintien de l'apparence démocratique (droits de l'homme) ne sont plus le discours dominant (comme l'ont montré les pourparlers entre Trump et Kim), contrairement à l'époque de la chute du bloc soviétique et au début du XXIe siècle. Ils ont cédé la place à une combinaison de discours très agressifs et d'accords impérialistes pragmatiques.
L'exemple le plus fort est celui de la crise coréenne. Trump et Kim ont d'abord utilisé une forte pression militaire (avec même la menace d'une confrontation nucléaire) et un langage très agressif avant de se rencontrer à Singapour pour marchander. Trump offrait des avantages économiques et politiques gigantesques (le modèle birman) dans le but d'attirer Kim dans le camp américain. Ce n'est pas totalement inconcevable car les Nord-Coréens ont une relation ambiguë et même une méfiance à l'égard de la Chine. Cependant, la référence à la Libye par les responsables américains (dont John Bolton, conseiller à la sécurité nationale) rend les Nord-Coréens particulièrement méfiants à l'égard des propositions américaines - la Corée du Nord pourrait en effet subir le même sort que la Libye, lorsque Kadhafi a été exhorté à abandonner ses armes, puis a été déposé par la force et tué.
Cette stratégie politique est une tendance plus générale dans les affrontements impérialistes actuels, comme en témoignent les tweets agressifs de Trump contre le Premier ministre canadien Trudeau, "un leader faux et faible" parce qu'il a refusé d'accepter des taxes à l'importation plus élevées défendues par les États-Unis. Il y a eu aussi l'ultimatum brutal de l'Arabie saoudite contre le Qatar, accusé de "centrisme" envers l'Iran, ou les déclarations belliqueuses d'Erdogan contre l'Occident et l'OTAN à propos des Kurdes. Enfin, nous mentionnerons le discours très agressif de Poutine sur l'État de l'Union, qui présentait les systèmes d'armes les plus sophistiqués de la Russie avec le message : "Vous feriez mieux de nous prendre au sérieux" !
Ces tendances renforcent les caractéristiques générales de l'époque, comme l'intensification de la militarisation (malgré la forte charge économique qui y est liée) parmi les trois plus grands requins impérialistes, mais aussi comme une tendance globale et dans le contexte d'un paysage impérialiste changeant dans le monde et en Europe. Dans ce contexte de politiques agressives, le danger de frappes nucléaires limitées est très réel, car il y a beaucoup d'éléments imprévisibles dans les conflits autour de la Corée du Nord et de l'Iran.
4) La tendance à la fragmentation de l'UE
Toutes les tendances en Europe au cours de la période écoulée - Brexit, la montée en puissance d'un important parti populiste en Allemagne (AfD), l'arrivée au pouvoir des populistes en Europe de l'Est où la plupart des pays sont dirigés par des gouvernements populistes, se sont trouvé accentuées par deux événements majeurs :
- la formation d'un gouvernement 100% populiste en Italie (composé du mouvement des 5 étoiles et de la Lega), qui conduira à une confrontation directe entre d'un côté les "bureaucrates de Bruxelles" (l'UE), les "champions" de la mondialisation (soutenus par l'Eurogroupe) et les marchés financiers, et de l'autre le "front populiste" du peuple ;
- la chute de Rajoy et du Parti Populaire en Espagne et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement minoritaire du Parti socialiste soutenu par les nationalistes catalans et basques et Podemos, ce qui accentuera les tensions centrifuges à l'intérieur de l'Espagne et en Europe.
Cela aura des conséquences énormes pour la cohésion de l'UE, la stabilité de l'euro et le poids des pays européens sur la scène impérialiste.
- (1) L'UE n'est pas préparée et est largement impuissante à s'opposer à la politique de Trump, qui consiste en un embargo américain sur l'Iran : Les multinationales européennes se conforment déjà aux exigences américaines (Total, Lafarge). Ceci est d'autant plus vrai que plusieurs États européens soutiennent l'approche populiste de Trump et sa politique au Moyen-Orient (l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Roumanie étaient représentées à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem) contre la politique officielle de l'UE. En ce qui concerne l'augmentation des taxes à l'importation, il est loin d'être certain qu'il y aura un accord au sein de l'UE pour répondre systématiquement aux tarifs d'importation plus élevés imposés par Trump.
- (2) Le projet d'un pôle militaire européen reste largement hypothétique dans le sens où, de plus en plus de pays, sous l'impulsion des forces populistes au pouvoir ou mettant la pression sur les gouvernements, ne veulent pas se soumettre à l'axe franco-allemand. D'autre part, alors que le leadership politique de l'UE est constitué de l'axe franco-allemand, la France a traditionnellement développé sa coopération technologique militaire avec la Grande-Bretagne, qui est sur le point de quitter l'UE.
- (3) Les tensions autour de l'accueil des réfugiés opposent non seulement la coalition des gouvernements populistes de l'Est à ceux de l'Europe occidentale, mais de plus en plus les pays occidentaux les uns contre les autres, comme en témoignent les fortes tensions qui se sont développées entre la France de Macron et le gouvernement populiste italien, alors que l'Allemagne est de plus en plus divisée sur le sujet (pression de la CSU).
- (4) Le poids économique et politique de l'Italie (troisième économie de l'UE) est considérable, sans aucune comparaison avec le poids de la Grèce. Le gouvernement populiste italien a l'intention, entre autres, de réduire les impôts et d'introduire un revenu de base, qui coûtera plus de cent milliards d'euros. Dans le même temps, le programme du gouvernement demande à la Banque centrale européenne d'effacer 250 milliards d'euros de la dette italienne !
- (5) Sur le plan économique mais aussi impérialiste, la Grèce avait déjà avancé l'idée de faire appel à la Chine pour soutenir son économie en difficulté. Encore une fois, l'Italie prévoit d'appeler la Chine ou la Russie pour obtenir de l'aide pour soutenir et financer une reprise économique. Une telle orientation pourrait avoir un impact majeur au niveau impérialiste. L'Italie s'oppose déjà au maintien des mesures d'embargo de l'UE à l'encontre de la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée.
CCI (Juin 2018)
Questions théoriques:
- Impérialisme [767]
Il y a cinquante ans, Mai 68, 2ème partie - Les avancées et les reculs de la lutte de classe depuis 1968
- 236 lectures
Sans les événements de Mai 1968, le CCI n’existerait pas. Marc Chirik avait déjà contribué à former un groupe au Venezuela, "Internacionalismo", qui depuis 1964, et ensuite, avait défendu toutes les positions de base qui devaient être reprises une décennie plus tard par le CCI. Mais Marc était conscient depuis le début que ce serait une renaissance de la lutte de classe dans les centres du capitalisme mondial qui serait décisive pour inaugurer un changement dans le cours de l’histoire. C’est cette compréhension qui l’a poussé à retourner en France et à jouer un rôle actif dans le mouvement de mai-juin, et cela incluait la recherche de contacts au sein de ses avant-gardes politisées. Deux jeunes membres du groupe vénézuélien étaient déjà partis en France pour étudier à l’université de Toulouse, et ce fut aux côtés de ces camarades et d’une poignée d’autres que Marc est devenu un membre fondateur de "Révolution Internationale" en octobre 1968 – le groupe qui allait jouer un rôle central dans la formation du CCI sept ans plus tard.
Depuis cette époque, le CCI n’a jamais dévié de ses convictions à propos de la signification historique de Mai 68, et nous sommes constamment revenus sur ce sujet. Tous les dix ans, ou à peu près, nous avons publié des rétrospectives dans notre organe théorique, la Revue Internationale, tout comme d’autre matériel dans notre presse territoriale. Nous avons tenu des réunions publiques pour marquer les 40 et le 50ème anniversaire de Mai et somme intervenus dans des événements organisés par d’autres organisations.[1] Dans cet article, nous commençons en revenant sur un de ces articles, écrit pour un anniversaire qui a depuis acquis une valeur symbolique précise : 1988.
Dans la première partie de cette nouvelle série[2], nous disions en conclusion que la première évaluation faite par "RI" – "Comprendre mai [714] – écrite en 1969, selon laquelle Mai 68 représentait la première grande réaction de la classe ouvrière mondiale à la réapparition de la crise économique historique du capitalisme – a été entièrement confirmée : en dépit de la capacité souvent étonnante du capital de s’adapter à ses contradictions qui s’aiguisent, la crise, qui à la fin des années 60 ne pouvait être détectée que par ses premiers symptômes, est devenue à la fois de plus en plus évidente et à toutes fins utiles, permanente.
Mais qu’en est-il de notre insistance sur le fait que Mai 68 signalait la fin des décennies antérieures de contre révolution et l’ouverture d’une nouvelle période, dans laquelle une classe ouvrière non défaite allait se diriger vers des luttes massives et décisives ; et qu’en retour, l’issue de ces luttes résoudrait le dilemme historique posé par la crise économique insoluble : la guerre mondiale, dans l’éventualité d’une nouvelle défaite de la classe ouvrière, ou révolution mondiale et construction d’une nouvelle société communiste ?
L’article de 1988, "20ans après 1968 – lutte de classe : le murissement des conditions de la révolution prolétarienne [770]"[3] commençait par argumenter contre le scepticisme dominant de l’époque – l’idée très répandue dans les media bourgeois et parmi toute une couche d’intellectuels, que Mai 68 avait au mieux été un magnifique rêve utopique que la dure réalité a conduit à se ternir et à mourir. Ailleurs dans notre presse, à peu près en même temps[4], nous avons aussi critiqué le scepticisme qui affectait de grandes parties du milieu révolutionnaire, et ce depuis les événements de 68 eux-mêmes – une tendance qui s’exprimait notablement par le refus des principaux héritiers de la Gauche communiste italienne qui restaient, de ne voir dans Mai 68 rien de plus qu’une vague d’agitation petite bourgeoise qui n’a rien fait pour soulever le poids mort de la contre révolution.
Autant les ailes bordiguistes que daménistes[5] de la tradition de la Gauche italienne d’après-guerre ont répondu de cette façon. Toutes deux tendent à voir le parti comme quelque chose en dehors de l’histoire, puisqu’elles considèrent qu’il est possible de le maintenir quel que soit le rapport de force entre les classes. Elles tendent donc à voir la lutte des ouvriers comme essentiellement circulaire par nature, puisqu’elle ne peut se transformer dans un sens révolutionnaire que par l’intervention du parti, ce qui pose la question de savoir d’où vient le parti lui-même. Les bordiguistes, en particulier, ont offert une caricature de cette approche en 1968, quand ils sortaient des tracts qui insistaient sur le fait que le mouvement n’irait quelque part que s’il se mettait sous la bannière du Parti (c’est-à-dire, leur propre petit groupe politique). Notre courant, de l’autre côté, a toujours répliqué que c’est là une approche essentiellement idéaliste qui sépare le parti de ses racines matérielles dans la lutte de classe. Nous nous considérions comme nous appuyant sur les acquis réels de la Gauche communiste italienne, dans sa période la plus fructueuse théoriquement – la période la Fraction dans les années 1930 et 40, quand elle a reconnu que sa propre perte d'importance depuis l’étape précédente du parti était un produit de la défaite de la classe ouvrière, et que seule une renaissance de la lutte de classe pouvait fournir les conditions de la transformation des fractions communistes existantes en une réel parti de classe.
Ces conditions se sont d’ailleurs développées après 1968, pas seulement au niveau des minorités politisées, qui connaissaient une phase de croissance importante dans le sillage des événements de 68, et les soulèvements de la classe ouvrière qui ont suivi, mais aussi à un niveau plus général. La lutte de classe qui a fait irruption en mai 68 n’était pas un feu de paille mais le point de départ d’une dynamique puissante qui allait rapidement venir au premier plan à l’échelle mondiale.
Les avancées de la lutte de classe entre 1968 et 1988
En accord avec la vision marxiste qui a depuis longtemps identifié le processus de la lutte de classe analogue à celui de vagues, l’article analyse trois vagues différentes de luttes au cours des deux décennies après 68 : la première, sans aucun doute la plus spectaculaire, a connu l’automne chaud italien en 69, le soulèvement violent à Cordoba en Argentine en 69 et en Pologne en 70, et des mouvements importants en Espagne et en Grande Bretagne en 1972. En Espagne en particulier, les travailleurs ont commencé à s'organiser à travers des assemblées de masse, un processus qui a atteint son point culminant à Vitoria en 1976. La dimension internationale de la vague a été démontrée par ses échos en Israël (1969) et en Egypte (1972) et, plus tard, par les soulèvements dans les townships d'Afrique du Sud qui ont été dirigés par des comités de lutte (les "Civics").
Après une courte pause au milieu des années 70, il y a eu une deuxième vague qui a couvert les grèves des ouvriers du pétrole iraniens, les travailleurs des aciéries en France en 1978, "l’hiver du mécontentement" en Grande Bretagne, la grève des dockers à Rotterdam, menée par un comité de grève indépendant, et ainsi que les grèves des sidérurgistes au Brésil en 1979 qui ont également contesté le contrôle des syndicats . Cette vague de luttes a connu son point culminant en Pologne en 1980, certainement l’épisode le plus important de la lutte de classe depuis 1968, et même depuis les années 1920. Et bien que la répression sévère des ouvriers polonais ait donné un coup d’arrêt à cette vague, il n’a pas fallu longtemps avant qu’un nouveau mouvement ait lieu avec les luttes en Belgique en 1983 et 1986, la grève générale au Danemark en 1985, la grève des mineurs en Angleterre en 1984-85, les luttes des cheminots et des travailleurs de la santé en France en 1986 et 1988, de même le mouvement des employés de l’éducation en Italie en 1987. Les luttes en France et en Italie, en particulier – comme la grève de masse en Pologne – ont montré une réelle capacité d’auto organisation avec des assemblées générales et des comités de grève.
Ce n’était pas une simple liste de grèves. L’article[6] met aussi en évidence le fait que ce mouvement en vagues de luttes ne tournait pas en rond, mais faisait faire de réelles avancées dans la conscience de classe :
"La simple comparaison des caractéristiques des luttes d'il y a 20 ans avec celles d'aujourd'hui permet de percevoir rapidement l'ampleur de l'évolution qui s'est lentement réalisée dans la classe ouvrière. Sa propre expérience, ajoutée à l'évolution catastrophique du système capitaliste, lui a permis d'acquérir une vision beaucoup plus lucide de la réalité de son combat. Cela s'est traduit par ;
- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;
- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière:
- journées d'action, manifestations-ballades-enterrements,
- les grèves longues et isolées...
Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:
- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier),
- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables; (France fin 86, Italie 1987 principalement)."
En même temps, l’article ne négligeait pas les réponses de la bourgeoisie à la montée de la lutte de classe : bien qu’elle ait été surprise par l’éclatement du mouvement de Mai 68, recourant à des formes brutes de répression qui ont joué comme un catalyseur de l’extension de la lutte, elle a par la suite énormément appris ou réappris comment gérer la résistance de son ennemi de classe. Elle n’a pas renoncé à l’emploi de la répression, évidemment, mais elle a trouvé des moyens plus subtils de présenter et justifier son emploi, comme l’épouvantail du terrorisme ; en même temps, elle a développé son arsenal de mystifications démocratiques pour dévoyer les luttes – en particulier dans des pays qui étaient encore gouvernés par des dictatures ouvertes – vers des buts politiques bourgeois. Au niveau des luttes elles-mêmes, elle a fait face au désenchantement croissant vis-à-vis des syndicats officiels et à la menace d’auto-organisation en développant des formes de syndicalisme, qui pouvaient même recouvrir des formes "en dehors des syndicats" (les coordinations mises en place par l’extrême gauche en France par exemple).
L’article commençait par reconnaître que beaucoup de discours optimistes sur la "révolution en 1968" avaient bien sûr été utopiques. Ce fut en partie le cas parce que toute la discussion à propos de la possibilité de la révolution s'était trouvée biaisée par des positions gauchistes selon lesquelles ce qui se passait au Vietnam ou à Cuba était vraiment des révolutions socialistes qui devaient être soutenues activement par la classe ouvrière des pays centraux. Mais aussi parce que, même lorsque la révolution était comprise comme quelque chose qui impliquait réellement la transformation des rapports sociaux, , les conditions objectives en 1968, par-dessus tout la crise économique mondiale, ne faisaient que commencer à fournir la base matérielle d’un défi révolutionnaire au capitalisme. Depuis lors, les choses sont devenues plus difficiles, mais plus profondes.
- "On parle peut être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968. Mais lorsqu' aujourd'hui le mot est crié dans une manifestation qui dénonce la nature bourgeoise des syndicats à Rome ou dans une manifestation de chômeurs à Bilbao il a un sens autrement plus concret et profond que dans les assemblées enfiévrées et pleines de fausses illusions de 1968.
1968 avait affirmé le retour de l'objectif révolutionnaire. Pendant 20 années les conditions de sa réalisation n'ont cessé de mûrir. L'enfoncement du capitalisme dans sa propre impasse, la situation de plus en plus insupportable que cela crée pour l'ensemble des classes exploitées, l'expérience cumulée par la combativité ouvrière, tout cela conduit à cette situation dont parlait Marx, qui rend "tout retour en arrière impossible".
Le tournant de 1989
Il y a beaucoup de choses dans cette analyse auxquelles nous pouvons toujours adhérer aujourd’hui. Et cependant, nous ne pouvons qu’être frappés par une phrase qui résume l’évaluation de la troisième vague de lutte de cet article :
"Enfin, la récente mobilisation des travailleurs de la Ruhr en Allemagne et la reprise des grèves en Grande-Bretagne en 1988 (voir l'éditorial de ce numéro) confirment que cette troisième vague internationale de luttes ouvrières, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans est loin d'être terminée".
En fait, la troisième vague, et d’ailleurs toute la période de luttes depuis 1968, devait arriver à une fin subite avec l’effondrement du bloc de l’Est en 1989-91 et la marée de campagnes sur la mort du communisme qui l’a accompagné. Le changement historique dans la situation mondiale a marqué l’arrivée définitive d’une nouvelle phase dans le déclin du capitalisme : la phase de décomposition.
Le CCI avait déjà remarqué les symptômes de décomposition antérieurement, dans les années 80, et une discussion à propos de ses implications pour la lutte de classe était déjà en cours dans l’organisation. Cependant, l’article sur Mai 68 dans la Revue Internationale 53 aussi bien que l’éditorial dans le même numéro, montrent clairement que sa signification la plus profonde n’avait pas été saisie. L’article sur 68 a un sous-titre "20 ans de décomposition" sans que soit fournie une explication du terme, alors que l’éditorial ne s’applique qu’à ses manifestations au niveau des conflits impérialistes – le phénomène qui a ensuite été qualifié de "libanisation", la tendance de pays-nations entiers à se désintégrer sous le poids de rivalités impérialistes de plus en plus irrationnelles. Il est probable que ces imprécisions aient reflété les réelles différences qui étaient apparues au 8ème congrès du CCI vers la fin de 1988.
L’ambiance dominante à ce congrès avait été celle d’un optimisme et d’une euphorie illusoires. Cela reflétait en partie l’enthousiasme compréhensible causé par l’intégration de deux nouvelles sections du CCI au congrès, au Mexique et en Inde. Mais cela s’exprimait surtout dans certaines analyses de la lutte de classe qui avaient été mises en avant : l’idée que ce n’était une question de mois pour que les nouvelles mystifications bourgeoises s'usent à leur tour, des espoirs démesurés dans les luttes qui avaient lieu en Russie, la conception d’une troisième vague qui avançait toujours avec des hauts et des bas, et par-dessus tout, une réticence à accepter l’idée que, face à la décomposition sociale croissante, le lutte de classe semblait marquer un "temps d’arrêt" ou piétiner (ce qui, étant donnée la gravité des enjeux en résultant, ne pouvait qu’impliquer une tendance au reflux ou à la régression). Ce point de vue était défendu par Marc Chirik et une minorité de camarades au congrès. Il était fondé sur une claire conscience que le développement de la décomposition exprimait une sorte de blocage historique entre les classes. La bourgeoisie n’avait pas infligé une défaite historique décisive à la classe ouvrière, et n’était pas capable de la mobiliser pour une nouvelle guerre mondiale ; mais la classe ouvrière, malgré les 20 ans de lutte qui avaient empêché la marche à la guerre, et qui d’ailleurs avaient vu des développements importants de la conscience de classe, avait été incapable de développer la perspective de la révolution, de poser sa propre alternative politique à la crise du système. Privé de toute issue mais toujours enfoncé dans une crise économique de longue durée, le capitalisme commençait à pourrir sur pied, et cette pourriture affectait la société capitaliste à tous les niveaux.[7]
Ce diagnostic a été puissamment confirmé par l’effondrement du bloc de l’Est. D’un côté, cet événement considérable était un produit de la décomposition. Il mettait en lumière l’impasse profonde de la bourgeoisie stalinienne qui était empêtrée dans un bourbier économique mais manifestement incapable de mobiliser ses travailleurs dans une solution militaire à la banqueroute de son économie (les luttes en Pologne en 1980 l’avaient clairement démontré à la classe dominante stalinienne). En même temps, il montrait les faiblesses politiques graves de cette partie de la classe ouvrière mondiale. Le prolétariat du bloc russe avait certes démontré sa capacité à lutter sur le terrain économique défensif, mais confronté à un événement historique énorme qui s’exprimait lui-même largement au niveau politique, il était complètement incapable d’offrir sa propre alternative et, en tant que classe, a été noyé dans le soulèvement démocratique faussement décrit comme une série de "révolutions du peuple".
En retour, ces événements ont considérablement accéléré le processus de décomposition à l’échelle mondiale. C’était plus évident au niveau impérialiste, quand l’effondrement rapide du vieux système des blocs a permis à la tendance au "chacun pour soi" de dominer de façon croissante les rivalités diplomatiques et militaires. Mais c’était vrai aussi concernant le rapport de force entre les classes. Dans le sillage de la débâcle du bloc de l’Est, les campagnes de la bourgeoisie mondiale sur la mort du communisme, sur l’impossibilité de toute alternative de la classe ouvrière au capitalisme, ont porté d’autres coups à la capacité de la classe ouvrière internationale – en particulier dans les pays centraux du système – à engendrer une perspective politique.
Le CCI n’avait pas prévu les événements de 1989-91, mais a été capable de leur répondre avec une analyse cohérente basée sur le travail théorique antérieur. Cela était vrai en ce qui concerne à la fois la compréhension des facteurs économiques impliqués dans la chute du stalinisme[8] , et la prévision du chaos grandissant qui, en l’absence de blocs, allait alors se déchainer dans la sphère des conflits impérialistes[9]. Quant au niveau de la lutte de classe, nous avons été capables de voir que le prolétariat était maintenant confronté à une période particulièrement difficile :
- "L'identification systématiquement établie entre communisme et stalinisme, le mensonge mille fois répété, et encore plus martelé aujourd'hui qu'auparavant, suivant lequel la révolution prolétarienne ne peut conduire qu'à la faillite, vont trouver avec l'effondrement du stalinisme, et pendant toute une période, un impact accru dans les rangs de la classe ouvrière. C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat, dont on peut dès à présent - notamment avec le retour en force des syndicats- noter les manifestations, qu'il faut s'attendre. Si les attaques incessantes et de plus en plus brutales que le capitalisme ne manquera pas d'asséner contre les ouvriers vont les contraindre à mener le combat, il n'en résultera pas, dans un premier temps, une plus grande capacité pour la classe à avancer dans sa prise de conscience. En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats.
Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classes, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne. Cela dit, on ne peut en prévoir à l'avance l'ampleur réelle ni la durée. En particulier, le rythme de l'effondrement du capitalisme occidental - dont on peut percevoir à l'heure actuelle une accélération avec la perspective d'une nouvelle récession ouverte - va constituer un facteur déterminant du moment où le prolétariat pourra reprendre sa marche vers la conscience révolutionnaire."[10]
Ce passage est très clair sur l’impact profondément négatif de l’effondrement du stalinisme, mais il contient encore une certaine sous-estimation de la profondeur du reflux. L'estimation selon laquelle "cela serait momentané" affaiblit déjà la position qui suit affirmant que le recul allait être "beaucoup plus profond que celui qui a accompagné la défaite de 1981 en Pologne", et ce problème allait se manifester dans notre analyse au cours des années qui ont suivi, en particulier dans l’idée que certaines luttes dans les années 90 – en 92 et de nouveau en 98 – marquaient la fin du recul. En réalité, à la lumière des trois dernières décennies, nous pouvons dire que le recul dans la conscience de classe n’a pas seulement continué, mais s’est approfondi, causant une espèce d’amnésie vis-à-vis des acquis et des avancées de la période 1968-1989.
Quels sont les principaux indicateurs de cette trajectoire ?
- L’impact de la crise économique à l’Ouest n’a pas été aussi linéaire que le passage cité ci-dessus l’implique. Les convulsions répétées de l’économie ont certainement affaibli les rodomontades de la classe dominante au début des années 90, selon lesquelles, avec la fin du bloc de l’Est, nous allions alors entrer dans une période de prospérité absolue. Mais la bourgeoisie a été capable de développer de nouvelles formes de capitalisme d’État et des manipulations économiques (caractérisées dans le concept de "néo-libéralisme") qui ont maintenu au moins une illusion de croissance, tandis que le développement réel de l’économie chinoise en particulier en a convaincu beaucoup que le capitalisme peut s’adapter indéfiniment et toujours trouver des nouvelles façons de se sortir de sa crise. Et quand les contradictions sous-jacentes revenaient à la surface, comme elles l’ont fait avec le grand crash financier de 2008, elles peuvent avoir stimulé certaines réactions prolétariennes (dans la période 2010-2013 par exemple) ; mais en même temps, la forme même qu’a pris cette crise "un resserrement du crédit" impliquant une perte massive des économies pour des millions de travailleurs, rendait plus difficile de répondre sur un terrain de classe, puisque l’impact semblait plus affecter les ménages individuels qu’une classe associée.[11]
- La décomposition sape cette conscience du prolétariat en tant que force sociale distincte de beaucoup de façons, qui exacerbent toutes l’atomisation et l’individualisme inhérents à la société bourgeoise. Nous pouvons voir cela, par exemple, à travers la tendance à la formation de gangs dans les centres urbains, qui expriment à la fois un manque de toute perspective économique pour une partie considérable de la jeunesse prolétarienne, et une recherche désespérée d’une communauté de rechange qui aboutit à la création de divisions meurtrières entre les jeunes, basées sur des rivalités entre différents quartiers et différentes conditions, sur la concurrence pour le contrôle de l’économie locale de la drogue, ou sur des différences raciales ou religieuses. Mais la politique économique de la classe dominante a aussi délibérément attaqué tout sentiment d’identité de classe – à la fois en faisant éclater le vieux centres industriels de résistance de la classe ouvrière et en introduisant des formes beaucoup plus atomisées de travail, comme ladite "gig economy" (économie des petits boulots) où les ouvriers sont régulièrement traités comme des "autoentrepreneurs".
- Le nombre croissant de guerres sanglantes et chaotiques qui caractérise cette période tout en réfutant carrément l’affirmation selon laquelle la fin du stalinisme ferait cadeau à l’humanité d’un "dividende de paix", ne fournit pas la base d’un développement général de la conscience de classe, comme il l’a fait par exemple au cours de la Première Guerre mondiale, quand le prolétariat des pays centraux était directement mobilisé pour la tuerie. La bourgeoisie a appris des conflits sociaux du passé provoqués par la guerre (y compris la résistance contre la guerre du Vietnam) et, dans les pays clefs en Occident, elle a fait de son mieux pour éviter l’emploi d’armées de conscrits et pour confiner ses guerres à la périphérie du système. Cela n’a pas empêché ces confrontations militaires d’avoir un impact très réel sur les pays centraux, mais cela a pris principalement des formes qui tendent à renforcer le nationalisme et à se reposer sur la "protection" de l’État : l’accroissement énorme du nombre de réfugiés qui fuient les zones de guerre, et l’action des groupes terroristes visant à riposter contre la population des pays les plus développés[12].
- Au niveau politique, en l'absence d'une perspective prolétarienne claire, nous avons vu différentes parties de la classe ouvrière être influencées par les fausses critiques du système offertes par le populisme d'une part et le djihadisme d'autre part. L'influence croissante de la "politique identitaire" parmi les couches les plus instruites de la classe ouvrière est une autre expression de cette dynamique : le manque d'identité de classe est aggravé par la tendance à la fragmentation en identités raciales, sexuelles et autres, renforçant l'exclusion et la division, alors que seul le prolétariat qui lutte pour ses propres intérêts peut être véritablement inclusif.
Nous devons faire face à la réalité de toutes ces difficultés et en dégager les conséquences politiques pour la lutte pour changer la société. Mais, dans notre vision, alors que le prolétariat ne peut éviter la dure école des défaites, les difficultés croissantes et même des défaites partielles ne sont pas encore parvenus au point de signifier une défaite historique de la classe et la disparition de la possibilité du communisme.
Dans les dernières décennies ou à peu près, il y a eu un certain nombre de mouvements importants qui donnent une assise à cette conclusion. En 2006, nous avons vu la mobilisation massive de la jeunesse scolarisée en France contre le CPE[13]. Les media de la classe dominante décrivent souvent les luttes en France, même si elles sont étroitement contrôlées par les syndicats, comme dans la dernière occasion[14], comme agitant le spectre d’un "nouveau Mai 68", la meilleure façon de déformer les leçons réelles de Mai. Mais le mouvement de 2006 a fait, dans un sens, revivre "l’esprit" authentique de 68 : d’un côté, parce que ses protagonistes redécouvraient des formes de lutte qui étaient apparues à cette époque, en particulier les assemblées générales où pouvaient avoir lieu de réelles discussions, et où les jeunes participants étaient prêts à écouter le témoignage de camarades plus âgés qui avaient pris part aux événements de 68. Mais en même temps, ce mouvement, qui avait débordé l'encadrement syndical, contenait le risque réel d’attirer les employés et les ouvriers dans une voie semblablement "incontrôlée", précisément comme en mai 1968, et c’est pourquoi le gouvernement a retiré son projet de loi.
En mai 2006 également, 23 000 métallurgistes de Vigo, dans la province de Galice en Espagne se sont mis massivement en grève contre une réforme du travail dans ce secteur et au lieu de rester enfermés dans l’usine, sont allés chercher la solidarité d’autres entreprises, notamment aux portes des chantiers navals et des usines Citroën, ont organisé des manifestations dans la ville pour rallier toute la population et surtout des assemblées générales publiques quotidiennes totalement ouvertes aux autres travailleurs, actifs, chômeurs ou retraités. Ces assemblées prolétariennes ont été le poumon d’une lutte aux méthodes exemplaires pendant une semaine, jusqu’à ce que le mouvement soit pris en tenailles entre la répression violente et les manœuvres négociatrices des syndicats avec la direction.
En 2011, nous avons vu la vague de révoltes sociales au Moyen Orient et en Grèce, qui a culminé dans le mouvement des "Indignados" en Espagne ou "Occupy" aux États-Unis. L’élément prolétarien dans ces mouvements était variable d’un pays à l’autre, mais il a été le plus fort en Espagne, où nous avons vu l’adoption largement répandue de la forme assemblée ; un élan internationaliste puissant qui saluait les expressions de solidarité de participants de tous les coins du monde et où le mot d’ordre "révolution mondiale" était pris au sérieux, peut-être pour la première fois depuis la vague révolutionnaire de 1917 ; une reconnaissance que "le système est obsolète" et une forte volonté de discuter la possibilité d’une nouvelle forme d’organisation sociale. Dans les nombreuses discussions animées qui ont eu lieu dans les assemblées et les commissions sur les questions de morale, science et culture, dans la remise en question omniprésente des dogmes selon lesquels les rapports capitalistes sont éternels – on a vu ici de nouveau l’esprit réel de mai 68 prendre forme.
Evidemment, la plupart de ces mouvements présentaient de nombreuses faiblesses que nous avons analysées ailleurs[15], la moindre n’étant pas la tendance chez ceux qui participaient à se voir comme "citoyens" plutôt que comme prolétaires, et donc une réelle vulnérabilité à l’idéologie démocratique qui allait permettre aux partis bourgeois comme Syriza en Grèce et Podemos en Espagne de se présenter comme les vrais héritiers de ces révoltes. Et, d’une certaine façon, comme dans toute défaite prolétarienne, plus haut vous montez, plus bas vous tombez : le reflux de ces mouvements a approfondi encore le recul général ans la conscience de classe. En Egypte, où le mouvement sur les places a inspiré le mouvement en Grèce et en Espagne, les illusions sur la démocratie avaient préparé la voie à la restauration de la même sorte de gouvernance autoritaire qui avait été le catalyseur initial du "printemps arabe" ; en Israël, où les manifestations de masse ont lancé une fois le mot d’ordre internationaliste : "Netanyahu, Moubarak, Assad, même ennemi", la politique militariste brutale du gouvernement Netanyahu a repris maintenant le dessus. Et plus grave que tout, en Espagne, beaucoup de jeunes gens qui avaient pris part au mouvement des "Indignados" ont été embarqués dans l’impasse absolue du nationalisme catalan ou espagnol.
L’apparition de cette nouvelle génération de prolétaires dans les mouvements de 2006 et 2011 a aussi donné naissance à une nouvelle recherche de la politique communiste dans une minorité, mais les espoirs que cela ferait surgir tout un nouvel apport de forces révolutionnaires ne se sont pas, pour l’instant, réalisés. La Gauche communiste reste largement isolée et désunie ; chez les anarchistes, où certains nouveaux développements intéressants commençaient à avoir lieu, la recherche de positions de classe a été sapée par l’influence de la politique identitaire et même du nationalisme. Dans un troisième article de cette série, nous analyserons plus en détail l’évolution du camp politique prolétarien et de son environnement depuis 1968.
Mais si Mai 68 nous enseigne quelque chose, il montre que la classe ouvrière peut se relever de nouveau des pires des défaites, resurgir des plus profondes retraites. Les moments de révolte prolétarienne qui ont eu lieu en dépit de la menace qui grandit de décomposition capitaliste révèlent la possibilité que surgissent de nouveaux mouvements, qui, en retrouvant la perspective de la révolution, peuvent déjouer les multiples dangers que la décomposition fait peser sur le futur de l’espèce.
Ces dangers – l’expansion du chaos militaire, de la catastrophe écologique, de la famine et des maladies à une échelle sans précédent – prouvent que la révolution est plus que jamais une nécessité pour l'espèce humaine. Le déclin du capitalisme et la décomposition amplifient certainement la menace que la base objective d’une nouvelle société puisse être définitivement détruite si la décomposition avance au-delà d’un certain point. Mais même dans sa dernière phase, le capitalisme produit encore les forces qui peuvent être employées pour le renverser – dans les termes du Manifeste Communiste de 1848, "ce que produit, par-dessus tout, la bourgeoisie, c’est son propre fossoyeur". Le capitalisme, ses moyens de production et de communication sont plus globaux que jamais – mais ainsi le prolétariat est plus international, plus capable de communiquer en son sein à l’échelle mondiale. Le capitalisme est devenu beaucoup plus avancé au niveau technologique – mais il doit donc éduquer le prolétariat pour l’utilisation de sa science et de sa technologie qui peuvent être employées pour les besoins des hommes dans une future société plutôt que pour le profit. Ce prolétariat plus éduqué, plus concerné internationalement a sans cesse fait son apparition dans les mouvements sociaux récents, surtout dans les pays centraux du système, et jouera certainement un rôle clef dans toute future résurgence de la lutte de classe, comme le feront les nouvelles armées prolétarienne créées par la croissance vertigineuse mais maladive du capitalisme en Asie et dans les autres régions préalablement "sous-développées". Nous n’avons pas vu la fin ni l'enterrement de l’esprit de mai 68.
Amos, juin 2018
[1] Voir par exemple World Revolution 315 "Réunion du CCI sur "1968 et tout çà" : la perspective ouverte il y a 40 ans n’a pas disparu [771]"
[2] « Il y a 50 ans, mai 68. Première partie :" l’enfoncement dans la crise économique" [716]. Revue Internationale n° 160.
[3] Revue Internationale 53. L’article est signé RV, un des jeunes « vénézuéliens » qui a contribué à fonder RI en 1968.
[4] Voir en particulier : "la confusion des groupes communistes sur la période actuelle : sous-estimation de la lutte de classe [772]" dans la Revue Internationale 54, 3ème trimestre 1988.
[5] Voir en particulier l’article "Les années 1950 et 60 : Damen, Bordiga et la passion du communisme [773]" dans la Revue Internationale n°158.
[6] "20ans après 1968 – lutte de classe : le murissement des conditions de la révolution prolétarienne [770]"
[7] Pour un bilan plus développé des luttes des dernières décennies, qui prend en compte les tendances à surestimer le potentiel immédiat de la lutte de classe dans nos analyses, voir : "Rapport sur la lutte de classe [774] du 21ème Congrès du CCI", Revue Internationale 156, hiver 2016.
[8] Voir "Thèses sur la crise politique et économique dans les pays de l’Est [775]", Revue Internationale 60, 1er trimestre 1990, et dans notre brochure "Effondrement du Stalinisme".
[9] Voir en particulier "Texte d’orientation : Militarisme et décomposition [401]", Revue Internationale 64, 1er trimestre 1991.
[10] "Thèses sur la crise politique et économique dans les pays de l’Est", Revue Internationale 64, 1er trimestre 1990.
[11] Voir le point 15 de la Résolution sur la lutte de classe [701] du 22ème Congrès du CCI.
[12] Voir les points 16 et 17 de la résolution citée précédemment.
[13] CPE = contrat première embauche, une mesure visant à accroître la précarité du travail pour les jeunes travailleurs. Pour une analyse de ce mouvement, voir "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [148]", Revue Internationale n° 125, 2ème trimestre 2006.
[15] Voir "Les indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation de la lutte de classe [565]", Revue Internationale 147, 1er trimestre 2011.
Structure du Site:
- Séries [777]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [41]
Rubrique:
Á propos de nos réunions publiques sur le cinquantenaire de Mai 68
- 255 lectures
Mai 68 a-t-il vraiment signifié la fin de près d'un demi-siècle de contre-révolution ?
Le CCI a tenu des réunions publiques dans un certain nombre de pays et villes à l'occasion du 50e anniversaire de Mai 68. D'une manière générale l'assistance se reconnaissait globalement dans les principales caractérisations du mouvement que nous avons mises en avant:
- Ce qui donne à ces évènements leur caractère historique, c'est le réveil de la lutte de classe s'exprimant dans la grève ouvrière la plus massive ayant jamais existé à cette époque -10 millions d'ouvriers en grève- et dont le développement ne doit rien à l'action des syndicats mais tout à l'initiative des ouvriers eux-mêmes partant spontanément en lutte;
- Ce mouvement de la classe ouvrière, qui n'a en rien été à la remorque d'une agitation étudiante importante concomitante, a en partie été catalysé par la répression brutale des étudiants qui a suscité une indignation profonde chez les ouvriers;
- Cet épisode historique a donné naissance à ambiance inédite, telle qu'il n'en existe que lors de grands mouvements de la classe ouvrière: la parole se libère dans les rues, les universités et certaines entreprises occupées, qui deviennent le cœur d'intenses discussions politiques;
- Fondamentalement, ce formidable mouvement est le produit des premières morsures de la crise économique ouverte, qui faisait son retour en affectant une classe ouvrière dont les jeunes générations se libéraient du poids écrasant de la période de contre-révolution;
- Ce mouvement voyait ainsi la chute d'un verrou important de la lutte de classe, le contrôle écrasant du stalinisme et de ses courroies de transmission syndicales.
L'idée que Mai 68 avait constitué le signal d'un développement d'une vague de luttes à l'échelle internationale n'a en général pas surpris les participants. Mais paradoxalement, il n'en a pas toujours été de même concernant cette autre idée que Mai 68 marquait la fin de la longue période de contre-révolution résultant de la défaite de la première vague révolutionnaire mondiale et, en même temps, ouvrait un cours nouveau aux affrontements de classe entre bourgeoisie et prolétariat. En particulier un certain nombre de caractéristiques de la période actuelle, comme par exemple le développement de l'intégrisme, la multiplication des guerres sur la planète, etc. tendaient à être interprétés comme des signes d'une période contre-révolutionnaire.
C'est une erreur qui à notre avis a sa source dans une double difficulté.
D'une part la connaissance insuffisante de ce qu'a été la période de contre-révolution mondiale ouverte avec la défaite de la première vague révolutionnaire, et de ce fait une difficulté à saisir vraiment ce que veut dire pour la classe ouvrière et sa lutte une telle période, mais aussi pour l'humanité dans la mesure où la barbarie inhérente au capitalisme en crise n'y connait plus alors aucune limite. C'est pourquoi dans cet article nous prenons le parti de revenir de façon circonstanciée sur cette période.
D'autre part, la période ouverte avec Mai 68, bien qu'elle puisse paraître plus familière aux générations qui –directement ou indirectement- ont connu Mai 68, sa dynamique d'ensemble sous-jacente ne s'appréhende pas spontanément. En particulier, elle peut se trouver occultée par des évènements, des situations qui pour être importants n'en constituent pas pour autant des facteurs déterminants. C'est pourquoi nous reviendrons également sur cette période en mettant en évidence ses différences fondamentales avec la période de contre-révolution.
L'histoire de la lutte de classe est faite d'avancées et de reculs
Le phénomène que chacun a pu constater à un niveau immédiat, à savoir qu'après une lutte la mobilisation ouvrière tend à retomber et souvent avec elle la volonté de se battre, existe aussi à un niveau plus profond à l'échelle de l'histoire. En fait, celle-ci permet de vérifier la validité de ce qu'avait signalé Marx à ce sujet dans Le 18 Brumaire, c'est-à-dire l'alternance de poussées, souvent très vives et fulgurantes de la lutte prolétarienne (1848-49, 1864-71, 1917-23) et de reculs de celle-ci (à partir de 1850, 1872, et 1923) qui d'ailleurs, à chaque fois, ont conduit à la disparition ou à la dégénérescence des organisations politiques que la classe s'était donnée dans la période de montée des luttes (Ligue des Communistes : création en 1847, dissolution en 1852; AIT -Association Internationale des Travailleurs-: fondation en 1864, dissolution en 1876; Internationale Communiste : fondation en 1919, dégénérescence et mort dans le milieu des années 20; la vie de l'Internationale Socialiste 1889-1914, ayant suivi un cours globalement similaire mais de façon moins nette. ("Le cours historique [568]", Revue internationale n° 18)
La défaite de la première vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 a ouvert la période de contre-révolution, la plus longue, la plus profonde et la plus terrible, jamais subie par le prolétariat conduisant à la perte de ses repères par la classe ouvrière dans son ensemble, les rares organisations demeurées fidèles à la révolution se réduisant à d'infimes minorités. Mais aussi ouvrant la porte à un déchainement de la barbarie qui allait surpasser les horreurs de la Première Guerre mondiale. C'est par contre une dynamique inverse qui s'est développée depuis 1968, et rien ne permet de dire qu'actuellement cette dernière ait à son tour été épuisée, malgré les difficultés importantes que connait le prolétariat depuis le début des années 1990 avec l'extension et l'approfondissement de la barbarie sur la planète.
La période 1924 – 1967: la plus profonde contre-révolution jamais subie par la classe ouvrière
L'expression "Il est minuit dans le siècle", du titre d'un livre de Victor Serge[1], s'applique parfaitement à la réalité de ce cauchemar long de près d'un demi-siècle.
Différents coups terribles portés très tôt à la vague révolutionnaire mondiale ouverte avec la révolution russe en 1917, constituent déjà l'antichambre de la longue série des offensives bourgeoises contre la classe ouvrière qui précipiteront le mouvement ouvrier dans les abysses de la contre-révolution. Car, pour la bourgeoisie, il ne s'agira pas seulement de vaincre la révolution, il faudra porter à la classe ouvrière des coups dont elle ne puisse se relever. Face à une vague révolutionnaire mondiale qui avait menacé l'ordre capitaliste mondial, et c'était effectivement son objectif conscient et affiché[2], la bourgeoisie ne pouvait simplement se contenter de faire refluer le prolétariat. Elle devait faire tout ce qui était en son pouvoir afin qu'à l'avenir cette expérience laisse une image telle aux prolétaires du monde entier qu'il ne leur viendrait jamais plus l'envie de recommencer. Il lui fallait, aussi et surtout, tenter de discréditer à jamais l'idée de révolution communiste et de la possibilité d'établir une société sans guerre, sans classes et sans exploitation. Pour cela elle a pu bénéficier de circonstances politiques qui lui ont été considérablement favorables: la perte du bastion révolutionnaire en Russie ne s'est pas effectuée par sa défaite dans l'affrontement militaire aux armées blanches qui tentèrent d'envahir la Russie, mais suite à sa propre dégénérescence interne (à la quelle bien sûr l'effort de guerre considérable contribua grandement). Si bien qu'il sera aisé à la bourgeoisie de faire passer pour du communisme la monstruosité qui est née de la défaite politique de la révolution, l'URSS socialiste. Il fallait dans le même temps que cette dernière soit perçue comme étant la destinée inévitable de toute lutte du prolétariat pour son émancipation. À ce mensonge, participeront toutes les fractions de la bourgeoisie mondiale, dans tous les pays, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche trotskyste[3].
Lorsque les principales bourgeoisies impliquées dans la guerre mondiale mirent un terme à celle-ci en novembre 1918, ce fut dans le but évident d'éviter que de nouveaux foyers révolutionnaires ne viennent grossir le flot de la révolution, victorieuse en Russie et menaçante en Allemagne, alors que la bourgeoisie de ce pays se trouvait affaiblie par la défaite militaire. Cela permit d'empêcher que la fièvre révolutionnaire, stimulée par la barbarie des champs de batailles ainsi que par l'exploitation et la misère insupportables à l'arrière des lignes de front, ne s'emparent également d'autres pays comme la France, la Grande-Bretagne, … Et ce but fut globalement atteint. Dans les pays vainqueurs, le prolétariat qui avait pourtant acclamé avec ferveur la révolution russe, ne s'engagea pas massivement derrière le drapeau de la révolution en vue du renversement du capitalisme, afin d'en finir pour toujours avec les horreurs de la guerre. Épuisé par quatre années de souffrance dans les tranchées ou dans les usines d'armement, il aspirait plutôt à se reposer en "profitant" de la paix que venaient de lui "offrir" les brigands impérialistes. Et vu que dans toutes les guerres, c'est toujours le vaincu qui, en dernière analyse, est reconnu comme le fauteur de celles-ci, dans le discours de l'Entente (France, Royaume Unis, Russie) la responsabilité du capitalisme comme un tout s'effaçait derrière celle des empires centraux (Allemagne, Autriche, Hongrie). Pire, en France, la bourgeoisie promettait aux ouvriers une nouvelle ère de prospérité sur la base des réparations qui seraient imposées à l’Allemagne. Ce faisant le prolétariat en Allemagne et en Russie tendait à être d'autant plus isolé.
Mais ce qui adviendra, dans les pays vainqueurs comme dans les vaincus, c'est l'avenir que Rosa Luxemburg avait tracé dans sa brochure de Junius: si le prolétariat mondial ne parvenait pas, par sa lutte révolutionnaire, à ériger une nouvelle société sur les ruines fumantes du capitalisme, alors inévitablement ce dernier infligerait à l'humanité à des calamités encore bien pires.
L'histoire de cette nouvelle descente aux enfers, qui culminera avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, se confond sur beaucoup d'aspects avec celle de la contre-révolution qui connaîtra son apogée à la fin de ce conflit.
L'offensive des armées blanches contre la Russie soviétiques et l'échec des tentatives révolutionnaires en Allemagne et en Hongrie
Très tôt après Octobre 1917, le pouvoir soviétique est confronté aux offensives militaires de l'impérialisme allemand qui ne veut pas entendre parler de paix[4]. Les armées blanches, soutenues économiquement depuis l'étranger, se structurent dans plusieurs parties du pays. Et puis, de nouvelles armées blanches, directement mises sur pieds depuis l'étranger, sont lancées contre la révolution et ce jusqu'en en 1920. Le pays est encerclé, pris en étau par les armées blanches et asphyxié économiquement. La guerre civile laisse derrière elle un pays totalement exsangue. Près de 980 000 morts dans les rangs de l’Armée Rouge, aux alentours de 3 millions au sein des populations civiles.[5]
En Allemagne, l’axe de la contre-révolution est constitué par l’alliance de deux forces majeures: le SPD traitre et l’armée. Celles-ci sont à l'origine de la mise sur pieds d'une nouvelle force, les Corps francs, les mercenaires de la contre-révolution, le noyau de ce qui deviendra le mouvement nazi. La bourgeoisie inflige un coup terrible au prolétariat berlinois en l'entrainant dans une insurrection prématurée à Berlin réprimée sauvagement en janvier 1919 (la commune de Berlin). Des milliers d'ouvriers berlinois et de communistes - vu que la majorité d’entre eux étaient également ouvriers - sont assassinés (1200 ouvriers sont passés par les armes), suppliciés et jetés en prisons. R. Luxemburg, K. Liebknecht et ensuite Léo Jogisches sont assassinés. La classe ouvrière perdait une partie de son avant-garde et son plus clairvoyant leader en la personne de Rosa Luxemburg, laquelle aurait constitué une précieuse boussole face aux tourmentes à venir.
En plus de l'incapacité du mouvement ouvrier en Allemagne à déjouer cette manœuvre, celui-ci souffrira d'un manque criant de coordination entre les différents centres du mouvement: Après la commune de Berlin, des luttes défensives éclatent dans la Ruhr impliquant des millions de mineurs, de sidérurgistes, d’ouvriers du textile des régions industrielles du Bas-Rhin et de Westphalie (1e trimestre 1919); s'ensuivront (fin mars) des luttes en Allemagne centrale et de nouveau à Berlin. Le conseil exécutif de la république des conseils de Bavière est proclamé à Munich puis il est renversé et la répression s'abat. Berlin, la Ruhr, de nouveau Berlin, Hambourg, Brème, l'Allemagne centrale, la Bavière, partout le prolétariat est écrasé paquet par paquet. Toute la férocité, la barbarie, la ruse, l'appel à la délation, et la technologie militaire sont mis au service de la répression. Ainsi par exemple, "pour reconquérir l'Alexanderplatz à Berlin, on a eu recours, pour la première fois dans l'histoire des révolutions, à toutes les armes utilisées sur les champs de bataille: artillerie légère et lourde, bombes pouvant peser jusqu'à un quintal, reconnaissance aérienne et bombardement aérien"[6]. Des milliers d'ouvriers sont fusillés ou tués dans les combats; les communistes sont pourchassés et beaucoup condamnés à mort.
Les ouvriers en Hongrie en mars se dressent eux-aussi contre le capital dans des affrontements révolutionnaires. Le 21 mars 1919 la République des conseils est proclamée mais elle est écrasée durant l'été par les troupes contre-révolutionnaires. Pour davantage d'information, lire nos articles de la Revue internationale[7].
Malgré les tentatives héroïques ultérieures du prolétariat en Allemagne, en 1920 (face au putsch de Kapp) et en 1921 (action de Mars)[8], qui témoignent de la persistance d'une forte combativité, il s'avèrera que la dynamique n'était plus au renforcement politique du prolétariat allemand comme un tout, mais bien l'inverse.
La dégénérescence de la révolution en Russie même
Les ravages des guerres contre les offensives de la réaction internationale, notamment les pertes considérables subies par le prolétariat; l'affaiblissement politique de celui-ci avec la perte de leur pouvoir politique par les conseils ouvriers et la dissolution de la Garde rouge; l'isolement politique de la révolution, tout cela a constitué le terrain favorable au développement de l'opportunisme au sein du parti bolchevique et de l'internationale communiste[9]. La répression l'insurrection de Kronstadt en 1921, qui eut lieu en réaction à la perte de leur pouvoir par les soviets, fut ordonnée par le parti bolchevique. D'avant-garde de la révolution au moment de la prise du pouvoir, celui-ci allait devenir l'avant-garde de la contre-révolution au terme d'une dégénérescence interne que n'ont pu empêcher les fractions qui ses sont dégagées au sein de ce parti pour justement y lutter contre l'opportunisme croissant[10].
Disparues les larges masses qui en Russie, Allemagne, Hongrie, … partaient à l'assaut du ciel. Celles-ci exsangues, épuisées, vaincues, n'en peuvent plus. Dans les pays vainqueurs de la guerre, le prolétariat s'est insuffisamment manifesté. Tout ceci allait signifier la défaite politique du prolétariat partout dans le monde.
Le stalinisme devient le fer de lance de la bourgeoisie mondiale contre la révolution
Le processus de dégénérescence de la révolution russe connait une accélération avec la prise de contrôle du parti bolchevique par Staline. L'adoption en 1925 de la thèse du "socialisme en un seul pays", laquelle devenait la doctrine du parti bolchevique et de l'Internationale communiste, a constitué un point de rupture et de non-retour. Cette véritable trahison de l'internationalisme prolétarien, principe de base de la lutte prolétarienne et de la révolution communiste, était désormais assumée et défendue par tous les partis communistes du monde[11] contre le projet historique de la classe ouvrière. En même temps qu'elle signe l'abandon de tout projet prolétarien, la thèse du socialisme en un seul pays correspond à la démarche d'insertion de la Russie dans le capitalisme mondial.
Dès le milieu des années 1920, Staline va mener une politique de liquidation impitoyable de tous les anciens compagnons de Lénine en utilisant à outrance les organes de répression que le Parti bolchevique avait mis en place pour résister aux armées blanches (notamment la police politique, la Tcheka). [12] L'ensemble du monde capitaliste avait reconnu en Staline l'homme de la situation, celui qui allait éradiquer les derniers vestiges de la révolution d'Octobre et auquel il fallait apporter tout le soutien nécessaire pour briser, exterminer la génération de prolétaires et de révolutionnaires qui, en pleine guerre mondiale, avaient osé engager la lutte à mort contre l'ordre capitaliste.[13]
Les révolutionnaires sont pourchassés et réprimés par le stalinisme, où qu'ils se trouvent, avec l'aide complice des grandes démocraties, les mêmes qui avaient envoyés leurs armées blanches pour affamer et tenter de renverser le pouvoir des soviets.
Désormais, "le socialisme c'est l'URSS de Staline", alors que le véritable projet prolétarien tend à disparaître des consciences
La Russie de Staline sera présentée par la bourgeoisie stalinienne, tout autant que par la bourgeoisie mondiale, comme la réalisation du but ultime du prolétariat, l'instauration du socialisme. Dans cette entreprise, toutes les fractions mondiales de la bourgeoisie ont collaboré, tant les fractions démocrates que les différents PC nationaux.
L'immense majorité de ceux qui croient encore à la révolution identifieront son but à l'instauration d'un régime du type de celui de l'URSS dans les autres pays. Plus la lumière sera faite sur la réalité de la situation de la classe ouvrière en URSS et plus s'approfondira une division dans le prolétariat mondial: Ceux qui continueront à défendre le caractère "progressiste" (malgré tous ses défauts), "sans bourgeoisie", de l'Union Soviétique; Ceux pour qui, au contraire, la situation en URSS constituera un épouvantail, mais sans pour autant avoir la force de concevoir un projet alternatif. Le projet prolétarien n'est plus alors porté que par des minorités de révolutionnaires, de plus en plus réduites, qui lui sont restées fidèles.
Le prolétariat face à la crise de 1929 et des années 1930
Les années qui suivent la crise de 1929 sont dramatiques pour les conditions de vie du prolétariat mondial, en particulier en Europe et aux États-Unis. Mais en général ses réactions à cette situation ne pourront pas constituer une réponse à même de déboucher sur une dynamique de développement de la lutte de classe et de remise en question de l'ordre établi. Loin s'en faut. Pire, des réactions notables en France et en Espagne seront dévoyées sur le terrain de l'impasse de la lutte antifasciste.
En France, la grande vague de grèves qui va suivre l'arrivée au gouvernement du Front Populaire en 1936 exprime clairement les limites de la classe ouvrière subissant la chape de plomb de la contre-révolution. La vague de grèves démarre avec des occupations spontanées d’usines et témoigne malgré tout d'une certaine combativité des travailleurs. Mais, dès les premiers jours, la gauche pourra se servir de cette gigantesque masse à manœuvrer pour imposer à l’ensemble de la bourgeoisie française les mesures de capitalisme d'État nécessaires pour faire face à la crise économique et préparer la guerre. S’il est vrai que pour la première fois on assista en France à des occupations d’usines, c’est aussi la première fois qu’on voit les ouvriers chanter à la fois l’Internationale et la Marseillaise, marcher derrière les plis du drapeau rouge mêlés à ceux du drapeau tricolore.[14] L’appareil d’encadrement que constituent le PC et les syndicats est maître de la situation, parvenant à enfermer dans les usines les ouvriers qui se laissent bercer au son de l’accordéon.
Le prolétariat espagnol étant resté relativement à l'écart de la Première Guerre mondiale et de la vague révolutionnaire[15], ses forces physiques demeuraient relativement intactes pour faire face aux attaques dont il a été victime tout au long des années 1930. Celles-ci feront néanmoins plus d'un million de morts entre 1931 et 1939), dont la partie la plus importante fut la conséquence de la guerre civile entre le camp républicain et celui du général Franco, laquelle n’avait strictement plus rien à voir avec la lutte de classe du prolétariat mais fut au contraire permise par son affaiblissement. La situation s'était précipitée en 1936 avec le coup d'État du général Franco. La riposte ouvrière avait alors été immédiate: le 19 juillet 36, les ouvriers déclarent la grève et se rendent massivement dans les casernes pour désarmer cette tentative, sans se préoccuper des directives contraires du Front Populaire et du gouvernement républicain. Unissant la lutte revendicative à la lutte politique, les ouvriers arrêtent par cette action la main meurtrière de Franco. Mais pas celle de la fraction de la bourgeoisie organisée dans le Front populaire. À peine un an plus tard, le prolétariat de Barcelone se soulève à nouveau, mais désespérément, en mai 1937, et se fait massacrer par le gouvernement de Front Populaire, le Parti Communiste Espagnol et sa succursale catalane du PSUC en tête, tandis que les troupes franquistes arrêtent volontairement leur avance pour permettre aux bourreaux staliniens d’écraser les ouvriers.
Cette terrible tragédie ouvrière, encore aujourd’hui mensongèrement présentée comme "une révolution sociale espagnole" ou "une grande expérience révolutionnaire" marque au contraire, à travers l’écrasement idéologique comme physique des dernières forces vives du prolétariat européen, le triomphe de la contre-révolution. Cette tuerie fut une répétition générale qui ouvrait la voie royale au déchaînement de la guerre impérialiste.[16]
Années 1930: la bourgeoisie a de nouveau les mains libres pour imposer sa solution face à la crise
La république de Weimar s'était illustrée par l'instauration d'une rationalisation poussée à l'extrême de l'exploitation de la classe ouvrière en Allemagne accompagnée par des mesures de représentation des ouvriers dans l'entreprise destinées à les mystifier.
En Allemagne, entre la république de Weimar (1923) et le fascisme (1933), aucune opposition ne se manifestera: la première avait permis l'écrasement de la menace révolutionnaire, de disperser le prolétariat, de brouiller sa conscience; la seconde, le nazisme, au terme de cette évolution, consacrera ce travail, réalisant d'une main de fer l'unité de la société capitaliste sur la base de l’étouffement de toute menace prolétarienne.[17]
Dans tous les pays européens se développent des partis se réclamant soit d'Hitler, soit de Mussolini, dont le programme est le renforcement et la concentration du pouvoir politique et économique aux mains d'un parti unique dans l'État. Leur développement se conjugue avec une vaste offensive anti-ouvrière de l'État, s'appuyant sur un appareil répressif renforcé par l'armée, et sur les troupes fascistes quand il le faut. De la Roumanie à la Grèce, on voit se développer des organisations de type fasciste qui, avec la complicité de l'État national, se chargent d'empêcher toute réaction ouvrière. La dictature capitaliste devenait ouverte, et prenait le plus souvent la forme du modèle mussolinien ou hitlérien.
Le maintien du cadre de la démocratie est néanmoins rendu possible dans les pays industrialisés les moins touchés par la crise. Celui-ci constitue même une nécessité pour mystifier le prolétariat. Le fascisme, en ayant fait naître "l'antifascisme", a renforcé les capacités de mystification des "puissances démocratiques". Sous couvert de l'idéologie des Fronts Populaires[18] qui permettent de maintenir les ouvriers désorientés derrière les programmes d'union nationale et de préparation à la guerre impérialiste, et en complicité avec la bourgeoisie russe, la plupart des PC inféodés au nouvel impérialisme organisent une vaste campagne sur la montée du péril fasciste.[19] La bourgeoisie n'a pu faire la guerre qu'en trompant les prolétaires, en leur faisant croire que c'était aussi leur guerre: "C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste." (Rapport sur la situation internationale de la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France [257])[20]
Les massacres de la Deuxième Guerre mondiale
La plupart des combattants enrôlés dans les deux camps ne sont pas partis la fleur au fusil, encore tétanisés par la mort de leurs pères à peine 25 ans auparavant. Et ce qu'ils ont rencontré n'a pas été pour leur remonter le moral: La "Guerre éclair" a quand même causé 90.000 morts et 120.000 blessés côté français, 27.000 morts côté allemand. La débâcle en France aura drainé dix millions de personnes dans des conditions épouvantables. Un million et demi de prisonniers sont expédiés en Allemagne. Partout des conditions de survie inhumaines: L'exode massif en France, la terreur de l'État nazi encadrant la population allemande.
En Italie comme en France, beaucoup d'ouvriers rejoignent le maquis dès cette époque. Le parti stalinien et les trotskistes leur font valoir l'exemple frauduleusement travesti de la Commune de Paris (les ouvriers ne se dressent-ils pas contre leur propre bourgeoisie menée par Pétain -le nouveau Thiers, alors que les allemands occupent la France?). Au milieu d'une population terrorisée et impuissante dans le déchaînement de la guerre, beaucoup d'ouvriers français et européens, embrigadés dans les bandes de résistants, vont désormais se faire tuer en croyant se battre pour la "libération socialiste" de la France, de l'Italie, …. Les bandes de résistants staliniens et trotskistes concentrent particulièrement leur propagande odieuse pour que les ouvriers se portent "au premier rang pour la lutte pour l'indépendance des peuples".
Alors que la première guerre mondiale avait fait 20 millions de morts, la seconde en fera 50 millions, dont 20 millions sont des russes tués sur le front européen. 10 millions de personnes périrent dans les camps de concentration, dont 6 millions sont à mettre au compte de la politique nazie d'extermination des juifs. Bien qu'aucune des exactions macabres du nazisme ne soit aujourd'hui inconnue du grand public, contrairement aux crimes des grandes démocraties, les crimes nazis demeurent une illustration irréfutable de la barbarie sans limite du capitalisme décadent, ... et aussi de l'hypocrisie odieuse du camp des alliés. En effet, lors de la libération, les alliés font mine de découvrir les camps de concentration. Pure mascarade pour dissimuler leur propre barbarie en exposant celle de l'ennemi vaincu. En fait la bourgeoisie, tant anglaise qu'américaine, connaissait parfaitement l'existence des camps et ce qui s'y passait. Et pourtant, chose étrange en apparence, elle n'en parle pratiquement pas pendant toute la guerre et n'en fait pas un thème central de sa propagande. En fait, les gouvernements de Churchill et Roosevelt craignaient comme la peste que les nazis n'expulsent massivement les Juifs pour vider les camps. C'est ainsi qu'ils refusèrent des offres visant à échanger 1 million de juifs. Même en échange de rien, ils n'en voulaient pas?[21]
Dans la dernière année de la guerre, ce sont les concentrations ouvrières qui sont directement visées par les bombardements pour affaiblir le plus possible la classe ouvrière en la décimant ou la terrorisant.
La bourgeoisie mondiale prend ses dispositions pour éliminer tout risque de surgissement du prolétariat
L'objectif visé est de prévenir la répétition d'un surgissement prolétarien comme en 1917 et 18 face aux horreurs de la guerre. C'est pourquoi les bombardements anglo-américains -sur l'Allemagne essentiellement mais aussi sur la France- se sont illustrés par de sinistres performances. Le bilan de ce qui fut sans conteste l'un des plus grands crimes de guerre de la seconde boucherie mondiale, autours de 200.000 morts[22] dont presque tous étaient des civils, le bombardement en 1945 de Dresde, ville hôpital sans aucun intérêt stratégique. Seulement pour décimer et terroriser les populations civiles[23]. À titre de comparaison, cet autre crime odieux que fut Hiroshima fit 75.000 victimes et les terribles bombardements américains sur Tokyo en mars 1945 provoquèrent 85.000 morts !
En 1943, alors que Mussolini avait été renversé et remplacé par le maréchal Badoglio, favorable aux Alliés, et que ces derniers contrôlaient déjà le Sud du pays, ils n'ont rien fait pour avancer vers le Nord. Il s'agissait de laisser les fascistes régler leur compte aux masses ouvrières qui s'étaient soulevées, sur un terrain de classe, dans les régions industrielles d'Italie du Nord. Interpellé pour cette passivité, Churchill répondra: "Il faut laisser les italiens mijoter dans leur jus".
Dès la fin de la guerre, les Alliés favorisent l'occupation russe partout où avaient surgi des révoltes ouvrières. L'Armée Rouge était la mieux placée pour ramener l'ordre dans ces pays soit en massacrant le prolétariat, soit en le détournant de son terrain de classe au nom du "socialisme".
Un partage du travail du même type se met en place entre l’Armée rouge et l’armée allemande. À Varsovie et à Budapest, alors qu'elle se trouvait déjà dans leurs faubourgs, l'Armée "rouge" laissera sans bouger le petit doigt, écraser par l'armée allemande, les insurrections visant à chasser celle-ci. Staline confiait ainsi à Hitler le soin de massacrer des dizaines de milliers d'ouvriers en armes qui auraient pu contrarier ses plans.[24]
Non contente d'offrir à Staline les territoires à "haut risque social", la bourgeoisie "démocratique" des pays vainqueurs appelle les PC au gouvernement dans la plupart des pays européens (notamment en France et en Italie) en leur dédiant une place de premier ordre dans les différents ministères (Thorez – secrétaire du parti communiste français - en France sera nommé vice-président du Conseil en 1944).
Immédiat après-guerre, la terreur imposée à la population allemande
Dans la continuité des massacres préventifs destinés à empêcher tout surgissement prolétarien en Allemagne à la fin de la guerre, ceux qui eurent lieu après celle-ci n'en sont pas moins barbares et expéditifs.
L'Allemagne en effet fut transformée en un vaste camp de la mort par les puissances occupantes russe, britannique, française et américaine. Beaucoup plus d'Allemands moururent après la guerre qu'au cours des batailles, sous les bombardements et dans les camps de concentration de la guerre. Selon James Bacque, l'auteur de "Crimes et miséricordes: Le sort des civils allemands sous occupation alliée, 1944-1950"[25], plus de 9 millions périrent comme résultat de la politique de l'impérialisme allié entre 1945 et 1950.
C'est seulement lorsque cet objectif meurtrier fut atteint et que l'impérialisme américain réalisa que l'épuisement de l'Europe après la guerre risquait de mener à la domination de l'impérialisme russe sur tout le continent et qu'en conséquence la politique de Potsdam fut changée. La reconstruction de l'Europe de l'Ouest exigeait la résurrection de l'économie allemande. Le pont aérien de Berlin en 1948 était le symbole de ce changement de stratégie[26]. Evidemment, tout comme le bombardement de Dresde, "… le plus beau raid de terreur de toute la guerre [qui] avait été l'œuvre des Alliés victorieux", la bourgeoisie démocratique a fait ce qui était possible afin d'obscurcir la réalité du véritable coût de la Barbarie largement partagée dans les deux camps de la Guerre mondiale.
Le prolétariat n'a pas été en mesure de s'élever dans une lutte frontale contre la guerre
Malgré des manifestations de luttes ponctuelles en différents endroits, et surtout celles en Italie en 1943, le prolétariat n'avait pas pu relever la tête en se dressant contre la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, comme il l'avait fait face à la Première.
La Première Guerre mondiale avait gagné des millions d'ouvriers à l'internationalisme, la seconde les a jetés dans les bas-fonds du plus abject chauvinisme, de la chasse aux "boches"[27] et aux "collabos"[28].
Le prolétariat a touché le fond. Ce qu'on lui présente, et qu'il interprète comme sa grande "victoire", le triomphe de la démocratie contre le fascisme, constitue sa défaite historique la plus totale. Elle permet d'ériger les piliers idéologiques de l'ordre capitaliste: Le sentiment de victoire et l'euphorie qui submergent le prolétariat, sa croyance dans les "vertus sacrées" de la démocratie bourgeoise – celle-là même qui l'a entrainé dans deux boucheries impérialistes et qui a écrasé sa révolution au début des années 1920. Et pendant la période de reconstruction, puis celle du "boom" économique de l'après-guerre, l'amélioration momentanée de ses conditions de vie à l'Ouest ne lui permet pas de mesurer la défaite véritable qu'il a subie.[29]
Dans les pays d'Europe de l'Est qui, eux, ne bénéficient pas de la manne américaine du plan Marshall puisque les partis staliniens l'ont refusée sur ordre de Moscou, la situation tarde plus longtemps à s'améliorer quelque peu. La mystification qu'on présente aux ouvriers est celle de la "construction du socialisme". Cette mystification remporte un certain succès, comme par exemple en Tchécoslovaquie où le "coup de Prague" de février 1948, c'est-à-dire la prise de contrôle du gouvernement par les staliniens, est réalisée avec la sympathie de beaucoup d'ouvriers.
Une fois épuisée cette illusion, des soulèvements ouvriers ont lieu comme en Hongrie en 1956, mais ils sont durement réprimés par les troupes russe.[30] L'implication des troupes russes dans la répression constitue alors un aliment supplémentaire du nationalisme dans les pays d'Europe de l'Est. En même temps, elle est utilisée abondamment par la propagande des secteurs "démocratiques" et pro-américains de la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale alors que les partis staliniens de ces pays utilisent cette même propagande pour présenter l'insurrection des ouvriers de Hongrie comme un mouvement chauvin, voire "fasciste", à la solde de l'impérialisme américain.
De plus, tout au long de la "Guerre froide", et même quand celle-ci a laissé place à la "coexistence pacifique" après 1956, la division du monde en deux blocs constitue un instrument de premier ordre de mystification de la classe ouvrière.
Dans les années 1950, le même type de politique que celle des années 1930 continue de diviser et désorienter la classe ouvrière: une partie de celle-ci ne veut plus rien savoir du communisme (identifié à l'URSS) alors que l'autre partie continue de subir la domination idéologique des partis staliniens et de leurs syndicats. Ainsi, dès la guerre de Corée, l'affrontement Est-Ouest est mis à profit pour opposer les différents secteurs de la classe ouvrière et embrigader des millions d'ouvriers derrière le camp soviétique au nom de "la lutte contre l'impérialisme". À la même période, les guerres coloniales constituent une occasion supplémentaire de détourner les ouvriers de leur terrain de classe au nom, encore une fois, de la "lutte contre l'impérialisme" (et non de la lutte contre le capitalisme) face auquel l'URSS est présentée comme le champion du "droit et de la liberté des peuples". Ce type de campagnes se poursuivra dans de nombreux pays tout au long des années 1950 et 1960, notamment avec la guerre du Vietnam où les États-Unis s'engagent massivement à partir de 1961.[31]
Une autre conséquence de ce très long et très profond recul de la classe ouvrière aura été la rupture organique avec les fractions communistes du passé[32], imposant ainsi aux futures générations de révolutionnaires la nécessité de se réapproprier de façon critique les acquis du mouvement ouvrier.
Mai 68, Fin de la contre-révolution
La crise de 1929 et des années 1930 avait, au mieux, suscité certaines réactions de combativité du prolétariat comme en France et en Espagne mais qui, comme on l'a vu précédemment, furent dévoyées du terrain de classe vers celui de l'antifascisme et de la défense de la démocratie, grâce à l'emprise des staliniens, des trotskistes, des syndicats. Ce qui ne fit que contribuer à encore approfondir la contre-révolution.
En 1968, on n'en est qu'au début du retour de la crise économique mondiale. Et pourtant, ce sont les effets en France de cette crise économique mondiale (montée du chômage, gel des hausses salariales, intensification des cadences de production, attaques contre la Sécurité sociale) qui expliquent en bonne partie la montée de la combativité ouvrière dans ce pays à partir de 1967. Loin de se laisser canaliser par les staliniens et les syndicats, le renouveau de la combativité ouvrière se détourne des "grévettes" et des journées d'action syndicales. Dès 1967, on assiste alors à des conflits très durs, très déterminés face à une violente répression patronale et policière et où les syndicats sont débordés à plusieurs reprises.
L'objet de cet article n'est pas de revenir dans tous les aspects importants de Mai 68 en France. Pour cela nous renvoyons le lecteur aux articles, "Mai 68 et la perspective révolutionnaire" écrits à l'occasion du 40e anniversaire de ces évènements[33]. Le rappel de certains faits est néanmoins important pour illustrer le changement de dynamique de la lutte de classe opéré en Mai 68.
Au mois de Mai, l'ambiance sociale change radicalement. "Le 13 mai, toutes les villes du pays connaissent les manifestations les plus importantes [en solidarité avec les étudiants victimes de la répression] depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La classe ouvrière est présente massivement aux côtés des étudiants. (…) À la fin des manifestations, pratiquement toutes les universités sont occupées non seulement par les étudiants mais aussi par beaucoup de jeunes ouvriers. Partout, la parole est libérée. Les discussions ne se limitent pas aux questions universitaires, à la répression. Elles commencent à aborder tous les problèmes sociaux: les conditions de travail, l’exploitation, l’avenir de la société (…) Le 14 mai, dans beaucoup d'entreprises, les discussions se poursuivent. Après les immenses manifestations de la veille [en solidarité avec les étudiants victimes de la répression], avec l'enthousiasme et le sentiment de force qui s'en sont dégagés, il est difficile de reprendre le travail comme si de rien n'était. À Nantes, les ouvriers de Sud-Aviation, entraînés par les plus jeunes d'entre eux, déclenchent une grève spontanée et décident d'occuper l'usine. La classe ouvrière a commencé à prendre le relais."[34]
L'appareil classique d'encadrement de la bourgeoisie ne fait pas le poids face à la spontanéité de la classe ouvrière à entrer en lutte. C'est ainsi que dans les trois jours qui suivent la manifestation du 13 Mai, la grève s'étend spontanément à des entreprises dans toute la France. Les syndicats débordés ne font qui suivre le mouvement. Pas de revendication précise. Un trait commun: grève totale, occupation illimitée, séquestration de la Direction, drapeau rouge arboré. Finalement, la CGT appelle à l'extension, tentant ainsi de "prendre le train en marche"[35]. Mais, avant même que ne soient connues les consignes de la CGT, il y a déjà un million des travailleurs en grève.
La conscience croissante de sa propre force par la classe ouvrière stimule la discussion en son sein et la discussion politique en particulier. Ceci n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, la vie politique qui traversait la classe ouvrière comme le rapportent les écrits de Trotsky et J. Reed à propos de l'effervescence révolutionnaire de 1917.
Le voile de mensonges tissés pendant des décennies par la contre-révolution et ses défenseurs tant staliniens que démocrates commence à s'étioler. Des vidéos d'amateurs tournées dans l'usine occupée de Sud-Aviation à Nantes montrent une discussion passionnée au sein d'un groupe d'ouvriers à propos du rôle des comités de grève dans la "dualité de pouvoir". La dualité de pouvoir en 1917 était le produit de la lutte pour le pouvoir réel entre l'état bourgeois et les conseils ouvriers. Dans beaucoup d'usines en grève, en 1968, les ouvriers avaient élus des comités de grève. Nous étions très loin d'être dans une situation prérévolutionnaire, mais ce qui était en cours c'était une tentative de la classe ouvrière de se réapproprier sa propre expérience, son passé révolutionnaire. Une autre expérience en atteste: "Certains ouvriers demandent à ceux qui défendent l'idée de la révolution de venir défendre leur point de vue dans leur entreprise occupée. C'est ainsi qu'à Toulouse, le petit noyau qui va fonder par la suite la section du CCI en France est invité à venir exposer l'idée des conseils ouvriers dans l'usine JOB (papier et carton) occupée. Et le plus significatif, c'est que cette invitation émane de militants... de la CGT et du PCF. Ces derniers devront parlementer pendant une heure avec des permanents de la CGT de la grande usine Sud-Aviation venus "renforcer" le piquet de grève de JOB pour obtenir l'autorisation de laisser entrer des "gauchistes" dans l'usine. Pendant plus de six heures, ouvriers et révolutionnaires, assis sur des rouleaux de carton, discuteront de la révolution, de l'histoire du mouvement ouvrier, des soviets de même que des trahisons... du PCF et de la CGT..."[36]
Une telle réflexion permettra à des milliers d'ouvriers de redécouvrir le rôle historique des conseils ouvriers, ainsi que des hauts faits de la lutte de la classe ouvrière, comme par exemples les tentatives révolutionnaires en Allemagne en 1919. De même, il se développe une critique du rôle joué par le PC (qui se définit alors lui-même comme un parti d'ordre) par rapport aux évènements de 1968 eux-mêmes mais également depuis la révolution russe. Ce fut ainsi la première remise en cause d'ampleur du stalinisme et du rôle des PC comme gardiens de l'ordre établi. La critique affecte également les syndicats, laquelle s'amplifiera lorsque ceux-ci se manifesteront ouvertement comme les diviseurs de la classe ouvrière pour lui faire reprendre le travail.[37]
C'est une autre époque qui s'ouvrait, caractérisée par une "renaissance" dans la conscience de classe dans les vastes masses ouvrières. Cette rupture avec la contre-révolution ne signifiait pas que cette dernière n'allait pas continuer de peser d'un poids négatif sur le développement ultérieur de la lutte de classe, ni non plus que la conscience ouvrière était exempte d'illusions très fortes, concernant en particulier les obstacles à surmonter sur le chemin de la révolution, beaucoup plus lointaine que la très grande majorité ne se l'imaginait à l'époque.
Une telle caractérisation de Mai 68, comme illustration de la fin de la période de contrerévolution trouvera sa confirmation dans le fait que, loin de rester un phénomène isolé, ces évènements constitueront au contraire le point de départ de la reprise de la lutte de classe à l'échelle internationale, aiguillonnée par l'approfondissement de la crise économique et dont le corollaire fut le développement d'un milieu politique prolétarien à l'échelle internationale[38]. La fondation en 1968 de "Révolution Internationale" en constitue en une illustration, puisque ce groupe jouera un rôle de premier plan dans le processus de regroupement qui mènera à la fondation du CCI en 1975, et dont "Révolution Internationale" est la section en France. Contrairement à la période noire de la contre-révolution, la bourgeoisie avait désormais face à elle une classe qui n'était pas prête à accepter les sacrifices de la guerre économique mondiale, et qui de plus constituait un obstacle au déclanchement de la Guerre mondiale, comme nous le verrons plus loin
La reprise internationale de la lutte de classe à partir de 1968
Le CCI vient de consacrer un article à cette question, "Les avancées et les reculs de la lutte de classe depuis 1968"[39] que nous conseillons à nos lecteur et auquel nous empruntons beaucoup d'éléments nécessaires à la mise en évidence des différences entre la période de contrerévolution et la période historique ouverte avec Mai 1968. En quelques mots la différence fondamentale entre la période de contre-révolution, initiée par une défaite profonde de la classe ouvrière, et celle ouverte avec Mai 68, réside dans le fait que, depuis ce surgissement de lutte et malgré toutes les difficultés auxquelles le prolétariat a été confronté, celui-ci n'a pas subi de défaite profonde.
L'approfondissement de la crise économique ouverte, qui n'en était qu'à ses débuts à la fin des années 1960, a poussé le prolétariat à développer sa combativité et sa conscience.
Trois vagues de luttes se sont succédé au cours des deux décennies après 68
La première, sans aucun doute la plus spectaculaire, a connu l’automne chaud italien en 69, le soulèvement violent à Cordoba en Argentine en 69 et en Pologne en 70, et des mouvements importants en Espagne et en Grande Bretagne en 1972. Il y eu aussi un automne chaud en Allemagne en 69 avec de nombreuses grèves sauvages. En Espagne en particulier, les travailleurs ont commencé à s'organiser à travers des assemblées de masse, un processus qui a atteint son point culminant à Vitoria en 1976. La dimension internationale de la vague a été démontrée par ses échos en Israël (1969) et en Egypte (1972) et, plus tard, par les soulèvements dans les townships d'Afrique du Sud qui ont été dirigés par des comités de lutte (les Civics).
Après une courte pause au milieu des années 70, il y a eu une deuxième vague avec les grèves des ouvriers du pétrole iraniens, les travailleurs des aciéries en France en 1978, "l’hiver du mécontentement" en Grande Bretagne, la grève des dockers à Rotterdam, dirigée par un comité de grève indépendant, et les grèves des sidérurgistes au Brésil en 1979 qui ont également contesté le contrôle des syndicats; En Asie il y a eu la révolte de Kwangju (Corée du Sud). Cette vague de luttes a connu son point culminant en Pologne en 1980, certainement l’épisode le plus important de la lutte de classe depuis 1968, et même depuis les années 1920.
Bien que la répression sévère des ouvriers polonais ait donné un coup d’arrêt à cette vague, il n’a pas fallu longtemps avant qu’un nouveau mouvement ait lieu avec les luttes en Belgique en 1983 et 1986, la grève générale au Danemark en 1985, la grève des mineurs en Angleterre en 1984-85, les luttes des cheminots et des travailleurs de la santé en France en 1986 et 1988, et le mouvement des employés de l’éducation en Italie en 1987. Les luttes en France et en Italie, en particulier –comme la grève de masse en Pologne– ont montré une réelle capacité d’auto organisation avec des assemblées générales et des comités de grève.
Ce mouvement en vagues de luttes ne tournait pas en rond, mais faisait faire de réelles avancées dans la conscience de classe s'exprimant à travers les caractéristiques suivantes:
- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;
- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière: journées d'action, manifestations-ballades-enterrements; les grèves longues et isolées...
Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:
- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier);
- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables (France fin 86, Italie 1987 principalement).
De même, les manœuvres de plus sophistiquées développées par la bourgeoisie pour faire face à la lutte de classe témoignent du développement de celle-ci durant cette période. C'est ainsi qu'elle a fait face au désenchantement croissant vis-à-vis des syndicats officiels et à la menace d’auto-organisation en développant des formes de syndicalisme, qui pouvaient même recouvrir des formes "en dehors des syndicats" (les coordinations mises en place par l’extrême gauche en France par exemple).
Le prolétariat frein à la guerre
Au terme de ces vingt années après 1968, la bourgeoisie n’ayant pas infligé de défaite historique décisive à la classe ouvrière, elle n'avait pas été capable de la mobiliser pour une nouvelle guerre mondiale, contrairement à la situation des années 1930 comme nous l'avons illustré précédemment dans cet article.
En effet, il était pour elle exclu de se lancer dans une guerre mondiale sans s'être auparavant assuré de la docilité du prolétariat, condition indispensable pour lui faire accepter les sacrifices requis par l'état de guerre, lequel exige la mobilisation de toutes les forces vives de la nation tant à la production que sur les fronts. En effet, un tel objectif était totalement irréaliste dès lors que le prolétariat n’était pas même pas prêt à se soumettre docilement aux mesures d’austérité que la bourgeoisie devait prendre pour faire face aux conséquences de la crise économique. C'est pourquoi la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu durant cette période alors que les tensions entre les blocs étaient à leur comble et que les alliances étaient déjà constituées à travers les deux blocs. De plus, dans aucune des concentrations historiques du prolétariat, la bourgeoisie n'a cherché à mobiliser celui-ci massivement pour participer comme chair à canon dans les différentes guerres locales, relevant de la rivalité Est-Ouest, et qui, pendant cette période également ont ensanglanté le monde.
Ceci est particulièrement vrais pour la classe ouvrière à l'Ouest, mais également pour celle de l'Est bien que plus faible politiquement compte-tenu des dégâts opérés par le rouleau compresseur du stalinisme, en URSS en particulier. En effet, la bourgeoisie stalinienne empêtrée dans un bourbier économique avait face à elle une classe qui luttait (comme l'avaient illustré en particulier les grèves en Pologne en 1980) et qu'il était donc manifestement impossible de mobiliser massivement dans une solution militaire à la banqueroute de son économie.
Cela dit, même si la classe ouvrière a constitué un obstacle à la guerre mondiale jusqu’à la fin des années 1980, du fait qu’elle avait été capable de développer ses luttes de résistance face aux attaques du capital dans les deux décennies après 1968 sans subir une défaite profonde inversant une dynamique mondiale de développement de la confrontation entre les classes, ce n’est pas pour autant qu’elle a été mesure d’empêcher les guerres sur la planète. En effet, durant cette période, celles-ci n’ont jamais cessé. Dans la plupart des cas, elles étaient l’expression des rivalités impérialistes entre l’Est et l’Ouest, ne s’exprimant pas un choc direct entre ceux-ci mais par pays interposés. Et dans ces pays appartenant à la périphérie capitalisme, le prolétariat ne constituait pas une force à même de paralyser le bras armé de la bourgeoisie.
Le prolétariat face à la décomposition du capitalisme
Malgré ces avancées opérées dans la lutte de classe à travers notamment des développements importants de la conscience de classe, et aussi le fait que la bourgeoisie n'avait pu embrigader le prolétariat pour un nouveau conflit mondial, la classe ouvrière avait néanmoins été incapable de développer la perspective de la révolution, de poser sa propre alternative politique à la crise du système.
Ainsi, aucune des deux classes fondamentales n'était en mesure d'imposer sa solution à la crise du capitalisme. Privé de toute issue mais toujours enfoncé dans une crise économique de longue durée, le capitalisme commençait à pourrir sur pieds, et cette pourriture affectait la société capitaliste à tous les niveaux. Le capitalisme entrait ainsi dans une nouvelle phase de sa décadence, celle de sa décomposition sociale. Ainsi que nous l'avons déjà souvent mis en évidence, cette phase est synonyme de difficultés renforcées pour la lutte du prolétariat[40].
En prenant du recul sur les trois dernières décennies, nous pouvons dire que le recul dans la conscience s’est approfondi, causant une espèce d’amnésie vis-à-vis des acquis et des avancées de la période 1968-1989 et qui s'explique fondamentalement par deux facteurs:
- L'impact énorme qu'avait eu l'effondrement du bloc de l'Est en 1989-91 mensongèrement identifié par les campagnes de la bourgeoisie à l'effondrement du communisme;
- Les caractéristiques de la période de décomposition elle-même, inaugurée par cet effondrement, à savoir en particulier: l'accroissement permanent de la criminalité, de l'insécurité, de la violence urbaine; le développement du nihilisme, du suicide des jeunes, du désespoir, de la haine et de la xénophobie; le raz-de-marée de la drogue; la profusion des sectes, le regain de l'esprit religieux, y compris dans certains pays avancés; le rejet d'une pensée rationnelle, cohérente, construite; l'envahissement des médias par le spectacle de la violence, de l'horreur, du sang, des massacres (…) le développement du terrorisme, des prises d'otages, comme moyens de la guerre entre États.
Malgré ces difficultés énormes de la classe ouvrière depuis 1990, deux éléments sont à prendre en compte pour comprendre la période actuelle:
- les difficultés croissantes et même des défaites partielles ne sont pas encore synonymes d’une défaite historique de la classe et de la disparition de la possibilité du communisme;
- la maturation sous-terraine se poursuit car, malgré la décomposition, le capitalisme continue et les deux classes antagoniques de la société se font face.
En effet, dans les dernières décennies, il y a eu un certain nombre de mouvements importants qui donnent une assise à cette analyse:
- En 2006, la mobilisation massive de la jeunesse scolarisée en France contre le CPE[41]. Ses protagonistes redécouvraient des formes de lutte qui étaient apparues en Mai 68, en particulier les assemblées générales où pouvaient avoir lieu de réelles discussions, et où les jeunes participants étaient prêts à écouter le témoignage de camarades plus âgés qui avaient pris part aux événements de 68. Ce mouvement, qui avait débordé l'encadrement syndical, contenait le risque réel d’attirer les employés et les ouvriers dans une voie semblablement "incontrôlée", précisément comme en mai 1968, et c’est pourquoi le gouvernement a retiré son projet de loi CPE.
- En mai 2006 également, 23 000 métallurgistes de Vigo, dans la province de Galice en Espagne se sont mis massivement en grève contre une réforme du travail dans ce secteur et au lieu de rester enfermés dans l’usine, sont allés chercher la solidarité d’autres entreprises, notamment aux portes des chantiers navals et des usines Citroën, ont organisé des manifestations dans la ville pour rallier toute la population et surtout des assemblées générales publiques quotidiennes totalement ouvertes aux autres travailleurs, actifs, chômeurs ou retraités.
- En 2011, la vague de révoltes sociales au Moyen Orient et en Grèce, qui a culminé dans le mouvement des "Indignados" en Espagne. L’élément prolétarien dans ces mouvements était variable d’un pays à l’autre, mais il a été le plus fort en Espagne, où nous avons eu la généralisation de la tenue d'assemblées générales; un élan internationaliste puissant qui saluait les expressions de solidarité de participants de tous les coins du monde et où le mot d’ordre "révolution mondiale" était pris au sérieux, peut-être pour la première fois depuis la vague révolutionnaire de 1917; une reconnaissance que "le système est obsolète" et une forte volonté de discuter la possibilité d’une nouvelle forme d’organisation sociale. Dans les nombreuses discussions animées qui ont eu lieu dans les assemblées et les commissions sur les questions de morale, science et culture, dans la remise en question omniprésente des dogmes selon lesquels les rapports capitalistes sont éternels – on a vu ici de nouveau l’esprit réel de mai 68 prendre forme. Evidemment, ce mouvement présentait de nombreuses faiblesses que nous avons analysées ailleurs[42], la moindre n’étant pas la tendance chez ceux qui participaient à se voir comme "citoyens" plutôt que comme prolétaires, et donc une réelle vulnérabilité à l’idéologie démocratique.
Les menaces que la survie du capitalisme fait courir à l'humanité prouvent que la révolution est plus que jamais une nécessité pour l'espèce humaine: l’expansion du chaos militaire, de la catastrophe écologique, de la famine et des maladies à une échelle sans précédent; La décadence du capitalisme et la décomposition amplifient certainement la menace que la base objective d’une nouvelle société puisse être définitivement détruite si la décomposition avance au-delà d’un certain point. Mais même dans sa dernière phase, le capitalisme produit encore les forces qui peuvent être employées pour le renverser – dans les termes du Manifeste Communiste de 1848, "ce que produit, par-dessus tout, la bourgeoisie, c’est son propre fossoyeur".
Ainsi, avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition, même si celle-ci s'accompagne de difficultés renforcées pour le prolétariat, rien n'indique que celui-ci ait subi une défaite aux conséquences irréversibles et de ce fait qu'il consentira à tous les sacrifices, tant ceux demandés concernant les conditions de travail, que ceux qu'implique l'embrigadement dans la guerre impérialiste.
Nous ne savons pas quand, ni avec quelle ampleur se produiront les prochaines manifestations de telles potentialités du prolétariat. Ce que nous savons par contre c’est que l’intervention déterminée et appropriée de la minorité révolutionnaire conditionne dès aujourd’hui le renforcement futur de la lutte de classe.
Silvio (juillet 2018)
[1] Victor Serge est d'abord connu pour sa célèbre narration de l'histoire de la révolution russe, L'an I de la Révolution russe.
[2] "Une nouvelle époque est née: l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat". Lettre d'invitation au premier Congrès de l'Internationale communiste. À ce sujet, lire notre article de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire", "La Plateforme de l'Internationale Communiste [778]". Revue internationale n° 94.
[3] La Quatrième internationale, en soutenant la Russie impérialiste (après la mort de Trotsky), trahissait à son tour l'internationalisme prolétarien. Voire notre article "Le trotskisme et la deuxième guerre mondiale [779]" au sein de notre brochure "Le Trotskysme contre la classe ouvrière".
[4] Ce qui conduira à la nécessité pour le pouvoir en Russie de signer les accords de Brest-Litovsk, afin d'éviter le pire.
[5] Lire notre article La bourgeoisie mondiale contre la révolution d’Octobre (Première partie) [740], de la Revue internationale n° 160.
[6] Paul Frölich, Rudolf Lindau, Albert Schreiner, Jakob Walcher, Révolution et contre-révolution en Allemagne 1918-1920 éditions Science Marxiste, 2013.
[7] Révolution allemande (iii): l'insurrection prématurée [780] et Il y a 90 ans, la révolution allemande: la guerre civile en Allemagne (1918-1919) [156].
[8] Lire notre article "L'action de mars 1921, le danger de l'impatience petite-bourgeoise [781]" de la Revue internationale n° 93.
[9] "Les tentatives de gagner le soutien des masses dans une phase de déclin de l'activité de ces masses conduisirent à des "solutions" opportunistes – l’insistance croissante sur le travail au sein du parlement et des syndicats, les appels au "Peuples d’orient" à se dresser contre l’impérialisme et, surtout, la politique de front unique avec les partis socialistes et social-démocrates qui jetait par-dessus bord toute la clarté si chèrement acquise sur la nature capitaliste de ceux qui étaient devenus des social patriotes." "La gauche communiste et la continuité du marxisme [112]".dans "qu'est-ce que le CCI ?" sur notre site.
[10] Lire dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire" notre article "1922-23: les fractions communistes contre la montée de la contre-révolution [134]" de la Revue internationale n° 101.
[11] Ceux-ci aussi connaîtront des fractions de gauche. Voire à ce propos notre article "La Gauche Communiste et la continuité du marxisme [112]".
[12] Lire notre article "Comment Staline a exterminé les militants de la Révolution d'Octobre 1917 [782]".
[13] Ainsi, par exemple, à partir de 1925 Staline reçoit le soutien sans réserve de la part de la bourgeoisie mondiale à sa lutte contre l'opposition de gauche qui, au sein du parti bolchevik, tentait de maintenir une politique internationaliste contre la thèse de la "construction du socialisme en un seul pays". Lire notre article "Quand les démocraties soutenaient Staline pour écraser le prolétariat [783]"
[14] Comme notre camarade Marc Chirik le disait lui-même: "Passer ces années d'isolement terrible, voir le prolétariat français arborer le drapeau tricolore, le drapeau des Versaillais et chanter la Marseillaise, tout cela au nom du communisme, c'était, pour toutes les générations qui étaient restées révolutionnaires, source d'une horrible tristesse". Et c'est justement au moment de la guerre d'Espagne que ce sentiment d'isolement atteint un de ses points culminants lorsque nombre d'organisations qui avaient réussi à maintenir des positions de classe sont entraînées par la vague "antifasciste". Voir notre article "Marc: De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale [784]". Revue internationale n° 65.
[15] Il faut toutefois signaler qu'une forte minorité au sein de la CNT s'était déclarée en faveur de l'adhésion à l'Internationale communiste lors de sa fondation.
[16] Voir à ce sujet "La leçon des évènements d'Espagne [494]" dans le numéro 36 de la Revue Bilan (novembre 1936). Republié dans notre brochure "Fascisme & démocratie deux expressions de la dictature du capital".
[17] Voir à ce sujet "L'écrasement du prolétariat allemand et l'avènement du fascisme [785]" dans le numéro 16 de la Revue Bilan (mars 1935), republié dans la Revue internationale n° 71.
[18] Pour plus d'informations lire "1936: Fronts populaires en France et en Espagne: comment la bourgeoisie a mobilisé la classe ouvrière pour la guerre [786]", Revue internationale n° 126.
[19] Voir à ce sujet "Les commémorations de 1944: 50 ans de mensonges impérialistes [787] (1e partie)". Publié dans la Revue internationale n° 78.
[20] Republié dans la Revue Internationale n° 59
[21] Lire à ce sujet "Souvenons-nous: les massacres et les crimes des 'grandes démocraties` [788]'". Revue internationale n° 66.
[22] C'est le chiffre avancé par les estimations américaines faites après la guerre.
[23] Pour information les bombardements les plus meurtriers de populations civile qui eurent lieu précédemment en Allemagne sont ceux de Hambourg (50.000 morts et 40.000 blessés en juillet 1943 essentiellement dans des zones résidentielles et ouvrières), Kassel (10.000 morts en octobre 1943), Darmstadt, Königsberg, Heilbronn (plus de 24.000 morts début 1944), Braunschweig (23.000 personnes carbonisées ou asphyxiées), Berlin (25.000 morts).
[24] Lire l'article "Quand les démocraties soutenaient Staline pour écraser le prolétariat [783]".
[25] Ce livre existe en anglais sous le titre "Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950". Pour l’auteur, "Plus de 9 millions d'Allemands sont morts des suites de la famine délibérée des Alliés et des politiques d'expulsion après la Seconde Guerre mondiale - un quart du pays a été annexé et environ 15 millions de personnes ont été expulsées dans le plus grand acte de nettoyage ethnique que le monde ait jamais connu. Plus de 2 millions d'entre eux, dont un nombre incalculable d'enfants, sont morts sur la route ou dans des camps de concentration en Pologne et ailleurs. Les gouvernements occidentaux continuent de nier que ces décès ont eu lieu."
[26] Voir notre article "Berlin 1948: le pont aérien de Berlin cache les crimes de l'impérialisme allié [789]".
[27] Boche est un terme péjoratif pour désigner un soldat allemand ou une personne d'origine allemande, dont l'emploi par le PCF en particulier était destiné à attiser la haine chauvine des Allemands.
[28] Désigne les personnes qui, pendant la seconde guerre mondiale, ont "trahi" en collaborant avec l'ennemi allemand.
[29] Lire à ce propos notre article "A l'aube du 21e siècle...pourquoi le prolétariat n'a pas encore renverse le capitalisme (I) [232]". Revue internationale n° 103.
[30] Pour davantage d'informations lire notre article "Lutte de classe en Europe de l'est (1920-1970): la nécessite de l'internationalisation des luttes [790]", Revue internationale n° 27.
[31] Lire à ce propos notre article "A l'aube du 21e siècle: Pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme (II) [791]". Revue internationale n° 104.
[32] Celles qui se sont dégagées des anciens partis ouvriers ayant dégénérés avec la défaite de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23.
[33] IL s'agit de deux articles qui se suivent: "Le mouvement étudiant dans le monde dans les années 1960 [17]" et "Fin de la contre-révolution, reprise historique du prolétariat mondial [715]" publiés respectivement dans les Revues internationales numéro 133 et 134.
[34] "Mai 68 et la perspective révolutionnaire (II): Fin de la contre-révolution, reprise historique du prolétariat mondial [715]".
[35] Cela leur permettra d'être présents au moment des négociations et de jouer le rôle de principaux diviseurs du mouvement en faisant reprendre le travail, branche par branche, au moyen de négociations isolées dans chacune de celles-ci.
[36] Idem.
[37] L'insistance ici portée sur la remise en cause de l'encadrement du PC et des syndicats ne doit néanmoins pas laisser penser que ceux-ci sont restés inactifs. Dans bon nombre d'entreprises occupées, les syndicats font tout pour isoler les ouvriers de tout contact avec l'extérieur susceptible d'exercer sur eux une influence "néfaste" (de la part de ceux qu'elle appelait les "gauchistes"). Là on occupera les ouvriers en les faisant jouer au pingpong toute la journée.
[38] Cette question justifie qu'il lui soit dédié un article à elle seule. Ce que nous ferons ultérieurement dans un article dédié à l'évolution du Milieu politique prolétarien depuis 1968.
[39] Publié également dans ce numéro de la Revue.
[40] La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste (mai 1990) [200]. Revue internationale n° 62.
[41] CPE = contrat première embauche, une mesure visant à accroître la précarité du travail pour les jeunes travailleurs. Pour une analyse de ce mouvement, voir "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [148]", Revue Internationale n° 125, 2ème trimestre 2006.
[42] Voir "Les indignés en Espagne, Grèce et Israël: de l’indignation à la préparation de la lutte de classe [565]", Revue Internationale 147, 1er trimestre 2011.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [41]
Rubrique:
Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire : Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme
- 1566 lectures
En septembre 1945, Marc Chirik écrivit une lettre de Paris à l'écrivain Jean Malaquais et à sa femme Gally. Malaquais avait travaillé avec Marc au sein de la Fraction française de la Gauche communiste à Marseille pendant la guerre, une période qui inspira son grand roman, Planète sans visa, dont un des principaux protagonistes est un révolutionnaire communiste, un internationaliste opposé à la guerre "antifasciste" nommé "Marc Laverne".
La lettre commence ainsi : "D'abord, les disparus. Michel, notre pauvre Mitchell, aucune nouvelle de lui, il a dû finir sa vie dans des conditions affreuses... De la Fraction belge, Jean, le meilleur élément, le plus talentueux et qui promettait beaucoup (l'as-tu connu ?) et son fils, ils ont été déportés et ont laissé leur vie dans un camp de concentration en Allemagne."
Vient ensuite une liste de camarades et de contacts du milieu politique de Marseille sous le régime de Vichy, ainsi que des membres de sa propre famille : ceux qui moururent, ceux qui revinrent après avoir subi d'épouvantables tortures, ceux qui réussirent à éviter la terreur nazie en adoptant de faux noms ou en fuyant. Une terreur poursuivie par la Résistance stalinienne, comme Marc le raconte plus loin :
- "Le moment le plus critique pour moi, et voyant la mort imminente, a été quelques semaines après quand les staliniens m'ont arrêté en compagnie de Clara1 et tous mes écrits. Ils se préparaient à me montrer ce qu'ils étaient. Ce n'est que par un miracle opportun que Clara a rencontré parmi les chefs supérieurs, une femme avec qui elle avait travaillé pendant un temps à l'UGIF (pour aider des enfants juifs) et que nous pûmes sauver notre peau de la haine stalinienne."
Telle était la situation à laquelle faisaient face les internationalistes pendant et immédiatement après la Seconde Guerre impérialiste mondiale.
Mitchell, qui était l'un d'entre eux, avait écrit une série d'articles sur "Les problèmes de la période de transition" dans les pages de Bilan. Nous les avons publiés dans cette série2 car ils offrent un cadre marxiste authentique pour discuter certaines des questions les plus fondamentales de la transformation communiste : le contexte historique et international de la révolution prolétarienne ; les dangers émanant de l'État de transition ; le contenu économique de la transformation, etc. Ces articles ont dû avoir une forte influence sur Marc et la Fraction française, et plus tard la Gauche communiste de France, comme l'illustrent leurs efforts de mener la critique de Mitchell de l'État de transition vers sa conclusion logique : le rejet de toute identité entre le prolétariat et ce mal nécessaire dans la transformation des relations sociales.3
Des remous dans le milieu prolétarien
La lettre à Malaquais demande des nouvelles du milieu politique de l'hémisphère occidental - le groupe de Paul Mattick à Chicago, qu'il liait à la Gauche hollandaise, le groupe d'Oehler dans la même ville, le groupe de la Gauche italienne à New York, le groupe d'Eiffels au Mexique. Marc répond aussi aux questions de Malaquais sur Victor Serge, qui avait été avec eux dans le milieu à Marseille mais était devenu un démocrate, soutenant les impérialismes alliés pendant la guerre4. Après un examen du rôle contre-révolutionnaire joué par les anciens partis ouvriers dans les accords d'après-guerre, Marc parle du milieu prolétarien tel qu'il était en France, mentionnant au passage la Fraction française et les divergences autour de la formation du parti en Italie, mais aussi les groupes qui étaient sortis du trotskisme. "L’Union communiste est morte, mais à sa place a surgi un groupe, les Communistes révolutionnaires, venant d'une scission d'avec les trotskistes et qui, bien que confus, est sincèrement révolutionnaire". Les CR s'étaient alignés sur le groupe autrichien/allemand Revolutionären Kommunisten Deutschlands, qui avait aussi rompu avec le trotskisme sur les questions cruciales de la défense de l'URSS et du soutien à la guerre. La Fraction française avait discuté et travaillé avec les RKD pendant la guerre, signant conjointement un manifeste internationaliste au moment de la "libération" de la France5.
Ainsi la Fraction française, et par la suite la GCF, étaient vivement intéressées à discuter avec tous les groupes prolétariens internationalistes qui avaient survécu à la guerre et qui faisaient d'une certaine façon leur retour dans son sillage6. En dépit de leur caractérisation du trotskisme officiel comme appendice du stalinisme, ils étaient ouverts à la possibilité que des groupes émergeant du trotskisme -à condition qu'ils aient rompu totalement avec ses positions et pratiques contre-révolutionnaires- pouvaient évoluer dans une direction positive. Cela avait évidemment été le cas pour la tendance RKD/CR et aussi avec le groupe de Stinas en Grèce, l'Union communiste internationale, bien que nous ne sachions pas grand-chose de l'existence de contacts entre Stinas et la Gauche communiste italienne pendant ou après la guerre.7
En France-même, la GCF entra en contact avec le groupe autour de Grandizo Munis et, à partir de 1949, avec le groupe Socialisme ou Barbarie animé par Cornelius Castoriadis/Chaulieu (qui avait été membre du groupe Stinas en Grèce), Claude Lefort / Montal et d'autres. Dans le cas du groupe de Munis, nommé ensuite Union ouvrière internationaliste, la GCF tint une série de rencontres avec eux sur la situation présente du capitalisme. Le texte phare, "L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective [258]", était basé sur l'exposé donné par Marc Chirik lors d'une de ces rencontres. Des initiatives similaires furent prises avec le groupe Socialisme ou Barbarie.
Dans un article ultérieur, nous examinerons les idées de Munis et de Castoriadis de manière plus détaillée, notamment parce que tous deux consacrèrent beaucoup d'énergie à définir la signification de la révolution prolétarienne et de la société socialiste dans une période de réaction continue pendant laquelle les déformations hideuses du stalinisme, du "socialisme réellement existant" en Russie et dans son bloc, étaient plus ou moins dominantes au sein de la classe ouvrière. Cette domination idéologique n'était pas du tout remise en cause par le trotskisme officiel, dont la "contribution" à la compréhension de la transition du capitalisme au socialisme se limitait à une apologie des régimes staliniens, définis comme États ouvriers déformés, et à un plaidoyer de la "nationalisation sous contrôle ouvrier" (c'est-à-dire une forme de capitalisme d'État) dans les pays en dehors du bloc russe. C'est ainsi particulièrement intéressant d'étudier le travail d'éléments qui étaient en train de rompre avec le trotskisme, non seulement à cause de son abandon de l'internationalisme mais aussi parce que sa vision de la transformation sociale demeurait fermement dans les limites du capitalisme.
En guise de préface à cette étude, nous pensons qu'il serait utile de republier le texte "Bienvenue à Socialisme ou Barbarie" d'Internationalisme n° 43, car c'est un bon exemple de la méthode employée par la GCF dans ses relations avec les rescapés du naufrage du trotskisme dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale.
Le titre de l'article donne immédiatement le ton : un accueil fraternel envers un nouveau groupe que la GCF reconnaît comme appartenant clairement au camp révolutionnaire, en dépit des nombreuses différences dans la méthode et la vision des deux groupes. Le nouveau groupe était le résultat d'une scission de la tendance Chaulieu / Montal au sein du parti trotskiste français, le Parti communiste internationaliste (dans lequel Munis avait aussi brièvement séjourné). Ceci conduisit la GCF à nuancer une déclaration antérieure qu'elle avait faite à propos de cette tendance :
- "Le jugement d’ensemble porté par nous sur cette tendance, dans un de nos récents numéros d’Internationalisme, aussi sévère qu’il fût, était absolument fondé. Nous devons toutefois porter un correctif concernant son caractère définitif. La tendance Chaulieu ne s’est pas liquidée, comme nous le pressentions, mais a trouvé la force, avec un très long retard certes, de rompre avec l’organisation trotskiste et de se constituer en groupe autonome. Malgré le lourd héritage qui pèse sur ce groupe, ce fait constitue une donnée nouvelle – ouvrant des possibilités à son évolution ultérieure. L’avenir seul nous dira dans quelle mesure il constitue un apport à la formation du nouveau mouvement révolutionnaire. Mais dès à présent on doit leur dire qu’ils ne sauraient s’acquitter de cette tâche qu’à la condition préalable de se débarrasser complètement et au plus vite des tares qu’il a héritées du trotskisme dont se ressent encore le premier numéro de leur revue".
Et en effet, il s'est révélé extrêmement difficile de se débarrasser du "lourd poids de cet héritage". Ce fardeau peut aussi se voir dans le travail ultérieur de Munis, mais il s'est révélé bien plus destructeur dans le cas de Socialisme ou Barbarie, notamment, comme le note l'article de la GCF, parce que le groupe Chaulieu proclama immédiatement qu'il était allé au-delà des autres courants révolutionnaires existants et qu'il serait en mesure de fournir des réponses définitives aux énormes problèmes auxquels la classe ouvrière faisait face. Cette supposition arrogante devait avoir des conséquences très négatives dans l'évolution future du groupe. Nous chercherons à le démontrer dans un article ultérieur.
Internationalisme n° 43, juin / juillet 1949
Salut à Socialisme ou Barbarie
Le premier numéro d’une nouvelle revue révolutionnaire instituée Socialisme ou Barbarie vient de paraître en France.
Dans la situation sombre où se trouve actuellement le mouvement ouvrier en France aussi bien que dans le monde, situation de guerre, où les rares groupes révolutionnaires – expression de vie et de l’état de conscience de la classe prolétarienne – qui, grâce à un constant effort idéologique et une volonté farouche d’agir, subsistent encore s’amenuisant et faiblissant un peu plus chaque jour, situation où la presse révolutionnaire se réduit à quelques petits bulletins périodiques ronéotypés, la parution d’une nouvelle revue imprimée "Organe de critique et d’orientation révolutionnaire" constitue un événement d’importance que tout militant ne saurait que saluer et encourager.
Quelle que puisse être l’ampleur de nos divergences avec les positions de Socialisme ou Barbarie et quelle que puisse être à l’avenir l’évolution de cette revue, nous devons, sur la base des positions fondamentales et l’orientation générale présentes, exprimées dans ce premier numéro, considérer le groupe, dont la revue est l’organe, comme un groupe indiscutablement prolétarien et révolutionnaire. C’est-à-dire que nous saluons son existence et suivrons avec intérêt et sympathie son effort et son activité ultérieurs. La sympathie révolutionnaire étant avec l’attention des positions politiques, nous entendons examiner sans parti pris, et avec le plus grand soin, les idées émises par Socialisme et Barbarie, les analyser au fur et à mesure de leur développement, en critiquer ce qui nous semblerait erroné et le cas échéant leur opposer les nôtres propres. Cela s’entend dans un but non d’une vaine polémique de dénigrement – chose hélas trop courante entre les groupes et qui nous répugne profondément – mais, si vive que puisse être parfois la discussion, exclusivement dans le but de confrontation et de clarification des positions.
Socialisme ou Barbarie est l’organe d’une tendance qui vient de rompre avec le parti trotskiste, la tendance Chaulieu – Montal. C’est une tendance politique connue dans les milieux militants en France. Nous avons parlé de cette tendance à plusieurs reprises, et encore tout récemment 8, et pas précisément dans des termes très tendres. Cela nécessite peut-être une explication supplémentaire de notre part.
Examinant le mouvement trotskiste en France et constatant qu’il se trouvait une fois de plus et pour la nième fois en état de crise, nous posions la question de savoir si cette crise avait une signification positive du point de vue de la formation révolutionnaire. Nous répondions catégoriquement non, et pour la raison suivante. Le trotskisme, qui fut une des réactions prolétariennes dans l’IC au cours des premières années de sa dégénérescence, n’a jamais dépassé sa position d’opposition malgré sa constitution formelle en parti organiquement séparé. En restant attaché aux PC – qu’il considère toujours comme partis ouvriers - où a triomphé le stalinisme, le trotskisme se rattache à ce dernier dont il est l’appendice. Il est lié idéologiquement au stalinisme et le suit comme son ombre. Toute l’activité du trotskisme depuis 15 ans le prouve. Depuis 1932-33 où il a soutenu la possibilité du triomphe de la révolution prolétarienne sous la direction stalinienne en Allemagne jusqu’à la participation à la guerre de 1939-45, à la résistance et la libération en passant par les fronts populaires, l’antifascisme et la participation à la guerre en Espagne, le trotskisme ne faisait rien d’autre que d’emboîter le pas du stalinisme. À la suite de ce dernier, le trotskisme a encore puissamment contribué à introduire dans le mouvement ouvrier les mœurs des méthodes d’organisation et des formes d’activités (bluff, intrigues, noyautage, insultes et manœuvres de toutes sortes) qui sont autant d’éléments actifs de corruption et de destruction de toute activité révolutionnaire. Cela ne veut pas dire que des ouvriers révolutionnaires, un peu éduqués, ne puissent se fourvoyer dans ses rangs. Au contraire, en tant qu’organisation, en tant que milieu politique, le trotskisme, loin de favoriser la formation de la pensée révolutionnaire et partant des organismes (fractions et tendances) qui l’expriment, est le milieu organique de leur pourrissement. C’est là une règle générale valable pour toute organisation politique étrangère au prolétariat, s’appliquant au trotskisme comme au stalinisme et vérifiable dans l’expérience. Nous connaissons le trotskisme depuis 15 ans en crise perpétuelle, avec scissions et unification, suivies de scissions et de crises, mais nous ne connaissons pas d’exemples où celles-ci aient été suivies de la formation d’une tendance révolutionnaire véritable et viable. C’est que le trotskisme ne secrète pas en son sein le ferment révolutionnaire. Au contraire il l’annihile. Le ferment révolutionnaire a donc pour condition de son existence et développement la nécessité d’être hors des cadres organisationnels et idéologiques du trotskisme.
La construction de la tendance Chaulieu - Montal au sein de l’organisation trotskiste et précisément après que celle-ci ait trempé jusqu’aux cheveux dans la deuxième guerre impérialiste, la résistance et la libération nationale, ne pouvait pas nous inspirer, à juste raison, une grande confiance à son égard. Cette tendance s’est constituée sur la base de la théorie du collectivisme bureaucratique en URSS et en conséquence le rejet de toute défense de cette dernière. Mais quelle valeur pouvait avoir cette prise de position contre la défense de l’URSS qui s’accordait dans la pratique avec la cohabitation dans cette organisation dont le plus clair de l’activité résidait concrètement dans la défense du capitalisme d’État russe, et la participation à la guerre impérialiste ? Non seulement la tendance Chaulieu – Montal trouvait possible sa cohabitation dans cette organisation, participait activement, à tous les échelons, à cet activisme typique du trotskisme fait de bluff et de mystification, à toutes ses campagnes électorales, syndicales et surenchères. De plus, on ne pouvait pas ne pas être défavorablement impressionné par le comportement de cette tendance à l’intérieur de l’organisation, comportement fait de manœuvres, de combinaisons, de compromis douteux, visant davantage à s’emparer de la direction du parti qu’à œuvrer au développement de la conscience de ses militants. Les hésitations prolongées des tenants de la tendance à quitter l’organisation, acceptant encore, au dernier congrès (été 1948) de se faire élire au Comité Central, dénote à la fois leur inconséquence politique, leur illusion sur un redressement possible de l’organisation trotskiste, leur esprit manœuvrier et finalement leur incompréhension totale pour ce qui est des conditions organisationnelles et politiques indispensables à l’élaboration de la pensée et d’une orientation révolutionnaire.
Le jugement d’ensemble porté par nous sur cette tendance, dans un de nos récents numéros d’Internationalisme, aussi sévère qu’il fût, était absolument fondé. Nous devons toutefois porter un correctif concernant son caractère définitif. La tendance Chaulieu ne s’est pas liquidée, comme nous le pressentions, mais a trouvé la force, avec un très long retard certes, de rompre avec l’organisation trotskiste et de se constituer en groupe autonome. Malgré le lourd héritage qui pèse sur ce groupe, ce fait constitue une donnée nouvelle – ouvrant des possibilités à son évolution ultérieure. L’avenir seul nous dira dans quelle mesure il constitue un apport à la formation du nouveau mouvement révolutionnaire. Mais dès à présent on doit leur dire qu’ils ne sauraient s’acquitter de cette tâche qu’à la condition préalable de se débarrasser complètement et au plus vite des tares qu’il a héritées du trotskisme dont se ressent encore le premier numéro de leur revue.
Il n’est pas dans notre intention de faire aujourd’hui une analyse approfondie et détaillée des positions du groupe Socialisme ou Barbarie… Nous y reviendrons une prochaine fois. Nous nous bornerons aujourd’hui à constater, à la lecture de ce premier numéro, que ce groupe est en pleine évolution, et que ses positions ne sont rien moins que fixées. Cela d’ailleurs ne saurait être retenu comme un reproche à son adresse ; au contraire. Ce groupe semble plutôt tendre à se dégager de sa position fixe d’une troisième classe : la bureaucratie, et de la double antithèse historique du capitalisme : le socialisme et le collectivisme bureaucratique. Cette position qui fut autrefois son unique raison d’être en tant que tendance, constituait en même temps une impasse, aussi bien dans le domaine de la recherche théorique que dans celui de l’action révolutionnaire pratique. C’est parce qu’il semble aujourd’hui abandonner, quoique partiellement et d’une façon confuse, cette conception d’une opposition entre l’étatisme et le capitalisme, et considérer l’étatisation plutôt comme une tendance inhérente au capitalisme dans la période présente, que ce groupe parvient à saisir correctement le problème du mouvement syndical présent de son intégration nécessaire à l’appareil d’État.
Signalons une étude extrêmement intéressante d'A. Carrier, sur le cartel des Syndicats autonomes où par sa plume, le groupe Socialisme ou Barbarie exprime pour la première fois "notre position sur la caractère historiquement révolu du syndicalisme comme arme prolétarienne contre le régime d’exploitation".
Cependant on serait quelque peu surpris d’apprendre, après une aussi nette déclaration sur le caractère révolu du syndicalisme, que cette position ne nous (Socialisme ou Barbarie) amène pas au refus de participation à toute vie syndicale. La raison de cette attitude pratique en contradiction de toute analyse faite du mouvement syndical est aussi formulée : "Nous allons où sont les ouvriers, non seulement parce qu’ils y sont, mais parce que là ils luttent avec plus ou moins d’efficacité, contre toutes les formes d’exploitation". Par ailleurs, on justifie la participation aux syndicats par : "Nous ne nous désintéressons pas des questions revendicatives. Nous sommes convaincus qu’il existe en toute circonstance des mots d’ordre revendicatifs corrects qui, sans résoudre le problème de l’exploitation, assurent la défense des intérêts matériels élémentaires de la classe, défense qu’il faut organiser quotidiennement face aux attaques quotidiennes du capitalisme". Et cela après avoir chiffres à l’appui démontré que : "Le capitalisme est arrivé au point où il ne peut guère plus rien donner, où il ne peut que reprendre. Non seulement toute réforme est impossible, mais le niveau même de misère ne peut être maintenu". Dès lors la signification du programme change.
Toute cette étude sur "Le cartel d’unité d’action syndical" par ailleurs extrêmement intéressante, est en plus d’une analyse valable du syndicalisme dans la période présente, une manifestation encore plus saisissante de l’état de contradiction dans laquelle se trouve le groupe Socialisme ou Barbarie. L’analyse objective de l’évolution du capitalisme moderne vers l’étatisation de l’économie et des organisations économiques des ouvriers (analyse qui est celle des groupes dits ultragauche, et dont nous sommes) se complète avec la vieille traditionnelle attitude subjective de participation et d’action dans les organisations syndicales, attitude héritée du trotskisme et de laquelle on n’est pas encore bien dégagé.
Une bonne partie de ce numéro de Socialisme ou Barbarie est consacré à la polémique contre le PCI (trotskiste). Cela se comprend fort bien. La sortie d’une organisation politique, à laquelle tout un passé de militant et de convictions se rattache, ne se fait pas sans certaine crise d’ordre affectif, et sans certaines récriminations personnelles, tout cela est dans l’ordre des choses. Mais cette fois nous assistons à une polémique et à un ton de polémique hors de proportion et hors de mesure.
Nous pensons à cet article de Chaulieu : "Les bouches inutiles" ; il s’agit de laver un membre du groupe, Lefort, des accusations portées contre lui par La Vérité. On comprend très bien quelle vive indignation a dû provoquer cette sorte "d’accusation" pleine de sous-entendus hypocrites et allusions malveillantes. Mais Chaulieu n’est pas parvenu à garder un certain niveau et, dans sa réplique, il ne fait que se plaire dans une regrettable grossièreté et vulgarité. Les jeux de mots sur les initiales de Pierre Frank sont juste dignes d’un galopin de lycée, et n’ont vraiment pas de place dans une revue révolutionnaire. Une fois de plus, nous sommes ici en présence d’une manifestation qui empeste depuis des années la vie du mouvement ouvrier. La reconstitution d’un nouveau mouvement révolutionnaire a aussi pour condition la libération de cette tradition pestiférante importée avec le stalinisme, et entretenue, entre autre, avec le trotskisme. On n’insistera jamais assez sur l’importance de cet aspect "moral" qui est un des fondements d’un travail révolutionnaire dans l’immédiat et dans l’avenir. C’est pourquoi nous étions si désagréablement impressionnés de trouver cette polémique malodorante s’étaler dans les colonnes du premier numéro de Socialisme ou Barbarie. Remarquons que, pris dans le feu de la polémique, Chaulieu et ses amis ont oublié de répondre à une des questions de fond, qui a fait éclore cette polémique, à savoir la possibilité de poursuivre la recherche des problèmes révolutionnaires à travers n’importe quelle revue, qui veut bien vous offrir ses colonnes.
Nous avons dans Internationalisme abordé déjà cette question et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est négative. Il existe aujourd’hui un problème angoissant d’absence de moyens d’expression de la pensée révolutionnaire. Chaque militant révolutionnaire pensant éprouve ce sentiment d’étouffement et ressent cette nécessité de briser avec l’imposition du silence auquel il est condamné. Mais au-delà d’un problème subjectif, c’est un problème politique en relation avec la situation. Il ne s’agit pas de se soulager en déposant ses pensées n’importe où, mais faire de sa pensée une arme efficace de la lutte de la classe prolétarienne. Lefort, Chaulieu et leurs amis se sont-ils demandés quel est le résultat d’une collaboration à des revues littéraires philosophiques ; genre Les Temps Modernes de Sartre ? Non seulement celle-ci ne peut produire que de l'élucubration révolutionnaire mais encore une telle collaboration accrédite les militants d'une revue, un courant idéologique face auquel la plus grande réserve politique et idéologique est nécessaire. Au lieu de clarifier en distinguant les courants, on ne fait qu’augmenter la confusion. Il faut soi-même ne rien comprendre au problème des conditions de la recherche révolutionnaire pour faire de Sartre et de sa revue, dont l’application politique de sa philosophie se fait au niveau du RDR 9, le lieu et le milieu de la discussion sur le rôle joué par Trotski et le trotskisme dans la dégénérescence de l’Internationale communiste. La recherche théorique révolutionnaire ne doit pas être sujet de conversation de salon, ni servir aux littérateurs de "gauche" en mal de thèmes. Aussi pitoyables que soient les moyens d’expression du prolétariat révolutionnaire, c’est uniquement révolutionnaire, c’est uniquement dans ce cadre que se fait l’œuvre d’élaboration de la théorie de la classe. Travailler à améliorer, développer ces moyens d’expression est la seule voie pour le militant pour rendre sa pensée action efficace. Chercher à se servir des moyens d’expressions autres que ceux des organismes de sa classe dénote toujours une tendance intellectualiste et petite bourgeoise. Le fait que ce problème ait été complètement négligé dans la polémique faite par Socialisme ou Barbarie prouve qu’il n’a même pas été saisi, sans parler déjà de sa solution, et dans quel sens. Ceci aussi est à notre avis, très significatif.
Avant d’entreprendre l’examen critique des positions défendues par le groupe Socialisme ou Barbarie, nous croyons qu’il est nécessaire de s’arrêter un instant sur un autre point, qui est lui aussi, hautement caractéristique : la manière de se présenter de ce groupe. On aurait tort de considérer cet aspect comme une chose sans importance. L’idée qu’on a de soi-même et l’appréciation que l’on porte sur les autres groupes sont intimement liées aux conceptions générales que l’on professe. C’est souvent cet aspect qui apparaît comme le meilleur révélateur de la nature d’un groupe. Il est en tous les cas un terme indispensable permettant de saisir immédiatement et sur le vif la conception profonde d’un groupe.
Voici deux passages extraits de l’article de tête du premier numéro de la revue, article constituant en quelque sorte, le credo, la plate-forme politique du groupe.
Parlant du mouvement ouvrier actuel, et après avoir constaté la complète aliénation des masses aux idéologies anti-ouvrières, la revue écrit :
- "Seules semblent surnager, dans ce naufrage universel, des faibles organisations telles que la "4ème Internationale", les Fédérations anarchistes, et les quelques groupements dits "ultragauche" (Bordiguistes, Spartakistes, Communistes des Conseils). Organisations faibles, non pas à cause de leur maigreur numérique – qui en soit ne signifie rien, et n’est pas un critère - mais avant tout par leur manque de contenu politique et idéologique. Relent du passé beaucoup plus qu’anticipation de l’avenir, ces organisations se sont trouvées absolument incapables déjà de comprendre le développement social du 20ème siècle et encore moins de s’orienter positivement face à celui-ci".
Et après avoir énuméré la faiblesse du trotskisme et de l’anarchisme, l’article continue quelques lignes plus loin :
- "Enfin, les groupements "ultragauches" soit cultivent avec passion leurs déformations de chapelle comme les bordiguistes, allant parfois jusqu’à rendre le prolétariat responsable de leur propre piétinement et de leur incapacité, soit, comme les "Communistes des Conseils" se contentant de tirer de l’expérience du passé des recettes pour la cuisine "socialiste" de l’avenir" (…) "Malgré leurs prétentions délirantes, aussi bien la "4éme Internationale" que les anarchistes et les "ultragauches" ne sont en vérité que des souvenirs historiques, des croûtes minuscules sur les plaies de la classe, vouées au dépérissement sous la poussée de la peau neuve qui se prépare dans la profondeur des tissus" (Socialisme ou Barbarie, n°1 page 9).
Voilà ce qui concerne les autres tendances et groupes existants. On comprend qu’après un jugement si sévère, une condamnation sans appel des autres, l’on se présente soi-même en ces termes :
- "En nous présentant aujourd’hui par le moyen de cette revue, devant l’avant-garde des ouvriers manuels et intellectuels, nous savons être les seuls à répondre d’une manière systématique aux problèmes fondamentaux du mouvement révolutionnaire contemporain ; nous pensons être les seuls à répondre d’une manière systématique aux problèmes fondamentaux du mouvement révolutionnaire contemporain ; nous pensons être les seuls à reprendre et à continuer l’analyse marxiste de l’économie moderne, à poser sur une base scientifique le problème du développement historique du mouvement ouvrier et sa signification, à définir le stalinisme et en général la bureaucratie "ouvrière", à caractériser la 3éme Guerre Mondiale, à poser enfin de nouveau, en tenant compte des éléments originaux créés par notre époque, la perspective révolutionnaire. Dans des questions de telle envergure, il ne peut s’agir ni d’orgueil, ni de modestie. Nous pensons que nous représentons la continuation vivante du marxisme dans le cadre de la société contemporaine. Dans ce sens nous n’avons nullement peur d’être confondus avec tous les éléments éditeurs de revues "marxistes" "clarificateurs" "hommes de bonne volonté", discutailleurs et bavards de tout acabit. Si nous posons des problèmes, c’est que nous pensons pouvoir les résoudre" (souligné par nous).
Voilà un langage ou la prétention, la flatterie sans borne de soi n’a d’égal que l’ignorance dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne le mouvement révolutionnaire, les groupes et tendances, leurs travaux et leurs luttes théoriques dans ces dernières 30 années. L’ignorance explique bien des choses mais elle ne saurait justifier et encore moins servir de titre de gloire. À quel titre le groupe Socialisme ou Barbarie s’autorise-t-il à parler, avec une telle désinvolture, du passé récent du mouvement révolutionnaire, de ses luttes internes, et des groupes, dont le seul tort est d’avoir posé avec quelque dix ou vingt ans d’avance, les problèmes que dans son ignorance il croit avoir découvert aujourd’hui. Le fait d’être venu à la vie politique tout récemment au cours des années de la guerre, et encore au travers de l’organisation politiquement corrompue du trotskisme, dans le bourbier duquel il a pataugé jusqu’en 1949, ne saurait être invoqué comme certificat d’honneur, comme garantie de maturité politique. L’arrogance du ton est un témoignage de plus de l’ignorance facilement contestable de ce groupe, qui ne s’est pas encore suffisamment libéré du mode de pensée et de discussion du trotskisme. Car s’il en était autrement, on s’apercevrait facilement que les idées qu’il énonce aujourd’hui, et qu’il considère comme son œuvre originale, ne sont pour la plupart qu’une reproduction plus ou moins heureuse des idées émises par les courants de gauche de la 3ème Internationale (Opposition ouvrière russe, Spartakistes d’Allemagne, Communistes de Conseils en Hollande, la Gauche Communiste d’Italie) depuis et au cours des vingt-cinq dernières années.
Si au lieu de se contenter de bribes de connaissance, et souvent d'ouï-dire, le groupe Socialisme ou Barbarie s’était donné la peine d’étudier plus à fond les documents nombreux, mais difficiles à retrouver, de ces courants de gauche, il aurait peut-être perdu de sa prétention à l’originalité, mais aurait assurément gagné en profondeur.
1 La femme de Marc qui était membre de la GCF et plus tard du CCI. Voir "Hommage à notre camarade Clara [792]" qui relate également cet incident.
2 Dans la Revue internationale n° 128, 129, 130, 131, 134. Voir : Revue Internationale, les années 2000: n°100 - 139 [793]
3 Voir : "Thèses sur la nature de l’État et la Révolution Prolétarienne (Gauche communiste de France, 1946) [794]"
4 Cette divergence était déjà apparue à Marseille, à en juger par la version fournie par Malaquais dans Planète sans visa, où le Marc fictionnel argumente contre la position pro-Alliés du personnage de Stepanoff, une version à peine déguisée de Serge.
5 Cette intervention commune avec les RKD fut faussement décrite comme "collaboration avec le trotskisme" par le Partito comunista internazionalista, et servit de prétexte à l'expulsion de la GCF de la Gauche communiste internationale. Mais les RKD avaient clairement rompu avec le trotskisme sur la question clé de l'internationalisme, l'opposition à la guerre et la dénonciation de l'URSS.
6 Voir par exemple notre article sur la conférence internationaliste en Hollande en 1947 : "Il y a soixante ans, une conférence de révolutionnaires internationalistes [795]".
7 Concernant Stinas, voir notre introduction aux extraits de ses mémoires dans la Revue Internationale n° 72 (Mémoires d'un révolutionnaire (A. Stinas, Grèce) : nationalisme et antifascisme [122]). Voir aussi en anglais : "Greek Resistance in WW2: Patriotism or internationalism? [796]". Les mémoires de Stinas ont été publiées en grec et en français : Agis Stinas, Mémoires : un révolutionnaire dans la Grèce du XXe siècle, préface de Michel Pablo, traduit par Olivier Houdart, La Brèche, Paris, 1990. Stinas était inébranlable dans son opposition à la guerre impérialiste et à la Résistance patriotique. Dans son cas, étant donné le manque de centralisation réelle dans l'autoproclamée Quatrième internationale, il avait supposé pendant quelques années que c'était la position "normale" du parti trotskiste. C'est seulement plus tard qu'il découvrit l'étendue réelle de la capitulation du trotskisme officiel face à l'antifascisme...
8 Internationalisme n° 41, janvier 1949, article "Où en sommes-nous ?".
9 Note du CCI : Rassemblement Démocratique Révolutionnaire, éphémère parti français qui fut fondé dans l'après-guerre (fin 1947 – début 1948) entre autres par Jean-Paul Sartre et plusieurs trotskistes et sociaux-démocrates de gauche.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Marc Chirik [572]
- Mitchell [797]
- Claude Lefort [798]
- Cornelius Castoriadis [799]
- Grandizo Munis [800]
Courants politiques:
- Trotskysme [801]
Approfondir:
Rubrique:
Revue Internationale 2019
- 449 lectures
Revue Internationale n°162
- 253 lectures
Présentation de la Revue numéro 162
- 121 lectures
Tout comme les deux précédents numéros de la Revue, celui-ci poursuit la célébration des centenaires d'évènements de portée historique ayant marqué la vague révolutionnaire mondiale de 1917 – 23.
Ainsi, après la révolution en Russie en 1917 (Revue n° 160), les tentatives révolutionnaires en Allemagne en 1919 (Revue n° 161), nous célébrons dans ce numéro le centenaire de la fondation de l'Internationale Communiste. Toutes ces expériences sont des pièces essentielles du patrimoine politique du prolétariat mondial dont la bourgeoisie fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elles soient dénaturées (la révolution en Russie et en Allemagne) ou qu'elles tombent dans l'oubli comme c'est le cas de la fondation de l'Internationale communiste. Le prolétariat devra se les réapproprier pour que, demain, une nouvelle tentative révolutionnaire mondiale puisse être victorieuse.
Cela concerne en particulier les questions suivantes dont certaines sont abordées dans ce numéro de la Revue :
- La vague révolutionnaire mondiale de 1917 – 23 avait été la riposte du prolétariat international à la Première Guerre mondiale, à quatre années de boucherie et d’affrontements militaires entre les États capitalistes pour le repartage du monde.
- La fondation de l’Internationale Communiste en 1919 avait constitué le point culminant de cette première vague révolutionnaire.
- Cette fondation concrétise d'abord et avant tout la nécessité, pour les révolutionnaires restés fidèles à l'internationalisme trahi par la droite des partis sociaux-démocrates (majoritaire dans la plupart de ces partis), d'œuvrer à la construction d'une nouvelle internationale. À l'avant-garde de cet effort et perspective se trouve en particulier la Gauche des partis sociaux-démocrates, regroupée autour de Rosa Luxemburg en Allemagne, Pannekoek et Gorter en Hollande, et bien sûr la fraction bolchevique du parti russe autour de Lénine. C’est à l’initiative du Parti communiste (bolchevique) de Russie et du Parti communiste d’Allemagne (le KPD, ex-Ligue Spartacus) que le premier congrès de l’Internationale a été convoqué à Moscou le 2 mars 1919.
- La fondation du nouveau parti, le parti mondial de la révolution, qui intervient tardivement alors que la plupart des soulèvements révolutionnaires du prolétariat en Europe ont été violemment réprimés, a pour mission première de fournir une orientation politique claire aux masses ouvrières : le renversement de la bourgeoisie, la destruction de son État et la construction d’un monde nouveau sans guerre ni exploitation.
- la plate-forme de l'Internationale communiste reflète le changement profond de période historique ouvert par la première guerre mondiale : "une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L’époque de la révolution communiste du prolétariat", si bien que la seule alternative pour la société est désormais : révolution prolétarienne mondiale ou destruction de l’humanité ; socialisme ou barbarie.
Tous ces aspects de la fondation de l'Internationale Communiste sont développés dans les deux articles de la présente revue que nous dédions à cette question, le premier en particulier, "Centenaire de la fondation de l’Internationale Communiste – L'internationale de l'action révolutionnaire de la classe ouvrière". Le second article, "100 ans de la fondation de l’Internationale Communiste - Quelles leçons tirer pour les combats du futur ? " développe plus particulièrement une idée déjà abordée dans le premier : à cause de la situation d’urgence, les principaux partis fondateurs de l’Internationale Communiste, notamment le parti bolchevique et le KPD, n’ont pas pu clarifier préalablement leurs divergences et confusions.
De plus, la méthode employée par le nouveau parti pour sa fondation n’allait pas l'armer pour le futur. En effet, une grande partie de l’avant-garde révolutionnaire fit primer la quantité en termes d'adhésions au détriment d’une clarification préalable sur les principes organisationnels et programmatique. Une telle démarche tournait le dos à la conception même élaborée et développée par les bolcheviks au cours de leur existence comme fraction au sein du POSDR.
Ce manque de clarification a été un facteur important, face au reflux de la vague révolutionnaire, du développement de l’opportunisme dans l’Internationale. Celui-ci sera à l'origine d’un processus de dégénérescence qui aboutira à la faillite même de l'IC, tout comme cela avait le cas pour la IIe internationale. Cette nouvelle Internationale a succombé, elle aussi, avec la trahison du principe de l’internationalisme par l’aile droite des partis communistes. Par la suite, dans les années 1930, c’est au nom de la défense de la "patrie soviétique", que les partis communistes, dans tous les pays, ont piétiné le drapeau de l’Internationale en appelant les prolétaires à s’entre-tuer, une nouvelle fois, sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.
Face à sa dégénérescence, l’IC, tout comme la IIe Internationale, a sécrété des minorités de Gauche parmi les militants des partis communistes restés fidèles à l’internationalisme et au mot d’ordre "Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays unissez-vous". Une des fractions ainsi constituées, la Gauche communiste d'Italie, et à sa suite la Fraction française de la Gauche communiste devenue par la suite la Gauche communiste de France (GCF) ont fait tout un travail de bilan de la vague révolutionnaire. Nous publions des chapitres du numéro 7 (Janvier / février 1946) de la revue Internationalisme, traitant de la question du rôle des fractions qui se dégagent du parti dégénérescent ("La fraction de gauche"), et de leur contribution à la formation du futur parti, en particulier la méthode à mettre en œuvre à cette fin ("Méthode de formation du parti").
Ces minorités révolutionnaires, de plus en plus réduites, ont dû œuvrer dans un contexte d'approfondissement de la contre-révolution illustré en particulier par l'absence de surgissement révolutionnaire à la fin de la deuxième guerre mondiale - contrairement à ce qui s'était produit suite à la première. Ainsi ce nouveau conflit mondial avait constitué un moment de vérité pour les faibles forces qui s'étaient maintenues sur un terrain de classe alors que les PC avaient trahi la cause de l'internationalisme prolétarien. C'est ainsi que le courant trotskiste trahissait à son tour, son passage au camp ennemi engendrant des réactions prolétariennes en son sein.
Le numéro 43 (Juin / juillet 1949) d'Internationalisme comporte un article, "Bienvenue à Socialisme ou Barbarie" (republié dans le numéro 161 de notre Revue, au sein de la première partie de l'article "Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme") qui prend une position claire sur la nature du mouvement trotskiste, lequel avait abandonné ses références prolétariennes en participant à la Seconde Guerre mondiale impérialiste. Cet article d'Internationalisme constitue un bon exemple de la méthode employée par la GCF dans ses relations avec les rescapés du naufrage du trotskisme dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. Dans la seconde partie de "Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme", publié dans ce numéro de la Revue, il est mis en évidence combien il est difficile, pour ceux qui ont grandi dans le milieu corrompu du trotskisme, de rompre profondément avec ses idées de fond et avec ses attitudes. Cette réalité est illustrée par la trajectoire de deux militants, Castoriadis et Munis qui, sans aucune doute, jusqu'à la fin des années 1940 et au début des années 1950, étaient des militants de la classe ouvrière. Munis l'est resté toute sa vie, ce qui ne fut pas le cas de Castoriadis qui a déserté le mouvement ouvrier.
En ce qui concerne Munis, il est mis en évidence sa difficulté à rompre avec le trotskisme : "Derrière ce refus d'analyser la dimension économique de la décadence du capitalisme se cache un volontarisme non dépassé, dont les fondements théoriques remontent à la lettre annonçant sa rupture avec l'organisation trotskiste en France, le Parti Communiste Internationaliste, où il maintient avec constance la notion de Trotsky, présentée dans les premières lignes du Programme de transition, selon laquelle la crise de l'humanité est la crise de la direction révolutionnaire". À propos de Castoriadis, il est souligné que : "ce "radicalisme" qui faisait tant saliver les journalistes de haut vol était une feuille de vigne qui couvrait le fait que le message de Castoriadis était extrêmement utile aux campagnes idéologiques de la bourgeoisie. Ainsi, sa déclaration selon laquelle le marxisme avait été pulvérisé a apporté un soutien "radical" à toute la campagne sur la mort du communisme qui s'est développée après l'effondrement des régimes staliniens du bloc de l'Est en 1989". Il est, en un sens, l'un des pères fondateurs de ce que nous avons appelé le courant "moderniste".
Nous poursuivons également, dans ce numéro de la Revue internationale, la dénonciation, entreprise dans son n° 160, de l'union de toutes les fractions nationales et des partis de la bourgeoisie mondiale contre la révolution russe d'abord, pour endiguer la vague révolutionnaire et éviter qu’elle ne se répande dans les grands pays industrialisés de l’Ouest de l’Europe. Contre les tentatives révolutionnaires en Allemagne ensuite, où le SPD jouera un rôle de premier plan, en tant que bourreau des soulèvements révolutionnaires dans ce pays. Immondes furent alors les campagnes de calomnies, organisée au sommet de l'État, pour justifier la répression sanglante. Plus tard, le stalinisme s'imposa à son tour comme bourreau de la révolution, prenant en charge l'exercice de la terreur d'État, la liquidation de la vieille garde du parti bolchevik. Dès lors que l'URSS était devenue un État bourgeois impérialiste contre la classe ouvrière, les grandes démocraties sont complices avec lui pour liquider physiquement et idéologiquement Octobre 1917. Une telle alliance idéologique et politique mondiale a traversé les années et a été relancée, plus fortement que jamais, au moment de l'effondrement du bloc de l'Est et du stalinisme, une forme particulière du capitalisme d'État qui a été mensongèrement présenté comme la faillite du communisme.
Il n'y pas dans cette revue d'article sur des questions brulantes de la situation internationale. Néanmoins nos lecteurs peuvent se diriger vers notre site où sont publiés de tels articles. De plus un prochain numéro de la Revue internationale accordera l'importance requise à ces questions.
(14/05/2019)
Centenaire de la fondation de l’IC: l'internationale de l'action révolutionnaire de la classe ouvrière
- 235 lectures
Il y a 100 ans, en mars 1919, s’est tenu le premier congrès de l’Internationale Communiste (IC), le congrès de constitution de la IIIe Internationale.
Si les organisations révolutionnaires n’avaient pas la volonté de célébrer cet événement, la fondation de l’Internationale serait reléguée dans les oubliettes de l’histoire. En effet, la bourgeoisie est intéressée à garder le silence sur cet événement, alors qu’elle ne cesse de nous abreuver de célébrations de toutes sortes comme celle du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. La classe dominante n’a pas du tout envie que la classe ouvrière se souvienne de sa première grande expérience révolutionnaire internationale de 1917-1923. La bourgeoisie aimerait bien pouvoir enterrer définitivement le spectre de cette vague révolutionnaire qui a donné naissance à l’IC. Cette vague révolutionnaire était la riposte du prolétariat international à la Première Guerre mondiale, à quatre années de boucherie et d’affrontements militaires entre les États capitalistes pour le partage du monde.
Cette vague révolutionnaire avait débuté avec la victoire de la Révolution russe en octobre 1917. Elle s’était manifestée par des mutineries de soldats dans les tranchées et par le soulèvement du prolétariat en Allemagne en 1918.
Cette première vague révolutionnaire avait traversé l’Europe, elle avait même atteint les pays du continent asiatique (notamment la Chine en 1927). Les pays du continent américain, comme le Canada et les États-Unis jusqu’à l’Amérique latine ont aussi été ébranlés par cette vague révolutionnaire mondiale.
Nous ne devons pas oublier que c’est la peur de l’extension internationale de la révolution russe qui avait obligé la bourgeoisie des grandes puissances européennes à signer l’armistice pour mettre fin à la Première Guerre mondiale.
Dans ce contexte, la fondation de l’Internationale Communiste en 1919 avait représenté le point culminant de cette première vague révolutionnaire.
L’Internationale Communiste a été fondée pour donner une orientation politique claire aux masses ouvrières. Elle s’était donnée comme objectif de montrer au prolétariat la voie du renversement de l’État bourgeois et la construction d’un monde nouveau sans guerre et sans exploitation. On peut rappeler ici ce qu’affirmaient les Statuts de l’IC (adoptés à son IIe Congrès en juillet 1920) : “La IIIe Internationale Communiste s’est constituée à la fin du carnage impérialiste de 1914-1918, au cours duquel la bourgeoisie des différents pays a sacrifié 20 millions de vies.
Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voilà la première parole que l’Internationale Communiste adresse à chaque travailleur, quelle que soit son origine et sa langue. Souviens-toi que, du fait de l’existence du régime capitaliste, une poignée d’impérialistes a eu, pendant quatre longues années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s’entre-égorger ! Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l’Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement ! Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible, mais inévitable !”
La fondation de l’IC exprimait d’abord et avant tout, la nécessité pour les révolutionnaires de se regrouper pour défendre le principe de l’internationalisme prolétarien. Un principe de base du mouvement ouvrier que les révolutionnaires se devaient de préserver et défendre contre vents et marées !
Pour comprendre toute l’importance de la fondation de l’IC, on doit d’abord rappeler que cette IIIe Internationale se situe dans la continuité historique avec la Ie Internationale (l’AIT) et la Seconde Internationale (Internationale des partis sociaux-démocrates). C’est pour cela que la Manifeste de l’IC affirmait ceci : “nous nous considérons, nous communistes, rassemblés dans la IIIe Internationale, comme les continuateurs directs des efforts héroïques et du martyre de toute une longue série de générations révolutionnaires, depuis Babeuf jusqu’à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Si la Ie Internationale a prévu le développement de l’histoire et préparé ses voies, si la IIe a rassemblé et organisé des millions de prolétaires, la IIIe Internationale, elle, est l’Internationale de l’action de masse ouverte, de la réalisation révolutionnaire, l’Internationale de l’action”.
Il est donc clair que l’IC n’a pas surgi du néant. Ses principes et son programme révolutionnaires étaient l’émanation de toute l’histoire du mouvement ouvrier, en particulier depuis la Ligue des Communistes et la publication du Manifeste rédigé par K. Marx et F. Engels en 1848. C’est dans ce Manifeste communiste qu’ils avaient mis en avant le célèbre mot d’ordre du mouvement ouvrier : “Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”
Pour pouvoir comprendre la signification historique de la fondation de l’IC, nous devons rappeler que la IIe Internationale est morte en 1914. Pourquoi ? Parce que les principaux partis de cette IIe Internationale, les partis socialistes, avaient trahi l’internationalisme prolétarien. Les dirigeants de ces partis traîtres avaient voté les crédits de guerre au Parlement. Dans chaque pays, ils ont appelé les prolétaires à “l’union sacrée” avec leurs propres exploiteurs. Ils les ont appelés à s’entre-tuer dans la boucherie mondiale au nom de la défense de la patrie, alors que le Manifeste communiste affirmait que “les prolétaires n’ont pas de patrie” !
Face à l’effondrement honteux de la IIe Internationale, seuls quelques partis sociaux-démocrates ont pu résister à la tempête, notamment les partis italien, serbe, bulgare et russe. Dans les autres pays, seule une petite minorité de militants, bien souvent isolés, vont aussi rester fidèles à l’internationalisme prolétarien. Ils ont dénoncé l’orgie sanglante de la guerre en essayant de se regrouper. En Europe, c’est cette minorité de révolutionnaires internationalistes qui va représenter la Gauche notamment autour de Rosa Luxemburg en Allemagne, Pannekoek et Gorter en Hollande et bien sûr la fraction bolchevique du parti russe autour de Lénine.
De la mort de la IIe Internationale en 1914 à la fondation de l’IC en 1919
Deux ans avant la guerre, en 1912, s’était tenu le congrès de Bâle de la IIe Internationale. Alors que les menaces d’une guerre mondiale en plein cœur de l’Europe se profilaient, ce congrès de Bâle avait adopté une résolution sur la question de la guerre et de la Révolution prolétarienne. Cette Résolution affirmait ceci : “Que les gouvernements bourgeois n’oublient pas que la guerre franco-allemande (de 1870) donna naissance à l’insurrection révolutionnaire de la Commune de Paris et que la guerre russo-japonaise a mis en mouvement les forces révolutionnaires de Russie. Aux yeux des prolétaires, il est criminel de s’entre-tuer au profit du gain capitaliste, de la rivalité dynastique et de la floraison des traités diplomatiques”.
C’était également au sein de la IIe Internationale que les théoriciens marxistes les plus conséquents, particulièrement Rosa Luxemburg et Lénine, ont été capables d’analyser le changement de période historique dans la vie du capitalisme. Rosa Luxemburg et Lénine avaient en effet clairement mis en évidence que le mode de production capitaliste avait atteint son apogée, au début du XXe siècle. Ils avaient compris que la guerre impérialiste en Europe ne pouvait avoir désormais qu’un seul but : le partage du monde entre les principales puissances rivales dans la course aux colonies. Lénine et Rosa Luxemburg avaient compris que l’éclatement de la Première Guerre mondiale a marqué avec fracas l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, de déclin historique. Mais déjà, bien avant l’éclatement de la guerre, l’aile gauche de la IIe Internationale a dû mener un combat acharné contre la droite, contre les réformistes, les centristes et les opportunistes. Ces futurs renégats théorisaient en effet que le capitalisme avait encore de beaux jours devant lui et que, finalement, le prolétariat n’avait pas besoin de faire la révolution et de renverser le pouvoir de la bourgeoisie.
Le combat de la gauche pour la construction d’une nouvelle Internationale
En septembre 1915, à l’initiative des bolcheviques, s’est tenue, en Suisse, la conférence socialiste internationale de Zimmerwald. Elle a été suivie d’une seconde conférence en avril 1916 à Kienthal, toujours en Suisse. Malgré les conditions très difficiles de la guerre et de la répression, des délégués de onze pays y ont participé, (Allemagne, d’Italie, de Russie, de France, etc.). Mais la majorité des délégués étaient pacifistes et ont refusé de rompre avec les sociaux chauvins qui sont passés dans le camp de la bourgeoisie en votant les crédits de guerre en 1914.
Il y avait donc aussi à la conférence de Zimmerwald une aile gauche réunie derrière les délégués de la fraction bolchevique, Lénine et Zinoviev. Cette “gauche de Zimmerwald” a défendu la nécessité de rompre avec les partis sociaux-démocrates traîtres. Cette gauche a mis en avant la nécessite de construire une nouvelle Internationale. Contre les pacifistes, elle affirmait, selon l’expression de Lénine, que “la lutte pour la paix sans action révolutionnaire est une phrase creuse et mensongère”. La gauche de Zimmerwald a repris à son compte le mot d’ordre de Lénine : “transformation de la guerre impérialiste en guerre civile !” Un mot d’ordre qui était déjà contenu dans les résolutions de la IIe Internationale votées au congrès de Stuttgart en 1907 et surtout au congrès de Bâle en 1912.
La Gauche de Zimmerwald va donc constituer le “premier noyau de la IIIe Internationale en formation” (comme le dira le compagnon de Lénine, Zinoviev, en mars 1918).
Les nouveaux partis qui se sont créés, en rupture avec la social-démocratie, ont commencé alors à prendre le nom de “parti communiste”. C’est la vague révolutionnaire ouverte par la Révolution russe d’octobre 1917 qui avait donné une impulsion vigoureuse aux militants révolutionnaires pour la fondation de l’IC. Les révolutionnaires avaient en effet compris qu’il était absolument indispensable et vital de fonder un parti mondial du prolétariat pour la victoire de la Révolution à l’échelle mondiale.
C’est à l’initiative du Parti communiste (bolchevique) de Russie et du Parti communiste d’Allemagne (le KPD, ex-Ligue Spartacus) que le premier congrès de l’Internationale - son congrès de fondation - a été convoqué à Moscou, du 2 au 6 mars 1919.
Le programme politique de l’Internationale Communiste
La plateforme de l’IC était basée sur le programme des deux principaux partis communistes, le parti bolchevique et le parti communiste d’Allemagne (fondé le 29 décembre 1918).
Cette plateforme de l’IC commence par affirmer clairement qu’ “une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L’époque de la révolution communiste du prolétariat”. En reprenant le Discours sur le programme de fondation du Parti communiste allemand, prononcé par R. Luxemburg, l’Internationale mettra clairement en avant que “le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d’aujourd’hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme”. Autrement dit, nous sommes entrés dans “l’ère des guerres et des révolutions”. La seule alternative pour la société était désormais : révolution prolétarienne mondiale ou destruction de l’humanité ; socialisme ou barbarie. Cette position est affirmée avec force dans le premier point de la Lettre d’invitation au Premier congrès de fondation de l’Internationale Communiste (rédigée en janvier 1919 par Trotsky).
Pour l’Internationale, l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, signifiait que la lutte révolutionnaire du prolétariat prend une forme nouvelle. C’est la période où se développe la grève de masse, la période où les Conseils Ouvriers sont la forme de la dictature du prolétariat comme l’avaient annoncé le surgissement des Soviets en Russie en 1905 et en 1917.
Mais l’un des apports fondamentaux de l’Internationale a surtout été la compréhension que le prolétariat doit détruire l’État bourgeois pour pouvoir construire une nouvelle société. C’est à partir de cette question que le premier congrès de l’Internationale avait adopté ses Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne (rédigées par Lénine). Ces thèses commencent par dénoncer la fausse opposition entre la démocratie et la dictature “car, dans aucun pays capitaliste civilisé, il n’existe de “démocratie en général”, mais seulement une démocratie bourgeoise”.
L’Internationale a ainsi affirmé que défendre la démocratie “pure” dans le capitalisme, c’est défendre, dans les faits, la démocratie bourgeoise, la forme par excellence de la dictature du capital. Contre la dictature du capital, l’Internationale affirmait que seule la dictature du prolétariat à l’échelle mondiale peut renverser le capitalisme, abolir les classes sociales, et offrir un avenir à l’humanité.
Le parti mondial du prolétariat devait donc donner une orientation claire aux masses prolétariennes pour leur permettre de réaliser leur but final. Il devait défendre partout le mot d’ordre des bolcheviques en 1917 : “Tout le pouvoir aux soviets”. C’était cela la “dictature” du prolétariat : le pouvoir des Soviets ou Conseils Ouvriers.
Des difficultés de la IIIe Internationale à sa faillite
En mars 1919, l’Internationale a malheureusement été fondée trop tardivement, au moment où la plupart des soulèvements révolutionnaires du prolétariat en Europe ont été violemment réprimés. L’IC a été fondée, en effet, deux mois après la répression sanglante du prolétariat allemand à Berlin. Le parti communiste d’Allemagne venait de perdre ses principaux dirigeants, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, sauvagement assassinés par le gouvernement social-démocrate pendant la semaine sanglante de Berlin en janvier 1919. C’est donc au moment où elle se constitue que l’Internationale a subi sa première défaite. Avec l’écrasement de la révolution en Allemagne, cette défaite était aussi et surtout une défaite terrible pour le prolétariat international.
Il faut reconnaître que les révolutionnaires de l’époque se sont trouvés dans une situation d’urgence, quand ils ont fondé l’Internationale. La Révolution russe était complètement isolée, asphyxiée et encerclée par toute la bourgeoisie de tous les pays (sans compter les exactions contre-révolutionnaires des Armées blanches à l’intérieur de la Russie). Les révolutionnaires étaient pris à la gorge et il fallait faire vite pour construire le parti mondial. C’est à cause de cette situation d’urgence que les principaux partis fondateurs de l’Internationale, notamment le parti bolchevique et le KPD, n’ont pas pu clarifier leurs divergences et confusions. Ce manque de clarification a été un facteur important de développement de l’opportunisme dans l’Internationale avec le reflux de la vague révolutionnaire.
Par la suite, à cause de la gangrène de l’opportunisme, cette nouvelle Internationale est morte à son tour. Elle a succombé, elle aussi, à la trahison du principe de l’internationalisme par l’aile droite des partis communistes. En particulier le principal parti de l’Internationale, le parti bolchevique, après la mort de Lénine, avait commencé à défendre la théorie de la “construction du socialisme dans un seul pays”. Staline, en prenant la tête du parti bolchevique, a été le maître d’œuvre de la répression du prolétariat qui avait fait la révolution en Russie. Il a imposé une dictature féroce contre les anciens compagnons de Lénine qui luttaient contre la dégénérescence de l’Internationale et avaient dénoncé ce qu’ils pensaient être le retour du capitalisme en Russie.
Par la suite, dans les années 1930, c’est au nom de la défense de la “patrie soviétique”, que les partis communistes dans tous les pays, ont piétiné le drapeau de l’Internationale en appelant les prolétaires à s’entre-tuer, encore une fois, sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Comme la IIe Internationale en 1914, l’IC a fait faillite, victime, elle aussi, de la gangrène de l’opportunisme et d’un long processus de dégénérescence.
Mais, comme la IIe Internationale, l’IC a aussi sécrété une minorité de Gauche parmi les militants restés fidèles à l’internationalisme et au mot d’ordre “Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays unissez-vous”. Ces minorités de Gauche (en Allemagne, en France, en Italie, en Hollande…) ont mené un combat politique au sein de l’Internationale dégénérescente pour essayer de la sauver. Mais Staline a fini par exclure ces militants de la gauche de l’Internationale. Il les a pourchassés, persécutés et les a liquidés physiquement (on se souvient des procès de Moscou, de l’assassinat de Trotski par des agents de la GPU et aussi des Goulags staliniens).
Les révolutionnaires exclus de la IIIe Internationale ont cherché aussi à se regrouper, malgré toutes les difficultés de la guerre et de la répression. Malgré leur éparpillement dans différents pays, ces toutes petites minorités de militants internationalistes ont été capables de tirer le bilan de la vague révolutionnaire de 1917-1923 afin d’en dégager les principales leçons pour le futur.
Ces révolutionnaires qui ont combattu le stalinisme n’ont pas cherché à fonder une nouvelle internationale, avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient compris qu’il était “minuit dans le siècle” : le prolétariat avait été physiquement écrasé, massivement embrigadé derrière des drapeaux nationaux de l’antifascisme et victime de la plus profonde contre-révolution de l’histoire. La situation historique n’était plus favorable au surgissement d’une nouvelle vague révolutionnaire contre la Guerre mondiale.
Néanmoins, pendant toute cette longue période de contre-révolution, les minorités révolutionnaires ont continué à mener une activité, souvent dans la clandestinité, pour préparer le futur en gardant confiance dans la capacité du prolétariat à relever la tête et à renverser un jour le capitalisme.
Nous voulons rappeler que le CCI se réclame des apports de l’Internationale Communiste. Notre organisation, se rattache aussi à la continuité politique avec les fractions de Gauche exclues de l’Internationale dans les années 1920-30, notamment de la Fraction de la Gauche communiste italienne. Ce centenaire est donc à la fois l’occasion de saluer la contribution inestimable de l’IC dans l’histoire du mouvement ouvrier, mais également de tirer les leçons de cette expérience afin d’armer le prolétariat pour ses futurs combats révolutionnaires.
Encore une fois, nous devons bien comprendre toute l’importance de la fondation de l’Internationale Communiste comme première tentative de constituer le parti mondial du prolétariat. Surtout, nous devons souligner l’importance de la continuité historique, du fil rouge qui relie les révolutionnaires d’aujourd’hui à ceux du passé, à tous ces militants qui, à cause de leur fidélité aux principes du prolétariat, ont été persécutés et sauvagement assassinés par la bourgeoisie, et surtout par leurs anciens camarades devenus des traîtres : les Kautsky, Noske, Ebert, Scheidemann, Staline. Nous devons aussi rendre hommage à tous ces militants exemplaires (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Léo Jogiches, Trotski et bien d’autres) qui ont payé de leur vie leur fidélité à l’internationalisme.
Pour pouvoir construire le futur parti mondial du prolétariat, sans lequel le renversement du capitalisme sera impossible, les minorités révolutionnaires doivent se regrouper, aujourd’hui comme dans le passé. Ils doivent clarifier leurs divergences par la confrontation des idées et des positions, la réflexion collective et la discussion la plus large possible. Ils doivent être capables de tirer les leçons du passé pour pouvoir comprendre la situation historique présente et permettre aux nouvelles générations d’ouvrir les portes de l’avenir.
Face à la décomposition de la société capitaliste, à la barbarie guerrière, à l’exploitation et à la misère croissante des prolétaires, aujourd’hui, l’alternative reste celle que l’Internationale Communiste avait clairement identifiée il y a 100 ans : socialisme ou barbarie, révolution prolétarienne mondiale ou destruction de l’humanité dans un chaos de plus en plus sanglant.
CCI
Vie du CCI:
- Réunions publiques [804]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [669]
Rubrique:
Centenaire de la fondation de l’Internationale Communiste - Quelles leçons tirer pour les combats du futur ?
- 402 lectures
Il y a un siècle, un vent d’espoir soufflait sur l’humanité. En Russie d’abord, la classe ouvrière était parvenue à prendre le pouvoir. En Allemagne, en Hongrie et en Italie ensuite, elle luttait courageusement pour poursuivre l’œuvre des ouvriers de Russie avec un seul mot d’ordre : l’abolition du mode de production capitaliste dont les contradictions avaient plongé la civilisation dans quatre années de guerre. Quatre années de barbarie sans précédent jusqu’à lors qui témoignaient de l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence.
Dans ces conditions, actant la faillite de la Deuxième internationale, s’appuyant sur tout le travail de reconstruction de l’unité internationale entamé à Zimmerwald en septembre 1915 puis à Kiental en avril 1916, la IIIe Internationale était fondée le 4 mars 1919 à Moscou. Déjà, dans les Thèses d’avril de 1917, Lénine appelait à la fondation d’un nouveau parti mondial. Mais l’immaturité du mouvement révolutionnaire avait nécessité d’en ajourner la fondation. Pour Lénine, le pas décisif fut franchi au cours des journées terribles de janvier 1919 en Allemagne au cours desquelles fut fondé le Parti communiste allemand (KPD). Dans une "Lettre aux ouvriers d’Europe et d’Amérique" daté du 26 janvier Lénine écrit : "Lorsque la Ligue Spartakus se fût intitulée Parti communiste allemand, alors la fondation de la IIIe Internationale, devint un fait. Formellement cette fondation n’a pas encore été consacrée, mais en réalité la IIIe Internationale existe, dès à présent." Outre l’enthousiasme excessif d’un tel jugement, comme nous le verrons plus longuement par la suite, les révolutionnaires de l’époque comprirent qu’il était désormais indispensable de forger le parti pour la victoire de la révolution à l’échelle mondiale. Après plusieurs semaines de préparatifs, 51 délégués se réunirent, du 2 au 6 mars 1919, afin de poser les jalons organisationnels et programmatiques qui devaient permettre au prolétariat mondial de continuer à aller de l’avant dans la lutte qui l’opposait à l’ensemble des forces bourgeoises.
Le CCI se réclame des apports de l’Internationale Communiste (IC). Par conséquent, ce centenaire est à la fois l’occasion de saluer et de souligner la contribution inestimable de l’IC dans l’histoire du mouvement révolutionnaire mais également de tirer les leçons de cette expérience et d’en soulever les faiblesses afin d’armer le prolétariat d’aujourd’hui pour les combats du futur.
Défendre la lutte de la classe ouvrière dans le feu révolutionnaire
Comme l’affirmait la "Lettre d’invitation au congrès" écrite par Trotsky : "Les partis et organisations soussignés considèrent que la convocation du premier congrès de la nouvelle Internationale révolutionnaire est d’une urgente nécessité. (...) La montée très rapide de la révolution mondiale posant constamment de nouveaux problèmes, le danger d’étouffement de cette révolution par l’alliance des Etats capitalistes contre la révolution sous l’hypocrite drapeau de la "Société des Nations", les tentatives des partis sociaux-traîtres de se réunir et d’aider encore leurs gouvernements et leurs bourgeoisies pour trahir la classe ouvrière après s’être accordé une "amnistie" mutuelle, enfin l’expérience révolutionnaire extrêmement riche déjà acquise et le caractère mondial de l’ensemble du mouvement révolutionnaire – toutes ces circonstances nous obligent à mettre à l’ordre du jour de la discussion la question de la convocation d’un congrès international des partis révolutionnaires".
A l’image de ce premier appel lancé par les bolcheviks, la fondation de l’IC exprimait la volonté du regroupement des forces révolutionnaires du monde entier. Mais également la défense de l’internationalisme prolétarien qui avait été foulé aux pieds par la grande majorité des partis sociaux-démocrates qui composaient la IIe Internationale. Après quatre années de guerre atroce qui avaient divisé et décimé des millions de prolétaires sur les champs de batailles, l’émergence d’un nouveau parti mondial témoignait de la volonté d’approfondir le travail commencé par les organisations restées fidèles à l’internationalisme. En cela, l’IC est l’expression de la force politique du prolétariat qui se manifestait partout à nouveau après le profond recul occasionné par la guerre ainsi que de la responsabilité des révolutionnaires pour continuer à défendre les intérêts de la classe ouvrière et la révolution mondiale.
Il a été maintes fois répété, au cours du congrès de fondation, que l’IC était le parti de l’action révolutionnaire. Comme c’est affirmé dans son Manifeste, l’IC voyait le jour au moment où le capitalisme avait clairement montré son obsolescence. L’humanité rentrait désormais dans "l’ère des guerres et des révolutions". Autrement dit, l’abolition du capitalisme devenait d’une extrême nécessité pour l’avenir de la civilisation. C’est avec cette nouvelle compréhension de l’évolution historique du capitalisme que l’IC défendit inlassablement les conseils ouvriers et la dictature du prolétariat : "le nouvel appareil du pouvoir doit représenter la dictature de la classe ouvrière (...) c’est à dire qu’il doit être l’instrument du renversement systématique de la classe exploiteuse et celui de son expropriation. Le pouvoir des conseils ouvriers ou des organisations ouvrières est sa forme concrète." (Lettre d’invitation au congrès). Ces orientations furent défendues tout au long du congrès. Par ailleurs, les "Thèses sur la démocratie bourgeoise", écrites par Lénine et adoptées par le congrès, s’attachaient à dénoncer les mystifications de la démocratie mais surtout à mettre en garde le prolétariat sur le danger que celles-ci faisaient peser dans sa lutte contre la société bourgeoise. Dès le départ, l’IC se plaçait ainsi résolument dans le camp prolétarien en défendant les principes et les méthodes de lutte de la classe ouvrière et dénonçait de manière énergique l'appel du courant centriste à une impossible unité entre les social-traîtres et les communistes, "l’unité des ouvriers communistes avec les assassins des dirigeants communistes Liebknecht et Luxemburg", selon les termes mêmes de la "Résolution du premier Congrès de l'IC sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne [805]". Preuve de la défense intransigeante des principes prolétariens, cette résolution, qui fut votée à l'unanimité par le congrès, constituait une réaction à la tenue récente par la plupart des partis sociaux-démocrates de la IIe Internationale d'une réunion[1] où furent prises un certain nombre d’orientations ouvertement dirigées contre la vague révolutionnaire"". La résolution se terminait en ces termes : "Le congrès invite les ouvriers de tous les pays à entamer la lutte la plus énergique contre l’internationale jaune et à préserver les masses les plus larges du prolétariat de cette Internationale de mensonge et de trahison."
La fondation de l’IC s’avéra être une étape vitale pour la poursuite du combat historique du prolétariat. Elle sut reprendre à son compte les meilleurs apports de la IIe International tout en rompant avec celle-ci sur des positions ou des analyses qui ne correspondaient plus à la période historique qui venait de s’ouvrir. [2] Alors que l’ancien parti mondial avait trahi l’internationalisme prolétarien, au nom de l’Union sacrée, à la veille de la Première guerre mondiale, la fondation du nouveau parti permettait de renforcer l’unité de la classe ouvrière et de l’armer dans la lutte acharnée qu’il menait alors, dans de nombreux pays de la planète, pour l’abolition du mode de production capitaliste. Ainsi, malgré des circonstances défavorables et les erreurs commises, comme nous le verrons, nous saluons et soutenons une telle entreprise. Les révolutionnaires de l’époque ont assumé leur responsabilité, il fallait le faire et ils l’ont fait !
Une fondation dans des circonstances défavorables
Les révolutionnaires face à la poussée massive du prolétariat dans le monde
L’année 1919 est le point culminant de la vague révolutionnaire. Après la victoire de la révolution en Russie en octobre 1917, l’abdication de Guillaume II et la signature précipitée de l’armistice devant les mutineries et la révolte des masses ouvrières en Allemagne, on voit apparaître des insurrections ouvrières, avec notamment l’instauration de la République des conseils en Bavière et en Hongrie. On assiste également à des mutineries dans la flotte et parmi les troupes françaises, ainsi que dans des unités militaires britanniques, refusant d'intervenir contre la Russie soviétique, de même qu'il y eut une vague de grèves au Royaume-Uni (1919) touchant en particulier les centres de la contestation révolutionnaire (la Clyde, Sheffield, la Galles du Sud). Mais en mars 1919, au moment où l’IC voit le jour à Moscou, la plupart de ces soulèvements ont été réprimés ou sont en passe de l’être.
Il ne fait aucun doute que les révolutionnaires de l’époque se trouvaient dans une situation d’urgence et qu’ils étaient obligés d’agir dans le feu du combat révolutionnaire. Comme le signalait la Fraction française de la Gauche Communiste (FFGC) en 1946 : "les révolutionnaires tentent de combler le décalage existant entre la maturité de la situation objective et l'immaturité du facteur subjectif (l'absence du Parti) par un large rassemblement des groupes et courants, politiquement hétérogènes, et proclament ce rassemblement comme le nouveau Parti."[3]
Il ne s’agit pas ici de discuter la validité ou non de la fondation du nouveau parti qu'est l'Internationale. C'était d'une impérative nécessité. En revanche, nous voulons pointer un certain nombre d’erreurs dans la démarche avec laquelle il s’est fondé.
Une surestimation de la situation qui préside à la fondation du parti
Même si la plupart des rapports soumis par les différents délégués sur la situation de la lutte de classes dans chacun des pays prennent en compte la réaction de la bourgeoisie face à l’avancée de la révolution (une résolution sur la Terreur blanche est d’ailleurs votée à l’issue du congrès), il est frappant de constater à quel point cet aspect est largement sous-estimé au cours de ces cinq jours de travaux. Déjà, quelques jours après la nouvelle de la fondation du KPD, qui faisait suite à la fondation des partis communistes d’Autriche (novembre 1918) et de Pologne (décembre 1918), Lénine considérait que les dés étaient jetés : «Lorsque la Ligue Spartakus allemande, conduite par ces chefs illustres, connus du monde entier, ces fidèles partisans de la classe ouvrière que sont Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Franz Mehring, eût rompu définitivement tout lien avec les socialistes comme Scheidemann, (...) lorsque la Ligue Spartakus se fût intitulée parti communiste allemand, alors la fondation de la IIIe Internationale, de l'Internationale communiste, véritablement prolétarienne, véritablement internationale, véritablement révolutionnaire, devint un fait. Formellement, cette fondation n'a pas été consacrée, mais, en réalité, la IIIe Internationale existe, dès à présent."[4] Anecdote significative, ce texte fut terminé de rédiger le 21 janvier 1919, date à laquelle Lénine fut informé de l’assassinat de K. Liebknecht. Cette certitude inébranlable allait parcourir la totalité du congrès. Dès le discours d’ouverture, Lénine annonçait la couleur : "La bourgeoisie peut se déchaîner, elle aura beau assassiner encore des millions d’ouvriers, la victoire est à nous, la victoire de la révolution communiste mondiale est assurée." Par la suite, tous les rapporteurs de la situation versaient dans le même optimisme débordant ; à l’image du camarade Albert, membre du jeune KPD, qui devant le congrès le 2 mars s’exprimait en ces termes : "Je ne crois pas faire preuve d’un optimisme exagéré en affirmant que les partis Communistes allemand et russe poursuivent la lutte en espérant fermement que le prolétariat allemand mènera également la révolution à la victoire finale et que la dictature du prolétariat pourra être également établie en Allemagne, malgré toutes les assemblées nationales, malgré les Scheidemann et malgré le nationalisme bourgeois (...) C’est cela qui m’a incité à accepter avec joie votre invitation, convaincu que dans un délai très rapproché nous lutterons côte à côte avec le prolétariat des autres pays, en particulier d’Angleterre et de France pour la révolution mondiale pour réaliser en Allemagne également les objectifs de la révolution." Quelques jours plus tard, entre le 6 et le 9 mars, une terrible répression s’abat sur Berlin faisant 3000 morts le 8 mars dont 28 marins faits prisonniers puis exécutés à la mitrailleuse dans la pure tradition versaillaise ! Le 10 mars Léo Jogiches était assassiné. Heinrich Dorrenbach[5] subit le même sort le 19 mai.
Pourtant, les derniers mots que Lénine prononça lors du discours de clôture démontraient que le congrès n’avait pas bougé d’un iota sur l’analyse du rapport de force. Il affirmait sans hésiter que "la victoire de la révolution prolétarienne est assurée dans le monde entier. La fondation de la république internationale des Conseils est en marche."
Mais comme le faisait remarquer Amedeo Bordiga un an plus tard : "Après que le mot d'ordre «régime des soviets" fut lancé dans le monde par le prolétariat russe et le prolétariat international, on a vu la vague révolutionnaire remonter tout d'abord, après la fin de la guerre, et le prolétariat du monde entier se mettre en marche. Nous avons vu dans tous les pays les anciens partis socialistes se sélectionner et donner naissance à des partis communistes qui ont engagé la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie. Malheureusement, la période qui a suivi a été une période d'arrêt, car les révolutions allemande, bavaroise et hongroise ont été écrasées par la bourgeoisie."
En réalité, des faiblesses importantes de la conscience au sein du prolétariat constituaient une entrave majeure au développement révolutionnaire de la situation :
- Une difficulté à ce que ces mouvements dépassent la lutte contre la seule guerre et s’élèvent à un niveau supérieur, celui de la révolution prolétarienne. Cette vague révolutionnaire s’était avant tout construite contre la guerre.
- Le développement de la grève de masse par l’unification des revendications politiques et économiques restait encore très fragile, et donc peu à même d'impulser un niveau plus élevé de conscience.
- Le pic révolutionnaire était sur le point d'être atteint. Le mouvement n’eut plus la même dynamique après la défaite des luttes en Allemagne et en Europe centrale. Même si la vague continuait, elle perdait déjà de sa force à partir de 1919-1920.
- La République des soviets en Russie restait cruellement isolée. Elle restait le seul bastion révolutionnaire avec tout ce que cela pouvait favoriser comme régression de la conscience, aussi bien en son sein que dans le monde.
Une fondation dans l’urgence qui ouvre la porte à l’opportunisme
Le milieu révolutionnaire très affaibli à la sortie de la guerre
- "Le mouvement ouvrier au lendemain de la première guerre impérialiste mondiale se trouve dans un état d'extrême division. La guerre impérialiste a brisé l'unité formelle des organisations politiques se réclamant du prolétariat. La crise du mouvement ouvrier, déjà existante avant, atteint, du fait de la guerre mondiale et des positions à prendre face à cette guerre, son point culminant. Tous les partis et organisations anarchistes, syndicales et marxistes sont violemment secoués. Les scissions se multiplient. De nouveaux groupes surgissent. Une délimitation politique se produit. La minorité révolutionnaire de la 2ème Internationale représentée par les bolcheviks, la gauche allemande de Luxemburg et les Tribunistes hollandais, déjà elle-même pas très homogène, ne se trouve plus face à un bloc opportuniste. Entre elle et les opportunistes tout un arc-en-ciel de groupes et de tendances politiques plus ou moins confus, plus ou moins centristes, plus ou moins révolutionnaires, représentant un déplacement général des masses rompant avec la guerre, avec l'union sacrée, avec la trahison des anciens partis de la social-démocratie. Nous assistons ici au processus de liquidation des anciens partis dont l'écroulement donne naissance à une multitude de groupes. Ces groupes expriment moins le processus de constitution du nouveau Parti que celui de la dislocation, la liquidation, la mort de l'ancien Parti. Ces groupes contiennent certes des éléments pour la constitution du nouveau Parti mais ne présentent aucunement la base de cette constitution. Ces courants expriment essentiellement la négation du passé et non l'affirmation positive de l'avenir. La base du nouveau Parti de classe ne se trouve que dans l'ancienne gauche, dans l'œuvre critique et constructive, dans les positions théoriques, dans les principes programmatiques que cette gauche a élaboré durant les 20 ans de SON EXISTENCE ET DE SA LUTTE FRACTIONNELLE au sein de l'ancien Parti."[6]
Ainsi, le milieu révolutionnaire est extrêmement éclaté, composé de groupes manquant de clarté et faisant encore preuve d’immaturité. Seules les fractions de gauche de la IIe Internationale (les Bolcheviks, les Tribunistes et les Spartakistes en grande partie seulement, car hétérogènes voire divisés) sont en mesure de donner un cap et de dresser des bases solides pour la fondation du nouveau parti.
Par ailleurs, bon nombre de militants manquaient d’expérience politique. Parmi les 43 délégués du congrès de fondation dont les âges sont connus, 5 se trouvaient dans la vingtaine, 24 dans la trentaine, seulement un seul avait plus de 50 ans.[7] Sur les 42 délégués, dont la trajectoire politique peut être retracée, 17 avaient rejoint les partis sociaux-démocrates avant la révolution russe de 1905, tandis que 8 étaient devenus des socialistes actifs seulement après 1914.[8]
Malgré leur enthousiasme et leur passion révolutionnaire, l’expérience indispensable dans ce genre de circonstance faisait défaut pour beaucoup d’entre eux.
Des désaccords au sein de l’avant-garde du prolétariat
Comme le soulignait déjà la FFGC en 1946 : "Il est indéniable qu'une des causes historiques de la victoire de la révolution en Russie et sa défaite en Allemagne, Hongrie, Italie réside dans l'existence du Parti révolutionnaire au moment décisif dans ce premier pays et son absence ou son inachèvement dans les autres pays." La fondation de la IIIe Internationale a longtemps été différée du fait des différentes embûches qui se dressèrent face au camp prolétarien au cours de l’épisode révolutionnaire. En 1918-1919, bien consciente que l’absence du nouveau parti était une faiblesse irrémédiable pour la victoire de la révolution mondiale, l’avant garde du prolétariat restait unanime sur l’impérieuse nécessité de fonder le nouveau parti. Cependant, tous ne s’accordaient pas sur la date à laquelle le faire et surtout sur la démarche à adopter. Alors que la grande majorité des organisations et des groupes communistes étaient favorables à une fondation dans les plus brefs délais, le KPD, et tout particulièrement Rosa Luxemburg et Léo Jogiches, optaient pour un ajournement, considérant que la situation était prématurée, que la conscience communiste des masses restait encore faible et que le milieu révolutionnaire manquait également de clarté[9]. Le délégué du KPD pour la conférence, le camarade Albert, eut donc mandat de défendre cette position et de ne pas voter en faveur de la fondation immédiate de l’Internationale Communiste.
- "Quand on nous dit que le prolétariat a besoin dans sa lutte d’un centre politique, nous pouvons dire que ce centre existe déjà et que tous les éléments qui se situent sur la base du système des conseils ont déjà rompu avec les éléments de la classe ouvrière qui penchent encore pour la démocratie bourgeoise : nous constatons que la rupture se prépare partout et qu’elle est en train de se réaliser. Mais une IIIe Internationale ne doit pas être seulement un centre politique, une institution dans laquelle les théoriciens se font les uns aux autres des discours chaleureux, elle doit être le fondement d’une puissance d’organisation. Si nous voulons faire de la IIIe Internationale un instrument efficace de lutte, si nous voulons en faire un moyen de combat, alors il est nécessaire qu’existent également ces conditions préalables. La question ne doit donc pas, à notre avis, être discutée et tranchée d’un simple point de vue intellectuel, mais il est nécessaire que nous nous demandions concrètement si les bases d’organisation existent. J’ai toujours le sentiment que les camarades qui poussent si fort à la fondation se laissent énormément influencer par l’évolution de la IIe Internationale, et qu’ils veulent, après la tenue de la conférence de Berne, lui imposer une entreprise concurrente. Cela nous semble moins important, et lorsqu’on dit que la clarification est nécessaire, sinon les éléments indécis rallieront l’Internationale jaune, je dis que la fondation de la IIIe Internationale ne retiendra pas les éléments qui rejoignent la IIe aujourd’hui, et que, s’ils y vont malgré tout, c’est que là est leur place." [10]
Comme on peut le voir, le délégué allemand mettait en garde contre le danger de fonder un parti en transigeant sur les principes et la clarification organisationnelle et programmatique. Bien que les bolcheviks prenaient très au sérieux les réserves de la centrale du KPD, il ne fait pas de doute qu’ils étaient eux aussi englués dans cette course contre le temps. De Lénine à Zinoviev, en passant par Trotsky et Racovsky, tous insistent sur l’importance de faire adhérer tous les partis, organisations, groupes ou individus qui se réclament de près ou de loin du communisme et des conseils. Comme il est signalé dans une biographie de Rosa Luxembourg, "Lénine voyait dans l’Internationale un moyen d’aider les divers partis communistes à se constituer ou à se renforcer"[11] par la décantation produite par la lutte contre le centrisme et l’opportunisme. Pour le KPD, il s’agissait d’abord de former des partis communistes "solides", ayant les masses derrières eux, avant d’entériner la création du nouveau parti.
Une méthode de fondation qui n’arme pas le nouveau parti
La composition du congrès est l’illustration à la fois de la précipitation et des difficultés qui s’imposaient aux organisations révolutionnaires à l’époque. Sur les 51 délégués ayant pris part aux travaux, compte tenu des retards, des départs avant la fin et des absences momentanées, une quarantaine sont des militants bolcheviks issus du parti russe mais aussi des partis letton, lituanien, biélorusse, arménien et de Russie orientale. Outre le parti bolchevik, seuls les partis communistes allemand, polonais, autrichien et hongrois avaient une existence propre.
Les autres forces invitées au congrès se composaient d’une multitude d’organisations, de groupes ou d’éléments pas ouvertement "communistes" mais dans un processus de décantation au sein de la social-démocratie et du syndicalisme. La lettre d’invitation au congrès appelait toutes les forces qui, de près ou de loin, soutenaient la Révolution de Russie et semblaient être de bonne volonté pour œuvrer à la victoire de la révolution mondiale :
- "10° Il est nécessaire de s’allier avec ceux des éléments du mouvement révolutionnaire qui, quoique n’ayant pas appartenu autrefois aux partis socialistes, se placent aujourd’hui dans l’ensemble sur le terrain de la dictature du prolétariat sous la forme du pouvoir des conseils. Il s’agit en premier lieu des éléments syndicalistes du mouvement ouvrier.
- 11° Il est enfin nécessaire de gagner tous les groupes ou organisations prolétariennes qui, sans s’être ralliés ouvertement au courant révolutionnaire, manifestent cependant dans leur évolution une tendance en ce sens."[12]
Cette démarche déboucha sur plusieurs anomalies qui témoignent du manque de représentativité d’une partie du congrès. Par exemples, l’Américain Boris Reinstein n’avait pas de mandat de son parti, le Socialist Labor Party. Le Néerlandais S.J. Rutgers représentait une ligue pour la propagande socialiste. Christian Racovsky[13] était sensé représenter la Fédération balkanique, les Tesnjaki bulgares et le PC roumain. Or, il n’avait plus aucun contact avec ces trois organisations depuis 1915-1916.[14] Par conséquent, malgré les apparences, ce congrès de fondation était dans le fond parfaitement représentatif de l'insuffisance de la conscience au sein de la classe ouvrière mondiale.
Tous ces éléments montrent également qu’une grande partie de l’avant garde révolutionnaire fit primer la quantité au détriment d’une clarification préalable sur les principes organisationnels. Cette démarche tournait le dos à toute la conception qu’avaient développé les bolcheviks au cours des quinze dernières années. Et c’est déjà ce que faisait remarquer la FFGC en 1946 : "Autant la méthode "étroite" de la sélection sur des bases principielles les plus précises, sans tenir compte des succès numériques immédiats, a permis aux bolcheviks l'édification du Parti qui, au moment décisif, a pu intégrer dans son sein et assimiler toutes les énergies et les militants révolutionnaires des autres courants et conduire finalement le prolétariat à la victoire, autant la méthode "large", soucieuse avant tout de rassembler immédiatement le plus grand nombre au dépens de la précision programmatique et principielle, devait conduire à la constitution de Partis de masses, véritables colosses aux pieds d'argile qui devaient retomber à la première défaite sous la domination de l'opportunisme. La formation du Parti de classe s'avère infiniment plus difficile dans les pays capitalistes avancés - où la bourgeoisie possède mille moyens de corruption de la conscience du prolétariat - qu'elle ne le fut en Russie."
Aveuglée par la certitude d’une victoire imminente du prolétariat, l’avant garde révolutionnaire sous-estimait énormément les difficultés objectives qui se dressaient devant elle. Cette euphorie l’amena à transiger avec la méthode "étroite" de la construction de l’organisation qu’avaient défendue avant tout les bolcheviks en Russie et en partie les spartakistes en Allemagne. Considérant que la priorité devait être faite à un grand rassemblement révolutionnaire permettant également de contrer "l’Internationale jaune" qui s’était reformée à Berne quelques semaines avant. Cette méthode "large" reléguait la clarification sur les principes organisationnels à un rang annexe. Peu importait les confusions que véhiculaient les groupes intégrés dans le nouveau parti, la lutte se mènerait en son sein. Pour l’heure, la priorité était donnée au regroupement du plus grand nombre.
Cette méthode "large" allait s’avérer lourde de conséquence puisqu’elle affaiblissait l’IC dans la lutte organisationnelle à venir. En effet, la clarté programmatique du premier congrès allait être foulée aux pieds par la poussée opportuniste dans un contexte d'affaiblissement et de dégénérescence de la vague révolutionnaire. C’est au sein de l’IC qu’émergèrent les fractions de gauche qui critiquèrent les insuffisances de la rupture avec la IIe Internationale. Comme nous le verrons par la suite, les positions défendues et élaborées par ces groupes répondaient aux problèmes soulevés dans l’IC par la nouvelle période de décadence du capitalisme.
(A suivre).
Narek, le 4 mars 2019.
[1] La conférence de Berne en février 1919 qui constituait "une tentative de galvaniser le cadavre de la Deuxième Internationale" et à laquelle "le Centre" avait envoyé ses représentants.
[2] Pour de plus larges développement voir l’article "Mars 1919 : fondation de l’Internationale communiste [806]", Revue internationale n°57, 2eme trimestre 1989.
[3] Internationalisme, "A propos du Premier Congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie", n° 7, janvier-février 1946. Cet extrait s'applique à la fondation de l'internationale et non pas à celle tout à fait volontariste, 27 ans plus tard, du PCI en Italie
[4] Lénine, Oeuvres, t. XXVIII, p. 451.
[5] Commandant de la division de la marine populaire à Berlin en 1918. Après la défaite de janvier, il se réfugie à Brunswick puis Eisenach. Il est arrêté et exécuté en mai 1919.
[6] Internationalisme, "A propos du Premier Congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie", n° 7, janvier-février 1946.
[7] Founding the Communist International: The Communist International in Lenin's Time. Proceedings and Documents of the First Congress : March 1919, Edited by John Riddell, New York, 1987, Introducion, p. 19
[8] Ibidem.
[9] C’est le mandat qu’ils donnèrent (dans la première moitié du mois de janvier) au délégué du KPD pour le congrès de fondation. Ceci ne signifie en rien que Rosa Luxemburg, par exemple était par principe opposée à la fondation d'une internationale. Tout au contraire.
[10] Intervention du délégué allemand le 4 mars 1919, in Premier congrès de l’Internationale Communiste, textes intégraux publiés sous la direction de Pierre Broué, Etudes et documentation internationales, 1974.
[11] Gilbert Badia, Rosa Luxemburg. Journaliste, polémiste, révolutionnaire, Editions sociales, 1975.
[12] "Lettre d’invitation au congrès", in Op. Cit., Premier congrès de l’Internationale.
[13] L’un des délégués les plus influents et décidés pour une fondation immédiate de l’IC.
[14] Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste (1919-1943), Fayard, 1997, p 79.
Rubrique:
Internationalisme n° 7 (Année 1946): À propos du 1er congrès du Parti communiste internationaliste d'Italie
- 255 lectures
Introduction
Pour alimenter la discussion autour de la formation du futur parti mondial de la révolution nous publions ci-après deux chapitres d’un article d’Internationalisme no 7 de janvier 1946, intitulé À propos du 1er congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie. La revue Internationalisme était l’organe théorique de la Fraction française de la Gauche Communiste (FFGC), c’est-à-dire du groupe politiquement le plus clair de la période immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. La Fraction va se transformer fin 1945 en Gauche communiste de France (GCF) pour éviter la confusion avec une scission constituée de militants français l'ayant quittée et ayant repris le même nom (celui de FFGC- bis).
Cet article développe, en se basant sur les leçons de la dégénérescence de la 3ème Internationale, les critères devant présider à la constitution d’un futur parti mondial. Les deux chapitres publiés dans cette Revue – le premier "La fraction de gauche" et le sixième "Méthode de formation du parti" – donnent un aperçu des questions politiques s'étant posées depuis la fondation de la 3ème Internationale et fournissent à leur propos une argumentation cohérente. Ils font le pont entre la période du premier après-guerre et celle du second après-guerre, sur la base du bilan tiré par la Fraction italienne dans les années 1930, tandis que les autres chapitres sont plutôt dédiés aux polémiques avec des positions et courants plus spécifiques des années 1940, tels les RKD (Revolutionäre Kommunisten Deutschlands, ex-trotskistes autrichiens) et Vercesi.
Brièvement résumés, les critères pour la fondation du parti sont d'une part, un cours ouvert vers la reprise de la lutte offensive du prolétariat, et d'autre part, l'existence d'une base programmatique solide pour le nouveau parti.
À ce moment-là, après la réunion du premier congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie, fin décembre 1945 à Turin, la GCF considère que la première condition – un nouveau cours favorable – est satisfaite. Donc, sur cette base, elle salue la transformation de la Fraction de gauche italienne "en donnant naissance au nouveau Parti du Prolétariat" (chapitre "La fraction de gauche"). C’est seulement plus tard, en 1946, que la GCF se rendait compte que la période de la contre-révolution n’était pas terminée et donc que les conditions objectives de la formation du Parti faisaient défaut. En conséquence, elle arrête alors la publication de son journal d’agitation L’Étincelle estimant que la perspective d’une reprise historique des combats de classe n'est pas à l'ordre du jour. La dernière publication de L’Etincelle date ainsi de novembre 1946.
Par ailleurs, la GCF critique sévèrement la méthode utilisée pour la constitution du parti italien, à travers "l'addition de courants et de tendances" sur une base programmatique hétérogène (chapitre "Méthode de formation du parti"), de la même manière qu'elle avait critiqué (dans le même chapitre) la méthode de formation de l'IC, faisant un "amalgame autour d'un programme volontairement laissé inachevé" et opportuniste(1), qui tournait ainsi le dos à la méthode qui avait été celle de la construction du parti bolchevique.
Le mérite de cet article d’Internationalisme est d’insister sur la rigueur nécessaire autour du programme, qui n’existait pas dans le parti récemment constitué en Italie. Cet article – écrit à peu près un quart de siècle après la fondation du Comintern, et quelques semaines après le congrès du PCInt – est certainement la critique la plus conséquente à l'encontre de la méthode du parti bolchévique dans la fondation de l'Internationale communiste. Internationalisme était aussi la seule publication du milieu de la Gauche Communiste de l’époque à relever l’approche opportuniste du PCInt.
En ce sens, la GCF est une illustration de la continuité avec la méthode de Marx et Engels lors de la fondation du parti de la social-démocratie allemande à Gotha en 1875 (cf. la critique du programme de Gotha), qui avait rejeté les bases confuses et opportunistes sur lesquelles le SAPD s’était fondé. Continuité également avec l’attitude de Rosa Luxemburg face l’opportunisme du révisionniste Bernstein dans la social-démocratie allemande 25 ans plus tard, mais aussi avec celle de Lénine en matière de principes d’organisation face aux Mencheviques. Continuité enfin avec l'attitude de Bilan face à l'opportunisme du courant Trotskiste durant les années 1930. C’est grâce à cette intransigeance dans la défense des positions programmatiques et des principes organisationnels que des éléments provenant du courant autour de Trotsky (tels les RKD) ont pu s’orienter vers la défense de l’internationalisme pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Tenir haut le drapeau de l’internationalisme face aux "partisans", défendre l’intransigeance contre l’opportunisme était donc une condition pour que les forces internationalistes puissent trouver une boussole politique.
Nous devons dans cette présentation préciser une formulation concernant le combat du Spartakusbund pendant la Première Guerre mondiale. L’article dit, dans le 6ème chapitre : "L'expérience du Spartakusbund est à ce sujet édifiante. La fusion de ce dernier avec les Indépendants n'a pas conduit, comme ils l'espéraient, à la création d'un Parti de classe fort mais à noyer le Spartakusbund par les Indépendants et à affaiblir le prolétariat allemand. Rosa Luxemburg, avant d'être assassinée, et d'autres chefs du Spartakusbund semblaient s'être rendu compte de leur erreur de fusion avec les Indépendants et tendaient à la corriger. Mais cette erreur n'a pas seulement été maintenue par l'IC en Allemagne, elle devait devenir la méthode pratiquée, imposée par l'IC dans tous les pays pour la formation des Partis Communistes". Il n’est pas exact de parler de fusion du Spartakusbund avec l'USPD. Le parti USPD fut fondé par la SAG (Sozialistische Arbeitsgemeinschaft – groupe de travail socialiste) ; le groupe "Die Internationale" (le Spartakusbund) s'y est intégré. Mais ce n'était pas une fusion à proprement parler, laquelle suppose une dissolution de l'organisation qui vient fusionner avec l'autre. En fait les Spartakistes ont conservé leur indépendance organisationnelle et celle de leur capacité d'action tout en se donnant l'objectif d'attirer à leurs positions la gauche de cette formation. Tout différente avait été la démarche de l'IC à travers la fusion de différents groupes dans un seul parti, en "abandonnant" la nécessaire sélection au profit de "l'addition", "les principes [étant] sacrifiés [au profit de] la masse numérique".
Il faut également rectifier une erreur factuelle de cet article. Il dit : "En Angleterre, l'IC imposera aux groupes communistes d'adhérer à l'Independant Labour Party pour former, à l'intérieur de ce parti réformiste, une opposition révolutionnaire massive". En fait, l’IC exigeait l’intégration des communistes dans le Labour Party tout court ! Cette erreur de détail n'altère en rien le fond de l’argumentation d’Internationalisme.
(14 mai 2019)
La fraction de gauche
À la fin de l’année 1945 s’est tenu le premier Congrès du jeune Parti Communiste Internationaliste d’Italie récemment constitué.
Ce nouveau Parti du prolétariat n’a pas surgi spontanément du néant. Il est le fruit d’un processus qui commence avec la dégénérescence de l’ancien Parti Communiste et de l’Internationale Communiste. Cette dégénérescence opportuniste a fait surgir à l’intérieur même de l’ancien parti la réponse historique de la classe : la Fraction de gauche.
Comme tous les partis communistes constitués au lendemain de la première guerre mondiale, le Parti Communiste d’Italie contenait au moment de sa formation des courants opportunistes et des courants révolutionnaires.
La victoire révolutionnaire du prolétariat russe et du Parti bolchevique de Lénine en octobre 1917, par l’influence décisive qu’elle exerçait sur le mouvement ouvrier international, achevait d’accélérer et de précipiter la différenciation et la délimitation organisationnelle et politique entre les révolutionnaires et les opportunistes qui cohabitaient dans les anciens partis socialistes de la IIe Internationale. La guerre de 1914 a brisé cette unité impossible dans les vieux partis.
La Révolution d’Octobre devait hâter la constitution des nouveaux partis du prolétariat. Mais cette influence positive de la Révolution d’Octobre contenait en même temps des éléments négatifs.
En brusquant la formation de nouveaux partis, elle empêchait la construction de se faire sur la base d’une netteté de principes et de programme révolutionnaire. Ceux-ci ne peuvent être élaborés qu’à la suite d’une lutte politique franche et intransigeante éliminant les courants opportunistes et les résidus de l’idéologie bourgeoise.
Faute d’achèvement d’un programme de la révolution, les anciens Partis Communistes, construits trop hâtivement sur la base d’un attachement sentimental à la révolution d’Octobre, offraient par trop de fissures pour la pénétration de l’opportunisme, dans les nouveaux partis du Prolétariat.
Aussi, l’IC et les Partis Communistes des divers pays verront, dès leur fondation, rebondir la lutte entre les révolutionnaires et les opportunistes. La lutte idéologique - qui devait se faire préalablement et être la condition de la construction du parti, qui ne peut se protéger de la gangrène opportuniste que par l’énonciation des principes et la construction du programme -, n’a eu lieu qu’après la constitution des Partis. Ce de fait, non seulement les anciens partis communistes de par leur constitution introduisaient en leur sein le germe de l’opportunisme, mais encore devaient rendre plus difficile la lutte des courants révolutionnaires contre l’opportunisme survivant et se camouflant à l’intérieur même du nouveau Parti. Chaque défaite du prolétariat, modifiant le rapport des forces de classe en défaveur du prolétariat, produisait inévitablement le renforcement des positions de l’opportunisme dans le Parti, qui à son tour devenait un facteur supplémentaire pour les défaites ultérieures du Prolétariat.
Si le développement de la lutte entre les courants dans le Parti atteignit rapidement une acuité si grande, cela est dû à la période historique présente. La Révolution prolétarienne est sortie des sphères de la spéculation théorique. D’un idéal lointain qu’elle était hier, elle est devenue un problème d’activité pratique, immédiate.
L’opportunisme ne se manifeste plus dans des élucubrations théoriques livresques agissant comme un poison lent sur les cerveaux des prolétaires. A l’époque présente de lutte de classes aiguë, il a sa répercussion immédiate et se paie par des millions de vies de prolétaires et de défaites sanglantes de la Révolution. A l’opportunisme surgissant et se renforçant dans l’IC et ses Partis, à l’opportunisme principal atout et auxiliaire du capitalisme contre la révolution, parce qu’il est le prolongement de l’ennemi de classe au sein même de l’organe décisif du prolétariat. Le Parti, les révolutionnaires ne pouvaient s’opposer qu’en constituant leur Fraction, en proclament la lutte ouverte et à mort contre lui. La constitution de la Fraction signifie que le Parti est devenu le théâtre où s’affrontent les expressions de classes opposées et antagoniques.
Elle signifie le cri de guerre des révolutionnaires pour sauvegarder le Parti à la classe, contre le capitalisme et ses agents opportunistes et centristes, tendant à s’emparer du Parti et à en faire un instrument contre le Prolétariat.
La lutte entre la Fraction communiste de gauche et les fractions centristes et droitières pour le Parti n’est pas une lutte pour la "direction" de l’appareil, mais essentiellement programmatique ; c’est un aspect de la lutte générale entre la révolution et la contre-révolution, entre le capitalisme et le prolétariat.
Cette lutte suit le cours objectif des situations, les modifications des rapports de force entre les classes et est conditionnée par ces derniers.
L’issue ne peut être que le triomphe du programme de la Fraction de gauche et l’élimination de l’opportunisme, ou la trahison ouverte du Parti, passant au service du capitalisme. Mais quelle que soit l’issue de cette alternative, l’apparition de la Fraction signifie que la continuité historique et politique de la classe est passée définitivement du Parti à la fraction et que c’est elle seule qui exprime et représente désormais la classe.
Et de même que l’ancien Parti ne peut être sauvegardé que par le triomphe de la Fraction, de même dans l’alternative de la trahison de l’ancien Parti, achevant ainsi son cours inéluctable sous la direction du centrisme, le nouveau parti de classe ne peut se former que sur les bases programmatiques données par la Fraction.
La continuité historique de la classe, le processus de cette continuité se faisant par la succession Parti-fraction-Parti, est une des notions fondamentales de la Gauche Communiste Internationale. Cette position fut longtemps un postulat théorique. La formation du P.C.I. d’Italie et son Ier Congrès apportent la confirmation historique de la justesse de ce postulat.
La Fraction de gauche italienne, après une lutte de 20 ans contre le centrisme, achève sa fonction historique en se transformant et en donnant naissance au nouveau Parti du Prolétariat.
De la fraction au parti de classe
Une deuxième confirmation historique nous est donnée par la constitution du PCI, à savoir sur le moment historique de la formation du nouveau Parti.
Les trotskistes, méconnaissant tous les critères marxistes, abordaient le problème de la formation du Parti comme une question ne relevant d’aucune condition objective. Pour eux, le problème de la formation du Parti ne relève que du volontarisme subjectif, du « savoir faire », de la manœuvre astucieuse et du noyautage.
Aussi passent-ils de leur position « d’opposition », se déclarant prêts à dissoudre leur organisation propre contre la liberté d’expression démocratique dans le Parti stalinien, à la proclamation du nouveau Parti et d’une nouvelle Internationale. Avec la même désinvolture ils peuvent, quelques mois après, dissoudre leur nouveau Parti et leur nouvelle Internationale pour retourner dans les Partis socialistes de la Iième Internationale qui, depuis 1914, sont devenus des partis de la bourgeoisie. Leur acrobatie dans le domaine du Parti - où, tour à tour, ils sont l’opposition du parti stalinien prêts à se dissoudre, POI, « opposition » dans le parti socialiste, de nouveau PCI pour redevenir opposition dans le PSOP et de nouveau POI - n’a de comparable que l’ensemble de leur inconsistance politique, leur défense de l’URSS, leur participation à la guerre impérialiste, leur participation à la libération nationale et à la résistance.
La Gauche Communiste Internationale a toujours condamné énergiquement cette espèce particulièrement dangereuse d’aventurisme et d’irresponsabilité qui consiste à proclamer, dans n’importe quelle situation, la formation du nouveau Parti.
La dégénérescence et la trahison de l’ancien Parti ne sont pas un produit de la volonté démoniaque ou de l'intrigue de quelques chefs qui se sont vendus à la bourgeoisie mais sont le reflet, la résultante de l'insuffisance du programme initial qui a permis d'abord la pénétration de l'idéologie bourgeoise de se faire et de se cristalliser en un courant opportuniste et d'un cours objectif de défaites et de reculs du prolétariat qui permet à la bourgeoisie de s'emparer du Parti, sans que le prolétariat puisse se défendre. Les mêmes conditions historiques ne permettent pas au prolétariat de sauvegarder son ancien Parti et lui interdisent la formation du nouveau Parti. Seuls un cours nouveau, un changement favorable au prolétariat dans les rapports de force, une reprise générale de la lutte offensive du prolétariat créent les conditions permettant la reconstitution du nouveau Parti. Cette situation n'existait pas entre 1933 et 1939 qui était justement la période du cours vers la guerre impérialiste.
Le RKD qui nous reprochait pendant toute une période, notre soi-disant centrisme, parce que nous restions et agissions en tant que Fraction et en repoussant la phraséologie révolutionnaire sur la formation du Parti quand le moment de cette formation n'était pas encore venu, ne faisait qu'exprimer leur propre incompréhension aussi bien sur la notion fondamentale du Parti et du moment de sa construction que sur la place historique qu'occupe la Fraction.
La formation du PCI d'Italie prouve que le Parti ne se forme pas par la volonté de militants à n'importe quel moment de l'histoire. La succession de la Fraction en Parti reste soumise à certaines conditions objectives comme c'est le cas pour la 1ère partie du processus dans la succession du Parti en Fraction.
La signification historique des évènements de juillet 1943 en Italie
La formation du Parti en Italie clôt pratiquement un débat passionné qui a surgi au sein de la GCI et de la Fraction Italienne. Une tendance dans la Fraction Italienne - la tendance Vercesi et en partie aussi la Fraction belge - niait, et cela jusqu'à la fin des hostilités, l'apparition du prolétariat italien sur la scène politique. Pour cette tendance, les événements de 1943 n'étaient qu'une manifestation de la crise économique dite « crise de l'économie de guerre », ou bien une Révolution de Palais, une chamaillerie dans les hautes sphères dirigeantes du capitalisme italien et rien de plus.
Le prolétariat italien, pour cette tendance, était et continuait d'être absent aussi bien politiquement que socialement. Cela devait cadrer avec toute une théorie, échafaudée par cette tendance sur "l'inexistence sociale du prolétariat pendant la guerre et pendant toute la période de l'«économie de guerre»".
Aussi, après 1943 comme avant, ils préconisaient la passivité absolue allant jusqu'à la dissolution organisationnelle de la Fraction. Avec la Fraction italienne, nous avons combattu pied à pied cette tendance liquidationniste dans la GCI (1 [807]).
Avec la Fraction italienne, nous avons analysé les événements de 1943 en Italie comme une manifestation avancée de la lutte sociale et de l'ouverture du cours vers la Révolution et préconisé l'orientation de la transformation de la Fraction en Parti.
On ne peut décemment se proclamer solidaire avec l'existence du PCI en Italie sans reconnaître la justesse de notre analyse en 1943. L'un implique l'autre ; la formation du nouveau Parti en Italie, son développement, sont la réponse la plus catégorique concluant un débat qui fut acharné entre nous et la tendance opportuniste de Vercesi.
Comment en effet peut-on concevoir qu'on approuve d'une part la formation du Parti en prétendant par ailleurs que le cours historique n'a pas subi de changement profond ?
Ceux qui, comme la tendance révisionniste, nient qu'en 1943 il y a eu une première rupture du cours de la guerre impérialiste, qu'en 1943 il y a eu une première manifestation d'opposition de la classe à la guerre, devraient - s'ils restaient logiques et s'ils restaient toujours convaincus de la formulation théorique de la Fraction de l'impossibilité de construction du Parti en période de reflux - condamner la formation du PCI comme un acte d'aventurisme volontariste. Il n'en est cependant rien, puisque ceux-là même qui n'avaient pas assez de sarcasmes contre notre analyse "optimiste" sont aujourd'hui les partisans les plus acharnés, les enthousiastes les plus bruyants aujourd'hui. C'est en vain qu'on cherchera dans leurs écrits récents une explication quelconque de leur contradiction flagrante. La facilité avec laquelle on change d'attitude et de position, on accumule des contradictions les plus criantes, est vraiment ahurissante. Les années de politique de zigzag de l'IC ont accoutumé et perverti les esprits au point que, même dans le milieu des groupes de la Gauche, les contradictions les plus évidentes ne provoquent pas toujours des réactions immédiates.
Mais qu'on la reconnaisse, qu'on la justifie ou non, une contradiction reste une contradiction. Devant chaque militant pensant, la question reste posée et aucun subterfuge ne peut en venir à bout. Ou bien le Parti peut être construit dans n'importe quelle période, aussi bien dans la période de flux que de reflux révolutionnaire, et alors ce sont les trotskistes qui avaient raison contre la Gauche communiste internationale, ou bien le Parti peut être construit en Italie et dans les autres pays parce qu'il s'y est ouvert un nouveau cours historique de flux révolutionnaire.
Mais si on accepte la deuxième formulation, cette question se pose immédiatement : "à quels événements doit-on attribuer la signification manifeste d'un nouveau cours historique opposé au précédent, et à quel moment se situe ce nouveau cours".
La chute du régime de Mussolini en Italie comme l'arrêt de la guerre, par eux-mêmes, ne déterminent pas un cours historique nouveau car, s'il en était ainsi, on ne comprendrait pas pourquoi la GCI déclarait impossible et s'opposait violemment à la fabrication de Partis dans la période précédant la guerre, c'est-à-dire la période où la guerre n'existait pas et cela aussi bien dans les pays à régime "démocratique". Non seulement la chute de Mussolini et l'arrêt de la guerre ne déterminent pas le cours montant et n'expliquent pas par eux-mêmes le nouveau cours, mais en se référant à ces événements on ne fait que renvoyer l'explication à des événements qui, précisément, doivent être eux-mêmes expliqués.
On ne fait ainsi que tourner dans un cercle vicieux et on va de difficulté en difficulté.
On connaît la théorie de Vercesi de la "crise de l'économie de guerre", appendice de sa théorie de "l'économie de guerre". Selon cette théorie, la guerre, qui est le point culminant de l'ère de plus grande prospérité et d'essor économique (2 [808]), ne s'arrête que par une crise due à l'épuisement économique. Passons sur le paradoxe que la plus grande prospérité qui est la guerre débouche justement dans une crise d'épuisement, cette idée est non moins absurde que la première et en découle directement, ce qui consiste à présenter et à définir la guerre et l'économie de guerre, qui se caractérisent par une politique économique de destruction, comme l'ère de la plus grande prospérité. Nous retiendrons ici seulement cette proposition selon laquelle la guerre s'arrête par une crise d'épuisement économique et c'est cette crise qui, après avoir déterminé l'arrêt de la guerre, conditionne ensuite, dans l'après-guerre, l'apparition du prolétariat et la reprise des luttes sociales.
Si nous admettions un instant ce schéma comme la reproduction exacte de la réalité, une chose reste toujours non démontrée, à savoir pourquoi cette crise "économique" déterminera par sa seule vertu une crise sociale et ouvrira le cours offensif de la révolution en dehors duquel ne peut se fonder le nouveau Parti ? Nous avons connu dans l'histoire bien des crises économiques qui loin d'être un point de départ d'un cours offensif du prolétariat ont, au contraire, coïncidé avec l'accentuation du cours de reflux. Nous prendrons pour exemple les années 1929 à 1934, période du plus bas de la crise permanente du capitalisme décadent. Cette période se caractérise par des défaites du prolétariat international et des défaites d'autant plus grandes qu'elles sont infligées à un prolétariat qui ne combat point et qui subit. C'est la période du passage ouvert des partis de l'IC au service de l'Etat capitaliste national, réapprenant aux ouvriers la défense de la Patrie. La "crise économique" de Vercesi est absolument impuissante à expliquer le cours historique nouveau.
Mais voyons la vérification de cette théorie dans la réalité concrète ? D'après elle, il fallait attendre patiemment la fin de la guerre impérialiste pour qu'on puisse voir resurgir le prolétariat et s'ouvrir un cours nouveau posant les conditions de la formation du Parti. Tout cela demandait un certain temps. Et en attendant la fin de la guerre, on ne pouvait rien faire du point de vue révolutionnaire. Tout au plus, pouvait-on utiliser cette "morte-saison" du prolétariat pour catéchiser la bourgeoisie, comme le faisait Vercesi dans le Comité antifasciste de l'émigration italienne à Bruxelles. Et que voyons-nous ?
Pendant que Vercesi préside aux destinées de la Coalition antifasciste et fait figure de rédacteur du journal de cette coalition où s'étaient les exhortations les plus chauvines pour la participation à la guerre impérialiste, pendant ce temps en pleine guerre, les militants révolutionnaires en Italie et, en premier lieu, ceux de la Fraction de gauche, font des efforts de rassemblement et s'orientent vers la formation du Parti. Même chronologiquement le Parti naît avant la fin de la guerre.
Le point de départ de la formation du nouveau Parti n'est pas la crise économique de l'après-guerre, mais directement la crise de la guerre, la rupture du cours de la guerre survenue et jaillissant dans le cours même de la guerre, et dont sa manifestation ouverte porte un nom et une date : les événements de Juillet 1943 en Italie.
Contre le capitalisme, pour la formation du parti ou pour l’antifascisme par la coalition avec la bourgeoisie
Aujourd'hui, tout le monde s'est rallié au nouveau Parti et, bien plus, ceux-là mêmes qui ont été les adversaires les plus acharnés de la construction du Parti sont ceux qui poussent le plus de clameurs en sa faveur. Ces cris enthousiastes sont probablement moins des hommages à l'adresse du Parti que le besoin d'oublier et de faire oublier les positions antérieures. Cependant, nous ne croyons pas obéir à on ne sait quel ressentiment, ni à de l'amour-propre, en rappelant les positions respectives de chacun. L'histoire nous a appris à nous méfier doublement des brusques conversions. Nous préférons l'hostilité d'un Martov à l'amitié pernicieuse d'un Martinov converti au bolchevisme. Ce n'est pas que nous considérons qu'une erreur, sur le plan individuel, soit fatale à celui qui la commet. Une correction des fautes, mêmes les plus graves, reste toujours possible. Mais pour qu'il y ait correction il faut qu'il y ait eu auparavant prise de conscience et examen critique.
L'"oubli" n'est que du refoulement. Une maladie blanchie n'est qu'une apparence de guérison et conduit en perspective à des accidents et rechutes fatales. La question est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas ici d'une individualité, d'un cas isolé, mais d'une maladie qui s'est développée au sein de l'organisme de la classe, dans la Fraction. Le fait que la Fraction a été "dépassée" par la fondation du Parti, ne signifie pas le dépassement automatique des maladies qui ont surgi dans la Fraction. Il y a continuité politique entre la Fraction et le Parti, comme il y a continuité physiologique entre l'adolescent et l'adulte.
Et parce qu'existe cette continuité, il n'y a pas d'effacement mais il doit y avoir dépassement. Quitte donc à paraître des trouble-fête et des empêcheurs de danser en rond, nous estimons indispensable de voir dans le déroulement des événements et d'en faire la preuve, l'examen, au travers desquels se vérifient, se confirment ou s'infirment les positions politiques fondamentales d'hier, et afin de permettre, au travers de cette vérification, de dégager la nature politique intime de tel ou tel courant.
Nous avons vu la Fraction italienne et la GCI se diviser en deux courants dont l'opposition ira en se creusant et en s'approfondissant davantage à chaque événement. L'analyse diamétralement opposée des événements de juillet 1943 devait faire sortir les divergences du domaine de la spéculation théorique et les matérialiser dans le domaine de la pratique immédiate. La résolution sur les "Tâches immédiates", votée par la Conférence d'août 1943, formulera notre orientation générale vers l'accentuation de la reprise d'activité sur le plan international et vers la construction du Parti en Italie. Mais tandis que la majorité de la Fraction italienne et de notre Fraction s'inspirèrent de cette résolution, de cette orientation dans leur activité politique, la tendance Vercesi combattra violemment cette orientation et toute l'activité. Partant de "l'inexistence sociale du prolétariat" durant la période de l'économie de guerre, niant son apparition politique dans les remous sociaux en 1943, la tendance Vercesi proclamera la nécessité de la passivité absolue jusqu'à ce que les nouvelles conditions aient mûri. Nous savons, depuis, en quoi consistaient les nouvelles conditions. Vercesi s'est expliqué publiquement à ce sujet. Elles consistaient dans la victoire du bloc anglo-saxon, "victoire que nous devons souhaiter".
Et puisque le défaitisme révolutionnaire de Lénine s'est transformé en défaitisme du fascisme tout court, et puisque cette défaite du fascisme est la condition (jusqu'à présent nous croyions que c'était non la condition mais le produit) de la reprise de la lutte de classes. Vercesi et sa tendance, afin de hâter la maturation de cette condition, proclameront la nécessité de la coalition avec la bourgeoisie "démocratique" et antifasciste. Avec la relève du gendarme nazi par le gendarme "démocratique", avec le changement de l'occupant, la substitution de l'occupation impérialiste allemande par l'occupation non moins impérialiste anglo-saxonne, qu'on a appelée la "libération", Vercesi et sa tendance trouveront la pleine liberté d'action, de la parole, de la presse (3 [809]). En prenant l'initiative de la formation du Comité de coalition antifasciste avec tous les partis "démocratiques" de la bourgeoisie, cette tendance traduit à son tour, dans l'activité pratique, ses vues théoriques.
On saluera l'action des "partisans" en qui on verra une force de classe. On enseignera que l'antifascisme aurait cessé d'être l'arme capitale entre les mains du capitalisme pour dévoyer le prolétariat et détruire sa conscience de classe, pour devenir l'arme de l'émancipation du prolétariat ; on découvrira que la coalition avec la bourgeoisie ne serait plus la trahison du prolétariat, mais serait de la "tactique indirecte" ; on appellera les ouvriers à participer à la farce bouffonne et trompeuse de "l'épuration" ; on fera comprendre aux ouvriers que leurs intérêts de classe leur dictent de se faire les auxiliaires bénévoles de la police et à pratiquer la "dénonciation" à la police des "fascistes" ; on réapprendra aux ouvriers que l'assistance et la culture sont des choses qui sont au-dessus des luttes des partis, c'est-à-dire des classes ; on fera passer les chefs socialistes, traîtres en 1914, pour des amis et protecteurs des ouvriers immigrés ; enfin on se servira de la phraséologie marxiste comme hors-d'œuvre dans le journal de la coalition où les plats de consistance seront les appels pour le recrutement des volontaires, pour la participation à la guerre impérialiste, pour la victoire des alliés, la libération de la mère-patrie et la reconstruction de la nouvelle Italie "républicaine et démocratique".
La négation de l'existence sociale et politique du prolétariat devait conduire cette tendance à abandonner les positions politiques de la classe et à se rattacher directement à la bourgeoisie. Il n'y a pas de voie mixte ou intermédiaire. Ou contre le capitalisme par la formation du Parti de classe ou pour l'antifascisme avec la bourgeoisie. La Fraction a choisi la première voie, la tendance opportuniste de Vercesi la seconde. Sa banqueroute fut totale.
Mais il ne suffit pas de changer géographiquement de lieu pour effacer derrière soi les traces d'une pratique et d'une politique de trahison. La conversion et le rattachement au Parti, quoique contenant la condamnation de cette politique, n'offre en soi aucune garantie. Cependant, nous ne préconisons pas comme absolument inévitable l'exclusion individuelle. La question est bien plus grave pour pouvoir se régler par de simples meures organisationnelles. Elle ne peut trouver sa solution que dans cette alternative : ou la tendance Vercesi exécute publiquement, devant le Parti et le prolétariat, sa politique de coalition antifasciste et toute sa théorie opportuniste qui l'ont conduit à cette politique, ou bien c'est au Parti, après une discussion critique ouverte, d'exécuter théoriquement, politiquement et organisationnellement, la tendance opportuniste de Vercesi.
Trois erreurs graves de la Fraction Italienne
Dans la dernière période de son existence, la Fraction Italienne a accompli, en dépit des terribles conditions du fait de la guerre et de sa faiblesse numérique, un travail fécond. Il suffirait de rappeler les documents et résolutions sur la nature de la guerre impérialiste, sur la nature capitaliste de l'Etat russe, les essais sur le problème de l'Etat après la victoire de la révolution, les documents contre la théorie révisionniste de l'économe de guerre pour ne citer que les points les plus importants, pour mesurer tout l'acquis positif de son travail pendant la guerre, et qui a dégagé la Fraction de l'impasse où elle s'est trouvée fourvoyée à la veille de la guerre. L'existence de notre Fraction Française de la GC, qui est due en grande partie à l'influence et à la participation directe des camarades de la Fraction Italienne, fait également partie de l'acquis positif de son travail pendant les années de la guerre.
Mais il serait faux de croire qu'il n'y a que de l'actif au bilan. Il y a aussi toute de nombreuses questions que la Fraction Italienne a laissées inachevées, sur lesquelles elle a hésité ou encore qu'elle a mal résolues. Ses erreurs et hésitations portent plus particulièrement sur la période transitoire s'ouvrant avec l'arrêt de la guerre mondiale, sur les objectifs et le programme d'action susceptibles de mobiliser les masses dans la nouvelle situation en vue de la révolution ; sur la question des organismes unitaires de la classe, les Conseils ouvriers ou les syndicats prétendus à tort comme représentant toujours, par leur structure et dans leur nature, l'organisation par excellence de la classe, comme un « Etat dans l'Etat ». Elles portaient aussi sur l'illusion d'une possibilité de retour du capitalisme à une « économie de paix » et, le renvoi à une perspective lointaine de la menace d'une troisième guerre impérialiste ; et, dans le domaine concret, une série de fautes à caractère sectaire furent accumulées dans les rapports avec les autres groupes, dans la voie du regroupement international de l'avant-garde.
Nous n'entendons pas faire ici l'histoire de la Fraction Italienne, ni examiner tout son travail. Nous ne voulons nous arrêter que sur les points liés directement à la formation du Parti en Italie, sur les erreurs, à notre avis, qui ont eu une répercussion directe et néfaste sur cette constitution.
a) – La non-rentrée de la Fraction en Italie en 1943
Si l'analyse donnée par la Fraction sur les événements de juillet 1943 a été juste, si 1943 marquait une brisure de la guerre impérialiste et ouvrait l'ère de la formation du Parti, il résultait que le devoir de la Fraction consistait dans son retour immédiat en Italie. En réalité la Fraction, qui avait théoriquement entrevu la probabilité des événements, fut pratiquement surprise lors de leur éclatement. Cela se traduit par l'incapacité où elle se trouva de dégager une ligne de conduite d'ensemble, par aucune vision cohérente de ses tâches immédiates, par des hésitations. Durant des mois, la Fraction se trouve dans la position de spectateur, au lieu de jouer un rôle actif d'acteur dans les événements. Pendant toute la période de juillet à septembre, c'est-à-dire jusqu'au moment où le capitalisme parvient à dominer et à canaliser les premiers mouvements spontanés du prolétariat, la Fraction est totalement absente en Italie. Il est évident que la Fraction paye ses fautes politiques et organisationnelles du passé puisqu'elle se trouve ne pas être à même de remplir sa fonction. Ainsi se manifeste une sorte de paralysie, de pétrification dont est atteinte la Fraction et bien que la vie dans l'émigration pendant 20 ans ne soit pas la cause capitale, elle a cependant contribué dans une large mesure. La non-rentrée immédiate de la Fraction en Italie ne doit pas être expliquée par des difficultés d'ordre extérieur certes réelles, mais relève essentiellement de l'état interne propre de la Fraction. Désormais, avec les nouvelles conditions de lutte du prolétariat italien, le maintien de la Fraction Italienne hors d'Italie est un anachronisme qui ne peut se solder que par sa liquidation totale ; et il est juste de dire, comme l'écrivait un camarade, qu'une seconde surprise de la Fraction de cet ordre signifierait sa faillite. En Italie même, les vieux militants de la gauche, les membres de la Fraction qui s'y trouvent, éprouvent le besoin de se regrouper. La pression des événements s'exerce sur eux et les pousse à donner à leur activité une forme organisée et organisationnelle.
La tendance à la construction du Parti en correspondance avec la situation objective s'impose chaque jour davantage. Mais, dans ce programme de construction du Parti qui va de 1943 à 1945, la Fraction, en tant qu'organisation, en tant que corps idéologique homogène, est absente. L'absence de la Fraction, dans cette période critique de formation, se fera terriblement sentir et aura des conséquences graves que nous retrouvons aussi bien dans le mode de regroupement que dans les bases programmatiques du nouveau Parti.
b) La théorie de la "Fraction Italienne à l'étranger"
Au lieu de remédier résolument au manquement de la Fraction à ses tâches fondamentales en préparant son retour en Italie, et cela dans le désir de minimiser sa propre défaillance, une partie de la Fraction a trouvé la formule de " la Fraction à l’étranger".
Par cette trouvaille on tendait à diminuer la gravité de sa responsabilité. Elle signifiait : "Toute la critique émise est peut-être juste mais n’a pas de caractère de gravité puisqu'elle ne s’applique en somme qu’à une partie de la Fraction, à la partie, à la section qui est à l’étranger tandis que le gros de l’organisation vit et agit sur place en Italie." Et de là à railler "les paniquards" et "leurs prétentions" de vouloir "dicter" au prolétariat et aux militants se trouvant en Italie.
Il est vrai que la Fraction est parvenue à rejeter cette théorie mais il est néanmoins vrai qu’elle n’est jamais parvenue à éliminer cet état d’esprit qui restait dominant.
La formule de "la Fraction à l’étranger" était doublement fausse et dangereuse. Premièrement, parce qu’elle entretenait consciemment cette contre-vérité de l’existence d’une solide organisation de la Fraction en Italie et, deuxièmement, parce qu’au lieu de chercher à surmonter sa défaillance elle la justifiait dans le passé et dans l’avenir en dégageant l’organisation qui existait de toute responsabilité politique.
Loin de nous de sous-estimer la valeur des camarades qui restaient en Italie. Il est certain que la plus grande partie de la gauche est restée en Italie. Il est probable aussi que cela s'applique aussi bien à la qualité des militants qu'à leur quantité. Le fait que la plupart, se retrouvant aujourd'hui, après 20 ans de fascisme, à leur poste, à la pointe du combat, témoigne hautement de leur trempe et de leur valeur. Mais il ne s'agit pas des valeurs individuelles. L'organisation n'est pas une somme de volontés individuelles, comme la conscience de classe n'est pas une somme des consciences individuelles. L'organisation est une entité. C'est le lieu où se produit et se continue la fermentation idéologique de la classe.
Or, c'est justement la possibilité de maintenir l'organisation qui manquait aux camarades en Italie ; et, quelle que puisse être leur valeur individuelle, elle ne peut tenir lieu d'une vie politique organisée. L'organisme politique de classe du prolétariat italien fut, durant le fascisme, la Fraction Italienne telle qu'elle a vécu, agi et évolué. Les positions politiques de la Fraction ne sont pas des contributions d'une section mais l'expression de la vie et de la conscience de la classe. Ce n'est pas une société à responsabilité limitée, une filiale à l'étranger mais la délégation de la classe.
Les militants de la gauche en Italie sont restés, dans des conditions historiques extrêmement difficiles, fidèles au programme de la révolution, et c'est leur grand mérite. Mais c'est la Fraction telle qu'elle a existé, avec son organisation, sa presse hors d'Italie, qui a assuré la continuité historique du prolétariat. C'est elle qui, au nom de la classe, a eu à combattre le centrisme, à faire le bilan de la lutte passée et, sur la base de l'expérience, corriger et compléter le programme de la révolution.
Les illusions sur l'organisation en Italie, les légendes infantiles sur les nouveaux cadres préparés dans le secret, à la barbe de Mussolini, par Bordiga en personne, n'étaient que de l'opium qu'on octroyait à soi-même et aux autres pour oublier, dans l'extase artificielle et mensongère, la réalité de ses propres misères et défaillances.
Pendant toute la période critique de la formation de 1943 à 1945, le Parti a énormément manqué de cadres. Et ces cadres formés par 15 ans de vie de la Fraction, couvraient leurs manquements, leur défaillance, leur absence du manteau de la fausse modestie et se consolaient avec la théorie d'une "section à l'étranger".
En entretenant cet état d'esprit, la Fraction détruisait son propre travail durant 15 ans ; ce travail théorique de la Fraction, qui devait être l'axe du nouveau programme du Parti, devenait "une simple contribution des camarades à l'étranger".
Si aujourd'hui nous trouvons des lacunes et des insuffisances dans la base programmatique du Parti, si nous trouvons une méthode de regroupement surprenant à première vue, la faute incombe avant tout et directement à la Fraction.
c) – La dissolution de la Fraction
Les erreurs s'enchaînent avec une logique implacable. De l'absence physique et politique aux moments décisifs par la justification de cette absence par la théorie de "la Fraction à l'étranger", on devait aboutir à la dissolution pure et simple de la Fraction. Ce dernier pas fut également franchi.
Nous savons très bien que les camarades de l'ancienne Fraction prétendent que nous sommes victimes d'un malentendu ou d'une fausse interprétation. Quelques-uns nous ont même accusés de mauvaise foi. Nous ne pouvons qu'exprimer une fois de plus notre regret et notre étonnement qu'après huit mois la résolution contenant la dissolution, et adoptée à la dernière conférence de la Fraction Italienne, soit toujours restée cachée. Il y a huit mois, on pouvait se perdre dans des finesses juridiques sur le terme équivoque de "rendre le mandat". Aujourd'hui, plus de subtilité possible. Depuis mai 1945, la Fraction Italienne est dissoute. Les camarades rentrés en Italie se sont intégrés en tant qu'individualités dans le Parti. Et nous assistons à ce spectacle paradoxal qui pourrait être comique s'il ne comportait pas un sens politique d'une extrême gravité.
En 1936, le mouvement ouvrier international est soumis à une épreuve historique décisive, c'est la guerre impérialiste en Espagne. Pour la première fois, l'antifascisme se traduit concrètement par l'adhésion à la guerre impérialiste. C'est le nouveau 2 août 1914. Chaque militant ouvrier, chaque groupe est mis à l'épreuve : POUR ou CONTRE la participation à la guerre. La cohabitation de ces deux positions est impossible. La délimitation politique doit aboutir à la délimitation organisationnelle.
En Belgique, une minorité rompt avec la Ligue Communiste Internationaliste pour donner naissance à la Fraction belge de la Gauche Communiste. Dans la Fraction Italienne, une minorité se sépare ou est exclue, et ira rejoindre l'Union Communiste alliée du POUM.
Cette minorité - qui, de 1936 à 1945, est restée hors de la Fraction, contre qui s'est formée la Gauche Communiste Internationale, qui garde et se réclame toujours de ses positions - se trouve aujourd'hui faisant partie du nouveau Parti en Italie.
En 1945, après 6 ans de lutte contre la ligne marxiste et révolutionnaire de la Fraction, la tendance Vercesi crée le Comité de Coalition Antifasciste où elle collabore, dans une union sacrée originale, avec tous les partis de la bourgeoisie.
De ce fait, précipitant la discussion politique, théorique la Fraction est amenée à exclure cette tendance de son sein. Aujourd'hui, cette tendance, sans avoir rien renié de ses positions et de sa pratique, se trouve être partie intégrante du nouveau Parti en Italie et occupe même une place importance dans la direction.
Ainsi, la Fraction - qui a exclu la minorité en 1936-1937 et la tendance Vercesi au début 1945 - se trouve dissoute elle-même fin 1945 mais unie à ceux-là même qu'elle avait exclus ; et cette union c'est... le Parti.
A croire que ce qui était une question de principe pour la Fraction ne l'est pas pour le Parti. Ou bien que ce qui était une question de principe "à l'étranger" ne l'est pas dans "le pays". Ou encore que tout ce qui s'est passé à "l'étranger", toute l'histoire de 15 ans de la Fraction, ses luttes, ses scissions ne sont que des "histoires de fous". C'est à croire que les eaux du Pô possèdent des qualités miraculeuses de laver de toute souillure, de purifier de tout pêché et, par-dessus tout, celle de réconcilier tout le monde. Nous ne savons pas si c'est "l'air du pays" qui possède ce don de transformer un homme du Comité de Coalition Antifasciste en membre du Comité Central d'un parti révolutionnaire, mais nous sommes convaincus que c'est là le résultat de la dissolution hâtive et prématurée, politique et organisationnelle de la Fraction.
La rentrée politique de la Fraction en Italie aurait servi de barrage pour la construction du Parti révolutionnaire du prolétariat.
La dissolution de la Fraction signifie l'ouverture des écluses par où s'infiltrent librement les courants opportunistes. Demain, ces courants risquent d'inonder entièrement le Parti. Telle est la conséquence d'une faute, la plus grave, commise par la Fraction Italienne.
Méthode de formation du parti
S'il est exact que la constitution du Parti est déterminée par des conditions objectives et ne peut être l'émanation de la volonté individuelle, la méthode employée pour cette constitution est plus directement soumise à un "subjectivisme" des groupes et militants qui y participent. Ce sont eux qui ressentent la nécessité de la constitution du Parti et la traduisent par leurs actes. L'élément subjectif devient aussi un facteur déterminant de ce processus et le suit ; il imprime toute une orientation pour le développement ultérieur du Parti. Sans tomber dans un fatalisme impuissant, il serait extrêmement dangereux de méconnaître les conséquences graves résultant de la façon avec laquelle les hommes s'acquittent et réalisent les tâches dont ils ont pris conscience de leur nécessité objective.
L'expérience nous enseigne l'importance décisive qu'acquiert le problème de la méthode pour la constitution du Parti. Seuls les ignorants ou les écervelés, ceux pour qui l'histoire ne commence qu'avec leur propre activité, peuvent se payer le luxe d'ignorer toute l'expérience riche et douloureuse de la 3ème Internationale. Et ce n'est pas le moins grave que de voir de tous jeunes militants, à peine venus dans le mouvement ouvrier et à la Gauche communiste, non seulement se contenter et s'accommoder de leur ignorance mais en faire la base de leur arrogance prétentieuse.
Le mouvement ouvrier au lendemain de la première guerre impérialiste mondiale se trouve dans un état d'extrême division. La guerre impérialiste a brisé l'unité formelle des organisations politiques se réclamant du prolétariat. La crise du mouvement ouvrier, déjà existante avant, atteint, du fait de la guerre mondiale et des positions à prendre face à cette guerre, son point culminant. Tous les partis et organisations anarchistes, syndicales et marxistes sont violemment secoués. Les scissions se multiplient. De nouveaux groupes surgissent. Une délimitation politique se produit. La minorité révolutionnaire de la 2ème Internationale représentée par les bolcheviks, la gauche allemande de Luxemburg et les Tribunistes hollandais, déjà elle-même pas très homogène, ne se trouve plus face à un bloc opportuniste. Entre elle et les opportunistes tout un arc-en-ciel de groupes et de tendances politiques plus ou moins confus, plus ou moins centristes, plus ou moins révolutionnaires, représentant un déplacement général des masses rompant avec la guerre, avec l'union sacrée, avec la trahison des anciens partis de la social-démocratie. Nous assistons ici au processus de liquidation des anciens partis dont l'écroulement donne naissance à une multitude de groupes. Ces groupes expriment moins le processus de constitution du nouveau Parti que celui de la dislocation, la liquidation, la mort de l'ancien Parti. Ces groupes contiennent certes des éléments pour la constitution du nouveau Parti mais ne présentent aucunement la base de cette constitution. Ces courants expriment essentiellement la négation du passé et non l'affirmation positive de l'avenir. La base du nouveau Parti de classe ne se trouve que dans l'ancienne gauche, dans l'œuvre critique et constructive, dans les positions théoriques, dans les principes programmatiques que cette gauche a élaborés durant les 20 ans de son existence et de sa lutte fractionnelle au sein de l'ancien Parti.
La révolution d'octobre 1917 en Russie provoque un enthousiasme dans les masses et accélère le processus de liquidation des anciens partis, de la trahison. En même temps, elle pose, d'une façon brûlante, le problème de la constitution du nouveau Parti et de la nouvelle Internationale. L'ancienne gauche, les bolcheviks, les spartakistes se trouvent particulièrement submergés par le développement rapide de la situation objective, par la poussée révolutionnaire des masses. Leur précipitation dans la construction du nouveau Parti correspond et est le produit de la précipitation des événements révolutionnaires dans le monde. Il est indéniable qu'une des causes historiques de la victoire de la révolution en Russie et sa défaite en Allemagne, Hongrie, Italie réside dans l'existence du Parti révolutionnaire au moment décisif dans ce premier pays et son absence ou son inachèvement dans les autres pays. Aussi les révolutionnaires tentent de combler le décalage existant entre la maturité de la situation objective et l'immaturité du facteur subjectif (l'absence du Parti) par un large rassemblement des groupes et courants, politiquement hétérogènes, et proclament ce rassemblement comme le nouveau Parti.
Autant la méthode "étroite" de la sélection sur des bases principielles les plus précises, sans tenir compte des succès numériques immédiats, a permis aux bolcheviks l'édification du Parti qui, au moment décisif, a pu intégrer dans son sein et assimiler toutes les énergies et les militants révolutionnaires des autres courants et conduire finalement le prolétariat à la victoire, autant la méthode "large", soucieuse avant tout de rassembler immédiatement le plus grand nombre au dépens de la précision programmatique et principielle, devait conduire à la constitution de Partis de masses, véritables colosses aux pieds d'argile qui devaient retomber à la première défaite sous la domination de l'opportunisme. La formation du Parti de classe s'avère infiniment plus difficile dans les pays capitalistes avancés - où la bourgeoisie possède mille moyens de corruption de la conscience du prolétariat - qu'elle ne le fut en Russie.
De ce fait, l'IC croyait pouvoir tourner les difficultés en recourant à d'autres méthodes qu'à celle qui a triomphé en Russie. La construction du Parti n'est pas un problème d'habileté et de savoir-faire mais essentiellement un problème de solidité programmatique.
À la plus grande force corruptive idéologique du capitalisme et de ses agents, le prolétariat ne peut opposer qu'une plus grande sévérité et intransigeance principielles de son programme de classe. Aussi lente que puisse sembler cette voie de la construction du Parti, les révolutionnaires ne peuvent en emprunter une autre que l'expérience a démontré comme conduisant à la faillite.
L'expérience du Spartakusbund est à ce sujet édifiante. La fusion de ce dernier avec les Indépendants n'a pas conduit, comme ils l'espéraient, à la création d'un Parti de classe fort mais à noyer le Spartakusbund par les Indépendants et à affaiblir le prolétariat allemand. Rosa Luxemburg, avant d'être assassinée, et d'autres chefs du Spartakusbund semblaient s'être rendu compte de leur erreur de fusion avec les Indépendants et tendaient à la corriger. Mais cette erreur n'a pas seulement été maintenue par l'IC en Allemagne, elle devait devenir la méthode pratiquée, imposée par l'IC dans tous les pays pour la formation des Partis Communistes.
En France, l'IC "fera" un Parti Communiste par l'amalgame et l'unification imposée des groupes des syndicalistes révolutionnaires, des groupes internationalistes du Parti Socialiste et la tendance centriste, corrompue et pourrie des parlementaires, dirigée par Frossard et Cachin.
En Italie, l'IC imposera également à la Fraction abstentionniste de Bordiga de fonder une seule et même organisation avec les tendances centristes et opportunistes d'Ordino Nuovo et de Serrati.
En Angleterre, l'IC imposera aux groupes communistes d'adhérer à l'Independant Labour Party pour former, à l'intérieur de ce parti réformiste, une opposition révolutionnaire massive.
En somme, la méthode qui servira à l'IC pour "la construction" des Partis Communistes sera partout à l'opposé de la méthode qui a servi et qui a fait ses preuves dans l'édification du Parti bolchevique. Ce n'est plus la lutte idéologique autour du programme, l'élimination progressive des positions opportunistes qui, par le triomphe de la Fraction révolutionnaire conséquente, servira de base à la construction du Parti mais c'est l'addition de différentes tendances, leur amalgame autour d'un programme volontairement laissé inachevé qui serviront de base. La sélection sera abandonnée pour l'addition, les principes sacrifiés pour la masse numérique.
Comment les bolcheviks et Lénine pouvaient-ils emprunter cette voie qu'ils avaient condamnée et combattue pendant 20 ans en Russie ? Comment s'explique le changement de méthode de la formation du Parti, pour les bolcheviks, avant et après 1917 ? Lénine ne nourrissait aucune illusion sur les chefs opportunistes et centristes, sur la conversion des Frossard, des Ledebour à la révolution, sur la valeur des révolutionnaires de la 13ème heure. Lénine ne pouvait méconnaître le danger que représentait l'admission de toute cette racaille dans les Partis Communistes. S'il se décide à les admettre, c'est qu'il subit la pression de la précipitation des événements, parce qu'il croit que ces éléments seront, par le déroulement même des événements, progressivement et définitivement éliminés du sein du Parti. Ce qui permet à Lénine d'inaugurer la nouvelle méthode, c'est qu'il se base sur deux faits nouveaux qui, à ses yeux, offrent une garantie suffisante : la prépondérance politique du Parti bolchevique dans l'IC et le développent objectif du cours révolutionnaire. L'expérience a montré depuis que Lénine a commis une erreur colossale de sous-estimer le danger d'une dégénérescence opportuniste toujours possible d'un parti révolutionnaire et d'autant plus favorisée que la formation du Parti ne se fait pas sur la base de l'élimination des tendances opportunistes mais sur leur camouflage, leur addition, leur incorporation en tant qu'éléments constitutifs du nouveau Parti.
Contre la méthode "large" d'addition qui triomphait dans l'IC, la gauche rappelait avec vigueur la méthode de sélection : la méthode de Lénine d'avant la révolution d'Octobre. Et c'est un des plus grands mérites de Bordiga et de sa fraction d'avoir le plus énergiquement combattu la méthode de l'IC et mis en évidence l'erreur de la méthode de formation du Parti et les conséquences graves qu'elle comportait pour le développement ultérieur des partis communistes. Si la fraction de Bordiga a finalement accepté de former le Parti Communiste d'Italie avec la fraction de "l'Ordino Nuovo", elle le fit en se soumettant à la décision de l'IC, après avoir formulé les plus sévères critiques et en maintenant ses positions qu'elle se réservait de faire triompher à travers les crises inévitables au sein du Parti et à la suite même de l'expérience historique vivante, concrète.
On peut aujourd'hui affirmer que de même que l'absence des partis communistes lors de la première vague de la révolution de 1918-20 fut une des causes de son échec, de même la méthode de formation des Partis de 1920-21 fut une des causes principales de la dégénérescence des PC et de l'IC.
Il n'est pas le moins étonnant que nous assistions aujourd'hui, 23 ans après la discussion Bordiga-Lénine lors de la formation du PC d'Italie (sur cette formation du Parti), à la répétition de la même erreur. La méthode de l'IC, qui fut si violemment combattue par la Fraction de gauche (de Bordiga) et dont les conséquences furent catastrophiques pour le prolétariat, est aujourd'hui reprise par la Fraction elle-même pour la construction du PCI d'Italie.
Beaucoup de camarades de la Gauche Communiste Internationale semblent être frappés d'amnésie politique. Et, dans la mesure où ils se rappellent les positions critiques de la gauche sur la constitution du Parti, ils croient aujourd'hui pouvoir passer outre. Ils pensent que le danger de cette méthode se trouve circonscrit sinon complètement écarté du fait que c'est la Fraction de gauche qui l'applique, c'est-à-dire l'organisme qui a su résister pendant 25 ans à la dégénérescence opportuniste de l'IC. Nous retombons ainsi dans les arguments des bolcheviks. Lénine et les bolcheviks croyaient aussi que, du fait que c'étaient eux qui appliquaient cette méthode, la garantie était donnée. L'histoire nous prouve qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Aucun parti, quel que soit son passé révolutionnaire, n'est immunisé contre une dégénérescence opportuniste. Les bolcheviks avaient au moins autant de titres révolutionnaires à faire valoir que la Fraction Italienne de la Gauche Communiste. Ils avaient non seulement résisté à l'opportunisme de la 2ème Internationale, à la trahison de la guerre impérialiste, ils avaient non seulement formé le Parti mais avaient aussi conduit le prolétariat à la victoire. Mais tout ce passé glorieux - qu'aucune autre fraction n'a encore à son actif - n'a pas immunisé le Parti bolchevik. Chaque erreur, chaque faute est une brèche dans l'armature du Parti par où s'infiltre l'influence de l'ennemi de classe. Les erreurs portent leurs conséquences logiques.
Le Parti Communiste Internationaliste d'Italie se "construit" par la fusion, l'adhésion de groupes et tendances qui ne sont pas moins opposés politiquement entre eux que le furent la Fraction abstentionniste de Bordiga et "l'Ordino Nuovo" lors de la fondation du PC en 1921. Dans le nouveau Parti viennent prendre place, à titre égal, la Fraction Italienne et la Fraction Vercesi exclue pour sa participation au Comité de Coalition Antifasciste. C'est non seulement une répétition de l'erreur de méthode d'il y a 25 ans mais une répétition aggravée.
En formulant notre critique sur la méthode de constitution du PCI d'Italie nous ne faisons que reprendre la position qui fut celle de la Fraction Italienne et qu'elle abandonne aujourd'hui. Et tout comme Bordiga continuait Lénine contre l'erreur de Lénine lui-même, nous ne faisons que continuer la politique de Lénine et de Bordiga face à l'abandon de ses positions par la Fraction Italienne.
Le nouveau Parti n'est pas une unité politique mais un conglomérat, une addition de courants et de tendances qui ne manqueront pas de se manifester et de se heurter. L'armistice actuel ne peut être que très provisoire. L'élimination de l'un ou de l'autre courant est inévitable. Tôt ou tard la délimitation politique et organisationnelle s'imposera. A nouveau, comme il y a 25 ans, le problème qui se pose est : Qui l'emportera ?
Les révolutionnaires doivent-ils adhérer au PCI d’Italie ?
Nous venons d'examiner longuement la place qu'occupe la constitution du PCI d'Italie dans l'histoire du mouvement ouvrier. Nous venons de voir jusqu'à quel point le nouveau Parti peut être considéré comme un pas en avant, un acquis positif du prolétariat ; mais nous avons également souligné les insuffisances et les côtés négatifs qui s'y trouvent.
Notre critique, aussi sévère fut-elle, ne nous conduit pas cependant à la position des RKD qui condamne à priori et définitivement le PCI. La critique que nous avons formulée contre la méthode de constitution du PCI, contre son insuffisance programmatique, conduit certains camarades et groupes à poser la question : faut-il adhérer à ce Parti ? Faut-il participer à cette expérience ?
Les "gauches communistes de la 13ème heure" - la "claque" de Vercesi - rougissent d'indignation à la seule formulation d'une telle question. Il est navrant de voir s'instituer ce genre de fétichisme dans la Gauche Communiste Internationale qui consiste à absoudre d'avance toute erreur que peut commettre à un moment donné, sur une question donnée, un groupe ou l'ensemble de la Gauche Communiste Internationale.
Ce système politique que nous avons trop connu chez les staliniens et les trotskistes - qui se passe de la nécessité d'apporter une démonstration, qui remplace la démonstration par l'affirmation : "Nous avons eu raison, nous avons raison et nous aurons toujours raison parce que nous sommes Nous!", qui ne connaît que l'approbation aveugle ou l'excommunication - est un système qui tue toute vie politique dans une organisation, anéantit toute fermentation intellectuelle, arrête tout développement des militants et transforme le mouvement en une misérable chapelle bureaucratique.
Celui qui en politique croit sur parole - disait Lénine - est un incurable idiot. Et toute organisation politique transformée en une église cesse d'être une école de militants pour devenir une machine à fabriquer, d'une part, une petite clique de bureaucrates infaillibles et, d'autre part, une masse de crétins béni-oui-oui.
Dégagés de tout amour-propre chatouilleux, nous entendons discuter toute objection qui peut être soulevée contre nos positions et celles de la Gauche Communiste Internationale. C'est dans cet esprit que nous saisissons l'occasion pour réfuter la position des RKD concernant le PCI d'Italie. Le RKD reprend partiellement notre critique sur l'insuffisance programmatique du PCI, sur la méthode erronée qui a présidée à la constitution du Parti et plus particulièrement notre critique contre le courant révisionniste de Vercesi, et le droit de citer qui lui a été fait dans le nouveau Parti dont il est un élément constitutif. De ce fait, le RKD définit, apparemment avec logique, le PCI d'Italie comme un Parti centriste. Et le RKD de tirer la conclusion que ce Parti est condamné dès maintenant à évoluer fatalement vers les positions opportunistes et contre-révolutionnaires. Aucune possibilité historique n'est donnée, selon les RKD, à un parti centriste de retrouver la voie de la révolution. Aussi proclament-ils la nécessité pour les révolutionnaires en Italie d'abandonner le PCI et de constituer un groupe indépendant.
Contre tout schéma, nous avons ici une suite de déductions logiques. A examiner de plus près la question, nous nous apercevons que c'est là un raisonnement logique dans l'abstrait, une vue schématique n'englobant pas la réalité de la situation concrète.
Quelle est la situation en Italie ? Après 20 ans de domination du fascisme, le prolétariat surgit sur l'arène politique et sociale dans les remous des événements de juillet 1943. Un cours nouveau de reprise de la lutte offensive s'ouvre, qui exige la constitution du Parti de classe. Evidemment si on perd de vue cette situation nouvelle, si on la méconnaît, on s'interdit de comprendre le problème de la constitution du Parti qui, dès lors, n'apparaît que comme un nouvel échantillon de la série des partis fabriqués par les trotskistes.
Contrairement à ces fabrications artificielles, artificielles parce que se faisant dans une situation de recul du prolétariat, ce qui caractérise la constitution du Parti en Italie c'est plutôt le décalage existant entre la reprise spontanée de la lutte classes et le retard accusé dans l'organisation de la conscience de classe : le Parti.
Qu'est-ce que l'acte de la constitution du Parti ? C'est la convergence historique entre une situation objective de reprise offensive de la lutte de classe et l'achèvement maximum du programme par l'organisme de la classe qu'est la Fraction. Cette convergence est rarement parfaite. L'histoire nous enseigne que c'est souvent sous le feu des événements que le Parti modifie, complète son programme. L'exemple le plus frappant nous est donné par le Parti bolchevik qui, entre février et octobre, en plein bouillonnement de la révolution, est appelé à rectifier profondément son programme. De même Spartakusbund travaille fiévreusement son programme au feu de la révolution de novembre 1918.
On peut évidemment se lamenter sur le retard de l'avant-garde mais cela n'avance à rien. Ce qui importe c'est d'avoir conscience de la tâche historique qui incombe aux révolutionnaires dans la période de recul, avec l'examen critique du passé et l'effort théorique, l'élaboration des positions programmatiques où pourra se situer la classe dans sa lutte révolutionnaire.
Cette conscience, la Fraction Italienne l'avait à un très haut degré ; cet effort, elle l'a fourni quasiment seule pendant 20 ans. Et si nous ne la trouvons pas entièrement prête au moment précis, en 1943 par exemple, les raisons sont multiples. Elles doivent être recherchées dans les conditions générales dans lesquelles a dû vivre la Fraction, dans son éloignement du pays, dans son isolement quasi-total, dans le recul le plus grand qu'ait jamais connu la lutte du prolétariat et aussi dans ses propres erreurs et propres faiblesses.
Mais la situation en Italie se bouleverse. 1943 fait jaillir le mouvement de classe comprimé durant 20 ans. La situation ne tient pas compte de la préparation ou non de l'organisme de la classe, de son état. Elle oblige l'avant-garde d'intervenir, de prendre sa responsabilité d'agir. C'est sous le fouet de la situation que l'avant-garde doit accélérer son regroupement, achever son programme.
Le PCI d'Italie, avec toutes ses insuffisances, traduit cet état de décalage de l'avant-garde en rapport avec la situation objective. On peut constater avec regret cet état. On doit accélérer la maturation programmatique mais on ne peut pas "condamner" un état. Voilà un premier point à établir.
La seconde erreur des RKD consiste à coller l'étiquette "centriste" au PCI. Qu'est-ce que le centrisme ? C'est un ensemble de positions politiques se situant entre la révolution et la contre-révolution, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Une organisation politique qui ne présentera pas un programme achevé, qui comportera même des erreurs sur un certain nombre de questions importantes mais secondaires, ne peut encore être taxée de "centrisme". Tout au plus peut-on parler de positions erronées, confuses ou inachevées de cette organisation. Mais pour y porter un jugement définitif, il faut tenir compte de l'orientation générale, du sens de l'évolution de cette organisation. Le Parti bolchevik, par exemple, ayant dans son programme une position erronée sur la révolution en Russie, conçue comme "une dictature révolutionnaire démocratique du prolétariat et de la paysannerie", ne s'est débarrassé de cette erreur qu'après des luttes et des crises internes sous le feu même de la révolution en 1917. La position des RKD mène directement à considérer et à qualifier le Parti bolchevik de parti centriste, donc à l'absurde. Mais arguent les RKD, le PCI contient en son sein des tendances centristes. Ceci est exact. Nous dirons même qu'il contient des courants opportunistes. Cela ne fait pas encore du PCI une organisation centriste mais cela en fait seulement une organisation où va surgir la lutte entre les courants révolutionnaires et les courants opportunistes. Ce qui caractérise la plate-forme du PCI c'est d'être "un moyen terme" et de ne pas être explicitement et politiquement la condamnation des positions centristes. C'est là une tout autre chose que d'être un Parti centriste.
La position des RKD n'est qu'une application au PCI de leur "axiome" infantile qui consiste à proclamer la nécessité de quitter immédiatement toute organisation où se manifeste un courant opportuniste. C'est en partant de cet "axiome" qu'ils croient être "la quintessence révolutionnaire" qu'ils blâment Luxemburg et la Gauche allemande de n'avoir pas rompu organisationnellement avec la social-démocratie allemande bien avant 1914. Pour la même raison, ils blâment les bolcheviks d'être restés dans la 2ème Internationale. Et c'est en partant de ce point de vue qu'ils condamnent la gauche communiste de n'avoir pas quitté l'IC et les Partis Communistes en... 1920-21.
Le RKD s'appuie sur l'expérience historique. Il n'existe pas d'exemple, dit-il, qu'un parti dans lequel s'est manifesté la maladie opportuniste ait pu être redressé ; aussi, les révolutionnaires ne font que servir l'opportunisme en restant dans ces partis. Un tel raisonnement est non seulement faux mais conduit à l'absurde. Suivez ce raisonnement et vous arriverez à la conclusion qu'il n'a jamais existé de parti du prolétariat. La 2ème Internationale contenait de l'opportunisme à sa fondation. La 3ème de même. Pour être logique le RKD devrait blâmer les révolutionnaires non pas de n'être pas sortis mais d'être entrés dans ces partis. Et cela serait valable également pour Marx et Engels dans la 1ère Internationale. Il est archi-connu que Marx a, en quelque sorte, composé dans la 1ère Internationale et que l'Adresse inaugurale qu'il a écrit pour elle est infiniment plus vague que le Manifeste Communiste qu'il a rédigé 15 ans avant pour la Ligue Communiste. La position des RKD est en somme une condamnation de toute l'histoire du mouvement ouvrier international. Rien d'étonnant à ce qu'ils n'aient jamais compris la notion de Fraction.
Cette position est d'ailleurs historiquement fausse. La 1ère Internationale où les marxistes ne sont qu'une petite minorité parvient progressivement à éliminer de son sein les positions petites-bourgeoises des Mazzinistes, des Garibaldiens, des Babouninistes etc.
La social-démocratie allemande également élimine les positions des Lassaliens, de Dühring et, pendant un temps, présente un rempart contre le Bernsteinisme et le Millerandisme. Les bolcheviks, comme nous l'avons déjà vu, surmontent leurs propres positions erronées et se redressent - sous l'attaque violente de Lénine et de ses Thèses d'avril - du marasme opportuniste où ils se trouvaient en février-mars 1917. Jusqu'au RKD qui nous offre l'exemple d'une organisation sortie du trotskisme et abandonnant, après des années, des positions opportunistes du Front unique et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Le Parti révolutionnaire "à l'état pur" que désire le RKD est un rêve magnifique et puéril. Tant qu'existent des classes et des luttes de classes, le Parti du prolétariat ne peut être absolument soustrait et garanti par rapport à la pénétration de l'influence de la classe ennemie. C'est en opposant consciemment une lutte constante et opiniâtre contre l'opportunisme que le Parti tend vers sa position idéale de pureté révolutionnaire. Mais aussi, au moment d'atteindre cet état, c'est-à-dire au moment où l'influence de la classe ennemie cesse de s'exercer sur lui, ce qui n'est le cas que par la disparition de cette classe, le Parti lui-même cessera d'exister comme tel et subira une transformation que personne n'est encore à même d'entrevoir.
Pour les uns, le PCI, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses erreurs de constitution et insuffisances programmatiques, de par la seule vertu qu'il est italien et qu'il s'intitule et se réclame de la Gauche Communiste Internationale, est hors de toute critique et restera toujours le Parti du prolétariat.
Pour les autres, comme le RKD, qui voient partiellement les insuffisances, les erreurs du PCI et l'existence en son sein d'une tendance opportuniste, le PCI est d'ores et déjà condamné à une dégénérescence fatale. C'est là une conception fataliste, stérile et désespérante.
Les marxistes révolutionnaires sont aussi loin de la conception fataliste qu'ils répugnent au mysticisme fétichiste.
C'est parce qu'ils ont conscience que l'évolution du PCI est conditionnée, d'une part, par le développement de la situation et, d'autre part, par la capacité du Parti d'éliminer les germes de l'opportunisme, qu'ils sont convaincus que le devoir de chaque révolutionnaire est de prendre place dans ce Parti, d'agir de toutes ses forces contre la gangrène opportuniste et de faire du PCI le guide et l'artisan de la victoire de la révolution communiste.
M.
(1) Lire à ce propos notre article "Battaglia Comunista" - À propos des origines du Parti Communiste Internationaliste (Revue internationale n° 34)
Conscience et organisation:
Personnages:
- Vercesi [810]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [115]
Rubrique:
Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskysme.
- 720 lectures
Deuxième partie: Sur le contenu de la révolution communiste
Dans la partie précédente de cette série, nous avons republié l'article Bienvenue à Socialisme ou Barbarie écrit par la Gauche Communiste de France en 1948. L'article a pris une position claire sur la nature du mouvement trotskyste, qui avait abandonné ses références prolétariennes en participant à la Seconde Guerre mondiale impérialiste:
- "Le trotskisme, qui fut une des réactions prolétariennes dans l’IC au cours des premières années de sa dégénérescence, n’a jamais dépassé sa position d’opposition malgré sa constitution formelle en parti organiquement séparé. En restant attaché aux PC – qu’il considère toujours comme partis ouvriers - où a triomphé le stalinisme, le trotskisme se rattache à ce dernier dont il est l’appendice. Il est lié idéologiquement au stalinisme et le suit comme son ombre. Toute l’activité du trotskisme depuis 15 ans le prouve."
Et il poursuit en disant:
- "Cela ne veut pas dire que des ouvriers révolutionnaires, un peu éduqués, ne puissent se fourvoyer dans ses rangs. Au contraire, en tant qu’organisation, en tant que milieu politique, le trotskisme, loin de favoriser la formation de la pensée révolutionnaire et partant des organismes (fractions et tendances) qui l’expriment, est le milieu organique de leur pourrissement. C’est là une règle générale valable pour toute organisation politique étrangère au prolétariat, s’appliquant au trotskisme comme au stalinisme et vérifiable dans l’expérience. Nous connaissons le trotskisme depuis 15 ans en crise perpétuelle, avec scissions et unification, suivies de scissions et de crises, mais nous ne connaissons pas d’exemples où celles-ci aient été suivies de la formation d’une tendance révolutionnaire véritable et viable. C’est que le trotskisme ne secrète pas en son sein le ferment révolutionnaire. Au contraire il l’annihile. Le ferment révolutionnaire a donc pour condition de son existence et développement la nécessité d’être hors des cadres organisationnels et idéologiques du trotskisme"[1]
La réaction initiale de la GCF vis-à-vis de la " tendance Chaulieu-Montal"[2] qui s'était constituée comme une tendance au sein du parti trotskyste français, le Parti Communiste Internationaliste, a donc été d'exprimer de sérieux doutes quant à son potentiel d'évolution. Et pourtant, suite à la rupture avec le PCI et la formation du groupe Socialisme ou Barbarie, la GCF a reconnu qu'une véritable rupture avait eu lieu, laquelle était donc à saluer. Cela n'a cependant pas empêché la GCF d'alerter sur le fait que le nouveau groupe continuait d'être marqué par des vestiges de son passé trotskyste (par exemple sur la question syndicale, ou dans sa relation ambiguë avec la revue Les Temps Modernes publiée par le philosophe Jean-Paul Sartre) tout en manifestant une arrogance insolite vis à vis des courants révolutionnaires qui avaient tiré des conclusions similaires à celles de Socialisme ou Barbarie bien avant sa rupture avec le trotskysme.
Dans ce nouvel article, nous chercherons à montrer à quel point la GCF avait raison d'être prudente dans son accueil à Socialisme ou Barbarie, et combien il est difficile pour ceux qui ont grandi dans le milieu corrompu du trotskysme de rompre profondément avec ses idées de fond et avec ses attitudes. Nous examinerons la trajectoire politique et le travail de deux militants - Castoriadis et Grandizo Munis - qui ont formé des tendances parallèles dans le mouvement trotskyste à la fin des années 1940, et qui ont rompu avec lui à peu près à la même époque. Le choix de ces deux militants est pertinent non seulement parce qu'ils illustrent le problème général de la rupture avec le trotskysme, mais aussi parce que tous deux ont longuement écrit sur la question sur laquelle est fondée cette série: le contenu de la révolution socialiste.
Rompre avec la IVe Internationale
Il ne fait aucun doute qu'à la fin des années 1940 et au début des années 1950, Castoriadis et Munis étaient des militants de la classe ouvrière. Munis l’est resté toute sa vie.
Alors jeune homme en Grèce occupée, Castoriadis a quitté le Parti Communiste parce qu'il s'opposait à sa politique de soutien (et même de direction) de la Résistance nationaliste. Il a trouvé sa voie vers le groupe autour d'Aghis Stinas[3], qui, bien que faisant officiellement partie de la Quatrième Internationale, a maintenu une opposition intransigeante aux deux camps dans la guerre impérialiste, y compris les fronts de la Résistance. Mal informés des trahisons réelles du mouvement trotskyste, il supposait que ce devait être la position "normale" pour tout groupe internationaliste puisqu'elle s'inscrivait dans la continuité de la position de Lénine sur la Première Guerre Mondiale.
Courant le danger à la fois des agents fascistes et staliniens, Castoriadis quitta la Grèce à la fin de la guerre et s'installa en France, devenant membre de la principale organisation trotskyste de ce pays, le PCI. Après avoir formé une tendance d'opposition au sein du PCI (la tendance Chaulieu-Montal évoquée par la GCF), elle s’est séparée du Parti en 1948 pour fonder le groupe Socialisme ou Barbarie. Le document de séparation de la tendance, Lettre ouverte aux militants du PCI et de la IVe Internationale [811]...., publié dans le premier numéro de Socialisme ou Barbarie, développe une critique approfondie de la vacuité théorique du mouvement trotskyste et de son incapacité à fonctionner autrement que comme un appendice du stalinisme: - soit parce qu'il considérait que l'URSS jouait encore un rôle historique mondial progressiste dans la création de nouveaux Etats ouvriers (quoique déformés) en Europe de l'Est; - soit parce qu'il suivait la coalition Parti socialiste/Parti communiste qui avait été intégrée au gouvernement de reconstruction en France et qui était chargée de superviser une intensification féroce de l'exploitation. La lettre était particulièrement tranchante dans sa critique de la flagornerie de la Quatrième Internationale à l'égard du dissident stalinien Tito en Yougoslavie, flagornerie qui exprimait clairement une rupture avec la vision de Trotski selon laquelle le stalinisme ne pouvait être réformé.
À la fin de sa vie, Trotsky avait fait valoir que si l'URSS sortait de la guerre sans être renversée par une révolution prolétarienne, son courant devrait revoir sa vision de l'État ouvrier et devrait conclure que celui-ci était le produit d'une nouvelle ère de barbarie. Il y a des traces de cette approche dans la caractérisation initiale par le groupe de la bureaucratie comme nouvelle classe exploiteuse, faisant écho aux analyses du "collectivisme bureaucratique" de Rizzi et Shachtman, qui définissent la Russie comme ni capitaliste ni socialiste; bien que, comme la GCF le reconnaît, le groupe se soit rapidement éloigné de cette notion pour aller vers l'idée d'un nouveau capitalisme bureaucratique. Dans un texte de Socialisme ou Barbarie, n° 2, Les rapports de production en Russie [812], Castoriadis n'hésite pas à critiquer la vision de Trotski de l'URSS comme un système avec un mode de distribution capitaliste mais avec un mode de production essentiellement socialiste. Une telle séparation entre la production et la distribution était, selon lui, contraire à la critique marxiste de l'économie politique. Dans le cadre de cet effort d'application d'une analyse marxiste à la situation historique mondiale, le groupe a considéré cette tendance à la bureaucratisation comme étant à la fois globale et une expression de la décadence du système capitaliste. Cette position explique aussi pourquoi la revue du nouveau groupe s'intitulait Socialisme ou Barbarie. En particulier, dans sa lettre ouverte et dans les premières années de Socialisme ou Barbarie, le groupe considérait qu'en l'absence d'une révolution prolétarienne, une troisième guerre mondiale entre les blocs de l'Ouest et de l'Est était inévitable.
Quant à Munis, son courage en tant que militant prolétarien a été particulièrement remarquable. Avec ses camarades du groupe bolchévique léniniste, l'un des deux groupes trotskystes actifs en Espagne pendant la guerre civile, et aux côtés des anarchistes dissidents des Amis de Durruti, Munis a combattu sur les barricades érigées par le soulèvement ouvrier contre le gouvernement républicain/stalinien en mai 1937. Emprisonné par les staliniens vers la fin de la guerre, il a échappé de justesse à un commando d'exécution et s'est enfui au Mexique, où il a repris son activité au sein du milieu trotskyste, s'exprimant aux funérailles de Trotski et devenant influent sur l'évolution politique de Natalia Trotski qui, comme Munis, devenait de plus en plus critique à l'égard de la position officielle trotskyste sur la guerre impérialiste et la défense de l'URSS.
L'une de ses premières critiques majeures de la position de la Quatrième Internationale sur la guerre était contenue dans sa réponse à la défense de James Cannon, lors de son procès pour "sédition" à Minneapolis, de la politique du Parti Ouvrier Socialiste aux Etats-Unis - une application de la "politique militaire prolétarienne" qui consistait essentiellement en un appel à placer la guerre des États-Unis contre le fascisme sous "contrôle ouvrier". Pour Munis, cela représentait une capitulation complète face à l'effort de guerre d'une bourgeoisie impérialiste. Bien que rejetant plutôt tardivement clairement la défense de l'URSS[4], Munis, en 1947, dans une lettre ouverte au PCI[5] écrite avec Natalia et le poète surréaliste Benjamin Péret, insistait sur le fait que le rejet de la défense de l'URSS était maintenant une nécessité urgente pour les révolutionnaires. Comme la lettre de Chaulieu-Montal, le texte dénonçait le soutien des trotskystes au régime stalinien à l'est (bien qu'il n'ait pas encore présenté une analyse précise de sa nature sociale) et aux gouvernements PC/PS à l'ouest. La lettre est beaucoup plus centrée que celle de Chaulieu-Montal sur la question de la Seconde Guerre mondiale et la trahison de l'internationalisme par une grande partie du mouvement trotskyste à travers son soutien à l'antifascisme et à la Résistance à côté de sa défense de l'URSS. Le texte rejette aussi clairement l'idée que les nationalisations –dont l'appel et le soutien étaient un élément central des "exigences programmatiques" du trotskysme– ne pouvaient être considérées autrement que comme un renforcement du capitalisme. Bien que la lettre contienne encore l'espoir d'une IVe Internationale revivifiée, purgée de l’opportunisme, et qu'à cette fin elle appelle à un travail commun entre son groupe et la tendance Chaulieu-Montal au sein de l'Internationale, en réalité, le courant autour de Munis rompt bientôt tous les liens avec cette fausse Internationale et forme un groupe indépendant (l'Union Ouvrière Internationale) qui, comme Socialisme ou Barbarie, entre en discussion avec les groupes de la Gauche Communiste.
Castoriadis sur "Le contenu du socialisme": au-delà de Marx ou retour à Proudhon?
Nous reviendrons plus tard sur la trajectoire politique ultérieure de Castoriadis et Munis. Notre objectif principal est d'examiner comment, dans une période dominée par les définitions stalinienne et social-démocrate du socialisme, une période de recul de la classe ouvrière et d'isolement croissant de la minorité révolutionnaire, ces deux militants ont tenté d'élaborer une vision d'un chemin authentique vers l'avenir communiste. Nous commençons par Castoriadis, dont les trois articles sur "Le Contenu du Socialisme" (CS), publiés entre 1955 et 1958 dans Socialisme ou Barbarie[6] sont sans doute sa tentative la plus ambitieuse de critiquer les falsifications dominantes sur la signification du socialisme et de proposer une alternative. Ces textes, mais surtout le second, devaient avoir une influence sur un certain nombre d'autres groupes et courants, notamment l'Internationale Situationniste, qui a repris la notion d'autogestion généralisée de Castoriadis, et le groupe socialiste libertaire britannique Solidarity, qui devait retravailler le deuxième article dans sa brochure Les Conseils Ouvriers et l'économie d'une société autogérée[7].
Les dates de publication sont significatives; entre le premier et le second article, il y a eu des événements marquants dans l'empire de "l’Est": le célèbre discours de Khrouchtchev sur les excès de Staline, la révolte en Pologne et surtout le soulèvement prolétarien en Hongrie qui a vu l'émergence de conseils ouvriers. Ces événements ont évidemment eu un impact majeur sur la pensée de Castoriadis et sur la description assez détaillée d'un projet de société socialiste exposé dans le deuxième article. Le problème est que l'arrogance théorique, relevée par la GCF en 1948, persiste dans ces articles, avec leur prétention d'avoir compris les éléments clés du capitalisme et de sa négation révolutionnaire qui n'avaient pas été saisis dans le mouvement ouvrier, y compris par Marx. Mais en réalité, plutôt que d'aller "au-delà" de Marx, ils ont tendance à nous ramener à Proudhon, comme nous l'expliquerons.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'éléments positifs dans ces textes. Ils confirment le rejet par Castoriadis de la vision trotskyste du stalinisme comme expression dévoyée du mouvement ouvrier, en insistant sur le fait qu’il défend un intérêt de classe qui est à l’opposé de celui du prolétariat. Bien que Castoriadis accepte librement que sa conception de la société post-révolutionnaire est très proche de celle avancée par Pannekoek dans sa brochure Les Conseils Ouvriers[8], il ne tombe pas dans certaines des erreurs cruciales du Pannekoek "tardif": le rejet de la révolution russe en tant que révolution bourgeoise et de tout rôle pour une organisation politique révolutionnaire. Au lieu de cela, la révolution russe est toujours traitée comme une expérience essentiellement prolétarienne dont il faut comprendre la dégénérescence et en tirer des leçons. Les textes ne tombent pas non plus explicitement dans la position anarchiste qui rejette la centralisation par principe: au contraire, il critique fortement la vision anarchiste classique et affirme que "refuser de faire face à la question du pouvoir central équivaut à laisser la solution de ces problèmes à une bureaucratie ou à une autre" (On the Content of Socialism II - Socialisme Ou Barbarie [813] – Référé "CS II" dans la suite du texte).
Rejetant l'opinion trotskyste selon laquelle un simple changement dans les formes de propriété peut mettre fin à la mécanique de l'exploitation capitaliste, Castoriadis insiste à juste titre sur le fait que le socialisme n'a de sens que s'il entraîne une transformation totale des relations au sein de l'humanité avec tous les aspects de la vie sociale et économique, un changement d'une société dans laquelle l'homme est dominé par les produits de ses propres mains et de son cerveau, à une société dans laquelle les êtres humains contrôlent consciemment leur propre activité, et surtout le processus de production. C'est pour cette raison que Castoriadis souligne l'importance centrale des conseils ouvriers en tant que formes par lesquelles ce changement profond dans le fonctionnement de la société peut être apporté. La difficulté se pose moins avec cette notion générale du socialisme telle que la restauration du "pouvoir humain comme fin en soi", qu’avec les moyens plus concrets que Castoriadis préconise pour atteindre cet objectif, et avec la méthode théorique qui se cache derrière les mesures qu'il met en avant.
Il n'y a rien de faux en soi dans l'idée de critiquer les contributions du mouvement ouvrier passé. En fait, c'est un élément essentiel dans le développement du projet communiste. Nous ne pouvons pas être en désaccord avec l'idée de Castoriadis selon laquelle le mouvement ouvrier est nécessairement affecté par l'idéologie dominante et qu'il ne peut se débarrasser de cette influence qu'à travers un processus de réflexion et de lutte constante. Mais les critiques de Castoriadis sont très souvent inexactes et conduisent à des conclusions qui tendent à "jeter le bébé avec l'eau du bain" - bref, elles le conduisent à une rupture avec le marxisme qui devait devenir explicite peu de temps après la publication de ses articles, et les prémisses de cette rupture sont déjà visibles dans ces textes. Pour donner un exemple: il rejette déjà la théorie marxiste de la crise comme un produit des contradictions économiques internes du système. Pour lui, la crise n'est pas le résultat de la surproduction ou de la baisse du taux de profit, mais le résultat du rejet croissant, par ceux "d'en bas", de la division de la société en donneurs d'ordre et ceux aux ordres, qu'il considère non pas comme le produit inévitable de l'exploitation capitaliste, mais comme son fondement réel: "L'abolition de l'exploitation n'est possible que lorsque toutes les strates distinctes de directeurs cessent d'exister, car dans les sociétés modernes, c'est la division entre directeurs et exécutants qui est à la base de l'exploitation"[9]. De même, dans CS II, il nous offre une caricature extrêmement réductrice (quoique très commune) de la théorie des crises de Rosa Luxemburg qui prédit un effondrement purement automatique du capitalisme.
S’appuyant sur une citation de Marx sur la persistance d'un "royaume de la nécessité" même dans le communisme, Castoriadis pense avoir découvert un défaut fatal dans la pensée de Marx: Le fait que pour Marx, la production serait toujours une sphère de déni et essentiellement d'aliénation, alors que lui seul, Castoriadis, a découvert que l'aliénation ne peut être surmontée que si la sphère de production est aussi celle dans laquelle notre humanité s'exprime. La référence qui est faite (dans CS II) concerne le passage du volume 3 du Capital où Marx dit que "Le règne de la liberté ne commence en fait que là où cesse le travail imposé par la nécessité et les considérations extérieures; de par la nature des choses, il existe donc au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite"[10]. Ce passage implique que le travail ou la production matérielle ne peut jamais être une zone d'épanouissement humain, et pour Castoriadis, cela représente un déclin par rapport au Marx à ses débuts qui attendait avec impatience la transformation du travail en activité libre (surtout dans les Manuscrits économiques et philosophiques de 1844). Mais présenter les choses de cette façon déforme la complexité de la pensée de Marx. Dans la Critique du programme Gotha, écrite en 1875, Marx insiste aussi sur le fait que le but de la révolution prolétarienne est une société dans laquelle "le travail est devenu non seulement un moyen de vie, mais le premier besoin de la vie". Nous pouvons trouver des idées similaires dans le Grundrisse, un autre travail "de la maturité"[11].
L'autogestion d'une économie de marché
Une critique courante sur Le Contenu du Socialisme est qu'il viole la mise en garde de Marx contre "l'élaboration de recettes de cuisine pour les livres de l'avenir". Dans CS II, Castoriadis anticipe sur cette critique en niant qu'il essaie d'élaborer des statuts ou une constitution pour la nouvelle société. Il est intéressant de voir à quel point la société capitaliste a changé depuis que CS II a été écrit, posant des problèmes qui n'entrent pas tout à fait dans son schéma - surtout la tendance à l'élimination de la grande production industrielle au centre de nombreux pays capitalistes centraux, la croissance de l'emploi précaire, et la pratique de l'"externalisation" vers des régions du globe où la main-d'œuvre est moins chère. On ne peut pas reprocher à Castoriadis de ne pas avoir prévu de tels développements, mais cela montre les pièges des anticipations schématiques de la société future. Quoi qu’il en soit, nous préférons examiner les idées contenues dans le texte et montrer pourquoi une partie si importante de ce que Castoriadis avance ne ferait de toute façon pas partie d'un programme communiste en pleine évolution.
Nous avons déjà mentionné le rejet par Castoriadis de la théorie des crises de Marx en faveur de sa propre innovation: l'exploitation, et la contradiction fondamentale du capitalisme "moderne", comme étant enracinées dans la division entre les donneurs d'ordre et les preneurs d'ordre. Et ce "révisionnisme" audacieux, cette mise à l'écart des contradictions économiques inhérentes au rapport salarial et à l'accumulation du capital, signifie que Castoriadis n'hésite pas à décrire sa société socialiste de l'avenir comme une société où toutes les catégories essentielles du capital restent intactes et ne présentent aucun danger d'une nouvelle forme d'exploitation et aucun obstacle à la transition vers une société pleinement communiste.
En 1972, lorsque le groupe britannique Solidarity a produit sa brochure Workers Councils and the Economics of a Self-managed Society (Les conseils ouvriers et l’économie d’une société autogérée), son introduction était déjà assez défensive sur le fait que la société "socialiste" décrite par Castoriadis conservait encore un certain nombre de caractéristiques clés du capitalisme: les salaires (bien que Castoriadis insiste sur l'égalité absolue des salaires dès le premier jour), les prix, la valeur du travail comme source de comptabilité, un marché de consommation, et "le critère de rentabilité". Et en effet, dans une polémique écrite en 1972, Adam Buick, du Parti socialiste de Grande-Bretagne, a montré à quel point la version de Solidarity avait expurgé certains des passages les plus embarrassants de l'original:
"Quiconque a lu l'article original ne peut nier que Cardan était un partisan du soi-disant "socialisme de marché". Solidarity lui-même a clairement trouvé cela embarrassant parce qu'il a supprimé lors de l’édition ses expressions les plus grossières. Dans son introduction, il s'excuse: "Certains considéreront le texte comme une contribution majeure à la perpétuation de l'esclavage salarié - parce qu'il parle encore de "salaires" et n'appelle pas à l'abolition immédiate de "l'argent" (bien que définissant clairement les significations radicalement différentes que ces termes prendront dans les premières étapes d'une société autogérée)" (p. 4). Et, encore une fois, dans une note de bas de page: "Tous les discours précédents sur les "salaires", les "prix" et le "marché", par exemple, auront sans doute fait sursauter un certain groupe de lecteurs. Nous leur demandons momentanément de contrôler leurs réponses émotionnelles et d'essayer de penser rationnellement avec nous sur la question" (p. 36).
Mais Cardan ne parlait pas seulement de "salaires", de "prix" et de "marché". Il a également parlé de "rentabilité" et de taux d'intérêt. C'était visiblement trop, même pour l'émotion contenue de Solidarity, puisque ces mots n'apparaissent nulle part dans la traduction publiée.
Il est très révélateur de donner quelques exemples de la façon dont Solidarity a atténué les aspects "socialisme de marché" des articles originaux de Cardan:
Original: magasins de vente aux consommateurs.
La version de Solidarity: les magasins qui distribuent aux consommateurs (p. 24).
Original: Le marché des biens de consommation.
La version de Solidarity: biens de consommation (rubrique p. 35).
Original: Ce qui implique l'existence d'un marché réel pour les biens de consommation.
La version de Solidarity: Ce qui implique l'existence d'un mécanisme par lequel la demande des consommateurs peut réellement se faire sentir (p.35).
Original: Monnaie, prix, salaires et valeur
Version de Solidarity: "argent", "salaires", "valeur" (rubrique p. 36)...
En fait, Cardan a envisagé une économie de marché dans laquelle tout le monde serait payé en argent circulant, un salaire égal, avec lequel acheter des biens qui seraient en vente à un prix égal à leur valeur (quantité de travail socialement nécessaire incorporée dans ces marchandises). Et il avait le culot de prétendre que Marx soutenait aussi que sous le socialisme, les biens s’échangeraient à leurs valeurs.... " [12]
La véritable continuité ici n'est pas avec Marx mais avec Proudhon, dont la future société "mutualiste" est une société de producteurs de marchandises indépendants, qui échangent leurs produits à leur valeur. ..
Le "socialisme" en tant que société de transition ?
Castoriadis ne prétend pas que la société qu'il décrit est le but final de la révolution. En fait, sa position est très similaire à la définition qui est apparue pendant la période de la social-démocratie et qui a été théorisée par Lénine en particulier: le socialisme est une étape sur la voie du communisme[13]. Et bien sûr, le stalinisme a profité pleinement de cette idée pour faire valoir que l'économie entièrement stratifiée de l'URSS était déjà le "socialisme réel". Mais le problème avec cette idée ne réside pas seulement dans la manière dont elle a été utilisée par le stalinisme. Une difficulté plus profonde est qu'elle tend à figer la période de transition dans un mode de production stable, alors qu'elle ne peut vraiment être comprise que d'une manière dynamique et contradictoire, comme une période marquée par une lutte constante entre les mesures communistes déclenchées par le pouvoir politique de la classe ouvrière, et tous les restes de l'ancien monde qui tendent à ramener la société vers le capitalisme. Que le régime politique de cette étape "socialiste" soit envisagé de manière despotique ou démocratique, l'illusion fondamentale demeure: que l'on peut arriver au communisme par un processus d'accumulation de capital. On peut même voir la tentative de Castoriadis de développer une économie équilibrée, où la production est harmonisée avec le marché de consommation, comme un reflet des méthodes keynésiennes de l'époque, qui visaient à éliminer les crises économiques précisément en réalisant un tel équilibre planifié. Et cela révèle à son tour à quel point Castoriadis a été ensorcelé par l'apparence de stabilité économique capitaliste dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale[14].
Dans une première partie de CS II, Castoriadis reprend à juste titre l'opinion de Marx selon laquelle la future société de producteurs libres doit simplifier profondément l'ensemble du processus de production et de distribution - doit rendre ses opérations "parfaitement simples et intelligibles", pour reprendre le terme utilisé par Marx dans l'une des rares descriptions de la société communiste contenues dans Le Capital[15]. Mais en conservant les catégories de production de valeur, non seulement toute tentative de planification rationnelle de la production et de la distribution sera entravée par les préoccupations du marché et de la "rentabilité", mais elle conduira tôt ou tard à la même vieille merde - à la crise économique et à des formes d'exploitation cachées, puis ouvertes. Il semble également assez ironique qu'ayant développé, dans la première partie de CSII, l'argument selon lequel la technologie capitaliste ne peut être considérée comme neutre mais est profondément liée aux objectifs de la production capitaliste, Castoriadis semble alors opter pour une sorte de solution technique, dans laquelle la "production planifiée" à l'aide de très gros ordinateurs, est en mesure de déterminer comment le marché autogéré parviendra à un équilibre économique parfait.
L'incapacité de Castoriadis à envisager un réel dépassement du rapport salarial est liée à sa fixation sur la notion d'"entreprise" socialiste en tant qu'unité autogérée, bien qu'elle se coordonne avec d'autres entreprises et branches de production à différents niveaux. Dans CS II, la description des relations dans la future société socialiste commence par une longue section sur la façon dont l'usine du futur sera gérée, et ce n'est que plus tard dans le texte qu'elle discute de la façon dont la société dans son ensemble sera gérée au niveau politique et économique. Le texte CS III est presque entièrement consacré à l'analyse de la réalité de la résistance au jour le jour dans l'atelier de l'usine, la considérant comme le terrain sur lequel une future conscience révolutionnaire se développera. Castoriadis n'a pas tort de souligner l'importance du lieu de travail en tant que centre d'intérêt pour l'association des travailleurs, pour leur résistance collective, et dans tout processus révolutionnaire, les assemblées de base sur le lieu de travail joueront certainement un rôle vital en tant que "cellules" d'un réseau plus large de conseils. Mais Castoriadis va plus loin que cela et suggère que, dans la société socialiste, l'usine/lieu de travail se maintiendra comme une sorte de communauté fixe. Au contraire, comme Bordiga a toujours souligné, l'émergence du communisme implique nécessairement la fin de l'entreprise individuelle, et le dépassement réel de la division du travail impliquera certainement que les producteurs seront de moins en moins liés à une seule unité de production.
Peut-être plus important encore, "l’usinisme" de Castoriadis conduit à une profonde sous-estimation de la fonction première des conseils ouvriers, qui n'est pas la gestion de l'usine mais l'unification de la classe ouvrière aux niveaux économique et politique. Pour Castoriadis, un conseil ouvrier est essentiellement un conseil élu par l'assemblée ouvrière d'une unité de production donnée, et vers la fin de CS II, il le distingue clairement des soviets russes qu'il considère comme essentiellement basés sur des unités territoriales[16]: "Bien que le mot russe "soviet" signifie "conseil", il ne faut pas confondre les conseils ouvriers que nous avons décrits dans ce texte, même avec les premiers Soviet russes. Les conseils ouvriers sont basés sur le lieu de travail. Ils peuvent jouer à la fois un rôle politique et un rôle dans la gestion industrielle de la production. Par essence, un conseil ouvrier est un organe universel. Le (Conseil) Soviet des députés ouvriers de Petrograd de 1905, bien qu'issu d'une grève générale et de composition exclusivement prolétarienne, soit resté un organe purement politique. Les Soviets de 1917 étaient en règle générale basés géographiquement. Eux aussi étaient des institutions purement politiques, dans lesquelles toutes les couches sociales opposées à l'ancien régime formaient un front uni".
Castoriadis envisage un réseau de conseils prenant en charge la gestion des affaires politiques locales et nationales, et Solidarity nous dessine utilement un schéma, mais celui-ci semble impliquer une assemblée centrale de délégués d'usine au niveau national sans lien avec le niveau local. Mais, fixé sur le problème de la gestion de l'usine (une question qui, en Russie, a été reprise par les comités d'usine), Castoriadis sous-estime l'importance du fait que les soviets sont apparus en 1905 et 1917 pour coordonner les lieux de travail engagés dans une grève de masse: il s'agissait d'un "conseil de guerre" de délégués de toutes les entreprises d'un village ou d'une ville donnée et, dès le début, il a pris la direction d'un mouvement qui passait du terrain de la défense économique à celui de la confrontation politique avec le régime existant.
Il est vrai qu'à côté, et souvent en liaison avec les soviets de députés ouvriers, il y avait des soviets de délégués de soldats et de marins, élus dans les casernes et sur les navires, et des soviets de députés "paysans" élus dans les villages, ainsi que des formes comparables élues sur la base des quartiers urbains, des groupes d'appartements, etc. En ce sens, de nombreux soviets avaient une base territoriale ou résidentielle forte. Mais cela soulève une autre question: la relation entre les conseils ouvriers et les conseils d'autres couches non exploiteuses. Castoriadis est conscient de ce problème puisque son "diagramme" envisage que l'assemblée centrale des délégués renferme des délégués des conseils paysans et des conseils de professionnels et de petits commerçants. C'est pour nous le problème central de l'État dans la période de transition: une période où les classes existent encore, dans laquelle la classe ouvrière doit exercer sa dictature tout en intégrant les autres couches non exploiteuses dans la vie politique et dans le processus de transformation des rapports sociaux. Castoriadis envisage un processus similaire mais rejette l'idée que cette organisation transitoire de la société constitue un État. Selon nous, cette approche est plutôt susceptible de permettre une situation où l'État devient une force "autonome" s'opposant aux organes de la classe ouvrière, comme cela s'est produit assez rapidement en Russie, compte tenu de l'isolement de la révolution après 1917. Pour nous, l'indépendance réelle de la classe ouvrière et de ses conseils est mieux servie en appelant l'État ce qu'il est, en reconnaissant ses dangers inhérents, et en s'assurant qu'il n'y a pas de subordination des organes de la classe ouvrière aux organes de la "société dans son ensemble".
Une dernière expression de l'incapacité de Castoriadis à envisager une véritable rupture avec les catégories de capital: la limitation de sa vision au niveau national. Des indices en sont donnés ici et là dans CS II où il parle de la façon dont les choses pourraient fonctionner "dans un pays comme la France", et comment "la population du pays tout entier" pourrait gérer ses affaires à travers une assemblée de délégués de conseil qui est dépeinte comme existant seulement à l'échelle nationale. Mais le danger de voir le "socialisme" dans un cadre national apparaît beaucoup plus explicitement dans ce passage:
- "(...) la révolution ne peut commencer que dans un seul pays, ou dans un seul groupe de pays. Par conséquent, elle devra subir des pressions de nature et de durée extrêmement variées. D'autre part, même si la révolution se propage rapidement à l'échelle internationale, le niveau de développement interne d'un pays jouera un rôle important dans l'application concrète des principes du socialisme. Par exemple, l'agriculture pourrait créer des problèmes importants en France - mais pas aux États-Unis - ou en Grande-Bretagne (où, inversement, le problème principal serait celui de l'extrême dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires). Au cours de notre analyse, nous avons examiné plusieurs problèmes de ce genre et nous espérons avoir montré que des solutions tendant vers une direction socialiste existaient dans chaque cas.
Nous n'avons pas été en mesure de prendre en compte les problèmes particuliers qui se poseraient si la révolution restait longtemps isolée dans un pays - et nous pouvons difficilement le faire ici. Mais nous espérons avoir montré qu'il est faux de penser que les problèmes résultant d'un tel isolement sont insolubles, qu'un pouvoir ouvrier isolé doit mourir héroïquement ou dégénérer, ou qu'il peut tout au plus "tenir bon" en attendant. La seule façon de "tenir" est de commencer à construire le socialisme; sinon, la dégénérescence nous a déjà gagnés et il n'y a rien à retenir. Pour le pouvoir ouvrier, la construction du socialisme dès le premier jour n'est pas seulement possible, elle est impérative. Si elle n'a pas lieu, le pouvoir détenu a déjà cessé d'être le pouvoir des travailleurs".[17]
L'idée qu'un pouvoir prolétarien peut se maintenir dans un seul pays en construisant le socialisme inverse la réalité du problème et nous ramène, finalement, aux erreurs des bolcheviks après 1921, et même aux positions contre-révolutionnaires de Staline et de Boukharine après 1924. Lorsque la classe ouvrière prend le pouvoir dans un pays, elle sera bien sûr obligée de prendre des mesures économiques pour garantir la satisfaction des besoins de base et, dans la mesure du possible, elles devraient être compatibles avec les principes communistes et contraires aux catégories de capital. Mais il faut toujours reconnaître que de telles mesures (comme le "communisme de guerre" en Russie) seront profondément déformées par des conditions d'isolement et de pénurie et n'auront pas nécessairement de continuité directe avec la reconstruction communiste authentique qui ne commencera qu'une fois que la classe ouvrière aura vaincu la bourgeoisie à l'échelle mondiale. Entre temps, la tâche essentiellement politique de l'extension de la révolution devra prendre le pas sur les mesures sociales et économiques contingentes et expérimentales qui auront lieu dans les premières étapes d'une révolution communiste.
Nous reviendrons plus tard sur la trajectoire politique suivie par Castoriadis, qui allait être significativement modelée par son abandon du marxisme au niveau théorique.
Munis: "Pour un second manifeste communiste".
Munis est retourné en Espagne en 1951 pour intervenir dans une flambée généralisée de lutte de classe, voyant la possibilité d'un nouveau soulèvement révolutionnaire contre le régime franquiste[18]. Il a été arrêté et a passé les sept années suivantes en prison. On peut soutenir que Munis n'a pas réussi à tirer des leçons politiques clés de cette expérience, en particulier en ce qui concerne les possibilités révolutionnaires de l'après-guerre, mais cela n'a certainement pas freiné son engagement pour la cause révolutionnaire. Il s'est réfugié de façon très précaire en France - l'État français l'a rapidement expulsé - et il a passé plusieurs années à Milan, où il est entré en contact avec les Bordiguistes et avec Onorato Damen de Battaglia Comunista, et il s’est développé une forte estime entre eux. C'est à cette époque, en 1961, que Munis, en compagnie de Péret, fonde le groupe Fomento Obrero Revolucionario. Dans ce contexte, il a produit deux de ses textes théoriques les plus importants: Les syndicats contre la révolution en 1960 et Pour un second Manifeste Communiste en 1961[19].
Au début de cet article, nous avons noté les similitudes dans les trajectoires politiques de Castoriadis et Munis dans leur rupture avec le trotskysme. Mais au début des années 1960, leurs chemins avaient commencé à diverger assez radicalement. À ses débuts, le titre "Socialisme ou Barbarie" correspondait au choix réel auquel était confrontée l'humanité: Castoriadis se considérait comme marxiste et l'alternative annoncée dans le titre exprimait l'adhésion du groupe à l'idée que le capitalisme était entré dans son époque de déclin[20]. Mais dans l'introduction au premier volume d'un recueil de ses écrits, La Société Bureaucratique[21], Castoriadis décrit la période 1960-64 comme les années de sa rupture avec le marxisme, considérant non seulement que le capitalisme avait essentiellement résolu ses contradictions économiques, réfutant ainsi les prémisses de base de la critique marxiste de l'économie politique; mais aussi que le marxisme, quelles que soient ses conceptions, ne pouvait être séparé des idéologies et des régimes qui s’en revendiquaient. En d'autres termes, Castoriadis, comme d'autres anciens trotskystes (comme les restes du RKD allemand) est passé d'un rejet total du "léninisme" à un rejet du marxisme lui-même (et s'est donc retrouvé dans un anarchisme de type "new look").
Même si, comme nous l'examinerons également, le ‘Second Manifeste’ indique à quel point Munis n'avait pas entièrement évacué le poids de son passé trotskyste, il dit clairement que, malgré toute la propagande contemporaine sur la société d'abondance et l'intégration de la classe ouvrière, la trajectoire réelle de la société capitaliste a confirmé les fondements du marxisme: que le capitalisme, depuis la première guerre mondiale, était entré dans son époque de décadence, dans laquelle la contradiction criante entre les rapports de production et les forces productives menaçait de mener l'humanité à la ruine, surtout à cause du danger historique de guerre entre les deux blocs impérialistes qui dominaient le globe. La société d'abondance était essentiellement une économie de guerre.
Loin de blâmer le marxisme pour avoir en quelque sorte donné naissance au stalinisme, le Second Manifeste dénonce avec éloquence les régimes et partis staliniens comme l'expression la plus pure de la décadence capitaliste qui, sous différentes formes à travers le monde, engendre une poussée vers un capitalisme d'État totalitaire. À partir du même point de départ théorique, le texte affirme que toutes les luttes de libération nationale sont devenues des moments de la confrontation impérialiste mondiale. À une époque où l'idée que les luttes nationales dans le Tiers-Monde étaient la nouvelle force du changement révolutionnaire, c'était un exemple frappant d'intransigeance révolutionnaire, et les arguments qui l'accompagnaient allaient être largement confirmés par l'évolution des régimes "post-coloniaux" produits par la lutte pour l'indépendance nationale. Cela contrastait avec les ambiguïtés du groupe SouB sur la guerre d'Algérie et d'autres questions fondamentales de classe. Le Second Manifeste indique clairement que SouB a suivi un chemin de compromis et d'ouvriérisme plutôt que de lutter pour la clarté communiste, contre le courant là où c'est nécessaire:
- "Pour sa part, la tendance "Socialisme ou Barbarie", également issue de la IVe Internationale, opère à la traine de la "gauche" française en décadence sur tous les problèmes et dans tous les mouvements importants: sur l'Algérie et le problème colonial, le 13 mai 1958 et le pouvoir gaulliste, les syndicats et les luttes ouvrières contemporaines, l'attitude envers le stalinisme et la direction de l'État en général. Au point où, bien qu'elle considère l'économie russe comme une forme de capitalisme d'État, elle n'a servi qu'à semer la confusion. En renonçant expressément à la tâche de lutter contre le courant et en disant seulement à la classe ouvrière "ce qu'elle peut comprendre", elle se condamne à son propre échec. Manquant de nerf, cette "tendance" a cédé à une sorte de polyvalence qui a des airs de funambulisme existentialiste. Pour eux, comme pour d'autres courants aux États-Unis, il vaut la peine de rappeler les paroles de Lénine: " quels intellectuels pitoyables qui pensent qu'avec les travailleurs, il suffit de parler de l'usine et de parler de ce qu'ils savent déjà depuis longtemps" ".
Encore une fois, contrairement à l'évolution de SouB, le Second Manifeste n'hésite pas à défendre le caractère prolétarien de la révolution d'Octobre et du parti bolchevique. Dans un document écrit environ 10 ans plus tard, et qui reprend des thèmes similaires au Second Manifeste, Parti-État, Stalinisme, Révolution[22], Munis argumente contre les courants de la gauche allemande et hollandaise qui avaient renié leur soutien initial à octobre et décidé que la révolution russe et le bolchevisme étaient essentiellement de nature bourgeoise. En même temps, le Second Manifeste se concentre sur certaines erreurs clés qui ont accéléré la dégénérescence de la révolution en Russie et la montée de la contre-révolution stalinienne: la confusion entre des nationalisations et de la propriété étatique et le socialisme, et l'idée que la dictature du prolétariat signifiait la dictature du parti. Dans Parti-État, Munis a également une vision précise de l'idée que l'État transitoire ne peut pas être considéré comme l'agent de la transformation communiste, faisant écho à la position de Bilan et de la GCF:
- "De la Commune de Paris, les révolutionnaires ont tiré une leçon de grande importance, entre autres: l'Etat capitaliste ne pouvait être conquis ou utilisé; il fallait le démolir. La révolution russe a approfondi cette même leçon de manière décisive: l'Etat, aussi ouvrier ou soviétique soit-il, ne peut être l'organisateur du communisme. En tant que propriétaire des instruments du travail, en tant que collecteur du surplus de travail social nécessaire (ou superflu), loin de dépérir, il acquiert une force et une capacité d'étouffement illimitées. Philosophiquement, l'idée d'un État émancipateur est du pur idéalisme hégélien, inacceptable pour le matérialisme historique" (Parti-État, p.43).
Et là où Castoriadis dans "Le contenu du socialisme" prône une forme de capitalisme autogéré, Munis ne laisse aucune place au doute sur le contenu économique et social du programme communiste - l'abolition du travail salarié et de la production de marchandises:
- "L'objectif d'une économie réellement planifiée ne peut être que de mettre la production en accord avec la consommation; seule la pleine satisfaction de cette dernière - et non le profit ou les privilèges, ni les exigences de la "défense nationale" ou d'une industrialisation étrangère aux besoins quotidiens des masses - peut être considérée comme l'impulsion de la production. La première condition pour une telle approche ne peut être que la disparition du travail salarié, pierre angulaire de la loi de la valeur, universellement présente dans les sociétés capitalistes, même si beaucoup d'entre elles prétendent aujourd'hui être socialistes ou communistes".
En même temps, cette force du ‘Second Manifeste’ concernant le contenu de la transformation communiste est aussi un côté faible - une tendance à supposer que le travail salarié et la production de marchandises peuvent être abolis dès le premier jour, même dans le contexte d'un seul pays. Il est vrai, comme dit le texte, que "dès le premier jour, la société en transition née de cette victoire doit viser cet objectif. Elle ne doit pas perdre de vue un instant l'interdépendance stricte entre la production et la consommation". Mais comme nous l'avons déjà fait remarquer, le prolétariat d'un seul pays ne doit jamais perdre de vue le fait que les mesures qu'il prend ne peuvent être que temporaires tant que la victoire révolutionnaire n'a pas été remportée à l'échelle mondiale, et qu’elles restent soumises au fonctionnement global des lois du capitalisme. Le fait que Munis ne garde pas cela à l'esprit à tout moment est confirmé en particulier dans Parti-État où il présente le communisme de guerre comme une sorte de "non-capitalisme" et considère la NEP comme la restauration des rapports capitalistes. Nous avons déjà critiqué cette approche dans deux articles[23] de la Revue internationale. C'est aussi confirmé par ce que Munis a toujours maintenu au sujet des événements en Espagne 36-37: pour lui, la révolution espagnole est allée encore plus loin que la révolution russe. C'était en partie parce qu'en mai 1937, les ouvriers montraient pour la première fois, les armes à la main, une compréhension du rôle contre-révolutionnaire du stalinisme. Mais il considérait aussi que les collectifs industriels et agraires espagnols avaient établi de petits îlots de communisme. En résumé: les rapports communistes sont possibles même sans la destruction de l'État bourgeois et l'extension internationale de la révolution. Dans ces conceptions, nous voyons, une fois de plus, un renouveau des idées anarchistes et même une anticipation du courant de "communisation" qui devait se développer dans les années 1970 et qui a une influence certaine au sein du mouvement anarchiste plus large d'aujourd'hui.
Et alors qu’une rupture incomplète avec le trotskysme prend parfois cette direction anarchiste, elle peut aussi se manifester par des séquelles plus classiques du trotskysme. Le Second Manifeste se termine donc par une sorte de version actualisée du programme de transition de 1938. Nous citons longuement à ce propos notre article de la Revue internationale 52:
- "En effet, le FOR a cru bon - dans "Pour un second manifeste communiste" - de mettre en avant toutes sortes de revendications transitoires, en l'absence de mouvements révolutionnaires du prolétariat. Cela va de la semaine de 30 heures, de la suppression du travail aux pièces et du chronométrage dans les usines, à la "revendication du travail pour tous, chômeurs et jeunes", sur le terrain économique. Sur le plan politique, le FOR exige de la bourgeoisie le "droit"(!) et la "liberté" démocratiques: "liberté de parole, de presse et de réunion; le droit d'élire pour les ouvriers leurs délégués permanents d'atelier, d'usine, profession", "sans aucune formalité judiciaire ou syndicale" ("Second Manifeste", p. 65-71).
Cela se situe dans la "logique" trotskyste, selon laquelle il suffirait de poser des revendications bien choisies pour arriver graduellement à la révolution. Pour les trotskystes, le tout est de savoir être pédagogue avec les ouvriers, qui ne comprendraient rien à leurs revendications, et de brandir les carottes les plus appétissantes dans le but de pousser les ouvriers dans leur "parti"... Est-ce cela que veut Munis, avec son programme de transition "bis" ? (...)
Le FOR ne comprend toujours pas aujourd'hui:
- Qu'il ne s'agit pas d'établir un catalogue de revendications pour les luttes futures: les travailleurs sont assez grands pour formuler spontanément leurs propres revendications précises, au cours de la lutte;
- Que telle ou telle revendication précise - comme le "droit au travail" pour les chômeurs - peut être reprise par les mouvements bourgeois et utilisée contre le prolétariat (camps de travail, travaux publics, etc.);
- Que ce n'est qu'à travers la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie que les ouvriers peuvent réellement satisfaire leurs revendications (…)
De façon très caractéristique, le FOR met sur le même plan ses mots d'ordre réformistes de "droits et libertés" démocratiques pour les ouvriers et des mots d'ordre qui ne peuvent surgir que dans une période pleinement révolutionnaire. On trouve ainsi pêle-mêle les mots d'ordre de:
- "expropriation du capital industriel, financier et agricole";
- "gestion ouvrière de la production et de la distribution des produits";
- "destruction de tous les instruments de guerre, atomiques aussi bien que classiques, dissolution des armées, des polices, reconversion des industries de guerre en production de consommation";
- "armement individuel des exploités sous le capitalisme, territorialement organisé, selon le schéma des comités démocratiques de gestion et de distribution";
- "suppression du travail salarié en commençant par élever le niveau de vie des couches sociales les plus pauvres pour atteindre finalement la libre distribution des produits selon les besoins de chacun";
- "suppression des frontières et constitution d'un seul gouvernement et d'une seule économie au fur et à mesure de la victoire du prolétariat dans divers pays."
Tous ces mots d'ordre montrent des confusions énormes. Le FOR semble avoir abandonné toute boussole marxiste. Aucune distinction n'est faite entre une période prérévolutionnaire, où domine politiquement le capital, une période révolutionnaire, où s'établit un double pouvoir, et la période de transition (après la prise du pouvoir par le prolétariat) qui seule peut mettre à l'ordre du jour (et non immédiatement!) la "suppression du travail salarié" et la "suppression des frontières"."[24]
La trajectoire ultérieure de Munis et Castoriadis.
Munis est décédé en février 1989. Le CCI a publié un hommage qui commençait en disant: "le prolétariat a perdu un militant qui a consacré toute sa vie à la lutte de classe"[25]. Après avoir brièvement retracé l'histoire politique de Munis à travers l'Espagne des années 1930, sa rupture avec le trotskysme pendant la Seconde Guerre mondiale, son séjour dans les prisons de Franco au début des années 1950 et la publication de Pour un second Manifeste Communiste, l'article reprend l'histoire à la fin des années 60:
- "En 1967, avec des camarades du groupe vénézuélien Internacionalismo, il participe aux efforts pour rétablir les contacts avec le milieu révolutionnaire en Italie. Ainsi, à la fin des années 1960, avec la résurgence de la classe ouvrière sur la scène de l'histoire, il a pris sa place aux côtés des forces révolutionnaires faibles qui existaient à l'époque, y compris celles qui allaient former Révolution Internationale en France. Mais au début des années 1970, il est malheureusement resté en dehors des discussions et des tentatives de regroupement qui ont abouti notamment à la constitution du CCI en 1975. Malgré cela, le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR), le groupe qu'il a formé en Espagne et en France autour des positions du 'Second Manifeste', a d'abord accepté de participer à la série de conférences de groupes de la gauche communiste qui a eu lieu à Milan en 1977. Mais cette attitude a changé au cours de la deuxième conférence; le FOR est sorti de la conférence, et ce fut l'expression d'une tendance à l'isolement sectaire qui prévalut jusqu'à présent dans cette organisation".
Aujourd'hui, le FOR n'existe plus. Il a toujours été fortement dépendant du charisme personnel de Munis, qui n'a pas su transmettre une solide tradition d'organisation à la nouvelle génération de militants qui se sont ralliés autour de lui, et qui aurait pu servir de base pour la poursuite du fonctionnement du groupe après la mort de Munis. Et comme le remarque notre hommage, le groupe a souffert d'une tendance au sectarisme qui a encore affaibli sa capacité de survie.
L'exemple de cette attitude mentionnée dans l'hommage est le départ plutôt ostentatoire de Munis et de son groupe de la deuxième conférence de la gauche communiste, en mettant en avant son désaccord avec les autres groupes sur le problème de la crise économique. Ce n'est pas l'endroit pour examiner ce problème en détail, mais nous pouvons voir le cœur de la position de Munis dans le Second Manifeste:
- "La reprise de l'esprit combatif et la résurgence d'une situation révolutionnaire ne peuvent être attendues, comme le prétendent certains marxistes qui penchent pour l'automatisme économique, comme conséquence de l'une de ces crises cycliques, appelées à tort "crises de surproduction". Ce sont les vibrations qui régularisent le développement chaotique du système et ne sont pas le résultat de son épuisement. Le capitalisme géré sait comment les atténuer et d'ailleurs, même si l'une d'entre elles se produit, cela pourrait facilement favoriser les dessins tortueux de nouveaux réactionnaires, qui attendent leur moment, les plans à cinq ans dans une poche, et les normes de production dans l'autre. La crise générale du capitalisme est son épuisement en tant que système social. Elle consiste, sommairement parlant, dans le fait que les instruments de production en tant que capital et de distribution de produits, limités par le travail salarié, sont devenus incompatibles avec les nécessités humaines, et même avec les possibilités maximales que la technique pourrait offrir au développement économique. Cette crise est insurmontable pour le capitalisme, et en Occident comme en Russie, elle s'aggrave de jour en jour".
La position de Munis n'est donc pas simplement de nier la crise de surproduction, et d’ailleurs, plus tôt dans le Second Manifeste, il attribue ces crises à une contradiction fondamentale du système, celle entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. De plus, dans son rejet de l'idée "d'automatisme" selon laquelle un crash économique conduirait mécaniquement à une avancée de la conscience révolutionnaire, Munis a raison. Il a également raison de voir que l'émergence d'une conscience véritablement révolutionnaire implique la reconnaissance du fait que les rapports sociaux mêmes, sous-jacents à la civilisation, sont devenus incompatibles avec les besoins de l'humanité. Ce sont des points qui auraient pu être discutés avec d'autres groupes de la gauche communiste et qui ne justifiaient certainement pas de quitter la conférence de Paris sans même expliquer ses véritables divergences.
Encore une fois, dans sa brochure Fausse Trajectoire de Révolution Internationale[26], où ses vues sur la relation entre crise économique et conscience de classe sont expliquées plus longuement, Munis vise parfois juste, puisque, comme nous l'avons dit dans notre résolution sur la situation internationale [814] du 21e congrès international[27], le CCI a parfois établi un lien immédiat et mécanique entre la crise et la révolution. Mais la réalité n'était pas vraiment du côté de Munis puisque, qu'on le veuille ou non, le système capitaliste est en effet coincé dans une crise économique très profonde depuis les années 1970; l'idée que les crises économiques font simplement partie du mécanisme de "régulation" du système semble refléter les pressions de l'époque où le Second Manifeste a été écrit, le début des années 1960, le zénith du boom de l'après-guerre. Mais ce pic a été suivi d'une descente rapide dans une crise économique mondiale qui s'est avérée fondamentalement insoluble, malgré toutes les énergies qu'un système géré par l'État a déployées pour ralentir et retarder ses pires effets. Et s'il est vrai qu'une conscience véritablement révolutionnaire doit saisir l'incompatibilité entre les rapports sociaux capitalistes et les besoins de l'humanité, l'échec visible d'un système économique qui se présente comme pas moins qu’une incarnation de nature humaine, jouera certainement un rôle clé pour permettre aux exploités de se débarrasser de leurs illusions sur le capitalisme et son immortalité.
Derrière ce refus d'analyser la dimension économique de la décadence du capitalisme se cache un volontarisme non dépassé, dont les fondements théoriques remontent à la lettre annonçant sa rupture avec l'organisation trotskyste en France, le Parti Communiste Internationaliste, où il maintient avec constance la notion de Trotsky, présentée dans les premières lignes du Programme de transition, selon laquelle la crise de l'humanité est la crise de la direction révolutionnaire:
- "La crise de l'humanité - nous le répétons mille fois avec L.D. Trotsky - est une crise de la direction révolutionnaire. Toutes les explications qui tentent de mettre la responsabilité de l'échec de la révolution sur les conditions objectives, le fossé idéologique ou les illusions des masses, sur le pouvoir du stalinisme ou l'attraction illusoire de ‘l'Etat ouvrier dégénéré’, sont fausses et ne servent qu'à excuser les responsables, à détourner l'attention du vrai problème et à entraver sa solution. Une direction révolutionnaire authentique, étant donné le niveau actuel des conditions objectives pour la prise du pouvoir, doit surmonter tous les obstacles, surmonter toutes les difficultés, triompher de tous ses adversaires"[28].
C'est cette attitude "héroïque" qui a conduit Munis à voir la possibilité d'une révolution prête à faire surface à tout moment dans la période décadente: - dans les années 1930, quand Munis voit les événements en Espagne non pas comme la preuve d'une contre-révolution triomphante mais comme le point culminant de la vague révolutionnaire qui a commencé en 1917; - après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand, comme nous l'avons vu, Munis a vu les mouvements en Espagne en 1951 comme précurseurs d'un assaut révolutionnaire; - à l'apogée de la période du "boom" des années 1960, puisque le Second Manifeste fait déjà référence à "l'accumulation d'énergies révolutionnaires redoutables" qui s'est produite au moment où il a été écrit. Et tout comme il a rejeté les efforts du CCI pour examiner l'évolution de la crise économique, il rejette également notre argument selon lequel même si la décadence signifie que la révolution prolétarienne est à l'ordre du jour de l'histoire, il peut y avoir des phases de défaite et de désarroi profonds dans la classe pendant cette période, des phases qui rendent la révolution presque impossible et qui confèrent des tâches différentes à l'organisation révolutionnaire.
Mais aussi graves qu'aient pu être ces erreurs, ce sont des erreurs compréhensibles d'un révolutionnaire qui désire de tout son être voir la fin du capitalisme et le début de la révolution communiste. C'est pourquoi notre hommage se termine ainsi:
- "Il est donc clair que nous avons des divergences très importantes avec le FOR, ce qui nous a conduit à polémiquer avec eux à plusieurs reprises dans notre presse (voir en particulier l'article de la Revue internationale 52). Cependant, malgré les graves erreurs qu'il a pu commettre, Munis est resté jusqu'à la fin un militant profondément loyal au combat de la classe ouvrière. Il a été l'un de ces très rares militants qui ont résisté aux pressions de la plus terrible contre-révolution que le prolétariat ait jamais connue, quand beaucoup ont déserté ou même trahi le combat militant; et il était de nouveau là aux côtés de la classe avec la résurgence historique de ses luttes à la fin des années 60.
Nous rendons hommage à ce militant de la lutte révolutionnaire, à sa loyauté et à son engagement indéfectible en faveur de la cause prolétarienne. Aux camarades du FOR, nous envoyons nos salutations fraternelles".
Castoriadis déserte le mouvement ouvrier
L'un des meilleurs récits de la vie de Munis a été écrit par Auguste Guillamon en 1993. Son titre - G. Munis, un révolutionnaire peu connu [815] - résume l'un des principaux points de l'article: que la plupart des militants qui, à travers les épreuves et les tribulations du 20ème siècle, sont restés fidèles à la cause prolétarienne, n'ont pas été récompensés par la gloire ou la fortune: aux côtés de Munis, il mentionne Onorato Damen, Amadeo Bordiga, Paul Mattick, Karl Korsch, Ottorino Perrone, Bruno Maffi, Anton Pannekoek et Henk Canne-Meijer[29]. En revanche, notre nécrologie pour Castoriadis s'intitulait: Mort de Cornelius Castoriadis: la bourgeoisie rend hommage à l'un de ses serviteurs [816]. Nous pouvons laisser l'article parler de lui-même, en ajoutant quelques commentaires supplémentaires.
"La presse bourgeoise, surtout en France, a fait du bruit sur la mort de Cornelius Castoriadis. Le Monde y fait référence dans deux numéros successifs (28-29 décembre et 30 décembre 1997) et lui consacre une page entière sous un titre significatif: "Mort de Cornelius Castoriadis, révolutionnaire anti-marxiste". Ce titre est typique des méthodes idéologiques de la bourgeoisie. Il contient deux vérités enroulées autour du mensonge que nous devrions avaler. Les vérités: Castoriadis est mort, et il était anti-marxiste. Le mensonge: c'était un révolutionnaire. Pour étayer l'idée, Le Monde rappelle les propres mots de Castoriadis, "répétés jusqu'à la fin de sa vie", "Quoi qu'il arrive, je resterai d'abord et avant tout un révolutionnaire".
Et en effet, dans sa jeunesse, il fut un révolutionnaire. À la fin des années 1940, il rompt avec la 4e Internationale trotskyste en compagnie d'autres camarades et anime la revue Socialisme ou Barbarie. À cette époque, SouB représentait un effort, quoique confus et limité par ses origines trotskystes, pour développer une ligne de pensée prolétarienne au milieu de la contre-révolution triomphante. Mais au cours des années 1950, sous l'impulsion de Castoriadis qui signa ses articles Pierre Chaulieu, puis Paul Cardan), SouB rejeta de plus en plus les faibles fondements marxistes sur lesquels il avait été construit. En particulier, Castoriadis a développé l'idée que le véritable antagonisme dans la société n'était plus entre exploiteurs et exploités, mais entre "dirigeants et dirigés". SouB a finalement disparu au début de 1966, à peine deux ans avant les événements de mai 68, qui ont marqué la résurgence historique de la lutte de classe mondiale après une contre-révolution de près d'un demi-siècle. En fait, Castoriadis avait cessé d'être un révolutionnaire bien avant sa mort, même s'il était capable d’en maintenir l'apparence illusoire.
Castoriadis n'a pas été le premier à trahir les convictions révolutionnaires de sa jeunesse. L'histoire du mouvement ouvrier est parsemée de tels exemples. Ce qui le caractérise cependant, c'est qu'il a habillé sa trahison dans les haillons du "radicalisme politique", en prétendant qu'il était opposé à l'ensemble de l'ordre social existant. Nous pouvons le voir en regardant un article écrit dans Le Monde Diplomatique en réponse à son livre final, "Done and to be done" ("Fait et à faire", 1997):
- "Castoriadis nous donne les outils pour contester, construire les barricades, envisager le socialisme du futur, penser à changer le monde, vouloir changer la vie politiquement... Quel héritage politique peut venir de l'histoire du mouvement ouvrier, alors qu'il est maintenant évident que le prolétariat ne peut pas jouer le rôle de force motrice que le marxisme lui attribue ? Castoriadis répond avec un superbe programme qui combine les plus hautes exigences de la politique humaine avec le meilleur de l'idéal socialiste... L'action et la pensée sont à la recherche d'un nouveau radicalisme, maintenant que la parenthèse léniniste est fermée, maintenant que l’État-policier du marxisme historique est tombé en poussière ...".
En réalité, ce "radicalisme" qui faisait tant saliver les journalistes de haut vol était une feuille de vigne qui couvrait le fait que le message de Castoriadis était extrêmement utile aux campagnes idéologiques de la bourgeoisie. Ainsi, sa déclaration selon laquelle le marxisme avait été pulvérisé (The rise of Insignificance, 1996) a apporté un soutien "radical" à toute la campagne sur la mort du communisme qui s'est développée après l'effondrement des régimes staliniens du bloc de l'Est en 1989".
Nous avons vu certains des premiers signes d'une recherche de reconnaissance dans la décision du groupe Castoriadis d'écrire pour Les Temps Modernes de Sartre, une pratique fortement critiquée par la GCF[30]. Mais c'est quand il abandonne finalement l'idée d'une révolution de la classe ouvrière et commence à spéculer sur une sorte d'utopie de citoyens autonomes, quand il plonge dans les bains plus obscurs de la sociologie et de la psychanalyse lacanienne, qu'il devient intéressant pour l'académie bourgeoise et les branches les plus sophistiquées des médias, qui étaient tout à fait disposées à lui pardonner les folies de sa jeunesse et à l'accepter dans leurs très confortables rangs.
Mais notre article ("Mort de Cornelius Castoriadis … ") accuse Castoriadis d'une trahison plus grave que d’abandonner la vie militante et de rechercher avant tout son avancement professionnel.
- "Mais le véritable test du radicalisme de Castoriadis avait déjà eu lieu au début des années 80, lorsque, sous la direction de Reagan, la bourgeoisie occidentale a lancé une campagne assourdissante contre la menace militaire de "l’Empire maléfique" de l'URSS afin de justifier une campagne d'armement sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. Et c'est précisément à cette époque que Castoriadis publie son livre "Facing War" où il tente de démontrer qu'il existe un "déséquilibre massif" en faveur de la Russie, "une situation qu'il était pratiquement impossible pour les Américains de modifier". De plus, cette "analyse" a été fréquemment citée par Marie-France Garaud, idéologue de la droite ultra-militariste et porte-parole en France des campagnes Reaganiste.
A la fin des années 80, la réalité a démontré que la puissance militaire russe était en fait largement inférieure à celle des États-Unis, mais cela n'a pas émoussé l'autosatisfaction de Castoriadis et n'a pas fait taire les louanges des journalistes à son égard. Ce n'était pas nouveau non plus. A partir de 1953-54, avant même d'abandonner ouvertement le marxisme, Castoriadis a développé toute une théorie selon laquelle le capitalisme aurait définitivement surmonté sa crise économique (voir 'La dynamique du capitalisme' dans SouB n° 120). Nous savons ce qui s'est passé après cela: la crise du capitalisme est revenue en force à la fin des années 60. Ainsi, lorsqu'un recueil de poche (Editions 10/18) des œuvres de Castoriadis a été publié en 1973, il y manquait certains écrits peu glorieux, ce qui a permis à son ami Edgar Morin de dire à l'époque: "Qui peut aujourd'hui publier sans honte, voire avec fierté, les textes qui ont marqué son parcours politique de 1948 à 1973, sinon un esprit rare comme Castoriadis ?" (Le Nouvel Observateur)".
Castoriadis a-t-il ouvertement appelé à mobiliser les travailleurs pour défendre la "démocratie occidentale" contre ce qu'il a appelé la "stratocratie" du bloc de l'Est ? Dans un fil sur Libcom en 2011, un post signé 'Julien Chaulieu' s'oppose au post original, un récit de la vie de Castoriadis écrit par la Fédération Anarchiste au Royaume-Uni, qui affirme que "dans sa dernière période, Castoriadis s'est orienté vers les investigations philosophiques, vers la psychanalyse. Dans cette période, son manque de connaissance des événements et mouvements sociaux actuels l'a conduit vers une tentative de défense de l'Occident - parce que la lutte y restait encore possible - contre l'impérialisme stalinien".[31]
Julien Chaulieu répondit:
- "En tant que personne qui a étudié toutes ses œuvres, aux côtés de Guy Debord et de nombreux anarchistes-libertaires socialistes, je peux confirmer que la déclaration ci-dessus est tout à fait fausse.
Castoriadis n'a jamais défendu l'Occident. Il s'agissait d'un malentendu, basé sur une propagande du parti social-fasciste stalinien grec (Parti Communiste de Grèce). Dans cette interview-vidéo (qui n'est malheureusement disponible qu'en grec), il affirme que l'URSS était effectivement oppressive et tyrannique, mais que cela ne veut pas dire que nous devons défendre les puissances capitalistes occidentales qui sont tout aussi brutales à l'égard du "Tiers Monde". Le fait qu'il ait abandonné les idées socialistes typiques, en s'orientant vers l'autonomie a provoqué des réactions massives au sein du PCG.
Dans cet entretien, il a déclaré ce qui suit:
- "Les sociétés occidentales ne sont pas seulement des sociétés capitalistes. Un marxiste dira que le mode de production dans le monde occidental est capitaliste, donc ces sociétés sont capitalistes parce que le mode de production détermine tout. Mais ces sociétés ne sont pas seulement capitalistes. Elles se nomment elles-mêmes démocraties (je ne les dis pas démocratiques parce que j'ai une définition différente de la démocratie), je les appelle des oligarchies libérales. Mais dans ces sociétés, il y a un élément démocratique qui n'a pas été créé par le capitalisme. Au contraire, il a été créé en contraste avec le capitalisme. Il a été créé alors que l'Europe sortait du Moyen Âge et qu'une nouvelle classe sociale était en train d'être créée, la soi-disant classe moyenne (qui n'a rien à voir avec les capitalistes) et elle a essayé d'obtenir une certaine liberté vis-à-vis des féodaux, des rois et de l'église. Ce mouvement se poursuit après la Renaissance avec la Révolution anglaise au XVIIe siècle, les révolutions française et américaine au XVIIIe siècle qui ont abouti à la création du mouvement ouvrier."
En fait, il semble très critique à l'égard du capitalisme, il dévoile le mythe selon lequel "le capitalisme est le seul système qui fonctionne, le moins mauvais", qui est l'approche occidentale dominante. Rien de pro-capitaliste ici. Au contraire, il dit la vérité qui a été détruite par des libéraux stupides".
Mais ce que nous trouvons réellement dans ce passage, avec son analyse alarmiste de la force militaire russe, et encore une fois avec certaines déclarations sur la guerre du Golfe de 1991[32] c'est que les textes ultérieurs de Castoriadis créent une zone d'ambiguïté qui peut facilement être exploitée par les vrais vautours de la société capitaliste, même si Castoriadis lui-même évite de s'incriminer avec des déclarations explicitement pro-guerre.
Notre article aurait également pu ajouter qu'il y a une autre facette de "l'héritage de Castoriadis": il est, en un sens, l'un des pères fondateurs de ce que nous avons appelé le courant "moderniste" (et qui, rappelons-le, a toujours été inspiré, dans une large mesure, par la version Castoriadis issue du trotskysme), composé de divers groupes et individus qui prétendent avoir dépassé le marxisme mais qui se considèrent encore comme révolutionnaires et même communistes. Plusieurs membres de l'Internationale Situationniste, qui tendaient vers cette direction, étaient même membres de SouB, mais la transmission de cette flamme est une tendance plus générale et ne dépend pas d'une succession physique directe. Les Situationnistes, par exemple, se sont mis d'accord avec Castoriadis sur le slogan de l'autogestion généralisée, ont convenu que l'analyse marxiste de la crise économique était une vieillerie, mais ne l'ont pas suivi dans l’abandon de l'idée de la classe ouvrière comme force motrice de la révolution. D'autre part, la tendance principale du modernisme ultérieur - qui tend aujourd'hui à se qualifier de "mouvement pour la communisation" - a lu Marx et Bordiga et est capable de montrer que cette notion d'autogestion est tout à fait compatible avec la loi de la valeur. Mais ce qu'ils héritent de Castoriadis, c'est avant tout l'abandon de la classe ouvrière comme sujet de l'histoire. Et de même que le dépassement de Marx par Castoriadis l'a ramené à Proudhon, de même le puissant acte "d’abrogation" cher aux communisateurs ramène ces derniers à Bakounine, où toutes les classes s'immolent dans la grande conflagration à venir. Mais ceci est une polémique que nous devrons reprendre.
C D Ward, décembre 2017
[1] Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire: Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme (première partie) [817], Revue internationale n° 161.
[2] Chaulieu étant un nom de guerre pour Cornelius Castoriadis - avec Paul Cardan et d'autres; Montal pour Claude Lefort.
[3] Lire à ce sujet: Mémoires d'un révolutionnaire (A. Stinas, Grèce): nationalisme et antifascisme [122] dans la Revue internationale n° 72; Revolutionary defeatists in Greece in World War II, Aghis Stinas [818].
[4] Voir par exemple ce texte de 1945 Defense of the Soviet Union and Revolutionary Tactics [819].
[6] On the Content of Socialism I - Socialisme Ou Barbarie [821], On the Content of Socialism II - Socialisme Ou Barbarie [813], On the Content of Socialism III - Socialisme Ou Barbarie [822]
[8] La brochure de Pannekoek a été écrite pendant la guerre mais publiée complètement dans les années qui ont suivi. La référence qu’y fait Castoriadis est dans On the Content of Socialism III - Socialisme Ou Barbarie [822]
[9] CS II.
[10] Chapitre XLVIII
[11] Voir notre article précédant dans cette série, Le renversement du fétichisme de la marchandise [824].
[12] Solidarity, the market and Marx [825]. Le texte est également intéressant dans la mesure où il salue l'apparition de nouveaux groupes comme Workers Voice à Liverpool, Internationalism aux États-Unis et le groupe de Londres qui, après s'être séparé de Solidarity, a formé World Revolution, qui sont beaucoup plus clairs que Solidarity sur le contenu du socialisme/communisme. Ce qu'il ne fait pas, c'est de s'opposer à la conception essentiellement nationale du socialisme contenue dans CS II - une faiblesse qui afflige inévitablement le SPGB avec sa vision d'un chemin parlementaire vers le socialisme. Voir note suivante.
[13] Pour nous - et nous pensons être plus proches de Marx ici, même s'il préférait beaucoup le terme "communisme" - nous considérons le socialisme et le communisme comme la même chose: une société où le travail salarié, la production marchande et les frontières nationales ont été dépassés.
[14] Voir notre article Décadence du capitalisme: le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme [286].
[15] Le Capital, volume 1, chapitre 1
[16] Il est intéressant de noter que dans une lettre à Socialisme ou Barbarie en 1953, Anton Pannekoek avait déjà remarqué la conception restrictive des conseils ouvriers par le groupe français: "Alors que vous limitez l'activité de ces organismes à l'organisation du travail dans les usines après la prise de pouvoir social par les travailleurs, nous les considérons aussi comme étant les organismes par lesquels les travailleurs vont conquérir ce pouvoir". Letter to Socialisme ou Barbarie [826]. Anton Pannekoek 1953.
[17] CS II
[19] Unions against revolution [828]. Ce texte fut également publié dans Internationalism n°3 au début des années 70, avec une introduction de Judith Allen, Les syndicats et le réformisme. La réponse de Munis à celle-ci fut Brouillon théorique et clarté révolutionnaire [829]. Il existe une édition française de Pour un second manifeste communiste [830].
[20] Voir par exemple Les rapports de production en Russie [831].
[21] La société bureaucratique 1: les rapports de production en Russie, éditions 10:18, 1973
[22] Parti-État, Stalinisme, Révolution, éditions Spartacus, 1975
[23] Les confusions du "fomento obrero revolucionario" sur Russie 1917 et Espagne 1936 [832] publié dans la Revue internationale n° 25; Polémique: Où va le FOR ? [498] (Ferment Ouvrier Révolutionnaire) dans la Revue internationale n° 52.
[25] À la mémoire de munis, un militant de la classe ouvrière [496], dans la Revue internationale n° 58.
[26] Dans la brochure Alarme, non datée.
[27] Revue internationale n° 156. Voir également la résolution sur la lutte de classe internationale [701] de notre 22eme congrès, en particulier son point 15, publiée dans la Revue internationale n° 159.
[29] Curieusement, il n'inclut pas Marc Chirik dans la liste, ni dans l'ensemble de l'article, ce qui le prive quelque peu d'un important domaine d'investigation. Non seulement les discussions entre Munis et la Gauche Communiste de France à la fin des années 40 et au début des années 50 ont joué un rôle dans la rupture de Munis avec le trotskysme, mais aussi nous pouvons voir tout au long des écrits de Munis sur la crise économique une polémique continue contre la conception de la décadence défendue par la GCF et plus tard le CCI.
[30] Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire: Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme (première partie) [817].
[32] Selon Takis Fotopoulos: "Enfin, il faut mentionner sa position sur la guerre du Golfe, ce qui était totalement inacceptable pour un membre auto-déclaré de la gauche anti-systémique, alors que, contrairement à d'autres analystes de la gauche comme Noam Chomsky (en aucun cas un extrémiste et lui aussi un admirateur enthousiaste de l'effondrement de l'URSS !), il n'a pas pris une position sans équivoque contre cette guerre criminelle, qui a ouvert la voie à la destruction éventuelle de l'Irak, mais il a plutôt adopté une approche indirecte de "distances égales" envers la victime (le peuple irakien) et le bourreau (l'élite transnationale). Ainsi, après avoir rejeté le pétrole comme la cause fondamentale de la guerre dans le Golfe (et plus tard, par conséquence, de l'invasion de l'Irak, ce qui est aujourd'hui reconnu même par le chef du système de la Réserve fédérale américaine de l'époque, il a ensuite suggéré - plus d'une décennie avant Samuel Huntington - une sorte de "choc des civilisations" version Castoriadis. Il s'agissait en fait d'une "approche à distances égales" déguisée à l'égard de la victime et de son agresseur (c'est-à-dire l'approche habituelle adoptée par la gauche réformiste sur toutes les guerres récentes de l'élite transnationale): "Le conflit va déjà bien au-delà du cas de l'Irak et de Saddam Hussein. Il est en train de se transformer en confrontation entre, d'une part, des sociétés maintenues sous l'emprise d'un imaginaire religieux tenace, aujourd'hui renforcé, et, d'autre part, des sociétés occidentales qui, d'une manière ou d'une autre, ont été délivrées de cet imaginaire mais se sont révélées incapables de transmettre au reste du monde autre chose que les techniques de guerre et la manipulation de l'opinion." Pas étonnant que, dans les années 1990, Castoriadis, à ma connaissance, n'ait jamais prononcé un seul mot contre l'embargo occidental catastrophique contre ce pays qui a entraîné, selon les estimations de l'ONU, la mort d'un demi-million d'enfants irakiens, ou contre les bombardements meurtriers du pays ordonnés par l'administration Clinton. Inutile d'ajouter qu'une approche "à distances égales", similaire à celle adoptée par Castoriadis et la gauche réformiste, implique en effet un soutien indirect des élites dirigeantes et de leurs "guerres" ! The Autonomy project and Inclusive Democracy: A critical review of Castoriadis’ thought’ [834], Takis Fotopoulos, The International Journal of Inclusive Democracy Vol. 4, No. 2 (Avril 2008).
Courants politiques:
- Gauchisme [835]
Rubrique:
La bourgeoisie mondiale contre la révolution (II): La social-démocratie et le stalinisme à jamais dans le camp bourgeois
- 275 lectures
Dans la première partie de cet article [740], nous avons mis en évidence la réaction de toutes les grandes puissances impérialistes pour endiguer la vague révolutionnaire et éviter qu’elle ne se répande dans les grands pays industrialisés de l’Ouest de l’Europe. Alors que les bourgeoisies d’Europe s’étaient entredéchirées durant quatre ans, elles faisaient désormais cause commune contre leur ennemi historique : le prolétariat mondial. Parmi les multiples forces que la classe dominante engagea pour la préservation de son système, la social-démocratie (dont la direction et l’aile droite avaient voté les crédits de guerre en 1914, consacrant ainsi un opportunisme de longue date qui l'amenait à passer définitivement dans le camp de la bourgeoisie) devait jouer un rôle déterminant dans la répression et la mystification de la révolution mondiale. Le parti social-démocrate allemand (SPD) se plaça aux avants postes de cette offensive puisqu’il fut le véritable bourreau de la révolution allemande en janvier 1919. Comme Lénine et Rosa Luxemburg l’avaient pressenti[1], l’impossibilité de l’extension de la révolution dans les grands centres industriels d’Europe de l’Ouest déboucha sur l’isolement, la dégénérescence de la République des soviets et la victoire de la contre-révolution stalinienne qui pèse encore énormément dans les rangs de la classe ouvrière mondiale.
I. La trahison de social-démocratie
Le rejet de la solidarité du prolétariat de Russie
Au cours de la vague révolutionnaire qui gagna l’Allemagne à partir de novembre 1918, la social-démocratie joua véritablement le rôle de tête de pont de la bourgeoisie dans le but d’isoler la classe ouvrière de Russie.
Lorsque la révolution éclata en Allemagne, les diplomates soviétiques furent expulsés par Scheidemann (sous-secrétaire d’État sans portefeuille dans le cabinet de Max de Bade). À ce moment-là, les masses ouvrières n’avaient pas véritablement perçu l’abandon progressif du marxisme par le SPD. À la veille de la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers d’ouvriers en Allemagne en étaient encore membres. Mais sa désolidarisation avec la révolution de Russie confirmait sa trahison et son passage dans le camp bourgeois. Après la mutinerie des marins de Kiel, Haase transmit par téléscripteur un message des commissaires du peuple au gouvernement soviétique en le remerciant pour l’envoi de céréales mais, après une pause, le message se poursuivait ainsi : "Sachant que la Russie est oppressée par la faim, nous vous demandons de distribuer au peuple russe affamé le grain que vous entendez sacrifier pour la révolution allemande. Le président de la République américaine Wilson, nous garantit l’envoi de farine et de lard nécessaire à la population allemande pour passer l’hiver." Comme l’a dit Karl Radek par la suite, "la main tendue resta suspendue dans le vide" ! Le gouvernement "socialiste" préférait l’aide d’une puissance capitaliste plutôt que celle des ouvriers de Russie ! En effet, à la place, le gouvernement allemand accepta de la farine et du lard américains, d’énormes quantités d’articles de luxe et d’autres marchandises superflues qui mirent le Trésor allemand à sec. Le 14 novembre, le gouvernement fit parvenir un télégramme au président américain Wilson : "Le gouvernement allemand demande au gouvernement des États-Unis de faire savoir par télégraphe au chancelier du Reich (Ebert) s’il peut compter sur la fourniture de denrées alimentaires de la part du gouvernement des États Unis, de façon à ce que le gouvernement allemand soit en mesure de garantir l’ordre à l’intérieur du pays et de rétribuer équitablement de tels approvisionnements."
En Allemagne, ce télégramme fut diffusé partout pour faire passer le message suivant aux ouvriers : "renoncez à la révolution et à abattre le capitalisme, et vous aurez du pain et du lard !". Mais aucune condition de ce genre n’avait été imposée par les Américains. Ainsi, non seulement la social-démocratie faisait du chantage aux ouvriers mais elle leur mentait effrontément en leur faisant croire que ces conditions étaient imposées par Wilson lui même.[2]
La social-démocratie à la tête de la contre-révolution
Dans ces conditions, il ne faisait aucun doute que la social-démocratie allemande se plaçait aux avant-postes de la contre-révolution. Le 10 novembre 1918, le conseil des ouvriers et de soldats de Berlin, l’organe suprême du pouvoir reconnu par le nouveau gouvernement, prit la décision de rétablir immédiatement les relations diplomatiques avec le gouvernement russe en attendant l’arrivée de ses représentants à Berlin. Cette résolution était un ordre que les commissaires du peuple auraient dû respecter mais ils ne le firent pas. Bien qu’ils s’en soient défendus dans l’organe de l’USPD, la trahison et la vente de la révolution aux puissances impérialistes a été acceptée par les Indépendants (USPD) comme le prouve le procès-verbal de la séance du conseil des commissaires du peuple du 19 novembre 1918 : "Poursuite de la discussion sur les relations entre l’Allemagne et la République des soviets. Haase conseille d’adopter une politique dilatoire. (...) Kautsky est d’accord avec Haase : la décision doit être différée. Le gouvernement soviétique ne peut survivre longtemps ; d’ici quelques semaines, il n’existera plus (...)."[3] Cependant, alors que l’aile droite de ce parti centriste passait progressivement du côté de la contre-révolution, l’aile gauche s'orientait plus clairement vers la défense des intérêts prolétariens.
Mais le zèle du gouvernement "socialiste" ne s’arrêtait pas là. Face à l’irritation de l’Entente du fait de la lenteur avec laquelle les troupes allemandes se retiraient des territoires orientaux, le gouvernement allemand répondit par une dépêche diplomatique qui, bien qu’envoyée après l’expulsion des sociaux-démocrates indépendants (du gouvernement), avait été élaborée avec eux. Voici ce qui était affirmé : "La conviction de l’Entente selon laquelle les troupes allemandes soutiendraient le bolchevisme, de leur propre initiative ou par ordre supérieur, directement ou bien en faisant obstacle aux mesures antibolcheviques, ne correspond pas à la réalité. Nous aussi, Allemands, et donc nos troupes également, retenons que le bolchevisme représente une menace extrêmement grave qu’il faut éventer par tous les moyens."[4]
Si le SPD illustre de la manière la plus extrême le passage de la social-démocratie dans le camp de la bourgeoisie, notamment dans sa lutte ouverte contre la révolution de Russie, la plupart des autres grands partis socialistes dans le monde ne furent pas en reste. La tactique du Parti socialiste italien a consisté, durant toute la guerre, à freiner la lutte de classes sous couvert d’une position faussement neutre dans le conflit mondial illustrée par le slogan hypocrite "ni saboter, ni participer", ce qui revenait à fouler aux pieds le principe de l’internationalisme prolétarien. En France, à côté de la fraction passée avec armes et bagage dans le camp de la bourgeoisie lors du vote des crédits de guerre, le mouvement socialiste restait gangréné par le centrisme qui ne faisait qu’encourager l’hostilité vis à vis de la révolution d’Octobre et de la fraction bolchevique. Néanmoins, un courant de gauche commençait à se dégager à la fin de l’année 1918 et au début de 1919. Même si la bourgeoisie surfait sur la vague de la victoire pour affermir le sentiment patriotique, le prolétariat français payait surtout l’absence d’un véritable parti marxiste. C’est d’ailleurs ce que faisait remarquer Lénine très lucidement : "la transformation du vieux type de parti européen parlementaire, réformiste à l’œuvre et légèrement coloré d’une teinte révolutionnaire, vraiment communiste, est chose extraordinairement difficile. C’est certainement en France que cette difficulté apparaît le plus nettement."[5]
La social-démocratie sabote et torpille les conseils ouvriers[6]
En Russie, comme dans tous les pays où vont éclore des soviets, les partis socialistes jouèrent un double jeu. D’un côté, ils laissaient croire qu’ils étaient favorables au développement de la lutte émancipatrice des ouvriers à travers les soviets. De l’autre, ils firent tout leur possible pour stériliser ces organes d’auto-organisation de la classe. C’est en Allemagne que cette entreprise prit le plus d'ampleur. En apparence favorables aux conseils ouvriers, les socialistes se révélèrent y être farouchement hostiles. En cela, leur action destructrice au sein des soviets montre bien qu’ils se sont comportés en véritables chiens de garde de la bourgeoisie. La tactique était simple, il s’agissait de saper le mouvement de l’intérieur afin de vider les conseils de leur contenu révolutionnaire. Il s’agissait ainsi de stériliser les soviets en les assujettissant à l’État bourgeois, en faisant en sorte qu’ils se conçoivent comme des organes transitoires jusqu’à la tenue des élections à l’Assemblée nationale. Les conseils devaient également être ouverts à toute la population, à toutes les couches du peuple. En Allemagne par exemple, le SPD créa des "Comité de salut public" accueillant toutes les couches sociales avec des droits identiques.
Par ailleurs, les dirigeants SPD/USPD sabotèrent le travail des soviets depuis le Conseil des commissaires du peuple[7] en imposant d’autres instructions que celles données par le Conseil Exécutif (CE), qui était, lui, une émanation des conseils ouvriers, ou encore en faisant en sorte que celui-ci ne possède pas sa propre presse. Sous majorité SPD, le CE prit même position contre les grèves de novembre et décembre 1918. Cette entreprise de démolition de l’auto-organisation de la classe eut lieu également en Italie entre 1919 et 1920 au moment des grandes grèves puisque le PSI fit tout son possible pour transformer les conseils en vulgaires comités d’entreprise bien incorporés à l’État et appelant à l’autogestion de la production. La gauche du parti mena donc le combat contre cette illusion qui ne pouvait qu’enfermer la lutte des ouvriers dans le périmètre étroit de l’usine : "Nous voudrions éviter que ne pénètre dans les masses ouvrières la conviction qu'il suffit sans plus de développer l'institution des Conseils pour s'emparer des usines et éliminer les capitalistes. Ce serait une illusion extrêmement dangereuse (…) Si la conquête du pouvoir politique n'a pas lieu, les Gardes Royales, les carabiniers se chargeront de dissiper toute illusion, avec tout le mécanisme d'oppression, toute la force dont dispose la bourgeoisie, l'appareil politique de son pouvoir" (A. Bordiga)[8].
Mais la social-démocratie allemande montra son nouveau vrai visage lorsqu’elle assuma directement la répression des grèves ouvrières. En effet, le déploiement d’une intense campagne idéologique en faveur de la République, du suffrage universel, de l’unité du peuple ne suffit pas à détruire la combativité et la conscience du prolétariat. Ainsi, désormais au service de l’État bourgeois, les traîtres du SPD firent alliance avec l’armée pour réprimer dans le sang le mouvement de masse qui prolongeait celui né en Russie et qui mettait en péril l’une des puissances impérialistes les plus développés du monde. Le commandant en chef de l'armée, le général Groener, qui avait collaboré quotidiennement avec le SPD et les syndicats au cours de la guerre en tant que responsable des projets d'armements explique :
- "Nous nous sommes alliés pour combattre le bolchévisme. La restauration de la monarchie était impossible. (...) J'avais conseillé au Feldmaréchal de ne pas combattre la révolution par les armes, parce qu'il était à craindre que compte tenu de l'état des troupes un tel moyen irait à l'échec. Je lui ai proposé que le haut commandement militaire s'allie avec le SPD, vu qu'il n'y avait aucun parti disposant de suffisamment d'influence dans le peuple, et parmi les masses pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était exclu de travailler avec les extrémistes radicaux. Il s'agissait en premier lieu d'arracher le pouvoir des mains des conseils ouvriers et de soldats de Berlin. Dans ce but une entreprise fut prévue. Dix divisions devaient entrer dans Berlin. Ebert était d'accord. (...) Nous avons élaboré un programme qui prévoyait, après l'entrée des troupes, le nettoyage de Berlin et le désarmement des Spartakistes. Cela fut aussi convenu avec Ebert, auquel je suis particulièrement reconnaissant pour son amour absolu de la patrie. (...) Cette alliance fut scellée contre le danger bolchevique et le système des conseils.» (octobre-novembre 1925, Zeugenaussage)[9]
Le gouvernement social-démocrate n’a pas non plus hésité à faire appel à la bourgeoisie d’Europe occidentale dans l’opération de maintien de l’ordre lors les journées cruciales de janvier 1919. De toute façon, celle-ci se faisait un point d’honneur d’occuper Berlin si la révolution sortait victorieuse. Le 26 mars 1919, le premier ministre anglais Lloyd George écrit dans un mémorandum adressé à Clémenceau et Wilson : "Le plus grand péril, dans la situation actuelle réside, selon moi, dans le fait que l’Allemagne pourrait se tourner vers le bolchévisme. Si nous sommes sages, nous offrirons à l’Allemagne une paix, qui, parce qu’elle est juste, sera préférable pour tous les gens raisonnables à l’alternative du bolchévisme."[10] Face au danger de "bolchévisation de l’Allemagne", les principaux chefs politiques de la bourgeoisie ne se montrèrent pas si pressés de désarmer l’ennemi d’hier. Lors d’un débat au sénat sur la question en octobre 1919, Clémenceau ne cachait absolument pas les raisons : "D’abord pourquoi avons-nous accordé à l’Allemagne ces 288 canons ? (...) Parce que l’Allemagne a besoin de se défendre et que nous n’avons pas intérêt à avoir une seconde Russie bolchevique au centre de l’Europe ; c’est assez d’une."[11]
Alors que l’armistice venait à peine d’être signé, le gouvernement des Ebert-Noske- Scheidemann-Erzberger scellait la paix avec les Clémenceau-Lloyd George et Wilson par un pacte militaire dirigé contre le prolétariat allemand. Par la suite, la violence avec laquelle le chien sanglant Noske et ses corps francs se déchainèrent lors de la "semaine sanglante" du 6 au 13 janvier 1919 n’a d’égale que la répression terrible qu’exercèrent les Versaillais contre les Communards lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Comme 38 ans plus tôt, le prolétariat subissait "la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi" (Karl Marx) de la bourgeoisie. Mais le bain de sang de janvier 1919, n’était que le prologue d’un châtiment beaucoup plus terrible qui s’abattit par la suite sur les ouvriers de la Ruhr, d’Allemagne centrale, de Bavière...
La mystification démocratique dans les pays "vainqueurs"
Dans les principaux pays alliés, la victoire sur les forces de la Triple Alliance n’empêcha pas la réaction de la classe ouvrière face à la barbarie que connut l’Europe entre 1914 et 1918. Malgré l’écho retentissant d’Octobre 17 au sein du prolétariat d’Europe de l’Ouest, les bourgeoisies de l’Entente surent instrumentaliser l’issue de la guerre afin de canaliser le développement des luttes du prolétariat entre 1917 et 1927. Alors que la guerre impérialiste est l’expression de la crise générale du capitalisme, la bourgeoisie réussit à faire avaler l’idée que ce n’était qu’une anomalie de l’histoire, que c’était "la der des der", que la société allait retrouver une stabilité et que la révolution n’avait pas lieu d’être. Dans les pays les plus modernes du capitalisme, la bourgeoisie martelait que désormais toutes les classes devaient participer à la construction de la démocratie. L’heure était soi-disant à la réconciliation et non pas aux affrontements sociaux. C’est dans cette optique qu’en février 1918, les parlementaires anglais adoptèrent le Representation of the People Act qui élargissait les effectifs électoraux et octroyait le droit de vote aux femmes de plus de trente ans. Dans un contexte où les luttes sociales faisaient rage en Grande-Bretagne, la bourgeoisie la plus expérimentée du monde, avec beaucoup d’habileté, tentait de détourner la classe ouvrière de son terrain de classe. Comme l’affirmait à l’époque Sylvia Pankhurst, cette habile manœuvre était en grande partie imposée par la menace d’une propagation de la révolution d’Octobre dans les pays occidentaux : "Les événements de Russie ont suscité une réponse à travers le monde, pas seulement parmi la minorité qui était favorable à l’idée du Communisme des Conseils, mais aussi parmi les tenants de la réaction. Ces derniers étaient parfaitement conscients de la croissance du soviétisme lorsqu’ils ont décidé de jouer la carte de la vieille machine parlementaire en accordant à certaines femmes à la fois le droit de vote et le droit d’être élues". (La menace ouvrière, 15 décembre 1923).[12]
Par ailleurs, la bourgeoisie sut très bien instrumentaliser l’issue de la guerre en jouant sur la division entre pays vainqueurs et pays vaincus afin de briser la dynamique de généralisation des luttes. Par exemple, à la suite de la dislocation de l’empire austro-hongrois, le prolétariat des différentes entités territoriales dut subir la propagande des luttes de libération nationale. De la même manière dans les pays vaincus il fut cultivé un état d’esprit revanchard parmi le prolétariat. Dans les pays vainqueurs, même si le prolétariat aspirait majoritairement à la tranquillité après quatre années de guerre, les nouvelles de Russie n’étaient pas accueillies sans provoquer un nouvel élan de combativité en France ou en Grande Bretagne notamment. Mais cet élan fut canalisé par la digue du chauvinisme et le battage de la victoire de la civilisation contre les "sales boches". Face à la dégradation des conditions de vie, consécutive à la poussée de la crise à partir des années 1920, des luttes ouvrières éclatèrent cependant en Angleterre, en France, en Allemagne ou encore en Pologne. Mais ces mouvements violemment réprimés pour la plupart n’étaient en fait que les derniers soubresauts de la vague révolutionnaire qui allait connaître ses dernières convulsions lors de la répression terrible des ouvriers de Shanghai et de Canton en 1927.[13] La bourgeoisie avait donc réussi à coordonner ses forces afin de finir d’étouffer et de réprimer les derniers bastions de la vague révolutionnaire. Par conséquent, comme nous l’avons déjà mis en évidence il faut reconnaître que la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation de la révolution. En effet, la crise économique mondiale telle qu’elle se déploie depuis les années 60 semble être une base matérielle beaucoup plus valable pour la révolution mondiale étant donné qu’elle touche tous les pays sans exception et qu’elle ne peut être stoppée contrairement à la guerre impérialiste. Les partis socialistes eurent un rôle central dans la promotion de la démocratie et du système républicain et parlementaire présentés comme un pas en avant sur le chemin de la révolution. En Italie, dès 1919, le PSI prôna sans ambiguïté la reconnaissance du régime démocratique en poussant les masses à aller voter aux élections de 1919. Circonstance aggravante, le succès électoral qui s’en suivit fut approuvé par l’Internationale Communiste. Or, une fois aux commandes, les socialistes gérèrent l’État comme une quelconque fraction bourgeoise. Dans les années suivantes, les thèses antifascistes propagées par Gramsci et les ordinovistes dirigeaient ni plus ni moins la classe ouvrière italienne vers l’interclassisme. Considérant que le fascisme exprimait une dérive et une particularité de l’histoire italienne, Gramsci prônait la mise en place de l’Assemblée constituante, étape intermédiaire entre le capitalisme italien et la dictature du prolétariat. Selon lui, "une classe à caractère international doit, en un certain sens, se nationaliser". Il fallait donc que le prolétariat fasse alliance avec la bourgeoisie au sein d’une assemblée nationale constituante où les députés de "toutes les classes démocratiques du pays" élus au scrutin universel, élaboreraient la future constitution italienne. Lors du Ve congrès mondial, Bordiga répondit à ces errements qui amenaient le prolétariat à quitter son terrain de classe au nom des illusions démocratiques : "Nous devons repousser l’illusion selon laquelle un gouvernement de transition pourrait être naïf au point de permettre qu’avec des moyens légaux, des manœuvres parlementaires, des expédients plus ou moins habiles, on fasse le siège des positions de la bourgeoisie, c’est à dire qu’on s’empare légalement de tout son appareil technique et militaire pour distribuer tranquillement les armes aux prolétaires. C’est là une conception véritablement infantile ! Il n’est pas si facile de faire une révolution !" [14]
II- Les campagnes de calomnie accompagnent la répression sanglante
Une propagande organisée au sommet des États
- "Parallèlement à la préparation militaire de la guerre civile contre la classe ouvrière, on procédait à la préparation idéologique" (Paul Frölich). En effet, très tôt, dans les semaines et les mois qui suivent la révolution en Russie, la bourgeoisie s’employa à réduire l’événement à la prise du pouvoir par une minorité qui aurait détourné la volonté des masses et mènerait la société au désordre et au chaos. Mais cette intense campagne de propagande antibolchevique et anti-spartakiste n’est pas l’entreprise de quelques individualités zélées et déterminées à jouer les chiens de garde de la classe dominante mais d’une politique de toutes les fractions de la grande bourgeoisie pilotée dans les plus hautes sphères des appareils d’État. Comme nous l’avons développé dans un article de la Revue Internationale n°155, la Première Guerre mondiale fut un moment déterminant dans la prise en charge massive, par l’État, de l’information à travers la propagande et la censure. Le but était clair, peser idéologiquement sur les populations pour assurer la victoire dans cette guerre totale. Avec l’ouverture de la période révolutionnaire, le but de la propagande étatique était tout aussi limpide : peser sur les masses pour faire en sorte qu’elles s’éloignent des organisations du prolétariat et assurer la victoire de la contre-révolution. Les grands industriels allemands se montrèrent les plus déterminés et cassèrent leur tirelire pour la "bonne cause" de l’ordre bourgeois. Grâce à la dotation de quelques milliers de marks du banquier Helfferich et du politicien Friedrich Naumann, est fondé un "Secrétariat général sur l’étude et le combat du bolchévisme" le 1er décembre 1918 à Berlin. Le 10 janvier, son fondateur, un certain Stadtler, rassemble près de 50 industriels allemands afin de leur exposer ses vues. De suite après, Hugo Stinnes, l’un des plus grands magnats de l’industrie allemande galvanise les troupes en hauts de forme : "je suis d’avis qu’après cet exposé toute discussion est superflue. Je partage entièrement le point de vue de l’orateur. Si le monde de l’industrie, du commerce et de la banque n’a pas la volonté et n’est pas en mesure de verser une prime d’assurance de 500 millions de marks pour nous prémunir contre le danger qu’on vient de nous révéler, nous ne méritons pas qu’on nous considère comme les représentants de l’économie allemande. Je demande qu’on déclare close cette séance et prie messieurs Mankiewitz, Borsig, Siemens, Deutsch, etc., etc. (il cita à peu près huit noms) de passer avec moi dans la pièce à côté pour que nous nous mettions d’accord immédiatement sur un mode de répartition de cette contribution."[15]
Avec ces centaines de millions de marks de subventions, plusieurs officines purent voir le jour afin de mener la campagne antirévolutionnaire. La Ligue antibolchevique (l’ancienne Association du Reich contre la social-démocratie) fut certainement la plus active pour cracher son venin sur les révolutionnaires de Russie et d’Allemagne par la diffusion de millions de tracts, d’affiches, de brochures ou l’organisation de meetings. Cette première officine faisait partie d’un des deux centres contre-révolutionnaires avec le Bürgerrat et l’hôtel Eden où siégeait le quartier général de la division de fusiliers de cavalerie de la garde.
L’organisation de propagande "Construire et devenir, société pour l’éducation du peuple et pour l’amélioration des forces nationales du travail", fondée par Karl Erdmann fut directement financée par Ernst Von Borsig et Hugo Stinnes. Ce dernier, subventionna par ailleurs la presse nationaliste et les partis d’extrême-droite pour mener la propagande contre les spartakistes et les bolchéviques.
Mais dans la plupart des cas, la social-démocratie fut le maitre d’œuvre dans la manipulation de l’opinion au sein de la classe ouvrière. Comme le relate Paul Frölich, "cela commença par la diffusion de discours insipides célébrant la victoire de la révolution de novembre. Suivirent les promesses, les mensonges, les réprimandes et les menaces. L’Heimatdienst, une institution créée pendant la guerre pour manipuler l’opinion publique, diffusa des centaines de millions de tracts, opuscules et affiches, le plus souvent rédigés par les sociaux-démocrates, en soutien à la réaction. Déformant sans pudeur la signification des révolutions précédentes et les enseignements de Marx, Kautsky y proclamait son indignation vis-à-vis de la "prolongation de la révolution". On faisait du "bolchévisme" un épouvantail pour enfant. Ce concert aussi fut dirigé par les sociaux-démocrates, ces mêmes gentilshommes qui pendant la guerre avaient acclamé, dans les colonnes de leurs journaux, les bolcheviks (décrits comme fidèles disciples de la pensée de Marx) parce qu’ils pensaient alors que les luttes révolutionnaires russes aideraient Ludendorff et compagnie à vaincre définitivement les puissances occidentales. Maintenant, au contraire, ils diffusaient d’affreuses histoires sur les bolcheviks, allant jusqu’à faire circuler de faux "documents officiels" selon lesquels les révolutionnaires russes avaient mis les femmes en commun."[16]
Les révolutionnaires réduits à l’état de sauvages sanguinaires
Dès lors, les forces révolutionnaires qui défendaient l’internationalisme prolétarien furent les principales cibles, tout particulièrement après la prise du pouvoir par les ouvriers de Russie en Octobre 1917. Consciente du danger que pouvait faire peser l’extension de la révolution pour le capital mondial, les États les plus développés mirent en œuvre une véritable campagne de calomnie contre les bolchéviques afin d’écarter tout sentiment de sympathie et toute tentative de fraternisation. Lors des élections de 1919, la bourgeoisie française profita de l’occasion pour axer la campagne sur le "péril rouge" en alimentant la diabolisation de la révolution et des bolchéviques. Georges Clémenceau, l’un des grands acteurs de la contre-révolution fut particulièrement actif puisqu’il fit campagne sur le thème de "l’union nationale" et de la "menace du bolchévisme". Une brochure et une affiche célèbre intitulées "Comment lutter contre le bolchévisme ?" dressaient même le portrait du bolchevik, semblable à une bête, les cheveux hirsutes et un couteau entre les dents. Tout ceci contribuait à assimiler la révolution prolétarienne à une entreprise barbare et sanguinaire. Lors du congrès de fondation de l’Internationale Communiste, George Sadoul rendait compte de l’ampleur des calomnies déversées par la bourgeoisie française : "Lorsque j’ai quitté la France en septembre 1917, c’est-à-dire quelques semaines avant la Révolution d’Octobre, l’opinion publique en France tenait le bolchévisme pour une grossière caricature du socialisme. Les leaders du bolchévisme étaient considérés comme des criminels ou comme des fous. L’armée des bolcheviks n’était à ses yeux qu’une horde composée de quelques milliers de fanatiques et de criminels. (...) Je dois vous avouer à ma grande confusion que les neuf dixièmes des socialistes de la majorité comme de la minorité étaient du même avis. Nous pourrions alléguer comme circonstances atténuantes, d’une part notre parfaite ignorance des évènements russes, d’autre part toutes les calomnies et les faux documents propagés par la presse de toutes tendances sur la cruauté, la félonie et la traitrise des bolcheviks. La prise du pouvoir par cette "bande de brigands" produisit en France un effet de choc. La calomnie qui nous empêchait d’apercevoir la vraie figure du communisme devint encore plus noire lors de la signature de la paix de Brest. La propagande anti-bolchévique atteignit alors son apogée."
Bien que les gouvernements de la Triple Entente aient pu jouer sur l’élan de la victoire pour calmer le mécontentement au sein de la classe ouvrière, ils se devaient également de détourner toutes les velléités révolutionnaires vers le chemin des urnes. La bourgeoisie se montrait sous son vrai visage, vile, manipulatrice, menteuse ! L’anti-bolchévisme véhiculé par la presse, les médias et le monde universitaire depuis plusieurs décennies prend donc racine très tôt, au cours de la vague révolutionnaire, dans les plus hautes sphères des appareils étatiques. En effet, l’offensive militaire aux frontières russes, la répression sanglante de la classe ouvrière allemande en janvier 1919 devaient s’accompagner inexorablement d’une intense campagne de propagande afin de détourner l’élan de sympathie grandissant envers la révolution prolétarienne auprès des couches exploitées du monde entier. Parmi, les multiples affiches de propagande contre-révolutionnaires produites en France, en Angleterre ou en Allemagne, les principales cibles demeuraient les organisations politiques du prolétariat rendues responsables du chômage, de la guerre, de la faim et régulièrement accusées de semer le désordre et le crime[17]. Comme le résume P. Frölich, "les affiches dans la rue représentaient le bolchévisme comme un fauve la gueule grande ouverte, prêt à mordre".
L’appel à tuer l’avant-garde du prolétariat
Dès novembre 1918, la bourgeoisie allemande fit de Spartacus la cible à abattre. Il s’agissait de neutraliser l’influence de l’organisation auprès des masses. Pour ce faire, elle s’employa à l’accuser de tous les maux, Spartacus devint le bouc-émissaire, considéré comme une vraie peste pour l’ordre social et le capital allemand. Il fallait le faire disparaître. Le tableau que dépeint Paul Frölich, dix ans après les évènements est édifiant :
- "Tout délit commis dans les grandes villes n’avait qu’un seul coupable : Spartacus ! Les spartakistes étaient accusés de tous les vols. Des délinquants en uniforme, protégés par des documents officiels, vrai ou faux, surgissaient dans les habitations, fracassant et pillant tout : c’était Spartacus qui les envoyait ! Toute souffrance, tout danger menaçant n’avait qu’une seule origine : Spartacus ! Spartacus, c’est l’anarchie, Spartacus, c’est la famine, Spartacus, c’est la terreur !"[18] L’ignominie de la social-démocratie et de toute la bourgeoisie allemande alla même plus loin, puisque le Vorwärts[19] organisa une véritable campagne de dénigrement et de haine contre Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg et d’autres militants influents de la Ligue Spartacus : "Karl Liebknecht, un certain Paul Lévi et l’impétueuse Rosa Luxemburg, qui n’ont jamais travaillé à un étau ou à un tour, sont en train de ruiner nos rêves et ceux de nos pères. (...) Si la clique spartakiste veut nous bannir, nous et notre avenir, alors que Karl Liebknecht et compagnie soient eux aussi bannis !"
Au discours de haine succéda l’organisation d’une véritable chasse aux révolutionnaires. La Ligue pour la lutte contre le bolchévisme promettait d’offrir 10 000 marks pour la capture de Karl Radek ou pour des informations pouvant conduire à son arrestation. Mais les cibles principales restaient Liebknecht et Luxemburg. En décembre 1918, un manifeste placardé sur les murs de Berlin n'appelait rien de moins qu’à les assassiner. Son contenu donnait le ton du degré de violence avec lequel la social-démocratie s’acharnait sur Spartacus : "Travailleur, citoyen ! La patrie est au bord de la ruine. Sauvez-là ! La menace ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur : du groupe Spartacus. Frappez leur chef ! Tuez Liebknecht ! Et vous aurez paix, travail et pain ! Les soldats du front." Un mois avant, le conseil des soldats de Steglitz (une petite ville du Brandebourg) avait menacé Liebknecht et Luxemburg que les soldats tireraient à vue s’ils se présentaient dans une caserne pour prononcer "des discours incendiaires." La presse bourgeoise diffusait en réalité une véritable atmosphère de pogrom, "elle chantait les murs éclaboussés de la cervelle des fusillés. Elle transformait toute la bourgeoisie en une horde assoiffée de sang, ivre de dénonciations, qui traînait les suspects (des révolutionnaires et d’autres, parfaitement inoffensifs) devant les fusils des pelotons d’exécutions. Et tous ces hurlements culminaient en un seul cri de meurtre : Liebknecht, Luxemburg !"[20] La palme de l’ignominie peut être décernée au Vorwärts qui, le 13 janvier, publiait un poème qui faisait passer les principaux membres de Spartacus pour des déserteurs, des lâches qui trahissaient le prolétariat allemand et qui ne méritaient que la mort :
"Des centaines de morts en une seule série –
Prolétaires !
Karl, Radek, Rosa et compagnie –
Pas un d’entre eux n’est ici !
Prolétaires !"
Nous savons tous que ces calomnies ont malheureusement eut des effets sordides puisque le 15 janvier 1919, Karl et Rosa, ces deux grands militants de la cause révolutionnaire étaient assassinés par les corps francs. Le récit totalement mensonger que le Vorwärts fit de ces crimes illustrait à lui seul la mentalité de la bourgeoisie, cette classe "pitoyable et lâche" comme le soulignait déjà Karl Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. D’après les journaux du 16 janvier au soir, Liebknecht aurait été tué lors d’une tentative d’évasion et Rosa Luxemburg lynchée par la foule. Comme le rapporte Paul Frölich, le commandant de la division de fusiliers de cavalerie de la garde, dont dépendaient les deux exécutants des deux meurtres, diffusa un communiqué qui falsifiait totalement le déroulement des évènements et qui fut repris par toute la presse. Tout ceci "donnant libre cours à un écheveau de mensonges, de manœuvres de dépistage et de violations de la loi qui fournira la trame d’une honteuse série de comédies interprétées par la magistrature."[21]
Au prix d’un travail acharné, toutes ces affabulations furent battues en brèche par Léo Jogiches qui, en collaboration avec une commission d’enquête créée par le conseil central et le conseil exécutif de Berlin, rétablit la vérité en mettant au jour le déroulement de ces crimes et en publiant la photographie du festin des meurtriers après leurs crimes. Il signait là son propre arrêt de mort ! Le 10 mars 1919, il était arrêté et assassiné dans la prison de la préfecture de police de Berlin. Un "simulacre de justice" eut lieu qui permit de percer la vérité malgré les intimidations et la corruption. Quant aux coupables, ils s’en sortirent par des acquittements ou de courtes peines de prison.
Hier, Rosa Luxemburg était cette sorcière rouge dévoreuse de "bons petites allemands", aujourd’hui, c’est la "bonne démocrate", "l’anti-Lénine", ce "dangereux révolutionnaire" et "l’inventeur du totalitarisme". La classe dominante n’est pas à une contradiction près, et puis, il faut bien le dire, les deux faces de son discours sur Rosa Luxemburg ne constituent pas à proprement parler une contradiction. C'est une nouvelle illustration de ce que la bourgeoisie fait de la mémoire des grands personnages qui ont osé défier son monde "sans cœur et sans esprit" : "Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d’oppresseurs les récompensent par d’incessantes persécutions ; elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d’en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d’entourer leur nom d’une certaine auréole afin de “consoler” les classes opprimées et de les mystifier ; ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu, on l’avilit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. C’est sur cette façon d’“accommoder” le marxisme que se rejoignent aujourd’hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier". (Lénine, L’État et la Révolution).
III- Le stalinisme, véritable bourreau de la révolution
L’échec de la vague révolutionnaire fait le lit de Staline
L’écrasement sanglant de la révolution en Allemagne a été un coup terrible pour le prolétariat mondial. Comme Lénine et Rosa Luxemburg l’affirmaient, le salut de la révolution à l’échelle mondiale dépendait de la capacité des ouvriers des grandes puissances capitalistes à s’emparer du pouvoir dans leur propre pays. Autrement dit, l’avenir de l’humanité dépendait de l’extension de la vague révolutionnaire qui avait commencé en Russie. Or, ce déferlement n’a pas eu lieu. L’échec du prolétariat en Allemagne, en Hongrie, en Italie sonnait le glas de la révolution en Russie, une mort par asphyxie car n’ayant plus en son sein un souffle suffisant pour donner de l’élan aux ouvriers du monde entier. C’est dans cette agonie "qu’intervient précisément le stalinisme, en totale rupture avec la révolution lorsqu’après la mort de Lénine, Staline s’empare des rênes du pouvoir et, dès 1925, met en avant sa thèse de "la construction du socialisme en un seul pays" grâce à laquelle va s’installer dans toute son horreur la contre-révolution".[22]
Mais voilà, depuis des décennies, historiens, journalistes et autres commentateurs en tout genre falsifient l’histoire en essayant de trouver une continuité entre Lénine et Staline, et alimentent le mensonge selon lequel le communisme est l’égal du stalinisme. Or, dans les faits, un abîme se dresse entre d'une part Lénine et les bolcheviks et, d'autre part, le stalinisme.
L’État qui surgit après la révolution échappait de plus en plus à la classe ouvrière et absorbait progressivement le parti bolchévique où le poids des bureaucrates devenait prépondérant. Staline était le représentant de cette nouvelle couche de gouvernants dont les intérêts étaient en totale opposition avec le salut de la révolution mondiale. La thèse du "socialisme dans un seul pays" servit justement à justifier la politique de cette nouvelle classe bourgeoise en Russie consistant à se replier sur l’économie nationale et l’État, garant du statu quo et du mode de production capitaliste. Lénine n’a jamais défendu de telles positions. Bien au contraire, il a toujours défendu l’internationalisme prolétarien, considérant ce principe comme une boussole permettant au prolétariat de ne pas s’égarer sur le terrain de la bourgeoisie. Bien qu’il ne pouvait pas anticiper ce que serait le stalinisme, dans les dernières années de sa vie, Lénine était conscient de certains dangers qui guettaient la révolution et notamment la difficulté à enrayer l’attraction conservatrice de l’État sur les forces révolutionnaires. Même s’il fut incapable de s’y opposer, il mit en garde contre la gangrène bureaucratique sans pour autant trouver une solution à un problème de toute manière inéluctable. De même, Lénine se méfiait beaucoup de Staline et était hostile à ce que ce dernier obtienne des charges importantes. Dans son "testament" du 4 janvier 1923, il tentait même de l’écarter du poste de secrétaire général du parti où Staline était "en train de concentrer un pouvoir énorme dont il abuse de façon brutale". Une tentative vaine puisque Staline contrôlait déjà la situation. [23]
Comme nous le mettions en évidence dans notre brochure L’Effondrement du stalinisme : "C'est sur les décombres de la révolution de 1917 que le stalinisme a pu asseoir sa domination. C'est grâce à cette négation la plus radicale du communisme constituée par la doctrine monstrueuse du "socialisme en un seul pays" totalement étrangère au prolétariat et à Lénine que l'URSS est redevenue non seulement un État capitaliste à part entière mais aussi un État où le prolétariat a été soumis plus brutalement et plus férocement qu'ailleurs aux intérêts du capital national rebaptisés "intérêts de la patrie socialiste".24]
L’URSS : un État bourgeois impérialiste contre la classe ouvrière
Une fois au pouvoir, Staline voulait donc s’y maintenir. À la fin des années 20, il détenait entre ses mains tous les leviers de commande de l’appareil d’État soviétique. Nous avons démontré, dans l’un des premiers articles produits sur la Révolution en Russie, le processus ayant mené à la dégénérescence de la révolution et à l’émergence d’une nouvelle classe dominante faisant de ce pays un État capitaliste à part entière[25].
Ainsi, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques n’avait de "soviétique" que le nom !
- "Non seulement le mot d'ordre de toute la période révolutionnaire : "Tout le pouvoir aux soviets" est abandonné et banni, mais la dictature du prolétariat, à travers le pouvoir des conseils ouvriers qui avait été le moteur et l'âme de la révolution et qui révulse et chagrine si fort nos chers "démocrates" d'aujourd'hui, (...) est totalement détruite et devient une coquille vide de sens, laissant la place à une implacable dictature du parti-État sur le prolétariat."[26]
Le stalinisme étant le produit de la dégénérescence de la révolution, il n’a jamais appartenu à un autre camp que celui de la contre-révolution. D’ailleurs, il a trouvé sa place pleine et entière dans le grand concert des nations bourgeoises précisément pour cette raison. Parce qu’il était une force magistrale pour mystifier la classe ouvrière en lui faisant croire que le communisme existait bel et bien à l’Est de l’Europe, que sa progression était momentanément ralentie, et que sa victoire totale reposait sur le soutien des ouvrières du monde entier à la ligne politique décidée par Moscou. Cette grande illusion était bien évidemment entretenue par tous les partis communistes du monde entier. Afin de relayer le mensonge à grande échelle, Moscou et les PC nationaux organisaient notamment les fameux voyages en Union soviétique des délégations ouvrières, un séjour au cours duquel on montrait tous les "fastes" du régime aux "touristes politiques" qui étaient par la suite mandatés pour prêcher la bonne parole dans leurs usines et leurs cellules à leur retour. Voici comment Henri Guilbeaux décrivait cette mascarade : "Lorsque l’ouvrier va en Russie il est soigneusement sélectionné, il ne peut s’y rendre d’ailleurs qu’en groupe. On le prend parmi les membres du Parti, mais on choisit aussi dans les syndicats et dans le parti socialiste, des éléments dits "sympathisants", très influençables et dont il sera facile de "bourrer le crâne". Les délégués ainsi "élus" forment une délégation ouvrière. Arrivés en Russie, les délégués sont reçus officiellement, pilotés, choyés, fêtés. Partout ils sont accompagnés de guides, de traducteurs. On leur fait des cadeaux. (...) Où qu’ils aillent, on leur dit : "Ceci appartient aux ouvriers. Chez nous, ce sont les ouvriers qui dirigent". Dès leur retour, les délégués ouvriers qu’on a repérés comme étant les plus capables de dire du bien de l’URSS sont montés en épingles. On les invite à venir raconter leurs impressions dans des réunions publiques."[27]
Ces séjours de décervelage politique n’avaient pour seul objectif que d’entretenir le mythe du "socialisme dans un seul pays" ; véritable falsification du programme défendu par le mouvement révolutionnaire. Car dès ses origines, celui-ci se présente comme un mouvement international dans la mesure où, comme l’écrivait Engels en 1847, l’offensive politique de la classe ouvrière contre la classe dominante s’effectue d’emblée à l’échelon mondial : "La révolution communiste (...) ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés (...) Elle exercera également sur tous les autres pays du globe une répercussion considérable et elle transformera complètement et accélérera le cours de leur développement. Elle est une révolution universelle ; elle aura, par conséquent, un terrain universel.[28]
Le socialisme dans un seul pays signifiait la défense du capital national et la participation au jeu impérialiste. Cela signifiait également la dissipation de la vague révolutionnaire. Dans ces conditions, Staline devint un homme respectable aux yeux des démocraties occidentales, désormais soucieuses de faciliter l’insertion de l’URSS dans le monde capitaliste. Alors que la bourgeoisie mondiale n’avait pas hésité à établir un cordon militaire autour de la Russie au moment de la révolution. Celle-ci changea radicalement de politique une fois le danger dissipé. D’ailleurs, suite à la crise de 29, l’URSS devint un enjeu central et toute la bourgeoisie occidentale tenta de s’attirer les bonnes grâces de Staline. C’est ainsi, qu’elle intégra la Société des Nations en 1934 et qu’un pacte de sécurité mutuelle fut signé entre Staline et Laval, le ministre des affaires étrangères français, dont le communiqué du lendemain illustrait la politique antiouvrière de l’URSS : "Monsieur Staline comprend et approuve pleinement la politique de défense nationale faite par la France pour maintenir sa force armée au niveau de sa sécurité". Comme nous le mettions en évidence dans notre Brochure L’effondrement du stalinisme: "C'est cette politique d'alliance avec l'URSS qui va permettre, au lendemain du pacte Laval-Staline, la constitution du "Front Populaire" en France, signant la réconciliation du PCF avec la social-démocratie pour les besoins du capital français dans l'arène impérialiste : Staline s'étant prononcé en faveur de l'armement de la France, du coup, le PCF vote à son tour les crédits militaires et signe un accord avec les radicaux et la SFIO."
La terreur stalinienne ou la liquidation de la vieille garde du parti bolchevik
L’ensemble de la bourgeoisie a compris que Staline était l’homme de la situation, celui qui allait éradiquer les derniers vestiges de la révolution d’Octobre 1917. D’ailleurs, les démocraties se montrèrent plus bienveillantes à son égard lorsqu’il a commença à briser et à exterminer la génération de prolétaires et de révolutionnaires qui avait participé à la révolution d’Octobre 1917. La liquidation de la vieille garde du parti bolchevik exprimait la détermination de Staline à éviter toute forme de conjuration autour de lui afin de consolider son pouvoir ; mais elle permit également de porter un coup à la conscience du prolétariat du monde entier en le poussant à prendre la défense de l’URSS contre les prétendus traîtres à la cause révolutionnaire.
Dans ces conditions, les démocraties européennes n’ont pas hésité à soutenir et à participer à cette entreprise macabre. Si celles-ci se montraient très enthousiastes lorsqu’il s’agissait de brailler de belles formules sur les Droits de l’Homme, elles étaient beaucoup moins disposées à accueillir et protéger les principaux membres de l’Opposition ouvrière, à commencer par Trotsky son principal représentant. Après avoir été expulsé de Russie en 1928, ce dernier est accueilli par la Turquie hostile au bolchévisme, qui, de mèche avec Staline, le laisse pénétrer sur le territoire sans passeport à la merci des résidus de Russes blancs bien décidés à lui faire la peau. L’ancien chef de l’armée rouge échappa à plusieurs tentatives de meurtres. Son chemin de croix se poursuivit après avoir quitté la Turquie lorsque toutes les démocraties d’Europe occidentale, en accord avec Staline, refusèrent de lui accorder le droit d’asile ; "pourchassé par les assassins à la solde de Staline ou des vestiges des armées blanches, Trotsky sera ainsi condamné à errer d'un pays à l'autre jusqu'au milieu des années 30, le monde entier étant devenu pour l'ancien chef de l'Armée Rouge une "planète sans visa"".[29] La social-démocratie s’avéra d’ailleurs la plus zélée à servir Staline. Entre 1928 et 1936, tous les gouvernements occidentaux collaborent avec lui et ferment leurs frontières à Trotsky ou, comme en Norvège, le mettent en résidence surveillée en lui interdisant toute activité politique et toute critique envers Staline. Autre exemple, en 1927, Christian Rakovski, ambassadeur de l’URSS à Paris, est rappelé à Moscou suite à la demande du gouvernement français le considérant comme "persona non grata" après qu’il ait signé la plateforme de l’Opposition de gauche. La "patrie des droits de l’homme et du citoyen" le livrait ignoblement à ses bourreaux et portait sa pierre à l’édifice des grandes purges staliniennes alors qu’aujourd’hui ces mêmes démocraties et leurs intellectuels de pacotille les dénoncent à cor et à cri afin de faire oublier qu’elles ont elles-mêmes participé à ces assassinats.
Pour tous les oppositionnels, les "grandes démocraties" n’étaient rien d’autre que les antichambres des couloirs de la mort staliniens ou les terrains de jeu des agents du Guépéou, autorisés à pénétrer sur leurs territoires pour massacrer les opposants. De même, la presse occidentale relayait la campagne de calomnie désignant les accusés comme des agents d’Hitler, elle justifiait également les purges et les condamnations en s’appuyant, sans les remettre en doute, sur les procès-verbaux des séances du tribunal. Bien évidemment, les partis communistes, suintant de zèle, allaient le plus loin dans la calomnie et la justification de tels simulacres de justice. Après la condamnation des seize accusés du premier procès, le comité central du PCF et les cellules de plusieurs usines votèrent des résolutions pour approuver l’exécution de ces "terroristes trotskistes". Le journal L’Humanité, se distingua également en appelant au meurtre des "hitléro-trotskistes". Mais la célébration la plus immonde de la terreur stalinienne reste peut-être L’hymne à la Guépéou, ce simulacre de poème écrit par Louis Aragon[30] en 1931 qui, après avoir été poète dans sa jeunesse devint un prédicateur stalinien qui ne cessa, jusqu’à son dernier souffle, de chanter des louanges à Staline et à l’URSS!
Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Smirnov, Evdokimov, Sokolnikov, Piatakov, Boukharine, Radek... pour ne citer que les condamnés les plus connus. Bien que certains se soient plus ou moins compromis dans la stalinisation, tous ces combattants du prolétariat incarnaient l’héritage d’Octobre 1917. En les liquidant, Staline assassinait un peu plus la révolution ; car derrière la farce de ces procès se cachait la tragédie de la contre-révolution. Ces grandes purges, loin d’exprimer l’épuration de la société pour "la construction du socialisme", marquaient un nouvel assaut contre la mémoire et la transmission des legs du mouvement révolutionnaire.
Alimenté ou discrédité, le mythe du communisme en Union soviétique a toujours été instrumentalisé par la bourgeoisie contre la conscience du prolétariat. Si on avait pu penser que l’éclatement du bloc de l’Est entre 1989 et 1991 allait entraîner dans sa chute cette grande supercherie, il n’en fut rien. Bien au contraire, l’assimilation du stalinisme au communisme n’a fait que se renforcer lors des trente dernières années, bien qu’au sein des minorités révolutionnaires le stalinisme soit reconnu comme le pire produit de la contre-révolution.
Conclusion
Cent ans après les évènements, le spectre de la Révolution d’Octobre 1917 hante encore la bourgeoisie. Et pour tenter de se prémunir contre un nouvel épisode révolutionnaire qui ferait vaciller son monde, elle s’acharne à enterrer la mémoire historique du prolétariat. Pour cela, son intelligentsia s’attelle inlassablement à réécrire l’histoire jusqu’à ce que le mensonge prenne l’apparence d’une vérité.
Dès lors, face à la propagande de la classe dominante, le prolétariat doit se replonger dans l’histoire de la classe et s’efforcer de tirer les leçons des épisodes passés. Il doit également se questionner, et nous espérons que cet article donnera matière à réflexion, sur les raisons qui poussent la bourgeoisie à dénigrer de manière toujours plus infâme l’un des évènements les plus glorieux de l’histoire de l’humanité, ce moment où la classe ouvrière a démontré qu’il était possible d’envisager une société où prendrait fin l’exploitation de l’homme par l’homme.
Narek, (27 janvier 2019).
[1] Voir notamment la brochure de Rosa Luxemburg sur la Révolution russe.
[2] Voir P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J.Walter, Révolution et Contre-révolution en Allemagne (1918-1920), Editions Science Marxiste, 2013.
[3] Cité dans P. Frölich, Op. Cit., p 25.
[4] Cité dans P. Frölich, Op. Cit., p 26.
[5] Cité dans Annie Kriegel, Aux origines du Communisme français, Flammarion, 1978.
[6] Pour une approche plus complète voir l’article "Révolution en Allemagne : Les débuts de la révolution (II)", Revue Internationale n°82.
[7] Le Conseil des commissaires du peuple était rien de plus que le nom pris par le nouveau gouvernement le 10 novembre 1918 composé par Ebert, Scheidemann et consorts. Cette appellation permettait de donner quelque peu l’illusion que les dirigeants du SPD étaient favorables aux conseils ouvriers et au développement de la lutte de classes en Allemagne.
[8] Cité dans "Révolution et contre-révolution en Italie (1919-1922). 1ère partie." Revue Internationale n°2.
[9] Cité dans "Révolution en Allemagne : Les débuts de la révolution (II)", Revue Internationale n°82.
[10] Cité dans Gilbert Badia, Les Spartakistes. 1918 : l’Allemagne en révolution, Editions Aden, 2008, p 296.
[11] Cité dans Ibidem, p 298.
[12] Voir l’article paru dans ICC online : "Campagne idéologique autour des "suffragettes" : droit de vote ou communisme ?"
[13] Voir l’article "Enseignements de 1917-1923 : la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial" dans Revue Internationale n°80.
[14] "Révolution et contre-révolution en Italie. Partie II : Face au fascisme" Revue Internationale n°3
[15] Cité dans G. Badia, Op. Cit., p 286.
[16] Cité dans P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, Révolution et contre-révolution en Allemagne. 1918-1920. De la fondation du Parti communiste au putsch de Kapp, Editions Science marxiste, 2013.
[17] Voir notre article "Naissance de la démocratie totalitaire", Revue Internationale n° 155.
[18] P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, Op. Cit., p 45.
[19] Le principal organe de presse du SPD.
[20] P. Frölich, Rosa Luxemburg, L’Harmattan, 1991, p 364.
[21] P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, Op. Cit., p 137.
[22] Brochure du CCI L’effondrement du stalinisme.
[23] Brochure du CCI : L’effondrement du stalinisme.
[24] Brochure du CCI : L’effondrement du stalinisme.
[25] "La dégénérescence de la révolution russe (Réponses au "Revolutionary Worker’s Group")", Revue Internationale n°3.
[26] Brochure du CCI : L’effondrement du stalinisme.
[27] H. Guilbeaux, La fin des soviets, Société française d’éditions littéraires et techniques, 1937, p 86.
[28] Dans "Principes du Communisme".
[29] Brochure du CCI : L’effondrement du stalinisme.
[30] Poète, romancier et journaliste français. Il adhère au PCF en 1927 et ne le quittera pas jusqu’à sa mort. Il est resté fidèle à Staline et au stalinisme toute sa vie et a approuvé les procès de Moscou.
Conscience et organisation:
Approfondir:
Rubrique:
Revue Internationale n°163
- 230 lectures
Présentation de la Revue N°163
- 69 lectures
Trente ans après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est, le monde s'enfonce à un rythme accéléré dans la misère, le chaos et la barbarie. Deux évènements de la situation internationale viennent en témoigner : une série de révoltes populaires dans des pays parmi les plus exposés à l'aggravation de la crise économique mondiale et un rebondissement récent dans l'équilibre des forces impérialistes en Syrie qui laisse présager de futurs développements du chaos guerrier mondial. Ces deux évènements sont traités respectivement dans deux articles de notre Revue.
Le premier article, "Face à la plongée dans la crise économique mondiale et la misère, les "révoltes populaires" constituent une impasse", fait état de mobilisations, souvent très massives au Chili, en Équateur, en Haïti, en Irak, en Algérie, au Liban, en Iran, souvent accompagnées de déchaînements de violence aveugle et d'une répression sanglante. Si la classe ouvrière est présente dans ces "révoltes populaires", interclassistes, stériles, porteuses de l'idéologie démocratique, et inaptes à s'opposer à la logique du capital, ce n'est jamais en tant que classe antagonique au capitalisme mais toujours noyée au sein de la population. C'est d'ailleurs l'absence du prolétariat de la scène sociale mondiale, conséquence de sa difficulté politique à se reconnaître en tant que classe spécifique au sein de la société, qui explique la multiplication de tels mouvements. Le fait d'y participer ne peut contribuer qu'à accroître une telle difficulté politique de la classe ouvrière.
Le second article, "Invasion turque dans le nord de la Syrie : La barbarie et le cynisme de la classe dirigeante". À quoi correspondent le retrait américain de Syrie, le lâchage des Kurdes qui jusque-là faisaient partie du dispositif américain, l'invasion turque en Syrie et, finalement, l'établissement sur place du parrain russe en tant que "garant" de l'équilibre forcément précaire ? Les États-Unis vont déléguer la défense de leurs intérêts régionaux à leurs alliés sur place (Israël, l'Arabie Saoudite, …) et, pourquoi pas, considérer Poutine comme un rempart possible contre la montée inexorable de la Chine. Nous assistons ici à un épisode de la guerre de chacun contre tous, élément central des conflits impérialistes depuis la disparition du système de blocs et qui n'en finit plus d'illustrer le cynisme de la classe dirigeante. Celui-ci se révèle, non seulement dans les massacres de masse que ses avions, son artillerie et ses bombes terroristes font pleuvoir sur la population civile de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan ou de Gaza, mais aussi par la manière dont elle utilise ceux qui sont contraints de fuir les zones de massacre.
La guerre de chacun contre tous est une conséquence du désordre mondial ayant résulté de l'effondrement du bloc de l'Est. Nous reviendrons, dans de prochains articles de notre site, sur l'ensemble des conséquences pour le monde de l'effondrement du bloc de l'Est et sur la réalité de la propagande mensongère de la bourgeoisie qui avait alors accompagné cet évènement. Selon celle-ci, ce n'était pas une partie du monde capitaliste qui s'effondrait mais le "communisme", et cet évènement augurait d'une aire de paix et de prospérité.
Plus que jamais, la situation du monde exige que la classe ouvrière mondiale renverse ce système pour édifier une nouvelle société qui, mettant au service de l'humanité l'énorme développement des forces productives accompli sous le capitalisme, pourra être libérée de l'exploitation, de la misère et des guerres. Mais cela doit être réalisé avant que ce système, devenu décadent depuis plus d'un siècle, n'engendre la destruction de ces mêmes forces productives, de la nature et de tout ce qui permet la vie sur terre, une destruction telle que les dommages deviendraient irréversibles et la fin de l'humanité inéluctable.
Toutes les campagnes orchestrées par la bourgeoisie autour des "mobilisations pour le climat" ont pour finalité essentielle de dégager la responsabilité du capitalisme de la catastrophe écologique, et de faire retomber celle-ci sur les "vieilles générations" pour avoir "vécu égoïstement en gaspillant les ressources de la planète". Elles travaillent ainsi à éluder que la seule solution face à la menace de destruction de la planète, ne peut venir que de la révolution prolétarienne. Nous avons largement dénoncé à travers des articles et par voie de tracts cette nouvelle offensive idéologique de la bourgeoise[1].
Malgré l'urgence objective de la révolution prolétarienne, la classe ouvrière n'est pas prête à se lancer à l'assaut du capitalisme. Il lui faut préalablement récupérer du coup terrible porté à la confiance en son projet historique par les campagnes sur la mort du communisme depuis 1990 et qui ont profondément affecté sa capacité à se reconnaitre comme la classe, et la seule, à pouvoir renverser le capitalisme et édifier la nouvelle société.
Par ailleurs, comme l'histoire de la première vague révolutionnaire l'a montré, toute nouvelle tentative révolutionnaire du prolétariat devra, pour être victorieuse, pouvoir compter sur la présence du futur parti mondial de la révolution. La fondation de celui-ci ne se décrète pas mais se prépare à travers l'activité des minorités révolutionnaires qui, depuis l'échec de la première vague révolutionnaire mondiale, ont entrepris et se sont transmises un travail de bilan de celle-ci, de ses insuffisances, de même que des erreurs et insuffisances de l'avant-garde d'alors, l'Internationale Communiste. Déjà, dans notre numéro précédent de la Revue, nous étions intervenus sur ce thème à travers des articles consacrés aux leçons qui devaient être tirées de la fondation de l'Internationale Communiste, en 1919, et une d'entre elles en particulier relative au caractère tardif de cette fondation, alors que la révolution allemande - cruciale à la fois pour la survie du pouvoir des soviets en Russie et pour l'extension de la révolution aux principaux centres du capitalisme - était déjà en marche. L'un de ces articles, "Cent ans après la fondation de l’Internationale Communiste, quelles leçons pour les combats du futur ?" insistait sur une autre leçon importante, relative celle-là à la critique de la méthode qui avait été employée à sa fondation, privilégiant le plus grand nombre plutôt que la clarté des positions et des principes politiques. Non seulement cette faiblesse n’avait pas armé le nouveau parti mondial, mais surtout elle l'avait rendu vulnérable face à l’opportunisme rampant au sein du mouvement révolutionnaire. Nous publions dans ce numéro de la Revue, la deuxième partie de cet article qui vise à mettre en lumière le combat politique que les fractions de gauche vont alors engager contre la ligne de l’IC, laquelle s'accrochait aux vieilles tactiques du mouvement ouvrier rendues caduques par l’ouverture de la phase de décadence du capitalisme.
Des avancées considérables au niveau théorique et programmatique ont été accomplies depuis la première vague révolutionnaire et les groupes prolétariens les plus avancés ont compris qu'il est nécessaire de prendre les mesures essentielles pour la formation d'un nouveau parti mondial avant les confrontations décisives avec le système capitaliste. Malgré cela, cet horizon semble encore très lointain. À ce propos, nous publions la première partie d'un article, "La difficile évolution du milieu politique prolétarien depuis Mai 68", évolution dont il est nécessaire de rendre compte en mettant en évidence les difficultés majeures ayant constitué un obstacle à la nécessaire clarification organisée et à la coopération en son sein, essentiellement à cause du poids du sectarisme. Un tel bilan critique est indispensable dans la mesure où le milieu politique prolétarien constitue nécessairement le creuset incontournable de la clarification / décantation en vue de la fondation du futur parti mondial.
L'histoire a montré combien il est difficile de construire un parti politique d'avant-garde à la hauteur de ses responsabilités, comme l'a été le parti bolchevique lors de la première tentative révolutionnaire en 1917. C'est une tâche qui exige des efforts nombreux et variés. Avant tout, elle exige la plus grande clarté sur les questions programmatiques et sur les principes de fonctionnement de l'organisation, une clarté qui se fonde nécessairement sur toute l'expérience passée du mouvement ouvrier et ses organisations politiques. Il existe un héritage commun de la Gauche communiste qui la distingue des autres courants de gauche qui ont émergé de l'Internationale Communiste. C'est pourquoi il est important de clarifier les contours historiques de la Gauche communiste et les différences qui la distinguent d'autres courants de gauche, notamment le courant trotskyste, face à des tentatives d'introduire de la confusion à ce niveau. C'est le but de cet article écrit en critique à des tentatives de ce type émanant d'un groupe qui se nomme Nuevo Curso.
Enfin, comme il est de tradition dans le mouvement ouvrier, les révolutionnaires ont la responsabilité de faire connaître les expériences de lutte de leur classe. C'est ce que nous avons fait avec la publication d'une série d'articles qui constituent une contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud. Nous terminons ici cette série par un article mettant en évidence comment la classe ouvrière, après s'être confrontée au "pouvoir blanc" de l'apartheid, a dû se confronter au nouveau "pouvoir noir" de l'ANC et de Mandela après l'élection de ce dernier en 1995. Elle a ainsi fait la douloureuse expérience que, quand les "têtes changent" à la tête de l'État, l'exploitation et la répression restent les mêmes.
(20/11/2019)
[1]. Voir à ce sujet, sur le site internet du CCI, notre tract international "Seule la lutte de classe internationale peut mettre fin à la course du capitalisme vers la destruction", distribué notamment dans les manifestations pour le climat.
Face à la plongée dans la crise économique mondiale et la misère, les "révoltes populaires" constituent une impasse
- 251 lectures
Partout dans le monde les attaques contre la classe ouvrière se généralisent et s'approfondissent[1]. C’est encore et toujours sur le dos des prolétaires que la classe dominante tente désespérément de freiner les effets du déclin historique de son propre mode de production et c’est toujours eux qui doivent payer la note ! Dans les pays "riches", les plans de licenciement se multiplient, en Allemagne et au Royaume-Uni en particulier. Certains des pays dits "émergents" sont déjà en récession (Brésil, Argentine, Turquie), avec tout ce que cela implique comme aggravation de la situation des prolétaires. Quant aux prolétaires des pays qui ne sont ni "riches" ni "émergents", leur situation est encore plus dramatique ; la population non exploiteuse y est, elle aussi, plongée dans une misère sans fond.
Ces derniers pays en particulier ont récemment été le théâtre de mouvements populaires en riposte aux sacrifices à répétition exigés depuis des années par le capitalisme et exécutés par des gouvernements souvent gangrénés par la corruption, discrédités et haïs des populations. De tels mouvements ont ainsi eu lieu au Chili, en Equateur, Haïti, Irak, Algérie, Liban, et plus récemment en Iran. Les mobilisations, souvent très massives, sont accompagnées dans certains pays de déchaînements de violence et d'une répression sanglante. Le mouvement très massif de protestation à Hong Kong, qui s'est développé en réaction non pas essentiellement à la misère et la corruption mais face au durcissement de l'arsenal répressif - permettant en particulier des extraditions vers la Chine continentale - a vu récemment l'irruption d'un niveau supérieur dans la répression : La police y a tiré à bout portant sur des manifestants.
Si la classe ouvrière est présente dans ces "révoltes populaires", ce n'est jamais en tant que classe antagonique au capitalisme mais toujours noyée au sein de la population. Ce sont d'ailleurs les grandes difficultés qu'elle confronte pour reconnaître sa propre identité de classe et son absence de la scène sociale mondiale qui expliquent la multiplication de tels mouvements populaires stériles et inaptes à s'opposer à la logique du capital. De plus, loin de favoriser l'émergence future d'une riposte de la classe ouvrière et, avec elle, la seule perspective viable, la lutte contre le système capitaliste, les révoltes populaires, interclassistes, porteuses de "no future", ne font qu'obscurcir une telle perspective. Elles renforcent encore les difficultés de la classe ouvrière pour assumer son combat de classe face aux expressions de plus en plus intolérables de la faillite du capitalisme. Néanmoins, elles ne peuvent éliminer ce fait que les contradictions de ce système, qui seront toujours plus profondes, pousseront toujours davantage la classe ouvrière mondiale à se confronter à toutes les difficultés qu'elle connait actuellement. Le rôle des révolutionnaires est ici déterminant car ils sont les seuls à être en mesure de faire une critique intransigeante de ses faiblesses.
L'exaspération face à la plongée vers encore plus de misère fait exploser la colère
Après des années d'attaques répétées c'est souvent une nouvelle attaque, pas nécessairement massive, qui "met le feu aux poudres".
Au Chili, c'est l'augmentation du prix du métro à Santiago qui est "la goutte d'eau qui fait déborder le vase". "Le problème n'est pas les 30 centimes [d'augmentation], mais les 30 ans [d'attaques] ", slogan surgi dans les manifestations. Dans ce pays, le salaire mensuel est inférieure à 400 €, la précarité est générale, les coûts de la nourriture et des services sont disproportionnés, les systèmes d'éducation et de santé souvent défaillants, celui des retraite condamne les retraités à la pauvreté.
En Équateur, le mouvement de protestation est provoqué par une hausse subite du titre de transport. Celle-ci s'ajoute à la hausse de tous les produits ou services de base, elle-même conjuguée au gel des salaires, aux licenciements massifs, au "don" obligatoire d'une une journée de travail à l'État, à la réduction des congés et d'autres mesures encore conduisant à une détérioration et précarisation des conditions de vie.
À Haïti, la pénurie de carburants s'abat sur la population comme une calamité supplémentaire qui conduit à la paralysie du pays le plus pauvre d’Amérique latine, l’un des seuls sur la planète à ne pas voir baisser son taux d’extrême pauvreté.
Si la crise économique est en général la cause première des attaques contre les conditions de vie, elle se superpose, dans certains pays comme le Liban et l'Irak, aux conséquences traumatisantes et dramatiques des tensions impérialistes et des guerres sans fin au Moyen-Orient.
Au Liban, c'est l'imposition d'une taxe sur les appels WhatsApp qui provoque la "révolte" dans le pays où la dette par habitant est la plus élevée du monde. Chaque année le gouvernement rajoute de nouveaux impôts, le tiers de la population y est au chômage et les infrastructures sont médiocres. En Irak, dès le premier jour d'un mouvement né spontanément après des appels à manifester sur les réseaux sociaux, les protestataires réclament des emplois et des services publics fonctionnels tout en exprimant leur colère contre la classe dirigeante accusée d’être corrompue.
En Iran, la hausse du prix de l'essence intervient dans une situation de profonde crise économique aggravée par les sanctions américaines contre le pays.
Impuissance des mouvements, répression et manœuvres de la bourgeoisie
Au Chili, les tentatives de lutte ont été détournées vers le terrain de la violence nihiliste sans aucune perspective, caractéristique de la décomposition capitaliste. On a aussi vu, favorisée par l'État, l'irruption du lumpen dans des actes de violence irrationnelle et minoritaire. Ce climat de violence a bien sûr été utilisé par l'État pour justifier la répression et intimider le prolétariat. Selon les chiffres officiels, celle-ci aurait fait 19 morts. La torture a fait sa réapparition comme aux pires moments de Pinochet. À la suite de quoi, la bourgeoisie chilienne a compris que la répression brutale n'était pas suffisante pour calmer le mécontentement. Le gouvernement de Piñera a alors fait son mea culpa, adopté une posture "humble", a dit "comprendre" le "message du peuple", a "provisoirement" retiré les mesures et a ouvert la porte à "la concertation sociale". C’est-à-dire que les attaques seront imposées par la "négociation", à partir de la table de "dialogue" où s'assoient les partis d'opposition, les syndicats, les employeurs, tous ensembles "représentant la nation". Pourquoi ce changement de tactique ? Parce que la répression n'est pas efficace si elle ne s'accompagne pas de tromperies démocratiques, du piège de l'unité nationale et de la dissolution du prolétariat dans la masse amorphe du "peuple".[2]
En Équateur, les associations de transporteurs ont paralysé le trafic; le mouvement indigène de même que d'autres regroupements diverses ont adhéré à la mobilisation. Les protestations des entrepreneurs du transport et d'autres secteurs de petits exploitants interviennent sur un terrain "citoyen" et surtout nationaliste. C'est dans ce contexte que des mobilisations naissantes de travailleurs contre les attaques - dans le sud de Quito, à Tulcán et dans la province de Bolívar - constituent une boussole pour l'action et la réflexion face à la déferlante de la "mobilisation" de la petite bourgeoisie.
La république d'Haïti est dans une situation proche de la paralysie générale. Les écoles y sont fermées, les principales routes entre la capitale et les régions sont coupées par des barrages, de nombreux commerces sont fermés. Le mouvement est accompagné de manifestations souvent violentes, alors que des gangs criminels (parmi les 76 gangs armés répertoriés à travers le territoire […], au moins trois sont à la solde du pouvoir, le reste est sous le contrôle d’un ancien député et des sénateurs de l’opposition) se livrent à des exactions, bloquent les routes et rackettent les rares automobilistes. Dimanche 27 octobre, un vigile privé a fait feu sur les protestataires, faisant un mort. Il a ensuite été lynché par la foule et brûlé vif. Un bilan non officiel fait état d’une vingtaine de morts en deux mois.
Algérie. Une marée humaine a de nouveau envahi les rues d'Alger le jour anniversaire du déclenchement de la guerre contre le colonisateur français. La mobilisation est semblable à celle enregistrée au plus fort du "Hirak", le mouvement de contestation inédit dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. Il s'oppose massivement à l'élection présidentielle que le pouvoir organise le 12 décembre pour élire un successeur à Bouteflika, estimant qu'elle ne vise qu'à régénérer ce "système".
Irak. Dans plusieurs provinces du Sud, les protestataires s'en sont pris aux institutions et à des permanences de partis politiques et groupes armés. Fonctionnaires, syndicats, étudiants et écoliers ont manifesté et entamé des sit-in. Alors que la répression des manifestations a provoqué jusqu’ici, selon un bilan officiel, la mort de 239 personnes, en majorité fauchées par des tirs à balles réelles, la mobilisation s'est poursuivie à Bagdad, et dans le sud du pays. Depuis le début de la contestation, les manifestants n'ont cessé de répéter qu'ils refusaient toute récupération politique de leur mouvement car ils veulent renouveler la totalité de la classe politique. Il faut aussi, disent-ils, en finir avec le compliqué système de répartition des postes par confession ou par ethnie, rongé par le clientélisme et qui tient toujours à l'écart les jeunes, pourtant majoritaires dans la population. Ces derniers jours, il y a eu des manifestations monstres dans la liesse et des piquets de grève qui ont paralysé universités, écoles et administrations. Par ailleurs, des violences nocturnes ont eu lieu contre des QG de partis et de milices.
Liban. La colère populaire est générale, elle transcende toutes les communautés, toutes les confessions et toutes les régions du pays. L’annulation de la nouvelle taxe sur les appels via WhatsApp n’a pas empêché la révolte de gagner l’ensemble du pays. La démission de Saad Hariri n’est qu’une infime partie des revendications de la population. Les Libanais réclament le départ de l’ensemble de la classe politique, jugée corrompue et incompétente, et un changement radical du système.
Iran. Dès l'annonce de la hausse du prix de l'essence des heurts violents entre émeutiers et forces de l'ordre ont fait plusieurs morts de part et d'autre, particulièrement nombreux du côté des manifestants.
La trilogie "interclassisme, revendication démocratique, violence aveugle"
Dans toutes les révoltes populaires interclassistes citées précédemment, et d'après les informations que nous avons pu recueillir, la classe ouvrière n'est que très ponctuellement parvenue à s'y manifester en tant que telle, y compris dans des situations comme au Chili où la cause première des mobilisations était clairement la nécessité de se défendre contre des attaques économiques.
Souvent, la "révolte" y prend alors pour cible privilégiée, voire unique, ceux qui, au pouvoir, sont rendus responsables de tous les maux qui accablent la population et, du coup, elle épargne le système dont ils sont les serviteurs. Focaliser la lutte sur le combat pour le remplacement de politiciens corrompus est évidemment une impasse car, quelles que soient les équipes au pouvoir, quel que soit leur niveau de corruption, toutes ne pourront et ne feront que défendre les intérêts de la bourgeoisie et mener une politique au service du capitalisme en crise. C'est une impasse d'autant plus dangereuse qu'elle est "légitimée" par des revendications démocratiques "pour un système propre", alors que la démocratie est la forme privilégiée de domination de la bourgeoisie pour maintenir sa domination de classe sur la société et le prolétariat. Il est à cet égard significatif qu'au Chili, après la répression féroce et face à une situation dont la bourgeoisie avait sous-estimé l'explosivité, celle-ci soit ensuite passée à une nouvelle phase de sa riposte à travers une attaque politique mettant en mouvement les organes démocratiques classiques de mystification et d'encadrement, aboutissant au projet de "nouvelle constitution" présentée comme une victoire du mouvement de protestation.
La revendication démocratique dilue les prolétaires dans l'ensemble de la population, brouille la conscience de leur combat historique, les soumet à la logique de domination du capitalisme, les réduit à l'impuissance politique.
Interclassisme et démocratisme sont deux méthodes qui se marient et se complètent de façon terriblement efficace contre la lutte autonome de la classe ouvrière. C'est d'autant plus le cas que, avec la période historique ouverte avec l'effondrement du bloc de l'est et les campagnes mensongères sur la mort du communisme[3], le projet historique du prolétariat a cessé temporairement de guider plus ou moins consciemment sa lutte. Lorsque cette dernière parvient à s'imposer, c'est à contrecourant du phénomène général de décomposition de la société où le chacun pour soi, l'absence de perspectives, etc. acquièrent un poids accru[4].
Les déchainements de violence qui souvent accompagnent les révoltes populaires sont bien loin d'exprimer une quelconque radicalité. C'est évident lorsqu'ils sont le fait du lumpen, agissant spontanément ou aux ordres occultes de la bourgeoisie, avec son vandalisme, les pillages, les incendies, la violence irrationnelle et minoritaire. Mais plus fondamentalement, une telle violence est contenue intrinsèquement dans les mouvements populaires dès lors que ceux-ci ne s'en remettent pas directement aux institutions de l'État. N'ayant évidemment à offrir aucune perspective de transformation radicale de la société pour abolir la pauvreté, les guerres, l'insécurité croissante, et autres calamité du capitalisme en agonie, ils ne peuvent alors qu'être porteurs de toutes les tares de la société capitaliste en décomposition.
Le pourrissement du mouvement de contestation à Hong-Kong en constitue une parfaite illustration en ce sens où, de plus en plus ostensiblement privé de perspectives – en fait il ne pouvait en avoir dès lors qu'il se cantonnait sur le terrain "démocratique" sans mettre en question le capitalisme - il se transforme en une gigantesque vendetta de la part de protestataires face aux violences policières, et ensuite des flics eux-mêmes qui répliquent, parfois spontanément, à la violence d'en face. C'est ce constat évident que certains organes de la presse bourgeoise sont capables de faire : "rien de ce qu'a pu tenter Pékin pour les arrêter n'a fonctionné, ni le retrait de la loi sur l'extradition, ni la répression policière, ni l'interdiction du port de masques sur la voie publique. Désormais ces jeunes hong-kongais ne sont plus mus par l'espoir, mais par l'envie d'en découdre, à défaut de toute autre issue possible".[5]
Certains s'imaginent - ou veulent nous faire croire – que toute violence dans cette société, dès lors qu'elle est exercée contre les forces de répression de l'État, est nécessairement à soutenir, s'apparenterait à la nécessaire violence de classe du prolétariat lorsqu'il entre en lutte contre l'oppression et l'exploitation capitalistes[6]. C'est une profonde méprise ou une mystification grossière. En fait la violence aveugle des mouvements interclassistes n'a rien à voir avec la violence de classe du prolétariat qui est libératrice, pour la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme, contrairement à celle du capitalisme qui est oppressive, dans le but notamment de défendre la société de classe. La violence des mouvements interclassistes est désespérée, à l'image de la petite bourgeoisie qui n'a aucun avenir propre, à qui il reste que le néant, à défaut de se ranger derrière la bourgeoisie ou bien le prolétariat.
En fait la trilogie "interclassisme, revendication démocratique, violence aveugle" est la marque de fabrique des révoltes populaires qui éclosent aux quatre coins de la planète en réaction à la dégradation accélérée de toutes les conditions de vie qui affecte la classe ouvrière, d'autres couches non exploiteuses et la petite bourgeoisie totalement paupérisée. Le mouvement des gilets jaunes qui a fait son apparition en France il y a un an appartient également à cette catégorie des révoltes populaires[7]. De tels mouvements ne peuvent que contribuer à obscurcir aux yeux des prolétaires ce qu'est la véritable lutte de classe, à renforcer leurs difficultés actuelles pour se concevoir comme classe de la société, différente des autres classes, avec son combat spécifique contre l'exploitation et sa mission historique de renversement du capitalisme.
C'est la raison pour laquelle la responsabilité des révolutionnaires et des minorités les plus conscientes au sein de la classe ouvrière est d'œuvrer à ce que la classe ouvrière se réapproprie ses méthodes de lutte propres, au cœur desquelles figurent la lutte massive ; l'assemblée générale comme lieu de discussion et décision défendu contre les tentatives de sabotage des syndicats, ouvert à tous les secteurs de la classe ouvrière ; l'extension aux autres secteurs, imposée contre les manœuvres d'enferment des syndicats et de la gauche du capital, . [8] Même lorsque ces perspectives apparaissent aujourd'hui lointaines, et c'est effectivement le cas actuellement dans beaucoup de parties du monde, en particulier là où la classe ouvrière est très minoritaire, avec une faible expérience historique, elles constituent néanmoins partout la seule boussole qui permettra au prolétariat de ne pas se dissoudre et se perdre.
Silvio. (17/11/2019)
[1] Lire notre article Nouvelle récession : Le capital exige davantage de sacrifices pour le prolétariat ! [838], Révolution internationale N° 478.
[2] Pour d'avantage d'informations et d'analyse au sujet de la situation au Chili, lire notre article Mouvement social au Chili : l’alternative dictature ou démocratie est une impasse [839].
[3] Nous reviendrons prochainement dans des articles de notre presse sur l'impact considérable de ces campagnes mensongères sur la lutte de classe et mettrons en évidence en quoi l'état du monde est devenu tout le contraire de ce qui était alors annoncé, une ère de paix et de prospérité.
[4] Renvoyer aux articles adéquats.
[5] "The Hong Kong Protesters Aren’t Driven by Hope [840]". The Atlantic
[6] De ce point de vue, il est éclairant de comparer les récentes révoltes au Chili avec l'épisode de la lutte des ouvriers en Argentine dit du Cordobazo en 1969 à propos duquel nous recommandons la lecture de notre article "Le Cordobazo argentin (mai 1969) : maillon d’une chaîne de mobilisations ouvrières à travers le monde [841]".
[7] Lire à ce propos notre supplément à Révolution internationale n° 478, "Bilan du mouvement des “gilets jaunes”: Un mouvement interclassiste, une entrave à la lutte de classe [842]".
[8] Lire à ce propos la résolution sur le rapport de forces entre les classes [843] adoptée au 23e congrès du CCI (2019)
Rubrique:
Invasion turque dans le nord de la Syrie: la barbarie et le cynisme de la classe dirigeante
- 130 lectures
L’appel téléphonique de Trump à Erdogan, le 6 octobre, a donné le "feu vert" à la Turquie pour une invasion majeure du nord de la Syrie et une opération de nettoyage brutale contre les forces kurdes qui contrôlaient jusqu’ici la région avec le soutien des États-Unis. Il a provoqué une tempête d’indignation à la fois parmi les "alliés" des États-Unis en Europe ainsi qu’au sein d’une grande partie de l’appareil militaire et politique à Washington, notamment de l’ancien secrétaire à la défense de Trump, James Mattis "le chien fou". La principale critique à l’égard de l’abandon des Kurdes par Trump a été la perte de toute crédibilité des États-Unis en tant qu’allié sur lequel compter : en bref, que c’est un désastre sur le plan diplomatique. Mais on craint aussi que le retrait des Kurdes n’entraîne une renaissance des forces islamiques dont l’endiguement a été presque exclusivement le fait des forces kurdes soutenues par la puissance aérienne américaine. Les Kurdes détiennent des milliers de prisonniers de Daesh et plus d’une centaine d’entre eux se sont déjà évadés de prison[1].
L’action de Trump a tiré la sonnette d’alarme au sein de parties significatives de la bourgeoisie américaine, accroissant davantage les craintes que son style de présidence imprévisible et égocentrique devienne un réel danger pour les États-Unis, voire qu’il perde le peu de "stabilité mentale" qu’il possède, sous son mandat et surtout sous la pression de l’actuelle campagne de destitution contre lui. Certes, son comportement devient de plus en plus incontrôlable : il étale non seulement son ignorance quand il affirme que "les Kurdes ne nous soutenaient pas au débarquement de Normandie", mais adopte aussi des manières de petit truand (comme avec sa lettre avertissant Erdogan de ne pas se comporter comme un idiot ou un dur, que le dirigeant turc a rapidement jeté à la poubelle, ou ses menaces de détruire l’économie turque). Il gouverne à coups de tweets, prend des décisions impulsives, ne tient pas compte des conseils de son entourage pour ensuite faire marche arrière, comme en témoignent également l’envoi précipité de Pence et Pompeo à Ankara pour bricoler un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie.
Mais ne nous attardons pas trop sur la personnalité de Trump. En premier lieu, il n’est que l’expression de la décomposition progressive qui impacte fortement sa classe, un processus qui partout fait surgir des "hommes forts" qui excitent les plus basses passions, se vantent de leur mépris de la vérité et des règles traditionnelles du jeu politique, de Duterte à Orban, de Modi à Boris Johnson. Même si Trump a sauté sur l’occasion avec Erdogan, la politique de retrait des troupes du Moyen-Orient n’est pas son invention, mais remonte à l’administration Obama qui a reconnu l’échec total de la politique américaine au Moyen-Orient depuis le début des années 1990 et la nécessité de réorienter sa politique impérialiste en Asie à partir de l’Extrême-Orient afin de contrer la menace croissante de l’impérialisme chinois.
La dernière fois que les États-Unis ont donné leur "feu vert" au Moyen-Orient, c’était en 1990, lorsque l’ambassadeur américain, April Glaspie, a fait savoir que les États-Unis n’interviendraient pas si Saddam Hussein marchait sur le Koweït. C’était un piège bien organisé, tendu avec l’idée de mener une opération massive dans la région et d’obliger ses partenaires occidentaux à se joindre à une grande croisade. C’était un moment où, après l’effondrement du bloc russe en 1989, le bloc occidental commençait déjà à s’effriter et les États-Unis, en tant que seule superpuissance restante, devaient affirmer leur autorité par une démonstration spectaculaire de force. Guidée par une idéologie "néoconservatrice" presque messianique, la première guerre du Golfe a été suivie de nouvelles aventures militaires, en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Mais le soutien décroissant de ses anciens alliés à ces opérations, et surtout le chaos total qu’elles ont provoqué au Moyen-Orient, piégeant les forces américaines dans des conflits ingérables contre les insurrections locales, a démontré la forte diminution de la capacité des États-Unis à contrôler la planète. En ce sens, il y a une logique derrière les actions impulsives de Trump, soutenues par des secteurs considérables de la bourgeoisie américaine qui a reconnu que les États-Unis ne peuvent pas régner sur le Moyen-Orient en posant leurs bottes sur le sol ou par leur puissance de feu aérienne. Elle s’appuiera de plus en plus sur ses alliés les plus fiables dans la région (Israël et l’Arabie saoudite) pour défendre ses intérêts par l’action militaire, dirigée en particulier contre la montée en puissance de l’Iran (et, à plus long terme, contre la présence potentielle de la Chine comme concurrent sérieux dans cette région).
La "trahison" des Kurdes
Le cessez-le-feu négocié par Pence et Pompeo (qui, selon Trump, sauvera des "millions de vies") ne modifie pas vraiment la politique d’abandon des Kurdes puisque son but est simplement de donner aux forces kurdes la possibilité de battre en retraite pendant que l’armée turque affirme son contrôle sur le nord du pays. Il faut dire que ce genre de "trahison" n’est pas nouveau. En 1991, dans la guerre contre Saddam Hussein, les États-Unis, sous la direction de Bush senior, ont encouragé les Kurdes du nord de l’Irak à s’élever contre le régime de Saddam pour ensuite laisser Saddam au pouvoir, désireux et capable d’écraser le soulèvement kurde avec la plus grande sauvagerie. L’Iran a également essayé d’utiliser les Kurdes d’Irak contre Saddam. Mais toutes les puissances de la région, comme les puissances mondiales qui les soutiennent, se sont toujours opposées à la formation d’un État unifié du Kurdistan, ce qui signifierait la rupture des arrangements nationaux existants au Moyen-Orient.
Les forces armées kurdes, quant à elles, n’ont jamais hésité à se vendre au plus offrant. C’est ce qui se passe sous nos yeux : la milice kurde s’est immédiatement tournée vers la Russie et le régime d’Assad lui-même pour les protéger de l’invasion turque.
C’est d’ailleurs le sort de toutes les luttes de "libération nationale" depuis au moins la Première Guerre mondiale : elles n’ont pu prospérer que sous l’aile de l’une ou l’autre puissance impérialiste. La même nécessité s’applique tout particulièrement au Moyen-Orient : le mouvement national palestinien a sollicité le soutien de l’Allemagne et de l’Italie dans les années 1930 et 1940, de la Russie pendant la guerre froide, de diverses puissances régionales avec le désordre mondial provoqué par l’effondrement du système des blocs. Entre-temps, la dépendance du sionisme au soutien impérialiste (principalement, mais pas seulement) des États-Unis, n’a pas besoin d’être démontrée, mais ne fait pas exception à la règle générale. Les mouvements de libération nationale peuvent adopter de nombreuses bannières idéologiques (stalinisme, islamisme, voire, comme dans le cas des forces kurdes au Rojava, une sorte d’anarchisme), mais ils ne peuvent que piéger les exploités et les opprimés dans les guerres sans fin du capitalisme à son époque de déclin impérialiste[2].
Une perspective de chaos impérialiste et de misère humaine
Le bénéficiaire le plus évident du retrait américain du Moyen-Orient est la Russie. Au cours des années 1970 et 1980, l’URSS avait été contrainte de renoncer à la plupart de ses positions au Moyen-Orient, en particulier à son influence en Égypte et surtout à ses tentatives de contrôler l’Afghanistan. Son dernier avant-poste, point d’accès vital à la Méditerranée, était la Syrie et le régime d’Assad, lui-même menacé d’effondrement par la guerre qui a balayé le pays après 2011 et qui a permis les avancées des rebelles "pro-démocratie" et surtout de l’État islamique. L’intervention massive de la Russie en Syrie a sauvé le régime d’Assad et rétabli son contrôle sur la majeure partie du pays. Mais il est douteux que cela ait pu être possible si les États-Unis, souhaitant éviter de s’enliser dans un autre bourbier après l’Afghanistan et l’Irak, n’avaient pas de fait cédé le pays aux Russes. Cela a généré des divisions majeurs au sein de la bourgeoisie américaine, avec certaines de ses factions plus établies dans l’appareil militaire encore profondément soucieuses de tout ce que les Russes pourraient faire, tandis que Trump et ceux qui le soutiennent ont vu en Poutine un homme avec qui on pouvait négocier et surtout il est apparu comme un rempart possible contre la montée apparemment inexorable de la Chine.
La remontée en puissance de la Russie en Syrie a en partie nécessité le renforcement des relations avec la Turquie, qui s’est progressivement éloignée des États-Unis, notamment à cause du soutien de ces derniers aux Kurdes dans son opération contre Daesh. Mais la question kurde crée déjà des difficultés pour le rapprochement russo-turc, puisqu’une partie des forces kurdes se tourne maintenant vers Assad et les Russes pour se protéger, tandis que les militaires syriens et russes occupent les zones précédemment contrôlées par les combattants kurdes, il existe un risque imminent de confrontation entre la Turquie, d’une part, et la Syrie avec son allié russe, d’autre part. Pour le moment, ce danger semble avoir été écarté par l’accord conclu entre Erdogan et Poutine à Sotchi le 22 octobre. L’accord donne à la Turquie le contrôle d’une zone tampon dans le nord de la Syrie aux dépens des Kurdes, tout en confirmant le rôle de la Russie en tant que principal arbitre de la région. Reste à savoir si cet arrangement permettra de surmonter les antagonismes de longue date entre la Turquie et la Syrie d’Assad. La guerre de chacun contre tous, élément central des conflits impérialistes depuis la disparition du système de blocs, n’est nulle part plus clairement illustrée qu’en Syrie.
Pour l’instant, la Turquie d’Erdogan peut également se féliciter de ses progrès militaires rapides dans le nord de la Syrie et du nettoyage des "nids de terroristes" kurdes. L’intervention turque s’est également présentée comme une aubaine pour Erdogan au niveau national : suite aux graves revers pour son parti, l’AKP, lors des élections de l’année dernière, la vague d’hystérie nationaliste provoquée par cette aventure militaire a divisé l’opposition, qui est composée de "démocrates" turcs et du Parti démocratique des peuples (HDP) kurde.
Erdogan peut, pour l’instant vendre une nouvelle fois le rêve d’un nouvel Empire ottoman, la Turquie ayant redoré son lustre d’antan d’acteur dans l’arène impérialiste mondiale alors qu’elle était "l’homme malade de l’Europe" au début du XXe siècle. Mais s’engager dans ce qui est déjà une situation profondément chaotique pourrait facilement devenir un piège dangereux pour les Turcs à plus long terme. Surtout, cette nouvelle escalade du conflit syrien augmentera considérablement son coût humain déjà gigantesque. Plus de 100 000 civils ont déjà été déplacés, ce qui aggrave considérablement le cauchemar des réfugiés à l’intérieur de la Syrie, tandis que l’objectif secondaire de l’invasion est de renvoyer dans le nord du pays les trois millions de réfugiés syriens qui vivent actuellement dans des conditions désastreuses dans les camps turcs, principalement au détriment de la population locale kurde.
Le cynisme de la classe dirigeante se révèle non seulement dans les massacres de masse que ses avions, son artillerie et ses bombes terroristes font pleuvoir sur la population civile de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan ou de Gaza, mais aussi par la manière dont elle utilise ceux qui sont contraints de fuir les zones de massacre. L’Union européenne, ce soi-disant modèle de vertu démocratique, compte depuis longtemps sur Erdogan pour servir de garde-chiourme aux réfugiés syriens sous sa "protection", les empêchant ainsi de s’ajouter aux vagues d’immigrants qui se dirigent vers l’Europe. Aujourd’hui, Erdogan envisage une solution à ce problème avec le nettoyage ethnique du nord de la Syrie et peut menacer (si l’Union européenne critique ses actions) de lâcher une nouvelle vague de réfugiés vers l’Europe.
Les êtres humains ne sont utiles au capital que s’ils peuvent être exploités ou utilisés comme chair à canon. La barbarie ouverte de la guerre en Syrie n’est qu’un avant-goût de ce que le capitalisme réserve à l’humanité entière s’il perdure. Mais les principales victimes de ce système, tous ceux qu’il exploite et opprime, ne sont pas des objets passifs. Au cours de l’année écoulée, nous avons entrevu la possibilité de réactions massives contre la pauvreté et la corruption de la classe dirigeante dans les révoltes sociales en Jordanie, en Iran, en Irak et plus récemment au Liban. Ces mouvements ont tendance à être très confus, infectés par le poison du nationalisme et nécessitent une nette affirmation de la classe ouvrière agissant sur son propre terrain de classe. C’est une responsabilité vitale non seulement pour les travailleurs du Moyen-Orient, mais pour les travailleurs du monde entier, et surtout pour les travailleurs des pays centraux du capitalisme où la tradition politique autonome du prolétariat est née et a ses racines les plus profondes.
Amos, 23 octobre 2019
[1] Il est bien sûr possible que Trump soit tout à fait à l'aise avec l'idée que les forces de l'État islamique retrouvent une certaine présence en Syrie, maintenant que ce sont les Russes et les Turcs qui seront forcés de traiter avec eux. De même, il semblait très heureux que les Européens soient confrontés au problème du retour des anciens combattants de l'EI dans leurs pays d'origine européens. Mais de telles idées ne resteront pas sans opposition au sein de la classe dirigeante américaine.
[2] Pour une analyse plus approfondie de l'histoire du nationalisme kurde voir l'article "Le nationalisme kurde : un autre pion dans les conflits impérialistes [844]", sur notre site Web.
Géographique:
- Syrie [657]
Rubrique:
Cent ans après la fondation de l’Internationale Communiste, quelles leçons pour les combats du futur ? (2e partie)
- 193 lectures
Dans la première partie de cet article, nous avons rappelé les circonstances dans lesquelles a été fondée la Troisième Internationale (Internationale communiste). L'existence du parti mondial dépend avant toute chose de l’extension de la révolution à l’échelle mondiale, et sa capacité à assumer ses responsabilités dans la classe dépend de la manière dont s'effectue le regroupement des forces révolutionnaires dont il est issu. Or, comme nous l'avons mis en évidence, la méthode adoptée lors de la fondation de l'Internationale communiste (IC), privilégiant le plus grand nombre plutôt que la clarté des positions et des principes politiques, n’avait pas armé le nouveau parti mondial. Pire, elle le rendait vulnérable face à l’opportunisme rampant au sein du mouvement révolutionnaire. Cette deuxième partie vise à mettre en lumière le combat politique que les fractions de gauche vont alors engager contre la ligne de l’IC, consistant alors à s'accrocher aux vieilles tactiques rendues caduques par l’ouverture de la phase de décadence du capitalisme.
Cette nouvelle phase de la vie du capitalisme nécessitait de redéfinir certaines positions programmatiques et organisationnelles afin de permettre au parti mondial d’orienter le prolétariat sur son propre terrain de classe.
1918-1919 : la praxis révolutionnaire remet en cause les vieilles tactiques
Comme nous l’avons rapporté dans la première partie de cet article, le 1er congrès de l’Internationale Communiste avait mis en évidence que la destruction de la société bourgeoise était pleinement à l’ordre du jour de l’histoire. En effet, la période 1918-1919 voit une poussée de tout le prolétariat mondial[1], en Europe d’abord :
- Mars 1919 : proclamation de la République des Conseils en Hongrie ;
- Avril-mai 1919 : épisode la République des Conseils en Bavière ;
- Mai / juin 1919 : réactions ouvrières en Suisse et en Autriche.
La vague révolutionnaire s’étend ensuite sur le continent américain :
- Janvier 1919 : "semaine sanglante" à Buenos Aires en Argentine, où les ouvriers sont sauvagement réprimés ;
- Février 1919 : grève dans les chantiers navals à Seattle, aux Etats-Unis, qui s'étend par la suite à toute la ville en quelques jours. Les ouvriers parviennent à prendre le contrôle du ravitaillement et de la défense contre les troupes envoyées par le gouvernement ;
- Mai 1919 : grève générale à Winnipeg, au Canada.
Mais également Afrique et en Asie :
- En Afrique du Sud, en mars 1919, la grève des tramways s'étend à tout Johannesburg, avec assemblées et meetings de solidarité avec la Révolution russe ;
- Au Japon, en 1918, se déroulèrent les fameux "meetings du riz" contre l'expédition de riz aux troupes japonaises envoyées contre la révolution en Russie.
Dans ces conditions, bien qu’ils surestiment la réalité du rapport de force, les révolutionnaires de l’époque avaient de véritables raisons de dire que "la victoire de la révolution prolétarienne est assurée dans le monde entier. La fondation de la république internationale des Conseils est en marche".[2]
L’extension de la vague révolutionnaire en Europe et ailleurs, confirmait les thèses du Premier Congrès :
- "1) La période actuelle est celle de la décomposition et de l’effondrement de tout le système capitaliste mondial, et ce sera celle de l’effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n’est pas battu.
- 2) La tâche du prolétariat consiste maintenant à s’emparer du pouvoir d’Etat. La prise du pouvoir d’Etat signifie la destruction de l’appareil d’Etat de la bourgeoisie et l’organisation d’un nouvel appareil du pouvoir prolétarien".
La nouvelle période qui s’ouvrait, celle des "guerres et des révolutions", confrontait le prolétariat mondial et son parti mondial à de nouveaux problèmes. L’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence posait directement la nécessité de la révolution et modifiait la forme que devait prendre la lutte de classes.
La formation des courants de gauche au sein de l’IC
La vague révolutionnaire avait consacré la forme enfin trouvé de la dictature du prolétariat : les conseils ouvriers. Mais elle avait également montré que les formes et les méthodes de luttes héritées du XIXe siècle, comme les syndicats ou la tribune parlementaire, étaient désormais révolues.
- "Dans la nouvelle période, c’est la praxis même des ouvriers qui remettait en cause les vieilles tactiques parlementaire et syndicale. Le parlement, le prolétariat russe l’avait dissout après la prise du pouvoir, et en Allemagne une masse significative d’ouvriers s’était prononcée en décembre 1918 pour le boycottage des élections. En Russie comme en Allemagne, la forme conseils était apparue comme la seule forme de lutte révolutionnaire en lieu et place de la structure syndicale. Mais la lutte en Allemagne avait révélé l’antagonisme entre prolétariat et syndicats."[3]
Le rejet du parlementarisme
Les courants de gauche dans l’Internationale vont se structurer sur une base politique claire : l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence imposait une seule et unique voie : la révolution prolétarienne et la destruction de l’Etat bourgeois en vue d’abolir les classes sociales et d’ériger la société communiste. Dès lors, la lutte pour des réformes et la propagande révolutionnaire dans les parlements bourgeois n’avait plus de sens. Dans plusieurs pays, pour les courants de gauche, le rejet des élections devient la ligne des véritables organisations communistes :
- En mars 1918, le parti communiste polonais boycotte les élections.
- Le 22 décembre 1918 est publié l’organe de la Fraction Communiste Abstentionniste du Parti Socialiste Italien (PSI), Il Soviet à Naples sous la direction d’Amedeo Bordiga. La fraction se fixait comme "but d’éliminer les réformistes du parti afin de lui assurer une attitude plus révolutionnaire". Selon elle, "tout contact devait être rompu avec le système démocratique", un véritable parti communiste n’étant possible que si l’on renonçait "à l’action électorale et parlementaire". [4]
- En septembre 1919, la Workers’ Socialist Federation en Grande-Bretagne se prononce contre le parlementarisme "révolutionnaire".
- Il en va de même en Belgique pour "De Internationale" en Flandres et le Groupe Communiste de Bruxelles. L’antiparlementarisme était également défendu par une minorité du parti communiste bulgare, par une partie du groupe des communistes hongrois exilés à Vienne, par la fédération de la jeunesse social-démocrate en Suède ainsi que par une minorité du Partido Socialista Internacional d’Argentine (futur Parti Communiste d’Argentine).
- Les Hollandais eux, restaient divisés sur la question parlementaire. Une majorité de Tribunistes restait en faveur des élections, alors que la minorité était indécise à l’image de Gorter. Alors que Pannekoek défendait une position antiparlementaire.
- Le KAPD s’opposera également à la participation aux élections.
Pour toutes ces organisations, le rejet du parlementarisme était désormais une question de principe. Il s’agissait en fait de mettre en pratique les analyses et les conclusions adoptées lors du premier congrès. Or, la majorité de l’IC ne l’entendait pas ainsi, à commencer par les bolcheviks. S’il n’y avait aucune ambiguïté sur le caractère réactionnaire des syndicats et de la démocratie bourgeoise, il ne fallait pas pour autant laisser tomber la lutte en leur sein. La circulaire du Comité exécutif de l’IC du 1er septembre 1919, entérinait ce pas en arrière en revenant à l’ancienne conception social-démocrate faisant du parlement un lieu de la conquête révolutionnaire : "(... les militants) vont au parlement pour s’emparer de cette machine et pour aider les masses, derrière les murs du Parlement, à le faire sauter."[5]
La question syndicale cristallise les débats
Les premiers épisodes de la vague révolutionnaire cités plus hauts avaient clairement montré que les syndicats étaient des organes de luttes dépassés, pire, ils étaient désormais contre la classe ouvrière[6]. Mais plus que partout ailleurs, c’est en Allemagne que ce problème fut posé de la façon la plus cruciale et que les révolutionnaires parvinrent à une compréhension la plus nette de la nécessité de rompre avec les syndicats et le syndicalisme. Pour Rosa Luxemburg, les syndicats n’étaient plus des "organisations ouvrières, mais les protecteurs les plus solides de l’Etat et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats."[7]
La direction de l’IC n’était pas aussi clairvoyante. Si elle dénonçait les syndicats dominés par la social-démocratie elle n’en conservait pas moins l’illusion de pouvoir les réorienter sur une voie prolétarienne : Les syndicats reprendront-ils à nouveau la vieille voie éculée, réformiste, c’est à dire effectivement bourgeoise ? [...] Nous sommes fermement convaincus que cela ne se produira pas. Un courant d’air frais a pénétré dans les bâtiments étouffants des vieux syndicats. La décantation a déjà commencé dans les syndicats. [...]La nouvelle époque produira une nouvelle génération de dirigeants prolétariens dans les syndicats renouvelés."[8]
C’est pour cette raison qu’à ses débuts l’IC acceptait dans ses rangs des syndicats nationaux et régionaux de métiers ou d’industrie. On pouvait notamment y retrouver des éléments syndicalistes- révolutionnaires comme les IWW. Or, si ces derniers rejetaient aussi bien le parlementarisme que l’activité dans les anciens syndicats, ils n’en restaient pas moins hostiles à l’activité politique et donc à la nécessité d’un parti politique du prolétariat. Ce qui ne pouvait que renforcer les confusions au sein même de l’IC, sur la question organisationnelle puisqu’elle comprenait en son sein des groupes qui étaient déjà "anti-organisation".
Le groupe le plus lucide sur la question syndicale restait sans ambiguïté la majorité de gauche du KPD qui allait se faire exclure du parti par la centrale dirigée par Levi et Brandler. Celle-ci n’était pas seulement contre les "syndicats réactionnaires" aux mains des sociaux-démocrates mais hostiles à toute forme de syndicalisme comme le syndicalisme révolutionnaire antipolitique et l’anarcho-syndicalisme. Cette majorité allait fonder le KAPD en avril 1920 dont le programme affirmait clairement qu’ "à côté du parlementarisme bourgeois les syndicats forment le principal rempart contre le développement ultérieur de la révolution prolétarienne en Allemagne. Leur attitude pendant la guerre est connue. [...] Ils ont conservé leur tendance contre-révolutionnaire jusqu’à aujourd’hui, pendant toute la période de la révolution allemande." Face à la position centriste de Lénine et de la direction de l’IC, le KAPD rétorquait que "la révolutionnarisation des syndicats n’est pas une question de personne : le caractère contre-révolutionnaire de ces organisations se trouve dans leur structure et dans leur système spécifique eux-mêmes. Ceci entraîne la sentence de mort pour les syndicats ; seule la destruction même des syndicats peut libérer le chemin de la révolution sociale."[9]
Certes, ces deux importantes questions ne pouvaient pas être tranchées du jour au lendemain. Mais les résistances qui s’exprimaient au sujet du rejet du parlementarisme et du syndicalisme démontraient les difficultés de l’IC à tirer toutes les implications de la décadence du capitalisme dans le programme communiste. L’exclusion de la majorité du KPD, puis le rapprochement entre le KPD expurgé et les Indépendants (USPD) – ces derniers contrôlant l’opposition dans les syndicats officiels - constituaient un signe supplémentaire de la montée de l’opportunisme programmatique et organisationnel au sein du parti mondial.
Le IIe congrès commence à faire machine arrière
Au début de l’année 1920, l’IC préconise la formation de partis de masses. Soit par la fusion des groupes communistes avec les courants centristes, comme c’est le cas en Allemagne entre le KPD et l’USPD. Soit par l’entrisme des groupes communistes dans des partis de la IIe Internationale, comme par exemple en Angleterre où l’IC préconise l’entrée du parti communiste dans le Labour Party. Cette nouvelle orientation tourne totalement le dos aux travaux du premier congrès qui avait acté la faillite de la social-démocratie. Cette décision opportuniste est justifiée par la conviction que la victoire de la révolution passe inexorablement par le plus grand nombre d’ouvriers organisés. Cette position était combattue par le bureau d’Amsterdam composé par la gauche de l’IC[10].
Le deuxième congrès de l’IC qui se déroula du 17 juillet au 7 août 1920 laissait présager une rude bataille entre la majorité conduite par les bolcheviks d'une part et, d'autre part, les courants de gauche sur les questions de tactique mais aussi sur les principes organisationnels. Le congrès se déroula en pleine "guerre révolutionnaire"[11] où l’Armée rouge marchait sur la Pologne et laissait croire à la jonction avec la révolution en Allemagne. Tout en demeurant conscient du danger de l’opportunisme, puisqu’il reconnaissait que le parti restait menacé par "l’envahissement de groupes indécis et hésitants qui n’ont pas encore su rompre avec l’idéologie de la IIe Internationale"[12], ce deuxième congrès commençait à faire des concessions par rapport aux analyses du premier congrès puisqu’il acceptait l’intégration partielle de certains partis sociaux-démocrates encore fortement marqués par les conceptions de la IIe Internationale[13].
Pour se prémunir d’un tel danger, avaient été rédigées les 21 conditions d’admission à l’IC contre les éléments droitiers et centristes. Lors de la discussion sur les 21 conditions, Bordiga, qui reprenait la position qui avait été celle des bolcheviks lors du deuxième congrès du POSDR en 1903, se distingua par sa détermination à défendre le programme communiste et mit en garde l’ensemble du parti face à toute concession dans les modalités d’adhésions : "La réalisation révolutionnaire de Russie nous ramenait ainsi sur le terrain du marxisme, et le mouvement révolutionnaire qui avait été sauvé des ruines de la IIe Internationale s'orientait sur ce programme. Et le travail qui commençait donnait lieu à la constitution officielle d'un nouvel organisme mondial. Je pense que dans la situation actuelle - qui n'a rien de fortuit, mais qui est déterminée par la marche de l'histoire, nous courons le danger de voir s'introduire parmi nous des éléments, tant de la première que de la seconde catégorie, que nous avions éloignés[14]. Ce serait donc un grand danger pour nous, si nous commettions la faute d'accepter ces gens dans nos rangs. (...) Les éléments de droite acceptent nos thèses, mais d'une façon insuffisante. Ils les acceptent avec des réticences ; nous autres, communistes, nous devons exiger que cette acceptation soit entière et sans restriction, tant dans le domaine de la théorie que dans celui de l'action. (...) Je pense, camarades, qu'il faut que l'Internationale Communiste soit intransigeante et qu'elle maintienne fermement son caractère politique révolutionnaire. Contre les sociaux-démocrates il faut dresser des barrières infranchissables. (...) Le programme est une chose commune à tous, ce n'est pas une chose qui est établie par la majorité des militants du parti. C'est cela qui doit être imposé aux partis qui veulent être admis dans la IIIe Internationale. Enfin, c'est seulement aujourd'hui qu'on vient d'établir qu'il y a une différence entre le désir d'entrer dans la IIIe Internationale et le fait d'y être accepté. (...) Je pense qu'il faut, après ce Congrès, donner au Comité Exécutif le temps de faire exécuter toutes les obligations imposées par la IIIe Internationale. Après cette période d'organisation, pour ainsi dire, la porte devrait être close, il n'y devrait être autre voie d'admission que l'adhésion personnelle au Parti communiste du pays. Il faut combattre l'opportunisme partout. Mais cette tâche sera rendue très difficile si, au moment où l'on prend des mesures pour épurer la IIIe Internationale, on ouvre les portes pour faire rentrer ceux qui sont restés dehors. (...) Au nom de la gauche du Parti Socialiste Italien, je déclare que nous nous engageons à combattre et à chasser les opportunistes en Italie, mais nous ne voudrions pas que s'ils sortent de chez nous, ils rentrent dans la III° Internationale par un autre chemin. Nous vous disons : ayant ici travaillé ensemble, nous devons rentrer dans nos pays et former un front international unique contre les socialistes traîtres, contre les saboteurs de la Révolution Communiste."[15]
Certes, les 21 conditions servaient d’épouvantails contre les éléments opportunistes susceptibles de frapper à la porte du parti. Mais, même si Lénine pouvait affirmer que le courant de gauche était "mille fois moins dangereux et moins grave que l’erreur représentée par le doctrinarisme de droite...", les multiples pas en arrière sur la question de tactique fragilisaient fortement l’Internationale, tout particulièrement face à la période à venir caractérisée par le repli et l’isolement, contrairement à ce que pensait la direction de l’IC. Inexorablement, ces gardes fous ne permettront pas à l’IC de résister à la pression de l’opportunisme. En 1921 le troisième congrès succombait définitivement au mirage du nombre en adoptant les Thèses sur la tactique de Lénine [845], qui préconisaient le travail au parlement et dans les syndicats ainsi que la constitution de partis de masses. Par ce virage à 180°, le parti jetait par la fenêtre le programme du KPD de 1918, une des deux bases de fondation de l’IC.
L’IC, malade du gauchisme[16] ou de l’opportunisme ?
C’est en opposition à la politique opportuniste du KPD que naquit le KAPD en avril 1920. Bien que son programme s’inspirait davantage des thèses de la gauche en Hollande plutôt que de celles de l’IC, il demanda d’emblée à être rattaché immédiatement à la IIIe Internationale.
Lorsque Jan Appel et Franz Jung[17] arrivèrent à Moscou, Lénine leur remit le manuscrit de ce qui deviendra La maladie infantile du communisme : le gauchisme qu’il avait rédigé en vue du deuxième congrès pour exposer ce qui a ses yeux prouvait les "inconséquences" des courants de gauche.
La délégation hollandaise avait eu l’occasion de prendre connaissance de la brochure de Lénine au cours du IIe congrès de l’IC. Herman Gorter fut chargé de rédiger la Réponse à Lénine sur "la maladie infantile du communisme" qui parut en juillet 1920. Gorter s’appuyait beaucoup sur le texte rédigé par Pannekoek quelques mois plus tôt intitulé Révolution mondiale et tactique communiste. Il ne s’agit pas ici de revenir en détails sur cette polémique.[18] Cependant, il faut faire remarquer que les différents éléments soulevés font parfaitement écho à la question de fond : l’entrée dans l’ère des guerres et des révolutions imposait-elle de nouveaux principes dans le mouvement révolutionnaire ? Ou les "compromis" étaient-ils encore possibles ?
Pour Lénine, le "doctrinarisme" des gauches constituait une "maladie de croissance". Ces "jeunes communistes" encore "inexpérimentés" cédaient à l’impatience et se laissaient aller à des "enfantillages d’intellectuels" au lieu de défendre "la tactique sérieuse d’une classe révolutionnaire" en fonction de la "particularité de chaque pays", tout en prenant en compte le mouvement général de la classe ouvrière.
Pour Lénine, rejeter le travail dans les syndicats et dans les parlements, s’opposer à des alliances entre les partis communistes et les partis sociaux-démocrates relevaient d’une pure absurdité. Selon lui, l’adhésion des masses au communisme ne dépendait pas seulement de la propagande révolutionnaire. Il considérait que ces mêmes masses devaient faire "leur propre expérience politique". Pour cela, il était indispensable d’en enrôler le plus grand nombre dans les organisations révolutionnaires, quel que soit leur niveau de clarté politique. Les conditions objectives étaient mûres, la voie de la révolution était toute tracée...
Seulement voilà, comme le fit remarquer Gorter dans sa réponse, la victoire de la révolution mondiale dépendait surtout des conditions subjectives, autrement dit de la capacité de la classe ouvrière mondiale à étendre et approfondir sa conscience de classe. La faiblesse de cette conscience de classe générale s’illustrait par la quasi-absence de véritables avant-gardes du prolétariat en Europe occidentale comme le signalait Gorter. Par conséquent, l’erreur des bolcheviks dans l’IC fut "de vouloir rattraper ce retard en cherchant des raccourcis tactiques qui se sont exprimés par le fait de sacrifier la clarté et le processus de développement organique au forcing de la croissance numérique à tout prix." [19]
Cette tactique, reposant sur la quête du succès instantané, était animée par le constat que la révolution ne se développait pas assez vite, que la classe mettait trop de temps à étendre sa lutte et que, face à cette lenteur, il fallait faire des "concessions" en acceptant un travail dans les syndicats et dans les parlements.
Alors que l’IC voyait en quelque sorte la révolution comme un phénomène inéluctable, les courants de gauche considéraient que "la révolution en Europe de l’Ouest [serait] un processus de longue durée" (Pannekoek) qui serait parsemé de reculs et de défaites pour reprendre les termes de Rosa Luxemburg. L’histoire a confirmé les positions développées par les courants de gauche au sein de l’IC. Le "gauchisme" n’était donc pas une maladie de jeunesse du mouvement communiste mais au contraire une saine réaction à l’infection opportuniste qui gagnait les rangs du parti mondial.
Conclusion
Quelles leçons peut-on donc tirer de la création de l’Internationale Communiste ? Si le premier congrès avait montré la capacité du mouvement révolutionnaire à rompre avec la 2ème Internationale, les congrès suivants marquaient un véritable recul. En effet, alors que le congrès de fondation avait reconnu le passage de la social-démocratie dans le camp de la bourgeoisie, le troisième congrès la réhabilitait ou faisait oublier son rôle anti-ouvrier en prônant une tactique d’alliance avec celle-ci dans le "Front unique". Ce changement de cap confirmait que l’IC était incapable de répondre aux nouvelles questions posées par la période de décadence. Les années qui suivent sa fondation, sont marquées par le recul et la défaite de la vague révolutionnaire internationale et donc par l’isolement croissant du prolétariat en Russie. Cet isolement est la raison déterminante de la dégénérescence de la révolution. Dans ces conditions, mal armée, l’IC était incapable de résister au développement de l’opportunisme. Elle aussi devait se vider de son contenu révolutionnaire et devenir un organe de la contre-révolution œuvrant pour les seuls intérêts de l’État soviétique.
C’est au sein même de l’IC que sont apparues les fractions de gauche afin de lutter contre sa dégénérescence. Exclues l’une après l’autre au cours des années 20, elles ont poursuivi le combat politique afin d’assumer la continuité entre l’IC dégénérescente et le "parti de demain" en tirant les leçons de l’échec de la vague révolutionnaire. Les positions défendues et élaborées par ces groupes répondaient aux problèmes soulevés dans l’IC par la période de décadence. Outre les questions programmatiques, les gauches s’accordaient sur le fait que le parti doit "rester un noyau aussi résistant que l’acier, aussi pur que le cristal" [Gorter]. Cela implique une sélection rigoureuse des militants au lieu de regrouper d’énormes masses au détriment de l’édulcoration des principes. C’est justement cela que les bolcheviks avaient laissé tomber en 1919 lors de la création de l’Internationale Communiste. Ces transigeances sur la méthode de la construction de l’organisation constitueront également un facteur actif de la dégénérescence de l’IC. Comme le soulignait Internationalisme en 1946 : "On peut aujourd'hui affirmer que de même que l'absence des partis communistes lors de la première vague de la révolution de 1918-20 fut une des causes de son échec, de même la méthode de formation des Partis de 1920-21 fut une des causes principales de la dégénérescence des PC et de l'IC."[20] En privilégiant la quantité au détriment de la qualité, les bolcheviques remettaient en partie en cause le combat qu’ils avaient mené en 1903 lors du deuxième congrès du POSDR. Pour les gauches qui se battaient pour la clarté programmatique et organisationnelle comme préalable à l’adhésion à l’IC, le "petit nombre" n’était pas une vertu éternelle mais une étape indispensable : "Si...nous avons le devoir de nous renfermer pour un temps encore dans le petit nombre, ce n’est pas parce que nous éprouvons pour cette situation une prédilection particulière, mais parce que nous devons en passer par là pour devenir forts" [Gorter].
Hélas, l’IC avait vu le jour dans la précipitation et le feu des combats révolutionnaires. Dans ces conditions, il lui était impossible de clarifier du jour au lendemain l’ensemble des questions auxquelles elle devait se confronter. Le parti de demain ne devra pas tomber dans les mêmes travers. Il devra être fondé avant que la vague révolutionnaire ne déferle, en s’appuyant sur de solides bases programmatiques mais également sur des principes de fonctionnement réfléchis et clarifiés auparavant. Ce qui ne fut pas le cas de l’IC en son temps.
Narek, le 8 juillet 2019.
[1] Lire notre article Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial [383], Revue internationale n° 80, 1995
[2] Lénine, discours de clôture du 1er congrès de l’Internationale Communiste.
[3] La gauche hollandaise. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire, CCI.
[4] La Gauche Communiste d’Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire, CCI, p.19.
[5] Op. Cit., La gauche hollandaise, p105.
[6] Voir "Leçons de la vague révolutionnaire 1917-1923", Revue Internationale n°80.
[7] Cité par Prudhommeaux, Spartacus et la Commune de Berlin, 1918-1919, Spartacus, p. 55.
[8] "Adresse aux syndicats de tous les pays", Du 1er au 2ème Congrès de l'IC, Ed. EDI.
[9] "Programme du KAPD", in Ni parlement ni syndicats : les Conseils ouvriers ! Le communisme de gauche dans la Révolution allemande (1918-1922), Les nuits rouges, 2003.
[10] À l’automne 1919, l’IC mit en place un secrétariat provisoire siégeant en Allemagne composé de la droite du KPD. Et un bureau provisoire en Hollande qui regroupait les communistes de gauche hostiles au virage à droite du KPD.
[11] Cette "guerre révolutionnaire" avait constitué un choix politique catastrophique puisque la bourgeoisie polonaise avait pu l’utiliser pour dresser une partie de la classe ouvrière polonaise contre la République des soviets
[12] Préambule aux conditions d’admission des Partis dans l’Internationale Communiste.
[13] Voilà ce que stipulait le point 14 des "Tâches principales de l’Internationale Communiste" : "Le degré de préparation du prolétariat des pays les plus importants, au point de vue de l'économie et de la politique mondiales, à la réalisation de la dictature ouvrière se caractérise avec le plus d'objectivité et d'exactitude, par le fait que les partis les plus influents de la IIe Internationale, tels que le Parti Socialiste Français, le Parti Social-Démocrate Indépendant Allemand, le Parti Ouvrier Indépendant Anglais, le Parti Socialiste Américain sont sortis de cette Internationale Jaune et ont décidé, sous condition, d'adhérer à la IIIe Internationale. [...] L'essentiel maintenant est de savoir achever ce passage et solidement affermir par l'organisation ce qui a été obtenu, afin qu'il soit possible d'aller de l'avant sur toute la ligne sans la moindre hésitation."
[14] Respectivement les social-patriotes et les sociaux-démocrates, "ces socialistes de la IIe Internationale qui voyaient la possibilité de l'émancipation du prolétariat, sans une lutte de classes poussée jusqu'au recours aux armes, sans la nécessité de réaliser la dictature du prolétariat après la victoire, dans la période insurrectionnelle". (Voir note 15)
[15] A. Bordiga, Discours au IIe congrès de l’IC sur les conditions d’admission [846].
[16] Ce terme correspond ici au courant communisme de gauche qui est apparu au sein même de l’IC en opposition au centrisme et à l’opportunisme qui gagnait peu à peu le parti. Il n’a rien à voir avec le terme actuel qui correspond aux organisations appartenant à la gauche du capital.
[17] Ce sont les deux délégués mandatés par le KAPD au IIe congrès de l’IC pour exposer le programme du parti.
[18] Pour plus de précisions, voir : Op. Cit., La gauche hollandaise, chapitre IV : "La gauche hollandaise dans la 3e Internationale".
[19] Op. Cit., La gauche hollandaise, p 119.
[20] Internationalisme n° 7, À propos du Premier Congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie [847] Republié dans la Revue internationale n° 162.
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [669]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [135]
Rubrique:
Il y a cinquante ans, Mai 68 - La difficile évolution du milieu politique prolétarien (I)
- 217 lectures
Introduction
Le 100e anniversaire de la fondation de l'Internationale Communiste nous rappelle que la révolution d'Octobre en Russie avait placé la révolution prolétarienne mondiale à l'ordre du jour immédiat. La révolution allemande, en particulier, était déjà en marche et était cruciale à la fois pour la survie du pouvoir des soviets en Russie et pour l'extension de la révolution aux principaux centres du capitalisme. A ce moment-là, tous les différents groupes et tendances qui étaient restés fidèles au marxisme révolutionnaire étaient convaincus que la formation et l'action du parti de classe étaient indispensables à la victoire de la révolution. Mais avec le recul, on peut dire que la formation tardive de l'IC -près de deux ans après la prise du pouvoir en Russie et plusieurs mois après le début de la révolution en Allemagne- ainsi que ses ambiguïtés et ses erreurs sur des questions programmatiques et organisationnelles essentielles, ont également été un élément de la défaite de la vague révolutionnaire internationale.
Nous devons garder cela à l'esprit lorsque nous repensons à un autre anniversaire : Mai 68 en France et la vague de mouvements de classe qui s'ensuit. Dans les deux articles précédents de cette série, nous nous sommes penchés sur la signification historique de ces mouvements, expressions du réveil de la lutte de classe après des décennies de contre-révolution : la contre-révolution provoquée par l'anéantissement des espoirs révolutionnaires de 1917-23. Nous avons essayé de comprendre à la fois les origines des événements de mai 68 et le cours de la lutte des classes au cours des cinq décennies à venir, en nous concentrant en particulier sur les difficultés que rencontre la classe pour se réapproprier la perspective de la révolution communiste.
Dans cet article, nous voulons nous pencher spécifiquement sur l'évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968, et comprendre pourquoi, malgré des avancées considérables au niveau théorique et programmatique depuis la première vague révolutionnaire, et malgré le fait que les groupes prolétariens les plus avancés aient compris qu'il est nécessaire de prendre les mesures essentielles pour la formation d'un nouveau parti mondial avant les confrontations décisives avec le système capitaliste, cet horizon semble encore très lointain et parfois disparaître complètement de la scène.
1968-80 : Le développement d'un nouveau milieu révolutionnaire rencontre les problèmes du sectarisme et de l'opportunisme
Le renouveau global de la lutte de classe à la fin des années 1960 a entraîné un renouveau global du mouvement politique prolétarien, l'éclosion de nouveaux groupes cherchant à réapprendre ce qui avait été détruit par la contre-révolution stalinienne, ainsi qu'une certaine réanimation des rares organisations qui avaient survécu à cette période noire.
On peut se faire une idée des composantes de ce milieu en regardant la liste très diversifiée des groupes contactés par les camarades d’Internationalism aux Etats-Unis dans le but de mettre en place un Réseau de Correspondance International[1] :
- USA : Internationalism et Philadelphia Solidarity
- Grande-Bretagne : Workers Voice, Solidarity
- France : Révolution Internationale, Groupe de Liaison Pour l'Action des Travailleurs, Le Mouvement Communiste
- Espagne : Fomento Obrero Revolucionario
- Italie : Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista)
- Allemagne : Gruppe Soziale Revolution ; Arbeiterpolitik ; Revolutionärer Kampf
- Danemark : Proletarisk Socialistisk Arbejdsgruppe, Koministisk Program
- Suède : Komunismen
- Pays-Bas : Spartacus ; Daad en Gedachte
- Belgique : Lutte de Classe, groupe "Bilan"
- Venezuela : Internacionalismo.
Dans son introduction, Internationalism a ajouté qu'un certain nombre d'autres groupes les avaient contactés pour demander à y participer : World Revolution, qui s'était entre-temps séparé du groupe Solidarity au Royaume-Uni ; Pour le Pouvoir International des Conseils Ouvriers et Les Amis de 4 Millions de Jeunes Travailleurs (France) ; Internationell Arbearkamp (Suède); Rivoluzione Comunista et Iniziativa Comunista (Italie).
Tous ces courants n'étaient pas le produit direct des luttes ouvertes de la fin des années 60 et du début des années 70 : beaucoup les avaient précédés, comme dans le cas de Battaglia Comunista en Italie et du groupe Internacialismo au Venezuela. D'autres groupes qui s'étaient développés avant les luttes ont atteint leur apogée en 68 environ et ont ensuite décliné rapidement - l'exemple le plus évident étant les situationnistes. Néanmoins, l'émergence de ce nouveau milieu d'éléments à la recherche de positions communistes a été l'expression d'un processus profond de croissance "souterraine", d'une désaffection croissante pour la société capitaliste qui a affecté à la fois le prolétariat (et cela a aussi pris la forme de luttes ouvertes comme les mouvements de grève en Espagne et en France avant 68) et de larges couches de la petite bourgeoisie qui était elle-même déjà en voie d'être prolétarisée. En effet, la rébellion de ces dernières couches en particulier avait déjà pris une forme ouverte avant 68 - notamment la révolte dans les universités et les protestations étroitement liées contre la guerre et le racisme qui ont atteint les niveaux les plus spectaculaires aux Etats-Unis et en Allemagne, et bien sûr en France où la révolte des étudiants a joué un rôle évident dans le déclenchement du mouvement explicitement ouvrier en mai 68. La réémergence massive de la classe ouvrière après 68, cependant, a donné une réponse claire à ceux qui, comme Marcuse, avaient commencé à théoriser sur l'intégration de la classe ouvrière dans la société capitaliste et son remplacement comme avant-garde révolutionnaire par d'autres couches, comme les étudiants. Elle réaffirmait que les clés de l'avenir de l'humanité sont entre les mains de la classe exploitée comme elle l'avait fait en 1919, et convainc de nombreux jeunes révoltés et éléments en recherche, quelle que soit leur formation sociologique, que leur propre avenir politique réside dans la lutte ouvrière et dans le mouvement politique organisé de la classe ouvrière.
Le lien profond entre la résurgence de la lutte de classe et cette couche nouvellement politisée confirme l'analyse matérialiste développée dans les années 1930 par la Fraction italienne de la Gauche communiste : le parti de classe n'existe pas en dehors de la vie de la classe. C'est bien sûr un facteur vital et actif dans le développement de la conscience de classe, mais c'est aussi un produit de ce développement, et il ne peut exister dans les périodes où la classe a connu une défaite historique mondiale comme dans les années 20 et 30. Les camarades de la Gauche italienne avaient fait l'expérience de cette vérité dans leur chair et dans leur sang puisqu'ils avaient vécu une période qui avait vu la dégénérescence des partis communistes et leur récupération par la bourgeoisie, et la réduction des véritables forces communistes en petits groupes assiégés tels que le leur. Ils en tirent la conclusion que le parti ne pourra réapparaître que lorsque la classe dans son ensemble se sera remise de sa défaite à l'échelle internationale et posera à nouveau la question de la révolution : la tâche principale de la fraction est donc de défendre les principes du communisme, de tirer les leçons des défaites passées et d'agir comme un pont vers le nouveau parti qui sera formé lorsque le cours de la lutte de classe sera profondément modifié. Et quand un certain nombre de camarades de la Gauche italienne oublièrent cette leçon essentielle et se précipitèrent en Italie pour former un nouveau parti en 1943 quand, malgré certaines expressions importantes de révolte prolétarienne contre la guerre, surtout en Italie, la contre-révolution régnait toujours en maître, les camarades de la Gauche Communiste de France prirent le flambeau abandonné par une Fraction italienne qui se dissout précipitamment dans le Parti Communiste Internationaliste (PCInt).
Mais comme, à la fin des années 60 et au début des années 70, la classe se débarrassait enfin des chaînes de la contre-révolution, que de nouveaux groupes prolétariens apparaissaient dans le monde et qu'il y avait une dynamique de débat, de confrontation et de regroupement entre ces nouveaux courants, la perspective de la formation du parti - pas dans l'immédiat, bien sûr - se trouvait à nouveau posée sérieusement.
La dynamique vers l'unification des forces prolétariennes a pris diverses formes, depuis les premiers voyages de Marc Chirik et d'autres du groupe Internacialismo au Venezuela pour relancer la discussion avec les groupes de la Gauche italienne, les conférences organisées par le groupe français Information et Correspondance Ouvrières (ICO), ou le réseau international de correspondance lancé par Internationalism. Ce dernier s'est concrétisé par les réunions de Liverpool et de Londres de différents groupes au Royaume-Uni (Workers Voice, World Revolution, Revolutionary Perspectives, qui s'était également séparé de Solidarity et était le précurseur de l'actuelle Communist Workers Organisation), avec RI et le GLAT de France.
Ce processus de confrontation et de débat n'a pas toujours été sans heurts : l'existence de deux groupes de la Gauche communiste en Grande-Bretagne - une situation que beaucoup d'éléments à la recherche d'une politique de classe trouvent extrêmement déroutante - aujourd'hui peut être attribuée à l'immaturité et à l'échec du processus de regroupement après les conférences au Royaume-Uni. Certaines des divisions qui ont eu lieu à l'époque n'étaient guère justifiées car elles étaient provoquées par des différences secondaires - par exemple, le groupe qui a formé Pour une Intervention Communiste (PIC) en France s'est séparé de RI très précisément à propos du moment où produire un tract à propos du coup d'Etat miliaire au Chili. Néanmoins, un véritable processus de décantation et de regroupement avait lieu. Les camarades de RI en France sont intervenus énergiquement dans les conférences d’Information et Correspondance Ouvrières pour insister sur la nécessité d'une organisation politique basée sur une plate-forme claire par opposition aux notions ouvriériste, conseilliste et "anti-léniniste" qui étaient extrêmement influentes à l'époque, et cette activité accéléra leur unification avec des groupes à Marseille (Cahiers des Communistes de Conseils) et Clermont-Ferrand. Le groupe RI a également été très actif au niveau international et sa convergence croissante avec WR, Internationalism, Internacialismo et de nouveaux groupes en Italie et en Espagne a conduit à la création du CCI en 1975, montrant la possibilité de s'organiser à une échelle internationale de manière centralisée. Le CCI se considérait, comme la GCF dans les années 1940, comme l'expression d'un mouvement plus large et ne voyait pas sa formation comme le point final du processus plus général de regroupement. Le nom "Courant" exprime cette approche : nous n'étions pas une fraction d'une ancienne organisation, bien que nous poursuivions une grande partie du travail des anciennes fractions, et nous faisions partie d'un courant plus large allant vers le parti du futur.
Les perspectives pour le CCI semblaient très optimistes : l'unification réussie de trois groupes en Belgique a permis de tirer les leçons de l'échec récent du Royaume-Uni, et certaines sections du CCI (en particulier en France et au Royaume-Uni) se sont considérablement accrues numériquement. WR, par exemple, a quadruplé par rapport à son noyau d'origine et RI comptait à un moment donné suffisamment de membres rien qu'à Paris pour qu'il existe une section nord et une section sud dans cette ville. Bien sûr, nous parlons encore de très petits nombres, mais c'était néanmoins une expression significative d'un réel développement dans la conscience de classe. Entre-temps, le Parti Communiste International bordiguiste (Programma/Le Prolétaire) a créé des sections dans un certain nombre de nouveaux pays et est rapidement devenu la plus grande organisation de la Gauche communiste.
Et la mise en place des conférences internationales de la Gauche communiste, initialement convoquées par Battaglia et soutenues avec enthousiasme par le CCI, a revêtu une importance particulière dans ce processus, bien que nous ayons critiqué la base initiale de l'appel pour les conférences (pour discuter du phénomène de "l'eurocommunisme", que Battaglia a appelé la "démocratisation sociale" des partis communistes).
Pendant environ trois ans, les conférences ont constitué un pôle de référence, un cadre de débat organisé qui a attiré vers elles des groupes d'horizons divers[2]. Les textes et les présentations des réunions ont été publiés dans une série de brochures ; les critères de participation aux conférences ont été plus clairement définis que dans l'invitation originale et les sujets débattus se sont davantage concentrés sur des questions cruciales telles que la crise capitaliste, le rôle des révolutionnaires, la question des luttes nationales, etc. Les débats ont également permis à des groupes partageant des perspectives communes de se rapprocher (comme dans le cas de CWO et de Battaglia, du CCI et de Fur Kommunismen en Suède).
Malgré ces développements positifs, cependant, le mouvement révolutionnaire renaissant a souffert de nombreuses faiblesses héritées de la longue période de contre-révolution.
D'une part, un grand nombre de ceux qui auraient pu être gagnés à la politique révolutionnaire ont été absorbés par l'appareil du gauchisme, qui s'était aussi considérablement développé dans le sillage des mouvements de classe après 68. Les organisations maoïstes et surtout trotskystes étaient déjà formées et offraient une alternative d’apparence radicale aux partis staliniens "officiels " dont le rôle de briseur de grève dans les événements de 68 et par la suite avait été évident. Daniel Cohn-Bendit, "Danny le Rouge", le célèbre leader étudiant de 68, avait écrit un livre attaquant la fonction du Parti Communiste et proposant une "alternative de gauche" qui se référait avec approbation à la Gauche Communiste des années 1920 et aux groupes conseillistes comme ICO à ce moment[3]. Mais comme tant d'autres, Cohn-Bendit a perdu patience à l'idée de rester dans le petit monde des véritables révolutionnaires et est parti à la recherche de solutions plus immédiates qui lui offraient aussi la possibilité d'une carrière, et il est aujourd'hui membre des Verts allemands qui a servi son parti au sein de l'Etat bourgeois... Sa trajectoire –depuis des idées potentiellement révolutionnaires jusqu’à l'impasse du gauchisme- a été celle suivie par plusieurs milliers d'éléments.
Mais certains des plus grands problèmes rencontrés par le milieu émergent étaient "internes", même s'ils reflétaient finalement la pression de l'idéologie bourgeoise sur l'avant-garde prolétarienne.
Les groupes qui avaient maintenu une existence organisée pendant la période de contre-révolution -en grande partie les groupes de la Gauche italienne- étaient devenus plus ou moins sclérosés. Les bordiguistes, en particulier des différents Partis Communistes Internationaux[4] s'étaient protégés contre la pluie perpétuelle de nouvelles théories qui "transcendaient le marxisme" en faisant du marxisme lui-même un dogme, incapable de répondre aux nouveaux développements, comme en témoigne leur réaction aux mouvements de classe après 68 -essentiellement la même que celle que Marx avait déjà tournée en dérision dans sa lettre à Ruge en 1843: "Voici la vérité (le Parti), à genoux !" Indissociable de la notion bordiguiste d'"invariance" du marxisme, on trouvait un sectarisme extrême[5] qui rejetait toute notion de débat avec d'autres groupes prolétariens, une attitude concrétisée dans le refus catégorique de tout groupe bordiguiste de participer aux conférences internationales de la Gauche Communiste. Mais si l'appel de Battaglia n'était qu'une petite avancée pour sortir de l'attitude consistant à considérer son propre petit groupe comme le seul gardien de la politique révolutionnaire, il n’était pas exempt lui-même d’une attitude sectaire: son invitation excluait initialement les groupes bordiguistes et n'était pas envoyée au CCI dans son ensemble, mais à sa section en France, trahissant une idée tacite que le mouvement révolutionnaire est fait de "franchises" séparées dans différents pays (Battaglia détenant bien évidemment la franchise italienne).
De plus, le sectarisme ne se limitait pas aux héritiers de la Gauche italienne. Les discussions sur le regroupement au Royaume-Uni en ont été torpillées. En particulier, Workers Voice, craignant de perdre son identité de groupe local basé à Liverpool, a rompu les relations avec la tendance internationale autour de RI et WR autour de la question de l'Etat dans la période de transition, qui ne pouvait être une question ouverte que dans le cadre d'un accord entre révolutionnaires sur les positions de classe essentielles du débat. La même recherche d'une excuse pour interrompre les discussions a ensuite été adoptée par RP et la CWO (produit d'une fusion éphémère de RP et de WV) qui ont déclaré que le CCI était contre-révolutionnaire parce qu'il n'acceptait pas que le parti bolchevique et l'IC aient perdu toute vie prolétarienne depuis 1921 et pas même un moment après. Le CCI était mieux armé contre le sectarisme parce qu'il tirait ses origines de la Fraction italienne et de la GCF, qui s'étaient toujours considérés comme faisant partie d'un mouvement politique prolétarien plus large et non comme le seul dépositaire de la vérité. Mais la convocation des conférences avait aussi mis en évidence des éléments de sectarisme dans ses propres rangs ; certains camarades avaient d'abord répondu à l'appel en déclarant que les bordiguistes et même Battaglia n'étaient pas des groupes prolétariens en raison de leurs ambiguïtés sur la question nationale. Il est significatif que le débat ultérieur sur les groupes prolétariens qui a conduit à une grande clarification du CCI[6] a été lancé par un texte de Marc Chirik qui avait été "formé" dans la Gauche italienne et française pour comprendre que la conscience de classe prolétarienne n'est en aucun cas homogène, même parmi les minorités les plus avancées politiquement, et que l'on ne peut déterminer la nature de classe d'une organisation indépendamment de son histoire et de sa réponse à des événements historiques majeurs, tels que la guerre ou la révolution.
Avec les nouveaux groupes, ces attitudes sectaires étaient moins le produit d'un long processus de sclérose que d'immaturité et d'une rupture avec les traditions et les organisations du passé. Ces groupes étaient confrontés à la nécessité de se définir par rapport à l'atmosphère dominante de la gauche, de sorte qu'une sorte qu'une certaine rigidité de pensée apparaissait souvent comme un moyen de défense contre le danger d'être aspirés par les organisations beaucoup plus importantes de la gauche bourgeoise. Et pourtant, en même temps, le rejet du stalinisme et du trotskysme prenait souvent la forme d'une fuite vers des attitudes anarchistes et conseillistes -ce qui manifestait non seulement la tendance à rejeter toute l'expérience bolchévique mais aussi une suspicion généralisée envers toute discussion sur la formation d'un parti prolétarien. Plus concrètement, de telles approches ont favorisé les conceptions fédéralistes de l'organisation, l'équation des formes centralisées d'organisation avec la bureaucratie et même le stalinisme. Le fait que de nombreux adhérents des nouveaux groupes étaient issus d'un mouvement étudiant beaucoup plus marqué par la petite bourgeoisie que le milieu étudiant d'aujourd'hui a renforcé ces idées démocratistes et individualistes, plus clairement exprimées dans le slogan néo-situationniste "le militantisme : stade suprême de l'aliénation"[7]. Le résultat de tout cela est que le mouvement révolutionnaire a passé des décennies à lutter pour comprendre la question de l'organisation, et ce manque de compréhension a été au cœur de nombreux conflits et divisions dans le mouvement. Bien sûr, la question de l'organisation a nécessairement été un champ de bataille constant au sein du mouvement ouvrier (comme en témoigne la scission entre marxistes et bakouninistes dans la Première Internationale, ou entre bolcheviks et menchéviks en Russie). Mais le problème de la réémergence du mouvement révolutionnaire à la fin des années 60 a été exacerbé par la longue rupture de continuité avec les organisations du passé, de sorte que nombre des leçons léguées par les luttes organisationnelles précédentes ont dû être réapprises presque de zéro.
C'est essentiellement l'incapacité du milieu dans son ensemble à surmonter le sectarisme qui a mené au blocage et finalement au sabotage des conférences[8]. Dès le début, le CCI avait insisté pour que les conférences ne restent pas muettes, mais qu'elles publient, dans la mesure du possible, un minimum de déclarations communes, afin de préciser au reste du mouvement les points d'accords et de désaccords qui ont été atteints, mais aussi -face à des événements internationaux majeurs comme le mouvement de classe en Pologne ou l'invasion russe en Afghanistan- qu'elles fassent des déclarations publiques communes sur des questions qui étaient déjà des critères essentiels pour les conférences, comme l'opposition à une guerre impérialiste. Ces propositions, soutenues par certains, ont été rejetées par Battaglia et la CWO au motif qu'il était "opportuniste" de faire des déclarations communes alors que d'autres divergences subsistent. De même, lorsque Munis et le FOR sont sortis de la deuxième conférence parce qu'ils refusaient de discuter de la question de la crise capitaliste, et en réponse à la proposition du CCI pour que soit faite une critique commune du sectarisme du FOR, BC a simplement rejeté l'idée que le sectarisme était un problème: le FOR était parti car il avait simplement des positions différentes, où donc était le problème ?
Il est clair que, sous ces divisions, il y avait des désaccords assez profonds sur ce que devrait être une culture prolétarienne du débat, et les choses ont atteint un point culminant lorsque BC et la CWO ont soudainement introduit un nouveau critère de participation aux conférences -une formulation sur le rôle du parti qui contenait des ambiguïtés sur sa relation au pouvoir politique qu'ils savaient inacceptables pour le CCI et qui l'excluait effectivement. Cette exclusion était elle-même une expression concentrée du sectarisme, mais elle montrait aussi que le revers de la médaille du sectarisme est l'opportunisme : d'une part, parce que la nouvelle définition "dure" du parti n'empêchait pas BC et la CWO de tenir une quatrième conférence grotesque à laquelle seuls eux-mêmes et les gauchistes iraniens de l'UCM (Unity of Communist Militants)[9] participèrent; et d'autre part, parce que, avec le rapprochement entre BC et la CWO, BC avait probablement estimé avoir retiré tout ce qui était possible des conférences, un exemple classique de sacrifice du futur du mouvement pour un profit immédiat. Et les conséquences de l'éclatement des conférences ont, en effet, été lourdes : la perte de tout cadre organisé de débat, de solidarité mutuelle et d'une pratique commune entre les organisations de la Gauche Communiste, qui n'a jamais été restaurée malgré des efforts occasionnels de travail commun dans les années suivantes.
Les années 1980 : crises dans le milieu
L'effondrement des conférences s'est rapidement révélé être l'un des aspects d'une crise plus large dans le milieu prolétarien, exprimée le plus clairement par l'implosion du PCI bordiguiste et "l'affaire Chénier" dans le CCI, qui a conduit plusieurs membres à quitter l'organisation, en particulier au Royaume-Uni.
L'évolution de la principale organisation bordiguiste, qui publiait Programma Comunista en Italie et Le Prolétaire en France (entre autres) a confirmé les dangers de l'opportunisme dans le camp prolétarien. Le PCI avait connu une croissance régulière tout au long des années 70 et était probablement devenu le plus grand groupe communiste de gauche au monde. Pourtant, sa croissance a été assurée dans une large mesure par l'intégration d'un certain nombre d'éléments qui n'avaient jamais vraiment rompu avec le gauchisme et le nationalisme. Certes, les profondes confusions du PCI sur la question nationale n'étaient pas nouvelles: il prétendait défendre les thèses du Deuxième Congrès de l'Internationale Communiste sur la solidarité avec les révoltes et les révolutions bourgeoises dans les régions coloniales. Les thèses de l'IC se révéleront très tôt fatalement défectueuses en elles-mêmes, mais elles contenaient certaines formulations visant à préserver l'indépendance des communistes face aux rébellions menées par les bourgeoisies nationales dans les colonies. Le PCI avait déjà pris des mesures dangereuses pour s'écarter de telles précautions, par exemple en saluant la terreur stalinienne au Cambodge comme un exemple de la vigueur nécessaire d'une révolution bourgeoise[10]. Mais les sections d'Afrique du Nord organisées autour du journal El Oumami sont allées encore plus loin, car face aux conflits militaires au Moyen-Orient, elles appelaient ouvertement à la défense de l'Etat syrien contre Israël. C'était la première fois qu'un groupe bordiguiste appelait sans vergogne à participer à une guerre entre États capitalistes. Il est significatif qu'il y ait eu de fortes réactions au sein du PCI contre ces positions, témoignant du fait que l'organisation a conservé son caractère prolétarien, mais le résultat final a été le départ de sections entières et de nombreux militants, réduisant le PCI à un groupe beaucoup plus restreint qui n'a jamais été capable de tirer tous les enseignements de ces événements.
Mais une tendance opportuniste est également apparue dans le CCI à l'époque - un regroupement qui, en réponse aux luttes de classe de la fin des années 70 et du début des années 80, a commencé à faire de sérieuses concessions au syndicalisme de base. Mais le problème posé par ce regroupement se situait surtout au niveau organisationnel, puisqu'il a commencé à remettre en cause le caractère centralisé du CCI et à faire valoir que les organes centraux devraient fonctionner principalement comme des boîtes aux lettres plutôt que comme des organes élus pour donner une orientation politique entre les réunions générales et les congrès. Cela n'impliquait pas que le groupement était uni par une profonde unité programmatique. En réalité, son existence était basée sur des liens affinitaires et des ressentiments communs contre l'organisation -en d'autres termes, c'était un "clan" secret plutôt qu'une tendance réelle, et dans une organisation immature il a donné naissance à un "contre-clan" dans la section britannique, avec des résultats catastrophiques. Et c'est l'élément douteux Chénier, qui avait l'habitude de voyager à travers des organisations révolutionnaires et d'y fomenter des crises, et qui se livrait à la manipulation la plus honteuse de ceux qui l'entouraient, qui attisait ces ressentiments et ces conflits. La crise a atteint son paroxysme à l'été 1981 lorsque des membres de la "tendance" sont entrés dans la maison d'un camarade alors qu'il était absent et ont volé du matériel à l'organisation au motif fallacieux qu'ils ne faisaient que récupérer l'investissement qu'ils avaient fait dans l'organisation. Cette tendance s'est transformée en un nouveau groupe qui s'est effondré après une seule publication, et Chénier est "retourné" au Parti Socialiste et à la CFDT -pour lesquels il avait travaillé depuis le début- probablement dans le "Secteur des Associations" qui surveille l'évolution des courants à gauche du PS.
Cette scission s'est heurtée à une réaction très inégale de la part du CCI dans son ensemble, en particulier après que l'organisation eut fait une tentative déterminée de récupérer son matériel volé en visitant les maisons des personnes soupçonnées d'être impliquées dans les vols et en demandant la restitution de ce matériel. Un certain nombre de camarades au Royaume-Uni ont simplement quitté l'organisation, incapables de faire face à la prise de conscience qu'une organisation révolutionnaire doit se défendre dans cette société, et que cela peut inclure l'action physique comme la propagande politique. Les sections d'Aberdeen/Edinburgh ont non seulement rapidement quitté les lieux, mais elles ont également dénoncé les actions du CCI et menacé d'appeler la police si elles faisaient elles-mêmes l'objet de visites (puisqu'elles avaient également conservé une certaine quantité de matériel appartenant à l'organisation, même si elles n'avaient pas été directement impliquées dans les premiers vols). Et lorsque le CCI a émis un avertissement public grandement nécessaire au sujet des activités de Chénier, ils se sont précipités pour défendre son honneur. Ce fut le début peu glorieux du Groupe Bulletin Communiste (CBG), dont les publications étaient largement consacrées aux attaques contre "le stalinisme" et même "la folie" du CCI. Bref, il s'agissait là d'un exemple précoce de parasitisme politique qui allait devenir un phénomène important au cours des décennies suivantes[11]. Dans le milieu prolétarien au sens large, il y avait peu ou pas d'expressions de solidarité avec le CCI. Au contraire, la version des événements du CBG circule toujours sur Internet et a une forte influence, en particulier sur le milieu anarchiste.
Nous pouvons citer d'autres expressions de crise dans les années qui ont suivi. Le bilan des groupes qui ont participé aux conférences internationales est essentiellement négatif : disparition de groupes qui n'avaient que récemment rompu avec le gauchisme (L'Éveil internationaliste, l'OCRIA, Marxist Workers Group aux États-Unis). D'autres ont été tirés dans la direction opposée : le NCI, une scission avec les bordiguistes qui avaient montré une certaine maturité en matière d'organisation lors des conférences, a fusionné avec le groupe Il Leninista et l’a suivi pour abandonner l'internationalisme avec une forme plus ou moins ouverte de gauchisme (OCI)[12]. Le Groupe Communiste Internationaliste, qui n'était venu à la troisième conférence que pour la dénoncer, exprimant déjà son caractère destructeur et parasitaire, a commencé à adopter des positions ouvertement réactionnaires (soutien aux maoïstes péruviens et à la guérilla salvadorienne, aboutissant à une justification grotesque des actions du "centriste Al-Qaida" et aux menaces physiques contre le CCI au Mexique[13]. Le GCI, quelles que soient ses motivations, est un groupe qui fait le travail de la police.... non seulement en menaçant de recourir à la violence contre les organisations prolétariennes, mais aussi en donnant l'impression qu'il existe un lien entre les groupes communistes authentiques et le milieu trouble du terrorisme.
En 1984, nous avons aussi vu la formation du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, réunissant la CWO et Battaglia. Le BIPR (aujourd'hui la TCI) s'est maintenu sur un terrain internationaliste, mais le regroupement s'est fait à notre avis sur une base opportuniste - une conception fédéraliste de groupes nationaux, un manque de débat ouvert sur les différences entre ces derniers, et une série de tentatives hâtives pour intégrer de nouvelles sections qui, dans la plupart des cas, aboutirent à un échec.[14]
1984-1985 a vu la scission du CCI qui a donné naissance à la "Fraction Externe du CCI". La FECCI a d'abord prétendu être le véritable défenseur de la plate-forme du CCI contre les prétendues déviations sur la question de la conscience de classe, l'existence de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier, le prétendu monolithisme et même le "stalinisme" de nos organes centraux, etc. En réalité, toute l'approche pour "retrouver le vrai programme" du CCI a été abandonnée très rapidement, ce qui montre que la FECCI n'était pas ce qu'elle pensait être: une véritable fraction pour lutter contre la dégénérescence de l'organisation originale. À notre avis, il s'agissait d'une autre formation clanique qui placent les liens personnels au-dessus des besoins de l'organisation et dont l'activité une fois qu'elle a quitté le CCI a fourni un autre exemple de parasitisme politique[15].
Le prolétariat, selon Marx, est une "classe de la société civile qui n'est pas une classe de la société civile", qui fait partie du capitalisme et qui lui est pourtant étrangère dans un sens[16]. Et l'organisation prolétarienne, qui incarne avant tout l'avenir communiste de la classe ouvrière, n'en est pas moins un corps étranger dans cette société en faisant partie du prolétariat. Comme l'ensemble du prolétariat, elle est soumise à la pression constante de l'idéologie bourgeoise, et c'est cette pression, ou plutôt la tentation de s'y adapter, de s'y concilier, qui est la source de l'opportunisme. C'est aussi la raison pour laquelle les organisations révolutionnaires ne peuvent pas vivre une vie "pacifique" au sein de la société capitaliste et sont inévitablement condamnées à traverser des crises et des divisions, alors que des conflits éclatent entre "l'âme" prolétarienne de l'organisation et ceux qui sont tombés sous l’emprise des idéologies d'autres classes sociales. L'histoire du bolchevisme, par exemple, est aussi une histoire de luttes politiques. Les révolutionnaires ne cherchent ni ne préconisent les crises, mais lorsqu'elles éclatent, il est essentiel de mobiliser ses forces pour défendre ses principes fondamentaux prolétariens s'ils sont ébranlés et lutter pour clarifier les divergences et leurs racines au lieu de fuir ces nécessités. Et bien sûr il est vital de tirer les leçons que ces crises portent inévitablement avec elles, afin de rendre l'organisation plus résistante dans le futur.
Pour le CCI, les crises ont été fréquentes et parfois très dommageables, mais elles n'ont pas toujours été entièrement négatives. Ainsi, la crise de 1981, à la suite d'une conférence extraordinaire en 1982, a conduit à l'élaboration de textes fondamentaux sur la fonction et le mode de fonctionnement des organisations révolutionnaires de cette époque[17], et elle a apporté des leçons vitales sur la nécessité permanente pour une organisation révolutionnaire de se défendre, non seulement contre la répression directe de l'Etat bourgeois, mais aussi contre des éléments douteux ou hostiles qui se font passer pour des éléments du mouvement révolutionnaire et peuvent même infiltrer ses organisations.
De même, la crise qui a conduit au départ de la FECCI a vu une maturation du CCI sur une série de questions clés: l'existence réelle de l'opportunisme et du centrisme comme maladies du mouvement ouvrier; le rejet des visions conseillistes de la conscience de classe comme étant purement un produit de la lutte immédiate (et donc la nécessité de l'organisation révolutionnaire comme expression principale de la dimension historique et profonde de la conscience de classe) ; et, liée à cela, la compréhension de l'organisation révolutionnaire comme une organisation de combat, apte à intervenir dans la classe à plusieurs niveaux: non seulement au niveau théorique et de la propagande, mais aussi de l’agitation, de fournir des orientations pour l'extension et l'auto-organisation de la lutte, de participer activement aux assemblées générales et aux groupes de lutte.
Malgré les éclaircissements apportés par le CCI en réponse à ses crises internes, ceux-ci ne garantissaient pas que le problème d'organisation, en particulier, était désormais résolu et qu'il n'y aurait plus de cas de rechute dans l'erreur. Mais au moins, le CCI a reconnu que la question de l'organisation était une question politique à part entière. D'un autre côté, le milieu en général n’a pas vu l'importance de la question organisationnelle. Les "anti-léninistes" de diverses tendances (anarchistes, conseillistes, modernistes, etc.) ont vu la tentative même de maintenir une organisation centralisée comme étant fondamentalement stalinienne, tandis que les bordiguistes ont commis l'erreur fatale de penser que le dernier mot avait été dit sur cette question et qu'il n'y avait plus rien à discuter. Le BIPR était moins dogmatique mais avait tendance à traiter la question de l'organisation comme secondaire. Par exemple, dans leur réponse à la crise qui a frappé le CCI au milieu des années 90, ils n'ont pas du tout abordé les questions d'organisation, mais ont fait valoir qu'elles étaient essentiellement un sous-produit des d’erreurs du CCI dans l’évaluation du rapport de force entre les classes.
Il ne fait aucun doute qu'une mauvaise appréciation de la situation mondiale peut être un facteur important dans les crises organisationnelles: dans l'histoire de la gauche communiste, par exemple, on peut citer l'adoption, par une majorité de la Fraction italienne, de la théorie de Vercesi sur l'économie de guerre, qui considère que la marche accélérée vers la guerre à la fin des années 1930 était la preuve que la révolution était imminente. Le déclenchement de la guerre impérialiste vit donc un désarroi total dans la Fraction.
De même, la tendance des groupes issus de la montée de 68 à surestimer la lutte de classe, à considérer la révolution comme étant "au coin de la rue", signifiait que la croissance des forces révolutionnaires dans les années 70 était extrêmement fragile: beaucoup de ceux qui avaient rejoint le CCI à cette époque n'avaient ni la patience ni la conviction pour tenir le cap quand il est devenu clair que la lutte pour la révolution était posée à long terme et que l’organisation révolutionnaire serait engagée dans une lutte permanente pour survivre, même lorsque la lutte de classe suivrait globalement un cours ascendant. Mais les difficultés résultant de cette vision immédiatiste des évènements mondiaux avaient aussi une composante organisationnelle majeure: non seulement dans le fait que, pendant cette période, les membres étaient souvent intégrés de manière rapide et superficielle, mais surtout dans le fait qu'ils étaient intégrés dans une organisation qui n'avait pas encore une claire vision de son rôle et sa fonction, et se voyait comme un mini parti, alors qu'il s'agissait surtout de se considérer comme un pont vers le futur parti communiste. L'organisation révolutionnaire dans la période qui a commencé en 1968 conservait ainsi de nombreuses caractéristiques d'une fraction communiste, même si elle n'avait pas de continuité organique directe avec les partis ou fractions du passé. Cela ne signifie pas du tout que nous aurions dû renoncer à l'intervention directe dans la lutte de classe. Au contraire, nous avons déjà soutenu que l'un des éléments clés du débat avec la tendance qui a formé la "Fraction Externe" était précisément l'insistance sur la nécessité d'une intervention communiste dans les luttes de classe -une tâche qui peut varier en ampleur et en intensité, mais qui ne disparaît jamais, dans différentes phases de la lutte de classe. Mais cela signifie que la plus grande partie de nos énergies a nécessairement été consacrée à la défense et à la construction de l'organisation, à l'analyse d'une situation mondiale en évolution rapide et à la préservation et à l'élaboration de nos acquisitions théoriques. Cette focalisation allait devenir encore plus importante dans les conditions de la phase de décomposition sociale à partir des années 1990, qui ont fortement accru les pressions et les dangers auxquels sont confrontées les organisations révolutionnaires, Nous examinerons l'impact de cette phase dans la seconde partie de cet article.
Amos
Annexe
Note introductive aux brochures contenant les textes et actes de la deuxième Conférence internationale des groupes de la gauche communiste, 1978, rédigées par le comité technique international :
"Avec cette première brochure, nous commençons la publication des textes de la Deuxième Conférence internationale des groupes de la gauche communiste, tenue à Paris les 11 et 12 novembre 1978 à l'initiative du Parti communiste international/Battaglia Comunista. Les textes de la première Conférence internationale, tenue à Milan les 30 avril et 1er mai 1977, ont été publiés en italien sous la responsabilité du PCI/BC et en français et anglais sous la responsabilité du CCI.
Le 30 juin 1977, le PCI /BC, conformément à ce qui avait été décidé à la Conférence de Milan et aux contacts ultérieurs avec le PCI et la CWO, a envoyé une lettre circulaire invitant les groupes suivants à une nouvelle conférence qui se tiendrait à Paris :
Courant communiste international (France, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Allemagne, Hollande, USA, Venezuela)
Communist Workers Organisation (Grande-Bretagne)
Parti communiste international (Programme communiste : Italie, France, etc.)
Il Leninista (Italie)
Nucleo Comunista Internazionalista (Italie)
Iniziativa Comunista (Italie)
Fomento Obrero Revolucionario (France, Espagne)
Pour Une Intervention Communiste (France)
Forbundet Arbetarmakt (Suède)
For Komunismen (Suède)
Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie
Kakamaru Ha (Japon)
Partito Comunista Internazionale/Il Partito Comunista (Italie)
Spartakusbond (Pays-Bas)
Dans le volume II, nous publierons cette lettre.
Parmi les groupes invités,
Spartakusbond et Kakamaru Ha n'ont pas répondu.
Programme communiste et Il Partito Comunista ont refusé de participer à travers des articles parus dans leurs publications respectives. Tous deux ont rejeté l'esprit de l'initiative ainsi que le contenu politique de l'initiative elle-même (en particulier sur le parti et les guerres de libération nationale).
Le PIC, à travers une lettre-document, a refusé de participer à une réunion basée sur la reconnaissance des deux premiers congrès de la Troisième Internationale, qu'il considère depuis le début comme étant essentiellement social-démocrate (voir Vol II).
Forbundet Arbetarmakt a rejeté l'invitation car elle doutait de pouvoir reconnaître les critères de participation (voir Vol II).
Iniziativa Comunista n'a pas donné de réponse écrite, et à la dernière minute -après avoir accepté de participer à une réunion conjointe de Battaglia et Il Leninista- a refusé de participer à la conférence, justifiant son attitude dans la publication de son bulletin qui a paru après la conférence de Paris.
Il Leninista. Bien qu'elle ait confirmé son accord de participation, elle n'a pas pu assister à la réunion en raison de problèmes techniques au moment où ils sont partis pour la réunion.
L'OCRIA des immigrés algériens en France n'a pas pu participer physiquement à la réunion pour des raisons de sécurité, mais a demandé à être considérée comme un groupe participant.
Le FOR, bien qu'il ait participé au début de la conférence -à laquelle il s'est présenté comme observateur en marge- s'est rapidement dissocié de la conférence, affirmant que sa présence était incompatible avec les groupes qui reconnaissent qu'il y a maintenant une crise structurelle du capital (voir vol II)".
Entre la deuxième et la troisième conférence, le groupe suédois För Komunismen était devenu la section suédoise du CCI et Il Nucleo et Il Leninista avaient fusionné pour devenir une seule organisation, Il Nuclei Leninisti.
La liste des groupes participants était la suivante : CCI, Battaglia, CWO, Groupe Communiste Internationaliste, L'Eveil Internationaliste, Il Nuclei Leninisti, OCRIA, qui a envoyé des contributions écrites. Le Marxist Worker's Group américain s'est associé à la conférence et aurait envoyé un délégué, mais il en a été empêché à la dernière minute.
[1] Publié dans Internationalism n°4, non daté, mais sorti vers 1973.
[2] Pour la liste des groupes qui y ont assisté ou ont soutenu les conférences, voir l'annexe.
[3] Obsolete Communism, the Left wing Alternative, Penguin 1969
[4] Ces groupes ont tous leur origine dans la scission de 1952 au sein du Parti communiste internationaliste en Italie. Le groupe autour de Damen a conservé le nom de Parti communiste internationaliste ; les "Bordiguistes" ont pris le nom de Parti communiste international, qui, après de nouvelles scissions, a correspondu à différentes organisations ayant chacune le même nom.
[5] Le sectarisme était un problème déjà identifié par Marx lorsqu'il écrivait : "La secte voit la justification de son existence et son point d'honneur non pas dans ce qu'elle a en commun avec le mouvement de classe mais dans le ‘schibboleth’ particulier qui la distingue du mouvement". Bien sûr, de telles formules peuvent être mal utilisées si elles sont prises hors contexte. Pour la gauche du capital, toute la Gauche Communiste est sectaire parce qu'elle ne se considère pas comme faisant partie de ce qu'elle appelle le "mouvement ouvrier" -des organisations comme les syndicats et les partis sociaux-démocrates dont la nature de classe a changé depuis l'époque de Marx. De notre point de vue, le sectarisme est aujourd'hui un problème entre organisations prolétariennes. Il n'est pas sectaire de rejeter les fusions prématurées ou l'adhésion qui couvrent des désaccords réels. Mais il est certainement sectaire de rejeter toute discussion entre groupes prolétariens ou d'écarter le besoin d'une solidarité de base entre eux.
[6] Ce débat a donné lieu à une résolution sur "Les groupes politiques prolétariens [848]" lors du deuxième Congrès du CCI, publiée dans la Revue internationale n° 11.
[7] Le début des années 70 voit aussi la montée de groupes "modernistes" qui commencent à mettre en doute le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière et qui ont tendance à considérer les organisations politiques, même lorsqu'elles sont clairement en faveur de la révolution communiste, comme de simples "rackets". Voir les écrits de Jacques Camatte. Ce sont les ancêtres de la tendance actuelle des "communisateurs". Un certain nombre de groupes contactés par Internationalism en 1973 sont partis dans cette direction et ont été irrémédiablement perdus: Mouvement Communiste en France (pas le groupe autonome existant, mais le groupe autour de Barrot/ Dauvé qui avait initialement fait une contribution écrite au meeting de Liverpool), Komunsimen en Suède et, dans un certain sens, Solidarity au Royaume-Uni qui partage avec ces autres groupes la grande fierté d'avoir dépassé le marxisme.
[8] "Le sectarisme, un héritage de la contre- révolution à dépasser [501]", Revue internationale n° 22.
[9] Une expression précoce de la tendance "hekmatiste" qui existe aujourd'hui sous la forme des partis communistes ouvriers d'Iran et d'Irak -une tendance qui est encore souvent décrite comme communiste de gauche mais qui est en fait une forme radicale du stalinisme. Voir notre article en anglais "Worker Communist Parties of Iran and Iraq : the dangers of radical stalinism [849]" "Les partis communistes ouvriers d'Iran et d'Irak : les dangers du stalinisme radical".
[10] Revue internationale n° 28, Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire [561], et Revue internationale n° 32, Le PCI (Programme Communiste) à un tournant de son histoire [850].
[11] Nous reviendrons sur le problème du parasitisme politique [851] dans la seconde partie de cet article.
[12] Organizzazione Comunista Internazionalista.
[14] Voir la Revue Internationale n° 121 : "BIPR : une politique opportuniste de regroupement qui ne mène qu'à des "avortements'" [852]"..
[15] Lire "La fraction externe du CCI [853]" dans la Revue internationale n° 45.
[16] Dans l'introduction à "Contribution à une critique de la philosophie du droit de Hegel"
[17] Voir les deux rapports sur la question de l'organisation de la Conférence extraordinaire de 1982 : sur la fonction de l'organisation révolutionnaire (Revue internationale n°29) et sur sa structure et son mode de fonctionnement (Revue internationale n°33).
Structure du Site:
- Séries [777]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [41]
Approfondir:
- Mai 1968 [718]
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud
- 294 lectures
De l’élection du président Nelson Mandela en 1994 à 2014
Dans l’introduction de l’article précédent[1], nous attirions d’emblée l’attention du lecteur sur l’importance des questions traitées en ces termes : "Si, face à de nouveaux mouvements sociaux la bourgeoisie s’appuie sur ces armes traditionnelles les plus barbares, à savoir ses forces policières et militaires, la dynamique de la confrontation entre les classes porte en elle des développements inégalés dans ce pays : la classe ouvrière n’y avait jamais encore fait preuve d’une telle combativité et d’un tel niveau de conscience ; face à une bourgeoisie qui, elle non plus, n’avait jamais à ce point sophistiqué ses manœuvres, notamment en ayant largement recours à l’arme du syndicalisme de base animé par l’extrême gauche du capital. Dans cet affrontement entre les deux véritables classes historiques, la pugnacité du prolétariat ira jusqu’à provoquer objectivement le démantèlement du système d’apartheid se traduisant par la réunification de toutes les fractions de la bourgeoisie en vue de faire face à la déferlante de la lutte de classe ouvrière."
Et par la suite nous avons pu montrer en détail l’ampleur de la combativité et du développement de la conscience de classe au sein du prolétariat sud-africain s’exprimant, par exemple, par la prise en main de ses luttes à travers des comités de lutte dits "CIVICS" (Community Based Organisations) par centaines. De même que nous avons illustré comment la bourgeoisie a pu parvenir finalement à bout de la magnifique combativité de la classe ouvrière sud-africaine en s’appuyant sur ses principaux piliers à savoir le "pouvoir blanc" (sous l’apartheid), l’ANC et le syndicalisme radical. En effet, le bilan global de ce combat entre la classe ouvrière et la bourgeoisie montre le rôle de premier plan joué par le syndicalisme de base dans le détournement des luttes véritablement prolétariennes sur le terrain bourgeois[2] :
Parlant du syndicalisme radical, nous disions "Mais sa contribution principale fut incontestablement le fait d’avoir réussi à construire sciemment le piège "démocratique/unité nationale" dans lequel la bourgeoisie put entraîner la classe ouvrière. D’ailleurs, en profitant de ce climat d’ "euphorie démocratique" résultant largement de la libération de Mandela et compagnie en 1990, le pouvoir central dut s’appuyer sur son "nouveau mur syndical" que constitue le COSATU et son "aille gauche" pour dévoyer systématiquement les mouvements de lutte sur des revendications d’ordre "démocratique", "droits civiques", "égalités raciales", etc. (…) Et de fait, entre 1990 et 1993 où d’ailleurs un gouvernement d’ "union nationale de transition" fut formé, les grèves et les manifestations se faisaient rares ou restaient sans effets sur le nouveau pouvoir. (…) D’ailleurs, tel était l’objectif central du projet de la bourgeoisie quand elle décida le processus qui aboutit au démantèlement de l’apartheid et à la "réconciliation nationale" entre toutes ses fractions qui s’entretuaient sous l’apartheid.
Ce projet sera mis en œuvre fidèlement par Mandela et l’ANC entre 1994 et 2014, y compris en massacrant nombre d’ouvriers résistant à l’exploitation et à la répression."
Dans cet article, nous allons nous efforcer de montrer comment le projet de l’ANC a été mis en œuvre méthodiquement par ses dirigeants successifs, en premier lieu Nelson Mandela. Nous montrerons, bien sûr, dans quelle mesure la classe ouvrière sud-africaine a pu faire face au nouveau "pouvoir noir" après avoir combattu l’ancien "pouvoir blanc", car comme nous le verrons plus loin, le prolétariat sud-africain n’avait pas perdu sa combativité se heurtant cependant à de nombreuses et lourdes difficultés. Ainsi, en plus de sa lutte quotidienne pour l’amélioration de ses conditions de vie, il doit alors se confronter aussi à la maladie, comme le SIDA avec ses ravages terribles, à la corruption du pouvoir en place, aux multiples violences sociales liées à la décomposition du système capitaliste, sous forme de meurtres, de pogroms, etc. D’autre part, comme avant Mandela, il continue à faire face à un pouvoir répressif, sanguinaire, celui-là même qui a causé la mort de nombreux mineurs de Marikana en 2012. Il n'en reste pas moins que le prolétariat sud-africain a d’ores et déjà montré sa capacité à jouer un rôle important en tant que fraction du prolétariat mondial en vue de la révolution communiste.
L’ANC dans l’exercice du pouvoir sud-africain
Au terme de la période du "gouvernement de transition", des élections générales furent organisées en 1994 et remportées triomphalement par l’ANC qui accéda ainsi à tous les leviers du pouvoir pour gouverner le pays selon les orientions du capital national sud-africain avec le soutien, ou la bienveillance, des principaux dirigeants sud-africains blancs qui l’avaient combattu.
Dès lors les choses sérieuses purent commencer pour Mandela, à savoir le redressement de l’économie nationale rudement malmenée par la crise économique à cette époque, mais aussi par les conséquences de la résistance ouvrière à l’exploitation. De fait, dès sa première année d’exercice en 1995, le gouvernement Mandela décida une série de mesures d’austérité dont une baisse de 6 % des salaires des fonctionnaires et de 10 % du budget de la santé. Dès cet instant, la question se posait de savoir comment la classe ouvrière allait réagir face aux attaques du nouveau pouvoir.
Premier mouvement de grèves sous l’ère du président Mandela
Contre toute attente et bien qu’assommée par la propagande autour de "l’union nationale" ou encore de la "nouvelle ère démocratique", la classe ouvrière ne put laisser passer sans réaction une attaque si agressive. En clair, on assista ainsi à l’éclatement des premiers mouvements de grève sous le gouvernement Mandela, notamment dans les transports et dans la fonction publique. Pour sa part, comme elle s’y attendait, la nouvelle bourgeoisie au pouvoir ne tarda pas à montrer son vrai visage de classe dominante en réprimant violemment les grévistes dont un millier d’entre eux furent arrêtés sans compter le nombre des blessés par les chiens policiers. Par ailleurs, parallèlement à la répression policière gouvernementale, le Parti communiste sud-africain et la centrale syndicale COSATU (Congress of South Africa Trade Unions), tous deux membres du gouvernement, à défaut de pouvoir empêcher l’éclatement des grèves, se mirent à dénoncer violemment les grévistes en les accusant de saboter la politique du "redressement" et de "réconciliation" du pays. À noter à ce propos un fait important : pendant que les dirigeants syndicaux du COSATU en compagnie du gouvernement dénonçaient et réprimaient les grévistes, des syndicalistes de base restaient "collés" aux ouvriers en prétendant les défendre contre la répression qui s’abattait sur eux. Il faut voir là une certaine habilité du nouveau pouvoir car, tout en associant le COSATU à la gestion des affaires du capital, il n’a pas oublié l’importance de s’appuyer sur un solide instrument d’encadrement des luttes ouvrières que constitue le "syndicalisme de base" dont un grand nombre de ceux qui gouvernent avaient fait l’expérience pratique[3].
L’ANC déploie un nouveau dispositif idéologique pour détourner combativité ouvrière
Tout en poursuivant l’application de ses mesures d’austérité, la nouvelle équipe gouvernementale se lançait dans des manœuvres idéologiques dans le but de mieux les faire accepter en créant des structures prétendant donner une légitimité à son orientation économique et politique. Ainsi, sous couvert de la "Truth and Reconciliation Commission" (TRC – "Commission Vérité et Réconciliation"), le gouvernement Mandela présenta en 1996 un programme intitulé "reconstruction négociation et réconciliation", puis un autre l’année suivante appelé (SCER - "stratégie de croissance, d’emploi et de redistribution"). En fait, derrière ces gadgets, se cachait la même orientation économique initiale dont l’application ne pouvait qu’aggraver les conditions de vie de la classe ouvrière. Dès lors, pour le pouvoir en place, la question était de savoir comment faire passer la "pilule" auprès des masses ouvrières dont une partie venait de manifester énergiquement son refus de telles mesures d’austérité. Et dans ce sens, devant la crainte d’une réaction ouvrière en opposition au plan gouvernemental, on assista d’abord à l’expression ouverte de divergences (tactiques) au sein de l’ANC :
"(…) La ligne politique de l’ANC est-elle encore vraiment au service de ses anciens partisans, au service du plus grand nombre, en particulier les plus démunis, comme il le revendique ? Le COSATU et le SACP (Parti communiste sud-africain) le mettent en doute de plus en plus, souvent, même si ce n’est pas frontalement. Ils reprochent à l’ANC de ne pas représenter les intérêts des plus pauvres, en particulier les ouvriers, de se désintéresser de la création d’emplois et de ne pas prêter suffisamment d’attention à l’accès de tous les citoyens à des conditions de vie correctes. (…) Cette critique a été abondamment relayée par les intellectuels de gauche et souvent de manière virulente. (…) Ces divergences de points de vue suscitent néanmoins des interrogations et des débats. Faut-il un parti ouvrier pour représenter en propre les intérêts ouvriers ? Le SACP (South African Communit Party ) a ainsi évoqué un temps la perspective d’une candidature autonome aux élections et certains au sein du COSATU ont même ébauché un projet de parti des ouvriers."[4]
Comme on peut le voir avec cette citation, l’équipe gouvernementale étale publiquement ses divisions. Mais il s’agit avant tout d’une manœuvre ou plus classiquement d’une division du travail entre la droite et la gauche au sommet du pouvoir dont le but principal était de faire face aux éventuelles réactions ouvrières[5]. Autrement dit, les menaces de scission pour créer un "parti ouvrier pour représenter les intérêts ouvriers" relevaient avant tout du cynisme politique trompeur visant à dévoyer la réflexion et la combativité de la classe ouvrière.
Toujours est-il que le gouvernement de Mandela décida de poursuivre sa politique d’austérité en prenant avec vigueur toutes mesures nécessaires pour le redressement de l’économie sud-africaine. Autrement dit, plus question de lutte de "libération nationale" ou de "défense des intérêts des plus pauvres" prônée hypocritement par la gauche de l’ANC. Et, dans un premier temps, cette politique d’austérité économique, de répression et d’intimidation de la part du "nouveau pouvoir du peuple" a eu un impact sur la classe ouvrière en provoquant de grandes désillusions et de l’amertume dans ses rangs. Il s’en est alors suivi une période de relative paralysie de la classe ouvrière face à la persistance des attaques économiques du gouvernement de l’ANC. En effet, d’un côté, une bonne partie des ouvriers africains, qui espéraient accéder plus vite aux mêmes droits/avantages que leurs camarades blancs, se lassaient d’attendre. D’un autre côté, ces derniers, avec leurs syndicats racistes (certes très minoritaires) menaçaient de prendre les armes pour la défense de leurs "acquis" (divers privilèges accordés sous l’apartheid).
Voilà une situation qui ne put favoriser objectivement la lutte et encore moins l’unité de la classe ouvrière. Heureusement, cette période ne fut que de courte durée, car trois ans après sa première réaction contre les premières mesures d’austérité du gouvernement de l’ANC sous Mandela, la classe ouvrière finit de nouveau par réagir en reprenant le combat mais beaucoup plus massivement que précédemment.
En 1998 : premières luttes massives contre le gouvernement de Mandela
En effet, encouragé sans doute par la manière dont il avait maîtrisé la situation face au premier mouvement de grèves de son règne contre ses premières mesures d’austérité, le gouvernement de l’ANC en remit une couche plus rude. Mais sans s’en rendre compte, il créa alors les conditions d’une riposte ouvrière plus vaste[6] :
- "(…) En 1998, on estime que près de 2 825 709 journées de travail ont été perdues du début du mois de janvier à la fin du mois d’octobre. Les grèves ont essentiellement pour objet des revendications économiques mais elles traduisent aussi le mécontentement politique des grévistes à l’égard du gouvernement. En effet, loin de vivre mieux, beaucoup d’ouvriers sud-africains ont vu leur situation économique se dégrader, contrairement aux engagements du RDP (Programme de Reconstruction et de Développement). Quant aux chômeurs, de plus en plus nombreux en l’absence de créations de nouveaux emplois et alors que de nombreuses industries (notamment dans le textile et de l’industrie minière) ferment ou se délocalisent, leur situation devient de plus en plus critique. On peut donc penser qu’en plus des revendications financières exprimées par les syndicats, les grèves manifestent aussi les premiers signes d’effritement de l’enthousiasme national à l’égard de la politique du gouvernement.
Le mouvement est large puisque les grèves touchent des secteurs aussi variés que le textile, la chimie, l’industrie automobile ou encore les universités ou les sociétés de sécurité et le commerce, souvent longues, deux à cinq semaines en moyenne, et parfois marquées par des violences policières[7] (une douzaine de grévistes tués) et des incidents sérieux, elles réclament presque toutes des hausses de salaire. (…) Face aux grèves, le patronat a initialement adopté une "ligne dure" et menacé de réduire sa main-d’œuvre ou de remplacer les grévistes par d’autres ouvriers, mais dans la plus part des cas, il a été forcé d’honorer les revendications des grévistes". (Judith Hayem, ibid.)
Comme on le voit, la classe ouvrière sud-africaine n’a pas attendu longtemps pour reprendre ses luttes contre le pouvoir de l’ANC, comme à l'époque où elle s’opposait aux attaques de l’ancien régime d’apartheid. C’est d’autant plus remarquable que le gouvernement de Mandela procéda de la même manière que son prédécesseur en faisant tirer sur un grand nombre de grévistes, pour tuer, dans le seul but (bien sûr inavoué) de défendre les intérêts du capital national sud-africain. Et ce sans provoquer la moindre protestation publique de la part des "démocrates humanistes". En effet, il est significatif de constater que rares ont été les médias (et mêmes les chercheurs-enquêteurs de terrain) qui commentaient, ou évoquaient simplement, les crimes commis par le gouvernement de Mandela dans les rangs des manifestants grévistes. En clair, pour le grand monde bourgeois et médiatique, Mandela fut à la fois "l’icône" et le "prophète intouchable", même quand son gouvernement massacrait des ouvriers.
Et, de son côté, le prolétariat sud-africain a démontré par là sa réalité de classe exploitée en luttant courageusement contre son exploiteur quelle que soit la couleur de sa peau. Et, par sa pugnacité, il assez souvent parvenu à faire reculer son ennemi, comme le patronat acculé à honorer ses revendications. Bref, il y a là l’expression d’une classe internationaliste dont la lutte constitue une démystification flagrante du mensonge selon lequel les intérêts des ouvriers noirs se confondraient avec ceux de leur propre bourgeoisie noire, en l’occurrence la clique de l’ANC.
Précisément, en réunissant l’ANC, le PC et la centrale syndicale COSATU dans le même gouvernement, la bourgeoisie sud-africaine voulait, d’un côté, convaincre les ouvriers (noirs) qu’ils avaient leurs propres "représentants" au pouvoir pour les servir, tout en prévoyant par ailleurs de laisser la base syndicale du COSATU dans l’opposition dans le cas où ce serait nécessaire pour encadrer les luttes. En clair, le gouvernement de l’ANC pensait avoir tout fait pour se prémunir contre toutes réactions conséquentes de la part de la classe ouvrière. Mais au bout du compte, c'est plutôt le contraire que Mandela et ses compagnons durent constater.
En 1999 : Mandela se fait remplacer par son dauphin Mbeki mais les luttes se poursuivent
Cette année-là, suite aux élections présidentielles remportées par l’ANC, Mandela cède sa place à son "poulain" Thabo Mbeki qui décide de poursuivre et d’amplifier la même politique d’austérité initiée par son prédécesseur. Pour commencer, il forme son gouvernement avec les mêmes fractions que précédemment, à savoir : l’ANC, le PC et la centrale syndicale COSATU. Et aussitôt son gouvernement formé, il décrète une vague de mesures d’austérité touchant de plein fouet les principaux secteurs économiques du pays et se traduisant par des réductions de salaire et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière. Mais, là aussi, comme sous Mandela, dès le lendemain, des centaines de milliers d’ouvriers se mirent en grève et descendirent massivement dans la rue et, comme à l’époque de l’apartheid, le gouvernement de l’ANC envoya sa police pour réprimer violemment les grévistes, faisant un grand nombre de victimes. Mais surtout il est remarquable de voir la rapidité avec laquelle la classe ouvrière sud-africaine prend conscience de la nature capitaliste et anti-ouvrière des attaques que l’équipe l’ANC au pouvoir lui fait subir. Le plus significatif encore dans la riposte ouvrière est le fait que, dans plusieurs secteurs industriels, les ouvriers décidaient de prendre en charge leurs propres luttes sans attendre les syndicats ou d’emblée contre eux :
- "(…) la grève d’Autofirst, qui débute hors du syndicat et malgré lui, est un bon exemple ; d’autant que, loin d’être un cas isolé, ce type de grève tend à se généraliser depuis 1999, y compris dans des grandes usines où les ouvriers se mettent en grève en dépit de l’avis défavorable du syndicat, voire son opposition formelle au conflit". (Judith Hayem, ibid.)
Voilà une démonstration éclatante du retour de la combativité s’accompagnant d’une tentative de prise en main des luttes que la classe ouvrière avait déjà expérimentée sous le régime d’apartheid. En conséquence de quoi, l’ANC dût réagir en réajustant son discours et sa méthode.
L’ANC sort une vieille ficelle de l’idéologie "racialiste" face à la nouvelle combativité ouvrière
Pour contrecarrer la pugnacité des ouvriers tendant à déborder les syndicats, le gouvernement de Mbeki et l’ANC décidèrent de recourir aux vieilles ficelles idéologiques héritées de la "lutte de libération nationale", en reprenant (entre autres) le discours "anti-blancs" de cette époque :
- "Le retour sous une forme renouvelée dans le discours politique gouvernemental de la question de la couleur, en particulier dans un certain nombre de déclarations fustigeant les Blancs - notion dont il faut examiner si elle agit (et dans ce cas comment) comme un marqueur racial, social, historique ou bien d’un autre registre et si elle opère également dans les formes de pensée des gens.
Corollaire de cette nouvelle politique présidentielle, les tensions au sein de la triple alliance (ANC, COSATU, SACP - Parti communiste sud-africain), toujours en place après de nombreuses menaces de scission, notamment à la veille des élections de 2004, sont de plus en plus manifestes et de plus en plus vives. Elles manifestent la difficulté de l’ANC, ancien parti de libération nationale, de conserver sa légitimité populaire une fois parvenu au pouvoir et en charge de gouverner pour le bénéfice, non plus de seuls opprimés d’antan mais pour tous les habitants du pays." (Judith Hayem, ibid.)
Mais pourquoi le gouvernement "arc-en-ciel", "garant de l’unité nationale", détenant tous les leviers du pouvoir, se trouve-t-il soudain acculé à recourir à une des vieilles recettes de l’ANC d’antan, à savoir fustiger le "pouvoir des Blancs" (qui empêcherait le pouvoir des Noirs) ? L’auteur du propos cité nous semble bien indulgent avec les dirigeants de l’ANC, quand il cherche à savoir à propos de cette "notion qu’il faut examiner pour savoir si elle agit comme marqueur racial, social, historique ou bien d’un autre registre…". En réalité cette "notion", derrière laquelle se cache l’idée suivant laquelle les "Blancs détiennent toujours le pouvoir au détriment des Noirs", l’ANC l’a utilisée ici en vue d’une énième tentative de diviser la classe ouvrière. Autrement dit, en agissant ainsi, le gouvernement espérait détourner les revendications visant l’amélioration des conditions de vie sur les questions raciales.
Effectivement, une partie de la classe ouvrière, notamment la base militante de l’ANC, ne peut s’empêcher d’être "sensibilisée" par ce discours sournois anti-Blanc, voire "anti-étranger". On sait par ailleurs que l’actuel président Zuma, avec ses accents populistes, instrumentalise fréquemment la "question raciale" en particulier quand il se trouve en difficulté face au mécontentement social.
L’idéologie altermondialiste au secours de l’ANC
Pour faire face à l’agitation sociale et à l’érosion de sa crédibilité, l’ANC décidait en 2002 d’organiser un sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg (le "Durban Social Forum"), auquel participèrent toute la galaxie altermondialiste de la planète et plusieurs associations sud-africaines dont celles caractérisées de "radicales" comme le TAC (Traitement Action Campaign) et le Landless People’s Movement ("Mouvement des sans-terres"), très actives dans les grèves des années 2000. Autrement dit, c’est dans un contexte de radicalisation des luttes ouvrières que l’appareil de l’ANC sollicitait l’apport idéologique du mouvement altermondialiste :
- "Par ailleurs, des grèves ouvrières hors cadre syndical ont éclaté comme à Volkswagen Port Elizabeth, en 2002 ou à Engen à Durban, en 2001. Certaines de ces actions, comme celles du TAC, remportent régulièrement des victoires face à la politique du gouvernement. Cependant, d’une part, aucun parti d’opposition ne relaie encore réellement ces points de vue dans l’arène parlementaire ; de l’autre, la capacité de ces organisations à infléchir durablement les décisions de l’État demeure encore fragile, en comptant sur leurs propres forces (sans s’institutionnaliser, ni entrer au gouvernement)." (Judith Hayem, ibid.)
On voit ici un double problème pour le gouvernement de l’ANC : d’une part, comment empêcher ou détourner les grèves tendant à échapper au contrôle des syndicats proches de lui, et d’autre part, comment trouver une opposition parlementaire "crédible" quant à sa prétendue capacité d’ "infléchir durablement" les décisions de l’État. Pour ce qui concerne ce dernier aspect on verra plus loin que le problème ne sera pas résolu au moment de la rédaction de cet article. En revanche, pour le premier l’ANC, put s’appuyer habilement sur l’idéologie altermondialiste bien incarnée par certains des groupes poussant à la radicalisation des luttes en particulier le TAC et le "Landless People’s Movement".
En effet, l’idéologie "altermondialiste" arrivait à point nommé pour le gouvernement de l’ANC en quête d’un nouveau "souffle idéologique", ce d’autant plus que cette mouvance avait le vent en poupe au niveau médiatique mondialement. Signalons aussi que, dans ce même contexte (en 2002), l’ANC menait campagne pour la réélection de ses dirigeants, pour lesquels il était alors opportun d’afficher leur proximité avec la mouvance altermondialiste. Mais cela n’a pas suffi à redorer la crédibilité des dirigeants de l’ANC auprès des masses sud-africaines. Et pour cause…
Une classe dirigeante issue de la "lutte de libération nationale" profondément corrompue
La corruption, l’autre "maladie suprême" du capitalisme, est une caractéristique largement partagée au sein des dirigeants de l’ANC. Certes, le monde capitaliste est très riche en exemples de corruption, de ce fait on pourrait penser qu'il est inutile de rajouter celui-ci. En fait c’est le contraire, dans la mesure où nombreux sont encore les "croyants" dans la "valeur symbolique exemplaire" et dans "la probité" des anciens héros de la lutte de libération nationale que sont les dirigeants de l’ANC.
Pour introduire le sujet, les passages suivants extraits d’un article intitulé " Système de ‘corruption légalisée’" et émanant d’un organe de presse bourgeois, à savoir Le Monde diplomatique, un des plus grands "anciens soutiens" de l’ANC, sont on ne peut plus éloquents :
- "Depuis la présidence de M. Thabo Mbeki (1999-2008), la collusion entre le monde des affaires et classe dirigeante noire est patente. Ce mélange des genres trouve son incarnation dans la personne de M. Cyril Ramaphosa, 60 ans, successeur désigné de M. Zuma, élu vice-président du Congrès national africain (African National Congress) en décembre 2012. A la veille du massacre de Marikana (…), M. Ramaphosa avait envoyé un message électronique à la direction de Lonmin, lui conseillant de résister à la pression exercée par les grévistes, qu’il qualifiait de "criminels".
Propriétaire de McDonald’s Afrique du Sud et président, entre autres, de la société de télécommunications MTN, M. Ramaphosa est aussi l’ancien secrétaire général de l’ANC (1991-1997) et du Syndicat national des mineurs (National Union of Mineworkers – NUM-, 19821991). Acteur central des négociations de la transition démocratique, entre 1991 et 1993, il sera évincé par M. Mbeki de la course à la succession de M. Nelson Mandela. En 1994, le voici recyclé dans les affaires, patron de New African Investment (NAIL), première société noire cotée à la bourse de Johannesburg, puis premier milliardaire noir de la "nouvelle" Afrique du Sud. Il dirige aujourd’hui sa propre société, Shanduka, active dans les mines, l’agroalimentaire, les assurances et l’immobilier.
Parmi ses beaux-frères, figurent M. Jeffrey Radebe, ministre de la justice, et M. Patrice Motsepe, magnat des mines, patron d’African Rainbow Minerals (ARM). Celui-ci a tiré profit du Black Economic Empowerment (BEE) mis en œuvre par l’ANC : censé profiter aux masses "historiquement désavantagées", selon la phraséologie de l’ANC, ce processus de "montée en puissance économique des Noirs" a en fait favorisé la consolidation d’une bourgeoisie proche du pouvoir. M. Moeletsi Mbeki, le frère cadet de l’ancien chef d’État, universitaire et patron de la société de production audiovisuelle Endemol en Afrique du Sud, dénonce un système de "corruption généralisée". Il souligne les effets pervers du BEE : promotion "cosmétique" de directeurs noirs (fronting) dans les grands groupes blancs, salaires mirobolants pour des compétences limitées, sentiment d’injustice chez les professionnels blancs dont certains préfèrent émigrer.
Si l’adoption d’une charte de BEE dans le secteur minier, en 2002, en a fait passer 26 % entre des mains noires, elle a aussi promu nombre de barons de l’ANC à des postes de direction importants. M. Mann Dipico, ancien gouverneur de la province du Cap-Nord, occupe ainsi la vice-présidence des opérations sud-africaines du groupe diamantaire De Beers. Le BEE a aussi favorisé des anciens de la lutte contre l’apartheid, qui ont renforcé leur position d’influence au sein du pouvoir. M. Mosima ("Tokyo") Sexwale, patron du groupe minier Mvelaphanda, a pris en 2009 la direction du ministère des ‘human settlements’ (bidonvilles).
Quant à M. Patrice Motsepe, il se distingue dans le classement Forbes 2012 au quatrième rang des fortunes d’Afrique du Sud (2, 7 milliards de dollars). Il a rendu un grand service à l’ANC en annonçant le 30 janvier le don de la moitié de ses avoirs familiaux (100 millions d’euros environ) à une fondation qui porte son nom, pour aider les pauvres. Même s’il ne fait pas d’émules, on ne pourra plus reprocher à l’élite noire de ne pas partager son argent".[8]
Voilà un descriptif impitoyable du système de corruption instauré par les dirigeants de l’ANC dès leur arrivée au sommet du pouvoir sud-africain post-apartheid. En clair, comme des gangsters, il s’agit de se partager les "gains" et "butins" que détenaient exclusivement leurs anciens rivaux blancs sous l’ancien régime, en se distribuant les postes selon les rapports de force et les alliances au sein de l’ANC. De ce fait, la lutte pour le "pouvoir du peuple noir" a été très vite oubliée, l’heure étant à la course aux postes qui mènent au "paradis capitaliste", en s’enrichissant plus vite et plus fort jusqu’à devenir (symboliquement) multimillionnaires en un petit nombre d’années, comme cet ancien grand dirigeant syndical et éminent membre de l’ANC, Monsieur Ramaphosa.
- "La bourgeoisie noire vit loin des ‘townships’, où elle ne distribue pas - ou peu - ses richesses. Ses goûts de luxe et son opulence ont éclaté au grand jour sous la présidence de M. Mbeki (1999-2008), à la faveur de la croissance des années 2000. Mais depuis l’arrivée au pouvoir de M. Zuma, en 2009, l’archevêque Desmond Tutu et le Conseil des églises d’Afrique du Sud ne cessent de dénoncer un "déclin moral" bien plus grave que le prix mirobolant des lunettes de soleil de ceux que l’on surnomme les Gucci révolutionnaires. Les relations peuvent se tisser de manière ouvertement vénale, sourit un avocat d’affaires noir qui préfère garder l’anonymat. On parle de sexe à table, et pas seulement à propos de notre président polygame ! La corruption s’étale…. A tel point que lorsqu’un ancien cadre de De Beer est accusé de corruption par la presse, il lance : "You get nothing for mahala" … (On n’a rien sans rien)." (Le Monde diplomatique, ibid.)
C’est hallucinant ce que rapporte cette citation, notamment l’implication des présidents successeurs de Mandela dans la construction du système de corruption sous leur règne respectif. Mais il faut aussi savoir que la corruption dans l’ANC existe à tous les niveaux et à tous les endroits, donnant lieu à des luttes sournoises et violentes comme chez les groupes mafieux. Ainsi, M. Mbeki a profité de sa présidence de l’appareil d’État et de l’ANC pour, au moyen de "coups bas", évincer son ex-premier rival Cyril Ramaphosa en 1990 et a ensuite limogé Zuma, son vice-président, poursuivi en justice pour viol et corruption. Evidemment, ces deux derniers (tout en se combattant mutuellement) ont pu répliquer par des moyens aussi violents qu’obscurs contre leur rival commun. Notamment Zuma, qui a eu beau jeu de se faire passer pour la victime d’un énième complot ourdi par son prédécesseur Mbeki "connu pour ses intrigues" (Le Monde, ibid.). Par ailleurs, on peut mentionner cet acte de violence caractéristique qui a eu lieu en décembre 2012 au Parlement, où en pleine préparation de leur congrès, les membres de l’ANC en sont venus aux mains pour imposer leurs candidats respectifs en faisant voler les chaises et en échangeant des coups de poing.
Et pendant ce temps-là, le "peuple libéré" de l’apartheid reste immergé dans la misère : un sud-africain sur quatre ne mange pas à sa faim et la maladie. "En attendant le niveau de désespoir se voit à l’œil nu. A Khayelitsha, on noie son chagrin dans le gospel, une musique en vogue qui retentit partout, mais aussi dans la dagga (cannabis), le Mandrax ou le tik (méthamphétamine), une drogue qui ravage le ‘township’. " (Le Monde diplomatique, ibid.)
Quelle sinistre plongée dans l’horreur d’un système économique moribond poussant ainsi ses populations dans l’abime sans issue !
Le SIDA s’invite au milieu de la misère et de la corruption du pouvoir de l’ANC
Entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, la classe ouvrière ne se battait pas seulement contre la misère économique, mais devait aussi faire face à l’épidémie du SIDA. Ce d’autant plus que le chef du gouvernement d’alors, Thabo Mbeki, avait pendant longtemps refusé de reconnaître la réalité de cette maladie, allant ainsi jusqu’à refuser cyniquement de s’investir véritablement contre son développement.
- "Un autre élément majeur de la situation en Afrique du Sud à partir de 2000 est précisément le déploiement avéré et dévastateur, enfin reconnu publiquement, de l’épidémie de VIH/SIDA. L’Afrique du Sud arbore désormais le triste record de pays le plus contaminé au monde. En décembre 2006, le rapport de l’ONUSIDA et de l’OMS indiquait qu’on estimait à près de 5,5 millions le nombre de personnes séropositives en Afrique du Sud, soit un taux de 18,8 % parmi les adultes âgés de 15 à 49 ans et de 35 % chez les femmes- ce sont elles les plus touchées- qui consultent dans les cliniques anténatales. La mortalité totale dans le pays, toutes causes confondues, a ainsi augmenté de 79 % entre 1997 et 2004 et ce, essentiellement, en raison de l’impact de l’épidémie.
(…) Au-delà de ce bilan sanitaire calamiteux, le SIDA est devenu l’un des grands problèmes du pays. Il décime la population, laisse orphelins des générations entières d’enfants mais son impact est tel qu’il menace aussi la productivité et l’équilibre social du pays. En effet, la population active est la frange la plus touchée par la maladie et l’absence de revenus générée par l’incapacité d’un adulte de travailler, même de manière informelle, plonge parfois des familles entières dans la misère quand la survie dépend parfois de ces seuls revenus. Des aides sociales sont désormais accordées par l’État aux familles touchées par la maladie mais elles demeurent insuffisantes. (…) Le SIDA a en effet envahi toutes les sphères de la vie sociale et le quotidien de chacun : on est soi-même infecté par la maladie et/ou affecté par la mort d’un proche, d’un voisin, d’un collègue…
(…) Il me semble que la clôture de la séquence de la négociation qui se dessinait déjà en 1999, avec la publication du GEAR (Growth Employement and Redistribution Program, Programme de croissance, d'emploi et de redistribution) s’est confirmée avec le déni de Thabo Mbeki de reconnaître le lien entre VIH et SIDA en avril 2000. Non pas tant en raison de l’immense controverse que cette déclaration a suscité dans le pays et dans le monde entier mais en raison de l’épidémie, qui représentait pourtant un défi majeur pour la construction du pays et son unité, marquant par-là que celle-ci ne devait plus être, à ses yeux, les principales préoccupations de l’État." (Judith Hayem, ibid.,)
Comme l’illustre ce propos, d’un côté, l’épidémie du SIDA faisait (et continue de faire) des ravages terribles dans les rangs du prolétariat sud-africain et dans les populations (surtout pauvres) en général, de l’autre côté, les responsables gouvernementaux ne se souciaient pas ou seulement partiellement du sort des victimes, alors même que des rapports officiels (de l’ONU) illustraient amplement la présence massive du virus dans le pays. En réalité, le gouvernement de Mbeki était dans le déni en ne voulant même pas voir que le SIDA avait envahi toutes les sphères de la vie sociale, y compris donc le quotidien des forces productives du pays, en l’occurrence la classe ouvrière. Mais le plus cynique dans cette affaire a été la ministre de la santé d’alors :
- "Fidèle du président d’alors, M. Thabo Mbeki, la ministre de la santé Manto Tshabalala-Msimang (…) n’a aucune intention d’organiser la distribution d’ARV dans le secteur public de santé. Elle argue qu’ils sont toxiques, ou qu’on peut se soigner en adoptant un régime nutritif à base d’huile d’olive, d’ail et de citron. Le conflit aboutit en 2002 devant la Cour constitutionnelle : l’hôpital public est-il autorisé à administrer aux mères séropositives un comprimé de névirapine qui réduit drastiquement le risque que l’enfant soit infecté lors de l’accouchement ? Le gouvernement est condamné. D’autres procès suivront, imposant en 2004 un début de stratégie nationale de traitement.". (Manière de voir, novembre 2015, supplément du Monde diplomatique).
Voilà l’attitude abjecte d’un gouvernement irresponsable face aux millions de victimes du SIDA livrées à elles-mêmes et où il fallut attendre l’intervention de la Cour suprême pour arrêter la folie criminelle des responsables de l’ANC et du gouvernement Mbeki face au développement fulgurant du SIDA qui a largement contribué à la chute de l’espérance de vie qui passait de 48 ans en 2000 à 44 ans en 2008 (où les malades infectés mouraient par centaines chaque jour).
La décomposition du capitalisme aggrave la violence sociale
Les lecteurs de la presse du CCI savent que notre organisation traite régulièrement des conséquences de la décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme sur tous les aspects de la vie de la société. Celles-ci se manifestent plus crument dans certaines zones, en particulier dans l’ancien "Tiers-Monde", où se situe l’Afrique du Sud.
Malgré son statut de première puissance industrielle du continent avec un relatif développement économique, l’Afrique du Sud est un des pays au monde où l’on meurt le plus "facilement" par homicide et les agressions violentes de toutes sortes sont le lot quotidien des populations et, bien entendu, en son sein, de la classe ouvrière. Par exemple, en 2008 l’Afrique du Sud a connu 18148 assassinats, soit un taux de 36,8 pour 100 000 habitants, ce qui place ce pays en sinistre deuxième place derrière le Honduras (en tête avec un taux de 61 pour 100 000 habitants). En 2009, une étude du Conseil sud-africain de la recherche médicale indique que le taux d’homicides de femmes commis par des partenaires de sexe masculin était 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale.
Les meurtres s’effectuent de nuit comme de jour en tous lieux, à la maison, dans la rue comme dans les transports, les terrasses de café, les lieux de loisirs (terrains de sports).
Parallèlement aux homicides il y a l’explosion d’autres violences : les violences sexuelles contre les femmes et les enfants se chiffraient en 2008 à 50 265.
Le plus sordide dans cette situation est sans doute le fait que le gouvernement sud-africain s’avère au mieux impuissant, au pire indifférent ou complice quand on sait que des membres de sa propre police participent à ces violences. En effet, en Afrique du Sud, la police est aussi corrompue que les autres institutions du pays et, de ce fait, nombre de flics sont impliqués dans les assassinats crapuleux. En effet, quand la police ne participe pas directement aux meurtres, elle se comporte comme les gangs qui rackettent et tabassent les populations. À tel point que ces dernières, qui subissent quotidiennement les violences, n’ont que peu de confiance dans les forces de l’ordre pour les protéger. Quant à la grande bourgeoisie, nombre de ses membres préfèrent se faire protéger (dans leurs demeures bien barricadées) par des vigiles et autres "agents de sécurité " surarmés, dont des sources indiquent qu’aujourd’hui leur nombre dépasse largement celui de la police nationale.
Le pogrom, summum de la violence
Le pogrom, l’autre volet barbare de la violence sociale, sévit épisodiquement en Afrique du Sud et encore récemment, en 2017. C’est d’autant plus grave que c’est directement la classe ouvrière sud-africaine, très composite depuis plusieurs générations, qui en est affectée. Les pogromistes sont qualifiés par les médias, pêle-mêle, de "laissés-pour compte", de "délinquants/trafiquants", de "précaires/chômeurs…". Bref, un mélange de " déclassés", de "nihilistes" et de simples frustrés, sans espoir et sans conscience prolétarienne. À titre d’exemple, nous rapportons un événement qui s’est produit en 2008. En juin de cette année-là, près d’une centaine de travailleurs immigrés sont morts, victimes de pogroms perpétrés par des bandes armées dans les bidonvilles de Johannesburg. Des groupes munis de couteaux et d’armes à feu s’introduisent à la nuit tombée dans les quartiers délabrés à la recherche de "l’étranger" et se mettent à frapper, à tuer, même à brûler vifs des habitants et chasser des milliers d’autres.
Les premiers massacres ont eu lieu à Alexandra, dans un immense bidonville (township) se situant au pied du quartier d’affaires de Johannesburg, capitale financière de l’Afrique du Sud. Les attaques xénophobes se sont étendues progressivement aux autres localités sinistrées de cette région dans l’indifférence totale des autorités du pays. En effet, il a fallu 15 jours de tueries pour que le gouvernement du président Mbeki se décide à réagir mollement (cyniquement en fait) en envoyant les forces de l’ordre s’interposer dans certaines localités tout en laissant les massacres se poursuivre à d’autres endroits. La plupart des victimes sont originaires des pays voisins (Zimbabwe, Mozambique, Congo, etc.). Il y a près de 8 millions d’immigrés en Afrique du Sud, dont 5 millions de Zimbabwéens qui travaillent (ou à la recherche d’un travail), notamment dans les métiers pénibles comme les mines. Tandis que d’autres sont des précaires qui vivotent en se lançant dans des commerce de survie. Mais ce qu'il y a de plus terriblement inhumain dans ces pogroms est le fait que nombre des victimes se trouvaient sur place parce qu’elles mouraient de faim dans leurs pays d’origine, comme ce zimbabwéen (rescapé) cité par l’hebdomadaire Courrier international du 29 mai 2008 : "Nous mourons de faim et nos voisins sont notre seul espoir. (…) Cela ne sert à rien de travailler au Zimbabwe. On n’y gagne même pas assez pour se loger dans les pires banlieues de Harare (la capitale). (…) Nous sommes prêts à prendre des risques en Afrique du Sud ; c’est notre vie à présent. (…) Mais si nous ne le faisons pas, nous mourrons quand même. Le pain coûte aujourd’hui 400 millions de dollars zimbabwéens (0,44 euros) et un kilo de viande 2 milliards (2,21 euros). Il n’y a plus de bouillie de maïs dans les magasins, et les gens qui travaillent ne peuvent plus vivre de leur salaire."
Voilà l’enfer dans lequel les responsables politiques zimbabwéens et sud-africains ont plongé leurs populations respectives, eux, "panafricanistes" et anciens champions de "la lutte de libération nationale" et de la "défense des peuples opprimés". En effet, non content d’avoir laissé les pogroms se dérouler longtemps avant d’intervenir, l’intervention du gouvernement de l’ANC a en fait consisté à expulser massivement les "travailleurs illégaux" vers leurs pays d’origine, le Zimbabwe en particulier, où ils sont livrés à la répression et à la famine.
Ces épisodes illustrent la destruction des liens sociaux et de la solidarité de classe entre prolétaires propre à la décomposition du capitalisme. Ainsi, on n’a pas entendu parler de manifestations de solidarité de la part la classe ouvrière sud-africaine envers ses frères de classe victimes des pogroms.
Le poids de la crise économique dans les tueries pogromistes et au Zimbabwe
Le gouvernement sud-africain avait sans doute les yeux rivés sur la conjoncture économique où il ne pouvait que faire le constat de son impuissance à sortir de la crise, en dépit de ses multiples et successifs plans d’austérité.
- "On aurait tort de penser que cette explosion de xénophobie est une simple réaction face à une immigration incontrôlée. C’est aussi la conséquence de l’envol des prix des produits alimentaires, de la chute du niveau de vie, d’un taux de chômage dépassant 30 % et d’un gouvernement qui paraît aveugle à la situation des plus pauvres." (Jeune Afrique du 25 mai 2008)
C’est donc dans ce contexte, où les effets de la crise faisaient des ravages dans les rangs ouvriers et de la population sud-africaine la plus pauvre, que l’on a vu surgir ces actes pogromistes commis par des éléments haineux "anti-étranger", ne trouvant d’autre solution à leur détresse morale et matérielle que la violence aveugle déchainée contre des bouc-émissaires.
Mais surtout comment qualifier la situation économique du Zimbabwe ? Simple crise "économique" passagère ou le signe avant-coureur du futur d’un système en voie de décomposition avancée ? Le caractère inqualifiable de ce qui se passait dans ce pays dans les années 2000 dépasse l’imagination : pour acheter une baguette de pain il fallait remplir un chariot de billets de banque pour l’obtenir ! Certes "l’hyperinflation" a disparu depuis lors, mais la misère est plus que jamais présente. Comme le montre Le bilan économique annuel de 2017 du quotidien français Le Monde : "Près des trois quarts des Zimbabwéens vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté et 90 % de la population active n’a pas d’emploi formel. Un tiers des enfants sont en retard de croissance. Le SIDA frappe 14,7 % de la population, un chiffre cependant en baisse."
En clair, il s’agit de l’enfer pour les populations, la classe ouvrière en particulier, le même enfer qui dure depuis des décennies dans ce pays totalement ruiné.
Une autre cause importante de la ruine du Zimbabwe se trouve dans l’engagement de ses dirigeants dans la guerre de conquête d’influence que se livrent les puissances impérialistes.
L’importance du facteur impérialiste dans la situation
En effet, l’autre facteur qui vient affecter le budget de ces deux États, c’est la recherche d’influence impérialiste de leurs dirigeants. D’ailleurs, si nous évoquons la "question impérialiste", ici, c’est avant tout parce qu’elle a une incidence sur les rapports entre les classes, alors que la bourgeoisie fait subir à la classe ouvrière le poids de l'économie de guerre à l’intérieur et, à l’extérieur, avec les tueries. En clair, les gouvernements respectifs de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe rivalisent avec les puissances impérialistes (grandes et petites) qui cherchent à contrôler les régions d’Afrique Australe et des Grands Lacs, en s’autoproclamant "gendarmes locaux". Ainsi, ces deux pays se sont massivement impliqués dans les guerres qui ont ravagé cette zone dans les années 1990/2000 et qui ont engendré plus de 8 millions de morts. C’est dans cette optique que le président zimbabwéen Robert Mugabe s’est lancé dans la guerre en République Démocratique du Congo qui a duré des années, où il expédié quelque 15 000 hommes, avec un coût exorbitant évalué à 1 million de dollars par jour (représentant sur une année 5, 5 % du PIB). Cette aventure militaire désastreuse fut sans doute un élément accélérateur de la ruine totale de l’économie du Zimbabwe, alors que ce pays était considéré jusque dans les années 1990 comme le "grenier" de l’Afrique australe. Par ailleurs, parmi les causes de la dégradation de la situation économique du Zimbabwe il faut aussi souligner l’embargo total imposé par les puissances impérialistes occidentales contre "le régime dictatorial" de Robert Mugabe. En effet, celui-ci a refusé de se conformer au "modèle de gouvernance démocratique" occidental en ayant tout fait pour s’accrocher au pouvoir du pays qu’il a dirigé pendant 37 ans jusqu’à l’âge de 93 ans, entre 1980 et fin 2017 où il est forcé de démissionner.[9] De fait, le régime de Mugabe n’avait que la Chine (et l’Afrique du Sud dans une moindre mesure) comme partenaire décisif qui lui fournit tout et le protège militairement et politiquement sans "s’ingérer" dans ses affaires internes.
En ce qui concerne le rôle spécifique de l’Afrique du Sud dans les guerres impérialistes en Afrique, nous renvoyons à la Revue internationale n° 155 et 157. Rappelons que, déjà avant leur arrivée au pouvoir, Mandela et ses compagnons s’impliquaient pleinement dans des menées impérialistes. Ils ont ensuite continué, par exemple, en allant jusqu’à disputer à la France, dans les années 1990/2000, son influence en Centrafrique dans la région des Grands Lacs.
Retour sur les grèves et autres mouvements sociaux
Une des caractéristiques majeures de l’Afrique du Sud depuis l’époque de l’apartheid est que, même en l'absence de grèves, la tension sociale débouche soit sur des manifestations, soit d’autres types d’affrontements violents. Par exemple, selon les données de la police, le pays a connu trois émeutes par jour (en moyenne) entre 2009 et 2012. D’après un chercheur sud-africain cité par Le Monde diplomatique, cela correspond une augmentation de 40 % par rapport à la période 2004-2009. Cette situation est sans doute en lien avec la violence des rapports qui existaient déjà entre les empires coloniaux et les populations de ce pays, et cela bien avant l’instauration officielle de l’apartheid, où les dirigeants successifs à la tête de l’État sud-africain ont toujours eu recours à la violence pour imposer leur ordre, ordre bourgeois bien entendu[10]. Cela se vérifie amplement à travers l’histoire de la lutte de classe en Afrique du Sud, sous l’ère du capitalisme industriel. En effet, la classe ouvrière a connu ses premiers morts (4 mineurs d’origine britannique) lorsqu’elle déclencha sa première grève à Kimberley, "capitale diamantaire", en 1884.
De son côté, la population, en l’occurrence la partie noire très majoritaire de la classe ouvrière, a toujours été acculée à la violence, notamment pendant l’apartheid, où sa dignité humaine fut simplement niée sous prétexte hérité des rapports esclavagistes qu’elle appartiendrait à une "race inférieure". De ce fait, au regard de tous ces facteurs, on peut parler de "culture de la violence" comme élément constitutif des rapports entre la bourgeoisie et la classe ouvrière en Afrique du Sud. Et le phénomène persiste et s’amplifie aujourd’hui, c'est-à-dire sous le règne du pouvoir de l’ANC.
Répression sanglante du mouvement de grève à Marikana en 2012
Ce mouvement fut précédé par d’autres grèves plus ou moins significatives, comme celle de 2010, impliquant les ouvriers chargés de construire les stades pour accueillir la Coupe du monde de football. Un mouvement de grève fut lancé par les syndicats du secteur en menaçant de ne pas terminer les travaux avant le début officiel des compétitions. Par ce "chantage syndical", les ouvriers grévistes purent obtenir des augmentations de salaire conséquentes (de 13 à 16 %). Il y avait un fort mécontentement dans tout le pays face à la dégradation des conditions de vie de la population et c’est dans ce contexte, deux ans après le coup de sifflet final de la coupe du monde, que la grève a éclaté à Marikana. En effet, depuis le 10 août 2012, les employés du puits de Marikana se sont mis en grève afin de soutenir les moins payés d’entre eux en réclamant que soit porté le salaire minimum à 1250 euros. Une revendication rejetée par le patronat minier et par le NUM (le plus important des syndicats affiliés au Cosatu).
- "La tension sociale est palpable depuis que, le 16 août 2012, la police a tué trente-quatre mineurs (et soixante-dix-huit blessés) en grève à Marikana, une mine de platine proche de Johannesburg. Pour la population, quel symbole ! Les forces d’un État démocratique et multiracial, dirigé depuis 1994 par le Congrès national africain (African National Congress, ANC), tiraient sur des manifestants, comme au temps de l’apartheid ; sur ces travailleurs qui constituent sa base électorale, l’écrasante majorité noire et démunie de l’Afrique du Sud. Dans ce pays industrialisé, seul marché émergent au sud du Sahara, les ménages pauvres, à 62 % noirs et à 33 % métis, représentent plus de vingt-cinq millions de personnes, soit la moitié de la population du pays, selon des chiffres publiés fin novembre par les institutions nationales.
L’onde de choc est comparable à celle du massacre de Sharpeville, dont les événements de Marikana ont réveillé le souvenir. Le 21 mars 1960, la police du régime d’apartheid (1948-1991) avait tué soixante-neuf manifestants noirs qui protestaient dans un township contre le "pass" imposé aux non Blancs" pour se rendre en ville. Quand la nouvelle du drame était arrivée au Cap, la population de Langa, un township noir, avait réduit les bâtiments publics en cendres.
Les mêmes réactions en chaîne se produisent aujourd’hui. Dans le sillage de Marikana, les employés des secteurs des mines, des transports et de l’agriculture multiplient les grèves sauvages. (…) Résultat : vignobles incendiés, magasins pillés et épreuve de force avec la police. Le tout sur fond de licenciement des grévistes. (…) Chez Lonmin, les mineurs ont décroché, après six semaines d’action, une augmentation de 22 % et une prime de 190 euros.
(…) Aujourd’hui, les syndicats noirs, forts de plus de deux millions d’adhérents, réclament au gouvernement une vraie politique sociale et des meilleures conditions de travail pour tous. Mais, particularité sud-africaine, ils sont… au pouvoir. Avec le Parti communiste sud-africain et l’ANC, ils constituent depuis 1990 une alliance tripartite "révolutionnaire" censée œuvrer à la transformation de la société. Communistes et syndicalistes représentent l’aile gauche de l’ANC, que le parti s’efforce de brider en distribuant le pouvoir. Les dirigeants communistes occupent ainsi régulièrement des postes ministériels, tandis que ceux du Cosatu siègent au comité exécutif national de l’ANC. Leur contestation de la gestion libérale de l’économie par l’ANC y perd en crédit.
(…) Pour la première fois, à Marikana, le Syndicat national des mineurs (National Union of Minworkers, NUM), affilié au Cosatu et parmi les plus importants du pays, a été débordé par un conflit social [11]. (Pour un entrepreneur), " la politisation des conflits sociaux, qui entraînent la remise en cause de l’ANC ou de ses dirigeants, fait peur aux grands groupes miniers ". (Le Monde diplomatique, ibid.)
Il s’agit là d’un récit implacable des événements tragiques de Marikana. À travers cette grève, on a assisté, une nouvelle fois, à une vraie confrontation de classes, entre la nouvelle bourgeoisie au pouvoir et la classe ouvrière sud-africaine. En effet, déjà, sans provoquer beaucoup de bruit, lors d’un mouvement de grève en 1998-99, le gouvernement de Mandela en personne, avait massacré une douzaine d’ouvriers. Mais cette fois la tragédie de Marikana est d’une ampleur sans précédent et riche d’enseignements que nous ne pouvons pas tous tirer dans le cadre de cet article. Ce nous voulons commencer par dire, c'est que les mineurs qui sont morts ou ont été blessés en se soulevant contre la misère imposée par leur ennemi de classe méritent hommage et grand salut de la part leurs frères de classe. Par ailleurs, aucun des donneurs d’ordre de cette tuerie n’a été condamné et le président de l’ANC M. Jacob Zuma s’est contenté de nommer une commission d’enquête qui a attendu deux ans pour rendre son rapport en préconisant simplement (cyniquement) : "Une enquête criminelle sous la direction du parquet à l’encontre de la police qui pointe les responsabilités de Lonmin. Elle exonère en revanche les responsables politiques de l’époque. " (Manière de voir, supplément du Monde diplomatique)
Ce conflit nous montre l'ancrage profond et définitif de l’ANC dans le giron du capital national sud-africain, pas seulement au niveau de l’appareil d’État, mais aussi pour ses membres à titre individuel. Ainsi, on avait précédemment montré (voir notre chapitre sur la "corruption") que nombre de dirigeants de l’ANC se trouvaient à la tête de grandes fortunes ou d’entreprises prospères. Ainsi, lors du mouvement de Marikana, les mineurs durent se heurter aux intérêts de grands patrons dont Doduzane Zuma (fils de l’actuel chef d’État sud-africain), à la tête de "JLC Mining Services", très présent dans cette filière. Dès lors, on comprend mieux pourquoi ce patron et sa compagnie rejetaient catégoriquement d’admettre le bien-fondé des revendications des grévistes en misant d’abord sur la répression policière et le travail de sape des syndicats proches de l’ANC pour venir à bout de la grève. En effet, dans ce conflit, on a pu voir le comportement abject et totalement hypocrite du Cosatu et du Parti communiste, faisant semblant de "soutenir" le mouvement de grève, alors même que le gouvernement dont ils sont des membres décisifs lançait ses chiens sanguinaires sur les grévistes. En réalité, la gauche gouvernementale était préoccupée avant tout par l’irruption dans le mouvement d’une minorité radicalisée de sa base syndicale tendant à échapper à son contrôle.
- "Le président Jacob Zuma ne s’est déplacé que quelques jours après les faits. Et il n’a pas rencontré les mineurs, mais la direction de Lonmin. Son ennemi politique, M. Julius Malema, 31 ans, ex-président de la ligue des jeunes de l’ANC, exclu du parti en avril pour "indiscipline", en a profité pour occuper le terrain. Se faisant le porte- parole de la base déçue, il a pris le parti des grévistes. Il les a accompagnés au tribunal, où ils ont dans un premier temps été eux-mêmes, accusés de meurtre, en vertu d’une ancienne loi anti-émeute de l’apartheid. Cette loi permettait de retourner une accusation de meurtre contre de simples manifestants, en leur reprochant d’avoir provoqué les forces de sécurité. Au vu du tollé, le chef d’inculpation visant deux cent soixante-dix mineurs a finalement été levé et une commission d’enquête nommée. M. Malema a saisi cette occasion pour appeler une énième fois à la nationalisation des mines et pour dénoncer la collusion entre pouvoir, bourgeoisie noire, syndicats et "grand capital "". (Le Monde diplomatique, ibid.)
En clair, d’un côté, on voit le président Zuma sans pitié contre les grévistes en évitant même de les rencontrer, de l’autre côté, on voit ce jeune Malema[12] profiter de son exclusion de l’ANC pour se radicaliser à outrance dans le seul but de récupérer les ouvriers scandalisés et révoltés par l’attitude des forces gouvernementales dans ce conflit. Pour ce faire, il a poussé à la création du nouveau syndicat des mineurs (AMCU) en opposition radicale au NUM (lié au pouvoir). Ceci explique l’attitude hautement manœuvrière et très acrobatique de l’aile gauche de l’ANC qui voulait simultanément assumer ses responsabilités gouvernementales et préserver de sa "crédibilité" auprès des grévistes syndiqués, en particulier sa base militante. De même que, sur le fond, il s’agit là d’une "division du travail" entre les dirigeants de l’ANC dans le but de briser le mouvement au cas où les morts n’y auraient pas suffi.
Que dire aussi de l’aspect symbolique de cette tuerie ? En effet, comme l’a fait remarquer la citation ci-avant, quel symbole pour la population ! Les forces d’un État démocratique et multiracial, tiraient sur des manifestants comme au temps de l’apartheid ! En effet, comme le montre ce témoin (visiblement un rescapé du carnage) : "Je me souviens qu’un de nos gars nous a dit : "Rendons-nous" en levant les bras en l’air, déclare un témoin. Une balle l’a touché aux deux doigts, là. Il est tombé à terre. Puis il s’est relevé et a répété : "Messieurs, rendons-nous". Une deuxième fois, les flics l’ont touché à la poitrine, et il est tombé à genoux. Il a essayé de se lever encore une fois, et une troisième balle l’a touché au flanc. Là, il s’est écroulé, mais il tentait encore de bouger…L’homme juste derrière lui, qui voulait lui aussi se rendre, a alors pris une balle en pleine tête, et s’est effondré à côté de l’autre gars." (Manière de voir –Le Monde diplomatique)
La voilà, la police de l’ANC, face à la classe ouvrière en lutte, reprenant la même méthode, la même cruauté que le régime d’apartheid.
Pour nous, révolutionnaires marxistes, ce que montre en définitive le comportement des dirigeants sud-africains actuels dans cette boucherie est qu’avant d’être de telle ou telle couleur de peau, les oppresseurs des grévistes sont avant tout des barbares capitalistes défendant les intérêts de la classe dominante, ce pourquoi Mandela et ses compagnons ont été mis à la tête de l’État sud-africain par tous les représentants du grand capital du pays. On peut également voir dans cet événement tragique pour la classe ouvrière un autre aspect bien plus symbolique (dans cet ex-pays d’apartheid) : le fait que le chef de la police qui a dirigé les opérations sanglantes contre les grévistes était une femme noire. Cela nous montre, une fois de plus, que le vrai clivage n’est nullement racial ou de genre mais de classes, entre la classe ouvrière (de toutes couleurs) et la classe bourgeoise. Et n’en déplaise à tous ceux qui prétendaient (ou croient encore) que les dirigeants de l’ANC (Mandela compris) auraient et défendraient les mêmes intérêts que la classe ouvrière sud-africaine noire.
Quant à cette dernière, noire ou blanche, elle doit savoir qu’avant et après la tragédie de Marikana, elle a toujours sur son chemin le même ennemi, à savoir la classe bourgeoise qui l’exploite, la matraque et n’hésite pas à l’assassiner le cas échéant. C’est ce que font les dirigeants actuels de l’ANC et c’est ce qu’avait fait Nelson Mandela quand il gouvernait lui-même le pays. Certes ce dernier est mort en 2014, mais son héritage est bien assuré et assumé par ses successeurs. Autrement dit, jusqu’à sa mort, Mandela fut la référence et l’autorité politique et "morale" des responsables de l’ANC. De même, il fut l’icône de tous les régimes capitalistes de la planète qui, d’ailleurs, l’avaient honoré et adoubé en lui attribuant "Le Prix Nobel de la Paix", en plus d’autres titres comme "héros de la lutte anti-apartheid et d’homme de paix et de réconciliation des peuples d’Afrique du Sud". Par conséquent, ce fut tout ce beau monde capitaliste (du représentant de la Corée du Nord jusqu’au président américain Obama en passant par le représentant du Vatican) qui était présent à ses obsèques pour lui rendre un dernier hommage pour "service rendus".
Au terme de cet article, mais aussi de la série qui en comprenait quatre, il s’agit à présent de conclure ce que nous avons voulu être une "contribution à une histoire du mouvement ouvrier".
Quel bilan tirer ?
Étant donné l’ampleur des questions posées et traitées dans cette série, il faudrait au moins un article supplémentaire pour tirer tous les enseignements qui s’imposent. Nous nous limiterons ici à n'exposer succinctement que quelques éléments de bilan en essayant de mettre en exergue les plus importants.
La question de départ était : existe-t-il une histoire de luttes de classes en Afrique du Sud ?
Nous pensons l’avoir mis en évidence en fouillant dans l’histoire du capitalisme en général et dans celle du capitalisme sud-africain en particulier. Pour ce faire, nous avons sollicité d’emblée l’éclairage de la révolutionnaire marxiste Rosa Luxemburg sur les conditions de naissance du capitalisme sud-africain (cf. L’Accumulation du capital, tome 2), et par la suite, nous nous sommes appuyés sur diverses sources de chercheurs dont les travaux nous semblent cohérents et crédibles. Le capitalisme existait bel et bien en Afrique du Sud dès le 19e siècle et il avait engendré deux classes historiques, à savoir la bourgeoisie et la classe ouvrière qui n’ont jamais cessé de s’affronter, depuis plus d’un siècle de face à face. Le problème ensuite était qu’on n’entendait jamais parler de luttes de classes, du fait notamment du système monstrueux que fut l’apartheid contre lequel Nelson Mandela et ses compagnons s’opposaient au nom de la "lutte pour la libération nationale". Et nous écrivions ceci dans le premier article de la série[13] : "L’image médiatique de Mandela voile tout le reste, à tel point que l’histoire et les combats de la classe ouvrière sud-africaine avant et pendant l’apartheid sont carrément ignorés ou déformés en étant systématiquement catégorisés dans la rubrique "luttes anti-apartheid ou "luttes de libération nationale.""
Les lecteurs qui ont pu lire l’ensemble de cette contribution peuvent constater la réalité patente de luttes de classes véritables et de nombreux combats victorieux ou glorieux de la classe ouvrière en Afrique du Sud. Dans ce sens, nous voulons insister plus particulièrement sur deux temps forts de la lutte de classe menée par le prolétariat sud-africain : d’une part, pendant et contre la Première Guerre mondiale et, d’autre part, ses combats décisifs au moment de la reprise internationale de la lutte de classe dans les années 1960/70, ce après la longue période contre-révolutionnaire.
Dans le premier cas, une minorité de la classe ouvrière manifesta, dès l’éclatement de la guerre 1914/18, son esprit internationaliste et son activité en appelant à s’opposer à cette boucherie impérialiste[14]. "En 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : "venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et les indigènes". Ce texte est publié par l’International Socialist League (ISL), une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains (…) et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du parti travailliste sud-africain et des syndicats de métiers". C’était là un acte exemplaire de solidarité de classe face à la première boucherie mondiale. Ce geste prolétarien et internationaliste est d’autant plus fort quand on sait par ailleurs que cette même minorité fut à l’origine de la création du Parti communiste sud-africain, véritablement internationaliste avant d’être "stalinisé" définitivement à la fin des années 1920.
Dans le second cas, des luttes massives dans les années 1970/80 vont jusqu'à ébranler le système d’apartheid, avec un point d’orgue : le mouvement de Soweto de 1976[15]. "Les événements de Soweto, de juin 1976, allaient confirmer le changement politique en cours dans le pays. La révolte des jeunes du Transvaal s’ajouta à la renaissance du mouvement ouvrier noir pour déboucher sur les grands mouvements sociaux et politiques des années quatre-vingt. Après les grèves de 1973, les affrontements de 1976 ferment ainsi la période de la défaite."
À un moment donné, le niveau de la combativité et de la conscience ouvrière avait fait "bouger les lignes" du rapport des forces entre les deux classes historiques. Et la bourgeoisie en prit acte lorsqu’elle décida le démantèlement du système d’apartheid, se traduisant par la réunification de toutes les fractions du capital en vue de faire face à la déferlante de la lutte de la classe ouvrière. Très concrètement, pour parvenir à ce stade de développement de sa combativité et de sa conscience de classe, la classe ouvrière dut prendre en main ses luttes en se dotant, par exemple, de comités de lutte (les tonitruants CIVICS ) par centaines dans lesquels s’exprimaient son unité et sa solidarité de classe durant la lutte en dépassant, de fait et dans une large mesure, la "question raciale" en son sein. Ces CIVICS, une haute expression du mouvement de Soweto, sont l’aboutissement d’un processus de maturation commencé dans la foulée des luttes massives des années 1973/74.
Pour faire face à ce magnifique combat ouvrier, la bourgeoisie, elle, a pu compter, particulièrement, sur la redoutable arme du "syndicalisme de base", sans jamais oublier pour autant son arsenal répressif.
Bien qu’éloigné géographiquement des bataillons les plus expérimentés et concentrés du prolétariat mondial dans les vieux pays capitalistes, le prolétariat sud-africain a fait la preuve, dans la pratique, de sa capacité à assumer un rôle très important dans le chemin qui mène au renversement du capitalisme et à l’instauration du communisme. Certes, on sait que le chemin sera long et chaotique et les difficultés énormes. Mais il n’en existe pas d’autre.
Lassou (fin 2017)
[1] Voir Revue internationale n° 158, l’article « Du mouvement de Soweto en 1976 à l’arrivée au pouvoir de l’ANC en 1993 ».
[2] Revue internationale, n° 158, ibid.
[3] Il s’agit notamment des dirigeants ou membres du COSATU issus de la FOSATU (Federation of South African Trade Unions), comme on peut le lire dans la Revue internationale n° 158 : "En effet, la COSATU fit usage de son "génie" pernicieusement efficace au point de se faire entendre simultanément par l’exploité et l’exploiteur en parvenant ainsi à "gérer" astucieusement les conflits entre les deux véritables protagonistes, mais au service, en dernière analyse, de la bourgeoisie. (…) Il (ce courant syndical) a développé au début des années quatre-vingt un projet syndical original et ce, à partir d’une conception explicitement indépendante des principales forces politiques ; il s’est formé à partir de réseaux d’intellectuels et d’étudiants (…) en se voulant à la fois "gauche syndicale" et "gauche politique" et que nombre de ses dirigeants furent influencés par l’idéologie trotskiste et stalinienne critique."
[4] Judith Hayem, La figure ouvrière en Afrique du Sud, Editions Karthala, 2008, Paris. Selon son éditeur, Judith Hayem est anthropologue, maître de conférences à l’Université de Lille 1 et membre du CLERSE-CNRS. Spécialiste des questions ouvrières, elle a réalisé des enquêtes d’usine en Afrique du Sud, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis et en France. Depuis 2001, elle poursuit ses recherches en Afrique du Sud autour des mobilisations en faveur de l’accès aux soins du VIH/SIDA dans les mines.
[5] D’ailleurs, 10 ans après cet épisode, les diverses composantes de l’ANC sont encore ensemble à la tête du gouvernement sud-africain, du moins au moment où nous écrivons ces lignes à l’automne 2017.
[6] Judith Hayem, Iibid.
[7] C’est en note de bas de page que l’auteur cité précise le nombre des victimes en ces termes : "On estime que 11 à 12 personnes ont perdu la vie, et que de nombreuses autres, grévistes ou non-grévistes, et main d’œuvre de remplacement furent blessés". Et le tout sans aucun commentaire, comme si l’auteur cherchait à minimiser l’importance du massacre ou à préserver l’image du responsable en chef Mandela, "l’icône des démocrates".
[8]Le Monde diplomatique, mars 2013.
[9] Encore actuellement (début août 2018), au moment de sa publication et donc postérieurement à la rédaction de cet article, lors des élections législatives, le Zimbabwe est en proie à une nouvelle flambée de violences et à une répression sanglante de l’armée contre les manifestations des "opposants" aux dignes successeurs du régime massacreur de Mugabe.
[10] Voir le premier article de cette série dans la Revue internationale, n°154 qui montre (entre autres exemples), que pour venir à bout d’un mouvement de grève des mineurs en 1922, le gouvernement sud-africain décréta la loi martiale et regroupa environ 60 000 hommes équipés de mitrailleuses, canons, chars et même des avions. Lors de la répression de cette grève, 200 ouvriers ont été tués et des milliers d’autres blessés ou emprisonnés.
[11] En fait, le NUM a été débordé par une nouvelle organisation indépendante, à savoir l’association des travailleurs des mines et de la construction l'AMCU (Association of Mineworkers and Construction) créée à l'initiative d'un certain Malema. Un syndicat de base qui a pris l’initiative de la grève en opposition frontale avec le NUM et le gouvernement de l’ANC en se révélant très combatif, y compris dans les affrontements armés avec les forces de l’ordre. Il s’agissait au départ d’un groupe d’ouvriers qui ne supportaient plus la dégradation de leurs conditions de travail mais aussi et surtout la complicité entre le NUM et le patronat minier et, ce faisant, ils ont été massivement suivis par leurs camarades mineurs, ralliant même des membres du syndicat officiel.
[12] Le même Julius Malema a créé depuis lors son propre mouvement politique dit « Combattants pour la liberté économique » (Economique Freedom Fighters), un mélange de populisme radical, de nationalisme (noir) et de « socialisme » (de type stalinien) en projetant de nationaliser l’économie au « profit des pauvres ». Par ailleurs, il est souvent à la tête des manifestations contre le gouvernement Zuma, comme celle du 12 avril 2017 à Pretoria réunissant plus de 100 000 personnes (selon la presse), "une grosse foule à dominante noire vêtue de rouge, la couleur des EFF".
[13] Voir Revue internationale n° 154, l’article « De la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale ».
[14] Voir Revue internationale n° 154, ibid.
[15] Voir Revue internationale n° 158, ibid.
Géographique:
- Afrique du Sud [550]