Révolution Internationale - les années 1970
- 3605 lectures
A ses tous débuts, Révolution Internationale est une revue ronéotée, tirée à la main, et vendue en librairie, dans les marchés, les manifs, et devant les usines. C'est l'expression du groupe "Révolution Internationale", qui deviendra plus tard la section en France du CCI.
Nous publierons ici, de temps en temps et selon leur utilité pour des débats en cours dans le camp internationaliste, des articles publiés dans Révolution Internationale.
Structure du Site:
Révolution Internationale - 1970
- 781 lectures
Révolution Internationale n°4 - ancienne série - Juillet 1970
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 941.2 Ko |
- 32 lectures
Le problème paysan
- 14 lectures
La révolution socialiste ne peut avoir aucune chance de triompher si elle ne parvient pas à s’étendre dans les campagnes ou encore si celles-ci lui demeurent hostiles. La révolution prolétarienne est obligatoirement totale et englobe l'ensemble de la société : le secteur industriel -du fait de sa dépendance vis à vis de l'agriculture pour les matières premières et pour l'essentiel de son alimentation- ne pourrait vivre isolé ni établir un régime économique quelconque indépendamment de la campagne. En outre, l’exploitation n’a pas comme domaine exclusif la ville et l'industrie : son plus ancien royaume fut la campagne. Le capitalisme en développant une nouvelle forme d’exploitation à la ville n‘a pas éliminé celle des paysans. Il n’a fait que l’abandonner dans des structures d’autant plus archaïques qu'elles contrastent avec celles de la production capitaliste.
Cependant, les déterminations économiques qui font du prolétariat la principale classe révolutionnaire n'existent pas dans le paysannat exception faite des entreprises agro-industrielles.
Il en découle des attitudes différentes avec des intérêts immédiats souvent contraires; ainsi, pendant les événements de Mai 68 (sauf quelques rares exceptions, à Nantes par exemple) le paysannat français demeura à l’écart du mouvement. Surpris -voire même amusé- au début, vite gêné, il devint fréquemment ouvertement hostile à cette agitation et à ces grèves qu'il ne parvenait pas à comprendre.
Le problème paysan est donc un des problèmes les plus difficiles auxquels devra faire face la révolution. Nous ne prétendons pas le résoudre ici, ni même le poser dans toute son ampleur. Nous tentons simplement d’esquisser les traits qui nous semblent fondamentaux à l'heure actuelle. Et cela surtout dans le cadre français et européen.
Dans la première partie nous essaierons de définir quels sont les problèmes qui se posent à l’agriculture et aux paysans européens à l'heure actuelle; dans la seconde , de quelle façon le prolétariat est amené à affronter le problème agricole.
- I - La situation de l’agriculture de l’Europe des six
L’agriculture européenne produit trop pour ses besoins et à des prix trop élevés.
Il est évident que ces deux constatations peuvent paraître contradictoires. Dès lors, on peut se demander :
- Pourquoi l’agriculture européenne produit trop î Par rapport à qui produit-elle à des prix trop élevés? L’insistance des capitalistes à dénoncer cette situation permet de dire,sans se tromper qu'ils - ne le- font pas pour défendre le pouvoir d1 achat -des travailleurs»
- Comment les dirigeants politiques envisagent-ils de résoudre ce problème?
- Quelles vont être les conséquences socio-économiques de la nouvelle politique envisagée ?
Au cours de cette première partie, nous tenterons de répondre à ces questions.
Dans son aspect fondamental, le problème agricole se pose à partir du moment où une société entre dans une phase d’industrialisation; c’est donc avant tout le problème de l’évolution des Structures socio-économiques, Le progrès technique résultant de l’industrialisation a, entre autres conséquences celle de décupler le rendement de la force de travail de l’homme à travers l’appropriation de certaines forces naturelles. Transposer au secteur agricole : si pour produire un volume de biens nécessaire (et suffisant) pour nourrir X personnes, il faut tant de travailleurs ayant à leur disposition tels moyens techniques ; l’augmentation de ces moyens techniques entraînera une augmentation du volume de production ; le résultat sera une surproduction. Compte tenu qu’il est très difficile, voire impossible, d'augmenter les besoins alimentaires des gens en ce qui concerne les produits de base à partir d’un certain niveau de satisfaction, deux situations peuvent se présenter :
- L'augmentation de la- productivité est compensée par une diminution équivalente de la main d’œuvre, et l'équilibre est rétabli,
- L’augmentation de la productivité n’est pas compensée par une diminution adéquate de la main d'œuvre et il y a déséquilibre. Le surplus de quantité apporté sur le marché va entrainer une baisse des prix, cela en vertu de la concurrence, sans pour autant permettre l'écoulement de la totalité de la production et donc une baisse de revenus pour le producteur ,
C'est une des origines de la crise agricole européenne et plus généralement de l'ensemble des pays capitalistes de type occidental, car pour le reste .du monde, le problème agricole à résoudre est exactement l'inverse.
Le problème agricole européen : aspect historique.
En Décembre 1960 le plan Mansholt est publié[1], Sa conclusion est simple : il est temps d'intégrer le secteur agricole à l'ensemble du système économique capitaliste. Car il représente de plus en plus une entrave au développement de ce système. Les politiques de soutien des prix et de l'amélioration des structures mises en place depuis 1964, dans le cadre de la Communauté Européenne, deviennent insupportables pour les différentes économies nationales (à cause des charges de plus en plus importantes qu'elles représentent),ce qui, à moyen terme remettrait en cause la rentabilité du système lui-même.
Pourtant depuis 1955? le problème des excédents agricoles se pose, et par la même occasion celui de l'évolution des structures socio-économiques. Dès lors on peut se cm mander pourquoi avoir attendu si longtemps pour essayer de résoudre ce problème.
L'ouverture de la production aux échanges monétaires et l'évolution des techniques (résultat de l'industrialisation) entraina une intégration spontanée et progressive de l'activité agricole dans le réseau des relations inter-industrielles. En effet, la concentration urbaine créant des besoins immenses en alimentation loin des centres de production obligea les agriculteurs à mettre sur le marché une part toujours plus grande du volume de leur production., Le progrès technique entraîné par le développement de l'industrie incita les agriculteurs à se moderniser pour produire davantage, ce qui, théoriquement devait leur permettre de voir leurs revenus s'accroître. Parallèlement cette modernisation leur créa des besoins financiers toujours plus élevés (amortissement du matériel, remboursement d'emprunts ). Le seul moyen de compenser ces sorties d'argent était d'augmenter encore la production, De plus, l'évolution du mode de vie à la ville se répercutant au niveau de la campagne notamment par l’intermédiaire des jeunes et aussi par la nécessité d'une certaine spécialisation du travail, condition nécessaire pour accroître la productivité, entraina la diminution de l'auto-consommation. On assista en contrepartie à une augmentation très nette des besoins des secteurs agricoles en biens provenait du secteur industriel,
Enfin, la modernisation du secteur agricole représentait pour l’industrie capitaliste d'énormes débouchés. Une publicité insidieuse, utilisant à fond la mentalité individualiste du paysan, réussit à lui imposer des besoins sans cesse nouveaux et accrus, qui le condamnent à se soumettre en tant que tel aux lois capitalistes ou bien à disparaître .
Avec le recul du temps, beaucoup de personnes (les technocrates entre autres) émirent l’idée que l'intégration du secteur agricole aurait dû se faire depuis longtemps :pourquoi l'avoir conservé avec des structures défiant tout rationalisme économique ? Une telle question dénote ou prouve un refus de voir les conditions de développement du capitalisme en général et sa position face ru problème agricole en particulier.
En I946 , l’ensemble des économies nationales européennes se trouvaient dans une situation catastrophique,
Il fallait d'une part assurer une production agricole capable dans l'immédiat de nourrir la population et de mettre fin au rationnement qui sévissait, d'autre part permettre la remise en route du secteur industriel particulièrement atteint par la guerre. Le peu de capitaux dont on disposait à ce moment-là devait aller en priorité à l'industrie, seul secteur représentant de réelles possibilités d'expansion. Du fait d'un parc matériel presque inexistant, une seule solution s'imposait au secteur agricole : disposer d’une main-d’œuvre[2] importante, ce qui se traduisait dans la réalité par le maintien des structures agraires traditionnelles[3].
Globalement, la population active agricole a diminué d'un tiers par rapport à 1955-
La formation brute du capital fixe qui comprend:
- la création de bâtiments neufs ou l'amélioration de bâtiments
- -l'acquisition de machines neuves et de matériel neuf
- -création de nouvelles terres et l’amélioration durable apportée aux terres.
Entre 1955 et i960, la formation brute du capital fixe en France, en Allemagne et en Italie est à peu près la même (près de cinquante milliards dans chacun des trois pays) ce qui représente une formation presque nulle en moyenne (par exploitation, en France, cela correspondrait à 4.000 Francs par an), Ceci indique dans la réalité une formation brute du capital fixe assez bonne au niveau des grandes exploitations, Ce fait est mis en évidence par un chiffre d’affaires exprimé par unité de travailleur très élevé au niveau do cette dernière catégorie d’exploitations par rapport à l’ensemble. Ceci sous-entend une productivité élevée du travail (toujours par unité de travailleur) et donc une forte utilisation de techniques modernes de production.
Le mode de faire valoir (méthode d’action de faire produire des revenus à une exploitation agricole) se subdivise en deux grands- groupes :
- les exploitations en mode de faire valoir direct, c’est à dire travaillées par les propriétaires eux-mêmes. Ceci intéresse la majorité des petites exploitations à caractère familial.
- Les exploitations à mode de faire valoir indirect qui, elles-mêmes se subdivisent en deux catégories:
- les exploitations en métayage. Le métayer prend en charge une partie des frais de production (un tiers et un demi), l’autre partie étant supportée par le propriétaire; le revenu (il faut entendre par là le montant de vente plus l’auto-consommation) se répartit dans les mêmes proportions. Le système de production est décidé en théorie d’un commun accord. '
Le capitalisme n'avait donc ni le besoin ni la possibilité d'intervenir directement au niveau des structures de production agricole.
Nous avons déjà montré la dépendance du secteur agricole vis à vis de l'industrie. Par la suite ce phénomène s’accéléra, lorsque le volume de la production avoisina la capacité d'absorption du marché, ce qui eut pour effet un tassement des prix et comme conséquence une augmentation du volume de la production[4] afin de compenser la baisse des prix. ^ partir de ce moment que l'on peut situer aux environs de 1955»plusieurs faits sont à noter :
- L'inorganisation des marchés, résultat du nombre incalculable d'intermédiaires, vivant en parasites sur le secteur agricole et tenant par-dessus tout à ce que les circuits intermédiaires entre la production et la vente ne soient pas réorganisés. Ceci pesa-et continue de peser- très lourd sur les prix à la production qui tendaient au fur et à mesure de la saturation des marchés à correspondre de plus en plus à une simple valeur résiduelle, principalement en période de surproduction aigue (cas des produits saisonniers).
- L'exode rural. L'attirance de la ville pour un bon nombre de jeunes (appelés aides familiaux) et d'ouvriers agricoles, duo à des salaires plus élevés et à un mode de vie leur paraissant plus conforme à leurs aspirations, liée très souvent à une nécessité de quitter l'exploitation, favorisa la migration d'une partie de la population active agricole . Dans beaucoup de cas, la déception deva.it suivre, car le véritable débouché qu'on leur offrait était manœuvre dans les usines ou sur les chantiers. La nécessité de quitter la campagne s’explique parfaitement par trois raisons:
- le manque de travail pour occuper tout le monde, conséquence de la modernisation.
- le manque de capitaux qui aurait permis en changeant l'orientation de l'exploitation d'assurer le plein emploi tout en permettant à chacun de disposer d’un revenu suffisant
- le manque de dynamisme du chef de l’exploitation qui reste très souvent attaché aux traditions; s'il se soumet ’ à une certaine modernisation pour se maintenir en vie, il refuse catégoriquement de remettre en cause les fondements de son mode de vie et de travail.
La politique des gouvernements
Une seule préoccupation majeure: maintenir les prix dans des limites raisonnables, c'est à dire:
- supportable par les ouvriers pour éviter des revendications.
- acceptable par les .agriculteurs, toujours dans le même but pour les nombreux intermédiaires, du moins provisoirement;
- satisfaire aux conditions de développement de capitalisme moderne.
Les quelques années qui suivirent la guerre furent très lourdes en conséquence. Il fallait produire pour nourrir ; de ce fait les prix pratiqués étaient déterminés par les besoins des gens et non par le coût de production. Il n'était pas possible pour le gouvernement d'imposer une baisse des prix des produits agricoles ce qui aurait entrainé, au niveau de ce secteur, des réactions très violentes.
Tant que l'agriculture européenne fut déficitaire, son principal rôle fut de faciliter l’augmentation de la productivité par une série de mesures (subventions, primes, prêts spéciaux) tant au niveau des structures d’exploitation qu’au niveau des organismes professionnels, véritables courroies de transmission entre le gouvernement et la profession.
Parallèlement, afin de régulariser les cours des marchés, on favorisa les exportations. Ceci présentait l’avantage d’obliger les agriculteurs à mettre sur les marchés des produits capables de concurrencer ceux provenant des importations, et ce- , au niveau de chaque pays[5].
En 1958, c’est le traite de Rorac pour chacun des six pays signataires[6], cela représentait avant tout une extension importante du marché, à la condition toutefois que leurs prix soient compétitifs, ainsi chaque pays mit sur pied une politique agricole qui devait -une fois la période de transition terminée- placer chacun d’entre eux dans une position favorable par rapport à ses voisins.
Croyant sans doute rendre service aux agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles lancèrent une campagne en faveur de cette politique, bien que les marchés fussent déjà très encombrés. Les résultats ne se firent pas attendre; la dégradation des prix agricoles -comme suite à la persistance de surplus- et une violente réaction des agriculteurs, dont l’immense majorité disposait d’exploitations inférieures à 20 Ha, (35%), obligèrent les syndicats à réclamer une politique, de soutien des prix et les gouvernements à la leur accorder, d'abord séparément, puis, en 1964, dans le cadre de la communauté (soutien inconditionnel des marchés).
Le besoin de pratiquer une politique efficace d'amélioration des structures de production, et de commercialisation, dans le cadre communautaire[7], apparut rapidement ; malgré les déclarations de principe, elle demeura le domaine réservé de gouvernements nationaux. Elle correspondait néanmoins^ dans tous les pays, aux mêmes besoins, à savoir : diminution du coût et rationalisation, tint au niveau de la production que de la commercialisation. On insista, de part et d'autre, sur la nécessité de la parité des revenus entre le secteur agricole et les autres secteurs.
Si, en apparence, cette politique donnait satisfaction à la profession, son contenu, malgré toute une phraséologie bourgeoise très classique (défense des valeurs morales, de l’exploitation à caractère familial, etc…), elle préparait en fait le terrain à des réformes menant obligatoirement l'agriculteur vers son intégration dans un mode de production capitaliste.
On voit mal cornaient peuvent se concilier deux impératifs aussi contraires que celui de la parité des revenus -qui, compte tenu du contexte socio-économique- ne pouvait être obtenue que par une augmentation des prix et celui de la diminution des coûts de production qui correspondrait à une baisse des prix de vente et qui, permettrait aux produits agricoles d'être compétitifs au niveau des marchés internationaux.
On nous abreuve encore actuellement de l'idée de placer l’agriculture dans une optique concurrentielle vis-à-vis des autres pays en vue de l'exportation de ses produits.
Si l'on précise que les marchés mondiaux des produits agricoles ne représentent que 5% de l'ensemble de la production mondiale et que ces % correspondent aux surplus nationaux, on peut se demander où se trouvent les débouchés internationaux. Les pays sous-développés représentent des "débouchés potentiels" mais, d'une part, le peu de liquidités dont ils disposent est investi par priorité dans l'industrie, et d'autre part, comme le fait si bien remarquer le rapport Vedel, les besoins biologiques immédiats, du "Tiers-monde" excèdent à court terme largement les possibilités financières que les pays développés sont prêts à accorder, compte tenu des avantages politiques recherchés et des rivalités entre les donataires. En termes clairs, cela revient à dire qu’ils n'offrent aucun débouché réel.
Les pays dits communistes (le bloc russe et la Chine) évitent dans la mesure du possible de s'approvisionner sur les marchés mondiaux. Ils ne le font que dans deux cas bien précis : l) lorsque leur production intérieure est nettement insuffisante, 2) lorsque les cours mondiaux sont très bas ; dans ce cas, les achats qu’ils effectuent dénotent une pratique marchande de la pire espèce. La Russie, experte en la matière, achète ainsi du blé ou du beurre au cours mondial ; elle en revend une partie à ses satellites au prix intérieur du COMECOM, ce qui lui permet -vue la différence de prix- de faire financer par son "satellite" la part qu’elle a conservée pour ses propres besoins.
Ceci étant dit (et devant être dit) ces pays-là ne représentent pas non plus de débouchés réels, pas plus que les autres pays, les pays capitalistes n'offrant pas de débouchés sérieux.
En effet, pour se développer, les "capitalismes nationaux" doivent éviter d’importer des produits agricoles ; le cas contraire les placerait dans une position de dépendance vis à vis des fournisseurs, ce qui, à moyen terme les mettrait obligatoirement en cause. Ceci les incite réciproquement à pratiquer une politique agricole d’auto-approvisionnement suffisant.
Une politique d’importation correspond à deux situations bien précises ; 1) lorsque les produits agricoles manquent (ce qui risque d’entraîner des mouvements sociaux), 2) lorsque les prix intérieurs des produits agricoles, trop élevés entraînent des revendications salariales. Dans ce dernier cas -comme nous l'avons vu- un apport extérieur permet de casser les prix agricoles momentanément.
LE VERITABLE PROBLEME : COMMENT PARVENIR A MIEUX EXPLOITER LES TRAVAILLEURS AU MOYEN DE L’AGRICULTURE....
Les raisons d’une politique agricole exportatrice étant écartées, il nous faut revenir aux problèmes intérieurs et voir dans quelle situation se trouvaient les capitalismes nationaux ; ceux-ci devaient penser maintenant à lutter sérieusement contre la concurrence internationale qui inondait de plus en plus les marchés nationaux, de produits industriels meilleur marché que les leurs. Si les barrières douanières assez élevées pouvaient leur permettre de respirer un peu, ils savaient pertinemment que cela ne pouvait représenter qu’un palliatif. De ce fait il leur était nécessaire de diminuer leurs coûts de production, ce qui passait obligatoirement par un accroissement de leur productivité et une compression de charges salariales.
L'étude de l'utilisation des revenus des ménages nous révèle un fait intéressant ; on dépense en moyenne pour se nourrir de 15 à 50% de son revenu, suivant que l'on est un patron ou un ouvrier. La relation est évidente ; si les prix de la nourriture baissent, on pourra limiter la hausse des salaires des ouvriers (basée sur l'augmentation du coût de la vie). Le but recherché pourra ainsi être atteint. Au niveau de chaque économie, cela implique une série de mesures à prendre, la première étant la diminution des prix agricoles par la réorganisation des structures de production.
La diminution du prix des produits agricoles ne peut s'obtenir que par une utilisation optimale des facteurs de production, c'est à dire, essentiellement par une augmentation de la productivité, ce qui correspond à une rentabilisation des facteurs de production.
Voyons quels sont les effets d'un accroissement de productivité dans le secteur agricole sur l'ensemble de l'économie (principalement au niveau industriel).
Une diminution du nombre d'heures socialement nécessaires pour produire une quantité donnée de marchandises, entraîne une diminution de leur valeur d'échange (valeur qui s'exprime obligatoirement en heures de travail) et donc, de la valeur pour les acquérir.
Comme Marx l'a mis en évidence, le salaire versé par le capitaliste correspond à la quantité de biens nécessaires à la reproduction de la force de travail du travailleur. C'est à dire qu'il ne paie pas à l'ouvrier une valeur (en heures de travail) constante, mais la valeur d'échange de cette quantité de biens.
Une partie du salaire correspond à une certaine quantité physique de biens alimentaires. Un accroissement de la productivité agricole -c'est à dire une réduction du nombre d'heures de travail socialement nécessaire pour produire ces biens- entraîne donc une diminution de la valeur de la part de salaire correspondant à 1'acquisition de cette quantité de biens alimentaires.
L'ouvrier ne recevant que la valeur nécessaire pour acquérir la même quantité de biens, son salaire réel (i.e. exprimé en temps de travail) s'en trouve diminué d'autant. La différence entre le travail fourni par l'ouvrier et la contrepartie qu'il reçoit sous forme de salaire -différence dont s'approprie le capitaliste- s'accroît de cette quantité. Le temps de travail de l'ouvrier étant toujours le même, l'ouvrier travaillera un temps plus long pour le capitaliste, tout en recevant un salaire moindre.
Cette diminution de salaire apparaîtrait dans le cadre d'un système économique capitaliste dans lequel la monnaie aurait une valeur constante, par une diminution en valeur (exprimée en monnaie) des prix agricoles et des salaires. Dans le cadre d'une économie capitalise inflationniste -dans laquelle nous nous trouvons depuis la première guerre mondiale- c'est à dire, caractérisée par une hausse constante et générale des prix, on assiste à :
- un accroissement du prix des produits agricoles inférieur à l'accroissement des prix industriels.
- un accroissement du niveau général des prix, supérieur à l'accroissement du niveau des salaires.
Ce surplus, dû à une compression réelle des salaires, permettre au capitaliste de diminuer ses prix de vente (limitation do la hausse) et d'accroître ses possibilités d'investissement.
Et des petits commerçants...
Cependant la seule diminution des prix agricoles ne suffisait pas.
Il fallait obtenir une réduction des prix des produits alimentaires[8] en général. La réorganisation des circuits de commercialisation[9] s'imposait, ce qui impliquait :
- l'organisation effective du secteur industriel de transformation clos produits agricoles[10] qui se situaient assez souvent à un stade d'évolution du type néo-artisanal.
- l'organisation du circuit de distribution qui se caractérisait par le désordre le plus complet. Le nombre incalculable d'intermédiaires et de détaillants (commerçants) dont chacun prélevait -et continue de prélever- sa marge de bénéfices, soi-disant en raison des services rendus[11] et qui concrètement vivent en parasites aux dépens des travailleurs de la ville et de la campagne, sont responsables du prix de vente toujours en hausse des produits agricoles en particulier, et des produits alimentaires en général.
Enfin, pour parfaire ces mesures, la concentration de l’industrie para- agricole, en aval de la production, devenait obligatoire,
La mise en place de l'Europe Verte, dont une des principales conséquences fut l'unification des prix agricoles européens, pesa lourd dans la balance, Pour chacun de ces pays, il était hors de question de fixer des prix inférieurs au cours pratiqué à l'intérieur d'un de ces pays, du moins en apparence. Une autre position aurait entraîné immédiatement des conflits entre gouvernement et agriculteurs sous le prétexte de la parité des revenus -parité déjà fort compromise. La politique de soutien des prix, mise en place communautairement en 1964, renforcée par le fait précédent, loin d'assainir la situation, augmenta les excédents ; en effet, la diminution du nombre d'actifs agricoles était loin de compenser une utilisation de plus en plus généralisée de techniques de production modernes.
Le niveau des prix pratiqués -tout en profitant à l'exploitant important qui voyait son revenu augmenter grâce à l'augmentation des rendements, et cela, malgré des charges de plus en plus lourdes- ne permettait pas au petit paysan de disposer d'un revenu lui permettant de vivre décemment. Pour lui, les charges augmentaient plus vite que les recettes. Mais, d'une part son attachement à la terre, d'autre part son âge (supérieur à 35 ans) qui lui créait un sérieux handicap pour se reclasser, le faisaient rester à la campagne.
En 1968, l'explosion des luttes revendicatives ouvrières, d'abord en France, puis dans l'ensemble de l’Europe.ne firent que renforcer la nécessité pour les capitalistes de mettre sur pied la réforme de l'agriculture et de ses circuits annexes. Ceux-ci se trouvaient dans une fort mauvaise posture ; d'un côté ils devaient faire face à l'accroissement des charges salariales, de l'autre, ils devaient financer l'aide à 1'agriculture (soutien des marchés, réorganisation dos structures de production). Le montant global des aides versé au secteur agricole en 1969 atteignit près de 30 milliards de francs[12]. (12),
Parallèlement la différence entre les prit: des produits agricoles européens et les cours mondiaux atteignait des niveaux records. Le tableau reproduit dans la page qui suit, illustre particulièrement bien ce phénomène.
De la recommandation verbale ou écrite, le capitalisme devait passer maintenant aux fait. Les déclarations gouvernementales étaient nettes.
L’agriculture traditionnelle devait disparaître pour laisser place, à une agriculture "intégrée". Mais avant de passer à la politique agricole envisagée, on doit préciser quelques points, '
Niveaux des prix(l) de certains produits agricoles du marché commun
par rapport au niveau des prix pratiqués sur le marché mondiale(2)
|
1967 / 68 en % |
|||
|
Produits |
Prix marché commun u.c./100kg |
Prix marché mondiale |
En % |
|
Blé tendre |
10,73 |
5,75 |
185 |
|
Blé dur |
16,14 |
8,07 |
200 |
|
Riz décortiqué |
17,96 |
15 ,34 |
117 |
|
Orge |
9,07 |
5,67 |
160 |
|
Maïs |
9,01 |
5,63 |
160 |
|
Sucre blanc |
22,35 |
5,10 |
438 |
|
Viandes bovines |
68,00 |
38,82 |
175 |
|
Viandes de porc |
56,71 |
38,56 |
147 |
|
Volailles |
72,33 |
35,00 |
131 |
|
Œufs |
51,14 |
38,75 |
132 |
|
Beurre |
187,44 |
47,25 |
397 |
|
Huile d’olive |
115,72 |
69,84 |
166 |
|
Graines oléagineuses |
20,19 |
10,11 |
200 |
|
(1) Y compris les aides directes à la production pour le blé dur, l’huile d’olive et les graines oléagineuses, (2) Prix d’entrée pour le commerce de gros. (3) Période de référence pour les divers produits différents SOURCE : Direction Générale de l'Agriculture. (Cité du plan Mansholt; annexe 12, p 93. Ed. Groupe La Fayette) |
l) La politique apparemment contradictoire des gouvernements repose sur deux faits essentiels: les paysans et les commerçants ont toujours constitué une masse électorale, fidèle défenseur des intérêts du capitalisme . De ce fait, les gouvernements en place ont très souvent été contraints, pour des raisons électorales de ‘'lâcher des débris" pour conserver leur appui. L'héritage de la révolution de 1789 avec sa tradition petite bourgeoise de la libre entreprise renforce ce phénomène.
Le capitaliste, bon père de famille qu’il est, support’ ces "parents bâtards" tant qu'ils peuvent lui rendre service ; Liais à partir du moment où ils lui coûtent de l’argent, on peut lui faire confiance pour qu’il s’en débarrasse. Il lui faut paver peur soutenir l’agriculture, • ce qui l’oblige, en plus, à consentir des augmentations de salaires. Or, cela ne surprendra personne, le capitaliste ne fait jamais de libéralités sans contrepartie future.
2) La rentabilité des capitaux en agriculture est de très loin inférieure à celle de l’industrie ou à certains services. Les capitaux vont par nature là où ils rapportent le plus. Les capitalistes n’ont, répétons-le, ni envie, ni intérêt à s’occuper de l’agriculture tant que celle-ci ne le gêne pas pour son développement.
...Tout en utilisant les syndicats...
Jusqu'à présent nous ne nous sommes guère préoccupés de 1'attitude des organisations professionnelles agricoles et des syndicats en particulier.
En règle générale, dirigés par les gros exploitants, les syndicats défendaient, à travers des revendications générales, les intérêts de cette catégorie. Dans un premier temps, ils firent le jeu du capitalisme, mais pris de vitesse ils se retrouvèrent obligés de prendre des positions franchement rétrogrades.
Quelque soient les pays, les syndicats se voulant représentatifs de l'ensemble des agriculteurs (petits ou gros propriétaires ou fermiers) ou au contraire étant spécialisés par grandes branches de produits, on constate des attitudes fondamentalement identiques.
Dans tous les cas leurs revendications portent essentiellement sur :
1) La demande d’augmentation du prix des produits agricoles ;
2) La demande du soutien des prix agricoles dans le cas de surproduction.
Ils se plaignent régulièrement de :
1) L’envahissement du marché national par les produits étrangers ;
2) L’augmentation du coût des moyens de production ;
3) De l'incompréhension de la ville face à leurs problèmes.
Leur position vis à vis des syndicats est claire : l’augmentation des salaires entrainant obligatoirement une augmentation du coût des moyens de production, les syndicats ouvriers sont donc responsables de leurs malheurs ! (les syndicats ouvriers tiennent d'ailleurs à peu près le même raisonnement) Il ne leur est pas venu une seule fois à l’idée que les capitalistes pouvaient être pour quelque chose dans l'affaire.
Ils jouent sans cesse un rôle de modération et de conciliation entre les agriculteurs ayant des intérêts opposés afin de maintenir l’unité de la classe paysanne en rendant tour à tour responsable n’importe qui de n'importe quoi (les ouvriers, les capitalistes, les commerçants, voire les paysans eux-mêmes !)
Ce rôle de conciliation se retrouve contre la profession et les capitalistes . Ils ne peuvent remettre en cause le capitalisme sans remettre en cause leur propre existence, tous deux défendant la même idéologie.
Refusant de voir le problème qui se pose aux petits paysans (fermiers et métayers) condamnés par le progrès technique à disparaitre, le syndicat s'appuie sur eux pour obtenir des garanties de prix et des subventions qui bénéficient surtout aux gros agriculteurs.
Ils sont obligés, pour se maintenir, de prendre position pour la majorité du paysannat, c'est à dire de défendre les petites exploitations familiales ; d’autre part ils sont soumis aux pressions des gros exploitants ; prisonniers de leurs contradictions internes, les syndicats agricoles ne sont en définitive qu'un instrument au service du capitalisme. La tendance socialiste qui se dessine à l'heure actuelle[13] demeurant très réformiste, ne laisse envisager à court terme qu'un éclatement au sein des syndicats.
Les autres organisations professionnelles, dont la plupart sont des vestiges du passé, ont permis à l'agriculture de conserver le plus longtemps possible ses structures archaïques (y compris sa mentalité). Leur attitude très semblable à celle des syndicats, ne mérite aucun commentaire si ce n'est pour préciser (ceci est tout aussi valable pour les syndicats) que l'on doit avant tout dénoncer le rôle qu'elles font jouer à l'agriculture face au prolétariat : celui de faciliter son exploitation.
La définition de la politique à suivre
Les capitalistes, toujours très sérieux en affaires, tiennent avant tout à expliquer pourquoi l'agriculture se trouve dans cette situation. On peut résumer très brièvement leur position, en reproduisant quelques extraits d'un article paru dans "L'Expansion" de février 69 :
- "L'agriculture est-elle un luxe?" ;
- "Le plan Mansholt pose brutalement le problème que personne ne voulait voir : l'Europe a deux fois trop de paysans."
Au cours de l'article on pouvait lire :
- "La production a augmenté de plus de moitié sur moins de terres et avec une main d'oeuvre diminuée de plus d'un tiers." ;
- ..."Non seulement elle (l'agriculture) ne fait plus la politique de l'Europe (...) mais encore elle est de plus en plus considérée comme un boulet un frein au progrès économique et social européen."!
Les mesures à prendre.
Les solutions proposées par l'intermédiaire du plan Mansholt pour résoudre les problèmes sont simples :
- augmenter la productivité ;
- limiter la production ;
- diminuer les coûts de production, de transformation et de commercialisation des produits ;
- diminuer progressivement les aides apportées à l’agriculture.
Au niveau agricole, cela, suppose :
- une diminution de 500.000 travailleurs agricoles par an (aides familiaux et petits paysans surtout). Pour arriver à cela on veut, d’une part accélérer la mise en retraite d’un certain nombre d'agriculteurs en leur donnant une retraite plus des primes (cela reviendra toujours moins cher que de soutenir les prix) et de plus., on conservera cette ¿nasse pour les élections. D’autre part, les jeunes devront -bon gré, mal gré- s’ils ne veulent pas "croupir dans la misère" vendre leur force de travail au capitalisme, venir grossir les rangs du prolétariat. Après avoir connu un délai, l’exode rural revient à l’ordre du jour, mais cette fois-ci définitivement. Du moins telle est l’opinion qu’on peut se faire ;
- Une utilisation rationnelle des techniques modernes de production, ce qui implique une dépendance réelle de la production par rapport au secteur d’amont (industriel).
La réduction des surfaces cultivées s'impose si on ne veut pas retomber dans le problème des excédents trop importants, (il faut en avoir juste ce qu’il faut pour limiter la hausse des prix.)
Certains pays -dont la France- n’osant pas le dire franchement préfèrent lancer une campagne sur la conservation de la nature et le besoin d'espaces verts où le citadin pourra aller se promener sans pour autant causer des préjudices à l'agriculteur. Celui-ci, bien entendu, sera chargé d'entretenir ces espaces. Compte tenu du nombre de citadins, cela réclame beaucoup d’espace, c’est normal !
La diminution des coûts de production.
Voici le point clé de l'affaire. Nous avons montré les incidences que cela entraîne pour le capitaliste et pour le travailleur. Elle, sera obtenue par la conjugaison des points 1 et 2 ci-dessus.
Au niveau du secteur en amont de la production, c'est évidemment l’intégration définitive de ce secteur ; cela touchera surtout les coopératives de production d'aliments de bétail, qui devront, face à la concurrence, soit se laisser avaler, soit disparaître.
Au niveau du secteur en aval de la production, une priorité : diminuer le nombre d'intermédiaires et de petits commerçants. Le replacement des intermédiaires par une politique contractuelle entre les producteurs et le secteur de transformation des produits agricoles, aura l’avantage d’orienter la production dans le sens désiré, tout en disposant d'un moyen de pression efficace sur les prix. Le secteur de transformation, de plus en plus sous le contrôle de grandes firmes (on peut citer à titre d'exemple la société américaine Lybies) ne manquera pas de jouer son rôle.
Pour la vente, les grandes surfaces ont fait leurs preuves. Elles rapportent à ceux qui investissent, tout en pratiquant des prix inférieurs à ceux des petits commerçants. Le chemin tracé, il n'y a plus qu'à le suivre.
Dépendant du secteur industriel d'amont, soumis au capitalisme d'aval, le nouvel agriculteur croyant devenir un capitaliste, ne sera en réalité qu'un façonnier au service d'une politique industrielle.
Cet agriculteur disposera d’un pouvoir d'achat élevé ; le capitaliste paie bien quand on lui donne le moyen d'exploiter davantage et surtout plus de personnes.
Pour parfaire l'ensemble de ces mesures, on tient à ce que ce type d'agriculture ne produise pas plus de 70% des besoins du marché. Le 30% restant seront fournis par l'agriculture traditionnelle, qui, de ce fait deviendra un simple volant de sécurité. En cas de surproduction ses produits ne trouveront de débouchés qu'à des prix dérisoires. En cas de sous-production, elle servira de complément. Bon an, mal an, elle arrivera à survivre sans plus.
Avant d’en arriver à ce stade d'évolution, il y aura tout de même quelques difficultés à résoudre.
Les difficultés à surmonter par le capitalisme
La première série de difficultés ost d'ordre financier : l’accroissement des dépenses pour le secteur agricole dans les quatre ans à venir va être assez fort. Or les difficultés financières des pays du marché commun laissent planer un doute sérieux quant aux possibilités de trouver de nouveaux capitaux sans entraîner une montée de l'inflation. D'autre part, il faut créer des emplois nouveaux, La difficulté pour trouver un emploi actuellement et le manque de capitaux pour en créer de nouveaux, n’apparaissent pas comme des signes de bon augure.
La deuxième série de difficultés est d'ordre politique. Jusqu'à présent les réactions des agriculteurs sont assez peu perceptibles. Comme d'habitude ils attendent les décisions concrètes. Or, les gouvernements n'ont pas le choix. Pour qu'elle soit efficace, cette politique doit être appliquée rapidement, Une mise en route dès cette année ou début 71, entraînera immédiatement des réactions très violentes de la part des agriculteurs,
Mais que peuvent faire les agriculteurs seuls, isolés de toutes parts, opposées à tout le monde -fait que les gouvernements ne manqueront pas d’exploiter- si ce n’est suivre le chemin qu’ils se sont tracés vis-à-vis du capitalisme, celui de le servir,
L'élargissement éventuel (et très probable) de la CEE par l’admission do plusieurs pays -l'Angleterre en tête- loin de résoudre les problèmes actuels de surproduction, risque néanmoins de favoriser la politique envisagée, au moins au niveau des prix. La productivité du secteur agricole de ces pays, jointe à des coûts do production très compétitifs pour un bon nombre de ¡produits, ne fera- que renforcer le besoin vital pour les capitalismes nationaux (qui continueront d’exister et de se concurrencer, y compris ceux de la Chine et de la Russie) de limiter les charges financières résultant des structures agricoles en place.
Face au problème agricole européen, les capitalistes réagissent de la seule façon qu’ils pouvaient le faire. On assiste à une concurrence do plus en plus effrénée, tant au niveau international que national entre capitalistes. Un seul point les réunit : exploiter toujours plus. Il importe peu pour eux de limiter la production de produits agricoles alors que globalement, deux hommes sur trois ne mangent pas à leur faim. Si un problème les préoccupe, ce n’est pas celui de la faim, mais bien celui de leur propre survie. Le problème agricole est à cet égard particulièrement édifiant
Paysans et prolétaire dans la lutte de classes
Depuis que le prolétariat a commencé à prendre conscience de sa lutte, le problème de son alliance avec le petit paysannat s’est toujours posé. Cette alliance semblait d’autant plus naturelle au début du capitalisme que les nouveaux prolétaires étaient très souvent d'origine paysanne ; c’est le temps de l'accumulation primitive du capital.
La nostalgie du monde de la campagne et de la production artisanale, face à l'enfer des industries, marquent ainsi les premières idées socialistes et peuvent expliquer l’influence de l’anarchisme en particulier celui de Proudhon, sur le mouvement ouvrier du XIXe siècle.
Cependant, au fur et à mesure que la classe ouvrière se développe en nombre et que ses intérêts propres apparaissent de plus en plus autonomes et antagonistes à l’ordre existant, la séparation entre petit paysannat et prolétariat ne fait que se creuser dans les faits.
En effet, quoique le petit paysan et l’ouvrier subissent tous deux l’oppression du capital, celle-ci s’exerce sur chacun d’eux de façon différente,
Pour le petit paysan, possesseur.de sa terre, producteur isolé elle s’exerce par le poids des hypothèques et des crédits usuriers et par une dépendance totale vis à vis des marchés sur lesquels il est de par sa position d’isolement impuissant. Il est en outre constamment menacé de disparition par les besoins de rentabilité et de concentration du capital qui tend à éliminer la petite propriété.
Pour les ouvriers ne possédant aucun instrument de production, cette oppression se traduit par l'obligation de se vendre quotidiennement comme force de travail, de participer à la production de façon totalement aliénée, c'est à dire dans l’impossibilité de contrôler le processus de production, et enfin, par la spoliation régulière de la plus grande partie de leur travail.
Aussi bien le petit paysannat que la classe ouvrière sont donc amenés à s’opposer au capital, mais de façons contraires; le petit propriétaire de terres qui voit ses prix de vente baisser sous la pression des acheteurs intermédiaires et de la concurrence, qui vit la menace de la disparition de son droit de propriété, tend à combattre le capital mais avec le désir de revenir à une situation antérieure, celle de la petite production où la propriété lui était garantie et où ses produits se vendaient sans difficulté.
Nostalgique d’une situation passée et assimilant tout progrès à sa disparition, son opposition est ainsi amenée à se manifester dans le sens d’un retour en arrière à constituer un frein à toute évolution ; cotte-opposition est donc historiquement conservatrice.
Les buts de la lutte de la classe ouvrière sont obligatoirement différents ; une fois que le capitalisme industriel s’est développé et que plusieurs générations d’ouvriers se sont succédées, aucun retour en arrière ne peut représenter un véritable attrait pour elle ; en outre, la participation directe à la production complexe moderne la force à comprendre à quel point un tel projet est absurde.
Le maintien de la propriété des moyens de production, est à la base de l’exploitation des travailleurs industriels ; l’ouvrier est contraint à se vendre lui-même comme force de travail à cause du haut niveau des techniques qui interdit toute possibilité de production individuelle à l’échelle sociale. Il est ainsi condamné à être la principale marchandise.
Quant à l’idée de partager les moyens de production parmi ceux qui travaillent -idée normale chez les petits paysans ne possédant pas assez de terres- elle n’a aucun sens pour le prolétariat qui participe à la production de façon associative par l’utilisation commune d’un complexe industriel. Le partage en parcelles d’une usine ne peut aboutir qu’à son démantèlement, Autant l’individualisme est naturel chez le paysan, producteur isolé qui n’a pas besoin des autres, ou qui ne peut les voir que comme concurrents, autant l’aspiration au communisme est le propre de la classe ouvrière..
C’est pourquoi, à l’heure de faiblesse de la classe dominante, quand le système en crise n’offre plus qu’un avenir de désastre et un présent de misère et de chômage pour la classe ouvrière, celle-ci ne peut plus envisager comme solution véritable que la gestion commune des moyens de production et l’élimination de la marchandise par l’élimination de son propre caractère de marchandise; c’est à dire la réalisation de la production en fonction des besoins des hommes et non plus en raison du profit et de la vente,
La lutte de la classe ouvrière contre le système est donc obligatoirement révolutionnaire. Par leur position même au sein du processus général de production, petit paysannat et prolétariat se trouvent donc en opposition face à l’oppression pourtant commune du capital.
Ce désaccord fondamental se double en outre d’antagonismes immédiats au sein du marché alimentaire; en effet ; la plus grande partie de la production agricole est consommée par les travailleurs des villes. Prolétariat et paysannat se trouvent respectivement en positions d'acheteur et de vendeur. Aussi, alors que les luttes ouvrières s'attaquent à la cherté de la vie, les paysans luttent contre la chute des prix auxquels on achète leurs produits. C'est le capital qui s'approprie l'écart croissant entre les prix de vente des paysans et les prix d'achat du même produit; l’ennemi est donc commun, mais les buts immédiats de la lutte divergent à nouveau : hausse contre baisse des prix.
A toutes ces raisons fondamentalement économiques viennent évidemment se greffer les différends qui en découlent au niveau idéologique, c'est à dire les habitudes, l'attachement aux traditions; bref, ouvriers et petits paysans ont deux façons totalement différentes de concevoir le monde.
Cependant, le prolétariat, d'une part, ne peut parvenir au triomphe de sa révolution sans surmonter l'hostilité de la campagne à son égard et, d'autre part, malgré leur attitude instinctivement conservatrice, les petits paysans ne pourront remédier à leur situation de façon définitive, que dans la révolution socialiste. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure la classe ouvrière peut intégrer le paysannat au processus révolutionnaire et en quoi le socialisme résout le problème paysan,
Ces deux questions sont d'ailleurs intimement liées ; pour définir de quelle façon le prolétariat pourra intégrer le paysannat au processus révolutionnaire il est nécessaire de comprendre en quoi le socialisme est une solution au problème paysan (sinon cette intégration serait impossible).
Mais en même temps, pour définir le processus révolutionnaire à la campagne il est nécessaire de comprendre jusqu'à quel point ou dans quel laps de temps le paysannat peut être amené à s'intégrer à la révolution.
Pour répondre à ces deux questions il serait absurde de chercher des formules abstraites, plaisantes à préconiser en prophètes. Ces problèmes ne peuvent être envisagés qu'à partir d'une analyse des conditions économiques qui déterminent les besoins et les problèmes delà campagne et de l’industrie, des paysans, et des prolétaires ; c'est seulement en partant d'une telle analyse qu’on peut comprendre comment ces deux groupes sociaux devront et pourront évoluer et donc définir une stratégie correspondant à la réalité.
Nous ne prétendons cependant pas établir ici le programme agraire de la révolution. Les mesures précises à prendre dans ce domaine ne pourront être véritablement définies qu'au cours même de la révolution, en présence des nouvelles conditions crées.
Pour le moment nous nous contentons de dessiner les traits généraux du problème sans prétendre en faire une étude exhaustive; nous essaierons simplement d'en tirer les conclusions les plus immédiates[14].
Si nous nous sommes penchés sur les différences opposant le petit paysannat au prolétariat industriel c'était pour relever l'obstacle principal qui s'opposera au lien nécessaire que devra établir la Révolution entre la ville et la campagne.
Il est maintenant nécessaire de distinguer dans le secteur agricole les différents types d'exploitation existants de façon à définir les tendances générales des paysans qui y travaillent et par la suite quelle peut être l'attitude du prolétariat révolutionnaire envers eux (ou chacun d'eux.)
1) La grande exploitation agro-industrielle
Il s'agit de grandes exploitations utilisant un outillage industriel assez important sur un grand nombre d'hectares et utilisant une main d'œuvre nombreuse.
Dans ce cas, les travailleurs de la terre sont des ouvriers agricoles. Leur situation dans la production est analogue à celle des ouvriers industriels de la ville : ils ne possèdent pas les moyens de production, ils sont salariés, ils créent de la plus-value et surtout ils travaillent en association, c'est à dire dans une division du travail imposée par l'utilisation commune de moyens de production complexes et dans laquelle chacun ne fait qu'une partie du travail total. Leur travail est organiquement de celui du reste des ouvriers agricoles. Par conséquent il ne peut venir à l'idée du salarié agricole de se partager les silos, les canalisations, les moissonneuses, le tracteur etc.... pour revenir à un stade primitif de production. Seule la mise en commun de la terre et des outils, et l'appropriation commune du produit de leur travail apparaît comme seul moyen de dépasser leur situation d'esclave salarié tout en maintenant le même niveau de technique -rejoignant ainsi dans ses objectifs le prolétariat industriel de la ville. Comme celui-ci il n'est pas attaché à la propriété privée car il en subit lui aussi quotidiennement les conséquences.
La révolution prolétarienne n'est donc pas étrangère au salarié agricole de l'exploitation agro-industrielle. Elle est le projet[15] même qu’il sera forcé de concevoir.
Les problèmes de la révolution face à l’exploitation agro-industrielle sont donc de mémé nature que pour l’industrie des villes.
La propagande révolutionnaire parmi les ouvriers agricoles de ces exploitations ne peut donc être autre que celle propagée parmi le prolétariat des villes.
De même l’organisation de ce type d'entreprise agraire sera celle des centres industriels lors de la révolution, c’est à dire la collectivisation des moyens de production et leur gestion par les Conseils d’ouvriers agricoles, liés et coordonnés avec les Conseils industriels. Les mesures prises dans les usines quant à l’élimination des marchés, des salaires, etc., pourront s’y appliquer simultanément.
Ces exploitations collectivisées seront obligatoirement les principaux piliers de la révolution dans la campagne. Leur prédominance dans des pays comme les Etats-Unis, surtout dans le sud, ou même dans certains pays d’Amérique Latine[16] éliminent pour ainsi dire "le problème paysan" pour la révolution dans ces régions.
Mais comme nous l’avons vu dans la première partie, dans la plupart des pays européens détruits par la guerre, ces types d’exploitations restent très peu nombreuses, du fait de la quantité importante des capitaux qu’elles nécessitent et de leur faible rémunération (sauf pour des productions maraîchères, fruitières, betteravières et dans une certaine mesure céréalières).
2) La grande propriété latifundiste de type semi-féodale
Il est important de la distinguer du type d’exploitation agro-industrielle. Sa caractéristique fondamentale est l’absence quasi-totale de moyens de production.
La production est l’œuvre des travailleurs qui paient un même latifundiste par la plus grande partie de leurs produits ; mais ils travaillent de façon indépendante ou presque c’est à dire en réalisant chacun dans son lopin de terre toutes les tâches de la production : préparation du sol, semis, façon culturale et récolte.
Malgré l'existence d’un patron commun, les différents paysans n’ont aucun lien réel organique au niveau de la production. Obligés de travailler pour un autre du fait de la non propriété de la terre, leur revendication la plus naturelle n’est pas la collectivisation mais le partage de terres et son appropriation individuelle.
Pour les paysans de ce type d’exploitation, prédominant sous le féodalisme ou actuellement surtout dans les régions non industrialisées, l’idée de la collectivisation des terres ne correspond à aucun besoin concret ni immédiat. Et ceci, non seulement parce qu’ils n’ont jamais travailler en association, mais parce qu’une telle mesure -en dehors de toute industrialisation- n’a aucun sens.
Le communisme n’a aucune réalité lorsque les moyens de production complexes qui imposent un travail en commun n’existent pas.
Sans les moyens de production nécessaires mettre le travail en commun dans le cadre agricole, n'a aucune raison d’entrainer un accroissement de rentabilité; au contraire, le seul stimulant qui peut exister, la recherche du profit individuel, disparait entièrement sans aucune compensation.
C’est pourquoi les révolutionnaires commettraient une erreur fatale s'ils prétendaient forcer en de pareilles conditions une collectivisation. Non seulement ils rencontreraient une résistance d’autant plus farouche qu’elle est naturelle de la part des paysans, mais en outre ils ne pourraient même pas en espérer les biens agricoles nécessaires au maintien de la révolution dans les villes.
Les mesures que prend le prolétariat révolutionnaire ne sont pas dictées par une série de clichés arbitraires ; elles acquièrent au contraire leur justification dans l’intelligence des situations, de la nécessité et de la possibilité de leur évolution.
Aussi, dans les régions trop faiblement industrialisées et à grandes propriétés semi-féodales le prolétariat sera souvent forcé d’accepter, le partage de la terre entre les paysans -comme cela fut fait par les Bolchéviks en Russie.
Il faut noter cependant qu’il ne pourrait s’agir d’une création de nouvelles petites propriétés privées. Bien que pour le paysan la non propriété de la terre apparaisse comme la base de son exploitation par le propriétaire a qui il doit céder la plus grande partie de sa production, ce n’est pas en permettant 1’appropriation JURIDIQUE de la terre que le prolétariat doit résoudre le problème, mais en permettant l’appropriation du produit du travail du paysan. La terre devient propriété collective, invendable, non héritable, non négociable.
Le produit devient intégralement propriété du paysan qui peut le vendre dans in marché prévu à cet effet[17].
Il est vrai que -comme le fit remarquer Rosa Luxembourg dans sa critique de la révolution russe -de telles mesures créent de nouvelles difficultés au chemin de la révolution. Mais dans ce cas le choix n'existe pas. Dans un tel cadre, une "collectivisation" ne peut rester que lettre morte ou bien se faire par la force.
La collectivisation par la force ne peut mener qu’au massacre des paysans et à des catastrophes comme celles qui eurent lieu lors de la "collectivisation" stalinienne (incendie des récoltes, massacre du cheptel par les paysans, dont l'URSS subit encore les conséquences)[18]. Ce sont là des méthodes qui correspondent uniquement au besoin capitaliste de l'accumulation primitive du capital.
Quant aux "nouvelles difficultés" créées par ces partages, elles ne peuvent être véritablement dépassées que par l'internationalisation de la révolution et la collaboration des zones véritablement industrialisées.
C'est seulement en présence des hauts moyens techniques d'agriculture que le petit paysannat peut ressentir le besoin de passer au stade de la collectivisation de la production.
3) La petite propriété familiale
Celle-ci est de très loin la forme d'exploitation la plus commune en France et en Europe Occidentale en général.
Elle est aussi celle qui a toujours représenté le plus grand nombre de difficultés lorsqu'on a envisagé le problème du ralliement de ces exploitants à la révolution.
Ces difficultés proviennent fondamentalement des caractéristiques du petit paysannat (propriétaire des terres, antagoniste au prolétariat au niveau du marché alimentaire, producteur isolé ne pratiquant pas le travail associé), caractéristiques qui le poussent au conservatisme et le condamnent souvent à l'incompréhension du besoin de collectivisations.
Il s'y est ajouté, dans les pays d’Europe occidentale les plus industrialisés, la caractéristique d’un niveau de revenu moyen relativement élevé (nous disons relativement, car nous le comparons à celui des paysans russes de 1917 qui se rallièrent à la révolution). Comme nous l'avons dit dans la première partie, le capitalisme européen a été contraint de maintenir les structures de petite et moyenne propriétés (fondamentalement à cause des deux grandes guerres et de leurs conséquences) tout en garantissant un niveau moyen permettant même aux plus petites exploitations de subsister tant bien que mal.
En 1962, on comptait que le revenu annuel moyen par ménage agricole en France était de 22.17 Francs (après impôts) soit presque celui d’un cadre moyen (23.47 F. la même année) -selon J.P. Ruault, Études et Conjonctures 1966, n°7. Ces chiffres sont certainement déformés : d’abord, la notion de revenu agricole est particulièrement contestée (l’auto-consommation et les investissements sont-ils compris ?) ; il ne s’agit de toutes façons que d’une moyenne. Mais, si l’on tient compte du fait que sur 1.8 millions d'exploitations agricoles en 1963, 108.000 seulement faisaient plus de 50 ha, il est clair que -sauf cas extrêmes- la situation des agriculteurs n’est pas comparable à celle des masses paysannes russes de 1917.
L’importance du niveau des revenus des petits paysans européens a joué un rôle lors de la vague révolutionnaire qu’entraina la première guerre mondiale (surtout en Allemagne). En effet, alors que dans les villes et sur le front, la guerre cause une diminution des revenus (rationnement alimentaire), la campagne a non seulement les aliments sur place, mais la grande demande de produits agricoles par la ville et la réduction du nombre de travailleurs aux champs, permet aux agriculteurs qui restent d’obtenir des revenus relativement élevés. Ainsi, les crises révolutionnaires produites par des guerres créent un nouvel obstacle au rapprochement paysans-ouvriers.
Il faut noter qu’au niveau des revenus agricoles, il s’est produit une nette dégradation, surtout depuis 1968, en France, L’accroissement des prix agricoles à la production est resté très inférieur à celui du niveau général des prix industriels et malgré les politiques de garantie des prix, les plus petites exploitations connaissent des difficultés croissantes. En effet, le jeu des primes, des prix, des subventions, favorisent systématiquement les exploitations qui ont les plus hauts rendements (prix et primes étant donnés au quintal de céréale, ou à la tête de bétail). Les gouvernements européens, obligés de rentabiliser leur agriculture se préparent à éliminer la majorité des petites exploitations, ne laissant que les plus rentables.
Du point de vue de la lutte de classes, les conséquences de telles mesures ne seront pas mécaniquement favorables à l'union paysans-ouvriers. D'abord une très grande partie des exploitations à éliminer, disparaîtront "de mort naturelle" : la moyenne d’âge des agriculteurs est extrêmement élevée et les jeunes quittent la campagne pour la ville (encouragés par le gouvernement). En France la moyenne d'âge des agriculteurs est de 52 ans.
Ensuite, les seules exploitations qui resteront seront les plus rentables et bénéficieront donc des revenus les plus élevés, Enfin, les paysans qui verront leur situation menacée, ne se lanceront dans la lutte que pour la défense de la petite propriété, sur une position inévitablement rétrograde.
Tout ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de paysans pauvres qui comprendront les buts et la lutte du prolétariat. De telles tendances peuvent se manifester facilement, surtout parmi les jeunes qui acceptent de reprendre 1'exploitation familiale en main. Mais il s'agit ici de déterminer quelle peut être l'attitude générale de l'ensemble du petit paysannat, en tant que groupe social.
Or, tout semble indiquer que dans le cadre d'une crise économique qui ébranlerait profondément la société, et dans laquelle le prolétariat se dégagerait comme force et pouvoir révolutionnaire autonomes, celui-ci ne pourra pas compter sur le petit paysannat en tant qu’appui fondamental. Il pourra tout au plus en attendre une non-hostilité gagnée en partie par le pouvoir de la ville dont dépend la campagne. En effet, une crise économique capitaliste se prolonge obligatoirement dans l'agriculture (sauf en cas de guerre), la production agricole dépendant de l'industrie pour ses débouchés et pour ses outils, Cette dépendance s'est particulièrement renforcée au cours des dernières années (il y a dix ans de la production agricole européenne était commercialisée, aujourd'hui, ce chiffre atteint 70%) En outre, l’agriculture dont la mécanisation s’accroît constamment, a de plus en plus besoin de produits de l’industrie,
Dans une crise économique le petit paysannat sera donc lui aussi soumis aux problèmes de misère et de sous-emploi ; d’autre part, il sera forcé au moment de chercher une solution, de tenir compte de la situation de la ville et de l’industrie beaucoup plus qu’à une autre époque. Le développement de la mécanisation et l’accroissement des difficultés pour produire de façon isolée, constituent alors un facteur en faveur d’une meilleure compréhension des buts du prolétariat par le paysannat,
Il existe un deuxième élément général qui a toujours freiné l’alliance des petits paysans et du prolétariat : c’est l’impossibilité pour celui-ci d’offrir aux agriculteurs un programme qui puisse les satisfaire à court terme dans leurs revendications essentielles,
- "Disons-le franchement ? étant donné ses préjugés, fondés sur toute sa situation économique, son éducation, sa façon de vivre isolément, et nourrie par la presse bourgeoise et les grands propriétaires fonciers, nous ne pouvons conquérir la masse des petits paysans du jour au lendemain, que si nous lui faisons des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir. Nous sommes obligés de lui promettre non seulement de protéger sa propriété dans tous les cas contre toutes les puissances économiques qui l’assaillent, mais même de la délivrer de toutes les charges qui, actuellement l’oppriment ; de faire du fermier un propriétaire libre, et de payer les dettes du propriétaire dont la terre est grevée d’hypothèques. Si nous pouvions faire cela, nous reviendrions nécessairement au point de départ d’un développement qui a nécessairement abouti à l’état actuel. Mous n’aurions pas libéré le paysan, nous lui aurions accordé un quart d’heure de grâce !
Mais notre intérêt n’est pas de gagner le paysan du jour au lendemain, peur que, du jour au lendemain, il nous quitte, lorsque nous ne pourrons pas tenir nos promesses. Du paysan, qui nous demande de maintenir la propriété parcellaire nous ne pourrons jamais faire un camarade, pas plus que du petit patron qui veut rester éternellement patron."
F, Engels "La question paysanne en France et en Allemagne"
Cette position d’Engels contraste particulièrement avec les archaïsmes hypocrites du MODEF (syndicat agricole du PCF ; mouvement de défense de l’Exploitation Familiale) qui, dans sa "lutte" pour la défense de la petite propriété et du protectionnisme agricole, en arrive jusqu’à préconiser 1’exonèretion totale des droits de mutation et d’enregistrement en cas d'héritage, de donation en partage et de soultes entre cohéritiers, jusqu’à concurrence de la superficie d'une exploitation moyenne et sous condition d'exploitation personnelle ! ("Modèle d’une agriculture de type strictement familial d'après les documents publiés par le MODEF -congrès de St Ouen 1958.
Le "partage des terres", revendication qui entraina le paysannat russe derrière le prolétariat en 1917, n'a aucun sens réel dans la plupart des régions d’Europe Occidentale, car cette tâche a été réalisée déjà lors des révolutions bourgeoises nationales. Les surfaces qui resteraient à partager sont trop peu nombreuses par rapport au nombre de petites exploitations existantes qui pourraient éventuellement revendiquer leur agrandissement,
Mais surtout, dans les pays industrialisés, la possibilité de mécaniser rapidement l’agriculture permet d’envisager la collectivisation des exploitations les plus arriérées.
Les classes moyennes, les petits paysans en particulier, condamnés par le capitalisme, mais ayant vécu grâce à lui et pour lui, ne peuvent pas attendre du prolétariat des pays développés la réalisation de leurs revendications immédiates. Le prolétariat ne peut pas, sans mentir, les leur promettre.
Les organisations politiques qui le font (PCF, maoïstes) sont d’autant plus hypocrites qu’elles se revendiquent du stalinisme dont on connaît les méthodes vis-à-vis des paysans. Aussi, en défendant les revendications de ces couches, ces organisations sont amenées à défendre des positions bourgeoises.
Répétant que la classe ouvrière ne peut rien SEULE, sans les autres classes et qu’il faut qu’elle les gagne, ils défendent un programme bourgeois libéral "pour ne pas effrayer" les autres couches "moins révolutionnaires."
Dans les pays occidentaux où le capitalisme est pleinement achevé, aucune tâche bourgeoise ne peut être à réaliser, et seule la révolution prolétarienne est à l’ordre du jour. Le capitalisme est suffisamment mur pour le socialisme, et, greffer au programme révolutionnaire des tâches bourgeoises n’est pas une tactique "habile" mais simplement la négation de celui-ci, par l’abandon des véritables buts de la classe révolutionnaire.
La difficulté dans les pays européens à réaliser l’alliance paysans-ouvriers se résume donc en deux points : la méfiance naturelle du petit propriétaire envers le prolétariat ; l’impossibilité pour ce dernier de se faire le champion de leur cause.
Mais, malgré les oppositions et les difficultés, le prolétariat devra amener le petit paysannat à son projet révolutionnaire. Comment ? Quelle peut être l'attitude des révolutionnaires avant la révolution ? Quelles mesures peut prendre le prolétariat vis-à-vis des petits paysans pendant la révolution ?
I. Avant la révolution
Le prolétariat, nous l’avons dit, n'a pas à faire des promesses qu’il ne puisse tenir. Les revendications immédiates du petit paysan, il faut le répéter, ne pourront être garanties. C’est, au contraire, la tâche des révolutionnaires que d'expliquer l'inévitabilité de la collectivisation des terres et de tous les moyens de production ; de faire comprendre que seul dans un tel état de choses, le travail de la campagne cessera d'être celui de l'esclavage, de la nature et du ghetto paysan ; montrer que prolétaires et paysans subissent une même oppression -le capital- et que leur émancipation à long terme ne peut être que commune.
Enfin, notre tâche est aussi d'expliquer quelles seront les mesures du prolétariat révolutionnaire envers la petite propriété.
Les tâches de révolutionnaires parmi les petits paysans avant la révolution sont donc fondamentalement celles de la propagande et de l’explication du contenu de la révolution. S’il fallait se fixer un but, on pourrait le résumer en disant : il faut que le jour de l’insurrection dans la ville, la campagne ne soit pas étrangère au mouvement, qu'elle ne le perçoive pas comme ce qu’il n’est pas, qu’elle sache ce qu’il veut en réalité et par quels moyens il compte le réaliser.
Car c'est en expliquant clairement les buts révolutionnaires que l’on peut montrer aux petits paysans que la lutte du prolétariat est aussi la leur.
II. Pendant la révolution, après la prise du pouvoir par la classe ouvrière
La collectivisation des moyens de production (dont la terre) est un des premiers buts de la révolution, liais il ne saurait être question d'exproprier et collectiviser les petits paysans par la force, comme ce sera fait pour les grands propriétaires.
- "Notre devoir envers le petit paysan est, en premier lieu, de faire passer sa propriété et son exploitation individuelles à l’exploitation coopérative, non en l’y contraignant, mais en l’y amenant par des exemples et en mettant à sa disposition le concours de la société. Et ici les moyens ne nous manquent pas pour faire entrevoir au petit paysan des avantages qui lui sauteront aux yeux dès aujourd’hui."
(Engels, id, p2)
Cela ne veut pas dire conserver la propriété privée de la terre. Comme nous l’avons dit, la terre devient immédiatement propriété collective : personne ne pourra acheter (ni donc vendre) ni hériter ou léguer des terres.
La politique de "coexistence" avec la petite exploitation se transformerait autrement en un moyen d'enrichissement de quelques-uns aux dépens des autres à la campagne, tout en développant de nouvelles formes d’exploitation. Ce que cette politique entraîne, c’est la possibilité pour le petit paysan de s’approprier du produit de son travail,
La raison en est l’impossibilité de forcer du jour au lendemain des millions de producteurs individuels à produire de façon associative, c'est à dire, en collaboration totale avec les autres producteurs. Les paysans qui demeurent attachés aux modes individualistes de production ne pourront être amenés au socialisme que lorsqu'ils comprendront concrètement son besoin. Et ce besoin ils ne le ressentiront que lorsqu’on leur aura montré dans les faits les avantages qu'ils en obtiendront.
Pour le prolétariat ces avantages sont évidents ; les contradictions du capitalisme qui impose -un mode de production en association, où tout est fait par la collaboration de tous les-prolétaires mais dont le processus est orienté et le résultat approprié par une minorité qui souvent ne participe même pas à la production, cette contradiction, la classe ouvrière la vit quotidiennement.
La solution de cette contradiction par l'appropriation collective des moyens de production et des produits du travail collectif, est obligatoirement son propre projet.
Mais pour celui qui produit isolément -comme le petit paysan- l’appropriation individuelle du produit de son travail lui semble tout aussi évidente.
"L’association" dans le travail il ne la connaît que par le capitalisme. Il ne peut donc l’assimiler qu’à l’idée de travailler pour "un autre". C’est pourquoi la première tâche de la révolution face au petit paysannat est de montrer les avantages du travail collectif lorsque son orientation et l’appropriation de son résultat sont aussi collectifs.
Il en découle logiquement que cette action devra se faire, par trois moyens : 1- l’exemple concret, 2- la mise à disposition du paysan de moyens de production demandant le travail associé, et, 3- son intégration au mode de distribution socialiste des biens.
1°- L’exemple : nous avons déjà parlé des grandes propriétés agro-industrielles qui seront collectivisées et gérées par le mode socialiste. Elles constitueront un exemple tangible de ce que la révolution offrira au petit paysan. Direction collective de la production par le conseil de travailleurs, réduction immédiate et importante du temps de travail, collaboration totale avec le reste de la société, obtention des biens régulière, croissante et de plus en plus selon les besoins individuels.
2°- Fournir les moyens de production. C’est l’utilisation des techniques modernes de production qui font du socialisme une nécessité. C’est en les procurant très facilement aux petits paysans qu’ils seront amenés à comprendre véritablement le besoin de l’association surtout si celle-ci n’a plus comme' contre-parti l’esclavage, capitaliste, mais la coopération socialiste.
3°- L’intégration la plus rapide au mode de distribution socialiste. Le but final dans la distribution des biens socialiste est l’application du principe : à chacun selon ses besoins. Le moyen : l’élimination de la marchandise, de l’argent comme moyen d’accumulation, de la vente et du profit. La production est en conséquence orientée exclusivement en fonction des besoins des individus.
Pour y parvenir une des conditions premières est la centralisation de tout ce qui est produit de façon à permettre une distribution rationnelle selon les possibilités de la société.
Pour le producteur isolé, s'appropriant directement du produit de son travail, le seul moyen d’obtenir les biens qu'il n'a pas produits, est l’échange.
Il devra donc s’établir un échange entre le secteur collectivisé et celui demeuré non-collectivisé, qui apposera des centres de distribution centralisés à des producteurs isolés. Ces échanges ne pourront se faire que suivant la mesure de la valeur travail des produits. Mais le simple fait, que les agriculteurs devront échanger tous avec un même centre, que celui-ci insistera et montrera en chiffres et en valeur les avantages qu’ils obtiendront par un travail collectif et organisé avec l’ensemble des conseils, constituera un moyen particulièrement efficace pour concrétiser les avantages et le besoin du socialisme.
C'est ainsi que le prolétariat pourra montrer que la contrepartie du travail collectif dans le socialisme n’est pas la spoliation des travailleurs,
Il faut ici noter que ces mesures ne sont rendues possibles que par un haut niveau de développement des forces productives de l’industrie. Les difficultés insurmontables qui entravaient les rapports entre ouvriers et paysans en Russie après le partage des terres, trouvaient leur raison d'être principalement dans l'impossibilité où se trouvait le prolétariat d’établir un échange égalitaire avec les paysans, vue la ruine et la pauvreté de la ville et de l’industrie.
- "nous sommes encore si ruinés, si accablés par le fardeau de la guerre (qui a eu lieu hier et qui, à cause de la cupidité et de la férocité des capitalistes peut éclater demain) que nous ne pouvons fournir au paysan des produit industriels en échange de TOUT le blé dont nous avons besoin. Sachant cela nous instituons l’impôt en nature, c’est à dire que nous prélevons à titre d’impôt le minimum de blé nécessaire (à l’armée et aux ouvriers). Le reste nous l’échangerons contre des produits industriels." -Lénine. "L’impôt en nature" Œuvres choisies, tome III, p714.
La réaction du paysannat -cacher ou brûler ses produits pour empêcher qu’ils ne leur soient confisqués- était normale, mais elle marquait la fin de tout espoir de socialisme en Russie.
La richesse de moyens de l’industrie que les pays les plus avancés possèdent aujourd'hui, constituera sur ce terrain-là, le principal atout de la révolution.
Mais cet avantage dont disposent les pays industrialisés interviendra surtout après la prise du pouvoir des Conseils ouvriers. Avant et pendant l’insurrection, le prolétariat de ces pays sera seul, face à toutes les classes sociales.
Les classes moyennes n’ont aucune raison immédiate de se porter on appui de l’insurrection prolétarienne. S’il est vrai que le petit paysan peut demeurer "neutre" au début de la lutte -car à long terme la lutte de la classe ouvrière est aussi, la sienne- les petits commerçants ne peuvent éprouver que l’hostilité la plus grande vis-à-vis du prolétariat, La révolution entraîne en effet leur disparition immédiate en tant que couche sociale. Le prolétariat au pouvoir peut en un premier temps coexister avec les formes de production précapitalistes du petit paysan ; par centre il ne peut pas entreprendre son émancipation économique sans briser le royaume de la marchandise.
Or le petit commerçant vit pour et par la marchandise au service du capital. Son profit provient en sa majeure partie du travail du paysan et du prolétaire.
Ne participant pas au processus la production, parasites obligatoires de la société, ils ne peuvent pas avoir leur place dans une société communiste. Et ils le savent. C'est pourquoi ils ont toujours constitué et constitueront, comme couche sociale, le principal pilier de la contre-révolution.
C'est donc sur ses propres forces et uniquement sur elles que doit compter le prolétariat des pays industrialisés.
- "Les ouvriers en Europe Occidentale sont tout seuls. Car d'autre part, c’est seulement une couche toute mince de la petite bourgeoisie pauvre qui les aidera. Et celle-ci est économiquement insignifiante. Les ouvriers devront porter tout seuls le poids de la révolution. Voilà la grande différence avec la Russie[19].
[1] Comme le prévoyait le traité de la CEE, tine Commission dénommée "Commission sur la réforme de l'agriculture dans la CEE" fut créée et chargée d'étudier la réforme de l'agriculture à envisager. Ainsi, le 10 Décembre 1968, Mansholt, président de ladite coordination présenta oralement le mémorandum qui devint "le plan Mansholt".
[2] En 1946, un tiers de la population active en France et en Allemagne se trouve dans le secteur agricole, soit le même pourcentage que cent ans auparavant. On observe en Italie une proportion de un demi.
[3] Les structures agricoles comprennent:
• les structures de production
• les structures de commercialisation
• l'organisation de la profession (les organisations professionnelles)
Les structures de production sont une donnée fondamentale dans la mesure où elles mettent en relief le modernisme, c'est-à-dire, le degré d'évolution de ce secteur. À ce niveau, on peut retenir :
• la surface d'exploitation. On notait à cette époque 70% des exploitations inférieures à 5, 6 hectares, Actuellement ce même pourcentage est obtenu avec des exploitations inférieures à 10 hectares (qui représentent 23% de la surface cultivable pour 1966) ; par contre 15% des exploitations (classe supérieure à 20 Ha) couvraient 54% de la surface cultivable.
- La composition de la main-d’œuvre et sa répartition. La main-d’œuvre agricole se répartit entre : les exploitants, aides familiaux et ouvriers. On assiste à une diminution importante des ouvriers agricoles ( par an) ainsi que des aides familiaux (7% par an); le nombre d'exploitants, au contraire, progresse.
[4] A ce sujet il est bon de noter la réaction parfaitement individualiste de l’agriculteur: lorsqu’une année un produit -se vendait très mal, l'année suivante, chacun croyant sans doute que l'autre produirait la même quantité, diminuait l'importance de cette production; le résultat était une baisse globale du volume uns sur le marché et, par la suite, des prix assez élevés.
L’année d’après, phénomène exactement contraire : tout le monde augmentait la production et, bien entendu, chute des prix, etc...
Le caractère, cyclique des productions agricoles a été mis en évidence par tous les économistes. Pour les productions annuelles, le cycle est de deux ans d'une manière générale: la durée du cycle correspond au temps qu'il est nécessaire pour retrouver la même structure de surproduction. On observe aussi que le trend (tendance générale sur plusieurs années) correspondant au volume de production »indique une hausse régulière, et ce, quels que soient les aléas naturels. Ceci en effet ne joue qu’au niveau, d'une année, sauf cas rarissime, comme par exemple, l’attaque par le phylloxéra du vignoble français au début du siècle.
[5] Ce phénomène joua à fond à partir de 1955. Les gouvernements, sous la pression des manifestations, durent imposer par la suite des barrières douanières pour les productions excédentaires. Ils essayèrent pourtant de détourner le problème en acceptant très souvent, dans le cadre d’accords bilatéraux, l’introduction do clauses comportant l’importation de produits agricoles. En France, on peut citer l’exemple des vins d’Algérie (ou d’importante groupes financiers avaient des intérêts), et surtout des fruits et légumes. En Italie c’est le cas du maïs où malgré les accords de la communauté on continuait à s’approvisionner à l’extérieur de la CEE, à des tarifs inférieurs à ceux1 officiellement admis, et sans pour autant payer des pénalités en dehors de la retenue normale à l’importation.
[6] La faible surface permettait de "vivre" si les produits se vendaient bien. Mais une baisse, même minime du revenu les plaçait dans une situation financière très difficile à supporter.
[7] Ce fait avait déjà été mis en évidence depuis le début des années 50, au niveau d'un bon nombre de pays
[8] Le prix des produits alimentaires résulte de l'addition du prix des produits agricoles et de celui du secteur en aval de la production, détaillants compris.
[9] Et plus généralement l'organisation en aval de la production.
[10] On estime que les deux tiers de la production agricole seront transformés par l'industrie d'aval, d'ici 1985.
[11] Les producteurs de fruits ne perçoivent que 20% du prix payé par le consommateur (L'Expansion, février 69)
[12] 30 milliards de francs représentent 6 milliards d'unités de compte. L'unité de compte (U.C.) est 1'équivalent de cinq francs.
[13] La "tendance dure" du Centre National des Jeunes Agriculteurs en France.
[14] nous serons appelés à revenir sur ce sujet de façon plus précise dans d'autres numéros de la revue complémentaire
[15] C’est le cas par exemple des immenses plantations de canne à sucre (Cuba, Brésil) On a vu ainsi, au Brésil, les ouvriers de la canne à sucre faire grève et occuper les usines de traitement de la canne avec les mêmes méthodes de lutte que les ouvriers des villes.
[16] Nous reviendrons sur ce problème du marché un peu plus loin
[17] Nous reviendrons sur ce problème du marché un peu plus loin
[18] Rien n'est plus abject que de voir les nouveaux adorateurs de Staline -celui qui se vantait d'avoir envoyé dix millions de paysans en camp de concentration- les maoïstes, se faire les champions de la cause des petits paysans.
[19] Gorter, "Réponse à Lénine"
Conscience et organisation:
Personnages:
Questions théoriques:
- Communisme [7]
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution Internationale - 1971
- 40 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale n°5 - ancienne série - Juillet 1971
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 376.79 Ko |
- 37 lectures
À propos de la Commune de Paris
- 23 lectures
Tirer les leçons d'un mouvement révolutionnaire quel qu’il soit présente des tas de difficultés. On aurait facilement tendance à sombrer dans la louange, à chanter la vertu des morts et leur œuvre, à faire des promenades "centenaire de la Commune", comme le font par exemple tous ceux qui vénèrent celui qui écrasa les prolétaires insurgés à Cronstadt. L’esprit religieux qui anime ces gens-là les poussent à idolâtrer non pas n’importe quoi, mais tout ce qui peut leur amener un peu de publicité; la loi du profit, en somme.
Ils veulent créer le parti révolutionnaire, centralisé et tout, et donc à la suite de leur maitre, quelle leçon tirent-ils de la Commune ?
Il n'y avait pas de parti centralisé, c’est bien pour ça qu’il lui est arrivé du malheur. Il suffit de lire la préface de Léon Trotsky
"les leçons de La Commune"[1](1) écrite en l921 pour s’en rendre compte : l'analyse historique compte peu, c’est par tous les moyens trouver dans le passé la justification des thèses que l’on défend dans le présent qui est important. Aussi Trotsky ne voit-il rien de bon dans les événements de la Commune. Dans tout ce que Marx y trouve de positif, au point d’en modifier le manifeste Communiste, Trotsky, soucieux de prouver que l’important c’est le Parti, ne voit que les échecs, les "erreurs", les faiblesses, et la SEULE leçon qu’il tire de l'histoire de la Commune, "c’est qu’il faut une forte direction du Parti".
Cette "méthode" d’analyse, qui consiste à expliquer l’histoire par la tangente, est propre à tous les idéologues de toutes les religions. Ayant découvert ou expérimenté "la vérité", "la solution", on fait fi de l'évolution historique, de la dialectique, pour justifier ses positions et son travail militant par la refonte de l’histoire : « si la Commune avait eu un Parti, etc…" On explique toutes les faiblesses dues à l’immaturité de la classe ouvrière et aux conditions économiques du siècle passé par le remède, la panacée, ce qui fait que nous sommes beaux et que nous avons raison de faire n’importe quoi, n'importe quand, et n’importe où, le Parti centralisé et organisateur et tout ça, dont nous sommes les constructeurs. Pour un peu ils diraient "si on avait été là" ces incroyables. Ils ne se rendent pas compte.
Cette histoire du Parti fait couler beaucoup d'encre. Après la version trotskyste-léniniste "tout dans le Parti, rien dans la classe" (ou plutôt les masses comme ils disent, puisque tout ce qui caractérise la classe tout ce qu'il y a de "bon" en elle se trouve concentré dans le ·Parti), la version des "conseillisto-anarcho-spontnaéistes" simplifie tout. Tout dans la classe, et le parti c’est la classe. Et réciproquement. Ainsi, la Commune se trouve sublimisée, l’exemple même d’une révolution prolétarienne, bien différente en cela de la Révolution -puis- bolchévique, qui elle est bourgeoise du fait de l’existence d’un parti distinct.
Ces deux points de vue sur la Commune de Paris et sur la révolution russe de 1917, pour opposés qu'ils soient, n’en sont pas moins sujets à la même erreur : ne regarder qu’une face du mouvement ouvrier. Trotsky voit la réussite de la révolution prolétarienne, déterminée par la forte direction du Parti ; celui-ci étant, en fin de comptes, indispensable, le mouvement, l’énergie, la Puissance, la force théorique et pratique de la classe ouvrière Comptent peu. Les "ultra-spontanéistes" voient la révolution dans ce qui échappe aux Trotskystes le prolétariat agissant, et à la lumière du 1917 Russe jettent tout le mal sur cette organisation du parti bolchévique et par extension à toute organisation de révolutionnaires.
Pour justifier l’emploi du terme "Parti" par Marx et les complications d’une réfutation, l'assimilation parti-classe s’impose.
Ainsi nous voyons d’un côté les trotskystes assimiler la classe au parti, et de l’autre, les "hyper-gauchistes" assimiler le parti à la classe. Il est clair que ces deux tendances sont très proches et même se rejoignent, en cela qu’elles expriment toutes deux un refus total de voir le mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Il est incontestable que la classe ouvrière est appelée à faire la révolution sociale, qu’elle est appelée à prendre le pouvoir elle-même ses organisations propres groupant l’ensemble des prolétaires. Les organisations de révolutionnaires, les partis sont les organisations des éléments les plus avancés du prolétariat s’organisant sur des bases politiques claires, en vue de propager les idées révolutionnaires, et de les expliquer.
La compréhension de ses actes est la plus puissante des armes du prolétariat, elle est la seule garantie que ce qu’il sera amené à détruire ne sera pas reconstruit. C’est en cela que les partis, ces organisations qui se proposent d’analyser politiquement la lutte du prolétariat, dans le but de soumettre leurs résultats à l’ensemble de la classe et de combattre le capitalisme sont indispensables pour la victoire finale.
Les éléments révolutionnaires doivent pousser les éléments moins conscients dans la voie de la clarification de leurs actes. La prise de conscience n’est pas simultanée chez tous les éléments de la classe, et c’est par l’intervention directe de tous ceux qui ont déjà saisi le comment et le pourquoi de la lutte engagée, que la compréhension pour le reste de la classe des objectifs finaux et des moyens d’y parvenir s’en trouvera facilitée. Les tâches théoriques et politiques des communistes sont simples :
- S’attaquer partout et en toute occasion à la propriété privée ou étatique des moyens de production, dénoncer partout et en toute occasion les aspects que peut prendre cette propriété, se prépare+ à combattre partout et en toute occasion tous les aspects que peut prendre cette propriété, se préparer à combattre partout et en toute occasion ceux qui par leur conception de la révolution ne feront que perpétuer le capitalisme et agir dans toutes les luttes parcellaires de façon que le prolétariat développe son autonomie de classe, qui agisse dans la perspective de sa tache globale historique.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la classe appelée à bouleverser l’ordre Social, est la classe exploitée. La première tentative de prise de pouvoir par la classe ouvrière, la Commune de Paris, nous montre les prolétaires au comble de la misère, ne trouvant même plus à qui vendre (leur unique bien), leur force de travail, capables d’ébaucher les grandes lignes de la société future, d'organiser pour leur compte l’ensemble de l’appareil d’état sur les ruines de celui de la bourgeoisie[2] (1). On y trouve ce qui fait l’originalité du mouvement révolutionnaire prolétarien: la classe ouvrière ne s1 appuie sur aucune base économique dé je, établie dans la société, sinon sa simple position dans le mode de production capitaliste, et son nombre.
Les révolutions passées avaient été l’œuvre de classes qui avaient déjà toutes un pouvoir réel sur la société, la prise de pouvoir politique n’étant pour elles qu’un moyen de mieux le confirmer, d’ôter les structures gênantes, et d’affirmer sur les classes dominées une domination à la mesure de ses nécessités. Ce handicap qu’a du seul point de vue économique le prolétariat sur toutes les autres classes révolutionnaires de l’histoire, le force à avoir sur celles-là l’avantage d’une conception globale du monde. Sa conscience de classe, la compréhension et l’organisation de sa lutte sont les seules armes qu’il possède pour compenser cela.
Il nous faut insister sur le fait que la conscience de classe ne tombe pas du ciel, mais qu’elle est un produit spécifique de la vie matérielle de chaque classe. L’importance qu’elle revêt pour le prolétariat est le fait de la situation économique et sociale originale qui le caractérise historiquement.
Nous voyons donc parfaitement se dessiner le pourquoi des deux positions politiques antagonistes. L’une, celle des trotskistes, se contente de voir un facteur "conscience" dans le prolétariat, et n’imaginant même pas qu’il peut être un produit propre à celui-ci, déclare très léninistement donc que la conscience est apportée de dehors aux "masses" dirigées. Le Parti ayant la conscience, et lui seul l’ayant., il se doit pour le bien de tous d’exercer la dictature. Les trotskistes, à priori, il faut les croire : la Révolution c’est leur profession.
Mais ne voir que le rôle historique abstrait du prolétariat, c’est se condamner à avoir une vision religieuse de la révolution prolétarienne, c’est la caractéristique même de la vision idéaliste, c’est ne rien comprendre au matérialisme historique, c’est, en fin de compte, une vision de bureaucrate professionnel. Ou du moins d’aspirant.
Les "super-conseillistes", eux, ne peuvent pas comprendre que les organisations de révolutionnaires fassent partie du mouvement général de la classe, qu'elles soient les expressions politiques et théoriques des différentes tendances du prolétariat au sortir du vieux monde, en lutte contre celui-ci. Ils n’ont jamais vu ça, ils n’y croient pas. Que la classe ouvrière ne soit pas homogène, ils s'indignent, faut pas les prendre pour des cons. Le parti trahit forcément. Commençons par pas le créer, disent-ils, ces sceptiques. On peut répondre que la révolution échoue forcément, pour pas la rater la faisons pas. C’est plus sûr.
Le facteur "conscience de ses actes" du prolétariat est refusé, ou bien considéré comme étant systématique, allant de soi, et son développement, uniforme chez tous les ouvriers. Ne pas le voir comme étant un long et difficile apprentissage à s’assumer, et que par conséquent l’effort de tous pour tous est non pas un devoir, mais une nécessité sine-qua-non pour la cause révolutionnaire, est le fait d’un refus de ses responsabilités allant jusqu’à l’inconscience totale des taches monumentales qu’implique la révolution prolétarienne.
La séparation que font "communistes de conseils" et "communistes de parti" entre la conscience pratique et la conscience théorique les poussent à devenir les tenants de l’une ou de l’autre et cela aux dépens de la révolution communiste. Le processus de constitution de la classe ouvrière exploitée, manipulée, utilisée , la classe en soi, en classe ouvrière pour soi, c’est à dire consciente de ses intérêts propres, en classe révolutionnaire de fait, est le même que celui de sa prise de conscience. Le mouvement qui pousse les ouvriers à comprendre leur situation et leurs actes est indissolublement lié au mouvement qui les pousse à prendre les armes. C’est un même mouvement qui fait s’organiser en parti politique les prolétaires les plus avancés dans un moment donné, et en conseils l1ensemble de la classe dont ils font partie. Il est clair que si le poids du passé et celui de l’idéologie bourgeoise était rayé du jour au lendemain, l’homogénéité de la classe ouvrière ferait que nul parti ne serait nécessaire, liais cela est un rêve, la Commune de Paris , et les révolutions russes et allemandes l’ont prouvé; ce n’est que petit à petit par la lutte, par l’exercice de sa dictature que le prolétariat parviendra à cette homogénéité.
En attendant, les communistes ne peuvent que se référer à l’histoire du mouvement révolutionnaire car la théorie révolutionnaire ne peut être basée essentiellement que sur la compréhension des événements réels, pratiques, considérant chaque cas dans ses conditions précises, tant au niveau matériel qu’idéologique. L’analyse qui critique les événements clients d’une époque à une époque plus évoluée, en lui rapprochant de ne pas avoir la vision de cette dernière époque, est strictement inutile au prolétariat; les "enseignements" que l’on tira par cette méthode ne sont en fait que les expressions des problèmes et des solutions que l’on apporte à la période vécue. Ce n’est pas utiliser les enseignements de la lutte passée, pour la lutte future, c’est se servir d’eux pour valider les actes que l’on a décidé de faire sans véritable perspective de classe. Une façon d’enterrer en somme.
"Moi, mon colon celle que j’préfère c’est la guerre de 14-18" dit la chanson. Cela pourrait tout aussi bien être celle des "tenants" de telle ou telle révolution prolétarienne. Cette manie qu’ont les gens de ne pas voir dans l’histoire des révolutions prolétariennes l’histoire de la classe ouvrière à des moments de son existence, cette manie qui consiste à préférer l’une à l’autre sans considérer qu’elles font partie d’un tout, qu’elles s’enrichissent mutuellement, qu’elles enrichissent toutes la révolution qui se prépare aujourd’hui dans le prolétariat de tous les pays; cette manie est caractéristique de tous les idéologues, tant gauchistes que trotskystes.
Pierre Ramos et Jacques Novar
[1] Éditée par les "Cahiers de Spartacus'', 11° 38B, "La Commune de 1871" de Tales, avec en annexe la préface écrite en 1921 par Trotsky et une critique à celle-ci de P. Guillaume Librairie "IA Vieille Taupe", 1 rue des Fosses Saint Jacques, Paris 5°
[2] Il convient ici de nuancer un peu. En fait, la Commune ne fut pas par ses actes, conscients révolutionnaire. Max Gallo et les déçus du "Nouvel Observateur" s’en désespèrent assez. L’abolition de l’armée permanente et la destruction de l’appareil d’état bourgeois, ne furent pas des actes conscients et réfléchis, mais le fruit même du ferment révolutionnaire du prolétariat. Ces mesures furent prises "de fait" sans que les prolétaires Parisiens aient le temps de prendre conscience de la portée historique de leurs actes. Mais ce qui manqua surtout à la Commune, c’est le temps, la possibilité de s’orienter et d’aborder la réalisation de son programme" (Lénine, Œuvres, tome17, page137). II s’agit de Lénine en 1911 évidemment. Les prolétaires dans un premier temps ne sont pas révolutionnaires par CE qu’ils croient être la révolution, mais par ce qu’ils sont amenés à faire quand les conditions le lui exigent .
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
LA COMMUNE
- 19 lectures
Il ne s’agit pas ici, pour nous, de pousser des cris d’indignation contre tout ce qu’il y a d’inhumain dans la société capitaliste, ni de nous apitoyer sur le sort de la classe opprimée, ni de jouer les prophètes annonciateurs d’un monde nouveau, mais d’analyser d’un point de vue prolétarien -sans pour autant, faire une étude exhaustive du problème- les conditions matérielles sur lesquelles pourrait naître une société nouvelle.
La nécessité de la dictature du prolétariat
La future forme d’organisation sociale allant de pair avec le dépérissement de l’ancienne, nous devons axer tout d’abord notre analyse sur les éléments qui concourent à ce dépérissement, c’est à dire chercher dans les fondements même du capitalisme les contradictions qui le conduisent à sa chute.
Le développement de la grande industrie et du machinisme, s’est accompagné lors de l’avènement de la société capitaliste, d’une transformation radicale dans les formes d’organisation sociale de la production; le système des corporations et de la petite production artisanale était en effet devenu une entrave au développement des forces productives, De même, alors qu’il était au début un facteur de leur développement, le nouveau mode de production caractérisant le capitalisme, devient à son tour inadapté à la croissance des forces productives.
Le phénomène social de la production, au lieu d’être un acte accompli au profit de la société toute entière, est, de par l’appropriation capitaliste du produit du travail de la masse des prolétaires, un acte bénéfique seulement à une minorité de la population, la bourgeoisie. La tendance expansionniste du capitalisme, due à la satisfaction d’un impératif vital, le profit, se heurte inévitablement au caractère limité des marchés auquel s’ajoutent les problèmes de concurrence inter-capitaliste. L’anarchie dans la production sociale et l’impuissance de la bourgeoisie à gérer l’économie d’une manière rationnelle, ne sont que l’expression de ces contradictions internes.
Les crises sont la conséquence inévitable des contradictions du capitalisme et de la difficulté croissante de celui-ci à les surmonter. Cette incapacité est elle-même l’expression des formes d’organisation économique de la société; "les conditions bourgeoises de production et d’échange, le régime bourgeois de la propriété, toute cette société bourgeoise moderne qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d’échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu’il a évoqué"(Le Manifeste Communiste)
L’antagonisme de classes est le reflet .de la position de celles-ci dans le processus de production: la classe bourgeoise possède et gère los moyens de production, la masse des prolétaires lui vend sa force de travail et crée la plus-value dont s'approprie la première. Les rapports existants entre ces deux classes ne peuvent être que des rapports, d’exploitation et de domination, les intérêts de l’une ne peuvent être satisfaits qu’aux dépens des intérêts de l'autre . Alors que la bourgeoisie, pour exister se doit d’exploiter au maximum la force de travail, l’intérêt du prolétariat, se trouve dans la suppression intégrale de l’exploitation. Pour que cesse sa condition d’opprimé, il doit s’attaquer aux principes fondamentaux sur lesquels repose son exploitation, aux structures mêmes du capitalisme; à l’appropriation bourgeoise des .moyens de production, donc à la gestion capitaliste de l’économie.
L’évolution du rapport de forces entre les classes antagonistes, est objectivaient conditionné par l’évolution des contradictions du capitalisme: a un certain degré de développement la bourgeoisie ne parvient à maintenir ses propres conditions d’existence que de plus en plus difficilement; les rapports sociaux correspondant à sa domination de classe entrent en contradiction avec les forces productives, Les conditions matérielles de l’affranchissement de la classe exploitée sont donc réalisées.
Étant bien entendu que le prolétariat, par sa position au sein des rapports de production, est la seule classe véritablement révolutionnaire, la seule capable de mener à bien le projet révolutionnaire, sa tache historique ne peut être accompli ni par une minorité, (même son avant-garde) ni par le "peuple". L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes et elle exigera obligatoirement l’organisation de ceux-ci en classe dominante : la dictature du prolétariat.
La dictature du prolétariat est l’aboutissement historique du mouvement réel de l’antagonisme de classes.
La lutte de classes "mène nécessairement à la reconnaissance de la domination politique du prolétariat, de sa dictature, c’est à dire d’un pouvoir qu’il ne partage avec personne et qui s’appuie directement sur la force armée des masses"("L’État et la Révolution" Lénine.)
La révolution prolétarienne n’est pas une idée en l’air, ni une croyance faisant abstraction de la réalité; c’est au contraire à partir du mouvement réel que s’est élaborée et s’élabore une conception révolutionnaire du monde. Le grand apport de la plus importante expérience révolutionnaire du XIX siècle, la Commune de Paris, c’est d’avoir ébauché les conditions nécessaires à la réalisation de la domination politique de la classe ouvrière, les premiers pas d’une révolution prolétarienne,
Révolution violente
A la veille de la Commune, comme à la veille de tout mouvement révolutionnaire, le conflit de classe éclate au grand jour, et l’inconciliabilité des classes est flagrante, Il ne peut y avoir de solution pacifique au conflit, La bourgeoisie peut, par une victoire violente, briser la résistance du prolétariat, mais l’existence de celui-ci étant la condition nécessaire de sa survie, elle ne peut pas éliminer les causes profondes de l’antagonisme; bien au contraire, à long terme le prolétariat ne peut sortir que plus puissant d’une telle expérience. La victoire de la bourgeoisie ne peut toujours, être que moment année.
La destruction pacifique de la société bourgeoise est une utopie car elle ne peut avoir pour aboutissement réel la suppression des classes.
Ce mouvement, là n’a donc aucun caractère révolutionnaire et-ne peut en aucune façon être considéré comme une "erreur" de la lutte prolétarienne. Il est au contraire une arme utilisée par et pour la bourgeoisie; il vise à calmer les masses, à les maintenir sous le joug de la classe au pouvoir. En opposition à ces conceptions dites "idéalistes", objectivement contre-révolutionnaires, l’histoire de la société de classe en général et donc celle du prolétariat, nous montre l’évolution sociale de l’humanité comme une suite de révolutions toutes fondées sur la violence. Jusqu’à la destruction de la société de classe, "à la veille de chaque remaniement général de la société, le dernier, mot de la science sociale sera toujours: "le combat ou la mort: la lutte sanguinaire ou le néant. C’est ainsi que la question est invinciblement posée".
L’affranchissement de la classe opprimée ne sera donc possible que par une révolution violente. Ce qui ne signifie nullement, comme pourraient encore le croire certains , que la classe révolutionnaire se bornera a une violence défensive. Cette attitude-là, nous l’avons bien vu pendant la Commune (alors que Paris en avait les moyens et ne marcha pas sur Versailles) ne peut qu’être favorable à la bourgeoisie; elle ne peut que lui permettre de mieux s’organiser militairement en vue d’écraser le prolétariat. La classe révolutionnaire doit donc prendre l’initiative de la violence.
La victoire violente du prolétariat se traduit par la répression des exploiteurs. Supprimant la bourgeoisie en tant que classe dominante, et en tant que force réactionnaire .cette victoire doit être totale car, pour que cesse sa condition d’exploité, c’est aux racines .profondes du conflit que le prolétariat doit s’attaquer.
La question de l’État
Comment le prolétariat organise-t-il sa violence, quelles formes d’organisation se donne-t-il pour réaliser sa dictature, pour assumer la direction de la société ?
La Commune de Paris et les mouvements révolutionnaires en général s’ils ont été des échecs, ont cependant irrémédiablement démasqué les institutions et organisations bourgeoises. Durant une période de calme la classe dominante, à l’aide de sa pression idéologique sur les masses justifie leur existence et leur pratique par "l’intérêt commun", la "nécessité de l’ordre dans un pays démocratique" et toute cette sérié "d’opiums du peuple". Mais la réalité est là pour montrer la véritable fonction de ces institutions et organisations. Lorsqu’elles prennent part aux conflits qui opposent bourgeoisie et prolétariat, la couverture idéologique qui les masquait, éclatant en miettes, elles révèlent leur véritable nature de classe.
Il en est ainsi pour l’État qui est présenté comme organe de conciliation de classe, comme arbitre en quelque sorte. Cette conception propre à l’idéologie bourgeoise joue bien son rôle: masquer la place que tient l’État dans une société de classe.
L’origine de l’État.
L’État est ”un produit de la société à un stade donné de son développement; il est l’aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s’étant scindée en oppositions inconciliables qu’elle est impuissante à conjurer" (Engels "L’origine de la Famille de la Propriété Privée et de l’État")
L’État est le produit des contradictions de classe. A un certain stade de développement de la société et de ses contradictions, la classe économiquement la plus puissante a besoin d’asseoir son pouvoir, d’ établir des rapports juridiques et politiques sauvegardant ses intérêts économiques. L’état est l'appareil que se donne cette classe en vue de mieux maintenir la classe opprimée sous son joug.
Dans la société capitaliste, l’état est l’appareil de la bourgeoisie son organisation de classe dominante. Les bureaucrates gouvernementaux , représentant de la classe privilégiée ne peuvent qu’avoir une situation privilégiée. De par l’inconciliabilité des classes antagonistes l’état est pour la bourgeoisie l'instrument garantissant l’exploitation et l'oppression du prolétariat. Il dispose de la "force publique": armée permanente , police, lois, contrôle idéologique, etc... Ce dernier est exercé pour faire adhérer la population aux intérêts du capital (mythes de la consommation, de la participation, de la réussite sociale, de l'égalité des chances au départ etc.…) : Les lois, pour légaliser et justifier l’ordre bourgeois, l’exploitation ; la police et l’armée pour sauvegarder les intérêts du capital national face aux prolétaires et face aux autres pays.
Tous les pouvoirs dont dispose l’appareil d’état bourgeois, en font une force placée au-dessus de la société,
Sa nature d’appareil de minorité, sa fonction de conservation des structures bénéfiques seulement à la classe capitaliste, en font un organe étranger à la société.
Destruction de l’État bourgeois
C’est pourquoi le prolétariat no peut renverser la bourgeoisie sans détruire son appareil d’état. Voilà la leçon fondamentale de la Commune.
- "à bien des égards, il faudrait aujourd’hui remanier ces passages « En face des immenses progrès de la grande industrie au cours de ces 25 dernières années, et du développement parallèle de l’organisation en Parti de la classe ouvrière; on face des expériences pratiques, d’abord de la .dévolution de Février, ensuite et surtout de la Commune de Paris, où, pour la première fois, le prolétariat a pu tenir entre ses mains le pouvoir politique pondant deux mois, ce programme a perdu, par endroits, son actualité. La Commune notamment a démontré que la "classe ouvrière n’était pas simplement prendre possession de la machine d’état telle quelle et l’utiliser pour ses propres fins".
Briser la machine bureaucratique et militaire et non la faire passer en d’autres mains; voilà la première tâche de la révolution prolétarienne, la reddition nécessaire à la réalisation du programme communiste.
La CONQUETE, démocratique ou pas, de l’état bourgeois, que se proposent toutes les bureaucraties staliniennes, n’a rien à voir avec le programme prolétarien,
- Dans la société capitaliste, la démocratie n’est dans le meilleur des cas qu’un moyen permettant de changer d’équipe au pouvoir. Mais il ne s’agit pas .pour la classe ouvrière de changer d’exploiteur, ni de "serviteurs des exploiteurs". Si le prolétariat est politiquement mur pour réaliser son émancipation, et si les conditions matérielles s’y prêtent, il ne peut pas confier la gestion de "ses affaires" à une bureaucratie nouvelle mode. Il ne peut que prendre le pouvoir. Le socialisme ne peut pas être une revendication parlementaire, il ne peut pas être le produit d’une série de petites réformes additionnées les unes avec les autres. Ce n’est pas en s’attaquent aux conséquences partielles du système que l’on vient à bout de celui-ci; c’est en attaquant ses fondements mémos , le pouvoir de la classe dominante dans son ensemble.
- C’est dans l’évolution du capitalisme qu’il faut chercher la raison d’être des programmes staliniens et des réformes auxquelles ils aspirent. Avec le développement du capitalisme, ses contradictions internes tendent à mettre de plus en plus en péril son existence même. Le capitalisme classique avec son organisation traditionnelle: libre concurrence, anarchie dans la production, non intervention de l’état etc... -ne parvient plus à fonctionner. Ses contradictions s’exacerbant, seule l’intervention de l’état dans tous les domaines- et surtout dans celui de l’économie assure un sursis. Le capitalisme tend vers sa forme la plus dépouillée,
"L’État" prolétarien
Pour la première fois, pendant la Commune de Paris, on voit le prolétariat face à la bourgeoisie, se constituer en une organisation ayant elle aussi des fonctions propres:
1) de répression. Répression des exploiteurs, des forces réactionnaires. Pour combattre les armées de Thiers, pour réprimer la bourgeoisie, les travailleurs Parisiens ont leur organisation armée, autonome : les bataillons de quartier, la Garde Nationale;
2) d’exécution des tâches politiques. De même que l’état bourgeois servait aux exploiteurs pour réaliser le programme politique de classe dominante, le prolétariat tout entier, organisé, réalise les premiers pas du socialisme, ses premières tâches révolutionnaires, La population de Paris avait trouvé cet organe : l'Assemblée Communale, c’est à dire "un corps agissant, exécutif et législatif à la fois".
Ainsi, dès la première heure apparaît, dans la destruction de la société capitaliste ce qu’on peut appeler dans une certaine mesure, un "État" prolétarien, c’est à dire l’organisation de la classe ouvrière on classe dominante, chargée, d’anéantir la bourgeoisie et d’accomplir les tâches socialistes. Cet État ne peut être considéré comme un appareil extérieur à la classe, C’EST LE PROLETARIAT LUI-MEME DANS LES ORGANISATIONS QUI LUI SONT PROPRES EXERÇANT SON PROPRE POUVOIR.
Il a toujours subsisté , lorsqu'on parle de "dictature du prolétariat" Un certain équivoque sur le mot "État", Nous entendons pour notre part comme Marx et Engels après la Commune, par "pouvoir d’état", dans la transformation révolutionnaire de la société, le prolétariat organisé en classe dominante, combattant les forces du vieux mondé. Dans la mesure ou les caractéristiques produites par la société capitaliste n'existent plus et surtout dans la mesure où il est historiquement appelé à disparaître, nous ne pouvons plus parler d’un "pouvoir d’État" proprement dit, " n'étant qu’une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour organiser la répression par la force contre ses adversaires... ; tant que le prolétariat a encore besoin de l’état, ce n'est point dans l’intérêt de la Liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l’État cesse d’exister comme tel. Aussi, proposerions-nous de mettre partout à la place du mot État, le mot gemeinwesen, excellent vieux mot allemand répondant au mot français commune" (F. Engels cité dans "l’État et la Révolution".)
La démocratie prolétarienne
Alors que l’état est l’appareil de répression d’une minorité, l’organisation du prolétariat ne pourra servir, qu’à la répression de cette même minorité,
La "dictature" "consiste DANS LA MANIERE D'APPIIQUER LA DEMOCRATIE, NON DANS SON ABOLITION , dans des mainmises énergiques et résolues sur les droits acquis et les conditions économiques de la société bourgeoise sans lesquelles la transformation socialiste ne peut se réaliser." (Rosa Luxembourg "La Révolution Russe")
La mise en place du socialisme, la direction de la société, n’est plus le privilège d’une minorité, elle est l’œuvre consciente de l’ensemble des travailleurs. Seule l’organisation du prolétariat, accompagnée de la démocratie la plus absolue, la plus directe, peut éviter Jo bureaucratisme. La Commune de Paris, pour la première fois dans l’histoire nous donne un exemple de démocratie prolétarienne s
-les organisations au service de la bourgeoisie (armée permanente, police etc.…) furent supprimées. La population s’est donné ses propres organisations, foncièrement différentes. D’autre part la représentativité étant nécessaire pour exécuter les directives de la base, les membres de la Commune, au lieu de détenir, le pouvoir pendant un temps déterminé comme il est pour les ministres de l’état bourgeois et toutes les organisations de la société capitaliste, étaient élus au suffrage universel ET REVOCABLES A TOUT INSTANT. Mais encore fallait-il éviter l’arrivisme, empêcher les délégués de jouir comme dans le système bourgeois d’une situation privilégiée. C’est ce que Marx, Engels et Lénine saluèrent dans la Commune : les rétributions de ses membres ne devaient pas dépasser la valeur d’un salaire d’ouvrier. Le chemin serait ainsi barré à la cupidité[1].(1)
Le pouvoir "s’éteint"
Le prolétariat est la première classe dans l’histoire qui ne vise pas à sa perpétuation en tant que classe. Il abolit les classes et vise à sa propre disparition donc à la disparition de son pouvoir de classe.
-La démocratie prolétarienne constitue un élément fondamental de l’extinction du pouvoir car elle est le début de la restitution totale des "forces" au corps social tout entier. En effet, la direction de la société n’apparaît plus comme l’œuvre d’une catégorie spéciale d’individus, il ne s’agit plus ici d’un "comité" chargé de gérer les affaires de la classe. La démocratie prolétarienne est le début de l'intéressement direct de chaque individu à la vie en société.
-Il est évident qu'une telle vie politique doit passer par la destruction totale des structures économiques de la société bourgeoise (valeur d’échange, propriété privée, salariat etc.) Or, cette destruction signifie l’abolition des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'existence des classes. Le pouvoir d'état n’est que l'expression de l’antagonisme des classes. Pendant la dictature du prolétariat, la bourgeoisie comme classe disparaissant progressivement, le pouvoir d’état, c'est à dire le pouvoir même du prolétariat qui ne peut trouver de raison d’être que dans la force réactionnaire constituée par la bourgeoisie, est voué à sa disparition. Il "s’éteint" car il devient superflu, inutile, et ne correspond plus aux intérêts d’une classe particulière du fait de la disparition de celles-ci.
"À l’assaut du ciel"
La crise de 1869 qui fut la cause de bien des grèves et du réveil de la classe ouvrière en France, après 1848, n'était cependant pas une défaillance mortelle du capitalisme. Il s'agissait d'une de ces crises cycliques propres au capitalisme en voie de développement . Celle-ci ne paralysait guère l'accumulation du capital sur un plan général. Les forces productives n'étaient pas encore vraiment freinées par l’organisation économique bourgeoise , par les contradictions du capitalisme. Celui-ci n'avait pas encore accompli sa tâche historique, il n'avait pas encore développé les forces productives à sa mesure. L'industrialisation de la production, bien qu'ayant énormément évolué dans les dix années précédant la Commune était encore loin de ses limites capitalistes extrêmes. De ce fait, la classe ouvrière n'était pas encore une puissance capable de renverser la bourgeoisie : la classe ouvrière était encombrée dans sa lutte d'un nombre considérable d’artisans que la bourgeoisie n’avait pas encore prolétarisés. Dans ces conditions, toute tentative de révolution prolétarienne était vouée à l’échec. La classe ouvrière n’était pas assez puissante pour renverser l’ordre social et maintenir son pouvoir, car la bourgeoisie avait encore d’énormes ressources à exploiter, elle n’avait pas encore fait du monde, un monde capitaliste.
La révolution prolétarienne n’était pas possible au siècle dernier. Le réformisme était à l’ordre du jour; la Commune, produit d’un exceptionnel concours de circonstance, devint le moteur d’une lutte qui n’était pas de son siècle. Le prolétariat de la capitale était capable de détruire l’appareil d’État bourgeois, mais les conditions n'étaient pas mûres pour qu’il s’organise en Conseils Ouvriers, Son avant-garde (la "MINORITE"[2](1)) était capable de poser les problèmes en termes prolétariens, de s’opposer à toutes les tendances bourgeoises au sein de la Commune, mais du fait de la faible maturité du prolétariat, elle était incapable de s’organiser en Partis pas plus que la classe n’était capable de s’organiser en Conseils. Dans cette mesure, le maintien du pouvoir était une utopie. Sa tentative, la Commune, laisse cependant au prolétariat du monde entier un gigantesque enseignement que tous les bureaucrates piétinent tant ils le craignent et que Marx, Engels et Lénine (celui de "l’État et la Révolution") surent apprécier à sa juste valeur.
En détruisant l’appareil d’État bourgeois, la Commune de Paris a démontré aux classes bourgeoises qu’elles avaient tout à perdre dans une révolution communiste. Elle a démontré aux prolétaires qu’il leur était possible de vivre libres, "qu’ils n'avaient rien à perdre que leurs chaînes". Elle leur a montré qu’ils avaient un monde à gagner sur les ruines de l'ancien.
Pierre Ramos et Jacques Novar
[1] Il est intéressant de remarquer ce que pouvait dire Lénine en 1917: "Toute l’économie nationale organisée ... de façon que les techniciens, les surveillants, les comptables reçoivent comme tous les fonctionnaires un traitement n’excédant pas les "salaires d’ouvriers", sous le contrôle et la direction du prolétariat armé : tel est notre but immédiat. Voilà l’État dont nous avons besoin, et sa base économique. Voilà ce que donneront la suppression du parlementarisme et le maintien des organismes représentatifs. Voilà ce qui débarrassera les classes laborieuses de la corruption de ces organismes par la bourgeoisie…" et de remarquer les écarts de salaires en URSS et l’attachement à la hiérarchie des salaires de la C.G.T. et le P.C.F.
[2] (1) "Celle-ci n’est pas absolument homogène, et même, elle ne s'est formée que progressivement. On peut dire néanmoins qu’elle groupe les Communards les plus soucieux de la question sociale ; qu'elle comprend le plus grand nombre d’ouvriers ; qu'elle s’inspire enfin de l’internationale ouvriers" (in "Les Communards" de J.P. Azéma et M. Winock)
Histoire du mouvement ouvrier:
Heritage de la Gauche Communiste:
Un début de regroupement révolutionnaire
- 16 lectures
La division de la classe ouvrière, son émiettement en une somme d'individus se livrant à la concurrence individuelle, son apathie face à l’exploitation quotidienne, ne peuvent produire qu'un éparpillement et un isolement des révolutionnaires. L'histoire ne l'a que trop démontré. Inversement, le renforcement du prolétariat comme classe autonome pour elle-même, son union dans la lutte et le développement de celle-ci, créent les bases et la nécessité d’un regroupement des éléments révolutionnaires.
Depuis près de trois ans, un nouvel élan de luttes révolutionnaires a commencé à ébranler le monde : Mai 68 en France, les luttes de Cordoba en Argentine, "l’été chaud" de 69 en Italie, la multiplication des grèves sauvages en Angleterre, les luttes des mineurs au Limbourg et à Kiruna ou les récents mouvements du prolétariat en Pologne ne sont que les éclats les plus brillants de ce réveil mondial de la classe ouvrière.
Réveil et non sursaut, parce que la raison profonde qui l’a provoqué jusqu'à présent, à. savoir, la décomposition actuelle de l'économie capitaliste mondiale qui fait peser toutes ses conséquences d'abord et avant tout sur la classe des exploités, cette décomposition ne fait que commencer. L'inévitable approfondissement de la crise actuelle du capitalisme annonce donc le renforcement, le développement et la radicalisation du mouvement des luttes prolétariennes mondiales.
Or, l'action et le regroupement des éléments les plus avancés dans la voie révolutionnaire restent encore prisonniers de 40 ans d'isolement et d'émiettement. Les partis dits "ouvriers" ou qui s’auto-qualifient de "révolutionnaires" et qui s'étalent de la social-démocratie et du stalinisme de Moscou au trotskysme , en passant par toutes les gammes de "maoïsme", ne font que jouer le rôle de derniers remparts du capitalisme sous sa forme privée libérale ou étatique totalitaire. Leurs positions, franches ou ambiguës face aux dernières luttes du prolétariat polonais les ont encore une fois ouvertement démasqués (cf. en France, le silence gêné gardé par les éléments du "Secours Rouge" qui quelques semaines auparavant se joignaient au Pape et aux "grands" du capital libéral pour implorer Franco de gracier les condamnés de Burgos, mais qui "n’avaient rien à dire" devant l’insurrection du prolétariat polonais).
Quant à l'intervention des révolutionnaires elle est restée jusqu'à présent condamnée au niveau artisanal à l'effort divisé, à la quasi-impuissance. Il est évident que la force d’une intervention révolutionnaire est conditionnée par le regroupement des révolutionnaires. Il est aussi net que ce regroupement n'est rendu POSSIBLE que grâce à l'action historique de la classe dans s::m ensemble et c'est cette action même qui le rend NECESSAIRE.
Mais il n 1y a pas un rapport mécaniciste entre le développement de la lutte prolétarienne et le regroupement des éléments les plus avancés. Entre ces deux phénomènes se greffe la volonté consciente des révolutionnaires. C’est dans cette perspective et pour ces raisons que les trois groupes : Communisme de conseils, Organisation Conseilliste de Clermont-Ferrand et Révolution Internationale, ont décidé d'engager ce processus en se donnant un programme d’action en ce sens.
Pour cela, les deux revues publiées actuellement par ces groupes ouvrent leurs colonnes à côté de leurs interventions propres à la discussion en vue de parfaire l’éclaircissement nécessaire à ce regroupement et sans lequel aucun rassemblement n’est possible.
Les trois groupes interviendront en commun sur les principaux évènements qui touchent à la lutte du prolétariat.
Les trois groupes en commun s’orienteront vers l’élaboration d’un journal ouvrier révolutionnaire.
Les trois groupes s'engagent à intégrer à leur effort tous les groupes et éléments isolés qui se situent sur un programme révolutionnaire.
La perspective de notre intervention s’oriente essentiellement dans deux axes principaux :
I/ La recherche de ce que Marx dans le manifeste appelait "l'avantage de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier".
2/ Et cela dans le but de l'intervention dans les luttes quotidiennes de la classe en vue de contribuer au processus qui mène à son auto-organisation comme classe historique pour son émancipation définitive, en "mettant en avant et faisant va loir, dans les diverses luttes· nationales des prolétaires, les intérêts communs du prolétariat tout entier sans considération de nationalité ; d’autre part dans les diverses phases de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, en représentant toujours l’intérêt du mouvement dans son ensemble".
CAHIERS DU COMMUNISISME DE CONSEILS
ORGANISATION CONSEILISTE DE CLERHONT-FERRAND
REVOLUTION INTERNATIONALE
Courants politiques:
Approfondir:
Chine – Pakistan, la fin des illusions
- 32 lectures
C’est une banalité que de dire qu’une des conditions fondamentales de l’émancipation du prolétariat est une conscience nette et claire des buts à atteindre et des moyens à mettre en œuvre ; que cette prise de conscience est le produit de la lutte de classe, mais qu’elle passe aussi par la destruction de toutes les illusions, de tous les mythes secrétés par la classe dominante et qui encombrent l’esprit des travailleurs.
Mais il faut ajouter que si l’activité théorique des révolutionnaires tend principalement vers une telle destruction, cette activité, par elle-même, ne saurait suffire à cette tâche si les évènements historiques ne venaient confirmer de façon irréfutable et tangible leurs analyses et prévisions.
À cet égard les évènements de ces dernières années et particulièrement ceux de ces derniers mois ont plus fait pour la conscience prolétarienne que l’activité des groupes révolutionnaires durant les cinquante dernières années.
Un à un, chacun de ces mythes, chacune de ces illusions ont subi l’assaut de l’histoire.
I. La disparition des crimes du capitalisme
Au centre de la domination idéologique de la bourgeoisie réside la croyance en un développement infini du capitalisme procurant aux membres de la société un bien être toujours meilleur. Le quart de siècle de prospérité qu’a connu le capitalisme après la seconde guerre mondiale a accrédité la thèse suivant laquelle les gouvernements étaient maintenant en mesure de maîtriser non seulement les crises cycliques du siècle dernier, mais encore les crises générales comme celles de 1929. Cette thèse a réussi à faire des adeptes jusqu’au sein même de certaines organisations qui maintenaient par ailleurs des positions révolutionnaires comme par exemple ''Socialisme ou Barbarie" ou certains communistes de conseils (Pannekoek à la fin de sa vie). Mais depuis le début de l’année 1967 cette illusion a commencé à se heurter aux dures réalités des crises successives de la livre, du dollar et du franc, de la croissance accélérée du chômage, de l’inflation galopante et des plans d’austérité qui l’accompagnent, des faillites spectaculaires du style Rolls Royce, etc., à tel point que certains des économistes les plus conformistes et réactionnaires en sont arrivés aujourd’hui à la conclusion que les difficultés actuelles du capitalisme préludent à une crise générale du système.
II. Les États "socialistes"
Un autre mythe que les évènements de ces dernières années ont malmené est celui du caractère socialiste des pays de l’Europe de l’est. Les insurrections Hongroises et Polonaises de 1956 lui avaient déjà porté un coup sévère, mais l’aspect encore nationaliste de ces mouvements avait permis aux gardiens de ce mythe (aussi bien les staliniens que les bourgeois libéraux) de brouiller les cartes.
Les évènements de 1968 en Tchécoslovaquie, furent le signal d’un malaise qui depuis va grandissant au sein, des partis staliniens. Quoique remettant en question l’infaillibilité des entreprises de Moscou, ce conflit ne permettait pas encore d’avoir une vision claire des luttes de classe en Europe de l’Est.
Par contre, une telle vision s’est imposée d’une façon irréfutable après les émeutes ouvrières qui ont éclaté en Décembre 1970 en Pologne, et qui ont dressés face à face le prolétariat et ses exploiteurs. Les combats de Gdansk, Stettin, Sopot etc. ont plus fait pour dévoiler aux yeux des prolétaires du monde entier la nature capitaliste de la Pologne et des autres pays de l’Europe de l’Est, que l’activité des communistes de gauche depuis la fin des années 20 (cette constatation ne permettant évidemment pas de dire que cette activité a été inutile mais seulement qu’elle trouve son plein sens aujourd’hui.)
III. "L’homme nouveau" à Cuba
Longtemps les bonnes âmes de la gauche, ont cru voir dans Cuba, la synthèse enfin réalisée entre "socialisme" et liberté. Et ce qui charmait le plus les intellectuels en mal d’exotisme, c’était la "liberté de la création artistique" que Fidel proclamait comme règle officielle.
"Hors de la Révolution rien ! Dans la Révolution tout !" était la devise du congrès culturel de la Havane tant vanté par les journalistes à la "Nouvel Observateur" et aussi par les soi-disant marxistes révolutionnaires regroupés au sein de la IV Internationale. Encore fallait-il que Castro précise ce qu’il entendait par révolution.
Depuis le début notre courant affirmait que ce terme ne recouvrait rien d’autre que le capitalisme d’État, et s’est presque fait traiter d’agent de la CIA par les trotskystes de 1a IV qui trouvaient que Cuba était un état ouvrier beaucoup moins dégénéré que les autres, (au même titre que le Nord-Vietnam et la Corée du Nord avec qui ils devait constituer une soi dis ante "troisième force"[1]).
L’annonce de l’arrestation, puis de l’auto-critique sinistre du poète Cubain Heberto Padilla, plongea toutes ces bonnes âmes dans la consternation la plus totale, consternation qu’ils exprimèrent dans un manifeste au nom de leur sympathie pour cette révolution cubaine à laquelle ils avaient tant cru. La réponse de Castro n’a pu qu’approfondir leur désespoir : "nous n’avons pas besoin de sympathie critique, seules les louanges inconditionnelles et dithyrambiques sont acceptées" leur a-t-il dit en quelque sorte.
Il aura donc fallu qu’on touche à l’un des leurs : un intellectuel, un artiste pour que ces adorateurs s’émeuvent et prennent conscience de ce qu’ils appellent "la réalité stalinienne" de Cuba. Dix années de bourrage de crâne forcené auprès des travailleurs cubains pour les persuader de PRODUIRE jusqu’à la limite de leurs forces n’avait pas suffi à les inquiéter ni à leur faire soupçonner ce que les révolutionnaires proclamaient depuis le début : la réalité tristement capitaliste de Cuba[2].
"L’homme nouveau" de Cuba ressemble trop au prolétaire exploité de tous les pays, mais ici son exploitation féroce est accompagnée d’une dose exceptionnelle d’opium administré à coup d’immenses rassemblements sur la "place de la Révolution", de discours du "leader Maximo", et de propagande incessante. Opium qui à d’autres époques a fait ses preuves contre le prolétaire allemand ou russe et encore aujourd’hui contre le prolétaire chinois, nord-coréen et beaucoup d’autres.
IV. Les voies pacifiques au socialisme
L’illusion des voies particulières, nationales et pacifiques au socialisme est certainement une de celles qui a fait le plus de mal au mouvement ouvrier depuis ses origines. Quels qu’aient pu être les recettes proposées ces formules ont toujours recouvert le réformisme dont les tenants se sont montrés en fin de comptes les meilleurs alliés du capital pendant les crises révolutionnaires.
Aujourd’hui la mystification tente de se perpétuer à travers l’existence de doux "socialismes" pacifiques : "le socialisme Scandinave" et depuis quelque temps "le socialisme chilien", Malheureusement pour les partisans d’une telle solution, les grèves sauvages qui ont éclaté dans la plupart des pays nordiques, depuis celles des mineurs de Kiruna jusqu’à celle de 75.000 ouvriers de la métallurgie finlandaise, ont porté au mythe de la "paix sociale" instauré par ces régimes un coup sérieux.
De son côté le "socialisme chilien" bien qu’il fasse encore illusion parmi de larges couches de la population (comme l’indique l’avance obtenue par la coalition d’Unité Populaire aux élections municipales de Mars 71) a déjà montré sa nature de classe profonde en envoyant la police contre les paysans qui avaient montré trop d’impatience en récupérant leurs terres avant la date prévue par le calendrier officiel[3] et en instaurant avec le prolétariat des rapports qui ne sont pas sans rappeler ceux existant dans n’importe quel régime capitaliste. On en retiendra pour preuves que les grèves aux quelles furent contraints dès Décembre 1970 les employés du téléphone, les ouvriers municipaux et les fonctionnaires administratifs de l’Université.
Par ailleurs le président Allende a prodigué à l’égard des travailleurs, des "encouragements" à produire dans "l’intérêt du Chili" qui, à part la phraséologie, ne le cèdent en rien à ceux d’un Pompidou ou d’un Chaban Delmas, A l’occasion du 1er Mai, ne déclarait-il pas :
- "…les bénéfices des entreprises serviront en partie à améliorer les salaires mais le plus grand pourcentage ira aux investissements... ne présentez pas des revendications exagérées, car il n’y sera pas répondu. La règle du jeu est simple : c’est le sort du Chili qui est en jeu."[4]
Voici donc les travailleurs prévenus : ils doivent comme partout respecter la règle du jeu, la règle du capitalisme !
D’ailleurs ils savaient à quoi s’en tenir depuis l’arrestation d’un militant ouvrier sous l’accusation "d’entrave à la liberté du travail" à la suite de la grève des transports en commun de Santiago déclenchée le 22 Mars, et la menace proférée de la bouche même d’Allende de mettre les dits transports sous contrôle de l’armée en cas de poursuite du mouvement.
La participation du "camarade président" et des "camarades ministres" en bras de chemise "aux journées de travail volontaire" inaugurées le Dimanche 16 Mai n’y pourront rien à la longue : là comme ailleurs, les travailleurs seront contraints de constater qu’intérêt national égal intérêt du capital.
V. "Le Front Uni" de Ceylan
Une autre expérience locale de "front uni" à coloration socialiste -puisque ce front comprend le P.C et même des "trotskystes" (exclus il est vrai, de la IV Internationale)- a, en l’espace de quelques mois fait ses preuves à Ceylan.
Une des premières mesures du gouvernement de Madame Bandaranaike fut de présenter un budget d’austérité préparé par le ministre "trotskyste" des finances. Mais, ce que l’histoire retiendra de ce gouvernement, c’est la répression sauvage contre le soulèvement populaire d’Avril 1971, soulève- ment des jeunes intellectuels sans travail, mais aussi d’une fraction de la classe ouvrière et d'une grande partie de la population paysanne.
Malgré les fanfaronnades de Mme Bandaranaike et de ses ministres (en particulier du leader du P.C. Peter Keuneman, qui ne voyait dans le soulèvement que l’œuvre "du gros capital, des esprits diaboliques et des organisateurs criminels"[5]) le gouvernement Ceylanais a dû faire appel à la "solidarité internationale" pour venir à bout de l’insurrection. Cette solidarité ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : elle a pris la forme d’armes de la garnison britannique de Singapour, de 6 hélicoptères américains[6] d’hélicoptères indiens et pakistanais[7], d’un bateau d’armes yougoslaves[8], d’un certain nombre de Mig 17 soviétiques[9] etc.... Si bien que Mme Bandaranaike pouvait, le 23 Avril, "remercier pour leur aide les États-Unis, la Grande Bretagne, 1'Union Soviétique, la RAU, l’Inde, le Pakistan, la Yougoslavie, et exprimer sa reconnaissance au Canada et aux deux Allemagnes pour leur soutien".
En cette circonstance, on a vu donc se faire l’unanimité des ennemis de toujours (Inde et Pakistan, les deux Allemagnes) au sein d’un front uni de la répression au service du capital mondial.
A plus d’un titre cette expérience est riche d’enseignements pour les travailleurs du monde entier. Elle laisse augurer de l’attitude qu’adoptera en cas de soulèvement prolétarien, un P.C. au pouvoir (le PCF par exemple) et de l’aide que ne saurait manquer apporter l’URSS aux classes régnantes dans de telles circonstances.
Les esprits perspicaces auront constaté que la Chine ne figure pas parmi les pays que Mme Bandaranaike dans son discours du 23 Avril remercia. Est-ce que ce dernier "bastion du socialisme" n’a pas voulu faire chorus avec les impérialistes et les révisionnistes ? On est là bien loin du compte puisque fin Mai[10] on apprend que vers le 25 Avril, la Chine a consenti un prêt de 150 millions de roupies (25 millions de dollars) et que M. Chou-En-Laï a adressé à Mme Bandaranaike une lettre où il dit :
- "Nous sommes heureux de voir que grâce aux efforts de Votre Excellence et du gouvernement de Ceylan, a été dominée la situation chaotique créée, par une poignée de gens qui s’appellent des "guévaristes" et dans les rangs desquels des espions étrangers se sont infiltrés. Nous sommes totalement d’accord avec la position correcte à laquelle Votre Excellence se réfère, qui consiste à défendre la souveraineté de l’État et à se protéger de toute ingérence étrangère".
Mais la nouvelle du soutien de la Chine Populaire à la répression Ceylanaise est passée alors pratiquement inaperçue car depuis plus d’un mois un autre soutien de la Chine jetait le désarroi parmi les adorateurs de la pensée de MAO et portait un coup sévère à un des mythes les plus tenaces non pas tant chez les prolétaires que dans la plupart des courants qui prétendent défendre leurs intérêts : la nature révolutionnaire des luttes de libération nationale et le caractère "progressif" des pays qui les soutiennent.
VI. Luttes de libération nationale et "États progressistes”
Depuis longtemps les révolutionnaires ont dénoncé dans les luttes délibération nationale :
- de simples moments d’un conflit inter-impérialiste ;
- leurs caractères profondément réactionnaire et déviateur par rapport à la seule lutte aujourd’hui historiquement révolutionnaire : celle du prolétariat international contre le Capital ;
- et dans le "socialisme" sur lequel elles débouchent parfois, le Capitalisme d’État.
Les grandes puissances soi-disant "socialistes" recouvrent leurs interventions dans ces conflits de phrases démagogiques du genre "soutien du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", Mais il arrive qu’elles prennent des positions complètement en désaccord avec ces thèses. Ces derniers temps, l’URSS s’est particulièrement distinguée dans ce genre d’exercice : intervention en Tchécoslovaquie, abandon de la résistance palestinienne, après que les objectifs principaux de l’intervention soviétique au Moyen Orient aient été atteints, à savoir l’utilisation des bases maritimes Égyptiennes qui permet à sa flotte de rivaliser en Méditerranée avec la sixième flotte américaine, de même que la mainmise sur tout le dispositif militaire de ce pays, clef stratégique du Moyen Orient et de son pétrole...).
Une de ses démonstrations les plus brillantes fut le soutien sans réserves apporté aux côtés de la Grande Bretagne, au gouvernement central du Nigéria dans son entreprise d’écrasement et de massacre du peuple Ibo insurgé, revendiquant pour le Biaffra "le droit à disposer de lui-même -et de son pétrole".
Dans cette circonstance la Chine était encore du "bon côté", c’est à dire aux côtés du peuple luttant pour son indépendance ; elle se trouvait en cette circonstance en bien curieuse compagnie ; celle des USA, du Portugal, et de l’Afrique du Sud ! mais on pouvait encore admettre qu’il peut arriver que les impérialistes se trompent dans le choix de leur camp et que ceux de Washington, de Lisbonne et de Pretoria s’étaient trouvés par hasard du bon côté.
Dans ces différentes occasions (Tchécoslovaquie, Palestine, Biafra) la propagande chinoise n’avait d’ailleurs pas manqué de dénoncer le "social impérialisme" et le "chauvinisme des grandes puissances" du "révisionnisme" soviétique.
Donc, jusqu’à ces derniers temps, le mythe de la Chine, fidèle et ultime défenseur des peuples opprimés, pouvait avoir encore un semblant de crédibilité.
Les récents évènements du Pakistan Oriental ont porté à ce mythe un coup mortel.
Le long silence observé par Pékin après le début du conflit a permis à la "Cause du Peuple" de commettre la plus grosse bourde de sa piètre existence : dans le numéro 38 du 8 Avril n’écrivait-il pas sous le titre enflammé "Pakistan-Bengale : la liberté ou la mort":
- "Le Pakistan est un de ces états monstrueux que les impérialistes vainqueurs taillèrent dans les pays d’Orient comme des morceaux d’étoffe. Tout dans le Pakistan a été créé de toutes pièces, mémé le nom ...
Très tôt, les deux Pakistan se sont dressés l’un contre l’autre : d'un côté, le Pakistan Occidental, siège du gouvernement, pays des grands propriétaires au pouvoir, de l’autre, le Pakistan Oriental minuscule et surpeuplé, où des millions de petits paysans meurent de faim sur des lopins de terre, souvent endettés envers les riches de l’autre Pakistan. De plus, le Pakistan Oriental a été "découpé" dans l’ancienne province du Bengale, dont le peuple depuis un siècle a mené des luttes farouches contre les Anglais pour conquérir l’indépendance. Ce désir d’indépendance ne l’a jamais quitté, il animait sourdement les soulèvements de plus en plus nombreux qui se sont succédés contre le pouvoir central..."
...le peuple est descendu dans les rues des villes du Pakistan Oriental : il n'a que ses mains et ses javelots pour se battre, mais il sait que de l'autre côté de la frontière de l’Inde, les paysans de Naxalbari n’avaient pas d’autres armes lorsqu’ils se sont levés et qu’ils ont vaincu... C’est dans l’Asie toute entière que les peuples détruisent les états fantoches et les frontières que les impérialistes leur avaient imposées, au Vietnam sur le 17° parallèle, en Corée sur les 38° parallèle, comme maintenant dans le Bengale insurgé"
Donc, cet article de la "Cause du Peuple" ne permet aucune équivoque : le Pakistan est un état fantoche colonialiste et la lutte de libération du Bengale est juste. Quelques jours après cet article la Chine commençait à montrer sa couleur en dénonçant "les menées expansionnistes de l’Inde" contre le Pakistan Oriental et enfin plus de deux semaines après le début du conflit elle abattait ses cartes sous forme d’un article dans le "Quotidien du Peuple" d’une lettre de Chou En Laï au maréchal Yahya Khan.
Le premier déclarait :
- "La Chine soutient résolument le gouvernement et le peuple Pakistanais dans leur juste lutte pour la sauvegarde de l’indépendance nationale et de la souveraineté de leur état, contre l’agression et l’intervention étrangères".[11]
.Chou En-laï de son côté écrivait[12] :
- "
Nous sommes certains que grâce aux contacts que vous et vos collaborateurs multiplient et grâce à tous vos efforts, la situation au Pakistan redeviendra normale...
L’unité du Pakistan et des peuples des provinces occidentales et orientales du pays est une garantie essentielle pour que celui-ci survive et trouve la prospérité et la puissance. Il faut distinguer la grande masse du peuple d’une poignée de gens qui ne pensent qu’à saboter l’union du Pakistan".
Donc la juste lutte n’était plus celle des Bengali mais celle des forces de répression qui les massacraient et ce n’était plus le "peuple qui descendait, dans la rue" "animés sourdement du désir d’indépendance" mais une poignée de gens qui ne pensent qu’à saboter l’union du Pakistan.
On peut imaginer aisément la détresse qui a dû envahir le malheureux responsable de "La Cause du Peuple" quand ils ont lu ces lignes. En fait la prise de position officielle de Pékin en faveur du régime militaire d’Islamabad n’est pas surprenante.
Le soutien apporté par la Chine, en Mars 1969 au gouvernement du Pakistan au moment du soulèvement général des ouvriers, paysans, étudiants faisait présager une telle prise de position.
Toute honte bue, les responsables de "La Cause du Peuple", ont dû publier dans le numéro suivant un article intitulé: "Chine et Pakistan : quelle est la vérité ?" et disant pratiquement le contraire de ce qu’affirmait le précédent, quand il n’essaie pas de nier carrément les faits indiscutables comme le message de Chou En Lai à Yahya Khan :
- "Jamais la Chine Populaire n’a soutenu le gouvernement de Yahya Khan depuis le début des évènements. Le gouvernement Indien a dû recourir à des faux et des provocations pour tenter de le faire croire".
Suit toute une partie où la "Cause du Peuple" explique que la Chine doit lutter contre une manœuvre d’encerclement de la part de l’impérialisme et du social impérialisme. Pour briser cet encerclement elle soutient toutes les luttes des peuples des pays qui y participent.
Par contre, le Pakistan entretient avec la Chine des relations amicales et s’oppose constamment à l’Inde qui est une des clefs de voûte de cet encerclement. Par conséquent la place de la Chine est aux côtés du Pakistan face aux "agressions" de l’Inde.
"L’humanité Rouge" dans son article du numéro 102, "A bas l’expansionnisme Indien" n’utilise pas d’autre argument pour justifier l’attitude de la Chine. Dans cet article on nous dit -ce que nous savions déjà- que l’Inde n’a cessé de mener une politique réactionnaire tout au long de son existence, politique qui tranche avec celle "progressiste" du Pakistan. L’Inde est ainsi injustement accusée d’avoir violemment réprimé des révoltes populaires en Tamil Nadu, au Maharastra, au Kérala, au Bengale et en Assam. Le gouvernement du Pakistan lui n’a jamais rien fait de tel : en Mars 1969 il n'a pas écrasé dans le sang un soulèvement populaire généralisé instaurant à cette occasion une loi martiale qui dure encore aujourd’hui, seuls les impérialistes osent prétendre qu’il se livre à un massacre systématique de la population Bengali pratiquement désarmée. L’article, après avoir repris une citation de Staline conclue en ces termes :
- "A l’heure actuelle, soutenir le mouvement national au Pakistan Oriental, c’est soutenir les réactionnaires indiens, agents de l’impérialisme US et du social-impérialisme, c’est aller contre les intérêts du mouvement anti-impérialiste en Asie et dans le monde.
C’est pourquoi les marxistes-léninistes et les anti-impérialistes conséquents soutiennent l’intégrité territoriale du Pakistan face à l’impérialisme et au social-impérialisme"
Au-delà du dégoût que peuvent inspirer les acrobaties rhétoriques qu’elles contiennent, on peut découvrir dans ces articles la véritable raison qui a poussé la Chine à prendre des positions si peu en accord avec ses proclamations officielles : il s’agit de la défense de ses intérêts nationaux et impérialistes.
On nous dit en effet clairement que si la Chine soutient le Pakistan c’est parce qu’il existe entre ces deux pays des intérêts nationaux communs face à ceux de l’Inde.
En fait le Gouvernement Chinois se moque bien de la structure féodale du Pakistan qui vaut celle de l’Inde, du caractère militaire policier et profondément réactionnaire de son gouvernement et de l’état de dépendance coloniale dans lequel est maintenu le Bengale. Tous ces faits qui sont dénoncés avec vigueur quand ils existent dans un État ennemi, sont tus lorsque la défense des intérêts impérialistes du capital chinois le commande.
Effectivement, la Chine, bouclée sur sa frontière septentrionale par l’URSS maintenant hostile, par les bases US établies en face de ses frontières maritimes (Okinawa, Guam, Corée du Sud, Formose, Sud-Viêt-Nam, Philippines, et Singapour), affrontant sur le Sud l’autre grande puissance du secteur, l’Inde, tente de briser cet isolement par tous les moyens.
L’alliance avec le Pakistan lui permet d’avoir un accès sur l’Océan Indien et par ailleurs de prendre les frontières terrestres de l’Inde dans une tenaille (à cet égard l’existence de deux Pakistan rattachés à une même autorité, est particulièrement efficace).
Soutenir le soulèvement bengali, même si celui-ci avait pu aboutir à un régime à sa dévotion, aurait signifié pour elle la perte de l’alliance du Pakistan Occidental autrement plus intéressant du point de vue stratégique étant la porte du Moyen Orient.
L’établissement de relations diplomatiques qui s’annonce entre la Chine et l’Iran[13] participe de ces mêmes desseins. Le fait que le gouvernement Iranien soit actuellement en train d’exercer une répression des plus féroces sur le mouvement populaire (étudiant, paysan et surtout ouvrier) qui se développe dans ce pays ne saurait entrer en ligne de compte devant les intérêts capitalistes de la Chine, De la même façon que l’assassinat d’Ernest Ouandié et de ses camarades n’a pu empêcher quelques jours plus tard, l’établissement de relation diplomatiques avec le Cameroun du "fantoche" Abidjo (2 avril), que le régime ultra-féodal et compradore qui règne dans l’Émirat de Koweït n’a pu contrecarrer l’établissement des mêmes relations avec celui-ci,(29 mars), que les régimes policiers qui accablent actuellement la Turquie et la Grèce aient été jugés dignes de bénéficier d’accords commerciaux[14], le fait que les États-Unis soient jugés comme le "chef de file de l’impérialisme mondial -ennemi des peuples du monde entier" n’a pas empêché la Chine Populaire de pratiquer à leur égard, pendant cette même période, la fameuse diplomatie du ping-pong.
On peut se demander pour quelles raisons ces régimes, considérés comme les plus réactionnaires, établissent des relations avec la Chine "rouge", "citadelle de la subversion". La réponse nous est donnée avec candeur par "Le Monde" du 28 avril :
- "Sur le plan politique, la reconnaissance de Pékin améliorerait l’image de marque de l’Iran, qui veut jouer un rôle prépondérant au Proche-Orient . Elle peut aider indirectement le gouvernement dans sa lutte contre les éléments d’extrême gauche qui viennent pour la première fois de s’engager dans des actions de guérilla rurale et urbaine en infligeant des pertes aux forces de l’ordre et en abattant le Général Farsiou, chef du parquet militaire".
Ainsi les partis "pro-chinois" qui sont légion dans ces pays n’ont plus qu’à aller se rhabiller : la Chine se moque bien de l’action qu’ils mènent au péril de leur vie. Ses intérêts impérialistes commandent.
Nos maoïstes de "la Cause du Peuple", placés devant le même genre de problèmes de cohérence essaient de leur côté dans leur numéro du 1er Mai de justifier, non seulement l’alliance de la Chine avec le Pakistan, mais également le massacre de l’insurrection Bengali. Les arguments utilisés valent qu’on les cite :
- "Vis-à-vis de cette situation (la résistance Bengali n’aurait presque pas existé et de plus elle aurait été appuyée par des commandos indiens, ndr). La chine Populaire, en tant qu’État, a déterminé son attitude de principe en fonction de la contradiction principale. Cette contradiction principale, c’était depuis le début (?), celle qui opposait le Pakistan, État indépendant[15], à l'Inde, puissance impérialiste, qui, utilisant l’attitude criminelle du "gouvernement de Bengladesh", avait entrepris, une intervention armée directe contre le Pakistan Oriental sous le couvert d’un soutien fictif, à une insurrection populaire...
On l’a vu il n’y a pas eu d’insurrection populaire armée : les masses bengalis sont descendues dans la rue à l’appel d’hommes qui les ont livrées au massacre et qui se sont enfuis. Il est évident que s’il y avait eu insurrection armée, si des forces populaires autonomes même faibles avaient pu organiser un début d’auto-défense et de résistance dans les villes et surtout dans les campagnes, la contradiction principale eut été autre : elle aurait opposé d’abord le peuplé aux réactionnaires pakistanais, et la Chine Rouge aurait alors soutenu ce réel mouvement. Il suffit de se rappeler son attitude vis à vis du grand mouvement de mai-juin 63 en France : la Chine soutenait la politique de relative indépendance nationale du gouvernement gaulliste ; mais dès qu’il fut clair qu’il y avait un réel mouvement de masse, qu’aucune force réactionnaire française ou étrangère n’était vraiment capable de manipuler[16] le gouvernement et le peuple de Chine ont magnifiquement soutenu 1a lutte des masses françaises".
La première chose qu’on peut souligner c’est qu’il n’a jamais rien coûté à la Chine d’appuyer verbalement un mouvement se déroulant à 10.000 kilomètres de ses frontières (surtout s’il crée des ennuis aux "révisionnistes" de service), alors que le Bengale se trouve sur ses propres frontières. Devant cette manipulation de "contradictions" échelonnées on se demande ce qui l’emporte chez les maoïstes du cynisme où de l’inconscience.
Leurs sinistres exercices de rhétorique n’essaient rien de moins que de nous faire "avaler" un des plus sanguinaires carnages de ces dernières années, où le nombre de morts se compte par centaines de millions[17] sans compter les épidémies et famines qui atteignent aussi bien les Bengalis qui sont restés dans leur pays que les six millions qu’on a "entassé" en Inde.
VII. Fin de deux mythes
La prise de position de la Chine en faveur du régime militaire pakistanais et l’activité diplomatique qu’elle a déployé pendant cette même période aura eu au moins le mérite de simplifier les choses : la Chine est un État Impérialiste au même titre que les USA, l’URSS et elle ne s’épargne aucune des attitudes qu’elle a dénoncé chez cette dernière. Maintenant, à ce sujet, les choses sont parfaitement limpides, mais il est un autre domaine où ces événements auront contribué à clarifier la situation : c’est celui du caractère des luttes de libération nationale.
En effet, que nous enseigne le soutien chinois à l’écrasement du soulèvement Bengali ? Que les grandes puissances "socialistes" ne sont prêtes à soutenir une lutte de "libération nationale" que pour autant que cela soit d’accord avec leurs intérêts impérialistes, sinon elles n’hésitent pas à contribuer à leur liquidation. Par conséquent aucune lutte de ce genre ne peut conduire aujourd’hui à une véritable libération nationale, puisqu’une telle libération ne signifierait justement que leurs intérêts sont lésés, ce que ne sauraient tolérer, ces puissances.
Dans un monde partagé en grands blocs d’influence, il n’existe que deux issues possibles pour de telles luttes :
- ou bien elles dérangent les intérêts de tous les blocs et alors ceux-ci n’hésitent pas à s’unir pour liquider ces luttes, comme ce fut le cas pour le Ceylan ;
- ou bien elles peuvent permettre à un des blocs d’étendre son influence dans une zone en dispute. Le soutien que celui-ci apporte à ces luttes est empoisonné car il ne peut conduire qu’à un changement de puissance de tutelle et non à une véritable libération nationale.[18]
Marx écrit dans "Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte" que'les grands évènements et personnages historiques se répètent deux fois : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme une farce.
Si les volte-face des partis staliniens suivant les intérêts nationaux de l’URSS représentaient pour le prolétariat inféodé à ces partis des tragédies (une des plus sanglantes fut celle qui le jeta dans la seconde guerre impérialiste mondiale sous couvert de "résistance" au fascisme) les actuelles contorsions de ceux qui revendiquent l’intégrité de l’héritage du stalinisme, y compris la vénération de sa figure de proue, ne sont plus en effet, qu’une farce (sinistre quelquefois quand ces contorsions s’appliquent à des évènements aussi tragiques que ceux du Bengale).
Les prolétaires d’aujourd’hui sont effectivement de moins en moins disposés à avaler les couleuvres que leurs pères et grands-pères durent ingurgiter pendant près de cinquante ans ; les pantalonnades de nos maoïstes ne peuvent plus leur inspirer que de l’indifférence et au pire de la pitié pour les militants sincères victimes de la répression.
Les maoïstes sont devenus une espèce triste, mélancolique et désemparée. Il faut tant de masochisme pour être aujourd’hui maoïste qu’on peut prévoir sans trop de risques l’extinction rapide de cette espèce. Dans cette prise de position à l’égard de l’attitude de la Chine dans l’insurrection Bengali, il ne s'agissait donc pas tant pour nous de nous associer au coup de grâce que l’histoire a donné, dans les pays au capitalisme le plus avancé, à ces courants politiques que de contribuer à l’effondrement de deux des mythes les plus néfastes auxquels s'est heurté le mouvement ouvrier : le caractère révolutionnaire des luttes de libération nationale et surtout la prétendue existence d’états "socialistes" ou d’un soi-disant bloc non-impérialiste.
En guise de conclusion
Il est des époques où l’histoire semble s’accélérer. Il en est ainsi des périodes de guerre et surtout de révolution. Depuis quelques années on assiste à un tel phénomène : depuis l’intensification des divers conflits inter-impérialistes -en particulier avec la pression du capital chinois qui tente par tous les moyens de prendre sa part du gâteau dans le partage du monde, passant par les convulsions internes au bloc "communiste" et les difficultés grandissantes de l’économie mondiale, jusqu’au renouveau international des luttes ouvrières, il ne se passe plus de mois qui n’apporte d’élément nouveau contribuant à chasser de l’esprit des travailleurs les mystifications qu'un demi-siècle de contre-révolution y ont déposées.
Après 25 années de reconstruction et de "sereine" prospérité, les classes régnantes du monde entier constatent avec effroi que les murailles du vieux monde sont lézardées de partout et leur effroi est d’autant plus grand que celles-ci commencent à être frappées avec une énergie chaque jour grandissante par ce géant qu’elles croyaient définitivement endormi : le prolétariat.
Quant à nous, nous ne pouvons que dire, après Marx :
- "Aux signes qui déconcertent la bourgeoisie, l’aristocratie et les piètres annonciateurs du déclin, nous reconnaissons notre noble ami, la vieille taupe qui sait travailler si vite sous la terre, le digne pionnier: la Révolution...,"
[1] Il revient à la vérité de dire ici que cette analyse n’est pas partagée par les autres courants trotskystes, en particulier l’OCI et "Lutte Ouvrière".
[2] Dans "le Monde " du 12 Mai le professeur Charles Bettelheim se lamente de voir "la révolution cubaine sur la voie soviétique" (sic). Il constate, avec une méthode que sans rire il qualifie de marxiste, que la direction cubaine a engagé par un certain nombre d’erreurs, le pays sur une voie qui le conduit au capitalisme. Comme illustration de ce jugement il cite l’existence depuis quelques années d’une "alphacratie" ainsi appelée parce qu’elle bénéficie l’automobile de luxe : Alfa Roméo d’importation réservée aux cadres supérieurs et moyens les plus "méritants". Et il n’hésite pas à qualifier cette catégorie sociale de "classe privilégiée". Sa vision imprégnée d’idéologie petite bourgeoise voit la différenciation entre classes uniquement comme une différenciation dans les privilèges matériels et non pas par rapport à la place occupée vis à vis du processus de production. Ce qui le choque dans Cuba ce n’est pas tant l’exploitation qu’y subit la classe ouvrière mais le manque de liberté et l’existence de privilèges. Le prolétaire par contre ne se dresse pas tant contre les privilèges de la bourgeoisie que contre l’exploitation et l’esclavage du travail salarié qu’elle lui impose.
[3] A ce propos cf. "le Monde" du 25 Mai et le discours de Monsieur Daniel Vergara, sous-secrétaire d’État à l’intérieur qui déclare "ce ne sera pas l’impatience de quelques-uns, l’immaturité ou la conduite irréfléchie de quelques autres qui nous empêcherons de respecter le cadre légal".
[4] "Le Monde" 9-5-71 page 6.
[5] "Le Monde" 16-4-71
[6] "Le Monde" 13-4-71
[7] "Le Monde" 15-4-71
[8] "Le Monde" 27-4-71
[9] "Le Monde" 23-4-71
[10] "Le Monde" 29-5-71
[11] "Le Monde" 13-4-71
[12] "Le Monde" 14-4-71
[13] Voir la réception à Pékin do la princesse Ashraf, sœur du Shah par L. Chou-En-Laï et les déclarations des deux parties en cette occasion dans "Le Monde" 16-4-71 et 28-4-71.
[14] Le "régime frère" de Tirana, s’est montré lui, encore plus direct en établissant de .relations diplomatiques au niveau d’ambassadeurs avec la Grèce le 6 mai.
[15] Quel est donc le contenu de ce concept ? Le Pakistan fait partie des "très impérialistes" traités militaires du CENTO et de l’OTASE, aux côtés des USA. Traités auxquels l’Inde n’adhère pas.
[16] "Purisme" que la Chine dut oublier eh appuyant le Biafra aux côtés des USA, la France, du Portugal et de l’Afrique du Sud.
[17] Ces massacres arrivent après les inondations de la fin 1970 qui avaient fait un nombre comparable de morts, inondations permises par le refus des autorités d’Islamabad de construire un système de digues. Ces autorités ont toujours préféré rapatrier vers le Pakistan Occidental les devises provenant du l’exportation du jute du Bengale (premier producteur du monde), maintenant avec ce dernier des rapports typiquement colonialistes. Ces rapports s’exercent dans tous les domaines : culturel (la langue, les races et les coutumes des deux Pakistan sont complètement différents, mais le gouvernement d’Islamabad a tenté, sans succès, d’imposer au Bengali l’emploi de l'Urdu, langue dominante au Pakistan Occidental) ; sociaux (157 seulement des Bengali dans l'administration centrale, 107 dans l’armée etc...).
[18] Pour une analyse plus complète des luttes de libération nationale voir le numéro 2 de R.I., et quant au caractère impérialiste de la Chine, voir l’article ‘sur le "conflit inter-impérialiste sino-soviétique", dans le numéro 9.
Géographique:
Courants politiques:
- Maoïsme [19]
Heritage de la Gauche Communiste:
Contre l’irresponsabilité politique et la singerie petite-bourgeoise des tâches révolutionnaires pour un engagement militant
- 24 lectures
Discussion
La pratique révolutionnaire exigera de ses protagonistes des réponses aux problèmes les plus importants que les hommes n’aient jamais été amenés à se poser : comment passer du monde de l’exploitation, du besoin et de l’aliénation, à celui de la liberté. Ce jour-là, peut être beaucoup de "déçus" et "d’impatients" d’aujourd’hui, commenceront à comprendre l’importance de tous les travaux théoriques, de toutes les tentatives d’éclaircissement que les révolutionnaires auront mené à bout au cours de leur combat vers la révolution.
Depuis près de cinquante ans, la faiblesse pratique du mouvement ouvrier s’est aussi manifestée dans celle de sa théorie... et pourtant, combien de problèmes nouveaux sont surgis, que de conclusions à tirer avec le nouveau recul de l’histoire...
Contre ceux qui se sont contentés de reprendre en bloc, comme un tout sacré et intouchable, certaines théories passées (trotskisme, "bolchevisme", par exemple) sans même se soucier des critiques qui leur étaient adressées par d’autres courants révolutionnaires dès l’époque de leur formulation ; sans même se poser la question de leur validité par crainte d’hérésie et besoin de sécurité lénifiante ; contre ces adorateurs stériles le mouvement révolutionnaire est forcé de repenser, d’approfondir, d’enrichir et d’affuter celle qui sera obligatoirement son arme principale : la vision claire des buts à atteindre et des moyens pour y parvenir, sa théorie révolutionnaire.
Aujourd’hui, ce travail conditionne la possibilité de formation de véritables organisations de révolutionnaires capables de mener à bien ses taches. Contrairement à ceux qui ne conçoivent le mot théorie que comme synonyme de spéculation et élucubration gratuite, ou bien de répétition systématique de quelque texte sacré, c’est dans un but essentiellement PRATIQUE que nous nous attaquons par l’analyse et la discussion à tous les problèmes théoriques que pose la lutte de classe.
C’est dans cette perspective que nous publierons le plus souvent possible des textes de discussion. C’est dans cette vision que nous publions ce texte d’un camarade de "l’Organisation Conseilliste de Clermont-Ferrand".
***********************
En période révolutionnaire, quand le destin de millions et millions de prolétaires est en jeu, -et par là même celui de l’humanité toute entière-, toute parole, tout geste, tout acte, prennent immédiatement, à tout moment, une signification cruciale. Les communistes, orientant le mouvement vers son but au sein des organismes de la classe, doivent donner tout son contenu politique de classe à l’action née spontanément. Là, chaque explication, chaque mot d’ordre, se vérifient aussitôt dans la pratique : pour cela, les révolutionnaires, -les communistes-, doivent avoir une assurance de fer, des nerfs trempés dans l’acier pour développer clairement les objectifs socialistes contre l’opportunisme de droite, le marais centriste, et l’aventurisme. C’est par la lucidité soutenue par la passion révolutionnaire et non dominée par elle, que les éléments avancés concrétiseront leur union avec les masses, et contribueront à l’homogénéisation de la conscience de classe.
Quand l’État bourgeois est mis à nu mais qu’il dispose encore de toutes ses forces de répression et qu’il reste l’immense tâche de le détruire, quand l’heure est à la lutte armée et que le prolétariat s’est constitué en milices, les communistes doivent aider à faire tomber les masques de tous les démocrates petits-bourgeois à la menchevik, de tous ceux qui ne parlent qu’au nom de la démocratie formelle, de la liberté formelle.
Les communistes disent qu’il n’y a pas à choisir entre 36 solutions, c’est : guerre impérialiste ou guerre de classes, dictature de la bourgeoisie ou dictature du prolétariat. Il faut lutter pour l’unité du prolétariat contre tous ceux qui la placent à l’extérieur du prolétariat dans un "front unique", dans un "gouvernement" des organisations dites ouvrières comme les staliniens et consorts trotskystes. Au sein des conseils, les communistes se battront pour que "tout le pouvoir" soit à ces conseils orientés vers le socialisme, et non pas entre les mains de soi-disant représentants exécutifs coupés du mouvement réel des masses. Contre les séparations d’appareils, vestiges de l’idéologie bourgeoise, les communistes luttent pour l’autonomie du prolétariat. Le combat sera dur, âpre, farouche, sans pitié et pourtant les révolutionnaires éduqueront toujours le prolétariat dans la poursuite de ce combat jusqu’au bout; ils agiront toujours dans le sens de fortifier la conscience de classe ; comme disait Karl Liebknecht dans son dernier article intitulé "Malgré Tout", paru dans le "Rote Fahne" le jour même de sa mort :
"La révolution du prolétariat, qu’ils ont pensé noyer dans le sang, va se dresser devant eux, gigantesque ; son premier mot: à bas Ebert-Scheidemann-Noske, assassins d’ouvriers… Car Spartacus, c’est le feu et l’esprit, c’est l’âme et le cœur, c’est la volonté et l’action de la révolution prolétarienne. Et Spartacus, c’est encore toute la misère, et l’espoir de bonheur, toute la volonté de lutte du prolétariat conscient. Car Spartacus enfin, c’est le socialisme et la révolution mondiale."
Ainsi pour ces tâches gigantesques qui les attendent, les communistes doivent se préparer sans faiblir, s'efforcer d’acquérir le maximum de cohérence pendant les périodes de reflux des luttes.
Dans ces temps de contre-révolution où le prolétariat se scinde en de multiples ouvriers, individualisés, atomisés, écrasés, où règne l’idéologie bourgeoise, toute la conscience de classe doit être préservée et les révolutionnaires doivent s’employer à cette tâche.
Pour un communiste, le sérieux doit être constant, l’effort doit être régulier, Comment pourrait-il en être autrement face à un ouvrier qui travaille huit heures et plus par jour, qui subit des cadences infernales, qui doit arriver à l’heure pour pointer ? L’ouvrier qui subit l’exploitation capitaliste dans sa chair, comprend la préparation de la révolution comme quelque chose de long et de difficile : il sait que la lutte des classes n’est pas un dîner de gala ! Les communistes ne confondent pas préparation et révolution comme les petits-bourgeois. La préparation est hérissée de souffrances, d’échecs, de réflexions, de critiques : ce n’est pas une fête ! La fête c’est s’aménager un petit coin douillet au sein du capitalisme, c’est l’accepter et donc collaborer avec lui à l’abrutissement de millions d’ouvriers, c’est se satisfaire de la misère et de la survie qu’il nous accorde.
La révolution transforme peu à peu l’homme émietté en homme total : l’homme qui réalisera ses désirs au sein d’une collectivité réelle. Son processus est complexe : la première phase n’est pas non plus la fête, c’est là où la préparation trouve sa suite logique, où le prolétaire orienté par le communiste tend à prendre son destin en mains. Il y a là déjà bien sûr une immense libération mais la révolution prolétarienne étant avant tout une révolution consciente, il n’y a d’illusions à entretenir sur cette première victoire. Pendant ce passage du quantitatif au qualitatif, où l’ouvrier devient dialecticien, surgit sur la scène historique pour réaliser le socialisme, les éléments avancés doivent redoubler de travail à l’intérieur des conseils (comme nous l’avons un peu esquissé au début du texte). La deuxième phase : la fin des classes, sera une fête dans le sens où ce sera le temps démesuré des maîtres sans esclave .
Ainsi la préparation refuse le dilettantisme car celui-ci ne peut que renforcer les éléments de là contre-révolution. La préparation refuse l’éparpillement et l’activisme. Au contraire, par leur concentration et leur approfondissement de la théorie, les révolutionnaires sauvegardent les principes du communisme. Voir la nécessité de la théorie de manière constante, c’est comprendre le socialisme scientifique dans ses applications pratiques, c’est se préparer à assumer sa responsabilité historique c’est à dire à agir au plein sens du terme quand les conditions sont réunies, quand le prolétariat dans la rue réalise la théorie.
Les révolutionnaires ne font pas dogme de la théorie mais la conçoivent comme un dépassement au sein des plus grandes convulsions. Ils n’en sont pas les gardiens jaloux comme Kautsky, qui en deviennent les renégats en la figeant à la manière d’un absolu formel, idéaliste et donc inaccessible.
Pour toutes ces raisons, les communistes doivent remplir entièrement les plus petites tâches qu’ils se sont fixées. Leur engagement ne doit pas être simplement une formule creuse, que l’on répète de temps à autre pour fuir les tâches concrètes auxquelles il nous lie. Les communistes, se différencient en tout point des petits-bourgeois qui, selon le thermomètre, plus ou moins brûlant de leur révolte, mènent leur travail politique de manière irresponsable, qui selon le degré de leur impatience révolutionnaire, singent plus ou moins bien l’ensemble des tâches d’un militant sincère. Par leur lâcheté, leur faiblesse, leur fainéantise, dues au caractère de l’idéologie de la couche qu’ils représentent, ces éléments nuisent à la cohérence que cherche à atteindre une organisation révolutionnaire. Gorki a dépeint toutes leurs tares dans de nombreuses pages de ses romans et pièces de théâtre, mais quand justement ils veulent "s’engager" dans le mouvement révolutionnaire sans essayer de les corriger, -sans avoir même quelquefois le moindre soupçon de leur existence-, ces tares prennent des dimensions catastrophiques pour l’organisation, que la littérature seule ne peut pas rendre. Les vrais communistes -ceux que l’histoire "institutionnalisée" a appelé les communistes de gauche, ou Ultra-Gauche, ou Conseillistes- attachent une importance, extrême à la cohérence. Contre un Parti de Masse qui enrégimente la classe à coups de propagande tactique, ils mettent en avant la nécessité d’une organisation regroupant des éléments totalement conscients. Ils pensent que c’est la cohérence d’ensemble fondée sur une conscience commune dans les buts qui empêche de manière interne la formation de rapports hiérarchiques entre les révolutionnaires. En situation contre-révolutionnaire les structures de l’organisation subissent toutes les pressions physiques morales et idéologiques de la société de classes: aussi la cohérence qui en ressort sera pleine de rigueur et la conscience d’un militant reposera en partie sur sa volonté de lutter, de persévérer, d’apprendre sans cesse.
Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on songe aux épreuves qu’ont dut traverser les quelques groupes ouvriers communistes pour garder leur cohérence révolutionnaire pendant les 50 ans de contre-révolution stalinienne qui ont laminé le prolétariat ?
Mai 68 a marqué une importante reprise des luttes et la classe ouvrière internationale à présent (mineurs de Limbourg, des Asturies, de la Ruhr, ouvriers de Fiat et Pirelli ... et les chantiers navals de Gdansk, Gdynia, Sopot, des textiles de Lodz) recommence à ouvrir clairement la voie vers le communisme. Mais comme le dit si bien la formule, "ce n’est qu’un début” Cependant pas encore au niveau d’un combat ouvert et prolongé contre le capitalisme (ce qui est la thèse de tous les groupuscules qui ont la rage de la tactique et de la préparation militaire : de l’AJS aux maoïstes de la "Nouvelle Résistance Populaire" !), mais surtout en ce qui concerne la préparation théorique nécessaire pour orienter la spontanéité révolutionnaire qui va se révéler de plus en plus importante.
En conséquence de tout cela, une organisation révolutionnaire, -si elle entend mener à bien les tâches actuelles de préparation théorique qu’elle s’est fixées-, ne peut tolérer en aucun cas, l’introduction de mœurs petites-bourgeoises qui peuvent se camoufler en son sein sous une façade dite anti-autoritaire (en effet, le petit-bourgeois se refuse à reconnaître l’autorité et ses conséquences : hiérarchie, domination... comme un mal social et non un mal-en-soi, un mal "absolu": ainsi il se borne à la nier comme il veut nier l’État -sans chercher à comprendre d’où elle vient et surtout sans se rendre compte que par sa négation de cette réalité, il contribue en fait à renforcer cette même réalité). Ainsi si l’on commence à mal interpréter les sources de l’autorité, d’une part on fait des rêves sur une organisation toute simple où tout le monde se regarderait gentiment "en croquant la pomme", et donc on mutile consciemment chacun de sa volonté et de l’apport de ses capacités (ceci au profit d’élucubrations sur la "réalisation des désirs", sur la "transparence des rapports inter-personnels" ; comme si le refus de prendre des décisions tranchées et précises en vue d’intervenir n’était pas lui aussi une des formes de l’aliénation entretenue par la société capitaliste)- on mutile aussi en conséquence le développement réel de l’organisation pour atteindre la cohérence, qui est complexe, difficile, pleine de dépassements. (La cohérence n’est pas une planification de pensées immobiles, mais la centralisation de pensées vivantes); d’autre part on tend à nier que le communisme passe par la dictature du prolétariat puisque l’on veut immédiatement une société sans autorité. Comme dit Engels dans un texte de 1873 intitulé "De 1’Autorité" :
"Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui existe, un acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l’autre partie à l’aide de baïonnettes, de fusils, de canons, moyens autoritaires s’il en fut... ainsi donc, de deux choses l’une : ou bien les adversaires de l’autorité ne savent pas eux-mêmes ce qu’ils disent et en ce cas ils ne créent que la confusion, ou ils le savent, et dans ce cas, ils trahissent la cause du prolétariat. De toute façon, ils servent la Réaction”.
Ainsi ont fini les anarcho-syndicalistes en France, qui, ne posant pas le problème de l’autorité par rapport à la lutte de classe, contribuèrent à envoyer le prolétariat sur les charniers Européens en 1914 ; ainsi ont-ils fini en Espagne en devenant ministres de "la République" aux cotés des crapules libérales, réformistes et staliniens, c’est à dire de la bourgeoisie antifasciste.
L’organisation doit rompre avec toute forme d’idéalisme ou d’opportunisme, en remettant les illusions "anarchisantes" ou "démocratiques”, car c’est la facilité, la paresse, la médiocrité aux dépens d’une analyse matérialiste qui laisse justement la place au renforcement de l’autorité et non à son dépérissement -surtout si de plus les conditions matérielles ne sont pas entièrement mûres. Les communistes doivent sans relâche éduquer l’ensemble du prolétariat et donc s’éduquer eux-mêmes dans les moments les plus qualitatifs de la classe et non pas être de "nouveaux administrateurs" qui en fait gouvernent à la place du prolétariat pour que des Cronstadt et un "moyen âge" comme le stalinisme ne resurgisse pas en retardant la marche de l’histoire. Car comme dit Rosa Luxembourg dans son texte sur la révolution russe :
"Cette dictature doit être l’œuvre de la classe, et non pas d’une petite minorité qui dirige au nom de la classe, c’est à dire qu’elle doit être l’émanation fidèle et progressive de la participation active des masses, elle doit subir constamment leur influence directe, être soumise au contrôle de l’opinion publique dans son ensemble, émaner de l’éducation politique croissante des masses populaires".
Face aux tâches importantes et radicales que nous avons définies, tout ce qui peut favoriser ou maintenir le confusionnisme doit être écarté. Seul un engagement militant qui découle en fait d’une analyse matérialiste de la décadence du capitalisme et du rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe, nous amène à rompre avec la débilité petite-bourgeoise qui a suivi Mai 68. Il ne s’agit pas de "tirer des plans sur la Comète" en ce qui concerne les structures et les divers modes d’intervention concrètes de l’organisation des révolutionnaires ; mais nous pouvons dès maintenant nous opposer définitivement, autant à ceux qui se placent d’un point de vue de "stricte commentateurs de luttes" (comme ICO), qu’aux divagations moralisantes de ceux qui ont abandonné l’analyse marxiste et ses implications concrètes (dictature du prolétariat en particulier) au profit des recettes magiques des révoltes sexuelles, de la critique de la vie quotidienne, des rapports "authentiques” dans l’organisation, etc... (de VLR aux divers résidus situationnistes).
La lutte des travailleurs des ports polonais de la Baltique était bien plus qu’une "grève sauvage" ou qu’une "révolte spontanée" ; elle montre que les travailleurs ont conscience que l’obstacle principal au développement de leurs aspirations est l’État bourgeois et ses organes de répression. Le premier objectif fut donc la tentative de commencer sa destruction : le plus haut moment de la lutte fut l’incendie du siège du Parti au son de l'internationale, chantée par des mil1iers de travailleurs.
L’engagement militant réside avant tout dans la compréhension du processus révolutionnaire. L’organisation des révolutionnaires devra être en mesure d’expliquer clairement et de contribuer à l'accomplissement de ce processus une fois enclenché. Concentrons-nous sur ces tâches !
L’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle peut résoudre. Ainsi, pour le moment, tout le reste n’est que pipi de chat.
------------
(Texte rédigé en vue de contribuer à préciser certaines positions de l’Organisation Conseilliste de Clermont-Ferrand, et par suite comme apport à la discussion au sein du courant Ultra-Gauche.)
12 Avril 1971
Vie du CCI:
- Débat [21]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Lutte de classe en Pologne capitaliste
- 12 lectures
La révolte de la classe ouvrière polonaise en décembre 1970 est peut-être l’évènement le plus important des quarante dernières années de lutte du Prolétariat mondial. C’est au plus profond des mythes bourgeois, au mensonge qui a pesé le plus lourdement de toute l’histoire du mouvement ouvrier que le prolétariat polonais s’est victorieusement attaqué : le mythe des États dits "communistes". En 56 ou en 68, dans les pays de l’Est, le problème de l’intervention soviétique a souvent permis de noyer le mouvement ouvrier dans un amalgame nationaliste. En décembre 1970, c’est la classe ouvrière elle-même, sur des revendications strictement prolétarienne, qui a brûlé le siège du Parti soi-disant ouvrier, commençant par là à affirmer son autonomie comme classe historique et privant bourgeois et bureaucrates de toutes possibilités d’équivoque. Ce n’est évidemment pas un hasard si la lutte "anti-fasciste" de tous les "progressistes" contre ce procès de quelques nationalistes basques a reçu cent fois plus de publicité.
"Quels sont d’une façon générale les indices d’une situation révolutionnaire ? Nous sommes certains de ne pas nous tromper en indiquant les 3 principaux indices que voici :
1) Impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée ; crise du "sommet", crise de la politique de la classe dominante, et qui crée une fissure par laquelle le mécontentement et l’indignation des classes opprimées se fraient un chemin. Pour que la révolution éclate, il ne suffit pas habituellement, que "la base ne veuille plus" vivre comme auparavant, mis il importe encore que "le sommet ne puisse plus".
2) Aggravation, plus qu’à l’ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées.
3) Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l’activité des masses, qui se laissent tranquillement piller dans les périodes "pacifiques", mais qui, en période orageuse, sont poussées, tant par la crise dans son ensemble que par le "sommet" lui-même vers une action historique indépendante" LENINE "La faillite de la Ile Internationale" Tome 21 des Œuvres Complètes (Août 14-Décembre 15)
Toutes proportions gardées, les évènements qui se sont déroulés en Pologne pendant le mois de décembre paraissent illustrer à merveille cette citation de Lénine. Après les secousses sociales qu’a connu le monde capitaliste traditionnel, (Mai 68 en France, le "mai rampant" italien, etc..,) et qui continuent à l’ébranler (voir la situation sociale en Angleterre et dans les pays nordiques) c’est le tour des pays de capitalisme d’État. Même la toute puissante Russie, n’est pas à l’abri des problèmes de l’économie capitaliste : inflation, chômage, et 'après les évènements de Pologne, on peut considérer le prolétariat de ce pays comme une des fractions les plus conscientes du prolétariat mondial actuellement.
"Il importe le sommet ne puisse plus..."
"À la longue, il est difficile d’admettre des situations incorrectes" commente le journal polonais Trybuna Ludu à propos de l’opération "Vérité des "Prix" annoncée le Samedi 12 Décembre par le gouvernement Polonais. Effectivement le "bilan" de l’économie polonaise dressé par Monsieur Jaszczuk n’était pas satisfaisant : "pendant la période I956-60 l’accroissement du revenu national était en moyenne de 6,5% par an. Ce chiffre est tombé à 6,2% pendant la période I961-65 et à 5,7% pendant le plan quinquennal qui s'achève. Ces dernières années les grands travaux n’ont été réalisés que dans la proportion de 93%... Les résultats de la production agricole ont été décevant depuis deux ans." Le Monde Éditorial : "Une Population exaspérée" P; 1 (17 Déc 70)
Pour rétablir la situation économique, le gouvernement polonais décide de mettre en œuvre une politique de "vérité des prix". L’agence PAP explique ainsi les mesures prises ; "les prix précédents ne couvraient pas les coûts de production de la grande majorité des articles alimentaires et même dans certains cas ne couvraient pas le prix d’achat des produits agricoles eux-mêmes" Le Monde 15 Décembre 70.
L’économie polonaise doit se débattre dans de sérieux problèmes à en juger par le montant des augmentations : 8% pour le lait, 12% pour le pain, l4% pour le sucre et les tissus d’habillement, 16% pour la farine, 24% pour les chaussures, 33% pour le saindoux, 28 à 68% pour les matériaux de constructions. (Le Monde Diplomatique 2/1/71)
A ces augmentations, s’ajoutent encore les mesures de rationalisation prises dans certaines entreprises qui doivent augmenter le rendement des ouvriers et diminuer les primes. (Le Monde Diplomatique 2/1/7I)
Nous sommes ici en présence d’une de des "crises du sommet, de la politique de la classe dominante et qui crée une fissure par laquelle le mécontentement et l’indignation des classes opprimées se fraient un chemin".
"AGGRAVATION, PLUS FORTE QUE D’HABITUDE DE LA MISERE ET DE LA DETRESSE DES CLASSES OPPRIMEES."
"Même avant la dernière hausse des prix, le salaire moyen était insuffisant pour couvrir les besoins les plus élémentaires": (Le Monde Diplomatique 2/l/7l)
Déjà avant cette mesure, les travailleurs polonais pratiquaient le "second emploi", non déclaré et qui permettait de vivre un peu mieux.
N’ayant aucun stimulant, mal payé, l’ouvrier polonais tout comme l’ouvrier russe pratique une "grève perlée" en permanence. Un dirigeant se plaignait récemment que les travailleurs viennent se reposer à leur travail officiel, reconstituant leurs forces pour un deuxième emploi... "noir".
Les hausses de prix, touchant à des produits de toute première nécessité viennent réduire un niveau de vie déjà très bas, Elles ont pour conséquences de réduire le minimum vital social à un point qui n’est plus accepté par le prolétariat. Cette hausse de prix annoncée quelques jours avant Noël -ce qui provoque une colère encore plus intense- aura pour résultat les évènements que l’on sait.
"Ceux d’en bas, ne veulent plus vivre, comme auparavant".
La réaction de la classe ouvrière ne se fait pas attendre, et c’est dès le Lundi matin 14 Décembre que les ouvriers des chantiers navals de Gdansk se mettent en grève, se rassemblent en manifestation .dans les rues pour aller devant le siège du comité de région du parti.
Rapidement des heurts éclatent avec les forces de l’ordre ; une vague "d’émeutes" déferle sur les trois ports de la Baltique : Gdansk, Gdynia et Stettin.
Ce qui dans un pays capitaliste traditionnel se serait soldé par des conversations, des accords entre patronat et "représentants des ouvriers" (syndicats), prend de suite en Pologne un caractère violent et explosif. Dans les pays de l’Est, il n’existe aucun "amortisseur" entre exploiteurs et exploités.
Dans les sociétés capitalistes traditionnelles l’existence de syndicats, intermédiaires en apparence autonomes, jouissant encore d’une certaine crédibilité aux yeux de la classe ouvrière, amortit dans la plupart des cas cette violence latente.
Le prolétariat, n'a pas perdu de temps, et a de suite affronté ses ennemis et ses organes. Dans l'économie capitaliste traditionnelle, du fait de la multiplicité des usines et des patrons indépendants, du fait que les rênes de l'économie se trouvent éparpillés parmi la classe bourgeoise, les ouvriers ne voient qu'après plusieurs luttes l'ennemi global à attaquer. Nous voyons apparaître d’abord des conflits localisés au niveau des usines, et c’est seulement dans le cas d’une crise plus profonde, donc d’un mécontentement accru, que l’État, et l’ENSEMBLE de la classe dominante sont mis en cause. (Confère tous les conflits parcellaires et localisés pendant l'année 67-68 qui aboutissent à Mai 68 en France).
En Pologne, le conflit se pose de façon plus crue et plus directe. Il n’y a pas à s’y tromper. Ce n’est pas le patron local qui est mis en cause, car celui-ci n'existe pas, ou bien n'est que le représentant direct, l’exécutant des ordres du pouvoir central.
Toute lutte ou revendication met donc directement en cause le gérant de l’économie : l'ETAT, LE PARTI. C’est ainsi que la foule ne se donne pas 36 buts, mais un : le siège du comité du parti.
Le capitalisme d’État
En Pologne "socialiste" il est clair que les moyens de production, étant nationalisés, sont la propriété de l’État. Ils sont donc contrôlés, dirigés par la couche qui détient le pouvoir d’État, dans ce cas, le Parti Ouvrier Unifié Polonais.
- "... Les dirigeants de la bureaucratie se considèrent être les représentants des intérêts de la classe ouvrière. Si nous voulons apprécier le système non d’après les déclarations de ses dirigeants, mais d’après les faits tels qu’ils sont, nous devons analyser la nature de classe de la bureaucratie. Le fait qu'elle exerce le pouvoir ne préjuge pas de sa nature de classe et ne l’explique pas de façon satisfaisante. Ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les rapports de production. Nous devons donc examiner le processus de production et les rapports dans lesquels entrent d’une part la classe ouvrière, créatrice de base du revenu national et d’autre part la bureaucratie politique centrale, détentrice des moyens de production." - "Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais"[1] page7, Kuron et Modzelewski
La bureaucratie
"Comme dans tout appareil hiérarchisé, à l’origine des ordres, se trouve une élite, un groupe de gens occupant dans la hiérarchie des postes de responsabilité et qui élaborent ensemble des décisions fondamentales. Dans notre système, l’élite du parti est en même temps l'élite gouvernementale. Les décisions du pouvoir d’État sont prises par elle, et au sommet des échelles hiérarchiques du Parti et de l’État on remarque généralement le cumul des postes. Exerçant le pouvoir dans l’État, cette hiérarchie dispose de l’ensemble des moyens de production nationalisés, décide de l’importance relative de la consommation et de l’accumulation des investissements dans les secteurs de son choix, de la part de .chaque groupe social dans la consommation du revenu national, bref de la répartition et de l’emploi de la totalité du produit social. Les décisions de l’élite sont indépendantes et libres de tout contrôle de la part de la classe ouvrière et du reste de la société." Kuron et Modzelewski page 6
Derrière chaque entreprise différente, se cache le propriétaire unique des moyens de production : l’ETAT.
Ne disposant pas des moyens de production, l’ouvrier polonais, tout comme l’ouvrier français ou américain, doit, pour survivre vendre la seule chose qu'il possède ; sa force de travail.
"À qui l’ouvrier vend-il sa force de travail dans notre pays ? A ceux qui disposent des moyens de production, donc à la bureaucratie politique centrale. A ce titre, la bureaucratie politique centrale est une classe dominante : elle a le pouvoir exclusif sur les moyens de production de base, elle achète la force de travail de la classe ouvrière, elle lui prend par la force brutale et la contrainte économique le surproduit qu’elle exploite pour des objectifs hostiles ou étrangers aux ouvriers c’est-à-dire dans le but de renforcer et d’élargir son pouvoir sur la production et la société. Et, ceci est, dans notre système, le type prépondérant des rapports de propriété, la base des rapports de production et des relations sociales."
Mais... argumentent les Trotskystes :
"La bureaucratie soviétique a politiquement exproprié le prolétariat pour défendre par ses propres méthodes les conquêtes sociales du prolétariat. Mais le fait même qu’elle se soit appropriée le pouvoir dans un pays où les moyens de production les plus importants appartiennent à l’État, crée entre elle et les richesses de la nation des rapports entièrement nouveaux. Les moyens de production appartiennent à l’État. L’État "appartient" en quelque sorte à la bureaucratie. Si ces rapports encore tout-à-fait récents, se stabilisaient, se légalisaient, devenaient normaux sans résistance ou contre la résistance des travailleurs, ils finiraient par la liquidation complète des conquêtes de la révolution prolétarienne. Mais cette hypothèse est encore prématurée. Le prolétariat n’a pas encore dit son dernier mot. La bureaucratie n’a pas créé de base sociale à sa domination sous la forme de conditions particulières de propriété. Elle est obligée de défendre la propriété de l’État source de son pouvoir et de ses revenus. Par cet aspect de son activité, elle demeure l’instrument de la dictature du prolétariat."[2] Trotski "La Révolution trahie" page 250 - Edition 10-18
Trotsky aurait dû tout d'abord se poser la question de savoir comment il est possible qu'une couche exproprie une autre, pour ensuite défendre les "conquêtes sociales" de la classe qu'elle vient d'exproprier,
Assurément, l'histoire ne nous a jamais donné l’exemple de semblables péripéties. Mais passons là-dessus pour analyser le dernier argument -au fond, le plus important.
Trotsky nous dit que "la bureaucratie n'a pas créée de base sociale à sa domination sous la forme de conditions particulières de propriété ". Il entend par là que juridiquement elle ne s'est pas accordé la propriété privée individualisée, transmissible, par vente ou par héritage... etc.
Trotsky, considère, ici, comme dans tous ses écrits, au sujet de l'URSS, que la propriété privée individualisée est un des caractères intrinsèques du capitalisme. Trotsky oublie que "propriété privée" a d’abord et avant tout le sens de propriété privée à autrui. Sous le capitalisme, il y a propriété privée des moyens de production (et c’est cela qui caractérise le système, c'est cela qui est à la BASE de toutes les contradictions du capitalisme) c'est en ce sens que les travailleurs n’ont pas accès à ces moyens de production, qu'ils sont PRIVÉS de tout contrôle sur eux, et en conséquence de tout contrôle et décision sur la production, et le produit social.
C’est parce que le travailleur est SÉPARÉ de ses moyens de production et donc du produit de son travail qu’il est aliéné ; c’est pour cela qu’il est obligé de vendre sa force de travail.
Lorsque Trotsky envisage l’économie russe, il confond la transformation formelle opérée dans les RAPPORTS DE PROPRIÉTÉ, avec une transformation des RAPPORTS DE PRODUCTION. ("La nationalisation du sol, des moyens de production, des transports et des échanges, et aussi le monopole des moyens de production forme les bases de la société soviétique. Et", cet acquis de la revoltuion prolétarienne définit à nos yeux l'URSS comme un état prolétarien").
Cette confusion est à la base de toutes les erreurs de la conception trotskyste.
Se trouvant face à un état de choses qu’il critique ardemment, et n’ayant pu se libérer de cette erreur théorique, Trotsky tombe, dans la confusion la plus totale, dans des analyses aberrantes du point de vue marxiste.
D’un côté, Trotsky voit la situation en Russie lucidement : ''Le passage des usines à l’État n’a changé que la situation, juridique de 1!ouvrier", d’un autre côté, il parle : d’"État ouvrier dégénéré" (caractérisation politique imprécise ; un État qui a été "ouvrier" mais qui ne l’est plus ? Qui l’est encore "un peu" ?), et de rapports de production (identiques pour lui à des rapports de propriété) "socialistes" avec parallèlement une distribution bourgeoise, ce qui comme l’a démontré Marx dans sa critique de l’économie politique bourgeoise, n’a aucun sens réel.
"Les rapports et les modes de distribution apparaissent donc simplement comme l’envers des agents de production. Un individu qui participe à une production sous la forme du travail salarié participe sous la' forme du salaire à la répartition des produits, résultats de la production. La structure de la distribution est entièrement déterminés par la structure de la production. La distribution est elle-même un produit de la production non seulement en ce qui concerne l’objet, le résultat de la production seul pouvant être distribué, mais aussi, en ce qui concerne la forme, le mode précis de participation à la production déterminant les formes particulières de la distribution;...
... dans sa conception la plus banale,(c’est celle à laquelle, il faut le penser, se rallient les trotskystes) la distribution apparaît comme distribution des produits , et ainsi comme plus éloignée de la production et pour ainsi dire indépendante de celle-ci. Mais avant d’être distribution des produits. Elle est une distribution des instruments de production, et deuxièmement, ce qui est une autre détermination du même rapport, distribution des membres de la société entre les différents genres de production (Subordination des individus à des rapports de production détermines). La distribution des produits n’est manifestement que le résultat de cette distribution, qui est incluse dans le procès de production lui-même et détermine la structure de la production : considérer la production, sans tenir compte de cette distribution qui est incluse en elle, ç’est manifestement une abstraction, vide alors qu’au contraire la distribution des produits est impliquée par cette distribution, qui constitue à l’origine un facteur même de la production (souligné par nous), Marx - "Introduction à la Critique de 1’Economie Politique" Ed. Soc. page 160-161.
Le trotskyste Mandel[3](I) a beau prétendre que l’idée d’une telle "loi de correspondance" entre mode de production et mode de distribution est une "conception mécaniciste" qui "est peut-être un produit du stalinisme, mais certainement pas un produit de Marx", il n’empêche que l’idée de Marx à ce sujet est particulièrement sans équivoque. Mandel ne critique peut-être que la volonté de vouloir la considérer valable "partout et toujours" ?[4] (2) Il n’empêche que Marx est très clair à ce sujet. C’est bel et bien de production, de consommation et de distribution au sens général du terme que Marx parle. Même dans l’extrait ci-dessus, quand il parle de salariat, ce n’est que pour citer un exemple parmi d’autres. C’est bien une loi générale que Marx met en évidence.
Les pirouettes théoriques de Mandel pour se réclamer de Marx tout en défendant de telles aberrations, utilisant "d’importantes considérations" du style de la "tendance foncièrement égalitaire" de la planification -en soi- ne peuvent se comprendre que dans un souci de maintenir la vielle mystification du caractère prolétarien du capitalisme d’État. "C’est un problème de direction". Si nous étions à la tête de cette même économie (soviétique) ce serait socialiste etc...
Déjà Marx, entrevoyait théoriquement, la possibilité d’un CAPITALISME "à la Russe".
"Dans une société donnée, elle (la centralisation), n’aurait atteint la dernière limite qu’au moment où le CAPITAL NATIONAL TOUT ENTIER ne formerait plus qu’un seul capital entre les mains d’un seul capitaliste ou d’une seule compagnie de capitalistes". MARX "Le Capital" Livre I, page 1139 Éditions de la Pléiade, tome I
L’URSS n’est pas le premier exemple dans l’histoire d’une société divisée en classes, sous la couverture d’une propriété qualifiée "juridiquement" de collective ou communiste. Le despotisme oriental ou système asiatique nous donne le premier exemple d’une telle organisation sociale ; juridiquement, nous sommes en communisme primitif ; dans les faits, c’est la caste détenant le pouvoir d’État qui est une classe dominante et exploite le reste de la société.
Du point de vue du prolétariat, le fait que les moyens de production soient concentrés dans les mains de l’État, ou bien éparpillés entre les mains de différents capitalistes, ne change aucunement les choses. Et, c’est pour cette raison, que la polémique avec les trotskystes, loin d’être simplement une question académique, ou intellectuelle -devient dans la réalité, une frontière de classe.
De leur analyse, Trotsky et ses épigones tirent la conclusion "qu’après la révolution politique, après le renversement de la bureaucratie, le prolétariat aurait à accomplir dans l’économie de très importantes réformes. IL N’AURAIT PAS A FAIRE UNE NOUVELLE REVOLUTION SOCIALE".
"La Révolution trahie" page 255 et aux épigones de crier après les évènements de Pologne : "Révolution politique car en Pologne, le capitalisme a été exproprié, l’État bourgeois détruit, les moyens de production collectivisés". "Information Ouvrière" n° 505. ;
C’est là entretenir une mystification de plus.
En Pologne, comme en URSS, comme dans les pays du capitalisme occidental, le prolétariat sera affronté aux mêmes tâches, aux mêmes problèmes :
- Destruction de l’État bourgeois et son remplacement par les organes de la dictature du prolétariat : les conseils ouvriers ;
- Transformation des rapports de production, création d’une économie où les travailleurs ne seront plus séparés des moyens de production : abolition de l’exploitation, abolition du salariat ;
- Transformation du BUT de la production ; la production en vue de l'accumulation, et de la production de valeur d’échange sera transformée en vue de créer des VALEURS D’USAGE destinées à satisfaire les besoins des hommes.
La révolution est sociale, donc économique et politique à l'Est comme à l’Ouest. En parodiant Marx excédé par la vision parcellaire et donc réactionnaire de Proudhon qui veut séparer le politique du social nous disons aux trotskystes "ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement économique. Il n’y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps".
Une bévue telle que celle d’envisager une séparation entre l’économique et le politique trouverait à la rigueur une explication (non, une justification) dans une économie libérale du XIXe siècle où la bourgeoisie privée "oppose farouchement à l’intervention économique de l’État dans ses affaires. Elle devient une pure aberration lorsqu’il s'agit d’une économie de type "soviétique" où la fusion économique et politique est parfaite jusqu’à se formaliser dans un parti unique détenant tous les pouvoirs. Parler alors de révolution politique et non économique ne peut s’expliquer que par le souci de défendre le type d’exploitation étatique, le capitalisme d’ETAT, justement celui auquel le prolétariat polonais s’est attaqué, lui payant du prix de centaines de ses morts les quelques revendications économiques qu’il a pu arracher.
La classe ouvrière
Dans le système de capitalisme d’État, la majeure partie des moyens de production sont nationalisés. Ils "appartiennent" tous à un même propriétaire : l’État. En ce sens, les "ventes" ou "achats" d’une branche à une autre, sont en réalité, simplement des "transferts" de même type que ceux, qui s’effectueraient dans une concentration verticale, en France par exemple.
Il y a une seule chose que la bureaucratie doit ACHETER véritablement : c’est la force de travail. Seule marchandise qui ne lui "appartient" pas, elle est achetée à sa valeur :
- "... le salaire dans notre pays correspond au minimum vital du moment, autrement dit, le salaire donne seulement à l’ouvrier dans la distribution du revenu national, la part qui lui est absolument nécessaire pour vivre et élever ses enfants, donc pour reproduite sa propre force de travail et préparer de nouveaux ouvriers pour l’industrie.
Le salaire est donc uniquement une composante des frais de production aussi indispensable que les dépenses en matières premières et en machines.." Kuron et Modzelewski page 12-13
L’ouvrier dispose en général d’un logement d’État qu’il paye très peu, c’est-à-dire qu’il utilise en grande partie gratuitement : mais il faut bien qu’il habite quelque part pour vivre et produire ; son appartement n’a rien de luxueux, et le plus souvent manque du confort le plus élémentaire. Il est une des composantes de son minimum vital qui lui est assuré en plus de son salaire.
L’ouvrier bénéficie de soins médicaux gratuit et de réductions sur le prix des médicaments : il doit être soigné pour entretenir sa capacité de travail. Les services médicaux gratuits et les médicaments à prix réduit sont encore des composantes de son minimum vital. Si l’on supprimait la gratuité des soins médicaux, si l’on élevait les loyers, et les charges au niveau de la rentabilité de la construction et de l’entretien des immeubles, le salaire devrait s’élever d’autant... Ces charges et services gratuits sont pour l’ouvrier une partie indispensable de son minimum vital, un complément à son salaire aussi nécessaire que le salaire lui-même. Ils entrent donc dans les frais de production
De même qu’en France ou dans les autres pays "occidentaux", la forme de travail en Pologne est la seule marchandise qui est capable de créer plus de valeur, qu’elle ne vaut. Le surproduit créé par la classe ouvrière est approprié par celui qui achète la force de travail : l’État.
- "En I962, un travailleur de l’industrie a créé en moyenne, un produit de valeur nette de 71.000 zlotys, dont il a obtenu sous forme de salaire 22.000 zlotys en moyenne. Autrement dit, pendant un tiers de la journée de travail, l’ouvrier produit son propre minimum vital et durant les deux autres tiers, il crée le surproduit". Kuron et Modzelewski.
Le fait que l’acheteur de la force de travail soit unique et que le régime soit totalitaire ne peut que rendre plus féroce les conditions d’exploitation.
Le but de classe de la production
De même que le but social de la production détermine le rôle social des classes dominantes :
"Chaque classe dominante détermine le but de la production sociale. Elle le fait évidemment dans son propre intérêt de classe, c’est-à-dire avec le souci de fortifier et élargir sa domination sur la production et la société.
La position d’un capitaliste individuel (d’une société anonyme, d’un monopole, etc.…) dans la société dépend de l’importance de son capital, de même que la position internationale de toute la classe capitaliste d’un pays donné dépend de l’importance du capital national. Car le capital est la forme actuelle de domination sur le travail et son produit. Ainsi la préoccupation constante d’un capitaliste sera l’élargissement donc l’accumulation de son capital. En fait, il est l’expression de son capital et de sa tendance à "l’expansion", La seule puissance matérielle de la bureaucratie, son champ de domination sur la production, sa position internationale (facteur très important pour une classe qui s’organise comme un groupe s’identifiant avec l’État), dépendent, de l’importance du capital national.
La bureaucratie tend donc à l’élargir, à étendre l’appareil de production et d’accumulation. Elle est l’expression du capital national, au même titre qu’un capitaliste le serait de son capital individuel.
Quel est le but de classe atteint par la bureaucratie au travers du processus de production ou en d’autres termes quel est le but de classe de la production ? Ce n’est pas le bénéfice de l’entreprise mais le surproduit à l’échelle de toute l’économie nationale. Et elle fournit les sources de l’accumulation ainsi que de toute dépense destinée au maintien et à l’affermissement de la domination de classe de la bureaucratie."
Qu’est-ce que le surproduit ? Il est constitué par la différence entre ce qui est avancé et ce qui est créé.
Il peut provenir en partie d’un échange inégal entre par exemple : les biens que l’état vend aux paysans et ceux qu’il obtient en contrepartie.
Dans la mesure où la petite propriété individuelle subsiste à la campagne, et que ces paysans ont besoin de s’approvisionner en moyens de production industriels, ils adressent à l’État où à ses organes une demande. L’État étant le vendeur monopoliste de tels biens, fixe ses prix de façon à pouvoir titrer un avantage de l’échange.
Le surproduit peut provenir aussi d’un échange inégal entre pays. Mais nous pouvons éliminer ici cette hypothèse car ce n'est certainement pas la Pologne, qui va tirer un bénéfice quelconque de ses échanges avec l’URSS c’est plutôt le cas inverse qui se produit.
Le surproduit provient d’abord et avant tout du surtravail de la classe ouvrière.
Le travail non payé de celle-ci est approprié par la bureaucratie et constitue la principale source d’accumulation, des salaires des travailleurs improductifs, du maintien de l’appareil policier, etc....
La classe ouvrière n’a aucun mot à dire quant à la façon dont cette partie du produit créé par elle est employée. Le travailleur est aussi aliéné par rapport à son travail et par rapport à son produit que dans n’importe quel autre pays.
L’importance des événements de Pologne.
Il est dans l’intérêt de la bourgeoisie mondiale (soit privée, ou bureaucratique) de maintenir la mystification au sujet du partage du monde entre deux types de sociétés opposées : d’un côté le capitalisme (qui LUI est libéral, démocratique, respecte les libertés individuelles, etc…) de l’autre de "socialisme” qui LUI est planifié, qui soutient les luttes pour l’émancipation des peuples frères, qui a aboli le capitalisme, etc…) Ce partage en deux "mondes”, deux types de société, (l’enfer étant toujours l’autre) est soigneusement entretenu par la classe dominante en vue de mieux consolider son pouvoir.
Un des aspects importants des évènements qui se sont déroulés en Pologne pendant les mois de Décembre 70, et suivants, c’est justement le fait qu’ils apportent encore une fois un démenti à cette thèse. Après les grèves allemandes de 53, la révolte hongroise et polonaise de 56, sans citer les revendications des intellectuels, des étudiants, etc.... les ''évènements de la Baltique" viennent avec une force, et une clarté encore jamais vue proclamer que la lutte du prolétariat est la MEME à l’Est et à l’Ouest.
Après avoir démarré sur un objectif strictement économique -maintien du prix de la force de travail ; maintien du taux d’exploitation- la grève se prolonge en revotant souvent, par la forme d’organisation aussi bien que par le contenu des revendications, un caractère extrêmement radical.
Les formes d’organisation et d’action
Le journal Berlinois "883" publia en janvier, un témoignage qui lui était parvenu de Pologne et qui signale qu’à Stettin :
"La grève s’étendait dans toute la ville, mais c’était une grève spéciale. Les employés du gaz et de l’électricité ne coupaient le gaz et l'électricité que dans les quartiers où habitaient les flics et les "pontes" du parti et non dans le port et les quartiers populaires. En même temps les vendeurs les magasins apportaient gratuitement de la nourriture aux ouvriers. L’essence était gratuitement donnée pour la fabrication de cocktails molotov".
Le mouvement polonais ne fut pas un "éclat" sans suite. Des arrêts de travail et des grèves se sont poursuivis ci-et-là pendant les mois de janvier et février.
Souvent, (cf. le Monde du 1er février) comme à Gdansk, les ouvriers s’arrêtaient de travailler une heure ou deux pour appuyer leurs revendications où élaborer davantage leurs "cahiers de doléances". C’est le cas aux chantiers navals de Szczecin, où, pour calmer l’agitation Gierek vint en personne dialoguer avec les travailleurs.
Ailleurs, comme à Lodz, centre textile polonais., "plusieurs milliers d’ouvrières ont cessé le travail dans sept grandes usines."(Le Monde 1er février 1971).
Dès le 13 janvier "le Monde" dans un article intitulé : "la direction du Parti sollicite le concours des conseils ouvriers qui avaient cessé toute activité depuis 1958 écrit : pour la première fois depuis 1958, le secrétaire du comité central, a envoyé une circulaire aux conseils ouvriers afin de leur expliquer les problèmes sociaux qui se posent dans le pays."
Que sont ces "conseils ouvriers" ? Ce terme de conseil, traduction française de "Soviet" désigne en général une assemblée d’ouvriers, de paysans ou de soldats dont le tout est de diriger ou contrôler telle ou telle activité. Chaque fois que la classe ouvrière est rentrée en lutte ouverte avec le capitalisme de tels organes sont apparus. Exerçant parfois un pouvoir parallèle à l’État officiel pour devenir les organes de la dictature du prolétariat par la suite (Russie 17), (en d’autres cas, ces conseils se sont sabordés eux-mêmes en donnant leurs pouvoirs à un gouvernement bourgeois (Allemagne 1919).
Apparus en Hongrie et en Pologne en 1956, ce furent ces organes populaires qui portèrent Gomulka au pouvoir qui en 1958 les interdit.
Aujourd'hui en Pologne, le gouvernement Gierek parle à nouveau de conseils ouvriers, demande leur collaboration.
Il semblerait donc qu’il y ait deux types de "conseils ouvriers".
D’une part, les "conseils ouvriers" officiels que le gouvernement a essayé de faire revivre comme organes "participationnistes" pour reprendre le contrôle de la situation. D’autre part, face à ces courroies de transmission du pouvoir, le prolétariat aurait constitué des "comités ouvriers" grâce auxquels il a mené sa lutte de façon indépendante et généralisant les revendications économiques pour les traduire immédiatement en termes politiques.
Les travailleurs "... dénoncent les méthodes du pouvoir et réclament un bouleversement des structures existantes : notation des cadres du parti, information libre et complète pour tous, exercices d’une démocratie réelle, autonomie des syndicats" (L’Express).
Dénonçant dans le sang la nature capitaliste des régimes des pays de l’Est, la classe ouvrière polonaise a donné deux enseignements précieux au reste du prolétariat mondial.
D’une part, elle détruisait un mythe, de l’autre, elle montrait le chemin à suivre dans la lutte.
Les réformes "efficaces" de Gierek, les accords avec l’Église et l’argent de Moscou peuvent peut-être momentanément rétablir la paix sociale que nécessite le capital polonais. Ils ne pourront cependant jamais éliminer le dernier acquis essentiel du prolétariat polonais : sa conscience de classe, sa confiance en lui-même. Bien sur le régime n’a pas été détruit. Le capitalisme d’État et le pouvoir bureaucratique sont restés sur pied malgré la secousse. La classe ouvrière ne pouvait pas réellement, par manque de force, d’expérience et de conscience, abolir d’un coup le système existant et apporter sa propre solution définitive. Elle a encore exigé (et donc attendu) de lui une solution. Mais les moyens qu’elle a utilisés ont été l’annonce d’une nouvelle étape de la lutte.
Les révolutions ne sont jamais un éclat victorieux et définitif du premier coup. Elles sont le processus d’une série de tentatives, de défaites, de bonds à travers lesquels, d’étapes en étapes, la classe révolutionnaire se prépare à l’affrontement final.
Le décembre 70 polonais ne constitue pas seulement une expérience "polonaise". Il est un moment de la lutte et du réveil actuel du prolétariat mondial. Ce n’est plus l’isolement international de 1956. En décembre 70 le prolétariat polonais était la véritable avant-garde du prolétariat mondial, ce même prolétariat qui avait déjà fait Mai 68, l’été chaud italien, qui a couvert l’Angleterre et la Scandinavie de grèves sauvages, le même qui fait trembler tous les régimes du monde.
"Les révolutions prolétariennes se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d’elles, reculent constamment à nouveau devant l’immensité infinie de leurs propres buts, jusqu’à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière, et que les circonstances elles-mêmes crient : Hic Rodus, hic Salta. C’est ici qu’est la rose, c’est ici qu’il faut danser". Marx "18 Brumaire".
La bourgeoisie elle-même ne se trompe pas lorsqu’elle écrit dans 1’Express :
"le décembre polonais, profondément prolétarien est peut-être à long terme plus dangereux : (que l’explosion de 56, ou que le printemps de Prague) car il pourrait facilement gagner la réalité soviétique ou Est Allemand (...) Certaines revendications des ouvriers polonais (...) pourraient fort bien être reprises par les salariés de Tour ou de Nantes."
Parfois la bourgeoisie parvient même à entrevoir que la lutte du prolétariat est une lutte mondiale. C’était l’essentiel à comprendre des évènements de Décembre70 en Pologne.
[1] Nous citerons fréquemment la "lettre ouverte au-Parti Ouvrier Polonais" de Kuron et Modzelewski. Son intérêt évident réside dans le fait que ces auteurs analysent en révolutionnaires la société qu’ils combattent, se montrant par là une première expression théorique de ce que la classe ouvrière commençait à mettre en pratique et dont Décembre 70 marque une étape fondamentale . Ils ne pouvaient que retrouver partiellement les analyses des révolutionnaires européens de "l’ultra gauche" qui dénonçaient la nature capitaliste des pays de l’Est, Kuron et Modzelewski parlent bien de CAPITAL et de régime d’EXPLOITATION de classes » Malgré certaines critiques que nous pouvons émettre quant à une partie de leur première tentative en ce sens, nous nous efforcerons donc d’utiliser leur propre point de vue pour comprendre la nature des évènements de Décembre 70.
[2] Nous reprenions ici un texte qui à été écrit à propos de l’Union Soviétique, et nous appliquons cette argumentation de Trotsky à la Pologne et aux autres démocraties populaires car ces arguments sont repris par certains trotskystes actuels ("Information Ouvrière" et " Rouge") à propos de ces pays.
[3] (I) Un des principaux représentants de la Quatrième Internationale, économiste belge.
[4] (2) In "Quatrième Internationale" Septembre 70.
Géographique:
- Pologne [24]
Rubrique:
Révolution Internationale - 1972
- 94 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale (ancienne série) N°6 - janvier-février
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 581.84 Ko | |
| 13.84 Ko |
- 30 lectures
La crise (allons-nous vers un nouveau 29 ?) - (I)
- 21 lectures
- "Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue." -Richard Nixon[1]
Nous constations dans notre précédent numéro "qu'il est des époques où l'histoire semble s’accélérer" et que, "depuis quelques années on assiste à un tel phénomène"[2].
Depuis juillet 1971, où nous écrivions ces lignes, l'actualité, poursuivant sa marche mouvementée, nous a gratifiés encore de l'annonce de la visite de Nixon à Mao, "du discours du 15 Août", de l'entrée de la Chine à l'O.N.U., de la guerre indo-pakistanaise et des récents accords de Washington qui entérinent la dévaluation du dollar. Même s'il n'y avait que ces événements successifs, le bilan de ces derniers mois serait déjà impressionnant, mais cette période se distingue encore par une "activité diplomatique" dont l'intensité ne s'était pas vue depuis l'immédiat avant-guerre de 1939 (nous ne citerons pas ici tous les déplacements de-* chefs d’Etats : la liste en est trop longue), et surtout parce que nous pourrions appeler " la grande peur" de la bourgeoisie mondiale. En effet, ces derniers mois, une interrogation angoissée a parcouru pratiquement tous les organes de la presse bourgeoise :
-"ALLONS-NOUS VERS UN NOUVEAU 29 ?"[3]
Si, à notre tour, nous posons la question, ce n'est certainement pas pour tenter de prendre place aux cotés de ces différents commentateurs de l'actualité, universitaires appointés par les diverses fractions de la bourgeoisie, mais bien parce que nous pensons, comme Marx et comme tous les révolutionnaires conséquents, "qu’une nouvelle révolution ne sera possible qu’à la suite d’une nouvelle crise"[4]. Pour nous, donc, les perspectives de la situation économique actuelle conditionnent d’une façon fondamentale la lutte prolétarienne des années futures et par suite la prévision de celle-ci implique la connaissance de celles-là.
Deux grands phénomènes dominent la situation actuelle de l'économie mondiale : la crise du dollar et la récession dont la moindre manifestation n’est pas l'augmentation du nombre de chômeurs qui a, d’ores et déjà, dépassé les dix millions pour les pays développés.
La crise et la dévaluation du dollar revêtent une importance considérable sans aucun rapport avec les dévaluations qui peuvent toucher les petites nations, et en particulier celles du tiers-monde, do manière quelquefois chronique. Ainsi, les dévaluations successives qui ont touché, ces dernières années, le peso uruguayen reflétaient la situation catastrophique de l’économie de ce pays, mais n’avaient aucune incidence sur la situation internationale. Par contre, la dévaluation du dollar exprime des difficultés qui ne touchent, ou ne toucheront pas, que les; Etats-Unis seuls :
- d’abord parce que cette dévaluation a lieu dans un pays qui produit 40% de la richesse mondiale et qui fait 20% du commerce international .
- ensuite, parce qu’une telle mesure n'a pas eu lieu depuis 1934 en pleine époque de la "grande dépression".
- parce que le dollar était considéré comme l’équivalent de l’or (Gold Exchange Standard), faisant usage de monnaie universelle ;
- enfin, parce que cette mesure vient après la dévaluation do deux autres monnaies majeures : la livre en 196?, le franc en 1969, ce qui traduit bien un malaise à l’échelle internationale.
Los thuriféraires du capital, les Rueff, les Barre, les Galbraith et Samuelson rivalisent d’ingéniosité pour trouver les "moyens techniques" de dénouer cette crise du dollar, "oubliant" de prendre en compte l’autre phénomène, la récession, dans leur analyse de la situation. Pour les économistes bourgeois il existe 4es problèmes monétaires qui doivent trouver une solution sur le plan monétaire et des "variations de la conjoncture" qu'on regarde faire en attendant des jours meilleurs. Cette vision parcellaire et étroite de la situation leur est dictée par l’alliance qu’ils ont contractée avec le capital ; une plus grande lucidité et une vue globale des choses leur donneraient le vertige puisqu’elles leur feraient apparaître le gouffre des contradictions insolubles au-dessus duquel est suspendu leur cher mode de production capitaliste.
Pour notre part, n'ayant pas de tels problèmes affectifs à résoudre, nous tenterons de déterminer les causes profondes qui sont à la base de ces deux phénomènes la crise et la dévaluation du dollar et la récession pour en révéler l’unité et dégager les perspectives immédiates et plus lointaines de l'humanité.
POURQUOI LA DEVALUATION DU DOLLAR ?
A cette question, Nixon s'empresse de -répondre, le 15 Août: "à cause des méchants spéculateurs acharnés à la perte de notre monnaie", et il s’empresse de prendre toute une série de mesures qui contredisent une telle vision simpliste[5]
Si on veut échapper à un tel simplisme, est utile de faire précéder toute réponse à cette question par quelques remarques sur la monnaie et son rôle dans l'économie.
Historiquement, la monnaie est apparue quand le simple troc s'est révélé trop rigide pour permettre les échanges entre les producteurs. A l'origine de toutes les sociétés marchandes on a vu apparaître et se singulariser une marchandise particulière ne se distinguant en rien des autres sinon qu’elle peut être utilisée par la quasi-totalité des membres de la société et que sa valeur d’usage se conserve dans le temps. Cette 'marchandise devient un équivalent général de la valeur reconnu par tous: tout vendeur est tenu d’accepter cette marchandise particulière en échange de ses produits et a la certitude qu'avec cette marchandise il pourra acquérir tous les biens nécessaires à sa consommation.
Cet équivalent général de la valeur, qui peut prendre des formes multiples suivant les sociétés (bétail, sel, dates, sucre, tabac, peaux d’animaux, ivoire, métaux précieux,.. .et billets de papier convertibles en monnaie métallique auprès des instituts d'émission) se caractérise par trois fonctions essentielles :
- il est un moyen d'échange général officiellement reconnu. En place du troc, les échangés suivent maintenant le schéma : marchandise A contre monnaie, monnaie contre marchandise B ;
- il est également un moyen de thésaurisation qui permet de faire face aux inéquations temporaires qu'il peut exister entre la production et la consommation (telle marchandise produite pendant une saison sera consommée pendant toute l’année, telle autre, produite durant toute l’année sera consommée en quelques semaines.) ;
- il est enfin et surtout un moyen de mesure de toutes les valeurs.
Cette condition est en effet indispensable pour que les autres soient assurées. En effet, l‘échange n'est possible que si est établie la proportion dans lesquelles s'échangent deux marchandises.
Cette proportion est donnée par le fait que le travail social moyen concentré dans deux marchandises s'échangeant est sensiblement le même[6]
Mais sur le marché, les agents ne comptabilisent pas la valeur des marchandises en heures de "travail social moyen" qu'elles renferment (et qui n'est en général pas connue) mais en unités de monnaie. Chacune d'elles, par conséquent est l'équivalent d'une certaine quantité de travail (le travail qu'il a fallu pour la fabriquer).
Actuellement, l'étalon universel monétaire est l'or -qui sert encore de base de référence- pour la fixation du rapport dans lesquelles s'échangent les différentes monnaies nationales. Et la valeur d'une certaine quantité d'or lui est conférée par le travail qu'il a fallu pour la produire. Par conséquent le taux de change des différentes monnaies nationales a encore à sa base une même quantité de travail socialement nécessaire qu'elles représentent, .ainsi si nous avons simultanément :
- 1 heure de travail = 12 yens et ;
- 1 heure de travail = 4 dollars[7] ;
l'échange entre les deux monnaies se fera corme suit :
4 dollars contre 12 yens c'est à dire 1 dollar contre 3 yens
Mais supposons que pour une raison quelconque l'heure de travail moyenne du travailleur américain ne vaille plus 4 dollars mais 6 dollars (à la suite d'une augmentation brutale et générale des salaires, par exemple) alors que celle du travailleur japonais continue à valoir 12 yens, l'échange 4 dollars contre 12 yens ne sera plus égal. Pour rétablir l'équilibre il faudra échanger 6 dollars contre 12 yens et le dollar ne vaudra plus que 2 yens au lieu de 3 précédemment.
Mais que se passerait-il si les Etats-Unis refusaient de dévaluer leur monnaie? Une même marchandise valant par exemple une heure de travail et produite à la fois par le Japon et les Etats-Unis vaudrait 6 dollars et 12 yens, alors que les monnaies s’échangeraient au taux de 4 dollars pour 12 yens. Un acheteur du marché mondial désirant se procurer cette marchandise et possèdent des dollars aurait intérêt à changer ces dollars contre des yens auprès de la banque fédérale américaine (qui, jusqu’à présent était censée accepter les dollars en échange de leur contrepartie officielle dans n'importe quelle monnaie) et ensuite d'acheter la marchandise en question au Japon. En effet, s'il achetait directement aux U.S.A il lui faudrait 6 dollars alors qu'en changeant ces dollars il obtiendrait 18 yens qui lui permettraient d'acheter 50% en plus de cette marchandise.
On assistera donc à un double phénomène :
- plus personne ne voudra des marchandises américaines, le marché américain lui-même étant envahi par les marchandises étrangères ;
- les détenteurs de dollars essaieront de s'en débarrasser et d'acheter à la place des yens (ou des marks ou des francs)
C’est exactement la situation qui se développe au cours de l’été71 et qui aboutit aux mesures du 15 août.
Celles-ci ont pour but essentiel d'empêcher la spéculation sur le dollar et par conséquent la fuite de capitaux en supprimant la convertibilité du dollar et de faire barrage aux marchandises étrangères en instaurant une taxe de 10% sur les importations. Mais ces mesures ne font que préluder à une véritable dévaluation qui a eu enfin lieu le 18 Décembre.
Nous avons vu par conséquent que la dévaluation est la mesure que doit adopter sous peine de catastrophe un pays quand le coût de production de ~ marchandises s'élève plus vite que celui des marchandises de ses concurrents. Quelles peuvent être les causes d'une telle élévation de ce coût? On peut en distinguer principalement trois :
1-une élévation plus que normale des salaires dos travail- de ce pays.
C'est le cas de la dévaluation de 1969 du franc qui a pour origine principale le déséquilibre provoqué par la hausse brutale de plus de 10% des salaires des travailleurs français à l'issue de la grève de mai-juin 1968,
En ce qui, concerne les Etats-Unis on peut en effet supposer que le taux élevé des salaires des travailleurs par rapport à ceux des autres pays a, à la longue pu constituer un handicap pour les produits américains. Mais ce taux reflète une productivité qui est de très loin la plus élevée du monde. D'ailleurs cet écart entre les salaires des travailleurs américains et les autres était déjà très important (sinon plus que maintenir^) dans la période qui a suivi la deuxième guerre mondiale et où l’économie américaine régnait en maîtresse incontestée. On peut d'autre part considérer que les hausses importantes obtenues ces dernières années par les salariés américains, consécutivement à la relance qui après 1965 a suivi la guerre du Vietnam, ont pu contribuer à grever les coûts de production des marchandises américaines. Mais pendant la même période les salaires des travailleurs allemands ont connu une hausse semblable ce qui n'a pas empêché les marchandises qu'ils produisaient de faire une concurrence des plus victorieuses aux marchandises américaines. Par conséquent, même si cette explication permet de rendre compte d'une certaine façon de la nécessité de dévaluer le dollar» elle ne peut le faire que d'une façon très partielle.
2°-Une augmentation de la productivité plus faible que celle des autres pays.
Ce fut le cas de l'Angleterre jusqu'en 1967 qui, n’ayant pas renouvelé suffisamment ses structures de production se trouvait une situation de stagnation de la productivité qui lui interdit sait de plus en plus la porte des exportations ». La dévaluation de la livre Sterling, payée par l'austérité des travailleurs anglais a permis à ce pays de rétablir sa balance commerciale et par suite de faire les investissements nécessaires.
On peut considérer de même que là réside une des causes de la dévaluation du dollar. Dans les dernières années les pays européens et le Japon (et en particulier ce dernier pays) ont développé et modernisé leur capital d'une façon beaucoup plus rapide que les Etats-Unis, ce qui a eu pour effet une hausse importante de la productivité de ces pays. L'indice de cette hausse de productivité peut être fourni, du fait du nombre à peu près constant des travailleurs de l'industrie dans ces différents pays, par la croissance moyenne de là production d'articles manufacturés, croissance, qui se révèle être plus élevée dans la plupart des pays qu'aux Etats-Unis :
Canada »…………. : 5,3%-
France ............... : 5,7%
Allemagne.......... : 5,9%
Italie .................. : 8,8%
Japon................. : 14,2%
Contre…Etats-Unis............. : 4,7%[8]
Il semble, par conséquent, que là réside une des causes importantes des difficultés actuelles du dollar, mais, cette hausse insuffisante de la productivité à elle-même une origine qu'on est obligé dc chercher dans la troisième cause qui peut contraindre en général un pays à la dévaluation :
Des charges improductives trop lourdes pour l'économie de ce pays.
En effet, dans le prix de revient d'une marchandise commercialisée sur le marché mondial entrent : 1°, la rétribution des salariés l'ayant fabriquée (capital variable), 2°, le paiement des matières premières et des machines mises en œuvre pour cette fabrication (capital constant) et, 3°, le profit du capital. Mais ces trois quantités sont toutes les trois frappées par les prélèvements qu'opère l'Etat pour financer ses dépenses (impôt sur les salaires, sur le capital, sur les profits et autres taxes indirectes) ce qui fait que le travailleur ne perçoit jamais l'intégrité de la quantité d'argent dépensée par le capitaliste pour le payer, que l'achat de moyens de production représente pour ce dernier une dépense plus élevée que leur valeur effective et qu'enfin, son profit, c'est à dire, sa faculté d'accumuler est à son tour atteint. Par conséquent le volume des prélèvements faits par l'Etat est un des facteurs qui intervient sur le prix des marchandises qu'un pays vend sur le marché mondial ainsi que sur le taux d'accumulation et de développement de son capital.
Un autre élément vient grever les prix de vente des marchandises : c'est l'ensemble des dépenses, faîtes par le capitaliste, qui n'entrent pas directement dans la production elle-même (salaires ou moyens de production) mais sont cependant indispensables pour commercialiser les produits. Il s'agit de tous les frais de publicité, d'études de marchés, de gestion qui alimentent ce qu'on appelle le "secteur tertiaire". Ce secteur est particulièrement développé aux Etats-Unis où les "cols blancs" sont aujourd'hui plus nombreux que les "cols bleus" et continuent encore à gagner du terrain.
Ce facteur contribue également à expliquer les difficultés récentes de l'économie américaine, mais là encore, il ne peut s'agir que d'une explication partielle puisque les autres grands pays industriels se sont engagés également, bien qu'avec un certain retard, dans un tel processus de développement du secteur tertiaire au détriment des secteurs secondaires et primaires (salariés de l'industrie et agriculteurs) qui sont les seuls producteurs.
Revenons-en aux prélèvements effectués par l'Etat sur l'économie nationale. Une partie de ces prélèvements est destinée à financer des dépenses productives : ainsi les dépenses gouvernementales d'équipement(transports, télécommunications...) de santé et d'éducation, de prise en charge de secteurs déficitaires mais nécessaires au capital d'un pays (SNCF en France par exemple), toutes ces dépenses donc, ne sont pas perdues pour le capital puisqu'elles lui sont restituées sous forme d'une force de travail de meilleure qualité, de coûts de transports plus faibles, etc..., et viennent d'autant renforcer la compétitivité des marchandises de ce pays.
Mais l'autre partie de ces prélèvements est destinée à des dépenses totalement improductives bien que nécessaires au maintien des positions du capital national tant à l'intérieur (police, tribunaux, administration, armée) qu'à l'extérieur des frontières (corps expéditionnaires, appui militaire des régimes "frères" ou "alliés", "experts" de toutes sortes).
Les Etats-Unis qui, depuis la dernière guerre mondiale se qualifient de "gendarme du monde", sont la nation qui engouffre la quantité de très loin la plus élevée dans ces dépenses improductives.
Or ces dépenses, et en particulier les dépenses militaires sont une perte sèche pour l'économie d'un pays. Alors que la production de biens de production ou de consommation constitue une métamorphose dans la forme de la valeur (qui tend à augmenter en quantité à chaque cycle productif mais jamais à diminuer), la production d'armements aboutit à une destruction de la valeur. Effectivement la valeur des moyens de production est restituée intégralement après leur utilisation dans le produit et celle des biens de consommation dans la force de travail qu'ils permettent d'animer (aliments pour nourrir les ouvriers, voitures pour les amener à leur travail...), mais par contre la valeur des obus et des bombes s'envole en fumée si l'on peut dire, au moment de leur utilisation qui ne crée aucune valeur nouvelle, (quand elle n'en détruit pas).
Les dépenses d'armement sont donc, pour un pays, une charge qui pèse directement sur le prix de ses marchandises et par suite sur sa compétitivité dans l'arène internationale.
Une vérification éclatante en est donnée par ce qu'on a appelé les trois "miracles" de l'après-guerre : le taux de croissance exceptionnel des trois vaincus de la dernière guerre mondiale, l'Italie l'Allemagne et le Japon.
Certains n'ont voulu chercher à ces "miracles" d'autre explication que le degré de destruction exceptionnel subi par ces pays pendant la guerre. La nécessité de "repartir de zéro" dans la reconstitution des moyens de production a permis de donner à ceux-ci un modernisme et par suite une rentabilité bien plus grande que dans les autres pays. Cet argument est partiellement vrai mais il ne suffit pas à tout expliquer : le pays qui a aujourd'hui encore l'instrument de production le plus moderne et le plus rentable est celui qui a subi le moins de destructions pendant la dernière guerre : les Etats-Unis.
Il existe une autre explication bien plus solide à ces "miracles" de pays vaincus : leur défaite en a fait des pays sans armement ou à l'armement limité. Par suite, la part de production nationale destinée à ces dépenses improductives s'en est trouvée réduite d'autant permettant un essor de l'accumulation en conséquence.
Par conséquent, il apparaît clairement que les dépenses énormes d'armement que les Etats-Unis ont faîtes ces dernières années sont un facteur décisif dans l'enchérissement de leurs marchandises et par suite dans la situation qui a conduit à la dévaluation du dollar. Et l'insistance croissante avec laquelle le gouvernement des Etats-Unis demande à ses alliés d'assumer une plus grande part dans la défense du "monde libre" n'est pas pour contredire cette hypothèse[9].
De l'avis même des officiels américains les dépenses militaires à l'étranger sont une des causes essentielles du déficit chronique de la balance des paiements américaine qui est une des composantes de la crise du dollar. (En 1970, 3358 millions de dollars sur 9,5 milliards de déficit - d'après "Informations et Documents", n° 311, publication de l'ambassade américaine).
C0NSEQUENCES et PERSPECTIVES de la DEVALUATION
Nous avons donc vu qu’à l'origine de la récente dévaluation du dollar, on trouve :
- une croissance trop importante des salaires ainsi qu'une augmentation de la productivité trop faible des travailleurs américains relativement à celle des travailleurs d* autres pays ;
- le poids chaque- .jour plus écrasant des dépenses militaires des Etats-Unis, "Gendarme du Monde".
Par conséquent la dévaluation du dollar, pour être efficace, doit s'accompagner de mesures qui devraient agir suivant deux axes principaux :
- un arrêt de la hausse dos salaires des travailleurs américains accompagnée d'une augmentation de.11 exploitation de ces travailleurs ;
- une réduction massive des dépenses militaires.
Les mesures du premier type ont été prises dès le 15 Août: instauration d'un blocage des prix et des salaires accompagnée d'une exhortation à l'effort national à la paix sociale, et à laquelle l'A.F.L.-C.I.O. s'est empressé d'acquiescer en participant aux commissions chargées de contrôler ce blocage.
On pourrait penser que le blocage des prix qui accompagne le blocage des salaires saura empêcher une baisse du niveau de vie des travailleurs américains. En fait, ceux-ci subiront immédiatement les hausses des prix des produits de consommation importés qui eux, évidemment, devront se conformer au nouveau taux de change du dollar. Quant aux produits industriels importés par les capitalistes américains leur renchérissement se répercutera automatiquement sur le prix des marchandises qu'ils auront permis de fabriquer et -si le blocage sur les 'prix de celles-ci se maintient- sur le taux de profit des capitalistes, (qui pour rétablir la situation s'empresseront d'intensifier l’exploitation des travailleurs.)
Par conséquent, dans tous les cas la dévaluation du dollar ne peut signifier, pour les travailleurs américains, qu'une baisse de leur niveau de vie et une augmentation de leur exploitation. Cotte agression contre les conditions de vie des travailleurs américains sera d'autant plus violente qu'au lieu de restreindre les dépenses d'armement, pourtant responsables du déséquilibre monétaire, le prochain budget fédéral prévoit une augmentation assez considérable de celles-ci: 6,3 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent.
Or, il ne s’agit pas là d'une lubie du président Nixon qui serait retombé dans les nasses du "complexe militaro-industriel". En fait, cette décision malgré le sort qu'elle porte au redressement du dollar est contrainte par deux impératifs :
- la place militaro-politique de l'impérialisme américain dans le monde : à l'heure ou s'annonce une recrudescence des divers conflits inter-impérialistes ( Indochine, Pakistan, etc.) et une redistribution des cartes entre les blocs, celui-ci a besoin du maximum de moyens pour maintenir ses positions face aux impérialismes russe et chinois, ses rivaux[10],
- le chômage croissant aux USA la crise qui touche un grand nombre des secteurs de pointe grands fournisseur de l’armée.
De la même façon que l'intensification de la guerre du Vietnam avait permis après 1965 une résorption du chômage et une certaine "relance" de l'économie américaine, le "désengagement" américain de ces pays, s'est répercuté immédiatement sur les branches industrielles concernées. En particulier, la réduction des effectifs du corps expéditionnaire a eu les conséquences les plus néfastes pour les compagnies aériennes américaines qui assuraient une bonne partie du transport des troupes.
(Pan Am et TR doivent leur survie aux commandes du Pentagone). Cette situation n'est pas étrangère à la crise que subit actuellement l'aviation Civile à l'échelle internationale, crise dont une des conséquences n'est rien moins que les faillites de Lockheed et de Rolls-Royce qui a plongé 40% de la population de Seattle dans le chômage et contribué à augmenter celui qui touche actuellement la Grande Bretagne. Sans tout expliquer, cette crise de l'aéronautique est particulièrement significative de la situation actuelle où toute réduction des dépenses militaires est synonyme d'augmentation du chômage et en particulier aux Etats-Unis où presque dix millions de salariés travaillent pour l'armement.
De tout cela il ressort, par conséquent que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que la dévaluation du dollar soit une réussite c'est à dire qu'elle permette : 1° une baisse importante sur les prix des produits américains en concurrence avec les- marchandises d'autres pays, condition fondamentale pour un rétablissement des positions commerciales américaines dans le monde, et 2°, une "exportation du chômage" qui s’installe actuellement aux U.S.A. ( où le chiffre des sans-travail atteint les six millions ). D'ailleurs, l’éventualité d'une telle réussite semble s'estomper puisqu'on assiste en ce début d'année 72 à une nouvelle "fièvre de l'or" : sur la place de Londres, le 2 Février, l'once d'or s'est vendue 49,25 dollars, alors que depuis les accords de Washington, le taux officiel est de 38 $, soit une dévaluation de près de 30%.
: Pour résumer, l'économie américaine se trouve prise dans un cercle vicieux : les mesures prises pour réduire le chômage (augmentation de dépenses fédérales et en particulier d’armements) se traduisent par une difficulté à .exporter la production ce qui est source de chômage.
Par ailleurs il serait vain de penser que la faiblesse (relative) de l'économie américaine par rapport à ses concurrents soit en mesure d'assurer un regain de prospérité pour ceux-ci : une récession aux Etats-Unis se traduit immédiatement par une réduction de la demande y compris des produits étrangers et par suite se répercute à terme sur ces économies. Il n'est d'ailleurs pas besoin de faire des prévisions puisque c'est déjà la situation actuelle où on voit le chômage s'installer dans les principaux pays développés.
Dans l'hypothèse d'une "réussite" de la dévaluation du dollar nous assisterons à une "exportation" directe des difficultés et du chômage américain vers les autres pays : depuis le 15 Août c'est d'ailleurs ce qui s’est partiellement passé et en particulier en Amérique Latine où les mesures Nixon ont fait souffler un vent de panique dans les milieux d'affaires. En tout état de cause, la puissance économique, politique et militaire, des Etats-Unis est encore assez forte pour retarder sa propre crise au détriment des "partenaires". Mais, là encore, il ne peut s'agir d'une solution définitive : la crise dans les autres pays réduira la demande de produits américains ce qui entraînera une récession aux Etats-Unis mêmes.
Quelle que soit l'hypothèse qui se réalisera, la perspective des prochaines années est donc un ralentissement de l'activité économique et une augmentation du chômage : un grand nombre d'économistes bourgeois ne s'y trompe pas qui annonce une récession accrue pour les années 72 et 73[11].
A ce stade nous pouvons déjà conclure, par conséquent à la faillite des théories néo-keynésiennes pour qui une action concertée et une demande importante de la part de l’Etat, étaient capables de garantir le plein-emploi et une expansion continue dans les pays industriels.
Le même constat d’échec s'applique aux conceptions qui ont pénétré jusque dans les rangs du mouvement révolutionnaire et suivant lesquels la production d'armements était capable de constituer des débouches illimités pour la production capitaliste et par suite de résoudre le problème de la surproduction. Le cercle vicieux évoqué plus haut, dans lequel se trouve enfermée l ’économie américaine et à sa suite toutes les autres économies, apporte à cette thèse un cinglant démenti : toutes les dépenses militaires engagées ces dernières années n'ont pas empêché le capitalisme de s'engager sur la voie d’une nouvelle récession et ceci de l'avis même de ses plus fidèles apologistes[12].
Mais pour pessimistes que soient ces économistes, leur audace ne va pas au-delà de la caractérisation de la crise actuelle comme une crise cyclique, semblable à celles qui, au siècle dernier, frappaient régulièrement les pays capitalistes tous les sept ou onze ans. La récession qui s’avance serait un "remake" de celle qui a touché les Etats-Unis vers 1965 en un peu plus grave mais qui, après une période de réadaptation et de réajustement du marché, céderait la place à une nouvelle expansion généralisée. Cette opinion est d'ailleurs partagée par un certain nombre de courants prétendus "marxistes" ou "révolutionnaires" (que nous critiquons par ailleurs[13]), pour qui le capitalisme serait parvenu à contrôler ou limiter ses crises économiques, la contradiction mortelle de ce mode de production résidant dans l'antagonisme irréconciliable entre exploiteurs et exploités, ou entre "dirigeants et exécutants"
La question qu’il faut donc poser est la suivante :
LA CRISE QUI COMMENCE EST-ELLE DU TYPE 19° SIECLE AVEC UNE REPRISE ASSUREE. APRES, UNE PHASE TEMPORAIRE D'INSTABILITE ET DE REAJUSTEMENT OU BIEN, RESSEMBLE-T-ELLE A CELLE DE 1929 QUI NE FUT SUIVIE D'AUCUNE REPRISE NOTOIR E ET ABOUTIT A LA GUERRE?
LES CRISES AU 19° SIECLE ET AU 20° SIECLE
Entre les crises telles qu'elles se déroulaient au siècle dernier et celles, beaucoup moins nombreuses qui ont secoué le 20° siècle une comparaison est facile à établir :
- dans les deux cas on assiste à une surproduction de marchandises qui ne trouvent plus d'acheteurs solvables, un grand nombre d'entreprises font faillite, ce qui jette dans le chômage un nombre exceptionnel de travailleurs et abaisse de façon importante les salaires de ceux qui gardent leur travail : dans un cas comme dans l'autre l'excédent de richesses conduit à un surcroît de misère pour ceux qui les produisent ;
- par contre la conclusion de ces crises est tout à fait différente d'après l'époque où elles ont lieu. Au siècle dernier, après une période de recul et d’instabilité, l’économie repartait de plus belle : l'élimination des entreprises les moins rentables et l'ouverture de nouveaux marchés suffisait à rétablir la situation. Au 20° siècle, le monde n'a connu que deux crises générales du capitalisme : en 1913 et en 1929, mais dans les deux cas, celles-ci ont abouti à des guerres mondiales[14] qui ont plongé l'humanité dans une barbarie dépassant de loin tout ce que Marx et Engels pouvaient imaginer quand ils utilisaient ce terme. Alors que la surproduction, au siècle dernier, se produisait dans le cadre des marchés existants mais n’excluait pas la possibilité de trouver de nouveaux débouchés dans d'autres secteurs non encore explorés (et, par suite, autorisait une solution pacifique à la crise), la surproduction au 20° siècle est générale. Pour résoudre la crise il n’existe plus la possibilité pour chaque nation de partir à la conquête de marchés encore vierges : cette conquête se fait, forcément au détriment d'une autre nation.
Par suite, les crises du 20° siècle ont comme prolongement logique et inéluctable la guerre impérialiste où chaque nation tente de ravir par la force les marchés de sa rivale. Ces guerres se traduisent donc par une destruction massive do capital (moyens de production et travailleurs) : les périodes de prospérité du 20° siècle, sont, par ces faits, des périodes de reconstruction du capital détruit pendant la période antérieure. Au cycle expansion-récession-nouvelle expansion du siècle dernier a succédé le cycle : CRISE-GUERRE-RECONSTRUCTION-CRISE...
Si, comme le dit Trotsky, les crises du siècle dernier étaient comme le s battement du cœur le Capitalisme qui connaissait alors son plein développement, les crises de ce siècle sont comme le râle de son agonie.
G. Ciné (A suivre)
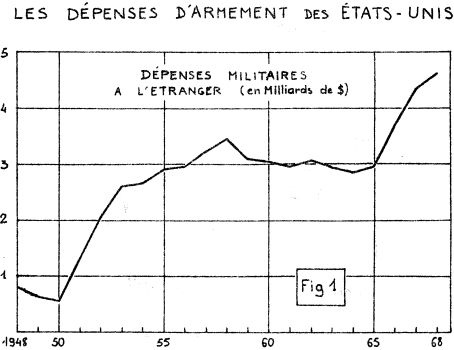
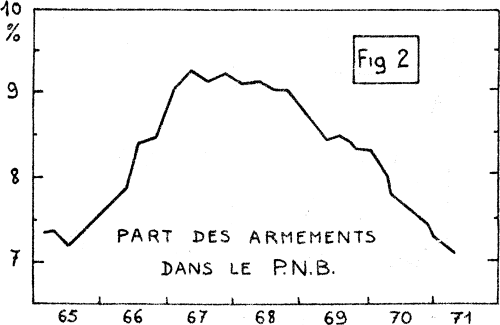
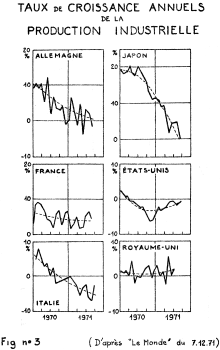
[1] Sentence prononcée en Janvier 1969 au cours du discours inaugural de son mandat de Président des Etats-Unis d’Amérique.
[2] R.I. N° 5. "La fin des illusions" p.55.
[3] (1) Cf. Le Monde du 5 Novembre 71 : "Va-t-on, vers une nouvelle "grande crise"" par André "Piettre.
[4] (2) Rheinische Zeitung 1850.
[5] Rappelons ici l'essentiel de ces mesures :
- -suppression de la convertibilité en or du dollar ;
- instauration d’une taxe de 10% sur toutes les exportations ;
- blocage des prix et des salaires pendant 90 jours ;
- réduction de certaines dépenses fédérales
- allégement de certains impôts sur le capital afin de relancer l’expansion et lutter contre le chômage
- réduction de l'aide à l'étranger
[6] Marx a montré qu'il n'existe que rarement une telle identité. En règle générale, le prix d'une marchandise, c’est à dire, le rapport dans lequel s'échange cette marchandise avec la marchandise monnaie, quintessence de toute valeur, oscille autour de sa valeur, c'est à dire le travail social moyen nécessaire à sa fabrication.
[7] (°) Ces proportions sont arbitraires et ne prétendent avoir aucun rapport avec' la réalité.
[8] Chiffres annuels moyens calculés entre 1945 et 1968 et donnés par l'O.C.D.E. en Décembre 1970.
[9] Le graphique n°1 permet de se faire une idée de l'évolution des dépenses militaires ces dernières, années.
[10] La récente installation en Grèce d'importantes bases navales qui renforcent d'autant le régime des colonels malgré les hauts cris de la bourgeoisie libérale américaine traduit bien cette tendance au renforcement des positions militaires de U.S.A. face à celles de l'U.R.S.S. qui, depuis le conflit du Moyen-Orient a fait son entrée en méditerranée.
[11] Voir "Le Monde" du 25-1-72, page 13 : "Pas de retour prochain au plein-emploi en Europe."
[12] Le graphique N° 3 donne une idée particulièrement nette du ralentissement actuel de•1 'économie mondiale.
[13] Voir "Volontarisme et confusion" dans le prochain numéro de R .I.
[14] Il est à noter que la Guerre de 14 éclate avant que la crise de 1915 n’ait pu connaître son plein épanouissement, ce qui autorise certains à dire que cette guerre n'est pas directement liée à une crise économique.-
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Révolution Internationale (ancienne série) N°7 - mars-avril
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 618.08 Ko |
- 57 lectures
LES ZIGZAGS DE L'INVARIANCE
- 62 lectures
Le "P.C.I." ("Programme Communiste" et "Le Prolétaire") se réclament d'une invariance, d'une ligne directe du manifeste Communiste à nos jours. Mais elle n’est "qu’une apparence recouvrant l’absence d’une vitalité de pensée, une invariance démentie par des contradictions et des confusions politiques du groupe".
L'évolution de la crise sociale se poursuit d'une façon si généralisée qu'on peut même voir ses conséquences idéologiques dans des sectes sclérosées du marxisme, telles que celle de "Programme Communiste". Les anciens dogmes dits révolutionnaires : le syndicalisme, la libération nationale, se heurtent aujourd'hui à la réalité des luttes ouvrières autonomes, des problèmes économiques et des conflits inter-impérialistes.
Aujourd'hui on assiste à un réveil de la lutte de classe qui rompant avec l'apathie sociale réduit l'isolement des révolutionnaires qui avait caractérisé les années de réaction. Même un groupe comme Programme Communiste, dont l'idéologie a été irrémédiablement déformée par la période de recul du mouvement, ne peut éviter de subir les répercussions d'un nouvel élan dans la classe ouvrière. Dernièrement, certains articles du "Prolétaire" ont rend évidente l'existence de divergences qui ont fait surgir une série de scissions. Celles-ci ont des fondements plus ou moins confus dans des questions telles que la fonction de syndicats et la critique de la conception léniniste du parti.
LES POSITIONS CONFUSES DE "PROGRAMME COMMUNISTE"
Depuis quelque temps déjà, "Programme Communiste" prend ses distances par rapport aux luttes de libération nationale. Il faut dire que, sur cette question, l'évidence crève les yeux même aux aveuglés. Mais, "Le Prolétaire", tout en soutenant EN PRINCIPE "le droit à l'autodétermination des peuples" ne veut tout de même pas se confondre avec les trotskistes et les tiers-mondistes. Ils se tirent du dilemme en considérant chaque lutte de Libération Nationale comme "un cas particulier" qui ne tient pas à la règle, ou en disant que dans tel ou tel pays, une "révolution démocratique" n'est plus à faire mais laissant entendre qu’ailleurs cela peut être autrement. N'ayant pas une vision globale de la période actuelle du capitalisme décadent, "Programme Communiste" ne peut pas avoir une analyse cohérente des positions politiques à prendre face aux problèmes actuels.
L'ambiguïté sur la nature des luttes de Libération Nationale ne peut qu'être politiquement gênante; la compréhension de la nature réactionnaire de telles luttes est devenue, une mesure essentielle du contenu révolutionnaire du programme d'un groupe politique. Par le fait même que la bourgeoisie mondiale utilisé les "Libérations Nationales" comme moyen idéologique pour entraîner les travailleurs dans des conflits inter-impérialiste s, (comme vient de le démontrer encore, récemment le Bangladesh) un groupe politique qui continue à se réclamer de ces mystifications ne fait que semer la confusion la plus dangereuse.
REGLER LES COMPTES AVEC LE SYNDICALISME
La confusion de "Programme Communiste" est également évidente en ce qui concerne la question du rôle des syndicats dans la lutte de classes. Après avoir soutenu depuis longtemps la position "orthodoxe" sur la nécessité d'une "C.G.T. Rouge", on a cru assister à une rapide volte-face dans le numéro 114 du Prolétaire. Dans un article intitulé "Régler les comptes avec le syndicat'", il est écrit :
- "Notre rôle, pensons-nous, est de dénoncer les syndicats pour ce qu'ils sont et d'appeler les ouvriers à combattre, leurs directives, à s'émanciper de leurs ordres défaitistes, à s'organiser indépendamment d'eux et contre eux"
On aurait cru que tout à coup un "bon vent avait soufflé" et que "le Prolétaire" avait pris subitement conscience du fait que le développement du système capitaliste a intégré les syndicats directement ou indirectement, dans l'appareil de contrôle étatique; que désormais le syndicalisme -en tant que forme historique de la lutte du Prolétariat- est condamné à un rôle contre-révolutionnaire.
Faisant cela, "Le Prolétaire" n'aurait fait que tirer les leçons des luttes ouvrières autonomes qui se placent en dehors et contre le cadre de récupération syndicale. Cependant, malgré le fait que la position "anti-syndicaliste" a dans l'"ultra-gauche" une tradition remontant jusqu'au K.A.P.D. et se rattachant à une critique de la tactique de la IIIe Internationale, l'article du "Prolétaire" a basé sa nouvelle position sur l'exemple d'une simple grève du métro parisien en 1971. Qu'est-ce qui a changé dans leur analyse de la lutte de classes globalement prise pour justifier cette nouvelle position? De toute façon, cela a semblé étrange que "le Prolétaire" ait publié un article en contradiction avec sa ligne officielle sans offrir d'explication aux lecteurs. Mais puisqu'aucun article du "Prolétaire" n'est signé (et qu'il faut donc les prendre tous comme "obiter dicta" du groupe dans son ensemble), on aurait pu croire que cette nouvelle analyse de la question syndicale devait être prise au sérieux. Mais apparemment "le Prolétaire" ne se soucie pas de la cohérence. Depuis novembre, les bordiguistes ne parlent plus de cette volte- face sur le syndicalisme. Comme si rien n'était jamais dit, "le Prolétaire" se contredit d'un numéro à l'autre sans signe d'une discussion interne. L'article, malgré tout ce qu'il promettait, n'était qu’une pierre jetée à l'eau. "Programme Communiste" sans doute se réfugiera dans l'affirmation que la lutte du prolétariat peut être aussi bien menée DANS les syndicats qu'en dehors, pourvu que le Parti en ait le contrôle. Mais ceci n'est qu'une façon de tourner le dos aux véritables problèmes des prolétaires en se cachant derrière l'idée de la compréhension miraculeuse d'un parti tout-puissant.
LES SCISSIONS
Sans doute, il fallait croire que cet article sur la grève du métro à Paris était l'expression d'une tendance politique au sein de "Programme Communiste" qui essayait de s'exprimer contre la position officielle. Mais l'absence d'une discussion dans les pages du "Prolétaire" ne nous a pas permis d'aller plus loin. Cependant, des scissions n'ont pas manqué de se manifester peu après. "Programme Communiste" ne tolère pas qu'une tendance politique en son sein puisse "douter" de la ligne. Au lieu d'offrir la possibilité de discuter jusqu'à ce que les divergences deviennent claires, "Programme Communiste" préfère précipiter les scissions pour se "protéger" contre leur influence "néfaste". Néanmoins un noyau a pu écrire un document "Pourquoi nous quittons Programme Communiste" nous permettant de voir, quant à leur scission, les raisons pour la rupture.
Ce texte de scission se réclame d'une position nettement anti-syndicaliste: "Dans la lutte révolutionnaire les syndicats n'ont aucun rôle à jouer. On ne peut les qualifier de trahison: ils sont désormais partie intégrante du Capital". Mais quant à la question du Parti du prolétariat, le texte dit: "A présent que ces tâches sont réalisées (c'est-à-dire que le Capital a généralisé la condition du prolétariat) le parti formel n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus besoin de médiation. Plus que jamais le parti sera le mouvement du prolétariat se constituant en classe -"parti historique"- Plus que jamais "l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes". Si "Programme Communiste" dit que le parti est la classe, ce texte semble avoir pris simplement le contre-pied en disant que la classe est le parti. En ce sens, le texte se rapproche des positions de la revue "Invariance". Si "Programme Communiste" élève le parti à un niveau absolu d'une omniscience mystique, ce texte élimine la nécessité d'un parti du prolétariat. Toutes deux, ces positions sont une réponse erronée à un problème d'une importance capitale.- Mais dans la mesure où le document de scission est une ouverture vers une discussion plus ample sur la question, il est beaucoup plus positif et important que la position figée de "Programme Communiste".
Le texte de scission se réfère au passé de "Programme Communiste" et du Parti Communiste International dans la mesure où il situe la scission d'aujourd'hui dans le contexte des critiques faites à la Gauche Italienne par "Internationalisme"(qui a scissionné après la guerre[1] et des critiques du camarade Vercesi (Perrone) en Belgique.
Les militants qui ont écrit ce texte étaient depuis longtemps dans "Programme Communiste". Il y a eu récemment des scissions de militants plus jeunes. A la suite, de Mai 68, beaucoup de jeunes militants ont été attirés vers "Programme Communiste" parce que ce groupe semblait offrir un certain sérieux, une expérience dans la lutte, un souci de préserver le marxisme. Mais il s'est avéré, que "Programme Communiste" n'offre pas un terrain favorable au développement d'une conscience critique, pour la formulation de nouvelles idées qui puissent répondre aux besoins de la lutte de classes aujourd'hui. "Programme Communiste" ne peut que susciter une profonde désillusion chez les militants quand ceux-ci se rendent compte de tout un monde d’idées (depuis, le K.A.P.D jusqu'au véritable passé du P.C.I lui-même) qui leur a été caché par ce groupe replié sur lui-même. W(1)
LA TENDANCE .VERS LE CONSERVATISME
Dans une certaine mesure, ce blocage de "Programme Communiste" a une explication historique. Pour, se protéger des assauts idéologiques de la contre-révolution, beaucoup de groupes révolutionnaires avaient senti le besoin de se renfermer sur les positions du passé déjà acquises. Néanmoins, pendant les années 30, la Gauche Italienne en exil (le groupe autour de la revue "BILAN") a fait une étude critique du passé d'une grande importance, en élaborant des positions CONTRE l'anti-fascisme, la défense de l'URSS, et le Front Populaire -ces positions étant les plus fermés de toute la Gauche Révolutionnaire à l'époque. Mais à partir de la déception qui suivit la deuxième guerre mondiale, après que les premières manifestations de luttes de classes eurent été immédiatement étouffées dans l'œuf, la Gauche Italienne a subi une régression par rapport à ses propres positions d'avant-guerre, et est tombée dans l'opportunisme en formant un parti en période de recul.
Les groupes révolutionnaires qui continuaient à exister pendant la période de réaction, réduits à l'isolement quasi-total, devinrent très souvent les simples conservateurs des positions du passé par peur de se dissoudre dans la confusion, ils fermaient la porte à tout. Cette situation a empêché l'évolution de "Programme Communiste" au point que quand la situation sociale a changé, le groupe soit resté figé dans ses positions passéistes (la tactique de la IIIe Internationale), incapable d'être à la hauteur des évènements, ni de la tâche théorique. Il continue à se réclamer d'une invariance, "une ligne directe du Manifeste Communiste jusqu'à nos jours", Mais, ni le mouvement ouvrier, ni la conscience de classe ne se développent en ligne directe; en voulant le voir ainsi, on finit par déformer tout contexte historique. Cette invariance se réduit à une simple répétition des erreurs de Lénine et à une déification de son œuvre révolutionnaire. L'Invariance de "Programme. Communiste" n'est qu'une apparence recouvrant l'absence d'une vitalité de pensée, une invariance démentie par des contradictions et des confusions politiques du groupe
LES COMMUNISTES DU BLACK POWER?
On peut mieux-mesurer la confusion qui règne chez les bordiguistes si on considère leur réponse aux "nouveaux problèmes" (ou au moins à un problème nouveau pour eux) : la question noire aux Etats Unis. Cette question touche au problème du nationalisme, au problème fondamental pour l'unification de la classe ouvrière aux Etats-Unis, dans le principal centre industriel du monde c'est-à-dire au cœur me- me de la lutte de classes. Dans le même numéro 114 du "Prolétaire" où paraissait l'article sur les syndicats, il y avait un article intitulé "Le mouvement noir aux Etats-Unis" à travers lequel le groupe essayait de dégager une perspective pour la lutte aux Etats-Unis.
L'article commence : "Leur cas (des noirs) est particulier puisque la race recouvre à peu près une appartenance de classe". Bien sûr, on est contre les revendications nationalistes des "peuples". MAIS -et c'est le grand MAIS, qui ouvre la porte à tous les noirs aux E.U. sont un cas particulier parce que la race est presque synonyme de classe. N'importe quel sociologue bourgeois peut nous fournir l'information que beaucoup de noirs appartiennent à la classe ouvrière, agricole ou industrielle. Mais ce qui est essentiel dans la question noire est son contenu POLITIQUE. Est-ce que les revendications spécifiques noires sont "à peu près" des revendications de classe ou non? Est-ce que les noirs en tant que noirs, ou n'importe quelle catégorie nationale, sont révolutionnaires en tant que tels ou non? Les bandes fascistes peuvent contenir statistiquement beaucoup d'ouvriers, mais est-ce que le fascisme est considéré une position de classe? ET le black power?
Gomme toujours quand on commence à dire que la race est "à peu près" la classe, on oublie de QUELLE classe il est question. "Ils (les noirs) appartiennent en effet en majorité au prolétariat ou au sous-prolétariat et la frontière est bien mince entre ces deux". Ainsi on finit par ne plus savoir faire la distinction entre le prolétariat et le lumpen. Justement, beaucoup de "gauchistes" aux. E.U., désespérés par la lenteur de la prise de conscience chez les ouvriers américains, ont mis leurs espoirs chez les marginaux, pour la plupart noirs que le système industriel ne peut plus intégrer dans la production. Les marginaux, qui vivent souvent dans la révolte individuelle, la violence et la criminalité, sont la proie parfaite de l'Idéologie Black Panther qui donne une mystique "révolutionnaire" et une justification raciale aux actes anti-sociaux sans avenir. L'article du "Prolétaire" tombe ouvertement dans le même piège en parlant des "prisons, école de guerre du communisme". L'article semble croire à la propagande Black Panther en considérant la population noire en prison comme étant composée en entier de prisonniers politiques. Il est vrai que le racisme est en grande partie responsable d'un taux élevé de criminalité chez les marginaux noirs et, par conséquent, d'une plus forte répression gouvernementale. Mais la population des prisons n'offre pas plus aux E.U qu'ailleurs, une qualité révolutionnaire en soi. L’article nous dit "Les détenus profitent de leur séjour en prison pour lire, pour discuter et finalement pour sortir de la prison avec une révolte consciente cette fois, des buts à atteindre et de l'ennemi à abattre". C'est du pur délire, surtout pour un journal qui se dit marxiste révolutionnaire.
L'article cite comme exemple de cette nouvelle conscience la révolte à la prison d'Attica en septembre 1971. Mais justement, la seule conscience qui soit issue de cette révolte est du niveau "Black Power". (Une des revendications les plus discutées de la révolte d'Attica était : davantage de gardiens noirs pour les prisonniers noirs. Ceci est à mettre en parallèle avec les revendications de DRUN (une organisation du Black Power dans certaines usines de Détroit) qui a demandé pendant une grève sauvage, davantage de contremaîtres noirs (!) L'article du "Prolétaire" soutient explicitement DRUN comme il soutient "les prisons, école de guerre du communisme".
Du point de vue de la conscience de classe, la révolte à Attica n'a même pas présenté un danger pour la bourgeoisie. Elle a simplement servi au gouvernement comme moyen de prouver sa fermeté devant des convulsions sociales chaotiques. En effet, toute convulsion sociale, bien qu'étant l'indice d'une décomposition sociale, n'est pas automatiquement une réponse de classe à la question de la lutte révolutionnaire. Attica trouve des parallèles en France et même au Luxembourg avec les révoltes des prisonniers dans ces pays. Aux E.U. le résultat fut un massacre comme seule la bourgeoisie est capable d'en faire : la violence gratuite et sanglante. La révolte n'a nullement marqué un début de conscience de classe et seuls les Blacks Panthers peuvent la voir comme un signe "positif".
Un flirt avec l'idéologie du Black Power imprègne tout l'article du "Prolétaire". On nous parle de la bourgeoisie "blanche", encore mieux, de "l’Amérique blanche". C'est le langage typique des tiers-mondistes aux E.U. qui voient le monde divisé en couleurs et non en classes, avec tous les blancs comme exploiteurs des gens de couleur du monde entier. Tout cela pour faire croire qu'aux E.U. les ouvriers blancs ne sont plus des exploités mais des collaborateurs en bloc avec la "bourgeoisie blanche". C'est une conception profondément réactionnaire, une idée qui ne peut sortir que de l'idéologie bourgeoise.
"Les noirs (quels noirs?) se sentent solidaires avec des luttes du Tiers-monde car c'est le même impérialisme qui les opprime Dans le Tiers-monde, il y a des impérialismes qui SE FONT CONCURRENCE; les USA, l’URSS, la Chine. Mais cela les tiers-mondistes ne l'admettent pas. Dans la mesure où les Black Panthers sont pro-chinois ou pro-russes, ils peuvent "se sentir solidaires" avec les luttes existant au Tiers-monde. Pour eux, il s'agit de choisir l'impérialisme de préférence -'impérialisme "de couleur"-. Comme le mouvement nationaliste noir préconise une alliance inter-classe pour tous les noirs aux E.U, il peut avec facilité soutenir les alliances inter-classes des différents peuples pour leur "libération nationale". Toute cette politique de couleur est logique pour les Blacks Panthers. Doit-on croire que c'est également la logique du "Prolétaire"?
En France, c'est encore facile d'émettre un tel bavardage sur la question noire -il n'y a pas une répercussion immédiate dans la réalité des luttes. Mais aux E.U, un groupe comme "le Prolétaire", avec de tels articles, serait immédiatement dénoncé comme apologiste du nationalisme, comme un danger pour l'effort vers la réunification de la classe ouvrière.
LES CONSEQUENCES DE LA CONFUSION
Le manque de clarté sur les positions à prendre face à la libération nationale, ne fera qu'amener "le Prolétaire" à semer la confusion partout. Sur la question syndicale, il se fera le serviteur de la C.G.T par sa position incohérente sur le rôle du syndicalisme aujourd'hui. Sur le passé du mouvement ouvrier, "Programme Communiste" n'of- fre aucune attitude véritablement critique permettant un dépassement; sur son propre passé, celui de la Gauche Italienne de 1930-1952; il préfère maintenir, les camarades dans l’ignorance. Il parle d'une haute théorie communiste en la rabaissant au niveau d'un catéchisme de Parti.
Leur mépris pour le "bas niveau" de conscience des ouvriers -ce qui à leurs yeux obligera le Parti à prendre le Pouvoir par-dessus les Conseils Ouvriers et même malgré eux- est d'autant plus ridicule que leur théorie n'a pas encore assimilé le contenu réel de ce que les luttes ouvrières autonomes nous montrent par leur pratique. Avec leur rigidité dans le léninisme, ils ont élevé la notion du Parti à une idée absolue, au point qu'ils ne voient plus que c'est dans la théorie léniniste du Parti (et l'identification du Parti à l'état en Russie) que le capitalisme d'état a trouvé et trouvera son plus fort apologiste.
Pour "Programme Communiste", les autres courants marxistes ne sont que de "la racaille"; et la férocité de sa polémique ne recouvre qu'une sclérose à l'intérieur du groupe. Il est définitivement figé dans le passé. Etant l'héritier d'une tradition ultra-gauche, il a transformé cet héritage en une invariabilité sacrée, et il l'a momifié au lieu de l'approfondir.
On ne peut que saluer les nouvelles scissions qui se' sont accomplies. Cela ne peut qu'être un bon signe de la force des nouvelles idées qui arrivent à pénétrer même le brouillard des "principes léninistes éternels" pour faire évoluer des militants. Maintenant que le premier pas est franchi, et que le carcan de la ligne "Invariable" est rejeté, il reste encore UN TRAVAIL DE CLARIFICATION POLITIQUE A FAIRE.
Judith Allen
[1] INTERNATIONALISME (la fraction française de LA Gauche Communiste) a scissionné en 1945 en s'opposant à l'opportunisme du P.C.I qui a formé le parti en Italie pendant la période de recul des luttes. "Internationalisme" défendait des positions anti-syndicalistes, anti-libérations nationales et critiquait la conception léniniste du Parti.
Courants politiques:
- Bordiguisme [29]
- PCI (Le prolétaire) [30]
Rubrique:
La crise - (allons-nous vers un nouveau 29 ?) - (II)
- 11 lectures
Mais une question se peso :
Pourquoi ce changement entre les deux périodes ?
Pourquoi est-il devenu pratiquement impossible dans la nouvelle période de trouver de nouveaux marchés ?
Niant l’évidence, la plupart des économistes actuels considèrent, à la suite de Jean-Baptiste Say, que la production crée son propre marché, à la suite de quoi ils se trouvent bien en peine d’expliquer, les crises de surproduction : mais on ne saurait demander aux apologistes apointés du capital de concevoir les conditions de la mort de la société qui les fait vivre.
Une idée analogue trouve des défenseurs au sein même du "courant marxiste" : puisque c’est la division du travail qui est à la base de l’économie marchande (dans une société où tout le monde produirait la même chose, les échanges n'auraient pas de sens), le marché n'a d'autres limites que la division du travail. Par suite les crises correspondraient à un retard du degré de division du travail par rapport- à l'extension du marché et trouveraient une issue après une période de rajustement dans 'un degré plus élevé de division du travail. Dans la mesure où le développement de la technique établit une division du travail chaque jour plus grande, il n'existerait donc pas de limite à l'extension des marchés.
Par conséquent, une telle conception, comme la précédente, est incapable de rendre compte du changement "qualitatif' qui s'est produit.au début du siècle.
Marx, dans ses différents travaux traitant des crises[1], couvre le sarcasmes Jean-Baptiste Say et ses disciples, qui ne voient dans les crises qu'un déséquilibre entre les différentes branches de la production, et pour qui "une surproduction générale est impossible". Ses critiques, par suite, s'étendent à ceux des "marxistes" qui, après sa mort prétendent que les crises n'ont d'autre origine qu’un développement déséquilibré des secteurs I et II de la production capitaliste (moyens de production et biens de consommation),
En fait, dans le livre III du Capital, Marx insiste essentiellement, pour expliquer les crises cycliques, sur la "loi de la baisse tendancielle du taux de profit" : la part croissante que prend le capital constant (moyens de production et matières premières) par rapport au capital variable (salaires) dans la production, entraîne une tendance à la baisse du taux de profit dans la mesure où celui-ci provient uniquement, de l'exploitation du travail non payé au salarié. Cette augmentation relative du capital constant par rapport au capital variable est intimement liée au progrès technique et à l'augmentation de la productivité ; et, dans la mesure où le capitalisme ne peut vivre sans ces deux facteurs, la tendance à la baisse du taux de profit, et par suite du taux d'accumulation, s'impose au capital avec une force irrésistible. Pour Marx donc, les crises sont les moments où se manifeste avec le plus d'acuité cette contradiction de base du capitalisme :
- "Périodiquement, le conflit des forces antagoniques éclate dans des crises. Les crises ne sont jamais que des solutions momentanées et violentes des contradictions existantes, des éruptions violentes qui rétablissent pour un moment l'équilibre troublé". ("Le Capital livre III" La Pléiade, tome 2, page 1031)
L'inverse des précédents, qui permettent d'entrevoir un développement infini du capitalisme et même une disparition des crises dans la mesure où les capitalistes des différentes branches seraient capables(1) de coordonner leurs productions respectives (par l'intermédiaire de l'État par exemple), cette théorie des crises présente l'intérêt de dégager le caractère temporaire du mode de production capitaliste et la gravité sans cesse accrue des crises qui secoueront la société bourgeoise. Avec une telle vision, on peut donc partiellement interpréter le changement qualitatif, .qui s'est produit entre 19e et le 20e siècle dans la nature des crises : la gravité croissante des crises trouverait son explication dans l'aggravation de la tendance à la baisse du taux de profit mais cette vision ne suffit pas à notre avis à tout expliquer[2] et en particulier à trouver une repense satisfaisante aux deux questions :
- pourquoi les crises se présentent-elle sous la forme d'une crise de marché ?
- pourquoi à partir d'un certain moment, les crises n'ont-elles pu que déboucher sur la guerre alors qu'auparavant, elles trouvaient une solution pacifique ?
Par bribes éparpillées au cours de son œuvre, Marx donne les éléments; qui permettraient de répondre à ces questions et d'établir de façon absolue le caractère nécessairement limité et temporaire du mode de production capitaliste. Dans son étude de la baisse du taux de profit, il analyse les causes qui s'y opposent et font que "la loi n'agit qu'en tant que tendance" donc l’action ne se manifeste nettement que dans certaines circonstances et au cours de longues périodes". Parmi ces causes il relève le commerce extérieur :
- "Dans la mesure où le commerce extérieur rend, en partie, meilleur marché les éléments du capital constant et les moyens de subsistance nécessaires en quoi le capital variable se transforme, il tend à faire monter le taux de profit et, augmentant le taux de plus-value et en diminuant la valeur du capital constant. Il agit généralement en ce sens en permettant d'élargir l’échelle de la production." (ibid, page 1021)
Il est à noter que quand Marx parle de commerce extérieur, il désigne le commerce entre pays capitalistes et économes non capitalistes puisque dans le livre I du Capital il écrit de façon explicite qu’il imagine "pour débarrasser l’analyse générale d'incidents inutiles" que "le monde commerçant" est "une seule nation" et constitue un tout économique, donc, les marches extra-capitalistes jouent, d'après lui, un rôle, dans la lutte du capital contre la baisse de son taux de profit et par suite contre les crises.
Mais il émet également l'idée que ces marchés sont indispensables indépendamment du problème de la baisse du taux de profit :
- "De plus, l'extension du commerce extérieur, base initiale du mode de production capitaliste, 'est issue de ce mode de production même ; celui-ci s'est développé en vertu des nécessités qui lui sont inhérentes, en particulier du besoin d'un marché de plus en plus étendu". (Ibid, page 1021)
Et plus loin, il rattache explicitement cette nécessité au problème de la réalisation de la plus-value :
- "L'existence des moyens de production nécessaires... étant assurée, la création de plus-value n'a d'autres limites que la population ouvrière, si le taux de la plus-value, donc le degré d'exploitation du travail est donné, elle n'a d'autres limites que le degré d'exploitation du travail si la population ouvrière est donnée... Il ne faut jamais oublier que la production de cette plus-value -et la reconversion d'une partie de cette plus-value en capital, ou accumulation, fait partie intégrante de cette production de la plus-value- est le but immédiat et le mobile déterminant de la production capitaliste...
Dès que toute la quantité de surtravail que l’on peut extorquer est matérialisée en marchandises ,1a plus-value est produite. Mais cette production de plus-value n'achève que le premier acte du processus de production capitaliste, le processus immédiat...Vient alors le second acte du processus, il faut que toute la masse de marchandises, le produit total, aussi bien la partie qui représente le capital constant et le capital variable que celle qui représente la plus-value, se vende. Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas les mêmes ; elles diffèrent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature, les unes n'ont d'autre limite que les forces productives de la société, les autres la proportionnalité des différentes branches de production et le pouvoir de consommation de la société. Mais celui-ci n'est déterminé ni par la force productive absolue ni par le pouvoir de consommation absolu ; il l'est par le pouvoir de consommation, qui a pour base des conditions de répartition antagoniques qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites.
II est, en outre, restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus "étendue... Il faut, par conséquent, constamment élargir le marché, si bien que ses interrelations et les conditions qui les règlent prennent de plus en plus la forme d'une loi naturelle indépendante des producteurs et deviennent de plus en plus incontrôlables. Cette contradiction interne tend à être compensée par l'extension du champ extérieur de la production. Mais, plus les forces productives se développent, plus elles entrent en conflit avec les fondements étroits sur lesquels reposent les rapports de consommation." (Ibid, page 1025-26-27)
A l'époque où il était encore révolutionnaire, Kautsky, dans une polémique contre Tougan-Baranowsky, reprend cette idée en la précisant :
"Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché qui s'élargit sans cesse avec l'augmentation de la richesse des premiers et le nombre des seconds, mais ce marché ne s'agrandit pas aussi vite cependant que l'accumulation du capital ni la productivité du travail, et ne suffit pas à lui- seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. Celle-ci doit chercher des débouches supplémentaires à l'extérieur de sa sphère, dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. Elle les trouve et les élargit toujours davantage quoique trop lentement. Car ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension du processus de production capitaliste. Dès que la production Capitaliste s'est développée en grande industrie, comme cela a été le cas en Angleterre dès le premier quart du 19e siècle, elle a acquis une telle faculté d'expansion rapide par grands bonds qu'au bout de peu de temps elle rattrape n'importe quel élargissement du marché. C'est ainsi que chaque période Je prospérité consécutive à toute extension brusque du marché est condamnée de prime abord à une vie brève, dont le terme inévitable est la crise. Telle est, en quelques mots, la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les marxistes orthodoxes et fondée par Marx."[3](1)
Cette explication de Kautsky sur les crises, pour claire qu'elle soit, est encore suffisamment imprécise pour laisser croire que le capitalisme peut trouver indéfiniment des nouveaux marchés et par suite être toujours en mesure de résoudre ses crises. En fait, c'est Rosa Luxembourg qui donne, dans "L'accumulation du Capital" (écrit en 1912, à la veille de la première guerre impérialiste) l'explication la plus précise de ce problème de la nécessité des marchés extra-capitalistes et la plus utile pour la compréhension de l’époque actuelle. Sommairement, sa théorie peut se résumer ainsi :
Si on considère la production totale du capitalisme au cours d'un cycle productif (une année par exemple) on peut affecter aux différentes parties de cette production les débouchés suivants (puisque toute la production doit être vendue pour que soit réalisée sa valeur) :
- une partie de la production de ce cycle a été utilisée, et par suite achetée, comme capital constant C (machines et matières premières) nécessaire à cette même production ;
- une autre partie a été achetée par les travailleurs pour renouveler leur force de travail (capital variable V) ;
- une autre partie a été achetée par les capitalistes pour leur consommation personnel 1© : cette quantité (PLI) correspond à une partie de la masse de la plus-value sociale.
- reste encore une quantité (PL2) de marchandises produites correspondant à l'autre partie de la plus-value destinée à l'accumulation et qui doit être préalablement réalisée donc vendue pour que celle-ci puisse avoir lieu.
A qui peut être vendue cette quantité PL2 de marchandise produite[4] ?
- pas aux ouvriers puisque ceux-ci ont consommé la totalité de leur salaire V et qu'ils ne disposent d'aucun autre moyen de paiement. Une augmentation de leur salaire ne pourrait résoudre le problème pour le capital puisque c'est a- lors son profit qui s'en trouverait amputé d'autant.
- pas aux capitalistes puisque ceux-ci seraient alors contraints de consommer tout leur profit ce qui leur interdirait un élargissement de leur capital.
- par ailleurs la quantité C de moyens de production mise en œuvre dans ce cycle productif ne peut constituer un débouché supplémentaire puisqu'elle est fixe par définition.
Par suite, cette quantité PL2 de marchandises, portion de plus- value destinée à l'accumulation ne peut trouver d'acheteur qu'à l'extérieur du champ de la production capitaliste : agriculteurs, artisans, population des pays coloniaux...
Et historiquement, c'est comme cela qu'on voit se développer
le capital qui trouve dans ces secteurs (à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières nationales) les débouchés nécessaires à son accumulation: depuis sa naissance il a vécu en symbiose avec un monde non capitaliste mais en même temps il l’a progressivement détruit ou absorbé :
"Le capital se substitue -à l’économie marchande simple, après avoir installé celle-ci à la place de l’économie naturelle. Si le capitalisme vit des formations et des structures non capitalistes, il vit plus précisément de la ruine de ces structures, et s’il a absolument besoin pour accumuler d’un milieu non capitaliste, c’est qu’il a besoin d’un sol nourricier aux dépends duquel l’accumulation se poursuit en l’absorbant. Vue dans une perspective historique,' l’accumulation capitaliste est une sorte de métabolisme entre les modes de production capitalistes et pré-capitalistes. Sans les formations pré-capitalistes, l’accumulation ne peut se poursuivre, mais en même temps elle, consiste dans leur désintégration et leur assimilation. L’accumulation capitaliste ne peut donc pas plus exister sans les structures non capitalistes que celles-ci coexister avec l’accumulation. L’accumulation du capital a pour condition vitale la dissolution progressive et continue des formations pré-capitalistes.[5]"
La théorie de Rosa Luxembourg est donc en mesure d’expliquer pleinement les différences entre ces deux âges du capitalisme :
Jusqu’à la fin du siècle dernier, le capitalisme connaît son plein épanouissement: l’existence de marchés extra-capitalistes non encore conquis lui garantit une accumulation sans problèmes. C’est pendant cette période que les grandes puissances industrielles actuelles se hissent à ce rang : l’Angleterre, la France, 1’Allemagne, Les Etats-Unis la Russie, le Japon; et c’est également, pendant cette période que ces puissances se partagent le monde. En même temps que celle du développement du capitalisme, l’histoire du 19e siècle est celle de la colonisation, qui garantit à la métropole des débouchés extra-capitalistes pour ses marchandises. Les cri-, ses de cette époque correspondent à la saturation momentanée des marchés existants mais une nouvelle expansion coloniale permet à chaque fois d’élargir ces marchés, Au début du 20e siècle le partage du monde est terminé.
Désormais pour un pays, la conquête de nouveaux marchés passe par un repartage du monde et par suite par une guerre impérialiste. La crise qui se développe en 1913 voit chacune des puissances impérialistes (et principalement la moins bien lotie en colonies: l'Allemagne) tenter d’arracher des marchés nouveaux au détriment de ses rivales et débouche immédiatement sur la guerre.
Dans la période actuelle la guerre apparaît pour chaque pays comme le moyen de faire payer par d’autres ses propres difficultés économiques: les vaincus do 1918 payent (ou sont supposés payer) des réparations de guerre en même temps qu’ils perdent leurs colonies. Un nouveau partage du monde sort de cette guerre: l’Angleterre victorienne perd sa place de première puissance capitaliste au profit des Etats-Unis. La Première Guerre Mondiale se caractérise par une destruction de capital dans des proportions inconnues jusqu’alors ; la période qui suit, ne correspond pas à une nouvelle expansion mais à une simple reconstruction du capital détruit (et encore ce n’est pas toujours le cas puisqu’on voit jusqu’en 1923 les économies européennes se débattre dans un marasme gigantesque). Et à peine la reconstruction terminée, le monde est de nouveau plongé dans une nouvelle crise qui est la plus grande qu’il ait jamais connue: celle de 1929. Les puissances capitalistes trouvent un exutoire momentané dans cette crise grâce aux grands travaux et à l’industrie d’armement (surtout développée en Allemagne sous le giron du fascisme). Ces productions ont le "grand mérite" do ne pas venir encombrer un marché déjà sursaturé mais en même temps elles ne font que reporter la difficulté à plus tard car cette production n’est pas payée: on assiste seulement à un endettement croissant do l’État. Aucune économie ne peut vivre sur .des dettes croissantes et généralisées: dès 1938 aux USA la crise réapparaît et l’Allemagne ne peut payer l’armement considérable qu’elle s’est constitué qu’en se lançant à la conquête de l’Europe.
La Deuxième Guerre mondiale qui s’en suit dépasse de très loin la Première par la barbarie et les destructions dont elle est le théâtre: villes rasées, économies ruinées, populations exterminées (certains pays perdent jusqu’à 15% de leurs habitants, au total 50.000.000 de morts). Le bilan de cette guerre éclair d’un jour sinistre l’alternative annoncée par Marx et Engels: "ou Socialisme ou chute dans la Barbarie"[6].
Là encore la période qui suit la guerre n’est pas une période d’expansion semblable à celles du siècle dernier mais une période de reconstruction.
LA RECONSTRUCTION DEPUIS 1945
Cette reconstruction se distingue de la précédente par deux traits qui ont fait souvent dire à certains que la véritable reconstruction était terminée depuis longtemps et que nous assistons actuellement à une expansion véritable du Capitalisme:
1. Le volume atteint par la production a dépassé depuis longtemps celui existant à la veille de la guerre sans que cela signifie l'arrêt de la croissance.
2. La reconstruction qui a suivi la Première Guerre Mondiale a duré une dizaine d'années (1919-29), alors qu'il y a maintenant plus de 25 ans que la Seconde est terminée.
Au premier argument il faut essentiellement répondre que la productivité du travail n'a jamais cessé de se développer et qu'elle a même fait depuis la dernière guerre des bonds impressionnants grâce à l'automation et à l'informatique. Par suite il devient impossible d'établir des comparaisons portant sur des volumes de production, la seule chose qu'il soit possible de faire est de définir le mécanisme économique de la reconstruction et d’établir à partir de quel moment ce mécanisme cesse de fonctionner.
Au second argument on peut opposer les remarques suivantes :
1. LES DESTRUCTIONS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE ONT ETE INFINIMENT PLUS IMPORTANTES QUE CELLES DE LA PREMIERE: entre 1914 et 1916 seules les régions des fronts ont été touchées : l'Angleterre, Paris et le Sud de la France, la plus grande partie de l'Allemagne ont été épargnées. Par contre entre 1939 et 1945 il n'est guère que les E.U. parmi les belligérants qui n'ait subi de destructions massives, surtout de par les bombardements aériens qui n'existaient pas dans la guerre précédente. En conséquence, le potentiel à reconstruire après 1945 était incomparablement plus important qu' après 1918.
2. PENDANT CETTE PERIODE, UN CERTAIN NOMBRE DE SECTEURS EXTRA-CAPITALISTES ONT FINI D'ETRE ABSORBES: Il s'agit des secteurs agricoles de pays comme l'Italie, la France ou le Japon (de 1962 à 1968 la population agricole de la France passe de 20,9'j à 15,5% de la population active, mais surtout des anciennes colonies dont "l'indépendance" représente pour les grandes puissances une excellente affaire. En effet, ces pays ne sont plus obligés de maintenir dans leurs anciennes colonies un corps expéditionnaire toujours coûteux, puisque dans celles-ci la police est désormais assurée par un gouvernement local et entretenue par la surexploitation des populations autochtones. Par ailleurs la dotation d'un armement moderne, qui a été la première mesure prise par un grand nombre de nouveaux États, a permis à certains pays, comme la France, d'excellentes opérations commerciales par suite de constituer d'importants débouchés (près du quart des exportations françaises sont constituées par des armements destinés surtout aux pays du Tiers Monde).
3. LA FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE N'A PAS SIGNIFIE IA FIN DE L'ECONOMIE D'ARMEMENT. Alors que la fin de ru guerre de 1914-18 a été suivie par une réduction considérable de la production d'armes (réduction liée à la paix quasi-générale qu'a connu le monde à cette époque), la "Guerre Froide" qui se développe sitôt la Seconde Guerre Mondiale terminée, a conduit les grandes puissances impérialistes à poursuivre l'effort d'armement.
Par conséquent, un des principaux moyens dont disposent les capitalistes pour retarder l’échéance de la crise, a été utilisée dès le début de la reconstruction, alors que dans la période précédente l’industrie d’armement ne s’était développée qu’APRES la catastrophe de 1929. Par suite, la "prospérité" qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale est interrompue plus tard que celle qui a suivi la première. Mais en même temps, le Capital s’est interdit un recours éventuel à l’industrie d’armement pour affronter la récession puisque ce moyen est déjà -et depuis le début- utilisé et que c'est justement cette production qui est, comme on l’a déjà vu, une des causes de la crise monétaire actuelle.
Nous avons donc vu pourquoi la reconstruction d'après 1945 a permis un dépassement considérable du volume de la production d'avant-guerre et pourquoi elle a duré beaucoup plus longtemps que celle d'après 1918. Il s'agit maintenant de déterminer les conditions de cette reconstruction et de sa fin.
Au centre de cette reconstruction il y a évidemment la reconstitution du potentiel productif des pays ravagés par la guerre. A la fin de la guerre, les E.U. se retrouvent avec des capacités productives considérables mises sur pied pour fournir des armements non seulement à ses propres armées mais aussi à colles des pays alliés (il y a jusqu'à l’URGS qui reçoive du matériel américain pendant la guerre). L'Europe et le Japon, par contre, se trouvent avec des économies exsangues et des besoins immenses mais, disposant d'un appareil productif dérisoire, ces pays ne sont pas en mesure de produire des valeurs susceptibles de servir de moyens de paiement.
Le plan Marshall, inauguré en 1947, permet à l'Europe occidentale, grâce à des prêts à long terme (6.521 millions de dollars entre 1947 et 1955) et à des dons (16.990 millions de dollars pendant la même période) d’acheter les premiers biens nécessaires à la reconstitution d'un potentiel économique (en 1949 cette aide représente plus du quart des importations européennes) .
Cette période sc caractérise donc par un double flux de marchandises et de capitaux dans le sens Amérique -Europe. Les marchandises américaines permettent la relance de la production de l'Europe et les capitaux américains, la mainmise des U.S.A. sur son appareil productif puisqu'une bonne part des sommes avancées par ce pays restent en Europe où elles sont investies : l'Europe paye en partie ses dettes en cédant ses entreprises aux compagnies américaines .
Après 1955, les Etats-Unis cessent leur aide gratuite mais les caractéristiques essentielles du marché se maintiennent:
- la balance commerciale des Etats-Unis est excédentaire alors que celle de la majorité dos autres pays est déficitaire.
- les capitaux américains continuent de s'investir plus rapidement en Europe que dans le reste du monde(1) ce qui équilibre la balance des paiements[7] de ces pays mais déséquilibre celle des U.S.A..
Cette situation conduit a un endettement croissant du trésor américain puisque les dollars émis et investis en Europe ou dans, le reste du monde (Euro-dollars) constituent une dette de celui-ci à l'égard des détenteurs de cette monnaie.
A partir des années 60 cette dette extérieure dépasse les réserves d'or du trésor américain (voir fig.7) mais cette non-couverture du dollar ne suffit pas à le mettre en difficulté tant que les autres pays sont endettés vis-à-vis des U.S.A. (remboursables en dollars).Les Etats-Unis peuvent donc continuer a s’approprier le capital du reste du monde en payant avec du papier et le taux de change du dollar se maintenir a une valeur supérieure à sa valeur réelle.
Cette situation se renverse avec la fin de la reconstruction. Celle-ci sc manifeste par LA CAPACITE ACQUIS PAR LES ECONOMIES EUROPEENNES ET JAPONAISE DE LANCER SUR LE MARCHETNTERNATIONAL DES PRODUITS CONCURRENTS DES PRODUITS AMERICAINS : vers le milieu des années 60 les balances commerciales de la plupart des anciens pays assistés deviennent positives alors que, après 1964, celle des Etats-Unis ne cesse de se détériorer (voir fig.No.6 ). Leur potentiel industriel reconstruit, ces pays sont donc en mesure de régler les dettes contractées envers les Etats-Unis et par suite d'accepter de plus en plus difficilement la tyrannie du dollar sur les échanges internationaux (la campagne de de Gaulle au milieu des années 60 chevauchant son "étalon-or" pour une réforme des mécanismes monétaires, marque la tentative du Capital français de se libérer de cette mainmise).
Donc, autour dos années 66-67 nous assistons à un changement de la structure des échanges internationaux :
- les pays européens et le Japon finissent de payer leurs dettes alors que les U.S.A. s'endettent de plus en plus à leur égard, ils acceptent donc de moins en moins l'emprise du dollar
- Le flux de marchandises entre les U.S.A et le reste du monde se renverse, ce qui sc traduit par un ralentissement des exportations et une accélération des importations américaines.
L'accroissement des dépenses militaires américaines contribue de façon sensible -comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article à aggraver cette situation par l’augmentation du déficit de la balance des paiements et le renchérissement des marchandises américaines.
De plus, la réduction des débouchés pour les produits américains renforce la baisse, tendancielle du taux de profit pour les entreprises dos USA (voir figures 4et 5) ce qui réduit d'autant la faculté de celles-ci à accumuler, c'est-à-dire à moderniser leur Capital et faire baisser les prix de revint de leurs produits.
La détérioration de la situation économique commence donc vers 1965; la guerre du Viêt-Nam lui accorde un sursis jusqu'en 1968 ou Johnson est obligé de prendre un certain nombre de mesures contre la fuite des capitaux[8] (1).
Sur le plan commercial les chiffres suivants sont particulièrement significatifs :
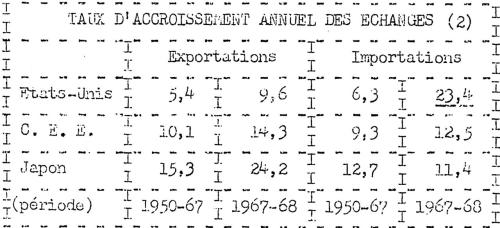
C'est en 1971 que la conjonction des différents facteurs énumérés plus haut joue pleinement on assiste simultanément au premier déficit de la balance commerciale américaine depuis 1893, à une hémorragie sans pareil des réserves d'or du Trésor Américain qui seraient descendues au-dessous du seuil de 10 milliards de dollars sans les mesures du 15 Août, et à une spéculation effrénée contre le dollar.
Les difficultés actuelles du Capitalisme américain et, à sa suite du capitalisme mondial, n’ont donc d'autre signification que la fin de la reconstruction de l’après-guerre[9].
Après une période où celui-ci a survécu et s’est développé en reconstituant son potentiel productif, il se trouve de nouveau confronté au problème qui depuis le début du siècle l’a plongé dans des convulsions de plus en plus profondes : où trouver de nouveaux débouchés ?
La question qu’on peut poser aujourd’hui est donc :
EXISTE-T-IL ENCORE DES DEBOUCHES QUI PERMETTRAIENT UNE RELANCE DU CAPITALISME?
1. Peut-on envisager un redémarrage de l’économie avec un mécanisme inversé des échanges, les E.U. devenant le client de l’Europe et du Japon ?
Une telle hypothèse est absurde car si les marchandises européennes et japonaises sont en train d'envahir le marché américain, l'économie américaine représente encore 40% de la production de 20% des marchés mondiaux. Elle possède d'autre part des fractions énormes du capital implanté dans les pays qui lui font concurrence. Les USA défendront leur capital poings et ongles et mettront toute leur puissance économique, politique et militaire dans la balance pour exporter vers les autres pays les difficultés qui les assaillent. À cet égard l'acceptation passive par les autres gouvernements de la taxe de 10% sur les importations américaines en dit long sur cette puissance.
En outre, si les E.U. importaient d'avantage ce ne serait que pour accroître leur puissance productive qui à l’heure actuelle a déjà besoin, pour subsister, d'immenses débouchés extérieurs. Loin de résoudre le problème celui-ci ne s'en trouverait que posé à une plus grande échelle.
2. Les pays du bloc dit "socialiste" peuvent-ils constituer un marché?
En fait avec des nuances liées aux différences qui peuvent exister entre capitalisme libéral et capitalisme d'État, les pays de l'Europe de l'Est sont confrontés aux mêmes problèmes que les pays occidentaux. La fin de la reconstruction, a signifié pour ces pays un ralentissement notable de la production et le développement d'un chômage qui pour être déguisé n'en est pas moins l'indice de graves problèmes économiques.[10]
Source: Banque des Règlements Internationaux : 40% rapport annuel.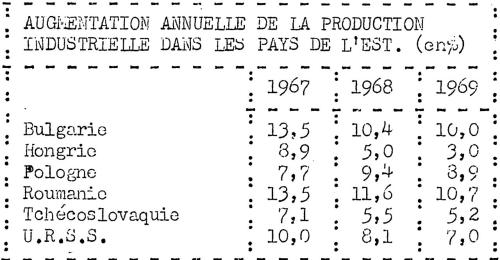
On ne voit donc pas comment ces pays pourraient constituer un débouché pour l'économie occidentale puisque leur propre production n’arrive pas à en trouver.
Par ailleurs certains fondent des espoirs sur le marché chinois que la visite de Nixon à Pékin a ouvert. Certes les besoins de la Chine sont immenses mais pour qu’on puisse lui vendre encore faut-il qu’elle puisse payer et donc exporter à son tour. Or ce n’est pas avec une industrie qui ne produit pas plus que celle de la Belgique, ni avec une agriculture qui suffit à peine à nourrir sa population et dont les produits sont d’ailleurs barrés, sur le marché mondial, par les produits agricoles américains, qu’elle pourra trouver de quoi faire un commerce volumineux avec l’Occident. Les milieux d’affaires américains ne s’y trompent d’ailleurs pas qui affichent leur scepticisme face aux "promesses" du marché chinois.
3. Existe-t-il encore des secteurs extra-capitalistes susceptibles d’être absorbés?
Les secteurs agricoles des grands pays industriels ont connu depuis 1945 des réductions impressionnantes et par ailleurs ils sont aujourd’hui complètement intégrés dans les nasses du capitalisme par le moyen des sociétés de crédit et de distribution[11]. Ce n’est pas là que le Capitalisme trouvera de nouveaux débouchés.
Les pays du Tiers-monde constituent à première vue un secteur extra-capitaliste considérable puisque la presque totalité de la population y est agricole. Mais en fait les économies naturelles de ces pays ont été détruites depuis longtemps par le Capitalisme et sa pénétration: si la presque totalité des populations de ces régions sont exclues de la production et de la consommation capitaliste il n’en reste pas moins que ce qui demeure de l’économie de ces pays est entièrement intégré dans le système capitaliste mondial et est la première à en subir les fluctuations. (Sensibilité extrême des cours des matières premières et produits agricoles) .
Pour que ces pays puissent acheter il faut qu’ils puissent payer, pour qu’ils puissent payer ce qu’ils produisent et pour cela qu’ils disposent d’un équipement industriel. Mais ils produiraient alors des marchandises qui devraient trouver à se vendre sur un marché sursaturé et dominé par les puissances disposant des plus hautes productivités et offrant les plus bas prix.
Depuis la fin de la guerre les grandes puissances capitalistes (de l’Est et de l’Ouest) ont consenti des prêts à ces pays mais cela s’est, traduit essentiellement par la situation suivante;
- les produits nouvellement créés par ces pays n’ont pas trouvé à se vendre plongeant ceux-ci dans une surproduction permanente et un chômage effrayant.
- loin de rembourser leurs dettes ces pays n’ont fait que s'endetter d’avantage (ainsi, la dette latino-américaine à l’égard des USA se monte en Août 71 à 58.943 millions de dollars, et la récolte de coton de l'Égypte est hypothéquée pour une quinzaine d’années surtout au bénéfice de l'URSS principal bailleur de fonds), Or, une économie, quelle qu’elle soit, ne peut vivre sur un endettement croissant, tôt ou tard cet édifice en équilibre instable s’effondre.
4. L'économie d’armement peut-elle constituer un débouché?
Nous ne nous étendrons pas sur ce point ayant déjà largement traité de cette question. Contentons-nous de rappeler les faits suivants:
- la situation est aujourd’hui différente de celle de 1929 puisque les armements constituent déjà près de 10% du PNE des principaux pays ;
- la production d’armement n'est pas réellement payée, elle conduit à un endettement des États et globalement à un appauvrissement même si elle permet à certains capitalistes (ou même à certains pays exportateurs) de s'enrichir ;
- les dépenses militaires sont aujourd'hui une des composantes fondamentales de la crise.
Là non plus n'existe donc de solution au problème des débouchés qui achemine le capitalisme vers l'impasse.
Il est donc temps de reposer la question que nous posions déjà au début de cet article :
ALLONS NOUS VERS UN NOUVEAU 29 ?
Il est apparu que la crise qui s’annonce est bien du type de celles qui ont plongé le monde du XX° siècle dans les plus grandes catastrophes et barbaries de son histoire. Ce n'est pas une crise de croissance comme celle du siècle dernier mais bien une crise de l'agonie.
Sans vouloir faire de pronostics sur le délai on peut donc tracer ainsi les perspectives du monde capitaliste:
- ralentissement massif des échanges internationaux; -guerres commerciales entre les differents pays ; -mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions douanières (CEE, Kennedy Round...)
- retour à l'autarcie;
- chute de la production; augmentation massive du chômage; -baisse des salaires réels des travailleurs.
Face à une telle situation le Capitalisme, comme nous l'avons déjà vu, n’a qu'une seule issue: la guerre impérialiste. Les guerres d'Indochine, du Moyen Orient, du Pakistan où on voit les différents blocs se disputer les zones d'influence par "peuple" et "libération nationale" interposée, constituent le prélude à une telle guerre. D'un autre coté le va-et-vient des chefs d'État, semblable à celui qui a précédé la Seconde Guerre Mondiale, les grandes manœuvres diplomatiques, les renversements spectaculaires des alliances" (pour parler comme la presse bourgeoise) parmi lesquels il faut ranger évidemment l'alliance sino-américaine derrière le Pakistan face à l'URSS, ainsi que le voyage de Nixon à Pékin, participent de cette préparation.
A la question: "allons-nous vers un nouveau 29" nous répondrons cependant par la négative.
La crise de 1929 arrive au lendemain de la plus grande défaite de l'histoire du mouvement ouvrier. La classe ouvrière a été vaincue physiquement et doit en plus subir le poids de la plus grande mystification qui ait jamais pesé sur elle: le mythe du "Socialisme de l'URSS". Sous la férule des partis staliniens ses moindres luttes sont inféodées à la défense delà "Patrie Socialiste", c'est à dire de l'impérialisme Russe. Autres fruits de la contre-révolution, fascisme et anti-fascisme, sont les deux moyens avec lesquels le Capital mobilise les travailleurs de tous les pays pour les amener à la deuxième boucherie inter-impérialiste, sans que ceux-là aient fait le moindre geste sérieux de résistance.
Pour pouvoir faire la guerre, le Capital a besoin d'un Prolétariat vaincu et susceptible d'avaler une bonne dose de mystification: LE PROLETARIAT ACTUEL N'EST PLUS DE CEUX-LA.
Avec les difficultés croissantes du camp socialiste: désintégration en plusieurs pôles antagonistes, luttes ouvrières, le mythe du "socialisme russe" s'effondre.
L'anti-fascisme a besoin d'un fascisme comme repoussoir et celui-ci tardé à venir malgré ce que peuvent en dire les gauchistes officiels.
Enfin, le Prolétariat d'aujourd'hui s'est relevé de ses défaites d'hier: les nouvelles générations ouvrières se jettent dans la lutte avec une ardeur depuis longtemps inconnue. La formidable réponse qu'apporte le Prolétariat mondial aux premières manifestations de la crise laisse augurer de ses réactions quand celle-ci se sera développée pleinement.
Dans ces conditions la perspective qu'ouvre la crise n'est pas la guerre impérialiste -comme en 29- mais bien un développement des luttes révolutionnaires.
Les révolutionnaires se doivent donc de reconnaitre l'arrivée de la crise et même, malgré les souffrances qu'elle infligera de nouveau au monde, de la saluer puisqu'elle annonce la possibilité de nouveau actuelle de la REVOLUTION SOCIALISTE MONDIALE.
C. Giné
-------------------------------------------------------
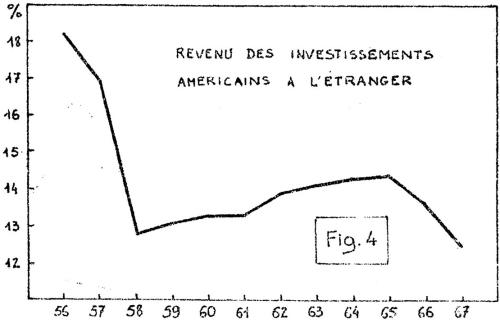
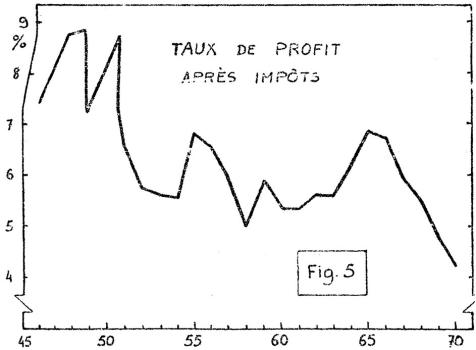
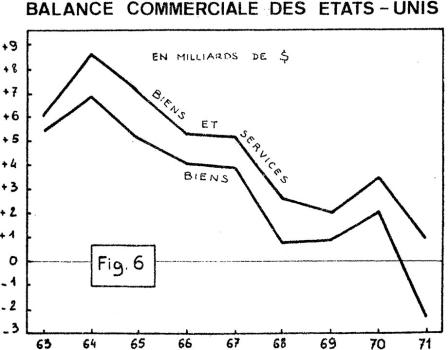
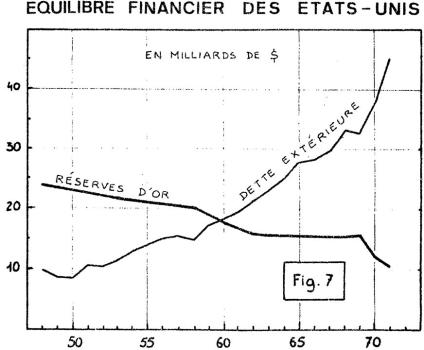
[1] Il s'agit essentiellement d'œuvres posthumes.
[2] Il faut, remarquer, que malgré une certaine baisse par rapport à ceux du siècle dernier, les taux de profit actuels sa sont maintenus à une valeur appréciable de 1'ordre de 10% maintien qui est essentiellement imputable à la formidable augmentation du taux d'exploitation subie par les travailleurs : sur une même journée de 10 heures, si l'ouvrier du 19e siècle en travaillait 5 pour lui et 5 pour le capitaliste (rapports fréquemment envisagés par Marx), l'ouvrier actuel en travaille 1 pour lui et 9 pour le patron.
[3] Cité par Rosa Luxembourg dans "L'accumulation du capital" Chapitre III, page 272 de la "Petite collection Maspero"
[4] Il est à noter que ce problème ne Se pose que parce que tout le profit n'est pas consommé par le capitaliste et qu'une partie de celui-là est destinée à l1 accumulation » Dans le cas d'une économie avec reproduction simple il n'y aurait donc pas de problème... liais le capitalisme est justement un système qui ne peut vivre qu'en élargissant constamment le champ de sa production.
[5] Rosa Luxembourg . "L’accumulation du capital". Œuvres IV, pg.85, petite collection Maspero
[6] Et il se trouve encore des imbéciles pour juger que notre société ne se trouve absolument pas dans une phase de décadence et que le Capitalisme ne s’est jamais aussi bien porté !
[7] Les investissements américains dans le monde évoluent comme suit (en milliards de dollars):
|
|
1956 |
1960 |
1965 |
1967 |
|
TOTAL |
22,5 |
31,8 |
49,5 |
70,7 |
|
Part de 1'EUROPE |
|
6,7 |
13,9 |
21,6 |
[8] (1) les mesures Nixon ne sont donc pas les premières du genre mais elles sont ben plus draconiennes que les précédentes : à maux plus graves remèdes plus énergiques.
(2) Manuel de Stats du Commerce International et du Développement. 1969.
[9] Il est significatif à cet égard qu'une part croissante des importations américaines soit constituée par des moyens de production et en particulier de l'acier, (chiffres en millions de dollars) :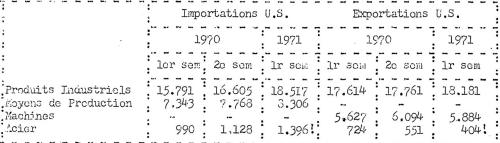
[10] cf. l’article de Pierre Drouin dans "le Monde"- du 14 bars.
[11] voir "R.I." N°4, "Le Problème Paysan".
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Volontarisme et confusion
- 15 lectures
À propos de l’abandon, non réformiste, du "catastrophisme révolutionnaire", et de la brochure "organiser le courant marxiste révolutionnaire".
"Voilà trois semaines qu'il ne pleut plus. Je crois qu'il ne pleuvra jamais plus"... Aussi curieux que cela puisse sembler -dans la plupart des cas- c'est un raisonnement analogue qui est tenu par tous ceux qui -en présence de la stabilité plus ou moins continue du capitalisme depuis la Seconde Guerre Mondiale- ont conclu à la fausseté des visions marxistes prévoyant d'inévitables crises du capitalisme. Ce "beau temps" n'a pas manqué d'éblouir certains groupes révolutionnaires tels que "Socialisme ou Barbarie" (Cardan), ou "Solidarity" en Angleterre (se réclamant aussi de Cardan)[1].
Cependant, les véritables "détracteurs" de la théorie des crises inéluctables du capitalisme ont toujours été les économistes bourgeois, soucieux tant de démentir le marxisme que d’affirmer l’aspect "éternel" et "naturel" de leur système d’exploitation.
Mais, "habit volé ne va pas au voleur" : en prenant aux bourgeois la thèse de base de leur économie politique, les révolutionnaires ne pouvaient aboutir qu'à une branlante et incohérente théorie de la révolution, porte ouverte à toutes sortes de pressions opportunistes.
Le "Groupe Marxiste pour le Pouvoirs des Conseils des Travailleurs" en publiant sa brochure "Organiser le Courant Marxiste Révolutionnaire" a montré de quel prix élevé l’intransigeance révolutionnaire doit parfois payer de tels emprunts à l'idéologie de la classe dominante.
Le fait que la crise de 1929 n’ait pas abouti à un soulèvement révolutionnaire mais à la guerre impérialiste et à la "prospérité" que provoquera la reconstruction qui suivit celle-ci, ont poussé ce groupe non seulement à abandonner ce qui constitue la base du socialisme scientifique mais encore à prétendre que cette vision de la crise nécessaire est étrangère au marxisme.
Ainsi ils écrivent, qu'avec la grande prospérité de post-guerre : ..."Les révolutionnaires qui n’avaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective -présentée comme pierre de touche du marxisme- d’une catastrophe inévitable de l’économie capitaliste, ne semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachroniques. Le Marxisme, continuent-ils, ne projette pourtant pas la vision d'une décadence inexorable et d’un effondrement nécessaire de la société d'exploitation."(p.2)
Les "réalistes" auteurs de la brochure auraient peut-être dû se demander qu’est-ce-qui avait poussé tous ces "chimériques" révolutionnaires à fonder si souvent, non seulement leurs "espoirs" mais aussi leurs analyses sur cette perspective "catastrophique" de l'économie capitaliste.
La vision matérialiste de l'histoire a montré que la disparition des sociétés passées n'a jamais été le fait de la SEULE volonté des hommes; que jusqu'à présent et jusqu’au socialisme ceux-ci ont dû rester soumis en dernière instance à leur économie, (et non l’inverse). Elle a permis de comprendre pourquoi des mouvements comme celui de Spartacus dans l'antiquité, ou de la Commune de Paris au XIX siècle, malgré l'immense force de volonté qui les caractérisa, étaient condamnés d'avance à l'échec du moment que les systèmes économiques auxquels ils s'attaquaient avaient encore un rôle progressiste dans l'histoire.
Loin d’avoir été le résultat de la PURE volonté des hommes (il faudrait d’ailleurs avoir une conception particulièrement masochiste de l’humanité) les rapports sociaux qui ont constitué les différentes sociétés passées se sont imposés à eux comme les seuls possibles dans un cadre de développement donné des techniques.
"Dans la production sociale de leur existence les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, INDEPENDANTS DE LEUR VOLONTE, rapports de production qui correspondent à un degré de développement détermine de leurs forces productives matérielles". (Marx[2],) (souligné par nous).
De cette aliénation à l’économie découle que le dépassement d’un système doit, pour être possible, correspondre à l’épuisement objectif des ressources de celui-ci. Il faut que -comme ensemble de rapports sociaux- le système se heurte irrémédiablement à ses propres limites, plongeant la société en de telles crises que le passage à un nouveau type de société devient le seul moyen, d'empêcher le recul de l’Humanité. Alors, et seulement alors, la volonté révolutionnaire, qui tend à jaillir de plus en plus spontanément, au sein de la classe porteuse d’une solution, trouve la possibilité de se CONCRETISER dans un véritable bouleversement révolutionnaire.
Face au volontarisme des socialistes utopistes pré-marxistes, le Marxisme ne démontrait donc pas l'INUTILITE DE LA VOLONTE mais son INSUFFISANCE. Il n'a pas nié le rôle fondamental de la volonté et de la détermination révolutionnaire du prolétariat. Il lui a donné au contraire son contenu réel, en dégageant le cadre historique dans lequel cette volonté devait cesser d'apparaître comme pure EXPRESSION DE DESESPOIR pour se transformer en MOTEUR DE L'HISTOIRE.
C'est montrer son ignorance -ou croire à celle des autres-que prétendre -sous prétexte "d'anti-mécanicisme"- que "le Marxisme ne projette pourtant pas la vision d'une décadence INEXORABLE et d’un EFFONDREMENT NECESSAIRE de la société d'exploitation".
Une vision de la Décadence
Pour Marx, le Capitalisme, comme tous les systèmes qui l'ont précédé connaît une période de plein épanouissement : c’est celle où les rapports de production capitaliste constituent LES SEULS compatibles avec un niveau donné de développement des forces productives. Mais ce développement connaît une limite : à un stade donné, les forces matérielles engendrées par le Capitalisme deviennent à leur tour, incompatibles avec la base sociale constituée par les rapports capitalistes. De condition et stimulant de ce développement la base capitaliste se tourne en entrave. Dès lors la destruction et le dépassement de l’ancien cadre devient le seul moyen d’assurer une véritable continuation du développement. Une fois ce point atteint par le Capitalisme, tant que le Prolétariat -seul protagoniste possible de ce dépassement révolutionnaire- ne parvient pas à détruire l’ancienne base (capitalisme) et à instaurer une nouvelle (socialisme) (seul véritablement compatible avec le niveau atteint par les forces productives), le Capitalisme se SURVIT, évidemment, mais il entre alors en sa phase de décadence, de DECLIN.
- "Le point d’épanouissement le plus haut de cette base même est celui où elle a atteint une forme qui la rend compatible avec le plus haut développement des forces productives, et par suite aussi avec le plus riche développement de l’individu. Dès que ce point est atteint, LA SUITE DU DEVELOPPEMENT APPARAIT COMME UN DECLIN ET LE DEVELOPPEMENT NOUVEAU COMMENCE A PARTIR D'UNE NOUVELLE BASE" (Marx, "Principes d'une critique de 1'Economie Politique", Ed. La Pléiade, p.252,253, T.II)-(souligné par nous).
Il est donc vrai que la période de DECLIN du capitalisme n'est pas envisagée par Marx comme INEXORABLE, inévitable. C’est, en effet, souvent que Marx cru au XIX siècle que la crise fondamentale du Capitalisme était imminente alors qu’il vivait la grande période de plein essor du Capitalisme, les crises pouvant éclater alors n’étant que des crises de croissance. "Un spectre hante l'Europe: le spectre du Communisme" écrivaient Marx et Engels dans le Manifeste en présence de la crise économique et sociale du 4 juillet 1948. Mais Engels devait lui-même expliquer plus tard, lucidement, l’erreur de leur analyse :
- "L'histoire nous a donné tort à nous et a tous ceux qui pensaient de façon analogue. Elle a montré clairement que l’état du développement économique sur le Continent était alors bien loin encore d’être mur pour la suppression de la production capitaliste" (introduction à "Luttes de Classes en France")
Si le capitalisme avait atteint ses limites définitives au cours du XIX siècle et que 1’éffondrement qui en aurait découlé avait été accompagné d'une intervention triomphante du prolétariat, on serait passé quasi-directement de l'essor capitaliste à celui du socialisme, avec la Seule interruption de la crise mondiale. L'Humanité n'aurait pas connu -comme elle devra le faire à partir de la Première Guerre Mondiale et de la Crise de 29- la phase, de DECLIN capitaliste avec toute la "BARBARIE" qui a caractérisé les dernières 50 années de l’histoire.
Marx, comme tout révolutionnaire, était poussé à surestimer les chances de la révolution et misa évidemment plutôt sur son triomphe que sur la "barbarie décadente" que son non avènement devait faire retomber sur l'humanité. En ce sens, et seulement en ce sens, il est vrai que Marx ne projeta pas l’INEXORABIUTE ; L'INELUCTABILITE de la décadence capitaliste. Il n'envisagea ce déclin que comme une hypothèse théorique au cas d'échec des réponses révolutionnaires aux premières manifestations d’un véritable effondrement capitaliste.
Un effondrement nécessaire
Mais s'il est vrai que Marx pouvait considérer non-inéluctable une longue période de décadence capitaliste, il est cependant purement aberrant de prétendre qu'il "ne projeta pas la vision d'un effondrement nécessaire." de la société capitaliste, "Une formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir" -dit Marx. Démontrer que le Capitalisme était condamné -à l'égal de tous les systèmes qui l’ont précédé- à un effondrement objectif produit de ses propres contradictions économiques internes, voilà quel était l'un des buts essentiels des travaux économiques de Marx.
Les études sur "la baisse tendancielle du taux de-profit" ou celles sur la contradiction entre les conditions de production et celles de réalisation de la plus-value n'étaient pas des éléments d'un manuel de gestion capitaliste indiquant des "dangers à éviter" mais bien des définitions des impasses inévitables auxquelles le capitalisme devait se heurter. Pour Marx, le Capitalisme, pas plus que les systèmes antérieurs, ne parviendra à assurer un développement indéfini et éternel des forces productives de la société. Et les racines de cette inviabilité historique se trouvent dans des lois objectives, globales, et': en dernière instance, "indépendantes de la volonté des hommes',! La tendance à l'élévation de "la composition organique du capital" ou la nécessité d'un "élargissement constant du marché extérieur", (phénomènes déterminés par l'obligation de développer constatent la productivité du travail), causes des contradictions aux niveaux du taux de profit et des débouchés, ne sont ni des phénomènes subjectifs ni des résultats de l’action du prolétariat (même si celle-ci influe sur eux). Ce sont des lois objectives qui s'imposent à la société du moment qu'elle produit selon des rapports capitalistes.
Aussi, cet effondrement est-il non seulement ENVISAGÉ mais encore considéré par Marx comme NECESSAIRE (quoique non SUFFISANT) à l'éclatement et à l’aboutissement d'une révolution socialiste.
"Étant donné cette prospérité générale -écrit Marx dans les luttes de classes en France- dans laquelle les forces productives de société se développent aussi abondamment que le démentir -sinon se contredire- immédiatement au paragraphe suivant: "Cependant la "fuite en avant" du Capitalisme ne peut pas être assimilée à l’emballement d’un moteur conduisant à la panne fatale. Dans la mesure où le processus historique est le produit de 1’action des classes sociales et non des lois objectives auxquelles les hommes seraient mécaniquement soumis le Socialisme n’est pas inéluctable".
À moins de prendre le lecteur pour un imbécile, il est évident que ce qu’on veut lui dire n’est pas qu’il n’y a pas de révolution prolétarienne sans action du prolétariat. Ce qu’on tente de lui expliquer c’est que sans action du prolétariat il n’y a pas d'effondrement du système. Ce qui n'est plus une tautologie mais une imbécillité.
Car, comment expliquer alors la crise mondiale de 1929?
La plus grave crise qu’ait connu jusqu'à présent le Capitalisme (il fallut aller jusqu'aux destructions massives et aux 50 millions de morts de la Seconde Guerre Mondiale pour la résoudre) se produit au moment même où le prolétariat vient de subir une défaite sanglante aussi bien dans les pays les plus développés qu’en Chine ou en Russie où la contre-révolution stalinienne règne définitivement sur les cendres de la Révolution de 1917. Cette situation de défaite historique de la classe ouvrière mondiale permet de comprendre pourquoi la crise de 29 a pu aboutir au fascisme dans certains pays et en tout cas n'ait pour ainsi dire engendré nulle part un véritable mouvement révolutionnaire. Mais elle dément radicalement que ce soit la lutte révolutionnaire du Prolétariat- qui ait pu provoquer le chaos de 29. Celui-ci au contraire, s’est imposé à la société comme l’expression parfaite de l'impossibilité pour le Capitalisme de résoudre ses contradictions économiques internes, comme le blocage objectif du développement des forces productives par les rapports de production existants.
Peut-être pour les auteurs de la brochure la crise de 1929 .n’est pas un "effondrement" de l'économie capitaliste. Il ne s'agirait que d’une crise passagère dont le capitalisme -puisque le Prolétariat "lui en a laissé la possibilité[3]" -se serait très bien tiré.
C’est à dire, on ne conçoit "effondrement" de l'économie capitaliste que s’il est synonyme de révolution socialiste. Mais, n’est-ce pas là une véritable vision mécaniciste de l’histoire ?
L'histoire des sociétés passées qu'il n'y a jamais eu concordance immédiate entre l'effondrement économique d’une société et sa conséquence ultime: sa disparition et son dépassement par un nouveau système. Entre l’écroulement de l’économie sous le poids des contradictions interne.: du système et l’instauration de nouveaux rapports il y a toujours eu une période de crises croissantes, de déclin et de tendances à la décomposition de la société et de tous les rapports qui la constituent. C’est, nous l’avons dit, la phase de décadence d’un système.
Il n’y a pas besoin d’être marxiste pour constater que la crise de 29 n'aboutit pas au socialisme, Mais il faut avoir été totalement aveuglé par les éclats des pires apologistes de l’économie bourgeoise pour ne pas voir que la crise de 29, ainsi que la Première Guerre mondiale, ont marqué les débuts d'une nouvelle forme de vie du Capitalisme, celle de sa décadence. Sans prétendre -comme le font dans le plus pur dogmatisme, certains trotskistes- que le Capitalisme a -au sens littéraire du terme- cessé de développer TOUTE force productive, il est évident que depuis lors -comme le dit Marx- "la suite du développement apparaît comme un déclin". La vie de la société a en effet été caractérisée par le "développement" d'une économie fondée sur la reconstruction de ce qu'elle détruit systématiquement et régulièrement. La guerre, destructrice de travail passé, et .la production d’armement, destructrice de travail présent et futur, ont cessé d’être des accidents occasionnels, des phénomènes accessoires pour devenir forme de vie sociale et moteur d’un développement économique qui ne peut par conséquent être qu'apparent et momentané. La Justification historique du Capitalisme s’écroule et avec elle toutes les valeurs morales, les institutions et les rapports sociaux entrent dans une crise permanente et croissante.
La crise de 29 n'a plus rien à voir avec les crises de croissance du XIX siècle. Le fait que le Capitalisme n'ait pu s'en relever que grâce à la Seconde Guerre Mondiale et par le maintien par la suite de guerres locales permanentes, atteste d'une part de LA FIN DE LA PERIODE DE PROSPERITE HISTORIQUE DU SYSTEME et d'autre part de l'aspect OBLIGATOIREMENT MOMENTANE DE TOUTE EXPANSION ECONOMIQUE: car un système de production fondé sur la destruction est historiquement voué à la décomposition et parce que toute reconstruction, aussi "poussée" et rationnelle soit-elle, connaît, obligatoirement, une fin.
Contrairement à ce qui est dit dans la brochure, depuis la première Guerre Mondiale, tout "développement" du capitalisme ne peut être "qu'assimilé à l'emballement d'un moteur conduisant à la panne fatale" La lutte du Prolétariat peut ACCENTUER les conditions de cette "panne" et cette crise peut aboutir à un bouleversement révolutionnaire si l'action consciente du prolétariat se développe et triomphe. Mais la crise éclate, tout comme celle de 1929, indépendamment de la volonté des hommes.
Les contradictions
En fait, c’est en vain qu’on cherchera dans la brochure une idée véritablement claire au sujet des contradictions du Capitalisme. Alors que le Marxisme définit distinctement d’une part des contradictions de classes et d’autre part des contradictions économiques internes aux rapports de production capitalistes, on ne trouve dans le texte que le mot "contradictions du capitalisme" sans autre précision, ce qui -vu la question traitée- laisse le lecteur dans la confusion la plus totale.
En fin de compte, lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les conditions qui créent une situation révolutionnaire on commence par abandonner sans équivoque toute idée de crise économique. Voulant certainement aller jusqu’au bout de leur pensée les auteurs arrivent même à voir dans l’expansion économique la condition de l’approfondissement de la lutte des classes. "LA POURSUITE DE L’EXPANSION ENGENDRE AINSI UNE RIPOSTE QUI TEND À METTRE EN CAUSE LES STRUCTURES DE L’ENTREPRISE ET LE POUVOIR PATRONAL. Elle crée les conditions d’un approfondissement de la lutte des classes."!
Comment cette expansion peut-elle provoquer une crise révolutionnaire? "Le développement du Capitalisme -répondent-ils- accentue les tensions, les déséquilibres, l’insatisfaction en suscitant dans tous les domaines des besoins qu’il est incapable de satisfaire (...) De l’insatisfaction à la révolte, il n’ y a qu’un pas: la jeunesse le franchit" Ces tensions, cette insatisfaction seraient surtout importantes dans les entreprises les plus modernes : "En réalité -écrivent-il- c’est une crise profonde du système de salariat lui-même qui s’annonce, crise dont les racines objectives se trouvent dans les transformations que subit le travail dans les entreprises les plus modernes"
C’est une mièvre et très universitaire explication sociologique qui prétend découvrir une "insatisfaction" nouvelle -comme si les conditions d’exploitation de la classe ouvrière depuis 150 ans avaient pu être significativement moins "insatisfaisantes", ou avaient engendré des "tensions" moindres- qui croit voir dans un phénomène de "jeunesse" ou autre conflit de génération une explication fondamentale aux problèmes du processus de la lutte des classes; qui se perd dans des détails du style "les entreprises les plus modernes", à l’heure même où les vieilles mines européennes ou les chantiers navales vétustés britanniques constituent des centres parmi les plus avancés de la lutte prolétarienne. Nous ne retiendrons de ce verbiage superficiel qu’un élément: la seule détermination désignée pour expliquer l’apparition d'une situation révolutionnaire consiste en fin de compte dans la volonté de la classe de refuser ses conditions de vie et de travail.
Derrière la sociologie "moderne" c’est le vieux volontarisme qui réapparaît.
Nous ne ferons que rappeler la vieille constatation de Lénine: Pour qu’une véritable situation révolutionnaire se produise il ne suffit pas que ceux d’en bas NE VEUILLENT PLUS Encore faut-il que "ceux d’en haut" NE PUISSENT PLUS continuer à faire fonctionner leur système d’exploitation, c’est à dire que celui-ci se grippe, entre en crise, sans que ni la volonté des uns ni la résistance des autres n’y puissent rien.
La compréhension de deux des caractéristiques essentielles de la révolution prolétarienne permet de saisir immédiatement pourquoi sans crise économique profonde il n’y a pas de révolution véritable possible.
1) LA REVOLUTION N'EST PAS UNE SERIE DE REFORMES mais le bouleversement radical des fondements mêmes du système, la mise en question définitive des lois économiques qui constituent le Capitalisme. C’est pourquoi elle ne peut éclater dans toute son ampleur que si la nécessité du dépassement des anciens rapports devient un besoin inéluctable, que si les mécanismes anciens apparaissent dans toute leur IMPUISSANCE comme cause immédiate de l’aggravation de la misère. SEUL ALORS LE SYSTEME LUI-MEME PEUT DEVENIR LA CIBLE DIRECTE DE L’ACTION CONSCIENTE DE LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE. Autrement les luttes prolétariennes s’épuisent en combats parcellaires, restant la proie des mouvements réformistes de toute sortes,
2) LA REVOLUTION NE PEUT ETRE -ni par ses moyens ni par ses buts- UN MOUVEMENT LOCAL, NATIONAL. Elle doit être mondiale ou elle ne peut pas être. Or, UNE CRISE, SI ELLE N’EST PAS ECONOMIQUE, N’A AUCUNE RAISON D’ETRE MONDIALE. C’est pourquoi parler de REVOLUTION INTERNATIONALE -et condamner la thèse stalinienne du "Socialisme en un seul pays"- tout en abandonnant la vision de l’inéluctabilité de la crise économique du Capitalisme, c’est se condamner à faire du Socialisme une pure UTOPIE[4].
Ce volontarisme utopiste qui doit obligatoirement accompagner l’abandon du "catastrophisme révolutionnaire" -"véritable pierre de touche du marxisme"- transparaît tout au long des positions exprimées dans la brochure; et plus particulièrement en ce qui concerne 1' analyse de la question du Parti Révolutionnaire, l’approche du "Contenu du Socialisme" et la "Question Nationale".
LE PARTI REVOLUTIONNAIRE
Comme il arrive souvent pour les conceptions parcellaires, la vision volontariste ignore les rapports qui engendrent et déterminent l'élément parcellaire qu’elle doit situer au centre de ses analyses.
Ignorant les crises économiques -et celles-ci étant en dernière instance le fondement même de la conscience révolutionnaire- les volontaristes sont inévitablement amenés à surestimer le rôle du Parti Ouvrier comme facteur agissant au niveau du développement de la conscience et de la volonté révolutionnaire. Ce qui aboutit à des résultats assez ridicules lorsqu'on prétend en même temps faire la critique de la théorie "léniniste" à ce sujet.
Le Lénine de "Que Faire" prétendait que la classe ouvrière par elle-même ne pouvait parvenir qu'à un niveau de conscience "trade-unioniste". Seul Le Parti pouvait donner aux luttes ouvrières un contenu révolutionnaire.
La brochure affirme: "Les positions léninistes sur la Parti ne peuvent être considérées comme une théorie valable pour toute une période historique" ... "La nécessité d'un nouveau Parti ne découle pas de l'impossibilité pour le prolétariat de dépasser un niveau de conscience "trade-unioniste" sans l'intervention du parti, ne découlé pas du fait que les travailleurs ne seraient capables d'engager des luttes politiques que dans la mesure où le Parti leur insufflerait, jour après jour, par sa propagande, ses mots d'ordre, ses actions exemplaires, le contenu de son programme" (pg.23-25)
Face à la conception Léniniste on écrit cependant: "L'histoire récente -Espagne, Hongrie, Pologne- a montré qu'en l'absence d'un parti révolutionnaire la classe ouvrière peut mener des luttes politiques mettant en cause la société toute entière. Mais elle a montré aussi qu'en l'absence d'une avant-garde organisée et solidement implantée définissant les objectifs transitoires et finaux de la lutte, ainsi que le rôle des nouveaux organismes créés par les travailleurs, agissant donc comme une force politique cohérente dans le processus révolutionnaire, la créativité des masses ne parvenait pas à briser définitivement les anciennes institutions".
C'est ce qu'on appelle défendre une idée juste avec des arguments suffis animent faux pour déteindre sur la justesse de l'idée défendue. Car cette "critique" de la conception léniniste du parti se résume à une pure question quantitative. Lénine limite les possibilités d'action "autonome" de la classe au "trade-unionisme" ; le texte la repousse un peu jusqu'à l'impossibilité de "briser définitivement les anciennes institutions". Mais la vision des rapports entre Parti et Classe reste tout aussi fausse et étriquée que celle de Lénine. (Ou que celle de certains "Conseillistes" qui ont cru résoudre le problème en repoussant cette limite jusqu'au bout niant la nécessité de quelque parti que ce soit).
Dans tous les cas la question est abordée sous un angle parcellaire, en tenant compte du seul rapport "Parti vers classe".
La démarche de cette conception simpliste est la suivante: on constate un fait: lorsque la lutte reste sur le terrain réformiste ou de la simple "mise en cause" , le Parti Révolutionnaire est insignifiant ; lorsque la lutte prend un contenu révolutionnaire le Parti est fort. Conclusion? C'est la Parti qui donne un contenu révolutionnaire aux luttes.
Cependant, du fait que Parti et Classe sont des éléments d'un même mouvement ils sont liés par une inter-relation dialectique. C'est dire qu'il existe un rapport -au moins aussi important- qui s'établit dans le sens "classe vers Parti" La réalité de ces inter-relations n'a rien à voir avec l'habituelle relation mécaniciste (souvent mystique) de cause (Parti) à effet (mouvement révolutionnaire de la classe).
De la même réalité constatée ci-dessus un rapport inverse se déduit: le Parti révolutionnaire est engendré par le mouvement révolutionnaire. L'histoire montre qu'un mouvement appelé à devenir révolutionnaire n'a jamais à ses débuts de perspective claire de bouleversement total. Il se caractérise au contraire par la conservation des illusions réformistes et par des actions timorées. Les grands partis des débuts sont toujours des partis liés à l'ancien ordre existant, porteurs de l'idée d'une possible réforme qui résoudrait les problèmes qui ont provoqué le mouvement sans avoir recours à un véritable bouleversement révolutionnaire, Les partis révolutionnaires se voient -par contre- relégués à être de petites minorités peu influentes, généralement considérées comme trop "puristes", ou trop "intransigeants" et en tout cas manquant de réalisme.
Ainsi, à leurs premiers pas aussi bien la Révolution Russe que l'Allemande ont été marquées par l'écrasante prédominance social-démocrate. Dans la conception volontariste la seule explication à un tel phénomène, pourtant général, ne peut être trouvée que dans le manque de "militantisme" ou de volonté au sein des éléments révolutionnaires par rapport aux militants réformistes. Ce qui est une pure aberration.
L'isolement des révolutionnaires est d’abord la conséquence de l'inévitable décalage qui existe en temps de "paix sociale" ou aux débuts d'un mouvement de classe entre le programme révolutionnaire et la réalité réformiste des luttes. Les "Spartakistes" ou les "Bolcheviks" n'ont gagné en force et en influence qu'au cours des luttes et à mesure que le processus de celles-ci se radicalisait. C'est à dire à mesure que le problème du bouleversement révolutionnaire s'imposait aux masses comme une alternative CONCRETE.
Aussi est-ce le mouvement révolutionnaire qui en réduisant dans les faits l'écart entre programme Révolutionnaire et lutte de la classe, en fournissant aux partis révolutionnaires l'essentiel du nombre de ses membres, en bouleversant souvent de vieilles positions révolutionnaires, en créant un champ réel d'intervention fait du parti (ou des groupes de révolutionnaires) un véritable parti d'intervention et d'action,
C'est en ce sens que -bien que le parti soit un INSTRUMENT INDISPENSABLE QUE SE DONNE LA CLASSE COMME ACCELERATEUR ET CATALISEUR FONDAI-1ENTAL DU COURANT REVOLUTIONNAIRE- en dernière analyse c'est le mouvement révolutionnaire qui engendre véritablement le Parti et non l'inverse.
C'est parce que l'Être tend à devenir conscient que l'organisation des plus conscients se crée et non parce qu'il existerait une conscience organisée que l'Être serait engendré.
Ignorer l'un des rapports dialectiques qui lient Parti et lutte de la classe, ne pas tenir compte de façon SIMULTANEE de la façon dont l'un réagit sur l'autre, c'est se condamner à une vision parcellaire, tronquée et donc erronée du problème.
Ainsi la seule explication que peut fournir la brochure du non-aboutissement révolutionnaire des luttes en Espagne, Hongrie, Pologne est "l'absence d'une avant-garde organisée et solidement implantée" Et, à la question de savoir pourquoi cette avant-garde n'a pas existé, la seule réponse ne peut être trouvée que dans le manque "d'impulsion des éléments les plus avancés" c'est à dire l'absence de volonté chez quelques individus.
C'est l'inévitable et absurde corollaire de l'abandon de la thèse de la nécessité de la crise économique.
Il est vrai que le GMPPCT affirme très justement deux positions fondamentales sur la question du Parti; l'une c'est la NECESSITE de cette organisation politique du Prolétariat, l'autre le rejet total de la thèse selon laquelle la dictature du Prolétariat pourrait être celle de son Parti. Lais aussi justes soient-elles -du moins dans les intentions qu'elles traduisent- elles portent la faiblesse et la fragilité des positions incohérentes, voire contradictoires, avec l’ensemble de la pensée qui les accompagne.
LE CONTENU DU SOCIALISME
Pour ce problème encore l'incompréhension de ce qui constitue l'apport scientifique du Marxisme, force les auteurs de la brochure à aborder le problème de ce qui sera la société future avec la même démarche que les courants utopistes pré-marxistes.
Pour ces derniers, de même que la fin du Capitalisme devait résulter de l'inviabilité des injustices que son existence provoquait, la définition de la nouvelle société devait résulter de la négation de ces injustices et la correction des défauts de la société capitaliste.
Si un tel raisonnement avait été tenu pendant la société antique esclavagiste ou dans le féodalisme, on aurait dû prévoir la société post-esclavagiste, ou post féodale, comme devant être le socialisme. (Ce qui fut, d’ailleurs, fait, aussi bien dans une société que dans l'autre, par des sectes religieuses).
Le Marxisme devait rejeter cette démarche et montrer que ce qui détermine le contenu d'une nouvelle société c'est d'abord et avant tout sa capacité à résoudre les contradictions qui ont mené la société passée à la faillite.
Le Capitalisme s'est avéré être bien plus inhumain que le féodalisme. Cependant, l'histoire a vérifié qu'il était le seul système permettant d’assurer un développement des forces productives à la suite du Féodalisme, le seul capable de représenter un dépassement des contradictions de la Société Féodale. L'histoire ne retient que ce critère.
La définition du Contenu du Socialisme ne peut pas avoir comme seul fondement la recherche d'un monde plus humain, mais bien la détermination de l'ensemble des rapports économiques et sociaux qui constitueront un dépassement possible des contradictions qui ont mené le Capitalisme à une impasse économique.
Le point de départ doit donc être l'étude des contradictions internes SPECIFIQUES du Capitalisme. Or les auteurs de la brochure ne retiennent comme "contradiction" que l'opposition entre "DIRIGEANTS et EXECUTANTS".
"Dans l'activité productive, la division entre appareil de production et masse d'exécutants, en étouffant les capacités créatrices de la majorité de la population, stérilise quotidiennement une somme colossale d'énergie qui, soit restent inemployées, soit s'investissent partiellement dans la résistance des producteurs aux impératifs de la production elle-même". (pg.16)
Puisqu'on part de la base qu'il n'y a pas de crises économiques, ni possibles ni nécessaires, on ne dit pas un mot sur les limites imposées à la production capitaliste par son aspect marchand ni par la nécessité d'un taux de profit suffisant.
Mais, aussi bien la société esclavagiste que la féodalité étaient divisées en "dirigeants et exécutants", elles "étouffaient autant les capacités créatrices" et "stérilisaient" aussi bien "une somme colossale d'énergies". Elles ne furent pas moins suivies de sociétés avec de nouveaux "dirigeants" et de nouveaux "exécutants".
Les auteurs de la brochure n'ont pas plus de sérieux dans leur démarche pour déterminer le Contenu du Socialisme que les sectes religieuses qui appelaient de leurs vœux aux temps des Empereurs Romains ou des Capétiens Français.
Les "réalistes" détracteurs de la vision des crises nécessaires qui empiriquement appellent à l'évidence des dernières années de "prospérité" se trouvent ainsi condamnés sur le terrain socialiste à tomber dans le plus complet UTOPISME.
Dans un accès de réalisme n'affirment-ils pas qu'après tout n’importe quelle autre société que le Socialisme peut aussi bien succéder au Capitalisme?
"L'Humanité peut aussi bien accéder à un nouveau type de civilisation -le Communisme- que connaître une forme nouvelle de société d'exploitation à la suite d'échecs répétés, de défaites sanglantes des forces révolutionnaires". (pg.4)
L'alternative marxiste: "Socialisme ou Barbarie" devient ainsi "Socialisme ou n'importe quoi"
Cette confusion incroyable a des répercussions immédiates en ce qui concerne la détermination de la nature des États dits "Communistes" Sans craindre l'ambiguïté on qualifie ceux-ci de "Sociétés d'exploitation" nais on s'applique tout au long de la brochure à les présenter cornue quelque chose de bien distinct et diffèrent des pays occidentaux. Peut-être est-ce encore un souci de "réalisme" empiriste, Mais on laisse en suspens la question de savoir s’il s'agit d'une solution possible aux contradictions capitalistes et donc s'ils ne sont pas une quelconque issue "progressiste" On s'avère incapable de comprendre que le soi-disant "Socialisme" du type russe ou chinois, loin de constituer un "nouveau système" n'est que la forme décadente du vieux Capitalisme: le Capitalisme d'État.
LA QUESTION de la LIBERATION NATIONALE
La confusion atteint son point culminant lorsque les auteurs de la brochure s'attaquent au problèmes des luttes de Libération Nationale.
Dès le début on se met fièrement à l’écart du terrain marxiste de la discussion. Celui-ci est peut-être considéré "trop vieilli" La question de savoir si les Libérations Nationales peuvent être aujourd’hui des conditions ou des entraves au développement des forces productives, des problèmes de l'antagonisme existant entre le nature bourgeoise des nouveaux États et les luttes prolétariennes qui se développent dans ces pays, de l'impossibilité pour un État de se libérer d’une puissance impérialiste sans l’aide d'une autre dont elle devra, par la suite, subir l'oppression, toutes ces questions sont mises de coté.
On se contente pour aborder le problème d’une vision sociologique, ou plutôt journalistique:
- "Le soutien aux mouvements révolutionnaires et anti-impérialistes du tiers-monde -écrivent-ils- ne se justifie donc ni par le simple fait qu'en se libérant ces pays pourront enfin s'industrialiser et créer ainsi les bases objectives de la Révolution Socialiste, ni par "l'obligation" pour les révolutionnaires de combattre l'impérialisme"
Quelle est alors la raison de cet appui?
- "...Si on saisit leur portée internationale (des luttes du Tiers-Monde), si on considère le monde actuel comme une totalité où les différents secteurs -quel que soit leur stade de croissance et justement en fonction des différences de développement- réagissant les uns suites autres, on comprend la lutte des masses du Tiers-Monde comme partie intégrante d'un processus révolutionnaire mondial, et le soutien à cette lutte devient dès lors une tâche permanente pour l'avant-garde dos pays avancés eux-mêmes."
C’est à dire, on les appuis parce-que cela fait partie de toute cette "contestation" mondiale dont on entend tellement parler. Les journalistes bourgeois sont friands de ce genre d'amalgames spectaculaires où hippies, Tiers-Monde, drogue, jeunesse, étudiants, grèves ouvrières, etc. font partie d'une mode "d’esprit contestataire" Des convulsions d'une société en décomposition les professionnels de la plume ne tirent que ce qui peut frapper, étonner, émouvoir aux larmes ou inciter la colère. N'importe quoi pourvu que cela se vende.
Il est normal que ces gens ne se posent même pas la question de savoir si les luttes de la fraction du prolétariat mondial qui vit dans le Tiers-Ronde, ne sont pas entièrement antagonistes aux très patriotiques luttes de libération Nationale que dirigent les différents "Fronts" de "classes progressistes" Tout au plus, les moins stupides expriment-ils un étonnement en transcrivant une dépêche relatant l'écrasement d'une grève ouvrière par un quelconque gouvernement "progressiste" ou les violents échanges entre Fidel Castro et les mineurs Chiliens en grève.
Mais que des éléments qui prétendent dégager les intérêts de la classe ouvrière mondiale reproduisent cette même confusion avec la même légèreté, cela ne peut s’expliquer que par une attitude opportuniste, facilitée par l'impossibilité de parvenir à une véritable vision marxiste de classe.
L'ambiguïté et le manque de rigueur théorique sont un handicap fatal à tout groupe voulant faire un travail révolutionnaire. Un tel travail n'a de sens que s'il est sous tendu par un effort constant pour parvenir à une vision cohérente, car elle seule permet de distinguer au milieu de la complexité de la réalité sociale, quels sont les véritables intérêts de la classe révolutionnaire. Elle est l'arme prin cipale contre toutes les pressions opportunistes auxquelles est soumise une organisation dont un des buts essentiels est de faire en sorte que l'ensemble de sa classe pense de la même façon qu’elle.
La confusion a toujours été l'arme de la bourgeoisie.
En ce sens, il y a fort à craindre qu'avec la brochure "ORGANISER LE COURANT MARXISTE REVOLUTIONNAIRE" la tentative "organisative" du "Groupe marxiste pour le Pouvoir des Conseils de Travailleurs" n'ait pris -du moins sur le terrain révolutionnaire- dès le départ, une voie de garage.
R. Victor
[1] Dans une certaine mesure on pourrait aussi citer, comme victime de la canicule capitaliste, des groupes tels que "Potere Operaio" en Italie, le GLAT (Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs) en France, ou le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) en Espagne, qui ne nient pas toujours l'inéluctabilité de nouvelles crises du système, mais qui ne les considèrent pas comme produits des contradictions économiques objectives du système mais comme résultats de l'action révolutionnaire du Prolétariat.
[2] "Avant-propos" à "la Critique de 1'Economie Politique".
[3] cf. pg.2, point 3 de la brochure.
[4] Il est peut-être bon de noter ici qu’il est certain qu’une fois un processus de généralisation de luttes engagé, ces mêmes luttes peuvent devenir à leur tour -si elles se prolongent sous la pression des difficultés économiques croissantes- un facteur accélérateur de la crise économique elle-même. C’est le cas par exemple actuellement en Italie et en Grande Bretagne»
Il est clair aussi que parfois la crise économique peut d’abord frapper les travailleurs sous des formes telles que la guerre.
Nous rappelons que ce dont il s’agit ici c’est de dégager des phénomènes généraux pour comprendre les phénomènes particuliers et non l’inverse.
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [32]
- Décadence [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution Internationale - 1973
- 890 lectures
Révolution Internationale (nouvelle série) N°2 - février
- 36 lectures
Rubrique:
Les barricades de la bourgeoisie
- 59 lectures
La célébration du suffrage universel
Ces derniers mois, le monde a vécu à l’heure dos élections, Tour à tour, ce sont les populations du Canada, des Etats-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Australie, do Nouvelle Zélande et di Japon qui ont été conviées à se rendre massivement aux urnes.
Au-delà de la simple coïncidence de dates, ce qui a frappé, au sujet de ces consultations électorales, c'est la débauche de moyens mis en œuvre par les gouvernements et les partis politiques pour faire voter. Chacun a encore en mémoire l'énorme battage publicitaire qui a entouré les élections américaines et leur préparation (élections primaires, ascension de Mac Govern etc.). On se souvient aussi qu'à cette occasion, le très réactionnaire Nixon a pris une mesure que notre PCP réclame à cor et à cris depuis longtemps : le droit de vote à 18 ans. Et il n'a pas été seul dans ce cas puisque les gouvernements allemand et néerlandais l’ont imité peu après.
En France, la radio, la télévision, la grande presse et les sondages d’opinion sont mobilisés dans la préparation des élections. Rien ne manque pour rehausser l’importance de l’évènement. La télévision à elle seule, avec ses "armes égales” et "Portraits de candidats" a commencé à "chauffer ll’ambiance" avant même l’ouverture officielle de la campagne électorale. Tous les partis mènent campagne tambour battant îles uns activement autour de leur "Programme Commun", les autres bruyamment contre. Et à côté des "grands partis sérieux" on a vu resurgir les adeptes d'un "parlementarisme révolutionnaire" : les trots kystes, qui ne sont pas les derniers à engager les électeurs à accomplir leur devoir.
Bref, tout est mis en œuvre pour que les élections législatives du 4 et du ll mars soient l'évènement de l'année 1973 ...A tel point que même l'ouverture do la pêche a été déplacée pour ne pas qu'elle porte ombrage à cette célébration.
En a-t-il toujours été ainsi ?
Aujourd'hui, tout ce tapage est entré dans les mœurs et parait presque normal. Et chacun semble avoir oublié qu’avant qui on ne parle de "devoir électoral"; les travailleurs du siècle dernier se sont battus pendant des dizaines d'années peur le "droit électoral”, pour le suffrage universel.
En Angleterre, maintenant considérée comme le pays démocratique par excellence, le suffrage universel faisait partie des revendications du mouvement chartiste, première manifestation massive du prolétariat mondial et qui mena pendant la première moitié du 19e siècle des luttes souvent sanglantes. En 1848, cette même revendication se trouvait dans le Manifeste Communiste.
En Allemagne, où tout le monde s’est félicité récemment du pourcentage élevé de participation électorale, ce n'est qu'en 1866 que les travailleurs ont obtenu ce que les luttes de 1848-49 n'avaient pu leur donner : le suffrage universel.
En Italie, où la loi accorde aujourd’hui une journée chômée pour les élections, tout le 19e siècle est fait de luttes pour l'obtention, entre autres, de ce droit.
En Belgique, où aujourd'hui le vote est obligatoire, le suffrage universel nia été arraché qu'après des mouvements successifs de grève générale de 1893, 1902 et 1913.
En France, enfin, où lion parle tant du "devoir électoral”, c'est le suffrage censitaire qui, malgré l789, a cours durant la majeure partie du 19e siècle. Ce n'est qu'après le bain de sang de la Commune que les travailleurs obtiennent définitivement le suffrage universel.
La question se pose donc pourquoi cette même bourgeoisie qui, au siècle dernier réprimait violemment les ouvriers qui demandaient le suffrage universel, fait tant d'efforts aujourd'hui pour que le maximum d'entre eux aille voter? Pourquoi est-elle devenue si démocratique?
Pour répondre à cette question, il faut faire ressortir ce qui distingue ces deux époques du capitalisme.
Deux époques du Parlement
Au siècle dernier, le capitalisme cornait sa phase d'apogée. Alimentée en débouchés par les sabres et les goupillons des "civilisateurs”, la production capitaliste se développe à pas de géant. Les crises cycliques qui secouent l'économie et éliminent les entreprises les plus faibles trouvent une solution dans l'élargissement du marché: elles constituent les battements de cœur du système.
C'est dans cette période de prospérité que la bourgeoisie assoit sa domination politique sur l'ensemble de la société et élimine brutalement ou progressivement le pouvoir de l'ancienne classe régnante : la noblesse. Le suffrage universel et le parlement constituent un des moyens les plus importants de lutte de la fraction radicale de la bourgeoisie contre la noblesse et contre les fractions rétrogrades de celle-là.
La lutte que mène le prolétariat, durant cette période est directement conditionnée par la situation du capitalisme. En l'absence de crise mortelle de celui-ci, la révolution socialiste n’est pas à l'ordre du jour. Pour le prolétariat il est seulement question de s'aménager la meilleure place possible dans le système, donc de lutter pour des réformes.
Les syndicats et les partis parlementaires lui permettant de se regrouper indépendamment des partis bourgeois et démocratiques et de faire pression sur l'ordre existant, au besoin en faisant alliance avec les fractions radicales de la bourgeoisie, sont les moyens qu'il se donne pour l'obtention des réformes.
Le parlement étant le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s'unissent ou s'affrontent pour gouverner la société, le prolétariat se doit d'y participer pour tenter d'infléchir son action dans le sens de la défense de ses intérêts et ceci malgré les dangers de mystification qu'une telle politique peut lui faire encourir.
Parallèlement, les élections constituent une tribune pour la propagande ouvrière, c’est pour cela que Marx écrit en 1850 :
- "même là où il n'y a pas la moindre perspective de succès, les ouvriers doivent présenter leurs propres candidats, afin de conserver leur indépendance, de compter leurs forces et de faire connaître leur position révolutionnaire et les points de vue de leur parti"[1]. (1)
Avec le 20e siècle, le capitalisme entre dans une nouvelle phase: celle de son déclin. Le partage du monde est terminé entre les grandes puissances. Chacune d'entre elles ne peut s’approprier de nouveaux marchés qu'au détriment des autres : le nouveau cycle de l”économie est désormais: crise -guerre impérialiste- reconstruction... Avec l'agonie du capitalisme s'ouvre, comme dit l'internationale Communiste", l'ère des guerres et des révolutions" En Russie (1905 et 1917), Allemagne (1918- 23) Hongrie (1919), Italie (1920) le prolétariat fait, trembler le vieux monde et pose sa candidature à sa succession.
Pour faire face à ses difficultés croissantes le capital est- contraint de renforcer constamment le pouvoir de son Etat.
- De plus en plus, l'Etat tend à se rendre maître de l'ensemble de la vie sociale en premier lieu dans le domaine économique. Cette évolution du rôle de l'état s'accompagne d'un affaiblissement du rôle du législatif en faveur de l'exécutif. Comme le dit le deuxième congrès de l'Internationale Communiste: "Le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement définitivement sorti du Parlement".
Aujourd'hui, en France, il est patent que l'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir, c'est tout au plus une chambre d'enregistrement: la grande majorité (80%) des lois qu'elle vote est présentée par le gouvernement et une fois votées cette loi doit être promulguée par le président de la république et pour prendre effet elle doit encore attendre que soit signé le décret d'application par ce même président. Ce dernier peut d'ailleurs se passer carrément du parlement pour légiférer en ayant recours aux ordonnances ou encore à l'aide de l'article 16 de la constitution qui lui donne les pleins pouvoirs.
Ce rôle insignifiant du parlement se traduit par une participation ridicule des députés à ses séances : la plupart du temps ils ne sont pas plus d'une vingtaine à suivre ses débats.
Dans d'autres pays où subsiste une constitution plus "démocratique", l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas par exemple, les crises gouvernementales se suivent ce qui indique une inadaptation des institutions aux nécessités actuelles du capital.
Le déclin du parlement comme organe de pouvoir est un fait objectif, lié à l'évolution de la société capitaliste et absolument indépendant, de la volonté des hommes et des partis politiques. En ce sens, la promesse de certains partis et en particulier de la gauche, de redonner vie au parlement est parfaitement mystificatrice : autant vouloir ressusciter un cadavre.
La question se pose donc : si les parlements et par suite les élections ont perdu l'essentiel du rôle politique qu'ils avaient au siècle dernier, pourquoi la bourgeoisie et ses différents partis font-ils un tel tapage et de telles dépenses pour pousser les citoyens vers les urnes ?
A quoi servent aujourd'hui parlements et élections ?
La théorie marxiste attribue à toute superstructure de la société de classes une double fonction: permettre que s’exercent du mieux possible les lois économiques au bénéfice de la classe dominante et entretenir auprès des classes dominées la mystification nécessaire pour qu'elles ne rejettent pas leur oppression. Le droit n'échappe pas à cette 'réglé et c’est justement avec cette forme idéologique qu'on voit le mieux, au cours de l'histoire, se manifester cette double fonction,
A l'origine de la civilisation, le droit remplit essentiellement la première de ces fonctions et ceci avec une franchise quelquefois brutale : ainsi les juristes romains ne se gênent-ils pas pour affirmer que les esclaves sont des "choses” et non des personnes. Mais plus le développement de l'économie et de la civilisation font entrer l'ensemble de la société dans la vie sociale active, plus la fonction essentielle du droit devient, non pas de refléter, mais précisément de masquer la réalité économique et sociale. Ainsi, le droit féodal qui reconnaît l'existence de privilèges et déclare "sujets" la majorité des hommes, est-il incomparablement plus sincère que le droit bourgeois avec son "peuple souverain" et ses " citoyens " "égaux en droit". De même; l'exploitation de l'ouvrier dans la société capitaliste est autrement plus insidieuse et voilée que celle du serf dans la société féodale pour qui le temps de travail qu'il consacre à lui-même est matériellement distinct de celui qu'il donne au seigneur.
Comme forme juridique et politique l'institution parlementaire et électorale exerce donc cette double fonction et c'est justement la reconnaissance de cette dualité et de son évolution historique qui permet d'élucider le changement d'attitude de la bourgeoisie à l'égard du phénomène électoral.
Il est certain, qu'au siècle dernier, la fonction mystificatrice du parlement et des élections existaient déjà comme était déjà mystificateur l'ensemble des superstructures mises en place par la bourgeoisie au cours de sa révolution et en premier lieu ses constitutions qui toutes sont fondées sur la "souveraineté du peuple". Dès 1879, Marx et Engels, dans une lettre circulaire [2](1), mettaient en garde la Social-Démocratie contre les dangers de la mystification électoraliste, mystification à laquelle Engels lui-même n'échappait pas quand il écrivait en 1895:
- "Cette bonne utilisation du suffrage universel entraîna un tout nouveau mode de lutte du prolétariat, mode qui se développa rapidement. On s'aperçut que les institutions dans lesquelles s'organise le pouvoir de la bourgeoisie, offre, à la classe ouvrière de larges moyens de combat...
Et ainsi la bourgeoisie et le gouvernement en vinrent à craindre; bien plus l'action légale du parti ouvrier, bien plus les résultats de l'élection que ceux de la révolte."[3](2)
Mais pendant toute cette période, la fonction mystificatrice de l'institution parlementaire passe au second rang derrière la fonction politique, et ce n'est pas par hasard que la bourgeoisie fait tout son possible pour en interdire l'accès au prolétariat. En même temps que s'amenuise la fonction politique effective du parlement, sa fonction mystificatrice grandit et la bourgeoisie ne s'y trompe pas qui, dès 1917 en Russie, et 1919 en Allemagne brandit l'assemblée constituante contre la révolution prolétarienne, d'une façon désespérée dans le premier cas mais avec succès dans le second.
Désormais, la démocratie parlementaire sera le meilleur moyen dont disposera la bourgeoisie pour domestiquer le prolétariat. Et la défense de cette démocratie sera le thème qui permettra de mobiliser les travailleurs pour la seconde boucherie inter-impérialiste là où les mots d’ordre nationalistes sont restés sans effet.
Rôle des élections dans la crise actuelle
Depuis des décennies les différentes bourgeoisies avec leurs partis et leurs coalitions interchangeables, démocrates et républicains, conservateurs et travaillistes, socio-démocrates et démocrates-chrétiens, centre droit et centre gauche ont amusé la galerie en faisant croire que leurs élections permettaient un choix véritable, mais cette alternance même fait partie de la mystification puisqu'elle ne représente aucun changement véritable, ni souvent même minime, dans la façon dont ces bourgeoisies gèrent leur capital national.
Dans toute la période de reconstruction qui suit la seconde guerre mondiale et pendant laquelle le capital, mondial semble avoir résolu de façon définitive ses contradictions, le petit train-train électoral suffit, sans efforts particuliers de la bourgeoisie, à produire une dose suffisante d'illusions pour maintenir le prolétariat en place.
Depuis quelques années, le capitalisme est entré dans une nouvelle période de difficultés et de soubresauts. "Révolution Internationale" en a suffisamment traité depuis 1968 pour qu'on n'y revienne pas ici[4] (1).
A ces difficultés le prolétariat mondial a opposé une réaction inconnue depuis 50 ans et est revenu hanter, à l'Est comme à l'Ouest, l'ensemble de la classe capitaliste. Celle-ci a dû réagir à son tour, en même temps qu'elle a commencé à prendre une série de mesures de sauvegarde de ses économies nationales: dévaluation plans d'austérité, blocage des prix et salaires, elle s'est remise à brandir frénétiquement et avec des moyens exceptionnels son suffrage universel et ses élections.
En France, la manœuvre est plus qu'évidente. Certes, la venue au pouvoir de la gauche a de quoi effrayer un certain nombre de professionnels de la politique qui depuis l5 ans tètent au pis du gaullisme et qui se retrouveraient sans emploi. Elle peut inquiéter un certain nombre de capitalistes qui se verraient obligés de vendre leurs usines à l'état, mais avec les dédommagements qu'on leur donnerait, ils pourraient toujours réinvestir dans les 85% de l'économie non touchée par les nationalisations. Mais Marchais, Mitterrand et compagnie font tous leurs efforts pour rassurer la bourgeoisie : Pompidou pourra rester en place s’il veut, il n'est pas question d'étendre les nationalisations au-delà de celles prévues dans le programme et Marchais n’a pas peur de dire "Les ouvriers travailleraient davantage s'ils avaient un gouvernement dans lequel ils ont confiance"[5](1)
Bref, si Mitterrand et Marchais venaient au pouvoir, cela ne changerait pas grand-chose à la situation du capital national, plutôt moins que les mesures de 1945 avec De Gaulle. Quant aux travailleurs, ils sont déjà prévenus : en échange de quelques broutilles accordées depuis déjà longtemps dans d'autres pays européens, ils seraient conviés à être encore plus exploités... et dans l'enthousiasme
En fait, pour la bourgeoisie, l'enjeu principal des élections n'est pas dans l'équipe qui sera au pouvoir au lendemain du ll mars : quelle que soit la coloration de celle-ci, sa politique lui sera dictée par des nécessités qui dépassent les convictions et les intérêts particuliers des hommes et des partis, les nécessités de la défense du capital national, privé et étatique contre les travailleurs, et contre les autres capitaux nationaux[6](2).
Le véritable enjeu des élections est ailleurs. Pour tous les partis du capital, ce qui compte aujourd'hui par-dessus tout, c'est bien de briser l'offensive que la classe ouvrière a réengagée depuis plusieurs années contre l'exploitation et les élections sont un excellent moyen de détourner son mécontentement vers un terrain qui n'est pas le sien, où elle ne peut être que vaincue. Tous les grands partis du capital tiennent aux travailleurs le même langage : "laissez là vos luttes et allez voter". C'est ainsi que Messmer exhorte les travailleurs à la "modération" et fait appel à leur "solidarité nationale", alors que Séguy déclare sans ciller ; "Il n'est pas exclu qu’on suppute une aggravation de la tension sociale susceptible de dégénérer en épreuve de force propice à toutes sortes de provocations, qui pourraient être bénéfiques aux intérêts politiques de la majorité à la veille des élections politiques. Nous sommes tout à fait conscients de ce danger On aurait tort de croire, en haut lieu, que nous sommes prêts à tomber dans le panneau... Nous réaffirmons que nous ne ferons rien qui soit de nature à perturber les élections et le déroulement de la campagne électorale"[7](3). C'est donc clair: la CGT ne tombera pas dans le panneau... de la lutte de classes. Et elle joint l'acte à la parole: la combativité qu'ont manifestée les travailleurs français jusqu'à la fin a partout rencontré une solide détermination des syndicats pour l'étouffer. On se souvient de la façon dont la grève dans la banque a été brisée début décembre. On se souvient également de la "journée d'action" du 26 Octobre, des mots d'ordre de grève tournante dans la SNCF, de la manifestation platonique du 9 décembre sur l'Education Nationale.
Toutes ces manœuvres, loin d'inciter à l'action, sont destinées à convaincre par leur échec, les travailleurs de l’inefficacité de toute action, à les démoraliser et à leur présenter ainsi le bulletin de vote comme le seul moyen d'exprimer leur mécontentement et de changer quelque chose.
Il est évident que les partis de gauche n'ont pas pour seul objectif de briser la combativité ouvrière; ce qui est au centre de leurs préoccupations c'est bien sur la conquête du pouvoir, mais celle-ci signifie la lutte contre tout mouvement prolétarien. S'ils remportent la victoire en mars, ils affronteront directement les travailleurs avec tous les instruments de coercition de l'Etat, tout en leur disant qu'ils doivent faire des sacrifices pour ne pas "faire le jeu de la réaction" ou bien "de l'étranger". S'ils échouent à ces élections ils continueront, par l'intermédiaire des syndicats qui leur sont inféodés, à saboter les luttes afin de ne pas "compromettre le résultat des suivantes". Dans un cas comme dans l'autre, les élections seront toujours utilisées par la gauche pour défendre le capital contre les travailleurs.
En résumé, on peut donc dire que, face à une situation économique qui s'ag- grave de mois en mois et face à une montée des luttes prolétariennes de plus en plus menaçantes, le capital déploie tous ses moyens de mystification pour maintenir ses positions. Comme les “luttes de libération nationale", les élections font partie de son arsenal et la frénésie qui entoure celles-ci aujourd'hui est à la mesure de la crise dans laquelle il s'enfonce.
Le jeu et les arguments des trotskystes
A la gauche de la gauche, on revoit s'agiter les trotskystes. Jusqu’à présent, l'essentiel de leur propagande a tourné autour de la lutte "anti-impérialiste". A grand renfort de campagnes, de meetings et de cortèges, ils ont essayé de battre le P.C.F sur son terrain : celui de la défense du "camp socialiste". Dans les conflits inter-impérialistes, qui sous couvert de libération nationale, font chaque année des centaines de milliers de : morts, .ils ont joué et continuent de jouer le rôle ignoble des véritables jusqu’au-boutistes.
Maintenant, à l’approche des élections, leur rôle de chien de garde du capital a trouvé une nouvelle occasion de s’exercer. S’engageant à fond dans la campagne électorale, présentant plus de 300 candidats, ils demandent aux travailleurs un "vote de classe" et se font les rabatteurs, au second tour, pour les partis de gauche.
Leur participation aux élections revêt donc un double caractère : présentation d’un certain nombre de candidats (et même d’un nombre certain pour certaines organisations) au premier tour et campagne en faveur du candidat de la gauche au second tour (et même au premier pour l’OCT- AJS).
En faveur du vote pour les partis de gauche ils avancent les arguments suivants :
- ce vote leur permet de ne pas se couper des masses ouvrières.
- le vote pour "l’union de la gauche" est un vote de classe.
- il va dans le sens du "front unique ouvrier" qui doit mettre les "partis ouvriers" au pied du mur”.
Quant à la présentation de candidats trotskystes elle est justifiée de la façon suivante:
- elle doit permettre d’envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche.
- elle permet d’utiliser la campagne électorale comme d’une tribune en faveur de la propagande révolutionnaire à un moment où l’intérêt des masses est polarisé sur les élections.
- en cas d'élection de candidats révolutionnaires, ceux-ci peuvent utiliser le parlement comme une tribune pour leur propagande :
- le résultat des élections permet de "tâter le pouls" de la classe ouvrière, de sa combativité et de l’influence que les révolutionnaires ont sur elle.
Etudions chacun de ces arguments.
Ne pas se couper des masses…
Sous des formes différentes, cet argument est repris par chacune des trois organisations trotskystes les plus importantes.
Comme souvent, la palme de l’opportunisme revient à l’OCI-AJS qui écrit dans son appel aux travailleuses, travailleurs, militants et jeunes :
"Elles (les revendications et aspirations exprimées dans la campagne électorale;) ouvrent la perspective d’un GOUVERNEMENT PS-PCF SANS^MINISTRE CAPITALISTE. Le prolétariat est prêt à s’engager dans l’enthousiasme dans cette bataille politique. Sans conditions[8](1),
l’OCL et l’AJS luttent pour un tel gouvernement.
La position de la Ligue Communiste ne vaut guère mieux bien que plus nuancée :
- "Au deuxième tour, nous appellerons à voter nationalement pour l’Union de la Gauche. Nous ne présenterons pas pour autant un éventuel gouvernement PS-PC comme un gouvernement des travailleurs, nous expliquons seulement aux masses qui croient encore en cette voie électorale que notre défection ne pourra être utilisée par les traîtres réformistes pour expliquer leur échec de demain.”[9]
- Quant à Lutte Ouvrière elle considère qu’elle a:
- "pour devoir de combler le fossé existant entre (elle) et les travailleurs influencés par le PCF, c’est à dire sinon la majorité de la classe ouvrière, du moins la majorité écrasante de son avant- garde.”[10]
Cet argument qui consiste à dire: "pour ne pas se couper des masses il faut faire ce que font les ouvriers, être là où ils se trouvent" relève d’une forme aigue d’opportunisme.
C’est l’argument qu’ont utilisé tous les socio-patriotes en 19l4pour justifier leur soutien à la guerre impérialiste et leur participation aux gouvernements d ‘union nationale et contre lequel les révolutionnaires se sont violemment élevés à cette époque, en particulier Lénine dans "Contre le Courant". C’est l’argument de toutes les capitulations devant la bourgeoisie. Rappelons (un exemple parmi beaucoup d’autres) que c’est en l’utilisant que les trotskystes d’Argentine ont, à une époque, soutenu ce fasciste au petit pied qu’était Juan Perón.
Un vote de classe…
Dans cette argumentation l’OCI-AJS encore une fois bat des records :
- "Contre le capital, ses partis, ses gouvernements. Pour le Front unique des organisations ouvrières VOTEZ CLASSE CONTRE CLASSE."
- "A la question : quel gouvernement peut satisfaire les revendications (du prolétariat, de la jeunesse, des masses exploitées des villes et des campagnes), il n’existe qu’une réponse : SEULEMENT UN GOUVERNEMENT DES GRANDS PARTIS OUVRIERS, UN GOUVERNEMENT FORME PAR LE PS ET LE PCF, UN GOUVERNEMENT SANS REPRESENTANTS DES PARTIS BOURGEOIS."[11]
La ligue Communiste, comme d’habitude est plus nuancée:
- "Le PS ne peut être défini aujourd’hui ni comme un parti bourgeois, ni comme un parti ouvrier bourgeois du fait de la faiblesse de l’implantation ouvrière."[12] "Dans l’union de la gauche, c’est le PCF, parti ouvrier réformiste qui est aujourd’hui hégémonique. c’est lui qui a imposé ses conditions. c’est cette hégémonie du PC qui donne à l‘ensemble de l’alliance sa nature de classe, et non la présence de tel ou tel politicien bourgeois."
De la même façon que sur le nombre "d’Etats ouvriers" existants à l’heure actuelle, les différents groupes trotskystes sont divisés sur le nombre de "partis ouvriers" qu’on peut compter en France. Si pour l’OCI-AJS, le PCF et le PS sont tous les deux des "partis ouvriers", pour la ligue Communiste et "Lutte ouvrière" seul le PCF est digne du Label.
Les arguments donnés pour caractériser comme ouvrier tel ou tel parti peuvent se résumer ainsi:
- 1° Ses origines historiques : le Ps est le descendant de la SFIO qui était une des sections de la 2e Internationale qui, à une époque, était une organisation défendant réellement les travailleurs. Le PC lui, fut une section de la 3e Internationale qui en 1919 constituait ltavant-garde révolutionnaire du prolétariat mondial. Leur caractère prolétarien se serait donc perpétué jusqu’à nos jours.
- 2° Sa composition sociologique et la confiance que lui témoignent les travailleurs: le caractère ouvrier du PC tiendrait, d’après la Ligue et “Lutte ouvrière”, à son "implantation" dans la classe ouvrière et dans les syndicats.
- 3° Le lien organique qui le rattache aux "états ouvriers dégénérés": c’est le grand dada de la ligue Communiste et en particulier de Weber qui font découler le caractère ouvrier du PCF de son allégeance à Moscou.
- 4° Les références au socialisme faites dans ses statuts.
Voyons ce que valent ces différents arguments.
-
Les origines historiques
La société capitaliste a deux moyens de lutter contre les organisations qui défendent les intérêts de la classe ouvrière: soit de les détruire physiquement par la répression, soit de les corrompre et de les transformer en rouages du système. Aucune organisation de la classe n’échappe à cette pression corruptrice du capital et en particulier les organisations permanentes qui ont un caractère de masse, c’est à dire qui sont composées d’individus qui bien que travailleurs, sont, en "temps normal", pour le plus grand nombre, soumis à l’idéologie bourgeoise.
Les partis social-démocrates et communistes étaient, à l’origine, des organes de la classe ouvrière. Mais la longue période de prospérité et de luttes réformistes qui va de la Commune à 19l4 pour l£S premiers et la terrible contre-révolution qui s test abattue en Russie et dans le monde entier après la vague révolutionnaire de 1917 à 23 pour les seconds ont eu raison de leur nature ouvrière et les ont transformés en principaux artisans de la contre-révolution. La nature de classe d’une organisation ouvrière ne lui est pas donnée d’une façon éternelle. Si l’on peut affirmer avec certitude qu’un parti bourgeois ne deviendra" jamais un parti prolétarien on peut par contre dire que tout parti ^prolétarien est constamment menace de devenir un instrument du capital: les exemples historiques ne manquent pas, et ce mouvement à sens unique si explique par le poids énorme qu’exerce l’idéologie bourgeoise sur les esprits : "les idées dominantes d’une époque sont les idées de la classe dominante". (Marx)
1 L’implantation dans la classe ouvrière.
Pour les mêmes raisons qu’on vient de voir, cet argument ne tient pas non plus. Dans une période où la bourgeoisie règne en maître incontesté, la majorité des travailleurs a une mentalité dominée par l’idéologie bourgeoise (ce qui ne veut pas dire que ceux-ci pensent exactement de la même façon que leurs exploiteurs). Dans ces conditions, tout parti qui a la confiance de la majorité des travailleurs ne peut l’obtenir qu’en abandonnant ses positions (en ce sens, seule une organisation ultra-minoritaire peut, dans une telle période, être le porteur des intérêts historiques du prolétariat).
La nature ouvrière d’une organisation n’est pas une question de statistique sociologique mais de fonction qu’elle exerce au sein de la société et de la lutte de classe. Si on retenait un tel critère statistique il faudrait dire que le parti nazi était bien plus ouvrier qu’un certain nombre de partis "communistes" actuels.
2 Le lien existant entre les partis "communistes" et l’URSS
Il n’est pas question d’entrer ici dans une analyse économique de l’URSS et des pays dits ”socialistes”[13] (1). Nous nous contenterons de rappeler l’ exploitation aigue subie par les travailleurs d’ URSS sous couvert de "stakhanovisme" et " d’émulation socialiste ", la déportation et l’extermination de millions d’entre eux qui tentaient de résister à cette exploitation inhumaine, la répression qu’ils continuent de subir aujourd’hui où la grève est considérée comme un crime et où depuis 53 en Allemagne de l’Est, 56 en Hongrie, 70 en Pologne ces régimes "socialistes" ont la palme quant à l’écrasement de mouvements prolétariens et au nombre d’ouvriers tués.
Tous ces faits attestent la nature profondément anti-ouvrière et contre- révolutionnaire de ces "états ouvriers" et l’argument de la Ligue se retourne contre elle: le seul fait pour les partis "communistes" de les appuyer suffit derechef à conférer à ces partis (ainsi qu’aux trotskystes qui également défendent l’URSS) une nature profondément anti-ouvrière et donc capitaliste.
3 Les références au socialisme faites dans les statuts.
L’OCI-AJS est spécialiste de ce genre d’arguties elle, qui a considéré que la social-démocratie allemande avait perdu son caractère ouvrier le jour où elle a abandonné toute référence au marxisme. Ainsi, l’écrasement de la révolution allemande en 1919’ l’assassinat de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et de milliers d’ouvriers, toutes œuvres de la social-démocratie, n’auraient pu faire ce que la simple modification d’une phrase dans ses statuts a suffi à réaliser : la modification de la nature de classe d’une organisation politique! Pouvoir des mots!
Il est à noter que l’OCI-AJS a l’air de revenir sur cette analyse puisqu’il semble qu’elle accorde à nouveau le label ouvrier à la social-démocratie quand elle écrit à propos des élections en Allemagne: "C’est contre l’ennemi de classe que les travailleurs et les jeunes ont utilisé le terrain électoral en votant SPD"[14]
Il est vrai que l’ OCI-AJS nous a habitués à ces voltes faces : n’a-t-elle pas crié sur tous les toits que l‘entrée de Mitterrand et de la Convention dans la SEEO allait enlever à celle-ci son caractère ouvrier.
Aujourd’hui, Mitterrand dirige le PS issu de cette fusion et celui-ci est toujours, pour l’OCI-AJS, un "parti ouvrier".
Pour les révolutionnaires, les statuts d’une organisation ne prouvent rien sur sa nature "ouvrière". Pas plus qu’un individu on ne juge un parti sur l’idée qu’il a de lui-même. Pour nous il n’existe pas une "essence" prolétarienne historique ou statistique des partis socio-démocrates et communistes. Ces partis sont qu’ils font. Leur nature leur est conférée par la fonction qu’ils assument dans la société bourgeoise.
Le rôle joué par les partis socio-démocrates depuis 1914 d’abord comme sergents recruteurs pour la boucherie inter-impérialiste, ensuite comme bourreaux de la classe ouvrière, enfin comme gérants fidèles du capital suffit amplement à les caractériser comme des partis bourgeois.
De même, la défense des intérêts impérialistes de l’URSS depuis les années 30, le coup de poignard dans le dos du prolétariat espagnol en 1936, la mobilisation des travailleurs sous couvert de "résistance anti-fasciste " pour le second conflit inter-impérialiste, la défense jalouse des intérêts du capital exercée par les ministres communistes dans neuf pays occidentaux après la "libération"[15]sans oublier l‘exploitation et la terreur policière appliquée aux travailleurs des pays de l’Est, rangent définitivement les partis "communistes" dans le camp du capital
Le front unique et la mise au pied du mur
Cette tactique adoptée aux 3è et 4è congrès de l’Internationale Communiste consiste pour les communistes à apporter leur appui aux partis (à l’époque les socio-démocrates) qui se réclament de la classe ouvrière sans défendre ses intérêts, afin de faire faire à celle-ci son expérience.
Devant les reniements et les trahisons de ces partis une fois au pouvoir les travailleurs prendraient conscience de leur véritable nature et ce tourneraient vers les révolutionnaires. Aujourd’hui il s’agirait donc de soutenir la gauche afin que celle-ci, une fois au pouvoir, se démasque aux yeux des travailleurs qui se tourneraient alors vers les trotskystes.
Depuis qu’elle est appliquée cette tactique a toujours échoué. Jamais, depuis 1922, les travailleurs ne se sont lancés dans des luttes révolutionnaires après qu’ils aient mis au pouvoir les partis de gauche. En fait, en 1923, cette tactique mise en application dans certains états allemands à la tête desquels se trouvait une coalition communiste socio-démocrate fut un coup de poignard dans le dos du soulèvement révolutionnaire des ouvriers allemands. Par cette alliance avec la social-démocratie, le parti communiste servit de caution à celle-ci et lui laissa les mains libres pour massacrer les travailleurs.
La tactique qui consiste à "faire faire sa propre expérience" à la classe se résume à la pousser à l’échec afin qu’elle comprenne après coup les dangers qui la menaçaient. Que penserait-on de l’attitude qui consisterait à pousser un enfant dans un escalier au lieu de le mettre en garde par avance, afin qu’il se rende compte que c’est là un endroit dangereux où il faut faire attention? Une telle attitude serait évidemment absurde, c’est pourtant la même que celle du "Front Unique".
Il est clair que c’est avant tout à partir de sa propre expérience que la classe ouvrière élève son niveau de conscience. Mais, contrairement à ce que pensent les trotskystes, les révolutionnaires ne peuvent réellement contribuer à cette prise de conscience qu’en luttant contre toutes les mystifications qui pèsent encore sur les travailleurs et non en les reprenant à leur compte. Une telle attitude est évidemment impopulaire et ne leur permet pas de gagner immédiatement la "confiance des masses" et c’est bien cela qui préoccupe les trotskystes d’aujourd'hui.
Ce que recouvre en fait la tactique du "Front Urique" c’est un opportunisme sans scrupule à l’adresse des partis socio-démocrates et staliniens de qui les trotskystes essayent de se faire reconnaître comme organisation "sérieuse" et "responsable". D’une façon inavouée, ce que recherchent et réclament en pleurnichant ces individus c’est un strapontin dans un futur "Gouvernement Ouvrier" PS-PCF, comme dit l’OCI-AJS, ou le droit d’y jouer le rôle de la mouche du coche.
Le "Front Unique" entre le PS, le PCF et les trotskystes sera peut-être un jour une réalité, mais il s’exercera alors non pas en faveur des travailleurs mais assurément contre.
Mais dès aujourd’hui, appeler les travailleurs à voter pour les partis de gauche, rebaptisés pour la circonstance "partis ouvriers", afin de les "mettre au pied du mur", revient en fait à jouer le triste rôle de larbins de ces partis: d’abord en perpétuant le mythe de leur caractère ouvrier qui a bien besoin d’être rafraîchi, ensuite en n'étant rien d ‘autre que des colleurs d’affiche bénévoles au service de "l’Union de la Gauche" tentant de racler à son profit les quelques voix des travailleurs que n’auraient pu séduire les chants de sirène des grands camps en présence.
"PRESENTER LES CANDIDATS POUR NE PAS DONNER CARTE BLANCHE A UN GOUVERNEMENT DE GAUCHE"
C’est exactement en ces termes que "Lutte Ouvrière" défend sa politique en titrant :
- "Pourquoi des candidats de Lutte Ouvrière aux élections législatives? Pour que les travailleurs puissent envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche".
L’OCI-AJS, de son coté, utilise un argument semblable quand elle écrit:
- "Voter OCI-AJS, c’est affirmer la nécessité de rassembler, d’organiser les militants, les travailleurs, les jeunes, qui veulent agir pour que le PS et le PCF rompent avec les partis bourgeois réalisent le Front Unique Ouvrier se battent pour former un gouvernement sans ministre capitaliste".
Disons tout de suite que la perspective de l’OCI-AJS est plutôt mal engagée puisque Marchais, à la tribune du 20e Congrès du PCF, tendait sa main à "ceux qui ont suivi De Gaulle par patriotisme" et se déclarait prêt, dans une interview à un journal anglais, à accueillir dans le futur gouvernement de gauche des centristes rebaptisés pour la circonstance "républicains de progrès".
Il est probable que les trotskystes recueilleront quelques centaines de milliers de voix, aux élections législatives mais cela ne représentera de toute façon pas grand-chose à côté de la douzaine de millions de voix nécessaires à la gauche pour l’emporté. Et même si la proportion leur était plus favorable, cela ne changerait rien à l’affaire : la bourgeoisie et ses partis se moquent bien de la pression morale et platonique de petits morceaux de papier dans les urnes.
Le seul moyen dont disposent les travailleurs pour ne pas donner carte blanche à un gouvernement quel qu’il soit demeure la lutte de classe et c’est justement cette lutte de classe que la politique électoraliste des trotskystes contribue à endormir,
La campagne électorale comme tribune
On lit dans "Lutte de Classe"n°2 (Revue théorique de Lutte Ouvrière) :
- "D’une manière générale les révolutionnaires, tout en ne se faisant aucune illusion sur le parlementarisme et en dénonçant publiquement ces illusions auprès des travailleurs, ont trois raisons fondamentales de participer à des élections au parlement bourgeois.
"Tout d’abord, se servir de la campagne, aussi bien de l’intérêt qu’elle sus cite auprès des électeurs et notamment des électeurs populaires que des moyens d’information qui sont mis à la disposition des candidats par l’État à cette occasion, pour développer une large propagande en faveur du programme et des idées révolutionnaires.
"Ensuite, compter leurs partisans. Cela peut se faire suivant les moments soit sur le programme socialiste, soit sur un programme plus limité mais correspondant aux- questions de l’heure et y apportant la réponse des travailleurs révolutionnaires... Les résultats électoraux ne constituent jamais qu’un reflet déformé de l’état d’esprit du pays et des travailleurs. Ce reflet, tel qu’il est, est tout de même un moyen irremplaçable[16] de connaître et de vérifier cet état d’esprit et l’influence des idées et des organisations révolutionnaires.
"Enfin, éventuellement, envoyer des militants révolutionnaires au parlement pour se servir de la tribune qu’elle offre à ceux-ci. Il est vrai que, en France tout au moins, cette tribune est de moins en moins écoutée. Il est vrai aussi que dans l’état actuel des choses il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu".
Le premier de ces arguments est repris par la Ligue Communiste :
- ”La présentation de candidats partout où la Ligue est implantée doit nous permettre de bénéficier de toutes les tribunes qu’offrent les institutions bourgeoises en période électorale (radio et presse régionale, etc.) afin de capter l’attention des travailleurs.”
"L’expérience a montré qu’il n’y a pas de campagne politique, en période électorale, sans participation directe à la compétition. Ne pas présenter de candidats, c’est passer sous la table.”[17] (1)
Commençons par répondre à ce premier argument:
Classe minoritaire dans la société, la bourgeoisie exerce le pouvoir non dans son ensemble mais en le délégant à une fraction minoritaire d ‘elle-même regroupée dans les partis politiques. Cela est valable aussi bien dans les "démocraties” (concurrence entre plusieurs partis) que dans les régimes totalitaires fascistes ou staliniens (parti unique).
Ce pouvoir d’une minorité de spécialistes de la politique n’est pas seulement le reflet de la position minoritaire de la bourgeoisie au sein de la société; il est également nécessaire pour préserver les intérêts généraux du capital national face aux intérêts divergents et concurrents des différentes fractions de cette bourgeoisie. Ce mode de pouvoir par délégation est donc inhérent à la société bourgeoise et se reflète dans chacune de ses institutions et principalement dans le suffrage universel. Celui-ci est même le moyen privilégié par lequel "la population", en fait la bourgeoisie, "confie" le pouvoir à un ou plusieurs partis politiques.
L’action révolutionnaire du prolétariat ne s’accommode pas de tels schémas. Dans ce cas, ce n’est pas à une délégation minoritaire de la classe que revient le rôle d’agir et de prendre le pouvoir mais à l’ensemble de la classe. C’est là la condition indispensable du succès de tout mouvement prolétarien. Le suffrage universel ne peut donc, de quelque façon que ce soit, servir de cadre pour l’engagement révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre existant. Loin de favoriser la mobilisation et l’initiative des plus larges masses, il tend au contraire à maintenir leurs illusions et leur passivité.
En ce sens, les révolutionnaires dont le rôle n’est pas de constituer la minorité à qui la classe confie son pouvoir, mais au contraire à contribuer à la prise de conscience et à l’auto-organisation de celle-ci, ne peuvent en aucune manière utiliser les campagnes électorales comme tribunes. Tous les moyens ne sont pas bons pour faire de la propagande révolutionnaire et en particulier, la participation aux élections s’oppose au but que se proposent d’atteindre les révolutionnaires : la nécessité pour la classe d’agir par elle-même.
Le parlement comme tribune révolutionnaire
"Lutte Ouvrière" le constate plus haut elle-même : " dans l’état actuel des choses, il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu." Gageons que les trotskystes reprendront un jour à leur compte la revendication du PCF depuis 1958 : le retour à la représentation proportionnelle qui leur permettrait d’avoir un certain nombre d’élus et donc de tribuns parlementaires.
Même si cette éventualité d'élections de candidats trotskystes n’est pas actuellement à l’ordre du jour, il faut répondre à cette conception du parlement comme tribune révolutionnaire qui se retrouve de façon constante dans tous les courants se revendiquant de la 3e Internationale.
L’argumentation développée contre l’utilisation de la campagne électorale s’applique à plus forte raison contre l’utilisation du parlement par les révolutionnaires.
Mais ce n’est pas tout. La participation au parlement est en plus pour les partis révolutionnaires un facteur puissant de dégénérescence opportuniste. Déjà, dans les partis de la 2e Internationale, les fractions parlementaires constituaient toujours les ailes droites. Rien de plus normal à cela : plus le programme et la propagande d’un candidat sont modérés, plus celui-ci a de chances d’être élu par un électorat imprégné de l’idéologie de la classe dominante. Pour conserver leur siège, les députés sociaux-démocrates faisaient pression pour orienter la politique de leur parti toujours plus à droite.
Lénine et la 3e Internationale sont parfaitement conscients de ce fait. Mais ils considèrent que le seul exemple de Liebknecht, utilisant la tribune parlementaire de façon révolutionnaire pendant la guerre, suffit- à justifier une telle tactique. Ils pensent aussi que le danger d’opportunisme peut être conjuré par une discipline très stricte dans le parti et par un contrôle rigoureux de ses instances suprêmes sur la fraction parlementaire.
Mais en fait, depuis cinquante ans qu’existe cette tactique, il ne s’est plus trouvé un seul Liebknecht pour détruire l’institution parlementaire "de l’intérieur" et la dégénérescence opportuniste s’est accomplie encore plus vite.
Cela n’a rien de mystérieux et s’explique simplement par le fait que les parlements s’étant vidés de toute vie politique réelle sont devenus uniquement les lieux de prédilection, de l’intrigue et de la corruption, et n’offrent aucune place pour une manifestation révolutionnaire.
Prendre le pouls de la classe et "compter ses partisans”
Le maître à penser de la Ligue, Lutte Ouvrière, OCI-AJS e.t autres, Trotsky lui-même écrit, à propos des "journées d’Avril" 19l7 où les ouvriers de Petrograd s’étant soulevés -avec les Bolcheviks en tête- contre une décision des partis conciliateurs n’avaient pas modifié leur représentation dans les Soviets :
- "La contradiction éclatante entre la hardiesse de l’offensive des masses et les tergiversations de sa représentation politique n’est pas accidentelle. les masses opprimées, à une époque révolutionnaire, sont entraînées à l’action directe plus aisément et rapidement qu’elles n’apprennent à donner à leurs désirs et à leurs revendications une expression en bonne et due forme par leur propre représentation. Plus est abstrait le système de la représentation, plus celui-ci retarde sur le rythme des évènements déterminés par les actions de masses. [18]"
Ce décalage entre la combativité des masses et la représentation qu’elles se donnent est plus qu’évident dans le cas des élections législatives et les exemples historiques ne manquent pas. Citons seulement le plus récent : Mai 68 ; la plus grande grève depuis la guerre débouche un mois après sur la plus grande victoire électorale que la droite ait connue en France.
La raison de ce décalage réside dans le fait que l’élection d’un député se trouve dans une sphère totalement différente de celle de la lutte de classe. Cette dernière est une action collective, solidaire, où l’ouvrier est accompagné d’autres ouvriers où les hésitations des uns sont emportées par la résolution des autres, où les intérêts en cause ne sont pas particuliers mais ceux d’une classe. Par contre, le vote fait appel à quelqu’un de déclassé : le citoyen, qui se retrouve seul dans l’isoloir face à un choix pour quelque chose d’abstrait, d’extérieur à sa vie quotidienne. C’est le terrain idéal pour la bourgeoisie, celui où la combativité ouvrière n’a aucune possibilité de se manifester réellement. Ce n’est pas par hasard que celle-là fait tant d’efforts pour faire voter.
Par conséquent, le résultat des élections du ll mars ne donnera aucune indication réelle sur l’état d’esprit et la combativité des masses ni d’ailleurs sur l’influence véritable des trotskystes auprès des travailleurs. La poussée prévue de la gauche ne signifiera pas une montée de la combativité ouvrière comme le pensent les trotskystes ni d’ailleurs le contraire. Elle exprimera essentiellement l’usure du pouvoir actuel auprès d’un grand nombre de catégories sociales, la "dynamique unitaire" du Programme Commun qui rend "crédible" un gouvernement de gauche et le ralliement de certaines couches petites-bourgeoises effrayées de voir le grand capital les faire disparaître progressivement et que la modération de ce programme n’effraie plus guère.
Loin d’être "un moyen irremplaçable de connaître et vérifier" l’état d’esprit des travailleurs, comme le dit stupidement Lutte Ouvrière dans son "Organe théorique" LUTTE de CLASSE, les résultats électoraux sont justement le terrain où ne s’exprime pas du tout la combativité des masses. Le seul moyen pour les révolutionnaires de savoir où en est la classe, est d’observer le niveau de ses luttes contre le Capital (grèves, occupations, affrontement des forces de répression).
La fonction des trotskystes
Tous les arguments des trotskystes pour justifier leur participation aux élections et leur soutien aux partis de gauche se retournent contre eux. Ce qui il reste essentiellement de toute leur action c’est que loin de démasquer la véritable fonction mystificatrice des élections dans la société bourgeoise actuelle, ils participent pleinement à cette mystification. De la même façon, au lieu de dénoncer impitoyablement les partis de gauche comme des partis du Capital, ils contribuent pleinement à préserver auprès des travailleurs le mythe de leur nature ouvrière.
Au même titre que leur propagande en faveur des "luttes de libération nationale, leur propagande autour des élections tend, non pas à élever le niveau de conscience politique des travailleurs, mais à maintenir en place les mystifications qui pèsent sur eux.
Sur bien des points la 3e Internationale a rompu avec le cours opportuniste et bourgeois de la 2e, particulièrement sur la caractérisation de la période ("ère des guerres et des révolutions") qui s’ouvre avec la guerre de 1914, et également sur la nécessité pour le prolétariat de détruire l’Etat Bourgeois et de le remplacer par le pouvoir des Conseils Ouvriers. Mais cette rupture n’est pas complète et ne va pas jusqu’au bout de ses implications ; ainsi, elle ne porte pas sur les tactiques frontistes, syndicales et parlementaires.
En 1920, les désaccords qui ont surgi autour de ces questions se situaient encore à l’intérieur d’un même de terrain classe. Mais les faillites successives auxquelles ont conduit ces "tactiques" ont fait de leur, rejet une question de principe, une frontière de classe au-delà de laquelle ne peut s’exercer, pour une organisation politique, aucune activité révolutionnaire.
En 1919, l’internationale Communiste luttait principalement contre les partis socio-démocrates et "centristes" dont l’opportunisme avait servi de dernier rempart à la bourgeoisie face au mouvement révolutionnaire des masses en divisant et démoralisant celles-ci.
Face à une nouvelle montée révolutionnaire de la classe ouvrière, le capital suscitera nécessairement l’apparition de tels partis conciliateurs jouissant d’une certaine audience parmi les travailleurs, mais en fait, entièrement à son service. Les partis sociaux-démocrates et "communistes", aujourd’hui partis de gouvernement, seront certainement trop déconsidérés à ce moment-là. La place sera donc libre. Par les services qu’ils rendent déjà à la bourgeoisie avec leur politique ouvertement opportuniste -mais soigneusement enrobée de phraséologie révolutionnaire- les trotskystes, posent dès aujourd’hui bien qu’ils sien défendent, leur candidature à cette place.
Perspectives
Dans les années d’après-guerre l’économie de reconstruction a permis à certains de penser que le capital avait enfin résolu ses contradictions de façon définitive. La crise revient maintenant hanter la société bourgeoise provoquant dès ses premières manifestations une réaction de la part de la classe ouvrière, d’une ampleur que l’on n’avait plus vue depuis cinquante ans.
Il s’agit pour la bourgeoisie de faire face à ces difficultés et en premier lieu de tenter de museler le prolétariat. Aidée par tous les partis du vieux monde -même les plus extrémistes comme les trotskistes-, elle se raccroche à toutes les planches de salut, c’est à dire, à toutes les diversions qui peuvent encore mystifieras travailleurs. Parmi celles-ci, les élections sont encore une des meilleures - et il faut croire qu’en France elles ont fait un certain effet, puisqu’ à l’approche des élections la combativité ouvrière qui s’était manifestée depuis la rentrée de Septembre 72, s‘est maintenant presque assoupie.
Certes, les travailleurs français sont pour l’instant mystifiés et il y a certainement un nombre important qui a confiance dans le Programme Commun. Mais ils ne le sont pas autant que la bourgeoisie elle-même qui s’imagine qu’elle a remporté là une victoire décisive : au lendemain du ll Mars, les travailleurs se retrouveront avec les mêmes problèmes qu’avant : hausse des prix, austérité (comme pourries travailleurs américains déjà), montée du chômage. La bourgeoisie aura beau multiplier les consultations électorales : à trop servir cette arme s’usera et la crise qui ne manquera pas de s’avancer (ne parle-t-on pas de nouvelles difficultés pour le dollar ?) contraindra les travailleurs des pays industrialisés à renouer avec une combativité croissante qui, malgré un cours en "dents de scie" au niveau de chaque nation, ne s’est globalement pas démentie depuis plus de quatre ans.
C. Giné
[1] (1) Adresse du Conseil Central de la Ligue
[2] (1) Lettre circulaire 1879, citée par Rubel dans "pages de Karl Marx pour une éthique socialiste".
[3] (2) Engels, préface de 1895 aux "luttes de classes en France" de K. Marx.
[4] (1) R.I. n°2 : ” La crise monétaire” et "Comprendre Mai" R.I. n° 6 et 7 "La Crise” ; (1) conférence de presse du 22 janvier 73.
[5] (1) conférence de presse du 22 janvier 73.
[6] (2) Georges Marchais (encore lui) est particulièrement clair là-dessus, lui qui s'insurge, dans la préface du "programme commun", de ce "que l'intérêt national n'est pas ce qui guide la politique de l'UDR", et qui se propose de rassembler "des patriotes... qui s'alarment avec raison de voir le pouvoir faire bon marché de la grandeur et de l'indépendance françaises" page 42). Comme pour les communistes, il est irrécusablement admis, depuis le manifeste de 1848, que "les prolétaires n'ont pas de patrie", cet "intérêt national" ne peut évidemment signifier autre chose que l'intérêt du capital national.
[7] (3) : "le Monde", 25/11/72
[8] (1) souligné par nous.
[9] Résolution politique du 3è congrès de la Ligue Communiste
[10] "Lutte de classe", revue théorique de Lutte Ouvrière.
[11] Notons que cette formulation de l’appel signifie que le pouvoir direct des travailleurs, la dictature du prolétariat organisé en conseils ne pourrait pas satisfaire ces revendications puisqu’à la question posée, "il n’existe qu’une réponse"-
[12] Rouge n° 184, page 10 "qu’est-ce-qu’un vote de classe ?"
[13] Pour cela voir l’article sur ”La loi de la valeur et le capitalisme d’Etat" qui paraîtra dans le numéro-3, et la résolution sur ” Le capitalisme d’Etat ” dans RI n°l nouvelle série.
[14] Informations Ouvrières n° 593.
[15] On se souvient du vice-président du Conseil Maurice Thorez exhortant les travailleurs au travail avec des phrases du genre: "retroussez vos manches", "travaillez d’abord, revendiquez ensuite", "la grève est l’arme des trusts". On se souvient aussi des bombardements de Sétif (20.000 à 40.000 morts) dirigés par le ministre de l’aviation Charles Tillon, aujourd’hui "récupéré" par la ligue Communiste (on a les amis qu’on mérite).
[16] souligné par nous.
[17] ROUGE n°184 page l0
[18] Histoire de la Révolution Russe Tome-1 "Février" p. 397 Ed. du Seuil.
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Révolution Internationale (nouvelle série) N°3 - avril
- 578 lectures
LE CAPITALISME D’ÉTAT ET LA LOI DE LA VALEUR
- 1235 lectures
LA TENDANCE GENERALE AU CAPITALISME D'ETAT
La nature capitaliste des ‘états ouvriers’.
L’analyse théorique qui reconnaît que le stade de développement du capitalisme décrit par Lénine dans l’"Impérialisme" (stade des trusts et des cartels, du capitalisme monopoliste) n’est pas le stade suprême de ce mode de production, se situe parmi les contributions théoriques les plus importantes des groupes ultra-gauche.
- "Depuis 1917, le capitalisme est entré dans une nouvelle phase, sa phase de décadence. De profonds changements de structure, politiques et économiques ont eu lieu, et de ce fait, le prolétariat se heurte à de nouveaux problèmes et de nouvelles conditions dans sa lutte révolutionnaire.
Ces problèmes historiques nouveaux étaient nécessairement inconnus de Marx et des théoriciens marxistes du passé.
C’est en essayant de comprendre les conditions de cette nouvelle période que les révolutionnaires peuvent intervenir de façon efficace en aidant le prolétariat à prendre • conscience de sa tâche historique : l’ émancipation de l’ humanité."
(Marc- "Salut à Socialisme et Barbarie’ Internationalisme –page 43- Juillet 49)
Ces changements économiques et politiques structurels du système capitaliste (qui déterminent la période de crise permanente et de guerres mondiales impérialistes) constituent la transition du capitalisme monopoliste vers le capitalisme d’Etat; les nationalisations des moyens de production, la planification étatique centralisée, l’absorption progressive de la société civile par l’Etat, le stalinisme etc... doivent être situés dans la trajectoire historique du développement capitaliste.
Les léninistes ont chanté les louanges de la Russie stalinienne en la qualifiant de "patrie du socialisme"; la IVe Internationale voyait dans l’URSS un "état ouvrier dégénéré", avec "un appareil d’Etat fascisant, un système de distribution bourgeois, et un système de production 'socialiste" (sic). A l’opposé de ces conceptions, qui défendaient inconditionnellement l’URSS, les groupes d’ultra-gauche mettaient en avant la nature capitaliste de la formation économique russe.
- "Le mode de production capitaliste s’est historiquement développé sur la base de la propriété individuelle des moyens de production. La Révolution Russe a démontré que sous certaines conditions, le mode de production capitaliste peut continuer a exister, bien que les propriétaires individuels soient éliminés et remplacés par un appareil collectif d’exploitation, dans lequel personne ne peut dire: ce moyen de production particulier est ma propriété individuelle.
Nier que la Russie soit un capitalisme d’Etat, c’est nier que le développement historique ait donné naissance à une nouvelle réalité. Il n’existe pas de terme exprimant plus clairement l’ordre économique établi en URSS, que celui de capitalisme d’Etat.
Le mode de production est capitaliste, c’est à dire qu’à travers le salariat, il y a appropriation de plus-value, de profit. Cette appropriation est faite par l’appareil d’Etat qui contrôle les moyens de production et distribue la plus-value suivant les besoins du système; à savoir les nécessités d ‘une accumulation aussi rapide que possible, et la sauvegarde de l’appareil par l’accroissement de son pouvoir et de son "prestige".
(International Council Correspondance Volume III -n°3 et 6- Juin 1937)
Au moment où des Léninistes de toute sorte aidaient à mobiliser la classe ouvrière pour la boucherie de la 2ème guerre mondiale, sous les mots d’ordre de l’anti-fascisme, de résistance nationale, des quatre libertés, etc. l’aile radicale du mouvement ouvrier ne voyait pas de différence entre le ‘fascisme rouge’ et le ‘fascisme brun’ (Otto Rühle), entre les deux blocs rivaux impérialistes :
- "En ce qui concerne le capitalisme, il n’existe pas de différence entre sa forme monopoliste-démocratique et sa forme étatique. En ce qui concerne les capitalistes, les Russes sont différents des Allemands, et ceux-ci des Américains. Un commissaire Russe parvient à sa position et la défend d’une façon différente de celle d’un propriétaire anglais. Les travaux Goering ont une histoire bien différente de celle de United Steel Trust. Cependant, quelles que soient les différences entre les divers propriétaires et contrôleurs du Capital, ils se comportent tous de la même manière."
(Mattick -"Competition and Monopoly”-.New essays -Vol. VI n°3- 1943)
L’apparition du capitalisme d’Etat en URSS, ou les tendances explicites en cette direction en Allemagne Nazie, en Italie; en Turquie sous Kemal, au Japon sous Tojos... n’étaient pas pour l’ultra-gauche une aberration historique; le capitalisme d’Etat représentait une nouvelle phase du développement du Capital international.
Selon Paul Mattick, un des militants les plus cohérents du mouvement du Communisme des Conseils, le développement du Capitalisme d’Etat dans les sociétés capitalistes plus faibles et moins avancées donne un aperçu de l’avenir des métropoles capitalistes les plus avancées.
En l’absence de révolution prolétarienne, quel que soit le vainqueur de la 2ème guerre mondiale, la tendance vers le capitalisme d’Etat intégral continuerait à se manifester: "quel que soit le vainqueur sur le plan militaire, le monde continuera à aller du monopolisme vers le totalitarisme (capitalisme d’Etat), de la même façon qu’il est venu de la concurrence aux monopoles" (Mattick -Competition and Monopoly)
Les groupes d‘ultra-gauche avaient correctement saisi les tendances inhérentes au développement capitaliste. L’après-guerre a vu l’extension du capitalisme d’Etat (sur le modèle russe) à travers l’Europe de l’Est et les secteurs d’Extrême Orient (Mongolie, Corée du Nord). En 1949, le triomphe de Mao en Chine et la victoire de Ho Chi Minh en 54 au Nord-Viet ’Nam ont mené à une plus grande extension de ce système.
Secteur étatisé et secteur privé dans le capitalisme traditionnel.
En Europe Occidentale, dans les sociétés capitalistes fatiguées et affaiblies par la guerre, le secteur d’Etat s’est élargi: En Grande Bretagne, la Banque d’Angleterre, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, et les transports routiers ont été nationalisés[1]. En France, la Banque de France, les quatre banques commerciales les plus importantes, de grandes compagnies d’assurance, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, de larges secteurs de l’industrie aéronautique, ainsi que la plus grande usine de voitures et de camions (Renault) ont subi le même sort. En France, une planification centrale fut inaugurée et dans les autres pays européens, le réseau contrôlé par l’Etat se développe considérablement.
En Italie, l’énorme secteur étatique né sous Mussolini (banque, crédit, fer, acier, armement, secteur mécano-électrique, production de wagons de chemins de fer et de locomotives, construction navale et industrie maritime) est demeuré intact, et a même été élargi dans les années suivantes: les téléphones et l’électricité ont été nationalisés, et des secteurs dynamiques tels que le pétrole, le gaz et la pétrochimie ont été développés sous contrôle étatique(ENI)
Au cours de la période même de prospérité relative qu’a connu le capitalisme occidental dans les années de 1’après-guerre, de nombreux projets nécessitant des investissements considérables n’ont pu être entrepris que par l’Etat.
En France par exemple, parallèlement à une participation étatique dans la plus grande compagnie pétrolière (CFP) une nouvelle compagnie appartenant exclusivement à l’Etat a été créée pour l’exploitation, le raffinage et la distribution de gaz et de pétrole, et pour le développement des secteurs pétrochimiques (ELF ERAP) ; l’expansion et la réorganisation du secteur étatique de l’industrie aérospatiale ont aussi été réalisées. (Sud-Aviation).
En Italie, des industries de pointe telles que les télécommunications, les ordinateurs et les systèmes automatiques sont développés par le capital d’Etat (STET) ; l’industrie aérospatiale se développe sur une base égalitaire ( 50$-50$ ) par le capital d’État (IRI) et le capital privé ( FIAT ) à travers la nouvelle compagnie Aeritalia; on peut ajouter' que dans son effort de nationalisation et réorganisation du secteur chimique, l’Etat (à travers IRI et ENI) est devenu 1’actionnaire le plus important de la deuxième compagnie italienne Montecatini-Edison.
Pour empêcher les secteurs-clés de leur économie nationale (électronique, secteur nucléaire, ordinateurs, pétrole, pétrochimie) de tomber sous le contrôle américain, les gouvernements français, italiens, britannique, et Ouest-Allemand ont imposé aux trusts privés une série de réorganisations et fusions en vue de créer des compagnies nationales viables et compétitives[2].
Il devient de plus en plus clair que la seule mesure efficace pour résister à la menace de domination américaine, est la fusion des capitaux privés et étatiques au sein d’un cadre de planification et de contrôle étatique.
La crise économique actuelle produit déjà une expansion plus étendue du secteur étatique en Europe occidentale: nationalisation de Rolls Royce et réorganisation de la construction navale en Grande Bretagne; la récente participation du capital d’Etat italien dans l’entreprise de très gros appareillages électrique (la plus grande d’Europe) Zanussi.
Les USA paraissent être la seule exception à cette tendance générale vers le capitalisme d’Etat. En effet, les secteurs étatiques développés pendant la deuxième guerre mondiale (et qui englobaient 20$ de la capacité productive nationale) ont été démantelés à la fin de celle- ci et ‘vendus’ aux entreprises privées. Cependant, la stabilisation de l’économie américaine et le niveau de Keynésianisme (Interventionnisme économique de l’Etat) institutionnalisé n’ont été qu’une interruption de cette tendance; interruption résultant de la domination quasi totale du marché mondial par les USA à travers la défaite et l’épuisement temporaire de ses rivaux impérialistes.
Avec la stagnation du capitalisme américain et la perspective de crise économique mondiale, il devient clair que la tendance irréversible (que le capitalisme américain lui-même ne pourra pas contrecarrer) est celle qui mène à une économie contrôlée et à une fusion entre capital privé et capital étatique.
Un indice de nationalisation au moins partielle du crédit, nous est fourni par la récente ‘garantie fédérale de prêt concédée à Lockheed au bord de la faillite. Au moment de l’affaire Lockheed, l’été dernier, le président de la Bank of America, Chauncy J. Medberry déclarait que aucun "programme de l’ampleur du L-1011 (avion) de Lockheed, qu’il soit commercial ou de défense, ne serait plus financé exclusivement par du capital prive." Il énonçait ainsi les besoins de participation directe du capital d’Etat dans les futures gros investissements.
Le système récent de contrôle des prix et des salaires a accéléré ce mouvement vers une économie contrôlée -stade préparatoire du capitalisme d’Etat- et nous pouvons nous attendre dans les mois prochains à d’autres mesures dans ce sens.
Mais, c’est surtout dans le tiers monde sous l’impact de dizaines d’années de stagnation et de crises, que la transition vers le capitalisme d’Etat se développe plus rapidement.
Selon la résolution sur la politique industrielle adoptée en Inde en 1956 les industries suivantes devaient passer sous "la responsabilité exclusive de l’État": munitions, énergie atomique, fer et acier, équipement électrique lourd, charbon, pétrole, chemin de fer, mines, aéronautique, transports, construction navale, électricité. Parallèlement, l’aluminium, les machines-outils, les alliages ferreux, la chimie lourde, les fertilisateurs, le caoutchouc synthétique, les transports routiers et maritimes devaient: "progressivement devenir propriété étatique" et la responsabilité de nouvelles initiatives dans ce secteur serait prioritairement étatique. Le gouvernement permettait à d’importants trusts d’opérer dans ces secteurs mais sous son contrôle et sa réglementation. En outre, les banques, le crédit et les assurances ont été nationalisés.
La junte militaire qui gouverne le Pérou depuis octobre 68 a entrepris -une réorganisation complète des bases du capitalisme péruvien. L’Etat a déjà acquis le contrôle de 50% du capital bancaire; il a créé un holding (COFIDE, corporation de développement financier) destiné à fournir des crédits à long terme aux entreprises publiques et privées s’engageant dans des projets à échelle importante. Les secteurs pétroliers et minéraux sont contrôlés par des entreprises d’Etat (PETROPEROU et MINEPEROU). L’exploitation directe des gisements de pétrole et des mines, l’établissement des raffineries, la commercialisation des produits finis ainsi que les accords -quand nécessaire- en vue participation du capital étranger dans ces secteurs, toutes ces attributions tombent sous la responsabilité des entreprises d’Etat. Celui-ci a en outre l’intention de devenir propriétaire et -de contrôler les "industries de base", fer et acier, chimie lourde et pétrochimie.
Les modalités de développement du capitalisme d’Etat sont aussi diverses que les idéologies qui masquent cette réorganisation du capital: socialisme démocratique (Inde), marxisme-léninisme (Cuba), communautarisme (Pérou), socialisme arabe (Egypte) Unité populaire (Chili).
Aussi différents soient-ils, ces systèmes représentent des étapes dans le mouvement vers un capitalisme d‘Etat intégral.
CRITIQUE DES THESES DE PAUL MATTICK
Le capitalisme d'Etat, un nouveau système ?
Les groupes d’ultra-gauche ont compris depuis longtemps que la survie du capitalisme dans la période de crise permanente, requiert l’expropriation progressive du capitalisme monopoliste, la destruction des trusts privés et des cartels, et une réorganisation économique sous contrôle étatique. Derrière les façades des idéologies "marxistes-léninistes" et populistes, ils ont vu une exploitation plus intensive du travail salarié, menée à bien par la militarisation, le stakhanovisme, les salaires basés sur la productivité, l’intégration totale des syndicats dans l’appareil d’Etat etc.
Pour comprendre ces développements historiques nouveaux, il est néanmoins nécessaire de posséder une analyse scientifique des lois fondamentales de développement de société de capitalisme d’Etat.
Il est clair que des différences importantes entre le capitalisme d’Etat et le capitalisme privé existent tant au niveau des structures qu’au niveau de l’organisation, mais:
- "Ces différences sont-elles suffisamment importantes pour justifier la thèse qui veut que le vieux système socio-économique a été remplacé par un système nouveau FONDAMENTALEMENT DIFFERENT? Ce nouveau système se trouve-t-il alors soumis aux mêmes lois de développement et aux contradictions du capitalisme? "
("How new is the ‘NEW ORDER’ of Fascism?” Mattick, Partisan Review 1941)
En 1941, dans le contexte de son analyse de l’économie nazie allemande, Mattick arrivait à la conclusion que les systèmes basés sur la propriété d’Etat et contrôlés par celui-ci étaient soumis aux mêmes lois et en proie aux mêmes contradictions fondamentales que les formes antérieures du capitalisme.
- "L’ensemble du marché capitaliste -à 1’exception des relations de marché entre capital et travail- peut disparaître sans affecter la forme de production capitaliste. La relation de marché entre capital et travail est l’unique relation capitaliste EN SOI. Sans son abolition le mode de production historiquement développé et qui est appelé capitalisme, ne peut pas disparaître."
(Mattick "How new..." page 300)
Le capitalisme d'Etat échappe-t-il à la loi de la valeur ?
Dans ses articles plus récents et plus particulièrement dans son livre "MARX ET KEINES"[3] dont les trois derniers chapitres traitent DU CAPITALISME d’Etat) Mattick nous fournit une analyse bien différente quant à la structure et à l’organisation des sociétés de capitalisme d’Etat.
Mattick fonde son analyse sur deux prémisses de base (qui ont notre accord) :
- -Alors que la distribution du travail est déterminée, dans tout type de société par les "économies de temps", "le type de régulation de la production amenée par la loi de la valeur... est spécifiquement capitaliste".
- -Le capitalisme d’Etat est un système basé sur l’exploitation de la classe ouvrière, sur la séparation des travailleurs d’avec leurs moyens de production.
Il subsiste toutefois une question fondamentale: ces systèmes d’exploitation basés sur la propriété d’Etat sont-ils ‘régulés’ par la loi de la valeur, c’est à dire sont-ils des systèmes de production capitalistes ?
Mattick commence son analyse en mettant en avant les similitudes entre capitalisme privé et capitalisme d’Etat.
- "Tous les systèmes capitalistes d’Etat s’apparentent à l’économie de marché du fait que les rapports capital-travail s’y trouvent perpétués... Formellement, il n’y a pas grande différence de l’un à l’autre système, si ce n’est, dans le cas de l’étatisation, un contrôle plus centralisé du surproduit."
(‘Marx et Keynes’, p. 347 et 348)
En effet, "le capitalisme d’Etat continue d’être un système générateur de plus-value" (ibid. page 348). Toutefois, par la suite, Mattick affirme que la société capitaliste d’Etat n’est pas "régie" par la loi de la valeur, pas plus que ses relations économiques ne sont mises en ordre sur la base de cette loi". (Ibid., page 387)
Pour Mattick, là où il n ‘y a pas de propriété privée du capital, là où la production est planifiée centralement, là où les salaires et les prix sont contrôlés directement par l’Etat et même fixés par lui, là où capital et travail sont alloués en dehors des relations de marché, la loi de la valeur cesse de fonctionner.
Cependant, les caractéristiques propres au mode de production capitaliste - Double caractère du travail (travail concret et travail abstrait);double caractère de la marchandise (valeur d’usage et valeur d’échange); force de travail considérée comme marchandise; plus-value, travail non payé -ces caractéristiques qui déterminent les lois de développement du capitalisme, n’existent que dans une formation socio-économique dont le mécanisme régulateur est la loi de la valeur.
En plus du fait qu’on ne peut pas parler de plus-value là où la production de valeurs a cessé d’exister, les contradictions fondamentales et insolubles de la société capitaliste doivent disparaître avec la disparition de la production basée sur la loi de la valeur, puisque c’est cette dernière qui les a engendrées.
Si la production est "réglée consciemment, alors les crises de surproduction n’existent plus; si les biens ne sont plus des marchandises destinées à être échangées à travers le marché, alors, le problème de la réalisation cesse de se poser.
En ce qui concerne la baisse tendancielle du taux de profit,-considérée par Mattick comme la contradiction fondamentale du capitalisme et la source de ses crises- elle aussi cesse d’être un facteur opératoire:
- "Le capitalisme d’Etat ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival ... Le capitalisme d’Etat peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."
("Marx et Keynes" page 350)
En raisonnant de la sorte, Mattick a rejeté la base matérielle de la révolution prolétarienne. Le communisme est le résultat de l’impossibilité économique de poursuivre l’accumulation du capital sur une échelle élargie; les crises économiques sont la principale manifestation de cet essoufflement du processus d’accumulation. Ceci n’est pas dire que les crises engendrent automatiquement une révolution socialiste, car le prolétariat doit prendre conscience de sa tache historique, il doit agir consciemment et se débarrasser du poids de l’idéologie bourgeoise.
Si ce processus n’a pas lieu, le monde sera condamné à une nouvelle orgie de guerres et de destruction. Cependant, la paupérisation croissante de la classe ouvrière, la crise permanente du capitalisme sont la base matérielle sur laquelle se développe la conscience de classe.
Là où il n’existe pas de crise économique, là où le système peut produire "sans être mené à la stagnation", le socialisme perd sa base de nécessité objective et devient simplement un espoir ou un rêve. La révolution prolétarienne en viendrait alors à dépendre de la puissance de persuasion de "l’idée", ou du programme que des intellectuels amèneraient à la classe. En ce sens, Mattick va du marxisme au socialisme utopique, du matérialisme à l’idéalisme.
Le capitalisme d ' Etat échappe-t-il à l'impérialisme ?
Selon Mattick, ce ne sont pas uniquement la loi de la valeur et les contradictions qui en découlent qui disparaissent dans le capitalisme d’Etat; "bases de l’impérialisme sont également absentes. Mattick a toujours soutenu que l’impérialisme est un produit inévitable" du mode de production capitaliste; sa base étant la recherche d’un taux de profit plus élevé dans les colonies (à travers l’exploitation des capitaux) pour contrecarrer la tendance à la baisse dans la métropole. Toutefois, il est clair que cette inévitabilité de l’impérialisme est spécifique seulement aux sociétés où la loi de la valeur joue, et ainsi elle est exclue dans la conception du capitalisme d’Etat chez Mattick.
Celui-ci évoque pour l’époque actuelle, une seconde cause de l’inévitabilité de l’impérialisme :
- "Il a pour objet non seulement de faire triompher les intérêts de groupes capitalistes organisés sur le plan national, mais encore de défendre ici et d’anéantir là- bas des structures sociales différentes."
("Marx et Keynes", page 324)
Pour Mattick, le capitalisme privé doit lutter contre la montée du capitalisme d’Etat, celui-ci constituant, un système différent et rival. Le capital privé "ne saurait tolérer l’expansion d’un système social différent du sien... Il lit dans la disparition du capital privé à l’étranger l’annonce de son éventuelle atrophie en Amérique". (Ibid, page 323)
Capitalisme d’Etat ou "Socialisme d'Etat" ?
Pour Mattick, cette explication aussi n’a d’application que pour le capital privé. Il argumente qu’à "côté du marché mondial dominé par les U.S.A" (cette partie du globe où domine l’impérialisme, et le colonialisme delà sphère du capitalisme privé) "il existe une espèce de second marché mondial dans lequel l’exploitation des pays sous-développés par les pays plus avancés est restreinte ou absente". ("The United States in South East Asia”, International Socialist Journal, Parag 14, page 134, Paul Mattick.)
Ce second marché mondial est composé du bloc de l’est, des sociétés de capitalisme d’Etat. Il semble que pour Mattick, le capitalisme d’Etat n’a besoin ni d’expansion ni d’impérialisme pour survivre. Ces sociétés n’auraient apparemment pas à exploiter ou piller les pays sous-développés.
A travers sa tentative pour distinguer le capitalisme d’Etat du capitalisme à ses débuts, il apparaît que pour Mattick. Les lois de développement, les mécanismes régulateurs ainsi que les tendances de développement ne sont pas les mêmes dans le capitalisme privé et le capitalisme d’Etat. Pour lui, ce dernier est un mode de production complètement différent, de celui que Marx analysait dans le ‘Capital’. Il le reconnaît quand il dit:
- "Le capitalisme d’État n’est ni capitaliste au sens traditionnel, ni socialiste au sens de Marx.
Du point de vue du capitalisme privé on peut le définir comme un socialisme d’Etat, du seul fait que le capital y est centralisé par l’État, mais du point de vue du socialisme prolétarien, il faut le définir comme un capitalisme d’Etat, puisqu’il perpétue la répartition capitaliste des conditions de production entre travailleurs et non-travailleurs. S’appliquant à des conditions identiques, les deux termes sont interchangeables."
(‘Marx et Keynes’, page 383)
Si la division entre travailleurs et non travailleurs est la seule caractéristique capitaliste de ce système, nous faisons remarquer que cette caractéristique n’est PAS spécifique au mode de production capitaliste.
La propriété et le contrôle des moyens de production par les non-travailleurs, l’extraction d’un surplus caractérisent des sociétés aussi différentes que la Rome Antique, l’Europe Féodale, et l’Empire INCA. L’exploitation des masses travailleuses commence avec la dissolution du communisme primitif et non pas avec le mode de production instauré par la bourgeoisie.
Le caractère spécifique de l’exploitation capitaliste se manifeste lorsque le surplus devient plus-value, sous forme de marchandises.
Ainsi le terme de capitalisme d’Etat employé par Mattick est faux. Le capitalisme d’Etat ou socialisme d’Etat tels qu’ils sont décrits par Mattick sont des sociétés d’exploitation qui ressemblent étrangement à la description que faisaient Bruno Rizzi et Max Scatman du "collectivisme bureaucratique", théorie apparue à la veille de la seconde guerre mondiale.
La crise du capitalisme, la crise du mode de production capitaliste basé sur la loi de la valeur n’engendre plus l’alternative historique: socialisme ou barbarie mais plutôt l’alternative: Socialisme barbarie ou capitalisme d’Etat. Le prolétariat n’est plus le seul à pouvoir résoudre les contradictions du capitalisme à travers la destruction de l’Etat bourgeois et du mode de production capitaliste; pour Mattick, le capitalisme d’Etat représente aussi une résolution historique des contradictions du système.
Peut-être trouve-t-on ici la raison du pessimisme de cet auteur en ce qui concerne la révolution prolétarienne. Il a dit par exemple que "l’époque des révolutions est peut-être révolue", bien qu’il dise aussi "tout est possible, même une révolution prolétarienne".
En l’absence d’une analyse plus détaillée et complète, il nous est impossible de savoir si Mattick prévoit une époque de socialisme d’Etat universel à la suite de l’essoufflement du capitalisme; pour le moment, nous tirons comme conclusion que, poux lui, une intervention consciente du prolétariat sur la scène historique demeure seulement une possibilité. Nous sommes loin de la conclusion qu’il donne à une brochure de 1935,"L’inévitabilité du communisme."
"Mais prématurée ou trop mûre, la révolution -locomotive de l’histoire- et avec elle la société communiste, s’affirme nécessairement et est menée à bien par les travailleurs eux-mêmes. La marche antérieure de l’histoire a créé des conditions ne permettant pas d’autre issue, la solution est identique aux nécessités vitales de la majorité de l’humanité."
Un libre développement des forces productives ...
Les contradictions spécifiques auxquelles le système capitaliste est en proie et qui mènent à son effondrement, à la paupérisation absolue de la classe ouvrière sont les manifestations particulières de cette contradiction fondamentale qui crée la nécessité objective de révolution sociale dans n’importe quelle formation socio-économique.
- "A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s tétaient mues jusqu’alors et qui n’en sont que l’expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale.’
(K. Marx, Avant-propos à la ‘Critique de l’Economie politique’ Ed La Pléiade -Tome1- page 272)
Selon Marx, le ‘moteur’ du développement historique est le développement des forces productives de la société: c’est seulement lorsque ces forces ne peuvent plus se développer dans le cadre des rapports de production existants que la révolution est à l’ordre du jour.
Cependant, cette impossibilité d’un développement plus étendu des forces productives n’est pas le fait d’une mauvaise gestion de la société par la classe exploiteuse, mais est inhérente à l’organisation et à la structure du mode de production lui-même dans ses lois régulatrices.
Mattick argumente que le capitalisme d’Etat ou socialisme d’Etat n’est pas sujet aux contradictions des sociétés basées sur la loi de la valeur; il affirme que ce nouveau mode de production permet un plus grand développement des forces productives que sous le capitalisme privé.
- "A la différence des économies occidentales de concurrence, les économies centralisées telles la Russie et ses satellites ne semblent pas craindre les conséquences de la cybernétique... En principe, ...la nature centralisée du capital russe permet une application plus large de la cybernétique aux processus économiques et sociaux que celle permise à l’Ouest. Et ceci à son tour permet une automation plus rapide parallèle à 1’augmentation générale de la productivité"
(‘The Economies of Cybernation’, Mattick, New politics)
Sous le capitalisme d’Etat, "le rythme et l’extension de l’automation industrielle sont déterminés par le fond d’accumulation disponible et le besoin de remplacement de l’appareil productif existant" (ibid)
En d’autres termes, le développement des forces productives n’est pas freiné par les questions de profit, ni par les difficultés de la réalisation de la plus-value ; seule la question technique concernant la quantité disponible de moyens de production -qui ne sont plus du capital constant- paraît affecter le taux et l’extension de ce processus.
Cependant, ce qui nous intéresse, c’est de savoir si Mattick prévoit un moment où le socialisme d’Etat lui-aussi deviendra une barrière au développement des forces productives; moment où la poursuite du développement de celles-ci exigera la destruction des rapports de production caractérisant ce nouveau système.
Mattick écrit :
- "Théoriquement et à l’exclusion de catastrophes naturelles ou politiques, l’introduction et l’extension de la cybernétique pourrait être un processus ordonné. La production pourrait être augmentée jusqu’à l’abondance, le temps de travail réduit, et même les deux processus pourraient être simultanément réalisés, bien que plus lentement. En pratique, ceci n’est pas possible étant donné que la Russie fait partie de l’économie mondiale et concurrence les autres nations en vue d’une suprématie économique et politique."
(‘The Economies of Cybernation’, New politics)
Il semblerait alors que ce ne sont pas les "lois" économiques de ce système, mais bien la menace d’un capitalisme privé encore puissant qui empêcherait le plein développement des forces productives à l’Est; c’est la nécessité de se défendre contre l’occident qui empêche dans la pratique ce qui est possible en théorie.
Peut-être que pour Mattick, l’extension du capitalisme d'Etat à travers le globe et le triomphe du système qui "élimine l’exploitation des pays sous-développés par les pays développés" permettra finalement le plein développement de la technologie.
Toutefois, Mattick invoque encore un autre facteur, cette fois-ci un facteur interne qui limite le développement des forces productives dans le système capitaliste d'Etat.
- "Dans le cadre d'une société où l’on pourrait réduire à un minimum le travail nécessaire, toutes les causes objectives des antagonismes sociaux disparaitraient. En revanche, dans toutes les sociétés de classes, et cela concerne les sociétés actuelles fondées sur la production de capital, le développement des forces sociales de production se voit entravé dés au’ il risque de nuire au bien-être et à la survie de la classe socialement dirigeante."
(‘Marx et Keynes’, page 359)
C’est apparemment la classe dirigeante qui délibérément et consciemment retarde le développement des forces productives de façon à empêcher la disparition de ses privilèges et l’effondrement, des rapports sociaux dont ils dépendent. Privilèges et rapports sociaux qu’un état d'abondance mettrait en péril.
Mais une classe dirigeante régie-t-elle consciemment le développement des forces productives de façon à empêcher la disparition ou bien ce processus est-il déterminé en dernière analyse par les lois de cette formation particulière, indépendamment de la volonté subjective de la classe dirigeante?
Dans toutes les sociétés antérieures, ce ne fut pas la capacité des forces productives à se développer, mais bien leur incapacité à se développer au-delà d'un certain point qui menaça la domination de la classe dominante. En effet, aussi longtemps que les forces productives pouvaient se développer dans le cadre des rapports existants, il n’y avait pas de possibilité de révolution sociale, et aucune menace ne se faisait jour contre la loi des exploiteurs. Le développement des forces productives prend fin lorsque les rapports de production existants ne permettent plus leur développement; c'est cette situation qui crée la nécessité objective de renversement des rapports de production.
Ce ne sont pas les capitalistes qui empêchent un développement plus grand des forces productives; ce sont les rapports de production capitalistes qui ne sont plus un cadre adéquat à un tel développement.
Mattick renverse cette relation causale, -base du matérialisme historique- lorsqu’il traite du socialisme d'Etat : pour lui, ce serait dans ce cas, la volonté subjective de la classe dominante qui empêcherait le développement des forces productives, bien que les rapports sociaux permettent un tel développement.
(A SUIVRE)
MAC INTOSH
(Reproduit du n° 2 d’Internationalism New York - sept 72)
[1] Le fer et l’acier ont été dénationalisés en 1951; et ensuite nationalisés de nouveau et réorganisés sous le nom de British Steel Corporation, sous le gouvernement de Wilson.
[2] Voir le refus opposé par le gouvernement- français à la vente du trust électronique Jeumont-Schneider par’ le groupe bancaire Empain, à Westinghouse et 1 ‘imposition gouvernementale de réorganisation et rationalisation du secteur électronique. Voir aussi les efforts du gouvernement italien pour empêcher la vente de Ercole Marelli et Franco Tosi, à Westinghouse conjointement aux négociations récentes en vue de la création d’un trust électronique national avec capital privé (Fiat, Marelli, Franco Tosi) et capital étatique (Finmeccanica) ; nous citons ces 2 exemples parmi les nombreux cas existants.
[3] (1) Edition française chez Gallimard Fév. 1972 -
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Révolution Internationale (nouvelle série) N°4 - juin
- 25 lectures
Rubrique:
CONFERENCE INTERNATIONALE
- 25 lectures
Au mois de Mai s'est tenue en Angleterre une conférence regroupant un certain nombre de groupes révolutionnaires. Cette rencontre n'avait nullement des objectifs immédiatement pratiques, mais constituait bien plutôt une tentative de connaître les positions d'autres fractions d’un mouvement renaissant à 1'échelle mondiale. Malgré toutes leurs limitations, de telles réunions sont pour nous d’une importance vitale. Les révolutionnaires se situent d'emblée, même lorsqu'ils sont peu nombreux, dans une perspective internationaliste. Ils ne se considèrent nullement comme une organisation nationale mais comme une fraction d’une classe mondiale. Il n'y a pas de principes qui soient "variables" selon les pays et les latitudes. Il n'y a pas non plus de domaines réservés, d'"indépendance nationale" des groupes. Tout révolutionnaire a le droit et le devoir d'intervenir activement là où il peut et les problèmes qui affrontent les ouvriers de tel ou tel pays sont ceux des prolétaires de tous les autres. Pour nous, les positions de classe ne sont pas le fruit de "cas particuliers" mais d'une expérience historique mondiale.
Si ce n'est que par une confrontation serrée, une autocritique impitoyable que le prolétariat pourra s'émanciper, les taches commencent dès aujourd'hui et par-delà les frontières.
Les groupes qui ont participé à ces discussions sont les suivants :
WORKERS’ VOICE : Ce groupe d'ouvriers est apparu au cours de la remontée des luttes en 1971-72 en Angleterre dans les usines de la région industrielle de Liverpool-Birkenhead. Ses positions essentielles sont 1'anti-parlementarisme, l'anti-syndicalisme, opposition aux luttes de libération nationale. C'est à dire qu'ils se situent sans ambiguïté dans la tradition de la Gauche Communiste européenne des années 20 : sur le terrain du prolétariat. Violemment hostiles aux trotskystes, maoïstes et autres opportunistes, la plupart de ces camarades nous semble cependant avoir développé, par réaction au substitutionisme léniniste des tendances conseillistes.
LE GROUPE DE LONDRES : est une tendance qui vient de scissionner du groupe "Solidarity". Ce dernier groupe se réclame des idées de "Socialisme ou Barbarie". Après avoir formé une fraction marxiste, ils ont rompu essentiellement sur la défense du matérialisme dialectique contre les aberrations cardanistes de "Solidarity" (idéalisme, pas de contradictions objectives dans le capitalisme, "dirigeants-dirigés "etc... ) et leur bouillie opportuniste (soutien au MLF, aux luttes de libération nationale etc.). Les camarades de Londres se rapprochent des idées de R.I.-Internationalism mais il y a encore discussion sur deux points de taille : la révolution russe et la question de 1'organisation.
L’ex-groupe de SOLIDARITY-ABERDEEN : qui a scissionné de "Solidarity" sur la question nationale et des questions d'organisation se réclame du marxisme et semble fortement influence par les idées du GLAT particulièrement sur la question de la crise.
Outre ces trois tendances d'apparition récente, en pleine évolution et qui en sont encore à se définir, deux tendances françaises R.I. et le GLAT étaient représentées (la camarade du GLAT a spécifié qu'elle était venue à titre individuel). Le Manifest Gruppen (Suède) et le Mouvement Communiste (France) ont envoyé des textes à la conférence.
LES DISCUSSIONS
Quatre sujets de discussion ont eu lieu :
1: LA CRISE. Ce débat ne pouvait de toute évidence être approfondi oralement et s'est résumé le plus souvent à une confrontation d'affirmations. Une opposition nette est apparue entre Aberdeen et R.I. sur la question de savoir si le capitalisme avait réussi, pour un temps, à éloigner la crise. Derrière cette polémique se cache en fait une différence radicale de méthode. Aberdeen se réclame des analyses du GLAT sur la baisse du taux de profit et de la lutte de classe comme auteur de la crise. Il se fonde sur la baisse d'intensité de la lutte de classe en Angleterre et une petite reprise temporaire pour affirmer que le spectre de la crise s'est pour quelque temps éloigné. (Pour une critique des thèses d'Aberdeen, voir R.I., bulletin de discussion n° 2) Quant à Workers' Voice, il y a reconnaissance générale de la crise, mais il ne semble pas y avoir de position développée et homogène sur cette question.
Londres et R.I., d'accord sur ce point, ont insisté sur le fait qu’on ne pouvait poser cette question de façon pragmatiste, étroitement nationale et purement conjoncturelle. Une conception générale de la période historique est le fondement même de toute analyse. 2 *
2 : LES SYNDICATS. En apparence, la position de tous les groupes présents semblait homogène. Tous considèrent les syndicats comme des organes contre-révolutionnaires et affirment que le prolétariat devra les détruire. Mais en fait la discussion a mis en lumière des clivages sérieux qui révèlent que derrière l’accord sur ce point se cachent de profondes différences. Le GLAT, et si nos souvenirs sont exacts, Aberdeen, estiment que les syndicats ont dès leur naissance au XIXo siècle été des gardiens de 1'ordre capitaliste, alors que R.I. et la plupart des camarades de Londres considèrent que c'est là une position qui ne tient pas compte de la différence des périodes historiques, (voir l'article de J.A. dans ce numéro, sur le GLAT.).
Sur la question des shop stewards tous les camarades présents se sont accordés à les définir comme des institutions bourgeoises et complètement intégrées, sauf les camarades d'Aberdeen qui défendent la conception d'une double nature de ces organisations, en s'appuyant sur le fait que les shop stewards sont élus et révocables à la base. Cette conception formaliste ne tient aucunement compte du problème de la fonction que doit remplir toute organisation permanente dans la société actuelle.
Les camarades de Workers' Voice ne partageaient nullement cette conception et ont montré de façon très convaincante l'intégration totale des shop stewards. Mais ils étaient par contre extrêmement hésitants sur la question de savoir si des militants pouvaient être shop stewards. Notre position à ce sujet était que ce n'était pas une question de tabou mais de savoir que l'on ne peut pas défendre clairement une perspective de rupture avec les syndicats tout en "organisant” les ouvriers à partir d'un poste syndical. Une fois dans une telle position, toutes les "critiques" à l' égard des syndicats deviennent une caution indirecte.
3 : L'ORGANISATION. Si tous étaient d'accord sur de très vagues généralités (rejet du substitutionisme mais affirmation de la nécessité d'une organisation des révolutionnaires au sein de la classe), la discussion n'a pas permis de véritablement faire ressortir de manière claire les divergences assez sérieuses que les participants ressentaient sur cette question. Quant à nous, très schématiquement, il nous a semblé que le rejet simple du substitutionisme menait la plupart des camarades présents à une tendance à sous-estimer le rôle politique de l'organisation et la nécessite d'un processus de centralisation à l'échelle nationale et internationale. Ceci conduit certains d'entre eux, notamment certains camarades de Workers' Voice à tendre à transformer les formes démocratiques nécessaires en fétiches administratifs.
4 : LE COMMUNISME. Bien que la discussion fût assez brève et ne permît pas d'aborder tous les problèmes complexes et non résolus sur la période de transition, il a semblé se dégager un accord général sur le contenu du communisme, comme destruction du salariat et de la production marchande, contre les idées de nationalisation et d'autogestion.
Les groupes participants ont décidé de maintenir un contact étroit pour approfondir la discussion.
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution Internationale (nouvelle série) N°6 - novembre-décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.6 Mo | |
| 1.86 Mo |
- 39 lectures
Crise du pétrole et récession
- 18 lectures
Au moment où nous sortons le n°6 de R.I., un vent de panique s’est mis à souffler sur le monde entier : depuis quelques jours, il n’est plus question que de la "crise du pétrole" et de ses effets désastreux sur l’économie mondiale. Les milieux officiels n’hésitent pas à parler de "croissance zér0 tt et de doublement du chômage pour 1974.
L’article qui suit,(Surproduction et Inflation, écrit avant la panique actuelle peut presque sembler démodé. Ainsi la question qu’il commence par poser : "La crise existe-t-elle ?", fait aujourd’hui sourire. Mais il n’en demeure pas moins d’actualité dans la mesure où il tente de montrer les causes profondes de l’inflation qui continue à sévir, ainsi que de la récession que tout le monde prévoit maintenant pour 1974. Et en cela, il permet de répondre par avance à la campagne de mystification qui se développe sur "la crise du pétrole". En effet la situation présente appelle les remarques suivantes :
1. : Il est indiscutable que le ralentissement des livraisons de pétrole entraîne déjà d’importantes difficultés pour les économies des plus développés, qui en ont fait une matière première extrêmement importante. Il est hors de doute également que les hausses sur ce produit contribueront à aggraver encore l’inflation. Ceci dit, il faut préciser que la situation politique qui est à l’origine de ces mesures est elle-même provoquée par une guerre qui tire ses causes profondes de l’aggravation les tensions inter-impérialistes conséquentes de la crise du capital mondial. En ce sens on peut dire que, bien que facteur aggravant, la crise du pétrole n’est elle-même en dernier ressort qu’un produit de la crise économique générale.
2. : La récession annoncée maintenant à grands cris pour 1974 a été prévue AVANT les derniers évènements du Proche-Orient (en particulier par l’OCDE). L’actuelle crise du pétrole et le freinage de la croissance qu’elle provoque dans les pays affectés, ne pourra qu’aggraver cette récession. Mais elle n’en sera pas la cause. Même si la, crise pétrolière se poursuit, elle ne sera que l’amplificateur d’un phénomène dont les racines sont ailleurs.
3° : L’extraordinaire battage qui est actuellement fait, dans le monde entier, autour des restrictions pétrolières n’est pas le seul résultat de l’affolement momentané, ni du goût du sensationnel des journalistes.
La-bourgeoisie mondiale trouve dans cette crise un bouc-émissaire inattendu, mais particulièrement opportun pour précipiter une série de mesures "impopulaires" qu’elle devra prendre. Les classes dominantes savent que la "récession" prévue exigera des licenciements, du chômage, c’est-à-dire d’attenter à un des seuls avantages réels que le capital ait été capable d’offrir au prolétariat depuis la deuxième guerre : la sécurité de l’emploi.
Celle-ci lui permettrai de supporter une deshumanisation accélérée de sa vie et de son exploitation. Les classes dominantes savent qu’elles devront s’attaquer de plus en plus violemment aux salaires réels de la classe ouvrière.
Elles savent aussi que depuis quelques années, il n’est pas aisé de s’attaquer trop brusquement au niveau de vie des travailleurs. La conscience des capitalistes du monde entier est aujourd’hui pleine d’avertissements qu’importent des noms comme Mai 68, Mai rampant italien, ou Gdansk 70.
La politique des pays producteurs de pétrole du Proche-Orient fournit dans ces conditions une occasion trop tentante de rendre effective une part de ces mesures; tout en en faisant porter la responsabilité sur cet homme à tout faire des moments difficiles de la bourgeoisie : "l’étranger" (en l’occurrence les arabes). Si les choses sont bien faites, on peut même se payer le luxe d’une petite "union sacrée de toutes les classes" face à la difficulté. La manœuvre est trop intéressante pour ne pas la deviner derrière toutes les campagnes de propagande actuelles qui accompagnent un raz de marée totalement disproportionné de fermetures d’usines et d’élévation des prix (l’essence en particulier). La force mystificatrice de cette manœuvre doit être dénoncée.
Dans l’ambiance de panique que la bourgeoisie développe une intervention militaire américaine au Proche-Orient, afin de rétablir "l’ordre pétrolier", apparaîtrait aux yeux des populations occidentales plus justifiée que lors des précédents conflits. La bourgeoisie aux abois aura de plus en plus à utiliser ce genre de mystifications. Dans cette tâche elle pourra compter sur les partis de gauche et sur les rabatteurs de ceux-ci : les gauchistes.
C’est pour cela que dans la période qui vient les révolutionnaires devront redoubler d’efforts pour mettre en lumière les véritables causes de la crise actuelle. Ils devront dénoncer toutes les mystifications véhiculées par les partis du capital pour tenter de préparer le prolétariat à la guerre impérialiste; seule réponse possible du capital a la crise.
Les deux articles "Surproduction et Inflation" et "la 4ème guerre du Proche-Orient" s’inscrivent dans cet effort.
Evènements historiques:
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Rubrique:
La grève des petits commerçants et le prolétariat
- 10 lectures
Lorsque face à la taxation, les petits commerçants ont fermé boutique, toute la "gauche" et l’"extrême gauche" ont brandi le drapeau de l‘alliance de toutes les "couches populaires" contre le capital. Soutien critique, soutien tactique, soutien conditionnel : chacun se démarque des affreux "opportunistes" d’à coté. Mais tous, sans exception, préconisent, l ‘union des couches inférieures du commerce avec le prolétariat.
Quant à nous, nous nous opposons absolument à tout front, fût-il temporaire, spécifique et "conditionnel", entre la classe ouvrière et d’autres couches sociales. Nous voulons ici essayer d’indiquer quelques-unes des raisons qui fondent notre position et montrer le sens des propositions d’alliance inter-classiste’ Nous traiterons uniquement du problème du petit commerce et non de celui de l’agriculture, qui est plus complexe (R.I. N° 5, ancienne série)
Quelle est la place des petits commerçants dans le système ?
Si la bourgeoisie et le prolétariat sont les deux classes fondamentales de la société capitaliste, elles ne sont pas seules. Il subsiste des catégories extérieures au schéma de la production capitaliste et qui sont des survivances de modes de production antérieurs.
Les petits commerçants en particulier sont des représentants de la période pré-industrielle. Mais ils n’en échappent nullement pour autant aux lois du capital qui domine l‘ensemble de la société. Ils dépendent étroitement des circuits de distribution et du marché dominé par le capital. Il est vrai que le capital leur abandonne les secteurs non rentables (ou pas encore). Il est vrai que, tirant profit de l’anarchie de la distribution, il arrive encore que, dans certains secteurs nouveaux ou de luxe, se développent des entreprises indépendantes. Mais il est clair que cela n’infirme pas la tendance à leur dépendance accrue et à leur disparition progressive, ni leur confère un rôle "indépendant" nouveau. Le petit commerçant n’est plus aujourd’hui le légendaire et fier entrepreneur qui défend sa "liberté" face au capital. Il reçoit ses marchandises soit directement d’entreprises capitalistes, soit de réseaux de distributions capitalistes. Le plus souvent, il dépend, pour se moderniser un tant soit peu, de la "générosité" du capital bancaire. Gueulard dans les meetings contre "les riches" en général, il est tout obséquieux devant ses fournisseurs et ses créditeurs. Avec ses airs de sans culotte, il trompe les journalistes et les gauchistes -mais pas les bourgeois !
Contrairement au prolétariat, les couches moyennes ne sont pas une classe porteuse d’une solution historique. Eh effet, ce qui fait l’unité d’une classe, c’est sa finalité historique, c’est la société qu’elle représente et non sa simple qualité de catégorie socio-économique. La finalité des classes moyennes n’existe pas; la forme de société à laquelle elles aspirent est une forme irréelle et irréalisable. Autrement dit, ces classes ne représentent pas un mode historique de production, elles ne sont porteuses d’aucune forme sociale.
Cette absence d’une forme sociale propre aux classes moyennes provient du fait que le capitalisme a poussé la socialisation de la production à un point où elle entre en contradiction avec toute forme d'échange, toute forme d'appropriation privée. Sauf si l'on suppose que l'humanité puisse retomber à un stade primitif ou dégénérer, sa survie exige désormais l’instauration du communisme : il n’y a plus d’autre rapport de production possible.
N’étant pas homogènes, les couches moyennes n’ont aucun intérêt commun :
- en tant que propriétaires de moyens de production, elles ne peuvent se hausser à la vision socialiste du monde, c’est à dire la fin de l’appropriation des richesses ;
- en tant que travailleurs indépendants et individuels, elles ne peuvent acquérir ni une vision collectiviste ni globale du monde ;
- en tant que travailleurs isolés elles ne peuvent acquérir un esprit de classe, chacun défend ses propres intérêts, qui ne sont pas les mêmes que ceux de son propre concurrent ;
- en tant que couches liées par toutes leurs fonctions à la marchandise, elles sont soumises à la forme actuelle (et la seule possible) de la société marchande : elles vivent en parasites du système. Elles "revendiquent” en son sein, mais tant qu’elles ne sont pas précipitées dans le prolétariat, tant qu’elles ne sont pas dépossédées, elles dépendent des conditions de leur survie sociale, même si cette survie n’est qu’une misérable agonie.
L’absence de vision historique des classes moyennes a une double conséquence : dans les luttes sociales, elles tentent bien de défendre leurs intérêts particuliers, mais sont réduites, quand les choses deviennent sérieuses, à l’impuissance; il ne leur reste plus qu’à se réfugier dans les bras du capital, sauf si le prolétariat, par sa force, leur inspire la prudence de rester neutres.
Pourquoi la démagogie de la "gauche" ?
La "gauche" s'apitoie naturellement sur le sort des petits commerçants. La CGT et le PC en tête, elle multiplie les oppositions de collaboration de classe entre toutes "les victimes de la politique (?) du gouvernement en matière (?) d'inflation." (L’Humanité)
Chaque jour nous amène son lot de perles. L‘hebdomadaire du PCF, "France Nouvelle", déclare : "Peut-on être révolutionnaire, peut-on vouloir le socialisme et considérer la démocratie avancée comme l’ouverture à ce dernier et, en même temps, défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises, c’est à dire, de propriétaires de moyens de production et d’échange, dont un certain nombre exploite la force de travail?" Sa réponse est affirmative. Et il conclut ; "En fin de comptes, et pour en revenir à l’alliance, sa base n’est donc en aucune manière conjoncturelle." La CFDT paraît avoir un langage plus gauchiste. Après la réunion tenue avec le bureau de la Fédération Nationale des syndicats des Commerçants non sédentaires, la CFDT déclare..."Comprendre le mécontentement des détaillants". Elle (la CFDT) leur a soumis en vue d’actions communes le texte de la déclaration des syndicats et des partis de gauche du 8 Novembre en insistant sur le caractère anti-capitaliste des objectifs poursuivis, qui mettent en cause tant le gouvernement que le patronat. Cela devient plus absurde encore que la CGT. Cette dernière en effet proposé aux commerçants une lutte contre les "monopoles" et le gouvernement, ce qui a au moins l’avantage d’être formellement logique. Mais la CFDT propose à des marchands de lutter contre le capital qu’il parasite. Autant demander du lait à un bouc.
Les fascistes ou le programme commun pourraient à la rigueur entraîner les commerçants dans l’attrape-nigaud de la lutte contre les "gros”. Mais quand M. Maire leur demande de devenir "anti-capitalistes", il leur demande de signer leur arrêt de mort. En fait, la CFDT ne croit pas à son propre baratin. Elle cherche simplement à paraître un peu plus à gauche que la CGT avec son "anticapitalisme" de pacotille, de façon à grignoter quelques ouvriers crédules.
Mais le but de toute cette démagogie effrénée est essentiellement de noyer toute réaction ouvrière dans le flot larmoyant des jérémiades démocratiques et inter-classistes. Un grand mouvement populaire sur un objectif concret et précis : La vie chère, dans lequel toute tentative par la classe ouvrière de -s ‘attaquer au capital puisse être traitée de "division" -voilà le rêve de M. Séguy; tant que les ouvriers sont noyés parmi la masse des "victimes" du gouvernement, la gauche peut manœuvrer, contrôler la classe, rassembler les "voix" des mécontents. Il faut à la gauche dans les conditions actuelles, pour parvenir au pouvoir, une classe docile, disciplinée, qui répond aux consignes syndicales et un glissement des voix de la petite bourgeoisie.
La gauche sait très bien que le seul dénominateur commun des prolétaires et des petits commerçants, c’est un antigouvernementalisme superficiel qui ne peut trouver son expression que sur le terrain "politique" des élections. Ce terrain est son terrain en tant que fraction du capital, et de plus, il est le terrain où les travailleurs atomisés et passifs ne lui poseront aucun problème.
Et dans cette opération, les gauchistes tiennent leur place habituelle, comme on va le voir.
Comment les gauchistes s'associent à cette opération
L’hebdomadaire "Rouge" du 16 novembre 1973 se permet de critiquer le PC qui soutient "inconditionnellement les petits commerçants". "Rouge" une fois de plus a le cul entre deux chaises et dit calmement sans rire, "le mouvement actuel des commerçants ne peut être soutenu inconditionnellement" (Nous soulignons). "Rouge" sera sans doute obligé de poser aux commerçants ses "conditions"! Le ridicule ne tue plus . Dans un accès de démagogie, "Rouge" abandonne toutes ses réserves et il se permet de dire que "les petits commerçants auraient tout à gagner à un système socialiste de distribution où ils ne seraient plus à la merci du grand capital, où ils n’auraient plus à payer les conséquences des aléas de la vente". Belle découverte ! Dans un "système socialiste", les commerçants, le marché et la vente existeront-ils toujours ? Évidemment, il n’y aurait plus d’aléas ! Le capital s’accumulerait en toute tranquillité ! Nous n’avons pas eu connaissance de ce socialisme-là. Il faut se rendre à l’évidence : soit nous ne connaissons pas la B-A-BA du marxisme, soit ces théoriciens sont en train de "révolutionner" le socialisme.
"Lutte Ouvrière", elle, ne s’embarrasse pas de toutes ces nuances et reproduit le mot d’ordre du PC (inadmissible d’après "Rouge") "Halte à la vie chère" parce qu’il rassemble tous les mécontents". LO se jette sans scrupules dans les bras des petits commerçants. "Le petit commerce a lui, face au pouvoir, les mêmes intérêts (sic !) que les travailleurs, victimes de la même inflation. C’est là qu’ils doivent chercher leurs alliés, s’ils veulent réellement voir leur sort changer." (LO, 26/11/73 page 12). La logique du frontisme amène ce groupe dans le populisme le plus abject. Ces populistes fustigent la CFDT qui est trop intransigeante et qui "dressera ouvriers et petits boutiquiers les uns contre les autres ... quitte à ne pas toucher les intérêts des grandes surfaces, des grands industriels des grandes banques. Tout comme ce fut la politique de la gauche au Chili, celle qui mena directement à la catastrophe actuelle ". (op cit.) Ce raisonnement nous laisse pantois : la "gauche" a réalisé l’Unité Populaire avec plusieurs couches de la population et c’est cette politique qui a fait faillite au Chili, comme en Espagne et en France en 1936. C’est cette politique qui a toujours fait faillite, qui a amené les prolétaires à la boucherie. Lutte Ouvrière feint d’oublier ces circonstances et affirme que si cette politique de vaste alliance avait été réalisée il n’y aurait pas eu de massacre au Chili.
Nous réaffirmons que les prolétaires n’ont pas à prendre parti dans la lutte sans merci que se livrent les différentes fractions du capital, ils ont encore moins à prendre parti pour la lutte des commerçants, ils ne défendent pas les petits capitalistes contre les gros et encore moins des fractions arriérées. Si au 19è siècle, les révolutionnaires prenaient parti pour certaines fractions de la bourgeoisie, c’était en vue de permettre le développement du capitalisme qui était encore un système progressiste. Aujourd’hui, il est définitivement entré dans sa phase de décadence, les révolutionnaires n’ont plus à soutenir des luttes bourgeoises, ils ont encore moins à prendre parti pour des couches condamnées par les secteurs encore dynamiques du capital.
L’attitude du prolétariat
"Toutes les autres classes se placent sur le terrain de la propriété privée des moyens de production et ont comme but commun la conservation de la société actuelle". Cette phrase d’Engels est aujourd’hui encore le fondement de la position du prolétariat sur la question. Le prolétariat, classe en lutte contre l’économie marchande n’a aucun intérêt commun avec les couches qui en vivent. Il ne peut former sa conscience politique et son organisation de classe que par la lutte contre les positions des classes moyennes. Cette lutte est le seul moyen de précipiter le passage de ces couches au prolétariat.
En effet, ce n’est qu’en montrant le maximum de détermination dans la défense de son programme et en s’affirmant comme porteur de la seule solution à la crise, la destruction de la société marchande, que le prolétariat peut forcer la neutralité des couches moyennes.
Les fractions petites bourgeoises ne sont révolutionnaires que dans l‘imminence de leur passage social au prolétariat.
En attendant, "les ouvriers devront porter tout seul le poids de la révolution" Gorter (Réponse à Lénine sur "la maladie infantile du communisme"-1920). Il nous faut tirer la leçon de cinquante ans de contrerévolution et d’alliances avec les couches petites-bourgeoises. Le prolétariat a été sans cesse massacré sous le drapeau de l’Unité Populaire. Il faut d’une part démystifier la fraction de "gauche" de la bourgeoisie qui pour arriver au pouvoir réclame une large alliance avec les couches moyennes. D’autre part, lutter pour que le prolétariat conquière son autonomie face à toutes les couches bourgeoises et qui en unifiant ses luttes, il impose son programme. Il faut réaffirmer qu’un petit nombre de petits-bourgeois rejoindront le programme prolétarien seulement si cette autonomie se dégage clairement.
En conclusion, nous disons que chaque fois que le prolétariat a perdu son autonomie de classe et accepté de se battre pour les buts des classes moyennes, sa défaite était acquise d’avance et celle des classes moyennes avec elle. Les couches moyennes devront accepter, de gré ou de force, la solution prolétarienne à la crise : leur propre disparition en tant que producteurs indépendants et leur intégration dans une économie socialisée et associée c’est à dire la dissolution de la production marchande.
Roux
Heritage de la Gauche Communiste:
La « Gauche Allemande » : apports et limites.
- 48 lectures
À PROPOS DE LA PARUTION DES TEXTES DU K.A.P.D. ET DES A.A.U.
La parution des textes du KAPD et des AAU (1920-1922) dans le recueil LA GAUCHE ALLEMANDE[1] vient à point et satisfait un des besoins les plus pressants du mouvement prolétarien renaissant : connaître son propre passé pour mieux en faire la critique[2]. Les dilettantes "modernistes" peuvent ignorer les tâtonnements de la classe ouvrière au cours de son histoire, mais les combattants de la future révolution se précipitent au contraire sur tout ce que le passé peut leur offrir. Et dans le cas de la gauche communiste d’Allemagne, ce dont il s’agit c’est bien de leur propre passé, des efforts d’un courant créé par la révolution, agissant dans la révolution et s’efforçant d’exprimer les moyens propres de la révolution à notre époque.
Beaucoup ne savaient de la révolution allemande que ce qu’avait bien voulu leur en dire l’historiographie combinée du stalinisme et du trotskysme. On connaît, par exemple la pauvre légende du professeur Broué : si la révolution allemande a échoué entre 1919 et 1923, c’est parce qu’il manquait au KPD des tacticiens capables de bien appliquer le "front unique". Quand on a une histoire si simple à se transmettre complaisamment, pourquoi se casser la tête sur les huluberlus de la "gauche", ces "gauchistes" puérils et aventuristes ?
La contrerévolution tente toujours de masquer sa propre nature, en forgeant un passé mythique sans révolution et sans révolutionnaire. Thermidor dépeignait Hébert comme un brigand braillard. Les bolcheviks eurent droit à un tel honneur tant qu’ils étaient un moment de la révolution et même un peu au-delà. Mais dès qu’ils furent devenus, consciemment ou non, des rouages de la réaction, ils participèrent à leur tour au refoulement du souvenir de l’irruption prolétarienne. Quant à ceux qui avaient exprimé de leur mieux ce mouvement, ils ont sombré à un tel point dans l’oubli que ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que les fractions communistes renaissantes commencent à mesurer toute l’ampleur des questions qu’ils ont soulevées.
La coagulation dans les années 30[3] en un courant figé et porteur d’une idéologie appauvrie (le Conseillisme") ne facilitait pas, il est vrai, la recherche de ce qu’avait représenté le KAPD à ses origines. Mais même dans les erreurs les plus désastreuses des Pannekoek, Mattick ou Meier, englués dans la défaite, il y avait encore un faible écho de l’orage prolétarien — alors que dans le marxisme des épigones de Lénine, il n’y avait plus que l’arrogance bornée de la réaction.
Quoi qu’il en soit, l‘ignorance a de moins en moins d’excuses. Il n’est plus possible, après une lecture attentive de ces textes d’amalgamer le KAPD aux anarchosyndicalistes ou de réduire la richesse de ce courant au conseillisme. Les temps changent et ce n’est pas trop tôt !
Mythe et réalité
La présentation et les notes du recueil permettent de tirer de l’enchevêtrement des évènements qui marquent la période 1914-1922 deux fils précieux. 1° : Les spartakistes ne sont qu’un des courants -et certainement pas le plus clair sur les problèmes décisifs- qui confluent en décembre 1918 dans le KPD ; mais à bien des égards, certains de ces groupes "radicaux de gauche" préfigurent le rejet du syndicalisme et du parlementarisme qui dominera dans le PC à ses débuts[4].
2° : Les gauchistes" qui formeront le KAPD représentent 80% du parti communiste et ce dernier, menacé de dépérissement, ne suivit qu’en se fondant dans l’USPD (socialiste-indépendants, six à sept fois plus nombreuse). On a ainsi la continuité suivante :
"Centrisme" social-démocrate---à USPD ----à VKPD (section officielle de la 3è I.C.)
Spartakus-IKD (groupes radicaux de gauche) ------------------à KPD ------à KAPD
Il faut se graver dans la mémoire ces faits si l’on veut comprendre quoi que ce soit. Le KAPD n’est pas une secte marginale. Elle constitue un moment et un résultat d’un processus de radicalisation prolétarienne. Nous reviendrons sur la question, de savoir pourquoi elle est devenue isolée. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle représente de par les conditions de sa formation, le courant le plus significatif de la montée révolutionnaire des années 20. Cela suffit à juger tous ceux qui ont traité par le mépris ou le silence son existence.
Autre fable répandue, et dont la lecture de ces textes ne laisse pas pierre sur pierre : celle qui prétend que c’est au nom d’un purisme "moral" que les communistes de "gauche" rejettent les tactiques préconisées par l’I.C. Ceux qui connaissaient les "gauchistes" à travers de vagues souvenirs de "La Maladie Infantile" de Lénine, seront certainement étonnés de voir qu’ils appréciaient de façon solidement réaliste les tâches objectives de l’"ancien mouvement ouvrier" : "s‘installer au sein de l’ordre capitaliste... envoyer des délégués au parlement et dans les institutions que la bourgeoisie et la bureaucratie avaient laissées ouvertes à la représentation ouvrière... Améliorer la situation du prolétariat au sein du capitalisme, etc. Tout cela fut mis à profit et à l’époque, c’était juste." (Jan Appel, page 33)
Quant à ceux qui s‘obstinent, comme les sous-produits dégénérés de la gauche italienne, à présenter les révolutionnaires allemands comme des "fédéralistes", ils devront expliquer comment Otto Rühle, l’un des plus "spontanéistes", puisqu’il trouvait le KAPD trop proche de la conception classique de l’avant-garde, pouvait écrire : "Le fédéralisme conduit à une caricature d’autonomie (droit d’autodétermination). On croit agir de façon sociale et prolétarienne quand on attribue à chaque région, chaque lieu (on devrait même le faire pour chaque personne) l‘autonomie dans tous les domaines. En fait, on ne fait qu’abolir l’empire pour le remplacer par une quantité de petites principautés. De partout surgissent des roitelets qui régissent... de façon "centralisée” une fraction des adhérents comme si c’était leur propriété."
On ne sait ce qui est le plus ridicule chez les bordiguistes, de leur apologie concassée de Lénine ou de leur rage à l’égard du KAPD. Quoiqu’il en soit, au lieu de ricaner bêtement sur le "formalisme conseilliste" de la gauche -ils feraient mieux de nous expliquer pourquoi, si c’est cela qui le caractérise fondamentalement, le KAPD refusait de participer aux formes vides des conseils d’entreprise légaux, méprisant en cela toutes les majorités statiques et électorales- alors que les léninistes s‘y accrochaient désespérément pour y trouver les masses et remplir la "forme" d’un contenu "révolutionnaire" :
- "Il arrive qu’en évoluant, d’authentiques conseils se corrompent et se figent en une nouvelle bureaucratie. Il faudra les combattre aussi vigoureusement que les organisations capitalistes..."
Mais la déformation la plus éhontée est celle qui a réussi à présenter la gauche communiste comme un courant spontanéiste, niant la fonction de l’avant-garde ou du parti. Que certains éléments en soient arrivés là ne permet pas de falsifier la pensée du courant dans son ensemble sur ce sujet. En tout cas, on peut affirmer sans crainte que le KAPD prenait mille fois plus au sérieux le concept d’avant-garde et la nécessité de ne pas noyer le parti dans les masses, que l’Internationale communiste ! Que ceux qui en doutent lisent soigneusement ces paroles de Jan Appel, en gardant à l’esprit la dissolution du KPD "léniniste" dans l’amas incohérent de la piétaille centriste en 1921 : "Le prolétariat a besoin d’un parti-noyau ultra formé. Chaque communiste doit être un communiste irrécusable... et il doit être un dirigeant sur place. Dans ses rapports dans les luttes où il est plongé, il doit tenir bon, et, ce qui le tient, c’est son programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les décisions que les communistes ont prises. Et là, règne la plus stricte discipline. Là, on ne peut rien changer, ou bien on sera exclu ou sanctionné..." (Jan Appel)[5]
Ces quelques rapides indications permettront de dépasser tous les faux procès faits à la Gauche Communiste et d’aller à l’essentiel : qu’y a-t-il de nouveau, d’original et de durable dans sa pratique et ses conceptions ?
Le KAPD, expression d’une nouvelle période
Le soubassement théorique des positions du KAPD, c’est d’abord la reconnaissance du caractère nouveau de la période ouverte par la première guerre mondiale : période de guerres, de crises et de révolutions. La décadence du capitalisme n’est pas définie, comme on le croit trop souvent, comme simple stagnation, mais comme une ère où "le caractère de lutte de classe de l’économie elle-même se réaffirme de manière dix fois plus accentuée qu’à l’époque de la floraison". La vision qui ressort de ces textes est la suivante s déclin du système ne signifie pas fin des oscillations cycliques et impossibilité pour le capital de se redresser. De fait, "le capital se reconstruit lui-même, sauve son profit, mais aux dépens de la productivité. Le capital reconstruit son pouvoir en détruisant l’économie". On a là une intuition imprécise mais profonde du caractère essentiel de la crise historique. Tentons de la préciser : la sauvegarde du capital exige, face à la saturation des marchés et à l’intensification de la concurrence qui en découle, des frais improductifs gigantesques et croissants. De ce fait, les progrès de productivité sont annulés par l’augmentation cancérique du temps de travail socialement nécessaire au maintien des conditions de reproduction du capital (armement, guerres, bureaucratie, secteur tertiaire, etc.)
Mais l’apport de la "gauche", ce n’est pas son analyse de la décadence, qui reste floue comme celle de l’IC dans son ensemble. C’est sa volonté acharnée de tirer toutes les conséquences du changement du cours historique. Les prolétaires qui se groupent dans la gauche du KPD, puis dans le KAPD, sont eux-mêmes un produit de la rupture brutale de 1914. Le réformisme n’est plus, pour eux, en discussion, il est mort. La pratique sociale-démocrate n’est donc pas un choix "tactique" possible parmi d’autres, mais une expérience déjà faite, nécessaire en son temps, mais qui a démontré clairement, à l’heure de la guerre impérialiste et de la révolution, son incompatibilité complétée avec les conditions et les tâches nouvelles.
Les fractions ouvrières qui commencent, dès la reprise de l’effervescence dans la classe en 1916, à avancer le mot d’ordre : "Sortez des syndicats !", S’attaquent sans crainte à des organes consacrés, forgés au cours de décennies de lutte. Ce qui leur donne cette audace inouïe, c’est que ces groupes ne considèrent nullement les institutions héritées du passé en fonction de ce qu’elles représentent dans la conscience mystifiée de l’ensemble des travailleurs -pas plus qu’ils ne déterminent la nature de celles-ci en les contemplant dans le miroir aux alouettes des possibilités "tactiques" qu’elles offrent. C’est là le subjectivisme "réaliste" de gangs qui veulent concurrencer la social-démocratie sur son terrain et non la méthode matérialiste du prolétariat révolutionnaire. Les délégués qui, au 1er congrès du KPD, préconisent unanimement la destruction des syndicats et à une très forte majorité le refus de participer aux élections (sur ce dernier point malgré l’opposition de Rosa Luxembourg), le font parce qu’ils ont vécu directement la fonction contre-révolutionnaire de ces organes. Poussés par une profonde conscience de classe, mille fois plus profonde que les arguties "léninistes" sur la question, ils parviennent d’emblée au nœud du problème syndical. DES ORGANES CONSTITUÉS POUR S’AMENAGER UNE PLACE DANS LE SYSTEME SONT INUTILISABLES POUR LE DÉTRUIRE, LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT REPRENDRE LES OUTILS DE LA CLASSE-EN-SOI[6]. "LE PROLETARIAT NE DOIT S’ORGANISER QU’EN VUE DE LA REVOLUTION" (‘Jan Appel).
"On se construit des syndicats pour un but bien déterminé : s’installer à l’intérieur de l’ordre capitaliste. Alors, quand les communistes croient (qu’on peut utiliser) ces organes qui sont incapables de conduire des luttes révolutionnaires... ils sont dans l’erreur." (Jan Appel)
On a coutume de citer ironiquement les attaques du KAPD contre les "chefs" pour démontrer son prétendu "infantilisme ". Au lieu d’aller au-delà de ce qu’il y a de confus dans les formulations pour découvrir ce qu»il y a de profond dans le noyau de leur pensée, on ironise sur des phrases maladroites. Seules les mauvaises causes procèdent de la sorte. En fait, contrairement à ceux qui ne projettent que leur propre superficialité sur les textes, la Gauche Allemande parvient à une compréhension de phénomène de la bureaucratie qui échappera complètement à l’IC (sauf très partiellement à la gauche italienne). Alors que les léninistes usent leur lance déclamatoire contre la "bureaucratie”, les directions réformistes qui "trahissent", "ne tiennent pas leurs engagements", on trouve chez la gauche communiste l’idée que les bureaucrates ne sont pas la cause de la pourriture des syndicats, mais le produit. Ce ne sont pas les chefs "réformistes” qu’il faut détruire, mais les organes qui les sécrètent et les sélectionnent inévitablement.
"Le vieux mouvement ouvrier avait besoin d’une union des travailleurs. On choisissait des hommes de confiance, des travailleurs capables de négocier avec les patrons... C’EST À DE TELLES ORGANISATIONS QUE TIENNENT LES CHEFS. IIS EXISTENT GRACE A ELLES." (Jan APPEL)
Période historique, tâches objectives, fonction, organes, "chefs". Voilà la suite organique que reconnaît implicitement dans tous ses textes la "Gauche". Derrière la question des "chefs", se profile, à chacune de ces pages brûlantes, la question des tâches du prolétariat et non une question "morale", comme l’ont raconté tant de falsificateurs, eux-mêmes décidément bien obsédés par ce faux problème.
C’est la même vision historique matérialiste qui éclaire l’antiparlementarisme du KAPD. L’opposition à l’égard de la démocratie électorale n’est en aucune façon un principe abstrait mais une nécessité pratique liée à la période. "Exhorter dans la période de décadence du capitalisme le prolétariat à participer aux élections, cela signifie nourrir chez lui l’illusion que la crise pourrait être dépassée par des moyens parlementaires." Voilà qui devrait suffire à faire taire les nombreux faussaires qui ont amalgamé la position antiparlementaire du KAPD à l‘abstentionnisme principiel de l‘anarchisme.
Mais si le rejet des tactiques réformistes à l’heure de la révolution est le trait le plus saillant des textes de la gauche, il ne représente que la partie la plus visible d’un ensemble de conceptions qui tendent vers une cohérence . Il est clair, en particulier pour le KAPD, que le changement général des taches prolétariennes implique également une remise en question des notions traditionnelles concernant la fonction et la nature du parti[7].
Avec la tâche de "s’installer au sein de l’ordre bourgeois", disparaît également le type de parti qui lui était adapté : le parti "politique" classique, dont la fonction était de gagner une représentation parlementaire et de gagner les masses. Les notions de parti réformiste et de parti "de masse" se complètent. Pour imposer à la bourgeoisie une place au mouvement ouvrier, à l’époque du capitalisme ascendant, il fallait recruter des "électeurs" et des "adhérents". Car c’est ainsi que se présente la classe lorsqu’elle ne peut être révolutionnaire. Pour recruter électeurs et adhérents, il fallait disposer d’une tribune, d’une crédibilité politique nationale. Tout se tient et la gauche, qui le comprend bien, rejette le "parti de masse"[8] : "Nous disons : un parti de masse, créé selon le principe ‘faisons entrer le plus de monde possible, après ça nous taperons sur tout cela pour que cela fasse un parti en règle d’un point de vue révolutionnaire sous la pression des rossées de la direction’, nous disons qu’un tel parti ... porte en lui, dans toute sa structure, la plus grande chance de faillir." (Schwab)
Ce n’est plus d’un centre de manœuvre dans la sphère des alliances et des pratiques interclassistes, appuyé sur une masse de socialistes du dimanche dont a besoin le prolétariat. Parce qu’ils sont le fruit d’un mûrissement révolutionnaire au sein de la classe, et non un rassemblement de petits stratèges à l’échine souple, les communistes de gauche répliquent hautement au frontisme de l’IC ces fortes paroles brûlantes de réalité et d’actualité :
"La méthode de la lettre ouverte est impossible et non dialectique. C’est-une méthode par laquelle on veut attirer à soi les masses telles qu’elles sont ... en transigeant avec les pensées qu’elles se font. On dit, il est vrai, dans une phrase- conclusive : ‘Nous savons bien que cela ne colle pas, mais nous exigeons’, etc. Les masses ne comprennent pas cette contradiction, mais elles savent que cela ne va pas. Ou bien, si elles sont encore aveugles, elles se disent : ‘Bon, si les communistes eux-mêmes disent qu’on doit demander cela, c’est que ça ira’..." (jan Appel)
Fronts uniques, lettres ouvertes, mises au pied du mur, négociations pour des pseudo-gouvernements ouvriers sont des manigances extérieures à la classe. Ces combines sont l’aliment de véritables rackets, pour reprendre l’expression d’"Invariance", cliques dont l’objectif est de "compter leurs membres comme des idiots ou des nombres morts" (Rühle). Le KAPD, lui, est une partie de la classe qui agit au sein de la classe. C’est pourquoi il repousse par toutes les fibres de son corps l’escroquerie qui consiste à encourager les illusions des ouvriers pour mieux les appâter. La logique du frontisme, c’est un parti de thésaurisateurs qui accumulent les ouvriers comme des "chiffres inertes". La classe ne se livre pas à de tels petits jeux "pédagogiques" avec elle-même.
Pour le KAPD, le parti n’est pas un état-major qui se distingue par sa finesse tactique. Il est avant tout l’organisation de ceux qui défendent le but communiste au sein du mouvement : "Nous avons la tâche non de lancer les mots d’ordre de la lutte quotidienne ... ces mots d’ordre doivent être posés par les masses ouvrières dans les entreprises... Nous ne repoussons pas le combat quotidien, mais dans ce combat, nous nous mettons en avant des masses, nous leur montrons toujours le chemin, le grand but du communisme." (Meyer)
Le KAPD, cela va de soi, n’excluait pas de prendre en tant que parti les initiatives nécessaires (soutien direct à la Russie soviétique par le sabotage, par exemple) . Mais tout en refusant une conception purement propagandiste de l’avant-garde, il considérait que la fonction principale pour laquelle il existait était la défense du communisme et non celle de telle particularité circonstancielle du développement du mouvement. "Le parti communiste ne peut pas déclencher les luttes; il ne peut pas, non plus, refuser le combat. Il ne peut obtenir, à la longue, la direction des luttes que s’il oppose à toutes les illusions des masses la pleine clarté du but et des méthodes de lutte."
Contrairement aux racoleurs du VKPD, les communistes de gauche rejoignent les bolcheviks de la meilleure période dans la conviction que le rôle du parti est de s‘opposer aux illusions des "masses", quitte à s‘isoler temporairement. Au-delà de ses aspects indéniablement volontaristes, voilà ce qu’il y a de profond dans l‘attitude du KAPD. "Le prolétariat aujourd’hui encore nous insulte. Mais si la situation se développe et mûrit, alors le prolétariat ... reconnaît la voie."
On le voit, c’est véritablement vers une conception d’ensemble des moyens propres à la révolution prolétarienne que s‘oriente la gauche. On nous opposera que nous avons choisi nos citations et les avons reliées nous-mêmes, alors que tout cela apparaît de façon éparse dans les textes. Mais précisément, nous avons tenu à dégager la cohérence sous-jacente. C’est elle qui est essentielle, car elle préfiguré, dans ses balbutiements, l’avenir du mouvement.
C’est justement parce que nous reconnaissons toute son importance et sa richesse, que nous pouvons tenter d’en faire une critique féconde. Contrairement à ceux qui s’attardent complaisamment sur la confusion, inévitable à l’époque, ou sur les erreurs superficielles, les maladresses, nous voulons à la fois apprécier ce moment de la résurgence du mouvement prolétarien et en tracer toutes les limites, toutes les tendances inachevées. C’est ainsi que la révolution procède à l’égard de son passé. Toute autre attitude est scolastique.
Éléments pour une critique de la Gauche
”Si la destruction des syndicats ... ne s’est pas montrée jusqu’ici assez violente, c’est parce que le début de la révolution prit un caractère plus politique qu’économique." (Meyer)
Ce diagnostic cerne peut-être l’aspect fondamental de la révolution allemande. La maturation du mouvement élémentaire de la classe ouvrière, qui donne déjà des signes de révolte contre le réformisme au moment où son apogée tire à sa fin -cette maturation est brutalement interrompue avec la guerre mondiale. La révolution russe de 1905, les premières grèves sauvages, la lente et confuse cristallisation d’une gauche dans la IIe Internationale ne sont que les tout premiers signes d’une remise à l’ordre du jour de la révolution, qui n’aura pas le temps de bouleverser en profondeur l’être de la classe. Le prolétariat se trouve brutalement projeté, en 1914, dans une nouvelle période historique, avant même que sa propre expérience put dégager les nécessités nouvelles qui s’imposent.
Ce n’est pas tout. Bien qu’elle constitue, dans son essence, une continuation de l’économie, la guerre se présente, en grande partie, aux yeux des ouvriers, comme une question politique, au sens étroit du terme. Avant même que. le prolétariat allemand ait pu tirer à fond les conséquences de la crise sociale du système, il est contraint de réagir de façon politique aux problèmes de la guerre, de la paix, de l’empire, etc.
Cette conjonction d’une entrée soudaine dans la nouvelle période et d’une rupture conjoncturelle entre mouvement politique et social a pour effet de briser le procès d’unification de la classe. L’éclosion de la révolte matérielle n’a pas eu le temps de prendre forme. D’une part, le ciment social qui permet de souder en une unité les différentes fractions de la classe fait défaut. D'autre part, le passage à la classe révolutionnaire est brisé, parce que manque le ferment décisif qui réveille les couches les plus arriérées de leur torpeur, défait les habitudes corporatistes et localistes. La misère de l’hiver "rutabaga" de 1917, le rôle policier des syndicats, et même la faillite de la social-démocratie sont perçus par l’immense arrière-garde de la classe comme des conséquences temporaires d’un phénomène précis : la guerre. Le désir le plus profond, c’est la paix et le retour aux conditions de l’ère précédente. D’où l’écrasante inertie qui frappe tous ceux qui étudient la révolution avortée de 1918[9]. On ne fait plus confiance aux sociaux-démocrates pour finir la guerre, mais on pense qu’une fois rétablie la stabilité sociale, ils pourront rejouer leur rôle. D’où le slogan ; "Liebknecht ministre de la guerre ; Scheidemann, ministre des affaires sociales".
De là provient la profonde scission qui lézarde la classe. D’un côté, les éléments radicalisés (nouvelle génération n’ayant pas connu la prospérité, chômeurs, etc.) ; de l’autre, une lourde masse retenue par un conservatisme nostalgique dont l‘expérience n’a pas eu le temps de saper les bases. L’ensemble de la classe trouve l‘expression de ses aspirations dans le socialisme "indépendant" (USPD, puis VKPD). Comme l’a bien vu Invariance dans son étude sur le KAPD, "les communistes de gauche se retrouvent en 1919 en dehors du parti qu’ ils avaient créé. Cela voulait dire qu’ils n’étaient pas l’élément déterminant, dirigeant. Ils n’avaient plus l’avantage..."
La tragédie de la gauche est celle du mouvement de la classe dont elle est l’avant-garde sécrétée par la lutte révolutionnaire, mouvement qui s‘est trouvé incapable pratiquement et théoriquement de poursuivre sa radicalisation au-delà du cadre des phénomènes politiques qui avaient déclenché la révolution, et donc de se hisser à la hauteur de ses taches historiques. Le KAPD tend vers une définition théorique globale de la révolution à notre époque, mais il succombe parce que la classe dans son ensemble ne parvient pas à se dégager de l’époque précédente. Le prolétariat n’est pas mûr pour, en unifiant lutte économique et politique, s‘unifier lui-même et s ‘affirmer comme classe révolutionnaire, destructrice du capital.
Lorsqu’en 1922-23, s‘approfondit la crise sociale qui frappe l’Allemagne et lorsqu’enfin apparaît dans toute sa nudité la putréfaction du capitalisme lui-même (les ouvriers désertent les syndicats), il est trop tard. Le cours s‘est inversé à l‘échelle mondiale et en Allemagne, la contre-révolution a écrasé les fractions les plus avancées, pénétré la classe par le VKPD, isolé la gauche qui se décompose sous des pressions volontaristes et désespérées. Le prolétariat est définitivement cloué sur le terrain du capital. La combativité ouvrière n’y changera rien. La suite du mouvement ouvrier allemand ne sera plus pour des décennies, qu’une nuit sans fin.
On peut donc situer la gauche comme un moment inachevé d’un surgissement de la classe qui tente, avant d’être résorbée par l’involution du mouvement de définir les moyens de la révolution prolétarienne, a l‘époque de la crise historique du capitalisme. Dès que le mouvement ouvrier est définitivement ramené sur une orbite bourgeoise, les communistes de gauche se présentent comme les rescapés d’une révolution avortée en période de contre-révolution. Sectarisme, dissolution et pétrification idéologique deviennent alors inévitables.
Les erreurs fondamentales du courant expriment l‘impasse ou il se trouve. Volontarisme, conseillisme, unionisme ne sont trop souvent considérés que comme une simple addition de déviations idéalistes. En fait, nous pensons qu’ils recouvrent surtout un dénominateur commun qui est la recherche désespérée d’un moyen de renverser le cours contre-révolutionnaire.
Le KAPD parvient à une profonde intuition de la nature de ce cours et de la barbarie de la période qui s‘ouvre. Le capital peut se relever "pour des années, sinon des dizaines d’années sur les cadavres des prolétaires". Une défaite irrémédiable du prolétariat signifierait la possibilité pour le système de prolonger son agonie. Il faut donc "rendre impossible le relèvement du capitalisme".
Ce volontarisme à contre-courant conduit la gauche à affirmer unilatéralement le prolétariat tel qu’il se présente en période de reflux : ENFERME DANS L’USINE. La tâche de l’AAU est définie comme "la révolution dans l’entreprise". Au lieu de considérer LES USINES comme autant de points de départ d’un processus d’unification qui tend à briser ces cadres capitalistes, L’USINE ISOLEE devient le lieu institutionnalisé de l’unification. Le passage à la classe révolutionnaire apparaît ainsi comme le résultat d’une simple addition de formes "purement prolétariennes" que sont les organisations d’entreprise. Tout le mouvement qui va des usines à la société est nié[10].
La théorisation de la division de la classe en entreprises braque la pensée des communistes de gauche sur la question de la forme d’organisation qui y correspond (d’où le caractère superficiel de certaines de leurs critiques contre les syndicats, accusés d’être structurés par métiers et non par entreprises). Elle les entraîne, de plus, à des positions volontaristes, selon lesquelles ce serait à l’avant-garde de "créer les formes” "créer un cadre qui puisse accueillir le prolétariat" , etc.
On a là l ‘embryon de ce qui distinguera les sectes conseillistes. Alors que pour les léninistes, la tâche est d ‘organiser les ouvriers à travers le parti, pour les conseillistes elle deviendra de montrer aux ouvriers quelles formes il faut, pour éviter de tomber entre les mains des léninistes. Dans les deux cas, les communistes sont les "organisateurs" de la classe.
"L’organisation d’entreprise est la garantie (!) que la victoire aboutisse à la dictature du prolétariat et non pas à la dictature de quelques chefs de parti et de leurs cliques."
L’organe devient le but -et le but communiste disparaît parce que toute apologie de l’institutionnalisation d’un organe quelconque gèle le développement du contenu du mouvement. Fétichisme du parti ou fétichisme du conseil ne reviennent qu’à transformer des moments de la révolution en son point final. Poussés à leurs conséquences ultimes, ils sont contre-révolutionnaires. La lutte de classe crée les organes nécessaires et il serait absurde pour les révolutionnaires de ne pas en reconnaître la nécessité. Mais la forme n’est qu’un moment d’un contenu qui la dépasse. Les révolutionnaires ont pour tâche spécifique de défendre le contenu.
Affirmation désespérée d’organes destinés, de par leur "structure" même, à offrir au prolétariat de renverser le cours contre-révolutionnaire. Repli sur l’entreprise pour tenter d’y trouver l’être de la classe révolutionnaire face au capital qui domine sur la scène politique ; au moment même où la gauche parvient à exprimer la révolution, elle est déjà en train d’être happée par la contre-révolution.
Plus grave encore, le conseillisme mène déjà à la théorisation de l’autogestion comme force du communisme : "l’organisation d’entreprise est le début de la forme communiste et devient le fondement de la société communiste à venir".
Comme l’a bien vu Invariance, c’est par réaction à la mystification démocratique inter-classiste à l‘extérieur de l‘usine, que le KAPD s‘obnubile sur la recherche de garanties dans la démocratie au sein de l‘usine. Ainsi, alors que le communisme signifie destruction du cadre de l’entreprise, dans la pensée conseilliste, ce cadre juridique qui est le lieu de la logique intime du capital devient la forme de la société future. Au lieu de considérer les conseils et les usines comme des formes transitoires de regroupement de la classe, dont la classe tend immédiatement à faire éclater les limites, au fur et à mesure qu’elle se nie -les conseillistes en font l’essence de la révolution. L’identification, par Meier, par exemple des "organes de destruction du capitalisme" avec les "organes du communisme" revient à identifier prolétariat et communisme, c’est à dire à perpétuer le prolétariat. C’est de cette grossière erreur que procèdent les théories de la "gestion ouvrière", des "bons de travail" et toutes les idéologies ouvriéristes, proudhoniennes qui ont refleuri depuis.
Hembe
[1] Édité par la "Vieille Taupe", "Invariance" et "La vecchia Talpa". Écrire au "Mouvement Communiste", G. Dauvé, BP 95 — 94600 Choisy-Le-Roi.
[2] USPD : Parti social-démocrate indépendant ; KPD : Parti communiste allemand fondé en 1918 (décembre) ; KAPD : Parti ouvrier communiste d’Allemagne fondé en avril 1920 par la gauche du KPD ; VKPD : Parti communiste unifié d’Allemagne : fusion en décembre 1920 de la droite du KPD et de la gauche de l’USPD ; AAU : Union générale des travailleurs (organisations d’entreprise)
[3] Voir en particulier les textes parus dans "La contre-révolution bureaucratique" (10/18).
[4] Ceci dit, nous ne partageons pas l’appréciation des présentateurs sur les "chefs spartakistes". Il est facile de mettre en évidence leur confusion, mais ce serait également aisé pour 1«IKD. Tous les courants sont mal définis. Les jeux superficiels qui consistent à isoler à tel moment les positions de courants instables, mouvants et qui s’interpénètrent sont, à notre avis académiques.
[5] Un grand nombre de ces citations sont extraites de discours prononcés à la tribune du 3e congrès de l’IC. Les orateurs disposaient de très peu de temps ce qui explique le caractère elliptique de leur style.
[6] La constitution des AAU (organes dans les faits mi-syndicaux) est à notre avis, une régression par rapport à la clarté atteinte dans ces textes.
[7]Nous ne traitons ici que de la position du KAPD et non, par exemple de celle d’Otto Rühle, plus tard.
[8] La question du parti de masse ne se pose pas en termes de nombre : le KAPD comprenait 40 000 à 50 000 membres et il n’est pas impossible d’imaginer un parti mondial qui en regrouperait des millions. Ce qui est en cause, c’est la vision du parti S’appuyant sur le maximum d’"adhérents" possibles, recrutant de façon souple. Et derrière cela, se profile le refus de l’ancienne conception de la classe organisée dans et par le parti. Si toute la classe est communiste, il n’y a plus besoin de parti (il n’y a d’ailleurs plus de classe) .Si la classe n’est pas communiste, alors le parti est une minorité et non l’être de la classe. La conception du parti avant-garde n’est nullement élitiste. Il ne s’agit pas d’un groupe d’élus qui "sélectionnent" ses membres artificiellement. Ce qui le rend minoritaire, c’est le contenu des positions qu’il défend, et non un quelconque sectarisme auto-conservateur.
[9] Voir en particulier l’absence effarante d’initiatives du prolétariat berlinois au cours des journées de janvier 1919. On ne voit souvent que la confusion des chefs (Liebknecht, homme de confiance etc.). Mais les chefs sont bel et bien un produit de cette foule passive, ou pas une voix ne s’élève pour les critiquer
[10] Dans sa présentation des textes, la tendance Mouvement Communiste-Invariance-met bien en relief l’inadéquation de l’idéologie "conseilliste". Mais elle tombe du même coup dans une autre vision unilatérale qui rejette les conseils comme "forme dépassée". Outre que ce ne sont jamais les revues théoriques mais le prolétariat lui-même qui dépasse ses formes antérieures, et qu’en attendant, la plus grande prudence est de rigueur — on peut faire remarquer que si l’entreprise isolée est le lieu de parcellisation de la classe, la production (les usines) reste la base sociale à partir de laquelle s’affirme la spécificité du prolétariat. Pour se nier, la classe doit s’affirmer. En refusant fort justement le fétichisme des conseils, on tombe dans un fétichisme anti-conseils qui, sous le prétexte valable de relativiser les forces, finit par les nier, même comme moments nécessaires . On transforme la négation du prolétariat en un concept métaphysique abstrait (dissolution immédiate). Cette conception est 1«aboutissement logique des aberrations sur la "classe universelle". Nous y reviendrons.
Conscience et organisation:
Personnages:
Courants politiques:
- Le Communisme de Conseil [13]
- Bordiguisme [29]
- Trotskysme [45]
Approfondir:
- Révolution Allemande [46]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [23]
Surproduction et inflation
- 122 lectures
Cet article ne prétend pas traiter à fond des causes de la crise qui touche aujourd'hui l'ensemble de l'économie capitaliste[1]. Il se propose seulement de tenter d'éclairer sous l'angle de la pensée révolutionnaire quelques-unes des manifestations de celle-ci et principalement celle qui aujourd'hui touche le plus directement les travailleurs : L'INFLATION.
La crise existe-t-elle ?
Aujourd'hui, cette question peut sembler farfelue. Inflation, crise du Système Monétaire International, plans de stabilisation, mesures d'austérité, conférences internationales : ces préoccupations sont devenues quotidiennes et à côté des retombées pétrolières de la guerre du Proche-Orient qui ne font que les aggraver, elles font la une de tous les journaux.
Dans les rangs de la bourgeoisie, le clan des ‘pessimistes’ croît en nombre, et certains de ses ‘experts’ n'hésitent pas à écrire :
- ‘Aujourd'hui, le pire est devant nous. Nous allons vers le suicide ‘collectif par les excès de toute sorte, comme dans le film ‘La ‘Grande Bouffe’. Il faut avoir le courage de le dire parce que ‘tout le monde veut l'ignorer’[2].
Si toutefois, nous posons la question ‘la crise existe-t-elle ?’, c'est parce que l'évolution de l'économie capitaliste en 1972 et 1973 semble infirmer les craintes qui se manifestaient parmi les plumitifs du capital après la récession de 1971 ainsi que les perspectives que nous tracions dans notre article ‘La crise’ (R. I. n° 6 et 7) :
- ‘Ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions douanières
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs.
De ces prévisions, 1972 et 1973 n'ont confirmé que l'intensification de la guerre commerciale (par le biais des fluctuations des monnaies) et la dislocation des unions douanières (difficultés accrues du marché commun). Par contre les salaires ont réussi pour le moment à suivre l'inflation (particulièrement en France) ; après une pointe début 1972 le chômage a régressé, les échanges internationaux ne se sont jamais aussi bien portés (augmentations annuelles de 10 à 20 % suivant les pays) et 1972 marque une très nette reprise par rapport aux années précédentes, en particulier pour les Etats-Unis qui connaissent leur plus forte croissance depuis la dernière guerre mondiale.
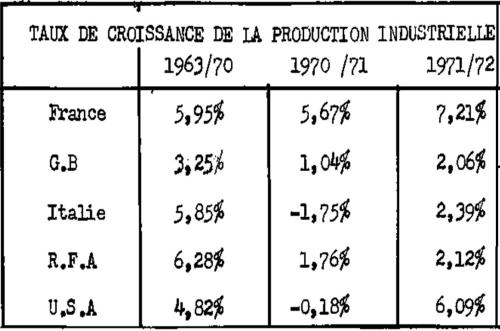
Ces résultats ont conduit certains à conclure que l'économie mondiale avait surmonté sa mauvaise passe et était repartie pour un nouveau boom (il faut d'ailleurs remarquer que ces ‘optimistes’ se recrutent plutôt parmi certains gauchistes[3] que parmi les ‘spécialistes’ officiels qui eux ne se font pas trop d'illusions et, déjà avant la guerre du Proche-Orient, prévoyaient, tels l'OCDE et Giscard, une récession pour 1974). On a en particulier spéculé sur la possibilité pour 1’inflation, telle qu'elle s'est développée en 1972-73, d'assurer une croissance continue.
Il s’agira pour nous d’expliquer pourquoi cette inflation et cette ‘mini-reprise’ annonceront en fait des difficultés accrues pour l'économie capitaliste.
Un autre phénomène fait dire à certains que les difficultés actuelles n’ont rien à voir avec une crise de surproduction modèle 1929. Alors qui en 1929 la crise s'était déclarée brutalement, en pleine période d'euphorie et qu'elle s'était traduite par un effondrement de la Bourse, on n'a pas vu dans la période actuelle de tel effondrement ni de la Bourse[4] ni de la production, mais essentiellement des difficultés sur le plan monétaire. Il s’agit donc de voir ce qui distingue les deux périodes et ce qui les identifie et s'expliquer comment la crise monétaire n'est qu’un reflet d'une crise des débouches. C'est ce que nous ferons d'abord.
Surproduction et crise monétaire
Depuis quelques années, la ‘crise Monétaire Internationale’ est devenue une vedette des journaux. Les dévaluations du dollar succèdent aux réévaluations du mark, les flottements de la livre aux spéculations sur l'or et les conférences internationales de gouverneurs de banques centrales aux réunions a trois, a cinq ou a quarante-sept des ministres des finances. Sur le plan monétaire, tout le monde est d'accord pour répondre : ‘Oui, la crise existe’. Et depuis quatre ou cinq ans, on convient aussi du fait que le ‘Système Monétaire International’ issu des accords de Bretton Woods de 1944 n'est plus adapte aux besoins actuels de l'économie mondiale et que, par conséquent, il faut le réorganiser au plus vite. Mais forts pourtant de ces constatations, les bourgeois n'ont pas réussi encore à résoudre cette crise qui loin de s'atténuer va en s'amplifiant : 1973 a connu une seconde dévaluation du dollar encore plus forte que la précédente (décembre 71 : 8,57 $ et mars 73 : 10 $) suivie d'une autre chute brutale en juillet, ainsi qu'une ascension vertigineuse du prix de l'or qui a triplé son prix officiel.
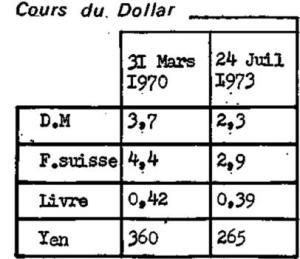
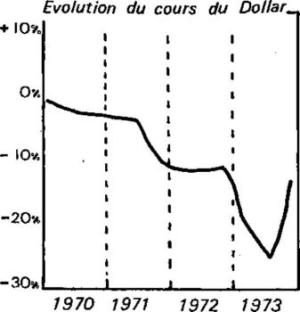
Pourquoi donc cette incapacité des bourgeois à résoudre leurs problèmes monétaires et à se mettre d'accord sur un nouveau S.M.I. ?
Est-ce parce qu’ils sont incompétents et ne savent pas par quel bout entreprendre cette tâche ? La compétence ne manque certainement pas au service de la bourgeoisie : depuis de nombreuses années, toutes les sommités économiques, des académiciens aux prix Nobel, se penchent sur le chevet du S.M.I. malade et lui concoctent toutes sortes de potions magiques. Leur échec ne signifie pas que ce sont des imbéciles mais tout simplement qu'ils se sont attaqués à un problème insoluble : remettre sur pied le Système Monétaire International alors que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est malade, malade d'un mal dont l'issue fatale s'appelle guerre ou révolution.
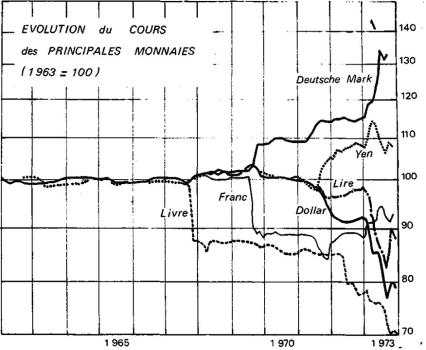
En effet, la monnaie n'a pas une existence indépendante par rapport à l'ensemble de l'économie. Il y a monnaie parce qu'il y a marchandise et c'est parce que celle-ci a besoin pour exister, qu'une marchandise spécifique s'autonomise par rapport aux autres que la monnaie revêt un certain aspect d'indépendance. Et c'est parce que la marchandise se trouve au cœur du mode de production capitaliste que les problèmes monétaires ont aujourd'hui une telle importance.
Le comportement de la monnaie au niveau international, sa stabilité aussi bien que ses fluctuations sont le reflet des conditions dans lesquelles se poursuit le mécanisme essentiel du mode de production capitaliste : la valorisation du capital. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui où la seule base sur laquelle repose la valeur de la monnaie d'un pays est la capacité de celui-ci à produire de façon rentable et à affronter la concurrence internationale.
Dans le passé, la monnaie papier émise par les banques centrales avait une contrepartie systématique, en or ou en argent ; convertibles avec des métaux précieux auxquels l'utilité sociale et le travail de production avaient conféré une réelle valeur d'échange, les billets de banque avaient cette même valeur.
Avec la diminution massive du taux de couverture des billets émis[5] c’est à dire l'impossibilité théorique de reconvertir en or une part importante de la monnaie en circulation, le problème change de données : désormais, ce qui garantit la valeur d'une monnaie, c'est la possibilité qu'elle a d'ache- ter des marchandises du pays où elle est produite. Tant que celui-ci est capable de fabriquer des marchandises échangeables sur le marché mondial (qualité et prix) le Monde a confiance dans sa monnaie. Par contre, si les marchandises produites par ce pays (pays A) n'arrivent plus à se vendre parce qu'elles sont plus chères que celles des autres, les détenteurs de la monnaie du premier s'en débarrassent au bénéfice de la monnaie des pays dont les marchandises se vendent bien. La monnaie du pays A n'étant la contrepartie d'aucune valeur réelle perdra alors la confiance de ses détenteurs et son cours s’effondrera[6]. Cet avatar arrive communément aux monnaies des pays sous-développés depuis de nombreuses années : leur chute presque incessante exprime les difficultés chroniques de l'économie de ces pays.
Mais le phénomène auquel nous assistons a une autre signification que 1'effondrement du Peso argentin, du Quetzal guatémaltèque ou du Kwacha du Malawi. La monnaie qui sombre aujourd'hui, qui, en trois ans,(Mars 70, Juillet 73) a perdu 37% de sa valeur par rapport au Mark, 34% par rapport au Franc suisse, 26% par rapport au Yen et même par rapport à la livre Sterling, cette monnaie donc n'est autre que le dollar ; devise de la nation qui produit 40% de la richesse mondiale, fait 20% du commerce international, devise qui pour cette raison, s'était imposée comme la monnaie universelle.
L'effondrement récent du dollar a exprimé le recul de la compétitivité des marchandises américaines sur le marché international, ainsi que sur son marché intérieur, face à celles de 1'Europe et du Japon. Et ceci est illustré par le fait qu'il a suffi, fin juillet, qu'on annonce que la balance commerciale américaine redevenait positive pour que le dollar accuse aussitôt un redressement spectaculaire.
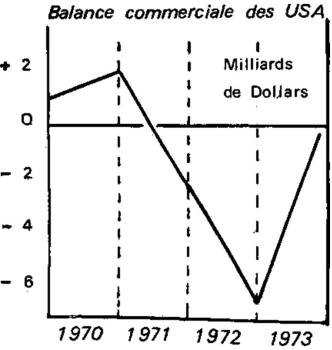 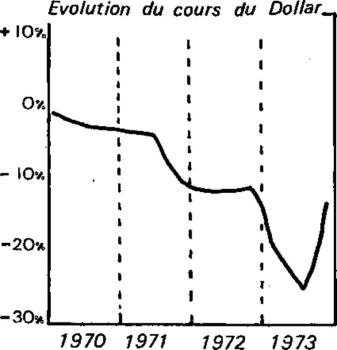 |
|||
|
|
Mais ce phénomène dépasse de loin le cadre de 1'économie américaine, compte tenu justement de sa place à part dans l'économie mondiale : dans la mesure où le dollar reste la monnaie universelle, sa crise est celle du Système Monétaire International. Dans la mesure où les U.S.A. sont encore la plus grande puissance commerciale du monde, leur difficulté à écouler leurs marchandises est le signe d'une saturation mondiale des marchés, l'un et l'autre phénomène étant évidemment lies de façon intime.
Comme nous l’expliquions dans notre précédent article[7], les causes profondes de la crise actuelle résident dans 1'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste depuis la première guerre mondiale : les grandes puissances capitalistes se sont partagé entièrement le Monde et il n'existe plus de marchés en nombre suffisant, pour permettre l'expansion du capital; désormais, en 1'absence de révolution prolétarienne victorieuse, seule capable d'en finir avec lui, le système se survit grâce au mécanisme : crise, guerre, reconstruction, nouvelle crise, etc. Parvenant maintenant (en gros à partir du milieu des années soixante) à la fin de la période de reconstruction, le capitalisme est de nouveau hanté par le spectre de la surproduction généralisée.
La bataille que se livrent les grands pays à coups de dévaluations, flottaisons de monnaies, etc. et qui a disloqué l'ancien S.M.I n'exprime rien d'autre que les tentatives de chaque pays, et en particulier des plus atteints, de faire porter aux: autres le fardeau des difficultés croissantes de l'économie mondiale. Dans cette guérilla, un pays encore une fois, est mieux armé que ses rivaux : les États-Unis. Ceux-ci restent forts du poids présent de leur production et de leur commerce, comme de leur poids politique et militaire (régulièrement, pour inciter les pays européens à plus de docilité, ils agitent le martinet du retrait de leurs troupes et de leur parapluie atomique). Mais, ce qui est plus paradoxal, ils restent forts de leur faiblesse, c'est à dire de leurs dettes : les centaines de milliards de dollars actuellement en circulation dans le monde entier sont autant de dettes contractées par l'économie américaine et les détenteurs de cette monnaie ont tout intérêt à ce que leurs débiteurs soient épargnés par toute catastrophe qui les empocherait de les honorer. C'est pour cela que les autres pays sont contraints d'accepter les diktats américains, que cela leur plaise ou non[8] ;
-
réévaluation de leur monnaie (Yen, Mark, Florin, Franc Belge, etc.)
-
dévaluations brutales et répétées du dollar, suivies par la flottaison en baisse de cette monnaie, encouragée en partie par le gouvernement américain (cf. son attitude en juillet 73)
autant de mesures qui ont le double avantage :
- d'amputer d'autant la valeur des dettes américaines
- de baisser les prix des produits américains sur le marché mondial, et partant, de les rendre plus compétitifs (1'achat récent par la Belgique d'avions américains au lieu des ‘Mercure’ français prévus, en est une des illustrations les plus spectaculaires, parce qu'elle montre la futilité des C.E.E., etc. devant la crise...)
Pour des raisons que nous avons vues dans notre précédent article, la crise de surproduction s'est d'abord attaquée au plus puissant des pays capitalistes, mais parce qu'il est le plus puissant, ce pays s'arrangera pour reporter sur les épaules des autres le fardeau de ses difficultés.
Actuellement, c'est à cela qu'on assiste : la dévalorisation massive du dollar a permis un regain de compétitivité des marchandises américaines, qui reviennent concurrencer celles d'Europe et du Japon et permettent à la balance commerciale américaine de se rééquilibrer. Mais c'est là un répit de courte durée pour les Etats-Unis : 1'invasion des autres pays par leurs marchandises conduira ceux-ci à réduire leur production, ainsi que leur main d'œuvre, ce qui diminuera d'autant leur demande et se répercutera donc à terme sur les exportations américaines. En résumé, ce qu'exprime la crise monétaire, c'est que le marché mondial est aujourd'hui trop étroit pour la production capitaliste, et cela même, les économistes bourgeois l'ont compris bien que chez eux, l'empirisme continue à être de règle et que la volonté se maintienne comme facteur économique :
- ‘La cause fondamentale de la crise monétaire peut se résumer en une phrase : chaque pays capitaliste, pour maintenir chez lui le plein emploi, veut réduire le déficit de sa balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) ou en maintenir, voire accroître l'excédent. Ces différents ‘projets’ nationaux sont incompatibles entre eux, dans la mesure où l'excédent global qui résulte de l'addition de ces projets ne peut être absorbé par le reste du monde non capitaliste[9].’
Marx constate quelque part que ce n'est que dans les moments de crise que la bourgeoisie devient intelligente, qu'elle comprend la réalité de son système et se persuade des contradictions de celui-ci. Il faut que la crise actuelle soit bien avancée pour qu'elle commence à faire ce que la plupart des ‘marxistes’ de ce siècle ont refusé ; reconnaître la validité de la thèse de Rosa Luxemburg sur la nécessité de l'existence de marchés extra-capita- listes pour que se poursuive le développement du capital[10].
Avec 1929 quelles différences ?
Depuis la 1ère guerre mondiale, le capitalisme est entré dans sa phase de décadence. Les crises de cette période se distinguent de celles du siècle dernier par le fait qu’elles ne peuvent se résoudre que par la guerre impérialiste. En ce sens on ne peut plus les considérer comme des crises cycliques de la croissance mais comme des râles de 1 ‘agonie. La crise actuelle fait évidemment partie de cette deuxième catégorie mais elle se distingue de la plus grande crise passée, celle de 1929 par le fait qu’elle commence par une crise monétaire et non par une catastrophe boursière comme celle du ‘jeudi noir’. Comment expliquer ces différences ?
La reconstruction suivant la première guerre mondiale a les caractéristiques suivantes :
- les productions d’armement sont réduites de façon considérable -applaudi par les économistes de l’époque qui y voient le remède enfin trouve à tous les maux du capitalisme, le crédit et particulièrement celui des banques privées se développe à une allure vertigineuse ;
- après l'intervention omniprésente de l'Etat dans l'économie de la période de guerre, on assiste à un certain retour au ‘laissez- faire’.
La reconstruction suivant la deuxième guerre mondiale se distingue par contre :
- par le maintien d'une économie d'armement (guerre froide)
- par une présence systématique de l'Etat dans la vie économique (achat d'armes, nationalisations, politiques budgétaires) qui se traduit sur le plan idéologique par le succès des conceptions néo-keynésiennes.
- un affaiblissement progressif du rôle de la bourse : des transactions importantes de capital se font maintenant directement entre grandes entreprises et souvent sous contrôle gouvernemental.
En résume on peut dire que si la première reconstruction se fait sous le signe du développement du crédit, la seconde se fait sous le signe de l'économie d'armement et de l'intervention de l'État.
Pour ces raisons c'est l'effondrement brutal (puisque l’État n'intervient pas pour ralentir le processus) du crédit et par suite de son instrument, la bourse, qui inaugure la crise de 1929.
De même, c'est parce que l'État contrôle maintenant l'ensemble de la vie économique et que les gouvernements ont tiré parti de l'expérience du passé que la crise actuelle n'a pas revêtu d'emblée un caractère brutal, que ses effets sont progressifs et qu'elle commence par se manifester sur le terrain par excellence des manipulations gouvernementales : la monnaie.
Les Conférences Internationales à répétition d'aujourd'hui où les gouvernements essaient constamment de faire front tout en ne pouvant cesser de tirer la couverture chacun à soi, sont à la crise actuelle ce que le ‘jeudi noir’ fut à la crise de 1929.
Ces différences entre les deux périodes de reconstruction expliquent également l’existence d'un phénomène relativement nouveau dans le capitalisme et qui aujourd'hui s'abat avec violence dans le monde entier : l'inflation.
Dans la partie qui suit, nous essaierons de dégager les causes de ce phénomène.
Les interprétations de l’inflation
L'inflation est un phénomène qui se manifeste depuis le début du siècle mais qui a connu son âge d'or depuis la deuxième guerre mondiale. Mais même les taux de l'après-guerre longtemps considérés comme inquiétants sont, depuis quelques années, amplement surpassés.
Hausse annuelle des prix à la consommation (en pourcentage)
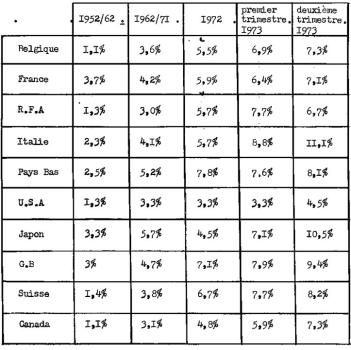
Et ce qu'il est frappant de constater, c'est que la ‘flambée’ des prix la plus importante correspond justement à la ‘mini-reprise’ de 1972. Ce n'est pas là un phénomène fortuit, c'est au contraire une manifestation de l'interpénétration des différents aspects de la crise actuelle. Pour comprendre l'inflation galopante actuelle, il nous faut d'abord expliquer le phénomène plus général de l'inflation telle qu'elle se manifeste depuis la deuxième guerre mondiale, particulièrement sous sa forme ‘rampante’.
Il existe autant d'interprétations de l'inflation qu'il y a d'écoles économiques. Pour certains c'est 1'excédent de la demande sur l'offre qui détermine une hausse constante des prix (inflation par la demande) : on comprend mal alors que le capitalisme mondial n'ait pu depuis de nombreuses années ajuster son offre à cette demande excédentaire alors que depuis longtemps il apparaît très nettement que ce qui limite la croissance ce ne sont pas des problèmes techniques d'élargissement de la production, mais un problème d'élargissement des marchés (existence de chômage et de capital sous utilisés), On comprend encore plus difficilement que la plus grande ‘flambée’ de l'après-guerre survienne à l'issue de sa récession la plus sérieuse : celle de 1971. Face à cette situation inexplicable pour eux, les économistes n'ont pu faire mieux que d'inventer un mot nouveau pour la désigner : la ‘stagflation’.
Tableau : capital et force de travail inutilisés aux USA.
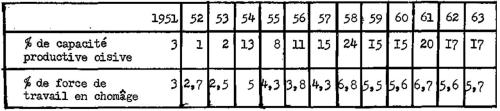
Suivant la première interprétation on explique donc la hausse brutale actuelle des prix par une demande exceptionnelle sur l'ensemble des biens et en premier lieu sur les matières premières et les produits agricoles pour lesquels les augmentations ont atteint leurs plus hauts sommets (doublement en six mois du prix de certaines matières premières et du blé, augmentation de 20 à 30% du prix de la viande, etc.). Ces hausses se répercuteraient ensuite sur l'ensemble des marchandises qui utilisent ces biens de base (deuxième interprétation) et, entre autres, sur les produits alimentaires, ce qui d'autant le prix de la force de travail, grande consommatrice de ces produits.
Tout mensonge, pour être crédible, doit receler une part de vérité ; en ce sens, cette interprétation de l'emballement actuel des prix est partiellement juste. En effet, c'est bien parce qu'il y a eu dernièrement des mauvaises récoltes de produits de base comme le blé et, par suite, une demande massive (achats considérables de l'URSS) que les prix de celui-ci et de l'ensemble des produits agricoles ont décollé[12]. Et les hausses record du prix du pétrole sont évidemment pour quelque chose dans 1'affolement actuel des prix.
De même, la poussée de la demande des acheteurs voulant devancer les hausses a été un des éléments contribuant à cet affolement, et ceci d'autant plus que la pratique d'anticipation des augmentations de tarifs, utilisée de façon courante par les fournisseurs, s'est généralisée avec les premiers assauts de l'inflation galopante.
Nous avons donc là une série de phénomènes : inflation par la demande, par les coûts, par l’anticipation des achats et des augmentations de tarifs, qui ont été longuement décrits et analysés ces derniers temps et qui, sans doute, contribuent partiellement à la panique actuelle. Mais toutes ces interprétations postulent :
- soit que la demande a, depuis la dernière guerre, dépassé l'offre, et principalement ces dernières années,
- soit que l'inflation existait parce qu'il y avait déjà inflation.
Nous avons vu plus haut ce qu'on peut penser de la première hypothèse; quant à la seconde, il suffit de la formuler pour qu'elle apparaisse comme une plate tautologie.
Ce qu'il s'agit de déterminer, c'est pourquoi, depuis plusieurs décennies, 1'ensemble des couts de production n'a cessé de monter alors que Hans la même période la productivité du travail a connu des taux d'augmentation inconnus jusqu'alors.
Certains bourgeois (parmi les plus réactionnaires) ainsi que certains ‘marxistes” ont une réponse toute trouvée, bien que formulée différemment :
- pour les premiers, c'est l'augmentation des ‘coûts salariaux’ imposée par l'action des syndicats qui est responsable de la hausse des coûts de production et donc des prix. Pour vaincre l'inflation, il faut donc briser l'échine des syndicats;
- pour les seconds, la lutte de classe, moteur de l'ensemble de la vie sociale, est à l'origine de la pression à la hausse sur les coûts de production, dans la mesure où elle contraint la bourgeoisie à accorder des augmentations de salaire aux ouvriers.[13],
Si l'on peut admettre effectivement que l'intensification des luttes ouvrières est un des éléments qui contribuent à faire évoluer l'inflation rampante (1945-1969) vers l'inflation galopante (après 1969)[1], cette hypothèse est cependant incapable de donner une réponse aux questions suivantes :
- pourquoi l'inflation s'est-elle poursuivie même pendant les années où la lutte de classe était particulièrement faible (années 50 et début des années 60), alors qu'au siècle dernier des luttes bien plus puissantes ne remettaient pas en cause la tendance à la baisse de 1'ensemble des prix ?
- pour quelle mystérieuse raison la lutte de classe s'est-elle intensifiée vers la fin des années 60 ?
L'incapacité de l'hypothèse des ‘coûts salariaux’ à rendre compte de ces phénomènes montre donc que ce ne sont pas, en dernier ressort, les prix qui courent après les salaires mais bien les salaires après les prix.
Une autre explication, dont le PCF s'est fait le spécialiste, consiste à dire que ce sont les sur-profits des monopoles qui sont responsables de la hausse des prix à la production. Il suffirait donc que la gauche vienne au pouvoir pour mettre au pas ces monopoles (éventuellement en les nationalisant) et briser net l'inflation. Il fallait y penser !
Nous ne nous attarderons pas sur le côté démagogique de cette explication (les monopoles sont-ils autre chose que la tendance générale du capitalisme vers la concentration du capital, et depuis quand l'État bourgeois est-il autre chose que le représentant du capital national ?). Nous nous contenterons de voir ce que contient cette notion de sur-profit monopoliste.
D'abord, supposons qu'une entreprise donnée soit seule sur 1e marché d'un produit. Dans une telle hypothèse, il est évident que cette entreprise ne serait plus obligée de fixer le prix de ses produits en fonction de leur valeur véritable. La loi de l'offre et de la demande ne jouant plus, puisque les clients ne pourraient s'adresser à aucun autre fournisseur, cette entreprise pourrait, théoriquement, établir ses prix aussi haut qu'elle le voudrait. Une telle situation ne peut exister dans les faits, puisqu'on verrait alors apparaître d'autres entreprises qui, même avec une productivité moindre, seraient en mesure de pratiquer des prix plus bas et donc de prendre les marchés de la première.
Et dans les faits, il n'existe aucun véritable monopole. Aucun marché dans le monde (excepté peut-être pour certains produits très particuliers et sur des volumes non significatifs) n'est la propriété exclusive d'une seule entreprise. Ce qui existe, par contre, ce sont des cartels, c'est-à-dire des ententes plus ou moins temporaires entre grandes compagnies, ayant pour but de limiter leur concurrence et de se répartir le marché. Ces ententes sont d'ailleurs toujours à la merci des fluctuations du marché mondial et ne sont, en fait, que de petites trêves dans la guerre continuelle que se livrent entre elles les différentes fractions du capital mondial[14]. Pour cette raison, même les ‘monopoles’ tant décriés ne sont pas en mesure de fixer librement leurs prix et provoquer 1'inflation, même s'ils peuvent, grâce aux cartels, s'opposer, dans certaines limites, aux tendances à la baisse et être les instruments de la transmission internationale de cette inflation.En fait, ces ‘monopoles’ et ces ‘cartels’ existent depuis fort longtemps déjà et ils alimentaient déjà les préoccupations des économistes à une époque où l'inflation était inconnue. Ils ne sont donc d'aucune utilité pour expliquer les causes fondamentales d'un phénomène qui est apparu bien après eux. Cet argument vaut également pour la thèse suivant laquelle c'est la baisse tendancielle du taux de profit qui serait responsable de l'inflation : pour lutter contre cette baisse, les monopoles auraient tendance à fixer leurs profits au- dessus du taux permis par la composition organique du capital, provoquant ainsi un déséquilibre général vers la hausse des prix. En fait, la tendance à la baisse du taux de profit s'exerce depuis que le capitalisme existe et n'a pas empêché pendant, toute une époque les prix de baisser. Si on peut donc admettre que c'est en partie à travers la baisse du taux de profit que les ‘monopoles’ ressentent aujourd'hui les contradictions du système et qu'ils sont obligés d'augmenter leurs prix, cette explication ne permet pas non plus de coup rendre l'essence de l'inflation. Là encore, on peut dire que les monopoles et les cartels en sont l'instrument, mais non la cause.
Les causes réelles de l’inflation
Les causes fondamentales de l’inflation sont à rechercher dans les conditions spécifiques du fonctionnement du mode de production capitaliste dans sa phase de décadence. En effet, l'observation empirique nous permet de noter que l'inflation est fondamentalement un phénomène de cette époque du capitalisme ainsi que de relever qu'elle se manifeste avec le plus d'acuité dans les périodes de guerre (1914-18, 1939-45, guerre de Corée, 1957-58 en France pendant la guerre d'Algérie...) c'est-à-dire celles où les dépenses improductives sont les plus élevées. Il est donc logique de considérer que c'est à partir de cette caractéristique spécifique de la décadence, la part considérable des armements et plus généralement des dépenses improductives dans l'économie[15], qu'on doit tenter d'expliquer le phénomène de l'inflation.
Comme nous l'avons vu plus haut, la décadence du capitalisme est causée par les difficultés croissantes et de plus en plus insurmontables que rencontre le système à écouler ses marchandises. Ces difficultés provoquent au niveau de chaque État l'augmentation constante des dépenses improductives destinées à maintenir en vie un système historiquement condamné :
- frais d'armement permettant à chaque État de défendre poings et ongles les positions de son capital national face à celles des autres capitaux concurrents.
- frais de fonctionnement de l'État qui, face à une société qui tend à se disloquer de plus en plus, se rend, véritable Moloch, maître de toute la vie sociale (police, administration, justice).
- frais de marketing, publicité, de recherches destinées à rendre les produits de plus en plus éphémères, frais qui sont tous consacrés à l'écoulement des marchandises et non à leur production.
Inexistence de frais improductifs dans la société capitaliste n'est pas en soi une nouveauté. Elle est le fait de toutes les sociétés et particulièrement des sociétés d'exploitation. Elle est la règle dans la féodalité, par exemple, où les nobles consomment la plus grosse part du surproduit social en biens de luxe. Elle se manifeste dans le capitalisme depuis ses débuts sous la forme de l'État, des porteurs de sabre et de goupillon et de la consommation de la classe capitaliste. Mais ce qui est fondamentalement nouveau dans la période de déclin du capitalisme, comme des autres systèmes d'ailleurs, c'est 1'ampleur que prennent ces dépenses par rapport à l'ensemble des activités productives : a ce stade, la quantité se transforme en qualité.
Aujourd'hui, dans le prix de chaque marchandise, à côté du profit et des coûts de la force de travail et du capital constant consommés dans sa production interviennent, de façon de plus en plus massive, tous les frais indispensables à sa vente sur un marché chaque jour plus encombré (depuis la rétribution des personnels des services de marketing jusqu’aux impôts destinés à payer la police, les fonctionnaires et les armes du pays producteur). Dans la valeur de chaque objet, la part revenant au travail nécessaire à sa- production devient chaque jour plus faible par rapport à la part revenant au travail humain imposé par les nécessités de la survie du système. La tendance du poids de ces dépenses improductives à annihiler les gains de productivité du travail se traduit par le constant dérapage vers le haut du prix des marchandises.
En d'autres termes, l'inflation exprime l'immense gaspillage de forces productives que le système en décadence est obligé de faire pour se maintenir en vie. Et dans la mesure où nous sommes dans une société d'exploitation l'inflation apparaît comme le moyen à travers lequel ce système fait porter aux travailleurs, par une agression continuelle contre leur niveau de vie, le fardeau de ses contradictions insolubles.
Que l'on considère l'histoire du XXe siècle sur de courtes ou de longues périodes, on peut constater que 1'augmentation des dépenses militaires (et en général les dépenses improductives) est toujours un facteur d'inflation. Sur de courtes périodes, on a déjà remarqué que les guerres provoquaient un taux record d'inflation. Sur de longues périodes, on peut faire apparaître que l'inflation rampante ininterrompue depuis la seconde guerre mondiale est le corollaire de la production massive d'armements depuis la guerre froide jusqu'à maintenant, alors que pendant l'entre-deux-guerres la période de désarmement était marquée par un ralentissement ou une disparition de l'inflation.
L’inflation galopante
En ce qui concerne la flambée actuelle des prix à l'échelle internationale, l'ensemble des éléments cités plus haut interviennent effectivement dans une certaine mesure.
Par exemple, la hausse des produits agricoles est liée à une pénurie réelle, mais il semble absurde qu'en 1973 l'humanité soit encore soumise aux caprices de la nature comme elle l'était au Moyen Age ou dans l'antiquité. En fait, cette brusque pénurie a pour cause véritable toute la politique de restriction de la production agricole (primes à l'arrachage, à la mise en jachère, destruction de stocks, etc. menée par les grandes puissances depuis la Seconde Guerre Mondiale. Soucieux de soutenir l'écoulement des produits agricoles dans un marché mondial saturé, le capitalisme, en en limitant la production au plus juste des besoins solvables, s'est mis à la merci de la première mauvaise récolte venue. Paradoxalement, c'est donc la surproduction qui est encore à l'origine de la pénurie actuelle des produits agricoles et donc des hausses qui les frappent.
On peut également dire que la montée mondiale de la lutte de classe depuis 1968 n'est pas absolument étrangère au processus d'emballement de l'inflation, mais là encore il faut préciser que cette montée était elle- même la conséquence d'une aggravation des conditions de vie des travailleurs, ressentie, entre autres choses, à travers la hausse des prix, aggravation due à l'exacerbation des contradictions du système capitaliste. Même si partiellement elle peut l'amplifier, la lutte de classe n'est pas la cause de l'inflation mais la conséquence.
De la même façon, nous avons vu que les explications bourgeoises sur le rôle des anticipations (à l'achat et à la hausse) sur la flambée des prix ne sont pas dénuées de tout fondement.
Nous avons donc là une série d'éléments qui permettent d'expliquer partiellement le passage de l'inflation rampante a l'inflation galopante. Il faut y ajouter un autre élément qui permet de comprendre comment la récession de 71 a contribué à renforcer le tourbillon inflationniste de 72-73. Depuis de nombreuses années, le système capitaliste se caractérise, outre l'existence séculaire d'une ‘armée industrielle de réserve’, par une sous-utilisation chronique du capital. Ce phénomène signifie que, outre les frais improductifs déjà signalés, le système doit supporter l'amortissement de la proportion importante du capital constant qui, bien que créée, n'est pas engagée dans la production et qui intervient donc comme frais improductif. En d'autres tenues, le coût de production d'une marchandise créée dans ces conditions. Incorporera, à côté du capital fixe réellement consommé, la part inemployée mais néanmoins payée de ce capital fixe.
Quand on sait que les taux d'utilisation des capacités productives sont respectivement (d'après l'I.N.S.E.E.) on peut prendre conscience de l'influence que le ralentissement de 1971 a eue sur la flambée des prix de 1972-73.
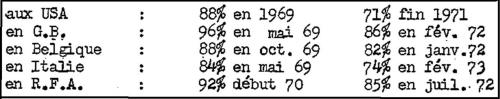
À l'influence de la sous-utilisation du capital constant vient s'ajouter, pendant la même période, celle de l'augmentation du chômage. En effet, même si les secours versés aux chômeurs sont souvent dérisoires, ils n'en représentent pas moins une dépense improductive que supporte l'ensemble de la société et qui se répercute donc sur les coûts, de production des marchandises.
Chômage et sous-utilisation des capacités productives sont donc deux éléments de la récession de 1971 qui contribuent encore à accentuer 1'explosion inflationniste de 1972-73.
Face à cette inflation galopante, quelles mesures peut prendre la bourgeoisie ?
L’échec de la lutte contre l’inflation
Comme nous l'avons vu, les causes fondamentales de l'inflation résident dans le mode d'existence actuel du système capitaliste, qui se traduit par un développement démesuré des dépenses improductives. En ce sens, il ne saurait y avoir de lutte efficace contre l'inflation sans réduction massive de ces dépenses improductives. Mais, comme nous l'avons vu également, ces dépenses sent absolument indispensables à la survie du système, ce qui revient à dire que le problème de la lutte contre l'inflation est aussi insoluble que celui de la quadrature du cercle.
Ne pouvant s'attaquer aux causes fondamentales du mal, la bourgeoisie est obligée de s'attaquer aux conséquences. C'est ainsi qu'elle a tenté de mettre en place une série de mesures :
- économies budgétaires
- freinage de la demande par la limitation du crédit
- blocage des prix
- blocage des salaires
Les économies budgétaires tentant de s'inscrire dans le sens d'une attaque contre les causes fondamentales de l'inflation. En fait, dans la mesure où une telle attaque est impossible sans toucher aux fondements mêmes du système, les politiques de ‘rigueur budgétaire’ ne signifient pas autre chose qu'austérité et restriction des ‘dépenses sociales’.
C'est ainsi qu'on a vu Nixon liquider la politique de ‘Grande Société’ mise en place par Johnson, Cette mesure n'a d'ailleurs pas été suffisante pour empêcher des déficits de plusieurs dizaines de milliards de dollars des deux derniers budgets américains, déficits qui, dans la mesure où ils sont couverts par la planche à billets, c'est-à-dire l'injection dans l'économie d'une masse de monnaie ne correspondant à aucune création de valeur en contre-partie, se traduisent par une baisse de la valeur de la monnaie et donc par l'inflation.
Par ailleurs, dans la mesure où les achats de l'État ont été pendant toute la période de la reconstruction un des débouchés de la production capitaliste, ces restrictions ont pour effet d'accentuer la récession actuelle. Les gouvernements doivent donc faire face au dilemme : inflation ou récession sans qu'ils puissent d'ailleurs réellement empêcher l'une par l'autre.
Les politiques de limitation du crédit, dans la mesure où elles se proposent de freiner la demande et, par suite, de réduire les débouchés, se trouvent elles aussi confrontées au même dilemme ; inflation ou récession. De plus, ces politiques de ‘crédit cher’ ont pour conséquence d'augmenter les frais d'amortissement du capital investi, frais qui se répercutent sur le prix des marchandises d'où à nouveau inflation.
Les blocages des prix, quant à eux, sont devenus maintenant l'occasion d'un scénario bien réglé : les prix ne bougent pas tant qu'ils sont soumis à la réglementation gouvernementale, mais dès que celle-ci cesse de s'appliquer on assiste à des bons spectaculaires, bons qui sont simplifiés par le fait que beaucoup de fournisseurs ayant attendu la fin du blocage pour effectuer leurs livraisons ont créé un déséquilibre entre l'offre et la demande au bénéfice de cette dernière. Loin d'empêcher l'inflation les politiques de blocage, des prix substituent une inflation par saccades a une inflation continue. Ces blocages n'auraient donc d'efficacité que s'ils étaient définitifs mais, dans la mesure où le système ne peut tricher avec ses propres lois et que celles-ci lui imposent une hausse continue des prix, il s'ensuivrait, dans ce cas un déséquilibre majeur qui se traduirait nécessairement par la récession : là encore la bourgeoisie est placée devant le même dilemme
Le blocage des salaires est la seule mesure qui ne fasse pas seulement intervenir des critères économiques mais également un rapport de force entre les classes. En ce sens l'échec ou la réussite (momentanée) d'une telle politique est conditionnée par le niveau de la combativité ouvrière. Dans la période actuelle, où la classe ouvrière s'est relevée de son écrasement de 50 années, toute agression majeure contre son niveau de vie se traduit par des réactions violentes (mai68, Gdansk70, grève des mineurs anglais en 71 qui ont obtenu 30% d'augmentation en période de blocage, grèves récentes des métallurgistes allemands). Par suite, la bourgeoisie, malgré quelques tentatives, continue à hésiter à imposer à la classe ouvrière la politique draconienne d'austérité que la situation réclame de plus en plus : les réactions de celle-ci lui font trop peur pour qu'elle ose l'affronter.
Si l'atteinte au niveau de vie des travailleurs est la seule politique qui reste à la bourgeoisie pour tenter de juguler l'inflation, c'est encore une politique qu'elle est obligée de manier aujourd'hui avec la plus grande circonspection.
En fait, depuis plusieurs années, le capitalisme mondial marche sur une corde raide: d'un coté la chute dans l'inflation galopante, de l'autre celle dans la récession. La récession de 1971 et le tourbillon inflationniste de 1972-73 sont l'illustration flagrante de cette situation. Ce que recouvre en fait la mini-reprise de 1972-73, c'est une certaine démission des gouvernements devant l'inflation qui a permis à celle-ci de se hisser à des taux spectaculaires. La libération temporaire du crédit, les anticipations des acheteurs sur les hausses, ainsi que le ‘rattrapage’ par rapport à l'année 71 (la reprise est d'autant plus spectaculaire qu'elle suit une année de stagnation) ayant permis cette reprise de 1972, certains ont voulu voir dans l'inflation un remède à la surproduction : du moment qu'elle reste plus ou moins uniforme dans chaque pays (il suffit de ne pas faire plus mal que son voisin), l'inflation galopante serait le ‘dopant’ qui manque aux économies actuelles. Qu'importerait, après tout, si les prix montaient de 10 ou 20% par an si, en même temps, pouvait se poursuivre le commerce international ?
Une telle possibilité, indépendamment de toutes les raisons qui nous ont permis d'expliquer le phénomène de l'inflation, est en soi absurde. En effet, une des fonctions fondamentales de la monnaie est d'être mesure de la valeur, fonction qui lui permet d'assurer toutes les autres (moyen de circulation des marchandises, de thésaurisation, de paiement, etc.). À partir d'un certain taux de dépréciation, une monnaie ne sera plus en mesure de remplir cette fonction : on ne peut pas passer de marché avec une monnaie dont la valeur change d'un jour sur l'autre ; en ce sens, la continuation du tourbillon inflationniste n'a d'autre issue que la paralysie a du marché mondial.
Par ailleurs, dans la mesure ou ce sont les anticipations qui, sont en grande partie responsables de la reprise de 1972-73, on se retrouve maintenant dans une situation:
- où les achats que devaient faire les entreprises pour la période actuelle sont déjà faits,
- où ceux-ci se sont traduits par un renforcement des capacités productives.
Cela signifie que la flambée inflationniste et la mini-reprise de 72-73 ne peuvent que déboucher sur une nouvelle récession à côté de laquelle celle de 1971 apparaîtra comme une aimable plaisanterie.
Plus que jamais, donc, les perspectives sont celles que nous tracions dans notre article précèdent :
- ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions douanières
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs
La crise et les tâches du prolétariat
Cette étude sur la situation économique actuelle ne correspond de notre part, à aucune préoccupation a caractère académique, mais uniquement militant. Les arguments du type : "il est inutile de se préoccuper de la situation économique puisque, de toute façon, nous n'y pouvons rien" ou "ce qui est important, c'est l'action des révolutionnaires" sont le fait d'irresponsables.
L’économie est le squelette de la société, c'est elle la base sur laquelle sont fondes l'ensemble des rapports sociaux. En ce sens, pour les révolutionnaires, connaître la société qu'ils combattent et se proposent de renverser, c'est connaître en premier lieu son économie. C'est à cause de sa place spécifique dans l'économie que le prolétariat est la classe révolution- maire et c'est a partir de conditions économiques précises de crise qu'il est en mesure d’accomplir sa tâche historique . C'est toujours à partir de la connaissance des conditions économiques dans lesquelles se déroule le combat de leur classe que les révolutionnaires ont tenté d'en préciser les objectifs et les perspectives.
En ce sens, les deux sujets traités dans cet article : l'inflation et la crise de surproduction permettent de situer les tâches actuelles du prolétariat.
L'inflation est l'expression de la crise historique du mode de production capitaliste, crise qui remet en cause le fonctionnement des rouages mêmes du système et de l'ensemble de la société. Par suite, son existence même comme maladie chronique de notre époque signifie que ce qui est historiquement, à l'ordre du jour pour le prolétariat ce n'est plus l'aménagement de sa place dans le système mais bien le renversement de celui-ci.
La récession qui s'annonce, quant à elle, dans la mesure où elle plonge le système dans des contradictions accrues et, partant, dans une situation de faiblesse, indique que c'est dans la période présente que ce renversement devient possible.
Dans les années qui viennent, la crise économique contraindra les travailleurs à mener des luttes de plus en plus dures. Face à celles-ci, le capital emploiera toute la panoplie de ses mystifications et, en particulier, tentera d'expliquer que ‘ce sont les anciennes directions qui portent la responsabilité de la crise’, ‘qu'avec une meilleure gestion, la situation pourra s'améliorer’... Déjà les forces de rechange du capital préparent le terrain : en France, la gauche se lance dans de grandes campagnes ‘contre la vie chère’, épaulée en cela par les gauchistes qui n'hésitent pas à écrire: "gouvernement et patrons organisent la vie chère"[16].
Contre ce type de phrases démagogiques, ce que doivent affirmer les révolutionnaires c'est, au contraire, que la bourgeoisie ne contrôle pratiquement plus rien, qu'elle est placée devant une situation contre laquelle elle peut de moins en moins, si ce n'est de tenter de mystifier les travailleurs pour mieux les massacrer ensuite.
Si les révolutionnaires ont une tâche fondamentale aujourd'hui, c'est d'expliquer que la crise actuelle est sans issue, qu'elle ne peut être résolue par aucune réforme du capital et que, par conséquent, il n'existe qu’une seule voie possible : celle de la révolution communiste, de la destruction du capital, de la marchandise et du salariat.
C.G.
[1] Pour une étude plus approfondie, voir ‘La Crise’ dans RI N°6 et 7 ancienne série.
[2] Article du professeur Christian Goux dans ‘Les Informations’, journal patronal
[3] Tels ceux qui considèrent que ‘les révolutionnaires qui n'avaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective -présentée comme pierre de touche du marxisme- d'une catastrophe inévitable de l'économie capitaliste, ne semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachroniques’ (‘Organiser le courant marxiste révolutionnaire’, brochure éditée par les ancêtres de l'actuelle Gauche marxiste’).
[4] Les baisses brutales de Wall Street en Août 71, Juillet 73 et Novembre 73 ne peuvent quand même pas être comparées à la catastrophe qui débute le ‘jeudi noir’ de 1929’
[5] Aujourd'hui, les dollars en circulation dans le monde sont couverts à peine à quelques % par de l'or ou des devises étrangères.
[6] Ce n'est pas nécessairement vrai si la parité de la monnaie A est fixe par rapport aux autres (comme ce fut le cas jusqu'à ces dernières années entre les grandes monnaies) mais, sinon, le maintien d'une monnaie à un taux surévalué conduit à une spéculation effrénée contre elle. Ce qui veut dire que la banque centrale du pays A se vide de toutes ses réserves en devises fortes ou en or et reste uniquement en possession d'un papier qu'elle a elle-même fabriqué, qui ne peut pas acheter grand- chose et dont personne ne veut. Une telle situation ne peut prendre fin qu'avec un contrôle draconien des changes pratiquement impossible à mettre en œuvre ou avec une dévaluation qui a une double fonction : abaisser le prix des marchandises de ce pays sur le marché mondial et décourager les spéculateurs qui désormais vendront leur monnaie à un prix moindre.
[7] ‘La Crise’ R I. N°6 et 7, ancienne série.
[8] L’alignement de Giscard sur les positions américaines lors de la conférence de Tokyo ouvrant le Nixon Round et lors de la réunion du F. M. I. Nairobi, après qu'il a crié sur tous les toits qu'il n'était pas question de se soumettre à ces conditions, est particulièrement significatif à cet égard.
[9] Philippe Simonot, ‘Le Monde’, 13 février 73 p.2.
[10] Cette bourgeoisie est certainement plus lucide que certains ‘marxistes'’ actuels, grands pourfendeurs de ‘piètres lecteurs de Marx’, qui prétendent que ‘la source des difficultés de fonctionnement du capitalisme se situe au niveau de la production et non sur le marché’ (Lutte de Classe, organe du GLA.T, Sept.-Oct. 73). Comme si on pouvait séparer les deux et comme si la production capitaliste n'était pas une production de marchandises ! Marx était certainement un bien ‘piètre lecteur de Marx’ lorsqu'il écrivait : ‘Toutes les contradictions de la production bourgeoise éclatent collectivement dans les crises générales du marché mondial... La surproduction est une conséquence particulière de la loi de la production générale du capital : produire en proportion des forces productives (...) sans tenir compte des limites de marché ni des besoins solvables...’(Marx, La Pléiade T.2 p 496.)
[11] Notons que ces deux interprétations ne sont pas contradictoires et que la plupart des économistes les utilisent simultanément : leur seul défaut est de ne rien expliquer.
[12] Nous verrons ailleurs que cette pénurie elle-même ne se comprend qu'en la replaçant dans le cadre de la surproduction actuelle.
[13] Il est évident que 1'augmentation de 10% accordée aux ouvriers français en mai 1968 est en partie responsable des hausses qui ont suivi.
[14] On se souvient de la guerre sans merci que se sont livrées les compagnies aériennes sur les tarifs des traversées de l'Atlantique Nord, guerre qui suivait une période de paix et qui a abouti à un nouveau statu quo? quand ces compagnies se sont retrouvées au bord de la faillite.
[15] Voir articles sur ‘la décadence du capitalisme’ dans RI N°2,4,5 ancienne série.
[16] ‘Lutte Ouvrière’ N°272.
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Rubrique:
Révolution Internationale - 1974
- 896 lectures
Revolution Internationale N°08 - mars-avril (nouvelle série)
- 55 lectures
Leçons de la lutte des ouvriers anglais
- 30 lectures
Depuis que la crise générale a frappé le capital anglais, particulièrement vulnérable, les ouvriers ont réagi par une lutte pratiquement ininterrompue à 1'attaque contre leurs conditions d’existence. Depuis 1966-1967, pas une branche, pas une catégorie, pas une grande entreprise qui niait, à plusieurs reprises, engagé la bataille et mené des grèves longues et dures. Les conflits ont succédé aux conflits, désorganisant la production, jetant la consternation dans la classe dominante, aggravant la situation du capital national, faisant pousser des cris effarouchés à la presse. Ce n'est pas la combativité et la confiance en sa force qui ont fait défaut à la première fraction du prolétariat des pays avances à subir les effets de la crise.
Cette vague de luttes revendicatives semblait sans fin et susceptible de se transformer graduellement en un processus d'unification révolutionnaire. Au plus fort de la marée (1972), les occupations d'usines tendaient à devenir pratique courante, les piquets volants indiquaient la perspective d'un dépassement du corporatisme. Dix mille ouvriers de la métallurgie s'unissaient aux mineurs pour remporter une mémorable bataille contre la police à Birmingham, et, cinq mois plus tard, une manifestation de masse, qui risquait de faire tache d'huile, imposait la libération des dockers emprisonnés. À de tels moments, la lutte change de nature et devient une affirmation qui porte en elle-même un mouvement d'unification et de dépassement révolutionnaire, qui tend vers un affrontement de classe. Le capital le savait, il a reculé. Après ces deux victoires, un souffle parcourait les usines du pays : tout était-il possible ?
En fait, ces succès spectaculaires masquaient un épuisement des luttes revendicatives. Elles sont restées le point le plus haut atteint dans la première phase de réaction du prolétariat à l'attaque du capital. L'accélération de la crise à la fin de 1973, loin de porter la lutte à un niveau supérieur, a trouvé une classe ouvrière craintive, hésitante, désorientée et s’accrochant à ses illusions syndicalistes et électoralistes. Les ouvriers ont, à l'heure actuelle» peur de la crise, peur de lutter, Ils acceptent passivement des accords de salaires de 10 % au maximum (hausse des prix : 20 %). Les amputations de salaires dues à la semaine de trois jours n'ont pas provoqué de réaction significative. Au moment où tout laissait présager une flambée de luttes, les travailleurs se sont repliés dans un lourd silence. Au moment où la grève des mineurs semblait le prélude à une offensive générale, elle a été étouffée, isolée et, nous le verrons, utilisée par le capital. Au moment où le cynisme affiché par les ouvriers depuis des années envers le Labour laissait prévoir des abstentions massives, et alors que le caractère anti-ouvrier des élections était manifeste, les prolétaires sont allés aux urnes. Les rares révolutionnaires qui dénonçaient la farce ont été accueillis avec hostilité.
Comment expliquer ce reflux ? La classe est-elle défaite au moment où la crise cesse d'être une menace pour devenir une réalité tangible ? Les luttes menées de 1966 à 1972 l'ont-elles été pour rien ? Que signifie ce graphique éloquent ?
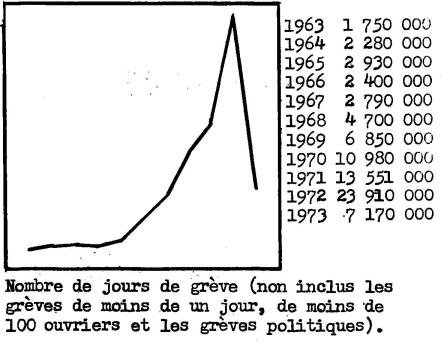
Ce ne sont certainement pas les apologistes du syndicalisme ni les braillards usinistes d'International Socialism, de Lutte Ouvrière ou de Potere Operaio qui pourront expliquer cette situation. Par contre, nous pensons que notre vision reçoit une illustration en Angleterre : impasse des luttes partielles, impossibilité du réformisme, nécessite d'un saut qualitatif vers l'unification révolutionnaire de la classe. C'est cette vision qui nous avait permis d'écrire, en juin 1973 :
"Dans les pays à forte tradition réformiste (USA, GB, Australie), la lutte a revêtu jusqu'ici un caractère de montée relativement continue. Mais l’échec des luttes trade-unionistes, qui est la cause du recul actuel dans ces pays, pourrait bien remettre en cause ce schéma." (R.I., n° 4, page 3)
L’Angleterre ne nous intéresse pas en elle-même, mais, par-delà ses aspects spécifiques, elle est un exemple particulièrement significatif du type de processus que devra parcourir le mouvement à l'échelle mondiale. L'Angleterre est un pays hyper-industrialisé, où le prolétariat représente la majorité de la population. Elle est frappée de plein fouet par la crise. Les syndicats y sont très forts, puissants, et regroupent la grande majorité des travailleurs. Elle est le pays des shop-stewards, délégués d'atelier élus et révocables à tout moment, dont les gauchistes voudraient nous faire croire qu'ils constitueraient une "meilleure forme" de syndicalisme, plus "près de la base[1]".
Et, dans ce paradis du trade-unionisme et de la démocratie d'atelier, après six ans de lutte intense, les travailleurs se replient en silence, élisent ceux qui avaient commencé l'attaque contre eux et acceptent passivement une réduction de leur pouvoir d'achat. Nous allons tenter d'expliquer pourquoi et montrer en quoi 1'Angleterre est la condamnation la plus claire de l'économisme, des illusions réformistes, du syndicalisme et des mystifications de gauche et gauchistes à cet égard.
Il faut nous expliquer tout de suite, pour écarter toute ambiguïté. Nous savons que les luttes immédiates sont nécessaires. Nous sommes parfaitement conscients que la classe devra faire et refaire l'expérience pratique de l'impossibilité du réformisme. Mais cette expérience, qu'elle forge de façon moléculaire, à travers un long processus de maturation, ne porte la possibilité d'un dépassement révolutionnaire, de sa négation, et de sa transcroissance, que si la classe saisit la signification de ses échecs, de ses revers. C'est le rôle des révolutionnaires, non de semer des illusions et de figer la lutte à ce stade en en faisant l'apologie, mais d'accélérer cette compréhension. Car la conscience de ce que le prolétariat sera historiquement contraint de faire est d’ores et déjà une partie intégrante de la pratique de la classe et devra le devenir de plus en plus.
LE POIDS DU PASSE
Les hommes ne bouleversent leurs rapports sociaux que lorsqu'ils ont épuisé toutes les possibilités de les rafistoler. Face à une transformation des conditions au sein desquelles ils agissent, ils tendent d'abord à réagir de façon conservatrice. La classe révolutionnaire tente d’utiliser toutes les armes qui lui ont permis de vivre dans l’ancienne société ; elle s’obstine à vouloir revenir en arrière, jusqu’au moment où la nécessité la contraint à rompre de façon radicale avec sa pratique révolue. La révolution naît précisément au moment où l’écart entre, d'une part, les conditions nouvelles et, d’autre part, la pratique et les idées anciennes, devient intolérable. Plus l’écart est grand et plus la révolution se présente comme un cataclysme, un renversement violent, soudain, apparemment inexplicable, des tendances. Comme l’a bien vu Trotsky dans sa préface à l'"Histoire de la révolution russe", la nécessité de la révolution provient du conservatisme de la conscience et de la pratique humaines, et non de leur souplesse. Il n'y a pas adaptation pacifique et évolutive au développement des forces productives, mais résistance, réaction, crise et donc nécessité d'un renversement brutal et révolutionnaire du cours social. Le conservatisme, qui ne dépérira que dans le communisme, plonge ses racines dans la domination des hommes par leurs propres rapports sociaux. La façon dont ils s’organisent à un moment donné pour produire se présente à eux comme une réalité naturelle, invariable, institutionnalisée. La ténacité avec laquelle les hommes perpétuent les rapports sociaux périmés, au risque de remettre en cause l’existence même de la société, exprime l’incapacité d'une humanité non encore unifiée de diriger sa propre autotransformation de façon créatrice et pacifique, en harmonie avec la transformation de ses conditions matérielles de reproduction.
Tant qu’existera une société déchirée en classes, aucune classe n’échappera à cette loi. Le prolétariat, classe de sans-réserves, n’ayant ni propriété, ni culture, ni "idéologie" particulière (au sens où l'ont les classes qui poursuivent un but propre : dominer la société) est, plus qu'une quelconque autre classe, soumis au conservatisme. Réduit à une collection d'individus sans autre communauté que leur opposition irréductible au capital, plongé dans une insécurité permanente, il subit l’exploitation la plus déshumanisante. C’est pourquoi, dans des conditions "normales", il est une classe profondément inerte, qui tend à reproduire obstinément la pratique qui, par le passé, lui a permis d'aménager sa survie. La classe ouvrière n'a rien ; il lui faut donc s'accrocher à l’illusion qu'il y a, à l’intérieur de la société et dans sa situation de classe exploitée, des organes, des institutions, des formes de pression qui constituent une garantie contre la déchéance et la misère : syndicats, négociations, grèves revendicatives, solidarité corporatiste, lois, "démocratie", partis "ouvriers", etc. Cette illusion se nourrit du passé, de l’époque ou ces moyens ont réellement permis d’aménager relativement la vie de la classe. Aujourd’hui, c'est par peur de couper le cordon ombilical avec cette époque que les travailleurs se laissent mystifier.
Mais, au même moment, par sa position dans les rapports de production, sa concentration, sa dépossession totale, lorsque les conditions le contraignent à agir, il apparaît soudain comme la classe la plus révolutionnaire, la plus audacieuse, la plus créatrice de l'Histoire, celle qui ne peut s'arrêter en chemin, car elle ne peut cesser de lutter que lorsqu’elle a créé une communauté humaine. Cette contradiction conservatisme-radicalisme, ni les ouvriéristes, qui attribuent aux ouvriers individuels en permanence des vertus révolutionnaires, ni ceux qui • nient la capacité révolutionnaire du prolétariat ne la comprennent. "Le prolétariat sera révolutionnaire ou ne sera rien", disait Marx. On cite souvent cette phrase, mais on ne voit pas que cela implique que la rupture avec le conservatisme est mille fois plus difficile pour les ouvriers que pour les autres classes, précisément parce que, une fois commencée, elle est contrainte de devenir mille fois plus radicale et profonde.
Plus que toute autre fraction du prolétariat mondial, les ouvriers anglais sont entrés dans la période historique de la révolution enfermés dans le corset de fer des illusions réformistes. Le trade-unionisme, l'électoralisme et la perception de la lutte de classe comme l'affirmation du travail salarié au sein de la nation, en harmonie avec le capital, n'ont jamais été sérieusement ébranlés, même au cours des années 1920. Pendant des dizaines d'années, depuis 1850, cette idéologie avait pris racine dans les luttes réelles de la classe et dans les conquêtes réelles que celle-ci avait pu arracher au capitalisme le plus puissant et le plus riche du monde. Pendant plus d'un siècle, les ouvriers avaient obtenu des droits politiques, une certaine sécurité, la journée de dix heures, des institutions pour réagir aux abus les plus flagrants du capital.
La première guerre mondiale et la crise révolutionnaire qui a suivi ont constitué une rupture trop soudaine pour être assimilée. En quelques années, la réalité criait aux travailleurs : "Ce que vous avez "créé par vos efforts inouïs a fait son temps et devient la pire des entraves. Vous n'avez pas de "conquêtes", pas d'"institutions", pas d'organisations permanentes, pas de place dans la nation. Vous êtes seuls et vous devez vous affronter aux syndicats et au Labour Party que vous avez construits." Seuls, quelques centaines de communistes de gauche, autour de Sylvia Pankhurst, ont commencé confusément à le comprendre. Mais pour la classe dans son ensemble, le saut était trop difficile.
D'où la suite : défaite (1920-1926), crise et misère, effondrement des conquêtes antérieures et mobilisation dans la guerre. Au cours de cette période, toutes les organisations "ouvrières", du Labour aux shop- stewards, révélèrent clairement leur fonction d'appendices du capital. Voilà l'expérience que dut parcourir la classe, ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Même s’il s'agit d'une expérience surtout négative, elle a ébranlé en profondeur la conviction des ouvriers de pouvoir améliorer durablement leur condition.
La reprise de l'économie capitaliste de 1950-1965 a créé une situation complexe et hybride. Sur une toile de fond générale propre à la décadence du système (impossibilité de grandes réformes qualitatives, intégration État-syndicats, intervention de l’État dans les conflits, etc.) s'est greffé une conjoncture où des gains de salaires appréciables et une résistance partielle à la rationalisation étaient possibles. L’amélioration conjoncturelle pour le capitalisme permettait d’obtenir certains aménagements pour la classe ouvrière, mais la situation historique du capital ne permettait pas des luttes réformistes générales d’envergure. Les ouvriers n'avaient plus confiance dans la lutte d’ensemble (la défaite de 1926 reste un souvenir vivace), mais ils saisirent qu'ils pouvaient, par des luttes locales, limitées, corporatistes, et en s’appuyant sur l’institution des shop-stewards, pressurer des gains, principalement autour des taux de travail aux pièces, du boni, des conditions de travail (négociés par atelier). Ce fut l’âge d’or du militantisme d’atelier, l’illusion du petit groupe compact et solidaire autour de son shop-steward. Ce sursaut dégénéré du syndicalisme se produisit sur un fond d’agonie des syndicats. Au moment même où cette fragmentation corporatiste battait son plein, les branches syndicales et le Labour Party achevaient de devenir des appareils squelettiques sans aucune vie. C'est là une indication que cette phase de syndicalisme de section, particulariste, qui n'a obtenu de succès que pour les travailleurs les mieux placés, ne peut être comparée au syndicalisme du siècle passé.
Pendant cette période, les shop-stewards ont pu présenter l’apparence d'une indépendance à l’égard de l’appareil syndical. Beaucoup de grèves étaient sauvages ("unofficial"), non parce qu'antisyndicales, mais parce que les shop-stewards ne prévenaient même pas l'appareil.
Mais nous allons voir comment l’entrée à nouveau dans la crise a surpris la classe, engoncée dans le corporatisme et les illusions syndicalistes. Mais cette fois, contrairement aux années 1920, le déroulement progressif de la crise permet au prolétariat de rompre, à travers une longue maturation et des expériences répétées, avec le conservatisme et les institutions qui le cimentent.
1968-1972 : L'USURE DU SYNDICALISME
Dès que la crise a contraint la classe dominante à attaquer les positions acquises par les travailleurs au cours de la période de reconstruction, le localisme est devenu le talon d'Achille de la classe, L'étroitesse corporatiste, le crétinisme réformiste ont été dépouillés de leur vernis d'"efficacité" à court terme et se sont révélés une arme du capital. Les shop-stewards ont dévoilé leur fonction capitaliste d'encadrement de la force de travail.
Pour resserrer son contrôle sur les ouvriers et entamer leurs dérisoires gains, la bourgeoisie a précisément utilisé ce qui avait fait la force apparente du mouvement au cours du boom. Cette attaque s test déployée sur deux fronts complémentaires : accords de productivité et contrôle des salaires .
Les trotskystes d'International Socialism ont voulu voir dans les accords de productivité une "attaque contre les shop-stewards". Il est vrai qu'en remplaçant le travail aux pièces, négocié par atelier, par une détermination "scientifique" et "mesurée" du rythme de travail, négocié par la branche syndicale au niveau de l'entreprise, la classe capitaliste a sapé irrémédiablement la base de l'illusoire pouvoir local et l'autonomie formelle des délégués d'atelier[2]. Mais cela, elle l’a accompli avec la collaboration des shop-stewards, qui ont été les premiers à faire avaler la mesure à leur "base" contre de la monnaie de singe ; elle l'a accompli grâce à la mentalité étroite et bornée dont les délégués étaient l'expression institutionnalisée. Elle m’a fait que supprimer cet anachronisme intolérable que constituait une illusion de "contrôle" sur les conditions de travail et d'indépendance[3] des délégués, pour les remplacer par l'intégration ouverte et la transformation des stewards en flics avérés du capital. Résultat : désarroi des travailleurs privés de leurs moyens d'action traditionnels et désorientés par la collaboration de plus en plus ouverte de "leurs hommes" avec les patrons. Le prix : augmentation de l’exploitation, de l'intensité du travail et impuissance des travailleurs face à la "rationalisation".
L’attaque sur les salaires a été plus difficile. Très longtemps, l'issue a été indécise et il a fallu des années pour corroder la résistance de la classe. La série de défaites qui se sont accumulées depuis l'été 1972 (hôpitaux, gaz, bâtiment, etc.) ont finalement fait pencher la balance. Les travailleurs se sont bel et bien battus, mais au jeu "capital et État contre catégories d’ouvriers isolés", c'est le capital et son État qui devaient l'emporter. Contrairement à ce que pensaient les travailleurs, la force de la classe ne réside ni dans l'esprit de corps de chaque métier ou de chaque usine, ni dans la capacité de petits groupes de bloquer la production, ni dans la grève "dure", mais dans la possibilité de s'unir sur le terrain social global (politique) face au capital et à l'État. Fragmentés en petits groupes combatifs mais imbus d’égoïsme particulariste, enchaînés à leurs illusions syndicalistes, rivés aux shop-stewards, les ouvriers se sont heurtés aveuglément à un capital solidement défendu par l’État et ont fini par user leur potentiel de lutte.
"Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il y a un apaisement dans la lutte salariale : les ouvriers sont confrontés à l’État, et les organisations traditionnelles (syndicats, comités de shop-stewards) sont soit directement contre eux, soit complètement inutilisables comme véhicules de la lutte de classe. Le trade-unionisme est si profondément enraciné dans la classe ouvrière de ce pays ... que la classe tente encore de lutter de l'ancienne manière, en reproduisant les divisions corporatistes créées par le capitalisme et que les syndicats maintiennent : l’usine, l’atelier, le métier, la branche d'industrie. C'est pourquoi la plupart des catégories d'ouvriers qui entrent en lutte se trouvent isolés et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, ils décident de réduire leurs pertes et de retourner au travail." (Workers Voice, février 1974)
C'est à partir de cette impuissance des travailleurs qu'on peut expliquer l'isolement et l'utilisation de la grève des mineurs.
Les mineurs ont obtenu satisfaction, mais leur grève a été utilisée par les partis et les syndicats pour préparer l'avenir. Cette opération est intéressante parce qu'elle montre que le capital est conscient qu'il ne peut se heurter à la classe de front, et qu'il lui faut donc clouer les luttes sur un terrain corporatistes, fragmentaire et institutionnalisé. À travers la comédie des "commissions de salaires", "commissions de relativités", on a créé une atmosphère totalitaire, où toute catégorie doit se justifier en faisant valoir qu'elle est un cas particulier. En venant témoigner du bien-fondé '“relatif" des revendications des mineurs, "lésés" par rapport aux autres, les syndicats ont clairement indiqué qu'ils sont et seront les gardiens du consensus national suivant : l'intérêt national exige que la masse salariale soit fixée par un accord État-syndicats. Pour poser une revendication, il faut démontrer qu'on a un cas spécial à faire valoir (spécial, soit parce qu'on a été défavorisé, soit parce que l'intérêt du pays justifie les demandes). Partager la misère entre les groupes concurrents d’ouvriers, voilà l'honorable tâche qui leur est dévolue.
Les capitalistes savent bien que les "commissions" sont des châteaux de cartes qui s'effondrent à la première lutte sérieuse. Par contre, ils savent aussi qu'ils créent une atmosphère où la moindre lutte sérieuse sera traitée d'"antipatriotique", de "démesurée" et, surtout, ils jouent à fond la carte du corporatisme, qui est, à 1«heure actuelle, leur arme la plus forte.
L'autre face de la médaille, c'est évidemment qu'à force d'utiliser le corporatisme contre les ouvriers, ils pousseront inévitablement les ouvriers à se révolter contre le corporatisme.
C'est la dynamique révolutionnaire potentielle qui donne son sens aux luttes revendicatives et à leur échec inévitable en général. En infligeant échec sur échec au trade-unionisme, le capital prépare les conditions du dépassement des divisions et de l'atomisation qui permettent aux syndicats d'encadrer le prolétariat. La lutte de la classe-en-soi (addition de catégories) forge les conditions objectives et subjectives pour le passage à la classe révolutionnaire qui balaiera le poids du passé. Il y a des défaites fécondes en ce qu'elles mettent à nu les institutions contre-révolutionnaires et sapent la crédibilité du réformisme.
C'est également l'absence de perspectives immédiates de lutte et l'essoufflement de la combativité qui forment la toile de fond de la participation massive des ouvriers aux élections derrière le Labour. L’inquiétude profonde et l'incertitude face à la crise ont fait réémerger avec virulence les vieux préjugés électoraux et les illusions. Il est vrai que personne n'attend du frétillant Wilson des améliorations. D’ailleurs, i ne les promet même pas. Mais les ouvriers re sentent, après tant d'échecs amers, la nécessité de croire qu'il y a quand même, dans la société, une force qui limite les dégâts et qui les protège contre les pires effets de la crise.
Mais, là encore, la lutte de classe aura contraint le capital à utiliser les illusions électoralistes des prolétaires contre eux, et, avec l'approfondissement de la crise le rejet de ces illusions en sera facilité.
C'est ainsi, à travers la lutte prolétarienne, la pratique de la classe, que s’infiltrent les leçons qui, silencieusement et de façon moléculaire, se cristallisent dans sa conscience et permettront aux surgissements futurs de se faire sur une base qualitativement supérieure.
LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE
En Grande-Bretagne, comme ailleurs, derrière les hésitations, les coups de boutoir, les replis de la classe, se dessine l'immensité du saut à accomplir d'une catégorie qui tente d'aménager son exploitation à une classe qui devra détruire l'exploitation. Ce saut n'est pas un phénomène futur sans lien avec le présent, il sera à la fois le résultat et la négation des mouvements actuels.
Ce qu'il faut, c'est saisir la nature du lien entre luttes revendicatives, à l'intérieur du système, et luttes révolutionnaires, contre le système.
Le prolétariat est une classe exploitée et révolutionnaire. C'est donc l'être-même de la classe qui constitue le lien dynamique entre les différentes phases transitoires, le mouvement qui se pose et se nie à travers les divers moments de la lutte. Le prolétariat n'est ni une simple catégorie pour le capital, ni une classe-pour-soi achevée, mais le mouvement de l'une à l'autre. L'UNITE DU MOUVEMENT, LE FAMEUX "LIEN", C'EST LA PRATIQUE DE LA CLASSE ELLE-MÊME EN TANT QUE SUJET AGISSANT.
Les travailleurs tentent de lutter en tant que classe-pour-le-capital (par catégories, usines, branches, de façon concurrente à l'image de la concurrence capitaliste, pour négocier le prix de la force de travail). Mais leur rapport au capital (leur division, leur soumission, leur acceptation de mètre que du travail salarié) entre en contradiction avec leur propre mouvement et devient intenable. C'est alors que la classe doit commencer à se poser comme négation de son rapport avec le capital, donc non plus comme une catégorie économique, mais comme CLASSE-POUR-SOI. Elle brise alors les divisions qui sont propres à son état antérieur et se présente non plus comme somme de travailleurs salariés, mais comme un mouvement d'affirmation autonome, c'est-à-dire de négation de ce qu'elle était auparavant. Ce n'est pas le travail salarié qui s'affronte alors au capital, mais le travail salarié en train de devenir autre chose, de se dissoudre. L'affirmation du prolétariat n'est que ce mouvement de négation. Qualifiés, non-qualifiés, ouvriers, employés, "productifs", "improductifs", barrières des usines, etc., toutes ces déterminations sont dépassées. Et à ce stade ce mouvement se heurte à l'État bourgeois, dernier rempart avant le début de la transformation communiste de la société.
On voit donc que c'est l'être-même de la classe, sa situation à l'égard du capital, qui permet de comprendre comment elle forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution.
Les sociaux-démocrates et les trotskystes pensent que c'est le parti et un programme de transition (ou minimum) qui font le lien. C'est une médiation extérieure à la classe qui fait le "pont" entre la classe- pour-le-capital et la classe-pour-soi. Il n'y a donc pas de continuité et d'unité du sujet. La classe n'est pas le sujet, identique à travers ses diverses phases et qui s'identifie précisément à travers elles. L'être n'est pas l'artisan de soi-même, de sa conscience. Il a besoin de quelque chose d'extérieur, d'un pédagogue, d'un ingénieur "ès ponts", d'une conscience qui lui est séparée, pour devenir. Ce n'est pas l'être qui devient, c'est un autre être qui le fait devenir. En tant que telle, la classe est vue de façon statique, sans dynamique, comme simple classe-pour-le-capital incapable de se mouvoir hors de cette sphère.
Les mouvements partiels, immédiats, revendicatifs, ces métaphysiciens les appréhendent, non du point de vue révolutionnaire inhérent à la nature de la classe (ce qu'elle sera contrainte de devenir), mais comme autant d'entités statiques. Ils ne les voient pas comme moments, modes d'existence que l'être dépasse, mais ils les identifient à la classe, qui est ainsi figée dans un état dont seule une intervention extérieure pourrait la sortir. D'où la nécessité d'introduire de façon volontariste et manœuvrières le "coup de pouce" qui imprimerait une dynamique à cet être sans mouvement interne. Puisqu'il n'y a pas de nécessité inhérente à la classe qui la force à nier tour à tour ses différents états comme autant de moments indispensables, mais intenables, il faudrait une puissance externe, arbitraire. La vision des trotskystes c'est : entre une classe-pour-le-capital et une classe révolutionnaire, un parti extérieur. C'est pourquoi ils ne peuvent dire que deux choses aux ouvriers : 1500 F pour tous et construisons le parti.
Une deuxième erreur découle de la première. Puisque la classe n’est pas le sujet qui fait le lien entre sa propre pratique immédiate et son action révolutionnaire, elle n'est donc pas contrainte de nier brutalement et de façon révolutionnaire ses premières tentatives de lutter de façon purement revendicative. Grâce à la médiation parti-programme transitoire, le mouvement devient évolutif. Graduellement, de revendication en "acquis", à travers les ponts qui "font le lien" entre son être passé et futur, la classe se trouverait insensiblement amenée à la révolution. Il n'y a pas de saut qualitatif, de NEGATION ; le passage de la lutte revendicative à la lutte révolutionnaire n'est plus un combat radical qui, sous la contrainte de la crise, force la classe à se transformer, mais un procès évolutif, pacifique, purement quantitatif .
Pour eux, la classe ne forge pas sa propre conscience à travers une lutte douloureuse contre son propre conservatisme, elle est "amenée" à une conscience qui existerait en dehors d'elle.
AINSI, IIS NIENT A LA FOIS CE QUI FAIT L’UNITE DU MOUVEMENT, SA CONTINUITE : L’ÊTRE REVOLUTIONNAIRE DE LA CLASSE, ET CE QUI CONSTITUE, A L’INTERIEUR DE CE MOUVEMENT, LE SAUT, LA NEGATION, LA RUPTURE.
Pour comprendre comment la pratique de la classe forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution, il faut d'abord concevoir que ce lien n'est pas évolutif et graduel, mais négatif et brutal. Il n’y a pas d'"acquis"' révolutionnaires dans la société capitaliste. Il n'y a pas de petits embryons de révolution dans chaque lutte, qui grandiraient, fusionneraient jusqu'au moment où la classe serait assez puissante pour faire la révolution. De même que la classe révolutionnaire est la négation en mouvement de la classe-pour-le-capital, de même la lutte révolutionnaire est la négation de la lutte revendicative. Les luttes revendicatives ne deviennent pas révolutionnaires ; c'est la classe qui, en dépassant et en niant sa lutte immédiate, devient révolutionnaire. Il y a un lien entre ces deux mouvements contradictoires. Et ce lien est précisément l'être de la classe,
Il ne s'agit donc pas de pousser "plus loin" la lutte revendicative, comme se l'imaginent les volontaristes et les syndicalistes, en faisant de la surenchère, car d'abord, la lutte revendicative n'est pas provoquée artificiellement, ensuite, elle ne peut se gonfler à l'infini, enfin, elle ne prend son sens que comme prélude à autre chose. Il faut précisément comprendre que c’est la contrainte de nier cette lutte qui constitue le mouvement qui va "plus loin".
Négation, bouleversement par le prolétariat de son propre être et de sa propre conscience, désintégration des divisions, catégories, embrigadements et clivages de la classe-pour-le-capital, réorientation complète de la façon dont les ouvriers voient le monde et agissent les uns à l'égard des autres, voilà le mouvement qui mûrit dans l'accumulation des défaites, des revers, de l'impossibilité de se défendre comme une catégorie à l'intérieur du système.
"Mais alors, si c'est la classe qui forme le lien, que faisons-nous ?" demandent avec horreur syndicalistes et gauchistes, reconnaissant ainsi avec franchise qu'ils ne sont pas une fraction de la classe, mais une secte qui se pose comme extérieure au mouvement.
À partir du moment où on est une fraction du prolétariat, on ne voit pas sa tâche comme étant de "représenter" le lien entre luttes revendicatives et action révolutionnaire. On se considère comme une partie du mouvement qui fera le saut. C'est la vie de la classe qui produira les conditions de ce passage. Notre tâche, en tant que fraction avancée de CE mouvement, du processus qui se meut vers ce passage, est de défendre la nécessité de la négation des luttes actuelles, de leur dépassement. Ce faisant, nous ne pensons pas créer le lien entre aujourd'hui et demain, ni provoquer le saut, mais nous agissons pour que ce passage inévitable se fasse dans le maximum de clarté et de conscience. C'est-à-dire que nous contribuons à ce que le mouvement accède plus vite, mieux et de façon plus explicite à la conscience de soi.
Nous ne sommes qu'un moment de la conscience que la classe se forge, et notre tâche est d'exprimer (et donc d'accélérer et de généraliser) cette conscience de la pratique révolutionnaire de la classe, de son être historique. Nous participons ainsi, en jouant un rôle spécifique, à cette dynamique qui tend à faire de la classe prolétarienne un sujet.
La classe tend, dès maintenant, à devenir le sujet de sa propre transformation. Cela, elle l'accomplit en découvrant pratiquement son impuissance à survivre comme simple classe-pour-le-capital, simple travail salarié. Elle l'accomplit en épuisant, avec obstination, toutes les solutions qui lui permettent d'éviter de remettre en cause son inertie conservatrice. Les flux et reflux ne sont que des moments de cette œuvre longue et titanesque qui dégage les conditions où il ne sera plus possible de lutter autrement que comme classe-pour-soi contre le capital et son État.
Les communistes ne client pas 1500 F et grève "dure", quand les syndicats crient 1200 F et grève "molle". Les communistes ne couvrent pas les luttes immédiates de louanges hypocrites et lénifiantes, mais, au contraire, expriment et stimulent l'insatisfaction de la classe, sa tendance à devoir dépasser sa condition actuelle. Ils ne tentent pas à tout prix de déclencher des luttes artificielles, mais comprennent les moments de passivité comme des phases indispensables de maturation souterraine, de réflexion, d'assimilation des expériences. Ils comprennent les revers temporaires comme le moteur de la prise de conscience révolutionnaire des ouvriers.
Ils sont présents, dans la mesure du possible, dans les luttes, aussi petites soient-elles et ils y déploient autant d'énergie et d'imagination que les autres travailleurs combatifs, ne serait-ce que parce qu'ils subissent la même exploitation et ressentent la même révolte contre la vie actuelle. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils proclament ouvertement, à contre-courant lorsque les autres prolétaires refusent encore de le reconnaître, que l'approfondissement de la crise et les revers actuels sont la condition de la révolution, en ce qu'ils permettent l'expérience pratique de l'impossibilité, à notre époque, pour le prolétariat de se défendre comme simple travail salarié, à 'intérieur de la société capitaliste .
Il n'y a pas d'issue dans le système. Voilà la vérité simple que doit marteler la minorité révolutionnaire. Et c'est le mouvement de la classe tout entière qui transformera, à travers les flux et reflux, cette expression théorique de son expérience en une pratique concrète et une conscience généralisée .
Hembe
[1] Le rapport Donovan sur les relations industrielles (1966) partage l'enthousiasme des gauchistes sur les délégués d'atelier. Ce rapport, véritable manuel pour capitalistes intelligents, les qualifie de "lubrifiant indispensable pour la bonne marche de la production", précisément parce qu'ils sont "démocratiques" et "près de la base".
[2] (&) International Socialism a été jusqu'à défendre le travail aux pièces comme "moindre mal".
[3] Ce n'est bien sûr qu'une illusion. Dès que les choses devenaient sérieuses, les shop- stewards se montraient pour ce qu'ils étaient (1914-1918, 1920-1926, 1939-1945, etc.).
Vie du CCI:
- Débat [21]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Aliénation [48]
Rubrique:
MISERE DE L’INVARIANCE
- 73 lectures
Cet article a été écrit en janvier dernier à l’occasion de réactions du PCI face à la guerre du Kippour.
Pendant longtemps la gauche italienne a constitué l’une des rares tendances qui a lutté avec acharnement pour préserver certains acquis du marxisme révolutionnaire face aux trotskystes et anarchistes de tout poil. Alors que la gauche allemande se dissolvait en divers courants confus, la gauche italienne des années trente, groupée autour de la revue "BILAN", tirait les leçons de la vague révolutionnaire de l9l7-2l et du processus contre-révolutionnaire : condamnation de toute espèce de frontisme, non-défense de l’URSS, dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des luttes de libération nationale.
Nous reviendrons un jour sur la véritable histoire de la gauche. Disons simplement ici que depuis l943, date de sa fondation, le prétendu "PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE", créé en pleine période de contre-révolution[l], n’a cessé de dégénérer et d’abandonner les positions de classe que le courant dont il se réclamait défendait dans les années 30.
L’une des preuves les plus flagrantes de cette dégénérescence se trouve dans son soutien aux luttes de libération nationale, biais par lequel il rejoint le cloaque nauséabond où s’agitent les trotskystes et autres maoïstes. Nous verrons plus loin que cette position est sous-tendue par la fumeuse théorie de l’"Invariance du marxisme" de l847 à nos jours et le refus de reconnaitre la crise historique mondiale du capitalisme, ce qui les amène à déclarer que le capitalisme est encore "révolutionnaire dans certaines aires géo-historiques". Nous verrons ainsi que le mythe de l’invariance n’est pas seulement une farce idéologique, mais qu’il conduit à des positions contre-révolutionnaires.
LE PCI ET LA GUERRE DU KIPPOUR
Nous accordons bien volontiers à "Programme Communiste" (n°6l) que la question nationale "permet de vérifier si l’on sait assimiler la méthode matérialiste et la théorie révolutionnaire". C’est l’objet de cet article. Après la fin de la guerre du Kippour, le PCI a rappelé sa position théorique sur les luttes nationales et "les droits des peuples"; ou plutôt, il a ressorti un texte de l953 ("Les révolutions multiples") accompagné d’un extrait de la critique de Lénine à la brochure de Rosa Luxembourg ("La crise de la Social-Démocratie"). ("Le Prolétaire", n° l64.)
On aurait pu espérer qu’avec la guerre du Moyen-Orient certains éléments du PCI commencent à douter de l’analyse des guerres de libération nationale que leur "parti" s’obstine à "répéter".
Jamais, en effet, un conflit n’aura montré avec une telle évidence le caractère contre-révolutionnaire et inter-impérialiste de ces guerres. C’est au nom de la délivrance des territoires occupés, de la "défense de la patrie" que les bourgeoisies du Moyen-Orient ont assassiné des milliers de prolétaires juif et arabes. Jamais les petites nations ou "nationalités" n’auront autant servi de pions sur l’échiquier mondial où s’affrontent USA et URSS, à la recherche de nouvelles positions • Les rivalités nationales des petits pays sont apparus sous leur vrai jour : des moments du conflit inter-impérialiste que se livrent les grands impérialismes. Quant aux ouvriers et paysans palestiniens, la "cause sacrée" de cette guerre, ils avaient eu l’intelligence qui fait défaut au génial "parti historique" auto-proclamé de ne pas participer à cette guerre où ils ne pouvaient que servir de chair à canon (à l’exception de quelques fedayin téléguidés par les Etats arabes). Gageons que la constitution d’un Etat palestinien au Moyen Orient permettra au capitalisme mondial de mieux fractionner le prolétariat de cette région de mieux museler le prolétariat palestinien déjà faible.
Mais "Le Prolétaire" (n° l60) n’a voulu voir dans cette guerre qu’une "farce sanglante", une comedia dell’arte où "russes et américains ont fait semblant d’être prêts à en venir aux mains". Le PCI ne semble avoir trouvé dans ce conflit qui décimait les rangs du prolétariat que l’occasion de tremper sa plume dans l’encrier du moralisme le plus plat : "le nième conflit du Moyen-Orient passera à la postérité comme un moment de cynisme bourgeois… cynisme de l’Egypte… cynisme d’Israël… cynisme de différents Etats arabes… cynisme des Etats Européens… cynisme des super-grands…", "C’est le triomphe des Metternich modernes, l’âge d’or de la nouvelle Sainte-Alliance à deux (Kossyguine et Kissinger)."
Admirons le grand art avec lequel le PCI évite de prendre une position de classe.
Mais au moins, se dira le naïf lecteur du "Prolétaire", ils vont reconnaitre que les seules victimes de cette guerre, ce sont les prolétaires. Même pas ! "Quand la nouvelle guerre a éclaté entre arabes et israéliens, nous avons écrit -ce n’était pas un pronostic difficile pour des marxistes (sic)- que les véritables victimes (souligné par le "Prolétaire") en seraient les feddayin. " (NB, les "fedayin" même pas les travailleurs palestiniens !)
Toutes ces pitreries et jongleries de petits littérateurs n’arrivent pas à dissimuler une profonde indifférence à l’égard du prolétariat de ces pays, un extraordinaire "indifférentisme", pour reprendre l’expression chère au PCI. Leur solidarité ne va pas aux Palestiniens (encore que le terme ne veuille rien dire en bon vieux langage marxiste), pas plus aux ouvriers arabes et juifs tués ou mutilés à vie : non, ils versent des larmes sur les membres d’un organe militaire bourgeois milice du capital palestinien naissant : les commandos de fedayin. On ne peut plus nettement choisir son camp.
Poursuivant ce brillant exercice de style, dans le même numéro, "Le Prolétaire" affirme que les USA et l’URSS sont intervenus pour défendre leur "condominium sur la terre entière" De deux choses l’une : ou bien "Le Prolétaire" a "oublié" ses critiques de la théorie de l’ultra-impérialisme de Kautsky, ou bien tout ceci n’est que poudre aux yeux pour éviter de prendre position.
Derrière les clichés journalistiques du "Prolétaire», il y a la volonté de ne pas prendre une position sans ambigüité. Lénine, le Lénine révolutionnaire de l9l4, dont fait semblant de se revendiquer "le Prolétaire", n’hésitait pas à appeler à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et à féliciter -en totale contradiction avec ses positions sur la question nationale- les socialistes serbes d’avoir refusé de défendre la "patrie nationale serbe" naissante. Il fustigeait tous les centristes qui refusaient de mettre en avant le programme révolutionnaire de la classe, tout en tenant de vagues propos internationalistes. Lénine a su alors montrer que la révolution (en l4 comme aujourd’hui) ne tolère pas les demi-positions.
Même si cette position est théorique, sans effet immédiat -et c’est toujours le cas en dehors des périodes révolutionnaires- une telle position de PRINCIPE à l’effet PRATIQUE de constituer une frontière de classe entre les éléments prolétariens et les éléments bourgeois.
Cette absence de position prolétarienne, ou plutôt cette volonté marquée de faire alliance avec la bourgeoisie palestinienne range une fois de plus le PCI dans le parti des gauchistes, souteneurs "critiques" professionnels.
Les épigones de la gauche italienne, regroupés dans le PCI feraient bien de méditer ce qu’écrivait le courant dont ils se réclament sur les "luttes de libération nationales" :
- "Les soubresauts nationalistes, les gestes terroristes de représentants des nationalités opprimées expriment aujourd’hui l’impuissance du "prolétariat et l’approche de la guerre. Il serait faux de voir dans ces mouvements un apport à la révolution prolétarienne, car ils ne peuvent s’épanouir qu’à la faveur de l’écrasement des ouvriers et donc en connexion avec les mouvements d’impérialismes opposés". "BILA.N" (n°l4).
OU MENE L'INVARIANCE
Le PCI se croit encore, pour certaines aires géo-historiques, en l848. Il reprend à la lettre déformée la nécessité de soutenir certaines « révolutions démocratiques bourgeoises". Comme le disait Lénine contre Kautsky, l’une des méthodes les plus sournoises de l’opportunisme consiste à, répéter une position valable dans le passé sans tenir compte du changement de période. Ici, c’est de la même chose qu’il s’agit : on fait croire au lecteur que la Palestine de l973, c’est l’Allemagne de l848.
Cette conception parfaitement idéaliste de l’Invariance qui efface les différences de périodes historiques, entraine plusieurs conséquences :
- on affirme que, dans certaines aires, le capitalisme demeure révolutionnaire, alors que dans d’autres il serait sénile. Ce faisant, on nie son caractère mondial depuis le début du siècle.
- il s’ensuit que, toujours dans ces mêmes aires, la révolution bourgeoise est à l’ordre du jour (ou la "révolution double" si le prolétariat peut en prendre la tête). D’où le soutien aux "révoltes des peuples de couleur (?), et le dépit très amusant de nos invariants de ne pas voir surgir des "jacobins" sans-culotte de ces « révolutions".
- on abandonne ainsi le terrain de classe du prolétariat MONDIAL et on nie l’antagonisme fondamental et irréconciliable qui oppose au cours de la décadence du mode de production capitaliste, les deux seules classes décisives de la société : bourgeoisie et prolétariat.
l) Caractère révolutionnaire des luttes de libération nationale?
Les conséquences contre-révolutionnaires de la théorie de l’Invariance apparaissent très nettement dans le numéro l64 du "Prolétaire" cité plus haut même s’il affirme d’un côté, que le capitalisme est "réactionnaire depuis l848", il déclare qu’il faut soutenir son développement dans tout pays arriéré. Ceci tant pour la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour les revendications socialistes" que par "les coups que ces insurrections et ces révoltes portent à l’impérialisme euro-américain". (nous soulignons)
Voilà qui devrait réjouir les tiers-mondistes en tout genre à la recherche de révoltes paysannes. Pour le PCI il ne semble exister qu’un impérialisme : "l’euro-américain", ce qui nie les rivalités inter-impérialistes entre chacune des nations européennes et américaine et oublie dans les faits l’existence d’un impérialisme russe ou chinois. ("L’anti-impérialisme" du PCI est ici à sens unique !). L’affaiblissement d’un impérialisme ne peut qu’entrainer, à une époque où l’impérialisme est devenu un système mondial, le renforcement d’un impérialisme rival ne serait-ce que par la vente fructueuse d’armement qui entraine d’ailleurs la dépendance du pays révolté à l’égard de l’impérialisme "ami". Fondamentalement l’impérialisme mondial ne peut être affaibli, il ne peut être que détruit par le prolétariat mondial.
Quant à l’idée de soutenir la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour des revendications socialistes" elle nous laisse rêveurs. Après le socialisme en un seul pays, voici le "socialisme dans une seule aire" (et de surcroît dans une aire arriérée !). Depuis quand les "revendications (!) socialistes" se posent-elles donc au niveau d’aires géographiques ?
Logique avec sa position, le PCI peut alors se permettre les déclarations les plus incroyables qui feraient frémir même un Trotsky des années 30 :
- "Les révolutions multiples contiennent l’affirmation la plus vigoureuse de la valeur révolutionnaire, même d’un "Bloc des Quatre Classes" en Chine et même du stalinisme en "Russie. C’est là le courage (sic) de la vraie Gauche Communiste…"
Si la révolution bourgeoise est encore progressiste il faut la soutenir.
Voilà ce qu’implique cette stupéfiante déclaration. Si chaque aire doit parcourir le même cycle que l’aire euro-américaine, alors, il faut adopter dans chaque pays concerné l’attitude du mouvement ouvrier au siècle dernier : soutenir ce qu’il y a de révolutionnaire dans la bourgeoisie.
En fait, à la base de la conception du "Prolétaire" il y a l’idée que le développement des forces productives à l’échelle nationale reste progressiste.
Ce faisant, il nie qu’il y ait une coupure entre la période d’avant et d’après la constitution du marché mondial. Pour le PCI la nation n’est pas un héritage barbare et décadent qui s’oppose au seul progrès historique désormais à l’ordre du jour, le développement MONDIAL des forces productives -elle est un cadre adéquat, "révolutionnaire" pour le développement des forces productives. Suivant une telle logique, le PCI aurait dû soutenir le capital russe progressif pendant les deux guerres mondiales impérialistes. Quand on se rappelle le VRAI courage de la gauche italienne en l9l4-l8 et en l939-45, on voit comment nos "invariants" renient le meilleur de l’esprit de leurs prédécesseurs.
Depuis l9l4 le conflit mondial inter-impérialiste a montré que le marché mondial est constitué, le problème n’est plus d’aider le capitalisme à se développer, mais de l’abattre définitivement.
C’est cette vision de changement de période qu’avait le Premier Congrès de l’I.C. lorsqu’il affirmait qu’on était entré dans une ère de guerres, de crises et de révolutions.
L’alternative était désormais : Socialisme ou barbarie.
Désormais, le rétrécissement des marchés extérieurs par rapport aux nécessités croissantes de réalisation de la plus-value entraine des rivalités, des conflits incessants entre puissances impérialistes. Désormais, l’impérialisme est un système mondial qui s’impose à tous les Etats nationaux. Dans un marché mondial pressuré par le capital, chaque nation est obligée d’être impérialiste par rapport aux autres nations pour survivre : le dernier exemple de cela, c’est le conflit entre le Sud-Viet-Nam et la Chine pour la possession des îles Paracels où l’on espère trouver du pétrole. Derrière chaque guerre, entre grands, entre petits se profile l’antagonisme entre les forces productives mondiales et le capitalisme forcément national. Toute vision qui reste enfermée dans le cadre national est incapable de comprendre la nature du capitalisme actuel.
Or justement, pour le PCI(tout comme pour les trotskystes) le capital n’existe pas vraiment comme système mondial et chaque nation poursuit son propre cours comme un atome indépendant dont on pourrait déterminer isolément la juvénilité ou la sénilité. A qui fera-t-on croire que ce bidonville qu’est l’inde est ''juvénile" par opposition aux USA "séniles" ?
Le PCI prétend aussi que les luttes "révolutionnaires nationales" permettent un développement des forces productives dans les pays où elles ont lieu. C’est vrai. Mais il n’en découle pas que ces luttes soient pour autant révolutionnaires.
Faisons d’abord remarquer que les pays ou se sont déroulées de prétendues "révolutions démocratiques bourgeoises" ne se développent que par le secteur lourd de l’armement (Chine), ou croupissent dans leur misère paysanne (Cuba et son économie sucrière). Si le PCI était logique il devrait soutenir également les pays totalement dépendants de l’impérialisme USA comme le Brésil ou la Corée du Sud où les taux de croissance atteignent 20%. Ou pourquoi ne soutient-il pas le capital Français ou Italien qui ont prolétarisé des millions de paysans depuis l945 ?
Aucun système et encore moins le capitalisme, ne vit sans permettre d’une façon ou d’une autre un certain développement des forces productives. Ceci est évident pour sa phase historique ascendante, mais se vérifie aussi au cours de sa décadence. C’est seulement au cours des grandes crises ouvertes qu’il se produit de véritables BLOCAGES de ce développement. Ce qui change radicalement d’une période à une autre, ce qui rend un système historiquement sénile, ce n’est pas une impossible stagnation permanente du développement des forces productives, mais le bouleversement définitif de la relation qui lie l’ensemble des rapports de production qui le constituent avec le processus de développement des forces productives. Tant que ces rapports de production sont LES SEULS COMPATIBLES avec le degré de développement des forces productives, le système vit sa phase ascendante. La décadence, la mise à l’ordre du jour de l’avènement d’une société nouvelle, commence avec la transformation de ces rapports en FREINS, ENTRAVES à la croissance des forces productives.
Attribuer un caractère progressiste au capitalisme dans telle ou telle région parce qu’il y développe des forces productives est donc absurde, non seulement parce que le capital ne peut être jugé que d’un point de vue MONDIAL[2] mais aussi parce que EN LUI-MEME aucun développement ne possède une signification historique.
Le développement qu'on· pu connaitre les économies du Tiers Monde perd toute signification progressiste dans le cadre historique mondial au sein duquel il se déroule. Si le Tiers-Monde crève de quelque chose ce n’est pas du manque de nations souveraines mais bien de la subsistance des nations dans le monde. C’est l’incapacité de l’humanité à détruire le cadre national (ce cadre économique créé par le capital et dont deux guerres mondiales ont montré, dans la plus horrible barbarie, la définitive obsolescence) qui a engendré le Tiers Monde. C’est parce que le développement des forces productives est mondialement entravé depuis plus d’un demi-siècle dans les carcans nationaux que les "nations souveraines" du Tiers-Monde s’enfoncent toujours plus dans leur arriération.
"Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt", dit un proverbe chinois. Quand le cadre national plonge dans la misère la plus horrible les deux tiers de l’humanité, le PCI nous fait remarquer que dans tel coin du tiers-monde le "cadre national" a tout de même permis la construction de quelques usines et que c’est très important, etc., etc. Bref, c’est dans la partie du monde qui justement subit le plus cruellement l’absurdité des nations que les nationalismes seraient "progressistes" !
De deux choses l’une : ou bien l’on affirme comme l’IC en l9l9 que nous sommes entrés dans l’ère de la révolution prolétarienne et l’on ne peut soutenir les guerres nationales -ou bien on verse dans le sentimentalisme poujadiste des défenseurs des "petites" nations contre les ''grandes". C’est ce dernier choix que fait le PCI qui, s’en prenant aux révolutionnaires, affirme que le non-soutien aux luttes nationales est : "une vision idéaliste qui converge en fait, involontairement avec le social pacifisme et le social-chauvinisme, sinon dans le soutien de l’ordre établi, du moins dans le messianisme de grande nation qui condamne les peuples des colonies et des semi-colonies, à l’immobilité dans l’attente de la révolution prolétarienne dans les métropoles". ("Le Prolétaire" n°l64)
"Grande nation" , "petite nation", "peuples", voilà les piteux discours que tient la pure et dure invariance de l’opportunisme ! Seuls des petits bourgeois qui ne se sentent pas organiquement fraction d’une classe mondiale peuvent, à l’heure du massacre des prolétaires par le capital, nous servir de tels bavardages. Seuls des gens pénétrés d’égocentrisme, de culpabilité "nationale", d’identification à leur pays ou aire, peuvent sombrer dans ce mépris du prolétariat mondial.
2) Le PCI et le Chili
Si les révolutions démocratiques sont encore à l’ordre du jour à l’époque du capitalisme mondialement décadent, on comprend que le PCI se fasse le conseiller de la bourgeoisie "démocratique" du Tiers-monde, à qui il reproche d’être trop "girondine" et pas assez "jacobine". Nos Daniel Guérin bordiguistes en viennent à rêver d’une révolution sans-culotte :"Ni potences, ni guillotines, ni canons pour accompagner la marche rien moins que théorique de la bourgeoisie progressiste" (n° l58).
Le PCI en arrive à jouer le rôle du trotskiste Pablo conseillant Ben Bella en Algérie. Ainsi, ils écrivent : "Un gouvernement qui prétend faire œuvre révolutionnaire sans mettre hors la loi les partis incarnant le passé et le présent (parce que naturellement, Allende représente l’avenir –(NdR) qu’il faut révolutionner, prépare le terrain à sa propre destruction". (n° l58)
Le résultat, c’est qu’on laisse supposer qu’Allende, cet homme de la bourgeoisie, aurait pu révolutionner quelque chose. Comme si Allende n’était pas l’instrument d’une politique de la bourgeoisie, destinée à mettra au pas le prolétariat chilien, que la crise économique rendait de plus en plus remuant, par des "méthodes de gauche" ; comme si Allende n’avait pas constamment employé la violence de classe contre le prolétariat chilien et les ouvriers agricoles ; comme si les différences entre les méthodes de Pinochet et celles d’Allende cachaient autre chose qu’une inévitable continuité dans le but de classe : la défense du capital national face à l’étranger et aux classes exploitées.
Mais le clou de l’analyse du "Prolétaire" sur le Chili et les "Révolutions multiples", c’est l’accusation de "girondisme" lancée à Allende :
- "Un régime statistiquement (?) "Populaire (?) et même plébéien (? ?), mais organiquement incapable de faire preuve d’une audace sans culotte (!), un régime qui écarte la violence (et la répression anti-ouvrière ?) avec pour seul résultat de subir la violence, qui fuit les mesures despotiques pour capituler devant le despotisme, qui en n’attaquant pas s’interdit même de se défendre, qui vénère la loi et l’ordre et les retrouve devant lui sur la gueule des canons et des mitrailleuses, qui ne prêche la paix que pour récolter la guerre" ("Le Prolétaire", n° l58)
Les prolétaires chiliens n’ont plus qu’à supplier le PCI d’envoyer à ce qui reste de l’U.P. un audacieux Robespierre, muni des principes tactiques invariants.
Ces jacobins qui se piquent de marxisme, parlent de "régime" là où il y a dictature de la bourgeoisie, se gargarisent de "statistiques" et de "peuple", là où il y a des classes. Derrière tout cela, il y a en fait une admiration inavouée pour le "régime" "populaire" d’Allende, et en dernier lieu une apologie des fronts interclassistes. Toute l’histoire du mouvement révolutionnaire est là pour montrer que lorsque de pseudo marxistes commencent à parler de "peuple ", de "plèbe" ils sont inévitablement amenés à remplacer l’analyse de classe par le populisme le plus éhonté et se retrouvent nécessairement dans le camp de l’ennemi.
3) Abandon du terrain de classe
Dans la même lignée de l’invariance de l’opportunisme, se trouve la théorie des "peuples de couleur" propagée par les petits intellectuels bourgeois "blancs" pour soulager leur constipation de citoyens "riches" et par les intellectuels bourgeois "noirs" pour mystifier les ouvriers de la même couleur qu’eux. Démagogiquement, on substitue la guerre des races à la guerre des classes. On comprend que le PCI reproche aux révolutionnaires "le simplisme grossier de ceux qui réduisent toute lutte de classe au binôme, toujours et toujours répété de deux classes conventionnelles[3] qui seraient les seules à agir"
Eh bien, oui, nous nous réclamons de ce simplisme grossier sur l’arène mondiale où se joue le sort de la société humaine, il ne peut y avoir en fait que deux classes décisives en présence. Ce sont les deux classes "conventionnelles" de Marx : bourgeoisie et prolétariat.
Nous ne nions pas qu’il y en ait d’autres mais elles ne sont pas des SUJETS déterminants ; elles se rangent derrière la bourgeoisie ou sont neutralisées puis lentement intégrées au prolétariat.
Toute cette rhétorique sur les "binômes" et "conventions " ne peut avoir comme but que de mettre en valeur la petite bourgeoisie.
Le PCI a tout renié du passé révolutiorulaire de la gauche italienne qui l’avait amené à réviser les positions contre-révolutionnaires de Lénine sur la question nationale. Aujourd’hui, il réclame avec la meute des gauchistes des Allende "jacobins", se pâme devant l’embrigadement des jeunes chômeurs palestiniens dans l’appareil militaire du capital (fameux "fedayin"), aperçoit des couleurs là où il y a des classes et braille fièrement que Stalinisme et Bloc des Quatre Classes sont révolutionnaires. A l’heure où le capitalisme mondial, putréfié, craquant de toutes parts, n’a plus qu’une seule solution : des massacres sans cesse plus sanglants et la destruction de l’humanité, les petits écrivains du "Prolétaire" réclament des mouvements "audacieux", "despotiques" de "jacobins" et de "sans-culotte".
Voilà où mène l’incompréhension théorique de la période historique, incompréhension fondée sur une invariance mythique d •un programme intégral qui n’a jamais existé.
A force de répéter invariablement les mêmes erreurs, on devient intégralement contre-révolutionnaire.
Et, à force d’être con, on devient odieux.
Chardin.
[l] C’est de lui qu’est issu, après la scission de l952 le P.C.I., regroupé autour du "Prolétaire" et "Programa Communista"
[2] Il est, à notre époque aussi absurde de parler de "capitalisme progressiste" pour une nation ou même une région du monde que d’affirmer que le féodalisme était un système progressiste en l780 parce que dans telle ou telle baronnie du royaume de France les défrichements de terres et les techniques de production connaissaient encore quelques développements.
[3] Il faut se rendre compte (ainsi parle toujours l’opportunisme NDR) que, dans les pays d’Outre-mer, vivent d'immenses collectivités de race jaune, noire, olivâtre (sic), dont les peuples ( !) réveillés par le fracas du machinisme, semblent ouvrir le cycle d’une lutte patriotique (!) et d’indépendance et de libération nationale comr.le celle dont s’enivraient (sic) nos grands-parents…" (texte de l953, repris dans le "Prolétaire" N°l65).
Courants politiques:
- PCI (Le prolétaire) [30]
Rubrique:
Sommes-nous sectaires ? Ce qui distingue les organisations révolutionnaires
- 26 lectures
Au travers des différents articles de Révolution Internationale nous avons été maintes fois amenés à constater que, dans leur quasi-totalité, les groupes et partis qui se réclament actuellement de la révolution prolétarienne, des staliniens aux anarchistes, en passant par toutes les gammes de "socialistes", "tiers-mondistes" et divers "trotskysmes" n’ont rien de révolutionnaires.
Cette affirmation provoque souvent, nous le savons, toute une série d’accusations du style : "sectarisme", "puritanisme révolutionnaire", "isolement volontaire par rapport aux masses", etc.
Voici donc quelques rappels pour ces "révolutionnaires" de bonne volonté non-sectaires", que d’étranges soucis de "réalisme" semblent troubler au point de leur interdire toute compréhension de ce qu’est un principe révolutionnaire ou une organisation prolétarienne
Avant de parler de ce qu’est le "sectarisme", de ce que recèle l’accusation de "puriste" chez celui qui s’en sert, ou du sens de l’expression "se couper des masses", voyons les critères que l’histoire du mouvement ouvrier a permis de dégager pour définir une organisation de révolutionnaires[1]. Et en premier lieu, les critères qui se sont révélés ne peut pas en être.
Les faux critères
La composition sociale
En apparence, il semble logique de dire qu’une organisation politique dont la majorité des membres est constituée par des ouvriers est une "organisation ouvrière". L’histoire a cependant violemment démenti ce syllogisme superficiel.
Un des exemples les plus frappants est probablement celui du parti social-démocrate allemand. Ce parti, dont la fondation est liée à Marx et Engels, qui regroupa le plus d’ouvriers de l’histoire, ce parti qui constitua un authentique parti ouvrier passant définitivement dans le camp du capital, avec armes et bagages, au cours de la première guerre mondiale. C’est lui qui, à la fin de la guerre, se chargea de l’écrasement de l’insurrection prolétarienne de 1918-1919.
C’est l’ouvrier Noske qui dirigea personnellement les corps francs. C’est le gouvernement social-démocrate "ouvrier" d’Ebert qui assassina Rosa Luxembourg et Liebknecht.
Personne n’oserait affirmer que le parti des Ebert, Noske, Scheidemann continuait alors d’être un parti ouvrier. Et, pourtant, sa base demeurait encore essentiellement ouvrière. Qui plus est, il disposait d’une écrasante majorité au sein des conseils ouvriers à la veille de l’insurrection.
Parmi d’autres, citons un exemple tout aussi important et inéquivoque : celui du Parti menchevik en Russie en 1917. Il est connu que le parti de Tseretelli et Tchkeidze possédait une base ouvrière très importante pendant la période révolutionnaire qui aboutit à Octobre. Au début du mouvement son influence en milieu ouvrier était même plus importante que celle des mencheviks. C’est pourtant contre lui et le gouvernement dont il était un des principaux piliers que l’insurrection prolétarienne d’Octobre dut se faire.
Que l’on réalise simplement que presque toutes les insurrections prolétariennes de ce siècle ont été écrasées ouvertement ou détournées dans une impasse par des gouvernements de "gauche" et des partis "à large base ouvrière" (et, en premier lieu par les PC), et l’on comprendra à quel point ce critère de la "composition ouvrière" d’un parti est devenu totalement inopérant à notre époque, alors qu’il pouvait posséder une certaine validité lors des premiers pas du mouvement ouvrier, au XIXe siècle.
Ce raisonnement paraît insuffisant à certains experts "ès dialectiques". Pour ceux-ci, le fait d’avoir participé à l’écrasement d’une insurrection ouvrière ne suffit pas à prouver qu’on ne peut plus être une organisation prolétarienne. C’est ce que soutiennent tous les partisans de la métaphysique dite "de la double nature de classe" des organisations réformistes. L’explication du miracle de la transformation des organisations de la contre-révolution permanente en organes du prolétariat et "vice versa", sinusoïdalement en quelque sorte, est la suivant : en temps de calme social, des organisation réformistes défendraient tant bien que mal les intérêts immédiats de la classe. Mais, étant incapables d’en défendre les intérêts historiques globaux, du fait de l’essence même de leur rôle , en temps de lutte ouverte de la classe elles passeraient objectivement dans le camp des défenseurs du système. Puis le calme revenu, elles reprendraient leur place dans les rangs du prolétariat, et on recommencerait, etc....[2]
Cette vision conduit, dans la pratique concrète, ses auteurs à adopter une attitude de défense des organisations réformistes en temps d’apathie de la classe (bien sûr défense critique) et en période d’effervescence sociale à des cris d’indignation "surprise", des dénonciations de "trahison", bref des larmes de crocodile. Mais dans les deux cas sa fonction contre-révolutionnaire est la même : masquer aux yeux des travailleurs la nature des organisations dites réformistes: des organes de la bourgeoisie au sein du prolétariat.
Deux aberrations théoriques principales sous-tendent ce pragmatisme réactionnaire :
1) L’affirmation de la possibilité d’existence, dans une société déchirée en permanence par les antagonismes de classe, d’une organisation politique capable de représenter alternativement les intérêts des deux classes. Une telle idée est un non-sens du point de vue marxiste: un parti est toujours une fraction et une expression politique d’une classe sociale et d’une seule. Il arrive qu’un parti ou groupe politique change de nature de classe, mais,
- cette transformation, quand elle a lieu, se produit toujours en faveur de la classe dominante; on n’a jamais vu, et on ne verra jamais une organisation politique de la bourgeoisie devenir un organe du prolétariat. En effet, à l’époque de la décadence la classe ouvrière ne peut plus s’organiser de façon permanente à l’intérieur de la société capitaliste, et toutes ses organisations antérieures doivent, pour survivre, fonctionner au service du capital (de même que celles qui se créent sans dépasser les anciennes conceptions réformistes). Une fois qu’elles s’installent dans cette fonction, elles défendent bec et ongles leur existence et donc la conservation de l’ordre social dont elles se nourrissent.
- Une organisation politique ne "trahit" pas deux fois. La deuxième fois, ce n’est plus une trahison mais la continuation d’une politique déjà déterminée une fois pour toutes, non par tel ou tel chef, bureaucrate ou "mauvaise direction", mais par son intégration au capitalisme. Les chemins qui traversent les frontières de classe sont à sens unique et sans possibilité de retour.
L’opportunisme n’est pas un label d’appartenance à deux classes, mais la manifestation non équivoque d’une nature de classe : celle de la classe dominante. Parler de "trahison" quand les syndicats, les PC ou les partis socialistes sont systématiquement passés, dans toutes les luttes sérieuses, du côté du capital, c’est écrire un roman d’espionnage, pas une analyse marxiste.
2) L’affirmation qu’une organisation du prolétariat peut être réformiste dans la période de décadence du capitalisme est la seconde aberration. Avec la fin de l’ère progressive du capitalisme, avec l’entrée de celui-ci en crise permanente, la mise à l’ordre du jour de la révolution socialiste a rejeté dans le camp de la contre-révolution tous les programmes réformistes.
Dans le capitalisme sénile, le réformisme n’est pas réactionnaire seulement dans les moments où la classe se lance dans des luttes révolutionnaires, il est devenu en permanence l’arme principale de la bourgeoisie dans le camp du prolétariat. Il n’y a pas plus de terrain de conciliation économique réel entre prolétariat et bourgeoisie que de place pour les réformistes dans les rangs du prolétariat, autrement que pour embrigader la classe dans les intérêts du capital.
Les ouvriers ne peuvent plus trouver dans les organisations réformistes que le reflet de leur apathie, jamais celui de leur combativité, car les travailleurs sont, aujourd’hui, inévitablement contraints, pour s’affirmer comme classe, d’emprunter la voie révolutionnaire et donc de s’affronter aux organisations réformistes.
Par "temps calme", l’importance relative des organisations réformistes en milieu ouvrier est le résultat, non pas de leur prétendue nature de classe prolétarienne, mais, au contraire, de l’atomisation et de la non-combativité de la classe.
En présentant la défense des individus ouvriers contre quelques empiétements trop grossiers du capital (défense institutionnalisée et nécessaire au système) comme synonyme de défense des intérêts de la classe ouvrière, en jouant leur rôle d’assistante sociale, ces organisations cherchent à se faire décerner un label prolétarien. Ce faisant, elles ne défendent même pas les intérêts immédiats de la classe, mais se donnent par contre la crédibilité nécessaire pour avoir un minimum d’efficacité dans l’encadrement, et la répression au moment des luttes véritables, de la classe ouvrière.
Le soi-disant mouvement de va-et-vient entre les classes qui semble animer les organisations réformistes recouvre en fait les deux moments d’un même, rôle au service d’une seule classe : préparation de la répression, exercice de la répression. La défense de ces organisations, leur assimilation au mouvement ouvrier dans les périodes où elles ne le répriment pas ouvertement n’est ainsi qu’une participation effective à la préparation des futures repressions. "Critique" ou non, l’appui aux forces contrerévolutionnaires participe entièrement du rôle de celles-ci.
Toujours en quête des "masses" les gauchistes, et spécialement les léninistes, éprouvent une sincère admiration pour la capacité des organisations réformistes à "s’implanter en milieu ouvrier". Ils voient dans cette capacité une preuve de l’authenticité de classe d’une organisation. Quant à nous, nous affirmons que l’existence de masses ouvrières dans une organisation n’est plus depuis longtemps une preuve de sa nature de classe prolétarienne ; le capitalisme décadent ne peut plus vivre sans ses propres organisations ouvrières ; ses besoins de contrôle totalitaire le lui imposent. Le fait qu’une organisation bourgeoise possède une influence en milieu ouvrier n’a jamais poussé les révolutionnaires à la "ménager" ou à la défendre "par principe" ou solidarité. Au contraire, les forces les plus dangereuses de la contre-révolution sont celles qui parviennent à s’infiltrer dans les rangs de la classe révolutionnaire. Leur dénonciation, la destruction des illusions qu’elles entretiennent dans la classe sont, pour les révolutionnaires, des tâches d’autant plus importantes qu’ils sont les seuls à pouvoir les accomplir.
la violence
Une organisation révolutionnaire prolétarienne est obligatoirement amenée à préconiser la violence de sa classe contre le système et ses représentants. Elle est, tout aussi inévitablement, appelée à connaître la violence de la régression de la classe dominante. De là à déduire que toute organisation politique qui se dit socialiste -ou quelque chose dans le genre- et préconise ou subit la violence est une organisation révolutionnaire, il n’y a qu’un pas. Ceux qui le franchissent partent, la plupart du temps, de deux erreurs :
-l’ignorance totale des critères révolutionnaires. Incapables du moindre approfondissement théorique du point de vue prolétarien, les adeptes de ce type de raisonnement sont contraints aux "analyses" superficielles où l’apparence, le spectacle, tiennent lieu de réalité. "Ils sont violents, ils sont donc radicaux, donc révolutionnaires"; ou bien : "ils sont poursuivis par le gouvernement, le gouvernement est bourgeois, ils sont donc anti-capitalistes".
-la mauvaise conscience de l’impuissance. Face à l’apathie des travailleurs, ou face à sa propre impuissance, l’impatience se transforme en admiration sans bornes pour "ceux qui, au moins, font quelque chose" : détourner n’importe quel moyen de transport faire un hold-up, piller un magasin, mettre une bombe, kidnapper un bourgeois ou être violemment poursuivi par le gouvernement bourgeois en place, sont des actes qui, par eux-mêmes, octroient à la première organisation qui ne se dise pas ouvertement bourgeoise, un label de révolutionnaire. Plus grande est la sensation d’impuissance, plus s’exaspère l’impatience, et plus on réduit le contenu de l’action révolutionnaire à la violence pure et simple.
- En milieu étudiant cette absurdité atteint un tel degré, que le seul dessin d’une arme empoignée est compris comme symbole révolutionnaire ! Réaction impuissante mais "sincère" de la part d’éléments authentiquement révoltés par l’abjection du capitalisme décadent ? Peut-être[3]. Il n’en demeure pas moins que son seul aboutissement est la complicité avec n’importe quelle fraction de la bourgeoisie qui, s’affublant de l’épithète de socialiste pour parvenir à ses fins, prend les armes contre ses concurrents politiques -ou simplement subit la répression de ces derniers.
La violence préconisée ou subie ne peut en aucun cas constituer un critère suffisant (ni même important) pour juger de la nature de classe d’une organisation politique. Dans une société fondée sur l’exploitation, tous les rapports humains tendent à être des rapports de force. Dans la civilisation du capital qui connaît la traite des noirs dès sa naissance, s’épanouit dans le plus sanguinaire des impérialismes et vieillit dans les holocaustes des guerres mondiales, cette tendance atteint son paroxysme. Mais cette violence omniprésente ne régit pas seulement les rapports entre les classes antagonistes ; elle caractérise aussi l’essence même des rapports entre fractions de la classe dominante. Quand les moyens "pacifiques", "démocratiques" ne suffisent plus, les fractions de la bourgeoisie sont contraintes de recourir aux moyens de la violence armée (ceci est d’autant plus fréquent que les butins qu’elles ont à se partager s’amenuisent -crises et difficultés économiques). Ainsi, les pays capitalistes les plus pauvres sont les plus secoués par ce type de conflits dans lesquels, par ailleurs, les puissances impérialistes trouvent un moyen de s’affronter à peu de frais.
Sentimentalement, les victimes de l’État tendent souvent à bénéficier -a priori- d’une certaine sympathie de la part des exploités. A fortiori si elles sont présentées comme révolutionnaires. Mais rien n’est plus abject que l’utilisation de la haine de la répression du capital comme "couverture prolétarienne" pour les contre-révolutionnaires qui sont en conflit avec la clique de leurs confrères qui se trouve au pouvoir. C’est à travers ce genre de méthodes que les fractions de la bourgeoisie parviennent à recruter la chair à canon de leurs conflits. Ainsi, les trotskistes, qui, depuis plus de quarante ans ont toujours trouvé un camp à choisir ("le plus progressiste", le "moins réactionnaire", le "plus antifasciste", etc.) dans les conflits entre bourgeois, sont passés maîtres dans l’art de sergents-recruteurs de la contrerévolution -guerres de "libération nationale", conflits inter-impérialistes, guerres "anti-fascistes"... peu nombreux sont les événements de l’histoire bourgeoise où ils n «aient pas apporté leur grain de sable ou leur goutte de sang.
Mais peut-être nous dira-t-on : ce ne sont encore là que des raisonnements de "sectaires-puristes" : ce n’est pas la violence en soi qui est un critère mais la violence exercée ou subie par des éléments ou des organisations "sincèrement convaincus de leur volonté révolutionnaire". Voyons donc le contenu de cet autre avatar de la "dialectique gauchiste".
la sincérité des militants
Lorsque nous mettons en question la nature de classe d’une organisation politique qui se dit "ouvrière" ou "révolutionnaire", on nous répond avec l’argument de "la sincérité des militants" (surtout celle de la "base"). L’absurdité de cet argument repose sur une séparation métaphysique entre l’organisation et ses membres, entre "les bons militants" et les "mauvais dirigeants" -alors que les organisations n’ont que les chefs qu’elles méritent : on utilise des arguments concernant des problèmes de personnalité pour éviter de poser les problèmes en termes de classes.
Pour déterminer les camps en présence dans une société régie par les confits de classe, l’histoire ne laisse aucune place à la "psychologie individuelle". Les illusions ne cessent pas d’être des illusions du simple fait qu’elles soient "sincères". D’illusions et de bonnes intentions, le camp de la contre-révolution en est pavé. On ne juge pas un individu d’après l’idée qu’il a de lui-même, disait Marx ; on ne juge pas une organisation politique d’après ce qu’elle dit d’elle-même, ni même d’après l’idée qu’en ont ses membres.
Du point de vue individuel, Hitler pouvait être aussi sincère et dévoué que Marx ; le problème n’est pas d’être "sincère" ou "malhonnête" envers une cause, mais de savoir quelle cause on défend dans la réalité, et, plus exactement, les intérêts de quelle classe on sert.
De deux choses l’une : ou bien on raisonne en termes de classe et on fonde la nature politique d’une organisation sur des critères de classe -et, dès lors, la seule attitude révolutionnaire face aux illusions qui surgissent inévitablement parmi les éléments en rupture avec la société actuelle, est celle de la dénonciation sans fard de leurs illusions et du rôle qu’objectivement celles-ci les amènent à jouer. Ou bien on s’embourbe dans le terrain individualiste pour patauger inévitablement dans les métaphysiques moralisantes des "motivations individuelles", On commence par affirmer le "droit à l’erreur[4]" et on finit toujours par confondre le respect de l’individu qui se trompe avec le respect de son erreur. On se prétend "compréhensif" et, ne sachant plus ce qu’il faut comprendre, on ne contribue qu’à enfermer "l’incompris" dans son erreur. Toute cette attitude "non-sectaire" a sa source dans la confusion et ne peut servir que la confusion ; elle se nie d’avance tous les moyens pour aborder la question de la nature de classe d’une organisation politique, puisqu’elle quitte dès le départ la problématique de classe.
Une telle façon d’envisager le problème serait une simple confusion, une simple "incapacité", si cette confusion n’était pas une force contre-révolutionnaire, si son résultat concret n’était pas, encore une fois, de permettre la défense des organisations de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier.
Posséder une origine historique prolétarienne, avoir une composition sociale ouvrière, être victime de la répression de l’État, préconiser ou pratiquer la violence, s’auto-proclamer révolutionnaire ou être constituée de militants sincèrement dévoués, aucun de ces traits (pris isolément ou dans leur ensemble) ne fait d’une organisation politique un organe de classe du prolétariat.
Aucun de ces arguments n’est politique . Ce sont pourtant eux qui tiennent le haut du pavé dans les milieux dits "gauchistes" et, de façon générale, partout où le marxisme est absent, ou présenté uniquement sous la forme d’une idéologie livresque. C’est pourquoi toute attitude politique, toute recherche de cohérence révolutionnaire y est automatiquement taxée de sectarisme.
Le vrai critère
Le rattachement d’une organisation politique à une classe est une question objective, qui se résout indépendamment des intentions et des illusions subjectives des membres qui la composent.
Être l’organe politique d’une classe, C’est tendre, dans le mouvement de cette classe, à exprimer et à défendre les positions des intérêts historiques de cette classe. La question n’est pas de savoir : si telle ou telle organisation croit ou non, cherche ou non à défendre les intérêts du prolétariat, mais objectivement, le fait-elle ? Ceci soulève au préalable deux questions :
1°- Comment se définissent ces intérêts ?
2°- En quoi consiste la défense de ces intérêts ?
Définir les intérêts de la classe
Pour beaucoup, c’est ce problème qui est au centre de la question du sectarisme. Définir les intérêts de la classe ? Oui, mais toute organisation qui se dit révolutionnaire, prolétarienne, est convaincue de posséder la vraie définition de ces intérêts. Le sectarisme ne serait, justement, rien d’autre que la conviction d’être les seuls à détenir cette vérité. Qu’est-ce qui prouve que telle pensée est celle qui correspond à la réalité objective des intérêts du prolétariat ?
La réponse ne peut être donnée que par la pratique.
"La discussion sur la réalité ou l’irréalité de la pensée, isolée de la pratique, écrit Marx, est purement scolastique.
La question de savoir si la pensée humaine peut aboutir à une réalité objective n’est pas une question théorique mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance, l’en-deçà de sa pensée". (Marx, Thèses sur Feuerbach)
Mais de quelle pratique peut-il s’agir dans la question qui nous préoccupe ?
La pratique immédiate de l’organisation ? Elle ne suffit pas. D’abord, parce qu’elle n’a aucun sens pratique matériel en dehors de celle de la classe, ensuite parce que cette pratique immédiate de l’organisation est réduite à son expression la plus faible tant que le prolétariat n’a pas entrepris, dans son ensemble, une action révolutionnaire .
La pratique des individus ouvriers ? Non plus. Ce serait croire à la démarché ouvriériste, qui voit dans l’intérêt de chaque ouvrier individuel, ou salarié, l’expression des intérêts généraux du prolétariat. La réalisation des besoins historiques d’une classe entraîne la satisfaction de ceux de ses membres. Mais l’inverse est totalement faux. C’est uniquement à partir de la pratique de la classe en tant que classe, face aux intérêts des autres classes, qu’un critère d’authenticité prolétarienne peut être établi.
Mais cette pratique de classe peut-elle se résumer à la pratique immédiate de la classe ? Et si les travailleurs se font mobiliser pour aller à la guerre impérialiste ? Ou s’ils demeurent dans la plus parfaite indifférence ou, du moins, dans une apathie larvée (ce qui est le cas le plus fréquent, puisque les périodes de véritable lutte de la classe sont rares dans l’histoire) ? C’est encore insuffisant.
La seule pratique qui permette de trancher sur l’authenticité de la définition des intérêts du prolétariat que peut donner une organisation, c’est la PRATIQUE DU MOUVEMENT HISTORIQUE de la classe, tel1e qu’elle s’est déroulée depuis plus d’un siècle et demi de luttes.
C’est au cours de la pratique de sa lutte historique que le prolétariat définit et prend conscience de ses intérêts. C’est en affrontant les autres classes que son propre "programme de classe" s’est forgé et continue de se définir. Les travailleurs rejoignent le véritable combat de leur classe lorsqu’ils retrouvent la ligne générale que les acquis du passé ont tracée et quand ils l’enrichissent par leur propre expérience.
Contrairement à ce que pensent les fanatiques de l’anti-sectarisme, la façon dont une organisation définit les intérêts du prolétariat ne vaut donc pas celle de n’importe quelle autre. Une idée n’en vaut une autre que tant que toutes deux ne sont pas confrontées à la pratique.
L’expérience historique du prolétariat a créé des critères objectifs, réels, capables de trancher impitoyablement parmi les subjectivités des différentes organisations qui se proclament révolutionnaires.
Lorsque nous formulons dans notre plate-forme politique les intérêts actuels du prolétariat mondial, nous ne le faisons pas à partir d’inventions théoriques nouvelles ou de découvertes de tel ou tel militant; nos positions sont toutes le résultat clair, indiscutable, de l’expérience de la lutte historique du prolétariat.
Lorsque nous affirmons que telle ou telle question constitue une frontière de classe (c’est-à-dire une question dont la réponse situe son auteur à l’intérieur ou à l’extérieur du camp prolétarien), c’est qu’il s’agit d’un problème que la pratique de la classe a déjà résolu de façon indiscutable et définitive.
Deux exemples importants permettront d’illustrer ce que nous affirmons :
La question de savoir si le prolétariat doit, pour son émancipation définitive, conquérir l’appareil d’État bourgeois ou le détruire, était une question théorique, ouverte, au sein du mouvement ouvrier avant la Commune de Paris. Avec la première expérience insurrectionnelle politique du prolétariat, la question fut tranchée définitivement.
La Commune coûta des milliers de morts au prolétariat. Mais, si elle fut une défaite, elle n’en fut pas moins utile à la lutte historique de la classe qui la réalisa. Avec elle, le prolétariat mondial s’était enrichi d’une expérience fondamentale, dont les acquis devaient devenir de précieuses armes pour ses futurs combats. Et parmi ces acquis, la certitude de l’impossibilité de conquérir l’appareil d’État bourgeois au profit de la révolution prolétarienne, donc la nécessité de le détruire.
La question syndicale fournit un autre exemple. Si, aujourd’hui, les révolutionnaires du monde entier peuvent affirmer que la forme d’organisation syndicale est devenue un simple instrument d’encadrement de la classe ouvrière au service du capital, ce n’est pas parce que quelques "puristes" géniaux auraient inventé ce principe à partir de leurs réflexions théoriques abstraites.
C’est parce que soixante années de répressions syndicales, larvées ou sanglantes, soixante années d’échecs sanctionnant toute tentative de former de "bons" syndicats, soixante années d’affrontements violents avec les syndicats à chaque fois qu’une lutte sérieuse s «est engagée, ont permis de savoir définitivement à quoi s «en tenir sur la question syndicale.
"Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne font qu’exprimer en termes généraux les conditions réelles d’une lutte de classes qui existe, d’un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux." (Marx et Engels : Manifeste...)
Parce qu’elle est la seule classe révolutionnaire de l’Histoire à être simultanément une classe exploitée, la classe ouvrière est la seule dont la victoire finale n’est pas le résultat d’une série de victoires partielles, mais, au contraire, d’une série de défaites fécondes. Cette suite de défaites ne peut contribuer à la victoire finale que si le prolétariat parvient à s’en approprier les résultats historiques.
Ces acquis, payés du prix de la vie de millions de prolétaires, sont la principale richesse du mouvement révolutionnaire prolétarien. Ce sont eux qui définissent de manière stricte le cadre minimal dans lequel s’inscrivent des "conceptions théoriques communistes". Ce sont eux qui obligent les révolutionnaires à dénoncer comme étrangères au mouvement prolétarien toutes les organisations qui, pour une raison ou pour une autre, ne les ont pas faits leurs.
Et il est évident que si, de ce qui précède, il découle que les questions autres que celles que 1«Histoire a tranchées restent ouvertes à la discussion, il n’en demeure pas moins que tout enrichissement, tout dépassement de notre plateforme ne peut se faire qu’en intégrant les acquis minimaux qui délimitent, sans aucune tergiversation possible, les frontières que l’histoire de ses luttes impose aujourd’hui à la classe prolétarienne. Défendre les intérêts historiques de la classe
En tant qu’organisation distincte, les révolutionnaires n’agissent pas directement, matériellement, contre le système qu’ils combattent. Seule la classe dans son ensemble peut entreprendre la transformation matérielle de la société. C’est pourquoi la "défense des intérêts historiques du prolétariat" consiste pour les révolutionnaires, d’abord et avant tout, à défendre au sein de leur classe l’acquis historique de sa propre lutte.
Aussi, ce qui garantit l’authenticité du lien d’une organisation politique avec le prolétariat, ce n’est :
- ni le "contact physique" avec les ouvriers (mythe de l’ouvriérisme gauchiste) ;
- ni l’affrontement violent avec l’État (mythe du terrorisme anarchiste), mais la capacité à faire siennes les positions politiques que l’histoire de la lutte prolétarienne a définies.
L’importance primordiale des positions politiques, des conceptions théoriques, ne transforme en aucune manière l’organisation révolutionnaire en un laboratoire théorique, un groupe d’études sociologiques. Le marxisme n’est pas une "interprétation du monde" mais la "théorie de sa transformation"
LA COHERENCE THEORIQUE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT SURGIR ET SE DEVELOPPER QUE SOUS L’IM- PUISION PERMANENTE DU SOUCI MILITANT DE L’INTERVENTION POLITIQUE.
Il faut donc qu’il n’y ait aucune équivoque sur ce que nous défendons : nous ne sous-estimons en rien les responsabilités militantes d’une organisation prolétarienne. Ce que nous cherchons à mettre au clair, c’est que le souci politique d’intervention militante, s’il est nécessaire, ne suffit pas, à lui seul, à faire d’une organisation politique un organe véritable du prolétariat.
Sectarisme et intransigeance révolutionnaire
L’intransigeance révolutionnaire ne peut être comprise comme nécessité que par les révolutionnaires eux-mêmes. Pour l’esprit philistin, pour la pensée opportuniste, elle apparaît comme du "sectarisme".
La pensée révolutionnaire ne peut se former qu’en opposition aux idéologies dominantes. C’est pourquoi les organisations politiques que l’histoire du mouvement ouvrier a consacrées comme authentiquement prolétariennes (l’A.I.T. pendant la Commune de Paris, le parti bolchevik en 1917» le Spartakusbund en 1918-1919» par exemple) ont toutes été des organisations ultra-minoritaires pendant la quasi-totalité de leur existence. Le développement de leur influence ne s’est produit qu’au cours des phases avancées du mouvement révolutionnaire. En fait, seul le parti bolchevik connut un véritable épanouissement de son importance, du fait que le mouvement révolutionnaire du prolétariat russe fut le seul à vivre suffisamment de temps avant la défaite. Toutes ces organisations, sans exception,’ ont entendu en permanence les accusations de "sectaires", de "puristes romantiques", etc., de la part de partis que leur "tolérance" devait conduire hors du terrain de classe. Et il ne pouvait en être autrement.
L’intransigeance d’un Lénine en avril 1917 celle d’un Liebknecht en novembre 1918 demeurent parmi les plus grands exemples d’efficacité révolutionnaire dans le mouvement prolétarien. Et leur force ne leur venait pas d’un mystérieux talent pour "inculquer la conscience aux masses passives", ou d’un "magnétisme personnel", mais de leur capacité à exprimer clairement et sans concessions la volonté révolutionnaire qui mûrissait dans les entrailles de la classe, dont ils n’étaient qu’une fraction.
Si sectarisme veut dire intransigeance impitoyable envers tous les courants étrangers à la lutte historique du prolétariat, capacité à aller "contre le courant", quitte à se retrouver encore plus minoritaires lorsque les idées de la classe dominante aveuglent les travailleurs, alors toutes les organisations révolutionnaires ont été "sectaires".
Contrairement au lieu commun si cher aux "réalistes" de la bourgeoisie, la secte ne naît pas de la faiblesse numérique ou de l’intransigeance théorique, mais de l’incapacité à rattacher sa propre existence au mouvement réel, apparent ou non, qui anime la vie des sociétés.
Lorsque Lénine, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg se retrouvaient seuls, isolés, avec une petite poignée de révolutionnaires, mais combattant sans pitié ni faiblesse la gigantesque marée chauvine qui inondait le prolétariat européen embrigadé dans la première boucherie impérialiste mondiale, lorsqu’ils misaient sur l’inévitable réveil du prolétariat mondial, ils ne s’enfermaient pas dans une "secte". Les sectes ne pouvaient plus naître dans leur camp mais dans celui des défenseurs d’un système social qui venait de signer dans la plus horrible barbarie sa propre condamnation à mort.
Ceux qui ne voient dans l’intransigeance révolutionnaire que du "sectarisme" ne sont que ceux que 1» Histoire a définitivement condamnés à mourir dans des sectes.
Quant aux révolutionnaires, l’Histoire leur a appris que leur pensée est comme la révolution elle-même : elle est intransigeante ou elle n’est rien !
R. Victor
[1] Nous parlons ici des organisations minoritaires, fractions de la classe regroupant les révolutionnaires sur des positions politiques (groupes partis) et non des organisations unitaires de la classe (syndicats au XIX0 siècle, soviets) réunissant les membres de la classe de façon unitaire, sans autre critère que cel1u de la participation à l’action du prolétariat.
[2] "Pouvoir ouvrier", en 1968, a été une des seules organisations à avoir eu le courage de publier dans sa presse, dans des termes aussi clairs, un pareil raisonnement. Ce fut d’ailleurs dans le dernier numéro de son journal. Cela n’est pas moins le raisonnement implicite de l’ensemble des organisations gauchistes, professionnelles du syndicalisme de gauche.
[3] Le sentiment de révolte est commun à toute classe exploitée, mais dans le capitalisme, entre l’attitude de simple révolte et sa transformation en attitude révolutionnaire il y a l’écart qui sépare la petite-bourgeoisie du prolétariat. Seule classe à porter en elle le projet révolutionnaire de la nouvelle société, la classe ouvrière tend inévitablement à transformer sa révolte en œuvre révolutionnaire , constructive, ouvrant des perspectives infinies à l’humanité. Sa violence révolutionnaire demeure un moyen, jamais un but en soi. Incapable de véritable cohérence, révoltée essentiellement par la menace de disparition que fait peser sur elle le capitalisme, la petite-bourgeoisie sombre au contraire inévitablement dans le désespoir sans issue de l’impuissance. La violence pour la violence, caractéristique du mouvement petit-paysan, des petits commerçants et des étudiants n’a pas d’autre fondement.
[4] Nous ne disons pas que nous ne commettons pas d’erreurs sur d’autres points non encore élaborés. La conscience révolutionnaire n’est certes pas achevée. Mais ce que nous disons, c’est que la confusion sur les questions déjà réglées maintes et maintes fois par la pratique du prolétariat est devenue contre-révolutionnaire.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revolution Internationale N°09 - mai-juin (nouvelle série)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.7 Mo | |
| 1.73 Mo | |
| 729.3 Ko |
- 34 lectures
Luttes revendicatives et surgissement de la CLASSE-POUR-SOI
- 26 lectures
Ce texte de tendance s’inscrit dans la perspective ouverte par les articles "Où va la lutte de classe en France ?"(n°4), "Lip : combativité et mystification” (n°5), "Situation actuelle, perspectives et activité des révolutionnaires" (n°7) et "Leçons de la lutte des ouvriers anglais" (n°8). Il a été rédigé avant que nous prenions connaissance de l'article du camarade Victor, auquel une réponse sera faite ultérieurement.
Précisons tout de suite les points suivants :
1) Nous employons les expressions de "classe-pour-soi" et de "classe-pour-le-capital" non parce que ça ferait bien, mais parce que nous n'avons pas trouvé, pour l’instant, de meilleures expressions pour nous exprimer. Voici dans quel sens nous les utilisons :
La classe-pour-le-capital est la classe telle qu'elle est constituée par le rapport capitaliste. Concrètement, ce sont des hommes qui sont matériellement unifiés dans la production sociale, dans le travail associé, mais qui sont socialement divisés par leur rapport au capital (travail salarié) . Leur unité sociale leur est extérieure, ils la retrouvent dans une puissance étrangère : le capital. Ils ne constituent pas une classe pour eux-mêmes, mais c'est à travers le rapport capitaliste, pour le capital, qu'ils sont une classe. Ils sont effectivement unis par le fait très simple que le rapport salarial les contraint à pointer tous les jours à l'usine, à faire la queue au bureau de chômage ou à s'embrigader dans un syndicat. Mais cette unité pour le capital produit précisément leur division pour eux-mêmes (division du travail, parcellisation des taches, fragmentation par usine, par corporations* hiérarchie, division en productifs/improductifs, travailleur s/chômeurs, concurrence entre les ouvriers, etc.). La contradiction qui est le moteur du mouvement de maturation de la classe pour le capital est celle qui oppose leur être matériel unifié au rapport social qui le divise : rapport salarié. Pour se défendre comme ensemble d'hommes confrontés à des besoins matériels, ils se heurtent d'emblée au rapport salarié et doivent donc commencer concrètement à détruire ce rapport, c'est-à-dire à remettre concrètement en cause leur être-pour-le- capital.
La classe-pour-soi est à la fois la même classe et une classe différente. Elle est la même parce que son unité sociale repose sur les mêmes caractéristiques matérielles que celles caractérisant la classe-pour-le-capital (bien qu'elle commence à les bouleverser en réorganisant la production). Mais cette unité matérielle n' est plus une unité sociale pour le capital, elle l'est pour elle-même, pour ses besoins propres. Elle n'est plus classe du point de vue du capital, mais par sa propre action contre lui, qui est un mouvement de destruction du salariat par l'association des travailleurs. Cette action est un processus qui va de l'unification révolutionnaire des catégories du travail salarié (surgissements) à l’accomplissement de premières tâches rudimentaires du communisme inférieur et, après la victoire militaire à l’échelle mondiale, jusqu’à la communisation complète de la société, qui est la réalisation ultime de la classe-pour-soi et sa dissolution finale : la communauté humaine.
La classe-pour-le-capital, c’est les prolétaires soumis concrètement au rapport salarial, luttant et organisés comme travail salarié ; la classe-pour-soi, c’est les prolétaires refusant concrètement le rapport salarial, luttant et s’organisant de façon unie comme travail collectif et mouvement de communisation, donc tendant à englober dans leur classe toute l’humanité.
2) Ce que nous cherchons à cerner, ce ne sont pas des catégories fixes, mais des processus. Il va de soi que ce que nous dégageons sont des approximations théoriques. Dans la réalité, il y a effectivement des enchevêtrements, des retours en arrière et, par exemple, la classe-pour-soi ne se présente jamais de façon pure. De même que la négation du prolétariat, l’affirmation de la classe-pour-soi est, surtout au départ, une tendance qui se présente de façon confuse, balbutiante, non explicitée clairement. Cependant, ce n’est qu’à partir d’une compréhension de la rupture qu’on peut comprendre le mouvement et ses moments.
3) Pour la énième fois et une fois pour toutes, nous ne sommes pas "pour” ou "contre” les luttes revendicatives. C’est un faux problème. Les luttes revendicatives existent et sont nécessaires. Nous l’avons assez rabâché pour ne plus avoir à le répéter. Mais notre tâche est de comprendre et d’exprimer qu’elle doit les dépasser en les niant et en détruisant l’organisation qui y correspondait (les syndicats). Il n’y a pa^ comme le croient les trotskystes, de "dynamique des luttes". Les luttes ne se trans- forment pas ; les luttes ne font rien du tout, ce sont les hommes qui sont obligés de lutter de façon différente, c’est-à-dire pratiquement de se transformer. Nous ne "condamnons" ni ne "dédaignons" rien ni personne. Nous sommes partis d’une classe qui essaie de comprendre les conditions de sa pratique. De même que nous n’"appelons" pas à voter, ou à ne pas se syndiquer, ou à ne pas vendre sa force de travail, nous n'"appelons" pas à refuser les luttes revendicatives. Nous tentons seulement d’exprimer l’expérience historique et quotidienne de leur échec, la nécessité de leur dépassement, ce qui nous amène à affirmer la nécessité de détruire les syndicats, etc.
4) Nous avons définitivement abandonné les termes de luttes "économiques" et "politiques" qui ne font qu’embrouiller les choses et étaient la première forme confuse à travers laquelle nous avions tenté de saisir le processus.
L’IMPASSE DES LUTTES REVENDICATIVES
À l’époque de la décadence, le prolétariat ne peut plus s’unifier et s’affirmer en tant que catégorie économique pour le capital, travail salarié. Tant que les travailleurs luttent, se conçoivent et s' organisent dans le but d’aménager les conditions de la vente de la force de travail, ils se heurtent inexorablement aux limites inhérentes au rapport capitaliste (corporatisme, sectionalisme, nationalisme, concurrence). Le problème-clé, la division de l’être de la classe, n’est pas un problème de plus ou moins d’ouvriers en lutte. Une lutte de huit millions de prolétaires peut être parfaitement fragmentée et n’exprimer que l’atomisation du travail salarié (Mai 68 après quelques jours), alors qu’une lutte limitée géographiquement, à un quartier par exemple, et à quelques milliers de travailleurs, peut parfois être qualifiée de surgissement de la classe-pour-soi (certaines insurrections en Espagne, et Gdansk,..) Se contenter de critiquer le sectionalisme sans faire la critique de la lutte revendicative, c’est faire la critique d’une forme de lutte sans essayer de voir au-delà que c'est le sujet lui-même (le travail salarié) qui reproduit la division et la concurrence comme quelque chose qui est propre à sa nature et qui donc engendre cette forme. Le travail salarié, les ouvriers salariés se présenteront toujours, tant qu' ils n'auront pas enclenché un processus de négation de cet état, comme enfermés dans l'usine, la branche, le particularisme régional ou national, la hiérarchie, la division entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, entre les cols bleus et blancs, etc. La division de la classe n'est pas quelque chose qu'elle pourrait surmonter sans s'engager dans un processus de transformation d'elle-même. L’unification du travail salarié est une utopie réformiste. Vouloir que les travailleurs se posent comme échangistes d’une marchandise (la force de travail) tout en supprimant la concurrence, le protectionnisme et le particularisme dans leurs rapports est tout aussi impossible que l’unification du capital. Reprendre le slogan syndicalo-gauchiste de 1’"unité des luttes revendicatives", c’est sombrer dans l’illusion qu’on pourrait unifier ce qui est par nature divisé.
Il faut poser la question : si les ouvriers pouvaient s’unifier sur le terrain revendicatif, celui des luttes salariales, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des syndicats ? Si les syndicats, même créés par les travailleurs eux-mêmes, deviennent des instruments du capital, n’est-ce pas justement parce que le travail salarié est, à notre époque, complètement atomisé et que le rapport salarial ne peut plus être aménagé, négocié et encadré que par le capital lui-même et lui seul ? En ce sens, les syndicats sont des organes à travers lesquels le capital tente d’organiser le travail salarié. Les ouvriers ne s’organisent pas à travers eux ; c’est impossible, puisque le travail salarié ne peut plus s'unifier et s'organiser. Par contre, c’est vrai que les syndicats "organisent”, encadrent la force de travail dans le rapport salarié. Si la classe est contre les syndicats, c’est parce qu’elle se heurte à son embrigadement en travail salarié. Mais les ouvriers ne se battront pas "contre les syndicats”, ils les détruiront au passage, en s’affirmant contre le rapport salarial. Tant qu’ils restent ouvriers salariés, ils resteront, dans l'ensemble, "organisés" (c’est-à-dire atomisés, réprimés, étouffés) par les syndicats.
Cela est prouvé par les luttes ouvrières des dernières années. Dès que le processus d’unification de la classe-pour- soi s’épuise et que les ouvriers se replient, faute de pouvoir aller au-delà, sur des revendications, le syndicat, ancien ou nouveau, réémerge comme direction de la lutte et, à partir de ce moment, à moins d’un événement nouveau (répression policière, provocation, etc., l’unification qu’aurait pu provoquer le 14 août 1973 à Besançon, par exemple) qui crée les conditions d’un resurgissement du processus, c’est le déclin, plus ou moins chaotique mais inexorable. Dès que la lutte est posée comme moyen de pression des ouvriers pour aménager leur condition de travailleurs salariés, une place est offerte à un organe qui "négocie" la défaite et "organise", par la violence "démocratique" ou physique, le retour des prolétaires à leur division antérieure. À propos de la grève de Renault en 1947, "Internationalisme", dans son numéro du 15 mai, exprimait-on ne peut plus clairement l’impasse des grèves revendicatives :
- "La grève de Renault démontre une fois de plus l’impossibilité d’asseoir désormais les luttes du prolétariat sur une base économique. Les staliniens peuvent reprendre en main d’autant plus facilement le mouvement qu’il se confine dans les revendications économiques. C’est là une voie d’impasse uniquement favorable à la bourgeoisie qui; au travers des tractations et des marchandages, parvient à fourvoyer le mouvement. C’est sur ce terrain que le syndicat a ses racines solidement accrochées et sur lequel il est irremplaçable." (Souligné par nous.)
Et un peu plus loin : "Toute action menée sans direction syndicale et dans le cadre syndical ne peut en définitive être qu’une lutte contre la classe ouvrière[1]." (Souligné par nous.) (Voir note page 26)
Mai 68 est un autre exemple de ce processus. Dès que le mouvement d’unification, qui n’était essentiellement que 1’affirmation embryonnaire, silencieuse mais indéniable, de la classe-pour-soi, s’est heurté aux limites de sa propre immaturité, on a vu simultanément : 1) le cloisonnement par les syndicats de la lutte sur le plan revendicatif ; 2) l’isolement des travailleurs dans leurs usines transformées en prisons ; 3) l’unité des premières heures, forgée de manière informelle à travers l'initiative des plus avancés, voler en éclats : les ouvriers les moins combatifs sont restés chez eux et les plus combatifs se sont divisés en clans staliniens, cédétistes, gauchistes, pendant qu’ une infime minorité allait aux universités. Plusieurs aspects s’entremêlent dans la façon dont le caractère revendicatif fragmente la lutte :
- À partir du moment où il s’agit d'aménager les conditions du travail salarié, inconsciemment, mais parfois consciemment, les ouvriers tirent de leur expérience collective et individuelle un scepticisme extrêmement sain quant aux possibilités réelles d’améliorations .
- "0n n’obtiendra de toute façon pas grand-chose, donc autant ne pas s’attirer d’ ennuis, ne pas risquer l’aventure et laisser le représentant patenté du travail salarié faire son boulot.”
- Si la question est d’obtenir quelques revendications, les travailleurs tendent à se concevoir selon ce que le capital fait d’eux, c’est-à-dire non comme membres d’une force de travail associée mondiale, mais comme 0S2 de tel atelier, de telle usine, etc., ou comme chômeur français qui aurait du travail si les algériens n’étaient pas là, ou comme col blanc qui croit avoir échappé à l’enfer de la chaîne, etc. Par exemple, souvent ils pensent que leur force n’est pas dans une extension mais, au contraire, dans la position de force de tel ou tel groupe (voir le phénomène fréquent de catégories ou de branches qui n’acceptent pas de "noyer" leurs revendications dans les luttes d’ensemble, comme récemment dans la grève des banques où les services informatique ne comptaient que sur leurs positions strictement corporatistes, ou la métallurgie en juin 68 qui prolongea sa grève quinze jours de plus pour obtenir plus que les accords de Grenelle).
Nous pensons qu’il était nécessaire de préciser cela, qui n’était pas clair dans les articles que nous avons cités au début, ce qui leur donnait un tour parfois indéfini. Pour le reste, on peut renvoyer aux articles.
QU’EST-CE QUE L’UNIFICATION DE LA CLASSE-POUR-SOI ?
Il n’y a pas de définition statique et sociologique de la classe ouvrière. Le problème n’est d’ailleurs pas de ”définir” la classe ouvrière. Les classes ne sont pas définies, elles se définissent dans la lutte de classe. Au XIXè siècle, parce qu’une lutte de classe pour l’aménagement du rapport salarial était possible et relativement unificatrice, Marx et Engels ont misé sur un développement de la conscience et de l’organisation communistes au sein du mouvement syndical, c’est-à-dire sur un développement continu de la classe révolutionnaire au sein du mouvement de la classe-pour-le-capital. Leur vision était : en se définissant comme classe salariée aux intérêts distincts, les ouvriers tendent en même temps à se définir comme classe-pour-soi. Le passage de l'un à l’autre est continu. En se définissant comme classe au sein de la société bourgeoise, le prolétariat se prépare organisationnellement à la détruire. Cette vision détermine toute leur pratique : la classe peut se définir comme classe par rapport au capital. Au XXè siècle, au cours de la décadence, c'est le capital et la contre-révolution qui l’ont définie comme classe-pour-le-capital, complètement incapable de s’affirmer et de s'unifier comme travail salarié, ce qui exige d’elle qu’elle renverse brutalement ce rapport et se redéfinisse comme classe-pour-soi. La classe, au sens historique global du terme, est un mouvement de la classe pour-le-capital (travail salarié) à la classe-pour soi, qui s’affirme et se nie en même temps. Cela Marx le disait déjà; ce qui change à notre époque, c’est la forme que devra revêtir ce processus.
Dans la société capitaliste, la classe ouvrière se présente à la fois comme du travail salarié, un simple moment du rapport capitaliste (capital variable) et comme un ensemble d’hommes travaillant dans des rapports matériels donnés (travail associé, production de masse, rapports universels, etc.). Lorsque la contradiction entre les rapports sociaux capitalistes et ces rapports matériels éclate, les hommes qui vivent cette contradiction au cœur du système (les prolétaires) sont contraints, par l’échec répété des tentatives de se défendre comme catégorie du capital, de s'affirmer comme négation du travail salarié, comme un ensemble d'hommes qui se définissent non par le fait qu'ils vendent leur force de travail, mais par leur position matérielle. Tous ceux qui, parce qu’ils vendaient leur force de travail sous la domination d'une puissance sociale et mondiale, le capital, sont séparés des moyens de production, parce qu’ils travaillent de façon collective, associée -tous ceux-là tendent, sous la contrainte des conditions matérielles, à se défendre autrement.
Lorsque, sans revendications, sans organisation préétablie, poussés par un besoin irrémédiable, les travailleurs d’un atelier arrêtent le travail, partent en cortège dans l’usine et entraînent l’ensemble des ouvriers pris par une passion subite de s’affirmer comme une classe associée lorsque les ouvriers d’une usine sortent de l’entreprise, entraînent les badauds, les chômeurs, des couches semi-prolétariennes et appellent, sans aucune revendication, les autres travailleurs des autres usines à les rejoindre (Espagne) ; lorsque, au mépris de tout "sectionalisme”, ils attaquent des locaux syndicaux, des postes de police -c’est le début, le tout petit début de la classe- pour-soi.
La révolte n’est pas moins matérielle et sociale qu’une grève salariale ; ce qui change, ce qui s’affirme, c’est bien une classe (un ensemble d’hommes occupant une position déterminée par rapport aux moyens de production). Cependant, cette classe ne se définit pas à l’intérieur du rapport capitaliste, mais contre lui, et ce qu’elle affirme, c’est sa nature de classe matériellement et socialement collective, dépossédée, mondiale, et son besoin d’affirmer des rapports communistes inférieurs pour survivre.
Ce premier moment de la classe prolétarienne révolutionnaire est fragile, instable, comme une boule en haut d’une pyramide. D’une part, c’est une classe qui tend à se poser comme destructrice du rapport salarié, non que les prolétaires disent tous : "nous nous riions comme travail salarié", mais parce que la classe fait d’emblée reposer sa force sur une base qui est la négation de ce rapport (tendance à l’unité avec les chômeurs, à la destruction des barrières des entreprises, à l’"oubli" de toutes les caractéristiques du rapport salarié: hiérarchie, productifs-improductifs, consommation collective, production de valeurs d’ usage pour elle-même, etc.). D’autre part, cette classe reste, objectivement et subjectivement, modelée par la division du travail capitaliste et n’a fait encore que nier le rapport salarié, sans pourtant se transformer en transformant mondialement les rapports de production, les forces productives, etc. On peut donc dire qu’il s’agit de l’amorce du processus de la révolution. Jusqu’à présent, et peut-être encore pour longtemps, ces surgissements de la classe-pour-soi se cogneront très vite à cette contradiction et laisseront, après peu de temps, la place aux revendications (mai 68z Gdansk, Turin) ou seront écrasés militairement (Espagne, Cordoba, etc.). Le retour sur le terrain revendicatif, et donc syndical, n’est pas quelque chose à condamner, mais à comprendre: il exprime une impuissance, à la fois une lucidité sur l’absence de maturation de la classe et un retour aux illusions qui avaient été momentanément dépassées .
La classe-pour-soi est à la fois continuation de la classe-pour-le-capital et rupture avec elle. Continuation d’un point de vue matériel, parce que son noyau son élément moteur, la source d’où se diffuse la communisation de la société, recouvre, en général, ce qui était le cœur de la classe-pour-le-capital (travailleurs productifs concentrés dans la grande industrie moderne). C’est en effet là que le capital a accumulé une masse de capital constant gigantesque et des masses de travailleurs salariés, c’est-à-dire du point de vue communiste, c’est-à-dire de la valeur d’usage, les forces productives et l’association du travail, qui permettent l’amorce d’un processus de communisation immédiate de la production et de la consommation, qui tend à révolutionner à son tour, les forces productives et cette association en produisant autre chose que la merde actuelle et d’une autre façon. Continuité, maïs aussi rupture, parce que le rapport salarial qui enserrait la classe-pour-le-capital dans la logique de ce dernier, est brisé. Désormais, on a la plus grande contradiction qui puisse s’imaginer : une classe ouvrière qui n’est plus une classe définie par son rapport au capital et qui, dans ce sens, commence à se nier comme classe salariée en même temps qu’elle devient une classe pour elle-même; une classe qui s’affirme comme distincte du reste de la société et qui, pourtant, par le fait même qu’elle se définit comme un mouvement mondial , universel de socialisation, tend à englober toute l’humanité; une classe qui dit: "est prolétaire quiconque est prêt à travailler de façon associée et donc à consommer de façon socialisée”, c’est-à-dire une classe qui, au même moment, se limite et s’ouvre. C’est pourquoi on peut dire que la classe-pour- soi n’est pas seulement la destruction de la classe-pour-le-capital, mais également un mouvement simultané d’affirmation et de négation de soi. La classe-pour-le-capital était un mouvement sans cesse reproduit de prolétaires salariés. Désormais la tendance est renversée. La classe-pour-soi est un mouvement de création élargie de membres de la classe-pour-soi, de travailleurs associés et communistes (intégration des autres classes).
On nous dira : "Tout cela n’est vrai qu’après l’insurrection.” Il faudrait plutôt dire que ce mouvement ne prend son essor complet et libre qu’après l’insurrection mondiale, car s’il est vrai que c’est seulement après avoir violemment détruit l’État qu’il l’empêche de s’étendre et de prendre racine qu’il peut transformer matériellement les forces productives, le travail, universaliser les rapports communistes en incorporant à lui les secteurs précapitalistes -il n’en reste pas moins que ce qui détruit l’État, c’est CE mouvement vers le communisme et non le travail salarié. La vision classique était que le prolétariat resterait classe-pour-le-capital et s’organiserait de façon purement politique pour l’insurrection. En fait, pour avoir une politique révolutionnaire, il faut déjà qu’ il soit un mouvement social révolutionnaire une pratique consciente de transformation des rapports sociaux, qui tente de s’effectuer, un mouvement communiste.
La meilleure preuve que la classe-pour-soi est processus de négation du travail salarié dès qu’elle surgit sur la scène, c’est sa façon même de lutter qui dissout toute l’organisation de la classe-pour le-capital. Il faut, en surgissant, faire voler en éclats toute l’organisation antérieure. Pour étendre la lutte, même si les ouvriers manuels d’industrie restent le moteur de l’action, le noyau autour duquel se condensent les autres éléments de la classe-pour-soi (employés, chômeurs, ménagères, etc.), il faut "oublier" qui est ouvrier manuel ou intellectuel, productif ou non, syndiqué ou non, étranger ou non. Par exemple, la lutte militaire part des centres ouvriers mais englobe, en les fondant dans la classe-pour-soi, les chômeurs, les couches prolétarisées marginales (tous les sans-réserves). Il y a bien un noyau matériellement déterminé, une avant-garde pratique de la classe-pour-soi (ouvriers des grandes entreprises), mais ce noyau , en sortant du rapport capitaliste, tend, d’emblée, à précipiter" l’imminence du passage des classes moyennes au prolétariat"(Marx) en processus effectif. Concrètement, cela veut dire que le prolétariat ne demandera pas aux participants de la révolution s’ils ont un prix de leur force de travail à défendre ou des mains calleuses, mais s’ils sont prêts à participer à la lutte avec tout ce que cela implique: organisation militaire, participation à la production(d’armes, de nourriture) de façon communiste, participation à la distribution communautaire des valeurs d’usage. C’est ainsi que, dans la guerre civile mondiale, le prolétariat puise sa force de sa situation matérielle et de sa capacité à y attirer tous les éléments potentiels de la classe-pour-soi. Les usines restent le point de départ de l'action, mais ils sont les centres d’où s’effectue la destruction des usines comme entités juridiques séparées.
Le "danger” de "dissolution" du prolétariat dans la population non prolétarienne n’existe pas. Le vrai danger, c’est que le prolétariat n’arrive pas à se hisser à la classe-pour-soi, ce qui le contraindrait à passer des "alliances", des "fronts" avec les couches petites-bourgeoises, au lieu de commencer, à travers des taches militaires et sociales, à les assimiler aux rapports communistes. Cette dissolution-là ne serait que la dissolution dans les rapports marchands, la régression à l’état de classe-pour-le-capital, c’est-à-dire l’emprisonnement du prolétariat, travail salarié, dans la "population" de la société capitaliste. Le prolétariat ne peut s’affirmer qu’en commençant à se nier, c’est* à-dire à dissoudre dans les rapports communistes les couches semi-prolétariennes. Il n’a que l’alternative suivante: commencer à se dissoudre comme travail salarié ou être dissous comme classe révolutionnaire par le capital dans l’atomisation du travail salarié!
Cependant, à ce stade, le mouvement n’est qu’une tendance inachevée, incomplète qui ne peut se réaliser complètement. Très vite, l’unification de la classe-pour-soi entre en contradiction avec l’État, personnification du capital. C’est donc bien le mouvement social communiste qui ressent les superstructures capitalistes comme une entrave à son libre développement. Par exemple: on a distribué la nourriture des supermarchés, on a occupé les logements, on a commencé à produire pour la classe-pour-soi elle-même les biens de première nécessité, on a mis en place un rudiment de distribution gratuite(transports, gaz, électricité, etc.), mais ce processus fragile, mal coordonné, confus ne peut se généraliser aux autres secteurs, prendre véritablement son essor, s’unifier définitivement, sans se concentrer sur le terrain politique et ramasser toutes ses forces pour les diriger contre l’État capitaliste. C’est pourquoi le parti devra, au cours de la période révolutionnaire, indiquer à la fois la perspective d’une extension maximale des rapports communistes et celle d’ une préparation à la guerre civile, en liant indissolublement les deux aspects, car c’est de sa position matérielle que dépend la capacité militaire du prolétariat.
Derrière la vision de type social-démocrate classique: le travail salarié s’organise politiquement pour prendre le pouvoir puis, après l’"insurrection", commence à se nier, il n’y a pas seulement une conception purement "politique" du processus révolutionnaire et une incompréhension de la nature sociale de la révolution(dont la politique est un moment), il y a aussi une conception purement nationale de la révolution. Dès qu’on considère la révolution mondiale comme une guerre civile sociale et militaire, la séparation rigide et abstraite qu’on effectue "avant" et "après" l’"insurrection" s’évanouit. Le prolétariat impose sa dictature dans un ou plusieurs pays, une ou plusieurs régions, se trouve confronté à l’organisation de la production de la répartition, de la guerre, qu’il doit effectuer de façon communiste, lesquels rapports communistes embryonnaires étouffent dans le cadre local et sont en butte à la contre-révolution, ce qui mène à la nécessité de l’extension militaire de la révolution, laquelle permet le développement du mouvement communiste, etc. Ainsi 1’ internationalisme n’est pas une idée, un idéal, pour le prolétariat, il est un besoin qui découle de la nature même de son mouvement social. Le "danger" n’est pas que la révolution devienne sociale! Il est qu’ elle ne devienne pas assez sociale pour acquérir une force militaire invincible fondée sur l’unité matérielle de la classe- pour-soi, débarrassée de la fragmentation marchande. Au lieu de faire de l’ironie sur nos termes "philosophiques", que les camarades "concrets" nous expliquent comment l’organisation politique du travail salarié pourrait mener à bien une guerre civile mondiale. Une fois la guerre civile finie à l’échelle mondiale, alors débarrassé des taches militaires, le mouvement social trouve sa piste d’élan propre, son terrain de plein épanouissement: la planète et l’humanité.
LE PASSAGE DES LUTTES REVENDICATIVES DE LA CLASSE-POUR-LE-CAPITAL AUX SURGISSEMENTS REVOLUTIONNAIRES DE LA CLASSE-POUR-SOI
Définir la classe ouvrière seulement comme le mouvement de la classe-pour- soi sans montrer le processus qui forge la possibilité du surgissement de ce mouvement serait transformer le prolétariat en une idée. Nous avons essayé de montrer, dans l’article sur la Grande-Bretagne (RI n°8), quelle était la nature de ce processus: les ouvriers tentent de se défendre comme classe-pour-le-capital et devant l’échec des luttes salariales sont contraints de surgir comme classe-pour-soi. Puisqu’on a préféré nous chercher des poux dans la tête et caricaturer notre position en s’appuyant sur des formulations floues et maladroites au lieu de chercher à comprendre le problème que nous posions, voici quelques précisions.
A. - Le processus de maturation de la conscience à travers l’échec des luttes revendicatives n’est pas purement subjectif. Il est alimenté par le développement de la crise et par la nécessité matérielle de lutter autrement qui s’accumulent. Bien que cette maturation puisse sécréter des petits groupes d’ouvriers radicaux, annonciateurs des surgissements futurs, elle est essentiellement silencieuse et inconsciente ou préconsciente. Le processus n’est pas, comme on a voulu complaisamment nous le faire dire : les ouvriers se rendent compte explicitement qu'ils ne peuvent plus lutter sur le terrain salarial et décident de surgir . Il est : l’accumulation des défaites contraint, à travers un enchevêtrement inextricable de dégradation matérielle et sociale, de besoins exacerbés et insatisfaits et de conscience diffuse et latente, le prolétariat à utiliser le seul moyen qui lui reste pour satisfaire ses besoins : l’affirmation de la classe-pour-soi. Cette affirmation se présente au début sous la forme de feux de paille brefs, mais tendra de plus en plus à dévoiler son contenu communiste. Dans la classe-pour-le-capital, la conscience du processus de maturation est encore embryonnaire, non développée, fragmentaire, partielle, et trouve son expression la plus avancée, et donc la plus explicite à ce moment, dans les fractions communistes, et son expression implicite, atomisée et plus hétérogène dans la désertion des syndicats, les grèves sauvages, la méfiance à l’égard du capital, le cynisme envers le patriotisme, etc.
B. - Quand nous disons que la classe s’unifie en dehors du terrain revendicatif, nous ne décrivons pas une forme précise de lutte, mais nous explicitons l’essence du processus. Un surgissement peut apparaître à partir de n’importe quoi: 2 centimes, 20 centimes, une répression policière, un accident du travail, une décision du gouvernement, un événement politique, le meurtre d’un ouvrier ou, comme cela arrive très souvent, rien du tout : une rumeur, un chef qui insulte un ouvrier, et même un mot d’ordre syndical. Ce qui caractérise le mouvement de la classe-pour-soi, ce n’est pas ce qui le déclenche, mais que ce qui le déclenche est secondaire, fortuit -un véritable prétexte. Ce qui est frappant, c’est que même lorsqu’il subsiste une revendication, celle-ci passe à l’arrière-plan, et que l’énergie, l'"irréalisme", l’extension, les moyens mis en œuvre n’ont aucune commune mesure avec la revendication. Ces surgissements sont inéquivoques et il faut être un bonze syndical ou un nostalgique du passé pour ne pas déceler leurs traits caractéristiques: ou bien il n’y a pas de revendication ou bien tout le monde se fout des ”revendications” ; ce n’est pas que les besoins matériels ne s’expriment pas, au contraire, la révolte sociale, générale, exprime la seule véritable nécessité matérielle que peut ressentir la classe en tant que classe face à la dégradation de toute la vie sociale, c’est-à-dire la transformation des rapports sociaux. Et la classe tente de répondre à ses besoins matériels de la seule façon possible à notre époque, en étendant la lutte, en dépassant la fragmentation de la classe-pour-le-capital, en "oubliant” le rapport salarié et en s’affirmant de manière révolutionnaire, c’est-à-dire : communiste.
C. - Pour ceux qui lisent de travers, rappelons qu’il a déjà été indiqué ("Perspectives...", n°7) qu’il ne faut pas considérer qu’il y aura un seul surgissement, mais bien des cycles : luttes revendicatives / défaites de la classe-pour-le-capital / exaspération-apathie / surgissements de la classe révolutionnaire / nouvelles tentatives de se défendre comme travail salarié / etc. Nous n’avons formulé aucun pronostic sur la forme précise, le nombre et le rythme de ces cycles, car c’est impossible. Tout au plus pourrait-on avoir des hypothèses intuitives à ce sujet. Par contre, ce dont on ne nous fera pas départir, à moins de nous apporter des arguments sérieux, c’est de la discontinuité fondamentale, de la rupture entre classe-pour-le-capital et classe-pour-soi, travail salarié et négation du travail salarié. Ce qui est commun, continu, qui fait le "pont” entre la fin d’un cycle de luttes revendicatives et le début du mouvement de la classe-pour-soi, ce qui, dans la négation, assure l’identité de la classe, c’est la position matérielle du noyau (grandes usines, etc.) de la classe- pour-le-capital et de la classe-pour-soi, qui est le même. C’est la continuité dans la négation.
D.- Le rôle des fractions qui se disent communistes au sein du prolétariat est d’indiquer la perspective de cette rupture en explicitant le processus de maturation silencieux au sein de la classe. Si les révolutionnaires ne le disent pas, qui le dira ? Ils n’ont pas l’illusion qu’ils pourraient avoir une influence très large tant que la classe elle-même n’a pas entamé un processus de dépassement des combats salariaux, mais ils font partie du mouvement de décantation, l’accélèrent dans la mesure de leurs moyens et, surtout, accomplissent sérieusement leur fonction spécifique, qui reste essentiellement d’indiquer et d’approfondir ce que le mouvement dans son ensemble sera contraint de faire. Même lorsque ce travail reste sur tout théorique, ils sont pratiquement, activement une partie intégrante du mouvement qui se déroule dans les cerveaux et la pratique de millions d’hommes. Ceux qui en douteraient exprimeraient simplement leur mauvaise conscience de ne pas faire ce travail. Quant à la question de savoir s’il faut intervenir plus ou moins, où, comment, est une question qu’il ne leur appartient pas de résoudre abstraitement, mais que le mouvement leur impose. De même que le mouvement oblige tous les prolétaires à réfléchir à certains moments, à intervenir à d’autres, de même il impose aux révolutionnaires de doser leur activité "théorique” et "pratique" en fonction du moment de la lutte de classe. Là encore, les fractions communistes sont "coupées" de la classe lorsque celle-ci est coupée d’elle-même (division de la classe-pour- le-capital) . Les "révolutionnaires" sont isolés des "ouvriers" parce que les ouvriers sont isolés les uns des autres. Les révolutionnaires sont contraints à un travail de réflexion, de maturation, d’intervention réduite, comme toutes les fractions de la classe. Ceux qui ne le comprennent pas sombrent dans l’activisme, le volontarisme et l’organisation artificielle.
[1] Cette phrase très profonde éclaire la question des comités de grèves sauvages (organes temporaires qui se dissolvent après la lutte). S’ils agissent comme des organes de négociation, ils sont en fait des syndicats et se retournent contre la classe. Par contre, s’ils sont un moment dans le dépassement de la lutte salariale, alors ils ont une fonction pour la classe. La formation d’un comité de grève contre les syndicats existants exprime un moment contradictoire dans le processus de maturation de la classe-pour- le-capital : les ouvriers accèdent pratiquement à la conscience de la nécessité de détruire la forme syndicale, mais continuent à tenter de lutter comme travail salarié. Cette contradiction est insoutenable : soit le comité de grève se transforme en syndicat et c’est son arrêt de mort comme agent prolétarien, soit il se transforme en organe de la classe-pour-soi et son contenu change complètement. Le rôle des révolutionnaires n’est pas de préconiser ou d’encenser de tels comités, mais, lorsqu'ils naissent, d’œuvrer à ce que la classe les dépasse. Il n’y a pas de syndicat "anti-syndical". C’est très logiquement que les ouvriers de Renault, en 1947, étaient conséquents en exigeant que le comité de grève aille jusqu’au bout de sa logique d’instrument revendicatif : se transformer en un syndicat (le Syndicat Démocratique Renault, S.D.R., trotskyste).
Vie du CCI:
- Débat [21]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Revolution Internationale N°10 - juillet-août (nouvelle série)
- 25 lectures
Rubrique:
LES ELECTIONS CONTRE LE PROLETARIAT
- 54 lectures
LES GAUCHISTES TELS QU’EN EUX-MEMES
Une fois de plus, le terrain des élections s'est montré un excellent révélateur du caractère contre-révolutionnaire des groupes gauchistes de tout acabit.
Après les élections anglaises, où les gauchistes nationaux avaient appelé à voter travailliste après l'une des plus grandes grèves qu'a menée le prolétariat des mines, les élections françaises de mai 1974 ont permis aux gauchistes nationaux de se vautrer dans l'électoralisme.
La plupart des groupes gauchistes français, qui s'étaient développés depuis 1965, en partie sur leur opposition au soutien de Mitterrand par le PCF, lors des présidentielles, proclament ouvertement qu'"il faut voter Mitterrand", ancien garde des Sceaux sous la IVe République. Mieux, ils font spécialement campagne pour lui au second tour, en se glorifiant, comme l'affirmait L.O. après le premier tour, d'avoir ramené à la gauche les voix des ouvriers dégoûtés par le même Mitterrand. L'utilisation de la radio et de la télévision leur a permis de bavarder sans retenue sur la "démocratie pour tout le monde" (heureux patronat qui, grâce aux gauchistes, pourra exploiter très démocratiquement les ouvriers.), d'inviter , très sérieusement, Mitterrand à "ne pas faire à de compromis avec la bourgeoisie" (Krivine), de décréter sans rire que le socialisme c'est "l'égalité devant la loi et l'argent" (Laguiller).
Il n'y a là nul "opportunisme" des gauchistes, à qui l'électoralisme ferait perdre leurs principes révolutionnaires. Le terrain pourri des élections a mis à nu leur nature d'agents de la bourgeoisie. Contrairement à ce qu’affirment les journalistes du "Prolétaire", ces théoriciens professionnels du gauchisme, les organisations gauchistes, comme L.O., n'"abandonnent pas le marxisme", n'ayant jamais été sur son terrain. On ne peut pas plus les taxer de "centristes", une organisation ne pouvant avoir une double nature de classe. Quant à l'opportunisme, dans le sens donné par Lénine, c'est une maladie grave qui ne peut se manifester que dans le camp prolétarien. Les gauchistes, sans aucun "opportunisme", ont fait très bien leur travail en poussant les ouvriers combatifs vers les urnes. Remercions- les pour leur campagne : gageons qu'elle amènera les ouvriers avancés à comprendre la nature capitaliste du gauchisme !
POURQUOI ROUVRIR LE DEBAT ?
Depuis longtemps, en effet, la question des élections n'en est plus une pour les révolutionnaires. La Commune de 1871 puis la vague révolutionnaire des années 1917-21 ont montré, dans la pratique, non seulement que la dictature prolétarienne devait nécessairement passer par la destruction du parlement, rouage de l'Etat bourgeois, mais encore que le parlementarisme dit "révolutionnaire" et, plus généralement, toute participation aux élections ne sont qu'un substitut à la lutte de classe, empoisonnant le prolétariat d'illusions démocratiques. Le passage des partis communistes a la contre-révolution, accéléré par leur "parlementarisme révolutionnaire", devait prouver, ainsi que les gauches italienne, allemande et hollandaise des années 1930 le soulignèrent, puis, avec force, "Internationalisme" après la deuxième guerre, que désormais l'antiparlementarisme, la non-participation aux élections, était une des frontières de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises.
Nous n'avons nullement l'intention d'ouvrir une polémique avec les gauchistes pour leur montrer qu'ils sont dans l'"erreur". Ils n'appartiennent pas au camp du prolétariat, et contrairement aux utopistes, nous né pensons pas que l'on puisse gagner la bourgeoisie -fût-ce sa fraction la plus à gauche- aux idées révolutionnaires. Nous ne devons pas cesser de combattre ceux dont le rôle est d'entraîner le prolétariat sur le terrain de prétendues "réformes". Nous devons dénoncer sans pitié devant le prolétariat cette "opposition de Sa Majesté le Capital", qui voit dans les élections une soupape de sûre- té -rêvée au mécontentement ouvrier, et invite donc les prolétaires à "manifester leur mécontentement", "avertir la bourgeoisie"...
Si nous remettons sur le tapis la question des élections, c'est que dans la période révolutionnaire qui s'annonce, une fraction du prolétariat révolutionnaire peut être amenée, faute d'une continuité organique avec le passé révolutionnaire de sa classe, à envisager une intervention sur le terrain des élections. Le mythe de la "tribune" (utilisation de la radio et de la télévision pour une "propagande révolutionnaire") risque de faire encore -du moins au début de la révolution- des ravages dans les rangs du prolétariat. Mais le danger le plus grave que court le prolétariat, au cours de la révolution, est encore son envoi de députés dans des formes rénovées et camouflées de parlements, par la transformation des soviets, organes de lutte du prolétariat, en assemblées consultatives dominées par les réformistes : "communes" locales rattachant le prolétariat à sa localité. Le "Grand Conseil ouvrier" de Budapest, en 1956, n'était qu'un parlement camouflé en conseil ouvrier, dont le but était de diluer la classe ouvrière hongroise dans la bourgeoisie et la petite-bourgeoise, derrière des mots d'ordre patriotiques. C'est ce qui faillit se produire en Russie avec les mencheviks jusqu'en septembre 1917 ; c'est ce qui se produisit effectivement en Allemagne, où la social-démocratie se chargea de transformer les conseils en chambres d'enregistrement de sa politique contre-révolutionnaire. C'est la maturité, la haute conscience de sa mission historique qui permet au prolétariat de donner un sens révolutionnaire au fait qu'il délègue ses pouvoirs à des députés ouvriers.
Voilà pourquoi notre position sur les élections -déjà abordée en détail dans R.I. n° 2, nouv. Série- doit être de nouveau affirmée. Avant de voir pourquoi les élections ne sont plus un terrain ou une tribune pour les ouvriers, il est nécessaire d'éclairer la question de l'antiparlementarisme, et donc de 1'abstentionnis me, à la lueur de l'expérience du prolétariat.
LA QUESTION DES ELECTIONS AU XIXe SIECLE
Au XIXe siècle, le parlement était le centre de la vie politique bourgeoise : c'est là que légiférait la classe dominante. Le prolétariat, à l'époque où le réformisme était possible non seulement, mais un mal inévitable, pouvait jouer des rivalités au sein de la bourgeoisie pour faire passer des réformes permettant d'améliorer sa position au sein du système capitaliste. Alors que le prolétariat se développait en nombre, les élections permettaient à la classe de se compter, de prendre conscience de sa force et de sa différence d'avec toutes les autres classes. Sur la participation aux élections, l'accord était total entre réformistes et révolutionnaires. Les révolutionnaires, eux, mettaient en garde sur le danger de corruption représenté par le parlement : ils dénonçaient le "crétinisme parlementaire", le parlement dont le rôle était de régulièrement "représenter" et "fouler aux pieds" la population laborieuse. De toute façon, pour les marxistes, le parlement était secondaire par rapport au terrain de la lutte de classe. C'était un mal inévitable en l'absence de luttes révolutionnaires, auquel le prolétariat payait un lourd tribut par des compromissions en tout genre. Seuls les anarchistes étaient par principe contre toute participation aux élections. Pour les "individualistes" dont la devise était "Ni Dieu, ni maître", le prolétariat qu'ils considéraient non comme une classe mais comme une somme d'individus, ne pouvait être représenté, d'après eux. Les partis sociaux-démocrates, en déléguant des députés au Parlement, aliénaient la volonté individuelle de chaque ouvrier. Les bakouninistes pensaient que la révolution était à tout moment à l'ordre du jour, appelaient au boycott du Parlement, et à la "propagande par le fait". En fait, la raison majeure de leur abstentionnisme était leur opposition à la formation du parti politique du prolétariat et à toute lutte politique pour le pouvoir.
Après 1914, lorsque le prolétariat rejette le Parlement, la non-compréhension du changement de période devait permettre à l'IC de qualifier d'"anarchistes" les gauches italienne et allemande, oubliant ce que disait Lénine de Kautsky, que "l'une des méthodes les plus sournoises de l'opportunisme consiste à répéter une position valable dans le passé" ("Le renégat Kautsky").
En effet, après 1914, avec la crise historique du capitalisme s'affirme le déclin du Parlement. Le centre politique de la bourgeoisie se déplace du législatif vers l'exécutif (Etat fort ou dictatorial). Les révolutionnaires sont unanimes pour reconnaître que l'alternative est désormais : socialisme ou barbarie; l'ère du réformisme est définitivement close; le prolétariat ne peut plus obtenir de réformes, ni par le syndicat, ni par le parlement qui devient l'ultime mystification de la bourgeoisie (Assemblées constituantes en Russie et en Allemagne).
Sur cela, les révolutionnaires étaient d'accord : le débat devait porter sur ce que Lénine appelait la "tactique". C'est sur cela que vont s'affronter bolcheviks et gauches européennes.
LE DEBAT DANS L'I.C.
Position des bolcheviksLes bolcheviks, contrairement aux gauchistes qui se revendiquent d'eux, a-
vaient, lorsqu'ils défendaient l'idée d'un "parlementarisme révolutionnaire", le souci constant de dénoncer le rôle du Parlement comme instrument de l'Etat bourgeois; leurs tracts les plus durs allaient contre le crétinisme parlementaire des sociaux-démocrates auxquels ils opposaient l'exemple de Liebknecht dénonçant en pleine guerre l'impérialisme allemand.
Leur position était d'ailleurs déterminée par la lutte de classe : en 1906, ils appelaient au boycott de la Douma, alors que la vague révolutionnaire de 1905 n'était pas encore tombée; en 1907, début du recul du prolétariat russe, ils envoient des députés à la même Douma. En Septembre 1917, ils se retirèrent du Pré-parlement. C'est le reflux de la vague prolétarienne dès 1920, qui les amena à remettre à l'honneur, au IIe Congrès de l'I.C., l'idée du "parlementarisme révolutionnaire", totalement absente au 1er Congrès.
Mais, ne comprenant pas que la nouvelle période entraînait l'abandon du terrain des élections, les bolcheviks et l'IC reprirent intégralement la vieille idée social-démocrate du Parlement, arène de la lutte de classe : "..., les intérêts et les conflits de classes se reflètent dans le Parlement" (Lénine). On pouvait entendre de la bouche de Lénine, au IIe Congrès, ceci : "... l'on peut tendre à détruire une organisation en y entrant (sic), en l'utilisant".
De détruire de l'intérieur, à la conquête du Parlement,... il n'y avait qu'un pas... vite franchi. D'abord la dénonciation des sociaux-démocrates comme piliers du capitalisme, se transforma très rapidement en collaboration de classe avec la social-démocratie ("gouvernement ouvrier" en 1923 en Allemagne); le "parlementarisme révolutionnaire" du IIe Congrès ne fit qu'ouvrir la voie au frontisme du IIIe Congrès dont se revendiquent, à juste titre, les gauchistes d'aujourd'hui.
La rapide mainmise des Cachin, Smeral, Lévi, sur les P.C., la prépondérance des chefs parlementaires "communistes" à la tête des partis transformèrent rapidement les nouveaux partis en bouges électoraux. Tel fut le haut fait du parlementarisme révolutionnaire.
Position des gauches communistesC'est contre cet abandon du terrain de classe que réagirent les gauches italienne, et surtout allemande et hollandaise.
Les gauches communistes insistaient sur le changement de période : le prolétariat ne pouvait plus employer les mêmes méthodes de lutte que par le passé. Il s'agissait de choisir entre préparation électorale et préparation révolutionnaire, dans le cours descendant du capitalisme qui ouvre la voie à la révolution mondiale. C'est ce que sentait Bordiga, même s'il limitait la non-utilisation du Parlement aux pays capitalistes avancés, lorsqu'il déclarait dans les "Thèses de la gauche italienne", présentées au IIe Congrès :
- "Dans la période historique actuelle (ouverte par la fin de la guerre mondiale, avec ses conséquences sur l'organisation sociale de la bourgeoisie; par la révolution russe, première réalisation de la conquête du pouvoir par le prolétariat, et par la constitution de la nouvelle Internationale en opposition au social-démocratisme des traîtres) et dans les pays où le régime démocratique a depuis longtemps achevé "sa formation, il n'existe plus, au "contraire, aucune possibilité d'utiliser la tribune parlementaire pour l'œuvre révolutionnaire des communistes, et la clarté de la propagande non moins que la préparation efficace de la lutte finale pour la dictature exigent que les communistes mènent une agitation pour le boycottage des élections par les ouvriers".
(On voit qu'à l'époque, il ne se trouvait pas de savants littérateurs "bordiguistes" pour disserter sur l'invariance du marxisme de 1847 à nos jours, sur la continuité "invariante" de la "tactique").
Néanmoins, c'est la gauche allemande qui avait la vision la plus claire; elle voyait très bien que la période ouverte par 1917 était celle du combat des masses prolétariennes donnant le meilleur d'elles-mêmes, et non plus celle de la social-démocratie (celle du jacobinisme de "Que Faire ?"), où des "chefs ouvriers" se substituaient à l'action des masses et discutaient avec les autres classes au sein du Parlement.
- "Le parlementarisme est la forme typique de la lutte par le moyen des chefs "où les masses elles-mêmes jouent un "rôle secondaire. Sa pratique consiste dans le fait que des députés, des personnalités particulières mènent la lutte essentielle. Ils doivent, par conséquent, éveiller dans les masses l'illusion que d'autres peuvent mener la lutte pour elles..."(Pannekoek).
La révolution mondiale demande que le prolétaire s'engage totalement, sans déléguer sa force vive à des chefs, pour s'émanciper par ses propres forces :
- "Vient la révolution. Maintenant (le prolétariat) doit faire tout par lui-même. L'ouvrier doit lutter seul avec sa classe contre le formidable ennemi, doit mener la lutte la plus terrible qui se soit jamais vue au monde... S'il fait confiance à ses chefs ou à d'autres classés au Parlement, un grand danger le menace : qu'il retombe dans "son ancienne faiblesse en laissant "agir les chefs, qu'il s'en remette à "son Parlement, qu'il se confine dans "la fiction selon laquelle d'autres "peuvent faire la révolution pour lui, "qu'il poursuive des illusions, qu'il "reste enfermé dans l'idéologie bourgeoise" (Gorter."Réponse à Lénine").
Cette position intransigeante de la gauche allemande ne fut pas tenue avec la même fermeté de principe par la gauche italienne.
Contrairement à ce que la gauche italienne affirmait et encore maintenant ses pâles épigones du P.C.I., il ne s'agissait nullement d'un débat sur l'utilisation tactique du Parlement, mais bien de la question de principe de la non-participation aux élections. A l'heure où le prolétariat révolutionnaire se moque bien de ces subtilités "tactiques", cette question devenait le point de rupture entre communistes et sociaux-démocrates reconvertis de fraîche date au communisme. N'en déplaise au P.C.I., la gauche italienne reconnaissait que c'était malgré tout une question fondamentale, ne serait-ce qu'en se constituant en fraction abstentionniste (1919). La soumission de Bordiga à l'I.C. allait entraîner la participation du P.C. d'Italie aux élections et précipiter la dégénérescence de ce parti. Qu'on en juge par cette proclamation de Bordiga lui-même (1924} qui flaire l'électoralisme le plus grossier :
- "Tout bon communiste n'a qu'un devoir : c'est de combattre... la tendance à l'abstention de nombreux prolétaires, conclusion erronée de leur hostilité au fascisme. En agissant ainsi, nous ferons une excellente propagande et nous contribuerons à former une conscience résolument révolutionnaire..." (Stato Operaio. Février 1924).
Telle était 1'utilisation "conséquente" -mot qu'affectionnent particulièrement les bordiguistes pour les zig-zig de leur invariance- du parlementarisme révolutionnaire : ramener les prolétaires combatifs et révolutionnaires sur le terrain électoral.
Il faut sans doute voir là l'origine de l'électoralisme du P.C.I. qui se présenta aux élections de 1948 en Italie (voir Bulletin d'Etude et de Discussion n° 7) tout en se déclarant par principe abstentionniste. Jusqu'à il y a peu de temps, le P.C.I. n'était plus pour le parlementarisme révolutionnaire, sauf ... "chez les peuples de couleur", "dans les pays où la révolution bourgeoise est encore en cours et où le parlement conserve son caractère originel d'institution anti-féodale et donc historiquement révolutionnaire (Russie 1917, pays coloniaux arriérés de 1920 et en partie d'aujourd'hui)". Mais la vertu des élections italiennes récentes, a ramené les courageux partisans de l'abstentionnisme sur le terrain des urnes : à l'occasion du referendum sur le divorce, "Programme Communiste" (n°9) a appelé les prolétaires à se prononcer en faveur du divorce sans appeler à voter. Le plus comique était que la section française du P.C.I., apparemment ignorante de ce fait, ou peu soucieuse d'en faire part aux lecteurs du Prolétaire, au même moment jetait ses foudres sur l'électoralisme des gauchistes. Vérité au-delà des Alpes, erreur en deçà. ? Nous attendons le point de vue "officiel" du P.C.I., qui n'a plus d'"international" que le nom et apparaît au grand jour comme une fédération de sections social-démocrates, cédant de plus en plus aux préjugés du prolétariat local[1].
LES ELECTIONS, NEGATION DE LA CLASSE OUVRIERE
L'expérience faite par le prolétariat des élections, il devait la payer chère dans les années 1930 : utilisation des élections pour l’embrigader dans la guerre (fronts populaires français et espagnol) comme chair à canon.
Le caractère totalitaire des élections est confirmé par la tendance mondiale à rendre obligatoires les élections tout comme les syndicats,(Belgique, pays du Tiers Monde légalement; pays à capitalisme d'Etat dans les faits). Ainsi partout a été mis en place le mécanisme de la démocratie bourgeoise. Les bourgeoisies qui proclament, en France, que le vote est plus un devoir qu'un droit, sont parfaitement conscientes du rôle mystificateur, totalitaire du vote dans le prolétariat. Les journalistes bourgeois qui se réjouissaient de l'exceptionnelle participation électorale pour le second tour des présidentielles étaient plus futés que tous ces théoriciens du "vote de classe", "utile", "révolutionnaire", "ouvrier", etc. Giscard aussitôt a d’ailleurs accordé le vote à 18 ans, revendiqué par le P.C. et les gauchistes.
Beaucoup diront : c'est vrai; mais malgré tout le vote est un signe du degré de la lutte de classe. Nous répondrons qu'on ne saurait tirer aucun argument de ce que les ouvriers votent en masse ou ne votent pas : cela peut montrer aussi bien une démoralisation profonde du prolétariat qu'une remontée de ses luttes et de sa combativité. La signification du vote global des ouvriers n'est que le reflet déformé du moment (recul ou remontée des luttes du prolétariat) . Avant toute chose, le vote des ouvriers ne peut que refléter les illusions profondes de leur classe sur la démocratie, ou leur attachement aux traditions électorales.
Mais avant toute chose, l'électoralisme est la négation absolue de la classe ouvrière. Même s'ils croient s'exprimer par le bulletin de vote (pour exprimer leur mécontentement), les ouvriers sont mystifiés enfermés, individu par individu, dans un isoloir, ils ne font qu'exprimer leur impuissance. En effet, le prolétariat, classe atomisée par la division du travail au sein de la société capitaliste (usines, ateliers, avec toute la hiérarchisation qui l'accompagne (qualifications) voit son atomisation renforcée par tout le jeu de la démocratie bourgeoise. Alors que même en l'absence des luttes revendicatives, même écrasé, le prolétariat existe en soi au sein de la société capitaliste, les élections ont pour fonction d'en faire une masse d'individus, atomes isolés, des "citoyens" privés de leur qualité de prolétaires. Le vote ne fait qu'isoler le prolétaire de sa classe, en fait un esclave docile prisonnier de la mystification démocratique, un "citoyen" comme les autres lié à sa "nation" à un prétendu intérêt commun, celui du capital national.
Le vote donne carte blanche à la bourgeoisie pour sa politique. C'est les élections de 1933 qui ont permis à Hitler de parachever le massacre du prolétariat allemand commencé par ses collègues sociaux- démocrates 'en 1919-1923. Les élections sont la corde que donne la bourgeoisie au prolétariat pour se pendre. Telle est la fonction du vote aujourd'hui : l'égalisation démocratique du pouvoir bourgeois. Noyés dans, un cloaque de bourgeois, épiciers, cadres, etc. le vote ne saurait permettre aux ouvriers révolutionnaires de se compter. Il y a tout un monde entre l'individu ouvrier qui vote et l'ouvrier qui lutte, participe à des grèves sauvages (ce sont parfois les mêmes ouvriers combatifs qui peuvent voter à droite) Le vote rend inconscient de sa force l'ouvrier le plus combatif.
Le mensonge de la "tribune"Mais le fin du fin de la justification de la participation aux élections, est de dire qu’on n’appelle pas à voter mais qu'on fait campagne pour utiliser la "tribune" des moyens de diffusion bourgeois.
Supposons une organisation qui aujourd'hui n'appellerait pas à voter mais se présenterait pour dénoncer impitoyablement le capital et ses agents (P.C., gauchistes): elle ne saurait être entendue en période de non-surgissement du prolétariat; pour se faire entendre, il faudrait faire des compromissions, pour se faire "comprendre", et donc flatter les préjugés des ouvriers. Se présenter aux élections, en période révolutionnaire où le prolétariat se lance dans l'action les armes à la main, relèverait d’une pure trahison.
Mais surtout, parler d'agitation, de "tribune" dans des périodes où le prolétariat ne se manifeste pas comme classe, est une mystification: les révolutionnaires, ultra-minoritaires en temps de calme social, d'intégration du prolétariat au capital par les syndicats, ne peuvent agiter que du vent! L'agitation des révolutionnaires ne peut plus s'effectuer que dans la lutte révolutionnaire de la classe, dans les usines et dans la rue. Mais le caractère le plus frappant de cette "tribune", c'est qu'elle est une tribune de théâtre dont on présente les marionnettes aux prolétaires, derrière l'écran d'une télévision.
Le jeu est réglé d'avance avec ses personnages principaux (Giscard, Chaban, Mitterrand) et ses bouffons (Dumont, Laguiller, Le Pen). Pour faire sérieux, tout doit donner l'impression de liberté, de démocratie - : on peut voir Krivine parler de révolution, de communisme; Arlette dénoncer la misère et l'exploitation et (démocratie oblige) les "abus" de la police. Dumont, bouffon attitré, peut faire son numéro de clown sur l'écologie. Tout ce bric-à-brac à idées et ce clinquant de liberté démocratique doivent donner l'impression au prolétariat que les élections c'est à la fois beau et sérieux. En effet, tout cela a pour fonction d'endormir la conscience du prolétaire devant son poste de télévision : au XIXe siècle, la religion était la consolation du prolétariat; au XXe, à l'époque où la religion ne fait plus recette, les élections — ce petit moment où surgit la politique au-delà de l'usine quotidienne — constituent le nouvel opium du prolétariat.
C'est pourquoi, dans ce ballet réglé à l'avance par la bourgeoisie, de prétendus révolutionnaires qui feraient campagne (même sans appeler à voter), ne pourraient que compléter le théâtre de marionnettes de la bourgeoisie; ils donneraient l'impression au prolétariat que, malgré tout, même s'ils disent la vérité ("Arlette dit la vérité" se disent les ouvriers, bien illusionnés sur le caractère révolutionnaire de la propagande de celle-ci), la "démocratie bourgeoise" du bon. Même les rouges peuvent s'exprimer !
LES REVOLUTIONNAIRES NE SONT PAS « ABSTENTIONNISTES »
Cependant, si la non-participation aux élections est une position active dans le camp révolutionnaire, elle ne saurait être un label de classe. Il suffit de rappeler que les gauchistes, unanimement, boycottèrent les élections de Juin 1968. Demain, si la classe ouvrière déserte le terrain électoral, les gauchistes se proclameront abstentionnistes pour ne pas se démasquer devant le prolétariat. On a pu voir d'ailleurs, lors de ces dernières élections présidentielles, maoïstes et anarchistes rivaliser d'abstentionnisme : 1'Humanité Rouge qui n'a de rouge que le sang des ouvriers massacrés par ses ancêtres staliniens, dénonçaient en Mitterrand un mauvais -patriote "bradant l’indépendance nationale au profit du social-impérialisme soviétique" (ce qui est faux, étant donné les sympathies atlantistes de Mitterrand); "Front Rouge" fort marri de n'avoir pu présenter son super patriote F.T.P., André Roustan, appelait aussi à l’abstention. Idem pour les francs- maçons et bourgeois libéraux du Monde Libertaire qui titrait "Elections, piège à cons", "oubliant" son soutien électoral au Front Populaire espagnol de 1936. En fait, ce qui déterminait anarchistes et maoïstes, c'était l'espoir de recruter les éléments dégoûtés par l'électoralisme des trotskystes et non des principes politiques. (Le plus comique de la campagne présidentielle aura été de voir les jeunes U.J.P. appeler à 1'abstention!).
Tout cela montre que les révolutionnaires ne peuvent en aucun cas se définir comme abstentionnistes, comme le faisait la gauche italienne en 1919. Aujourd’hui, faire campagne pour l'abstention ne ferait que donner une valeur au vote et même indirectement rentrer dans le grand jeu électoraliste par le décompte des "voix" abstentionnistes. Les communistes se battront bec et ongles en période révolutionnaire contre la gauche et les gauchistes qui manœuvreront tout ce qu'ils pourront pour amener les ouvriers à voter; à ce moment-là, les révolutionnaires et leur classe boycotteront par la violence les urnes; il n'y aura là aucune position abstentionniste qui, comme l'indique le terme, est purement défensive et passive.
Contrairement à ce que certains pourraient croire, nous ne nous définissons pas comme antiparlementaires, anti-syndicats ou anti-luttes de libération nationale. Les révolutionnaires ne peuvent se définir comme "anti-quoi que ce soit". Ils ne sont pas une collection de positions, même si des positions de classe, chèrement acquises par 1e prolétariat, permettent de les distinguer des agents gauchistes du capital. Les révolutionnaires sont une cristallisation consciente, organisée, du combat sans merci qui conduira le prolétariat à s'affirmer mondialement par la destruction politique de la bourgeoisie, ouvrant ainsi le règne de la société sans classes délivrée de l'esclavage salarié.
Chardin
[1] "Il s'agit de dire à la poignée de prolétaires que nous touchons par notre presse et notre intervention orale qu'il n'est pas indifférent (sic) à nous communistes que les prolétaires puissent ou ne puissent pas divorcer".(Programme Communiste n°9).
De plus en plus le P.C.I. apparaît comme une secte gauchiste trouvant au prolétariat des "acquis" à défendre (divorce) dans la société capitaliste, abandonnant l'abstentionnisme pour l'électoralisme honteux et le frontisme le plus vigoureux.
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La bourgeoisie face à la crise (1ère partie)
- 15 lectures
Nous commençons ici la publication d'un article du groupe Internationalism de New York où il est principalement question des effets de la crise mondiale sur les économies des États-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale, et de la réponse que tentent d'y apporter les diverses bourgeoisies. Dans l'article "Crise économique et capitalisme d'État en Amérique du Sud ("Internationalism" n° 1) étaient analysées la crise et la réponse de la bourgeoisie dans le Tiers Monde. Cette analyse fut poursuivie avec l'article "l'irrésistible Chute d'Allende" ("Internationalism" n° 4). Dans des numéros ultérieurs d“Internationalism", il est prévu une analyse de la manière dont la crise affecte la Russie, les pays d'Europe orientale et la Chine.
La crise est là. Le premier trimestre de 1974 a été tellement désastreux pour l'économie américaine que la bourgeoisie elle-même a dû, pour décrire cette situation, utiliser un terme banni du vocabulaire capitaliste depuis trente ans, le mot : crise. La production globale, ainsi que l'indique le PNB, est tombée à - 5,8 % l'an ; les prix à la consommation ont monté au rythme de 14,3 %, et le chômage grimpe à 5,1 %, selon les données officielles, qui masquent une part importante du chômage réel.
Partout, la crise sape les bases fragiles de l'édifice capitaliste. Ses trois principales manifestations sont :
- chute de la production,
- chômage croissant,
- inflation galopante.
Les fluctuations du PNB ne peuvent en aucun cas donner une image précise des variations dans la production ; de telles données néanmoins peuvent indiquer la tendance générale vers la stagnation ou la baisse de la production qui frappent le monde capitaliste. Les graphiques suivants illustrent la détérioration des capitaux américains et japonais.
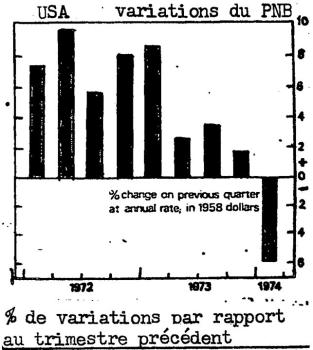
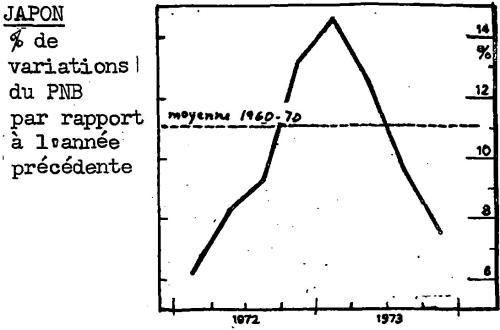
Le gouvernement japonais compte sur une croissance du PNB de 4,5% pour 1974. Mais, bien qu'un tel taux soit bien au-dessus de ce que les économies américaines et ouest-européennes à bout de souffle peuvent donner, il ne sera pas suffisant pour empêcher l'économie nipponne -habituée à un taux de croissance supérieur à 10 %- de tomber en vrille. La "croissance" au taux espéré ne sera pas assez forte pour éviter de sérieuses dislocations dans l'économie, un déferlement de banqueroutes et de luttes sociales. En Grande-Bretagne, le Trésor prévoit une baisse du PNB de 1% pour 1974, tout en misant sur une reprise de l'activité industrielle au cours du second semestre.
Le chômage .progresse à un rythme alarmant dans tous les pays capitalistes avancés. En Allemagne fédérale, il est passé de 273.000 chômeurs en 1973 à 517.000 en avril 1974. En France, il a grimpé de 210.000 en décembre 1969 à 430.000 en janvier 1974. En Grande-Bretagne, un rapport de l'institut national de recherche économique et sociale publié à la veille des élections générales prévoyait de 600.000 à un million de chômeurs pour la fin de l'année, sans tenir compte d'une éventuelle dégradation imprévue de l'économie. L'un des principaux porte-parole du capital britannique, le journal "The Economist", écrivait que "raisonnablement, le chômage pourrait même atteindre un million et demi de travailleurs l'hiver prochain, soit 6% de la force de travail" (6/4/1974).
L'inflation galopante a atteint des proportions catastrophiques dans les pays avancés. La bourgeoisie semble impuissante à contenir une inflation qui s'étend à une allure qui, jusqu'à présent, était le lot des pays sous-développés. Le Japon est le plus durement touché :
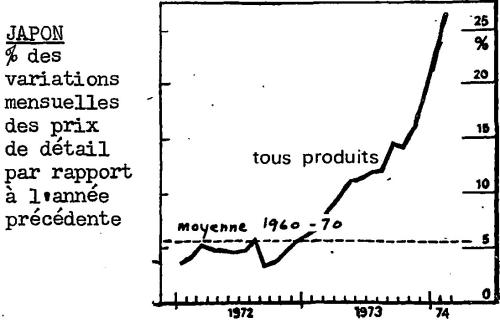
En Grande-Bretagne, les prix de détail augmenteront de 14 à 18% en 1974 ; et la situation présente mène à penser que cette estimation sera un minimum. En Allemagne, on prévoit un taux d'inflation de 10%, au Danemark il tourne maintenant autour de 16% l'an, et l'Italie semble tenir la tête avec un taux entre 18 et 20%. En France, pour le premier trimestre, les prix de détail ont progressé au rythme de 18% l'an.
Il y a quarante ans, l'état de santé de l'économie capitaliste pouvait être apprécié en prenant le pouls de la sidérurgie et de la métallurgie. Partout, les hauts barons de l'acier dominaient l'industrie capitaliste : Krupp et Vereinigte Stahlwerke en Allemagne, GKN Steel et Baldwins en Angleterre, Schneider et de Wendel en France, Bethlehem Steel et US Steel Corp. aux Etats-Unis. De nos jours, c'est l'industrie automobile qui est devenue la clé de voûte de l'édifice économique capitaliste. La santé d'une multitude d'industries -acier, pneus, verre, bureaux d'études- dépend de la prospérité des compagnies géantes d' automobiles. Une baisse brutale de leur production entraînerait des conséquences désastreuses pour toute l'économie. Et l'actuelle chute de production dans les pays avancés est précisément conduite par l'industrie automobile ! Volkswagen a annoncé le premier déficit de la compagnie depuis la dernière guerre mondiale : 34,4 millions de dollars pour le premier trimestre 1974. Encombrée d'un énorme stock de 472 000 véhicules invendus, elle a réduit les horaires de 45.000 ouvriers. En avril 1974, les ventes internationales de Toyota étaient de 32% inférieures à celles d'avril 1973, et celles de Nissan Motors chutaient de 33,4%. Citroën enregistre une baisse de ses ventes en France de 9% pour le premier trimestre, et des rumeurs circulent sur une éventuelle prise de participation de l'État pour sauver la société[1]. En mars, les ventes de véhicules ont dégringolé de 20 % en France par rapport à l'année précédente. En Italie, les affaires de Fiat tournent maintenant à moins de 15% de leur tenue déjà médiocre de l'année dernière. Aux Etats-Unis, toujours pour le premier trimestre, les ventes de Ford, General Motors et Chrys1er ont brusquement baissé, créant ainsi d'énormes parcs d'invendus. Lorsque les effets de ces baisses des ventes et de la production se seront répercutés à travers toute l'économie, la crise s'approfondira.
La bourgeoisie a réagi à la crise avec une panique qu'on ne lui avait plus vue depuis 1929. L'effondrement de la bourse de Londres le plus actif et le plus important, avec Wall Street, de tous les marchés boursiers est un signe révélateur de la peur qui s'empare de la bourgeoisie.
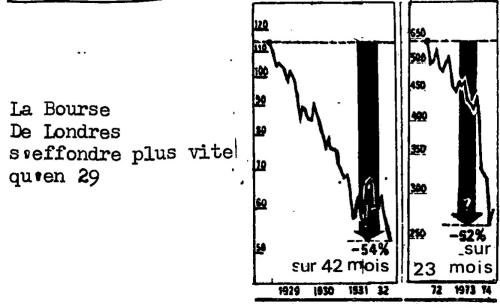
L'intensité de la crise économique a obligé les bourgeoisies nationales à tenter de définir une politique qui amortisse les chocs et protège le capital national. Les États capitalistes, impuissants à résoudre les insolubles contradictions du système, ont essayé, à travers une intervention politique, de "planifier" la crise pour l'atténuer. Les voies ouvertes à chaque État capitaliste pour retenir la débâcle quasi complète de sa propre économie et la chute "catastrophique" des profits du grand capital peuvent être classées en trois directions -chacune étant tentée simultanément avec les autres. La première voie consiste à tenter de détourner la crise sur un autre pays, ce qui laisse présager un accroissement des antagonismes inter-impérialistes. La seconde consiste à dévier la crise sur les secteurs faibles du capital, comme la petite-bourgeoisie et la paysannerie. Cela entraînerait une concentration et une centralisation du capital plus poussées, qui, prises en charge par l'État, accéléreraient la tendance vers le capitalisme d'État. La troisième voie revient à faire supporter la crise au prolétariat en s'attaquant à ses salaires et à ses conditions de vie, en programmant une austérité draconienne, etc. Dans cette tentative-ci, l'État le ferme soutien des syndicats.
Les deux dévaluations du dollar (août 1971 et février 1973) et la sensible réévaluation du mark et du yen ont été les deux premiers coups tirés dans la guerre commerciale que se livrent de plus en plus ouvertement les Etats-Unis, d'une part, et le Japon et l'Europe, d'autre part. Ces dévaluations ont contribué à restaurer la compétitivité du capital américain sur le marché mondial et à protéger son marché intérieur (aux dépens de l'Europe et du Japon). En 1973, des balances commerciales et des paiements positives ont permis au dollar de se rétablir. Le tableau suivant illustre l’irrésistible ascension du dollar contre les autres monnaies entre juillet 1973 (lorsqu’il fut annoncé que le solde de la balance commerciale était positif) et janvier 1974.
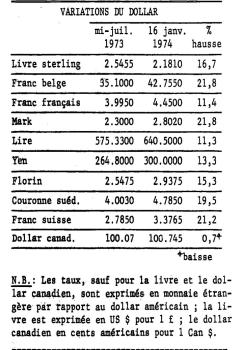
La manière dont les deux dévaluations du dollar furent appliquées et le fait que les bourgeoisies allemande et japonaise durent accepter une spectaculaire réévaluation de leurs monnaies qui affaiblit leur compétitivité sur le marché mondial démontrent à quel point l'Europe et le Japon sont dépendants du capital américain. La "crise du pétrole", particulièrement la hausse brutale des prix du brut, a encore plus fait pencher la balance en faveur des Etats-Unis.
Le tableau ci-après donne le montant des balances commerciales et des paiements pour 1973, ainsi que les estimations pour 1974, des Etats-Unis, du Japon et des principaux pays du Marché commun. Les estimations pour 1974 ont été calculées en tenant compte des effets de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, et en présumant "que les principales nations industrielles parviendront à améliorer substantiellement leurs performances commerciales sauf en ce qui concerne le pétrole et le gaz" ("World Financial Markets" du 22/1/1974). Cette assertion, les événements de ces quatre derniers mois se sont chargés de la faire voler en éclats, comme nous le verrons plus loin.
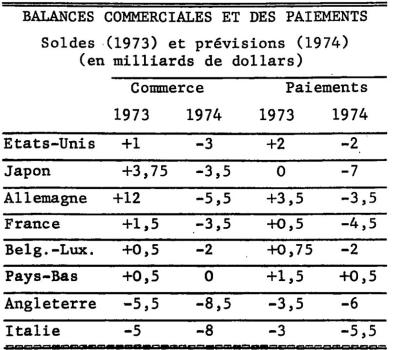
Devant l'impossibilité dans laquelle se trouvent tous ces pays d'augmenter leurs exportations et de diminuer leurs importations autres que celles de pétrole et de gaz, les déficits commerciaux et des paiements seront donc, pour au moins certains d'entre eux, bien plus importants que ces chiffres ne l'indiquent. Pour le moment, cependant, nous n'examinerons que les conséquences de l'augmentation des prix pétroliers sur la balance commerciale de ces huit pays.
Ce qui est frappant, c'est que le renchérissement du pétrole aura des effets beaucoup plus désastreux sur les économies japonaise et européennes que sur celle des Etats-Unis[2]; la Grande-Bretagne et l'Italie, déjà durement frappées par la crise avant même la hausse des prix du pétrole, auront, de ce fait, des déficits commerciaux "ingérables". Le Japon, la France, la Belgique et le Luxembourg, qui avaient un commerce assez notablement excédentaire, vont devoir faire face à un énorme déficit. Les États-Unis, quant à eux, même en perdant le bénéfice de l'excédent de leurs balances commerciales et des paiements, ne seront pas aussi durement touchés que leurs concurrents. Les bourses étrangères furent sensibles au fait que les Etats-Unis se montraient moins dépendants de l'étranger pour leur approvisionnement en énergie que la plupart des autres pays industrialisés, et qu'en outre ils possédaient une très grande capacité d'accroître leurs ressources énergétiques nationales. Au moment même où l'on annonçait, en octobre et décembre 1973, la hausse des prix pétroliers, le dollar reprit sensiblement de sa valeur sur le marché des changes.
Trouver le moyen de financer le déficit de leurs balances des paiements, prévenir l'affaiblissement de leurs monnaies, tel était, dans cette conjoncture le problème numéro un auquel les bourgeoisies européennes et japonaise durent s'affronter. L'inféodation complète de l'Europe et du Japon au capitalisme américain s'est douloureusement manifestée à cette occasion. L'Italie dut humblement aller quémander au FMI (dominé par les États-Unis) un crédit de secours de 1,2 milliard de dollars et, en outre, la couverture consentie à la Banque d'Italie par la Fédéral Reserve Bank de New York passa de 2 à 3 milliards de dollars. En Grande-Bretagne, le nouveau chancelier de 1'Echiquier, Denis Healy, dut s'agiter pour calmer l'affolement sur le sterling et redonner confiance aux milieux financiers internationaux et il négocia sur les chapeaux de roue et un emprunt de 2,5 milliards d’eurodollars (le plus formidable emprunt jamais réalisé sur ce marché !) et une extension de 2 à 3 milliards de dollars de la couverture accordée par la Fédéral Reserve Bank. Le gouvernement français dut s'endetter de 1,5 milliard dur le marché de l'eurodollar, et les banques japonaises profitaient de la suppression du contrôle américain sur les mouvements de capitaux pour décrocher d'importants crédits auprès de grandes banques américaines, tout en empruntant des eurodollars. La levée de ce contrôle, mis en place depuis dix ans, a été à la fois une expression de la compétitivité croissante du capital américain sur le marché mondial et un effort pour financer, dans un cadre général d'hégémonie américaine, les importations de pétrole du Japon et de l'Europe. Selon "World Financial Markets", "les États-Unis ont non seulement dû payer leurs propres importations de plus en plus cher, mais encore financer une part appréciable de celles d'autres pays[3]"(21/5/1974).
Le renchérissement des prix pétroliers a non seulement renforcé la dépendance financière structurelle de l'Europe et du Japon à l'égard des Etats-Unis, mais il a aussi, directement et indirectement, entamé la compétitivité de leurs marchandises par rapport aux biens américains. Le prix des marchandises européennes et japonaises s'est en effet alourdi avec 1' augmentation des prix du pétrole (plus force qu'aux Etats-Unis) et avec le fardeau que représentent les importantes dettes faites pour financer les énormes déficits des balances des paiements. Pour ne donner qu’un exemple, le récent emprunt britannique mentionné plus haut est assorti d' un intérêt d'environ 10,5% ! Confrontées à des balances commerciales déjà désastreuses, la dernière chose que pouvaient se permettre les bourgeoisies européennes et japonaise était un affaiblissement supplémentaire de leur position compétitive. La comparaison des balances commerciales américaine et anglaise au cours du premier trimestre de 1974 illustre à la fois les effets directs et indirects de la hausse des prix du pétrole. Le déficit global du commerce britannique était de 429 millions de livres en février et de 453 millions en mars. Le déficit dû aux produits pétroliers passait respectivement de 247 millions .à 294, tandis que celui dû aux autres produits baissait de 182 à 159 millions de livres. Ainsi, même mis à part le déficit pétrolier, la Grande-Bretagne traîne un déficit commercial spectaculaire, malgré une dévaluation de fait de 18% de la livre depuis décembre 1971 ! Et le relèvement économique que le gouvernement travailliste attendait de la fin de la semaine de travail de trois jours et d’un boom des exportations a fait long feu : en mai, le déficit du commerce britannique a atteint le record de 481 millions de livres...
Les Etats-Unis, pour leur part, présentait un solde bénéficiaire de 694 millions de dollars pour le premier trimestre, sans tenir compte du prix élevé du pétrole importé. En mars, alors que leur balance commerciale se détériorait gravement, le déficit n’atteignait que 171 millions de dollars -largement en dessous du record britannique de 453 millions de livres ! Et, à l'exception de l'Allemagne fédérale, le Japon et les autres pays européens font l'expérience, à un degré seulement un peu moins fort, des difficultés britanniques.
La tactique du capital américain
Alors que les deux dévaluations du dollar et les effets directs et indirects des prix plus élevés du pétrole ont sérieusement émoussé la compétitivité des produits japonais et européens sur le marché mondial et renforcé les liens de dépendance des pays capitalistes avancés à l’égard des Etats-Unis, la position du capital américain a été encore relativement améliorée par un autre effet de la hausse des produits pétroliers. Le transfert de milliards de dollars d'Europe, du Japon et des Etats-Unis aux pays producteurs soulève la question de la destination finale de ces fonds. Certains seront dépensés à la fois en biens de production et en biens de consommation (particulièrement pour importer d'indispensables produits agricoles), et la plus grande partie sera disponible pour investir à 1'"Ouest". Dans les deux cas, une énorme fraction de ces sommes ira aux États-Unis. Ainsi, en plein milieu de la crise qui s'approfondit, les Etats-Unis apparaissent comme une place relativement sûre pour des investissements, alors que le délabrement des économies européennes et japonaise n'offre que le risque d'une éventuelle tempête sociale.
De plus, l'industrie et l'agriculture américaines, plus compétitives, sont dans une meilleure position pour bénéficier des marchés ouverts dans les pays producteurs, lesquels constitueront un véritable canal pour le transfert pur et simple de richesses des économies affaiblies du Japon et de l'Europe vers l'économie américaine, plus robuste. Cela aggravera la crise dans ces pays et, dans une certaine limite, l'atténuera en Amérique.
Toutefois, la bourgeoisie américaine ne tient pas à ce que les économies européennes et japonaise s'effondrent. En premier lieu, les marchés qu'elles représentent sont les plus importants pour les produits américains, et si un choc trop rude les ébranlait, cela signifierait une réduction de la demande dont les exportations américaines souffriraient. En second lieu, le capital américain est profondément enraciné en Europe, particulièrement dans les industries les plus "modernes" (automobiles, électronique, pétrole, pétrochimie, produits pharmaceutiques, ordinateurs, etc.). Un effondrement de l'Europe affecterait sérieusement les profits des grandes compagnies américaines. Par ailleurs, les luttes ouvrières que provoquerait une débâcle économique en Europe et au Japon pourraient avoir l'effet soit de détruire de fond en comble l'ordre bourgeois, soit de permettre aux fractions de la bourgeoisie favorables à une orientation pro-russe de parvenir au pouvoir. La bourgeoisie américaine est extrêmement sensible à la menace d'un soulèvement prolétarien ou d'une extension du pouvoir russe en Europe ou au Japon.
Ce que la bourgeoisie américaine veut, c'est une réorganisation de l'économie occidentale ajustée aux nouvelles réalités imposées par la fin de la période de reconstruction d'après-guerre, par la saturation des marchés mondiaux et le développement de la crise sous une forme plus ouverte et plus aigüe. Dans cette nouvelle version de la "pax americana", les bourgeoisies européennes et japonaise doivent accepter une place plus modeste, réfréner leurs ambitions d'expansion et permettre à la bourgeoisie américaine de leur faire supporter certains effets de la crise. Toutefois, au fur et à mesure que la crise d’approfondira, la tendance de la bourgeoisie américaine sera d'infliger de plus en plus de contraintes à ses "alliés", afin de préserver ses propres profits.
L’éclatement de l’Europe
Impuissantes à contester effectivement l'hégémonie du capital américain, les bourgeoisies européennes ont tenté de protéger leurs intérêts nationaux aux dépend de 1'"unité" européenne tant vantée.
- "Aujourd'hui, le Marché commun est en miettes, et l'Europe comme "bloc" est complètement disloquée. Le Marché commun n'a jamais été autre chose qu'un "marché commun" pour la reconstruction d'une Europe ruinée par la guerre, et cela sous l'œil intéressé et paternaliste des Etats-Unis. Face aux Etats-Unis, pris eux-mêmes dans les difficultés de la crise, l'Europe, réduite à la portion congrue, ne peut que manifester sa mauvaise humeur, se soumettre davantage aux diktats des États-Unis, se déchirer encore plus, et les différents États qui la constituent sont amenés à chercher séparément et isolément leur salut en s'intégrant à l'un des grands blocs impérialistes mondiaux en voie de constitution." ("Révolution Internationale" -Bulletin d'études n°5, p.28-29)
La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest a maintenant éclaté au sein du Marché commun. Des fractions importantes des bourgeoisies britannique et danoise sont déterminées à se retirer de la CEE ou, du moins, à renégocier les bases de leur engagement pour aboutir à des termes plus favorables. Le nationalisme économique, le protectionnisme, les barrières douanières et une tendance prononcée vers l'autarcie ébranlent le Marché commun ; même la libre circulation des marchandises à travers les frontières nationales, qui fut à sa base, connaît des restrictions. Chaque nation est déterminée à réduire ses importations au strict minimum, tout en développant ses exportations[4]. Le mot d'ordre de la politique économique est devenu : "Vendre des biens au voisin sans lui en acheter !"
Les économies les plus faibles (Italie, Danemark, Grande-Bretagne), qui, sous le régime de la libre circulation, seraient les victimes des offensives exportatrices de leurs voisins, s'emploient actuellement à ériger des barrières pour protéger leurs marchés intérieurs et tenter de mettre un frein à leurs déficits commerciaux. Quant aux économies dont la petite santé dépend du succès d'un boom des exportations (France, Allemagne), elles sont confrontées à la perspective d'un rétrécissement des marchés et vont donc bientôt ressentir de plein fouet les effets de la crise.
L'Italie fut le premier pays à réagir. Du fait que la position du capital italien est de moins en moins compétitive, en 1974, le déficit de la balance commerciale dépassera largement l'estimation de 8 milliards de dollars calculée en ne tenant compte que de l'incidence de l'augmentation des prix des produits pétroliers. Pour le premier trimestre de 1974, seulement, un déficit spectaculaire de 3 milliards de dollars a été enregistré ! Par ailleurs, la marge de manœuvre qui était jusqu'à présent en partie assurée par l'existence de revenus dits "invisibles" qui alimentaient la balance des paiements est maintenant menacée. En effet, particulièrement en ce qui concerne les sommes que deux millions de travailleurs italiens émigrés, soit 10 % de la force de travail, envoyaient à leur famille restée en Italie, ces versements risquent de diminuer fortement, car l'augmentation du chômage à travers toute l'Europe menace plus particulièrement ces travailleurs, qui, retournant au pays, viendraient gonfler l'armée grandissante des sans-emplois. La dégringolade de la lire et sa solvabilité de plus en plus douteuse ont conduit les représentants de la bourgeoisie à parler de banqueroute nationale au cas où l'Italie ne parviendrait pas à stopper l'aggravation des déficits commerciaux et des paiements[5].
En mai, le gouvernement italien a adopté une série de mesures protectionnistes destinées à restreindre les importations. Les entreprises importatrices de produits agricoles et de produits semi-finis ou finis, doivent placer la moitié de la valeur de leurs importations à la Banque d'Italie pendant six mois ; de plus, elles ne recevront aucun intérêt pour ces dépôts. Certaines importations de biens d'équipement et de matières premières nécessaires à l'industrie, et qui ne peuvent être produits à l'intérieur du pays, sont exemptées de cette mesure. Cependant, ces nouvelles règles affectent près de la moitié des importations du pays.
Le Danemark fut le pays suivant à élever des barrières aux importations, dans une tentative de mettre fin à l'augmentation de son déficit commercial, qui l'avait contraint, au cours de ces dernières années, à recourir à des emprunts de plus en plus importants. L'inflation galopante et la hausse des prix du pétrole importé ont amené le pays aux limites de la solvabilité. Traînant une industrie non compétitive dans le Marché commun et confrontée à un déficit de la balance des paiements d’un million de dollars, la bourgeoisie danoise a pris des mesures énergiques visant à réduire les importations et à arrêter l’hémorragie de ses réserves de devises. Une augmentation très forte sur toute une série de biens de consommation doit partiellement fermer le marché danois aux "partenaires".
La mise en place de barrières douanières par certains pays a provoqué de nombreuses réactions et mesures de rétorsion de part et d'autre. Les appels désespérés de l'Italie pour une aide financière des autres pays du Marché commun ont permis à la France et à l'Allemagne d'exiger la levée ou la modification de ses restrictions à l'importation, lesquelles, surtout pour les produits agricoles, commençaient à a- voir des effets désastreux sur les économies française et allemande. Giscard d'Estaing sait parfaitement que la santé de l'économie française et la prévention de soulèvements sociaux de masse dépendent de la possibilité de développer les exportations. La guerre commerciale croissante au sein du Marché commun et la détérioration de sa position compétitive ont d'avance compromis les chances d'un boom des exportations de la France, et on parle de plus en plus, à Paris, d'une restriction des importations (le déficit de la balance commerciale, pour le seul premier trimestre de 1974, a été de 1,6 milliard de dollars) .
La prospérité de la bourgeoisie allemande dépend d'une progression rapide et soutenue de ses exportations. Si les mesures protectionnistes, qui limitent déjà les exportations allemandes, restent en place (ou pire, si elles sont renforcées), cela entraînerait toute l'économie allemande à la catastrophe. La République fédérale est cependant en position de force en Europe, car, pour financer leurs déficits, de nombreux pays auront besoin de son secours. Et, sans aucun doute, la bourgeoisie allemande fera de l'abaissement des droits de douane et d'un engagement renouvelé de garantir la liberté du commerce la condition des énormes prêts qui lui seront sollicités Toutefois, pour ses partenaires commerciaux qui accepteraient ces conditions, le résultat pourrait être une véritable vassalisation à l'égard de l'Allemagne car, au fur et à mesure que les dettes augmenteraient, leur marché intérieur serait inondé de produits allemands. L'alternative serait un renforcement des mesures protectionnistes et l'exacerbation des tendances autarciques.
Le Japon dans l’impasse
Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, la bourgeoisie japonaise prépare une nouvelle offensive de ses exportations. La seule manière d'éviter, sous le poids du coût élevé du pétrole et la saturation de son marché domestique, la débâcle économique est de lancer ses produits à l'attaque des marchés du monde entier. Selon 1'"Economist" du 6 avril 1974, la bourgeoisie nipponne , pour contenir le déficit de sa balance des paiements dans des limites supportables et conjurer la catastrophe économique, est déterminée à augmenter de plus de 30% ses exportations pour cette année. Son marché intérieur étant protégé par d'impénétrables barrières douanières, les industriels peuvent vendre leurs marchandises à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués au Japon-même. Le ''dumping" est donc le fondement de sa politique commerciale. Cependant, sa tentative d'exporter sa crise ne peut que provoquer des réactions protectionnistes en Europe et aux Etats-Unis. Lorsque cette situation sera à l'ordre du jour, le Japon sera confronté à la crise dans toute son ampleur et, pour la première fois depuis la guerre de Corée, la bourgeoisie devra faire face à un chômage massif.
L’enjeu américain au Proche-Orient
La bourgeoisie américaine tente de reporter les effets de la crise sur l'Europe et le Japon. Et à son tour, chaque capital européen tente de les reporter sur son voisin, tandis que le capital nippon se défend tous azimuts. Il y a une accentuation incontestable des antagonismes inter-impérialistes au sein même du bloc dit "occidental". Ce phénomène ne doit toutefois pas masquer l'antagonisme inter-impérialiste fondamental qui prévaut aujourd'hui : celui qui oppose, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Russie et les États-Unis .
En s'accentuant, la crise mondiale a exacerbé cet antagonisme. Alors que la presse parle de détente et de paix au Proche-Orient et que les bordiguistes font grand bruit au sujet d'un prétendu condominium mondial russo-américain, la lutte entre les capitalismes russe et américain s'intensifie. Le récent "coup" de Kissinger au Proche-Orient, loin de marquer une diminution de la menace permanente d'hostilités dans cette région, entre dans une stratégie agressive des Etats-Unis qui a pour but de déloger le capital russe de cette zone vitale. Il y a quatre ans, lors de l’"initiative de paix" de Rogers, Kissinger avait déclaré que l'objectif était d'extirper la présence militaire russe en Égypte. Le récent triomphe de la diplomatie Kissinger est un nouveau pas dans l'accomplissement de ce programme et indique la possibilité de son extension à la Syrie.
C'est l'armement et le soutien logistique américain qui ont rendu possible la contre-offensive israélienne contre les armées arabes équipées par la Russie, lors de la guerre de Kippour. Le fait que l'armée israélienne soit parvenue à une trentaine de kilomètres de Damas et se soit fermement installée sur la rive occidentale du canal de Suez , a démontré sans ambiguïté aux bourgeoisies arabes les limites du soutien russe. Les manœuvres diplomatiques qui ont amené la fin des hostilités, le détachement provisoire de l'Égypte du bloc russe et l'influence actuelle des Etats-Unis en Syrie ont déjà fortement affaibli les positions russes au Proche-Orient. En outre, les Américains ne souhaitent pas seulement une limitation de la présence militaire russe mais également un affaiblissement de son emprise économique sur certains pays de la région. La "réouverture" de l'Égypte au commerce et à l'influence financière américaines ainsi que la nouvelle position acquise en Syrie constituent une importante victoire pour Le capital américain dans sa lutte pour les marchés et le contrôle stratégique du Proche- Orient. Le nouveau comité américano-égyptien pour la coopération et le développement est destiné à faciliter la pénétration de l'impérialisme américain sur un marché qui lui était jusqu'ici fermé. L'industrie et les banques américaines sont avides de profiter de ces nouvelles possibilités. Les États producteurs de pétrole ont déjà promis 200 millions de dollars pour l'oléoduc de Sumed, 400 millions pour le complexe pétrolier d'Alexandrie et 200 millions pour le développement du logement et du tourisme. Le capital américain cherche à saisir la part du lion des contrats concernant ces projets. Des possibilités supplémentaires s'ouvrent avec la signature d'un important pacte économique et militaire entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, qui prévoit la mise en place d'une commission paritaire à travers laquelle le capital américain aidera le roi Fayçal à réaliser un plan d'industrialisation de 10 milliards de dollars. Quant aux besoins de ce pays, qui augmentent fortement, ils seront pris en charge par une commission militaire qui l'aidera à assumer ses "responsabilités" dans la défense de la région.
Cependant, le Proche-Orient est une zone trop importante pour que les Russes y renoncent sans lutter ; c'est pourquoi une réponse de leur part à l'offensive américaine ne saurait tarder. La dernière chose qui soit possible, quand la crise s'intensifie, c'est une période de détente.
Mac Intosh.
(A suivre)
[1]Entre le moment où cet article a été rédigé et celui où nous le publions, ces rumeurs se sont confirmées, puisque le "sauvetage" de Citroën a été entrepris, non par l'État, mais par Peugeot.
[2] Nous ne prenons pas en considération le fait que les superprofits réalisés par les compagnies pétrolières internationales (principalement américaines) aideront le capital américain à compenser la hausse du coût du pétrole —avantage qui n'existe pas pour ses concurrents
[3] La faiblesse du dollar depuis janvier peut être en grande partie attribuée aux sorties de capitaux qui ont suivi la levée des contrôles en la matière et non à un quelconque affaiblissement de la compétitivité américaine.
[4] Les exportations sont devenues la seule façon d'éviter la catastrophe économique, au moment où les marchés intérieurs sont saturés sous la pression de l'inflation, de la chute des salaires réels, du chômage, des restrictions de crédit, de l'augmentation des impôts, des réductions des dépenses "sociales", bref de toute la panoplie des mesures déflationnistes. Nous verrons plus loin les problèmes que pose une telle politique.
[5] En juin, en réponse à la menace imminente d'une banqueroute nationale italienne, les ministres des Finances des "Dix" sont convenus que les principaux pays pourraient désormais gager leurs réserves d'or à un prix voisin de celui du marché en garantie de leurs emprunts. Cette décision ne donnera à la bourgeoisie italienne qu'un répit de courte durée. En effet, l'Italie devra emprunter près de 10 milliards de dollars à l'Allemagne et aux Etats-Unis, et, au prix de 150.$ l'once environ, les réserves italiennes vaudront 12 milliards de dollars. Ainsi, c'est la presque totalité de son stock qui risque d'être hypothéquée vers la fin de l'année, sans aucune perspective de pouvoir lever de nouveaux emprunts, mais le risque très sérieux de se trouver au bord de la faillite.
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Quand donc les vrais conseils ouvriers surgiront-il ?
- 8 lectures
Grèves, barricades, piquets armés, diatribes hystériques de la presse sur 1'"anarchie", troupes envoyées pour briser une grève menée par un soi-disant "conseil ouvrier"... tout pourrait faire croire que la révolution prolétarienne vient d'éclater en Ulster.
Il est sûr que la grève semble actuellement avoir le soutien actif de la majorité de la classe ouvrière protestante (il ne faut cependant pas oublier les méthodes d'intimidation auxquelles ont recours les organisations extrémistes protestantes, U.D.A., U .V .F . , etc.). Les ouvriers ont montré leur force, leur capacité à acculer le capitalisme au précipice. Mais tant que les travailleurs protestants permettront que cette force soit utilisée pour soutenir une fraction capitaliste dans ses règlements de compte avec une autre, ils agiront directement contre leurs propres intérêts. La grève n'est alors ni prolétarienne, ni révolutionnaire, elle n’est qu'un moment supplémentaire de la débâcle contre-révolutionnaire dans laquelle la classe ouvrière a été prise au piège depuis des décennies.
Les "troubles" irlandais
Les troubles en Irlande du Nord, qui commencèrent à faire la "une" à partir de 1969, sont en fait une des manifestations de la crise mondiale du capitalisme qui s'accélère depuis la fin des années 1960. Mais alors qu'en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Argentine, en Pologne et ailleurs, les ouvriers ont répondu aux restrictions de salaires, aux crises du logement, à l'inflation sur une base de classe (contre les patrons, les syndicats, l'État), en Irlande, les conditions historiques particulières ont entraîné la classe ouvrière dans l'impasse des solutions purement nationalistes.
La classe dirigeante loyaliste, fermement soutenue par le capital britannique, a pu maintenir un ordre social particulièrement archaïque, en réussissant à conserver vivantes les divisions religieuses et nationales au sein de la classe ouvrière. Ainsi, elle s'assura que les ouvriers protestants aient toujours les meilleurs logements et les meilleurs emplois, pendant que les travailleurs catholiques étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Et cela maintint vives les mystifications religieuses et nationales qui, hors d'Irlande, ont depuis longtemps perdu une grande partie de leur emprise sur les ouvriers.
Quand, à la fin des années 1960, la crise économique mondiale commença à ronger l'économie irlandaise, la situation des ouvriers catholiques devint de plus en plus intolérable, et un mouvement de protestation commença à s'élever des ghettos catholiques. Mais parce que ce mouvement n'a jamais dépassé l'idée qu'il s'agirait là d'un problème catégoriel de "catholiques" ou d’"Irlandais" opprimés, pour voir plutôt que ce n'était qu'une forme particulière de l'exploitation capitaliste, il devint un terrain fertile pour les fausses solutions nationales et "démocratiques" de la bourgeoisie. Au début, le mouvement était dirigé par les charlatans du Mouvement pour les droits civiques, qui prit modèle sur le mouvement qui avait tenté d'émasculer la combativité des ouvriers noirs d'Amérique. Mais la réaction rapide et violente des loyalistes (attaque des ghettos catholiques par des gangs paramilitaires, par la populace ou les forces de police officielles) poussa la population catholique dans les bras de l'IRA, laquelle, jusqu'alors, n'était qu'un vestige moribond des conflits antérieurs. Se posant comme leur défenseur face aux assassins loyalistes, l'IRA pouvait ainsi devenir la police effective des ghettos catholiques. Le conflit tourna ainsi à l'affrontement entre fractions armées et l'armée britannique fut envoyée pour rétablir l'"ordre" et séparer les parties rivales. Mais ses méthodes brutales ne firent qu'exacerber le conflit, et, aujourd'hui, la classe ouvrière d'Irlande du Nord est dans une situation de cauchemar, où elle est divisée, torturée et embrigadée par une sainte-alliance du capital -armée britannique, IRA et gangs loyalistes- et où les travailleurs catholiques et protestants et les soldats britanniques servent de chair à canon à ces forces réactionnaires.
Face à ce chaos et en fonction de leur ambition nouvelle de moderniser l'Irlande et de l'intégrer dans le Marché commun, d'importants intérêts capitalistes, en Irlande comme en Grande-Bretagne, cherchent à mettre une fin à ces luttes de sectes et sont prêts à jeter par-dessus bord le vieil ordre d'Orange en faveur de capitalistes plus "rationnels", d'accord pour exploiter les ouvriers sur une base "égale", qu'ils soient catholiques ou protestants. C'est ce qui explique l'actuel conflit entre les loyalistes et l'État britannique.
Les ouvriers protestants redoutent particulièrement les conséquences de toute intégration à l'Irlande du Sud et de toute concession à la minorité catholique. Ils voient l'accord de Sunningdale comme le début de la fin de leur situation privilégiée, déjà menacée paf la crise économique. Leur volonté de conserver leurs très relatifs privilèges les pousse à l'action de masse ; mais, quelle que soit sa combativité, cette action n'a d'autre but que d'obtenir le droit de se faire exploiter par des patrons protestants et de se faire tuer par les soldats de l'État britannique — tout comme les ouvriers catholiques qui soutiennent 1'IRA ne font que défendre le droit pour la bourgeoisie catholique irlandaise d'étendre sa domination réactionnaire à toute 1'Irlande.
Nation ou Classe
Mais que ce soit un patron anglais, irlandais, blanc ou noir, américain ou russe qui commande, cela ne fait Aucune différence pour la classe ouvrière : elle reste des esclaves salariés écrasés sous le talon de l'État. La vérité, c'est que le capitalisme, qu'il soit orange ou vert (ou d'État, comme le souhaitent certains gauchistes dans la ligne idéologique de 1'IRA) n'a plus rien à offrir aux ouvriers d'Irlande ou d'ailleurs. À l'intérieur du système, il n'y aurait qu'une seule solution pour que les divisions en sectes en Irlande commencent à se résorber : que l'économie irlandaise dans son ensemble amorce une expansion soudaine assez rapide pour assurer des logements décents et de meilleurs emplois pour tous. Impossible rêve, puisque l'économie irlandaise n'est qu'un appendice arriéré de l'économie britannique, qui sombre elle-même dans la crise mondiale du capitalisme. Très vite, les ouvriers protestants n'auront plus aucun "privilège" à défendre, et le niveau de vie des ouvriers catholiques empirera encore.
La classe ouvrière irlandaise, catholique ou protestante, se trouve placée devant un choix historique : ou bien permettre que les fractions capitalistes en présence continuent de la manœuvrer et de l'exploiter, ou bien s'affirmer sur une base de classe contre ce conflit fratricide. C'est-à-dire prendre conscience que la "nation" n'est qu'un masque qui cache la domination du capital et que la seule identité que les travailleurs ont à défendre, c'est leur appartenance à une classe mondiale exploitée, dont les intérêts réels sont les mêmes partout. La crise du capitalisme est d'abord et avant tout une crise de l'État national, une manifestation du fait que la division du monde en capitaux nationaux concurrents est devenue un cadre trop étroit pour les forces productives que le capitalisme lui- même à développées. L'État national est un anachronisme monstrueux auquel ont été sacrifiées des millions de vies de travailleurs dans les guerres capitalistes de ce siècle ; c'est pourquoi la classe ouvrière d'Irlande ne peut avoir aucun intérêt à se battre pour un nouveau découpage national, que ce soit sous la forme d'une "Irlande unie" ou sous celle d'un "Ulster loyaliste". Au contraire, le seul moyen de se tirer du bourbier, c'est de devenir partie prenante d'un mouvement révolutionnaire mondial de la classe ouvrière contre les frontières et les États nationaux, pour la création d'une communauté mondiale des producteurs capable de mettre les richesses et les forces productives de cette planète au service des besoins humains et non à ceux du profit.
Si la classe ouvrière d'Irlande est trop profondément prise au piège des mystifications nationalistes pour pouvoir acquérir cette conscience par elle-même, c'est aux ouvriers hors d'Irlande -et surtout à ceux de Grande-Bretagne- de leur venir en aide, en répondant à l'approfondissement de la crise en termes de classe et avec un programme révolutionnaire : abolition du travail salarié, du système du profit, des États nationaux, etc. Ce programme sera appliqué par l'intermédiaire des conseils ouvriers, qui sont apparus dans chaque mouvement réellement révolutionnaire de la classe pendant ce siècle. Mais ces conseils-là n'auront rien à voir avec ce misérable ramassis de notables, de syndicalistes et de "généraux" loyalistes qui ont monté ce soi-disant "conseil ouvrier de 1'Ulster".
Les véritables conseils ouvriers seront des organes de toute la classe ouvrière élus et révocables, qui auront brisé toutes les divisions, religieuses, raciales, sexuelles, corporatives, etc., qui la paralyse, et qui transformeront radicalement toute la vie sociale. Quand ils surgiront, ces conseils balaieront pour toujours le "conseil ouvrier de l'Ulster", les gouvernements de Londres, de Dublin et le Storemont, l'IRA et toutes les institutions de la classe capitaliste mondiale.
Londres, le 29 mai 1974.
WORLD REVOLUTION
(Traduction d'un projet de tract.)
Géographique:
- Irlande [54]
Rubrique:
Revolution Internationale N°11 - septembre - octobre
- 650 lectures
L'irrésistible chute du capital français
- 1035 lectures
En quelques mois, l'espace d'un été, la situation s'est brusquement aggravée pour le Capital français. Alors qu'au début de l'été, le premier ministre Chirac déclarait triomphalement: "La France est épargnée',' une cascade de faillites dans les petites entreprises, une brusque flambée de chômage, l'accentuation de l'inflation ont provoqué un vent de panique dans la classe capitaliste: "Nous allons inéluctablement vers une crise économique dont personne ne peut imaginer l'ampleur.
Nous vivons la fin d'un monde.", déclare le Crésus de la boutique, Edouard Leclerc. (Entreprise N°992) A l'heure actuelle, les économistes bourgeois ne voient pas l'économie française sortir du bourbier où elle s'enlise avant 1980, voire même 1990. On ne cesse d'évoquer 1929: la chute irrésistible de la bourse qui s'est accélérée pendant les vacances permet à un journal officiel de constitution et de dissolution de sociétés (Petites affiches N° 103) d'affirmer: "Nous sommes très exactement... dans la même situation qu'en 1929, avec les coussins et les matelas en plus. Nous vivons un krach silencieux et différé...Tout le reste est vent dans les roseaux".
LA CRISE MONDIALE FRAPPE LE CAPITAL FRANÇAIS
La bourgeoisie française ne se fait donc plus aucune illusion: les lendemains ne chanteront pas.
Si la "France est épargnée", c'est seulement jusqu'à la fin de l'année. Elle "est épargnée" parce qu'apparemment elle dispose de plus d'atouts que l'Angleterre et l'Italie: une monnaie (encore) stable, une inflation relativement "modérée" (15% contre 16,57 pour l'Angleterre, 207 pour l'Italie et 307 pour le Japon), et surtout un taux de croissance encore nettement positif (4,757), alors que beaucoup d'autres pays sont en-deçà de la "croissance zéro"
(U.S.A -2,77; G.B.:-67; Japon:-6,57.). Elle bénéficie également d'une moindre dépendance par rapport au marché mondial: la production agricole très diversifiée réduit la part des importations; la part des importations dans l'industrie nationale est seulement de 157 (contre 207 en Allemagne). C'est cela qui permet à la bourgeoisie française d'espérer n'être frappée par la crise qu'à retardement, comme ce fut le cas après 1929 (la crise devient effective à partir de 1932).
Pour l'instant, les grosses entreprises semblent avoir encore quelques beaux jours à vivre: Peugeot embauche 800 ouvriers à Mulhouse et Berliet -qui vient de s'ouvrir des marchés au Moyen Orient- 1000 ouvriers. Appliquant le cri de guerre de la bourgeoisie en période de crise: "exporter", elles font partie de ces cent entreprises qui assurent 407. des exportations. L'industrie sidérurgique tourne au maximum de ses capacités et l'industrie d'armements est débordée de commandes. C'est cette situation que reflète Ceyrac, chef du C.N.P.F lorsqu'il déclare au début septembre: "la situation économique de la France est encore exceptionnellement bonne par rapport à tous les autres pays, y compris les Etats-Unis."
Néanmoins, de sinistres craquements se font entendre au sein du grand capital.
En l'espace de quelques mois, il vient de se produire: les faillites des usines de remorques Titan-Coder mettant au chômage 2700 ouvriers; la liquidation du France, symbole de l'expansion du capital*français au début des années soixante, liquidation qui entraîne le licenciement de 2000 marins invités à chercher du travail dans l'industrie hôtelière. On annonce aussi le licenciement de 6000 ouvriers à la SNIAS (ex-Sud Aviation). De sombres nuages s'amoncellent sur l'industrie automobile depuis un an (Citroën) et sur l'industrie lainière (-20% en l'espace d'un an à la veille de l’été): ce sont des milliers de licenciements qui guettent à l'avenir les travailleurs de ces industries.
A l'avenir, sinon dans l'immédiat, la "croissance zéro" ou plutôt la croissance négative va devenir réalité.
Sur le plan financier c'est carrément la ruine à plus ou moins brève échéance.
Alors que les marchés se rétrécissent comme peau de chagrin ne laissant la place qu'aux plus forts (USA, Allemagne, Japon ) que le commerce mondial se ralentit, que les exportations sont amenées à décroître dans l'économie française, la part des importations en valeur ne cesse de croître au sein de celle-ci. Le déficit commercial, du fait du renchérissement du coût des matières premières, est déjà de 11,7 milliards de francs. Selon l'OCDE, l'équilibre de la balance commerciale ne serait pas rétabli à la fin de 1975, ce qui signifie à terme une banqueroute à l'italienne.
Point ne sera besoin d'attendre si longtemps: déjà, aux dires des commentateurs bourgeois, la bourse française affronte son "septembre noir" (chute de -30% en moins d'un an des valeurs françaises). "Entreprise" parle même du danger d'un nouveau "Herstatt[1]" en France devant les krachs bancaires qui affectent les Etats-Unis et surtout l'Allemagne. Le krach est donc déjà là, même s'il est encore "silencieux et différé". .
La situation est si grave pour la France comme pour toutes les autres puissances capitalistes qu'une rencontre des représentants du grand capital international a eu lieu au château de Champs-sur-Marne, en vue d'établir un contrôle des changes et de soutenir les banques défaillantes: comme dans un château de cartes, la banqueroute d'une puissance capitaliste ne peut qu'entraîner celle de toutes les autres.
La situation relativement "privilégiée'’ du capital français, si l'on songe à la situation catastrophique de l'Angleterre, de l'Italie (production de -20% chez Fiat en un an) ou même du Japon (krach d'un important "zaibatsu" de l'électronique) sera donc d'une très courte durée.
LES PREMIERES VICTIMES: MOYENNE ET PETITE BOURGEOISIE
Ce sont les petits patrons et aussi les petits commerçants.
a) Les petites et moyennes entreprises.
Au même moment où Ceyrac chantait victoire Gingembre, le porte-parole des PME déclarait: "Les restrictions de crédit constituent un lent étranglement des entreprises industrielles qui doit conduire inéluctablement au chômage total et puis à la liquidation judiciaire ou à la faillite." La politique déflationniste menée par Giscard et qui s'est manifestée par la hausse du loyer de l'argent et le blocage des crédits par les banques aux PME a entraîné des faillites en cascade (tanneries d'Annonay, La Prairie en Charente). Durafour, ministre du travail, avoue que deux cents dossiers de petites entreprises sont entre ses mains. Les dépôts de bilan se multiplient et les cabinets de syndics sont débordés (6000 dépôts en un an: + 23% par rapport à 73).
Jusqu'ici le mécontentement des petits patrons s'est exprimé de manière verbale, dans les colonnes de l'Aurore ou du Nouvel Observateur.
Ce sont les paysans et les petits commerçants qui ont tenu le devant de la scène cet été par des explosions de violence (notons que depuis un certain temps, la petite bourgeoisie étudiante ne tient plus le haut du pavé) Les paysans.
En France comme dans toute la CEE ce sont eux qui ont fait le plus parler d'eux. Rien qu'en un an, le revenu global des paysans a baissé de 15%. Ils sont donc descendus sur les routes avec leurs tracteurs ou ont attaqué les préfectures comme en Corse. Laminés par l’inflation, ils demandent une réévaluation des prix agricoles, alors que le gouvernement mène une politique de blocage des prix. Couche condamnée à la ruine par le grand capital, elle tente de survivre en se raccrochant à son capital national: elle demande à la bourgeoisie la fermeture des frontières et, pour l'obtenir, s'attaque aux camionneurs étrangers qui transportent des produits agricoles, comme on a pu le voir dans le Nord. Bref, ce qu’elle demande à ses maîtres c'est de survivre, que la bourgeoisie soit "nationale", pour tout dire, protectionniste.
En tout cas, pour le moment du moins, le grand capital n'a pas l'intention de relever les prix agricoles(l)[2],il s'agit de juguler l'inflation pour éviter à la fois la banqueroute financière et une explosion prolétarienne. Cependant, lorsque ce géant endormi, le prolétariat, deviendra menaçant, la bourgeoisie, par calcul politique, n'hésitera pas à céder, au mépris de ses intérêts immédiats, à accorder ce que demande la paysannerie: la hausse des prix agricoles. Il s'agira en effet pour la bourgeoisie de trouver des alliés contre le prolétariat.
b) Les commerçants.
Pour les commerçants, les mêmes causes ont conduit non à un affrontement avec l'Etat mais à un conflit entre gros et petit commerce.
La crise qui s'est manifestée par l'augmentation de leurs impôts, le blocage plus ou moins autoritaire des prix (campagne du 5% de baisse volontaire menée par le gouvernement), le blocage des crédits ont précipité les faillites dans la petite boutique. Alors que leur mécontentement s'était manifesté l'an dernier contre l'Etat (attaques de perceptions, bagarres avec les CRS), il s'est tourné cette fois contre les grandes surfaces, chargées de tous les péchés du monde. Face au petit commerce symbolisé par Nicoud, les grandes surfaces par la voix de Leclerc, demandent l'abolition de la loi Royer, favorable aux petits commerçants, laquelle freine, sinon stoppe, l'implantation de celles-ci.
Tel est le sens des violents affrètements entre les troupes de Nicoud et celles de Leclerc qui ont éclaté à Rochefort à propos de l'extension des magasins Leclerc. Le fait que les troupes de Nicoud aient eu le dessous est significatif: il montre l'inéluctable disparition d’une couche de petits boutiquiers parasitant le système de distribution capitaliste. L'Etat capitaliste qui souhaite réduire les prix pour, en même temps, lutter contre l'inflation et éloigner la colère ouvrière face à la hausse des prix galopante, ne peut que favoriser maintenant (après avoir favorisé l'an dernier pour des motifs électoraux la petite boutique par la loi Royer), le développement des gros distributeurs qui, par leur concentration, peuvent se permettre des marges bénéficiaires plus petites et donc des prix moins élevés.
Il est à noter que, pendant ces événements ni les paysans ni les commerçants n'ont songé à s'attaquer au prolétariat ou à le rendre responsable de la situation actuelle. Les syndicats d'exploitants agricoles, Nicoud et Leclerc, n'ont cessé de proclamer qu'ils étaient le meilleur défenseur du brave consommateur ouvrier. Belles paroles et distributions gratuites de vin et de viande auront alterné pendant ces événements.
c) Et le prolétariat ?
La peur qu'il lui inspire, le spectre de 68, explique que la bourgeoisie ne se soit pas encore attaquée directement à lui.
Jusqu'ici, la classe ouvrière française a conservé son ancien niveau de vie malgré l'inflation. Aux dires des économistes pour 1974, la hausse moyenne des salaires devrait être de 207 «pour une hausse des prix de 157» (on en est à 13% en septembre). Ce caractère encore "privilégié" du prolétariat français par rapport à ses frères de classe italiens, anglais, et même américains qui ont vu leur niveau de vie diminuer, explique que les ouvriers ne se soient guère manifesté depuis presque un an, même s'ils ressentent avec inquiétude les vertigineuses hausses des prix ou la diminution de la température dans les immeubles pour cet hiver.
La réaction du prolétariat à la crise se manifeste essentiellement dans "la défense de l'hmploi": les ouvriers des usines liquidées occupent les lieux de travail ou manifestent dans la rue (Titan-Coder à Maubeuge et Marseille, occupation du France, occupation des tanneries d'Annonay).
Il s'agit là d'une réaction défensive d'un tout petit secteur du prolétariat qui suit encore les consignes syndicales de "défense de l'outil de travail".
C'est à la fin de l'année que l'affrontement risque de se produire et sans doute d'abord dans 1’automobile, qui a été obligée de réduire sa production et qui, malgré cela, n'arrive pas à écouler ses stocks.
Pour des raisons de paix sociale, les industries de l'automobile ont maintenu l'emploi; il semble inévitable que le capital s'attaque aux travailleurs de ce secteur.
Ce qui veut dire, étant donné l'effet d'entraînement des ouvriers de l'automobile sur l'ensemble des travailleurs, un affrontement inévitable du prolétariat au capital.
En tout cas, pour le moment, le prolétariat se place dans l'expectative. Une veillée d'armes avant la guerre de classe.
LES GRANDES MANŒUVRES DU CAPITAL
Elles se situent à trois niveaux: le gouvernement, la gauche, les gauchistes, face à leur ennemi commun: le prolétariat.
a) Le gouvernement essaie de faire oublier la crise. Giscard continue la politique qu'il a entreprise depuis sa venue au pouvoir: celle de la poudre aux yeux par toutes sortes de mesures libérales.
Après le vote à 18 ans, la pilule libres et presque gratuite, il continue sur cette lancée. Il préconise l'abolition de la censure cinématographique. La lecture des journaux, sauf celle de quelques feuilles antimilitaristes est autorisée dans les casernes: les gauchistes devront donc trouver d'autres "libertés démocratiques" à obtenir et aller gesticuler ailleurs. Bien plus -ce qui a fait frémir plus d'un bourgeois de droite pas encore habitué à ces hardiesses-, Giscard n'a pas hésité à aller visiter une prison à Lyon et à serrer la main d'un prisonnier après les émeutes du mois di juillet: ce qui est "un comble" de la part du chef de l'ordre social existant avec ses tribunaux et ses prisons!
Chez les gaullistes l'heure est à la main tendue vers les communistes. Après Charbonnel (gaulliste "de gauche") prêt à s'entendre avec les communistes, les jeunes gaullistes ont rencontré les jeunes communistes. Soucieux de se frayer une place au soleil des postes ministériels et aussi antiaméricains et nationalistes les uns que les autres, les compères ne peuvent que s'entendre. Encore une fois on voit qu'il n'existe aucune différence de fond dans le programme des diverses fractions du capital.
Malgré la grogne gaulliste, Giscard a la situation bien en main. Le "Nouvel Observateur", et avant lui Lecanuet, faisait remarquer à juste titre que Giscard était en train de réaliser tout le programme de la gauche. Bref, une concurrence déloyale de la part de la droite qui se met à empiéter sur les chasses gardées de la gauche.
b) La gauche se prépare à son rôle de gestionnaire du capital en crise. Malgré les appels du pied de Lecanuet aux socialistes pour s'entendre et gouverner dans l'avenir sans les communistes elle est restée unie.
Elle cherche à montrer que face à la crise économique, à la décomposition sociale c'est elle seule qui peut se charger de maintenir l'ordre.
Les syndicats ont repris la même chanson du calme nécessaire. Séguy parle de forcer le patronat à discuter avec lui, ce qui a fort étonné et même inquiété le patronat qui attendait de ses commis de se montrer plus crédibles vis-à-vis de la classe ouvrière.
En tout cas, chez les syndicats, il s'agit d'interdire toute lutte ouvrière:
- "La CGT a eu plusieurs fois l'occasion, par la voix de ses militants les plus autorisés, de préciser qu'elle n'entendait pas compromettre par des exigences immédiates, insoutenables pour l'économie du pays, la réalisation d'un programme de la gauche qu'elle a soutenu depuis son origine." (Séguy au Figaro)
De leur côté, les partis de gauche aiguisent leurs armes gouvernementales.
Le P.S s'apprête à devenir un grand parti social-démocrate. La bourgeoisie française -qui dans son ensemble est pro-américaine, par nécessité- préfère avoir un parti de gauche atlantiste contrebalançant le P.C encore pro-russe. Un tel parti, plus démocratique, ne peut que favoriser l'emprise de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. Cette emprise du P.S, fort réduite d'ailleurs, sinon insignifiante commence à s' exercer par l'intermédiaire de la CFDT; l'adhésion prochaine du PSU au PS ne pourra que favoriser cette entreprise par l'apport d'éléments, ouvriers. Les trotskistes vont donc à nouveau s'interroger, et s'interrogent déjà sur la possibilité d'entrisme dans la nouvelle organisation "ouvrière". La grande maison est toute grande ouverte pour les enfants prodigues.
C'est le PC qui prépare le plus soigneusement son accession de futur garde- chiourme gouvernemental. Apparaissant comme le grand parti démocratique (grande fête de l'"Humanité" à La Courneuve) il lance une campagne de recrutement pour couper l'herbe sous le pied de son rival socialiste, ouvrant toutes grandes les portes de ses cellules. Pour montrer qu'il sera un parti social-démocrate comme les autres le PC ne manque pas une occasion de prendre ses distances à l'égard de la politique russe (vente des livres de Soljenitsyne à la fête de l'"Humanité", protestations contre la répression en URSS).
C'est lui qui représente le mieux le programme du capitalisme d'état qui s'impose à la bourgeoisie en période de crise, en dénonçant le capitalisme "monopoliste d'état" qui serait... occidental et non russe!
- "Globale, elle (la crise) affecte tous les domaines: économique, social, politique, culturel, idéologique, moral. Permanente, elle n'est pas une crise de conjoncture. Il s'agit de la crise du système capitaliste à son stade actuel où s'interpénètrent les monopoles et l'Etat, la crise du capitalisme monopoliste d’Etat".
Et, bien entendu, pour montrer que le capitalisme d'Etat ne subit pas la crise et que c'est le socialisme, on déclare: "Les pays socialistes ignorent l'inflation, la flambée des prix, le chômage, l'insécurité de la vie qui règnent dans le monde capitaliste." (Projet de résolution au XXI° Congrès extraordinaire) Ce type de propagande pro-russe risque d'ailleurs de disparaître étant donné l'état de crise avancée dans le bloc de l'Est (grèves sur les chantiers polonais de la Baltique en juillet; crise économique en Tchécoslovaquie)
Le PC représente en tout cas la défense la plus acharnée du capital national dans le sens le plus chauvin et le plus protectionniste. Ainsi, Ballanger, dirigeant du PCF, déclarait aux chambres d'agriculture qu'il fallait l’arrêt des importations qui concurrencent la production française et une véritable aide aux exportations.
c) Les gauchistes. Il est significatif que l'aile extrême du capital ait gardé le silence sur la crise dans ses journaux. Ils ne sont pas appelés pour l'instant à des responsabilités gouvernementales et leur rôle est de rabattre vers la gauche les ouvriers qu'ils influencent. Par exemple, Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière), préconise un soutien pur et simple de la gauche: "C'est aux syndicats ouvriers, c'est aux partis qui se réclament des travailleurs de proposer un plan d'action, s'ils sont vraiment dignes de la confiance que les travailleurs leur prêtent".
La gesticulation gauchiste a surtout porté cet été sur les commerçants, les paysans, les prisons et l'armée.
Expression de la petite bourgeoisie en décomposition, il est normal que les gauchistes défendent son existence. Ainsi les trotskistes à la suite des maoïstes et du PC, affirment que les "petits commerçants et les ouvriers ont des intérêts communs" (Lutte Ouvrière) et citent le programme de transition de Trotsky qui demande aux ouvriers de marcher "la main dans la main" avec les paysans et les petits commerçants.
Etrangers au prolétariat, il était normal que les gauchistes s'agitent sur les prisons et l'armée. Et de s'acharner à montrer que la révolte des prisons est une expression du prolétariat car la majorité des prisonniers est d'extraction ouvrière. Et de prétendre, comme le fait «Rouge',' organe du Front Communiste Révolutionnaire, que la manifestation de rue des soldats du contingent à Draguignan est révolutionnaire, sinon la révolution. C'est une excellente occasion pour eux de détourner l'attention du prolétariat du seul, vrai problème: l'affrontement organisé du prolétariat avec le capital et la destruction de ce dernier. Occasion aussi de se présenter comme les seuls vrais démocrates. "Rouge" N° 265 demande des "réformes" dans l'armée, "la solde à mille francs". Laguiller (Lutte Ouvrière, N° 316) chante les mérites de l'apprentissage des armes sur les lieux de travail et d'habitation, à l'exemple suisse.
Une fois de plus, les gauchistes assument pleinement leur fonction de rabatteurs du capital tachant de détourner les prolétaires de leur terrain de classe pour les placer sur le terrain des "réformes", de la défense de la petite bourgeoisie ou des marginaux, et donc, du capital national.
Lénine faisait déjà observer que la condition de la révolution prolétarienne était que "ceux d’en bas ne veuillent plus" et que "ceux d’en-haut ne puissent plus !"
La crise, encore lente en France, pour peu de temps, laisse le prolétariat dans l’expectative et permet toutes les manœuvres des forces politiques du capital.
Le fait nouveau en France ce sont les révoltes dans les prisons et l’armée, le cœur même de l’appareil de répression d’Etat. Ce sont des signes d’une décomposition sociale prononcée, au même titre que le développement de la drogue et de la pornographie. Le fait que la bourgeoisie voit son appareil de répression se gripper est un signe de son impuissance à contrôler la crise. Aussi met-elle rapidement en avant des mesures de réforme dans les prisons et l'armée, seule condition du maintien de son ordre social. Mais voir dans ces signes de décomposition une expression du prolétariat, comme le font les gauchistes, c'est nier que le prolétariat est la seule classe révolutionnaire dans la société. "Le prolétariat est seul contre toutes les autres classes" disait Gorter.
Pour les révolutionnaires, il est important de dénoncer sans relâche les gauchistes qui, de ces signes de décomposition sociale font l'essence de la révolution.
En France, sur toute la planète dominée par le Capital il ne peut y avoir qu'une révolution: PROLETARIENNE.
Si déjà la bourgeoisie montre qu'elle ne "peut plus", le prolétariat français sera tôt ou tard amené à ne "plus vouloir", "à faire irruption sur la scène politique" (comme le disait Trotsky quand il était encore un combattant du prolétariat), avec ses frères de classe du monde entier.
CHARDIN.
[1] Banque allemande qui a sombré
[2](1) Ce n'est pas seulement la bourgeoisie française qui est intransigeante mais encore plus celle d'Allemagne et des Pays-Bas qui, dans les négociations récentes de Bruxelles ont imposé un maximum de 57» de hausse des produits agricoles.
Situations territoriales:
- France [55]
- Situation sociale en France [56]
LES COMMISSIONS OUVRIERES : UNE ILLUSION CONTRE REVOLUTIONNAIRE
- 29 lectures
Toute organisation ouvrière de caractère permanent doit être analysée à partir des objectifs qu’elle poursuit. Dans le cas des commissions ouvrières, il existe une véritable résistance de la part des militants dits de "gauche" ou d’"avant-garde" à accepter l’idée que celles -ci soient orientées par une politique définie. Il existe toute une tendance qui voit dans les commissions ouvrières l’embryon de la future organisation de la classe sans autre objectif, dans le présent, que la "lutte contre l’exploitation".
Dans ce contexte, il est logique que ces militants pensent aussi que tout ouvrier combatif qui lutte se doive de rejoindre les commissions ouvrières. Il est logique également que, devant une dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des C.O, ils n’y voient qu’une tentative de les liquider.
Pourtant, les C.O. ont effectivement une politique, et de plus bien définie et concrète : "La lutte contre la dictature et la lutte pour un syndicat de classe". Et ces objectifs politiques nous pouvons les trouver dans n’importe quel tract des commissions; nous les trouvons dans l’activité-pratique de ses militants.
Quels que soient leurs efforts pour faire semblant de l’ignorer, tous ceux qui appuient les commissions sont en fait en train de défendre la même politique qui en 36 s’est concrétisée par la consigne : "D’abord gagner la guerre, contre le fascisme, après la Révolution socialiste". La même qui essaye de faire croire à la classe ouvrière qu’en renversant le régime de Franco et en donnant le pouvoir à la fraction démocratique de la bourgeoisie, l’exploitation sera moins dure.
Le fait que les commissions ouvrières soient dans la pratique la seule organisation qui regroupe un minimum d’ouvriers en Espagne ne peut servir de justification à l’ouvriérisme de faux ouvriers disposés à accepter n’importe quelle politique, à la condition que la classe ouvrière s’organise.
Il est évident qu’il existe toujours des organisations "ouvrières" au sein du capitalisme. La preuve en est l’existence des syndicats de différentes tendances, des organisations corporatistes, etc. Mais le fait que ces organisations soient composées d’ouvriers ne signifie pas nécessairement que ce soient des organisations de la classe ouvrière.
Ce qui fait qu’une organisation est révolutionnaire, ce sont ses objectifs de classe. Si la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire, c’est uniquement par la défense des objectifs de la classe ouvrière qu’une organisation peut jouer un rôle révolutionnaire.
Les positions défendues par les commissions ouvrières (lutte purement corporatiste, lutte syndicale, lutte antifasciste), ainsi que leurs formes organisatrices (hiérarchisation, bureaucratisation, domination occulte des partis politiques), les invalident comme organisations de la classe ouvrière, et ceci quel que soit le nombre d'ouvriers qui peuvent les rejoindre. La tâche des révolutionnaires est de lutter pour empêcher la classe de leur faire confiance.
Cependant, parler aujourd'hui des commissions ouvrières, c’est parler d’une poignée de militants des partis de "gauche" qui, dans l’usine, s’organisent en commission ouvrière. Plus de dix années de pratique syndicale et volontairement réformiste ont été suffisantes pour commencer à dévoiler au prolétariat le mensonge et la mystification constitués par les commissions ouvrières.
Mais, le fait que les commissions soient en crise ne signifie pas que la lutte de la classe ouvrière ne continue pas à se développer. La disparition de ses militants dans beaucoup d’entreprises, l’abandon de la commission par beaucoup d’ouvriers ont signifié dans un grand nombre de cas le renforcement de la lutte à travers d’autres organes, comme les assemblées d’usine, avec des comités contrôlés et révocables par l’Assemblée.
C’est à partir des années 69-70, quand -principalement en Catalogne et dans le nord de l’Espagne- coïncidant avec le début de la crise des commissions ouvrières, commencent à surgir des luttes d’une extrême dureté, qui sont toutes menées et dirigées par des assemblées d’usine, que la classe peut ainsi se passer des bons offices des C.O.
C’est pour cela que la critique des C.O. et leur dénonciation ne sont, d’aucune façon, une activité liquidationniste : C’EST LE MOUVEMENT OUVRIER LUI-MEME QUI PAR SA PROPRE LUTTE LIQUIDE LES COMMISSIONS. Mais, en même temps, le fait que les C.O. soient en crise ne signifie pas qu’elles aient disparu ou qu’elles soient en train de disparaître.
Le pouvoir contre-révolutionnaire des C.O. résident dans les positions qu’elles défendent, et ces positions, parce qu’elles sont celles de la bourgeoisie, ne disparaîtront pas avec les commissions mais, uniquement, avec la liquidation de la bourgeoisie. C’est pour cela que notre devoir de révolutionnaires consiste à dénoncer toutes les tentatives qui aujourd’hui, sous le nom de commissions ouvrières, et demain sous n’importe quel autre, tendent à faire dévier le prolétariat du chemin de la révolution prolétarienne pour le conduire dans l’impasse des luttes antifascistes, démocratiques ou de libération nationale.
NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES COMMISSIONS OUVRIERES
Coïncidant avec l’accélération du développement industriel, la lutte pour l’amélioration des conditions de vie s’est peu à peu généralisée à toute l’Espagne.
En 1962, les conditions particulières et conjoncturelles de ce développement industriel - étape suivant le plan de stabilisation de 1959 - permettent aux ouvriers pour la première fois depuis 1939, de tenter de défendre leurs conditions d’existence contre les détériorations subies jusqu’alors, d’oublier les guerres et les cartes de rationnement des années précédentes et revivre à nouveau l’illusion du réformisme, sans craindre une répression inexpiable du capital. Avec l’apparition des conventions collectives, s’ouvre une étape de négociation salariale dans laquelle les travailleurs interviennent activement en faisant pression par leur lutte.
C’est dans cette situation (théoriquement favorable pour qu’aussi bien les vieilles organisations syndicales: C.N.T., U.G.T., que d’autres nées dans l’après-guerre d’Espagne : USO, OSO, ASO, puissent jouer un rôle significatif) qu’apparaît, indépendamment de tout groupe politique une forme d’organisation ouvrière pour la lutte revendicative, qui rapidement éclipse les autres organisations illégales: les commissions ouvrières, COMMISSIONS D’OUVRIERS ELUS PAR L’ASSEMBLEE D’USINE.
Cependant, il serait faux de déduire que la crise et le rejet des organisations syndicales existantes ont signifié le rejet du syndicalisme par la classe ouvrière. Les organisations syndicales qui existaient comme l’USO, l’OSO, l’ASO n’ont jamais réussi à se développer dans la classe ouvrière comme syndicats d’opposition au syndicat vertical CNS.
En réalité, ces organisations étaient constituées uniquement et exclusivement de quelques groupes de militants d’organisations politiques (PSOE, PCE) s’employant à maintenir les vieilles positions de la période républicaine.
Débordés par les premières assemblées massives et confrontés à la nécessité de contrôler le mouvement ouvrier, ils ont démonté leurs organisations syndicales pour tenter de dominer les commissions ouvrières en en faisant le syndicat qu’eux-mêmes n’avaient jamais réussi à construire. C’est pour cela que la rupture avec les anciennes organisations ne signifie pas la rupture avec les conceptions syndicalistes.
Les fait démontrent clairement que les C.O. se sont donné comme activité fondamentale la défense des intérêts économiques des travailleurs. A la base de toutes les luttes des C.O. on trouve depuis le premier instant les revendications économiques.
Bien qu’un grand nombre de luttes aient été, du point de vue revendicatif de grandes défaites, il n’est pas moins certain également que dans certains cas (principalement avant la récession internationale de 1967-1968, fortement ressentie en Espagne) le prestige et le renforcement numérique des commissions étaient dus justement à la possibilité d’obtenir des améliorations immédiates à travers leur lutte. La convention collective provinciale de la branche de la métallurgie, les améliorations obtenues par les mineurs asturiens, etc. ont constitué un important tremplin pour le développement des commissions dans toute l’Espagne.
Et ceci est tellement vrai, que rares ont été les usines où la lutte ne se soit accompagnée de l’apparition d’une C.O., soit que celle-ci ait été le produit de la lutte, soit qu’elle ait été créée pour l’impulser et la diriger[1].
Mais, même dans les cas où une victoire a été remportée, celle-ci n’a pas tardé à se transformer en défaite. L’inflation permanente, les augmentations de productivité obtenues principalement à travers les accélérations des cadences et la hausse constante des prix alimentaires et des biens de consommation se sont chargées de récupérer amplement les augmentations salariales arrachées avec difficulté. Ce n’est un secret pour personne que les salaires perdent progressivement leur pouvoir d’achat et que la situation de la classe ouvrière espagnole, au même titre que celle de la classe ouvrière dans le monde entier (bien qu’il reste des gens pour penser qu’il s’agit dans le premier cas d’une ’’mauvaise gestion” du capitalisme espagnol), ne fait qu’empirer.
Avec la récession de 1968 et l’état d’exception qui l’a suivie, les "illusions" de victoire des années antérieures se sont évanouies. Avec elles, les assemblées massives dans les champs, l’utilisation des "possibilités légales", la semi-légalité des dirigeants des commissions ouvrières, l’occupation des locaux syndicaux, les succès revendicatifs à l’occasion de la négociation des conventions collectives, etc. ont fait place aux arrestations, emprisonnements, déportations, expulsions ou démissions des charges syndicales, à l’impossibilité d’obtenir des améliorations réelles et durables. Tout cela a mis en lumière clairement et ouvertement le véritable visage d’un système devenu incapable d’accorder à la classe ouvrière la moindre amélioration.
LE SYNDICALISME DE GAUCHE
La crise des commissions ouvrières, leur incapacité à encadrer la classe ouvrière espagnole derrière les objectifs de lutte pour un ’’syndicat de classe” et pour la démocratie bourgeoise, ont provoqué le départ d’un nombre important de leurs militants et leur organisation autonome en dehors des dirigeants permanents du mouvement.
Cette rupture, qui dans certains cas suppose la, critique de la politique des commissions ; (syndicalisme, pacte pour la liberté), république démocratique, etc.), s’accordage en règle générale de 1’organisation de nouvelles commissions situées à la gauche du PCE et de "Bandera roja’.* Au sein de ces nouvelles commissions, on voit ndJliter en grande majorité des éléments d'organisations politiques minoritaires.
Mais pour la majorité de ceux-ci, la crise des commissions ouvrières se réduit à la "bureaucratisation", au manque "d'organisation réelle dans les entreprises" et au contrôla des partis politiques". Ce seraient les dirigeants' qui empêcheraient 1’extension et la consolidation des commissions ouvrières.
Dans un document édité par les "Groupes ouvriers autonomes", on trouve l’analyse suivante de la crise des C.O. :
- "Ceux qui ont supporté les conséquences de ce sectarisme, ce sont nous les travailleurs, à cause de notre inexpérience. Pendant que nous étions en train de lutter dans les usines et dans les mines, nous avons laissé nos prétendus représentants détruire ce que nous avions commencé à construire. Déboutés, déçus, nous avons abandonné tous ces faux représentants de la classe ouvrière et nous continuons de lutter sur nos lieux de travail ; Nous organisons des grèves comme on n’en avait vu depuis de nombreuses années. Au Pays basque : laminoirs de Bandas, hauts-fourneaux, la "Naval"; aux Asturies : les mines et la métallurgie; à Pampelune : "Eaton Ibérica" et "Potasses de Navarre". "Harry-Walker", "Blausol" , "Macosa", "Maquinista" à Barcelone; "Aviation" et "Saca" à Séville; "hauts-fourneaux à Sagunto, etc., sont des noms qu’on n’oubliera pas, car ils correspondent à des grèves héroïques, quelquefois modèles d’organisation, auxquelles il a manqué pourtant la solidarité et l’appui que permet seule une union large et solide."
"Le prolétariat espagnol a montré sa combativité, mais il a été incapable de créer une organisation en rapport avec ce haut niveau de lutte et facteur de son amplification. Pendant ce temps, les bureaucrates et les membres des partis se distribuaient la dépouille de ce qui aurait pu être la grande organisation de la classe.
Il ne faut accuser personne, sinon nous-mêmes, du fait que nous n’ayons pas encore été capables de créer une organisation ouvrière, capable de défendre nos intérêts. La tâche de la bourgeoisie et de ses alliés dans le mouvement ouvrier est de créer la division entre les travailleurs. Ce serait trop facile d’accuser les capitalistes qui essayent de défendre leurs intérêts. C’est là leur "mission.
- "Mais le nôtre est de nous organiser et d’empêcher l’infiltration d’éléments étrangers à notre organisation ; Pour cela les travailleurs, nous qui menons la lutte dans l’entreprise devons prendre la responsabilité d’établir la coordination indispensable entre les entreprises en vue du soutien mutuel et de l’élaboration d’un programme d’action. Cela doit être notre tâche, tâche que nous ne devons pas laisser entre les mains de professionnels au service d’intérêts de groupes qui ont la tête pleine de faux problèmes idéologiques, pour la défense desquels ils sont capables de détruire une organisation dont la construction nous a coûté des années d’efforts et de sacrifices..."
Pour eux donc tout le problème se résume à empêcher que les "dirigeants" des "partis” ne se glissent dans l’organisation des ouvriers. Comment l’empêcher?... En expliquant aux ouvriers la nécessité de s’organiser pour la lutte pour des améliorations économiques et sociales de tous types (plus de la moitié du document cité est consacrée à expliquer toutes les revendications capables d’impulser ou de radicaliser la lutte dans l’usine), en expliquant comment s’organise une commission ou autre organisation similaire, en expliquant comment élaborer une plate-forme revendicative qui ait un écho parmi la majorité des travailleurs de l’entreprise, ou les moyens pour la faire connaître (bombages, tracts, papillons, etc.), en organisant les ouvriers les plus conscients, etc.
La seule chose qu’ils ne proposent pas est la dénonciation constante de la politique desdits groupes -les intérêts de classe deviennent pour eux des intérêts de groupe !-, groupes avec de "faux problèmes idéologiques" qui détruisent l’organisation mise en place avec tant de sacrifices... Il s’agit seulement de "bureaucrates", "d'hommes de parti", de "professionnels", "d'éléments extérieurs".
Dénoncer les intérêts de classe défendus par les politiques de ces groupes supposerait de leur part la définition d'une autre politique distincte de celles-ci, et cela les convertirait automatiquement en un autre groupe du type de ceux qu'ils veulent combattre.
Ainsi, en évitant d'aborder les questions qui pourraient diviser la classe ouvrière en plusieurs fractions[2] (voir note 2 page suivante), telles que le syndicalisme dans la phase de décadence du capitalisme, les luttes de libération nationale, le capitalisme d'Etat, etc., ils proposent eux-mêmes le plus grand confusionnisme et finissent par défendre les mêmes positions que le PCE ou très semblables.
A la page 44 du même document déjà cité, ils donnent un exemple des avantages qu’apportera d'après eux au prolétariat "l’union" pour l'union :
..."Là où elle fut obtenue (il s’agit de l’union) : Russie, Chine, Cuba, Syrie, Algérie, Zambie, Vietnam, etc., les travailleurs ont arraché le pouvoir aux capitalistes. En d’autres endroits, ils sont sur le point d’atteindre ce résultat (Amérique du sud) et dans d’autres enfin, ils disposent d’organisations capables de défendre leurs droits les plus élémentaires : France, Angleterre, Italie" (souligné par nous).
C’est à dire, dans une série de pays où règne le capitalisme d’Etat, à différents degrés de son développement, les travailleurs auraient "arraché le pouvoir aux capitalistes". Dans d’autres d’Amérique latine où le prolétariat se débat dans la mystification de la lutte anti-impérialiste que fait peser sur lui ses différentes bourgeoisies nationales, il serait "sur le point d’atteindre ce résultat". Enfin, dans une série de pays d’Europe occidentale, où ces organisations (PC, syndicats) présentées comme un modèle, se révèlent être un des obstacles essentiels à leur lutte, les ouvriers disposeraient d’organisations "capables de défendre leurs droits les plus élémentaires"...
C’est pourquoi, quelles que soient les extinctions de voix gagnées à crier contre le bureaucratisme, entendant par intérêt de classe le droit de vote au sein d’organisations qui n’ont rien à voir avec la classe, entendant par autonomie ouvrière 1’exclusion des groupes politiques, "les groupes ouvriers autonomes" NE PEUVENT EVITER QUE LEURS COMMISSIONS ANTI-BUREAUCRATIQUES NE RESSEMBLENT COMME UNE GOUTTE D’EAU A UNE AUTRE, AUX COMMISSIONS DU PCE, DU PCI, OU DE "BANDERA ROJA".
Partir de la base, comme ils disent, et en s’appuyant sur leur longue expérience de lutte dans les usines, concevoir l’idée que pour pouvoir parler de socialisme aux ouvriers il est d’abord nécessaire de "gagner leur confiance" (vivre avec eux, parler des mêmes choses qu’eux) considérer que dans un premier temps les ouvriers ne s’organisent que pour la lutte économique et que par suite les révolutionnaires doivent baser leur travail d’organisation sur ce type de lutte comme condition nécessaire, pour pouvoir passer ultérieurement à un "niveau supérieur" et enfin qualifier toute cette activité de simple "procédé pédagogique " pour atteindre l’objectif fondamental (la révolution socialiste), tout cela suppose dans la pratique la défense des mêmes positions que celles des commissions ouvrières qu’ils accusent de bureaucratisme, suppose aussi agir de la même façon dirigiste et manœuvrière que celle de ceux qu’ils accusent d’être de "faux dirigeants" et des "éléments extérieurs" à la classe. En fait, il ne s’agit de rien d’autre que de bureaucratisme anti-bureaucratique.
A ces camarades attelés à la création de nouvelles C.O. nous disons : Ce ne sont pas les révolutionnaires qui créent à l’avance les organisations dans lesquelles le prolétariat s’affirmera comme classe dominante. C’est là PRATIQUE de la classe elle-même, à travers les différentes étapes de la société qui la conduit à la conscience de ses intérêts économiques et politiques. SON ORGANISATION est inséparable de sa CONSCIENCE. La tâche des révolutionnaires consiste à montrer à tout moment la véritable raison du combat et JAMAIS ni par pédagogie ni par "tactique", ni pour toute autre raison, ceux-ci ne peuvent cacher à la classe le véritable sens de sa lutte.
Si aujourd’hui les commissions ouvrières n’arrivent pas à s’implanter, à englober la majorité des travailleurs, être en définitive l’organisation unitaire, démocratique, autonome et représentative, ce n’est pas parce que certains groupes pleins de bureaucrates les boycottent.
C’est ailleurs qu’il faut chercher les raisons de leur crise. Et c’est dans la maturation de la conscience du prolétariat, dans l’assimilation de toutes les expériences de la lutte -aux côtés des commissions- qu’on les trouvera. Le syndicalisme, le réformisme impossible, la démocratie bourgeoise, la pactisation, la négociation, les formes de luttes civiques... toute une politique en définitive profondément étrangère aux intérêts du prolétariat. C’est cela qui constitue la raison de leur crise et de l’existence du bureaucratisme en leur sein.
Les bureaucrates sont le produit de leur politique. Attribuer la crise des commissions aux bureaucrates sans dénoncer leur politique contrerévolutionnaire équivaut à défendre l’idée qu’en remplaçant quelques dirigeants déloyaux par des révolutionnaires, il serait possible de changer toute l’organisation et de la rendre révolutionnaire. Mais ce ne sont pas les chefs qui font l’organisation, sinon exactement le contraire.
COMMISSIONS OUVRIERES ET LUTTE REVENDICATIVE
A la base des CO, qu’elles soient "locales", "de secteurs" ou de "plateformes", on trouve un même objectif : l’organisation de la classe ouvrière de façon permanente pour la lutte revendicative, la formulation de programmes "tactiques" plus ou moins réformistes.
C’est pourquoi, en tant que portes paroles infatigables de la lutte revendicative, les CO deviennent le frein le plus puissant pour l’unification de la classe ouvrière parce que celle-ci ne peut s’unir qu’à travers le mouvement qui la mène vers la révolution socialiste, c’est à dire à travers le mouvement qui brise les chaines qui tentent de la maintenir attachée à des programmes tactiques masquant ses véritables objectifs révolutionnaires.
Dans la période de décadence du capitalisme, toute organisation permanente de 1’ensemble de la classe ne peut exister que sur la base de la révolution socialiste.
En général, toutes les luttes revendicatives (pour des salaires plus élevés, des journées de travail plus réduites, des cadences moins épuisantes, etc.) conduisent à un affrontement avec l’état (occupations d’usine, heurts contre les forces répressives de l’état, arrestations, etc.) c’est à dire que de revendicatives, la majorité des luttes TENDENT A PRENDRE DE PLUS EN PLUS UN CARACTERE REVOLUTIONNAIRE.
L’activité systématique des commissions ouvrières dans ce processus est révélatrice : négociations constantes avec le patron, justification de l’affrontement avec l’état UNIQUEMENT à travers le caractère fasciste de celui-ci en masquant le fait que c’est la BOURGEOISIE COMME CLASSE QUI EXPLOITE LE PROLETARIAT et non les secteurs fascistes... En définitive les C.O. ne cessent d’agir comme le bouchon d’une bouteille pour que la force révolutionnaire qui existe à l’état latent en chaque lutte, pour petite qu’elle soit, ne puisse trouver de sortie.
De cette façon, l’unité de tout le mouvement ouvrier dont on jacasse tant, les mène à identifier l’organisation des commissions avec celle de la classe et celle-là avec un "syndicat de classe".
Voyons ce que dit le compte-rendu de la première réunion nationale des "secteurs de commissions ouvrières":
- "Avec toutes leurs imperfections, traînant avec elles de nombreux défauts et surtout avec un grand décalage entre leurs possibilités réelles et les véritables nécessités organisationnelles de la classe ouvrière, ces nouvelles commissions[3] apparaissent déjà comme l’embryon d’un syndicat de classe. Et elles le sont, non seulement parce qu’elles font de la conquête d’un syndicat leur objectif politique le plus important, mais aussi parce qu’elles essaient dès maintenant d’assumer les taches propres à un véritable syndicat ouvrier : améliorer les conditions de salaire et de vie des travailleurs, forger leur unité, impulser la lutte solidaire et la généralisation des conflits, encadrer tous les ouvriers derrière des objectifs politiques clairs et enracinés dans les masses" (document cité plus haut, p.3).
Il apparaît donc d’une façon parfaitement claire que la lutte revendicative pour laquelle elle se propose d’organiser la classe ouvrière n’exprime pas la nécessité d’une révolution prolétarienne sinon la nécessité de conquérir le droit au... "syndicat de classe".
En d’autres mots, elles veulent dire que pour la bonne marche de la lutte revendicative, pour obtenir des améliorations, il est nécessaire de faire appel à un syndicat. Ceux qui pensent ainsi doivent croire fermement dans les possibilités encore progressistes du système capitaliste ; pour eux, parler de la décadence et de la crise doit sonner comme une plaisanterie de mauvais goût : le capitalisme -nous diront-ils s’ils sont conséquents- n’est ni un système social mondial, ni un frein au développement des forces productives...!
Dans le cas contraire, comment peuvent- ils prétendre qu’un syndicat est l’instrument pour obtenir des améliorations de toute sorte (fondamentalement économiques) de la part d’un système qui, pour survivre, ne peut offrir autre chose qu’une exploitation tous les jours plus effrénée ?
Quant aux "objectifs politiques clairs derrière lesquels ils se proposent d'encadrer toute la classe travailleuse", ils les définissent comme la lutte contre la DICTATURE pour une DEMOCRATIE bourgeoise qui doit se concrétiser dans la "République Démocratique Bourgeoise".
C’est cela la clarté politique des ’’Commissions ouvrières de secteurs” et de "Bandera Roja". Nous ne pouvons faire moins que les féliciter pour la "clarté" et la "cohérence" avec lesquelles ils oublient et mettent aux archives la révolution prolétarienne. Au moins, la classe ouvrière et leurs propres militants ne se feront pas d’illusions sur les objectifs de ces organisations.
Devant cette définitions de la lutte revendicative identifiée avec la lutte syndicale, nous devons prendre en considération les faits qui se produisent dans le monde entier et qui indiquent la perspective révolutionnaire : c’est vrai que la lutte pour un "syndicat de classe" est une lutte "revendicative’,' mais sont également des luttes revendicatives toutes celles qui se déroulent dans les pays capitalistes (où les syndicats ouvriers existent) en dehors et contre les syndicats. Nous voulons parler concrètement des grèves dites "sauvages". Dans ce cas les luttes économiques qui sont aussi des luttes revendicatives, ne peuvent en aucune façon s’identifier avec la lutte syndicale. Aujourd'hui, dans le monde entier, et particulièrement en Europe, la lutte de la classe ouvrière pour ses revendications économiques tend à se développer avec de plus en plus de force en dehors des syndicats.
Et en même temps que se développe cette tendance, nous voyons comment les syndicats (ET L’EXEMPLE DU PORTUGAL LE REAFFIRME EN TOUTE CLARTE) sont les premiers à réclamer de leurs gouvernements respectifs la promulgation de lois contre les "grèves sauvages", en même temps qu’ils sont devenus les fers de lance de la répression de toute lutte qu’ils ne contrôlent pas : la grève général de mai 1968 en France a été un exemple limpide de l’efficacité de la CGT française (courroie de transmission du PC français) dans la tâche de liquidation de la lutte. En Pologne, en 70, les ouvriers de la Baltique ont été obligés d’affronter et de détruire matériellement leur "syndicat ouvrier".
Quand en Espagne, les Commissions ouvrières affirment que leur objectif fondamental est la conquête d’un "syndicat de classe", elles préparent dans la pratique, la subordination de toute lutte à l’atteinte de cet objectif. De cette façon, sous le slogan de "liberté syndicale", on essaie de mystifier le véritable contenu de la lutte. Quand celle-ci déborde à intervalles de plus en plus rapprochés le cadre syndical et fait montre de sa véritable perspective révolutionnaire, les C.O font tout leur possible pour canaliser toute l’énergie et le potentiel révolutionnaire du prolétariat et les DEVIER vers le syndicalisme stérile et contre-révolutionnaire. C’est là le sens véritable de la consigne ’’pour un syndicat de classe”.
Dans un autre paragraphe du document de la réunion nationale des C.O de secteur, sont analysées les causes de la crise des commissions. Voici les arguments :
- ”Et il ne s’agit pas seulement de l’existence de ces organisations -les C.O-, mais aussi de leur fonctionnement, de leurs critères organisationnels et de travail, de leurs objectifs politiques. Là se trouve réellement le problème.
Nous ne faisons rien de neuf en parlant des C.O. Nées comme on le sait en 1962, dix années de vie ont montré l’évidence que les orientations qu’elles ont reçu pendant une longue période n’ont pas contribué à faire des C.O une organisation vraiment unitaire, vraiment développée, vraiment enracinée. Dans beaucoup de cas, c’est le contraire qui est advenu, ces orientations (de concevoir les commissions comme un mouvement désorganisé, appuyé seulement sur des chefs plus ou moins prestigieux, de forcer la légalité au-delà-de-ce qui pouvait se faire sans mettre à découvert tout son appareil et squelette organisationnels, de transférer toute la responsabilité dans la direction des luttes à ceux de leurs militants occupant des charges syndicales) ont conduit les CO de plusieurs centres industriels importants à perdre leur efficacité, à être victimes de la répression, à l’incapacité à faire face aux nécessités croissantes de la lutte ouvrière" (document cité, page 2).
La remise en cause de toutes ces "PETITES CHOSES" facilement corrigibles(mettre leurs propres dirigeants à la place des autres, ne pas laisser la direction de la lutte à des chefs "prestigieux” ou assumant des charges syndicales)s’est traduite dans la pratique par la manipulation des luttes par de nouveaux dirigeants avec plus de "prestige’’(plus crédibles par les ouvriers)se substituant aux assemblées d’usine, par la direction des luttes en accord avec la légalité ,(en essayant de toujours respecter la législation bourgeoise du travail),par le pacte et la négociation et par leur canalisation à travers le syndicat vertical.
Avec ces "petites choses", les commissions "locales" et les autres ont boycotté la lutte de Macosa et encore plus clairement celle d’Harry Walker. Dans celle-ci, une des plus longues et dures de ces dernières années à Barcelone, parce qu’il n’y avait pas de commission pour se mêler du combat, parce qu’il n’y avait pas de charges syndicales qui puissent le "diriger" , c’est l’Assemblée Générale de tous les travailleurs de l’usine qui a dirigé leur propre lutte et Leur a permis de ne pas se laisser tromper aussi facilement.
Le seul fait d’observer que bien qu’ils n’arrivent pas à étendre les commissions, à les implanter réellement dans les entreprises, la lutte du prolétariat, AU LIEU DE FAIBLIR SE REFORCE CONSTAMMENT (même sans commission renforcée et coordinatrice) devrait suffire à ces gens pour les faire réfléchir sur la validité de leur politique, sur les intérêts de classe que celle-ci défend. Et encore plus quand leur tâche fondamentale ,1a lutte revendicative,(pour de meilleurs salaires, la durée du travail les cadences, etc. ;) est menée à bien, de façon spontanée, par les travailleurs sans une commission qui ait à leur dire : "camarades, il faut lutter.”
Mais non, il ne s’agit pas d’une question d'objectifs politiques. Il s'agit simplement de quelques "défauts" facilement corrigibles... quatre retouches par-ci par-là et le tour est joué ! Nous avons des commissions ouvrières toutes neuves!
C'est de cette façon que ceux qui défendent avec le plus d'abnégation la lutte revendicative du prolétariat, ceux qui se trouvent le plus souvent à sa tête, deviennent ses bourreaux les plus impitoyables quand celle-ci montre son caractère révolutionnaire. Et ils ne font pas cela par mauvaise foi ou mauvaise volonté.
TOUTE ORGANISATION SYNDICALE EST' INEVITABLEMENT CONDAMNEE A JOUER CE ROLE DANS LA PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME.
Quelle est notre position à l'égard de la lutte revendicative ?
Depuis que le prolétariat existe comme classe, c'est à dire comme un ensemble d'individus socialement déterminés par une situation matérielle commune, sa lutte révolutionnaire garde inévitablement un caractère de lutte revendicative.
L'histoire du mouvement ouvrier se refuse obstinément à marquer une séparation entre lutte revendicative et lutte révolutionnaire.
Aussi bien la majeure partie des luttes n'ont pas réussi à dépasser le cadre purement revendicatif et n'ont pu être que potentiellement révolutionnaire, aussi bien il n'a pas existé une seule lutte révolutionnaire qui n'ait été simultanément revendicative.
Le mouvement révolutionnaire de 17 en Russie est extrêmement éloquent à cet égard. La classe ouvrière se lance dans la lutte révolutionnaire poussée par la misère économique et par la guerre. Le mouvement s'unifie et se renforce à travers la lutte pour une revendication : la PAIX.
La bourgeoisie ne peut céder à cette revendication et pour l'obtenir le prolétariat ne peut que poursuivre le combat jusqu'au bout: LA."DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS.
Ce qui a distingué la fraction la plus avancée du prolétariat, le parti bolchevik, des fractions de la bourgeoisie russe(mencheviks et socialistes révolutionnaires) CE NE FUT PAS DE DEFENDRE LA LUTTE POUR LA PAIX CONTRE LA GUERRE, MAIS DE MONTRER LA VERITABLE SIGNIFICATION, LA VERITABLE RAISON DU COMBAT DU PROLETARIAT RUSSE : LA REVOLUTION PROLETARIENNE.
De la même façon, la réponse contre l'attaque fasciste de juillet 1936 était potentiellement révolutionnaire. Si elle a conduit à la défaite la plus tragique ce fut parce que la gauche du capital (les partis communistes dirigés par le P.C. d'Union Soviétique) a réussi à mystifier, encadrer et vider de son contenu révolutionnaire, le véritable sens du combat du prolétariat. La défaite du prolétariat espagnol a été la préparation au massacre du prolétariat mondial ; la seconde guerre impérialiste mondiale. La crise capitaliste a pu se résoudre momentanément à travers la guerre impérialiste et la perspective de la révolution socialiste a du s'éloigner.
En Espagne, durant la guerre de 1936, s'est exprimé le caractère révolutionnaire de la lutte contre le fascisme. Les partis socialiste, communiste, la C.N.T et le P.O.U.M, en compagnie des bourgeois républicains et nationalistes ont réussi à mystifier et encadrer le prolétariat derrière la république bourgeoise, et à vaincre la révolution. Octobre 1934 aux Asturies et mai 1937 à Barcelone sont des exemples clair: de la façon dont les partis du capital déguisés par les noms de "communiste" ou "socialiste" sont les bourreaux de la révolution.
On nous dira alors que nous, révolutionnaires, avons pour tâche principale de provoquer les luttes revendicatives. A ceux qui pensent ainsi, nous répondons que ce n'est PAS NOTRE TACHE. LA LUTTE REVENDICATIVE N'EST L'INVENTION GENIALE D'AUCUN REVOLUTIONNAIRE INSOMNIAQUE, elle existe depuis la naissance même du prolétariat et avec celle-ci, sa potentialité révolutionnaire.
Dans la phase ascendante du capitalisme (quand c'était un système social capable de développer les forces productives jusqu'à des limites insoupçonnables) le capital a connu ses moments de plus grande richesse et développement. Celui-ci pouvait concéder des réformes et des améliorations réelles et durables à la classe ouvrière en lutte, aussi bien dans le domaine économique (diminution de la journée de travail, augmentation de salaires, etc.) que social (droit à la libre association, à la syndicalisation, suffrage universel, etc.) sans que l’économie soit mise en danger. Il y avait dans le monde de nouveaux marchés à conquérir. Seuls, des "débordements révolutionnaires” des luttes revendicatives marquent cette période.
Pendant celle-ci, la classe ouvrière unifiée à travers les syndicats et les partis parlementaires, développe sa lutte sans que celle-ci conduise directement à l’affrontement avec l’Etat bourgeois. Le Capital est suffisamment riche et les marchés suffisamment nombreux pour que le système puisse ne pas être mis en péril par les concessions que la lutte ouvrière l’oblige à faire. La révolution sociale ne peut pas être à l’ordre du jour.
Quand le Capital entre dans sa phase de décadence, les luttes se transforment beaucoup plus rapidement et fréquemment en luttes révolutionnaires parce qu’il ne peut pas concéder de véritables réformes, parce que toute concession doit être rapidement RECUPEREE, parce que c’est AU SEUL PRIX DE LA CONSTANTE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA CLASSE OUVRIERE QU’IL PEUT RETARDER SA CRISE DEFINITIVE.
Ce qui a changé dans la phase de décadence du capitalisme, c’est que ces luttes revendicatives sont de moins en moins de simples luttes économiques, QUE LEUR NATURE ET LEUR POTENTIEL REVOLUTIONNAIRE SURGIT BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT QU’AU SIECLE DERNIER.
Mais aujourd’hui comme hier, la lutte revendicative de la classe ouvrière n’est l’invention d’aucun révolutionnaire, le résultat d’aucune "tactique miraculeuse". En elle, aujourd’hui comme hier, est contenue sa potentialité révolutionnaire. Et c’est fondamentalement parce que la classe ouvrière commence, après 50 années de contre-révolution, à comprendre le sens véritable de sa lutte, qu’elle rejette de plus en plus souvent à l’ECHELLE MONDIALE les tentations du Capital pour l'encadrer et l’intégrer.
Aujourd'hui les organes qui peuvent paraître idéaux pour mener à bien sa lutte (syndicats, organisations permanentes pour sa lutte revendicative, etc.) sont non seulement ABANDONNES par la classe mais aussi, POUR ETRE DEVENUS DES INSTRUMENTS DU CAPITAL, doivent être affrontés et détruits par celle-ci si elle veut développer de façon conséquente sa lutte.
Ceci est la leçon, entre autres, des luttes de la classe ouvrière polonaise, quand, en 1970, devant la hausse des prix décidée par le gouvernement "socialiste" de Gomulka, elle s'est jetée dans la lutte, affrontant les milices du gouvernement, le P.C polonais et les syndicats. Dans sa lutte elle a organisé des conseils ouvriers dans les usines et a généralisé la grève sauvage contre les syndicats. Ce n'est qu'avec les armes que les "socialistes" et les "syndicats ouvriers" ont pu vaincre la classe ouvrière polonaise.
Alors que la tâche des agents du Capital au sein de la classe ouvrière est de CACHER le caractère révolutionnaire de la lutte revendicative de la classe ouvrière, de la FREINER et de 1'ENCADRER derrière les objectifs du Capital pour qu’elle perde sa potentialité révolutionnaire, la tâche des révolutionnaires est de montrer à chaque instant son véritable contenu.
- "Nous ne nous présentons pas devant le monde en doctrinaires, armés d’un nouveau principe : voici la vérité, mets-toi à genoux ! Nous ne lui disons pas : abandonne tes luttes car ce sont des sottises ! Nous ne faisons que lui montrer la vraie raison de sa lutte : la conscience est quelque chose qu'il doit faire sienne qu’il le veuille ou non !" (Marx, lettre à Ruge)
NOTRE OBJECTIF N'EST PAS DIFFERENT. Ce qui distingue les révolutionnaires aujourd’hui ce n'est pas leur "popularité", leur "capacité à attirer les masses" ou leur talent pour "gagner la confiance des secteurs bourgeois".
Contrairement à ceux qui vendent la révolution et trahissent le prolétariat en défendant les objectifs du Capital pour ne pas "se voir isolés des masses ouvrières", les révolutionnaires savent qu’en indiquant les buts véritables de la lutte ils seront très souvent "impopulaires" qu’ils seront traités de "provocateurs gauchistes" dans les moments de recul de la lutte, de "diviseurs de la sacro-sainte unité", d’"Agents de la réaction", et même de collaborateurs avec le fascisme quand ils dénonceront le populisme et les fronts démocratiques tant à la mode, comme les feuilles de vigne du Capital.
ACCIÓN PROLETARIA.
[1] Durant toute une période, les commissions ont surgi dans une multitude d’usines, au feu des mouvements de grève qui se sont développés en Espagne à partir du début des années 60. Elles surgissaient, disparaissaient, reparaissaient au rythme des progressions et des reculs de la lutte.
Cette instabilité dans leur continuité, en tant qu’organisations, constituait une entrave énorme pour la formation d’un ’’syndicat de classe”. C’est pour cela que les partis de gauche avec en tête le PCE ont impulsé la création d’organismes permanents hiérarchisés et exécutifs (coordinations locales, régionales, provinciales, nationales) qui, indépendamment de la conjoncture et de la lutte, se sont efforcé d’orienter politiquement tous les ouvriers et toutes les luttes - aussi partielles et éparses qu’elles aient pu être - vers un même but : la lutte contre la dictature et pour des réformes corporatistes.
Et ce fut le PCE, grâce à son potentiel financier et propagandiste, qui put, dans presque toute l’Espagne, se rendre maître de ces organisations. Il n’a pu développer sa politique de "réconciliation nationale "et de" pacte pour la liberté" qu’à la condition de disposer d’un certain poids et d’un certain contrôle parmi les travailleurs. Avec les commissions ouvrières il a trouvé sa ’’chair à canon”.
L'impossibilité d'obtenir des améliorations réelles et durables a provoqué chez les ouvriers une apathie et une résistance à s'organiser de façon stable dans les commissions ouvrières. De plus en plus, et principalement à partir des années 70, les luttes -qui n’ont décru ni en quantité ni en intensité- se sont déroulées en marge de l’organisation officielle des commissions ouvrières.
De nouveau, les luttes se déroulent avec des assemblées d’usine, comités unitaires, etc. ; en dehors et quelquefois contre les commissions.
Aujourd'hui, on peut dire que les commissions ouvrières ne sont rien d’autre qu’une organisation formée uniquement par les militants des groupes politiques qui refont de celles-ci des organisations identiques à ce qu'étaient les USO, OSO, etc.
[2] la classe ouvrière ne peut se diviser en deux moitiés : l’une révolutionnaire, l’autre réactionnaire. La classe ouvrière est la classe révolutionnaire dans son ensemble. Des ouvriers pris comme individus (bien qu’en nombre ils puissent constituer une majorité) peuvent faire leurs les intérêts d’une autre classe et par là s’opposer aux intérêts de leur classe.
[3] Il s’agit des "secteurs" de C.O. opposés aux vieilles commissions "locales" où le PCE est prédominant.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La bourgeoisie face à la crise (2ème partie) - Centralisation du capital et des classes moyennes
- 17 lectures
La crise accélère la tendance vers une centralisation du capital aux dépens des secteurs les plus faibles du capital, ainsi que de Ta petite-bourgeoisie et des petits paysans. La part de la plus-value globale qui est à présent appropriée par ces éléments sera de plus en plus appropriée par le grand capital, qu’il se présente sous sa forme monopolistique ou d’État. L’exemple le plus flagrant de l’accélération de ce processus a été l’attaque récemment menée par les compagnies pétrolières contre les entreprises de raffinerie et de distribution indépendantes. L’approvisionnement en pétrole brut des raffineries indépendantes a été coupé et les stations-service indépendantes, en plus des ”restrictions” de pétrole, se sont vu concurrencer par les ventes à plus bas prix des compagnies qui tentaient ainsi de les ruiner. De cette façon, ces dernières espéraient s’emparer des 20% du marché de raffinerie et de détail qui leur échappaient jusqu’à présent. Le même phénomène se produit dans l’industrie des transports, où les camionneurs indépendants ont dû faire face à une vigoureuse attaque des grandes compagnies de transports routiers qui, pour faire face à la crise, ont tenté d’étendre leur emprise en poussant à la faillite leurs concurrents aux moyens plus limités .
Les politiques déflationnistes qui sont appliquées partout ont des conséquences particulièrement catastrophiques pour le petit capitaliste, le boutiquier et le petit paysan. Des impôts plus élevés et une politique du crédit restrictive, à travers lesquels le capital espère freiner l’inflation galopante, font des ravages dans leurs rangs. Aux USA, le taux d’intérêt est monté jusqu’au chiffre record de 11,5% en mai. Les économistes gouvernementaux ont admis que les ”petites entreprises payent à présent 14 à 16% sur des prêts à court terme et les banques leur refusent des extensions” (Newsweek,10 juin 1974). Incapables de financer leurs opérations, les petits capitalistes et les boutiquiers font faillite à un rythme accéléré. La somme totale des dettes des compagnies banqueroutières dépasse de loin $ 200 millions par mois, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à 1973. C’est évidemment le grand capital qui tirera profit de cette vaste opération de ”nettoyage".
Face à ces politiques gouvernementales, la petite bourgeoisie (boutiquiers, camionneurs indépendants, petites stations-service, etc.) a, contrairement aux propriétaires de petites et moyennes usines, démontré leur volonté de riposter par des formes violentes de lutte afin de défendre leurs privilèges de classe possédante.
En France, en Novembre 1973, à la suite de fortes augmentations d'impôts, les petits commerçants qui vendent au détail une grande part de la production agricole se sont mis en grève pour faire diminuer les nouveaux impôts qui venaient, menacer leurs profits. Partout en France les marchés de gros ont été fermés, et les supermarchés qui ne fermaient pas se sont vus attaqués ou entourés de piquets de grève; on crevait les pneus aux camions qui essayaient d'y livrer leur marchandise. A Paris, le 15 Novembre, presque tous les vendeurs au détail, les cafés et les restaurants, ont été fermés, et ceux qui refusaient d'observer le mot d'ordre de grève étaient menacés de violences.
Aux Etats-Unis, en Décembre 1973, des milliers de camionneurs indépendants se sont mis en grève contre la politique du gouvernement sur l'essence, qui les mettait en danger de faillite. Les autoroutes ont été bloquées et on tirait sur les camions qui continuaient à rouler. En Janvier, des propriétaires indépendants de stations d'essence de Long Island ont commencé une grève pour protester contre les restrictions sur l'essence. Les propriétaires qui gardaient leur station ouverte ont été menacés ou attaqués par les propriétaires en grève. La "gauche" a soutenu ces luttes de la petite bourgeoisie avec un enthousiasme effréné. En France, le P.C. et la C.G.T. ont soutenu inconditionnellement la lutte des petits commerçants. Les trotskystes de l'aile Mendel-Franck de la IV° Internationale (Rouge) ont suivi le P.C. en arguant que la petite bourgeoisie, comme la classe ouvrière est une victime des monopoles et donc l'alliée naturelle du prolétariat. Pris dans leur propre rhétorique ils sont allés jusqu'à affirmer que "les petits commerçants auraient tout à gagner dans un système de distribution socialiste où ils ne seraient plus à la merci du grand capital, où ils n'auraient plus à payer les conséquences des hasards de la vente".
Aux Etats-Unis pendant la grève des camionneurs indépendants, la Spartakist League trotskyste a signalé la nécessité de "gagner la direction des classes moyennes" en "donnant des garanties aux petits commerçants en lutte" (Workers' Vanguard. 4 Janvier 1974). Ceux d'international Socialism ne se sont pas contentés d'affirmer que la petite bourgeoisie est l'alliée naturelle du prolétariat dans la lutte pour le socialisme, ils ont aussi décidé d'incorporer la petite bourgeoisie dans la classe ouvrière.' Dans ses écrits sur la grève des camionneurs indépendants, International Socialism a fièrement proclamé qu'on ne saurait voir une image plus vivante du pouvoir des ouvriers américains” (Workers' Power n°88).
L'image d'un "socialisme" sécurisant les classes moyennes, d'un front unique de toutes les victimes des monopoles (petits capitalistes, professions libérales, petite bourgeoisie, paysans, ouvriers) et même la démagogie avec laquelle la petite bourgeoisie est transformée en "ouvriers", sont des caractéristiques de l'aile gauche du capital. Derrière ces alliances multi-classistes et ces programmes populistes, l'aile gauche de la bourgeoisie se prépare d'abord à dévier le prolétariat de l'assaut révolutionnaire contre l'État capitaliste pour ensuite paver le chemin du massacre des ouvriers.
La question des classes moyennes et des rapports du prolétariat envers celles-ci est extrêmement complexe et demande un développement bien plus détaillé que celui que nous pouvons faire ici. Nous pouvons cependant énoncer certains points fondamentaux. La "protection" des classes moyennes présuppose la survie du système capitaliste. L'existence même des classes moyennes est directement liée à la perpétuation du système de production de marchandise, du marché et de la loi de la valeur. Le socialisme ne "protège" pas les classes moyennes et ne leur garantit aucune "stabilité". Il représente leur destruction en tant que couches distinctes ayant des privilèges et des propriétés.
C'est vrai que les classes moyennes sont victimes de la tendance centralisatrice du capital. Cependant, il n'existe pas de mode de production correspondant à la domination de la petite bourgeoisie. Les classes moyennes ne peuvent pas avoir un pouvoir étatique correspondant à leurs propres intérêts de classe. En effet, la petite bourgeoisie ne peut pas lutter contre le capitalisme sans se suicider en tant que classe possédante. Afin de préserver ce qui leur reste de privilèges et de propriété, les classes moyennes ne peuvent que se tourner vers les représentants du grand capital dans sa forme monopoliste ou étatique.
Si la centralisation du capital condamne la petite bourgeoisie à une destruction progressive, le désordre et le trouble social qu’apporte le réveil d’une insurrection prolétarienne constituent une menace bien plus grande et immédiate à la sécurité et la stabilité des classes moyennes. Face à la menace de la révolution prolétarienne, las classes moyennes apportent leur soutien au capitalisme dans ses formes d’oppression les plus brutales, dans l’espoir de débarrasser la société de l’insécurité que représente un prolétariat militant.
Cela ne veut pas dire que des éléments des classes moyennes ne peuvent pas être gagnés par la lutte pour le socialisme. Cependant, la petite bourgeoisie rejoint le mouvement prolétarien non pas pour défendre ses intérêts de classe, mais avec la conscience que la révolution socialiste veut dire l’élimination de la petite bourgeoisie non pas en tant qu’individus, mais en tant que classe distincte et privilégiée.
Le contenu réel du programme de l’aile gauche de la bourgeoisie, quoique celle-ci puisse bien dire, n’est pas la protection des classes moyennes. Si la gauche sauve les classes moyennes de la domination des monopoles privés, ce n’est que pour les assujettir au contrôle total et à la domination du capitalisme d’État. Les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas nationalisées seront organisées et réglementées par l’État à travers son appareil de planification. Les producteurs indépendants seront organisés dans un réseau de ”coopératives” sous le contrôle total de l’État. Tandis que l’appareil de planification déterminera la répartition des matières premières, contrôlera les prix et les profits etc., les institutions du "crédit public" placeront les fonds dans ces entreprises déterminant ainsi les conditions de leur existence, leur taille etc. La base du programme de la gauche est la subordination stricte des plus petites entreprises et des producteurs indépendants les plus insignifiants aux besoins et aux diktats du grand capital
Dans le moment présent, les monopoles privés et leurs représentants dans le pouvoir d’État se trouvent devant un dilemme par rapport aux classes moyennes. À mesure que la crise s'approfondit, les monopoles ont besoin de se saisir de la part globale de plus-value que les classes moyennes s'approprient sous une forme ou une autre. Pour lutter contre l’inflation galopante, le grand capital a besoin d'une politique de restriction des crédits qui hâtera la destruction des petits capitalistes et de la petite bourgeoisie. Cependant, les politiques déflationnistes que requiert La conjoncture économique présente ont des ramifications politiques dangereuses dans la mesure où elles affectent les classes moyennes. La hausse des impôts et les restrictions de crédit peuvent provoquer des soubresauts violents de la petite bourgeoisie à une époque où le grand capital a besoin du soutien des classes moyennes contre le prolétariat. Pour pouvoir utiliser les classes moyennes contre le prolétariat, le grand capital doit au moins faire semblant de protéger leurs intérêts. La division dans les rangs du grand capital sur la question des classes moyennes (entre ceux qui suggèrent une vaste politique déflationniste et ceux qui parlent de la nécessité de protéger les classes moyennes) ne porte en fait que sur les moyens de s’attaquer aux couches moyennes. Face à la faillite économique, la grande bourgeoisie devra s’attaquer directement aux classes moyennes, même au risque de perdre leur soutien politique. Si la situation économique se stabilise, ne fût-ce que pour une courte période, le grand capital pourra se satisfaire d'une attaque indirecte sur les classes moyennes, ce qui permettrait la continuation du processus de centralisation sans entrave majeure, tout en essayant de garder le soutien politique de la petite bourgeoisie grâce aux promesses de protection du gouvernement.
La centralisation du capital, que la crise est en train d’accélérer, est aussi en train d’affecter le grand capital lui-même. À mesure que la crise s'approfondit, la tendance vers le capitalisme d'État se prononce de plus en plus. Dans les années à venir, la balance entre capital privé et capital d'État penchera de plus en plus en faveur de ce dernier. Il ne sera plus seulement question de nationaliser les industries qui marchent à perte, mais de nationaliser bon nombre d’industries les plus profitables. La perspective est à la fusion et non à une lutte violente entre les représentants du capital privé et d’État. Cependant, ce sera la force ou la faiblesse relative du capital national dans le marché mondial qui déterminera le nouveau point d'équilibre entre capital privé et étatisé. C'est la lutte entre les différentes fractions du capital pour un repartage du marché mondial, la nécessité de se préparer pour une guerre impérialiste mondiale, qui est à la base de la tendance inexorable vers le capitalisme d'État.
La "gauche" officielle est le véhicule de base des fractions de la bourgeoisie qui défendent le système capitaliste d'État le plus achevé. La "gauche" ne représente pas seulement l’aile la plus étatiste, elle représente aussi la plus nationaliste. Alors que l'aile "modérée" du Parti Travailliste anglais (Wilson, Healy) était le reflet fidèle des intérêts de la City et entretenait les relations les plus étroites possibles avec le capital américain, la "gauche" travailliste (Tony Benn, The Tribune Group) est le reflet d'une tendance grandissante à une; économie nationaliste et autarcique. Ainsi, la "gauche" travailliste est décidée à retirer l'Angleterre du Marché Commun et à utiliser le National Enterprise Board prévu pour, selon les mots mêmes de M.Benn "s'opposer aux multinationales et empêcher les industries anglaises d'investir outre-mer". Les nationalisations, les accords de planification, le N.E.B., les contrôles sur les échanges etc. voilà les instruments dont la "gauche" espère se servir pour conduire le capital britannique dans la voie de l'autarcie.
En France, aux récentes élections présidentielles, François Mitterrand, le candidat des partis Socialiste, Communiste et Radical de gauche a clairement fait savoir son intention de limiter les activités des compagnies multinationales, et de protéger l'"indépendance" du capital français. En réponse à un questionnaire de la revue "Entreprise", organe de pointe de l'aile "moderniste" du patronat, Mitterrand affirme :
- "Je veux préserver notre indépendance dans trois domaines essentiels :
Vis-à-vis des investissements étrangers dans les secteurs-clé.
- Technologiquement, surtout dans les industries de pointe (ordinateurs, énergie nucléaire).
- En tenant compte des approvisionnements en énergie et en matières premières.
C'est dans cet esprit que ces mesures envers les multinationales seront étudiées et votées." (Entreprise n°975)
Mitterrand voit aussi les nationalisations comme un moyen de sauvegarder les "intérêts nationaux" français :
- "Dans certains cas (les nationalisations) sont aussi une solution pour éviter que certaines compagnies ne tombent sous le contrôle étranger. Si Roussel-Uclaf avait été nationalisé, comme nous l'avons proposé en 1973, cela lui aurait évité de passer entre les mains du capital étranger. [1]" (Idem).
Comme l'indépendance du capital français ou anglais est une illusion, et que la seule alternative à la domination américaine est de se tourner vers le capital russe, la dégradation de la situation économique va renforcer l'influence de la fraction de gauche du capital, aussi sûr que la nationalisme et l'étatisme sont deux manifestations de l'orientation grandissante vers la guerre.
Les solutions de la bourgeoisie
Intensification du travail, blocage des salaires, programmes d'austérité et déflation servent à reporter la crise sur le prolétariat et à abaisser les salaires. Les énormes investissements en capital fixe sont de moins en moins en mesure d'aider le grand capital, entraîné, dans une crise qui s'approfondit, face à la saturation des marchés, à augmenter la productivité du travail. La baisse des profits, les taux d'intérêt élevés, les taxes qui augmentent rapidement ont d'ores et déjà entamé la capacité du capitalisme à faire de nouveaux investissements importants. Ainsi en Mai en Angleterre, la Confédération de l'industrie britannique "affirmait qu'il y avait eu un effondrement sans précédent dans les perspectives du capital" (Financial Times 4/6/74 Pour relever le taux de profit, la bourgeoisie devra de plus en plus utiliser la bonne vieille méthode d'intensification du travail, avec ses conséquences Inévitables: épuisement, maladies, accidents et mort précoce qui seront le sort des ouvriers qui auront encore du travail. Cette augmentation du taux d'exploitation entraînera dans son sillage un chômage massif, puisque moins de travailleurs produisent plus de plus-value.
La lutte pour les marchés s'intensifiant, chaque fraction nationale de la bourgeoisie doit tenter de réduire ses coûts de production. Pour renforcer sa compétitivité et élever son taux de profit, la bourgeoisie essaie aujourd'hui de diminuer ses frais salariaux, de réduire le coût de travail à son strict minimum, jusqu'à payer les ouvriers en-dessous de la valeur de leur force de travail.
Lors de la dernière grande crise économique des années 30, la bourgeoisie avait deux politiques de base qu'elle pouvait utiliser alternativement dans ses assauts contre le niveau de vie du prolétariat : la déflation, qui entraîna une réduction directe des salaires (Allemagne, Italie, Flandin et Laval en France) l'inflation, qui, elle, entraîna une baisse indirecte du pouvoir d'achat dû à la dépréciation de la valeur de la monnaie (Etats-Unis, Angleterre, Blum en France). Dans la mesure où les prix étaient tombés depuis cinq ans à un niveau sans précédent, et où le lourd fardeau des dettes (les crédits bancaires qui ont financé la reconstruction d'après-guerre) condamna bien des capitaux à l'oisiveté, le grand espoir de la bourgeoisie résidait dans une politique inflationniste comme celle de Roosevelt aux Etats-Unis, qui cherchait à relever les prix et à délivrer les capitalistes du poids de leur endettement grâce à la dévaluation de la monnaie. Les répercussions sur le prolétariat ne furent pas moins désastreuses que celles de la politique déflationniste allemande. D'après William Green, président de l'A.F.L., le revenu des ouvriers a augmenté de 7,5% entre Avril 1933 où le Dollar avait été dévalué et Février 1934, alors que le prix des produits alimentaires de base augmentait de 16,7% et les prix des vêtements et autres marchandises de 27,5%. "Il y eut une hausse du salaire nominal mais une baisse du salaire réel" (Lucien Laurat "Cinq Années de Crise Mondiale", Paris 1934, p.74).
L'actuelle crise mondiale bien que caractérisée par une chute de production et une augmentation du chômage (quoiqu'à un niveau différent de celui qui a suivi le krach de 1929) ne se manifeste pas par une chute vertigineuse des prix mais au contraire par l'inflation galopante. Le palliatif temporaire de politique inflationniste qu'avait utilisé le New Deal américain et le Front Populaire français dans les années 30 est aujourd'hui impossible. Les tentatives de renflouer l'économie à travers, soit la diminution des taxes, soit les mesures destinées à faciliter le crédit (mesures prônées par The Economist en Angleterre ou Keyserling aux Etats-Unis) entraîneraient une sur-inflation à côté de laquelle l'actuel chiffre d'inflation semble modeste et un risque d'effondrement économique. En Occident, la bourgeoisie a opté pour une politique déflationniste dans l'espoir d'enrayer l'inflation. Aux Etats-Unis, Arthur Burns, le président du Fédéral Reserve Board, a affirmé "l'inflation où elle en est risque de saper les fondements de notre société...l'avenir de notre pays est en danger". Le taux d'intérêt aux Etats-Unis s'est élevé à un niveau record de 11,5% et la bourgeoisie semble déterminée à sa politique d'argent cher, malgré la menace très réelle d'une crise des liquidités et d'une vague de banqueroutes. En Italie, Guido Carli, le gouverneur de la Banque d'Italie insiste sur la nécessité de prendre "de sévères mesures pour limiter le crédit", pour enrayer le déficit des paiements qui s'amorce et éviter la banqueroute nationale. En Italie, le taux d'intérêt est monté jusqu'à 15,5% en Juin ! En France, Wormser qui était le gouverneur de la Banque de France jusqu'en Juin, appelait à une "déflation orthodoxe',' seul moyen de sauver la France de la ruine économique. Sa politique semble avoir gagné l'accord du nouvel occupant de l'Élysée puisque le nouveau gouverneur de la Banque Centrale, B. Clappier a annoncé le 20 Juin que la Banque de France avait augmenté son taux d'escompte de 2%, la plus grande augmentation de l'histoire du pays (ce taux atteint le niveau sans précédent de 13%). Bien que la déflation ne signifie pas que l'État bourgeois va permettre l'effondrement des grandes banques et entreprises par manque de crédits (comme la théorie orthodoxe le recommanderait) rien ne dit que la bourgeoisie soit prête à accepter et supporter la dépression économique et le taux de chômage, impensables il y a quelques années dans un effort désespéré d'arrêter le cycle d'inflation. Entre la sur-inflation (style Weimar), d'un côté, et une crise des liquidités accompagnée d'une chute massive de la production de l'autre, la bourgeoisie a un champ de manœuvre restreint.
L'effet le plus désastreux de la politique déflationniste en sera les conséquences pour la classe ouvrière. C'est le prolétariat qui devra faire les sacrifices nécessaires pour rendre chaque capital national à nouveau compétitif sur le marché mondial, pour arrêter la baisse des profits . Les blocages de salaires, les politiques de revenus, et les "contrats sociaux" pour empêcher la hausse des salaires et par là-même pour amener une baisse du salaire réel. Plus encore, il est important de constater que la part du capital variable destiné à payer les salaires directement aux ouvriers décroît, contrairement à ce qui se passait à l'époque du capitalisme "libéral" (19° siècle.) Une part croissante des coûts destinés à entretenir et assurer la reproduction de la force de travail .des ouvriers est prélevée directement par l'État (le représentant du capital national global) grâce à des taxes directes ou indirectes, et ainsi ne passe pas dans les mains du patron individuel et n'apparaît pas dans la paye des ouvriers. Dans ces coûts sont inclus, en partie ou en totalité, le logement, l'éducation, les transports, l'hygiène, la sécurité sociale, etc. Ainsi les salaires ou les coûts d'entretien des ouvriers peuvent être largement réduits par l'action de l'État, sans que cela prenne la forme d'une réduction du salaire nominal directement payé aux ouvriers. Cette réduction peut prendre la forme d'une réduction de "services sociaux" ou d'une élévation de facto. De telles réductions de "salaires" ne peuvent être combattues au niveau de l'entreprise et demandent une réponse politique immédiate de la classe ouvrière. Enfin, la bourgeoisie se servira aussi du chômage massif pour baisser les salaires.
Les secteurs dirigeants de la bourgeoisie sont à présent engagés dans une politique déflationniste, mais l'application de cette politique s'avère difficile. Dans les années 30, la bourgeoisie affrontait un prolétariat physiquement vaincu ou dominé idéologiquement par les partis contre-révolutionnaires social-démocrates et staliniens. Le chemin était alors laissé libre à la bourgeoisie d’imposer ses solutions à la crise (d'abord Inflation ou déflation, ensuite guerre mondiale impérialiste). Aujourd'hui elle affronte un prolétariat qu'il reste encore à vaincre par la terreur ou l'affrontement armé, et qui n'est plus soumis au strict contrôle idéologique de la gauche officielle Les cinq dernières années ont vu un essor des luttes ouvrières caractérisé par une combativité accrue et une indépendance vis-à-vis des syndicats et des partis de "gauche". La tentative d'imposer son programme d'austérité est lourde de dangers pour la bourgeoisie, d'autant plus qu'elle risque de provoquer une forte explosion sociale et un affrontement armé avec le prolétariat, pour lequel les capitalistes ne sont pas encore préparés. Le problème pour la bourgeoisie est de trouver un cadre dans lequel elle puisse sans danger lancer son assaut contre la classe ouvrière. Les changements dans les gouvernements occidentaux, qui ont pris des proportions démesurées cette année (Angleterre, Belgique, Danemark, France, Italie ainsi que les difficultés de Tanaka au Japon et de Nixon aux U. S. A) sont les symptômes d'une crise politique de la bourgeoisie. La participation active des syndicats et des partis de "gauche" au gouvernement, que ce soit dans un gouvernement d’"Unité nationale" ou par la formation d’un bloc politique de gauche est la plus sûre garantie de la bourgeoisie pour imposer sa politique, calmer les ouvriers et préparer le massacre du prolétariat. Les trotskistes, maoïstes et autres gauchistes qui apportent leur "soutien critique" à la fraction de gauche du capital ne font que révéler une fois de plus leur participation active à la contre-révolution.
Le nouveau gouvernement travailliste anglais a proposé un budget déflationniste digne d'un Enoch Powell. Il a essayé de divertir la classe ouvrière par une brusque augmentation des taxes sur la part de plus-value consommée individuellement par les capitalistes, mais il agit d'une façon strictement orthodoxe (très appréciée dans les milieux financiers internationaux) en imposant une élévation des taxes sur l'industrie pour obtenir un effet de déflation sur l'économie. Plus important toutefois est le coup porté au prolétariat par le budget de Healy présenté au parlement. D'abord, il y a une série d'augmentations exorbitantes des prix des services sociaux de base, pour pallier au déficit énorme qui entrave les industries nationalisées. L’électricité à usage domestique augmentera de 30% (le budget d’origine parlait de 60% pour les tarifs de nuit, mais il a été modifié depuis). Le charbon à usage domestique, les chemins de fer et le téléphone augmenteront de 12 à 15%. Les impôts directs sur les revenus (même pour les bas salaires) augmenteront de 30 à 33% par rapport à leur taux actuel. La T.V.A a été étendue aux confiseries, boissons non-alcoolisées et au pétrole, tandis que la taxe à la vente a augmenté sur les cigarettes, la bière, le whisky et les paris. Comme toutes les taxes à la vente, c'est sur la classe ouvrière qu'elles pèseront plus lourd.
Pour maintenir les salaires à un bas niveau, le gouvernement travailliste a établi son fameux contrat social avec le T.U.C, avec l'accord des syndicats :
- ne pas renégocier tout de suite les contrats signés au cours de la "phase trois” de Heath.
- un écart de douze mois entre deux négociations
- "Les prochaines mesures permettront seulement aux salaires de rattraper les prix”. -"Il devra y avoir aussi peu de grèves que possible”.
Le contrat social doit encore être mis à l'épreuve, mais la perspective n'est pas bonne pour la bourgeoisie. Les syndicats ont réussi à détourner la lutte de classe dans des chemins corporatistes et sectoriels, mais ils risquent de perdre leur contrôle sur les ouvriers s'ils tentent d'étouffer les grèves qui revendiquent des augmentations de salaire. La stratégie de Wilson consiste à reporter la crise sur les ouvriers par le biais des réductions des services sociaux et une augmentation des taxes, tout en comptant sur l'impact dégrisant de la menace du chômage pour désamorcer la lutte de classe.
La réaction du prolétariat à cette érosion constante de son niveau de vie apparaîtra clairement en automne, lors de la nouvelle vague de grèves prévue. Si Wilson et les syndicats ne peuvent contenir la classe ouvrière grâce au contrat social et à la menace du chômage , l'actuel gouvernement travailliste aura échoué. Face à la sur-inflation, au déficit spectaculaire des paiements et à la chute raide de la production, la bourgeoisie doit trouver une nouvelle politique pour éviter le désastre économique et social. La tentation s va devenir forte de recourir à une série de mesures protectionnistes pour réduire les importations à leur strict minimum. La voie sera alors ouverte à la gauche travailliste qui réagira à la crise en se retirant du Marché Commun et en réorganisant l’économie sur une base autarcique. Benn et le "Tribune Group” sont persuadés qu’ils pourront imposer une telle politique aux ouvriers qui devront faire les sacrifices nécessaires à une Angleterre socialiste.
Il y a une autre alternative possible pour la bourgeoisie. Si la sur-inflation domine le contexte social, la bourgeoisie peut s'apprêter à se tourner vers Enoch Powell. En plein désastre social (entraîné par une inflation type Weimar), Powell pourrait mobiliser les classes moyennes, le lumpen-prolétariat, les petits capitalistes, etc. En imposant un chômage massif (la base de son programme économique) comme le dernier reste d'effort pour sauver la Grande-Bretagne et rendre à l’économie sa santé.
En Italie les différentes fractions de la bourgeoisie se sont aujourd’hui accordées sur la base d’un programme d'austérité. La bourgeoisie a déjà imposé de sévères restrictions sur les importations et une politique monétaire rigoureuse, et a décidé après la dernière crise politique du gouvernement, de la nature des sacrifices que les travailleurs seront obligés de faire. Les dépenses en services sociaux vont subir une réduction vertigineuse. Les prix des transports urbains et de l'électricité, du gaz et de l’eau vont être augmentés-sans parler de l’augmentation de l’essence. Les taxes sur les revenus et à la vente vont être relevées, de telle sorte que les propriétaires de voiture devront payer une taxe supplémentaire. Les nouvelles taxes sont destinées à soutirer au moins cinq milliards de dollars sur le pouvoir d'achat dans l'espoir de combattre l’inflation et de freiner ensuite les augmentations. La plus grande partie de ces cinq milliards de dollars seront enlevés de la poche des travailleurs.
Premier Mariano Rumor en plus de s’être de longue date engagée dans la consultation des leaders syndicaux en matière de politique économique, a été requis pour la coalition gouvernementale par ses partenaires socialistes, pour assurer une consultation régulière du PC avant toute décision importante. C’est le premier pas vers la coalition de "sécurité nationale’’ proposée par les syndicats. Bien que le PC ne soit pas encore au gouvernement, l’appel à un "compromis historique que Berlinguer a lancé aux démocrates-chrétiens montre que le PC est déjà prêt à prendre ses ’’responsabilités’’ pour assurer la mise en place du programme d’austérité. Giovanni Agnelli, la tête du gigantesque empire de Fiat et le nouveau président de la ”Confindustria" (l’association des patrons) a récemment fait savoir son adhésion à une telle ouverture "à gauche". Le nouveau programme d’austérité sera mis à l’épreuve dans les mois à venir, ainsi que la capacité que pourront avoir les syndicats comme la gauche de le faire accepter à la classe ouvrière.
En France, en Belgique et au Danemark, la bourgeoisie élabore désespérément de nouveaux programmes d’austérité qui seront dévoilés dans les semaines à venir. D’un bout de l’Occident à l’autre, de l’Angleterre et d’Italie au Japon, à l’Allemagne de l’Ouest et aux USA, la bourgeoisie s’est engagée dans une politique de déflation à l’intérieur et d’exportations accrues, pair tenter de résoudre la crise. Ces mesures déflationnistes, qui assaillent brutalement le prolétariat, ne peuvent pas arrêter l’inflation galopante. La réduction la plus énergique des coûts d’entretien des ouvriers, n’aura pas d’effet sur la croissance démesurée des dépenses improductives qui sont indispensables à la survie du système capitaliste dans sa phase de décadence[2]. Ces dépenses, qui sont la véritable cause de l’inflation dévastatrice qui est aujourd’hui en train de saper les bases du système capitaliste, s’étendront au fur et à mesure que la crise s’approfondira et que l’appareil productif sera consacré, de plus en plus, à la production de moyens de destruction. Les barrières de douane se dressant partout dans le monde et l’heure étant à l’économie nationale et à l’autarcie, les espoirs que la bourgeoisie met dans un boom des exportations pour enrayer les déficits grandissants du commerce et des paiements, se révéleront illusoires.
De même qu’il était impossible à la bourgeoisie dans les années 30 de résoudre la crise par de sévères mesures inflationnistes ou déflationnistes, de même aujourd’hui, ni la déflation, ni l’effort d’exportation ne constituent une porte de sortie à la bourgeoisie pour se libérer de la crise . Il n’y a qu’une solution capitaliste à la crise : la guerre mondiale impérialiste. La signification réelle des différentes mesures que prend la bourgeoisie en période de crise, c’est la préparation à la guerre. Cette préparation implique la forme la plus extrême de centralisation du capital -le capitalisme d’État- qui met en place les structures économiques nécessaires à la guerre. Les attaques contre le prolétariat sont le pendant indispensable de la préparation de la bourgeoisie à la guerre.
- "La destruction de la conscience de classe du prolétariat par la mystification idéologique et son écrasement physique par la terreur, sont les moyens employés tour à tour et simultanément pour obtenir l’adhésion ou tout au moins la passivité docile de la classe ouvrière, condition indispensable permettant au capitalisme d’aller à la guerre." (R.I. Bulletin d’étude et de discussion n° 5)
Que la bourgeoisie n’ait qu’une issue ne signifie pas que la perspective est à une guerre impérialiste mondiale. L’intensification de la lutte de classe montre à quel point le prolétariat peut barrer la route à la guerre. Les prochaines années seront décisives. Il dépend aujourd’hui de la réaction du prolétariat à la crise que la bourgeoisie puisse ou non imposer sa solution.
Mac Intosh.
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [57]
Rubrique:
Revolution Internationale N°12 - novembre-décembre
- 20 lectures
Convulsion du capital mondiale et lutte de classe
- 15 lectures
Le triomphe du marxisme
Marx constate quelque part que ce n'est que dans les périodes de crise que la bourgeoisie devient intelligente, qu'elle commence à prendre conscience des contradictions insolubles de son économie. Le reste du temps, dans les périodes dites de "prospérité", où les lois du système semblent assurer à celui-ci un développement harmonieux, les différents apologistes du mode de production capitaliste s'empressent de crier sur tous les toits que, grâce à leur "science", ce mode de production a enfin réussi à résoudre tous ses problèmes, que désormais les crises font partie d'une imagerie d'Épinal désuète et qu'un avenir d'infinie sérénité se présente qui mettra enfin un terme à toutes les plaies de la société.
Un tel optimisme était déjà coutumier des économistes bourgeois de la période ascendante du capitalisme quand les crises de surproduction n'étaient pas comme au XX” siècle des crises mortelles, mais de simples crises de croissance, les battements de cœur du système et non des râles de l'agonie. C'est ainsi qu'un grand nombre d'auteurs de cette époque, des plus insipides comme Jean-Baptiste Say aux géants de la pensée comme Ricardo, considéraient que, la production créant son propre marché, les crises générales étaient impossibles, ce qui n'empêchait pas évidemment celles-ci d'arriver tous les 7 ou 11 ans !
Mais l'optimisme dans lequel se plongent avec extase les économistes du XX° siècle à la moindre occasion n'est plus celui d'une classe historiquement progressive, partant à l'assaut de l'avenir, mais bien celui que manifeste le moribond à la plus petite rémission de son mal fatal. Ainsi, par une force d'inertie bien compréhensible, puisqu'elle lui permet de reculer le moment où elle sera confrontée au néant de son avenir, la bourgeoisie par la voix de ses idéologues appointés, se refuse à voir la crise quand elle est devant son nez ou quand elle est déjà plongée dedans.
Ainsi, le 16 Octobre 1929, une semaine avant le "Jeudi noir", le professeur Irving Fischer, une des sommités de l'époque, n'avait pas peur de déclarer :
"Les cours de la Bourse ont atteint un niveau élevé qui semble devoir être permanent". Rappelons que ceux-ci sont tombés de 86 % dans les mois qui ont suivi !
C'est ainsi également, que quand les premiers symptômes de la crise actuelle ont commencé à se manifester de façon évidente vers 1967-68, on a d'abord fait tout un battage autour de "la crise monétaire" qui aurait eu pour cause le vieillissement du S.M.I. mis en place en 1944 à Bretton Woods. Ensuite, toute1'attention de la bourgeoisie et de ses économistes s'est reportée sur ce nouveau serpent de mer que constituait "l'inflation galopante". À ceux qui commençaient à évoquer 1929, le chœur des économistes répondait :
"Mais cela n'a rien à voir ! En 1929, la Bourse s'est effondrée : aujourd'hui, elle tient. En 1929, la production a fait le grand plongeon : aujourd'hui, elle ne cesse d'augmenter. En 1929, les prix ont baissé : aujourd'hui, ils augmentent...et de quelle façon !"
La "crise du pétrole" a servi d'ultime alibi à la bourgeoisie de droite comme de gauche pour essayer de justifier la non existence d'une crise réelle. Mais que dire d'une économie qui serait à la merci, pour les uns, des caprices de quelques "rois du pétrole", pour les autres, de la cupidité d'une poignée de "firmes multinationales" ? Qu'une telle économie est décidément bien vulnérable malgré tous les efforts des États et des organismes internationaux, toutes les ressources de 1'"économétrie", de l'"informatique", etc. qui en avaient fait quelque chose de "moderne", de "rationnel", de "scientifique".
Que les représentants appointés du capital soient restés aussi longtemps plongés dans leur cécité s'explique, comme nous l'avons vu plus haut. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que des prétendus défenseurs de la Révolution Prolétarienne aient élevé en système les mêmes illusions que les premiers. Et ceci, quelquefois au nom même du marxisme.
C'est ainsi que "Socialisme ou Barbarie" a mis au point toute une théorie "montrant" que le capitalisme avait réussi à surmonter ses contradictions économiques et que la contradiction fondamentale de la société devenait la division entre dirigeants-dirigés.
C'est ainsi que tous les courants issus plus ou moins directement de ce groupe, qu'il s'agisse d'ICO[1], du GLAT[2], de l'IS[3], de PO-Gauche Marxiste[4] ou des groupes anglo-saxons "Solidarity-London" et "Solidarity-Philadelphia" ont opposé les plus grandes résistances à reconnaître l'arrivée de la crise ou continuent à raconter Ainsi, l'internationale Situationniste, dans son numéro 12, faisait des gorges chaudes sur les "débris du vieil ultra-gauchisme, (à qui) il fallait au moins une crise économique majeure..., (qui) subordonnaient tout mouvement révolutionnaire à Bon retour et ne voyaient rien venir".
De même, le courant "PO-Gauche Marxiste" déversait en 1971-72, une lourde ironie sur les "révolutionnaires qui n'avaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective, présentée comme pierre de touche du marxisme, d'une catastrophe inévitable (et qui) ne semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachroniques"[5].
Quant à "Solidarity" de Londres,- son numéro de Janvier 1974 montre à quel stupide aveuglement ces conceptions peuvent mener :
"L'exemple de l'Angleterre est peu significatif du capitalisme moderne. Il y a le problème chronique de la balance des paiements. Il y a le problème de la sous-capitalisation (sic) et d'une gestion rétrograde. A ces problèmes est venu s'ajouter celui de la hausse des prix du pétrole.(...) Mais ces difficultés spécifiques du capitalisme britannique ne doivent pas être extrapolées, comme elles le sont par tant de révolutionnaires pour signifier une crise économique incontrôlable, du type de celles prévues par Marx, affectant le système dans son ensemble".
Le GLAT de son côté continue à affirmer que la contradiction insurmontable du système réside en l'opposition entre "les rapports sociaux communistes" noués par les prolétaires au sein du capitalisme et "les rapports sociaux capitalistes" issus des rapports de production du même nom. Et de même ce groupe a emboîté le pas aux bourgeois et politiciens les plus réactionnaires pour proclamer que "l'inflation et la crise actuelle tirent leurs origines des augmentations de salaires consécutives à la montée des luttes de la classe ouvrière" (qui elle, sans doute, est un effet du Saint-Esprit !).
"Socialisme ou Barbarie" et ses épigones "ICO", "PO-Gauche Marxiste" et "Internationale Situationniste" sont maintenant morts. Ils n’ont pas pu résister à l'approfondissement de la crise et au développement de la lutte de classe. Quant à "Solidarity" et au "GLAT", leur incapacité à comprendre la réalité actuelle, ou -à simplement en rendre compte,- leur confère un caractère de plus en plus marqué de secte qui ne leur annonce pas un sort meilleur.
Une autre école "révolutionnaire" s'est taillée un certain succès en affirmant que le capitalisme avait surmonté ses crises économiques. C'est celle du professeur Marcuse qui considérait que le prolétariat était intégré et qu'il ne pouvait plus jouer le rôle de classe révolutionnaire, rôle qui devait échoir aux couches marginales (étudiants, noirs, habitants affamés du Tiers-Monde, etc.). Quand on les relit aujourd'hui, ces théories ne peuvent provoquer qu'un grand éclat de rire et fort peu d'intérêt sinon sur le plan des curiosités historiques.
L'heure n'est plus à ces sornettes. Les "rénovateurs" du marxisme se taisent de plus en plus devant la gravité actuelle de la crise dont 1974 a marqué un brutal approfondissement.
Sur le plan de l’inflation, tous les records ont été battus dans la première moitié de l'année 1974 : USA, 11,5%; Canada, 11,5%; Japon, 29,75%; France, 15% ; Allemagne Fédérale, 7,75% ; Italie, 19,5% ; Grande-Bretagne, 16,5%. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, l'augmentation annuelle des prix à la consommation a été multipliée par 3,4 par rapport à la période 1961-71 et ce rapport s'élève à 4,2 pour le Japon, 4,8 pour le Portugal, et... 14,8 pour la Grèce[6].
Mais ce qui est relativement nouveau, c'est qu'un certain nombre de pays, et non des moindres, ont -rangé au musée leur belle croissance du PNB de 1973 pour se plonger dans une - non moins belle récession : USA, -2,75% au lieu de +5,9%; Grande-Bretagne, -6% au lieu de +5,4%; Japon, -6,5% au lieu de +10,3%[7]. De plus, les Bourses qui, jusqu'à présent, n'étaient pas trop secouées et permettaient à nos chers économistes de déverser des sommes d'idioties sur le thème "ce n'est pas 29" se sont mises à plonger à leur tour. Le mouvement, amorcé en 1973, s'est renforcé en 1974, ce qui fait que d'Août 73 à Août 74, la valeur des actions a évolué comme suit : USA, -22,5% ; Canada, -21,2% ; Japon, -19,8% ; France, -30,5% ; Allemagne, -20,1% ; Italie, -16,0% ; Grande-Bretagne, -47,8%[8]. D'ores et déjà, la Bourse de Londres a baissé plus rapidement qu'en 1929-30. Par ailleurs, ces chiffres ne tiennent pas compte de la hausse générale des prix qui ampute d'autant la valeur réelle des actions. En fait, si on raisonne en valeur constante, le prix moyen des actions traitées au Stock Exchange de New-York est tombé de 79% depuis 1968, ce qui n'est pas loin des 86% (toujours en valeur constante puisqu'alors les prix baissaient) de 1929-32[9].
A l'heure actuelle, même les plus crétins des économistes, y compris les lauréats du Prix Nobel, ont compris que la situation était mauvaise. C'est ainsi que Paul Samuelson a pu déclarer avec finesse : "Je vois venir des difficultés, mais elles ne ressembleront pas à celles de 1930-33". Décidément traumatisée à l'idée que la crise actuelle pourrait ressembler à celle de 1929, la revue américaine Newsweek du 30 Septembre 1974 ne consacre-t-elle pas tout un article à essayer de démontrer "Pourquoi ce n'est pas de nouveau 29"[10],(Why It Isn't "29 Again), la bourgeoisie se rend compte de plus en plus que c'est tout de même d'une CRISE dont il s'agit et non de quelconques petits problèmes monétaires ou autres, ce qui fait écrire à ce même numéro de Newsweek :
"...la vérité est que l'économie des USA en particulier, et celle de la plupart des pays du monde occidental en général sont sérieusement malades -et probablement le plus pénible de l'affaire, c'est que personne n'a la moindre idée vraiment nouvelle ou éprouvée sur comment les guérir".
C’est là le cri du cœur de la bourgeoisie ! Avec sa modération d'usage pour ne pas amplifier la panique qui l'envahit, elle montre avoir enfin compris que la situation est catastrophique et surtout QU'IL N'Y A RIEN A FAIRE.
Le président Giscard d'Estaing lui-même, réputé parmi ses collègues des autres pays par ses "compétences" en matière d'économie, n'a-t-il pas récemment déclaré à son tour[11] :
"Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que, s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe".
Au fur et à mesure qu'avec les PNB, les Bourses, l'emploi, s'effondrent les illusions de la bourgeoisie et toutes les théories fumeuses qu'elles-mêmes ou ses compagnons de route se proposant de "recommencer la révolution[12]" en dépassant le marxisme, avaient mises sur pied, s'affirme jour après jour avec plus d'éclat, LE TRIOMPHE DU MARXISME qui dès 1848 proclamait le caractère insoluble des contradictions économiques capitalistes, l'inévitabilité de crises de plus en plus profondes et l'enfoncement de la société dans une barbarie croissante.
La crise qui se développe et qui laisse un peu plus chaque jour la bourgeoisie terrifiée face à son avenir, ouvre de plus en plus, par la résistance croissante de , la classe ouvrière qu'elle provoque, la perspective de la solution aux contradictions actuelles de la société : la révolution prolétarienne, là encore, contre toutes les aberrations qui se sont développées sur l'intégration définitive du prolétariat, sur la disparition de son caractère de classe révolutionnaire, au bénéfice d' autres catégories sociales, le marxisme remporte UN NOUVEAU TRIOMPHE : LE PROLETARIAT EST BIEN LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE DANS LA SOCIETE CAPITALISTE ET LA SEULE.
C'est parce qu'ils n'avaient pas, à l'image de tant de groupes "révolutionnaires" en mal de "nouveauté", jeté le marxisme aux orties mais en avaient fait leur instrument de compréhension de la réalité que nos camarades du groupe "Internacionalismo[13]" du Venezuela pouvaient écrire dès Janvier 1968, sous le titre : "68, une nouvelle convulsion du capitalisme commence" :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la Livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson, la lutte inter-capitaliste s'aiguise rendant chaque jour plus réelle la menace de guerre mondiale, voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui durant quelques années était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" qui avait succédé à la Seconde Guerre Mondiale... Au milieu de cette situation, lentement et par à-coups, la classe ouvrière se fraie un chemin dans un mouvement souterrain qui par moments paraît inexistant, explose ici, jette une lumière aveuglante pour s'éteindre subitement et se rallumer plus loin : c'est le réveil de la classe ouvrière, du combat ouvert...
Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les évènements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement sûrs et conscients, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de l'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise. Et nous sommes sûrs également que le processus inverse, de développement de la combativité de la classe qu'on vit actuellement de façon générale, va conduire la classe ouvrière à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois".
Voilà ce qu'écrivaient les marxistes il y a presque sept ans, avant Mai 1968, "le mai rampant" italien, l'insurrection des ouvriers polonais en 1970, etc. et toutes les difficultés économiques qu'on connaît aujourd'hui alors que le devant de la scène était tenu par les jacassements de pie sur "la société de consommation", "la disparition des crises" et "l'intégration du prolétariat".
C'est donc avec le marxisme, que l'histoire impose de plus en plus comme SEULE ARME THEORIQUE DU PROLETARIAT, que nous devons analyser la situation présente de la société et tenter d'en dégager les perspectives.
La situation actuelle pose quatre types de problèmes :
- A quel moment de la crise se trouve l'économie capitaliste ?
- Comment se répercute la crise dans les rapports entre les nattons ?
- Comment se répercute la crise dans la politique interne de chaque nation ?
- Comment réagit le prolétariat ?
L'étape actuelle de la crise
L'année 1974 marque une étape importante dans l'approfondissement de la crise du capital qui la rend évidente même aux plus optimistes adorateurs du système. Mais les premiers symptômes de celle-ci remontent en fait au milieu des années 60. C'est vers 1964-65 qu'on assiste à un renversement des balances commerciales de la CEE et du Japon qui de négatives deviennent positives. Ce fait signifie que ces pays deviennent capables d'exporter ou, en d'autres termes, que la reconstruction d'après-guerre est terminée. C'est là un évènement d'une importance capitale. En effet, à partir du début du XX° siècle, au moment où les différents blocs impérialistes ont fini de se partager le marché mondial, le système capitaliste est entré dans une phase nouvelle de son développement historique : celle de sa DECADENCE.
Alors que l'époque antérieure était marquée par une formidable explosion des forces productives explosion liée à la conquête de vastes marchés coloniaux et extra-capitalistes (le rôle moteur du marché colonial dans la prospérité de la grande puissance de l'époque, l'Angleterre, n'est plus à démontrer), celle qui s'ouvre avec la première Guerre Mondiale est marquée par le cycle infernal CRISE-GUERRE-RECONSTRUCTION. Si les crises du siècle dernier trouvaient une solution dans les conquêtes de nouveaux marchés liés à une plus grande pénétration coloniale (c'était donc, en quelque sorte, des crises de croissance) celles de ce siècle ne peuvent plus se résoudre de cette façon. Les crises du XX° siècle ne peuvent déboucher que sur un REPARTAGE DES MARCHES EXISTANTS, c'est-à-dire SUR LA GUERRE IMPERIALISTE (ce sont des crises mortelles) et seule la reconstruction des forces productives détruites par ces guerres peut momentanément permettre à la machine économique de se remettre en marche. C'est là la signification des périodes de prétendue "prospérité" qui ont suivi les deux guerres mondiales. Le mécanisme de la reconstruction du deuxième après-guerre étant essentiellement fondé sur un flux presque unilatéral de marchandises et de capitaux des Etats-Unis vers l'Europe et le Japon, flux indispensable à la reconstitution du potentiel productif de ces derniers pays, il est donc logique de conclure que la reconstitution de ce potentiel et sa capacité nouvelle à exporter signifient la fin de la reconstruction et donc de la "prospérité" factice de cet après-guerre.
Cette situation nouvelle provoque immédiatement un ralentissement de la machine économique américaine dont les produits sont de plus en plus concurrencés sur le marché mondial par les produits européens et japonais. Ce n'est que la guerre du Viêt-Nam à partir de 1965 qui permet à ce ralentissement de ne pas se transformer en récession brutale. C'est pour cela que les premières manifestations importantes de la crise n'apparaissent qu'en 1967. Elles frappent un des pays qui a le moins profité de la période de reconstruction pour moderniser son appareil productif : la Grande-Bretagne. Celle-ci, face à un marché mondial de plus en plus encombré et incapable d'affronter la concurrence commerciale des autres pays est obligée de dévaluer la Livre Sterling.
Peu après, ce sont les Etats-Unis qui connaissent leur première crise financière : face à l'hémorragie de capitaux que représente la guerre du Viêt-Nam et que compense de moins en moins un excédent commercial en diminution, le président Johnson est obligé, en Janvier 1968, de prendre toute une série de mesures pour tenter de rétablir la balance des paiements et protéger le Dollar. C'est le début de la CRISE MONETAIRE qui s'accompagne aussi, au niveau international, par une forte poussée de l'inflation et par du chômage sans que ces deux derniers éléments deviennent la préoccupation dominante.
Ce qui est au centre de toutes les préoccupations, de tous les débats des "spécialistes" de l'économie, c'est ce qu'on appelle LA CRISE DU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL, mis en place à la conférence de Bretton Woods en 194-A' sur la base de l'adoption du Dollar comme étalon équivalent de l’or (1 once d'or = 35 $). Tous les "spécialistes" jacassent sur la nécessité d'un "nouveau Bretton Woods" qui permettrait d'adapter le système "aux nouvelles réalités".
Dans la petite tête de tous ces experts, l’idée qu’il ne puisse s'agir d'autre chose que d'un problème uniquement monétaire ne trouve pas de place. D'ailleurs n'assiste-t-on pas sur le plan économique à des réussites remarquables ? Après le fléchissement de 1967, 68 et 69 sont en effet des années fastes sur le plan de la croissance et de l'expansion du commerce mondial.
- S'ils avaient daigné se pencher sur l'œuvre économique de Marx au lieu d'affirmer avec l'assurance de l'ignorance qu'elle est dépassée, ils auraient pu y lire :
que les questions monétaires dépendent étroitement du processus central de l'économie capitaliste : la valorisation du capital, production et réalisation de plus- value. - que les crises économiques connaissent en général deux phases, la première se situant sur un plan monétaire (instabilité et dévaluation des monnaies, hausse des prix, crise du crédit, etc.), la seconde constituant la crise ouverte sur le plan directement économique (engorgement des marchés, effondrement de la production, déferlement du chômage), l'ordre des deux faisant croire à tort aux "experts" que la seconde est conséquence de la première.
C'est effectivement ce schéma qui s'est déroulé dans la présente crise et les années 70 et surtout 71 marquent "le commencement de la fin" des illusions bourgeoises sur la croissance illimitée. Les taux de croissance y connaissent par rapport à la période antérieure, une chute importante : aux USA, -0,18 7» pour la production industrielle en 1971 au lieu de 4,82 7o dans la période 1963-70; en Allemagne, 1,76 7» au lieu de 6,28 7«; en Grande-Bretagne, 1,04 % au lieu de 3,25 %; en Italie, ..1,75 % au lieu de 5,85 7.. Parmi les grands pays occidentaux, seule la France avec 5,67 % et le Japon avec un taux supérieur à 10 7«, semblent échapper à la récession. C'est vers cette époque qu'un certain nombre de "spécialistes" 'parmi les plus lucides commencent à se poser la question "Allons-nous vers un nouveau 29 ?". Mais la situation en 1972 et 1973 fait, taire ces audacieux. Celle-ci se caractérise par une reprise importante de la production (avec 6,09 % en 1972, les USA par exemple connaissent leur taux le plus élevé depuis la guerre). Il est vrai que simultanément les taux d'inflation atteignent des sommets jusqu’alors considérés comme inaccessibles et que cette manifestation de la crise passe au premier plan des préoccupations des économistes, devant même la crise du S.M.I.
L'inflation est un phénomène caractéristique du capitalisme décadent. Elle a pour origine l'immense gaspillage de forces productives que celui-ci a besoin de faire pour se maintenir en vie et réaliser sa ' plus-value : markéting, commercialisation, bureaucratie d'État croissante, armement, etc. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, elle était chronique sous sa forme "rampante", mais le phénomène nouveau de la fin des années 60 et surtout du début des années 70 est constitué par "l'inflation galopante". Celle-ci exprime, outre une augmentation massive des dépenses improductives liées à la montée des tensions inter-impérialistes (Vietnam, Moyen-Orient, Pakistan, etc.), une véritable fuite en avant du système qui tente de suppléer à l'encombrement croissant du marché par une explosion du crédit. L'État, pour payer ses dépenses improductives est le premier à s'endetter, mais l'ensemble de la société s'endette: ainsi, entre 1965 et 1974, la part des dettes dans l'ensemble de la valeur du capital des entreprises américaines passe de 25% à 507.
Ainsi la dette de l'économie américaine s'élève à 2500 milliards de dollars.
C'est ainsi également qu'un ministre brésilien a été amené à avouer[14]:
"Nous ne faisons rien d'autre que d'imprimer de la fausse monnaie pour financer notre expansion. Mais nous sommes bien décidés à continuer tant qu'il y aura des gens pour accepter notre signature.[15]"
Une telle situation de fuite en avant ne peut que conduire au désastre. Ainsi, pour l'ensemble des entreprises américaines, 1e rapport entre les profits bruts et le montant des remboursements de l'intérêt des dettes est passé de 12,5 en 1966 à 9 en 1968, 5 en 1970 et se situe actuellement entre 2 et 3 ; en d'autres termes, les profits du capital suffisent de moins en moins à payer ses dettes. Cet endettement croissant et de moins en moins solvable est à la base de l'approfondissement brutal de la crise à partir de 1974. Bien qu'elles aient servi de catalyseur du mouvement, les hausses de pétrole sont reconnues de plus comme en étant qu'un alibi à la crise actuelle. En fait, la signification des chiffres de l'année 74 est claire : NOUS SOMMES MAINTENANT DE PLEIN PIED ET DE FAÇON OUVERTE DANS LA CRISE DE SURPRODUCTION.
Une question reste cependant posée : allons-nous assister maintenant à un effondrement brutal du type de celui de 29 ? Ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes les mesures ont déjà été tentées pour retarder l'échéance; et qu'on ne voit pas bien maintenant quel miracle pourrait tirer l'économie mondiale de cette impasse. Cependant, depuis 1967, le système a montré qu'il n'avait pas perdu les leçons de 1929 et que s'il est parfaitement incapable de trouver une solution à la crise, il peut cependant en ralentir l'évolution. De 1967 à 1974, c'est progressivement que le monde s'est enfoncé dans la crise même si ce rythme est parfois troublé par de brusques secousses comme en 1974. Il est probable qu'avec d'autres secousses éventuelles, ce rythme se maintiendra dans 1'avenir, grâce à une intervention de plus en plus massive des États dans l'économie. Mais cela n'empêchera pas la situation de s'aggraver inexorablement, imposant avec de plus en plus de force la seule alternative possible : GUERRE MONDIALE OU REVOLUTION PROLETARIENNE.
Le cours vers la guerre mondiale
Les guerres localisées, essentiellement déguisées en guerres de "libération nationale" n'ont pas cessé un seul instant depuis la fin du deuxième conflit impérialiste. Mais c'est au milieu des années 60, en liaison étroite- avec l'aggravation de la situation économique, que ces guerres deviennent de plus en plus fréquentes et violentes : Viêt-Nam, Laos, Cambodge, Biafra, Inde et Pakistan, Moyen Orient et tout dernièrement Chypre... On se demande quel sera le prochain pays à ajouter sur cette liste déjà longue.
Comme dans le passé, l'approfondissement de la crise conduit à une exaspération des tensions inter-impérialistes. Samuel Pisar, un des grands spécialistes des négociations internationales et particulièrement entre l'Est et l'Ouest résume la situation à une formule lapidaire : "Global needs, national means" ("Besoins globaux, moyens nationaux")[16] (1).
C'est là un des problèmes fondamentaux que ne peut résoudre l'économie capitaliste : la crise est mondiale alors que chacun des États doit tenter de la résoudre dans son propre pays et de la faire payer par d'autres. Après la ■ guerre commerciale, la guerre véritable est la conséquence logique de la situation.
Concernant cette aggravation des tensions internationales, il faut remarquer trois points :
1 - Les anciens foyers de guerre n'ont pas disparu alors que de nouveaux ne cessent d'apparaître.
C'est ainsi que périodiquement les journaux, viennent nous rappeler que la guerre n'a jamais cessé en Indochine, qu'elle est toujours prête à se rallumer au Moyen-Orient... C'est ainsi, par exemple, après plusieurs années d'accalmie que la question Kurde fait de nouveau parler d'elle. A l'heure actuelle, elle risque de revêtir une importance fondamentale. En effet, elle touche une région qui, entre la Méditerranée et le Golfe Persique s'étend le long de la frontière de l'Iran et de l'Irak qui sont deux très importants producteurs de pétrole et qui sont soutenus chacun par un des grands blocs : l’Irak par l’URSS, l'Iran par les Etats-Unis. La formidable accumulation actuelle d'armements par l'Iran et qui fait dire à un des proches du Shah que celui-ci se prend tantôt "pour un envoyé de Dieu sur la terre" tantôt "pour la Reine Victoria" en voulant "reconstituer l'empire britannique"[17], cette accumulation d'armements donc, est lourde de menaces pour l'avenir de cette région.
2 - Les blocs se renforcent de plus en plus et laissent de moins en moins de latitude aux nations secondaires qui les constituent. Ce phénomène avait déjà été illustré dès 1968 par 1'intervention russe en Tchécoslovaquie, pays qui tentait timidement de s'affranchir de la tutelle politique et économique de son "grand- frère". Il a été illustré plus récemment par une allégeance croissante de l'Europe Occidentale à l'égard des USA et tout dernièrement par l'affaire de Chypre. Dans ce dernier cas, l'évolution pro-russe de la politique de Makarios a été, sur ordre de Washington, brutalement interrompue par le coup d'État qui l'a renversé. Et la mainmise américaine a été renforcée par l'intervention de l'armée turque. Ces évènements ont montré à quel point les antagonismes nationaux qui depuis toujours opposent les différents États capitalistes, et qui en l'occurrence opposaient la Turquie et la Grèce, ne sont en fait que des cartes du jeu des grandes puissances, et qui, même s'ils sont exacerbés par l'intensification de la crise, doivent toujours céder le pas aux intérêts de celles-ci. Aujourd'hui les différentes tendances centrifuges que la crise fait surgir un peu partout n'ont aucune chance d'entamer la discipline croissante que chaque grande puissance exige de ses alliés dans la préparation des futurs affrontements inter-impérialistes.
3 - De la périphérie, les affrontements inter-impérialistes se rapprochent du centre.
D'abord localisé en Extrême-Orient, se rapprochant ensuite avec les conflits Indo-Pakistanais et du Moyen-Orient, l'affrontement Est-Ouest par petits peuples interposés a fait, avec la guerre de Chypre, un pas de plus vers le cœur du système. Cette fois c'est le contrôle de la Méditerranée qui était en cause, c'est-à-dire de la mer qui baigne à la fois l'Europe Occidentale et les champs pétrolifères du Moyen-Orient, qui est, du point de vue militaire, une des positions stratégiques les plus importantes du moment.
De la même façon que la crise a commencée d'abord par frapper les pays de la périphérie du système (Amérique Latine, Tiers-Monde) et qu'elle s'étend actuellement aux métropoles du capital, les champs d'affrontement des grands blocs impérialistes se rapprochent de plus en plus des centres nerveux de ces blocs.
Cela signifie-t-il que la guerre est maintenant inévitable entre les grands blocs eux-mêmes ?
La guerre est la seule réponse que le système puisse par lui-même apporter à la crise. Mais pour qu'il puisse la mettre en œuvre, Il doit disposer d'un prolétariat suffisamment brisé et mystifié pour que celui-ci accepte de marcher dans les sacrifices de la "défense nationale". Aujourd'hui, les premières atteintes de la crise ont jeté sur la scène historique un prolétariat d'une combativité inégalée depuis plus d'un demi-siècle. Les vieilles mystifications nationalistes et antifascistes ayant fait leur temps parmi les prolétaires des pays les plus avancés, la bourgeoisie est actuellement incapable de la mobiliser contre ses frères de classe des différents pays. Ceci signifie qu'avant que le capital puisse apporter "sa solution" à la crise, il doit d'abord briser le prolétariat. C'est pour cela que la perspective actuelle n'est pas GUERRE IMPERIALISTE GENERALISEE mais GUERRE CIVILE GENERALISEE. Et c'est à cette guerre-ci que la bourgeoisie devra se préparer de plus en plus.
Les préparatifs capitalistes à la guerre civile
N'étant pas marxiste, la bourgeoisie ne peut pas prévoir que la seule alternative à la crise actuelle est GUERRE ou REVOLUTION. Mais de la même façon qu'elle s'est rendu compte de la nécessité de se préparer de mieux en mieux à la guerre impérialiste, elle a pris conscience que la crise l'amènerait à affronter de plus en plus directement le prolétariat. A l'heure actuelle, pour chaque capital national, il n'y a pas 36 solutions pour tenter de tirer son épingle du jeu : il doit réduire le prix de ses marchandises pour prendre le marché de ses concurrents. Et pour ce faire, la bourgeoisie ne peut ni réduire dans ce prix la part revenant au capital constant utilisé, ni rogner sur ses profits qui lui sont indispensables pour rendre son capital plus productif et concurrentiel. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est peser sur la composante "capital variable" du prix de ses marchandises : en d'autres termes, attaquer le salaire des ouvriers. Pour elle l'énoncé du problème est donc simple : comment faire accepter à la classe ouvrière une réduction de son niveau de vie ?
Pour que les ouvriers soient prêts à accepter le sacrifice que la situation requiert, il faut donc qu'ils aient l'impression que leur intérêt et celui du capital national sont identiques ; que l'État est d'une certaine façon leur État.
Ainsi, dans les pays du bloc oriental, la propagande officielle ne cesse de répéter aux ouvriers que leur patrie-est celle du socialisme, de la classe ouvrière et donc que la défense de celle-ci passe par la-défense de cette patrie. Et quand les ouvriers font preuve d'une trop grande combativité, comme en 1970 en Pologne, on les gratifie d'un nouveau dirigeant ancien ouvrier comme Gierek qui vient leur montrer ses mains encore calleuses et leur demander au creux de l'oreille d'ouvrier à ouvrier, de reprendre le travail.
Dans les pays occidentaux, c'est la gauche qui sera appelée de plus en plus à demander à la classe ouvrière ces sacrifices.
D'abord son programme de nationalisations, de contrôle étatique plus grand sur l'ensemble de l'économie, plus qu'une fonction économique (qui peut être à certains moments assumée par la droite : au Chili, Pinochet n'a pas remis en cause les nationalisations d'Allende) assume la fonction .politique de faire croire aux travailleurs qu'on s'attaque aux intérêts privés et qu'on est donc beaucoup mieux placé pour lier la classe ouvrière à son capital national que les partis de droite, défenseurs traditionnels des "intérêts privés", et partant.de lut faire accepter bien plus de sacrifices.
Ensuite, les références "ouvrières" de la gauche, ses liens plus ou moins étroits avec les syndicats, en font "la représentante des intérêts ouvriers" au sein même de l'État. Un gouvernement de gauche, par le caractère de sa propagande, par l'origine sociale même de son personnel est une arme importante du capital pour tenter de dissuader les ouvriers de la nécessité de s'attaquer à l'État. Il peut même tolérer un certain nombre d'atteintes aux intérêts capitalistes (expropriations et autogestion en Espagne durant la guerre civile par exemple) du moment que la classe ne se pose pas le problème central de sa lutte : destruction de l'État capitaliste et prise du pouvoir politique à travers ses organes autonomes.
Enfin, la gauche, les partis "ouvriers" sont les mieux placés pour assumer la tâche spécifique de bourreau du prolétariat. Dans une période de montée des luttes révolutionnaires, le capital ne peut pas attaquer immédiatement la classe ouvrière : avant de l'écraser, il doit d'abord détourner sa combativité dans une voie de garage, endormir sa vigilance et la diviser. Dans Les expériences révolutionnaires passées, c'est exactement cette politique que la bourgeoisie a déployée face à la classe. Et si elle a finalement échoué en Russie en étant incapable d'éviter Octobre 1917, elle a pleinement réussi entre 1918 et 1923 en Allemagne où la révolution a été écrasée dans le sang des ouvriers et des meilleurs révolutionnaires (Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, etc.) par le parti social- démocrate lui-même.
Aujourd'hui donc, chaque échelon gravi par la crise et chaque pas en avant de la lutte de classe met plus à l'ordre du jour la mise en place de "solutions de gauche" à la tête des États capitalistes. C'est ainsi qu'on a pu voir en Grande-Bretagne la fonction exercée par le Parti Travailliste dans la liquidation de la grève des mineurs au début de 1974. On a pu voir de quelle façon les syndicats ont été associés à la politique capitaliste contre la classe ouvrière à travers le "contrat social". Cependant la combativité déjà importante des ouvriers anglais, qui risque de s'approfondir en même temps que la crise, oblige les syndicats à "gauchir" leur vocabulaire afin de continuer d'exercer une emprise minimale sur eux. C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'entrée d'un militant du parti communiste anglais (Ken -Gill) et de deux militants "gauchistes" (Clive Jenkins- et Jim Slater) à la direction du TUC lors du récent congrès de Brighton.
Dans un grand nombre d'autres pays, le capital prépare la relève de gauche et particulièrement en France, en Italie et en Espagne.
En France le reclassement de toute une partie de l'ancienne majorité derrière l'union de la gauche et particulièrement du Parti Socialiste (Jacques Delors, ancien conseiller de Chaban-Delmas vient de prendre sa carte du PS) s'accompagne de toute une campagne de séduction de la majorité gouvernementale actuelle en direction de François Mitterrand. Dans les milieux politiques, on parle de plus en plus ouvertement d'une équipe Giscard à l'Élysée et Mitterrand à Matignon. Le PCF de son côté, craignant de se faire doubler, a consacré son congrès- extraordinaire à "l'union du peuple de France" et a bien insisté sur le fait qu'il n'existe "aucune limite à l'union populaire".
En Italie, face à une situation économique et sociale inextricable la bourgeoisie se trouve confrontée à des problèmes politiques insurmontables. C'est dans ce contexte qu'on parle de plus en plus du "compromis historique" qui permettrait au puissant parti communiste italien de venir prêter main- forte au gouvernement, à la démocratie chrétienne. Ce parti "communiste" décidément très "réaliste" ne s'est pas gêné pour apporter son appui à Agnelli, directeur de Fiat, quand celui-ci a mis en chômage partiel plus de 60.000 ouvriers de son entreprise.
Ce parti a même réussi à rassurer une bonne partie de la bourgeoisie quant à sa politique extérieure qui se veut aussi européen et même atlantiste que celle de ses acolytes. C'est ainsi qu'Aurelio Peccei, président du "Club de Rome" a déclaré de lui:
"D'un point de vue strictement européen, nos communistes sont sans doute meilleurs que nos chrétiens-démocrates...Je pense qu'en Italie un homme comme Berlinguer peut beaucoup plus facilement que n'importe quel leader non socialiste fixer à l'Europe des objectifs suffisamment vastes, modernes et à long terme"[18].
La grande réconciliation de la démocratie chrétienne et du FCI pourrait se faire autour du thème de l'antifascisme qui aujourd'hui est agité de façon obsédante par toutes les fractions du capital, depuis celle qui est au pouvoir actuellement jusqu'aux gauchistes. Il n'y a pas de semaine sans que se produise un attentat "fasciste" immédiatement monté en épingle, sans qu'on découvre un nouveau "complot" d'extrême-droite, une nouvelle "piste noire".
En Espagne, après-franquisme est déjà en marche et même si le PCE semble pour le moment écarté des plans de la bourgeoisie, un nombre croissant d'anciens dignitaires du régime se tourne vers les partis démocratiques particulièrement vers le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier) dont le récent Congrès de Suresnes (France) a reçu une publicité importante de la part de la presse. Quant au PCE, les ponts ne sont pas coupés entre lui et les milieux qui préparent la relève : ils sont maintenus à travers "la junte démocratique" qui regroupe également Calvo Serrer, ancien directeur du journal "Madrid" et proche collaborateur du Comte de Barcelone, le père de l'actuel successeur désigné de Franco.
Le capital de ces différents pays a les yeux fixés sur le Portugal où justement la relève de gauche vient de s’opérer. Les évènements du Portugal sont particulièrement significatifs de la tendance actuelle à faire de la gauche le "gérant de la crise". C'est d'une part le pays du monde où la droite était la plus forte. D'autre part, c'est une fraction habituellement rétrograde du capital qui - a amené la gauche au pouvoir. Enfin, les évènements qui se sont déroulés depuis le 25 Avril 1974 ont indiqué clairement dans la pratique que la gauche, et particulièrement les PC, est la fraction du capital la mieux armée pour garder en mains une situation de plus en plus insaisissable. C'est la gauche qui au Portugal seule a pu venir à bout des guerres coloniales. C'est le PCP qui s'est révélé le meilleur auxiliaire de l’État et de l'armée pour venir à bout des grèves ouvrières qui se sont prolongées après le 25 Avril et particulièrement pour briser- la grève des postiers et celle des travailleurs de la compagnie aérienne TAP. C'est également le PCP qui s'est montré le plus efficace pour mettre en échec la dernière tentative de reprise en nain par la droite de Spinola fin Septembre, et en même temps pour -mobiliser les ouvriers pour une journée de travail gratuite le dimanche 6 Octobre.
L'autorité manifestée au service de l'ordre capitaliste par le Parti Communiste et le Mouvement des Forces Armées, principaux piliers du gouvernement provisoire a même été saluée par La Confédération de l'industrie Portugaise par un message de soutien à ce gouvernement le 3 Octobre.
La situation au Portugal préfigure ce qui va arriver bientôt dans beaucoup d'autres pays. Elle indique également, partout où ce sera possible, que le capital utilisera le thème de l’antifascisme pour détourner la combativité du prolétariat de ses objectifs de classe. Elle indique enfin que dans cette tâche, les gauchistes seront, comme ils l’ont été au Portugal,- des- auxiliaires de choix pour la gauche officielle.
Face aux grandes manœuvres que le capital développe un peu partout pour pouvoir affronter la classe ouvrière, il faut maintenant tenter de dégager quels problèmes celle-ci sera amenée à affronter dans sa lutte vers la révolution communiste.
Les préparatifs de la classe ouvrière
La grève générale de Mai 1968 en France -la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier-, "le mai rampant" italien de 1969 sont les premières grandes réponses que la classe ouvrière a apporté aux premières atteintes de la crise. La puissance de ces mouvements alors que celle-ci était encore relativement faible (ce qui a amené certains à conclure que les grèves n'avaient pas de causes économiques mais correspondaient à une révolte contre "l'ennui de la vie quotidienne") a d'emblée signifié que la perspective immédiate ouverte par la crise n'était pas celle de la guerre mondiale mais celle de la guerre civile.
Ces circonstances placent le prolétariat devant une situation entièrement nouvelle pour lui. • En effet, alors que toutes les révolutions bourgeoises ont fait suite à des crises économiques (1789, 1848, etc.), les tentatives révolutionnaires du prolétariat ont, dans le passé, toujours fait suite à une guerre : Commune de Paris après-guerre de 1870; révolution de 1905 après-guerre russo-japonaise; 1917 en Russie et 1918 en Allemagne, pendant et après la Première Guerre Mondiale. La montée révolutionnaire actuelle de la classe ouvrière est donc la première qui ne viendra pas à l'issue d'une guerre mais directement à l'issue d'une crise économique (telle que Marx l'avait envisagée pourrait-on dire).
Au centre des problèmes posés par la révolution prolétarienne se trouve celui du pouvoir. L'étape fondamentale par laquelle doit passer le prolétariat avant la transformation de la société est celle de la destruction de l'État bourgeois et de la prise du pouvoir politique : les différentes expériences révolutionnaires de la classe n'ont fait que confirmer l'importance de ce problème déjà souligné dans le "Manifeste communiste".
Mais, comme on l'a vu, celles-ci se sont déroulées à la suite de guerres qui ont obligé d'emblée le prolétariat à se confronter à des problèmes politiques et rapidement à se poser la question du pouvoir puisque c'était la seule qui pouvait décider du problème de la guerre.
Par contre, dans la période actuelle, le prolétariat sera confronté d'abord à des problèmes économiques. Sa lutte prendra nécessairement un caractère de plus en plus politique dans la mesure où elle sera obligée de s'affronter de plus en plus à l'État, mais le contenu même de ses revendications restera sur une longue période, économique. En fait les deux problèmes qui seront au centre de la lutte seront celui des salaires et celui du chômage.
Pour pouvoir concurrencer les marchandises étrangères, chaque capital national s'attaquera de plus en plus directement aux salaires, ce qui obligera les ouvriers à développer leurs luttes pour le maintien de leur pouvoir d'achat (contrairement à ce qu'ont pu dire les théoriciens de la "société de consommation").
De même, l'effondrement des marchés et donc de la production jettera un nombre croissant d'ouvriers dans le chômage, chômage dont on peut voir dès aujourd'hui la montée en flèche. Ce chômage risque, à certains moments, d'être un facteur de démoralisation et de recul de la combativité. Parce qu'il prive les ouvriers qui en sont touchés de l'arme de la grève et qu'il permet au capital d'exercer un certain chantage sur ceux qui ont encore du travail, le chômage est certainement une calamité qui désoriente beaucoup d'ouvriers. Mais en même temps, ce phénomène signe la faillite économique du système qui ne peut même plus garantir à la classe travailleuse le plus élémentaire : du travail pour vivre. En ce sens, c'est un puissant facteur dans la prise de conscience prolétarienne de la nécessité de renverser un système qui a fait la preuve évidente de sa caducité.
Si dans une période de recul de la classe, comme celle que celle-ci connaissait en 1929 au moment de la crise, le chômage provoque essentiellement le premier type d'effets sur la combativité ouvrière, c'est essentiellement le deuxième type de conséquences qu'il provoque dans une période de montée des luttes comme c'est le cas actuellement. C'est là une loi qui s'applique plus généralement à l'ensemble des expériences de la classe qui veut que celles-ci se transforment en facteurs de passivité, dé démoralisation et de recul du niveau de conscience ou bien encore en facteurs de plus grande combativité, d'enthousiasme et d'élévation de la conscience suivant le cours général du mouvement ouvrier dans lequel prennent place ces expériences. L'exemple le plus frappant en est celui des défaites. Depuis que le capitalisme est entré dans sa phase de décadence, celles-ci sont le lot quotidien de la classe. Si au siècle dernier, la marge de manœuvre dont disposait le système lui permettait d'accorder aux ouvriers de réelles améliorations quand ceux-ci luttaient, dans l'époque actuelle et surtout maintenant en période de crise ouverte le système est incapable d'accorder quoi que ce soit. C'est pour cela que les luttes ouvrières du XX° siècle aboutissent généralement à des défaites qui deviendront d'autant plus sévères que l'économie s'enfoncera dans le marasme. Mais si, dans les périodes de recul général de la classe, chacune de ces défaites est un degré de plus en plus -descendu dan* la pente qui conduit au gouffre de la guerre impérialiste, dans une période ascendante- chaque- défaite est, pour le prolétariat, un marchepied pour se propulser vers un niveau supérieur de radicalisation et de conscience.
Dans la période actuelle, les luttes économiques que sera conduit à mener le prolétariat seront essentiellement des défaites, défaites qui seront inévitables. Mais ce sont ces échecs qui lui feront comprendre la faillite totale du système, son incapacité à accorder autre chose qu'une misère croissante, donc la nécessité de le détruire. Ils lui feront prendre conscience, face aux tentatives des syndicats et de la gauche d'isoler ses luttes et de les détourner de ses objectifs de classe, de la nécessité de généraliser ses luttes, de se donner, .une forme d'organisation autonome et d'affronter cette gauche et ces syndicats.
Certains prétendent que les luttes économiques sont et seront défaites parce "qu'elles sont des luttes du capital" et qu'il faudrait donc dissuader les ouvriers de se battre sur ce terrain afin de leur éviter ces défaites.
D'autres voudraient également épargner aux ouvriers ces défaites en les faisant se battre pour des "programmes transitoires", des "échelles mobiles", le "contrôle ouvrier" (sur sa propre exploitation ?) etc.
Quel que soit le radicalisme qu'elles puissent afficher, ces deux conceptions tendent, en fin de compte, à démobiliser la classe dans son combat : la première parce qu'elle conduit à dire aux ouvriers : "abandonnez vos luttes actuelles" ; la seconde parce qu'elle tente d'enfermer ces luttes dans un carcan au lieu d'en élargir toujours plus le cadre et le contenu.
Pour notre part, nous affirmons que ces luttes économiques et ces défaites sont une étape indispensable du combat de- la classe vers son émancipation et qu'il n'existe pas de recette magique, de "saut dialectique" ou de revendication miraculeuse pour les éviter. En cela, nous ne faisons que prendre la suite des autres communistes qui dans le passé ont souvent répliqué aux philanthropes qui voulaient faire faire aux ouvriers l'économie de leur lutte contre l'exploitation ou de la défaite. Parmi ces communistes, nous ne citerons que Marx qui déclarait qu'une classe qui ne lutte pas contre l'exploitation de chaque jour ne sera jamais capable de faire la révolution, ainsi que Rosa Luxembourg qui écrivait la veille d'être assassinée par le gouvernement socialiste Ebert-Noske-Scheidemann :
"La révolution est la seule forme de "guerre" -et c'est là aussi une loi de vie qui lui est propre- où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de "défaites".
Une des autres grandes caractéristiques de la situation actuelle est, comme nous l'avons déjà signalé, que, contrairement à 1929, le rythme d'approfondissement de la crise est relativement lent. Ce fait a une grande importance sur les conditions dans lesquelles la classe est amenée à réagir à la crise.
Nous avons déjà constaté l'ampleur de ces premières réactions prolétariennes. Elles sont l'indice de formidables réserves de combativité dans les nouvelles générations ouvrières. Mais en même temps, compte tenu de la lenteur même de ce rythme ces réactions tendent à être relativement espacées dans le temps. Un des exemples les plus frappants en est sans doute la lutte de classe en France : il a fallu plus de six ans pour que les travailleurs reprennent, avec la grève des PTT, le chemin des luttes massives qu'ils avaient abandonné en Juin 1968. Entretemps, même si certaines luttes comme celle des OS de Renault, des vendeuses des Nouvelles Galeries, des Ouvriers de Lip, etc. avaient indiqué une radicalisation incontestable de certaines fractions de la classe ouvrière, le niveau moyen de la combativité n'était pas supérieur à celui d'avant 1968. La même situation se rencontre un peu partout : ce qui frappe, dans les luttes actuelles, c'est leur cours en dent de scie, les explosions brusques de combativité suivies d'une longue période d'apathie.
Ces conditions de la lutte font que le prolétariat éprouve les plus grandes difficultés à tirer les leçons de celle-ci. Entre chacune de leurs expériences dans un secteur donné, il s'écoule trop de temps pour que les travailleurs puissent encore réutiliser valablement les enseignements des premières dans les suivantes. Ainsi, les syndicats français qui en 1968 avaient été démasqués et débordés par un certain nombre de travailleurs ont réussi assez facilement par la suite à reprendre les choses en main et à se faire passer dans la grève des PTT comme les véritables défenseurs des travailleurs.
L'exemple est encore plus frappant en Italie : en 1969, la dénonciation des syndicats était devenue un des thèmes majeurs de beaucoup de grèves, aujourd'hui ceux-ci ont "regagné la confiance" de beaucoup d'ouvriers et maintiennent un contrôle important sur la classe.
La difficulté qu'éprouve la classe à tirer les leçons de ses expériences, ne provient pas seulement de l'irrégularité de ses luttes, elle est liée également aux circonstances historiques dans lesquelles se situe la montée actuelle du mouvement. Celle-ci intervient après la plus grande défaite de l'histoire du prolétariat, après une période d'un demi-siècle de contre-révolution -qui a privé celui-ci de la presque totalité de ses traditions quand elle n'a pas converti ces traditions en fétiches contre-révolutionnaires qui l'a privé des moyens mêmes de tirer parti de son expérience et au premier chef de ses partis et fractions communistes.
Et cette carence dans les moyens du prolétariat pour comprendre sa propre lutte est un facteur qui vient amplifier le cours en dent de scie de celle-ci. Pour la grande majorité des travailleurs la défaite qui suit chaque lutte importante est ressentie essentiellement sous cet aspect de défaite sans qu'elle puisse encore en comprendre l'aspect positif d'étape indispensable à ses combats futurs. C'est pour cela que ces luttes sont souvent suivies d'une période assez longue de démoralisation et d'apathie.
Mais il ne s'agit pas là d'un cercle vicieux, d'une situation sans issue. La crise générale du capitalisme ne pourra aller qu'en s'approfondissant contraignant les ouvriers à laisser de moins en moins de répit au capital. Un des exemples les plus frappants en est sans doute la Grande-Bretagne où la situation économique catastrophique - a conduit les ouvriers anglais à un combat continu contre la dégradation de ses conditions d'existence, combat que seule la mystification du gouvernement travailliste a pu momentanément tempérer.
Cette accélération du rythme de la lutte de classe, outre qu'elle permettra une accumulation d'expériences permettra ainsi de tirer un profit grandissant de celles-ci, d'intégrer de plus en plus les acquis de chacune dans la conduite des suivantes et donc d'approfondir le niveau de conscience et d'organisation de la classe.
Dès aujourd'hui, c'est dans un des pays où la lutte contre une des exploitations les plus dures d'Europe se donne le moins de répit, l'Espagne, que le prolétariat s'est également donné les formes les plus combatives et conscientes de cette lutte. Par certains de ces aspects le débordement des syndicats, la solidarité de classe, la pratique courante des assemblées générales, la tendance systématique à la généralisation des grèves d'une usine à l'autre, au niveau d'une ville ou d'une région (Vigo, El Ferrol, Pampelune, Bajo Llobregat, etc.), les affrontements avec les forces de répression -la lutte actuelle des ouvriers espagnols préfigure celle que devront de plus en plus mener les ouvriers du monde entier.
Aujourd'hui, le prolétariat est engagé dans une des plus grandes batailles de son histoire, probablement la plus grande. En face de lui, la bourgeoisie a compris que, plus que tout autre problème, celui que lui posera cette bataille sera difficile à résoudre. C'est pour cela qu'elle est en train de mettre en place les équipes politiques qui au lendemain de la première guerre mondiale lui ont permis de briser la première offensive généralisée de la classe ouvrière.
Depuis 1968, les ouvriers des quatre coins du monde ont répliqué massivement à la crise capitaliste. Mais le faible approfondissement de celle-ci et aussi leur manque d'expérience et de traditions ont permis encore au capital de contenir ces luttes, de les isoler ou de les détourner. Mais de plus en plus les ouvriers du monde entier seront confrontés à des situations comme celles qu'affrontent aujourd'hui les ouvriers israéliens qui ont vu, début novembre leur pouvoir- d'achat agressé sauvagement. Ils seront -alors obligés de reprendre le drapeau de la lutte qu'ils avaient pu ranger momentanément, et ils devront mener au capital un combat de plus en plus constant, profond et conscient.
Avec la misère croissante qui ne manquera pas d'accabler les masses travailleuses, leur vieux cri de guerre redeviendra de plus en plus à l'ordre du jour :
- "Que les classes régnantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner".
C.G.
[1] "Informations et Correspondance Ouvrières" venant d'"informations et Liaisons Ouvrières" qui fut une scission de "Socialisme ou Barbarie –(S ou B)" en 1958-59.
[2] "Groupe de Liaison pour l’Action des Travailleurs", issu d'une scission de S ou B en 1958-59.
[3]" Internationale Situationniste", dont un des théoriciens, Guy Debord a fait partie de S ou B avant de cracher dessus de toute la force de ses poumons.
[4] "Pouvoir Ouvrier" : tendance apparue dans S ou B au début des années 60 sur la base de "la défense du marxisme" rejeté par Cardan, pseudo de Castoriadis.
[5] Brochure "Organiser le courant marxiste - révolutionnaire".
[6] D'après "Perspectives économiques de l'OCDE", Juillet 1974.
[7] Idem.
[8] OCDE : Main économie indicators, Octobre 1973 et Octobre 1974.
[9] D'après "TIME" du 9 Septembre 1974.
[10] Article dans lequel on fait intervenir, entre autres différences, que les agriculteurs américains de l'époque étaient ruinés alors qu'aujourd'hui ils sont prospères...
[11] Réunion de presse du 24 Octobre.
[12] Titre d'une série d’articles de Cardan dans "Socialisme Ou barbarie".
[13] Seul groupe de notre courant international existant à l'époque.
[14] Cité par l’"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[15] Cette déclaration à elle seule est significative parce qu'elle met à mal toutes les envolées sur la "magnifique expansion" du Brésil qui devint prouver pour certain la possibilité de développer les pays du Tiers-Monde dans la période actuelle.
[16] Cité par l'"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[17] Cité par l'"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[18] "Le Monde" du 1° Août 1974.
Questions théoriques:
- L'économie [27]
Rubrique:
Le capital français à la dérive
- 7 lectures
En France, berceau du rationalisme, le petit bourgeois se plaît à expliquer le monde par de grandiloquents concepts métaphysiques de Droit, de Justice, d'Egalite ou de Liberté. Pour lui, l'échange international sur la base de l'entente loyale réciproque est le plus sûr garant de la marche en avant du progrès. C'est aux nations privilégiées de rivaliser pacifiquement entre elles suit le terrain économique pour faire bénéficier l'humanité entière des bienfaits de leur industrie et hisser toutes les autres à leur niveau par la sainte émulation de la libre-circulation des personnes et des biens.
Se pouvait-il alors qu'un pays qui a légué au monde moderne l'impérissable testament de la bourgeoisie triomphante, la "Déclaration de l'Homme", essaimé sa brillante civilisation sur les Cinq Continents, la France qui a montré aux autres nations l'image de leur propre avenir, puisse connaître les affres de la crise comme le dernier pays colonial ou semi-colonial ? "Que diable ! s'écrie notre buveur de camomille, la Touraine n'est pas le Sahel. Le peuple français qui a émerveillé le monde par les constructions de son génie doit être payé en retour; la voix de la France continuera à tonner dans les instances internationales pour faire respecter l'esprit des accords mondiaux ou alors gare à notre armée."
Il était si convaincu de l'universelle confiance placée par les peuples civilisés dans l'idéal français, il avait tellement nourri ses pensées de cette creuse philosophie que la réalité lui apparaît comme un maléfice jeté dans le dos de la démocratie française par quelque puissance occulte, en occurrence l'arabe qui surenchérit le prix du brut. Il ne peut plus dès lors se mettre au lit sans entrevoir aussitôt des places noires de monde, des ouvriers qui disputent la rue aux forces de police, bref le spectre de la sociale. Et de s'assurer que le verrou de son huis le protège vraiment des "partageux".
Si notre petit bourgeois, qui n'habite pas forcément les beaux quartiers, se trouve être membre "d'un parti pas comme les autres", il verra dans les malheurs de sa patrie la main des multinationales, ces forces étrangères à la nation, et, auxquelles se trouvent honteusement subordonné le gouvernement. "Que la France commerce avec les pays socialistes ! Qu'elle resserre les liens d'amitié qui lient notre peuple aux nations progressistes ! Et nous pourrons repartir de l'avant d'un nouveau pas" sera son cri du cœur, sa charte économique du bon sens et de la bonne volonté.
Mais aucun de ces deux citoyens respectueux de l'ordre capitaliste ne veut savoir que la contradiction .entre le développement de la production et le rétrécissement des marchés, forment une chaîne indestructible qui ne trouvera pas son Pinel parce que cette fois elle n'attache plus quelques malheureuses victimes de l'ordre asilaire, mais des pays dépendants tous des conditions mondiales dominantes.
De "droite" ou de "gauche", c'est le dénominateur commun de la bourgeoisie de voir, impuissante, son organisation sociale partir à la dérive, et ce en dépit de toute sa formation technique et intellectuelle acquise au cours de plusieurs siècles de pouvoir politique imposé soit par le knout, soit par des lois démocratiques "d'avant-garde". Cette faillite idéologique s'exprime avec force dans la science économique par un retour stérile à l'école keynésienne ou à opposer à celle-ci la rivale monétariste, l'une et l'autre incapables de saisir, dans toute leur ampleur, les tenants et les aboutissants d'une crise qualifiée "de civilisation". Toute intelligence de ce qu'est vraiment l'économie politique abandonnée pour un empirisme vulgaire, la vénérable Académie Royale de Suède couronnera la recherche économique de deux parfaits imbéciles au lieu de leur remettre le bonnet d'âne mille fois mérité, le suédois Myrdal et l'autrichien Von Hayek.
La première de ces deux lumières a écrit une bibliothèque pour expliquer la chose suivante : "L'un des dangers de l'inflation vient de l'irritation qu'elle provoque entre le mari et la femme, le travailleur et l'employeur, les citoyens et le gouvernement". Le second expose, avec tout le sérieux requis par sa fonction sociale, les thèses qui lui ont valu de partager le prix Nobel d'économie avec la première cité. Elles ne sont pas moins grotesques : "À chaque époque, il existe une proportion idéale entre la valeur des biens de production investie et celle des biens de consommation. Cette proportion idéale dépendrait, dans un système d'épargne volontaire, de la seule abstinence des individus" pour conclure à l'impossibilité du socialisme car pour ce plumitif, les tendances socialisantes portent la responsabilité des fascismes que les politiciens auraient dû empêcher en organisant le système libéral".
Tels sont les brevets de maîtrise intellectuelle décernés par les Harvard, Cambridge et les London School of Economies.
LA CRISE MONDIALE EN FRANCE
Chez certains "marxistes" à la vue basse, on en est encore à parler de crise de l'automobile, de crise de l'aéronautique, de crise du textile, de crise du bâtiment, de crise céréalière et, ainsi de suite jusqu'à l'infini. En outre, ce qu'ils ne peuvent comprendre, c'est l'impossibilité pour chaque fraction du capital de ' se détacher les unes des autres pour vivre une paisible robinsonnade autarcique.
Ainsi, le tassement intervenu dans la zone d'échanges commerciaux de la CEE au premier semestre de l'année 1974 était consécutif à la baisse prononcée de la production américaine et japonaise. Il faudrait que s'y produise le renversement d'un tel cours pour que la croissance française se ressaisisse. Et même si c'était le cas, le rythme de reprise s'élèverait tout au plus à 3,6% comme le prévoit le B.I.P.E.(Bureau d'information et de Prévisions Économiques). Mais en raison d'un chômage qui a crevé le plafond des 7% de la population active américaine, des 4 millions de chômeurs dans les pays de la CEE, cette perspective appartient au domaine des illusions.
Comment progresse la crise en France, pays membre de la CEE, nous le voyons au moyen de la bourse même si c'est au travers d'un prisme déformant. Depuis les huit premiers mois de l'année, l'hémorragie des valeurs continue sans qu'aucun garrot d'urgence n'ait pu arrêter le flot, et les observateurs boursiers notent un recul de l’indice général de 35%, au plus bas depuis une dizaine d'années. En raison des incertitudes générales planant sur les chances de reprise de la croissance "Industrielle, du progrès de l'inflation, des valeurs qui hier encore intéressaient d'éventuels investisseurs se raréfient. De cela ressort que le chancre inflationniste a entamé, en profondeur, des gains de productivité obtenus par une augmentation d'appropriation du surtravail. C'est pourquoi l'écroulement de la plupart des titres notamment ceux des sociétés Michelin, Moulinex, Poclain, auparavant vedettes du hit-parade boursier conduisent cambistes et actionnaires à multiplier les allusions à la crise de 1929. Lorsque l'ensemble des opérateurs en vient à parler de créer une "Croix Rouge" internationale des banques, c'est que le seuil de dislocation du marché mondial n'est pas loin.
Au Printemps "des barricades", à la grève généralisée du Mai 1968 avait succédé une vigoureuse reprise industrielle : les entreprises françaises se classaient parmi les quarante firmes européennes les plus rentables en 1972; sur les 105 entreprises mondiales réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à deux milliards de Dollars, 9 étaient nationales, c'est-à-dire autant que le Japon et le Royaume-Uni. Durant une courte période au début de 1973, la France était parvenue à occuper le troisième rang mondial des pays exportateurs, derrière les Etats-Unis et l'Allemagne Fédérale, devant le Japon. Le taux de couverture des échanges passait de 100% en 1967 à- 104% en 1973. D'importantes restructurations opérées dans l'appareil de production, peu après la décolonisation, expliquerait en partie cette progression. (Péchiney-Ugine-Kulhman, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson).
A présent, s'agit-il de crise de "reconversion", de "crise passagère", ainsi que quelques manitous de l'idéologie dominante s'efforcent de l'accréditer ? Aucune véritable comparaison ne peut être établie avec la récession passagère des années 1957-60, corollaire de l'inévitable décolonisation, récession qui devait provoquer la fermeture de mines, d'usines textiles, le marasme local ou même régional. Il s'agissait à cette époque d'une refonte de l’appareil reproductif décidée par les représentants de pointe du patronat et de la haute administration français. Sous le capitalisme dirigiste, où l'État se donne les- moyens d'exercer la planification, de la prévision, la restructuration ne constitue pas une raison de crise réelle. La bourgeoisie continue d'avoir bien en mains les secousses qui s'en dégagent.
Qu'il fasse de la "mono" ou de la polyculture, qu'il produise des biens de consommation ou des biens de production, le paysan et l'entrepreneur industriel sont également touchés par une crise qui tient en ceci : la fin de la période de reconstruction d'après-guerre. Face à elle, aucune couche sociale ne se trouve être immunisée, aucun secteur d'activité ne peut s'y soustraire. La crise est générale à tous les pays, et, de son caractère véritablement international dépend l'avenir de la société humaine : ou guerre ou révolution prolétarienne.
Les faciles rodomontades du genre : "La France n'a pas de problème d'emploi global et notre taux de chômage est l'un des plus faibles au monde" faites par Fourcade lors de la présentation du budget de l'État le 19 Septembre, ou encore celles de Poniatowski déclarant au journal "Newsweek" : "En 1969, nous sommes parvenus, et sur la base de prévisions, à rattraper l'Angleterre" ont la clarté du borgne en voyage au royaume des aveugles. La difficulté grandissante de la bourgeoisie à travestir les faits introduits dans la "vie économico-sociale pour la bouleverser, l'amène à parler un langage social différent. Ceux-là mêmes qui élevaient du plus profond de leur poitrine d'idéologues des alléluias pour célébrer le "miracle français", son cortège d'augmentations constantes de la production, des profits du capital, se mobilisent sur l'heure pour se faire les apôtres d'une nouvelle règle de vie à la Spartiate. Leur fonction d'endormeurs de la classe ouvrière demeure au-delà de leur spécialisation idéologique du moment. .
Une énième fois, la vision marxiste triomphe sur le cadavre de ses détracteurs et, pour les petits maîtres poussés sous la serre universitaire, la pilule est amère.
Autre tarte à la crème pour régaler les gogos : la hausse du prix du pétrole a entraîné une formidable poussée inflationniste. Or, l'incidence de cette hausse, qui somme toute ne représente qu'un épiphénomène du marché mondial est comprise entre 2 et 2,5% sur une augmentation générale des prix à la consommation de 16%. Il s'agit donc, à un moment où le taux de couverture est descendu à 90%., de rééquilibrer la balance commerciale. Certes, une économie de 10% de la consommation pétrolière épargnerait 5 milliards de Francs à l'économie française, mais désorganiserait la production industrielle et agricole à tel point que le capitalisme devrait retourner en arrière. Le fardeau de la politique énergétique malthusienne sera donc rejeté sur les épaules de la classe ouvrière.
Le gouvernement prépare l'opinion à un rationnement de la consommation énergétique par la généralisation d'un plan de répartition appliqué dans l'hiver 1973 un première fois à 73 départements métropolitains. Dans son discours devant l'association de presse anglo-américaine du 19 Septembre, M. Chirac a apporté d'utiles précisions quant aux intentions gouvernementales: "...Mobiliser l'opinion publique contre le gaspillage d'énergie de façon libérale ce qui est notre vocation, de façon autoritaire ce qui est notre devoir". La solidarité nationale, ce mot que la bourgeoisie ressort chaque fois qu'elle s'avère incapable de se maintenir solidement dans son rôle de classe dominante de la société et d'imposer les règles de l'accumulation, voudrait que la classe ouvrière s'adapte à des mesures dites "consignes de lutte contre le gaspillage" acceptant du coup de voir son standard de vie directement attaqué. Sinon, ce sera la matraque du flic qui s'abattra très démocratiquement sur elle.
Si en 1973, le solde de la balance commerciale faisait apparaître un gain de 1500 millions de Dollars (36000 et 34500), fin 1974 il y aura un déficit de l'ordre de 4050 millions de Dollars (44950 et 49000). C'est pourquoi les programmes de redressement économique portent en priorité sur l'effort à l'exportation. La bourgeoisie l'a annoncé par la voix de son actuel ministre des finances, M. Fourcade. Traduit en langage marxiste, cette invite plusieurs fois réitérée, est synonyme de "retroussez vos manches !" et du "serrez-vous la ceinture !", car, le rétablissement de l'équilibre implique l'exportation de toute augmentation de la production et non sa consommation pour satisfaire les besoins intérieurs. Comparativement avec' la stratégie de relance, espérée quelques semaines plus tôt dans une allocution présidentielle pour retourner la conjoncture le contraste est énorme. C'est le moins qu'on puisse dire.
Des idéologues de la bourgeoisie en viennent à parler un langage typiquement maoïste : "Dans la période de transition qui s'imposerait, compter sur ses propres forces serait absolument essentiel" dixit C. Goux, ci-devant professeur à l'université de Paris-I et à qui le très sérieux "Monde Diplomatique" offrait l'hospitalité de ses colonnes dans son dernier numéro de Novembre 1974.
Comment l'intervention d'un Giscard d'Estaing pourrait-elle arrêter l'incendie dès lors que les conditions de fonctionnement antagoniques de la société renforcent leur caractère. La bourgeoisie française soumise à une rude loi économique dont elle reste l'objet, prend les dispositions rendues nécessaires par l'accentuation de la crise. Mais cette fuite en avant la conduit à une impasse : voulant chasser une inflation consécutive au lancement de travaux improductifs par la porte, elle fera rentrer le chômage par la fenêtre. ' Si besoin était, les compressions drastiques des dépenses courantes de l'Etat (1,6 milliards de Francs de crédit inscrits au Fonds d'Action Conjoncturelle et, 1 autre milliard de Francs sans étiquetée précise ne seront pas débloqués cette année), l'irréversible tendance à la stagnation démontre l'incapacité de la bourgeoisie à résoudre les contradictions immanentes au capitalisme et, dans lesquelles elle se débat en pure perte.
Il suffira que moins d'équipements soient réalisés par les grandes entreprises nationalisées, telles que la SNCF, les PTT, l'EDF..., que ce qui devait être renouvelé en temps utile serve jusqu'à la corde, pour que certains "marginaux" se croient autorisés à parler de succès des thèmes écologiques, de préservation des ressources de la nature, de sauvegarde de la qualité de la vie et autres bobards, de concert avec la bourgeoisie favorable à donner un tour de vis supplémentaire.
"De toute manière, la crise n'est pas de conjoncture. Elle constitue un avertissement: les ressources de la planète sont limitées. Il faut donc, de gré ou de force, réduire nos importations, c'est-à-dire renoncer au gaspillage. Cette nécessité économique rejoint les exigences de l'environnement puisque toute la dégradation du milieu de vie est finalement du gaspillage" (souligné par nous. N.d.R.) expliquera en substance M. Gruson, sous-fifre du Ministère de la Qualité de la Vie.
L'ACCROISSEMENT DU CHOMAGE EST UNE FATALITE DU CAPITALISME DECADENT
Dans la période ouverte avec l'irruption de la crise des débouchés, la bourgeoisie est contrainte de refuser de s'encombrer d'entreprises en difficulté. Que l'État modifie sa politique de subvention financière, qu'il brandisse ses foudres de guerre économique, à savoir la restriction du crédit et la fixation d'une taxe conjoncturelle, et c'est le surgissement en nombre des faillites. Pour en savoir plus long sur cette dernière décision qui a provoqué la levée de boucliers des PME, il faut écouter quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, M. A. Roux, vice-président du CNPF : "On peut se demander si l'on ' n'a pas fait preuve d'une pudeur excessive à tourner autour du pot alors qu'on aurait pu envisager simplement une taxe sur les augmentations de salaires abusives."
Leur président, M. Gingembre a beau rappeler la tradition libérale de l'économie française, protester auprès des pouvoirs publics comme un diable trempé dans un bénitier, descendre dans la rue entourée de ses troupes, n'empêche, à brève échéance, les PME finiront dans l'étouffement d'un crédit toujours plus rarissime et plus cher. Le temps où celles-ci pouvaient faire appel au capital financier, au crédit-bail dont la formule connaissait le succès que l'on sait, est révolu. Quand bien même les dirigeants des PME menaceraient de fermer leurs entreprises le 25 Novembre, le gouvernement n'entend nullement relâcher son étreinte. Bloch-Lainé, PDG du "Crédit Lyonnais" ne vient-il pas d'être sanctionné pour s'être cru au-dessus de la solidarité gouvernementale ?
Il reste que seules les grandes entreprises placées en situation de force sur un marché mondial pris de convulsions continueront à recevoir des crédits en augmentation de façon à consolider leur capacité concurrentielle. Tout naturellement, les dépenses de l'État-patron iront vers les entreprises nationalisées et publiques. Une partie de leur financement sera assuré par la hausse de leurs propres tarifs et, par des emprunts sur le marché .financier international. D'ores et déjà, tout ce que le pays compte de politiciens en place ou y aspirant a entrepris de flatter l'instinct à l'épargne du petit bourgeois français à qui est promis un taux d'intérêt indexé sur l'inflation.
En conséquence, on est largement en droit de s'attendre à une rapide crue de l'armée des sans travail, forte aujourd'hui de 630.000 unités :
- de Juillet 1973 à Juillet 1974, le chômage s'est accru de 15%, les offres d'emploi ont diminué de 25% pour le seul mois de Septembre, 100.000 travailleurs ont été rejetés de la production parce que sans utilité pour l'appétit d'accumulation de la bourgeoisie.
- dans les PME, dont les carnets de commandes se situent au plancher, le dépôt semestriel de bilans aura été de 8000, soit 23% de plus que durant une même période l'an passé.
Qu'est devenue l'industrie de construction automobile longtemps considérée comme l'épine dorsale et l'ambassadeur de la croissance industrielle française avec ses deux millions de salariés et des centaines d'entreprises sous-traitantes si ce n'est le malade qui donne des signes de faiblesse les plus inquiétants. Citroën ne pourra survivre que dans une association de type holding avec Peugeot. A ce jour, 1'exportation d'automobiles françaises qui avait atteint son maximum au cours du premier semestre 1974 a commencé sa chute et, sur le marché national par rapport à L'an passé, les préfectures ont enregistré une baisse d'immatriculations de 25%.
L'agriculture, le secteur des biens de consommation, la petite mécanique sont les branches touchées de plein fouet par la crise. Non parce qu'il y aurait une faillite de gestion mais parce que les partenaires de la France doivent, pour faire solder la crise aux travailleurs qu'ils tiennent sous leur coupe, cesser d'importer ces marchandises dont la France est grande exportatrice. Dans la longue liste des entreprises en difficulté on trouvera encore l'aéronautique qui n'a pas ' su se tirer de sa mauvaise- passe malgré les faramineuses commandes passées par l'industrie d'armement. Là, le directoire de la SNIAS a eu recours à un véritable tour de prestidigitation : le transfert des activités traditionnelles dévolues aux usines de Tarbes et de Bourges à celles de Toulouse afin d'y maintenir le niveau de l'emploi.
Avec une rapidité ignorée depuis bien des lustres, le chômage partiel ou total, est en train d'étendre ses ravages sur l'économie française, inéluctabilité engendrée par le capitalisme à sa période de décadence. Ce qui est fondamental, c'est qu'en fonction du caractère non cyclique mais permanent de la crise, ces centaines de milliers de chômeurs ne forment pas une armée de réserve dont les éléments pourraient retrouver leur place à l'usine à la -suite d'un nouvel essor du capitalisme. L'incertitude et, l'instabilité auxquelles l'exploitation capitaliste soumet le travail vivant n'a pas cessé de se renforcer. Ce qui est véritablement à l'ordre du jour est bien : "le combat ou la mort; la lutte sanguinaire ou le néant. C'est ainsi que la question est véritablement posée;" (Marx) car le capitalisme a cessé d'être un mode de production progressif.
A-t-il raison, le patronat d'espérer venir à bout de la classe ouvrière en agitant sous ses yeux l'épouvantail de "la crise ? Si lors de la dépression mondiale des années - 30, il était possible à la bourgeoisie de diviser le prolétariat en profitant au maximum de sa faim, de désamorcer la bombe sociale en jouant sur le réflexe d'autoconservation individuelle, cette perspective est sans objet. Aujourd'hui, la période est à la reprise mondiale de la classe, le prolétariat européen a conservé intact son potentiel de lutte qui, à tout moment peut embraser l'ordre capitaliste.
Contre l'attente de l'État, loin d'avoir levé un vent de panique chez les travailleurs, les menaces de licenciement, les réductions d'horaires sans compensation de salaire ont, au rebours, déclenché le regroupement combatif de leurs forces. Les risques de réaction brutale de la classe ouvrière demeurent trop réels pour que l'État se heurte de front à ses conditions d'existence. Jusqu'ici, la tactique de la bourgeoisie a été de procéder par petits paquets, et promettre des allocations de secours aux ouvriers chassés des usines.
Une chose est certaine : le refus de l'État à entretenir une force de travail désormais superflue puisqu'il n'y trouve plus le profit es- compté. Ce qui était possible de faire avec deux cents ou trois cents mille chômeurs ne l'est plus une fois franchi le cap des deux millions. Alors que, le triomphe facile, les syndicats claironnaient "victoire" (!) sur l'accord du 14 Octobre, le gouvernement n'a pas tardé à préciser qu'il laisserait presque entièrement à la charge des employeurs et des salariés le financement de la garantie des ressources aux chômeurs. L'allocation ne serait pas relevée de 10 à 16 Francs pour qu'elle soit au même niveau que l'allocation minimale de 1'UNEDIC.
Avant même d'avoir, pu chloroformer les travailleurs, le sens réel des accords patronat- syndicats relatifs à l'assistance apportée aux chômeurs s'est dissipé en fumée, ne pouvant plus cacher l'abandon de centaines de milliers de travailleurs, de femmes sans emploi, de jeunes à la recherche pour la première fois d'un travail. Qu'ils se fassent une raison eux pour qui les causes de leur souffrance sont d'ordre "démographique", "sociologique", comme l'a souligné Monsieur Durafour, Ministre du Travail, devant la sénile Assemblée Nationale.
Le capitalisme qui, sans lésiner, accorde droit d'asile, droit à la contraception, droit de vote à dix-huit ans a fait de toutes ces catégories de prolétaires de véritables parias. Ils ne recevront d'aide matérielle de personne si ce n'est de leurs familles, ceci parce que pour le prolétariat, seule classe non exploiteuse de la société, la fraternité n'est pas un mot creux et sournois mais sa véritable forme d'existence sociale.
LA POLITIQUE CAPITALISTE DU "PROGRAMME COMMUN"
On - aurait tort de croire qu'en décidant les grèves pour la défense de l'emploi -ou en les prenant en marche- les syndicats cégétistes et cédétistes luttent pour le maintien du niveau de vie de la classe laborieuse. Sous le leitmotiv d'empêcher "le démantèlement des établissements nationalisés", de fait ils veillent en cerbères à la défense de la Nation, de son économie, de son capital. Le sentiment que la défense des intérêts des travailleurs passe par celle de l'économie nationale est un poison que les staliniens distillent dans la classe ouvrière pour la river plus solidement à la galère capitaliste battue en brèche.
Toute la gauche mène campagne contre la "braderie" de l'économie nationale, contre la dépendance française à l'égard de la puissance américaine qui, après la disparition de De Gaulle, a pu augmenter ses apports de capitaux, ses prises de participation dans l'industrie hexagonale : 4 milliards de Francs de 1969 à 1971. N'est-il pas dans l'ordre des choses que l'autre grande famille de patriotes français, le gaullisme, lui emboite le pas ? Que Marchais se découvre devant la mémoire du général dont le nom reste attaché "à la fierté nationale recouvrée" ?
Qui analyse la politique du parti soi-disant communiste y verra une volonté forcenée de maintenir la classe des esclaves salariés sous la domination du capital, quel qu'en soit le prix payé par le prolétariat : "Après beaucoup de misères, souffrances et cadavres abandonnés sur le champ de bataille de 1'industrie"(Marx). Pour ces modernes marchands de chair humaine, il faut prouver, chiffres en main, la rentabilité des entreprises depuis les usines Coder jusque et y compris aux plus infâmes boyaux de mines lorrains. Des mains sclérosées d'une autre fraction de la bourgeoisie, ils ont recueilli le credo de la religion du capital : stimuler l'appétit d'accumulation en flétrissant toute consommation individuelle ne venant pas renforcer l'appareil de guerre économique. Et devant les travailleurs, ils exalteront l'idéal de la canaille : selon lequel plus le maître est gras, mieux se porte l'esclave. Si l'ouvrier ne trouve plus dans la classe ennemie l'acheteur de sa force de travail, son existence toute entière subordonnée au rapport salarial se trouve compromise. Le capitalisme, comme puissance sociale déterminée et non comme force personnelle, disparaît de la scène s'il ne fonctionne plus en tant que processus d'accumulation.
Quand, relayé par son réseau complexe d'organisations syndicales, culturelles, municipales, sportives, le PCF explique que "le petit et moyen capital non monopolistique est à son tour pillé par le grand capital", quand devant son XXI° Congrès Extraordinaire de Vitry il conclut à une solidarité entre travailleurs et petits patrons qui battent de l'aile, quand l'"Humanité",, son organe central, ironise dans ses colonnes que "si la gauche était arrivée au pouvoir, les PME seraient aujourd'hui en bien meilleure posture car le Programme Commun n'est pas un programme de collectivisme", c'est cette communauté d'intérêts qui est proclama entre le maître et l'esclave. Hier, les Pères de 1'Eglise glorifiaient le servage médiéval, aujourd'hui les sycophantes staliniens de l'économie politique se prosternent devant le Veau d'Or.
Qu'attend donc le gouvernement pour exploiter "des centaines de millions de tonnes de charbon (qui) dorment sous, le sol de la France, condamnés"? De faire fabriquer pour son compte : "l'industrie française est obligée d'acheter pour un milliard à l'étranger les machines dont elle a besoin et, qui pourraient être fabriquées ici". ' ("L'Humanité. 9/11/74). L'autre aile marchante de la contre-révolution, la CFDT, ne tient pas un langage différent; elle-même s'est livrée à une étude sur les prix à la production. Cela donne; par exemple : "la compétitivité du charbon national est donc indiscutable. Si l'on valorisait le prix du charbon national, compte tenu du coût de la thermie fuel, les charbonnages de France pourraient être une entreprise bénéficiaire" ("Le Monde" 14/11/74).
En dénonçant le mauvais coup de mise en chômage technique à Rhône-Poulenc ou à Citroën, le stalinisme tire très habilement profit de la situation de crise pour renouveler sa candidature au pouvoir, afin de gérer les intérêts capitalistes. Il a donc besoin du soutien indéfectible de la classe ouvrière, cette "grande force tranquille" qui- "luttant pour ses salaires a la conviction qu'elle défend l'intérêt national et l'avenir de notre pays, que la politique gouvernementale compromet gravement" ("L'Humanité" 9/11/74).
Réellement, il s'agira pour l'ennemi recouvert d'un masque "ouvrier" de prêcher la pratique du baise-main au patron, d'encenser la soumission aux intérêts suprêmes de la nation. Avec l'aide consciente des gauchistes qui après leur petit score au premier tour des législatives partielles d'Octobre se sont désistés par "discipline prolétarienne" au profit du candidat unique de la gauche, on tentera d'annihiler la combativité de la classe sur le terrain des mystifications électorales, syndicales et autogestionnaires. Dans un autre moment, si les travailleurs ne se sont pas laissés épuiser par des balades, on essaiera d'écraser sous une pierre tombale la saine réaction de classe, devenue pour les chiens de garde un crime pour la France républicaine.
Le prolétariat n'est pas un peu contre le régime de la libre concurrence et beaucoup contre les monopoles. Pas plus qu'il n'est contre les différentes formes revêtues par son exploitation, il n'est contre tel ou tel gouvernement qui y correspond et l'assume. Son opposition à la société qui fait de son travail, un article de commerce est irrépressible. Pour cette même raison, et parce qu'il "refuse de se laisser traiter en canaille" (Marx), le prolétariat est le seul sujet révolutionnaire conscient de la nécessaire transformation du monde, l'agent qui assurera "le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté". Liberté qui ne commencera que là où le travail salarié aura cessé de s'imposer aux hommes.
R. C.
Situations territoriales:
Rubrique:
Les syndicats contre la classe ouvrière (*)
- 89 lectures
(*) Cet article est une reprise de l'article paru dans le numéro 3 de R.I. n° 3, ancienne série (décembre 69),"GREVES SAUVAGES ET SYNDICATS". Plusieurs modifications et ajouts y ont été apportés.
Il y a un siècle, la constitution d'organisations syndicales était pour la classe ouvrière un sujet de lutte contre les gouvernements. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements et le patronat qui luttent pour la syndicalisation des ouvriers.
- "Une certaine re-syndicalisation de la masse ouvrière française est nécessaire, car elle donnerait aux employeurs un interlocuteur valable et limiterait la gravité et la fréquence des conflits sociaux." (Schuman, lorsqu'il était ministre d'État chargé des Affaires Sociales, à France-Inter le 4 décembre 1968.)
"En contre-partie de la liberté des chefs d'entreprise, il est souhaitable que, comme élément d'équilibre, le syndicalisme ouvrier puisse s'affirmer. Personnellement, plus je suis partisan de la liberté, plus je souhaite un syndicalisme ouvrier fort. Et cela, c'est vraiment la conception d'une société cohérente." (F. Ceyrac, président du C.N.P.F., organe le plus représentatif du patronat français.)
Dans tous les pays, les gouvernements subventionnent plus ou moins grassement les centrales syndicales, et le patronat "éclairé" souhaite le "renforcement des syndicats ouvriers".
Quant aux ouvriers, ils se battent en dehors des syndicats, et contre eux. Les grèves anti-syndicales, les grèves sauvages, sont devenues le cauchemar du capital international. Qu'il s'agisse de grands éclats de la lutte ouvrière (comme Mai 68 en France, 69 en Italie ou 70 en Pologne, par exemple), ou des grèves parcellaires qui marquent chaque jour la vie du capitalisme mondial, une même règle se vérifie à chaque occasion : LE PROLETARIAT NE PARVIENT A SE BATTRE POUR SES INTERETS QU'EN SE HEURTANT AUX SYNDICATS. Le caractère "sauvage" d'une grève est devenu la première condition d'une véritable grève ouvrière.
Ainsi, les ouvriers se dressent aujourd'hui contre les organisations que leurs camarades avaient constituées, il y a cent ans, au prix de luttes acharnées.
Les ouvriers du siècle dernier avaient-ils donc tort de former des organisations syndicales ? Marx se trompait-il lourdement quand il y voyait un pas fondamental dans la lutte historique du prolétariat ? Toutes ces luttes ont-elles été inutiles, voire même néfastes pour l'avenir de la classe ouvrière ? Ou alors, est-ce que ce sont les ouvriers de notre é- poque qui ont perdu le "fil de l'histoire" ? Les grèves sauvages sont-elles seulement l'expression de leur incapacité à reprendre les tâches de leurs prédécesseurs et à former de "bonnes organisations syndicales"?
Il s'agit en fait de deux formes de luttes correspondant à deux époques historiques différentes.
Depuis le XIXe siècle, beaucoup de choses ont changé dans le capitalisme, et, fondamentalement le fait que d'un système en plein essor, il est devenu un système historiquement décadent.
La période ascendante du capitalisme
Détruisant les rapports de production féodaux et construisant un monde à son image, le capitalisme a connu au XIXe et au début du XXe siècle, une expansion extraordinaire et sans heurts importants.
L'organisation capitaliste de la production correspondait à des besoins historiques objectifs, réels. Après l'étouffoir qu'étaient devenus les rapports de production féodaux, elle permettait aux forces productives de reprendre un essor extraordinaire, sans précédents dans l'histoire de l'humanité. La bourgeoisie avait le monde entier à industrialiser, ses profits croissaient sans limites, les débouchés pour l'industrie semblaient intarissables, les frais improductifs de maintien du système étaient insignifiants. (L'État, principale source de dépenses improductives du capital, était essentiellement circonscrit à sa tâche de "gendarme" et constituait un appareil relativement restreint.)
Dans ce contexte, le capitalisme pouvait accepter, si la lutte de la classe ouvrière le lui imposait, une modification de la répartition du produit social. Il lui était possible de supporter une augmentation réelle des salaires, ou une diminution effective du temps de travail, sans pour cela courir à la faillite ou se lancer dans une spirale inflationniste. La prospérité du système était telle qu'elle créait au sein de l'antagonisme entre ouvrier et capital un terrain "d'entente", où des améliorations réelles de la condition ouvrière ne s'opposaient pas irrémédiablement à des avantages pour l'expansion du capital.
Lorsque le prolétariat arrachait la satisfaction d’une revendication, c'était de façon durable, réelle ; toutes les formes de lutte en étaient déterminées : partis politiques de masses, parlementarisme, syndicalisme. Le réformisme, non comme idéologie, mais comme forme de lutte, avait un sens pour la classe ouvrière parce qu'il était possible.
Un tel état de choses est difficile à concevoir aujourd'hui, après un demi-siècle au cours duquel toute augmentation générale des salaires a été immédiatement annulée par une hausse équivalente des prix et où toute promesse de réduction du temps de travail est pour l'essentiel restée lettre morte[1].
Afin de mieux comprendre les conditions historiques qui faisaient du syndicalisme un véritable instrument du prolétariat au XIXe siècle, voici comment Marx commentait dans "SALAIRE,PRIX et PROFIT" la conquête de la Loi des Dix Heures par les ouvriers anglais :
- "Vous connaissez tous le Bill des Dix Heures, ou plutôt des dix heures et demi, introduit depuis 1848. Ce fut là un des plus grands changements économiques dont nous n’ayons jamais été témoins. Hausse des salaires subite et forcée, et cela non pas dans quelques branches et localités, mais dans les branches principales de l'industrie qui donnent à l'Angleterre la suprématie sur les marchés mondiaux. Hausse des salaires effectuée dans des circonstances singulièrement défavorables.) Cette douzième heure qu'on voulait ôter aux capitalistes, c'était à les en croire (les économistes "officiels") la seule et unique heure de travail d'où ils tiraient leur profit. Ils nous annoncèrent de grands maux : l'accumulation diminuée, les prix en hausse, les marchés perdus, la production ralentie, avec réaction inévitable sur les salaires, enfin la ruine. (...) Le résultat ? Une hausse des salaires en argent pour les ouvriers des fabriques, en dépit du raccourcissement de la journée de travail, une augmentation importante des bras employés, une chute continue du prix des produits, un développement merveilleux des forces productives de leur travail, une expansion inouïe des marchés pour leurs marchandises."
Effectivement, un tel évènement serait tout simplement impensable à notre époque.
La phase de déclin du capitalisme
La guerre de 1914-1918 marque pour le capitalisme le début d'une nouvelle phase historique. C'est la période de l'inflation constante, de la saturation des marchés, de l'exacerbation des antagonismes impérialistes, du besoin de destructions massives par la guerre et l'économie d'armement. Les contradictions propres au système commencent à éclater violemment, provoquant des secousses de la taille de la crise de 1929 ou des guerres mondiales.
C'est la fin de l'âge d'or du capitalisme et LE DEBUT DE SA DECADENCE.C'EST AUSSI LE DEBUT DE L'ERE DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE.
Notre but ici n'est pas d'expliquer les raisons économiques profondes qui ont provoqué ce changement. Pour les besoins de l'analyse des syndicats, nous nous contenterons de relever deux effets de cette décadence :
- l'impossibilité pour la classe dominante de concéder des - réformes réelles au prolétariat;
- l'accroissement et le renforcement du rôle de l'Etat dans la société.
1 - L'impossibilité des réformes.
Aujourd'hui, le capitalisme a étendu sa domination au monde entier. Depuis 1914 les débouchés manquent, les marchés sont saturés. Les forces productives ont subi un violent freinage. Chaque crise qui secoue l'économie l'ébranle plus profondément. Le capital oe peut plus assurer sa survie qu'en suivant le cycle absurde : CRISE - GUERRE - RECONSTRUCTION. ..CRISE...
La bourgeoisie est obligée d'extraire une quantité toujours plus grande de surtravail à la classe ouvrière,
a) pour affronter une concurrence internationale qui s'est exacerbée jusqu'à ses dernières limites ;
b) pour faire face à des dépenses improductives qui se sont accrues en proportion de l'approfondissement des contradictions du système :
- maintien de l'appareil administratif et policier de l'État, devenu monstrueux ;
- dépenses gigantesques de la production militaire, (jusqu'à 50% du budget de l'État dans des pays comme l'URSS ou les USA) ;
- frais de subventions aux entreprises devenues déficitaires de façon chronique ;
- frais absurdes tels ceux entraînés par les surplus agricoles, etc.
- enfin toutes les dépenses d’une gestion devenue d'autant plus coûteuse qu'elle a affaire à une économie contradictoire et absurde : marketing, publicité, et plus généralement l'essentiel du secteur dit "tertiaire".
Tous ces nouveaux frais improductifs, caractéristiques du capitalisme en déclin, ne sont pas un luxe du système, mais la forme même de sa survie.
Dans ce contexte, la bourgeoisie ne peut plus se permettre, même sous la pression des luttes ouvrières, d'accorder satisfaction aux revendications du prolétariat. Malgré les promesses du capital, les signatures apposées au bas d'accords solennels, malgré les illusions humanitaires que pourrait entretenir telle ou telle fraction "réformiste" ou "progressiste" de la bourgeoisie, malgré la crainte de mouvements sociaux importants, la réalité du capitalisme décadent est implacable : le capital ne peut plus accorder de réformes véritables au prolétariat.
Il est devenu banal de constater que depuis cinquante ans, toutes les luttes pour des revendications salariales n'aboutissent à rien. Les augmentations de salaires se traduisent immédiatement par une hausse correspondante -sinon supérieure- du niveau des prix. L'élévation des salaires arrachée en France en juin 1936 (accords de Matignon : 12% en moyenne) était annulée en six mois : rien que de septembre 1936 à janvier 37, les prix montèrent en moyenne de 11%. On sait aussi, par exemple, ce qui resta un an plus tard des augmentations obtenues en juin 68 avec les accords de Grenelle.
Sur le plan des conditions de travail, le phénomène est le même. Alors que dans la période ascendante du capitalisme, le temps de travail diminuait effectivement sous la pression des luttes ouvrières, -de 1850 à 1900 la durée hebdomadaire de travail dans l'industrie est passée de 72 à 64,5 heures en France et de 63 à 55,3 heures aux USA-, dans le capitalisme décadent, celui-ci va connaître une stagnation, sinon un accroissement (sans parler du temps de transport qui augmente de jour en jour). Eo mai- juin 68, la classe ouvrière devait reprendre la revendication qui soi-disant avait été obtenue en 36 : les quarante heures de 36 étaient devenues 44,3 en 1949, 45,7 en 1962!
La période de reconstruction qui s'ouvre en 45 après les misères de la crise et de la guerre, a pu faire croire cependant qu'un aménagement des conditions de travail et de vie était encore possible : la relative prospérité que connaissait le capital était parvenue à résorber en partie le chômage, offrant une certaine sécurité de l'emploi. Partout, les défenseurs du réformisme faisaient miroiter la "spectaculaire augmentation du niveau de vie" dans les pays industriels. Quelle réalité recouvre donc cette "amélioration" qui a même amené certains à dire que le prolétariat avait disparu, dilué par une prétendue "société de consommation"?
- une exploitation accrue:
Ce qui détermine les conditions de vie des travailleurs, c'est en priorité le temps de travail (plus-value absolue) et son degré d'intensification (plus-value relative).
Dans le domaine du temps de travail, aucune concession significative n'a été accordée (et cela suffit amplement pour dénoncer les défenseurs du réformisme comme les plus abjects adulateurs du capital). Si l'on ajoute à la journée de travail -qui n'a pas été diminuée- les heures supplémentaires et celles que l'ouvrier passe eu transport, quel temps lui reste-t-il pour profiter des fameuses jouissances de la "société de consommation"?
"Dans le domaine strictement économique, la situation de la classe ouvrière ne fut jamais pire. Dans de nombreux pays, le refus de faire des heures supplémentaires est cause immédiate de renvoi et partout l'introduction du ’ soi-disant salaire de base, délibérément mesquin, des primes et bonifications à la productivité, etc., forcent le travailleur à accepter de "son plein gré" des journées de 10 à 12 heures...
Dans l'aspect le plus profond de l'exploitation, celui de la productivité par tête et par heure, le prolétariat se voit acculé à une situation terrifiante. La production qu'on lui soutire chaque jour s'accroît prodigieusement. D'abord les innovations techniques, qui retirent à l'ouvrier toute intervention créatrice dans son travail, mesurent tous ses mouvements à la seconde et le transforment en un "mécanisme de servitude" vivant, assujetti à la même cadence que les mécanismes métalliques. Ensuite, le chronométrage, traquenard atroce et répugnant, force les hommes à travailler chaque fois d'avantage avec le même outillage et dans la même unité de temps. En troisième lieu, la discipline de chaque établissement rogne sur la plus petite suspension de travail, même pour allumer une cigarette ou pour déféquer. La production qu'on arrache par ces moyens à chaque homme est énorme, comme dans la même proportion son épuisement physique et psychique." (MUNIS "Les syndicats contre la révolution")
Les cadences infernales, l'exploitation scientifique grâce aux chronométreurs et autres psychologues, voilà le tribut que paye le travailleur au capitalisme décadent.
Quelle formidable amélioration peut "compenser" cela?
- l'augmentation du pouvoir d'achat.
Cette augmentation tant vantée par les réformistes consiste en gros dans l'acquisition de la télévision, de la voiture, du "confort" (appareils électroménagers). Mais il ne s'agit que du minimum que doit accorder le capital pour faire passer une exploitation intensifiée. Le meilleur exemple en est la télévision, qui en plus d'être le plus triste moyen de faire oublier au travailleur son épuisement pendant les trois ou quatre heures qui lui restent après sa journée de travail, constitue un instrument idéologique dont la réputation n'est plus à faire. Si les ouvriers refusaient de posséder la télévision du fait de son prix, le capital les rendrait gratuites.
Ce "minimum social" est la contrepartie indispensable pour que le prolétariat accepte ses conditions de vie, autant que sont nécessaires les congés payés pour récupérer une année de labeur inhumain. Tout ce que l'on veut peindre comme un super luxe dépassant de loin le minimum vital, n'est en fait que le strict minimum de l'époque moderne.
Pour faire accepter au travailleur une exploitation poussée jusqu'aux limites de l’épuisement, le capital disposait donc de deux armes, pendant toute la période où il a reconstruit sur ses ruines le mythe de la société de consommation et la sécurité de l'emploi.
Avec la crise qui se fait à nouveau cruellement sentir, ces deux remparts s'effondrent. Le spectre du chômage va de nouveau hanter les rues, et la voiture deviendra rapidement un luxe inabordable. Implacablement, le capital sera contraint d'intensifier encore son exploitation, sans que le prolétariat ait la moindre illusion de compensation. L'illusion syndicale apparaît dans toute sot\ abjection,
2 - L'accroissement et l'intensification du rôle de l'État dans la société.
Les crises et les guerres mondiales ont montré les difficultés croissantes auxquelles doit faire face le système pour survivre :
Développement des conflits entre capitalistes d'une même nation, des conflits entre différentes fractions du capital mondial, des conflits entre classes antagonistes, et de façon générale, exacerbation du conflit global entre le développement des forces productives et le cadre social devenu trop étroit. Le développement et le renforcement de l'État sont ceux de ces conflits.
De par ses propres mécanismes, la société capitaliste tend à se désagréger de toutes parts. La force totalitaire de son État intervenant à tous les niveaux, contrôlant tout, devient dès Lors un facteur essentiel pour le maintien du vieil édifice capitaliste.
Si, dans la prospérité du XIXème, le règne du "libre échange" et du non interventionnisme économique était possible, aujourd'hui le capital a besoin d'un État renforcé, coordinateur et contrôleur direct de toutes les forces productives. Il n’est pas de décision importante en ce qui concerne la production qui ne passe par l'État : les échanges internationaux et nationaux, les finances, les orientations générales des investissements, etc.… l'État doit tout centraliser, tout planifier, tout contrôler : il devient en fait partie intégrante et essentielle de la production.
Moins que tout autre aspect de la production, le rapport salarié, le rapport capital-travail, ne peut être laissé à l'initiative privée. Il est le cœur de la production, la base essentielle sur laquelle repose tout l'édifice. C'est aussi de ce cœur que surgit la mise en question du système, que se développent les forces de son futur fossoyeur. C'est pourquoi, il est essentiel à la survie du système, que l'État multiplie les organisations chargées de planifier scientifiquement la vente et l'utilisation de la force de travail, les organes d'encadrement de la classe ouvrière, les mesures destinées à donner des illusions de conciliation (salaire minimum, conventions collectives, etc.…) et renforce son appareil de répression.
L'impossibilité pour la classe dominante d'accorder des concessions au prolétariat s'est accompagnée en toute logique, du développement de son appareil d'oppression et d'encadrement de la classe exploitée.
Les syndicats dans la période de déclin du capitalisme
Impossibilité de véritables aménagements de l'exploitation et nécessité du développement du totalitarisme étatique, ces deux caractéristiques du capitalisme décadent ont ôté aux syndicats leur fonction initiale et donné à leur existence un sens nouveau, anti-ouvrier.
Ce qui constituait le rôle des syndicats au XIXème siècle, assurer constamment la défense des travailleurs au sein du système, négocier en permanence avec le capital les améliorations pour la classe ouvrière, est devenu dans le capitalisme en déclin une tâche impossible.
Or, un organe dont la fonction originale disparaît est condamné soit à disparaître lui- même, soit à acquérir une fonction nouvelle.
Avec l'impossibilité de négociation véritable pour le prolétariat, disparaît la possibilité d'existence d'une organisation ouvrière de négociation permanente. La seule solution qui reste à la classe ouvrière, c'est l'affrontement violent. Aujourd'hui, une organisation qui ne se propose pas l'alternative révolutionnaire ne peut être authentiquement ouvrière.
Incapables de dépasser le cadre du capitalisme, les syndicats sont inévitablement séparés de la lutte prolétarienne. Forcés par la nature même de leur fonction au "réalisme", c'est-à-dire à la réalité du capitalisme décadent, -impossibilité d'aménagements significatifs- ils ne peuvent "négocier" que les miettes destinées à cacher l'intensification de l'exploitation. Ils deviennent ainsi la courroie de transmission indispensable à l'État pour assurer sa domination sur le monde ouvrier.
Les syndicats sont devenus l'État présent à l'usine. C'est ainsi qu'ils ont aidé la classe dominante à entraîner les travailleurs dans toutes les boucheries de la guerre impérialiste. Ils ont freiné -sinon réprimé- tous les mouvements prolétariens importants des dernières années; chaque jour ils dévoilent un peu plus leur nature d'instruments de l'État capitaliste.
Les syndicats ont-ils une double fonction ?
On a souvent dit —en particulier en Mai 1968, lorsqu'on voyait les syndicats "trahir" le mouvement — qu'ils avaient - une double fonction à l'époque actuelle : -en temps "calme", lorsqu'il n'y a pas de luttes importantes, les syndicats défendraient la classe ouvrière face au patronat; en temps d'effervescence sociale, ils défendraient le patronat contre la classe ouvrière. Les syndicats seraient "contre la révolution" mais non "contre la classe ouvrière". Ce raisonnement n'est qu'une façon biaisée de rejustifier les syndicats tout en ayant l'air de les rejeter. C'est un argument d'autant plus contre-révolutionnaire qu'il cherche à se draper de radicalisme révolutionnaire. C'était par exemple la position du groupe Pouvoir Ouvrier qui spécifiait dans sa plateforme politique : "A l'étape présente, dans la plupart des pays capitalistes, les syndicats exercent objectivement une double fonction :
- défendre contre le patronat les intérêts immédiats des salariés,
- défendre la société capitaliste, dont ils acceptent les bases, contre tout mouvement des travailleurs qui pourrait la mettre en difficulté". (P.0. N°90, Mai 1968).
Cette pensée ne dépasse pas la profondeur de celle selon laquelle le corps des CRS défend les intérêts du travailleur lorsqu'il le sauve de la noyade sur la plage et qu’il ne les défend plus lorsqu'il le matraque lors d'une grève, servant alors le patronat.
Premièrement, rien n'est plus absurde que de prétendre que dans une société divisée en classes antagonistes et dont les intérêts sont chaque jour plus opposés, une organisation qui est aussi imbriquée dans la lutte de classes que les syndicats, puisse passer du service d'une des classes à celui de l'autre, puis de nouveau servir la première, etc. selon les circonstances et de plus sans subir la moindre transformation ni dans ses structures, ni dans sa direction.
Deuxièmement, on ne détermine pas la nature de classe d'une organisation par son attitude aux moments de "calme social", lorsque le prolétariat passif reste soumis au pouvoir de la bourgeoisie autant sur le plan économique qu'idéologique. Si l'on veut déterminer la nature de classe d'une organisation, c'est au moment où les classes s'affrontent ouvertement qu'il faut le faire. Alors les masques commencent à tomber car les contradictions de classe apparaissent clairement.
Si l'on veut avoir une idée réelle du rôle social des CRS dans la lutte des classes, on ne fonde pas le jugement sur leur -fonction au bord des plages en été, ou sur les routes, mais bien sur celle qu'ils ont lorsque la lutte des classes éclate au grand jour.
La fonction des syndicats est CLAIRE lorsqu'on les voit, aux moments comme Mai-Juin 1968, empêcher les contacts entre ouvriers de différentes usines, falsifier les revendications des travailleurs, utiliser le mensonge et la calomnie pour faire reprendre le travail, en un mot, lorsqu'ils jouent le rôle de force de répression contre les luttes des travailleurs.
Cependant, on sait que les syndicats sont OFFICIELLEMENT les "organisations représentatives de la classe ouvrière", que c'est eux qui sont chargés de défendre les intérêts des travailleurs aux Comités d'Entreprises, ainsi que dans les organisations économiques gouvernementales. On sait aussi que, par temps calme, ils organisent d.es "journées d'action" et que lorsque la base bouge, ils organisent des grèves (même si elles ne sont que de vingt-quatre heures). De même, il est vrai que dans certains pays, ou dans certaines usines en France, il vaut mieux être syndiqué pour assurer son emploi ou obtenir certains avantages.
Mais faut-il en déduire alors que les syndicats sont au service de la classe ouvrière ?
Non. Cette "seconde fonction" des syndicats n'est en fait qu'un aspect de la première.
D'une part, si aux occasions comme Mai-Juin 1968, les syndicats peuvent agir comme ils l’ont fait sans provoquer immédiatement une révolte généralisée des ouvriers contre eux, c'est entre autre parce qu'ils ont, pendant "la période tranquille" entretenu soigneusement le mythe du syndicat, représentant unique et légitime des travailleurs; et ceci avec l'aide de tous les gouvernements. Les petites grèves, les revendications pour des vestiaires plus propres, ou pour des primes de bleu de travail, les "journées d'action" etc. sont le moyen pour donner "l'autorité" aux syndicats d'ordonner la reprise du travail le jour des véritables luttes.
De même que les CRS doivent sauver des noyés ou maintenir l'ordre sur les routes pour justifier leur existence et agir les jours de répression au nom de l'intérêt de "tous", de même les syndicats doivent remplir ces tâches de "petites revendications" pour pouvoir assurer les jours de lutte leur fonction d'encadrement et de répression "au nom de la classe ouvrière". En ce sens, déjà, ce ne sont donc pas là deux fonctions de nature différente, ce sont deux moments d'une même fonction.
D'autre part, ces tâches dont sont chargés les syndicats, correspondent à des besoins précis du capitalisme décadent. En effet, considérons le cas des pays où les syndicats sont partie intégrante de l'État, au même titre que le Ministère de l'Éducation ou les forces de police. C'est ce qui se produit dans les pays fascistes (Espagne par exemple) ou dans les pays de capitalisme d'État, prétendus "socialistes" (URSS, Chine, Pays de l'Est, etc.). St dans ces pays -où même la grève est interdite dans les faits- il existe des syndicats, c'est parce qu'ils correspondent à un besoin réel de l'État capitaliste. En effet, ils remplissent une fonction devenue vitale pour le capitalisme décadent : l'encadrement de la classe ouvrière.
Il faut à l'État un encadrement efficace de la classe ouvrière :
1) Pour pouvoir manier la principale force productive (la force de travail) selon les besoins du capital national (planification et participation);
2) Pour permettre le jeu des lois économiques capitalistes au niveau du marché de la force de travail et éviter même des abus de capitalistes privés ou de gérants locaux qui risqueraient de provoquer des baisses de productivité ou des épuisements néfastes pour l'économie nationale;
3) Enfin, pour encadrer et briser toute tentative de réelle lutte ouvrière.
- "Le X° Congrès des syndicats soviétiques (1949) a défini les buts du syndicat dans l'ordre suivant :
l- Organiser l'émulation socialiste pour assurer l'exécution et le dépassement des plans de production, l'accroissement de la productivité, LA REDUCTION DES PRIX DE REVIENT (!);
(...) 5- Veiller au respect de la législation du travail et de la sécurité (...)".
En Chine : "... le Comité Exécutif de la CGT réuni le 10 Juillet 1953 prescrit à "tous les échelons syndicaux de considérer le renforcement de la discipline du travail comme leur devoir primordial et permanent". Si les résultats de cette campagne sont insuffisants, il faudra "punir d'une manière appropriée les éléments récalcitrants qui commettent constamment des infractions graves contre la discipline du travail". ("Le syndicalisme dans le monde" Georges Lefranc. Que-Sais-Je ? pg 102-107).
Personne ne s'aviserait de dire que les syndicats fascistes espagnols sont des organes de la classe ouvrière ou que les syndicats russes défendent les travailleurs contre leur patron, l'État; les syndicats n'étant qu'un outil de celui-ci.
Lorsque les syndicats des pays occidentaux participent aux organismes économiques gouvernementaux (en France, le Conseil du Plan, le Conseil Économique et Social, etc.), lorsqu'ils font partie des comités d'entreprises, lorsqu'ils concluent des conventions collectives, lorsqu'ils participent à la gestion d'entreprises nationalisées, quand ils constituent cet "interlocuteur valable" dont a besoin l'État, lorsque ces syndicats dénoncent quelques abus trop criants commis par un patron ou un gérant, ou bien lorsqu’ils brisent systématiquement tout mouvement de grève : ils ne font que remplir les mêmes tâches que les syndicats russes ou fascistes. Ce ne sont pas là des fonctions au service de la classe ouvrière. Ce sont au contraire des fonctions correspondant aux besoins du capitalisme décadent. C'est pourquoi, aussi bien dans les régimes totalitaires que dans les régimes libéraux, les gouvernements subventionnent ou créent des syndicats pour "représenter la classe ouvrière".
Ce qui différencie les syndicats des régimes "démocratiques" de ceux des autres pays, c'est le fait que leur intégration est faite au travers de partis politiques.
La fonction que la bourgeoisie reconnait à ses "partis de gauche", c'est le contrôle de la classe ouvrière. Le syndicat est l'outil indispensable dont ceux-ci ont besoin pour assurer leur implantation en milieu ouvrier. Face au danger de la montée des luttes prolétariennes, la bourgeoisie peut avoir recours à ces partis, en les appelant au gouvernement : l'intégration des syndicats à l'État est alors directe. Mais lorsque le parti ou le courant politique qui domine le syndicat est en opposition au gouvernement en place, il peut donner aux luttes ouvrières dont il se sert, un caractère plus "dur".
Un syndicat peut même provoquer des mouvements importants pour des raisons strictement politiques lui convenant : ce fut par exemple le cas des grèves lancées par la CGT en 1947 après l'exclusion du Parti Communiste du gouvernement et des manifestations organisées par la CGT et le PC en 1953 lors de la venue du Général Ridgeway à Paris. Fréquentes dans les années de contre-révolution triomphante, ces mobilisations artificielles, où les syndicats promènent les travailleurs en cortèges dociles et obéissants se font de plus en plus rares. Dans l'actuelle reprise de la lutte de classe, les syndicats réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans n'importe quelle mobilisation, sachant qu'à chaque reprise ils seront de moins en moins capables de garder le contrôle de ce que la presse appelle "leurs troupes".
Par ailleurs, les courants dominants des syndicats sont généralement partisans des régimes du capitalisme d'État. Ils préconisent par conséquent les nationalisations.
Cela explique la crainte de certaines grandes entreprises privées à l'égard des syndicats. Mais dès que la lutte ouvrière secoue leur entreprise, ils se jettent dans les bras du syndicalisme. Voit par exemple Agnelli. Le rattachement à des partis préconisant le capitalisme d'État peut ainsi donner aux syndicats une apparence de combativité anti capitaliste mais en fait il suffit de connaître leur attitude lorsque LEUR parti est au pouvoir (PCF en France après la deuxième guerre, Labour Party en Angleterre actuellement), ou d'assister aux manipulations politiques auxquelles ils se livrent au sein des lieux de travail dans leur course aux adhérents, pour comprendre qu'il ne s'agit pas là de défendre des intérêts ouvriers mais ceux de leur organisation politique. Le délégué syndical -aussi dévoué soit-il- est vite entraîné à devenir consciemment ou inconsciemment, non plus le représentant des intérêts des travailleurs mais un instrument de sa centrale.
Au Congrès de 1946, la majorité communiste de la CGT fit voter un texte déclarant : "La CGT appelle les travailleurs à soutenir un effort de travail nécessaire pour atteindre une production maximum. Un salaire plus élevé doit être atteint comme fruit de ces efforts et de ce travail" ("Le Syndicalisme en France". G. Lefranc. Que-Sais-Je ? p.100).
Il n'y a donc pas "une double nature" des syndicats se traduisant par des fonctions ouvrières et des fonctions capitalistes alternativement. Il s'agit seulement de deux aspects d'une même et unique fonction capitaliste : encadrer la classe ouvrière au sein et au service du système.
La bureaucratisation des syndicats et les illusions sur leur "reconquête"
Lorsqu'on n'a pas compris la nature de classe des syndicats dans la décadence capitaliste, il est normal qu'on entretienne les plus absurdes illusions sur d'éventuelles "reconquêtes" et autres "débureaucratisations".
Au lieu de saisir la bureaucratie et les "mauvais" chefs syndicaux comme des produits inévitables de la nature capitaliste des syndicats, on voudrait les présenter comme des causes des "erreurs" et des "trahisons" syndicales.
La bureaucratisation d'une organisation n'est pas le renforcement du pouvoir de décision de ses organes centraux. Contrairement à ce que pensent les anarchistes, centralisation n'est pas synonyme de bureaucratisation. Au contraire. Dans une organisation traversée par l'activité consciente et passionnée de chacun de ses membres, la centralisation est le moyen le plus efficace pour stimuler la participation de chaque membre à la vie de l'organisation. Ce qui caractérise le phénomène de bureaucratisation, c'est le fait que la vie de l'organisation ne vient plus de l'ensemble de ses membres, mais qu'elle est artificiellement, formellement réduite à celle de ses "bureaux", de ses organes centraux.
Si un tel phénomène s'est généralisé à tous les syndicats dans la décadence capitaliste, ce n'est pas du fait de la "malveillance" des responsables syndicaux, ni d'un phénomène inexplicable de "bureaucratisation" sur lequel aucun homme n'aurait de prise.
Si la bureaucratie s'est emparée des syndicats, c'est parce que les travailleurs ne peuvent plus apporter ni vie, ni passion à un organe qui n'est plus le leur.
L'indifférence des ouvriers à l'égard de la vie syndicale n'est pas, comme le pensent les gauchistes, une preuve d'inconscience des travailleurs. Elle manifeste au contraire un sentiment plus ou moins clair dans le prolétariat de la nature capitaliste des syndicats.
Les rapports entre les travailleurs et leur syndicat ne sont pas des rapports d'une classe avec son instrument. Ils prennent la plupart du temps la forme des rapports entre des individus, avec des problèmes individuels, et une assistante sociale ("qui est bien avec le patron"). La propagande syndicale se résume d'ailleurs la plupart du temps à l'argument : nous, nous avons obtenu tel ou tel avantage du patron. Faites-nous confiance, etc.
Il y a bureaucratie parce qu'il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de vie ouvrière dans le syndicat. Celui-ci est un appareil extérieur à la classe qui ne rentre en contact réel avec elle comme classe, que pour l'encadrer et freiner ses luttes.
C'est parce que les syndicats ne sont plus des organisations ouvrières qu'ils ne peuvent avoir que des rapports bureaucratiques avec leurs membres ouvriers. Empêcher cette bureaucratisation est aussi impossible que d'empêcher la décadence du capitalisme.
Il en va de même pour les illusions sur les changements de chefs syndicaux. Le problème des syndicats n'est pas une affaire de bons ou de mauvais chefs. Ce n'est pas un hasard si, depuis plus de cinquante ans, les syndicats ont toujours eu de "mauvais dirigeants".
Ce n'est pas parce que les chefs sont mauvais que les syndicats ne se prêtent pas aux véritables luttes de la classe ouvrière. C'est au contraire parce que les syndicats comme organisations ne peuvent plus servir à la lutte prolétarienne que leurs chefs sont inévitablement "mauvais".
- Comme le faisait remarquer Pannekoek :
"Ce que Marx et Lénine ont dit et redit de l'État, à savoir que son mode de fonctionnement malgré l'existence d'une démocratie formelle, ne permet pas de l'utiliser comme instrument de la révolution prolétarienne, s’applique donc, aux syndicats. Leur puissance contre-révolutionnaire ne sera pas anéantie, pas même entamée, par un changement de dirigeants, le remplacement des chefs réactionnaires par Ses hommes de "gauche" ou des "révolutionnaires". C'est bel et bien la forme d'organisation elle-même qui réduit les masses à l'impuissance ou tout comme et qui leur interdit d'en faire les instruments de leur volonté".
L'idée chère aux "trotskistes" et "léninistes" de partir à la "reconquête" des syndicats est une utopie d'autant plus réactionnaire qu'elle est le prétexte pour la défense des syndicats.
Le syndicalisme révolutionnaire
En réaction à la dégénérescence des syndicats et des partis socialistes dès la fin du siècle dernier, a surgi l'idée de syndicats se donnant des buts révolutionnaires.
Mais un syndicat est une organisation 1) de masse, 2) permanente, 3) dont la tâche spécifique n'est pas la destruction de la société d'exploitation, mais l'aménagement de la place des travailleurs en son sein.
En se donnant un but qui n'est pas celui du syndicat tout en s'enfermant dans la logique syndicale, le syndicalisme révolutionnaire ne peut être qu'une source de confusion et de contradictions.
Comment donner un but révolutionnaire à une organisation de masse en dehors des périodes révolutionnaires ?
Pour construire une telle organisation, il faut des masses révolutionnaires. Or celles-ci n'existent -par définition- qu'en période d'insurrection. Dans une époque non révolutionnaire, le "syndicalisme révolutionnaire" ne peut donc qu'aboutir à deux réalités :
Ou bien le syndicat fait adhérer les travailleurs sans conviction révolutionnaire en considérant que la seule volonté des chefs suffit à faire de l'organisation un corps révolutionnaire, et alors il ne fait que se tromper et tromper ses adhérents.
Ou bien, il n'accepte en son sein que des travailleurs possédant de fermes convictions révolutionnaires et il se transforme alors en petit groupe politique n'ayant plus de syndicat que le nom.
Il ne reste donc à concevoir qu'un "syndicat révolutionnaire" ne pouvant qu'exister en période révolutionnaire. Mais, premièrement un syndicat qui n'existe pas de façon permanente n'est plus un syndicat, et deuxièmement, toutes les luttes révolutionnaires l'ont montré; la forme d'organisation que se donne la classe pour sa lutte révolutionnaire, celle qui s'adapte le mieux à ses besoins, ce n'est pas le syndicat, mais les conseils ouvriers.
À l'époque où le syndicalisme correspondait encore à une nécessité et à une possibilité pour le mouvement ouvrier, le syndicalisme révolutionnaire ne parvint jamais à remplir vraiment aucune des fonctions qu'il se donnait.
- "Le syndicalisme révolutionnaire présuppose chez l'ouvrier une mentalité révolutionnaire qui ne peut être que le résultat final d'une longue pratique. Les syndicats demeurent de petits groupes d'ouvriers aux sentiments révolutionnaires dont l'ardeur ne saurait remédier à la faiblesse de l'organisation. (...)
Voulant assurer une autre fonction que la sienne, le syndicat se trouve dans l'incapacité de remplir sa fonction propre, l'amélioration des conditions de travail. Ce qui lui incombe, organiser les masses, il ne le fait pas, et ce qu’il entreprend, l'éducation révolutionnaire, il le fait de travers." (Pannekoek, dans "Pannekoek et les Conseils Ouvriers", EDI, p.83).
À l'époque de la décadence du capitalisme, la logique syndicale dont il ne pouvait se débarrasser l'entraine tôt ou tard à perdre tout caractère prolétarien.
Ainsi, le syndicalisme révolutionnaire français , relativement fort avant la première Guerre Mondiale resta-t-il rapidement au niveau de simples vœux pieux : les centrales syndicales révolutionnaires (la CGT à l'époque) dégénérèrent comme les autres et comme elles participèrent à la guerre impérialiste à côté de leur bourgeoisie, les tendances qui s'opposèrent à la guerre étant demeurées quelques minorités insignifiantes vites oubliées.
Quant à la CNT espagnole, elle fut amenée à jouer pendant la guerre d'Espagne le rôle d’un parti politique de masse. Et, tout en se défendant de "faire de la politique'', elle dut cependant comme telle conclure le "Front Populaire" avec les staliniens et la bourgeoisie républicaine puis participer au gouvernement même de la république. Tenter de faire revivre la forme d'organisation syndicale alors qu'elle ne correspond plus aux besoins de la lutte mène à lui conférer obligatoirement des tâches anti-ouvrières[2].
L'apport principal du syndicalisme révolutionnaire au mouvement ouvrier, c'est d’avoir prouvé, avec toute sa "bonne volonté", le caractère néfaste de toute forme de syndicalisme, aussi radical se veuille-t-il, dans le capitalisme décadent.
Au cours de plus d’un demi-siècle de décadence capitaliste, le prolétariat a du cruellement constater :
1) L'impossibilité définitive d'obtenir des améliorations réelles des conditions de son exploitation.
2) L'impossibilité de se servir pour ses luttes de la forme d'organisation syndicale (organisations de masse, existant en permanence, c'est-à-dire survivant en dehors des périodes de lutte et se donnant pour but l'aménagement de l'exploitation.).
3) L'inévitable intégration de toute organisation de type syndical aux rouages de l'État capitaliste.
Les luttes ouvrières n'ont pas cessé pour autant. Au travers de grèves sauvages, d'insurrections sporadiques, son combat s'est poursuivi. Quel est donc le contenu de ces luttes ? Quelles en sont les formes d'organisation ?
Le contenu des luttes ouvrières dans le capitalisme décadent
Devant le constat du rôle ouvertement anti-ouvrier des syndicats, les grèves sauvages, anti-syndicales se sont multipliées dans tous les pays. Elles expriment dans la pratique l'antagonisme prolétariat-syndicats et traduisent une conscience de plus en plus claire de la nature capitaliste de ces organes. Mais quel est leur contenu ?
Le fait que le capitalisme ne soit plus en mesure d'accorder des aménagements véritables de l'exploitation du travail, a réduit les luttes prolétariennes à un combat de résistance contre l'attaque permanente du capital sur les conditions d'existence des travailleurs.
Nous avons montré, avec les exemples de 1936 et 1968 en France, comment le capital est contraint de reprendre immédiatement n'importe quelle amélioration que les luttes généralisées aient pu lut arracher. Mais 1936 et 1968, où l'on voit des augmentations de salaires être rattrapées postérieurement par des hausses de prix sont des exceptions correspondant à des luttes d'une particulièrement grande ampleur. La situation normale, celle qui caractérise le capitalisme actuel, ce n’est pas les hausses de prix courant derrière les hausses de salaires, mais l'inverse. Ce n'est pas le capital qui essaie de récupérer en permanence ce que les travailleurs lui arrachent, mais les travailleurs qui, par leurs luttes, tentent de résister à l'intensification de leur exploitation.
Mais ce qui caractérise le contenu des luttes ouvrières dans le capitalisme décadent, ce n'est pas le fait qu'elles soient des luttes de résistance en soi (ceci est commun à toutes les luttes prolétariennes depuis que les ouvriers affrontent leurs exploiteurs), mais :
- le fait qu'elles ne puissent plus être que des luttes de résistance (sans espoir de nouvelles conquêtes comme au XIX° Siècle).
- le fait qu'elles tendent à mettre immédiatement en question les conditions mêmes d'existence du système d'exploitation à devenir ouvertement révolutionnaires.
La résistance ouvrière dans le capitalisme décadent ne peut plus échapper à l'alternative suivante :
- soit accepter l'enfermement dans le terrain purement économique et elle doit alors se conformer aux impératifs de l'économie capitaliste en permanente difficulté : c'est le "réalisme" bien connu des syndicats qui transforment les luttes en tristes farces où les défilés carnavalesques, avec chansonnettes et chapeaux de papier, sur la tête, cachent mal qu'on a, en fait, accepté d'abandonner tout combat.
- soit elle s'affirme, conséquente, décidée, REELLE, et dès lors, elle mène inévitablement à l'affrontement avec la légalité bourgeoise et en premier lieu avec ses représentants au sein de l'usine : les syndicats.
Il n’y a plus de terrain de conciliation possible entre le capital et la force de travail. L'antagonisme originel est, dans la décadence capitaliste, constamment poussé à ses dernières limites. C'est pourquoi toute lutte ouvrière véritable se pose inévitablement et de façon immédiate en lutte politique et REVOLUTIONNAIRE.
Deux remarques à ce propos : Premièrement, le contenu révolutionnaire de ces combats n'est pas donné par le fait que las ouvriers se réclament de la "révolution communiste mondiale", ni par la conscience immédiate qu'ils peuvent avoir de la nature réelle de leur action. Ce contenu est un fait objectif imposé par les conditions historiques de la lutte générale. Comme disait Rosa . Luxembourg :
- "L'inconscient précède le conscient et la logique objective du processus historique précède la logique subjective de ses protagonistes".
Deuxièmement, ce contenu révolutionnaire éclate avec plus ou moins d'ampleur, suivant que :
- la lutte répond à une situation de crise plus ou moins approfondie,
- les conditions politiques auxquelles les travailleurs s'affrontent contiennent plus ou moins "d'amortisseurs sociaux" (syndicats, partis "ouvriers", libéralisme politique, etc.).Dans les pays où ces "amortisseurs" font défaut ou sont trop rigides pour remplir ce rôle (pays de l'Est, États fascistes par exemple) les luttes ouvrières tout en étant moins fréquentes, prennent beaucoup plus rapidement une tournure ouvertement révolutionnaire.
Mais quelles que soient les circonstances précises, qu’elle soit l'intensité des combats, la résistance ouvrière à notre époque ne peut plus s'affirmer sans acquérir immédiatement une substance révolutionnaire.
C'est cette nouvelle caractéristique de la lutte ouvrière qui a amené les révolutionnaires dès la première Guerre Mondiale, à proclamer désuète la vieille distinction social-démocrate entre "programme minimum" défini par un ensemble de réformes à obtenir au sein du capitalisme et le "programme maximum" (la révolution communiste). Désormais, seul le "programme maximum" pouvait exprimer les intérêts de la classe ouvrière.
Lorsque le réformisme est devenu une pure utopie contre-révolutionnaire, seul ce qui est révolutionnaire est ouvrier SEUL CE QUI CONDUIT VERS LA REVOLUTION PEUT ETRE AUTHENTIQUEMENT PROLETARIEN. Tout le reste n'est qu'idéalisme réactionnaire et supercherie capitaliste.
Il est devenu à la mode, surtout au cours des derniers mouvements étudiants des années 1967-69 d'interpréter cette position apparue dans le mouvement ouvrier dès les premières années de ce siècle en affirmant que les luttes "revendicatives", "salariales", étaient devenues une négation de la lutte véritablement révolutionnaire (la revue "Invariance" s'est fait un des plus ardents défenseurs de cette pensée). Ce faisant, loin de "radicaliser" la théorie révolutionnaire, on ne fait que la vider de son support matériel réel, c'est-à-dire, on la relègue au monde des utopies idéalistes?]
Les formes d’organisation
Avec la perte des syndicats, il se pose à la classe ouvrière le problème de se doter d'une NOUVELLE forme d'organisation. Mais ce n'est pas chose simple dans le capitalisme décadent.
La grande force des syndicats vient de leur capacité à se faire reconnaître comme le seul cadre possible pour la lutte. Ainsi, patronat et gouvernement n'acceptent pas d'autre "interlocuteur" que les syndicats. Tous les jours, inlassablement, par voie de tracts, presse, radio et télévision, etc. le capital répète systématiquement au prolétaire : "votre organisation, ce sont les centrales syndicales". Tout est mis en œuvre pour renforcer cette capacité mystificatrice des appareils syndicaux.
L'opération n'a pas toujours le succès escompté : dans un pays où le matraquage sur la représentativité des syndicats est aussi violent qu'en France, il n'y a pas plus d'un ouvrier sur cinq qui ressente le besoin de se syndiquer. Il faut par contre de plus en plus souvent la collaboration des organisations "gauchistes" pour maintenir auprès des travailleurs les plus combatifs la crédibilité de ces appareils du capital. À cet égard le récent changement d'attitude des grandes centrales françaises vis-à-vis des gauchistes, n'est rien d'autre que la reconnaissance des bons et loyaux services que ces derniers leur rendent quotidiennement comme "rabatteurs de moutons égarés", avec leur "appui critique".
Soumis sans relâche à pareille opération mystificatrice, les travailleurs des pays à forte "liberté syndicale" ont le plus grand mal à envisager la possibilité d'organiser leurs luttes en dehors des appareils traditionnels. Il faut une situation particulièrement insupportable pour qu'ils trouvent la force de s'opposer, ouvertement, à l'immense machine de l'État avec ses partis et ses syndicats. Car c'est bien cela qui caractérise et rend si difficile .la lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent : en s'opposant aux syndicats, la classe ouvrière ne se heurte pas seulement à une poignée de bureaucrates syndicaux; c'est l’État capitaliste lui-même qu'elle affronte. Mais le fait même de cette difficulté rend plus significatif tout surgissement de la classe en dehors des syndicats. Il donne toute son importance à la question des formes d'organisation extra-syndicalistes.
Le problème des FORMES d'organisation de la lutte ouvrière n'est pas un problème indépendant ou séparé de celui du contenu de cette lutte. Il y a une interrelation étroite entre le contenu révolutionnaire que tendent à prendre immédiatement les luttes prolétariennes dans la décadence capitaliste, et les formes d'organisation que la classe se donne.
Au cours de ses plus grandes luttes révolutionnaires de ce siècle, le prolétariat abandonnant les syndicats s’est donné une nouvelle forme d'organisation adaptée à sa tâche historique : les Soviets ou Conseils Ouvriers. Il s'agit d'assemblées de délégués, mandatés par les assemblées générales de travailleurs dans les usines et dans les quartiers ouvriers. Ces organes permettent une véritable unification de la classe en créant le lieu où elle forge, au feu.de la lutte, les forces matérielles et théoriques de son attaque contre l'État, Mais par leur forme même, ils ont une particularité majeure. Du fait qu'ils sont des assemblées de délégués élus par des assemblées générales quasi permanentes, leur existence est entièrement dépendante de l'existence d'assemblées générales dans les usines et les quartiers ouvriers. Si la classe n'est pas en lutte dans l'ensemble des usines, s'il n'y a pas d'assemblées générales des travailleurs dans tous les lieux où ils combattent, les Conseils ne peuvent pas exister. Les Conseils sont un organe de lutte et ils ne peuvent vivre que pour et pendant cette lutte. Ils ne peuvent devenir des organes permanents que lorsque l'action révolutionnaire de la classe devient permanente, c'est-à- dire lorsque le prolétariat entre dans la phase insurrectionnelle de la lutte. Le combat insurrectionnel généralisé est toujours l'aboutissement d’une série de luttes plus ou moins parcellaires qui l’annoncent et le préparent. Son contenu révolutionnaire n'est pas distinct de celui des luttes antérieures. Il n'est que l’épanouissement logique du contenu de toutes les grèves qui l'ont précédé.
Ce lien qui existe dans le capitalisme décadent entre le contenu des grèves parcellaires et la lutte insurrectionnelle généralisée, se retrouve au niveau des formes d’organisation. L'expérience des grèves anti-syndicales de ce siècle montre que la forme d'organisation que se donne la classe dans ces luttes est une forme embryonnaire des Conseils ouvriers. En effet dans les grèves sauvages, les travailleurs opposent au comité de grève syndical, un comité de grève -ou comité d'usine- formé de délégués élus par l'assemblée générale des grévistes et responsable uniquement devant elle. L'assemblée générale des grévistes est ainsi le véritable cœur et cerveau de la lutte.
À première vue, la différence entre un comité de grève syndical et un comité de grève sauvage peut sembler formellement bien faible. Les grèves syndicales se donnent souvent des délégués élus par les assemblées générales. Et par ailleurs, un comité de grève élu, même en se déclarant anti-syndicaliste, peut se transformer en un simple organe syndical du moment qu’il accepte d'enfermer la lutte dans un cadre purement localiste et économique. Un comité de grève qui n'agit pas en vue de la généralisation de la lutte, qui entretient des illusions plus ou moins fortes sur la nature des syndicats, qui ne pose pas la question de l'affrontement avec l'État (et en premier lieu, avec les organes de l'État dans l'entreprise: les syndicats), un tel comité de grève ne serait pas sorti du cadre syndical.
De là à conclure que la forme d'organisation n’a aucune importance et que tout est une question de contenu, il n'y a qu'un pas; pas qui est allègrement franchi par les défenseurs "critiques" du syndicalisme.
Une forme d'organisation ne peut en aucun cas être, par elle-même, une garantie du contenu de la lutte. Conseils ouvriers ou assemblées générales et comités d'usine ne sont pas des CONDITIONS SUFFISANTES pour l'épanouissement de la lutte prolétarienne. Mais elles n'en sont pas moins des CONDITIONS NECESSAIRES. Un - comité de grève peut mener une grève à l'impasse économique et localiste, tout comme n'importe quel syndicat. Mais alors qu'un syndicat ne peut jamais mener une lutte vers la révolution, il n'est pas de marche vers la révolution qui ne passe par les assemblées générales, les comités d'usine et les Conseils.
C'est pourquoi il est impossible de parler du contenu de la lutte ouvrière sans parler de ses formes d'organisation. Seul celui qui ne comprend pas que les syndicats sont un organe de l'État peut négliger l'importance de ces formes d'organisation et de la capacité de la classe à se les donner. Il ne peut pas comprendre, en effet, que la capacité à s'organiser en dehors de l'appareil syndical est le début de la capacité à s’opposer à l'État.
En ce qui concerne la lutte elle-même, grève ou insurrection, les formes organisationnelles de la classe apparaissent donc bien définies. Mais un problème subsiste.
Dans le capitalisme ascendant, les syndicats constituaient de façon permanente, avec les partis de masse, des lieux de rencontre des travailleurs. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des "écoles du communisme". Avec leur disparition comme organisations de la classe, il se crée un problème pour les travailleurs : comment s'organiser EN DEHORS DES LUTTES OUVERTES ?
Sur ce problème bien des révolutionnaires se sont cassé les dents. En effet, lorsque la lutte cesse, après une grève sauvage par exemple, les comités de grève disparaissent avec les assemblées générales. Les travailleurs tendent à redevenir une masse d'individus atomisés et vaincus, acceptant de plus ou moins bon gré la représentativité des syndicats. Ce retour à la passivité peut prendre plus ou moins de temps, mais s'il n'y a pas de nouvelle lutte ouverte, il est toujours inéluctable. Pour éviter un tel retour, il est fréquent qu'au lendemain d'une lutte, les travailleurs les plus combatifs tentent de rester organisés, de créer une organisation PERMANENTE qui permette de regrouper la classe en dehors de ses combats. L'échec a toujours été systématique pour ce genre de tentative. Cet échec prend généralement une des trois formes suivantes :
- Soit l'organisation d'usine créée se dissout après un certain temps sous l'effet de la démoralisation due à l'incapacité à regrouper l'ensemble des travailleurs; ce fut le cas - des AAU en Allemagne après les luttes de 1919-23 par exemple, ou de tous les comités d'action qui tentèrent de subsister dans les usines en France après Mai 1968.
- Soit elles se transforment en de nouveaux syndicats (ce fut le cas du comité de grève que les trotskystes essayèrent de faire subsister après la grève de Renault en 1947, ainsi que celui de la plupart des "comisiones obreras" en Espagne).
- Soit elles tentent de se transformer en une sorte de groupe politique mal défini.
Ce dernier type d'expérience est apparu depuis 68, aussi bien en France, qu' en Italie ou en Espagne. Son contenu est le suivant : à partir de cercles ouvriers subsistant dans les entreprises, généralement à la suite de luttes dures, on tente de bâtir une organisation qui refuse aussi bien d'être un syndicat qu'un parti politique. On nie le syndicalisme en refusant de se restreindre à la lutte purement économique. On nie l'organisation politique, le parti, en refusant de se donner une plateforme politique définie. Cette dernière issue, à l'égal des deux premières (dissolution par inefficacité et transformation en syndicat)a abouti tout aussi systématiquement à des échecs cuisants.
Pourquoi tous ces échecs?
Parce qu'on essaie de stabiliser, de figer un organe qui, par définition, est instable, provisoire.
Que ce soient les unions (AAU) en Allemagne entre 1919 et 23, ou les Comités d'Action en France en 1968-69, les CUB (Comités Unitaires de Base) et les "Assemblées Autonomes" en Italie, ou les Commissions Ouvrières en Espagne, il s'agit toujours à l'origine de cercles d'ouvriers formés par les travailleurs les plus combatifs.
Tous ces cercles expriment la tendance générale de la classe vers l'organisation. Mais, contrairement à ce que pensent les gauchistes étudiants qui se sont attachés à vouloir inventer de nouvelles formes d'organisation de la classe (des "Cahiers de Mai" en France aux "Assemblées Autonomes" en Italie actuellement) il n'y a pas quinze formes d'organisation possibles pour le prolétariat. Une forme d'organisation doit inévitablement être adaptée 'au but qu'elle poursuit. À chaque but il correspond une forme d'organisation la plus adaptée, la plus efficace. Or, la classe ne poursuit pas quinze buts. Elle en a un : lutter contre l'exploitation qu'elle subit; en combattre aussi bien les effets que la cause.
Le prolétariat ne dispose pour ce combat que de deux armes :
- sa conscience ;
- son unité.
Aussi, lorsqu'en dehors des luttes ouvertes, des travailleurs se regroupent afin de contribuer au combat général de leur classe, ils ne peuvent se donner que deux types de tâches principales :
- contribuer à l'approfondissement et à la généralisation de la conscience révolutionnaire de la classe ;
- contribuer à son unification.
Les formes d'organisation de la classe sont donc inévitablement marquées par la nécessité de remplir ces deux tâches. Mais c'est ici que surgissent les problèmes : ces deux tâches sont deux aspects d'une même tâche générale, deux contributions à un même combat. Mais elles n'en ont pas moins des caractéristiques contradictoires.
Pour pouvoir UNIFIER la classe, il faut une organisation à laquelle n'importe quel prolétaire puisse adhérer indépendamment de ses idées politiques, par le simple fait qu'il est ouvrier.
Pour ELEVER LE NIVEAU DE CONSCIENCE de l'ensemble des travailleurs, tl faut que ceux qui sont les plus avancés ne restent pas les bras croisés à attendre que ça se développe tout seul. C'est leur devoir de diffuser leurs convictions, de faire de la propagande, d'intervenir avec leurs positions politiques parmi le reste de leur classe. Tant que la classe ouvrière existera comme classe exploitée (et lorsqu'elle ne sera plus exploitée, elle ne sera plus une classe) il subsistera en son sein des différences immenses quant à la conscience et à la volonté révolutionnaire de ses membres. Au cours des luttes tous les prolétaires tendent, de par la situation même qu'ils occupent au sein de la production, vers la conscience révolutionnaire. Mais tous n'évoluent pas au même rythme. Il existe toujours des individus et des fractions de la classe plus décidés, plus conscients de la nécessité et des moyens de l'action révolutionnaire, et d'autres plus craintifs, plus hésitants, plus sensibles à l'idéologie de la classe dominante. C'est au cours du long processus des luttes de la classe que la conscience révolutionnaire se généralise. L'intervention des éléments les plus avancés est alors un facteur actif de ce processus. Mais ce travail exige un accord politique important entre ceux qui le font. Et, par ailleurs, il ne peut être fait que de façon organisée. Aussi, l'organisation qui se donne cette tâche ne peut être formée que par des individus d'accord sur une PLATEFORME POLITIQUE. Si une telle organisation acceptait en son sein toutes les convictions politiques existant dans la classe, c'est à dire, si elle refusait de se donner cette plateforme politique, elle deviendrait incapable d'accomplir sa tâche. Sans critères politiques strictes d'adhésion, elle est condamnée à devenir une source de confusion. .
S'unifier, d'une part, élever son niveau de conscience, d'autre part, ce sont là deux tâches dont la classe doit s'acquitter de façon organisée. Mais elle ne peut le faire avec un seul type organisation. C’est pourquoi elle s'est toujours donné deux formes fondamentales d'organisation :
- les organisations UNITAIRES, ayant pour tâche de regrouper tous les travailleurs sans égard à leurs idées politiques (c'étaient les syndicats dans le capitalisme ascendant, ce sont les conseils et les assemblées générales dans le capitalisme décadent);
- les organisations POLITIQUES, fondées sur une plateforme politique et sans critère social d'adhésion. (partis et groupes politiques).
Ces deux types d'organisation doivent être distincts, mais ne sont pas pour autant incompatibles. Ils sont au contraire complémentaires car ils correspondent à deux besoins d'une • même lutte, d'une même classe. C'est dans les organisations unitaires de la classe que l'organisation politique s'épanouit et remplit le plus efficacement la fonction pour laquelle la classe l'engendre.
Toute organisation de travailleurs qui se donne pour tâche de contribuer au combat prolétarien, TEND inévitablement vers l'une ou l'autre de ces deux formes d'organisation.
C'est à partir de la compréhension de cette double tendance organisationnelle de la classe que l'on peut saisir la nature de ces cercles ouvriers qu'on voit surgir dans le capitalisme décadent autour des luttes importantes de la classe (ils surgissent généralement peu avant les luttes et disparaissent peu après leur fin). Eo fait, ce ne sont ni des véritables organisations unitaires de la classe, ni des organisations politiques. Ils sont des DEBUTS D'ORGANISATION DE LA CLASSE, des TENTATIVES INACHEVEES D'ORGANISATION des travailleurs.
En tant que tels ils sont des organes totalement INSTABLES pouvant CONTRIBUER aussi bien à la constitution d'organisations unitaires de la classe (ce fut le cas en Russie en 1905), qu'à la formation du parti politique du prolétariat (c'est en leur sein que commencent à se regrouper les éléments les plus combatifs de la classe). Mais ils ne sont ni des conseils, ni des partis politiques. Ce sont des formes TRANSITOIRES, qui ne peuvent vivre qu'en EVOLUANT. Elles ont un creuset et une croisée de chemins pour l'organisation de la classe lorsque le mouvement de luttes est ascendant. C'est pourquoi la condition-même pour qu'ils soient un apport à la lutte prolétarienne est qu'ils soient fécondés par le développement des luttes. En dehors d'un tel développement, tenter de les maintenir en vie artificiellement conduit inévitablement à les transformer, en bloquant leur évolution, en des monstruosités aberrantes telles des syndicats comme ce fut le cas pour la plupart des "comisiones obreras" en Espagne) ou des groupes politiques inavoués, confusionnistes et donc réactionnaires (tels "les cahiers de mai" en France après 1968).
La reprise des luttes prolétariennes que provoque la crise actuelle du capitalisme mondial, fera renaître dans la classe des milliers de cercles de ce genre. À chaque reflux de la lutte, ils seront soumis aux mêmes dangers d'avortement et de dégénérescence. Mais en attendant les conseils et le parti révolutionnaire, ils constitueront un des lieux de renaissance du mouvement révolutionnaire prolétarien.
L'intervention des révolutionnaires
Les syndicats sont appelés à jouer dans les années à venir un rôle primordial sur la scène politique de la lutte des classes. Ils sont le principal rempart derrière lequel le capital peut se protéger contre l'assaut prolétarien. Pour le prolétariat, ils sont le premier ennemi à abattre, la première barrière à faire éclater. C'est pourquoi, leur dénonciation est une des premières tâches de l'intervention des révolutionnaires. Les communistes doivent expliquer uoe et mille fois aux travailleurs que ceux qui aujourd'hui sont en tête de leurs cortèges syndicaux et prennent tant de soin à les encadrer d'un service d'ordre à brassard rouge, sont les mêmes qui demain prendront les armes contre eux. Ils ont à dénoncer tout aussi inlassablement ceux qui, sous prétexte de "double nature des syndicats", "fronts uniques ouvriers" et autres "appuis critiques" s'escriment à présenter ces organes du capital comme des organisation ouvrières : les gauchistes, les autogestionnaires et autres rabatteurs de gibier du capitalisme décadent.
Les révolutionnaires renvoient dos à dos les syndicalistes qui s'attachent à enfermer les luttes dans un contenu purement économique, et les "anti-syndicalistes" qui ressentent "un dédain transcendantal" pour le caractère économique des luttes ouvrières parce que "intégré au capitalisme".
Les communistes ne défendent pas des revendications particulières. Ils font leurs toutes les revendications de la classe du moment qu'elles expriment la RESISTANCE du prolétariat à l'aggravation de son exploitation, car ils savent et proclament que dans cette lutte la classe forge les armes de son combat final contre l’État capitaliste. Leur tâche est de montrer que dans le capitalisme décadent il ne peut plus y avoir de lutte contre les effets de l’exploitation qui ne soit lutte contre les causes de l'exploitation ; qu'il n’y a d’autre victoire réelle dans les luttes revendicatives que celle d'acquérir les moyens de la lutte pour la destruction définitive du système lui-même.
La dénonciation des syndicats va inévitablement de pair avec la défense des formes d'organisation propres à la lutte prolétarienne dans le capitalisme décadent : conseils, comités d’usine, assemblées générales.
Les révolutionnaires insistent autant sur la nécessité de ces formes que sur la mystification qui consiste à les présenter comme des conditions suffisantes, des recettes miracle, afin d'escamoter le problème du contenu de la lutte.
Les révolutionnaires sont présents dans les cercles ouvriers pour y défendre leurs positions, tout en luttant contre toute tentative de les vider de leur vie en les figeant dans des formes bâtardes.
Face au problème syndical la tâche des communistes est d’exprimer à haute voix et de façon résolue- ce que les travailleurs ressentent plus ou moins confusément depuis cinquante ans, à savoir, que les syndicats devront être détruits, tout comme l'État capitaliste dont ils ne sont qu'un rouage.
R. Victor.
[1] Cette incompréhension de la période ascendante du capitalisme - qui va inévitablement de pair avec l'incompréhension de l'essence de la période actuelle - constitue par ailleurs la source principale d'aberrations au sujet du problème syndical : ainsi la "condamnation" de tout syndicalisme ou lutte pour des réforme6,(ceux du XIX siècle y compris), indépendamment de la période historique - attitude très en vogue depuis 68 en milieu étudiant contestataire n'est que le symétrique de la défense de ceux-ci dans la période actuelle.
[2] La CNT d’ESPAGNE, seul exemple d’organisation syndicale à avoir tenté plusieurs fois la réalisation de son programme maximum, la "révolution sociale" (en 33 et 34), ne le fit qu'après que les anarchistes de la FAI aient mené à l'intérieur de cette organisation une lutte sévère. Pendant toute la dictature de Primo de Ribera, la CNT, qui se caractérisait pourtant par son "apolitisme révolutionnaire" était en contact avec toute sorte de conspirateurs : Macia, l'Alliance Républicaine et les militants d'opposition dans le pays.
En juillet 1927 fut fondée la FAI. Ses membres, repoussant toute sorte de compromission d'ordre tactique, se proposaient la conquête de la CNT, afin de réaliser la révolution sociale. Elle fut le point de ralliement de tous ceux qui désapprouvaient l'orientation réformiste de l'anarcho-syndicalisme.
Lors du congrès national de 1930 les deux tendances s'affrontèrent. Les leaders de la CNT; qui mettaient surtout l'accent sur le syndicalisme de la CNT, et proposaient de s'allier avec d'autres groupes et fractions pour faciliter l'implantation de la république : et les "purs" de la FAI insistant sur l'anarchisme de la confédération, refusant toute compromission. Ceux-ci l'emportèrent, les vieux leaders furent-délogés ' de leurs postes, puis quittèrent avec leur fraction (les "trentistes'' organisèrent leur propre syndicat) la confédération. La CNT ne participa donc pas de justesse à cette ébauche de front populaire en 1930.
Sous l’impulsion de la FAI, elle aussi "apolitique", la CNT alla de grève générale en tentative d'insurrection jusqu’en 36. Fortement affaiblie par la répression, découragée par .-ses échecs successifs, la confédération avait ' suffisamment payé de sa personne l’impossibilité du syndicalisme révolutionnaire. Le congrès de 1935 vit revenir les "trentistes", qui entre temps avaient contracté toute sorte d'alliances avec la bourgeoisie. La tentative d'insurrection des droites le 18 juillet 36 et le soulèvement du prolétariat le 19 sonna le glas de l'organisation ; les forces "«ouvrières" montèrent au pouvoir CNT et FAI en tête. En Catalogne, la place forte, la CNT fit partie du Comité des Milices Antifascistes en marge du "Gubierno de la Generalidad" puis entre dans ce dernier, donnant ainsi l’appui ouvrier tant recherché. L’apolitisme Syndicaliste avait triomphé, les "purs" de la F.A.I. eux-mêmes n'allaient pas tarder à accepter d’être ministres de la république tant combattue.
Les "anti-autoritaires", partisans d’une "révolution sociale apolitique", agissant au nom de sacro-saints principes moraux, n’ont jamais compris la destruction de "l’appareil de l'État comme un moment de la lutte politique du prolétariat contre son ennemi de classe la bourgeoisie.
Défendant des positions révolutionnaires (anti-frontisme, antiparlementarisme au nom de la pureté d’une idéologie, les transgresser sous la pression des évènements ne revêtait pas grande importance à leur yeux, l'idéologie étant toujours "pure? Ainsi la CNT et la FAI s'allièrent aux partis bourgeois, participèrent au gouvernement de la république bourgeoise, laissèrent massacrer le prolétariat lors des journées de Barcelone en 37 "pour ne pas briser l’unité". En d’autres termes, ils révélèrent ce qui peut sembler une évidence, à savoir que l’apolitisme le refus des frontières de classe institutionnalisée en principe, est une arme pour la bourgeoisie.
Dès 1936, la politique d'unité anti-fasciste de la CNT lui fait tenir le rôle de tous les autres syndicats réformistes : l'encadrement de la classe ouvrière au service du capital. Malgré 1'honnéteté de ses militants, l'organisation "apolitique" a rejoint les rangs de la bourgeoisie.
D'avoir tant lutté et sacrifié tant de militants révolutionnaires pour en arriver à siéger dans des ministères de la république, voilà le triste destin du "sociétalisme révolutionnaire apolitique".
S'alliant avec ceux qui ne cessèrent jamais de tirer sur les ouvriers révolutionnaires (dont la plupart étaient ses propres militants) la CNT enterrait l'anarcho-syndicalisme dans les poubelles de l'histoire aux côtés des partis parlementaires, des syndicats réformistes, des trotskystes et des staliniens.
Questions théoriques:
- Syndicalisme [58]
Révolution Internationale - 1975
- 926 lectures
Revolution Internationale N°13 - janvier/fevrier
- 899 lectures
DEUX AVORTONS DE LA GAUCHE DU CAPITAL
- 31 lectures
Pour les organisations politiques, la frontière de classe qui sépare le camp bourgeois du camp prolétarien constitue une sorte de "soupape" qui ne permet le passage que dans un seul sens : du terrain prolétarien à celui de la bourgeoisie, jamais dans le sens inverse.
La gauche du capital vient d’engendrer deux nouveaux avortons à prétention "révolutionnaire" : "Union ouvrière" et "Combat communiste", tous deux issus de l'organisation trotskyste "Lutte Ouvrière". A la lecture des premiers numéros de leurs publications, nous pouvons confirmer qu'une fois de plus la vieille loi de la soupape s'est révélée juste.
UNE ORGANISATION PROLETARIENNE NE PEUT PAS SURGIR DU SEIN D'UNE ORGANISATION BOURGEOISE.
L'histoire du mouvement ouvrier connaît des centaines de trahisons. Les exemples d'organisations politiques prolétariennes qui n'ont pu résister à la très puissante attraction du camp de la classe dominante sont malheureusement difficiles à compter. Parfois ces cas ont été de taille : la IIème Internationale avec la presque totalité de ses partis sociaux-démocrates, puis la IIIème Internationale avec le parti bolchevik en tête et tous les partis communistes à sa suite, ont pu, au jour de triomphe de la contre-révolution, abandonner en renégats le camp prolétarien. Et si les internationales n'ont pu survivre à leur trahison que formellement (car la bourgeoisie, de par son être même, ne peut être internationaliste), les partis nationaux sont par contre devenus de véritables bastions de la contre-révolution au sein des travailleurs.
La victoire de la bourgeoisie sur le prolétariat n'est pas seulement physique et économique : elle est aussi idéologique. Et dans le combat permanent des classes chaque trahison d'une fraction révolutionnaire s'est inscrite comme un puissant coup porté par la bourgeoisie contre son irréductible ennemi ouvrier. Pour le prolétariat, de tels coups sont aussi néfastes, et souvent plus, que les massacres et les écrasements physiques des luttes ouvrières. Le combat galvanise, la trahison démoralise. Or la conscience, la foi et la volonté révolutionnaires sont -avec sa capacité d'organisation-, les seules armes réelles dont dispose la classe ouvrière pour sa lutte révolutionnaire.
Mais si l'armée du prolétariat a cédé à la bourgeoisie des organisations précieuses, l'inverse n'a jamais été possible. On trouve dans les rangs du combat historique du prolétariat des militants qui sont passés auparavant par des organisations bourgeoises, ex : Plekhanov était au départ du parti populiste. Mais ce sont toujours des individus, jamais des organisations. L'histoire ne connaît aucun cas d'organisations bourgeoises qui soient devenues ultérieurement prolétariennes ; aucun exemple significatif d'organisation prolétarienne qui ait surgi de la scission d'une organisation bourgeoise.
Pourquoi en a-t-il toujours été ainsi ? Pourquoi n'a-t-on jamais vu une organisation prolétarienne surgir du sein d'une organisation bourgeoise, alors, que l'inverse a été si fréquent ?
Deux raisons majeures expliquent ce fait : 1° La différence de nature entre le programma prolétarien et les théories bourgeoises. 2° Les mécanismes mêmes qui caractérisent une scission organisée.
1° Théorie révolutionnaire et mystification bourgeoise
Le Programme communiste est cohérent ou il n'est rien. Pour l'abandonner, pour le trahir, il suffit de le rendre incohérent, d'abandonner une seule de ses positions fondamentales. Il est de ce point de vue opposé aux théories politiques bourgeoises.
La bourgeoisie ne fonde pas son pouvoir sur sa conscience, sur sa capacité à comprendre et à analyser le monde qui l'entoure. Tout comme l'esclavagisme et le féodalisme, le capitalisme est un résultat "aveugle" du développement des forces productives. "Dans la production sociale de leur existence, dit Marx, les hommes établissent entre eux des rapports de production indépendants de leur volonté." Le socialisme sera aussi un résultat du développement des forces productives. Mais, alors que la conscience était un élément absolument secondaire pour 1'instauration et le maintien des sociétés d'exploitation, elle constitue une condition nécessaire, INDISPENSABLE pour la destruction du capitalisme et l'instauration du communisme.
Pour consommer les bénéfices de l'exploitation, pour les transformer en nouveaux moyens d'exploitation ou même pour remplacer le despote féodal par le despotisme des lois capitalistes, la bourgeoisie n'a pas besoin d'une conscience politique très approfondie. Elle en est d'ailleurs incapable. Son pouvoir dépend de la force brute de son Etat et de sa capacité à faire accepter le système par les exploités.
Par sa tâche mystificatrice, la bourgeoisie peut se servir de n'importe quelle aberration de la pensée, aussi éloignée soit—elle de la réalité (la religion par exemple). Du moment qu'elle lui permet de justifier son Oppression et d'inculquer la soumission et l'abnégation aux exploités. La pensée politique des classes exploiteuses n'est pas et ne peut être un instrument cohérent capable de rendre compte de la réalité concrète, parce qu'elle doit être d'abord un "OPIUM DU PEUPLE". Qu'importe la cohérence du moment qu'on a l'ivresse.
Le bourgeois n'a d'ailleurs même pas conscience de ce fait. Il est la première "victime" de son mensonge. La particularité c'est que pour lui, elle est une justification de ses privilèges, alors que pour les autres elle bat une consolation à leur souffrance.
Il en est tout autrement pour la théorie de la classe révolutionnaire exploitée : le prolétariat.
D'une part, du fait que le but de sa révolution n'est pas le remplacement d'une classe exploiteuse par une autre, mais la fin de l'exploitation. Le prolétariat est la première classe révolutionnaire de l'histoire qui n'a plus besoin d'idéologies mystificatrices. La pensée révolutionnaire prolétarienne est la première dans l'histoire qui a la possibilité d'être une pensée non-mystifiée capable d'envisager la réalité sans fard, de façon cohérente, scientifique.
Mais d'autre part, le prolétariat est aussi la première classe révolutionnaire pour qui la conscience objective est une NECESSITE, un impératif concret et matériel. Les autres classes, telle la bourgeoisie, ont pu développer leurs nouveaux rapports de production au sein même de l'ancienne société : bourgeois et seigneurs féodaux ont coexisté pendant des siècles en se partageant les masses à exploiter dans le cadre du pouvoir politique féodal. Lorsque la révolution politique est intervenue pour concentrer le pouvoir uniquement aux mains de la bourgeoisie (Révolution bourgeoise), il y avait déjà longtemps que les rapports de production bourgeois avaient commencé à dominer la société. Les "penseurs" bourgeois qui ont surgi pour créer la justification idéologique de ce changement politique pouvaient raconter des âneries aussi scientifiques que les théories du "despote éclairé" de Voltaire, sans que cela empêche la révolution d'avoir lieu : de toute façon l'essentiel, la transformation réelle des rapports de production, avait déjà été fait.
Rien de cela n'est possible pour la classe ouvrière. Lorsqu'elle prend le pouvoir politique, TOUT reste à faire sur le terrain de la production et, par ailleurs, ce qu'elle doit faire est radicalement opposé à tout ce qui a existé auparavant: le communisme ne sera pas un nouveau système de lois économiques, c'est-à-dire les hommes soumis aveuglément à des lois économiques stables, à des relations de production qui s'imposent à eux "indépendamment de leur volonté". C'est la fin de l'esclavage économique. La nouvelle société ne pourra être qu'une OEUVRE CONSCIENTE du prolétariat.
La théorie de la classe révolutionnaire ne peut donc plus se contenter de quelques approximations incohérentes tout justes bonnes à se justifier vis-à-vis des autres classes.
La conscience objective des buts réels et des moyens appropriés de la révolution est une FORCE MATERIELLE indispensable, dont l'existence conditionne matériellement la réussite de la transformation de la société.
Autant les théories fumeuses et incohérentes sont nécessaires pour les révolutions bourgeoises, autant une théorie juste, scientifique et cohérente, c'est-à-dire capable de rendre compte de la réalité et de constituer un moyen réel de la transformer est indispensable pour la révolution prolétarienne. Il ne s'agit pas d'un goût éthique pour la "vérité en soi", mais d'une nécessité matérielle concrète.
La nature des positions politiques du prolétariat, son programme historique, a donc comme caractéristique spécifique par rapport aux positions politiques bourgeoises d'être un CORPS COHERENT, UNIQUE, défini par la réalité même qu'il appréhende : la société capitaliste et l'expérience pratique de la lutte pour sa destruction.
On comprend dès lors aisément combien il est simple d'abandonner le programme prolétarien pour tomber dans l'incohérence et les fumisteries bourgeoises et combien, par contre, il est complexe de quitter le marais idéologique bourgeois pour s'élever à la cohérence théorique du prolétariat.
Le programme communiste n'est pas une somme de positions juxtaposées. Il contient une synthèse d'"acquis" donnés par l'expérience historique de la classe ouvrière, mais aucun de ces acquis n'a un sens en lui-même, par lui-même, isolé du reste des acquis. Une position politique particulière du programme communiste n'est, en fait qu'une manifestation, parmi d'autres, sur un problème concret précis, d'une vision générale, d'une cohérence globale.
C'est Pourquoi, on ne peut pas parvenir aux positions prolétariennes à partir de quelques idées à apparence révolutionnaire récupérées au sein d'une organisation bourgeoise, aussi radicale qu'elle se prétende
Il y a de moins en moins de partis bourgeois ayant le courage de se réclamer de leur classe. Pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches spécifiques d'endormeurs des exploités, ils sont de plus en plus contraints d'emprunter un langage "ouvrier", si possible "révolutionnaire". Et ce phénomène ira en se développant au fur et à mesure qu'iront s'étendant les luttes de la classe. Pour cela, ils intégreront dans leurs programmes, du moins en paroles, des positions en apparence prolétariennes.
On "radicalise" son langage. Cependant, pour une organisation politique, deux ou plusieurs positions prolétariennes juxtaposées ne sont pas le Programme communiste, ni même un pas vers lui, du moment qu'elles sont accompagnées de positions bourgeoises. Une seule position bourgeoise suffit à Ôter tout caractère prolétarien à un parti prétendu ouvrier. La social-démocratie allemande a perdu toute nature ouvrière, malgré ses traditions, malgré sa formation, du fait d'avoir pris une seule position bourgeoise : la participation à la guerre impérialiste.
Celui qui, ayant adhéré à une organisation bourgeoise -croyant s'intégrer à la lutte prolétarienne, mystifié par le langage "ouvrier" de celle-ci- voudrait un jour rompre avec elle pour retrouver les positions de classe, ne peut en aucun cas se contenter de rejeter "les quelques positions fausses de cette organisation" et "les remplacer par de bonnes". C'est toute la vision d'ensemble qui doit être "remplacée".
C'est une illusion de croire qu'on peut "conserver" quelque chose des positions politiques d'une organisation bourgeoise. C’est s'imaginer que le Programme du prolétariat est un agrégat composé d'éléments divers qui peuvent être ajoutés ou soustraits au gré de sa conscience individuelle.
Le Programme prolétarien est le produit de la conception cohérente du monde, d'une classe dont les intérêts historiques sont clairement et objectivement définis dans la réalité sociale. Il n'accepte en son sein aucune position bourgeoise, parce que dans la réalité il n'y a rien de conciliable entre la classe révolutionnaire exploitée et la classe exploiteuse réactionnaire.
La rupture avec une organisation politique du capital doit Être -pour être réelle- une rupture avec TOUT ce qu'elle défend, car RIEN N'Y EST A CONSERVER. Autrement la rupture n'est pas un dégagement du bourbier réactionnaire mais un ré- enfoncement à un endroit différent.
UN INDIVIDU peut parfaitement parvenir à établir une telle rupture. Cela dépend de sa conscience et l'évolution de sa conscience politique n'est conditionnée -du point de vue organisationnel- que par sa capacité INDIVIDUELLE à se débarrasser de tout le fatras idéologique qu'il a ingurgité pendant son travail dans une organisation du capital.
Mais IL EN EST TOUT AUTREMENT POUR UN GROUPE POLITIQUE. Les "mécanismes" d'une scission imposent à un groupe d'individus (aussi restreint soit-il) des entraves insurmontables qui rendent pratiquement impossible le passage ORGANISE d'une organisation politique bourgeoise à une organisation prolétarienne.
2° Les mécanismes d'une scission
Une scission n'est pas la rupture d'une somme d'individus épars. Elle implique des individus plus ou moins fortement organisés au sein de l'organisation qu'ils s'apprêtent à quitter. C'est à dire, des individus qui possèdent, à côté des désaccords qui les conduisent à rompre (ou à être exclus), un certain nombre de positions communes avec l'organisation d'origine. Ces positions qui les lient à l'ancienne organisation peuvent être plus ou moins nombreuses, plus ou moins importantes. Mais elles existent toujours du moment qu'on parle de scission. Dans la "nouvelle" organisation subsistent en conséquence, immanquablement, toutes les positions considérées "non erronées" de l'ancienne. Une scission est toujours une "filiation", aussi "radicale" qu'ait pu être la rupture. Et la marque de cette filiation n'est autre que la continuité d'un certain nombre de positions. .
Lorsqu'une organisation révolutionnaire rompt avec une organisation ouvrière qui vient de trahir en adoptant des positions bourgeoises, elle se réclame de la continuité de l'ancien corps. Elle dénonce la trahison, l'abandon des principes et s'affirme comme la continuité de la survivance des principes de départ.
C'est ainsi que la III internationale, par exemple, s'est fondée en dénonçant la trahison de la II, et le passage définitif de celle-ci date le camp de la bourgeoisie. Ce faisant, elle pouvait et devait se réclamer des principes prolétariens qui avaient présidé à l'existence de l'internationale Socialiste. L'Internationale Communiste pouvait être le fruit de différentes scissions de la II, et rester une organisation révolutionnaire, parce que la II était une véritable organisation ouvrière. Elle était le parti mondial du prolétariat pendant des décennies et comme telle elle avait à transmettre tout l'acquis théorique et organisationnel des luttes prolétariennes de son temps.
Cet acquis que les parlementaires social-démocrates venaient de fouler au pied en votant les crédite de guerre, dans les principaux pays belligérants, la gauche de l'internationale (et principalement les bolcheviks et les spartakistes) pouvaient et devaient le reprendre à leur compte et assurer la continuité vivante en rompant violemment pour former une nouvelle Internationale.
Mais de quelle continuité peut se réclamer une organisation qui rompt avec une organisation bourgeoise pour parvenir au Programme Communiste, c'est-à-dire au camp prolétarien ? Comme nous l'avons vu, du fait même de la nature cohérente du programme prolétarien, aucune position de la bourgeoisie ne peut être conservée, encore moins servir de base pour le ralliement au camp révolutionnaire.
La seule position qui peut être commune à des éléments qui rompent avec une organisation bourgeoise pour passer au prolétariat, c'est : nous avons tous été des aveugles. Mais on le comprend aisément, une telle position est une base peu flatteuse personnellement et politiquement plus qu'insuffisante, pour permettre la formation d'une organisation qui cherche en premier lieu à rejoindre la clairvoyance de la classe révolutionnaire. Sur la base de la seule dénonciation d'une organisation dans laquelle on a milité et qui faisait partie du camp du capital il est impossible de s'organiser. Sur cette base, il ne peut exister qu'une somme d'individus qui après avoir reconnu l'erreur bourgeoise qu'ils avaient commise, doivent reprendre individuellement le chemin du camp prolétarien. Individuellement, car la seule chose qui les lie entre eux est une participation effective au travail du capital.
Or, c'est précisément ce lien qu’il est indispensable de dissoudre en premier lieu. Chaque fois que cette dissolution n'a pas lieu, il y a inévitablement conservation des fondements politiques de l'organisation "mère". Il y a filiation avec les forces du capital.
Cette filiation peut prendre parfois la forme de la révolte infantile, du "contre-pied systématique". On croit alors rompre les liens avec l'organisation d'origine en s'efforçant de défendre "le contraire" de tout ce que pouvait défendre l'ancienne. Mais le critère d'orientation politique n'est pas pour autant l'expérience historique des luttes de la classe ouvrière. Lorsqu'on s'attache essentiellement à prendre le contre-pied d'une idéologie bourgeoise on ne peut aboutir qu'à un symétrique tout aussi bourgeois que la première. On demeure prisonnier de la même idéologie car on se détermine toujours par rapport aux idées politiques du capital et non en fonction de la lutte historique du prolétariat.
Ce genre de réaction est particulièrement fréquent en milieu "contestataire" étudiant. L'anarchisme, le "situationnisme" et autres apparentés du "cardanisme", se sont définis surtout en réaction au stalinisme et à son petit-fils, le trotskysme. Tout ce qui de loin ou de près ressemblait à un de ces derniers était réactionnaire et parallèlement était bon, "révolutionnaire", tout ce qui pouvait paraître être une critique de ces idéologies.
Le résultat était, entre autres, le rejet de la révolution russe, la plus grande expérience de la classe ouvrière, le rejet du marxisme et, sous une forme plus ou moins nette, le rejet de toute l'expérience historique de la classe considérée comme "vieille chose". Quant aux positions sur les problèmes fondamentaux de la lutte de classe, il est frappant de constater combien elles finissaient souvent par retrouver le "concret" de celles des groupes trotskystes et staliniens tant abhorrés.
Les organisations politiques de la bourgeoisie, aussi "radicales" et "révolutionnaires" se prétendent-elles, jouent -consciemment ou non, cela est secondaire- une fonction précise au service du capital. L'exercice de cette fonction crée des liens puissants qui les rattachent au capital au point d'y empêcher toute scission révolutionnaire, tout enfantement organisé au profit du prolétariat.
La lutte du prolétariat n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plus d'un siècle de combats ouvriers au cours desquels se sont définis les fondements concrets de cette lutte historique. Rejoindre le camp révolutionnaire aujourd'hui, ce n'est pas se définir par rapport à telle ou telle organisation de la gauche du capital, mais s'approprier des résultats de cette expérience. Or, cela ne peut être fait sans avoir auparavant rompu tout lien avec la politique du capital.
C'est ce que n'ont pu faire ni "Union Ouvrière", ni "Combat Communiste" en scissionnant de façon organisée de "Lutte Ouvrière".
DEUX AVORTONS DE LA GAUCHE DU CAPITAL
Fruits de la crise politique du capitalisme.
La crise économique du capital entraine des secousses croissantes dans sa sphère politique. Et,..."lorsque le bateau coule, les rats quittent le navire". Le navire de la bourgeoisie fait de l'eau par toutes ses organisations politiques. . "Lutte Ouvrière", une des organisations gauchistes les plus connues (grâce notamment à la candidature d'A. Laguiller au poste de chef de toutes les polices, de toutes les armées et tribunaux du capital français) n'échappe pas à ce phénomène.
La "rupture" d'"Union Ouvrière" et 1'"exclusion" de "Combat Communiste" sont une manifestation, minuscule certes, mais authentique, de cette crise politique qui secoue le capital dans le monde entier.
Pour le cas du "gauchisme" -mouvement à base estudiantine depuis 1968- il faut ajouter qu’il subit aussi actuellement les conséquences de la fin du mouvement étudiant, lycéen, enterré par le début des luttes ouvrières ouvertes. Ce que nous avions écrit en 1969 (RI N°3, Ancienne Série) se vérifie avec une implacable irréversibilité : "Il n'y aura plus mouvement étudiant, parce qu'il y aura mouvement ouvrier".
Une filiation revendiquée.
Pourquoi "Union Ouvrière" et "Combat Communiste" ont-ils rompu avec "Lutte-Ouvrière" ? Pourquoi ont-ils cru nécessaire de créer deux nouvelles organisations politiques ?
Ils n'invoquent aucune raison sérieuse dans les premiers numéros de leur presse... et ils n'en invoqueront jamais aucune. Car, du point de vue du prolétariat, la seule raison valable pour rompre avec le trotskysme et le gauchisme, c'est le fait qu'ils constituent des courants politiques du capital. Or, non seulement l'idée’ n'est même pas insinuée, mais au contraire on se revendique de cette filiation.
- "Combat Communiste" n'a pas estimé nécessaire de dédier plus de cinq petits paragraphes à la question.(Le papier est surtout rempli par des commentaires, style "nouvel Observateur" sur l'avortement, l'automobile, le logement et quelques notes sur des entreprises pour nous dire qu'elles n'ont pas été conçues "pour accomplir un travail efficace dans de bonnes conditions (?), mais pour permettre à quelques centaines de parasites de faire marner 2000 travailleurs". (Qui l'eût cru !)).
Ce qui est dit dans les cinq paragraphes sur la rupture se résume à deux idées : Io "Notre tendance rejette le dogme selon lequel l'URSS serait aujourd'hui un Etat "ouvrier", même "dégénéré" comme l'affirme "L.O." et 2° "Renouer avec le véritable programme communiste est essentiel pour le mouvement ouvrier. Il ne nous a pas été possible de continuer à exprimer ces idées au sein de Lutte Ouvrière. C'est donc devant l’ensemble des travailleurs que nous les défendrons désormais, avec une vigueur renforcée, en tant que fraction (?) indépendante (??) du mouvement ouvrier révolutionnaire (???)".
"Union Ouvrière" est plus prolixe sur la question, mais c'est la même plaisanterie : "Une année de débat au sein de ce groupe (L.O.), et l'impossibilité pratique (?) qu'il y a à le transformer, nous ont à la fois appris la profondeur du mal (sic) dont il est atteint (et, par-delà lui, la quasi-totalité de l'actuel Mouvement "gauchiste") et la nécessité qu'il y a d'engager, en direction des exploités et des révolutionnaires, une entreprise radicale de rétablissement des principes révolutionnaires et d’intervention communiste directe au sein du Mouvement dans son ensemble".
Quant à la divergence principale elle semble bien se situer aussi sur la question des "Etats ouvriers dégénérés".
- "Sur toute la planète, et à Moscou comme à Washington, à Pékin, à Paris, à Alger ou à Barcelone (...) les travailleurs sont réduits à* 1'ESCLAVAGE dans tous les aspects de leur existence". Nous parlerons plus loin de ce que ces courants disent des pays dits "socialistes".
Quant aux rapports avec leur organisation mère, on nous dit donc qu'ils ont dû rompre ou être exclus parce que "Combat Communiste" ne pouvait pas "exprimer au sein de L.O." ses idées sur les "Etats ouvriers dégénérés", parce qu'il y avait pour "Union Ouvrière" "impossibilité pratique à le transformer", parce que L.O. et "la quasi-totalité" du gauchisme sont atteints d'un "mal" mystérieux...?
Qu'est-ce qu'ils appellent le mouvement révolutionnaire ? Quel est ce mal ? Pourquoi ces impossibilités d’expression sur les pays dits "socialistes" dans L.O.? En quoi "Union Ouvrière" voulait transformer L.O.?
Les deux avortons restent muets sur ces questions ou se perdent, tel "Union Ouvrière", dans des dissertations larmoyantes sur "la sectarisation extrême de la quasi-totalité des composantes du mouvement" ("sa première maladie") et sur la nécessité d'une "recomposition unitaire du mouvement prolétarien".
"Union Ouvrière" et "Combat Communiste" ne parviennent pas à donner d'explication à leur rupture avec le trotskysme tout simplement parce qu'en fait ils n'ont pas rompu avec lui.
Si on ne trouve nulle part dans leurs publications une dénonciation du trotskysme et du gauchisme en tant qu'éléments de la bourgeoisie, c'est parce qu'en fait aucune des deux "scissions" n'est sortie de ce camp.
En ne dénonçant pas la nature bourgeoise du gauchisme et du trotskysme, les deux avortons revendiquent en fait leur filiation bourgeoise. Et il ne pouvait en être autrement. .
La seule chose qui lie de telles organisations au moment de leur formation c'est leur origine commune. Dénoncer cette origine comme bourgeoise aurait été la première condition (nécessaire même si elle n'est pas suffisante) pour pouvoir tenter de "renouer avec le véritable programme communiste" (comme le veut "Combat Communiste"), ou pour "s'engager dans une entreprise radicale de rétablissement des principes révolutionnaires" (comme l'affirme "Union Ouvrière").
Mais si cette condition avait été remplie, il n'y aurait pas eu d'"Union Ouvrière" ni de "Combat Communiste"; les "scissionnistes" et les "exclus" auraient dû renoncer au délicieux caprice de faire leur propre petit torchon gauchiste. Et ça...
"Union Ouvrière", plagiant une formulation de Marx à propos de la dialectique de Hegel, écrit qu'il faut "dégager le noyau rationnel du gauchisme contemporain de sa gangue mystique". (Grands dieux!!). Que d'honneur pour ce détritus de l'idéologie bourgeoise en décomposition qu'est le "gauchisme". Le noyau du gauchisme n'est pas plus "rationnel" que la décomposition de la petite bourgeoisie dans le capitalisme décadent. Sa "gangue" n'est pas plus mystique que les fusils de la contre-révolution dont il est la dernière expression.
Ceux pour qui la pourriture du gauchisme n'est pas suffisamment avancée pour trouver la force de rompre avec lui, peuvent y rester; mais qu'ils n'aient aucune illusion sur le sort que leur réserve la révolution prolétarienne.
UNE FAUSSE RUPTURE
Révolte petite-bourgeoise oblige. "Union Ouvrière" teinte son langage d'une résonance "situationnisante" : "l'agitation spectaculaire des groupuscules", "la subversion radicale de toute la société de classes", "la révolution radicale qui est l'affaire des générations qui viennent", "les curés en tous genres", "réactiver les IDEES de la subversion radicale". "La subversion communiste du vieux monde", etc...
Les trotskystes honteux veulent probablement exorciser avec des mots les fantômes qui hantent la vie des militants de Lutte Ouvrière : le militantisme érigé en apostolat religieux, l'ouvriérisme, le vocabulaire populiste "pour ne pas effrayer les prolos", etc.
Peine perdue. Les avortons sont "trotskystes" dans l'âme. Trotskystes, entre guillemets, parce qu'en fait le trotskysme n'existe pas, il existe le stalinisme et il existe les divers "appuis critiques" au stalinisme. Ces critiques peuvent se réclamer de Trotsky, de Mao ou de Guevara. Mais objectivement ils ont tous la même caractéristique : la défense "critique" de la perspective stalinienne. Parasites des P.C., ils en sont les meilleurs appuis, ceux des heures critiques, des moments difficiles. Ils ne dénoncent le bureaucratisme des staliniens que pour mieux défendre leurs positions politiques contre-révolutionnaires au sein de la classe avec verbiage soi-disant plus radical .
"Union Ouvrière" et "Combat Communiste" rejettent aujourd'hui (cinquante ans après la Gauche Communiste) l'idée qu'il n'y a pas d'exploitation dans les pays soi-disant communistes. (Mais qui croit encore aujourd'hui à ce mensonge stalinien ?). Peut-être pourrait-on dire : mieux vaut tard que jamais. Même pas.
Pour le prolétariat, la dénonciation des pays dits "communistes" (ou "en voie" de le devenir) en tant que pays de capitalisme d'Etat, n'est qu'un aspect de la dénonciation de la TENDANCE GENERALE DU CAPITALISME DECADENT VERS SA FORME ETATISEE[1]. Tous les Etats du monde subissent cette tendance, TOUS LES ASPECTS DE LA VIE DU CAPITALISME sont marqués par cette évolution. Et principalement les rapports entre capital et force de travail, entre bourgeoisie et prolétariat.
Dans ce domaine, 50 ans d'encadrement et de "trahisons" syndicales, 50 ans de planification et d'exploitation avec la collaboration des appareils syndicaux, 50 ans d'intensification de l'exploitation et de désillusions sur toute possibilité d'obtenir de véritables réformes du capitalisme en faveur de la condition ouvrière, 50 ans enfin de massacré des insurrections ouvrières avec la participation active des syndicats , ont tracé avec du sang une frontière de classe entre le prolétariat et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre se font les défenseurs (aussi "critiques" soient-ils) de ces institutions du capital. Dans le capitalisme décadent, la tendance mondiale au capitalisme d'Etat s’est manifestée en premier lieu par la transformation des syndicats en organes de l’Etat capitaliste. Dénoncer le capitalisme d'Etat, c'est d'abord dénoncer ces institutions comme organes de l'Etat
Or, non seulement "U.O " et "C.C." ne voient aucun lien entre le capitalisme d'Etat et les "trahisons" des syndicats, mais en outre ils ne font une critique de ces appareils que pour dénoncer les dirigeants, Séguy et Maire, "chiens de garde du capital dans les rangs de la classe ouvrière" ("Union Ouvrière"), "agents de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier" ("Combat Communiste"), et, pour expliquer qu'afin de ne pas "se couper des exploités" il faut "développer dans les syndicats même (...) un travail d’opposition COMMUNISTE" ("Union Ouvrière").
Certes, "Union Ouvrière" dit bien qu'il faut "systématiquement mettre en évidence aux yeux des exploités la FONCTION SOCIALE d'encadrement du prolétariat des actuelles machines syndicales et pas seulement les "atermoiements des chefs"", mais il ne s'agit que d'une phrase démentie tout au long du reste du journal par la "critique des dirigeants" et l'appel à travailler au sein de cette police de l'Etat. Bref, à répéter en termes à peine plus "radicaux" ce que clament les "trotskystes" et autres "critiques" du stalinisme depuis des décades.
Les "atermoiements" et la confusion qui caractérisent les deux nouveaux journaux sur la question syndicale sont tels qu’ils pourraient peut-être laisser à certains des doutes sur leur incapacité à se dégager du trotskysme. Nous serions trop exigeants, trop intransigeants, trop sectaires... Leur position sur un autre problème que 60 ans de décadence capitaliste ont tranché en creusant une autre frontière de classe, les questions des "libérations nationales", Ôtent toute hésitation sur leur attachement au camp du capital.
Alors que depuis la première Guerre Mondiale, toutes les "luttes de libération nationale" n’ont servi qu’à fournir de la chair à canon ouvrière et paysanne sur l’autel des conflits entre grandes puissances impérialistes, alors que des centaines de mouvements nationalistes, ont démontré dans le sang une et mille fois que la voie nationaliste, dans les pays industrialisés comme dans les autres, est celle du renforcement du capitalisme d’Etat et de la marche aux boucheries capitalistes, alors que les travailleurs des pays coloniaux ou semi-coloniaux ont été utilisés systématiquement comme "pions" des grandes puissances sous prétexte de les rendre "Indépendants" (c’est-à-dire libres d’être exploités par leurs propres bourreaux nationaux, libres de mourir sous les bombes russes ou américaines, anglaises ou chinoises), "Combat Communiste" pousse sans gêne le cri de guerre confusionniste qui a permis tant de fois d’aboutir à ces opérations de mystification : "A bas le colonialisme. Vive la lutte des travailleurs antillais pour l’indépendance... et (il faut bien se draper du chapeau ouvrier) pour le socialisme".
Plus "pudique", "Union Ouvrière" fait de même, mais du bout des lèvres (pour qu’on entende moins ?): "flétrissure de l’oppression sous toutes ses formes (...). Le mouvement de destruction communiste de toutes les sociétés de classes (...) ne peut être indifférent à aucune des formes d’oppression que le développement du capital a répandues par toute la terre, et notamment au martyr colonial ou semi-colonial des masses paysannes et prolétariennes des deux tiers de la planète".
On se mouille le moins possible mais on défend la même écœurants marchandise nationaliste sous prétexte de "non indifférence" à "toutes les formes d’oppression". .
Dans le capitalisme décadent, il y a une oppression fondamentale qui SEULE commande à toutes les autres : celle du capital sur le prolétariat.
Le combat contre le capital est un combat contre l’oppression impérialiste, mais le soi-disant combat contre l’oppression impérialiste n’est plus aujourd'hui un combat contre le capital. Des millions de prolétaires et de paysans morts sous les drapeaux de l'"anti-impérialisme" sont là pour en témoigner.
L’indifférence, ce n'est pas la dénonciation des mystifications nationalistes, mais la crainte de le faire parce qu'on se sent "solidaires" de sa propre bourgeoisie de pays industrialisé.
"L'indifférence" et le crime contre-révolutionnaire c'est croire que le combat contre le capital et contre son cadre politique, la nation, est valable uniquement dans une partie du monde, l'autre étant condamnée à mourir pour l'indépendance de SA bourgeoisie nationale et pour les intérêts de SA puissance impérialiste tutrice.
Un seul combat est à l'ordre du jour dans tous les pays : la révolution prolétarienne. Dans tous les pays, chez les yankees comme chez les zoulous, chez les moscovites comme chez les patagons, intérêt national égal intérêt du capital.
Non, on ne "renoue" pas "avec le véritable programme communiste" à partir d'une organisation issue du camp politique de la bourgeoisie. "Combat Communiste" et "Union Ouvrière" viennent de le confirmer une nouvelle fois.
A leurs militants qui croient avoir franchi un pas vers le prolétariat, qui ont peut-être décelé un instant l'immensité du mensonge stalinien et trotskyste, nous ne pouvons souhaiter, pour leur bien, qu'une chose : que leurs nouvelles organisations meurent.
R. Victor
[1] D'ailleurs, ni "Union Ouvrière", ni "Combat Communiste" ne se risquent à prononcer le mot de "capitalisme d'Etat". Us préfèrent parler d’"esclavage salarié" (Engels rejetait explicitement ce terme qu'il considérait servir surtout à faire un amalgame confusionniste qui escamotait la véritable réalité du capitalisme.)
Courants politiques:
- Gauchisme [59]
La crise dans les pays de l'Est
- 1171 lectures
L'année 1974 vient de se terminer dans un concert généralisé au monde entier sur le thème de la "crise". Toutes les interprétations possibles en sont données: "crise du pétrole", "crise des structures", "crise de l'énergie", "crise de civilisation" sont les diverses "explications" qui accompagnent une hausse vertigineuse des prix et du chômage et les appels à la baisse de la consommation et à l'austérité.
La "crise de civilisation" et la "crise du pétrole" ayant fait long feu face à l'approfondissement actuel de la dégradation du capitalisme, on commence à voir apparaître un nouveau cheval de bataille pour démontrer que le système peut encore s'en tirer. "En 1975, le taux de croissance (de l'URSS) sera de 6,5% selon les économistes soviétiques et de 7,2% selon les prévisions américaines. (...) C'est un incontestable succès face à l'économie occidentale frappée de stagnation et de chômage"[1]. Les mêmes qui, il n'y a pas si longtemps, affirmaient avec aplomb que la France restait un oasis de paix dans un monde en crise, récidivent maintenant sans peur du ridicule: on commence à tourner les yeux vers l'Est, car dans l'affolement généralisé, il faut entre autres trouver à tout prix "un champ de prospection pour notre commerce extérieur"(1). Cette recherche effrénée de marchés, qui se traduit par la multiplication des tentatives d'accords commerciaux est le lot de toutes les nations: entre l'Europe et les Etats-Unis, le Moyen-Orient et l'Europe, l'URSS et l'Europe, etc.
L’INTEGRATION AU MARCHE MONDIAL
L'URSS négocie des contrats de fourniture d'hydrocarbures à l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, la France du même type de ceux qui existent déjà avec l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie. Les entretiens entre Etats-Unis et URSS font en ce moment grand bruit. Tout ne va pas sans mal. Le P.C.F. attribue à la rapacité de l'impérialisme américain les difficultés qui peuvent se présenter, mais il se fait tout doux lorsqu'elles s'aplanissent. Et lors de la rencontre Brejnev- Giscard, il n'était plus question que d'"intérêt mutuel" et de "coopération exemplaire".
"Coopération” et "détente" sont les nouveaux leitmotive Pour le reste, G. Marchais, dans sa polémique avec le P.S. précise qu'il s'agit de "résoudre sans crise les problèmes du monde moderne"[2]. Face aux problèmes qui se posent au capitalisme mondial —trouver des marchés pour écouler la production, proposer du "socialisme" pour calmer les ouvriers—, la bourgeoisie rejoint les P.C. dans la louange des pays "socialistes". The Bankers de Glasgow proclame que l'"économie soviétique est plus stable, moins exposée à des chocs destructeurs que ne l'est l'économie occidentale. Si, comme on peut le penser, les désordres sociaux nous guettent (...) et si les dirigeants soviétiques sont capables de garder le contrôle à la fois sur le plan économique et sur le plan social, les points faibles de leur système sont peut-être dans ce cas le tribut qu'ils acceptent de payer en échange de la stabilité qui nous fait défaut"[3].(3).En frères ennemis, les diverses fractions de la classe capitaliste mondiale se rejoignent sur les remèdes à adopter: stabiliser la situation sociale pour pouvoir se consacrer à la guerre pudiquement qualifiée d'"économique". Pour encadrer la classe ouvrière, c’est la gauche qui a le vent en poupe; pour l'embrigader derrière chaque capital national, c'est encore elle qui représente le mieux la tendance générale au renforcement de l'Etat capitaliste. Car si l'on défend l'idée de l'existence dans le monde d'une aire "socialiste", c'est avant tout chacun pour soi. Pour Marchais, les P.C.F; et P.C.U.S. doivent coopérer certes mais en "luttant dans des conditions très différentes et déterminant souverainement leur ligne"[4].
Alors on affirme que la moitié de l'humanité échapperait à l'heure actuelle aux affres de la crise. Les échanges internationaux, la saturation du marché mondial, l'exacerbation des tensions avec la montée des conflits de toutes parts, ne sont que pacotille aux yeux des sinistres rêveurs de "paradis socialiste" et d'"expansion". Pour eux, le marché des pays de l'Est échappe aux lois du capitalisme mondial: la vente et la production ne sont là-bas pas de la même nature.
Pourtant, les faits sont là: "La diminution dans la vente comme dans la production de quelques articles —postes de TV et tourne-disques en R.D.A., machines à laver, aspirateurs, réfrigérateurs en Pologne, postes de radio en Tchécoslovaquie et en Bulgarie— peut être attribuée à une saturation du marché intérieur compte tenu du prix et de la qualité et en partie à l'expansion simultanée de ces productions dans l'ensemble des pays est-européens, ce qui a réduit les exportations dans ce domaine"[5]. En fait, c'est bien plutôt la possibilité ou l'impossibilité d'exporter qui déterminent l'état du marché intérieur. La réalisation du profit contenu dans la marchandise produite ne peut se faire que par la vente à l’"extérieur". A notre époque, le capitalisme qui doit vendre à tout prix mais pas à n'importe quel prix n'a plus d'issue; à l'Est comme à l'Ouest, c'est bien à la vente qu'est destinée la production. La loi de la valeur s'impose; l'Est a du mal à vendre et se tourne vers l'Ouest, l'Ouest a du mal à vendre et se tourne vers l'Est.
Alors qu'en 1973, la récolte de blé en URSS avait été particulièrement satisfaisante, ce pays a signé le contrat du siècle avec les Etats- * Unis pour l'importation massive de blé américain.
En 1973 encore, la part des importations provenant de l"extérieur" occidental a été de 20% du revenu global de la Pologne, de 40% pour la Hongrie. Au sein même du "bloc" de l'Est, tout ne va pas au mieux. On prétend d'une part que la crise de l'énergie ne sévit pas et on expliquera nécessité de couvrir une partie de la consommation —de pétrole—par des importations des pays capitalistes à des prix qui ont quadruplé en quelques mois"[6].
Cette crise dite du "pétrole" ou de 1'"énergie", tarte à la crème de l'agonie du capitalisme en 1974, , outil de la classe capitaliste pour imposer la baisse de la consommation, touche donc déjà 1 "'oasis de stabilité" qu'est le "marché socialiste". Le prix de l'essence a doublé en Tchécoslovaquie depuis le 30 Mars 1974 et la vitesse a été limitée sur les routes. Dès la fin 1973, de distingués économistes du Frankfurter Allgemeine Zeitung signalaient que "la crise du pétrole aurait des répercussions défavorables sur l'économie de l'ensemble du bloc oriental". D'un cêté on affirme qu'il ne manque pas une goutte d'énergie dans les pays de l'Est; de l'autre on utilise encore cette mystification éculée ... et le tour est joué.
La dépendance à l'égard du marché mondial éclata au grand jour. D'ailleurs, le COMECON, cette sorte de Marché Commun est-européen suit à quelques variations près les prix du marché mondial.
LA DECOMPOSITION
Les objections à la crise sont nombreuses, à commencer par les plus plates apologies de l'URSS. Certes, dans tous ces phénomènes que l'on retrouve à l'Est semblables à ceux de l'Ouest, l'URSS • tire mieux que ses "partenaires" son épingle du jeu. La domination qu'elle exerce par les accords commerciaux qu'elle réussit à imposer moyennant une "protection" militaire qui peut n'être souvent qu'une "menace", lui permet d'être apparemment moins dépendante que les autres Etats; notamment pour ce qui est sa part d'importations. Mais en est-il autrement dans l'autre zone d'influence où les Etats-Unis bénéficient des mêmes avantages.
Les effets du marasme commencent à se faire sentir. Les difficultés, l'impossibilité d'élargir les débouchés se répercutent dans une désorganisation de la production au sein de chaque unité, de chaque région, de chaque nation, de chaque bloc. La lutte devient serrée autour du gâteau.
L'acharnement à ouvrir les portes aux hommes d'affaires, qui ont eu droit à un éloge de la part de Brejnev au cours de sa rencontre avec Nixon, va de pair avec les appels de Podgorny contre le "pillage économique". Ce dernier a "demandé à la presse un effort pour dénoncer les escrocs, les dilapideurs et autres adeptes du système D, dont les journaux, pourtant, signalent quotidiennement les activités, (et) n'a pas caché que le mal est fort répandu."[7]. C'est dans le domaine alimentaire que le problème semble le plus préoccupant pour le gouvernement. Les responsables désignés
par le régime sont les "renégats sociaux", les "houligans", les "fainéants". lorsque ce "pillage" prend la forme d'un détournement systématique de marchandises, de produits alimentaires de leur destination officielle, vers le marché noir, on peut dire que les "houligans" ont bon dos. Imagine-t-on Paris aux mains des blousons noirs ? Imagine-t-on une usine "clandestine" de textiles, comptant 200 ouvriers, installée dans les sous-sols d'un théâtre...comme à Tbilissi et vendant aux autres Etats de l'Union mais pas dans le sien bien sûr î
La règlementation étatique n'a jamais tout contrôlé et la classe exploiteuse s'est longtemps accomodée plutôt bien que mal de cet état de choses. La montée des difficultés économiques accélère la décomposition sociale et nécessite un renforcement de l'Etat, une intervention plus efficace. L'appel que lance Podgorny est clair à cet égard: "Les travailleurs honnêtes, les collectivités, les organisations, cherchent à produire davantage, prennent des engagements élevés, luttent avec abnégation pour augmenter la productivité et mettre en exploitation de nouvelles ressources". Voilà qui n'a rien d'une lutte contre de la délinquance, mais ressemble comme deux gouttes d'eau à la défense du capital national, à la préservation de la "propriété socialiste"(7).
Le système en difficulté doit tenter de rationaliser’ sa production. En URSS, dans l'agriculture, le gouvernement essaye de réorganiser sovkhozes et kolkhozes, de rentabiliser au maximum, d'élaguer tout ce qui reste sans apporter une contribution suffisante. Dans la gestion des entreprises, c'est aussi partout le remue-ménage; Gvichiani [8](3), gendre de Kosygine, répond à la question d'une réintroduction de la notion de profit: "Non, pas de profit, de rentabilité.(...) C'est une question d'organisation rationnelle mais il faut aussi qu'il y ait des stimulants moraux et économiques". Toute une génération de managers à l'américaine fait son entrée sur scène, prône de nouvelles méthodes. On envisage des concentrations industrielles à l'image de celles qui se tentent en Occident, afin d'assurer une hausse sensible de productivité.
Partout on cherche des solutions capables d'éviter la dégradation soudain accélérée d'un système en faillite. Les appels sont les mêmes: décentraliser, réorganiser, etc. Tout cela bien sûr toujours au nom des ouvriers. A Cuba, le gouvernement octroie même une expérience de "pouvoir élu et révocable par les masses". S'il le faut, on fera même gérer aux ouvriers leur propre exploitation. On ne manque pas d'en appeler aux nationalistes de tout acabit pour la création d'un "front commun des patriotes". A Cuba, la devise reste plus que jamais: "Mon travail, ma famille, mon C.D.R." (Comité de Défense de la Révolution).
Les réactions nationalistes, régionalistes s'exacerbent. Le P.C.U.S. remet de l'ordre au sein du P.C. Ukrainien un peu trop turbulent à son gré. En Chine également, on normalise. Les gouvernements de tous les pays rivalisent d'appels, d'avertissements, de menaces et de palabres. Malgré toutes ces similitudes de la crise dans ses nombreuses manifestations, la gauche est là pour nous rappeler les "différences'' les "nuances" surtout bien sûr en ce qui concerne la classe ouvrière.
CHOMAGE ET INFLATION
La Vie Ouvrière du 15 Janvier 1975 consacre une quinzaine de pages à nous persuader qu'"Il y a des pays sans chômage". En Allemagne de l'Est, "si quelqu'un est menacé de chômage, c'est l'employé du bureau de placement... On ne met que trois jours pour retrouver du travail, etc.'' Tout est axé sur les problèmes de la "main d'œuvre”.
Pour illustrer l'éclat de rire de mineurs bulgares, on nous explique que la "raine est condamnée", mais que les ouvriers sont contents car ils savent qu'ils seront reclassés dans le bâtiment par exemple. On a là toute une mécanique rationalisée* de la vente de la force de travail. On y reconnaît la possibilité de licenciements" pour des "raisons d'organisation" mais ceci seulement..."avec l'autorisation du syndicat". On reconnaît aussi qu'il y a des problèmes mais que "les ouvriers français seraient heureux d'avoir ces problèmes".
Trêve de plaisanterie, malgré ce tableau idyllique, "la Tchécoslovaquie préconisait dès Juillet 1973 des mesures d'économies". Quant à la Hongrie, elle "a tenté de minimiser les effets psychologiques de la crise pétrolière"[9]. Tous les pays d'Europe de l'Est ont pris des mesures d'austérité en 1973, restreignant la consommation publique et privée d'électricité. Que sont ces effets "psychologiques"? On lit dans la "Pravda”: "L'ouvrier se plaint de ne plus pouvoir profiter des jours de repos avec sa famille: son épouse, comme les autres employées de l'usine, travaille toute la semaine, sans jour de congé et sans pour autant, toucher de primes. Il faut reconnaître que personne n'oblige les femmes à travailler le Dimanche. C'est du 'volontariat' donc une affaire personnelle. L'administration n'a jamais donné d'ordre à ce sujet. Mais il a été décrété qu'elles ne devraient pas compter sur le treizième mois ni sur le 'salaire progressif' si elles ne se portaient pas volontaires" (Janvier 1974).
Pour un salaire de 1750F. par mois pour deux (type de revendication avancée au cours de la grève des PTT en France par ceux-là mêmes qui voient quelque chose de "socialiste" à l'Est), il en coûte 5F pour une plaquette de beurre, 8F. pour un paquet de café.
La pénurie volontaire de certains produits dont les prix sont fixés à de très hauts niveaux contraint la classe ouvrière à épargner, à financer ainsi la classe qui l'exploite. En 1969, les ménages russes ont épargné 2/3 de leur revenu supplémentaire, en Tchécoslovaquie, 95%.
Officiellement, les prix n'augmentent pas. Cependant, le dernier modèle de Volga coûte 65% plus cher que le précédent alors même qu'un ingénieur pourrait difficilement y voir une différence avec l'ancien.
L'évolution qu'a suivi le capitalisme mondial depuis la deuxième guerre mondiale pendant la période de la reconstruction a touché à sa fin vers
1963-64, avec notamment la chute de Kroutchev, les luttes de fractions en Chine. Tous les pays du bloc de l'Est connurent à cette époque le même léger passage à vide de la croissance. Le 1968 tchèque fut un sévère avertissement au grand de l'Est, l'URSS. 1970 en Pologne marqua la reprise de la lutte du prolétariat.
Dès 1966, la revue polonaise Polityka affirmait: "Il est certain et nous devons en prendre conscience, que la population doit choisir entre soit une augmentation importante de l'emploi, soit une limitation de l'emploi et une amélioration des salaires réels; il n'y a pas d'autres solutions". La classe ouvrière l'apprit à ses dépens et c'est une flambée inflationniste sans précédent doublée d'une pénurie alimentaire qui la poussa à s'attaquer en 1970 directement à l'Etat et aux syndicats.
La décadence du système impose à la classe capitaliste un gonflement démesuré des dépenses improductives; le secteur dit des "services" s'accroît sans cesse, la bureaucratie est pléthorique. Marx analysait lors des crises périodiques le phénomène du chômage; le mécanisme reste le même à l'époque de la crise permanente. "Marx déclare: "il y a périodiquement trop de capital et par conséquent trop d'ouvriers'.' Il pose en outre la question: "par rapport à quoi y-a-t-il trop de capital et trop d'ouvriers?" et il répond: "par rapport aux possibilités d'écoulement dans des conditions" normales" assurant le profit nécessaire. C'est parce que le marché se trouve périodiquement trop étroit pour les marchandises capitalistes, qu'une partie du capital doit être mise en sommeil, et du même fait, une partie de la main d'œuvre mise à pied". (R Luxembourg, L'Accumulation du Capital).
La Revue des Pays de l'Est (N°3, Janv.73) signale que "le chômage réapparaît de nouveau en tant que problème sérieux vers la moitié des années soixante". Dans la revue Kultura, (N°12/291, Déc.71), il est dit qu'"au lieu de croître, le niveau de vie des travailleurs a diminué de 2,5% par an". Evidemment pour le catéchisme de propagande qu'est Etudes Soviétiques, la vie est rose: "La plupart des denrées alimentaires depuis des années et même des décennies sont les mêmes en URSS"(sic). Pour étayer "scientifiquement" ce phénomène, un économiste soviétique déclarait en Août 1974: "Nous n'avons pas d'inflation, nous n'avons que des prix élevés". Etudes Soviétiques ajoute avec "humour": "...à la librairie, les livres sont relativement pas chers" alors que récemment une mesure préconisait de remettre à l'Etat 15Kg de vieux papiers pour l'achat d'un livre...
La tendance générale du système capitaliste mondial à l'étatisation est une nécessité pour la classe exploiteuse. La concurrence que se livrent les différents capitaux exige la mise en place de tout un appareil de domination politique et militaire pour faire face à deux obstacles fondamentaux et définitifs à la perpétuation du capitalisme: la saturation du marché mondial, la montée de la lutte de classe. La solution pour la bourgeoisie serait la guerre mondiale; la perspective est à la lutte du prolétariat. Les fractions de gauche de la bourgeoisie sont les plus aptes à diviser le prolétariat mondial sur les différences, les nuances qui peuvent exister entre les diverses variantes apparentes de l'exploitation capitaliste. Ultimes mystificateurs, les gauchistes apportent par leurs théories "critiques" un soutien non négligeable pour la déviation de la lutte de classe sur des objectifs capitalistes.
LES CONTORSIONS THEORIQUES
Les staliniens, peu nuancés, martèlent avec la carotte —on promet à la classe une exploitation sans douleur— ou avec le bâton —on envoie l'armée contre les ouvriers—, que le socialisme est en place et qu'à l'Ouest, seule une "caste étroite" de grands financiers et de méchants patrons est responsable du marasme dans lequel nous sommes plongés.
Les trotskystes quant à eux se proposent de ravaler la façade de la contre-révolution stalinienne, de corriger les déviations, les erreurs, les manœuvres contre-révolutionnaires d'une poignée de bureaucrates qui font "dégénérer", qui "déforment" les Etats...ouvriers. Le soubassement et les fondements matériels de la lutte de classe sont balayés pour faire place à un problème de direction de la société sans toucher ou si peu aux rapports de production. Selon les sectes et les chapelles on n'applique pas exactement les mêmes critères pour juger du degré "ouvrier" ou "petit- bourgeois"(?) de tel ou tel Etat. Pour évincer la "caste parasitaire", point n'est besoin de révolution prolétarienne mondiale mais d'une simple "révolution politique", un changement des mauvais dirigeants par les bons.
Ces mêmes trotskystes, à l'heure où le prolétariat polonais s'affrontait à l'Etat capitaliste en 1970, bénissaient la nouvelle "révolution politique" de façon expéditive pour se consacrer et applaudir à tout rompre aux réactions nationalistes et terroristes d'une fraction de la bourgeoisie espagnole aux abois (Procès de Burgos). Aujourd'hui, on quête en milieu gauchiste pour Eva Forest, soupçonnée de complicité dans l'assassinat de Carrero Blanco; on parle peu ou pas des affrontements avec la police d'un prolétariat exaspéré qui a généralisé sa lutte au Nord de l'Espagne. ,
On justifiera toute cette confusion entretenue par des contorsions théoriques, des aberrations du genre : "Les principaux moyens de production, dépouillés de leur forme marchandise, sont directement produits comme valeur d'usage. (...) Tant qu'il y a pénurie, les biens de consommation demeurent des marchandises"(D. Bensaîd, Revue Critique de l'Economie Politique, La Nature des Pays de l'Est). Comme par hasard, les marchandises aux mains des bureaucrates sont "socialistes", celles destinées aux ouvriers ne le sont pas ! Et les implications politiques sont clairement développées longuement: dans les pays de l'Est, "les racines sociales de ces mobilisations (ouvrières) sont bien différentes de celles des mobilisations anti-capitalistes que nous connaissons" car elles ne "remettent pas en cause les rapports sociaux fondés sur l'appropriation collective des moyens de production!...) et portent tous leurs- efforts sur la confiscation du pouvoir politique". Pour que les pays de l'Est soient véritablement socialistes, il suffira alors à l'ouvrier d'aller vendre sa force de travail à l'Etat trotskyste aprî:3 qu'ait été confisqué le pouvoir politique des mains de la "caste parasitaire"... L’appropriation collective des moyens de production n'est ici que la capitalisme concentré dans les mains de l'Etat, cc capitaliste idéal dont parlait Engels, forme la plus achevée de la tendance générale depuis 1914.
L'histoire l'a prouvé, la pire des mystifications est celle qui s'orne des défaites de la classe ouvrière, embaume les révolutionnaires et les idéalise. Pour la défense de l'URSS, la pierre de touche, l'ultime argument c'est : "il y a eu 1917". Trouver dans un coin du monde un acquis matériel de la vague révolutionnaire mondiale des années 1917-20, c'est nier le caractère global du capitalisme à notre époque, c'est morceler la classe ouvrière en des tâches différentes selon le lieu, le moment, le sexe, la couleur, la langue, le climat... Et tel est le but de la bourgeoisie pour avoir les mains libres de gérer le capital.
Le degré de "socialisme", d'"ouvrier" se mesure également différemment selon la sophistication du thermomètre utilisé. Dans les rangs des "marxistes" aveuglés par l'attachement à une lueur d'espoir, par le goût de la nouveauté, on observe qu'"il existe une espèce de second marché mondial dans lequel l'exploitation des pays sous-développés par les pays les plus avancés est restreinte ou absente"(international Socialist Journal. Mattick).
La période de reconstruction pendant laquelle l'économie d'armements n'a pas cessé de s'accroître a été essentiellement marquée par la persistance et l'exacerbation des conflits inter-impérialistes où les plus puissants se sont affrontés par fractions des bourgeoisies nationales interposées; Indochine, Moyen-Orient, Bengale, Corée, Biafra, Kurdistan, Chypre, etc. par philanthropie peut-être?
Les bordiguistes y ont trouvé quelque chose de "progressiste", de positif dans la soi-disant apparition de capitalismes "juvéniles", dans des "révolutions par en-haut". Pourquoi pas par derrière?
Brejnev, toujours aussi peu nuancé, disait récemment à Schmidt : "Ni vous, ni nous ne sommes des institutions de bienfaisance”.
Le système économique mondial n'a pas de solution à la crise. La prolifération de conflits encore localisés, où chaque bloc y va de son soutien à l'un ou à l'autre est significative du seul cours que pourrait prendre le capitalisme à l'heure actuelle : la généralisation de la guerre. La résistance opiniâtre aux assauts du capital de la part d'une classe ouvrière mondiale qui, à l'Est comme à l'Ouest, émerge de 50 ans de contre-révolution ouvre la possibilité de la révolution mondiale comme première perspective. Aux tentatives de division et de mystification de la classe ouvrière par la bourgeoisie et notamment dans son acharnement à prouver l'existence du "socialisme" en "un seul pays", "ouvrier", le prolétariat répondra comme il l'a déjà ébauché en Pologne en 19/0, en Egypte en 1975.
M. G.
[1] L’Express du 13-19/1/75
[2] Le Monde du 14/1/75
[3] Décembre 1973
[4] L'Humanité du 7/12/74
[5] Notes et Etudes Documentaires d'Avril 1974
[6] Déclaration du Président de l'Office des Prix Tchécoslovaque dans Le Monde du 2/4/74
[7] Le Monde du 8/3/74
[8] Interviewé par L'Express en Juillet 1974
[9] L'Europe de l'Est en 1973, La Documentation Fr.
Sous les plis du drapeau versaillais
- 753 lectures
Il y a trente ans dans l'été 44, du gros bourdon de Notre-Dame dominée par un immense drapeau tricolore, aux églises des banlieues ouvrières, Paris sonnait de toutes ses cloches la résurrection de la patrie outragée. Les ultimes combats des francs-tireurs lavaient dans le sang impur des derniers occupants hitlériens et des collaborateurs vichyssois l'honneur national, conformément aux mêles accents de la "Marseillaise".
Une fois les mitraillettes Sten rangées aux râteliers la foule envahissait la rue, prenait possession des fenêtres et des toits donnant sur les Champs Elysées. C’était fait de façon si spontanée que De Gaulle, qui avait transporté la légitimité à la semelle de ses souliers, pouvait s'écrier, ravi comme le gosse d'Aubervilliers en colo: "Ah! C’est la mer!".
Champs Elysées des cocottes et des cannibales versaillais. Champs Elysées où, pour se compter après leur grande trouille du printemps 68, défila la marée des bien-pensants à Croix de Lorraine. Champs Elysées que Giscard remonta "crânement" à pieds aux lendemains de son élection présidentielle victorieuse. "Marseillaise" qui rythme les razzias coloniales en Algérie et au Tonkin. "Marseillaise" pour saouler les soldats de la première guerre impérialiste. "Marseillaise" de la lutte contre le "fascisme" et, le "sale boche". "Marseillaise" que défend, en ces jours de crise, le P.C.F. contre l'"atteinte instrumentale" que lui fait subir G. d'Estaing.
Il y a trente ans du nord au sud, d'est en ouest la France se couvre de nouvelles prisons, et de camps d'internement. Le parti "communiste" a donné le signal d'une bacchanale d'"épuration qui doit être brutale et prompte, car on a oublié qu’après des années d'abjection, un pays ne se retrouve que dans la virilité" comme le déclare son plumitif de service Y. Farge.
A Poitiers, des prisonniers allemands d'origine russe et géorgienne sont massacrés sur la Place d'Armes par une foule en délire. A l'autre bout de la France, à Marseille, 500 suppliciés sont jetés dans un ruisseau, à la ville servant d'égout industriel.
Comme le programme de la Résistance a laissé croire aux travailleurs que la chute du IIIe Reich amènerait la fin des privations et de l'interdiction du droit de grève, la paix et le bien-être, c'est dans la liesse populaire que sont accueillis les "libérateurs: De Gaulle, Leclerc, Koenig De Lattre... A des milliers de kilomètres, au Liban -pour peu de temps encore sous mandat français- les travailleurs de la base militaire de Rayack pavoisent à leur tour aux couleurs de Paris et de Moscou. L'ivresse du moment leur fait oublier ce que la présence de l'impérialisme français, sous couvert de garantir les droits des minorités chrétiennes, avait signifié journellement pour eux: une féroce administration de satrapes levant corvées et amendes collectives, pillant et dévastant l'économie naturelle des tribus et villages pastoraux.
LA RECONSTRUCTION CAPITALISTE
Alors, pour faire rejaillir la responsabilité de la mort de 50 millions d'êtres humains, dont 6 millions de juifs et 1 million de Tziganes, sur l'idéologie nazie, on offre le spectacle pitoyable de ceux qui ont réchappés aux camps d'extermination Auschwitz efface Dresde, les stalags blanchissent les deux bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima.
Or, cette euphorie germanophobe générale dans la métropole et les colonies, gravement hypothéquées par les anglo-américains, ne peut cacher l'ampleur du désastre subi par l'économie nationale. De 12 000 locomotives, il n'en reste plus que le ¼; 1/10 du parc auto est en état de rouler; 3 000 ponts autoroutiers ont sauté; les grands ports maritimes, les canaux, les écluses, sont encombrés d'épaves.
Tout était à réorganiser dans de très courts délais: de l'appareil de production en partie démantelé par les forces d'occupation, en partie détruit par les bombardements alliés sur les concentrations industrielles, à la machine étatique. A l'armistice de juin 40, celle-ci s'était scindée en deux fractions rivales, pétainistes et résistants. C'est la détérioration de la situation économique, aggravée par l'envoi de nombreux ouvriers qualifiés au Service du Travail Obligatoire"[1] (S.T.O.) en Allemagne, qui convainc nombre d'industriels français des dangers économiques croissants que comporte cette politique. Soucieux de sauvegarder leurs intérêts de classe, ces patriotes rejoignent la Résistance, tout en appliquant les ordonnances du gauleiter Sauckel sur le blocage des salaires.
Dans les colonies la situation générale n'est pas meilleure, loin s'en faut. A deux doigts de perdre Madagascar, sur laquelle lorgne dangereusement l'allié britannique, l'impérialisme français affronte les premières vagues du mouvement "anticolonialiste" qu'il réprimera avec la dernière énergie. La France libre, fille de la lutte contre le fascisme, exterminera, en avril 47, 90 000 malgaches soulevés contre les réquisitions de l'économie de guerre métropolitaine qui les affamaient. Commence aussi la guerre du Viêt-Nam, avec pour premiers soldats des volontaires maquisards.
Derrière son homme providentiel, la bourgeoisie résistante a besoin pour reconstruire un capitalisme décrépit de toutes parts:
- primo: de desserrer l'emprise américaine à qui la j France doit 720 millions de dollars au titre de prêt- bail;
- les E.U. hésitent à reconnaître de jure le G.P. secundo: de s'imposer à l’intérieur comme gouvernement de salut public.
Où peut-elle puiser si ce n'est à gauche, plus précisément vers l'élément stalinien représentatif de la légalité républicaine, malgré les groupes fractionnels qui surgissent en son sein pour essayer d'instaurer une "démocratie populaire" à l'instar des pays de l'Est.
Au sortir de quatre années d'occupation, la bourgeoisie est obligée de réclamer la collaboration de tous les patriotes sans exclusive, jacobins ou royalistes, thoréziens ou libertaires. Ces cohortes formeront le vaste rassemblement national pour mener à termes un effort immense, difficile, le pressant appel lancé aux "communistes" qui ont fait de la résistance le devoir sacré par excellence trouve l'écho attendu. Le premier, De Gaulle savait ce parti authentiquement français, intégré par toutes ses fibres à la nation, qu'il ne constituait pas une 5°colonne, mais un parti totalement subordonné à la défense de l'impérialisme français.
C’est donc avec la collaboration d'un parti entièrement réhabilité par sa participation au second massacre impérialiste que la bourgeoisie a pu gouverner. De son internement dans les prisons algériennes, le P.C. était passé à la coopération franche et loyale. C'est ce que sa propagande apocryphe appellera "Le chemin de l'honneur". Lorsque De Gaulle fait entrer dans son gouvernement ces subversifs, sortis grands vainqueurs de la consultation électorale de novembre 46 avec 5.498.000 voix, il n'est pas sans savoir quel profit il va en tirer.
A cette époque, ni les soi-disant communistes, ni la C.G.T. sortie de son illégalité ne parlaient de pouvoir personnel, trop heureux d'aller à la soupe. Tous deux ont pendant les années d'occupation su faire preuve de leur attachement à la cause nationale pour embrigader dans les maquis une partie des travailleurs réfractaires à la déportation en Allemagne.
Certes, jusqu'à ce que la Russie lâche Hitler, en conséquence des premières brouilles russo-allemandes qui éclatent à propos du contrôle des champs pétrolifères des Balkans, pour entrer en guerre aux côtés des démocraties occidentales, les staliniens français ont fait de l'esbroufe pacifiste à sens unique. Il faut, coûte que coûte, faire passer le pacte de non-agression germano-soviétique, signé le 23/0Û/39, par Molotov et Von Ribbentrop à Moscou, pour un inestimable service rendu par les soviétiques à la cause de ...l'antifascisme. Certes, pendant les neuf premiers mois de "la drôle de guerre", les principaux dirigeants ne se sont pas rendus dans les casernes à l'appel sous les drapeaux. Certes, le "meilleur stalinien de France", M. Thorez, a-t-il déserté le 6/10/39, parce qu’expliquera-t-il dans son interview au journal frère "Daily Worker":
- "Les communistes luttent de toutes leurs forces contre la guerre impérialiste. Nous agissons comme les vrais défenseurs du peuple français en ne voulant pas que les jeunes gens de notre pays soient victimes du massacre causé par les capitalistes anglais dans la guerre d'intérêts qu'ils sont en train de faire contre les capitalistes allemands" (20/11/39)
Certes, aux débuts des hostilités une fraction notable de syndicalistes de la C.G.T. se sont ralliés à la "Révolution nationale" du sénile maréchal Pétain. Tel fut le cas pour H. Lagar- delle, vétéran du* syndicalisme apolitique inspiré de la Charte d'Amiens (1906), qui conquis par le corporatisme calqué sur le modèle italien et rédacteur en chef de la revue fasciste "Prélude”, remplacera Belin au secrétariat de la Confédération d'Etat au Travail.
Sous la houlette de ces mandarins du syndicalisme devait, sous le couvert de "Relève", s'effectuer un fantastique trafic de viande humaine. De quoi était-il question? La réponse est celle-ci: I prisonnier français en Allemagne réintégré son foyer quand 3 ouvriers français partent le remplacer en "volontaires".
Par la suite, la vapeur a été complètement renversée. Le P.C.F. rangé résolument du côté allié a tant et tant orchestré le concert d'excitations chauvines, se terminant par la note finale "A chacun son boche!", "Plus forts les coups sur le boche chancelant !''; il s'est montré d'une telle intransigeance en matière de défense nationale et de défense des intérêts impérialistes français -coïncidant alors avec ceux des Russes-; il a su si bien mener l'intox pour l'ouverture d'un "deuxième front" en Europe, réclamé à cor et à cris par Staline, que la bourgeoisie se rend compte d'une réalité éclatante. Elle a affaire à un parti de gouvernement; un parti qui a fait sien "Tout ce qui sert la guerre est bien, tout ce qui la dessert est mal" ne peut pas rester sur la touche. Il est irremplaçable. Les raisons qui l'amènent à l'associer au pouvoir ne sont à chercher nulle part ailleurs.
Une première fois, le 3/04/43, le P.C.F. participe directement au gouvernement formé à Alger par les généraux De Gaulle et Giraud. Les "camarades ministres" F. Billoux et P. Grenier siègent aux côtés des Queuille, Pleven et consorts sur un programme comprenant les points suivants:
- 1) mise en œuvre de tous les moyens pour la guerre par la formation d'une puissante armée anti-hitlérienne.
- 2) châtiment des traîtres et saboteurs de la grande lutte libératrice.
- 3) union totale de la France et des territoires d'outre-mer.
- 4) accroissement du rôle de la France dans le concert des Nations-Unies.
L'entrée au gouvernement de ce parti qui, en 1920 à la scission de Tours s'était juré de ne jamais répéter la trahison social-démocrate d'août-14, est venue couronner l'ensemble de ses actes d'Union Sacrée. En retour, sa .propagande allait forger une auréole de héros des droits démocratiques à De-Gaulle, le laver des anciennes accusations d'"agent de la City", de "persécuteur acharné du prolétariat", tout cela en fonction de la morale solvable bourgeoise donnant-donnant.
A la classe qui a subi la défaite sous sa forme démocratique, donnant à fond dans la mystification du Front Populaire puis du bloc de résistance, le tripartisme des associés communistes-socialistes-démo-chrétiens du H.R.P., imposera un plan de famine et la politique du "Retroussez-vos manches". Sous la poigne d'acier du P.C./C.G.T. le retour à l’ordre républicain, après la parenthèse de Vichy, s'est effectué avec un minimum de bavures.
Paix, cette politique menée tambour battant par les staliniens pour poursuivre l'hitlérisme dans ses derniers retranchements, cette mobilisation de masse pour l'accomplissement maximum de l'effort de guerre[2] (1)? Pain, cette existence de la classe ouvrière plus que jamais aux prises avec la faim et la maladie: 4 tuberculeux pour 100 000 habitants au lieu de 3 en 1936. Bien-être ces semaines de travail où pour reconstituer ses forces, l'ouvrier doit travailler 47 heures (légalement).
Le contrat fixant la création d'une puissance industrielle lourde rempli, avec une volonté inébranlable de la part des staliniens, ces derniers furent remerciés du jour au lendemain par la bourgeoisie se tournant davantage vers les USA sous la pression des socialistes et du M.R.P. Après avoir remis le pays affaibli au travail sur un rythme d'accumulation forcené qui étonnera les ingénieurs, les valets sont rentrés dans l'opposition. Eux qui avaient espéré par leur entrisme faire pencher la balance française du côté russe reprocheront à la bourgeoisie son ingratitude, de se laisser économiquement marshaliser par le Yankee, une poche bourrée de dollars, l'autre de chewing-gums pour les petits enfants du "peuple français".
Dans les usines, la mine, les chantiers et les bureaux, la vie syndicale a repris son cours; encore unifiée la C.G.T. compte 6 millions d'adhérents; la démocratie est rétablie dans sa souveraineté. Le capitalisme français qui a eu besoin de passer par une phase d'étatisation prononcée de son appareil productif peut à nouveau disposer de "sa" classe ouvrière en toute liberté. Ont été expropriés les gros actionnaires des usines Renault, SNECMA, du gaz et de l'électricité, de la Banque d'émission, comme traîtres à la nation.
La résistance, en exigeant de l'ouvrier un appui aux bons patrons patriocistes et en lui imposant pour toute grève celle qui bloque l'appareil de guerre nazi, a fait du bon ouvrage. Ce ne sont pas les successeurs de Churchill, Roosevelt, De Gaulle ou Staline qui nous démentiront. Peut-être bien les trotskystes,…
LES RESISTANTS TROTSKISTES
Tout comme G.V Plekhanov lors de la première guerre impérialiste, la "IVe Internationale" se mit en 1940 à énoncer les canons de la morale défensiste, à cette différence près d'avec le vieux lutteur marxiste qu'à aucun moment de son histoire, le trotskysme n'a appartenu au prolétariat —l'Opposition trotskyste trouve son origine dans une certaine manière de concevoir l'application du plan d'Etat à l'économie soviétique.
Rude école cette guerre, réactionnaire des deux côtés, par son feu impitoyable n'a laissé pierre sur pierre de l'édifice bancal des formules trotskystes. Comme porte-parole des intérêts du capitalisme d'Etat russe, Trotski a modifié la caractérisation de la guerre telle que le marxisme l'avait formulée bien avant août 14. On sait qu'il ne devait point faire mystère de ses profondes convictions "défensistes" au cours de la guerre de 39/45. Pour lui, "la défense de l'U.R.S.S." coïncide en principe avec la préparation de la révolution prolétarienne mondiale" si l'on en croit le "Manifeste" rédigé de sa main, et qu'adopta une conférence de sections de la IVe à New-York en mai 40. Des plus brèves interviews accordées aux journaux "radicaux" américains à son dernier ouvrage "théorique", "Défense de l'U.R.S.S.", Trotski n'a pas cessé d'avoir pour conduite de donner à Staline et aux démocraties, conseils, directives pour bien faire, la guerre; d'accuser le régime "bonapartiste" d'avoir affaibli les capacités militaires de l'Armée Rouge, d'avoir capitulé devant les exigences japonaises. Du fait que "la dictature bonapartiste de Staline s'appuie sur la propriété d'Etat, et non sur la propriété privée", cette guerre devenait l'affaire du prolétariat mondial pour aligner chaque pouce de territoire occupé par l'Armée Rouge sur le régime de la propriété étatique.
Nonobstant leurs querelles idéologiques, toutes les sections de la IV° se sont retrouvées au coude à coude avec les staliniens et les gaullistes pour "la lutte pour l'indépendance et pour la sauvegarde des libertés démocratiques" (I.K.D., section allemande), contre l'asservissement de l'Europe par les nazis redonnant actualité aux mots d'ordre démocratiques d'indépendance nationale" (P.O.I. section française).
Trop faibles pour constituer d'eux-mêmes leurs propres maquis, ces valeureux "bolcheviks" rejoignirent ceux des F.F.I. ou des F.T.P., car "la lutte pour la démocratie" primait tout. Au nom des grands principes du défaitisme-révolutionnaire, les révolutionnaires ne doivent pas heurter le sentiment patriotique des masses laborieuses écrivaient les uns et les autres.
Il y a trente ans aussi, le P.C.I. (IV°) dé- fendait son honneur de résistant rappelant à l’opinion publique que LUI aussi a servi dans la lutte contre le nazisme, et dressait la liste de ses martyrs tombés au champ d'honneur. Pour le "Groupe Communiste", aujourd'hui popularisé et massifié sous le sigle "Lutte Ouvrière", les travailleurs embrigadés dans les maquis auraient pu "fournir des cadres précieux et expérimentés à la classe ouvrière" pour peu qu'on y introduise, dans ces maquis, les sacro-saints principes de la démocratie ouvrière. Six mois avant la reddition du général Von Choltitz, un appel de cette organisation disait aux jeunes gens:
- "Dans les groupes de Résistance, dans les maquis exigez votre armement et l'élection démocratique des chefs!" (Lutte de Classe", n°24 du 8.2.44.)
Qu'importe donc si je tue mon frère de classe du moment que je le fais avec les armes bénies par les prêtres de la démocratie ouvrière! Mon honneur d'internationaliste est sauf, de plus j’affirme ma dignité nationale contre le désarroi du pacifisme petit-bourgeois! Mon maître a dit:
- ''Je ne saboterai pas la guerre. Je serai le meilleur soldat, tout comme j'étais l'ouvrier le meilleur et le plus qualifié de l'usine" - Débat entre J. Cannon et Trotski. "Socialist Worker Party" -juin 40- "Je lui obéirai alors au doigt et à l'œil" !
Il suffit d'un simple grattage de la mince couche de vernis internationaliste qui recouvre l'organisation "Lutte Ouvrière" pour faire apparaître en pleine lumière le garde-chiourme de l'impérialisme:
- "L'armée de Tchang Kaï-Chek, qui compte plusieurs millions d'hommes et qui, bien équipée pourrait balayer l'impérialisme japonais, manque complètement d'armes" -"Lutte de Classe" n°25.
Faute de direction révolutionnaire décembre 27 à Canton, où 4 000 prolétaires communistes furent abattus à la mitrailleuse par l'anti-impérialiste Tchang Kaï-Chek, ou jetés vivants dans les chaudières des locomotives; 1934 dans les Asturies et en Autriche; 1936 en Espagne et en France; 1944, encore, en France sont pour les trotskystes de toute obédience des occasions manquées. Faire prendre des vessies pour des lanternes a toujours caractérisé le travail du charlatanisme trotskyste.
En août 44, son antienne a été "Tout est possible et à toute vitesse!". Peut-on avoir de révolution plus exemplaire à revendiquer que 1944, révolution préparée par le Commandement Allié, dirigée par le C.N.R. de De Gaulle et Bidault, accouchée par les colonnes de blindés américains, canadiens, britanniques et français, révolution ralliée par la quasi-majorité de la Préfecture de Police de Paris?
Ne sont-ils pas sublimes les titres de noblesse du trotskysme ?
UTILITE ET LIMITE DES REMINESCENCES DE LA "LIBERATION" DANS LA CRISE ACTUELLE
C'est une bourgeoisie assaillie par la recrudescence des difficultés économiques qui commémorait, au grand complet, ce 30° anniversaire de la renaissance laborieuse du capitalisme français. Durant une semaine, pendant laquelle les ondes ont rengainé du "Chant des Partisans", toutes les cérémonies rituelles de la sorcellerie rationaliste y sont passées. Ici, c'étaient des dépôts de gerbes; là des inaugurations de mausolées; il y eut de savants colloques pour les lettrés et des feux d'artifice pour les pékins; quelques grands compagnons de route ranimèrent la flamme à l'Arc de Triomphe; des légions d'honneur distribuées à discrétion.
Des messages de félicitation rappelant la "fraternité d'armes entre la France et l'Union soviétique durant les années de la seconde guerre mondiale et leur lutte commune contre la tyrannie fasciste" lui sont parvenus, dans cet été 74, du camp socialiste. Bien entendu, ces cérémonies, qui se voulaient grandioses, ne pouvaient pas passer sans une déclaration de la meilleure veine nationaliste, par la voix du sénateur "communiste" Duclos. La voici dans toute sa nudité capitaliste:
- "La maturité politique manifestée par le peuple français il y a trente ans se traduit aujourd'hui dans l'aspiration des Françaises et des Français à porter haut le drapeau de l'indépendance nationale"
Qu'est-ce à dire sinon que si de nouveau éclatait une troisième guerre impérialiste pour le repartage du monde et, dans laquelle chaque peuple comme s'est son rôle, est appelé par la classe dominante à se battre sur le terrain du capital, ce parti est tout disposé à se lancer dans une nouvelle Union Sacrée, un nouveau bloc de résistance autour d'un homme providentiel. Et, c'est bien ce que la bourgeoisie qui a une conscience aiguisée de ses intérêts a enregistré sur ses tablettes.
A plusieurs reprises, elle a exprimé ces derniers temps sa confiance au parti "communiste" La récente polémique Duclos-Poniatowski, dans les austères décors du Sénat, aura rappelé à qui sait lire que dans sa tournée des popotes le 27/8/47 De Gaulle s'exprimait dans les termes suivants:
- " Oui, à la libération j'avais avec la Résistance tout entière, jugé qu'il fallait offrir à ces séparatistes l'occasion de s'intégrer à la communauté nationale. (...). J'ai donc joué le jeu. Je l'ai joué carrément. J'ai introduit des hommes de cette sorte dans le gouvernement qui réunissait alors des hommes de toutes opinions. Pour ce que j'en attendais momentanément dans la période difficile qui a suivi la Libération, cette décision a atteint son but" (Le Monde" I5/II/74.)
Tout aussi bien des gaullistes de "progrès", actuellement placés dans l'opposition, que des hommes liés aux grands "monopoles" se déclarent favorables à une participation de la gauche stalinienne aux affaires de l'Etat.
On a vu, entre deux algarades sénatoriales, Poniatowski en personne tendre la perche:
"Il faudra encore de nombreuses années et des preuves tangibles pour que nous vous admettions dans les rangs des hommes libres. C'est ce que je souhaite pour l'unité de la France".
Le prince-ministre, qui ne craint nullement de réchauffer un serpent dans son sein, a tout à fait raison en ce qui concerne les souhaits de sa classe. Toutefois, nous estimons qu'il se trompe en ce qui concerne l'appréciation de l'intervalle de temps qui sépare le P.C. de son entrée au gouvernement comme gérant loyal de la crise. Réussir à vaincre la sotte méfiance qui subsiste à son égard dans certaines couches gouvernementales, certains chefs d'entreprises, est la tâche impérieuse qui, derechef, s'impose à lui.
Il y arrivera à force de déclarer son intention bien arrêtée de permettre à la France de jouer dans le monde un rôle à sa mesure, de l’arracher à son état de dépendance économique vis à vis des Etats-Unis. La bourgeoisie, loin de lui en faire reproche, s'est reconnue dans ces objectifs exprimés dans le Programme Commun, visant à agrandir la place économique de la France, à consolider sa position diplomatique dans le monde. Elle n'oublie pas, non plus, qu'au soir même des élections présidentielles de mai 74, le parti "communiste" se montrait on ne peut plus rassurant pour la suite de sa politique:
"Qu'on ne compte pas sur nous pour venir troubler l'ordre social. Dès demain matin les travailleurs, conscients de leur poids grandissant dans la société et la Nation, vont reprendre le travail dans l'ordre et la dignité", devait déclarer, en substance, son secrétaire général aux micros des différentes radios périphériques.
Ensuite, commençait une campagne de "main tendue" et d'alliance en direction des gaullistes, ceci pour trouver une issue à la crise dont souffre le pays par la faute des "monopoleurs" apatrides. Un des premiers résultats de ce rapprochement qui nous renvoyait 38 ans en arrière ("Je te tends la main, camarade catholique" M. Thorez), aura été l'élection d'un nouveau délégué gaulliste au conseil régional Rhône-Alpes, en application, scrupuleuse des accords de l'automne 73 pour déléguer à ladite assemblée autant de représentants de la majorité que de l'opposition. Comme Paris vaut bien une messe, il ne serait pas étonnant que pour se gagner les faveurs de toute la bourgeoisie et quelques strapontins ministériels nos communistes épurent leur fameux Programme Commun.
Les cérémonies marquant la fin d'un massacre qui a fait des dizaines de millions de morts et d'estropiés dans le monde entier sont passées. Elles n'ont pas été marquées par l'enthousiasme délirant des travailleurs. Que la bourgeoisie et ses valets pleurent à chaudes larmes la Résistance n'est pas notre affaire à nous qui savons que désormais le prolétariat se dirige, malgré les innombrables obstacles dressés sous ses pas et sous les coups de la crise, vers l'affrontement de classe.
La bourgeoisie peut ressortir ses lampions pour pavoiser aux couleurs de Versailles; elle peut essayer de saouler la classe ouvrière avec ses petits airs de bal musette bon enfant et ses chants patriotiques. Le parti respectueux de constitution républicaine peut répondre "aux calomnies déversées sur son honneur de Français" en allant fleurir les tombes des héros de la Résistance: au même moment a lieu la grève de six semaines des 300.000 postiers qu’il s'emploie à liquider aux moindres frais pour l’Etat-patron. Le parti "communiste" est bien un parti du capital.
Depuis 1968 l'inévitable affrontement révolutionnaire est apparu comme un fait, une nécessité inéluctable pour la société. Et ce jour-là, ce ne seront plus les immondes usines à bénir les armes qui sonneront avec fracas, mais les trompettes de la Révolution Mondiale:
"J'étais, je suis, je serai!".
R.C.
- Extraits d'archives -
Le Secrétaire du Parti Communiste Internationaliste (Région du Sud-Ouest) à Monsieur le Commandant Louis, Commissaire Régional à l'Information (1944, IV° Internationale).
"En date du 6 Novembre 1944, je vous ai adressé une demande d'autorisation de paraître pour notre journal "Octobre". Vous nous l’avez promis, nous l’attendons toujours.
Vous savez pourtant que nous y avons droit. En effet, une circulaire de IVe République déclare que: "seront autorisés à paraître dès le jour de la libération, les organes patriotiques clandestins qui paraissaient illégalement avant le 1er Janvier 1944.
"Octobre" répond bien à cette définition.
Depuis 1942, "Octobre” a paru illégalement. Nous avons édité et diffusé 12 Numéros qui tous appelaient les travailleurs à la lutte contre l'occupant nazi et ses collaborateurs.
Bien plus, notre parti a été l'un des premiers à dénoncer le danger que faisait courir l'hitlérisme à la classe ouvrière, puisque dès 1928, nous lancions l'alarme et préconisions l'unité d'action de la classe ouvrière allemande contre Hitler. A partir de 1932, nous n'avons jamais cessé de souligner l’incapacité de nos gouvernants à préparer la lutte contre les nazis. Dès cette époque, nous préconisions la formation en France, d'un gouvernement ouvrier fort, qui pourrait épauler et susciter en Allemagne, un mouvement ouvrier contre Hitler. Nul doute que si on nous avait suivis, l'hitlérisme aurait pu être liquidé sans cet amoncellement de ruines sur l'Europe. Est-ce parce qu'aujourd'hui ce sont les mêmes gouvernants (ou leurs frères) qui reviennent au pouvoir, est-ce pour cela que ces gouvernants refusent de nous donner l'autorisation à laquelle nous avons droit. Ils feront en tous cas la preuve que la démocratie est un vain mot en IV° République.
Peut-être est-ce que notre patriotisme n'est pas le même que le vôtre. C'est exact sur ce point, nous ne partageons pas votre position. Nous pensons que pour nos maîtres, les capitalistes, la patrie n'est pas autre chose que leurs usines, leurs chantiers, leurs coffres forts. Les travailleurs, eux, n'ont que leurs intérêts de classe ouvrière à défendre. C'est pourquoi nous les faisons passer avant tout. Mais que nous soyons en désaccord n'est pas une raison suffisante pour nous refuser une autorisation à laquelle nous avons droit à moins que nous ne revenions aux méthodes de Pétain. En tout cas, nous pouvons vous affirmer que ce n'est pas pour ce résultat que le prolétariat aura mené la lutte pendant quatre années d'occupation."
[1] Promulgué le 1/9/42 en zone nord, le 6/4/42 aux Pays-Bas, le 6/l0/'42 en Belgique. Les Allemands invoquent l'article 52 de l'annexe à la 4e Convention de la Haye, qui prévoit des prestations de service pour les besoins de l’armée d'occupation. –Favard, "Déportation des travailleurs français dans le lIIe Reich".
[2] "Je travaille honnêtement à redonner à la France une armée de l’Air qui soit digne du rôle que la France doit conserver en tant que grande nation industrielle, et c'est parce que le peuple de France aime son armée qu'il entend aussi voir la France demeurer une nation industrielle et exige que tout soit mis en œuvre pour la reprise économique du pays.” C. Tillon, Ministre de l’Air en 44 et parrain du "Secours Rouge" en 1970.
Revolution Internationale N°14 - mars/avril
- 26 lectures
Rubrique:
A PROPOS DE L'ARTICLE : "Deux avortons de la gauche du capital"
- 17 lectures
L’article paru sous ce titre, dans le dernier numéro de R.I. (N° 13, Février 1975), soulève à la fois des problèmes théoriques généraux et des questions politiques pratiques de très grande importance. Il s'agit de dégager les lignes de force générales à travers lesquelles se poursuit dans l’histoire de la lutte de classe le processus continu de l'organisation des révolutionnaires. Si l'organisation révolutionnaire apparaît être une nécessité absolue pour le développement révolutionnaire de la classe, elle n'en est pas moins sujette aux vicissitudes du déroulement de la lutte de classe, car avant toute chose elle est un produit, une manifestation de la lutte même de la classe. Si l'organisation révolutionnaire exprime-le niveau de la prise de conscience de la lutte de' classe et est un puissant facteur indispensable dans son développement, ce n'est pas elle qui détermine l'existence de la classe ni sa lutte, mais elle est elle-même déterminée par cette existence.
Ainsi, entre la nécessité impérieuse ressentie par la classe de se doter d'organismes politiques aptes à assumer une fonction précise pour laquelle la classe les secrètent, et sa réalisation pratique, s'intercale la réalité concrète et complexe fondée sur des facteurs objectifs, tels que le développement du capitalisme et de ses contradictions et l'ampleur de la lutte de classe qui en résulte, ainsi que les résultats généraux et immédiats de la lutte : les victoires et les déroutes subies, rompant et modifiant le rapport de forces existant entre les classes.
L'existence et l'activité de l'organisation révolutionnaire ne reposent donc pas uniquement sur un besoin général, mais aussi sur les conditions telles qu'elles se présentent dans la réalité complexe de son déroulement concret. Méconnaître ce double fondement de l'organisation et de l'activité révolutionnaires et ne retenir unilatéralement qu'un seul de ces deux éléments, mène inévitablement ou à la secte qui, si cohérente soit-elle, reste détachée de la réalité et tombe dans une impuissance fataliste, ou au volontarisme immédiatiste qui en fait d'activisme s'agite dans le vide et ne fait que gaspiller des énergies révolutionnaires précieuses.
Par ailleurs, la juste compréhension de ce double fondement nous donne la clé et l'explication du déroulement de l'histoire du mouvement ouvrier avec ses périodes de développement et d'expansion et ses périodes de recul des organisations et de leur activité révolutionnaire, dont aucune cohérence ni volonté, fussent-elles celles d'un Marx ou d'un Engels, ne pouvaient substantiellement modifier le cours.
Ceci explique également la possibilité toujours existante de la dégénérescence des organisations de la classe dans des circonstances défavorables au prolétariat, dégénérescence qui peut aller jusqu'au passage de ces organisations dans le camp de la classe ennemie. Il ne sert à rien de recourir en guise de consolation aux élucubrations bordiguistes qui séparent un Parti Historique infaillible mais inexistant d'un Parti Formel existant et faillible parce que non révolutionnaire. Ce sont là des spéculations métaphysiques sur l'âme immortelle sans corps et les corps sans âme. Ces "explications" n'expliquent rien et ne font qu'embrouiller la compréhension du fait que le processus de l'organisation et l'activité révolutionnaire se présentent comme un mouvement continu (du fait de la continuité de l'existence de la classe dont il est issu) mais n'est pas pour autant une forme linéaire, gradualiste, toujours en ascension. Ce processus est constamment en bute à des forces contraires qui entravent constamment son développement. Son mouvement, constamment heurté, se fait par des avances et des reculs, par des bonds et des rebondissements, dans une réalité dominée par la classe ennemie. Dans cette guerre historique de classe, et jusqu'à la victoire finale, le prolétariat semble n'avancer qu'au travers d'une série de défaites momentanées et partielles. Il est quasiment inévitable que dans ces grandes défaites le prolétariat perde des corps d'armée plus ou moins grands et forts, qui sont ses anciennes organisations de classe. Ce qui le met dans l'obligation de continuer à les reconstituer à nouveau, armé de tout l'acquis de l'expérience passée.
Dans cette guerre de classe, l'arme peut- être la plus dangereuse parce que la plus pernicieuse, utilisée par le capital contre le prolétariat, est l’arme idéologique. L’article insiste avec force raison sur l'importance primordiale que joue pour le prolétariat (à la différence des autres classes dans l'histoire) sa prise de conscience. Sans ce mouvement de prise de conscience, le prolétariat ne pourrait jamais triompher et toutes ses révoltes seraient inexorablement vouées à des défaites sanglantes. Or le prolétariat vit sous la domination de l’idéologie capitaliste qui le pénètre de toutes parts, et dont il subit jour après jour l'influence. Au fur et à mesure qu'approche l'échéance du règne du capital, le capitalisme affine son arme la plus opérante contre le prolétariat, son arme idéologique qui vise à empêcher et à décomposer la prise de conscience de celui-ci. En le désarmant de sa conscience, il l'immobilise, il le rend incapable de s'organiser pour un affrontement ouvert, il dévoie son mécontentement grandissant vers des impasses, sur des terrains étrangers, comme celui des guerres nationales (impérialisme), des prétendues guerres de libération, au plus grand bénéfice de la survie du système capitaliste mondial.
Pour ce faire, le capital utilise de prédilection les déchets des anciennes organisations défaites, qu'il ramasse dans les poubelles du prolétariat pour en faire ses grands hommes -utilise en bloc les anciennes organisations ouvrières après avoir réussi à les corrompt lentement jusqu'à la moelle, et à les happer dans son engrenage, faisant d'elles les meilleurs serviteurs du capital, par leur meilleure aptitude d'agir en agents parmi les ouvriers.
L'article explique non seulement le mécanisme du passage d'une organisation ouvrière au service du capital, mais, et cela est d'une importance majeure, met en évidence le caractère irréversible de ce mécanisme qui ne fonctionne qu'à sens unique ; jamais un parti bourgeois ne peut passer dans le camp du prolétariat, jamais ne peuvent éclore en son sein des tendances prolétariennes. S'appuyant sur toute l'histoire du mouvement ouvrier, l'article démontre magistralement que cela reste vrai comme c'était vrai pour les anciens "partis ouvriers" une fois que ceux-ci ont franchi les frontières de classe du prolétariat.
"Révolution Internationale" reprend et réaffirme avec force la position défendue de toujours par la Gauche Communiste dans les années 1920 contre la politique opportuniste de l'internationale Communiste et de Lénine, préconisant le retour des groupes communistes d'Angleterre dans le Labour Party, l'unification entre le jeune Parti Communiste d 'Allemagne avec le Parti des "Indépendants", le tout au nom d’"aller vers les masses". C'est avec le même acharnement que la Fraction de la Gauche Italienne dénonçait dans Bilan dans les années 1934-35 les manigances de l'Opposition de Gauche de Trotsky avec les courants de la "gauche socialiste" aboutissant finalement au retour des trotskystes au sein des partis socialistes et de la IIème Internationale de triste mémoire. En revendiquant aujourd'hui cette position, R.I. montre qu'elle se situe comme la continuité de ce qui était la Gauche Communiste, exigeant une rigueur de la pensée et du comportement communistes contre le flou et le vague des manœuvres et manipulations toujours à l'honneur chez les confusionnistes en tous genres[1].
Tout en affirmant notre plein accord sur le fond du contenu de l'article, nous croyons cependant nécessaire de formuler quelques critiques à son égard :
I. L'article apparaît comme coulé d'un seul bloc. La cohérence tant exigée et avec raison se transforme ici en une rigidité toute mécanique. Voulant trop prouver, il finit par être une preuve abstraite, schématique. Ainsi cette affirmation : "Une seule position bourgeoise suffit à ôter tout caractère prolétarien à un parti prétendu ouvrier", sans distinction, sans préciser concrètement à quel sujet se réfère la position en question, ni à quelle période, donne une idée fausse de la cohérence comme quelque chose de fini, de définitivement achevé donné une fois pour toutes, au lieu de la voir en sa réalité comme un mouvement se poursuivant, en constante élaboration. Cela correspond plus à une vision bordiguiste pour qui le Programme et les principes révolutionnaires ont été révélés au prolétariat totalement achevés par Marx et Engels, un beau jour de ... 1848. La réalité est toute autre. Le prolétariat baigne dans un monde dominé par l'idéologie bourgeoise. C'est lentement, péniblement qu'il s'en dégage pour acquérir à travers l'expérience de sa lutte et sa réflexion la conscience de ses véritables intérêts historiques de classe. Ce qui est vrai pour la classe est également vrai pour l'organisation révolutionnaire qui traîne longtemps avec elle des idées et des positions venant de la classe ennemie et ne s'en débarrasse qu'au feu vivant de l'histoire. Les frontières de classe aussi bien dans la réalité (dont le temps est une des dimensions) que dans la conscience révolutionnaire ne sont pas fixes, mais se déplacent et se précisent. Ainsi les positions telles que l’anti-électoralisme, l'anti syndicalisme, le rejet des libérations nationales, aujourd'hui frontières de classe, pouvaient encore être en discussion et défendues par les bolcheviks, l'I.C. à son début, sans qu'on puisse dire que cela "ôtait à ces organisations tout caractère prolétarien". Avec une telle démarche nous ne rejetons pas seulement les positions erronées en lés dépassant, nous rejetons aussi tout le mouvement et ses organisations de l'histoire qui devient alors un vide.
En un mot, il faut se garder de présenter le programme communiste comme un bloc achevé, un schéma, un absolu. Il faut le considérer comme un niveau atteint par la conscience de classe dans le temps et irréversible.
II. A propos de la scission de l’Union Ouvrière et de Combat Communiste, il ne suffit pas d'énoncer une vérité générale, mais il faut encore tenir compte de son contexte, et circonstances concrètes du moment et des conditions dans lesquelles cette scission a lieu, pour dégager toute sa signification réelle. Dire que la continuité organique provenant d'un corps politique tel que le trotskysme n'offre pas la condition de sa transformation en une organisation révolutionnaire est certes vrai mais n'explique pas encore sa signification politique. Du trotskysme, sortent aussi bien des courants qui vont vers le P.S.U. et le P.S. Cela a une toute autre signification politique qu'un courant comme "Union Ouvrière". Il ne faut pas les mettre dans le même sac. La faiblesse de l'article est de ne pas montrer ce qui constitue l'aspect positif d'une telle scission qui s'oriente vers des positions de classe. Cela ne veut nullement dire qu'il faut s'emballer et s'exalter comme l'ont fait le P.I.C. ou Alarma pour qui tout est possible, même la constitution de l'organisation révolutionnaire à partir du trotskysme.
Il importe d'éviter de tomber dans une unilatéralité de "tout est possible" des uns à "rien n'est possible" des autres. Le trotskysme se présente comme une des dernières barrières politiques de la position bourgeoise. Tout en étant aussi néfaste pour le développement de la conscience de classe que les autres partis du capital, il ne reste pas moins qu'il constitua un milieu bien plus vulnérable et qui se traduit dans les moments de crise par un ébranlement plus profond de ses militant. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'écrit Alarma à propos de cette scission et qui consiste dans le fait que depuis la sortie du groupe de Munis et de Socialisme ou Barbarie du trotskysme, c'est-à-dire depuis les premières années de l'après-guerre, c'est la première fois qu'une partie significative quitte les rangs du trotskysme à la recherche de positions de classe. Cela doit être souligné, compris et expliqué en relation avec le développement de la crise du capital et la montée de la lutte du prolétariat. C'est cette signification positive de la scission que l'article n'a pas suffisamment mis en évidence, trop préoccupé à marquer les limites et l'impasse organisationnelles.
Ainsi l'article et surtout son titre donnent la fâcheuse impression d’une condamnation en bloc et à priori au lieu de montrer le mouvement que constitue cette scission, avec ses ambiguïtés et ses limites. Et en cela il manque son but. S'il est d'insister sur le fait qu'un groupe issu d'une telle scission ne peut pas constituer un pôle pour une nouvelle organisation révolutionnaire, il n'est pas vrai qu'il n'est qu'un avorton incapable d'aucune évolution. II est incontestable que nous assistons à une évolution politique vers des positions de classe mais cette évolution est forcément limitée car sa continuation met nécessairement en question le cadre organique, l'existence organisationnelle même de ce groupe. Il est inévitable qu'après cinquante ans de réaction, d'absence de pôle solide de reconstitution du parti de classe, de tels groupes qui rompent avec la contre-révolution tendent dans un premier temps à se maintenir dans leur cadre organique originel. C'est là indiscutablement un danger, une entrave sérieuse à leur évolution qui se heurtera inévitablement à la limite infranchissable de l'organisation. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la formulation "nous ne pouvons souhaiter, pour leur bien, qu'une chose : que leurs nouvelles organisations meurent" qui concluait l'article "Deux avortons de la gauche du capital".
Leur dissolution organique est certes une mesure nécessaire mais n'est pas non plus une garantie absolue. La reconstitution d'une fraction ex-L.O. au sein de R.l. par des éléments qui avaient pourtant adhéré individuellement, en est la preuve.
Notre tâche n'est ni de flatter, ni de condamner mais de soumettre à une critique sévère toutes les incompréhensions pour aider ces groupes qui apparaissent à surmonter les entraves que constitue leur propre passé, les aider à s'intégrer dans le processus de regroupement révolutionnaire. Tel est et doit rester le souci qui guide notre attitude critique face à ces groupes.
Juan M.
[1] Il n'est peut-être pas inutile de mentionner l'article "Salut à Union Ouvrière" paru dans Alarma (Organe du groupe F.O.R. N°28) à l'occasion de la scission de ce groupe avec L.O.. Pas un instant, Alarma ne se pose la question de la possibilité du surgissement organique de courants authentiquement révolutionnaires au sein du trotskysme, et pour cause. Lui-même, se réclamant de la tendance Munis, en provient. Cette tendance, qui a rompu avec la IVème Internationale trotskyste au cours de la IIème Guerre Mondiale sur la question de la défense de l'U.R.S.S. n'a jamais su rompre totalement avec le cordon ombilical politique qui l'attache à ses origines trotskystes. Tout comme l’anguille, revenant aux lieux originels de sa naissance, Alarma a les yeux braqués sur sa terre d'origine : les organisations trotskystes d'où il continue à espérer que surgira un beau jour l'organisation révolutionnaire en dépit du fait que depuis plus de quarante années d'existence du trotskysme tous les groupes qui s'en sont séparés à un moment ou à un autre de Shachtman à L.O., de News and Letters à Socialisme ou Barbarie, sont allés se perdre dans le marais gauchiste, sinon pire. Sans aucune explication sur la signification de cette nouvelle scission, sans un mot de critique des positions confuses affichées par ce nouveau groupe (U.O.), Alarma se contente d'un panégyrique affirmant sans craindre le ridicule que "la présence d'Union Ouvrière au sein du prolétariat promet se révéler le fait organique le plus positif arrivé en France pour le moins depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui" (Lire "depuis la rupture de Munis et ses amis de la IVème trotskyste"). Rien que ça ! Et les amis de Munis de nous certifier que "la constitution d'Union Ouvrière marquera une nouvelle époque dans la régénération du mouvement révolutionnaire en France". Décidément le confusionnisme se porte bien.
Courants politiques:
- Gauchisme [59]
Revolution Internationale N°15 - mai
- 24 lectures
Rubrique:
A PROPOS DE LA BROCHURE : "violence et solidarité révolutionnaire"
- 35 lectures
A l'heure où la crise sape les fondements du capitalisme et où le prolétariat se prépare à l'affrontement décisif avec le capital mondial, il se trouve encore des "théoriciens" d'on ne sait quel "mouvement communiste", mais au fond anarchistes, qui se font les défenseurs subtils, mais bien entendu "critiques", de la propagande par le fait habilement qualifiée pour la circonstance d'action "subversive" de "prolétaires". Ces descendants honteux d'un anarchisme qui n'ose plus dire son nom depuis sa participation au gouvernement républicain qui écrasa les ouvriers espagnols à Barcelone en mai 37, ne se nomment plus anarchistes mais "communistes de mouvement". Tout comme leurs ancêtres, à l'action mondiale de la classe ils substituent celle de minorités ou d'individus élus.
Jean Barrot est l'un de ces théoriciens de la "subversion". Sortant de l'anonymat de feu le "Mouvement communiste", sous le couvert duquel se manifestait son activité d'auteur "subversif", il vient de publier récemment en son nom propre une brochure[1] intitulée "Violence et solidarité révolutionnaires : le procès des communistes de Barcelone".
Revenant sur l'attitude du "M.C." lors de l'affaire Puig Antig, cette brochure justifie tout en la critiquant la création d'un "comité de soutien" aux emprisonnés avec des libéraux et des syndicalistes, justifie aussi, au nom d'une prétendue "spécificité espagnole" (p.14), l'action des éléments du MIL, et condamne au passage comme sectaire la position prise par R.I. lors de ces évènements.
Rappelons brièvement l'affaire. Les militants du M.I.L. (Mouvement ibérique de libération !) sont des éléments qui ont rompu avec le gauchisme ou le nationalisme - les deux ne faisant d'ailleurs qu'un. A la faveur des luttes ouvrières de 1970, telle la grève de Harry Walker à Barcelone, il s'est dégagé au sein des Commissions ouvrières, où militaient les ouvriers combatifs et des étudiants "radicaux", des éléments qui ont fini par remettre en cause les syndicats, même s'ils prennent l'aspect de commissions ouvrières. Influencés, disent-ils, par les textes des gauches communistes italienne et allemande, ils devaient adopter un certain nombre de positions révolutionnaires : définition du capital comme système du travail salarié dominant les 5 continents et donc les pays dits "socialistes"; dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des partis staliniens et gauchistes. Mais sortant de la bourgeoisie à travers ses organisations national-gauchistes et fortement influencés par toutes les idées du style "M.C.", condamnant l'organisation des révolutionnaires comme "rackett", ils devaient non pas œuvrer à l'organisation de la classe en militant dans ses organes de lutte (comités d'action, comités de grève, etc.); mais aussitôt rejeter toute forme de militantisme conçu comme aliénant ou "rackettiste". La logique de leurs positions devait les amener à s'auto-dissoudre au cours d'un "congrès d'auto-dissolution" (!) en août 73, et à se transformer en "groupes autonomes de combat" préconisant "le terrorisme et le sabotage comme des armes actuellement utilisables par tout révolutionnaire". En novembre 73, alors que Puig Antig et ses camarades venaient d'être arrêtés à la suite d'une "expropriation", un "collectif des prisonniers politiques anti-autoritaires" devait définir l'action de ces groupes ou individus : ...Le MIL est une organisation révolutionnaire qui impulse la lutte de classe mettant au service de l'émancipation des travailleurs une série de mesures radicales de combat ; Le MIL attaque la propriété privée, expropriant des mains des exploiteurs le capital accumulé dans les banques (véritable expression symbolique et réelle de la domination capitaliste). Ces fonds "récupérés par le HIL des mains des exploiteurs permettaient le financement d'une agitation armée anticapitaliste et permettaient aussi de doter de moyens de combat radicaux les travailleurs en lutte en appuyant des grèves, réalisant des sabotages, en fournissant des moyens de propagande et d'agitation théorique, en minant à la racine les bases mêmes de la structure sociale exploitrice…" (cf. brochure des "Editions mai 37").
C'est ce que le MIL appelait le "passage à l'histoire" et l'"abandon de la préhistoire de la lutte de classe". En fait, le MIL abandonnait la lutte de classe et revenait à la préhistoire de la lutte de classe, celle de l'anarchisme, pour finir par avoir une activité de racket, que Puig Antig devait malheureusement payer de sa vie.
En fait, ce qui caractérise tous les groupes venant du gauchisme, c'est un anti-"léninisme" viscéral qui les amène à rejeter toute forme d'activité organisée et bientôt tout militantisme. Mais croyant rejeter le "léninisme", ils en reprennent en fait l'idée de base : la classe ouvrière n'est pas spontanément révolutionnaire et ne peut être que trade-unioniste ; incapable d'acquérir une conscience spontanée 1e ses intérêts historiques, il faut la médiation du parti pour réaliser le programme communiste. Le M.I.L. à la différence des "léninistes" substitue à la classe non pas le parti, mais l'action terroriste, se concevant co1nme une organisation "impulsant la lutte de classe". Incapable de s'insérer dans le combat du prolétariat contre 1e capital, il s'attaque non pas à celui-ci mais à ses "représentations symboliques (les banques)".
La condamnation dans le numéro 6 de R.I de telles conceptions, étrangères aux révolutionnaires, nous a attiré les foudres de Barrot et de son sous-fifre "Le fléau social" (ex-gauchistes du F.H.A.R.). Barrot a voulu voir dans notre critique du MIL et du "Mouvement Communiste" l'expression d'un groupement se livrant à un sectarisme forcené pour faire valoir sa marchandise organisationnelle : "RI a vu également dans cette histoire une nouvelle phase dans sa délimitation forcenée par rapport aux groupes voisins supposés concurrents (GLAT, PCI, Invariance) et maintenant le "MC"."
Ainsi, au lieu de critiquer sérieusement nos positions, Barrot ne trouve que des raisons d'ordre psychologique : notre égocentrisme, un maladif besoin de sauvegarder notre "boutique". Regrettant amèrement le fait que "jamais RI ne pourrait collaborer même de loin avec un groupe aux positions divergentes des siennes" Barrot trouve à cela une lumineuse explication : RI est (suprême injure!) un groupe "politique" et en tant que tel "chaque groupe politique dissimule ses faiblesses en étalant celles (réelles ou inventées) des autres". Pour RI, selon Barrot, "1ennemi devient celui qui apparait le plus proche et en même temps différent". Et Barrot de conclure : "C'est encore être victime du capital que s'attarder sur les faiblesses des autres".
Cette méchanceté de RI vis-à-vis des faibles, est d'ailleurs confirmée par un des autres participants au "Comité Vérité" de Vidal-Naquet : le "Fléau social" qui dans ses explications se montre moins subtil que Barrot. Là aussi, on ne peut que trouver des raisons d'ordre psychologique. Si RI n'a pas participé à ce comité, il faut y voir une vengeance contre les militants du MIL : "RI qui se prend pour la crème (sic) du mouvement communiste a montré dans cette affaire que mis au pied du mur il se dégonflait comme une vieille baudruche qu'il est. Il ne suffit pas d'affirmer des théories, encore faut-il un minimum de pratique. Pour ces moralistes jésuites, la pratique du MIL n'est pas correcte : il fallait donc les punir, c'est-à-dire les laisser crever en les dénonçant; on a jamais vu une telle hypocrisie, ces zèbres (sic) vont jusqu'à reprocher aux copains du MIL de n'avoir rompu que très récemment avec le gauchisme" (n° 5-6).
Voyant dans notre refus de nous associer au "Comité" l'élitisme d'intellectuels sans pratique le "Fléau social" se lance dans une diatribe anti-R.I. dont le ridicule le dispute à l'odieux : "A force de se défier de tout opportunisme, on sombre dans l'élitisme et l'inaction totale. Une théorie sans pratique, ça n’est qu'une vue de l'esprit ;·seulement le garrot lui ça n'est pas une vue de l’esprit ;·c’est une pratique concrète et à moins d'avoir des âmes tordues de martyrs, le jour où il risque de se serrer autour de vos cous racés d'intellectuels (sic) vous ferez moins la fine bouche, à moins que ce soit vous qui le serriez".
Une telle unanimité anti-RI n'est pas surprenante. Des opportunistes pris en flagrant délit d'opportunisme n’aiment pas qu'on s'attarde sur ce qu'ils appellent pudiquement leurs "faiblesses". Pour "noyer 1e poisson, ils ont alors recours soit au psychologisme du café du commerce, soit purement et simplement à 1’injure, reprenant les mêmes arguments que les staliniens : le "réalisme" qu'on oppose à la théorie juste bonne pour les intellectuels.
L'objet de cet article est de montrer que ceux qui remplacent l'analyse politique, les principes politiques révolutionnaires de la classe (n'en déplaise aux situationnistes attardés de l'ex-MC qui sont allergiques au mot politique) sont amenés par leur campagne frontiste dite de "solidarité" à se placer sur le terrain de la bourgeoisie. Pire, que toute apologie, même voilée, du terrorisme ne fait que pousser les éléments les moins clairs du prolétariat vers le massacre. Ainsi, que tout groupe qui aujourd'hui préconise des "comités" en alliance avec les organisations bourgeoises, ou le terrorisme ne font que se rendre complices consciemment ou inconsciemment de la bourgeoisie et contribuent ainsi à serrer le garrot autour du cou du prolétariat.
I - LA QUESTION DE LA SOLIDARITE
Avant de voir comment la "solidarité" n'a servi à Barrot qu'à se livrer à des opérations frontistes, il est nécessaire de rappeler en quoi consiste la solidarité prolétarienne, et quel soutien peuvent apporter les révolutionnaires aux victimes de la répression capitaliste, et dans quelles conditions.
- Solidarité prolétarienne et solidarité révolutionnaire
La solidarité, dans le sens prolétarien, ne peut être que le fait de la classe tout entière luttant contre la bourgeoisie, aussi bien dans sa résistance quotidienne au capital que dans la lutte proprement révolutionnaire. Elle n'est pas seulement la réaction de défense de la classe contre la répression qui frappe ses membres, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire du mouvement ouvrier (cas de la révolution russe de 1905, après le dimanche sanglant) Plus généralement, elle est la manifestation exacerbée de la lutte de classe. Le prolétariat qui passe à l'offensive par la grève, l'insurrection, perd son caractère atomisé pour former un tout homogène : la classe révolutionnaire. La solidarité qui soude les rangs ouvriers et pousse la classe plus en avant dans le processus révolutionnaire est l'expression vivante, concrète du développement de la maturité et de la conscience révolutionnaire en son sein.
Les formes de solidarité n'ont pas toujours été identiques depuis la naissance du mouvement ouvrier. La classe ouvrière dans ses luttes de résistance au capital, que ce soit sous la forme de grèves économiques ou sur le terrain de la lutte politique. Contre la bourgeoisie, dès ses origines le prolétariat constituait des caisses de secours ou d'aide mutuelle. La constitution de ces caisses était toujours liée à la lutte immédiate, apportant l'aide matérielle nécessaire aux ouvriers victimes des lock-out. Avec le développement du mouvement ouvrier organisé dans la seconde moitié du XIXe siècle, elles deviennent permanentes et sont un des organes du syndicat qui se charge d'assurer l'aide matérielle et morale aux ouvriers en lutte ou victimes du capital.
La première guerre impérialiste qui marque le passage définitif des syndicats dans le camp du capital, va changer les anciennes formes de solidarité. Au cours des événements révolutionnaires en Europe, ce seront les ouvriers eux-mêmes qui spontanément organiseront des collectes et se chargeront de secourir les victimes de la répression capitaliste. Ainsi en Allemagne en 1920-21. Comme expression de la classe en lutte, les organisations politiques du prolétariat, tels le KAPO ct les Unions, apportaient tout leur soutien à cette solidarité de classe.
Par contre, c'est en opposition à la solidarité spontanée que l'on vit apparaitre des organisations du type Secours Rouge. La naissance du Secours Rouge en pleine débâcle révolutionnaire, après 23, fut moins motivée par un réflexe de défense prolétarienne que par le souci de l'URSS passée à la contre-révolution de se gagner des sympathies dans la classe ouvrière par des gestes spectaculaires lors de la répression qui suivit la défaite de la révolution. Alors que les syndicats abandonnaient tout secours aux victimes ouvrières, le Secours Rouge prit la relève en monnayant son aide contre un soutien inconditionnel à la politique stalinienne. Rapidement, il devint un instrument de chantage dont pâtirent particulièrement les ouvriers exilés en désaccord avec la politique des PC et qui se trouvaient sans défense contre les mesures d'expulsion.
Le feu "Secours Rouge" que les gauchistes essayèrent de créer il y a quelques années n'avait lui pas la prétention de défendre et soutenir les combattants prolétariens, puisqu'il défendait essentiellement des nationalistes, comme lors du procès de Burgos, ou des terroristes du style guévariste ou maoïste, bref les éléments des diverses fractions "radicales" de la bourgeoisie. Il devait d'ailleurs pousser plus loin encore l'aspect de racket stalinien : à côté du célèbre massacreur de Sétif en 44, Charles Tillon, l'ex-ministre de l'Aviation, on voyait s'agiter toutes sortes de groupes gauchistes cherchant à recruter avec du "sang à la une " de leurs journaux.
Tel est le triste bilan des Secours Rouge.
L'apparition au grand jour de tels organismes est autant néfaste qu'inutile pour la classe dans son combat. Alors que la solidarité prolétarienne est organiquement liée à ce combat, est l'expression des masses ouvrières plongées dans le feu de l'action, la prétendue "solidarité" organisée par les secours rouge ou comité de défense de tout acabit est une entrave pour l'organisation et la conscience de la classe ouvrière. Elle laisse croire au prolétaire que sa propre organisation, née de sa lutte, est inutile ; que des personnes de "bonne volonté", de bons samaritains, peuvent remplacer cette lutte. Elle est à l'opposé du mot d'ordre révolutionnaire de la Première Internationale : "L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes". Ce n’est pas un hasard, si pendant les luttes ouvrières, on voit apparaître aujourd'hui les groupes gauchistes sous la forme de "comités de soutien" ou de "popularisation" des luttes ; ils ne font que remplir leur rôle de dévoyeurs et de contre-révolutionnaires opposés à cette autoémancipation du prolétariat.
En période de recul, profond ou momentané, les dévoyeurs ne peuvent que se transformer en de purs et simples charognards, lorsque des individus ouvriers tombent sous les coups de la répression victimes de leur propre démoralisation.
Dans une telle période, les révolutionnaires ne peuvent que voir leur action limitée comme celle de leur classe. Ni les comités Sacco-Vanzetti, ni les manifestations de centaines de milliers d'ouvriers à travers le monde n'ont pu sauver les militants anarchistes de la chaise électrique. De même la création d'un comité Van der Lubbe - du nom du jeune prolétaire hollandais, qui démoralisé par le recul profond de sa classe incendia le Reichstag en 1933 - fut autant inutile que nuisible : elle ne pouvait que faire croire aux rares éléments ouvriers révolutionnaires de l'époque qu'un quelconque comité pouvait remplacer l'action de leur classe. De tels comités, aussi révolutionnaires soient leurs éléments, ne peuvent que quitter le terrain de la lutte de classe. Leur action ne peut en aucun cas empêcher les décisions prises d'avance par la bourgeoisie : la mort pour Van der Lubbe, pour terroriser le prolétariat allemand, la mort pour Puig Antig, à la fois pour mettre au pas les tendances démocratiques de la bourgeoisie espagnole et servir de coup de semonce aux ouvriers. Quoi qu'on fasse, les dés sont pipés d'avance. Et donc, le soi-disant réalisme qui consiste à créer ou à participer à des comités de "soutien" ou "vérité" ne peut être qu'un alibi, comme nous le verrons plus bas.
Quelle peut être alors, dans ces conditions, la solidarité des révolutionnaires? Dans quelles conditions peut-elle se manifester ?
Le fait d'être en proie à la répression ne peut en aucun cas être une condition suffisante déterminant l'aide matérielle des révolutionnaires. Ce qui est à la base de cette aide ce sont et ce seront toujours des critères politiques et non une morale charitable ou humanitaire qui ferait du secours apporté "à des vies humaines en danger" un impératif catégorique. Les révolutionnaires laissent une telle morale à la bourgeoisie et qui n'est rien d'autre que l'idéologie de sa propre domination de classe. Refusant de céder au chantage des sentiments de quelque nature qu’il soit, leur aide dépend rigoureusement au critère d'appartenance ou non au camp prolétarien. Ainsi, dans le passé (comme aujourd'hui), les révolutionnaires n'avaient -et n'auront- aucune aide à apporter aux libéraux sociaux-démocrates, staliniens, à tous les éléments de la gauche du capital, victimes de la démocratie ou du fascisme. Dans la lutte que se livrent d'une manière sanguinaire les fractions de la bourgeoisie depuis que le système capitaliste est entré dans sa phase de déclin, tels des gangs rivaux se disputant l’honneur de gérer les affaires du capital, les révolutionnaires n’ont pas à prendre position pour un camp ou un autre : ils ne peuvent qu'éviter les coups et faire en sorte qu'ils ne retombent pas sur leur classe. En aucun cas, il ne peut donc être question d’apporter une aide quelconque aux éléments de la contre -révolution. La meilleure "aide" qu'on puisse apporter à ces éléments embrigadés dans les organisations du capital, c'est de combattre sans pitié les idées qu'ils véhiculent.
Par contre, il est évident que les révolutionnaires font tout ce qu'ils peuvent pour aider, ou mieux soutenir matériellement et politiquement, leurs camarades en proie à la répression bourgeoise. De même qu'à travers ses éléments soumis à la répression la classe ne peut que se reconnaître tout entière de même à travers le soutien apporté à leurs camarades les révolutionnaires favorisent le combat collectif de la classe contre la bourgeoisie. L'intérêt de la classe ne peut qu'être toujours au-dessus de la vie de chaque individu, et à travers l'aide apportée à des individus révolutionnaires, c'est toujours l'intérêt général de la classe qui doit prédominer.
Quant aux formes concrètes que prend ce soutien, elles sont avant tout une question de circonstances et non de principe. Dans le n° 6 de RI, l'article de Hembé donnait des exemples de ce soutien matériel : soudoyer un juge, acheter un journaliste, etc. Là où il ne s'agit que d'exemples, pris entre mille, des gens comme Barrot n'ont voulu y voir que des recettes, d'ailleurs, parfaitement irréalistes :
- "Il ne fut pas possible de 'soudoyer' un juge, ni d''acheter un journaliste, comme le conseille RI, dont chacun apprécie le réalisme. L'or du MC, n'y aurait pas suffi et les fonds secrets de RI restaient encore ignorés."
Barrot ne comprend absolument pas quel est le fond du problème : il ne s'agit pas de rechercher quelle forme de solidarité est la plus 'réaliste', mais de faire en sorte que cette aide apportée à des camarades n'amène aucune compromission, si faible soit-elle, avec des éléments de la bourgeoisie et donc avec la bourgeoisie.
C'est uniquement dans une période de recul, de non-réaction de la classe que les révolutionnaires peuvent être amenés à utiliser les formes de solidarité sur lesquelles ironise Barrot. Dans une telle période, la solidarité des révolutionnaires n'est rien d'autre que l'expression d'une minorité de révolutionnaires cherchant à secourir ou sauver des individus ou des minorités révolutionnaires. Elle n'est donc pas l'expression des masses prolétariennes en lutte. Dans ces conditions la solidarité des révolutionnaires ne peut avoir qu'un aspect limité. Si les révolutionnaires peuvent requérir l'aide d'un bourgeois, comme ils l'ont fait dans les années 30 en se servant d'un Spaak pour sortir Victor Serge de Russie, cette aide ne doit en aucun cas apparaître comme l'expression de l'organisation révolutionnaire : elle n'est pas publique. Pour les révolutionnaires, il est absolument impératif qu'aucune illusion, si petite soit-elle, ne pénètre dans la classe sur la nature de la démocratie bourgeoise et de ses organisations.
Répétons-le : la meilleure forme de solidarité ne vient pas des révolutionnaires, elle vient de la classe dans sa totalité. C'est elle seule qui peut ouvrir les prisons et retenir la main des bourreaux.
C'est la seule VRAIE solidarité. Si, en période de recul, les révolutionnaires font tout leur possible pour venir en aide à leurs camarades, ils sont parfaitement conscients que si la bourgeoisie décide de frapper ils ne pourront pas grand-chose, et dans certains cas toute publicité intempestive donnée à des "affaires" peut amener la classe capitaliste à frapper le plus fort possible, pour faire un exemple.
Dans certains cas, il vaut mieux se taire. C'est ce que n'a malheureusement pas fait Barrot.
- Quand solidarité = frontisme
"Des fonds secrets" du "Mouvement communiste" devait sortir un comité "Vérité" avec Vidal-Naquet, et l'or du MC ne cachait qu'en fait le vil métal du frontisme.
La position de Barrot, pour défendre le "comité", est un chef-d’œuvre de jésuitisme. D'abord Barrot nous prévient : cette affaire du MIL "est par nature délicate", et ainsi "il est trop facile de se lancer dans une dénonciation ou une justification". Nous sommes donc avertis : M. Barrot a l'épiderme chatouilleux à la critique, il s'agit de rester entre gens du monde et garder un ton mesuré. Ainsi, au lieu de se livrer à une critique impitoyable des éléments du MIL en leur montrant que leur confusion ne peut que les mener à leur perte ou à la contre-révolution il préfère prendre une attitude professorale celle d'un Salomon du " mouvement communiste" :
- "A tout prendre, compte tenu de l'isolement, leur contusion n'est pas pire que celle des autres. Son danger n’est que plus visible (!)".
Plus loin, il déclare : "Il est donc exclu de juger des individus ou des groupes." Une telle attitude, irresponsable, n'est qu'une apologie pure et simple de la confusion. Refuser de critiquer les positions politiques des groupes, tel le MIL, enlève aux révolutionnaires tout critère de jugement pour déterminer si telle ou telle organisation appartient ou non au prolétariat. Abandonner le critère des frontières de classe, revient à affirmer que les positions du prolétariat et celles de la bourgeoisie sont équivalentes. Une telle position s'appelle OPPORTUNISME. Lénine remarquait justement que l'opportunisme se manifestait moins par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. En tant que tel, il ne peut être qu'une arme aux mains du capital. Le prolétariat, classe exploitée dominée par tout le poids des illusions répandues par l'idéologie bourgeoise, n'a que sa conscience pour affronter et détruire le capital. Seule une extrême clairvoyance sur la nature des forces sociales s'affrontant au travers d'organisations politiques permet au prolétariat de renforcer ses forces et son organisation face à tout l'appareil de la bourgeoisie. Le refus de la politique de la part de Barrot ne peut que renforcer le poids du capital sur le prolétariat qui reste alors désarmé. Dans ce sens-là, les idées de Barrot ne font qu'apporter une cartouche de plus dans l'arsenal du capital.
Il n'est donc pas surprenant que cet opportunisme ait conduit Barrot à des positions frontistes, beaucoup plus claires que tout son bavardage sur le "mouvement communiste". Avec la création du "comité" chaperonné par le libéral Vidal-Naquet et s'appuyant sur les organisations de gauche (tel le syndicat CGT des correcteurs), il a eu moins de problèmes de conscience : cela était sans doute moins "délicat".
Pourtant, Barrot jure ses grands dieux qu'il n'a pas fait de frontisme, car, dit-il, "le frontisme au contraire est un accord sur une plateforme politique ou de revendications, même minimale". D'ailleurs, ajoute-t-il, il ne s'agit que d'un "compromis" : "On contacta Vilal-Naquet, afin d'avoir accès aux moyens d'information nécessaires pour briser le silence. Ce compromis n'avait rien de plus compromettant que tous les autres compromis que les révolutionnaires sont· obligés de passer dans leur activité 'révolutionnaire' et dans le reste de leur vie (salariat) ". Apparemment, Barrot bredouille et passe à côté de la question. Le frontisme, tel qu'il le définit, est vidé de tout contenu de classe et ne devient qu'une simple catégorie morale. Si on suit à la lettre sa définition, le regroupement des révolutionnaires sur une même base programmatique serait du "frontisme"; l'élaboration de revendications communes par les ouvriers en lutte serait elle aussi du "frontisme"! Barrot sait très bien ce qu'il ne dit pas. Le frontisme, qu'on le camoufle ou non derrière les mots de "compromis" ou "d'accord" a toujours été la caution consciente ou inconsciente donnée à des organisations bourgeoises. Si le prolétariat et les révolutionnaires peuvent à certains moments céder du terrain, signer des armistices (comme ce fut le cas à Brest-Litovsk), ils ne se compromettent jamais avec la bourgeoisie, comme le sous-entend Barrot. Jamais les révolutionnaires ne marchandent leurs principes! Alors que les gauchistes, et Barrot qui s'en fait ici le porte-parole, au nom des "compromis" travaillent à répandre des illusions dans le prolétariat, se "compromettent" jusqu'au cou avec la bourgeoisie, les révolutionnaires agissent constamment de manière à ce qu'aucune illusion sur la nature du capital et de ses fractions politiques ne s'infiltre au sein même du prolétariat.
Il est vrai que Barrot juge par trop indécent de parler de prolétariat, d'ouvriers : "ce sont des mots trop "compromettants". Affirmer que les révolutionnaires (Barrot ne parle pas de la classe ouvrière) font un "compromis" en vendant leur force de travail ne fait que manifester un mépris sans limite des ouvriers. Ce sont les petits-bourgeois les plus réactionnaires, les boutiquiers qui prétendent que l'on peut choisir dans la société d'être ouvrier ou "indépendant", que les ouvriers sont donc responsables de leur propre sort. Telle est aussi la vision des intellectuels petits-bourgeois (Barrot préfère les appeler "prolétaires" et y voit le vrai sujets de son mouvement communiste") qui tout en reconnaissant 1a réalité de l'exploitation capitaliste la nient dans les faits en voyant des possibilités de choix individuel au sein du système. Quand Barrot et ses disciples voient des individus là il y a une classe exploitée comme classe par le capital, ils ne font que rejeter la révolution prolétarienne, celle de toute la classe soumise au·salariat.
S'étant donc compromis, sans faire de frontisme, Barrot donne l'ultime raison de la création du comité :
- "il été nécessaire d'être à l'initiative du comité", parce que : "le premier objectif était d’entamer le mensonge de l’Etat espagnol". Et ajoute-t-il : L'arme de l'Etat est bien plus l'information (une connaissance coupée de toute action) que le mensonge pur et simple..." Autant d'explications contradictoires et embarrassées. En fait toute cette casuistique sur le mensonge et la vérité, toute cette mauvaise philosophie le sur la "connaissance" ne servent qu'à cacher le vrai sens de la création de ce comité.
D’ailleurs Barrot déclare lui-même : "Son emploi (du comité) s impose même s'il faut passer par l'intermédiaire d’individus non ‘révolutionnaires".
Ici, Barrot est pris en flagrant délit de mensonge : pour nier la réalité frontiste du comité, il ne parle qu'utilisation individuelle de ce qu'il appelle pudiquement des "non-révolutionnaires", alors que ce fameux comité est justement passé par l'intermédiaire non d'individus mais d'authentiques organisations bourgeoises.
Le "Fléau social", participant du comité, met moins de subtilité pour justifier ce frontisme, que non seulement il reconnaît mais dont il se glorifie.
"Sans faire de l'humanisme chrétien, il nous semble que la vie d'un garçon de 25 ans mérite d'être sauvée, et qu'il est logique de faire tout ce qu'on peut, et y compris la pute avec les organisations de gauche (nous soulignons, NDR) pour le sauver.
C'est pourquoi nous avons enjoint celles-ci de réagir en leur faisant une sorte de chantage. C'est putassier et hypocrite, mais merde, on n'a pas à prendre de gants avec ces salauds; on leur a demandé d'agir quitte à gueuler ensuite à la récupération, et pourquoi pas?" (Fléau social, N° 5-6).
Au moins ces messieurs ont le mérite de dire tout haut ce que Barrot pense tout bas. Cet écœurant chantage aux sentiments est digne des campagnes menées par la bourgeoisie pour endormir les ouvriers. Il ne peut à terme que mener tous ces "humanistes" dans les organisations de la bourgeoisie. Quand on commence à faire la "pute" avec la bourgeoisie -ct même si l'on joue les esprits forts en se servant de termes grossiers en guise d'exorcisme-, on la fait jusqu'au bout et on finit par en attraper toutes les maladies. Quant à l'argument-choc "la vie d'un garçon de 25 ans" il est tout ce qu'il y a de plus répugnant et de plus contre-révolutionnaire : c'est au nom des "copains" tués par "l'ennemi", que les officiers des 2 camps pendant les grandes boucheries impérialistes envoyaient les soldats se faire tuer au front. Un tel argument de gens qui se piquent d'être révolutionnaires n'est rien moins que "putassier et hypocrite".
Ce qu'il y a de commun chez Barrot et ses sous-fifres du "Fléau social" c'est le même refus d'admettre que les révolutionnaires et leur classe aient une activité autonome; il leur faut toujours trouver des intermédiaires, des soutiens, incapables qu'ils sont d'avoir une activité révolutionnaire autonome; ils font appel aux bons offices de bourgeois libéraux avant de faire la "pute" auprès des partis de gauche. C'est toute la politique du gauchisme, qui justifie toujours ce qu'il appelle des "compromis" par sa faiblesse. Pour eux, la solidarité n'est qu'un prétexte à frontisme. Incapables de se sentir éléments du prolétariat, ils ne peuvent concevoir leur activité que sous la pire forme de l'individualisme petit-bourgeois :
- "Au sens large, je suis solidaire de tous les opprimés, mais pas seulement du petit voleur pris sur le fait, aussi (sic) du salarié qui perd sa vie à la gagner ... Confronté à des individus ou groupes qui font la même chose que moi· je suis capable de les aider si nécessaire."
Le prolétariat n'a que faire du moi de M. Barrot, qui est vraiment tombé bien bas pour sortir de telles insanités.
Nous ne pouvons passer sous silence l'attitude du PIC à propos du MIL. Ces camarades qui sont incontestablement des révolutionnaires et avec qui nous avons déjà eu l'occasion de collaborer (tract sur le Portugal), ont voulu voir dans notre position du purisme, pire "la continuation de l'immobilisme le plus total, synonyme de démission" jugeant trop sévère notre critique du MIL. Contrairement à ce qu’i1 affirme "Jeune Taupe" n° 3, "la traduction de textes ultragauches" ne suffit pas à donner à une organisation une nature prolétarienne. Il est évident, comme le dit J.T., que "les communistes renoncent à leurs tâches, s’ils refusent la clarification avec d'autres groupes qui arrivent sur un terrain de classe."
Le malheur c'est que le MIL et bien d'autres groupes qui proviennent de la décomposition du gauchisme ne peuvent se situer sur un terrain de classe par leur conception de la classe comme amalgame d'individus et leur apologie des actes terroristes ou exemplaires; ce qui les amène finalement à déserter le terrain de la lutte de classe. Critiquer les groupes confusionnistes qui risquent (et ont déjà) d'entraîner à la mort ou pire dans le camp du capital les éléments confus qui émergent aujourd'hui après 50 ans de contre-révolution, ce n'est pas faire de l'"élitisme". C'est la seule attitude responsable de la part de révolutionnaires conscients : le seul soutien possible aux éléments du MIL c'est la plus impitoyable critique des idées qu'ils véhiculent. Ce que le PIC appelle de l'élitisme n'est rien d'autre que l'intransigeance des révolutionnaires qui loin de se laisser emporter par le courant, afin de devenir "populaires" luttent contre toute forme de confusion, surtout si elle est de bonne foi. Si être intransigeant sur les principes, c'est faire de l'"élitisme", alors nous sommes "élitistes". Les camarades du PIC qui s'affolent à n'importe quelle décomposition du mouvement gauchiste, comme en atteste leur citation élogieuse d'"Union ouvrière" dans le dernier JT, et qui se lancent dans de grandes entreprises du type;-"comité Portugal" (cf. notre critique dans n"l2) devraient prendre garde à ne pas céder eux aussi au prurit du frontisme. Leur anti-"élitisme" est bien proche de l'opportunisme d'un Barrot.
II - I.E TERRORISME CONTRE LE PROLETARIAT
Nous avons constamment vu en filigrane, à propos du problème de la solidarité, tel qu'il était envisagé par Barrot et consorts, apparaître une apologie plus ou moins voilée du terrorisme. .Si l'attitude de Barrot est particulièrement grave dans l'affaire du comité Vidal-Naquet, celle qui consiste soit à prôner soit à considérer d'un œil bienveillant -même si l'on se veut "critique"- le terrorisme est encore plus grave. C'est jouer à bon compte, en spectateur impavide du "mouvement communiste", avec la peau des autres, et surtout avec celle du prolétariat qui subit toujours sous forme de répression ou de massacre les retombées du terrorisme.
- Prolétariat et violence
Avant d'aborder plus particulièrement le problème du terrorisme et voir comment Barrot aborde la question et quelles sont les conséquences de "sa" position, il est nécessaire de rappeler les positions classiques du marxisme sur la violence et son utilisation par le prolétariat.
Le prolétariat, classe exploitée de la société capitaliste, ne disposant d'aucune assise économique et classe amenée à remplir une tâche positive : l'édification de la société communiste, société de la communauté humaine, n'emploie pas spontanément la violence dans le cours de la révolution. Le prolétariat dans l'élan de sa propre émancipation et dans l'euphorie de la prise du pouvoir révolutionnaire ne fait pas immédiatement usage de la violence contre l'ancienne classe déchue. Au contraire, toutes les révolutions prolétariennes se caractérisent par l'incroyable mansuétude, dénuée de tout sentiment de vengeance de la part du prolétariat. Comme le remarquait Trotski, à l'époque de la révolution russe, dans "Terrorisme et communisme", où au milieu d'une apologie du capitalisme d'Etat brillent encore quelques éclairs révolutionnaires :
- "Une coutume très répandue consiste à montrer les révolutionnaires, bourgeois ou socialistes, comme des individus assoiffés de sang, de pillage, et de meurtre. Il serait au contraire facile et nécessaire d'écrire un chapitre liminaire à insérer dans chaque histoire d'une révolution pour souligner la générosité, la mansuétude des révolutionnaires. Les hommes d'une classe opprimée qui vient de monter au pouvoir ne sont pas dominés par l'idée de vengeance; tout à la joie du triomphe, de se sentir libérés des longues servitudes, ils n'aspirent qu'à réaliser l'idéal pour lequel ils ont combattu, à construire la cité nouvelle au cours de leur lutte."
Néanmoins, la résistance de l'ancienne classe exploitrice à la révolution et la terreur dont elle use contre le prolétariat révolutionnaire, font de la violence une nécessité impérieuse pour le prolétariat pour la survie de la révolution. L'exemple russe, où les ouvriers relâchent les généraux tsaristes contre leur promesse de ne pas travailler contre la révolution doit être médité. Dans la révolution prolétarienne future il est fondamental de briser sans pitié l'échine de la bourgeoisie, dès les premiers jours de la révolution, pour éviter de nouveaux massacres de prolétaires.
Une telle position, assurément fera grincer des dents les utopistes qui croient que la révolution prolétarienne est un processus simple qui s'impose spontanément dans la société , ou les ennemis jurés de la révolution qui se réfugient derrière des phrases creuses humanitaires.
Déjà au siècle dernier, en opposition aux idéalistes et aux pacifistes qui niaient le rôle de la violence dans l'histoire, Engels polémiquant contre un Dühring affirmait clairement que la violence était l'expression des luttes de classes au sein de la société. La division irréconciliable de la société en classes antagonistes et la dictature de la classe dominante sur l'ensemble du corps social reposent depuis la fin du communisme primitif sur l'utilisation de la violence. Sous une double forme : comme force de conservation sociale employée au service de la classe devenue une entrave à l'essor des nouvelles forces productives pour maintenir son système d'exploitation; comme force motrice de l'histoire entre les mains de la classe révolutionnaire qui se développe au sein même de la société. C'est ainsi que la classe des propriétaires d'esclaves dans la Rome antique devait utiliser la violence pour annihiler les armées de Spartacus. Au contraire, la violence aux mains de la bourgeoisie, classe révolutionnaire montante, devait lui permettre de balayer le féodalisme : tel est le cas de la Révolution anglaise au XVII° siècle avec Cromwell, tel est le cas de la Révolution française.
Ainsi, contrairement aux assertions des bordiguistes, il n'y a pas de violence révolutionnaire par elle-même. La violence comme n'importe quelle manifestation de l'antagonisme social a un sens, un contenu de classe. Les bordiguistes qui font de la violence ("Terreur rouge") l'essence de la révolution, surtout quand elle est "plébéienne", pour reprendre une de leur expression favorite, ne font que dissimuler l'essence de la révolution. La violence n'est pour le prolétariat qu'un instrument, et rien de plus, sur le chemin qui le mène au communisme.
- Sur la question de la violence, les marxistes sont d'ailleurs loin d'avoir toujours été clairs. Longtemps obnubilés par l'exemple de la Révolution française, ils donnaient en exemple la violence plébéienne des masses sans-culottes, violence aveugle étrangère à une classe consciente Ainsi, Marx écrivait : "Bien loin de s'opposer aux prétendus excès, aux exemples de vengeance populaire contre des individus haïs ou contre des édifices publics auxquels ne se rattachent que des souvenirs odieux, il convient non seulement de tolérer ces exemples mais encore d'en prendre soi-même la direction en main." (Adresse du Conseil central de la Ligue, 1850)
Une telle vision devait d'ailleurs être largement partagée par les bolcheviks, en réaction il est vrai contre l'écœurant pacifisme de la social-démocratie. Un Miasnikov, qui appartenait à l'aile gauche du parti, devait par exemple prendre la tête d'un groupe d'ouvriers pour exécuter le grand-duc Michael et son secrétaire, donnant ainsi un "exemple de vengeance". L'exemple de "la glorieuse grande Révolution française", comme on se plaisait à l'appeler, explique l'apologie de la "Terreur rouge", dont Trotski se fait le défenseur dans le pamphlet déjà cité. Une telle vision de la révolution, considérée sous l'angle de la terreur, est indiscutablement liée aux conceptions jacobines et substitutionnistes très répandues dans l'ensemble du mouvement révolutionnaire de l'époque. L'instauration d'équipes de spécialistes de la terreur (les Tcheka) devait vite se retourner contre la classe avec le recul puis la défaite de la révolution.
Dans la révolution prolétarienne, la violence ne peut qu'être entièrement aux mains du prolétariat qui en a le monopole. Elle ne peut être aux mains de spécialistes ou d'individus, fussent-ils ouvriers, se substituant à l'action de l'ensemble de la classe. La Révolution russe a montré que la violence ne peut être utilisée que par les organismes de la classe : les soviets ou conseils d'usine; elle ne peut à aucun prix être remise à un Etat qui par sa nature ambiguë d’expression des intérêts divergents de la société de classe ne peut que retourner la violence contre le prolétariat.
Ce qui constitue l'essence de la révolution prolétarienne, c'est l'action collective de la classe révolutionnaire consciente, qui a le contrôle de chacun de ses actes. Ce qu'il y a de commun à ceux qui se font les apologues de la terreur en tant que telle, qu'elle soit "rouge" ou individuelle, c'est leur refus de considérer la classe comme adulte, capable de s'émanciper par ses propres forces. Il est donc faux de prétendre comme Trotski ("Terrorisme et communisme") que : "L'intimidation est le plus puissant moyen d'action politique tant dans la sphère internationale qu'à l'intérieur." C'est confondre les buts de la classe, dont la réalisation dépend de son organisation et de sa conscience, avec ce qui n’est qu'un moyen, un tout petit moyen sur la voie du communisme.
Quant à ce qu'on appelle aujourd'hui le "terrorisme", le résultat est le même que pour la "terreur rouge"; la seule différence étant son caractère minoritaire et individuel. Alors que l'exaltation de la terreur dite "rouge" fut une erreur profonde des bolcheviks, le terrorisme quant à lui a toujours été une politique de diverses fractions de la bourgeoisie.
- Le terrorisme : une politique de la bourgeoisie
L'exemple le plus fameux de terrorisme est celui du populisme russe au 19° siècle. Comme l'écrivait Rosa Luxemburg, en 1905, à propos des attentats terroristes :
- "La terreur comme système, comme méthode de lutte pratiquée par quelques individus du centre révolutionnaire contre d'autres individus responsables du régime absolutiste fut, de par sa nature, conçu en opposition à la lutte de masse de la classe ouvrière."
Dès l'origine, en effet, les organisations terroristes populistes naquirent des tentatives désespérées de la bourgeoisie de renverser l'ancien ordre féodal par la violence individuelle, à une époque où les révolutions bourgeoises devenaient impossibles. C'est le tsar autocrate qui devait mettre en œuvre l'abolition du servage et le début de l'industrialisation de la Russie. La bourgeoisie trop faible devait essayer au début par des attentats dirigés contre le tsar et son personnel aristocratique de s'emparer du pouvoir politique Cette tentative désespérée d'une bourgeoisie trop faible pour prendre en mains le développement du capital russe était condamnée à l'échec : les membres de la "Volonté du peuple" de Jeliabov furent vite décimés par la police tsariste. Bientôt avec la naissance d'une classe ouvrière russe, ce "centre révolutionnaire" devait disparaître et se rallier au tsarisme dans les tâches de gestion du capital, ou bien pour ses éléments sincèrement révolutionnaires à la cause du prolétariat : tel est le cas de Plekhanov qui abandonna le populisme pour le marxisme- Par la suite, les attentats des socialistes-révolutionnaires qui prennent le relai devaient s'inscrire comme manifestation de la décomposition de la petite-bourgeoisie en opposition à l'action prolétarienne pour finir par être l'expression de la terreur blanche sous la Révolution russe.
Quant aux attentats anarchistes tant en France au 19° siècle (Ravachol, bande à Bonnot, etc.) qu'en Espagne au début de ce siècle, ils manifestent autant le poids d'éléments fraîchement prolétarisés au sein d'un tout jeune mouvement ouvrier que l'emprise croissante, du réformisme et la réaction petite-bourgeoise contre ce dernier sous une forme désespérée et impuissante.
Si au 19° siècle, le terrorisme pouvait prendre ce double aspect ambigu, d'impuissance de la bourgeoisie ou de confusion chez les éléments arriérés du prolétariat, il est devenu aujourd'hui dans toutes les formes qu'il prend une politique de la bourgeoisie.
Dans sa forme la plus visible, la plus courante, l'action terroriste est un moment de la lutte entre différentes bourgeoisies nationales ou fractions d'une même bourgeoisie nationale. Depuis l'attentat de Sarajevo jusqu'à l'actuel assassinat de Carrero Blanco, le terrorisme manifeste le combat sans merci qui se livre au sein de la bourgeoisie décadente pour gérer au mieux les affaires du capital. Bien plus encore, le terrorisme permet à la bourgeoisie de souder les ouvriers derrière la bannière nationale : par le cycle attentats-répressions-attentats, faisant continuellement boule de neige, les nationalistes de l'IRA et Orangistes ont entraîné les ouvriers "catholiques" ou "protestants" sur le terrain de la défense de la "patrie" contre l'"ennemi" anglais ou irlandais "papiste". De même, les organisations terroristes palestiniennes ont par leurs attentats encore mieux embrigadé prolétaires juifs ou arabes derrière le capital national. Le terrorisme prend une coloration anti-ouvrière éclatante, quand l'IRA il y a peu de temps tuait les maçons "protestants" sur leur chantier.
La forme actuelle la plus pernicieuse du terrorisme est celle qui réussit à prendre un masque "ouvrier". Alors que le prolétariat, là où la lutte de classe reprend après plus de cinquante ans de contre-révolution rejette les actes terroristes pratiqués par les groupes "guérilléristes" de tout acabit, la lenteur de cette reprise ou un recul momentané redonnent vie aux groupes pratiquant "L'action exemplaire" qu'ils expriment la décomposition de la petite- bourgeoisie intellectuelle (bande à Baader- Meinhof en Allemagne) ou la démoralisation profonde d’éléments ouvriers après la retombée de la lutte (cas des Brigades rouges en Italie). La sympathie que peut rencontrer en milieu ouvrier ces actes exemplaires ne rend que plus nécessaire la condamnation impitoyable et sans équivoque de la part des révolutionnaires de ces éléments. Comme le disait Rosa Luxembourg :
- "Tandis que les efficaces méthodes de représailles des terroristes favorisaient, avant tout chez les éléments les moins clairs et sûrs du mouvement révolutionnaire de vagues attentes et espérances sur les actions extraordinaires de l'invisible main vengeresse, elles affaiblissaient la conscience de l'absolue nécessité et de la signification absolument décisive du mouvement populaire et de la révolution prolétarienne de masse." (Sächsische Arbeiterzeitung, février 1905)
Les groupes "exemplaristes" qui aujourd'hui substituent à l'action de classe celle de minorités élues, espèces de "Zorro" de la lutte de classe, ne font que se ranger totalement dans le camp: du capital. C'est toute la politique de la bourgeoisie de se présenter comme une "élite" devant se faire reconnaître par les masses "abruties". Le MIL n'avait pas une conception différente lorsqu'il se définissait comme un groupe qui "appuyait" les ouvriers dans leurs luttes.
Mais le fin du fin consiste à justifier indirectement le terrorisme derrière l'alibi des "expropriations". On dira que cela n'a rien à voir avec le terrorisme. En fait, c’est le même esprit : celui de la substitution de l'action de minorités à l'action de la classe elle-même.
Cet alibi se trouve d'ailleurs conforté par la confusion d'un certain nombre de marxistes sur ce problème. C'est ainsi que Lénine, après la défaite de 1905 en Russie, devait préconiser des actions de "partisans" afin de "récupérer" l'argent dans les banques tsaristes, sous le prétexte de financer le mouvement alors déclinant. La vague d'attentats et de "récupérations" devait culminer au fur et à mesure que la vague prolétarienne décroissait, laissant la place aux aventuriers, qui malgré leurs convictions révolutionnaires au départ ne tardèrent pas à se laisser corrompre par l'argent de leurs "récupérations" pour devenir finalement de simples bandits. Là où les "ex" sévirent particulièrement (Russie du Sud, région de Bakou), le mouvement mit des années à s'en remettre. Voici le témoignage que rapporte Trotski dans son 'Staline':
- "L'insurrection écrasée continua sous la forme d'explosions isolées, d'attaques de partisans, d'actes terroristes individuels ou par groupes. La statistique de la terreur caractérise d'une façon remarquablement claire la courbe de la révolution. En 1905, 233 personnes furent tuées, en 1906 768, en 1907 1231. Le nombre des blessés varia d'une manière quelque peu différente, car les terroristes apprenaient à tirer plus juste. La vague terroriste atteint son apogée en 1907".
"Plus tard, quand commença la renaissance du mouvement ouvrier révolutionnaire, cette renaissance fut d'autant plus lente qu'il y avait eu plus d'engouement pour les "ex"."
Ainsi, quelle que soit la forme prise par le terrorisme, quelle que soit la manière dont on le justifie, la lutte du prolétariat subit toujours un profond recul Ceux qui aujourd'hui préconisent la violence en dehors de la lutte de classe ne peuvent que se ranger, consciemment ou inconsciemment, dans le camp du capital. Tel est aujourd'hui le cas des "programmistes" du Parti communiste international qui après avoir salué il y a quelques années le vrai "courage" des maoïstes, affirment que :
- "Ceux qui revendiquent la violence - fût- elle plébéienne contre la chaîne mondiale de l'ordre établi - méritent la sympathie du prolétariat." (Prolétaire n° 189).
Au moins les apologistes de la violence "plébéienne" ont le "courage" de ne pas se donner comme alibi la violence prolétarienne. Ils se font ouvertement les défenseurs de la violence bourgeoise.
- La position de Barrot
Barrot, lui, est plus "malin". Il n'est pas bien sûr, pour les actions exemplaires, pour le terrorisme. Il admet que : "Les révolutionnaires ne peuvent qu'être battus d'avance sur un terrain qui n'est pas le leur. Jamais ils ne progressent par des coups d'éclat destinés à impressionner l’opinion." - "Le capital pousse une partie de ceux qui se rebellent vers des communautés politiques, culturelles, de drogue, etc. De même il en conduit d'autres vers la communauté de la violence, sûr de les isoler et au bout du compte de les détruire physiquement. Tant qu'existeront des Etats, tout Etat pourra tuer des révolutionnaires, mais un groupe révolutionnaire même bien implanté ne pourra jamais lutter efficacement par les armes contre un Etat que seule la révolution peut anéantir."
Mieux, Barrot ajoute : "Lorsque certains se laissent entrainer et, tombant dans le piège du capital, entament une action violente contre lui au risque de se détruire sans rien changer, il est impensable de ne pas les mettre en garde."
Voilà qui est parfaitement juste. Malheureusement Barrot s'empresse de répandre bien vite le goudron dans le baril de miel. Outre le fait de qualifier quand même de "révolutionnaires" les groupes terroristes, il déclare :
- "La violence minoritaire n'est pas à exclure même en période relativement calme, à condition que ceux qui l'exercent aient au moins la capacité de donner à leur acte son sens (son emploi) révolutionnaire."
Ainsi, pour Barrot, la violence de minorités ou de déclassés style le "Voyou" auquel il apportait naguère son soutien, serait non pas l’expression de classes sociales, mais simplement une pharmacopée dont il suffirait de trouver le dosage adéquat ! Barrot qui pèse le pour et le contre pour se donner une couverture d'objectivité, voire de dialectique, ne se montre ici qu'un dangereux philistin. Dénoncer l'"apport argent (dangereux par son caractère artificiel)" et "les équipes spécialisées" ne rendent que plus dangereuse la confusion qu'entretient Barrot dans son opuscule, lorsque de temps en temps on y découvre des bribes de marxisme. Pire, cette attitude "neutre" qui consiste à jouer les professeurs "objectifs" est tout à fait répugnante : elle consiste à jouer avec la vie des éléments confus qu'on ne cherche absolument pas à retenir sur la pente bourgeoise du terrorisme.
Au fond, derrière le refus de Barrot de condamner le terrorisme sans équivoque possible, derrière son refus de ne pas cautionner les entreprises frontistes, se cache une totale incompréhension de ce qu'est le prolétariat.
Pour Barrot, il y a d'un côté une classe ouvrière qui n'est rien d'autre que du "capital variable" et qui en tant que "capital variable" ne peut s'exprimer qu'au travers des syndicats, comme il est affirmé dans "Le Mouvement communiste" n°1. A classe ouvrière, dont le terme déplaît par trop dans le milieu contestataire étudiant car rappelant la réalité de l'exploitation par le salariat, Barrot préfère le terme plus "révolutionnaire" de prolétariat. Mais quel contenu met Barrot dans ce mot ? Pour lui, le prolétariat ce ne sont pas les ouvriers qui font des "compromis" (sic) en vendant leur force de travail, mais "ceux qui ressentent le besoin du communisme".
A partir de là, tout se tient. Si le communisme est une question de besoins individuels (le fameux "Je" de Barrot), on comprend que l'auteur de la brochure soutienne comme "actes de prolétaires" -même si comme les trotskystes on prend soin de demeurer "critique"-les actions d'individus qui s'inscrivent dans un "mouvement social" de révolte petite-bourgeoise : Noirs de Watts en 67, incendie de CES, les actes du MIL.
Contrairement à ce que croit Barrot, il n'innove pas. Depuis le début du mouvement ouvrier, les révolutionnaires ont eu à combattre les anarchistes ou de pseudo-marxistes tels les mencheviks, tous se retrouvant d'accord pour dénier à la classe ouvrière la faculté de bouleverser et détruire la société capitaliste Barrot en faisant de la révolution l'affaire d'individus et non de la classe ouvrière dans sa totalité, lesquels il baptise pour la cause "prolétaires", ne fait que rejoindre sous sa forme la plus vieillotte le proudhonisme qui déniait au prolétariat toute possibilité d'activité politique, sous le prétexte que c'était reconnaître la politique bourgeoise!
Il n'est pas étonnant que Barrot méconnaisse totalement la nécessité d'une organisation politique pour le prolétariat. Pour lui et pour l'ensemble des groupes depuis "Invariance" jusqu'à "Négation" en passant par son dernier avorton "une Tendance communiste", parler de problèmes d'organisation c'est encore avoir une vision "politique" et non pas sociale du communisme. Pour lui ce ne serait rien d'autre que du fétichisme et contribuerait à la constitution de nouveaux "racketts" politiques.
Mais attention ! Barrot n'est pas contre l'organisation en soi. Voilà ce qu'il en dit :
- "l’organisation est le lien que l'on se donne pour faire quelque chose." (M.C. n°3) "Le regroupement n'est possible que sur la base de besoins communs qui poussent à une action commune sur un ou plusieurs points et finalement créent une communauté -théorico-pratique." (M.C. n°l)
Ainsi pour Barrot, l’organisation n'a pas une fonction dans la classe, celle de clarification et d'intervention au sein de la lutte de classe, mais n'est rien d'autre qu'un lien entre des individus liés par leurs besoins (?). Mieux elle est déjà l'amorce du communisme : la fameuse communauté -tant en vogue chez les contestataires, celle-ci remplaçant le but révolutionnaire, et n'étant rien d'autre que réformiste.
Une telle conception de la classe et de l'organisation révolutionnaire débouche inéluctablement sur le substitutionisme, sur l'apologie de la violence brute et individuelle. Barrot, qui pourtant a écrit une critique du léninisme ("Le renégat Kautsky et son disciple Lénine"), est amené à reprendre la même vision substitutionisme :
- "On est révolutionnaire, lorsqu'on cherche à bouleverser ce qu'on a devant soi (et le reste). Baader cherchait à réveiller le prolétariat allemand." (M.C. n’5)
Quand on parle de réveiller le prolétariat point n'est besoin de se sentir comme fraction agissante de la classe. Barrot ne fait ainsi que manifester un mépris sans borne pour le prolétariat.
A l'heure où la crise s'accélère, où depuis 68 la classe ouvrière ressurgit comme classe sur son terrain, il est nécessaire de répéter que la révolution n'est pas simplement une question de violence, forme que prend la lutte de classe, mais aussi une question d'organisation du prolétariat, et donc de formation de sa fraction révolutionnaire : le parti, intimement liée à sa conscience.
Ceux qui dénient au prolétariat toute possibilité de s'organiser, le transforment en une masse amorphe (capital variable) et se font les apôtres de l'individualisme (les "besoins") ne font qu'alimenter le confusionnisme et donc renforcer le poids du capital au sein de la classe ouvrière. Pire, leurs idées les conduisent logiquement au frontisme. Aujourd'hui, plus que jamais alors que le système craque de toutes parts, il est du devoir des révolutionnaires de dénoncer impitoyablement la tendance Barrot et Cie comme frein, tout petit il est vrai si on le compare avec celui du stalinisme, vis-à-vis de la révolution.
CHARDIN
[1] Petite bibliothèque bleue, Editions de l'oubli. (J. Barrot).
Personnages:
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Terrorisme [61]
Rubrique:
Capitalisme et lutte de classe en Pologne, 1970-71, (I.C.O. (*)) : Insurrection ouvrière et journalisme politique
- 11 lectures
- "Les employés du gaz et de l’électricité ne coupent la distribution que dans les quartiers où habitent les policiers et les membres du parti, les quartiers ouvriers et les chantiers continuant à être alimentés... Il semble que ces faits spontanés au début aient été rapidement organisés par les comités de grève... Le comité de grève du chantier naval WARSKI, le plus important, s’est transformé en comité de grève central... C'est lui qui organise le ravitaillement, le faisant venir de fort loin... C'est lui qui assure les communications jusqu'à Gdansk... La grève est organisée méticuleusement. Les chantiers sont sous la surveillance de tous. Les hauts parleurs de l'usine diffusent les informations sur les événements. D'autres groupes patrouillent sur les rives de l'Oder, d'autres en armes gardent les bâtiments de la direction... La milice ouvrière armée, munie de brassards distinctif..."
Durant l'hiver 1970-71, la Pologne dite "socialiste" et plus particulièrement les ports de la Baltique Gdansk et Szczecin, étaient le théâtre d’affrontements très violents entre la classe ouvrière et le pouvoir d'Etat dit "ouvrier".
Ces insurrections sont les faits les plus marquants de la reprise prolétarienne internationale; jamais depuis la vague révolutionnaire des années 1917-23 la classe ouvrière n'avait fait preuve d'autant de détermination, de conscience, et de capacité d'organisation autonome, A ce titre, ils méritent toute l'attention du mouvement ouvrier international, qui sachant en tirer le maximum d'enseignements, enseignements qui sont les seuls acquis véritables de la lutte, leur donneront leur véritable dimension historique .
L'année 1968 est l'année du resurgissement de la crise mondiale du capitalisme. La Pologne, pays le plus dévasté par les deux guerres est pratiquement pillée par le "grand frère" russe depuis 1945, en a subi très durement les premiers assauts et le prolétariat payé très cher les frais. Diminuer les coûts de production en s'attaquant au niveau de vie des ouvriers pour pouvoir percer un marché mondial plus que saturé, voilà la préoccupation majeure de chaque bourgeoisie nationale. La Pologne, pays capitaliste à part entière, n'échappe pis à cette loi inflexible de l'économie de marché; d'ailleurs les dirigeants polonais affirment eux-mêmes cette réalité :
- "... Parce que nous devons suivre la compétition économique créée par le rapide développement des autres pays, pour garantir à la Pologne sa bonne position digne d’elle dans la division internationale du travail, c'est-à-dire dans la communauté (sic) internationale." (Gierek, 8ème Plénum, 6-7/2/71)
Ainsi, en 1969, l'application "de nouvelles normes techniques de travail" visant à diminuer le prix de revient des marchandises polonaises aura pour conséquence une baisse générale de 15 % des salaires, baisse qui provoquera des grèves nombreuses, mais isolées, donc vite étouffées. Malgré tout, au fil des mois, la situation ne va qu'en s'aggravant, et faisant fi des dangers que cela représente, la bourgeoisie d'Etat, valet du capital, est contrainte de prendre de nouvelles mesures; elles sont de taille. Un dimanche de décembre, le 13, jetant la consternation dans la classe ouvrière polonaise, la radio annonce une hausse générale des produits alimentaires de 20 à 30%. La riposte ne se fait pas attendre. Pour faire annuler cette hausse des prix, les ouvriers des chantiers navals de Gdansk envoient une délégation au siège du parti, elle est emprisonnée. Dès lors, la classe ouvrière va donner libre cours à sa colère, sa révolte explosant en des émeutes qui se généralisent à l'échelle du pays. Le même scénario se répétant dans plusieurs villes; c'est à Szczecin où, éclatant trois jours après Gdansk, la grève insurrectionnelle atteindra le maximum d'efficacité.
L'historique de ces insurrections vient d'être complété par un tout dernier livre, œuvre du collectif ICO[1], qui vient concentrer et enrichir le peu d'informations que l’on pouvait glaner de ci de là.
Cet ouvrage est important dans la mesure où les évènements qu'il narre sont importants et leur connaissance vitale pour le mouvement ouvrier, l’interprétation qu'il en donne et les enseignements qu'il en tire laissent, eux, plus qu'à désirer.
La première erreur qu'on peut relever à la lecture du livre est l’analyse qu'il donne des conditions objectives qui ont déterminé les insurrections polonaises. En effet, pour ICO, la crise économique qui a projeté les ouvriers polonais dans la misère n'est qu'une crise structurelle, passagère; le capital, ayant atteint un certain degré de développement, se trouve contraint d'adopter de nouvelles structures pour pouvoir continuer sa marche éternelle à travers l'histoire :
- "... Il n'est pas interdit de penser que les récents ennuis internationaux (spéculation sur le dollar, etc.), 1oin. de représenter une "crise" au sens classique de ce terme, sont en fait un épisode de cette lutte et montrent la vitalité du Capital (de ce point de vue) dans la recherche d’une nouvelle transformation structurelle pour lutter contre sa maladie congénitale, contre ses contradictions internes. Le problème qui se pose au Capital pourrait être celui d'une nouvelle transformation permettant la destruction raisonnée et raisonnable du Capital, à l'échelle mondiale cette fois...".
Sur un ton opportuniste : "il n'est pas interdit de...", "pourrait être", cette prise de position est d'une remarquable confusion; on parle d'une crise structurelle, en d'autres termes d'une crise de croissance, d'une crise qui n’en serait pas une, exprimant tout au plus la "vitalité du système", mais posant toutefois le problème d'une destruction de capital. Cette nécessité d'autodestruction comme condition indispensable à sa survie, nécessité à laquelle le capital se trouve confronté depuis que le marché mondial est réalisé (cela depuis 1914) montre bien la sénilité du système et non sa "vitalité". Le ressurgissement de la crise mondiale du capitalisme après les reconstructions consécutives à la deuxième guerre mondiale ouvre de nouveau la perspective de la révolution internationale dans laquelle s'inscrivent les insurrections polonaises. Cela, minimisant la crise ou la niant purement et simplement, nos journalistes ne peuvent le comprendre. Les difficultés économiques du capitalisme ne sont pas de simples "ennuis" mais bien l'expression d'une gangrène qui le mine lentement mais sûrement. Nous n'avons pas besoin ici de grandes théories pour le démontrer; ne serait-ce que dans les pays de l'Est, les chiffres parlent d'eux-mêmes, montrant que, loin de s'atténuer,1a crise mondiale du capitalisme n'a fait que s'approfondir depuis 1971 et s'aggravera encore, préparant de nouvelles insurrections. Ainsi, l'on pouvait assister "à une hausse du prix du super au printemps 1974, de 69% en Pologne et de 44% en Tchécoslovaquie ; du litre d’essence ordinaire de 80% à Varsovie et de près de 50% à Prague. Le gouvernement hongrois a, le 1er septembre 1974, relevé de 40 % les carburants autos, de 16% le charbon, de 20% le gaz domestique, de 18% le bois de chauffage... L’URSS vend son pétrole environ 120%, plus cher aux pays frères"; suit toute une série de chiffres éloquents : "le zycie gospodasze", hebdomadaire économique du parti, reconnaît qu'entre novembre 1973 et novembre 1974, le prix du poulet a augmenté de 42%, des pommes de terre de 43%... des oignons de 50%, des carottes de 70%, des choux de 10%, des pommes de 20%, du bœuf de 10%,...". Et on pourrait continuer à l'infini. Mais il est vrai que, toutefois, les journalistes d’ICO se posent encore des questions sur l’existence ou non de la loi de la valeur en URSS :
- "Nous ne nous sentons pas capables, quant à nous, de répondre à la question de l'existence de la loi de la valeur en URSS de manière tranchée." (page 254)
On peut même lire, page 258 :
- "Peut-on et doit-on augmenter les salaires réels pour se rattraper sur la productivité ? Tel est le dilemme qui se pose aujourd’hui à la Russie. Mais ce dilemme est d'autant plus difficile à résoudre que l'augmentation du niveau de vie n'est possible que s'il y a déjà une certaine augmentation de la production de biens de consommation, donc de la productivité. C'est un problème d'amorçage de pompe dont la solution est loin d'être aisée".
La pompe, ce sont les ouvriers russes qui l'ont prise dans la gueule ! Quand on voit que "les soviétiques épargnent jusqu'à 50% de leurs revenus,... 200 000 millions de zlotys dorment dans les caisses d'Etat polonaises. Et si les premiers 100 000 millions ont été économisés depuis 25 ans, pourquoi les 100 000 autres y sont-ils depuis 3 ans seulement ?"("Zycie Literackie" 5/1/1975). Mais nos journalistes atteignent le comble de la bêtise ou de l'inconscience quand ils disent que :
- "Les mesures à long terme visent à introduire, aussi bien dans les structures que dans les esprits, les termes d'un capitalisme moderne d'une société de consommation", (page 152).
En attendant, les ouvriers du monde entier touchés par la crise peuvent toujours consommer leur misère en attendant des lendemains qui chantent ! En tout cas, les ouvriers polonais n'ont pas été dupes : les rires de la foule devant les premières salves de mitraillettes ont été une façon de dire : "nous n'avons rien à perdre que nos chaînes". Une telle incompréhension de la situation historique du capitalisme mondial, outre le fait qu'elle entretient la mystification sur les possibilités à court ou long terme du capitalisme, empêche radicalement de comprendre la signification et la portée de tels événements. Ainsi, comment comprendre le fossé qui existe entre les événements de 1970-71 et ceux de 53 en Allemagne de l'Est, de 56 en Pologne, et Hongrie, si l'on ne se réfère pas directement à la situation historique du capitalisme mondial dans laquelle ils se déroulent. En effet, l'effort de reconstruction consécutif à la 2ème guerre mondiale réclamait, de la part du capitalisme russe, durement touché, une exploitation intensive de sa classe ouvrière ainsi que la mise à sac des pays placés sous "sa protection". Cette mise à sac était d'autant plus possible que le prolétariat mondial venait de subir la plus grande contre-révolution de l'histoire, donnant directement lieu à une boucherie, abominable. Néanmoins, un tel effort se révèle trop dur à supporter et provoque une série de réactions où le prolétariat se trouve bien mêlé, mais noyé dans la mystification nationaliste, démocratique et inter-classiste. Aussi les insurrections de 70-71 offrent-elles un tout autre aspect, cette fois purement prolétarien ; il ne s’agit pas de démocratiser le système bureaucratique et de "libérer la nation du joug russe" mais d'imposer par la force le point de vue du prolétariat : c'est en chantant 1'"Internationale" que les ouvriers ont brûlé les sièges du P.O.U.P.! Dans le récit qu'ils font des événements, nos journalistes enregistrent bien la différence qualitative qui existe entre les mouvements de 56 ou de 68 à Prague et ceux de Pologne en 70-71. Mais, avec une .telle vision de la crise, "crise de croissance", "crise structurelle", comment pourraient-ils en saisir le sens, la nature, la dimension historique ? Par le fait qu'ils s'inscrivent dans la réaction révolutionnaire du prolétariat international à la crise mondiale du capitalisme, vague qui a fait surgir mai 68 en France, l'automne chaud italien, les mouvements de grèves suivies en Allemagne et Scandinavie dans les années 69-70, en Angleterre en 72, les luttes généralisées des ouvriers espagnols ces dernières années, etc... la lutte des ouvriers polonais acquiert une tout autre dimension historique que celle que leur attribuent les auteurs du livre : "une révolte contre des mutations économiques et sociales" (page 94).
Mais là n’est point la seule mystification que contient ce livre, il en est une qui est d'autant plus dangereuse qu'elle touche directement le mouvement ouvrier : l'autogestion. Si nos ICOistes semblent avoir bien compris que les pays de l'Est sont capitalistes, par contre, il est certain qu'ils n'ont pas compris ce qu'est le capitalisme, et, partant, la révolution communiste. Cette conception du mouvement révolutionnaire les amène à dire :
- "... dans le processus révolutionnaire, c’est ce stade d'auto-organisation sur le lieu de production qui conditionne la transformation sociale. Celle-ci est véritablement engagée dès que se font jour des tentatives de gestion de l'appareil économique par les travailleurs eux-mêmes. Ces tentatives sont finalement plus importantes que l'organisation même de la : lutte physique contre les forces de répression, aussi importante soit-elle, car la prise en mains de l'appareil économique signifie l’affirmation du pouvoir de la classe des producteurs..." (page 56).
S'il est bien vrai que le stade d'auto-organisation du prolétariat est le moment Le plus crucial, le moment où tout se joue, par contre, il est faux et mystificateur de dire que le prolétariat doit s'auto-organiser pour "gérer l'appareil économique" ; cela aurait pour conséquence directe le cloisonnement du prolétariat dans le cadre corporatiste de l'usine et donc la défaite. L'un des moyens de bloquer le processus de généralisation et d'organisation de la lutte, processus dans lequel se dégagent les perspectives révolutionnaires :
-affrontement général et destruction de l'Etat bourgeois, dictature du prolétariat, est de faire en sorte que les différentes unités de la classe se retrouvent retranchées, attachées derrière leurs lieux de travail respectifs. Pour cela, tous les moyens sont bons. L'un des meilleurs : l'autogestion, offre une mystification d'autant plus insidieuse qu'elle peut faire croire aux prolétaires qu'ils maîtrisent les conditions sociales de production.
Pour la révolution bourgeoise, la prise du pouvoir politique sanctionne tout le processus de l'instauration du pouvoir économique. Pour la classe ouvrière, il en va tout autrement : elle est la seule classe exploitée dans l'histoire à être une classe révolutionnaire séparée des moyens de production. Elle ne peut donc entamer le processus de transformation révolutionnaire des rapports sociaux de production (et non pas du mode de gestion, le capitalisme étant avant tout un mode de production) que si elle s'est préalablement emparée du pouvoir politique.
Le mythe auto-gestionnaire atteint son comble page 116 :
- "Mais certaines de ces possibilités, comme par exemple, la prise en main de l'économie, ou même des tentatives d'autogestion, ne furent pas utilisées. Ce pas n'étant pas franchi, l'occupation des usines ne pouvait être qu'un objet de marchandage avec la classe dominante..."
Ce refrain ; "Laissez tomber vos luttes revendicatives", soit pour vous autogérer ou pour instaurer des rapports sociaux communistes, nous le connaissons bien, pour l'avoir entendu sur tous les tons. En fait, ces mots d'ordre, qui se veulent radicaux, ne peuvent avoir pour seule conséquence que de détourner le prolétariat de sa tâche la plus urgente : l'instauration de sa dictature de classe sans laquelle il a les mains liées. Le "patriote" Gomulka le savait bien quand, en 56, il disait aux ouvriers : "Il faut saluer avec une profonde reconnaissance l'initiative de la classe ouvrière concernant l'amélioration de la gestion des entreprises industrielles et sa participation à cette gestion. Cela prouve que la classe ouvrière a une foi ardente et bien fondée dans le socialisme."
Bien entendu, ICO ne se revendique pas d'une telle autogestion, il se revendique de la "vraie" autogestion, mais ne nous précise jamais ce qu'elle doit être. En fait, ils seraient bien en peine de nous l'expliquer, sans nous révéler le caractère bourgeois d'un tel programme. La classe ouvrière ne pourra jamais gérer l'économie que lui lègue le capitalisme, elle devra la détruire, et c'est de cette destruction que naîtra le communisme. En période de crise révolutionnaire conditionnée par une crise économique, la mystification auto-gestionnaire peu se présenter comme le dernier rempart du capital. Associer ses esclaves au maintien de sa survie en les attachant à la gestion de l'entreprise et les précipiter dans la barbarie au nom de la défense de cette fameuse "Gestion ouvrière". Les organisations dont se sont dotés les travailleurs polonais ont été des organes de combat contre la bourgeoisie et non des organes de gestion de l'économie nécessairement capitalistes. C'est grâce à de telles organisations que les ouvriers polonais ont pu mener leur lutte et c'est à travers ces mêmes organisations qu'ils ont pu développer leur conscience. La détermination sans l'organisation, c'est le massacre ; à Szczecin, les ouvriers l'ont bien compris qui se sont organisés de manière autonome avant même de commencer 1'insurrection, gagnant par là le maximum d'efficacité tout en épargnant des vies précieuses.
Le problème qui se pose aujourd'hui au mouvement ouvrier international : capacité de s'organiser en dehors et contre les syndicats ; développement des perspectives et du programme révolutionnaire. Les ouvriers polonais ont commencé à nous en montrer les solutions.
- "La chose la plus importante est que nous fassions rendre au maximum notre économie, nos entreprises... Ne nous en veuillez pas de la politique énergique du gouvernement et de l'ordre qu'il fera régner dans les rues de nos villes." (Les bourgeois Gierek et Jaroszewics aux ouvriers de Szczecin).
- "Nous ne voulons pas de fables, nous voulons du pain... Nous avons mené la grève. Nous savons comment elle est partie... Mais, pratiquement, à vrai dire, on n'en a rien. Vos interventions n'ont pas convaincu les travailleurs... Nous arrêtons la grève, non par conviction, mais parce que les autres l'arrêtent, C'EST TOUT." (Ouvriers de Szczecin aux bourgeois Gierek et Jaroszewics).
M. PRENAT
[1] * Informations et correspondances ouvrières (ICO) est un groupe conseilliste créé en 1958, après une scission de Socialisme ou barbarie autour de Claude Lefort et Henri Simon,
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Evènements historiques:
- Pologne 1970-71 [62]
Courants politiques:
Rubrique:
Revolution Internationale N°16 - juillet
- 29 lectures
Rubrique:
Revolution Internationale N°18 - Octobre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 2.64 Mo |
- 656 lectures
France – au bout du tunnel : le prolétariat
- 754 lectures
"Nous commençons à voir le bout du tunnel."(CHIRAC)
Confrontées à la "plus grande secousse que l'économie mondiale ait connue en temps de paix depuis 45 ans" -comme le disait Giscard d'Estaing lui-même dans son dernier "discours au coin du feu"-, toutes les fractions nationales de l'appareil politique de la bourgeoisie mettent autant d'acharnement à se démarquer les unes des autres, qu'à tenter de persuader (et de se persuader) qu'il y a des solutions dans le cadre du système. En fait, pour la bourgeoisie, faire croire qu'IL Y A UNE SOLUTION devient une nécessité d'autant plus vitale que la lutte de classe la menace, en même temps que la crise, dans ses fondements mêmes. La bourgeoisie des pays autrefois les plus prospères brandit ses plans de relance, aussi bien aux Etats-Unis, qu'en Grande-Bretagne, au Japon ou en Allemagne, mais, devant le scepticisme général, ravale très vite ces mêmes plans en modestes "plans de soutien" pour conserver, malgré tout, une certaine crédibilité.
UNE SOLUTION DE LA BOURGEOISIE AU POUVOIR : LE PLAN ET LE CONTRE-PLAN
Dans l'incertitude, la bourgeoisie ne s'aventure plus sur les plans à long terme, elle navigue "au jugé" dans la brume épaisse de la crise mondiale, attendant que son plan soit efficace dans quelques mois, que la "reprise économique" vienne des pays partenaires ou d'un développement économique intérieur des plus hypothétique. En fait, en présentant le contre-plan de septembre 1975 comme une solution pour l'avenir, la bourgeoisie ne fait qu'agiter vainement un épouvantail à lutte de classe: il y aurait une solution SI, entre autre considérations, la classe ouvrière acceptait les quelques généreux 5 milliards de francs "d'aide à la consommation" en attendant patiemment des jours meilleurs.
Le plan anti-inflation de 1974, avait, lui aussi, été présenté comme une recette magique A CONDITION QUE la consommation soit limitée, tout comme les investissements et les crédits. Pour tous les pays, la solution était alors la même : importer peu, exporter plus, et le cercle se refermait, chaque pays cherchant à écouler ses stocks tout en achetant moins. Ce fut l'escalade diplomatique des commis-voyageurs, tous aussi célèbres les uns que les autres, de Chirac à Kissinger, et la mise aux enchères de "marchés du siècle" d’autant plus spectaculaires qu'ils étaient plus futiles par rapport aux stocks existants. Il fallait montrer que la bourgeoisie cherchait des solutions et qu'elle les connaissait, que les échecs ne pouvaient venir que d'accidents commerciaux : le pragmatisme devenait la méthode de gestion courante de ces temps d'incertitude.
Mais, bientôt, la bourgeoisie dut se rendre à l'évidence : l'inflation avait légèrement baissé, certes -et pour des raisons surtout conjoncturelles- mais au prix d'une récession de plus en plus forte: la production industrielle a chuté de 13 % entre juillet-74 et juillet-75, tandis que le chômage atteignait le chiffre de 1,200,000 le 1er août-75. C'est l'escalade du chômage partiel, des licenciements collectifs et des dépôts de bilan : Boussac, Idéal-Standard, les conserveries Blanchard, Sacilor-Sollac, Foclain et bien d'autres sont atteints.
Le gouvernement "trouve" alors UNE AUTRE SOLUTION : le contre-plan Giscard de septembre 75, plan anti-récession, dit "plan de relance" et plus tard, plus modestement, "plan de soutien" : il s'agit d'injecter 30 milliards de francs dans une économie atteinte d'une maladie chronique... La majeure partie de ce financement va aux entreprises pour leur faire continuer la politique qu'elles ont tout naturellement tendance à suivre : celle de produire, toujours plus, toujours en moins de temps. Prise dans le rouage de la productivité qui lui est naturelle, l'économie décadente est bientôt prise de vertige : produire pour qui ? Les pays dits partenaires -de qui est attendu le miracle d'écouler la surproduction- sont dans la même situation : ils veulent vendre leurs stocks, mais ne pas acheter. Produire pour produire, la bourgeoisie le peut pratiquement avec les seules limites des matières premières utilisables : mais elle se heurte bien vite à ses propres contradictions : la plus-value à réaliser, c'est-à-dire le profit sous forme de marchandises qu'il s'agit de transformer en argent, puis en nouveaux moyens d'exploitation, est de plus en plus importante, la plus-value réalisée de plus en plus faible. Jouissant de possibilités productives gigantesques, le capitalisme est contraint de diminuer ensuite volontairement sa production : ainsi, le potentiel industriel ne fonctionne déjà plus qu'à 70 % de sa capacité productive. Le meilleur exemple de l'absurdité des contradictions de cette période de décadence est celui de Fos-sur-Mer le "plan de relance" se propose d'entamer la deuxième tranche du projet, donc de terminer la construction de l'ensemble prévu. Or, sur les deux hauts-fourneaux existants, un seul peut fonctionner, l'autre est éteint faute de débouchés pour sa production.
Ainsi, au moment même où elle prétend se moderniser, où elle prétend développer sa productivité, la bourgeoisie ne fait que creuser davantage sa propre tombe:
- la récession provisoirement ralentie du fait de l'injection fictive de capitaux ne va pas pour autant empêcher le déficit de 40 milliards de francs prévue pour 75 et la continuation du chômage ; ainsi, Ceyrac, président du CNPF, le disait lui-même, et dès les premiers jours du plan : "De nouveaux licenciements seront indispensables";
- le développement du crédit occasionné par le plan de relance, en faisant de la planche à billets une technique courante de la politique économique, va faire de l'inflation une réalité tous les jours plus pesante : les prévisions la voient déjà atteindre les 15 % après être passée de 13,5% à 10% sous l'effet du précédent plan. Les prix vont eux-aussi augmenter en même temps que 1'inflation, et l'actuelle augmentation ne donne qu'une idée bien pâle de ce qu'elle sera dans quelques mois : en effet, ils ont augmenté de 15,2% de juillet 74 à juillet 75 tandis que le SMIC n'augmentait que de 8,6%.
Entrée dans le tunnel de la crise dès les années 66-67, la bourgeoisie française le voit de plus en plus se refermer sur lui-même : le plan anti-inflation n'a fait que provoquer la récession sans résorber l'inflation. Le plan anti-récession ne fera que développer l'inflation sans freiner la récession. "Solution" d'autant plus stérile qu'elle ne résout rien du point de vue du capitalisme et ne s'assure pas la neutralité de la classe ouvrière. De cette faille du régime actuel surgissent les solutions de rechange qui, si elles ne sont pas plus efficaces du point de vue du capitalisme, tendent au moins à résoudre la deuxième question : la nécessité de tenir en main la classe ouvrière.
"LA SOLUTION" DE LA GAUCHE: UN CAPITALISME D'ETAT "SOCIAL" *
Devant le "plan de relance" de Giscard d'Estaing, le PC a sorti son "programme du 8 août" issu du "programme commun de la gauche" et qui ressemble étrangement au plan gouvernemental, avec, toutefois, une différence d'accent...
L'intervention de l'Etat prendrait, sous la direction de la gauche, non plus seulement la forme d'intervention de l'Etat dans le capitalisme privé : elle adopterait même la forme juridique du capitalisme d'Etat. En effet, la gauche pousserait la hardiesse jusqu'à nationaliser formellement des entreprises qui ne doivent déjà leur survie qu'à l'aide financière de l'Etat ; Citroën par exemple, a bénéficié d'une imposante somme de l'Etat pour ne pas être obligé de fermer ses portes et de mettre en chômage plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Sa nationalisation ne fera que rendre officiel ce qui existe déjà.
L'intérêt de ces nationalisations, pour le capital, ne se situe pas tant dans la tentative de résoudre le problème de la crise dans ses contours économiques que dans la manière de présenter cette opération à la classe ouvrière : les nationalisations sont présentées comme une lutte contre les monopoles assimilés pour la circonstance en lutte contre le capitalisme, elles sont présentées comme des mesures socialistes ouvrières nécessaires à un "gouvernement des travailleurs". Les nationalisations deviennent alors PLUS QU'UNE SOLUTION A LA CRISE: le moyen pour amener la classe ouvrière à se fourvoyer dans une voie qui n'est pas la sienne.
Après les échecs des deux dernières grandes grèves du prolétariat français -les PTT en oct.-nov. 74, Renault en 75-, la gauche éprouve sans cesse le besoin de maintenir son influencé sur la classe ouvrière. Ceci d'autant plus que le chômage chronique et l'augmentation des prix constituent une véritable poudrière.
Les contre-plans de la gauche sont un prétexte comme un autre pour se démarquer de la politique gouvernementale actuelle et présenter par ce fait même, sa candidature au pouvoir tout en souhaitant retarder le moment de reprendre en main une situation en aussi mauvais état. La gauche reproche à ce plan d’être anti-ouvrier puisqu'il favorise les grandes entreprises, elle lui oppose une espèce de contre- plan qui se veut pour "la relance de la consommation populaire", pour le développement de l'activité économique et la défense de l'emploi, pour le blocage des prix à la production de la grande industrie, pour quelques suppressions de TVA, pour le contrôle de l'exportation des capitaux et pour les nationalisations. Sauf quelques fragments nouveaux -mais qui sont irréalisables donc uniquement démagogiques et que la gauche rangerait bien vite dans ses tiroirs si elle était au pouvoir-, le contre-plan de la gauche n'est qu'une réédition un peu plus sophistiquée du "plan Giscard" sans les contraintes imposées par le libéralisme à celui-ci.
Le but que recherche la gauche réside dans le fait de présenter le programme commun comme - l'assise économique d'un éventuel pouvoir de la classe ouvrière, de se présenter comme des gérants efficaces de ce pouvoir. Se déclarer seule détentrice des clés de la crise ne saurait lui suffire ; il lui faut encore fignoler son rôle d'opposition conséquente au régime: se montrer victime du régime actuel, refuser avec hauteur toute proposition gouvernementale de discussion.
"Victime" Marchais lui-même, en visite dans les entreprises avec une délégation de choc du PCF et refoulé chaque fois par la police. C'était la première partie de la mise en scène.
La deuxième partie se situe le jour de la discussion du "plan de relance", où des manifestations de travailleurs sont arrêtées devant les portes de l'Assemblée Nationale. Les députés communistes sortent ostensiblement pour "discuter" avec eux, prendre leurs pétitions et reviennent tout aussi ostensiblement s'asseoir sur les bancs du Parlement. Et le député communiste Ducoloné de conclure : "Dans les usines, on veut empêcher les députés communistes de s'entretenir avec les travailleurs ; à l'Assemblée Nationale, on empêche les travailleurs de venir parler aux députés", (L'Humanité du 10 septembre 75).
"Intransigeant", un PC qui se dit lui-même "champion" de l'Union de la Gauche, qui a refusé le premier les propositions gouvernementales et qui ne fait pas de la visite de Fabre à Giscard d'Estaing une occasion pour se distinguer des radicaux de gauche. "Le problème de l'Union ne se pose pas en termes de confiance entre dirigeants des partis de gauche. Nous regrettons la démarche de R. Fabre, cela pose un problème sérieux, mais nous ne pensons pas pour autant que l'Union de la Gauche soit dans la situation extrêmement difficile que prétendent les adversaires de 1'Union".(Conférence de presse de Marchais, le 19 septembre).
De manquement à la discipline d'Union de gauche, la discussion de Fabre avec Giscard d'Estaing devient un instrument de la politique de cette union:
- c'est un moyen pour réaffirmer, après les polémiques autour du Portugal, l'union de la gauche contre le gouvernement;
- c'est un moyen de sonder, par personne interposée et sans compromettre les leaders PS et PC de l'Union, les possibilités de collaboration avec le gouvernement. Marchais n'a pas caché son espoir que Fabre puisse rendre compte de sa visite : "Nous sommes toujours disponibles pour des rencontres entre les partis de gauche, y compris au sommet. Je doute qu'après une rencontre avec Giscard d'Estaing, Robert Fabre éprouve le besoin d'une telle réunion pour faire le bilan." (Conférence de presse du 19 septembre).
Test pour la gauche cette visite l'est aussi pour le gouvernement désireux d'utiliser, une force tampon entre la droite et la gauche avant une éventuelle collaboration. Même si s'ébauche ainsi une possibilité de participation au gouvernement, la gauche reste prudente: la situation de la classe ouvrière va empirer de jour en jour et provoquera une reprise inévitable de la lutte de classe, la situation économique ne pourra que continuer à se détériorer, avec ou sans la gauche au pouvoir, avec un plan ou un contre-plan ou un contre-contre- plan. .. La gauche présentera sa participation au gouvernement ou sa "prise de pouvoir" comme une "victoire des travailleurs" ; elle présentera alors la persistance de la crise, et donc, l'impuissance de son programme comme l'héritage d’une mauvaise gestion dont les "travailleurs au pouvoir" continueraient de faire les frais, rétrospectivement. Ainsi, la "solution" de la gauche se réduit à ce qu'elle est : UNE MANIERE DE FAIRE ACCEPTER LA CRISE PAR LA CLASSE OUVRIERE.
La bourgeoisie, en tant que classe exploiteuse, ne se maintient au pouvoir, même émoussé, que par l’éventualité d'une relève de gauche toujours possible, et d'autant plus "à gauche" que la classe ouvrière est plus combative. Ainsi, Fabre est à Giscard d'Estaing ce que le PS et le PC sont à Fabre, ce que les gauchistes -et notamment les trotskystes- sont au PC : un gouvernement de rechange, dont les "solutions" ne font que changer de nom. Ainsi, au programme commun s'oppose le programme de transition des trotskystes, et des gauchistes dans les faits, UNE AUTRE MANIERE DE FAIRE ACCEPTER LA CRISE A LA CLASSE OUVRIERE.
"LA SOLUTION" DES GAUCHISTES : LE PROGRAMME DE TRANSITION.
Bien que ne se réclamant pas tous du programme de transition de Trotsky, les gauchistes le suivent tous dans les faits : ils avancent tous la même nécessité de revendications transitoires. Les trotskystes, LO comme Rouge, reprennent textuellement le texte de 1938, l'un avec le populisme démagogique d'une Laguiller :
- "Au plan de Giscard, il faut que les travailleurs opposent leur propre plan. Un plan qui ne permettrait pas aux capitalistes de maintenir leurs profits, un plan qui permettrait aux travailleurs de ne pas supporter les conséquences de la crise", (LO du 6 septembre).
l'autre avec la pseudo-combativité d'un intellectuel pondéré:
- "La seule voie qui s'ouvre est donc celle de la lutte. Pour mettre fin au chômage, en imposant une réduction massive du temps de travail sans diminution de salaire ; pour mettre fin à la baisse du niveau de vie, en imposant une augmentation réelle du pouvoir d'achat des salaires", (Rouge du 12 septembre)
Il s'agit de mettre en avant des "solutions" qui leur permettent de "se mettre au niveau de la masse" en lui proposant toutes sortes d'illusions, du style "imposons la fin du chômage", et d'éviter de parler de la nécessité de détruire ce système qui ne donnera que du chômage. . . "Les gens ne comprendraient pas"..., alors, on ment, comme n'importe quel parlementaire en quête de votes. Quelles que soient les élucubrations "tactiques" qui peuplent le cerveau de ces politicards, leur intervention n'aboutit qu'à revendiquer et à créer l'illusion de la possibilité d'un capitalisme sans profits, sans chômage, sans abus-, ... sans exploitation. C'est, en fait, la vieille tromperie réformiste à peine recouverte d'un craquelant vernis de verbiage radical : "imposons..." Dans le programme de transition de 1938, Trotsky présentait ce réformisme déguisé de la façon suivante:
- "Il faut aider la masse dans le processus de sa lutte quotidienne à trouver le pont entre ses revendications actuelles et le programme de la révolution sociale. Ce pont doit consister en un système de REVENDICATIONS TRANSITOIRES partant des conditions actuelles et de la conscience actuelle de larges couches de la classe ouvrière et conduisant invariablement à une seule et même conclusion : la conquête du pouvoir par le prolétariat."
Seule une idéologie éloignée de tout processus révolutionnaire, parce qu'elle est, en 1938, le produit de la période la plus noire ' du triomphe de la contre-révolution,-les capitalistes des principales puissances comptent leurs troupes de prolétaires vaincus, atomisés, endoctrinés au fascisme ou à l'antifascisme, prêts à aller s'entre-massacrer au profit de leurs capitaux nationaux- seule une telle pensée peut, en oubliant tout ce que peut être la marche des prolétaires vers la révolution, imaginer le processus révolutionnaire comme un "pont" rectiligne et continu dont les piliers seraient une série de "revendications transitoires", partant des revendications les plus simples et immédiates pour arriver à la revendication du pouvoir.
Certes, la lutte du prolétariat pour la conquête du pouvoir est un aboutissement, conséquence logique de la lutte quotidienne, immédiate, de résistance du prolétariat contre son exploitation. C'est même là une spécificité essentielle de la classe ouvrière : les autres classes exploitées, menacées dans leur existence par le développement du capital lui-même, petits paysans, petits commerçants, etc. n'aboutissent en aucun cas, par leurs luttes quotidiennes à une mise en question réelle du capitalisme et encore moins à une solution de dépassement de celui-ci. Au contraire, lorsque ces luttes dévoilent leur contenu en se généralisant, elles ne parviennent qu'à la revendication d'un maintien de l'ordre social existant ou à un retour en arrière de l'histoire. Seules, les luttes immédiates de la classe ouvrière portent en elles et dans leur développement l'avènement d'une nouvelle société. C'est en celà que ses luttes immédiates contre la dégradation de ses conditions d'existence et sa lutte pour la conquête du pouvoir ne sont que deux moments d'un même combat.
Ainsi, les gauchistes, et plus particulièrement les trotskystes, ne détonnent pas, dans l'arsenal des «solutions" à la crise: ils ont un "plan" tout comme le gouvernement actuel a un "plan de relance" et la Gauche un "programme commun" ou un "programme du 8 août". Ils ont eux aussi des revendications à avancer dans le cadre du système actuel, revendications qui sont, comme celles du PC, plutôt des vœux pieux que des "solutions", mêmes capitalistes. Néanmoins, ils ont une clé : celle qui pourrait assommer la classe ouvrière en l'immobilisant derrière des revendications.
Les sociaux-démocrates avaient un programme minimum et un programme maximum ; refusant plus le manque de lien entre les deux que le fond même de la question, à savoir la perspective de ne plus avoir aujourd'hui de possibilités de programme minimum, les trotskystes ont inventé un lien : le pont des revendications transitaires, et le problème est résolu. Ainsi ne vont-ils pas manquer de retrouver toutes les revendications transitoires du programme de transition de 1938 : celles destinées aux pays arriérés, celles destinées aux pays fascistes, celles réservées à l'URSS... avançant, sans le dire ni le comprendre la possibilité de, mesures communistes avant la révolution : dualité du pouvoir par l'existence du contrôle ouvrier du comité d'usine, etc.
Recettes de la bourgeoisie, les mesures demandées par les trotskystes sont aussi stériles et inefficaces que celles avancées par la bourgeoisie officielle. Dans cette période de décadence, tout programme minimum, y compris le droit au travail, est devenu caduc, et toute tentative d'avancer ce programme sous forme de revendications transitoires n'est pas de la simple démagogie, mais de la mystification.. Quand on demande "pas de chômage", dans le meilleur des cas, c'est un voeu pieux qui nie la réalité de la crise, dans le pire, c'est la négation de l'existence de la crise comme possibilité objective d'amener avec elle la révolution. Quand on parle de "partage du travail entre tous”, d'échelle mobile-des heures de travail comme d'échelle mobile des salaires, on avance la même chose que l'égalité de tous devant l'argent, on propose un programme basé sur l'étalement de la misère dans le cadre du capitalisme. Que chacun ait un peu de travail, un maigre salaire, mais qu'il n'y ait plus de chômeurs, ni de disparités trop criantes entre les salaires. Quand on demande de ne pas faire de "diminution de salaire", on demande à la bourgeoisie de ne pas faire de plus-value, alors que la réduction de la masse salariale a justement pour but de faire conserver à la bourgeoisie un minimum de plus-value potentielle.
Mais c'est absurde de croire que le passage d'un moment à l'autre de cette lutte peut prendre la forme d'un pont de revendications progressives ou transitoires.
Toute l'histoire des processus de luttes qui ont abouti à des tentatives de conquête du pouvoir par le prolétariat le montrent : loin d'être un processus uniforme comme celui des révolutions bourgeoises au XVIIIème et XIXème siècle, celui de la révolution prolétarienne est caractérisé par des sauts brusques, des reculs profonds, un chemin rempli de méandres, de craintes et de témérités. Ce n'est pas une suite de victoires sur des revendications progressives qui mène le prolétariat à détruire l'Etat bourgeois et instaurer sa dictature, mais, au contraire, une suite de défaites matérielles immédiates au cours desquelles il comprend :
- 1) qu'il ne sert à rien de revendiquer quoi que ce soit d'un Etat qui ne peut rien lui accorder ;
- 2) que la seule victoire qu'elle acquiert dans ses luttes quotidiennes, c'est l'apprentissage de sa force, de sa capacité à s'organiser comme un seul corps uni, de la conscience des buts et des moyens réels de son combat ;
- 3) que, ne pouvant plus "revendiquer" de l’Etat bourgeois, il ne lui reste qu'à le détruire.
La prise du pouvoir n'est pas une revendication ultime, mais la fin des revendications.
C'est pourquoi ceux qui prétendent opposer aux plans de sauvetage économique du capital des plans "de transition", des revendications organisées du système, quelque soient leurs illusions de "tactiques révolutionnaires", ne s'inscrivent pas dans le processus de développement des luttes prolétariennes mais dans celui de leur freinage, celui du réformisme. Le prolétariat ne va pas à la révolution inconsciente derrière des carottes transitoires qui lui seraient adroitement et opportunément tendues devant le museau par son avant-garde. Son avant- garde ne peut au contraire que lui montrer la nécessité de faire sienne la conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il sera contraint de faire, et, entre autre, de cesser de se faire des illusions sur les possibilités d'obtenir du capital une quelconque amélioration de son sort.
NM & RV
MODERNISME - DU GAUCHISME AU NEANT
- 192 lectures
Les remous de Mai 68 en France ont laissé bien des fantômes sur les rives du gauchisme. Parmi ces fantômes idéologiques, on trouve le modernisme, orientation politique plutôt vague qui, tout en se réclamant de la révolution communiste, s'attaque en fait à la continuité réelle du mouvement ouvrier et du marxisme. Le modernisme est l'idéologie de ces gauchistes intellectuels qui proclament avoir découvert une "nouvelle dynamique" du capitalisme qui "dépasse" ou "nie" les positions- défendues par Marx et le prolétariat révolutionnaire.
Mais il est évident que le rôle de l'intelligentsia gauchiste est précisément de brasser et de répandre toutes sortes de mystifications, dont la variété moderniste fait partie. Les modernistes représentent inconsciemment dans ce cadre la nécessité pour le capital actuel d'attaquer idéologiquement la classe ouvrière. Sur un autre plan, la quête des modernistes de formes de pensée se voulant " nouvelles " est engendrée par les intérêts concurrentiels du capital, perpétuellement à la recherche de nouvelles marchandises susceptibles de mieux se vendre.
Les modernistes sont trop nombreux et trop variés pour être énumérés. L'important dans ces sectes (habituellement composées d'un Hamlet avec un ou deux amis) c'est leur commune perspective anti-ouvrière. Pour elles, la classe ouvrière est une classe capitaliste comme la bourgeoisie ; la classe ouvrière équivaut à du capital et tant qu'elle produit de la plus-value (accumulée par le capital), elle reproduit seulement le capital et non la conscience communiste. Cette notion est succinctement exprimée dans un récent texte moderniste publié en Suède :
- "La classe ouvrière est donc une classe capitaliste ; on peut même dire qu'elle est la plus capitaliste. Sans elle, l'accumulation de la valeur ne peut se poursuivre ; et c'est la force vitale du capital. La domination totale de la valeur est précisément la base du capital ; et la classe ouvrière est la classe qui apporte la valeur aux produits et une partie de cette valeur est ultérieurement accumulée comme capital."[1]
La spécificité de cette idéologie ne réside pas tant dans ce qu'elle dit, et qui n'est rien d'autre que l'image que le bourgeois se fait de lui-même, attribuée à son ennemi mortel le prolétariat, mais comment elle le dit. Sa terminologie est empruntée au marxisme. Des concepts tels que "travail salarié", "valorisation", "valeur d'usage" et "valeur d'échange", etc., sont employés par les modernistes avec une dextérité et une familiarité qui peuvent étonner et confondre un lecteur qui n'est pas averti. "Sont-ils révolutionnaires ?" peut se demander un lecteur confus. "Ils ont l'air de parler du communisme, aussi y-a-t-il peut-être quelque chose dans ce qu'ils disent Mais regardons y de plus près. L'emploi facile de la terminologie marxiste n'est en fait qu'une jonglerie de mots comme un bref examen suffit à le prouver.
Bien sûr, le meilleur moyen de détruire la théorie révolutionnaire, c'est d'employer sa propre terminologie et d'ainsi mieux diluer ses implications révolutionnaires et même de l'en priver. L'obscurantisme féodal et le catholicisme ont agi ainsi contre les philosophes révolutionnaires de la bourgeoisie naissante, et le capitalisme décadent, au moyen du stalinisme et du maoïsme, fait sans cesse de même contre le marxisme. De telles attaques idéologiques inconscientes sont l'expression de la lutte de classe et agissent dans un seul sens : de la bourgeoisie contre le prolétariat. La classe ouvrière par contre n'a ni la ressource ni le besoin d'attaquer l'idéologie bourgeoise "de l'intérieur". Elle n'a qu'une seule mission : détruire le capital dans son ensemble pour construire la société communiste mondiale. Par conséquent, depuis ses débuts, c'est ouvertement que l'activité autonome du prolétariat tend à s'opposer à l'idéologie bourgeoise. Le marxisme, en tant que vision mondiale théorique du prolétariat, est la critique claire et sans ambiguïté de tous les rapports sociaux bourgeois y inclus l'idéologie. Seule une classe décadente et condamnée a besoin de semer la confusion chez son fossoyeur et de le démoraliser puisque cela peut repousser la fin inévitable de son système. En ce sens, le modernisme exprime des besoins idéologiques plus profonds que ses protagonistes ne l'admettraient.
LES RACINES DU MODERNISME.
Pendant les périodes de réaction, le prolétariat ayant subi des défaites historiques, les railleurs et les prophètes de toutes espèces braillent et vocifèrent Sur la scène politique. S'il arrive à ces individus de parler "au nom de la révolution" c'est une bonne affaire pour eux puisque leurs propos deviennent alors une marchandise plus convoitée; La fonction de tels charlatans n'est en aucun cas négligeable ; ils doivent expliquer au prolétariat vaincu les causes de sa déroute. Et, voyez-vous, le principal coupable de telles débâcles historiques se trouve être presque toujour... le prolétariat lui-même.
Depuis la plus grande défaite que le prolétariat ait jamais subie (le déclin de la vague révolutionnaire de 1917-23), un nombre incalculable de ces charlatans a "expliqué" le pourquoi de la défaite du prolétariat. Les trotskystes besogneux se lamentent sur l'absence d'un "parti révolutionnaire", les reichiens (adeptes de W. Reich) babillent sur la nature sexuelle répressive de la classe ouvrière ; d'autres plus modernes affirment que la révolution prolétarienne est un mythe inventé au XIXème siècle.
Les sources de ces attitudes et de ces "explications" viennent de l'intelligentsia gauchiste en retraite, pulvérisée par le déclin du capitalisme mondial. Dans les années 30 et 40, les sympathisants staliniens de l'Institut de Recherche Sociale" de Francfort (Marcuse, Horkheimer, Adorno) ont commencé à édifier l'ossature qu'utilisent les modernistes d'aujourd'hui. Pour eux le marxisme et le prolétariat ont fauté pour n'avoir pas été assez "révolutionnaires". Par exemple, les travailleurs n'ont pas rallié avec suffisamment d’enthousiasme la défense de l'Espagne républicaine en 36- 38, Wilhelm Reich, expliquant à la bourgeoisie pourquoi le prolétariat allemand n'a pas su défendre la démocratie bourgeoise contre le nazisme, proclamait que les ouvriers allemands "avaient choisi" Hitler et la barbarie en 1933. Incapables de voir que l'écrasement du soulèvement prolétarien de 17-23 préparait en fin de compte une nouvelle guerre impérialiste, ces dilettantes "ont choisi" avec enthousiasme de soutenir les alliés durant ce même conflit. A côté de cela, pour Reich, le prolétariat allemand semblait avoir fortement besoin d'une "thérapie de masses" capable de secouer son inhérente attraction vers le fascisme. Le professeur Marcuse et les bombardiers alliés ont fait de leur mieux pour fournir cette thérapie. Marcuse a servi l'impérialisme des alliés pendant et après la guerre (il a servi au US Office of Intelligence Research du Département d'Etat et est devenu directeur de la section de l'Europe de l'Est). Reich qui vint aux Etats-Unis en 1939, "a annoncé qu'il était prêt à mettre au point ses découvertes et leurs possibles applications militaires et à essayer par tous les moyens d'attirer l'attention sur ses travaux?[2]
Sur le plan "philosophique", les professeurs de Francfort commencèrent à adopter un point de vue légèrement différent de celui de leurs collègues staliniens. Pour Marcuse and Co, le boniment stalinien sur la base économique qui détermine directement la superstructure n'était pas assez subtile. Et en fait, il ne l'était pas. Le stalinisme est une autre expression de la récupération de la terminologie du marxisme par l'idéologie capitaliste. Par "base économique", les staliniens entendent les bureaux de planification de Vesenkha et par superstructure, les édits de Staline et de la GPU.
Au lieu d'attaquer le stalinisme de front, comme ennemi mortel du prolétariat, Marcuse et sa coterie, comme toute l'intelligentsia gauchiste, n'ont pu que ramper. Leurs "révisions" du "marxisme" n'étaient en fait qu'une partie d'échecs jouée sur l'échiquier du stalinisme et du gauchisme. Leurs critiques de la "culture", de "1’idéologie", de "l'autorité" et des autres "aspects superstructurels" n'avaient rien à dire sur le capitalisme d'Etat en Russie ou ailleurs, ou sur l'impossibilité des luttes de libération nationale à notre époque, ou sur la nature contre-révolutionnaire des syndicats et du parlementarisme. Rien en d'autres termes sur les positions que la classe a à défendre. La misère de la philosophie ne pouvait être plus grande.
Ces idéologues, et ils comprennent les sociologues gauchistes tels que Lucien Goldmann, Roland Barthes, Bruce Brown et Jürgen Habermas prétendent que le capitalisme "avancé" ou "moderne" a éliminé les différences entre la base économique de la société et sa superstructure. "Le capitalisme avancé" aurait apparemment réuni les deux, essentiellement en manipulant l'économie par les mécanismes keynésiens et par l'extension "d'un marché de consommation" illimité. Implicitement cette notion signifie que la classe ouvrière s'est fait "acheter" par un capitalisme qui ne souffre lui-même d'aucune contradiction économique fondamentale. Si la base matérielle de la société n'est plus confrontée à d'insolubles contradictions, il s'ensuit alors que les contradictions du capitalisme se sont déplacées de la base vers la superstructure. Ainsi, la "critique de la vie quotidienne (comprenant de pédantes dissections de langage, des critiques "sémiologiques", etc.)" a pris une importance prépondérante pour ces idéologues. Ils considéraient 1'analyse économique concrète de la décadence du capitalisme avec mépris comme "un problème classique s'apparentant à l'obsession et dépassé dans le capitalisme moderne."
Si la base économique du capitalisme s'était confondue avec sa superstructure, il serait alors superflu sinon réactionnaire d'établir des séparations ou des distinctions conceptuelles entre les deux domaines. La technologie et la science, devenues elles-mêmes idéologies (selon Habermas et Marcuse), rationalisent ou "légitiment" le capitalisme aujourd'hui. L'idée que le prolétariat s'exploite lui-même suit sans difficulté, puisque l'absence de difficultés économiques signifie que les ouvriers pourraient satisfaire leurs besoins matériels dans le système capitaliste. Ce qu'ils ne pourront pas satisfaire pour ces idéologues ce sont leurs "besoins sociaux". Mais la classe ouvrière ne peut pas le savoir. Elle n'est pas seulement manipulée par le capitalisme de consommation, elle se manipule elle-même dans sa recherche d’une consommation répressive illimitée.
Comme un autre commentateur gauchiste l'affirme :
- "... Les explications sur la production de la conscience doivent prendre pour point de départ les institutions de la vie quotidienne puisqu’elles sont principalement responsables de l'échec de la classe ouvrière à agir dans son propre intérêt de classe, même après la dégradation violente de ses conditions de vie et de travail. La révolution réclame la transformation de la vie au niveau micro- social comme élément de la lutte pour détruire les rapports de classe du capital puisque ces institutions arrivent "à reproduire des rapports sociaux capitalistes dans la tête des ouvriers et dans leurs relations personnelles, même quand le système est rendu impuissant à maintenir sa domination."[3]
On peut voir comment cette "fusion" de la base économique avec sa superstructure est liée à la soi-disant transformation de la classe ouvrière en une "classe capitaliste". La sagesse de ces professeurs a fourni les premières bases des positions modernistes actuelles.
Mais nous examinerons maintenant la contribution d'autres milieux gauchistes dans la naissance de l'idéologie moderniste.
LE BOOM D’APRES GUERRE ET LE GAUCHISME
Des groupes sortis après la guerre du trotskysme (Socialisme ou Barbarie aujourd'hui disparu) ont aussi contribué à l'élaboration des idées modernistes. De la même manière, la rapide décomposition de différentes sectes bordiguistes dans ces dernières années a accéléré l'apparition de revues modernistes telles qu’Invariance et Kommunismen, aujourd'hui disparu. Le stalinisme lui-même n'a pas manqué d’apporter sa propre contribution en France, centrée autour du philosophe Henri Lefebvre[4], qui avec S. ou B. ont fourni les fondements philosophiques de l'Internationale Situationniste[5] . Mais avant de pouvoir aller plus avant dans l'étude des racines actuelles du modernisme, il est nécessaire d'examiner le contexte social du capitalisme depuis 1945, et les idées qui ont fleuri sur "la société de consommation", la "société d'abondance", du "spectacle", et sur le capitalisme libéré des crises, la "gentille" théorie de S. ou B.[6]
Le boom que le capitalisme mondial a connu après 1945 a accordé une période de répit à un système social en putréfaction, en crise permanente et en décadence depuis 1914. Les tempêtes économiques actuelles qui enfoncent toujours plus profondément le capitalisme dans le bourbier de la désintégration économique, montrent à quel point l'expansion apparemment "éternelle" des années d'après-guerre était fragile. En ce sens, Mai 68 marque l'apparition d'une nouvelle période dans le mouvement ouvrier, parce qu'il indique la fin du boom économique et le début de la nouvelle résurgence de la classe ouvrière. En quelques jours les ouvriers français ont détruit beaucoup de mythes concernant la prétendue intégration au capitalisme du prolétariat. Les évènements ont également confirmé la position défendue par le mouvement ouvrier sur la nécessité de conditions matérielles préalables à une période révolutionnaire : crise économique, tendance du capitalisme mondial à l'effondrement.
Mais les idées réactionnaires meurent difficilement, surtout quand elles sont nourries par la longue période d'expansion que le capitalisme décadent a connu. La fin de la 2ème guerre mondiale n'a vu surgir aucune grande vague révolutionnaire. Les quelques surgissements qui se sont déroulés en Europe, en Grèce, au Vietnam furent impitoyablement désarmés et écrasés par les staliniens et autres forces des alliés (avec la participation critique des trotskystes). Après des années de sang versé et de destruction matérielle de toutes les économies, les ouvriers étaient prostrés et n'étaient pas en mesure de résister A la nouvelle expansion du capitalisme. En revanche, la guerre et la période qui a suivi illustrent clairement la situation à laquelle le mouvement ouvrier était confronté dans le capitalisme décadent à l'exception des mouvements révolutionnaires, la classe ouvrière ne peut plus dans cette période créer ou maintenir aucune organisation de masse permanente. Toutes les institutions que la classe ouvrière du siècle dernier avait créées pour défendre son niveau de vie (syndicats, coopératives), sont devenues des institutions capitalistes. De la même manière, les partis qui par le passé ont exprimé les buts révolutionnaires de la classe. (Social-Démocratie, PC), ne sont plus que des organes du capital depuis 50 ans.
Un tel panorama social fut trop dur A avaler pour les gauchistes. Toutes les "organisations ouvrières" ne sont rien d'autre que des organes capitalistes ? Mais comment oses-vous ! La mentalité gauchiste n'a pu que réagir avec sa haine petite-bourgeoise contre la réalité de la lutte de classe. Mais le mystère de la période de reconstruction devait avoir de toutes façons une explication, et le manque de combativité relatif de la classe ouvrière être expliqué "sociologiquement". Le mage trotskyste Mandel a "trouvé" un soi-disant néocapitalisme sorti tout droit de sa propre tète. Les professeurs de ce qui allait devenir plus tard le groupe anglais International Socialism ont inventé une "nouvelle" rationalisation de leur réformisme abject, en le basant sur une "économie d'armement permanente". Chaulieu/Cardan, une des lumières de S. ou B., commença à poser, comme les ex-trotskystes Bruno Rizzi, James Burnham et Max Shachtman l'avaient fait avant lui, une "troisième alternative historique" : le triomphe du "capitalisme bureaucratique moderne".
Ce "nouveau" système devait soi-disant dominer le globe, et avait pour principale caractéristique le fait que l'Etat pouvait contenir les crises économiques, éliminer la loi de la valeur et offrir un "cauchemar climatisé" A ses esclaves. Le boom n'était pas seulement économique ; il était également idéologique et a produit des rejetons nombreux et grotesques : l'intelligentsia gauchiste, renforcée numériquement et idéologiquement par une forte expansion de production de "gaspillage" a vécu un âge d'or durant 25 ans.
Le marcusianisme, le "guerillérisme", le situationnisme et bien d'autres "ismes" ont grandi aux côtés des partis staliniens, trotskystes et maoïstes officiels. A un niveau ou à un autre, ils ont tous adhéré au principal postulat bourgeois du boom de l'après-guerre : la classe ouvrière s'est intégrée au capitalisme. Mais si la classe était intégrée, cela semblait être le cas contraire pour les couches marginales de la société : les jeunes, les paysans vietnamiens, le lumpenprolétariat noir des Etats-Unis, Che Guevara et même Thimothy Leary. Dans "L'homme Unidimensionnel", Marcuse exprime carrément cette idée, mais elle n'est pas originale[7]. Les anarchistes avaient tenu ce genre de propos depuis un siècle. En fait toute école bourgeoise économique, politique ou sociologique considère comme allant de soi le fait que la classe ouvrière est simplement le pendant harmonieux du capital. S'interrogeant rétho- riquement, Henri Lefebvre en 1968 exprime cette idéologie :
- "Que voyons-nous ? Une société tactiquement et stratégiquement orientée vers "l'intégration de la classe ouvrière. Cela réussit en partie (par une vie au jour le jour organisée répressivement par des moyens de restrictions, par l'idéologie persuasive du pouvoir de consommation plutôt que par la réalité de la consommation), mais dans le même temps elle perd la capacité d'intégrer des éléments tels que les jeunes, les groupes ethniques, les femmes, les intellectuels, les sciences, les cultures."
Un écrivailleur américain anarchiste,
Murray Bookchin, écrivait même, plus cyniquement, en 1969 :
- "En dépit de son rôle indispensable dans le procès industriel, la classe ouvrière industrielle ne représente pas encore la majorité de la population, et sa position stratégique dans la société est érodée par l'automation et d'autres progrès technologiques. Désormais, cela nécessite un acte de haute conscience pour le prolétariat d'utiliser le pouvoir qu'il a pour réaliser une révolution sociale. Jusqu'à présent, la réalisation de cette conscience a été continuellement bloquée par le fait que l'usine est un des lieux qui se cantonne le plus à l'éthique du travail, au système hiérarchisé des managements, à l'obéissance au chef et récemment à une production de marchandises superflues et d'armements. L'usine sert non seulement à "discipliner", "unir", "organiser" les ouvriers, mais aussi à le faire d'une manière totalement bourgeoise. Dans l'usine, la production capitaliste renouvelle non seulement les rapports sociaux capitalistes chaque jour de travail, comme Marx l'a observé, mais recrée également les valeurs psychiques et l'idéologie du capitalisme."
Bookchin continue:
- "Le point essentiel est que la lutte de classe traditionnelle cesse d'avoir des implications révolutionnaires; elle se révèle être la physiologie de la société en place, non les douleurs de l'enfantement. En fait la lutte de classe traditionnelle représente une précondition à la stabilité de la société capitaliste en "corrigeant" ses abus (salaires, horaires de travail, inflation chômage "etc.)
Et pour souligner ce point" essentiel" il éclate d'une rage hystérique contre la classa ouvrière :
- "Renforcer cette structure de classe en bavardant sur le "rôle" de la classe ouvrière, renforcer cette lutte de classe "traditionnelle en lui imputant un contenu "révolutionnaire", corrompre le nouveau mouvement révolutionnaire de notre "époque par "ouvrièrite", c'est ce qu'il y a de plus profondément réactionnaire... Quand la maladie
- touche à sa fin, quand les blessures commencent à se cicatriser dans leurs plus profonds replis, alors le processus de guérison est engagé ; les implications révolutionnaire de la lutte de classe perdent leur signification en tant que construction théorique et réalité sociale. Le processus de décomposition embrasse non seulement la structure de classe traditionnelle, mais aussi la famille patriarcale, les modes autoritaires d'éducation, l'influence de la religion, les institutions de l'Etat, le mythe du travail, la renonciation, la culpabilité et la sexualité réprimée. En bref, le processus de désintégration commence maintenant à se généraliser et pénètre de fait toutes les classes, valeurs et institutions traditionnelles. Il crée des issues, des modes de luttes et des formes d'organisation entièrement nouvelles et appelle à une approche toute "nouvelle de la théorie et de la praxis."
Pour finir voilà ce qu'est devenu le message typiquement moderniste ;
- "L'ouvrier devient révolutionnaire quand "il détruit sa "condition d'ouvrier, quand il en vient ici et maintenant à détester son statut de classe, quand il commence à rejeter exactement les caractéristiques que les marxistes prisent le plus en lui : son éthique du travail, son caractère dérivé de la discipline industrielle, son respect de la hiérarchie, son obéissance au chef, son esprit de consommation, ses vestiges de puritanisme. En ce sens l'ouvrier devient révolutionnaire à partir du moment où il "perd son statut de classe et réalise une conscience de non-classe. Il dégénère et dégénère magnifiquement. Ce qu'il perd, c'est précisément ses chaînes de classe qui le lient à tous les systèmes de dominations. Il abandonne ses intérêts de classe qui le rendent esclave de l'esprit de consommation de banlieue" (De l'article Listen Marxism qui parut dans la revue américaine "Anarchos" en Mai 69)[8]
Rarement les idées modernistes ont été exprimées avec autant de cynisme. Mais de telles idées décrivent non la décomposition de la classe ouvrière, mais la désintégration de la petite-bourgeoisie gauchiste, due à l'émergence de la crise. Ce que les modernistes déplorent c'est leur propre dégénérescence en tant que couche sociale condamnée, une dégénérescence qu'ils reportent sur la classe ouvrière. Leurs propres traits psychologiques, leur propre avilissement et leur passivité sont ainsi transférés au prolétariat révolutionnaire.
COMMENT LES GAUCHISTES ET LES MODERNISTES CONSIDERENT LA CLASSE OUVRIERE
"Socialisme ou Barbarie" n'a pas appelé au rejet de la classe ouvrière dans les années 50, mais très peu de ceux qui sont devenus par la suite des " Modernistes" ne l'ont fait. L'occasion de franchir cette étape ne s'était pas encore présentée. Pour cela il leur faudra attendre un an ou deux avant 68[9]. Il est important d’insister sur CE point. Pour les trotskystes comme pour tous les autres gauchistes, la classe ouvrière englobe les syndicats. En d’autres termes, ils voient la classe ouvrière engendrer des institutions capitalistes et faisant partie de celles-ci. Ainsi S ou B s'est toujours fait le défenseur du travail dans les syndicats de toutes sortes. Certains de ses ex-militants sont devenus de grands inspirateurs idéologiques du syndicat français CFDT. (Mothé)[10].
La conception de la classe ouvrière défendue par ces ex-trotskystes ne différait pas en fait de la version des trotskystes officiels. Pour SouB le socialisme était simplement un capitalisme aménagé humainement, opérant nationalement sous la loi de la valeur (avec "salaires égaux" et production de marchandises).
La conception trotskyste ou bordiguiste n'est pas différente, sauf à propos du rô1e "dirigeant" assumé par leur parti dans "l'Etat ouvrier".
Toute la question des crises du capitalisme pour les staliniens et les trotskystes d’avant-guerre tournait autour d'un simple facteur : comment défendre la Russie stalinienne contre ses rivaux impérialistes, ravagés par le militarisme, le fascisme et l'effondrement économique. Cela renvoie à une des références à laquelle, staliniens et trotskystes font appel quand ils analysent la crise actuelle du capitalisme. Contre la crise, la classe ouvrière se doit de défendre la "Patrie Socialiste" ou les "Conquêtes d'Octobre"[11]. Le stalinisme n’a pas pu voir dans la classe ouvrière autre chose que de la chair à canon pour défendre et maintenir le pouvoir de la classe capitaliste bureaucratique de Russie. Le trotskysme, toujours à la remorque du stalinisme, parle de la classe ouvrière dans les mêmes termes même de "façon critique". L'extension du pouvoir russe sur l'Europe de l'Est a été considérée par la majorité des trotskystes comme une extension des "conquêtes d'Octobre", quoique "dégénérée".
Ce mépris de la classe ouvrière, ce dévoiement capitaliste des conquêtes de la classe ouvrière est inhérent au trotskysme dès sa naissance. Il suffit de lire les recettes du "Programme de Transition" de 1938 ou n'importe quel journal trotskyste d'aujourd’hui pour voir la nature profondément capitaliste d'Etat du trotskysme. Il y a donc un lien organique entre l'idée d'après-guerre selon laquelle la classe ouvrière a capitulé devant le capitalisme et la conception gauchiste de la classe ouvrière. Le gauchisme a toujours considéré comme établi le fait que la classe ouvrière soit intégrée au capitalisme. Les bureaucrates de la social-démocratie en 1914 l'admettaient aussi quand ils apportaient leur soutien à la première guerre impérialiste. Les stalinistes et leurs valets trotskystes l'admettent également chaque fois qu'ils ont essayé ou qu'ils essaient de mobiliser les travailleurs pour des guerres impérialistes (comme en 39-45), pour des luttes de libération nationale, pour le syndicalisme, le parlementarisme et d'autres politiques capitalistes.
Quand Lénine, en 1902, affirme que la conscience socialiste est extérieure à la classe ouvrière, il exprimait une incompréhension fondamentale, que la totalité du mouvement ouvrier partageait à un degré ou à un autre à cette époque. Aujourd'hui, une telle conception n'est pas une erreur mais un mensonge réactionnaire. Quand, aujourd'hui, les trotskystes ou les gauchistes en général parlent du "rôle d'avant-garde du parti" dans ce qu'ils imaginent être une révolution socialiste, ils considèrent que la classe ouvrière bien entendu est intégrée au capitalisme. Par conséquent, le prolétariat a seulement besoin d'un Etat-Major pour l'organiser, pour lui injecter la "conscience communiste" (il faut lire les "escroqueries du capitalisme d'Etat"), parce que les travailleurs, voyez-vous, laissés à eux-mêmes, sont seulement capables d'"économisme" ou de "trade-unionisme". Et puisque ces dernières tendances sont des "idéologies bourgeoises",(en fait, ni plus ni moins que le trotskysme), cela montre que la classe ouvrière n'est qu'une classe-en-soi "dominée par la bourgeoisie", qui attend l'arrivée de Messieurs Healy, Cliff, Mandel, Hansen, Frank et de toute cette cabale de petits Staline.
Entre la conception bourgeoise qu'ont les gauchistes de la classe ouvrière et celle des modernistes, il n'y a qu'une différence de degré.
Il est vrai que les modernistes s'opposent aux tactiques d'avant-garde des staliniens et des trotskystes, et que généralement ils planent au-dessus des anarchistes ignares en jonglant avec les mots. Mais leur vision de la classe est la même. C'est le point de vue Capitaliste de l'intelligentsia gauchiste, couche créée, ordonnée et désintégrée par le développement d'après-guerre du capitalisme décadent. Pour les gauchistes, (staliniens, trotskystes, maoïstes, etc.), la conscience communiste vient de l’"intelligentsia" socialiste scientifique, qui ensuite l'apporte aux ouvriers, comme Prométhée a apporté le feu à l'humanité. De la même manière, les modernistes, la conscience communiste naît des cerveaux des intellectuels "communistes" (c'est à dire d'eux-mêmes). Mais, contrairement aux gauchistes, ces sages s'abstiennent de déverser leur savoir sur les ouvriers. Les prolétaires ne méritent pas une telle "faveur". Après tout quel besoin a une classe capitaliste de la "conscience communiste". Les modernistes tendent à faire circuler leurs textes uniquement entre eux ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas une mauvaise chose.
NODENS
Extrait du n*4 de World Révolution.
[1] "Un texte qui n'en est pas un à proprement parler". Janvier-75.
[2] Cité dans : "La vie et l'œuvre de Wilhelm Reich" de Michel Cartier, New York 1973, p. 207.
[3] Critique de l'ouvrage de Bruce Brown par Stanley Aronowitz : "Marx, Freud et la critique de la vie quotidienne", parue chez Télos 18 (p. 180).
[4] Voir sa "critique de la vie quotidienne", Paris 1958 et la "Vie quotidienne* 1 2 3 4 5 6 7 dans le monde moderne" Paris 1968.
[5] Pour une documentation sur l’évolution des situationnistes, voir : "Leaving in the 20th century. The incomplète work of the Situationist International", traduit et édité par l'ex situationniste C. Gray, qui, actuellement, soutient (!)... une campagne de propagande massive afin de faire connaître au public la possibilité d'une révolution... simultanément avec la création de "thérapeutiques de masse11 Londres 1974, p. 167.
[6] Pour un regard critique sur l'origine, les idées et le destin de S ou B, voir les analyses suivantes publiées par nos camarades français :
- - "Lettre d'un camarades de R.I, au groupe de Aberdeen" dans le bulletin d'études et de discussion de RI, n°2, mai 1973, p.29.
- "Une tentative de dépassement du marxisme : S ou B" dans le bulletin d'études et de discussion n° 11, janvier 75, p.2.
[7] Ces idées sont encore très en vogue. Un best-seller relativement récent "The greening of America", de Charles Reich. Cet auteur prôner la "persuasion" et "un changement dans la conscience" par les charades démocratiques bourgeoises. A partir des mêmes prémisses que Marcuse, il arrive à des conclusions plus savoureuses sur les couches moyennes.
[8] Ce joyau fit couler beaucoup d'encre de la part des sectes réactionnaires. Par exemple le Britlsh Solidarity Group (influencé par Cardan) fit une critique de cette brochure en 1970 et dit: "C'est indubitablement la meilleure brochure anarchiste produite depuis des années." Le critique, expert en la matière, conclue : "Inutile de dire que c'est le travail d'un ex-marxiste" (sic). Solidarity, vol.6 n° 5 p.20.
[9] Dans "Le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande", 1965, les situationnistes ont déjà commencé à parler de l'intégration du prolétariat classique à la "société du spectacle". Les émeutes noires de Watts étaient soi-disant la "négation" de la marchandise, alors que les blancs en étaient esclaves.
Selon Cardan (1964), utiliser le terne de prolétariat c'était... se laisser aller à une sociologie purement descriptive. "Redéfinition de la révolution", Londres 1974,p.9. Cette négation conceptuelle du prolétariat était devenue le label de la "Nouvelle Gauche!' en Europe et aux Etats Unis.
[10] Cardan, sous le nom de Coudray, se situait entièrement dans cette tradition gauchiste quand il écrivit en 1968: "En mime temps il est nécessaire d'appeler les travailleurs à rejoindre la CFDT, sans leut laisser aucune illusion sur le syndicat en tant que tel parce qu'elle est la moins bureaucratisée, la plus perméable à sa base aux idées du mouvement, et qu'elle permet de poser la question de l'autogestion, qui est bonne non seulement en dehors du syndicat, mais aussi pour la section syndicale, le syndicat lui-même, la fédération et la confédération". "La révolution anticipée", mai 68. La Brèche, Paris 68, p. lll et 112.
Les sympathisants anglais de Cardan ont toujours caché soigneusement ces passages, puisque Solidarity se déclare "contre" les syndicats. Mais leur respect pour le "shop-stewardisme" est bien connu. Un autre rejeton de S ou B, la revue française "Lutte de Classe", éprouve une égale fascination pour le shop-stewardisme et donc pour les mystifications capitalistes de l'autogestion.
[11] Or, comme diraient les maoïstes, les ouvriers et les capitalistes progressistes doivent défendre la Chine de Mao. En France, la pernicieuse idéologie maoïste s'est facilement fondue avec des bribes d'anarchisme même avant mai 68. L'interview suivante de D. Cohn Bendit, la prima dona de l'anarchisme en mai 68, est instructive à ce niveau : "Q-: Vous prenez quelques éléments de votre définition du socialisme dans Trotsky et dans Mao? R-: De Mao en fait. Par exemple. Mao rompt avec le léninisme au sens strict du terme quand il fait confiance à une autre classe que la classe ouvrière : la paysannerie. Les communes villageoises sont aussi pour nous une forme d'organisation tout à fait souhaitable." Tiré de "l'anarchisme dans le mouvement de mai 68 en France, Londres 1973, p. 11. Cohn Bendit s'abstient de tout commentaire sur le charme de la "réhabilitation maoïste" dans les camps politiques. Mais en dépit de telles omissions, le journaliste, orateur verbeux,
E. Morin, s'empresse d'applaudir: "sa pensée était plus lucide à cette époque que les plus éminentes figures académiques et politiques." En d'autres termes, il était presque aussi lucide qu'Edgar Morin.
Courants politiques:
Révolution Internationale - 1976
- 897 lectures
Revolution Internationale N°22 - fevrier
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 2.06 Mo |
- 664 lectures
De l’irresponsabilité en matière d’organisation
- 639 lectures
REUNION OUVERTE DE LA SECTION DE PARIS
Comme chaque mois, la section de Paris de "Révolution Internationale" a organisé le 10 janvier 1976 une réunion publique sur le thème de "Organisation et regroupement des révolutionnaires". Cette réunion a mis en relief, par l'affluence qu'elle a connue et l'animation des débats, l'intérêt provoqué par ce sujet parmi les éléments proches des positions révolutionnaires. Elle a mis également en évidence la confusion qui persiste encore en ce qui concerne tant la fonction des révolutionnaires qui sont souvent vus comme des "confectionneurs de feuilles de boites” ou comme des individualités allant de cercle d'étude en revue éclectique peur s'adresser "personnellement" à la classe, qu'en ce qui concerne la nécessité de regrouper ceux-ci dans un corps organisé autour d'un programme clair et cohérent. En particulier, la notion fondamentale de frontière de classe sur laquelle l'histoire a tranché de façon définitive et qui établit la distinction entre les organisations de la classe ouvrière et celles de la bourgeoisie est malheureusement trop souvent méconnue ou interprétée comme un artifice sectaire.
Mais le point particulier sur lequel a porté notre insistance a été celui de l'absolue nécessité du regroupement des forces révolutionnaires à l'échelle mondiale avant même que la classe ne s'engage dans ses combats décisifs. En effet, à côté des conceptions qui nient toute nécessité pour la classe de se donner une organisation de ses éléments les plus conscients, à côté de celles qui sont d'accord avec une organisation des révolutionnaires mais à condition qu'elle ne joue aucun rôle, on en trouve de plus subtiles encore, qui veulent bien que les révolutionnaires s'organisent à l'échelle mondiale dans le but d'influencer la lutte de classe mais qui considèrent que "ce n'est pas encore le moment". Souvent ces conceptions considèrent que c'est dans les affrontements révolutionnaires eux-mêmes que se constitue cette organisation et que vouloir regrouper les forces révolutionnaires avant que la classe ne soit confrontée au problème de la prise du pouvoir n'est rien d'autre que du "volontarisme organisationnel". Les expériences sanglantes de la classe et particulièrement celles du prolétariat allemand en 1919 qui se soulève alors que les révolutionnaires viennent juste de se regrouper et qui, faute d'une vision d'ensemble de sa lutte, est écrasé par la bourgeoisie ville après ville, montrent à quel point une telle vision est irresponsable. Une des grandes carences de la grande vague révolutionnaire qui suit la première guerre mondiale est le retard avec lequel se constitue l'organisation mondiale de son avant-garde. Quand l'Internationale Communiste est fondée en mars 1919, les plus grands combats de la classe ont déjà eu lieu et la classe a déjà subi les défaites qui s'avéreront décisives. S'il est une leçon que les révolutionnaires se doivent de méditer, c'est bien celle-ci, afin de s'atteler, dès maintenant, à la tâche du regroupement mondial de leurs forces. Les révolutionnaires ne devront pas s'unifier "le plus tard possible" mais au contraire le plus tôt possible, afin que leur organisation ait eu le temps de se renforcer le plus possible avant d'affronter l'épreuve du feu des combats révolutionnaires.
L'effort actuel vers l'unification mondiale des révolutionnaires affronte toute une série d'entraves qui ont principalement pour origines la rupture organique survenue comme conséquence d'un demi-siècle de contre révolution dans les fractions communistes du passé, et le poids idéologique de la petite bourgeoisie, particulièrement intellectuelle, en pleine décomposition sous les coups de boutoir de la décadence et de la crise aigüe du capitalisme.
Le premier de ces deux phénomènes a eu pour effet de priver les courants révolutionnaires que la reprise présente de la classe a fait surgir, d'une somme d'expériences pratiques que les fractions du passé avaient capitalisé et qui s'est perdue, pour une part importante, avec elles. C'est justement sur la question d'organisation que ces expériences étaient le plus précieuses et que c'est en grande partie à travers leur propre pratique que les révolutionnaires d'aujourd'hui ont été amenés à comprendre ce qui dans le passé avait été acquis depuis longtemps.
Le deuxième de ces phénomènes est un boulet que le mouvement ouvrier traîne à son pied depuis ses débuts dans la mesure où les rangs prolétariens ont reçu à toute époque des éléments venant de la petite bourgeoisie et transmettant avec eux leurs préjugés de classe. Ce phénomène se poursuit aujourd'hui de façon intense, mais c'est surtout de la part des couches de la petite bourgeoisie intellectuelle que le prolétariat subit les assauts idéologiques les plus importants.
Manifestation la plus spectaculaire de la crise de cette couche sociale, le "mouvement étudiant" connaît son apogée au moment du début de la reprise prolétarienne et, de ce fait, ses scories viennent encombrer fortement la conscience des groupes que celle-ci a fait surgir. Ces scories se manifestent essentiellement sous forme des cultes à la "nouveauté", de la "singularité", de la phrase, de l'individu, etc. qui réussissent souvent à transformer ces groupes en de simples sectes plus préoccupées de mettre en relief ce qui les distingue des autres afin de justifier leur existence séparée que d'œuvrer dans le sens d'un rapprochement.
L'ATTITUDE DU PIC
Une illustration éclatante de cet esprit de secte nous a été fournie par l'attitude du PIC par rapport à cette réunion ouverte. Dans la lettre que nous publions à la suite, nous invitions les camarades de cette organisation à venir débattre publiquement de la question inscrite à l'ordre du jour et qui constitue justement la divergence essentielle entre nos deux organisations. Nous pensons en effet que c'est par une confrontation publique que les positions en discussion ont le plus de possibilité de s'éclaircir face aux éléments qui s'approchent d'une orientation révolutionnaire et qui sont désemparés par l'existence de deux organisations se réclamant d'un même programme fondamental. Malheureusement, le PIC n'a pas jugé nécessaire de venir à notre réunion, ni même de donner une réponse à notre lettre d'invitation. Cette réponse, se trouvait en fait, de façon implicite, dans le n° 8 de "Jeune Taupe", l'organe du PIC, qui consacrait deux pages pour signifier à ses lecteurs deux choses fondamentales:
- 1. que "RI est le roi des cons"
- 2. que "... le PIC décide de ne plus entretenir aucun contact (correspondance, réunions, échanges divers...) avec une organisation dont les tendances contre-révolutionnaires et les méthodes appropriées à ces tendances ne feront que s'amplifier".
Pour justifier cette rupture, le PIC donne les arguments suivants:
- "Depuis plusieurs numéros de sa revue, le groupe "Révolution Internationale" s'acharne à vouloir jeter le discrédit sur le P.I.C…"
- "Loin de faire des critiques politiques et de débattre en toute fraternité" de groupe à groupe dans la mesure où ceux-ci pouvaient se placer sur un terrain de classe, R.I. a préféré, dans sa logique de volontarisme organisationnel, de recrutement forcené, de formation de "cadres révolutionnaires", de "lutte pour le pouvoir" au sein de la clarification communiste, répandre une quantité importante de mensonges".
- "devant la teneur des références au P.I.C. dans un article du n° 20 de RI. -...- nous estimons que le seuil de tolérance a été dépassé dans le chapitre des injures et des calomnies."
- "que les attaques telles qu'elles sont adressées à un individu (notre camarade cité dans l'article), relèvent des méthodes staliniennes les plus éculées (souligné par J.T.)
Nous ne suivrons pas le PIC sur son terrain: à l'accusation de mensonge pour motiver une rupture, nous dirons que c'est là la seule chose qu'aient été capable de faire tous les groupes qui ont refusé le débat politique avec nous (à commencer par l'Internationale Situationniste).
Le PIC se plaint de l'acharnement de R.I. contre lui. Que devrions-nous dire pour notre part puisque pratiquement tous les numéros de "Jeune Taupe" contiennent des attaques contre R.I. ou le C.C.I. Le numéro un de cette publication donnait d'ailleurs le ton dans son article : "L'affaire Puig Antich: Certains se démasquent" (page 8):
- "Le groupe R.I. notamment, qui prétend représenter le "pôle" du courant communiste, a révélé un aspect de sa non- activité caractéristique de ses tabous de secte élitiste par rapport au processus du mouvement prolétarien. Ses justifications pour ne pas assurer la défense des emprisonnés (...) sont proprement puantes (souligné par J.T.)
Loin de prendre la mouche, R.I. n'a pas tiré argument de ces termes (que les lecteurs pourront comparer avec ceux incriminés dans le n° 20 de RI) pour rompre toute relation avec le P.I.C. Au contraire, les camarades de ce groupe ont été invités à la même époque à la réunion nationale de R.I., le P.I.C. a été invité à s'associer et signer le tract "Au Portugal, le capital affronte le prolétariat mondial" de juin 74, de même qu'il a été invité, en Janvier-75, à la conférence de notre courant international.
Notre attitude fraternelle à l'égard du P.I.C. est même allée jusqu'à la mise à la disposition de ce groupe, qui ne s'était même pas donné les moyens de sa volonté "d'intervention", de notre propre matériel pour la confection de sa publication. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence: le maintien et même l'accentuation de l'hostilité du P.I.C. à l'égard de R.I. est devenue la preuve que le P.I.C. existait essentiellement contre R.I. A partir de ce moment, il devenait également évident que le P.I.C. n'apportait pas une contribution positive à l'effort des révolutionnaires vers leur regroupement mais constituait un obstacle à cet effort, ce que depuis lors nous avons dénoncé comme tel. La décision du P.I.C. de rompre tout contact avec nous constitue une illustration éclatante de l'esprit de secte qui anime cette organisation. Elle est à rapprocher de celle du "Communist Workers' Organization".
Au même titre que le "Communist Workers’ Organisation" qui, en inventant de nouvelles frontières de classe a placé d'autorité le C.C.I. dans le camp capitaliste, le P.I.C. est donc en train de faire la preuve de l'irresponsabilité de ces groupes qui n'ont entre eux de commun que de cultiver leur singularité. Faudra-t-il que la classe connaisse un autre échec sanglant, bien plus terrible encore que les précédents pour que ces courants comprennent que les intérêts historiques du prolétariat se placent infiniment au-dessus de leurs petits intérêts mesquins.
CG.
"La Secte cherche la justification de son existence et son point d'honneur, non pas dans ce qu'elle a de commun avec le mouvement de la classe, mais dans la silhouette particulière qui l'en distingue".
Marx (Lettre à Weydemeyer)
Paris, 12/12/75
Chers Camarades,
Le samedi 10 janvier 1976, la section de Paris de "Révolution Internationale" organise une réunion ouverte sur le thème du "Regroupement des révolutionnaires" à laquelle nous convions cordialement le PIC à participer et à y défendre publiquement ses positions.
Les réunions de ce type organisées par notre groupe sont en principe ouvertes à toute personne intéressée par les positions révolutionnaires et, les membres du PIC peuvent donc venir à chacune d'elles, mais la raison pour laquelle nous vous transmettons une invitation spéciale à celle du 10 janvier réside dans la nature du sujet traité ce jour-là.
En effet, le problème du regroupement des révolutionnaires autour d'une cohérence principielle fondamentale a toujours été crucial dans le développement pratique et théorique de la lutte de classe. Dès le "Manifeste Communiste", l'unité internationale du prolétariat et de son avant-garde était posée comme une nécessité de la lutte de celui-ci. La fonction essentielle de l'AIT, quant à elle, était, de l'avis même de ses fondateurs, de réaliser l'unification des forces vives du prolétariat mondial, en particulier par le dépassement des sectes de la période antérieure. Par la suite, cette question s'est reposée avec insistance à chaque moment décisif de la lutte de classe, quelque fois de façon tragique si on songe, par exemple, au poids énorme qui a pesé dans l'échec de la Révolution en Allemagne en 1919, l'incapacité des révolutionnaires de ce pays à se regrouper à temps.
Aujourd'hui, au moment où l'effondrement croissant de l'économie capitaliste pousse la classe ouvrière dans la voie d'une reprise de la lutte révolutionnaire, les communistes sont de nouveau placés devant leurs responsabilités historiques dont celle de leur indispensable unité, d'autant plus difficile à assumer que pèse sur eux le poids de la rupture organisationnelle avec les fractions communistes du passé, provoquée par un demi-siècle de contre-révolution.
C'est parce que le PIC et RI défendent les mêmes principes fondamentaux et que leur divergence essentielle porte justement sur ce problème du regroupement, que nous jugeons très importante votre participation à notre réunion ouverte. Nous pensons effectivement que c'est publiquement, face à ceux qui s'intéressent à nos positions communes, et qui bien souvent n'arrivent pas à bien comprendre où se situent nos divergences, que doit se poursuivre le débat existant entre nos deux organisations. Nous sommes sincèrement convaincus qu'un tel débat public, au cours duquel vous disposerez évidemment des mêmes moyens que nous pour défendre votre point de vue, devrait permettre tant à ces éléments proches qu'à nos deux organisations de faire un pas de plus dans la compréhension de ce problème crucial.
En espérant que vous donnerez une suite positive à notre proposition, nous vous transmettons, chers camarades, nos salutations communistes.
Révolution Internationale.
Vie du CCI:
«Le Prolétaire» ou comment dénaturer les acquis de la «Gauche Communiste»
- 861 lectures
Récemment, "Le Prolétaire", organe du Parti communiste international a publié deux articles (n° 203-204) sous le titre de "la légende d'une gauche européenne" consacrés à la "critique" de "Révolution Internationale et ses amis".
Nous aurons l'occasion de faire à notre tour une critique plus approfondie de ce courant politique dans la "Revue Internationale", non pour offrir au PCI une réponse en bonne et due forme mais pour montrer par le négatif du PCI ce qu'est le marxisme -comme acquis fondamental de la lutte de classe du prolétariat- et comment l'héritage des fractions communistes (de Bilan en particulier), loin d'être l'expression d'un prétendu marxisme "occidental" ou "européen" est l'héritage vivant et fondamental de la dernière vague révolutionnaire, lequel est la source authentique du programme communiste aujourd'hui.
Pour nos lecteurs qui seraient peu au courant des positions de ce "parti", voire de son existence, il est bon d'apporter quelques précisions. Le Parti communiste international se réclame de la Troisième Internationale et se proclame le plus fidèle continuateur de Lénine et "marxiste invariant", se dit le continuateur de la Gauche italienne née en 1919 comme "Fraction communiste abstentionniste" et dont le représentant le plus important fut Amadeo Bordiga. C'est autour de Bilan, dans les années trente et jusqu'à la fin du second conflit impérialiste, que devaient se regrouper les éléments révolutionnaires issus de la Gauche communiste italienne. Né en 1943 sous le nom de Parti communiste internationaliste en Italie, mais existant sous sa forme actuelle depuis 1952 - date de la scission d'avec le groupe Damen, fondateur réel de ce parti, qui continue son activité autour du journal Battaglia comunista, le parti bordiguiste regroupé en France et en Italie autour de "Programma comunista" et du "Prolétaire" n'a en fait plus rien à voir avec le glorieux passé de la Gauche italienne.
Aujourd'hui les "programmistes" ne se distinguent plus qu'à grand peine des trotskystes. Faisant depuis plus de 25 ans l'apologie des mouvements nationalistes du tiers monde ("peuples de couleur"), se faisant depuis quelques années les donneurs de conseils aux groupes gauchistes, auxquels ils reprochent leur "opportunisme", il ne manquait plus à leur brillant tableau que de se faire les propagandistes de l'urne démocratique à l'occasion de référendums en Italie et en Suisse, ce qui est un comblé pour des gens se réclamant de la "Fraction communiste abstentionniste" et qui il y a dix ans proclamaient que "le prolétariat naissait antiparlementaire".
Depuis deux ans, la pénétration des idées trotskystes s'est faite toujours plus profonde au sein du PCI. Si le parti "bordiguiste" ne préconise pas encore le "Front unique"-"tactique" préconisée par le troisième Congrès de l'IC pour "gagner les masses" avec "l'opportunisme" que sous sa forme syndicale, et non sous sa forme politique comme le font les trotskystes, il préconise aujourd'hui ouvertement, tout comme ces derniers, le programme minimum des réformistes du siècle dernier qu'il n'ose encore baptiser "programme de transition". Le programme communiste "intégral" de la révolution est devenu un livre de recettes (35 heures, travail pour tous, chômage payé à 90%, etc.) s'adressant à chaque catégorie particulière du prolétariat qu'on divise en femmes, jeunes, etc., recettes qu'on, jette en pâture aux ouvriers à qui on laisse espérer que leur seule action économique pour des réformes impossibles pourrait remplir leurs ventres affamés par la crise. Misérables recettes de charlatans qui proposent aux ouvriers d'accommoder avec le vide de phrase creuses les restes putréfiés d'un capitalisme sénile.
Une telle continuité dans la prostitution des acquis de la «Gauche Communiste» n'a d'égale, dans la série d'articles mentionnés que leur impudence à falsifier le passé. Selon eux, "Bilan a fait des erreurs politiques, c'étaient justement des erreurs, des concessions à des courants de type "gauche européenne" mais ceci dans une attitude oscillante qui interdit de prétendre que Bilan avait une théorie particulière qui aurait révisé les positions originelles de l'Internationale et de la Gauche".
LES "ERREURS" DE BILAN
Voyons un peu ce que le PCI appelle les "erreurs" de Bilan:
- l'internationalisme. sans doute? Bilan a commis en effet "l'erreur" dans les années trente de rejeter sans hésitation toute forme de nationalisme, tout ce qui prend le nom aujourd'hui de tiers-mondisme, de préconiser le défaitisme révolutionnaire dans les deux camps lors de la guerre italo-éthiopienne, lors de la guerre entre la Chine et le Japon, en opposition totale au trotskysme. "Erreur", le refus de défendre l'Espagne républicaine, "erreur" cette fermeté inébranlable à défendre le camp prolétarien et à lutter avec intransigeance contre toutes les fractions du camp du capitalisme du POUM aux anarchistes;
- la remise en cause des positions erronées de l'I.C. qui ont servi de .justification à la contre-révolution stalinienne. Si Bilan reste oscillant ' sur la question syndicale, il remet en cause l'idée partagée par les révolutionnaires des années 20 que le parti doit se fondre dans l'Etat et gouverner au nom du prolétariat. C'est Bilan qui affirme à travers les articles de Mitchell que la dictature du prolétariat ne peut s'exercer qu'à travers les organisations unitaires de la classe : les conseils ouvriers, dont l'existence et l'autonomie sont la condition même de la consolidation du pouvoir prolétarien;
- la définition du cycle du capital après 14. En continuité avec les thèses -défendues par l'IC à ses débuts, Bilan puis Communisme (organe de la fraction belge) réaffirment fortement que la première guerre impérialiste a ouvert l'heure de la révolution mondiale du prolétariat dans la phase de déclin historique du système capitaliste, en complète opposition aux thèses du PCI qui prétend qu'aujourd'hui le capitalisme poursuit un cycle d'expansion "juvénile" dans les pays de l'Est ou du tiers monde;
- définition de la Fraction 'comme l'embryon du futur parti, lequel ne peut surgir qu'en période de lutte intense du prolétariat,. Et donc condamnation d'avance de la formation aventuriste du Parti en 43, alors que triomphait sur toute la ligne la mystification démocratique et antifasciste, dans la pire con fusion.
Ce sont tous ces acquis immenses du prolétariat, les principaux des années trente, que le PCI veut ensevelir dans l'oubli, ne voulant y voir que des errements infantiles,-sous l'influence ... d’une prétendue "Gauche européenne". II est vrai que les éléments qui furent expulsés de "Bilan" pour leur participation à la guerre d'Espagne dans le camp impérialiste républicain et ressurgirent à la fin de la guerre à la tête du PCI sont peu enclins à voir dans les positions de "Bilan" les vrais positions internationalistes défendues par la petite, poignée de révolutionnaires de l'époque.
Voyons maintenant ce que le PCI entend par "gauche européenne" ou "marxisme occidental". Selon lui, il y aurait eu après 14 deux sortes de gauche: une gauche européenne incarnée par la gauche allemande et la gauche russe "léniniste", véritablement internationale. C'est une pure mystification digne de tous les mensonges bourgeois de l'époque et d'aujourd'hui que de présenter la révolution qui a suivi le premier après-guerre comme purement russe, les fractions communistes des pays industrialisés en sorte comme une réaction "occidentale" menchevik, aux excès des Russes, contre "la barbarie et l'arriération russe, la magnifique révolution occidentale et civilisée" (Le Prolétaire n° 204). Ce que le PCI appelle "gauche occidentale" était :
- a) Comme le parti bolchevik en 1914, l'expression de tout le courant de la gauche internationale, qui mènent une lutte intransigeante contre la dégénérescence de la deuxième Internationale. Après le passage de celle-ci à l'ennemi, la "gauche européenne" italienne et surtout allemande œuvra de toutes ses forces à la formation d'une fraction communiste indépendante, en liaison avec les bolcheviks dans le cas des "linksradikalen" de Brème, dont Pannekoek était membre. Son combat est inséparable de celui de toute la gauche communiste internationale contre la guerre et la trahison social-démocrate.
- b) Avec la gauche russe (groupe ouvrier de Miasnikov, Ossinakl, Sapronov), cette prétendue "gauche occidentale" engage un combat acharné contre la dégénérescence de la révolution russe et œuvra dès 1922 (et non dès 1920 comme le prétend le Prolétaire) au regroupement des éléments révolutionnaires dans une nouvelle Internationale (la KAI), afin de maintenir toujours levé le drapeau du communisme. Après la disparition physique de la gauche allemande au début des années 30, ce fut la gauche italienne qui reprit le flambeau de l'internationalisme, avec la fondation des fractions belge et française (Communisme, Internationalisme). Cherchant à tout prix à resserrer les liens distendus entre fractions communistes isolées, Bilan publia des textes des camarades du GIK de Hollande, dont il fit toujours une critique pleine de chaleur révolutionnaire.
- c) Lorsque le Prolétaire sépare révolution "européenne": "Embourbée dans le démocratisme, l'immédiatisme, l'autonomisme, l'anti-autoritarisme, le mépris aristocratique pour la violence "aveugle" et la peur de quitter le terrain du légalisme", de la Révolution russe, non seulement il ne veut pas reconnaitre que l'extension et la mort de la révolution se firent simultanément, le prolétariat étant écrasé, mais il fait une assimilation calomnieuse de toute la Gauche avec la social-démocratie traître De tels mensonges jetés sur ce qui reste l'acquis du marxisme révolutionnaire aujourd'hui, suffisent pour juger à quel degré de sclérose le PCI qui ose -sans la moindre honte- se réclamer de la vraie gauche italienne.
Comment expliquer une telle attitude? On se tromperait en voulant voir dans leur apologie inconditionnelle du parti bolchevik l'origine de leur dégénérescence. Des bolcheviks, ils ont oublié tout l'enseignement révolutionnaire; à l'inverse, des mencheviks ils reprennent de plus en plus les positions, authentiquement contre-révolutionnaires Toute la politique des "programmistes" qui se font de plus en plus les idéologues des "révolutions nationales", "bourgeoises", "des insurrections des peuples opprimés" n'est que la continuation de toute la politique mencheviste. Ces "défenseurs" de la Révolution "russe", "léniniste" contre les partis "infantiles", "extrémistes" de l'"Occident" ne font que reprendre, bien après les Dan et Tsérétéli la théorie des staliniens et des gauchistes d'aujourd'hui "de la voie nationale au socialisme". En niant le caractère international de la révolution, qui dans le passé s'est manifestée par l'apparition simultanée en Europe des fractions communistes -apparition qui débordait largement le cadre européen-, ils ne peuvent qu'être amenés à cracher sur tout ce qui incarne mondialement le communisme. Il est logique qu'après avoir fait si longtemps silence sur Bilan, ils ne voient plus dans les positions de la Gauche italienne des années trente que des "Bourdes" (sic).
Les "programmistes" devraient être plus logiques: la "Fraction communiste abstentionniste" qui rejeta la conception du parlementarisme révolutionnaire a fait des "bourdes" de type "infantile" et "occidental"; la lutte contre les Serrati, réintégrés dans l'Internationale sur l'ordre de Lénine, a été non moins une "bourde", de même que le refus de cautionner la politique zinoviéviste des "gouvernements ouvriers".
Quant" à permettre la publication dans «Il Soviet», le journal fondé à Naples par Bordiga, de textes de Pannekoek, Gorter, Pankhurst en 1919-20, il a fallu que la "Fraction abstentionniste" soit déjà terriblement gangrenée par "des concessions à des courants de type "gauche européenne".
RI "ANARCHISTE"
Pour le PCI la résurgence du courant de la gauche communiste à travers "RI et ses amis"'(entendez par là le Courant communiste international) correspond au fait que : "la victoire théorique du marxisme sur le bakouninisme a eu son revers de la médaille; en fait, l'anarchisme aujourd'hui se voit dans l'obligation de "couvrir d'un voile marxiste le vieux fond idéaliste, stirnérien et pré-marxiste". Il est vrai que le PCI croit bon de nous assimiler, nous les bakouninistes, à des "professeurs de marxisme" (n° 204). En sorte, aujourd'hui, les "anarchistes" se doivent de donner des leçons de marxisme pour donner le chancre.
0k ne pourrait que s'esclaffer à la lecture de telles niaiseries, si le PCI ne cherchait -avec une mauvaise foi aussi voyante que-grossière- à présenter le KAPD comme "une école méprisable" et à faire apparaître: calomnieusement notre Courant comme "ultragauche en paroles, ultraconservateur dans les faits". Depuis plus de cinquante ans, la calomnie portée sur la théorie révolutionnaire est la seule invariance que connaissant soit les opportunistes soit les ennemis déclarés de la révolution prolétarienne et cela ne saurait étonner les révolutionnaires.
Mais voyons ce qu'il en est exactement de l'anarchisme de "RI et de ses amis". Examinons les points les plus importants et les plus significatifs qui sont censés définir les anarchistes:
- a) L'Etat. Est "anarchiste" la position de répéter après Engels que l'Etat est le fléau dont hérite le prolétariat après la résolution. Est "anarchiste" sans doute, la position répétée mille fois par Lénine au début de la révolution "russe" - que la dictature du prolétariat s'exprime par les Conseils ouvriers. Comme ".Bilan", nous répétons que les conseils ouvriers sont la seule forme du pouvoir prolétarien et que le parti ne peut se substituer à la classe en prenant en main les affaires de l'Etat et nous rejetons comme une idée tout à fait de type populiste le fait qu'une petite minorité de la classe puisse se Substituer à l'action générale de la classe; (idée "léniniste" et "bordiguiste" que le parti prend le pouvoir).
- b) Sur la violence. Ce sont surtout les anarchistes qui considèrent la révolution par essence comme le simple et limité exercice de la violence du prolétariat contre la bourgeoisie. Certains, comme Sorel, considéraient même la violence comme une pédagogie destinée à éveiller le prolétariat à la conscience (on voit que les "programmistes" n'ont rien innové). Pour le camp marxiste, il ne se discute plus si le prolétariat fera une révolution "Violente”; la reconnaissance et la défense acharnée de la nécessité de violence de la classe pour détruire les chaînes du vieux monde sont depuis longtemps une frontière de classe.
Seule peut être discutée dans le camp marxiste la forme que prend la violence de classe : violence globale exercée par l'ensemble de la classe, liée au développement de la prise de conscience de la classe, ou minoritaire, fait de quelques groupes ou individus non contrôlés par les organes de la classe, et, derechef, aveugles. Contrairement aux anarchistes qui voient dans la violence et le terrorisme la réalisation immédiate du communisme, nous affirmons, en conformité avec la théorie marxiste, qu'elle est un moyen pour réaliser le but, le communisme, pour lequel ont surgi les Conseils ouvriers et les partis du prolétariat. Figer la révolution dans la phase de violence de la classe conduit à une mystification conservatrice de la société de classes. - c) Sur le parti. Les "programmistes" sont fort gênés lorsque l'on parle du terme fraction. C'est une gifle; à la théorie du parti "historique" qui existerait de tout temps, même en période de contre-révolution. "Le Prolétaire", qui fait semblant de croire que !'RI et ses amis" "louent la fraction" pour mieux nier la nécessité du parti, ne fait lui-même que nier l'existence de la fraction comme étape nécessaire de la reformation du parti, lorsque celui-ci disparaît en passant à l'ennemi, pour mieux minimiser les conditions d'apparition du parti : en période de lutte généralisée de la classe et non par une pure gymnastique volontariste qui fait du parti historique" une coque "informelle" et du "parti formel", une chose a-historique. Leur Confusion entre théorie et "école de pensée" ("école anarchiste',' 'école marxiste"!) est une manière non classiste et purement philosophique de considérer les théories comme indépendant tes de leurs racines historiques, et donc des classes antagoniques qui font cette histoire, dont l'antagonisme se manifeste sur le plan superstructurel par l'apparition de théories ou d'idéologies matériellement déterminées.
Mais, peut-être que nous, ''anarchistes", donnons une fois de plus des leçons de marxisme...
On peut se demander pourquoi le PCI mène une telle polémique contre RI, après avoir soigneusement évité pendant longtemps toute allusion à notre existence. L'apparition du Courant communiste international, qui contredit la théorie "programmiste" que seul le PCI peut se manifester internationalement, à la différence de la gauche "infantile" marquée par sa nature "occidentale", porte un rude coup au même PCI. Depuis 64, tant en Italie qu'en France, le PCI ne cesse de se décomposer; la soudaine disparition de ses sections Scandinave et allemande (Internationale Revolution. Kommunismen) lui a fait perdre toute prétention' internationale. On comprend que le PCI veuille taire l'existence gênante du Courant en parlant de "RI et ses amis", ou bien, de "RI avec des cousins en perpétuelle dispute", manière perfide de nous présenter à ses lecteurs non comme une organisation centralisée internationalement -dans laquelle la discussion ne peut que se développer pour affermir une réflexion jamais achevée- mais comme une fédération de clubs de discussion.
Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer que c'est l'incompréhension de la période ouverte par le premier conflit impérialiste (voir RI et bulletin de discussion) qui amenait le PCI dans de telles aberrations théoriques.
Et même, à une pure falsification des positions de la Gauche communiste. Réfugiés derrière leur paravent de l'invariance du marxisme depuis 1848, ils pratiquent la même politique des sociaux-démocrates qui consistait à se réfugier derrière l'apparente orthodoxie d'idées dépassées par la lutte de classe pour mieux trahir la méthode marxiste d'analyse et d'action. Aujourd'hui, le PCI prend le chemin qui l'amène à quitter sans espoir de retour le camp prolétarien pour celui de la bourgeoisie.
Pour une fois, nous serrons d'accord avec le PCI, lorsqu'il affirme que le passé fait tomber des groupes "dans les déchets que l'histoire vivante laisse inévitablement à chaque cycle de son métabolisme incessant et riche de lendemains exaltants". Le PCI, lui, appartient plutôt à la catégorie des déchets -de l'histoire morte, à celle qui corrompt et entrave le "métabolisme incessant" de la lutte de classe.
CHARDIN
Revolution Internationale N°24 - avril
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.88 Mo |
- 642 lectures
ECOLOGIE, FÉMINISME, RÉGIONALISME... UN FREIN A LA LUTTE DE CLASSE
- 122 lectures
Nous n'avons pas de chroniques régulières sur l'écologie, l’avortement, les minorités culturelles opprimées, etc... et certains lecteurs nous reprochent d'être des "économistes", de ne jamais parler des multiples facettes de l'exploitation et de l'oppression. Il n'est pas question pour nous, à l'instar des gauchistes, d'avoir chaque mois un article pour faire plaisir aux écologistes, un pour les féministes, un pour les régionalistes... Car, si elles ne sont pas ouvertement bourgeoises ou interclassistes, ces tendances sont des freins à la prise de conscience par les prolétaires de leurs intérêts historiques. Depuis quelques années, l’intelligentsia gauchiste et marginale fait beaucoup de bruit autour de ces mouvements. Les révolutionnaires se doivent donc de les dénoncer ; pour cela, il faut en voir le fond et la forme, le contenu et l'emballage. Commençons par le fond.
Le point commun de tous ces groupes est d'attaquer le système sur un point spécifique et de s'adresser à telle ou telle catégorie d'individus (habitants d'une région, femmes, usagers des transports, de la médecine, de la psychiatrie, consommateurs, pollués, etc...) Ils réduisent donc le capitalisme à une somme d'aspects reliés entre eux par on ne sait quelle logique et proposent de l'attaquer sur cet aspect particulier, deviennent des spécialistes et s'enferment dans une lutte stérile. Face à ces critiques sur son mode de fonctionnement, le capitalisme peut, soit rectifier le tir (par exemple sur le gaspillage des emballages plastiques dont la fabrication nécessitait d'importer plus de pétrole ou sur des moyens de répression idéologique dépassés comme pour l’avortement) et donc tirer tous les bénéfices de ces "réformettes". Ou alors, tout retour en arrière mettant en cause la survie même de son économie, il est dans l'impossibilité de céder -comme sur la politique de développement des centrales nucléaires-, et ce n'est pas une poignée d'écologistes, de marins ou d'agriculteurs qui peut le faire reculer. La bourgeoisie trouve même une justification à sa politique d'austérité et de réduction de la consommation avec les campagnes menées pour une croissance zéro (les écologistes doivent être tout à fait satisfaits : les cheminées ne fument plus car les usines sont fermées) contre les voitures ou contre la "société de consommation". Toutes ces manifestations de la domination totale du capitalisme dans le monde entier sont comme l'arbre qui cache la forêt ; et cette forêt, ce sont les rapports de production, base même du système. A la limite, le capital serait aussi prospère avec l'égalité des sexes (les femmes ministres ou PDG sont aussi efficaces que les hommes), avec des transports en commun plus rapides et confortables (les ouvriers seraient moins fatigués en entrant à l'usine le matin), avec un relais important du pouvoir au niveau de la région (il y a 50 Etats aux USA). Le capital est même capable d'instituer l'autogestion pour que les travailleurs produisent avec encore plus d'abnégation pour l'économie planifiée. Mais il est une chose que l'on ne peut toucher sans que le château de cartes ne s'écroule, c'est le fait qu'il y ait des producteurs n'ayant aucun moyen de contrôle sur leur vie, et d'autres qui vivent du travail des premiers, comme patrons ou hauts fonctionnaires de l'Etat. Peu importe les apparences, ce qui compte, c'est le maintien d'une société de classes. Cette société, seule la classe ouvrière peut l'abattre. Elle est au cœur du système dans les usines, les chantiers et les bureaux, elle y est concentrée, elle y voit la faillite d'un système décadent incapable d'améliorer ses conditions d'existence, c'est là qu'elle doit s'imprégner de la nécessité de renverser la base môme du système : le salariat. Et là, il n'est pas question de la diluer dans la masse invertébrée du "peuple", des citoyens, des usagers ; elle est seule, elle ne peut compter que sur elle-même, elle doit s'attaquer clairement à son ennemi central. Dès sa naissance, le capital a créé la force qui le détruira; en étant obligé de mettre des hommes derrière ses machines, il introduisait le ver dans la pomme.
Que font donc tous ces mouvements : ils tentent de sortir la classe ouvrière de son terrain de lutte, pour lui faire enfourcher des chevaux de bataille qui ne sont pas les siens. Ils reculent donc d'autant le moment où les camps en présence devront se livrer l'assaut final, l'un ayant épuisé toutes les mystifications et l'autre surmonté toutes les déviations menant à des impasses. Ils participent à ces mystifications de manière plus ou moins efficace, donc plus ou moins dangereuse.
Voyons comment : Ces groupes ont pris de la vigueur avec le début de la crise à la fin des années 60. Les premières manifestations de la crise ont été appelées "crise de civilisation", liée en grande partie au problème étudiant : mai 68 a montré à ces révoltés leur force, mais aussi la force de la classe ouvrière ; ainsi, un une partie d'entre eux a essayé, au niveau des mots, de concilier sa propre révolte avec les intérêts historiques du prolétariat, en adoptant un langage "de classe", "anticapitaliste". Le gros des forces provient des déçus de mai 68, ceux qui ont cru que c'était la Révolution et qui, ne voyant pas le prolétariat refaire mai 68 tous les six mois, en ont conclu qu'il était décidemment incapable de se libérer de ses aliénations. On assiste alors à un éparpillement politique et géographique en une multitude de petites sectes incapables de dépasser leurs intérêts de boutique. L'exemple le plus frappant est l'écologie : outre les petits groupes locaux, on a vu naître plusieurs groupes à vocation nationale, certains avec des positions identiques, le tout allant d'un pacifisme chrétien à un militantisme léniniste. Toutes ces tendances sont parfois antagonistes mais se retrouvent pour des alliances éphémères sur le point précis qui les a vu naître. De même, le mouvement régionaliste, qui va des anarchistes à l'extrême droite, en passant par des groupes léninistes, des groupes proches du PC ou du PS, ou même des groupes "apolitiques". Dans cet extrême morcellement, les groupes les plus dangereux sont les groupes les plus à gauche, car ils essaient d'entraîner et de se servir du prolétariat.
Pour mieux utiliser le prolétariat, il faut lui faire perdre son identité ; ces groupes sont des experts pour trouver un problème spécifique pour chacun: les femmes sont exploitées par les patrons bien sûr, mais aussi par une société mâle, les bretons et les occitans sont exploités par des patrons mais ce sont des patrons parisiens... Quand on a trouvé le problème qui n'est plus spécifiquement prolétarien, il faut trouver la catégorie sociale qui en souffre le plus, et donner une identité à cette somme d'individus disparates : les jeunes, au moment du journal "Tout", les homosexuels avec le FHAR ou l'IHR, les femmes avec le MLF, les basques ou les portoricains, les noirs aux USA avec le Black Power, les usagers de la psychiatrie, etc. Il ne reste plus qu'à relier avec des mots comme libération, classe ouvrière, capitalisme, et le tour est joué. Un trait significatif de ces groupes est l'obligation qu'ils ont, quand ils veulent se manifester au niveau régional ou national, de se mettre pieds et poings liés entre les mains des organisations gauchistes. Eux seuls possèdent les moyens nécessaires pour organiser une telle manifestation. Aubaine pour les gauchistes qui peuvent alors se livrer à leur sport favori : la pêche à la ligne.
La période de reconstruction a permis la naissance de ces mouvements. Le prolétariat alors pansait ses plaies de la .seconde guerre mondiale et profitait de la relative amélioration de ses conditions de vie. Devant ce vide, les théories subtitutionnistes à la lutte de classe se sont développées avec le même point commun : le combat principal n'est pas celui qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie. Depuis 1973, la crise du capitalisme, bien plus que des dizaines d'articles, a remis chacun à sa place. La marche sur Bugey ou la manifestation à vélo à Paris, qui avaient rassemblé des milliers de personnes, sont maintenant improbables. Les dernières manifestations publiques de toutes ces tendances se sont soldées par des échecs, L'utopie du développement éternel du capitalisme vole en éclats : avec la crise, le prolétariat ressurgit et les adversaires se montrent au grand jour, d'un côté, la bourgeoisie et ses oripeaux, de l'autre, la classe ouvrière seule avec ses mains et sa conscience II faut choisir entre le les deux camps en présence; pour notre part, ce choix est fait.
Ed. SELKIRK
Rubrique:
La “Lanterne noire" ou les lumières de l'astre mort
- 28 lectures
En dehors du marxisme, aucune théorie ne peut donner de réponse valable aux questions gigantesques posées à l'humanité avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence.
Il ne suffit pas de se tenir jalousement à l'écart de la politique pourrie de la fédération anarchiste où crypto-staliniens font bon ménage avec des maçons entichés de morale humaniste pour évoluer vers des positions révolutionnaires. A jamais est révolu le temps où quelques petits groupes anarchistes pouvaient, tant bien que mal, fournir un effort de réflexion théorique et une défense conséquente des frontières de classe. La mort de l'anarchisme date du 4 août 1914 : ralliement des mandarins anarchistes -et tout d'abord du vénérable Kropotkine- à l'effort de guerre impérialiste.
Quant à la partie saine du mouvement libertaire, elle ne pouvait que se joindre à la formidable vague des années héroïques marquées par la constitution de l'Internationale Communiste Ce que fit le petit noyau des anarchistes internationalistes regroupés autour de Guilbeaux et de Rosmer, ce que fit ensuite Serge, compagnons de Trotsky au plus haut moment de la lutte mondiale pour le pouvoir des Soviets, mais aussi après l'échec, lorsque la terre entière ne fut plus qu'une "planète sans visa" pour tous les survivants des purges et procès de Moscou, quand il était "minuit dans le siècle".
S'il est vrai que l'histoire juge les idées et les hommes, alors, nous pouvons dire que, passé au crible de la critique des faits, il n'est rien resté debout de l'édifice de belles théories anarchistes. Sur l'autel de l'Ordre bourgeois, l'anarchisme, durant ces 3/4 de siècle dut sacrifier tous ses principes : "anti-militariste", il exigea des armes pour combattre l'ennemi "fasciste" mais fit une guerre d'extermination aux seuls internationalistes : ceux qui prônaient le "défaitisme révolutionnaire" ; "anti-politicien", il entra au gouvernement républicain de Madrid et à la Généralité de Catalogne ; partisan de 1'"action directe", il appela le prolétariat espagnol à "savoir arrêter une grève" et à reprendre le travail ; "émeutier", il se fit démolisseur des barricades du Mai 37 à Barcelone ; "anti-étatiste", il développa dans les usines le capitalisme d'Etat.
A la Libération, il poursuivit l'épopée "anti-fasciste" dans les rangs de la résistance gaulliste ; "internationalistes" soi-disant dans la tradition et l'esprit de l'AIT, ses rejetons du "Mouvement du 22 Mars" crient victoire pour 1'"oncle" Hô.
Le cas qui nous intéresse ici est celui de la "Lanterne Noire". Evidemment, rien de comparable à la CNT/FAI, mais quand même une publication qui se présente : revue de critique anarchiste dans laquelle, nous dit-on, s'expriment des anciens de "Noir et Rouge" et d'ICO. Au quatrième numéro, la "Lanterne Noire'', sans se déclarer POUR, donne l'hospitalité cependant aux communiqués de groupes qui, de l'Irlande au Japon, ont fait de la propagande par le fait (on dit "guérilla urbaine") leur credo intangible. Pour présenter l'action des GARI dans l'enlèvement d'un sous-fifre du capitalisme espagnol ou les exploits de la bande à Baader et autres assoiffés de sang de l'Armée Rouge Japonaise (sic) elle n'a pas lésiné sur la dépense : 28 pages.
Les jeteurs de machines infernales dans les usines japonaises de Mitsui, Teijin, Tsaei ont causé la mort d'au moins huit travailleurs et la mutilation de dizaines d'autres Les mitrailleurs de l'IRA ont fauché des dizaines de travailleurs à Londonderry et à Belfast, parce qu'ils n'étaient pas de l'Eglise catholique et romaine. Parler de ces carnages en chroniqueurs, présenter leurs auteurs comme des victimes de la répression revient à introduire en contrebande une camelote criminelle.
Les idées et les méthodes du terrorisme individuel contre laquelle le mouvement organisé de la classe a lutté sans relâche pour lui opposer l'action consciente du prolétariat ont trouvé dans ce numéro leur expression pudique, sous le couvert d'"informer" les bonnes gens.
Mais la "Lanterne Noire" précise qu'elle est séparée de ces groupes "et d'abord de leur avant-gardisme". Eternel équivoque : le programme bourgeois, oui, les méthodes, non ! Là est la nature profonde de tous ceux pour qui principes et tactique se séparent. Et voilà un autre trait de ressemblance frappante avec le trotskysme en compagnie de qui on va retrouver la "Lanterne Noire". Qu'une même poule puisse couver indistinctement ses propres œufs et ceux de la mère-cane n'est pas un vulgaire phénomène de basse-cour. On le rencontre dans la vie politique bourgeoise et la démocratie y arrive très bien avec ses anarchistes et ses trotskystes.
A l'époque de la décadence, l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat devient l'axe essentiel de la vie sociale C'est ou l'ouverture d'un cours général vers la guerre impérialiste, ou d'un cours vers la révolution prolétarienne. Et la victoire de la classe montante repose sur des principes, ceux que la "Lanterne Noire" rejette pour ne pas faire dans le dogmatisme... genre RI.
Ce que ces fossiles rajeunis du fard moderniste appellent de façon idiote "dogmatisme" n'est en fait que la continuation de la théorie communiste qui se fait chair et os dans les organisations et les militants qui appartiennent à la classe révolutionnaire. De la vieille souche libérale ou qu'ils se targuent d'être de pénétrants sociologues d'université, les anarchistes seront toujours les contempteurs du marxisme parce que celui-ci est la doctrine de la lutte de classe.
De quoi se démarque vraiment la "Lanterne Noire" ? Que des éléments de ce groupe (chez eux, on n'agit pas comme un corps organisé collectivement, mais selon des déterminations passionnelles où la "raison du cœur" tient lieu de programme) aient participé, en novembre 75, au Comité de Jussieu préparatif à la marche sur Hendaye est là pour montrer quel triste rôle de flanc-garde du trotskysme joue l'anarchisme Pour ces éternels partisans du moindre mal, de la troisième voie entre le capitalisme inhumain et le communisme totalitaire, une bourgeoisie sans Franco et ses affidés de la Phalange est préférable à tout prendre.
Du temps de l'ancien régime portugais, la LUAR s'activait par des coups de mains contre le salazarisme. Depuis l'éclosion des œillets, elle joue la mouche du coche du MFA entrelaçant "dialectiquement" le soutien aux organismes d'autogestion, la défense d'un syndicalisme de "base" et l'appui aux luttes anti-coloniales. C'était suffisamment éloquent à la "Lanterne Noire" pour tresser une couronne de lauriers révolutionnaires à une organisation qui fut le factotum de Carvalho.
Toute cette gymnastique n'a pas empêché la rédaction de la "Lanterne Noire" d'écrire qu'elle était d'accord avec nos camarades belges d'"Internationalisme" sur les points de la plateforme du CCI : fronts populaires, "frontisme", "luttes anti-fascistes" comme mystifications ; "luttes de libération nationale" comme moment de lutte impérialistes pour le contrôle des "nouvelles bourgeoisies''.
La mise en accord des actes avec la pensée leur est chose inconnue. En paroles, mais en paroles seulement, la "Lanterne Noire" reconnaît des vérités essentielles mais, en fait, aide la IVème Internationale trotskyste à mener ses grandes campagnes démocratiques Personne n'est obligé d'être révolutionnaire et n'importe quel élément peut défendre l'équivoque. Mais c'est le travail des révolutionnaires de dénoncer le charlatanisme du demi-anarchisme justement parce qu'il se manifeste sous le masque d'un marxisme de carnaval.
Se déclarer d'accord avec la moitié des positions de classe et rejeter l'autre moitié, se nourrir pour moitié de théorie des Gauches Communistes et pour l'autre moitié des miettes du trotskysme, marcher moitié d'accord, moitié critique avec le trotskysme, bref tout faire et tout penser à moitié, voilà l'anarchisme.
Dans la dure bataille qui se prépare, le prolétariat devra se libérer de ses faux amis qui prétendent parler et agir de façon révolutionnaire et qui, chaque jour, ont une activité foncièrement contraire à tous les enseignements de la lutte de classe
N'ayant pas d'armes propres, pas de principes, pas de programme, refusant la conception marxiste de l'histoire, contestant le rôle révolutionnaire du prolétariat, la "Lanterne Noire" prend des armes et des principes malpropres.
Il appartient aux camarades de la "Lanterne Noire" qui sont encore capables de pensée politique, qui sont vraiment d'accord avec notre lutte principielle, de quitter le plus rapidement possible un groupe qui offre pour toute alternative, ou ne rien faire, ou emboîter le pas aux trotskystes pour former des fronts unis.
Ainsi que Marx le disait de Proudhon, "charlatanisme scientifique et accommodements politiques sont inséparables d'un pareil point de vue". Cent ans plus tard, nous pouvons ajouter : l'anarchisme ne peut plus rien refléter que l'idéologie dominante.
R.C.
Courants politiques:
Rubrique:
Revolution Internationale N°26 - juin
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.81 Mo |
- 561 lectures
Les suffragettes du capital
- 537 lectures
Aujourd'hui et depuis quelques années, on nous rabat les oreilles avec "les femmes", la "condition féminine", l'"année de la femme", l'"oppression de la femme", "MLF vaincra", etc. Au point qu'il n'est plus aucun gouvernement "démocratique", aucun syndicat et aucun parti politique qui se respectent qui n'aient leur secrétariat d'Etat, leur organe ou leur section "spécial femmes". De la droite à la gauche -et surtout les gauchistes- tous veulent se mettre au goût du jour en apportant "la solution" aux problèmes, à la condition des femmes. Dire qu'il existe un problème "des femmes" aujourd'hui, c'est participer de l'éternelle vision sociologique, bourgeoise de la société : la société n'est qu'une juxtaposition de couches sociales (qui existeront éternellement) plus ou moins opprimées par d'autres "couches sociales": le but devenant alors de trouver le moyen de faire cohabiter ces couches dans la "meilleure harmonie possible", à travers des réformes sociales. Mais, dans la réalité de la lutte de classe, le but réel de tous ces mouvements qui tendent à aménager la condition de telle ou telle couche, revient, dans la réalité, à laisser intacte la société d'exploitation capitaliste en mettant en avant de fausses analyses, et donc des fausses solutions, des voies sans issue.
Intégration des femmes à la production capitaliste
Qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes, c'est une évidence : tant que l'homme n'enfantera pas, le rôle de reproduction de l'espèce humaine reviendra à la femme. Depuis que l'humanité existe, la femme a donc toujours assumé cette fonction sociale : le cadre social, dans lequel cette fonction de reproduction s'est accomplie a évolué dans l'histoire en fonction du degré de développement atteint par les forces productives et, donc, des rapports de production existants. La "condition féminine" a donc toujours été directement déterminée par les liens juridiques et sociaux que les hommes ont noués entre eux dans chaque système social déterminé. Cette "division du travail" dans la fonction de la reproduction de l'espèce humaine a donc toujours accompagné l'évolution de l'humanité à travers les divers types de société qu'elle a traversés. Dès le départ, nous pouvons donc déjà dire que d'un point de vue matérialiste, il est aberrant de vouloir inventer une vision du monde d'après les intérêts propres des femmes comme si celles-ci pouvaient exister indépendamment des rapports de classe existants dans une société. Pour comprendre la position qu'occupe "la femme" dans la société actuelle, et pourquoi il est aberrant d'en faire un cas particulier, ayant des problèmes particuliers et des solutions propres il n'est pas inutile de faire un très bref rappel de comment la femme a été intégrée au mode de production capitaliste. C'est avec la dissolution de l'économie agricole et le passage à la prépondérance au mode de production capitaliste -en d'autres termes, avec le développement du machinisme et du travail salarié* que la femme a commencé à être, peu à peu, intégrée directement à la 'production capitaliste. Cette intégration a été facilitée par plusieurs facteurs : - avec le développement et la généralisation des machines, il s'est avéré que la force de travail féminine était aussi utilisable que celle de l'homme ; - l'exploitation forcenée de la classe ouvrière, sur laquelle s'est accomplie l'accumulation primitive du capital (journées de travail de 11, 12, 13 heures pour des salaires permettant tout juste de se reproduire -des salaires de misère) a poussé à la dissolution de fait de la famille (comme dit Marx dans le Manifeste Communiste) en faisant aller à l'usine hommes, femmes, et enfants pour pouvoir survivre ; - dès le départ, la force de travail féminine a été moins rémunérée que celle des hommes. Du point de vue du capitaliste, celle-ci est en effet moins sûre : chaque fois qu'une femme doit mettre au monde un enfant, cela lui fait autant de journées de travail perdues (d'où la "faiblesse" des femmes et le prétexte pour les payer moins). Mais si, dans la période d'accumulation primitive du capital la surexploitation des hommes, femmes et enfants est manifeste, dans la phase ascendante du capitalisme, dans son véritable apogée l'idéal social bourgeois a toujours été que la femme reste à la maison -pour procréer et s'occuper de la survie-matérielle de l'ouvrier et des futurs petits ouvriers -tout simplement parce que, dans ces conditions, la production capitaliste était mieux assurée et l'exploitation était mieux supportée, ti en a découlé que, autant la femme de l'ouvrier que l'ouvrière elle-même se sont vues impartir le rôle de ménagères : pour les femmes des ouvriers cela veut dire : rester à la maison, s'occuper du ménage et élever les enfants (d'où la fameuse "soumission" des femmes), pour les femmes ouvrières cela implique d'avoir à accomplir non seulement ses heures de travail à l'usine, mais, en plus le travail de ménage habituel (la "double journée de travail"). Ce sont donc les conditions matérielles que le capitalisme a imposées aux femmes qui leur ont conféré ces particularités (un certain "conservatisme" parce que subissant plus fortement la domination du capital, une position d'infériorité dans la société) que les féministes voudraient aujourd'hui abolir en luttant "contre les hommes". les femmes dans la lutte de classe Dans le contexte des 18e, 19e et dt but du 20e siècles, à l'époque où les organisations révolutionnaires de la classe ouvrière avaient comme but de gagner autant de réformes que possible du capitalisme en faveur de la condition ouvrière, et donc, d'affirmer la classe ouvrière comme force au sein de la société capitaliste, il n'est ni étonnant ni contradictoire avec les nécessités de l'époque de voir que les partis ouvriers (la social-démocratie en particulier) consacraient, au sein de leur organisation, des sections spéciales pour les femmes. Même si cette division qui était faite entre les hommes et les femmes était un reflet du poids de l'idéologie bourgeoise au sein même du parti, elle reflétait en même temps une réalité sociale de cette époque : la soumission de la femme par l'homme était plus marquée qu'aujourd'hui. Mais leur but était quand même de faire participer les femmes à la lutte de toute la classe ouvrière pour le socialisme. L'influence de cette période a pesé même sur la 3ème Internationale où les Bolcheviks ont préconisé, en 21, des tactiques de propagande spécialement dédiées aux femmes. Mais il faut signaler que cela a été fait dans le but de renforcer les partis communistes par n'importe quel moyen, alors que la lutte de la classe était en reflux. En fait, dans les périodes de luttes révolutionnaires de la classe, le problème "des femmes" ne s'est jamais posé. Les femmes y ont, non seulement participé, mais elles en ont souvent été le détonateur- ; parce que, quand "même les femmes" descendent dans la rue, "au risque de laisser des orphelins", c'est que la crise du système et l'impossibilité de continuer à vivre en son sein, sont une évidence. Avec l'entrée en décadence du système capitaliste et l'impossibilité, au niveau mondial, d'améliorer le sort de l'humanité autrement que par la révolution communiste, tout mouvement parcellaire qui a comme but de s'affirmer en tant que tel au sein de la société, toute lutte pour des réformes pour l'amélioration de son sort, non seulement est vouée à la défaite, mais participe au renforcement de la société capitaliste, en créant des illusions sur ses capacités de "changement".
Les groupes femmes
Toute l'idéologie féministe (de "Psy et-Po" au groupe "Lutte de femmes", en passant par les "Pétroleuses") s'est évertuée à faire des femmes une catégorie spécifique (comme les homosexuels, immigrés, jeunes, handicapés), une sorte d'inter-classe (cf. collectif italien de Milan) qui, de la bourgeoise à l’ouvrière, toutes les deux sœurs, auraient des revendications communes... Ceci n'étonnera personne quand on connaît la vision bourgeoise qu'ont les gauchistes de la classe ouvrière : en effet, ils noient la classe ouvrière dans le "peuple", dans une masse d'opprimés qui doivent se regrouper par catégories (race, sexe) pour une première prise de conscience. C'est aussi de la révolution prolétarienne qu'ils ont une vision contre-révolutionnaire : en effet, s'ils justifient les "groupes femmes", c'est qu'à leur avis, une révolution "économique" (laquelle?) n'entraînerait pas nécessairement un changement des rapports sociaux (hommes, femmes, enfants) et donc qu'il y a nécessité d'un mouvement autonome de femmes qui pousserait à ce changement, qui achèverait la révolution incomplète. Ils t prennent comme exemples tous ces pays qu'ils soutiennent critique-ment et dont ils disent qu'ils sont en voie vers le socialisme (Chine, Cuba, Vietnam, Pays de l'Est). En effet, leur programme économique n'est tout simplement qu'un peu plus "à gauche" que le PC, à savoir : nationalisations + contrôle ouvrier + mouvements de femmes, en l'occurrence. Avec un tel programme, ce qu'on prépare, ce n'est pas la révolution, mais une gestion de la crise, la gestion du capital dans ses aspects les plus totalitaires : le capitalisme d'Etat. Mais les gauchistes ne sont pas les seuls à s'intéresser aux femmes: du secrétariat à la condition féminine aux partis politiques de gauche qui ont chacun leur"8ection femmes", chacun y voit un terrain privilégié pour détourner des problèmes réels. Ils seront les premiers à impulser des groupes de femmes dans les quartiers ou les entreprises où ils assument très bien leur double rôle d'encadrement et de division de la classe ouvrière. Sous prétexte qu'il y a moins de femmes dans les syndicats et que les femmes font moins de politique que leurs maris, on voit arriver les gauchistes se chargeant de faire "l'éducation politique et syndicale des masses" (comme si la conscience de classe était affaire de pédagogie. Dans le fait que les ouvrières sont moins encadrées que les ouvriers par les syndicats, les gauchistes y voient une faiblesse de la conscience de classe et une masse à manœuvrer. Pourtant, dans les luttes importantes, plus enracinées dans la réalité de leur exploitation quotidienne, les ouvrières se trouvent être souvent les plus combatives et les moins soumises aux mystifications syndicales. Mais les gauchistes jouent, là encore, très bien leur rôle de rabatteurs de la gauche : en mettant en avant des revendications "spécifiques" aux femmes, qu'ils veulent faire reprendre en charge par les syndicats, ils s'en font des auxiliaires et des conseillers dévoués, ils redorent leur blason, ils se veulent plus "à gauche" que les syndicats. Mais ces revendications sont de bien faibles choses, elles se résument à: "je veux être exploitée comme les autres, je veux qu'on m'aménagé ma double journée' En fait, ils voient la libération de la femme dans l'aménagement du salariat. Là où le système d'encadrement du capital est insuffisant, les gauchistes sont là pour colmater les brèches. Ils entreprennent aussi des luttes sur la contraception et l'avortement et font apparaître comme des victoires les lois qui sont votées. Alors que c'est au contraire un besoin de plus en plus pressant pour le capital de limiter les naissances, de rationaliser la reproduction de la force de travail... Ce qu'ils montrent comme victoire dans les pays occidentaux, -libération' de la femme, "libre disposition de son corps"- apparaît avec son vrai visage et sa barbarie dans d'autres pays (stérilisation forcée aux Indes, contraception à outrance aux Antilles, etc. Même si elle se cache sous le visage du gauchisme, la mystification féministe contribue d'une part à maintenir le prolétariat sur un terrain bourgeois, en faisant croire qu'il lui est possible d'aménager ses conditions de vie à l'intérieur du capital et, d'autre part, contribue à renforcer les divisions que sécrète le capital dans les rangs du prolétariat. C'est à cela que nous assistons quand nous voyons des "femmes" s'organiser en tant que femmes dans les entreprises et les quartiers. Le seul critère d'adhésion à cette forme d'organisation est d'être "une femme", indépendamment de toute considération de classe. Avec cette vision on arrive à faire une théorie marxisante (mais jamais marxiste), à savoir que les femmes sont une interclasse : les femmes de bourgeois étant des bourgeoises, les femmes d'ouvriers étant des ouvrières, mais toutes les deux ayant des revendications communes. On aboutit ainsi à une dissolution d'une partie du prolétariat : les ouvrières dans une catégorie sociale : les femmes, et d'opposer sous prétexte de revendications spécifiques, la femme au mari, l'ouvrière à l'ouvrier, comme l'attestent certains groupes qui, faisant "du travail de masse", écrivent des tracts sur le "chômage spécifique des femmes". Ces groupes parachutés n'arrivent à se poser les problèmes qu'en termes psychologiques : le "désir" de parler de soi et la "culpabilité" de ne pas agir là où ils sont (groupes de conscience)[1]. Leur "théorie" ne reste qu'une description de l'oppression sociale des femmes: rapports au travail, au mari, aux petits chefs, aux enfants et aboutit le plus souvent à une dénonciation hystérique des rapports qu'impose le capital. Alors que seul le prolétariat est la classe révolutionnaire, les femmes en s'organisant en tant que femmes, ne peuvent que se couper de toute perspective révolutionnaire et, de fait, servir de masse de manœuvre à la gauche de l'appareil politique du capital. Leur activité "politique" se résume à soutenir des fractions de la bourgeoisie contre d'autres: soutien des luttes antifascistes au Chili, en Espagne, au Portugal, etc... Depuis quelques années, on n'entend plus parler du MLF. En effet ce type de mouvement paraît à l'avant-scène quand la classe ouvrière est faible ou qu'elle a subi un reflux de ses luttes comme après 68. Mais aujourd'hui, la crise s'accentue et les luttes ouvrières reprennent à un niveau mondial, renvoyant aux poubelles de l'histoire les déchets qui n'auraient jamais dû les quitter. Dans ses luttes, le prolétariat doit tendre à l'unité la plus complète, tous ceux qui essaient de le diviser s'en font les pires ennemis. Le féminisme comme mystification de la classe ouvrière n'est pas déterminant, il ne prend tout son sens qu'en s'intégrant à tout l'arsenal bourgeois mis en avant par les gauchistes.
J. S. T.
[1] Ces groupes de conscience où l'on vient parler de ses problèmes ne sont en fait rien d'autre que des "courriers du cœur" améliorés au langage plus élaboré.
Rubrique:
Revolution Internationale N°29 - septembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.7 Mo |
- 591 lectures
Revolution Internationale N°31 - novembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.88 Mo |
- 603 lectures
Revolution Internationale N°32 - décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.94 Mo |
- 573 lectures
Révolution Internationale - 1977
- 793 lectures
Revolution Internationale N°39 - juillet
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 777.75 Ko |
- 539 lectures
A PROPOS DES «GROUPES OUVRIERS» (I)
- 27 lectures
Nous publions à la suite un texte du "Groupe Autonome Ouvrier de Clermont-Ferrand" touchant un des problèmes importants soulevés par le processus actuel de prise de conscience du prolétariat : la signification et la fonction des groupes et cercles ouvriers de discussion. Par manque de place nous ne pouvons donner ici que des extraits -ceux que nous pensons les plus significatifs- de ce document.
Les lecteurs intéressés pourront en trouver l'intégralité dans "Jeune Taupe!" n°l5 (l). Mais contrairement à cette revue qui le publie sans commentaires, nous estimons nécessaire de faire suivre ce texte d'un certain nombre de remarques en particulier pour critiquer certaines confusions qui s'y manifestent et contribuer à la clarification des questions qu’il soulève. Nous estimons en effet que le rôle de l'organisation des révolutionnaires ne saurait se limiter à celui d'un bureau d’édition des différents documents écrits par des ouvriers -une offset au service de la classe, en quelque sorte- mais bien d'intervenir activement dans le processus de développement de la conscience du prolétariat par des analyses et des prises de position sur l'ensemble des problèmes auxquels il est confronté.
PLATEFORME MINIMUM POUR L’AUTONOMIE OUVRIERE
L'expérience de nos luttes trahies, de nos échecs, des grèves éclatant en dehors des syndicats ou contre eux, font que des ouvriers prennent conscience du rôle contre-révolutionnaire des syndicats, les font se regrouper en noyaux autonomes.
Pourquoi nous dressons-nous contre des organisations que la classe ouvrière s'est données, il y a un siècle, au prix de luttes acharnées !
Avons-nous perdu le fil de l'histoire, ou est-ce simplement que ce qui était valable il y a cent ans ne l'est plus aujourd'hui?
(...) Si les syndicats trahissent nos luttes, c'est parce qu'ils sont réformistes et non à cause de leurs chefs ; il ne peut plus y avoir de bons chefs avec des organisations réformistes qui ne peuvent plus servir nos luttes.
(...) En effet, pour qu'une organisation soit véritablement démocratique, il faut que tous ses membres soient intégrés à son activité. Si le désintéressement gagne l'ensemble, il n'y a plus de possibilité de véritable collaboration, de véritable démocratie. Ceux des membres qui continueraient à s'agiter pour maintenir un semblant de vie, ne peuvent que devenir des CHEFS BUREAUCRATES d'une masse plongée dans l'indifférence. Or les syndicats sont, par définition, des organisations de masse et permanentes. Les syndicats existent aussi bien au moment des luttes qu'au moment des replis. Aussi, dès qu'il y a reprise de la lutte, les ouvriers trouvent en face d'eux une organisation hiérarchisée qui tend à faire des ouvriers des exécutants passifs de la direction syndicale. C'est pour cela que nous sommes d'accord avec les camarades qui opposent aux syndicats la démocratie directe (...). De plus, cette démocratie ne peut exister que quand tout le monde est intéressé, au moment des luttes.
Enfin, les syndicats servent de courroie de transmission aux partis de gauche et aux gauchistes. Le programme de ces organisations est réformiste à l'instar des syndicats. C'est un programme pour nous mystifier. Il propage l'idée que la crise économique n'est qu'une affaire de mauvaise gestion, que le socialisme n'est que quelques nationalisations plus ou moins autogérées.
C'est pourquoi, devant la crise mondiale grandissante, devant la décomposition des appareils d'Etat, le capitalisme appelle de plus en plus la gauche au pouvoir pour gérer son système pourrissant.
(...) Pour lutter contre l'autonomie du prolétariat, la gauche a deux armes : l'électoralisme et le modernisme!
(...) Chaque élection lui permet de mettre les ouvriers au pas, de casser les grèves sous prétexte que les élections se déroulent dans un climat de sérénité. Surtout les élections permettent à la gauche de détourner le prolétariat de ses tâches essentielles, son autonomie et son auto-organisation, en le faisant participer à un jeu de dupes monté par la bourgeoisie et qui ne sert qu'à isoler l'ouvrier de sa classe. Notre seule force est celle que nous donne la lutte collective.
(...) Le modernisme permet à la vieille gauche, grâce à la complicité volontaire de tous les gauchistes, de faire peau neuve... Les idéologues modernistes, l'autogestion, les groupes spécifiques, les comités non violents, le régionalisme, l'écologie, etc... donnent à la gauche un air dans le vent, révolutionnaire. . . Mais ces idéologies permettent surtout à la gauche de lutter contre l'autonomie du prolétariat en créant des divisions, en noyant la classe ouvrière dans des catégories qui ne sont que l'image de la société capitaliste.
La gauche et ses courroies de transmission, les syndicats, étant devenus des appareils intégrés à l'Etat capitaliste, notre lutte ne pourra se développer qu'en dehors et contre eux.
(...) L'expérience des plus grandes luttes du prolétariat en dehors des syndicats a montré que la forme d'organisation est celle des comités d'usine ou de comités de grève élus et révocables... Toutes les décisions concernant la marche de la lutte sont prises par les assemblées d'ouvriers... Les tâches de coordination sont assurées par un comité de grève ou comité d'usine, formé de délégués élus en assemblées et responsables à tout moment devant elles... Cette forme d'organisation particulièrement simple est en effet la seule qui permet la véritable participation de tous les ouvriers au combat. Elle fait de celui-ci l'affaire propre des ouvriers, et non plus celle des centrales syndicales Elle permet l'unité et la cohérence effectives que les divisions syndicales empêchent.
(...) Ces comités d'usine ou de grève ne correspondent pas seulement à un souci de démocratie. Ils sont déjà en eux-mêmes une préfiguration des Conseils Ouvriers, organisation que se donne la classe ouvrière pour prendre définitivement le pouvoir.
(...) Aujourd'hui, il est fondamental que la forme d'organisation des luttes prenne les traits essentiels des organisations pour la prise totale du pouvoir, et seule une telle organisation peut donner un sens et une issue à nos luttes.. .
Cependant le processus qui mène à ces formes de lutte va se heurter à une série d'obstacles qui tendent à maintenir le mouvement de la classe ouvrière sous le contrôle des organisations syndicales... Il y a d'abord "l'habitude"... Depuis des années, la classe ouvrière, bercée dans le mythe des syndicats, "organisations représentatives des intérêts ouvriers", laisse la conduite de la lutte et son organisation aux mains des centrales syndicales et de leurs bonzes. Aussi l'idée de s'organiser sans eux semble souvent une chose irréalisable. . .
Cette habitude dans les grèves sauvages d'atelier, là où l'influence syndicale est moins forte, commence à être brisée. Elle sera de plus en plus brisée que sera plus fort le besoin de la lutte.
(...) Il est fondamental que le groupe autonome ouvrier répande l'idée de ces formes nouvelles de lutte, que les expériences des grèves sauvages des ouvriers italiens, anglais, marocains, espagnols, de toute la classe ouvrière, soient connues de tous, que l'on sache qu'il existe des formes de lutte et d'organisation autres que les syndicats et qu'elles se développent partout dans le monde.
S'opposer aux syndicats apparaît à certains ouvriers comme "s'isoler du mouvement général". Il est indispensable de montrer que ce sont les syndicats qui s'isolent et vont s'isoler de plus en plus des véritables luttes du mouvement ouvrier... D'autres facteurs empêchent certains ouvriers de dépasser le cadre syndical au moment de la lutte: ainsi le besoin de coordination avec d'autres usines en lutte ou le fait que les patrons n'acceptent de discuter qu'avec les délégués syndicaux... les centrales syndicales étant normalement le seul lien existant entre les ouvriers de différentes entreprises, la rupture avec elles peut faire craindre l'isolement de la lutte. En fait, l'expérience a montré que les syndicats utilisent systématiquement leur pouvoir pour isoler et diviser les luttes
La tactique qui consiste à annoncer faussement dans une usine en grève que les autres ont repris afin de faire cesser la grève est devenue classique. Il est donc fondamental que le groupe autonome ouvrier développe tous les liens possibles avec d'autres groupes autonomes ou comités d'usine et assure le jour de la lutte des liaisons.
Quant au problème que le patron n'accepte de discuter qu'avec les syndicats, seules la combativité et la détermination
des ouvriers peuvent le résoudre : par l'épreuve de force seulement les ouvriers peuvent imposer leurs propres délégués et donc leur propre volonté.
(...) Si le groupe autonome ouvrier est composé d'ouvriers participant à la prise de conscience de la classe, nous ne sommes pas la conscience ni le noyau dirigeant. Nous ne sommes pas le noyau des futurs conseils ouvriers, ni l'embryon d'un futur parti. Nous n'avons pas à inventer des revendications pour les luttes.
Notre raison d'être dans toutes les luttes est celle d'un pôle de discussion, de réflexion, pour aborder nos problèmes d'un point de vue d'ensemble, non localement mais globalement, pour mieux connaître les idées motrices qui animent le mouvement de la classe, pour mieux savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos amis. Nous sommes des ouvriers militant pour l'organisation autonome des ouvriers, et non des instruments de quelque parti ou tendance politique. Nous regroupons des ouvriers de différentes tendances politiques ou d'aucune tendance ou groupe précis pourvu qu'ils soient d'accord sur la nécessité de développer les formes d'organisation et de lutte autonome des ouvriers.
(...) Le groupe autonome ouvrier est une avant-garde. C'est la cristallisation et la manifestation d'un processus de prise de conscience qui s'opère dans la classe. Nous militons pour l'autoorganisation de la classe, donc nous serons amenés à l'auto-dissolution dès qu'apparaîtra l'organisation autonome de la classe que nous, ouvriers, nous nous donnerons. Nous militons comme ouvriers, éléments de la classe ouvrière, et non comme un groupuscule ou pseudo avant-garde éclairée.
Nous sommes une avant-garde mais pas, à l'instar des léninistes, une avant- garde éclairée permanente apportant de l'extérieur la conscience, encadrant les ouvriers...
Le groupe autonome ouvrier est composé d*ouvriers révolutionnaires mais nous ne sommes révolutionnaires que si nous sommes conscients de nos responsabilités et que nous les réalisons effectivement.
En plus d'être des révolutionnaires participant activement et résolument dans la lutte constante de la classe à son auto-organisation, à la solidarité révolutionnaire, nous avons pour tâche essentielle d'œuvrer pour la conscience théorique de la classe et dans la classe, car l'autonomie de la classe est avant tout l'autonomie politique . . .
(...) C'est pourquoi nous devons ... nous réapproprier les acquis des luttes du passé, regrouper nos forces à l'échelle de la classe ouvrière, c'est à dire mondiale, mettre au centre de nos préoccupations la crise du capitalisme et ses conséquences pour l'ensemble des ouvriers, la dictature révolutionnaire du prolétariat, l'internationalisme, la violence révolutionnaire, la période de transition.
Le groupe ouvrier autonome de Clermont-Ferrand.
*******
Indiscutablement, ce texte constitue le résultat d'un effort sérieux de réflexion d'un point de vue prolétarien. Sur certains points, il fait une défense très vivante et percutante des positions révolutionnaires. En particulier il est très clair dans son analyse du mécanisme de développement de la bureaucratie syndicale, dans sa dénonciation de la gauche, des gauchistes, et de leurs armes : les élections et le "modernisme". De même il met en avant avec vigueur, à la fois la nécessité de l'auto-organisation des luttes ouvrières, de leur extension face à l'isolement maintenu par les syndicats et à la fois la nécessité pour la classe d'une réflexion approfondie par rapport à son expérience et aux perspectives de sa lutte. Cependant le texte contient un certain nombre d'idées et de formulations erronées qu'il nous appartient comme révolutionnaires de relever et de réfuter.
On peut lire dans ce document des phrases comme : "si les syndicats trahissent nos luttes, c'est parce qu'ils sont réformistes"... ou bien "le programme de ces organisations politiques (gauche et gauchistes) est réformiste à l'instar des syndicats".
Ces formulations sont inexactes et introduisent une confusion là où; par ailleurs, le texte est très clair : la nature capitaliste de la gauche et des syndicats.
nature du réformisme
Le réformisme appartient à une période et à des circonstances bien précises de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un terme qui définit la maladie dont ont été atteintes la plupart des grandes organisations ouvrières dans la période ascendante du capitalisme. Dans cette période, celui-ci était capable d'accorder des réformes réelles et, dans la mesure où il constituait le cadre approprié au développement des forces productives, sa disparition n'était pas à l'ordre du jour. Pour la classe ouvrière la lutte pour des réformes n'était pas seulement possible mais nécessaire en attendant que mûrissent les conditions économiques de la révolution, nécessaire à la fois pour améliorer ses conditions d'existence et pour se préparer à l'affrontement final. Le réformisme était justement la politique qui, en s'appuyant sur l'illusion que le capitalisme pourrait indéfiniment poursuivre son ascension, rejetait le deuxième aspect des luttes de la classe. Dans cette conception, "le but n'est rien, le mouvement est tout" (Bernstein) : le seul objectif des luttes est une transformation progressive de la société capitaliste dont le socialisme est l'aboutissement organique. Même si elle était favorisée par la pratique quotidienne de la classe, une telle vision était indiscutablement d'essence bourgeoise : le réformisme était une manifestation du poids de l'idéologie bourgeoise au sein des organes de lutte de la classe ouvrière. Mais dans la mesure où justement, la révolution n'était pas encore à l'ordre du jour, ces organes pouvaient assurer une défense réelle des Intérêts Immédiats des travailleurs. Syndicats et partis sociaux-démocrates de masse étaient des instruments de la classe ouvrière et malgré leurs imperfections et leurs limites, les révolutionnaires y militaient afin d'y défendre, contre les réformistes, la perspective historique de la lutte de classe : le renversement du capitalisme.
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, ces organisations sont passées dans le camp du capitalisme : dans la mesure où le système n'était plus capable d'accorder de réforme, elles ne pouvaient plus, sur le terrain qui leur était propre, assurer une quelconque défense des intérêts prolétariens et c'est tout "naturellement" qu'elles sont devenues des instruments de l'Etat bourgeois, des officines de celui-ci en milieu ouvrier. Leur programme actuel, même s'il s'applique à maintenir des illusions réformistes au sein de ia classe, la croyance en la possibilité d'améliorations réelles, n'est pas "réformiste". Il est bourgeois. Sous couvert de "réformes", il se propose de perfectionner les instruments d'oppression et de mystification de la classe, de renforcer l'emprise totalitaire de l'Etat sur la société. La journée de 10 heures, à l'époque où les ouvriers en travaillaient quatorze ou seize, était une conquête prolétarienne. Les nationalisations sont des mesures capitalistes.
Ce n'est par goût de l'exégèse que nous avons critiqué ces formulations, mais parce qu'elles recouvrent des confusions qui risquent d'être dangereuses. Si la vision qui se dégage de ce texte est authentiquement prolétarienne, par contre c'est sur la base de l'idée que le PC et le PS sont (quand même) "réformistes" que les gauchistes justifient leur politique bourgeoise de soutien à ces partis. Entre les mains d'une organisation du capital, toute confusion de la classe devient une arme redoutable et c'est pour cela qu'il ne faut en laisser passer aucune.
0O0
Dans la seconde partie de cet article, nous traiterons du problème central soulevé par ce texte : la fonction des cercles ouvriers.
C.G.
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [23]
Rubrique:
Revolution Internationale N°40 - août
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 812.82 Ko |
- 556 lectures
A PROPOS DES «GROUPES OUVRIERS» (II)
- 17 lectures
La première partie de cet article (RI n°39) était constituée d'un document émanant du "groupe ouvrier autonome de Clermont-Fd. intitulé "plateforme minimum pour l'autonomie ouvrière" et du début d’une critique de ce texte. Celle-ci portait sur un certain nombre de formulations erronées ou ambiguës concernant la nature présente des syndicats et des partis de gauche. En effet, si le texte est particulièrement clair sur la nature bourgeoise de ces organismes, il introduit une confusion en les considérant comme "réformistes". La critique essayait de démontrer qu'un tel terme qui s'appliquait à certaines organisations ouvrières du siècle dernier ne saurait convenir aux organisations bourgeoises à langage ouvrier d'aujourd'hui. Nous poursuivons ici la critique de ce document en abordant le sujet qui en constitue l'axe : la signification et la fonction des groupes et cercles ouvriers de discussion qui surgissent dans la classe à l'heure actuelle.
Les organisations de la classe ouvrière
Pour les communistes, il est acquis depuis longtemps que les armes fondamentales du prolétariat dans sa lutte contre le capitalisme sont sa conscience et son organisation. Nous ne reviendrons pas ici sur les causes de cette caractéristique de la lutte prolétarienne, ni sur la façon dont elle s'est manifestée aux différentes étapes de celle-ci (voir résolution sur l'organisation dans RI n° 17 et article sur les statuts du CCI dans la Revue Internationale n°5). Ce qu'il est indispensable de faire apparaître, c'est que, dans l'affrontement décisif contre le capital, la classe ouvrière se dote, comme traduction de cette double nécessité, d'une part, d'une organisation générale et unitaire, les Conseils Ouvriers et, d'autre part, d'organisations politiques, les partis prolétariens, regroupant les éléments les plus avancés de la classe et dont la tâche est de généraliser et approfondir le processus de prise de conscience dont ils sont une expression.
Démentant les conceptions de l'internationale Communiste, l’histoire de ce dernier demi-siècle a démontré qu'il ne pouvait exister pour la classe d'autres formes d'organisation que celles qui viennent d'être définies. Les syndicats, dont l'IC voulait faire des "courroies de transmission" entre le parti et la classe, se sont confirmés comme courroies de transmission entre l'Etat capitaliste et le milieu ouvrier. Les Unions Ouvrières, opposées par la Gauche Communiste d'Allemagne aux syndicats, se sont révélées comme des formes rénovées... de syndicats. En effet, de tels organismes, se proposant de rassembler tous les ouvriers, membres ou non du parti, sur la base du rejet des syndicats et de la reconnaissance de la nécessité de la dictature du prolétariat, n'ont pu remplir ni la tâche d'un parti, compte tenu de leur hétérogénéité ni celle de l'organisation générale dans la mesure où ils excluaient les travailleurs en désaccord avec ces positions. Et, si de tels organismes bâtards ont pu connaître un semblant de vie dans les moments de lutte intense au début des années 20, le reflux des luttes les a confrontés à l'alternative : disparaître ou suivre le chemin des syndicats, c'est-à-dire baser leur existence permanente sur la conquête de revendications; 1’intégration dans les structures étatiques devait suivre nécessairement. Et le fait qu'ils fussent organisés par usines et non par métiers ou branches d'industrie n'y changeait rien.
Les leçons d'un demi-siècle d'expériences depuis la vague révolutionnaire des années 17-23 sont claires :
- 1) l'organisation unitaire de la classe ne peut exister de façon permanente (conseils ouvriers) qu'au moment des luttes révolutionnaires. Elle regroupe alors l'ensemble des travailleurs et constitue l'organe de la prise de pouvoir par le prolétariat. En dehors de telles périodes, dans ses différentes luttes de résistance contre l'exploitation, les organes unitaires que se donne la classe, les comités de grève basés sur les assemblées générales, ne peuvent exister qu'au moment des luttes elles-mêmes et doivent se dissoudre après celles-ci sous peine de se transformer en nouveaux syndicats.
- 2) les organisations politiques de la classe peuvent, comme expression d'un effort constant de celle-ci vers sa prise de conscience, exister dans les différentes phases de la lutte. Dans les périodes de lutte intense, elles ont un impact direct sur celle-ci : on peut alors parler de partis. Dans les périodes de reflux, elles ne peuvent plus prétendre avoir un tel impact et leur tâche essentielle consiste dans une préparation théorique et organisationnelle du futur parti qui ressurgira nécessairement lors de la reprise prolétarienne. Mais, dans un cas comme dans l'autre, et quelles que soient les tâches immédiates de tels organes, leur base d'existence est nécessairement un programme élaboré et cohérent, fruit de l'ensemble de l'expérience de la classe et qui ne saurait être constitué d'une quelconque "plate-forme minimum" ni d'un ramassis éclectique de points d'accord. L'histoire, particulièrement celle de l'"Opposition de Gauche" regroupée autour de Trotsky sur des bases floues et volontaristes a montré de façon indiscutable que de tels regroupements sans principes sont toujours un facteur de confusion et non de prise de conscience, quand ils ne passent pas simplement à l'ennemi de classe lors des épreuves décisives (cas du trotskysme lors de la 2nde guerre mondiale).
Ce que les cercles ouvriers ne sont pas
Différents à la fois des organisations unitaires et des organisations politiques, on voit aujourd'hui surgir des groupements rassemblant un certain nombre de travailleurs sur la base d'un rejet des syndicats, de la gauche ; et animés de la volonté d'impulser la lutte prolétarienne. De tels organes ont des origines et revêtent des formes multiples que nous ne pouvons analyser ici. Mais le "groupe ouvrier autonome de Clermont-Fd" en constitue un bon exemple puisque, par certains côtés, il a atteint un niveau élevé de clarté, et que, par d'autres, il souffre de certaines confusions communes à ces différents groupes et qu'on peut résumer ainsi : l'idée qu'ils sont des ébauches soit de l'organisation générale de la classe, soit d'une organisation politique ou qu'ils constituent une sorte d'intermédiaire entre ces deux types d'organes.
En effet, ce "groupe", s'il affirme: "Nous ne sommes pas le noyau des futurs conseils ouvriers, ni l'embryon d'un futur parti", démontre qu'il ne s'est pas entièrement dégagé d'une telle conception en écrivant : "...l’expérience a montré que les syndicats utilisent systématiquement leur pouvoir pour isoler et diviser les luttes ... Il est donc fondamental que le groupe autonome ouvrier développe tous les liens possibles avec d'autres groupes autonomes ou comités d'usine et assure, le jour de la lutte, des liaisons'.' Dans cet extrait, le G.O.A.C. se place clairement sur le même plan que les comités d'usine élus par les assemblées générales lors des luttes et se propose les mêmes tâches : généraliser et coordonner les combats de la classe. Constatant que les syndicats ne font pas et empêchent un tel travail, il se propose donc de constituer un organisme permanent (les comités d’usine étant eux constitués pour la durée des luttes) qui se chargerait de l'assumer. Qu'il le veuille ou non, il s'agit là d'une nouvelle forme de syndicat...
On lit également : "...c'est pourquoi nous devons (les groupes ouvriers) regrouper nos forces à l'échelle de la classe ouvrière, c'est-à-dire mondiale..." Là encore, malgré ses dénégations, le G.O.A.C. se donne des tâches qui ne peuvent être les siennes. Ou bien il considère que l'organisation internationale des groupes ouvriers devra préluder à l'organisation générale de la classe à cette échelle, et il rejoint la vision anarcho-syndicaliste qui veut "préfabriquer" ce qui surgira spontanément des assemblées ouvrières. Ou bien, c’est en vue de constituer une organisation politique à l'échelle de la classe qu’il estime nécessaire que les groupes ouvriers regroupent leurs forces. Dans la mesure où le texte s'intitule "plateforme" et qu'il fixe comme autres tâches la réappropriation des "acquis des luttes du passé" et la discussion sur "la crise du capitalisme, la dictature... du prolétariat,... la période de transition", il semble montrer que c'est de cette deuxième forme d'organisation qu'il s'agit. Et, là encore, il tombe dans l'erreur de vouloir constituer une organisation politique qui n'ose dire son nom, basée sur un programme flou et incomplet (puisque «minimum"), ce dont nous avons déjà signalé les dangers.
Il s'avère donc que la tentative de ce "groupe ouvrier" de se définir le conduit, aussi clair qu'il puisse être par ailleurs, à se donner des tâches qui ne peuvent être les siennes.
oOo
Nous verrons dans la partie suivante de cet article comment un tel type d'erreur est en fait inhérent à ce genre de groupements. Nous y analyserons la signification du surgissement de ce type d'organes et la tâche des révolutionnaires à leur égard.
C. G.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
« LA GAUCHE COMMUNISTE EN ALLEMAGNE (1918-21)» : AUTHIER-BARROT AU-DESSUS DE LA MELEE
- 54 lectures
Le prolétariat, en ressurgissant sur la scène historique, après un terrible et tragique écrasement tant par sa durée que par l'ampleur de ses conséquences, se trouve confronté à un grand vide, presque à un néant : une brisure sans précédent avec son passé. Cette coupure est avant tout le résultat du passage dans le camp adverse de l'ensemble de ses organisations, créées pourtant au prix d'une lutte acharnée entre prolétariat et capital, de la sclérose ou de la décomposition, quand ce n'est pas de la disparition pure et simple de celles qui, peu nombreuses et au prix d'une formidable résistance à la pression de l'idéologie bourgeoise, ont tant bien que mal défendu les acquis historiques de la classe et ainsi participé à la préparation de son nouvel assaut.
Le poids de cette rupture organique s'est et se fait encore concrètement ressentir lorsque, après la réémergence du prolétariat à un niveau mondial depuis 68, le premier obstacle a été pour les minorités révolutionnaires sécrétées par ce mouvement, de se percevoir comme le produit d'une lutte entamée déjà depuis plus d'un siècle.
On peut diviser en deux grandes catégories les falsifications produites autour de l'élan révolutionnaire des ouvriers allemands : la première, celle du stalinisme et de son soutien critique : le trotskysme. En France, elle est représentée principalement par Badia et Broué. Chez Badia, en dehors des spartakistes érigés, à l'image du mausolée de Lénine, en totem du panthéon socialiste, c'est tout simplement le traitement du silence Infligé aux principales organisations communistes à côté du PC officiel (KAPD, AAUD) qui, pourtant, regroupent un moment la majorité des communistes et de la classe en lutte, et représenteront la meilleure tentative de la classe de continuer la marche de la révolution et de résister au reflux de celle-ci.
Chez Broué, si celui-ci fait référence dans son ouvrage monumental aux "gauchistes" allemands, il réduit les faiblesses et l'échec du mouvement à la crise de la direction révolutionnaire et à l'absence d'une pratique systématique de front unique.
La deuxième grande catégorie des mystifications produites par la chape de plomb de la contre-révolution est d'autant plus dangereuse qu'elle est le fait de groupes produits du combat de la classe ouvrière contre la dégénérescence de ses organisations (l'IC et les différents partis communistes), mais qui, ayant subi toute la pression énorme de la défaite, ont entamé un lent processus de dégénérescence, rendant par là-même, confuses ou même contre- révolutionnaires leurs positions sur bien des points.
Ainsi, nous avons la version bordiguiste selon laquelle la gauche allemande des années 20, bien qu'étant un courant authentique de la classe, une réaction saine de celle-ci, serait foncièrement minée dès le début par l'anarchisme ("Programme Communiste", n°58), la rendant ainsi impropre à toute effective action de classe, et justifiant donc, malgré ces erreurs, l'attitude du PC officiel (KPD), lui, foncièrement communiste.
A l'opposé de cette vision, et pourtant en parfaite symétrie avec elle, nous avons le purisme conseilliste. Pour lui, l'enseignement du mouvement révolutionnaire allemand des années 20 étant essentiellement réductible aux conseils ouvriers, il rejette par là tout l'immense apport du mouvement sur la question du parti, son rôle, sa relation avec les conseils, etc., et en arrive ainsi au fétichisme d'une forme qui, sans contenu révolutionnaire n'est rien et ne représente en soi aucune garantie contre le reflux de la révolution. Cette vision le rend incapable d'apprécier justement le rôle de l'organisation des révolutionnaires et les
épigones conseillistes actuels qui tendent à nier tout rôle à celle-ci, ne font par-là que répéter les erreurs du passé, produits avant tout du reflux (Rühle et les AAUE).
Le prolétariat confronté à la nouvelle période
Le livre[1] de Authier-Barrot sur la gauche communiste en Allemagne est le bienvenu, dans la mesure où il tend à renouer ce fil rompu avec l'histoire de la classe, oubliée, falsifiée, dénaturée par 50 ans de contre-révolution. Le livre, en se plaçant globalement sur un terrain de classe, s'attaque aux différents mythes attachés à cet épisode fondamental du mouvement ouvrier dont quelques-uns des plus tenaces, des plus crapuleux, sont énoncés plus haut. Il essaie également d'aborder d'une manière critique les questions posées par deux des principales fractions communistes qui ont lutté contre la dégénérescence de l'IC, contre le reflux, les gauches italienne et allemande.
Il tend à voir comment ces deux fractions ont exprimé la conscience que le prolétariat prenait de cette période de bouleversement incessant de "guerres et révolutions", des tâches impliquées par elle, et aussi la difficulté, les obstacles, en particulier en Allemagne à cette prise de conscience.
"La gauche allemande, à la différence des bolcheviks, s'est trouvée directement confrontée aux tâches de la révolution dans les pays les "plus avancés", elle en a reconnu lucidement quelques-unes, elle a fait une tentative très intéressante de les résoudre que la révolution future doit absolument dépasser" (Barrot).
Cette tentative est appuyée par un travail important, bien que parfois un peu universitaire. A travers une documentation très fournie et souvent peu accessible, il part des origines et de la situation du capitalisme et de la classe ouvrière en 14 pour aller jusqu'au reflux définitif du mouvement révolutionnaire après 23, en passant par les étapes fondamentales de ce mouvement, tels l'écrasement de la Commune de Berlin et l'assassinat de Luxembourg et de Liebknecht en janvier 19, ou encore la fondation du parti communiste allemand (KPD) puis du parti communiste ouvrier (KAPD).
Le livre est toutefois plus axé sur la gauche communiste proprement dite, c'est-à-dire sur ce qui va s’opposer à la dégénérescence de l'IC et des partis communistes et synthétiser le degré de compréhension du prolétariat de ses nouvelles tâches, celles-là même que Lénine va stigmatiser du nom de "gauchistes" dans la "Maladie infantile".
Malheureusement, le seul cadre permettant de voir clair dans cette vague incessante de flux et de reflux que fut le combat mortel entre prolétariat et capital en Allemagne, c'est-à-dire :
- une classe ouvrière gangrénée, chloroformée, par des années de paix sociale, de réformisme, confrontée brusquement avec la première boucherie mondiale, à l'ampleur de ses tâches historiques ; -l'isolement rapide, rendu vite tragique par la première grande défaite du prolétariat allemand en janvier 1919 du bataillon avancé de la révolution mondiale, la révolution russe, isolement ayant facilité la tâche du capitalisme, battre la classe par petits paquets ;
- un assaut prolétarien issu d'une guerre : 1*insurrection allemande éclate avec le mot d'ordre de la paix et du pain";
- enfin, reflet de cette situation, l’immaturité des organisations révolutionnaires et le retard avec lequel celles-ci se regroupent sur des bases non équivoques (le parti communiste allemand qui se constitue trois mois après le déclenchement de la révolution allemande) est, soit absent de ce livre, soit dilué dans tout un tas de conceptions confuses.
Ainsi les faiblesses et erreurs de l'IC et des différents partis communistes sont certes bien mises en évidence, mais perçues uniquement comme une somme mécanique, leur énonciation n'échappe pas dès lors à une certaine complaisance, tout au long des chapitres, sans jamais voir le fond du problème, alors qu'il est clairement exprimé dans le programme de la Ligue Spartakus : "...cette révolution est survenue après quatre années de guerre, après 4 ans au cours desquels, grâce à l'éducation que lui ont fait subir la social-démocratie et les syndicats, le prolétariat allemand a révélé une dose d'infamie et de reniement de ses tâches socialistes.. Que, si l'on se situe sur le terrain du développement historique, on ne peut s'attendre à voir surgir soudain une révolution grandiose, animée par la conscience de classe et des objectifs clairs à atteindre" (Luxembourg).
Par leur refus de tout ce qui peut leur rappeler le léninisme, ils en arrivent à l'incompréhension fondamentale du rôle de l'organisation révolutionnaire. Cette incompréhension culmine dans la non-reconnaissance du rôle actif joué par celle-ci dans la généralisation et la clarification de la conscience que la classe prend d'elle-même et de son but historique : le communisme.
Cela les amène ainsi à nier l'un des enseignements majeurs de l'histoire de la gauche allemande : prise de court par le tourbillon de la période révolutionnaire, elle n'a pu approfondir à temps suffisamment toutes les questions suscitées par l'ouverture du cycle de guerre et de révolution (exergue du 1er Congrès de l'IC) et, donc, se regrouper sur des bases programmatiques claires.
En résumé, les auteurs ne tirent pas, pour aujourd'hui, les conséquences de cette tragique expérience du prolétariat allemand, à savoir l'extrême importance du regroupement des révolutionnaires, parallèlement à l'approfondissement politique, avant que la classe n'ait déjà engagé ses combats décisifs, de même qu'ils sont incapables de comprendre l'immense apport de la gauche allemande sur la question du parti. Le KAPD fut pendant presque deux ans une démonstration éclatante de qu'est-ce qu'un parti vivant, anti-pyramidal, anti-hiérarchique ; bref, un centralisme effectif.
Les lunettes du modernisme
Cet ensemble d'erreurs et de confusion ont toute leur origine dans le modernisme de leurs auteurs.
Cette vision qui prend naissance dans la période de reconstruction (qui s'achève au début des années 60) se caractérise dans une volonté de dépasser le marxisme explicitement comme l'a fait "Socialisme ou Barbarie", ou inconsciemment en opposant l'ancien mouvement ouvrier au nouveau.
Elle exprime deux choses essentielles :
- une réaction saine mais balbutiante, écrasée encore par 50 ans de contre- révolution, de la classe ouvrière qui, renouant avec son être, se heurte violemment au monstre stalinien et à ses différentes formes ;
- le résultat de la pression permanente de la bourgeoisie afin de désarmer, démoraliser idéologiquement son ennemi mortel.
Cette opposition entre "ancien" et "nouveau" mouvement ouvrier se manifeste chez nos auteurs, par une sorte d'attitude de juges de l'histoire. Du haut de leur chair, forts de l'expérience accumulée pendant cinquante ans, ils décernent les bons et les mauvais points. Ainsi, l'immaturité, la confusion qui règne dans la gauche allemande et dans l'ensemble du mouvement ouvrier d'alors tend à être mesurée à l'aune d'un radicalisme abstrait, les faiblesses et confusions de la conscience de classe sont confrontées à un programme communiste que l'on n'appliquerait pas et les défaites peuvent pâtre ainsi imputées à un "manque de communisme".
Enfin, le confusionnisme de cette vision conduit à un rejet des conseils -ils étaient valables en 1920 parce que "l'usine, le lieu de travail, n'était pas encore conquis par le capital". Là encore, on retrouve l'ambiguïté présidant à l'analyse des auteurs. S'il est absolument correct d'affirmer, comme ils le font ensuite que "la prise en main de l'ensemble de l'appareil productif par les conseils ouvriers n'a rien de révolutionnaire si les ouvriers se contentent de gérer...", et d'insister sur le danger de l'usinisme, (la tâche fondamentale de la révolution sera bien sûr son extension), il est faux à partir de là d’en conclure à un rejet, par le fait même que les usines, les lieux de production présentent la base à partir de laquelle peut s'affirmer le prolétariat en lutte.
En conclusion, on peut dire que ce livre, quoique intéressant à lire, souffre fondamentalement des conceptions encore modernistes de Authier-Barrot, et de leur attitude académique, "au- dessus de la mêlée", ou du pur regard radical jeté sur le passé. En effet, il n'y a qu'une seule manière effective de dépasser l'apport limité, mais cependant essentiel de la gauche allemande, c'est tout simplement de poursuivre leur œuvre en participant, dans une optique de continuité-dépassement, à la préparation de la reconstruction d'un parti communiste qui, désormais, ne pourra être que mondial.
R. N.
[1] Publié chez Payot.
Courants politiques:
Approfondir:
- Révolution Allemande [46]
Rubrique:
Revolution Internationale N°44 - décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.33 Mo |
- 566 lectures
Rapport sur la situation en France (I)
- 635 lectures
Dans ce numéro, nous publions la première partie du rapport sur la situation en France adopté tout récemment par la section territoriale du CCI en France.
Ce rapport, qui s’inscrit dans la continuité des précédents travaux de notre Courant, dégage les perspectives fondamentales et met en lumière quelles sont les lignes de force qui orientent la société de classe dans ce pays.
Il se veut être une contribution qui permette à l'organisation des révolutionnaires de faire face à ses tâches dans un tout proche avenir et il doit être compris comme tel.
■ Malgré l'écran idéologique qu'a pu projeter la bourgeoisie, la crise mondiale et la situation de misère physiologique et spirituelle faite à des centaines de millions d'êtres humains dans les différents pays civilisés apportent, pour les révolutionnaires, la preuve que le régime bourgeois de la production a exacerbé ses propres contradictions pour aboutir à une impasse dont il ne peut sortir.
Partout, le capitalisme est acculé à une situation de faillite internationale. Celle-ci fournit la preuve palpable qu'il ne pourra remonter le courant, qu'il ne pourra pas retrouver l'expansion qui a été la sienne après la 2ème guerre. Le capitalisme ne peut plus organiser le processus d'accumulation comme avant l'éclatement de la crise; il ne peut plus le faire sur les mêmes bases qu'auparavant.
Malgré les lénifiantes déclarations optimistes des gouvernements, la "confiance" dans le redémarrage du bien-être social s'est perdue et le cauchemar de la guerre commence à envahir et à hanter la conscience de l'humanité qui a déjà vécu deux holocaustes. Le vieux monde capitaliste ne vit plus dans 1'opulence du développement des forces productives: des pans entiers de son édifice construit "dans le sang et dans la boue" sont emportés par la crise.
Quoiqu’il existe une série de facteurs sociaux, historiques et politiques propres à la France, la situation dans ce pays est déterminée par les lois du marché mondial.
0O0
En France, le capitalisme ne régule plus son marché et se trouve étouffé par un surplus de marchandises faute de débouchés en acheteurs solvables. Il a jeté sur le marché une surproduction d'articles de toutes sortes, il a inondé de billets de banque le marché monétaire amenant une inflation à deux chiffres. A la rentrée d'octobre 1977, le rythme de l'inflation atteignait 12%, les produits alimentaires accusaient une hausse annuelle de 20%, les services de 11%.
Les capacités de l'appareil de production français ne sont utilisées qu'à 75% en moyenne de leur capacité -65 % dans la sidérurgie; les investissements ne sont engagés qu'avec la plus grande hésitation, tandis que les taux de croissance sont plus faibles et les taux d'augmentation des prix plus élevés que pendant les années favorables que l’on a connues autrefois. Les courbes de croissance industrielle déclinent beaucoup plus vite que celle des géants (USA, Japon, RFA); les achats industriels s'effondrent; le vieillissement de la machinerie s'accélère.
Compte tenu de la faiblesse de l'augmentation du taux de productivité des usines françaises, les produits finis et élaborés trouvent difficilement acquéreurs. Non seulement la France perd divers marchés mais encore doit-elle protéger son marché intérieur de la percée étrangère. La libre circulation des marchandises au sein de la CEE étant morte de sa belle mort, l'austérité dans l'autarcie pour réduire la consommation de produits importés, devient la règle.
Après une brève reprise au premier semestre 76, reprise sectorielle et non généralisée à l'ensemble des branches d'activité, le capitalisme a plongé encore plus bas dans le marasme. Depuis le printemps 77, la production ne croit plus et baisse, se tasse dans le courant de l'été et la chute se poursuit à la rentrée d'automne. Une nouvelle détérioration générale est attendue, faisant craindre le pire pour la tenue du franc. La décote de celui-ci par rapport au deutschemark est venue alourdir la facture des importations. Le taux de couverture du commerce extérieur est tombé à 94 % alors que la dette extérieure française s'élève à 10 milliards de dollars. Les carnets de commande se vident et les stocks d'invendus s'alourdissent. Ce bilan désastreux, comparable à celui de l'Espagne, de l'Italie et de la Grande-Bretagne range la France dans le peloton des "hommes malades de l'Europe".
A lui seul, le nombre de chômeurs complets permet de se faire une idée précise de la dimension et de la profondeur de la crise: 1,220,000. Des dizaines de milliers de jeunes en âge d'entrer dans la production ou les activités annexes restent sur le pavé. La plupart des salariés de l'industrie et du commerce, qui avaient été mis à pied par suite de "conjoncture défavorable" n'ont pas, depuis, retrouvé de travail. Maintenant, la bourgeoisie décidée à faire baisser le chômage essaie de dresser les ouvriers au travail contre les chômeurs "fauteurs d'inflation"; elle renvoie dans leurs pays d'origine les travailleurs étrangers et limite sévèrement les contingentements de main d'œuvre. Il suffit que le chômeur ne se présente pas à une convocation d'un employeur, où qu'il soit situé sur le territoire national, pour être radié du chômage. Les tentatives du gouvernement pour assainir le marché de l'emploi ont l'appui, plus ou moins franc, des syndicats qui développent le thème du "fabriquons français !", cherchant par-là à atteler la classe ouvrière à la défense de "son" capital.
Sur toute la ligne, le plan du docteur Barre est allé d'échec en échec. Devant ces graves revers et leurs conséquences en pleine période de préparatifs électoraux le gouvernement, en particulier sous la pression de l’ex-premier ministre Chirac, a eu recours à un saupoudrage de "social" (facilité de retraite anticipée, aide aux ouvriers et aux familles pour la rentrée scolaire, appel à la philanthropie patronale et municipale pour le secours aux chômeurs, embauche de 300.000 jeunes...) aussi bien pour maquiller les plaies du régime que pour dégonfler, le temps d'une campagne électorale, les statistiques du chômage. Toujours dans une préoccupation d'ordre politique, le gouvernement a accordé à plusieurs catégories sociales -petits industriels, commerçants, artisans- la déduction de 20% sur la déclaration de leurs revenus.
Dans un souci d'apaisement, le gouvernement a fini par faire voter une loi sur l'imposition des "plus-values" particulièrement atténuée.
Le capitalisme français n'est plus capable de reprendre souffle et de continuer à orienter la production sur les bases de la propriété privée. Malgré les pétitions de principes sur le libéralisme giscardien, jamais les pouvoirs publics ne sont intervenus aussi souvent et aussi directement dans l'économie française. Tour à tour dans l'automobile (Peugeot, Citroën) et les poids lourds (Berliet, Saviem), dans l'industrie nucléaire et l'informatique (CGE, CII, Alsthom), c'est-à-dire les principaux secteurs à technologie avancée et de l'économie de guerre ont été placés sous la coupe directe de l'Etat. Pour l'instant, le secteur public en France représente 9,6% de la population active et 24% des investissements. Quel que soit le résultat des élections de 1978, cette marche tendant à renforcer le caractère omniprésent de l’Etat-Parasite sera accélérée en tous cas. Le capitalisme d'Etat, pour diriger la nation tout entière vers l'effort de guerre, a donné plus nettement encore au gouvernement -démocratique ou totalitaire- le caractère de machine exerçant une dictature sociale et politique sans précédent.
Sans les exportations militaires, le déficit de la balance des paiements de la France aurait été le double en 1974.
Le capitalisme français ne peut plus se survivre sans une gigantesque économie de guerre. Il a lancé sur le marché, dans l'espace et sous les mers, un stock incalculable d'armes et d'engins de mort des plus meurtriers. Il a converti une masse énorme de moyens de production en moyens de destruction. Il a consacré une masse d'argent de plus en plus fabuleuse pour la recherche militaire. Il a investi des milliards pour construire des sous-marins nucléaires et la bombe atomique. Il a militarisé la vie de l’homme depuis le berceau jusqu'à sa tombe.
Le capitalisme contient et conduit à la guerre pour anéantir les propres richesses créées par le travail de la société. La guerre est devenue le mode de survie permanent du capitalisme qui ne paraît que capable de plonger l'humanité dans le précipice d'une 3ème guerre mondiale annoncée par les conflits impérialistes sur la scène du monde. Par les efforts déployés pour son armement, par sa politique munitionnaire, par ses expériences atomiques, par la construction de dizaines de centrales nucléaires, la France se place aux avant-postes de la préparation à la guerre.
La crise a précipité, non l'effritement, mais le renforcement des blocs. Elle a mis les pays de second ordre en demeure de choisir leur camp; elle a resserré les jeux diplomatiques des différentes nations.
Capitalisme affaibli par la dernière guerre mondiale, la France a payé du prix de son indépendance nationale le soutien logistique, économique et financier que lui assure la puissance nord-américaine. C'est pourquoi elle a dû rabaisser ses prétentions sur ses anciennes chasses-gardées d'Afrique Noire et de l'Indochine. Les Etats-Unis n'abandonnent qu'une maigre portion du marché mondial à son allié auquel est fixé un cadre d'exportation bien défini qui ne pourra aller qu'en se rétrécissant. Renault et Michelin ont rencontré d'énormes difficultés aux USA: les USA ne sont pas un marché pour la France.
En outre, les interdictions de survol de New-York par le Concorde ont frappé d'un rude coup toute l'aéronautique française. Sous la pression de l'Amérique, qui doit à tout prix contenir les forces du Pacte de Varsovie en Europe, la France a été quasiment contrainte d'accroître son budget militaire. La restructuration de l'armée française, l'abandon de son projet stratégique de "défense tous azimuts", la substitution de la technologie américaine pour la conception et la réalisation des centrales atomiques à la filière nationale "graphite-gaz", traduisent la soumission de la France au bloc de tutelle. Dans l'impossibilité de jouer sa propre carte en politique étrangère, la France voit ses intérêts généraux se confondre à ceux du bloc américain. Elle sera toujours plus soumise au diktat américain, renoncera à toute initiative diplomatique et militaire sans l'accord américain, et réintégrera l'OTAN.
Dans une deuxième partie, nous verrons comment la crise économique se répercute sur le plan politique, et sonne le branle-bas de combat contre la classe ouvrière pour les différentes fractions du capital.
Situations territoriales:
Révolution Internationale N°41 - septembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 894.16 Ko |
- 557 lectures
Espagne : LE REGIONALISME CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
- 31 lectures
A l'heure où l’Espagne subit, plus que bien d'autres pays développés, le tourment de la crise générale du capitalisme, l'actuel regain du "particularisme" régionaliste met tout d'abord en relief la faiblesse constitutive du capital espagnol. Expression des contradictions au sein de la bourgeoisie, le régionalisme n'en agit pas moins corme force de mystification contre le prolétariat. Il contribue à l'isolement des luttes ouvrières et favorise dans le prolétariat les tendances localistes. Face à une résurgence ouvrière qui lui pose problème, toutes les fractions de la bourgeoisie, gauchistes compris, tentent de conjuguer leurs efforts pour renouveler le coup réussi en 1936-37, en faisant feu de tout bois, régionaliste et autre. Mais, dirigée vers une classe qui, contrairement à ce qui était en 1936, ne relève pas d'une défaite mondiale et multiplie les signes de sa combativité, la mystification régionaliste ne peut que voir son poids de plus en plus diminuer.
ITINERAIRE ET BILAN DU CATALANISME “REVOLUTIONNAIRE”
Que le particularisme se manifeste avec une exceptionnelle vigueur dans la péninsule ibérique n'est pas un pur produit d'un milieu géographique circonscrit, mais de l'histoire mondiale tout entière, voilà l'explication du marxisme. En Espagne, la force du séparatisme tient à ce que Marx qualifiait d’"ignominieuse et lente décomposition" de l’organisme social. Après la perte du Portugal et la tentative de sécession avortée de la Catalogne au 17° siècle, l'élan politique centralisateur impulsé par l'accumulation primitive est interrompu, l'unité économique entre les régions relâchée. La classe dominante, mélange hétéroclite de bourgeois flanqués de "caciques", de parasites des congrégations religieuses se replie sur son agriculture et veille principalement à maintenir son immense empire colonial.
Dans un pays où les aspirations a l'hégémonie politique d'une bourgeoisie catalane se trouvent bridées par une monarchie à l'arrière-ban de l'Europe, il y a un catalanisme républicain anticlérical comme il y a un fort sentiment séparatiste chez les ouvriers encore largement occupés dans la manufacture et le travail à domicile, comme il y a un catalanisme des communautés libertaires parmi les misérables métayers et les journaliers agricoles.
A un prolétariat qu'elle ne pouvait pas associer à une impossible prospérité, la bourgeoisie devait faire subir de terribles saignées. Sa chirurgie spécifique, et chaque fois "bénéfique" à l'organisme social, ce fut d'attirer les travailleurs et les paysans dans des aventures pour l'autonomie.
Combien de fois la bourgeoisie catalane a-t-elle réussi à les tromper cyniquement et à les meurtrir en agitant le thème du "statut d'autonomie de la province" ? Tantôt ce sont les émissaires alliancistes bakouniniens qui, assimilant unité politique et tyrannie gouvernementale, proposent la conquête de l'autonomie conjuguée au principe fédératif des groupes de producteurs, des communes et des régions. Un peu plus tard, c'est le courant de ces mêmes alliancistes agissant pour la "décentralisation" du pouvoir révolutionnaire dans chaque ville et village lors de la première république espagnole de 1873, écho lointain mais vite muet de la révolution démocratique européenne de 1848. Aux lendemains de la restauration de la monarchie, c'est le parti fédéraliste proudhonien de Pi y Margall qui prétend répondre aux aspirations du petit peuple catalan par un retour en arrière vers le régime des guildes et corporations de métiers libres de l'ancienne principauté catalane. Puis c'est 1'Esquerra de Macià et Companys qui cherchera à capter l'énergie des masses afin de l'utiliser dans sa lutte pour ramener le centre de gravité de la vie sociale et politique de Madrid à Barcelone^
De 1911 à 36, il n'y a pas un seul congrès de la Confédération qui ne fasse acclamer l'autonomie de la Catalogne, pas une seule prise de terre par les paysans, pas une seule grève où les cénétistes ne mettent en avant la "Catalogne libre", pas un déclenchement de soulèvement dans les "pueblos" n'agissant pour son compte sans se préoccuper des autres.
Autour des années 30, c'est la Fédération communiste catalano-baléare qui se présente sur la scène sociale en déployant le drapeau du droit de la nationalité catalane à la libre disposition d'elle-même, jusques et y compris le divorce. En 29, elle se sépare du squelettique parti officiel sur la critique qu'il n'agit pas dans le sens du vaste mouvement autonomiste qui agite toute la péninsule et affaiblit l'appareil d'Etat. Son mot d'ordre sera la "République fédérale" et elle estime que le prolétariat se suiciderait politiquement s'il tentait de substituer sa propre dictature de classe au régime du général Primo de Rivera tombé tout seul comme un fruit pourri. Pour Maurin, la tête pensante, cette révolution est typiquement "espagnole" et elle s'appuiera non sur les soviets mais sur les "Juntas", plus conformes à la "spécificité" locale.
Elle pousse le souci d'exprimer la place tenue par la Catalogne dans le progrès social et l'apport culturel de son peuple[1] au point de se voir accuser de défendre des thèses "droitières" par une Internationale dont la théorie du socialisme en un seul pays et le kuomintangisme ont définitivement scellé le destin contre-révolutionnaire. Etait-ce à dire qu'elle est convaincue que la Catalogne est la "nation élue" et la classe ouvrière de Barcelone la plus avancée du monde ? A en croire les augures "marxistes", la révolution qui va s'accomplir en Catalogne surpassera à tous les niveaux celle de 17 dans la Russie "incomparablement plus arriérée". Que ce soit sous le label de Fédération communiste catalano-baléare, de "Bloc" -né de la fusion avec le Partit Comunista Catala- d'"Alliance" ou de POUM, s'enchaîne la spirale de toute une politique nationaliste catalane à couleur "maximaliste".
N'y a-t-il pas de la fierté nationale quand, après le succès de la "gauche" aux élections d'avril 31, qui apportent la seconde République, le "Bloc" envoie un détachement armé de ses propres forces assurer la garde du nouveau gouvernement, la Generalitat, que vient de se donner la bourgeoisie catalane ? Parce qu'à Barcelone, le "camarade" Companys est installé à la Generalitat, il n'y a aucune raison de se mettre en grève. Fier d'avoir réussi la première étape de la révolution démocratique, le Bloc propose à 1'Esquerra et à sa base paysanne l'Uniò des Rabassaires le front unique. L'Alliance Ouvrière, sous le nom duquel désormais agit le Bloc, pousse 1'Esquerra à armer les ouvriers contre les menaces de la "droite". La voilà apportant aide et appui à un gouvernement qui, derrière le paravent de sa "législation progressive” décrète illégales les grèves sans préavis et expulse les paysans qui occupent les terres.
Au "Bloc" a succédé le POUM par assemblage autour de la Fédération de plusieurs "agrupaciones", comme de bien entendu autonomes, localisés en Catalogne et de la majorité de la Gauche communiste de Nin. Sous la direction de celui-ci, au moment du pronunciamento franquiste, le POUM tout comme la CNT, va parachever sa politique d'union antifasciste. Que disait le POUM sur la nature de classe de la Generalitat ? Ce gouvernement n'est comparable à aucun autre, écrivaient et la "Batalla" et "El Comunista" : "Le gouvernement de la République est l'expression de la volonté des masses populaires incarnée par leurs partis et organisations" (5/ 12/36). Que faisait le POUM par rapport au problème fondamental de la destruction de l'Etat ? C'est avec l'argument de la lutte anti-fasciste qu'il entre dans le Conseil Economique, que ses milices s'intègrent dans l'armée régulière soumise à 1'Etat-Major qui a rétabli le code militaire de la monarchie, qu'il participe au gouvernement[2] (2). Et le gouvernement dans lequel Nin fait office de ministre de la justice est celui-là même qui décide la dissolution des Comités nés dans les premières journées révolutionnaires de juillet 36.
Quant à Messieurs les anti-étatistes, il était hors de question, par souci de tolérance politique, que la CNT déposât Companys et décrétât la dictature du prolétariat. Jetant aux orties son intransigeance de façade, elle acceptait de participer aux gouvernements centraux de Madrid et de Barcelone composés de partis ayant trempé jusqu'au cou dans la plupart des répressions antérieures. Côte à côte, en tournée de propagande républicaine, on a pu voir Nin unir ses efforts à ceux de Companys pour faire plier les derniers comités à la nouvelle légalité des conseils municipaux. Tandis qu'à Valence, l'anarchiste Oliver surveille l'application de la justice "populaire", à Barcelone, elle s'exécute sous l'oeil vigilant du "marxiste" Nin.
Déterminés à défendre, à l'intérieur du camp républicain, l'unité contre l"'ennemi commun" : le fascisme, les chefs de la CNT et du POUM prirent part à la liquidation des barricades édifiées au début de mai 37, sur le port et dans les faubourgs barcelonais. Oh ! bien sûr, pas en tirant directement sur les insurgés : d'un côté, la "Batalla" appela à abandonner la rue, de l'autre, "Solidaridad" arrangeait une "trêve" avec la Generalitat (cf. RI n° 38).
Avec leurs formules générales de gauche, les dirigeants cénétistes et poumistes ont laissé entrevoir aux ouvriers que pouvait exister un catalanisme à contenu "révolutionnaire" dépassant, il va de soi, celui de 1'Esquerra. Ce triste bilan du catalanisme "révolutionnaire" se passe de longs commentaires : une profonde défaite pour le prolétariat et un nouveau sursis pour la domination capitaliste.
R. C.
Géographique:
- Espagne [92]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Régionalisme [93]
Espagne : UN COMBAT D'EPICIERS
- 14 lectures
D'un puissant concours dans l'orchestre démocratique bourgeois depuis la mort de Franco, les "bandas" régionalistes espagnoles, après 1'"historique" sanction des urnes de juin, redoublent de vigueur aux accents de frénétiques sardanes et autres fandangos. Dans le contexte d'une Espagne capitaliste pressée comme un citron par la crise, transpirant des chômeurs par centaines de milliers et n'offrant aux ouvriers "libérés" du fascisme pas une autre perspective qu'une exploitation accrue, l'austérité et la répression, il est déjà assez écœurant d'entendre les chantres nationalistes basques ou catalans reprendre à pleines voix leurs hymnes vétustes à la gloire de la langue, de la culture, des coutumes "libertaires" et du génie ancestral de "leur" peuple ; mais le "particularisme" atteint une dimension proprement caricaturale et délirante lorsque, derrière le Pays Basque, la Catalogne et la Gallice, il nous faut assister depuis l'Andalousie, le León, 1'Estrémadure même, et jusqu'aux plus grises sous provinces d'Espagne, au spectacle d'une cul-terreuse et épicière bourgeoisie s'exciter à retardement du chatouillis autonomiste. Le branle-bas régionaliste actuel est d'autant plus remarquable et consternant que, par rapport à la seconde république de 1931, on voit cette fois, et à quelques indécrottables phalangistes près, tout l'éventail des partis politiques espagnols, depuis l'extrême gauche -confondue à l'extrémisme sépariste- jusqu'au parti néo-franquiste de Fraga, en passant par le PSOE et le PCE, y participer sous une nuance ou une autre. Les marxistes, gens de froide rigueur, dit-on, ne s'épuisent pas en vaines colères, et pourtant la vision de toutes ces ganaches vieillies en exil avec encore sur elles le sang séché des massacres ouvriers de la république, les Dolores Ibárruri, les Federica Montseny et les Josep Tarradellas (successeur de Companys), qui viennent reprendre du service dans leur terroir, a de quoi les révulser.
En ouvrant des négociations avec Tarradellas et Jesús Maria de Leizaola pour la reconduction des statuts d'autonomie de la Catalogne et du Pays Basque, le gouvernement Suarez, au nom de la bourgeoisie, essaie de renouer le fil cassé de la maigre et peu brillante tradition démocratique espagnole, inséparable de la "question des nationalités" au regard de la structuration du capital et de son Etat.
Le problème national, en Espagne, a le même caractère que partout, dans le cours de la décadence capitaliste : il est pon progressiste et revêt une fonction de mystification contre le prolétariat. Il n'offre un intérêt d'examen aux révolutionnaires que par rapport à l'appréciation des forces de la bourgeoisie et des conditions de la lutte révolutionnaire des ouvriers dans ce pays.
Du point de vue de la bourgeoisie nationale, ce que traduit avant tout le "particularisme" régionaliste, c'est le caractère archaïque de l'économie espagnole. Même s'il faut bien reconnaître un progrès certain depuis la situation des années 30, le relatif retard historique du développement du capitalisme en Espagne s'accuse encore. Le régionalisme, comme première conséquence de cet archaïsme, découle, à un niveau superficiel, de la disparité de l'implantation des capitaux à l'intérieur de l'Espagne. Mais la conséquence fondamentale réside dans le poids toujours important que représentent, par rapport à l'ensemble de la bourgeoisie, les secteurs non industriels de cette classe, propriétaires terriens, commerçants, plus liés aux formes anciennes de production et, par nature, hostiles à la concentration et à l'étatisation. C'est donc tout naturellement parmi ces couches anachroniques que le régionalisme, dans ce qu'il a de plus bêlant et de proprement réactionnaire, trouve l'essentiel de son humus idéologique. Sous cet angle, la recrudescence présente du sentiment "particulariste", représente bien la ré réaction viscérale de couches arriérées de la bourgeoisie devant leur décomposition sous le fouet d'une crise qui contraint le capitalisme à la rationalisation.
Le fait que le régionalisme trouve son expression la plus consistante justement dans les aires les plus industrialisées d'Espagne, loin de venir en contradiction à notre analyse, la confirme. Il explique que, dans ces provinces, le Pays Basque et la Catalogne, le régionalisme peut adopter des formes d'autant moins primitives que la petite-bourgeoisie y est moins prépondérante. Le contenu de ce régionalisme-là, qui n'adopte une tournure fédéraliste que pour enjôler la petite-bourgeoisie, sinon le prolétariat, dénote une meilleure compréhension des intérêts globaux de la bourgeoisie espagnole et de ceux de l'Etat. C'est d'ailleurs pourquoi, sur cette base, la concession d'un statut d'autonomie, pour la Catalogne par exemple, fut et demeure parfaitement négociable en 1932 comme en 1977 par toutes les sphères de la bourgeoisie liées plus directement à l'Etat. Cet autonomisme-là n'en illustre que mieux le trait général d'immaturité du capitalisme espagnol par le fait qu'il tire sa substance ferme d'une excentration caractéristique des foyers économiques par rapport au siège de la vie administrative et politique madrilène.
11 est important de souligner toutes les conséquences qu'entraîne cette situation pour la lutte d'un prolétariat surtout concentré en Catalogne et au Pays Basque, cela dans le sens d'un affrontement différé avec la force centrale de l'Etat et d'une pente facilitée vers l'isolement localiste.
C'est d'ailleurs par ce dernier biais que le régionalisme a le plus de chance de figurer avec efficacité dans la panoplie mystificatrice de la bourgeoisie contre le prolétariat. En tant qu'exaltation idéologique du fait culturel et linguistique, sa capacité de brouillage, sensible peut-être dans les secteurs et les moments où le prolétariat, faible, se trouve isolé parmi les autres couches sociales, ne tient pas longtemps devant une classe ouvrière rassemblée et fortement combative, qui se ressaisit de toute une expérience historique où jamais il n'a été question d'un programme révolutionnaire régionaliste. Qu'est-ce que l'important contingent des travailleurs immigrés andalous et galiciens, en Catalogne et au pays Basque, peut bien avoir à faire avec la culture et la langue du pays ! Trimant, tels de vulgaires OS maghrébins en France, dans des bagnes industriels qui n'ont rien de spécifiquement régionaliste, ils ont par contre beaucoup à penser de syndicats, CNT, UGT et autres, qui viennent leur parler des intérêts ouvriers dans une langue qu'ils ne comprennent pas ! Ils ont là une bonne occasion de vérifier la sale besogne syndicale de division de la classe ouvrière ! De même, les travailleurs français, qu'ils soient bretons ou occitans et qui, venus passer leurs vacances en Espagne, ont vu leurs voiture se consumer dans les flammes de la passion gauchiste des supporters , basques et catalans confondus (sans doute l'ébauche d'une internationale régionaliste), d'Apalategui, pourront méditer et tirer, à partir de cet exemple extrême, la leçon du contenu hautement prolétarien du régionalisme, qu'il s'affuble ou non de la phraséologie révolutionnaire internationaliste.
Les régionalistes de toute vertu, qu'ils s'étouffent avec leurs millénaristes antiennes, c'est de l'expérience vive d'une classe porteuse d'avenir que les révolutionnaires tirent et répètent cette leçon : pas plus que l'émancipation du prolétariat mondial ne peut se contenir dans le cadre des nations, pas moindre peut être son exploitation que les capitalistes soient du village, du pays, du cru, ou pas.
Mx
Géographique:
- Espagne [92]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Régionalisme [93]
Rubrique:
LA DEUXIEME MORT DE SACCO ET VANZETTI
- 24 lectures
On ne les a pas envoyés tout droit à la chaise électrique, mais l'infernale machine judiciaire du Massachussetts les a tués 7 fois 365 jours avant de le faire. Après ces années de torture morale dans leur prison de Boston, de lutte avec la mort comme bien peu l'on connue, le 22 août 1927, les deux anarchistes italiens Sacco et Vanzetti étaient électrocutés par la mercantile Amérique. Pays où se respire à pleins poumons l'air le plus libre du monde, c'est à dire que la "loi du peuple américain" pendit les cinq martyrs de Chicago, que 1'American Legion brûla vifs femmes et enfants d'un campement de mineurs à Ludlow, que la milice patronale de Manville-Jackes battit à mort et braqua ses fusils sur les ouvriers du textile à Gastonia, que des centaines de militants membres des IWW pourrirent dans les pénitenciers.
Il n'y a nul système d'exploitation et de contrainte de l'homme par l'homme comme le capitalisme pour appeler à son aide ceux qui figurent en victimes de la tragédie sociale et les faire plaider pour leur propre bourreau en une mise en scène parodique de l'histoire. Ainsi, s'ordonnèrent les procès du "Centre anti-soviétique trotskyste" de Moscou. Ou alors, c'est le bourreau lui-même qui s'approprie sa propre victime. Ainsi, Mussolini, tortionnaire du prolétariat italien, mêlera sa voix pour sauver Sacco et Vanzetti, "ses infortunés frères italiens".
Mais le capitalisme n'était pas encore arrivé aux limites de la récupération que nous lui connaissons désormais. Il sera donné à notre époque de montrer à quels sommets de détournement il peut se hisser pour transformer la boue en or, la haine en vénération. Ce n'était pas assez qu'il payât grassement des juges pour condamner et des flics pour tuer. En ce cinquantième anniversaire du supplice de Sacco et de Vanzetti, à son déclin, le capitalisme s'adonne à tous les trafics, use de toutes les combines de brouillage idéologique. Voilà qu'aujourd'hui le gouverneur en place du Massachussetts décrète le 23 août "journée du souvenir" de Sacco et Vanzetti pour, paraît-il, réparer l'injustice de son prédécesseur. De distingués professeurs honoris causa, d'éminents juristes, des sociologues certifiés, tous ceux à qui incombent le devoir d'éclairer de leurs lumières le chemin de la démocratie, commentent les pièces et les témoignages du procès de Delham. Avec une charité toute chrétienne, ils conclueront à la "non-culpabilité" de ce "bon cordonnier et du pauvre crieur de poissons", deux parias de l'opulente Amérique.
Maintenant, l'Amérique puritaine et obscène de Carter ne craindra pas d'utiliser l'agonie de Sacco et de Vanzetti pour faire passer au monde le message de son nouvel ange exterminateur : l'évangile des "droits de l'homme". C'est ainsi que le capitalisme se sert sans vergogne du sang répandu par lui quotidiennement pour huiler les mécanismes de son système de broyage et d'abrutissement de l'homme ; qu'il transforme sa chaîne de brutalités en une couronne de pitié. Sous tous les cieux, le capitalisme anthropophage joue la grandiloquente scène de la concorde universelle.
Sous toutes les latitudes, ivres de sang humain, dansent les goules du capitalisme en chantant la gloire des "droits de l'homme". Ces "droits de l'homme" qui se glissent dans la vie des hommes comme l'ombre funeste des rapports de propriété !
Il n'y a aucune organisation de l'ennemi de classe qui, tel le PCF, peut émasculer toute protestation prolétarienne devant l'assassinat d'un sans- grade de la guerre de classe. Pas encore tout à fait mis à genoux par la contre- révolution, le prolétariat qui s'était dressé unanime dans de grandioses manifestations pour empêcher /'inéluctable exécution de Sacco et de Vanzetti, se trouva travesti des oripeaux mangés aux mites de la "démocratie". L'attaque du palais de la SDN dans la paisible Genève, la grève des mineurs gallois et des dockers de la Tamise, l'important défilé des grévistes du port de Sydney et les batailles de rue dans le Paris des ouvriers deviendront, pour les staliniens, autant de marques d'attachement du prolétariat mondial aux institutions républicaines.
Malheureusement, le fait est que l'épuisement du prolétariat permettait aux staliniens de transformer la révolte de dégoût des ouvriers du monde entier en une démonstration de son respect des codes et des lois érigés par la bourgeoisie, à métamorphoser ces vibrants hommages d'internationalisme prolétarien en un combat de défense et d'élargissement des conquêtes constitutionnelles.
Que le prolétariat toléra et accepta que sa révolte se convertisse en campagne démocratique avec l'inévitable kyrielle d'avocats et de représentants de l'intelligentsia révélait bien son état d'extrême affaiblissement dont le débouché sera la mobilisation à la guerre.
Cependant, les hésitations de la bourgeoisie américaine à exécuter la sentence de mort réflétèrent sa crainte d'un sursaut, d'une dernière flambée de l'incendie social encore plausible en 1927. Aussi, dans la nuit où Sacco et Vanzetti se dirigeaient vers la chaise électrique, dehors la prison de Charlestown était équipée comme si elle allait avoir à soutenir un siège militaire : à la garde ordinaire, le gouverneur ajouta d'autres flics et des centaines de ses prétoriens armés de mitrailleuses et de lance-grenades.
Il n'y a pas dans 1'"affaire Sacco et Vanzetti, un cas exceptionnel à dissocier du mouvement historique général dont il n'est qu'un témoignage. Au moment où le prolétariat vaincu descend la pente fatale vers la guerre, à l'échelle de deux individus, la mort de Sacco et de Vanzetti symbolise la tragédie que vit dans ses chairs la classe révolutionnaire, le prolétariat. Leur mort marque effectivement le signal de recrudescence de l'offensive capitaliste pour conjurer le "péril rouge". Les deux électrocutés de Boston annonceront la vague de répression sanglante qui, immédiatement, allait s'abattre sur le prolétariat du monde entier.
S'adressant une dernière fois à ses camarades de lutte, Sacco écrivait que "la classe capitaliste ne connaît pas de pitié pour les bons soldats de la révolution". Ont réellement été des soldats de la révolution sociale, ceux dont nous saluons ici la mémoire -bien que nous ne nous réclamions pas de l'idéologie anarchiste-, et non des chantres de la Démocratie. Sacco et Vanzetti ont payé de leur vie la politique contre-révolutionnaire de la social-démocratie durant l'assaut révolutionnaire des années 20. De tels souvenirs ne doivent jamais s'effacer du cœur et de l'esprit des prolétaires. Ils doivent leur redonner la soif de combattre par l'affirmation d'une claire perspective de lutte.
C'est le prolétariat mondial qui renversera l'ordre du bourreau. Cela seul, la révolution prolétarienne, permettra de rendre définitivement impossible les meurtres que le capitalisme perpètre de sang-froid à l'abri de la loi républicaine ou de la "constitution socialiste". Quand le prolétariat se mettra debout pour reprendre la lutte intransigeante, alors se réalisera ce qui ne pouvait être qu'un vœu de Sacco : "DEMOLIR CETTE HORRIBLE MAISON DE MORT AVEC LES MARTEAUX DU PROGRES !"
R. C.
Personnages:
Evènements historiques:
- SACCO ET VANZETTI [96]
Rubrique:
LES LUTTES DE LA CLASSE OUVRIERE : FREIN A LA GUERRE
- 21 lectures
Les grèves qui ont secoué l'Afrique du Nord ces derniers mois marquent le resurgissements de plus en plus évident du prolétariat dans cette région du globe.
La crise dans son long travail de sape sert de révélateur face aux impostures "socialistes" et au carcan nationaliste. Dans une zone où pèse la menace de la guerre, 'la combativité du prolétariat joue un rôle de frein dans le développement des conflits impérialistes de la périphérie vers le centre du capitalisme. La menace d'un affrontement entre l'Algérie et le Maroc se heurte déjà à la réalité de la lutte d'un prolétariat proche de celui de l'Europe à travers toute son expérience de l'immigration.
De plus en plus, au Moyen-Orient comme en Afrique du Nord, les luttes de la classe ouvrière deviennent le plus sûr garant de la lutte contre la guerre face à l'hécatombe que la bourgeoisie propose comme "solution" à la crise mondiale du capitalisme.
Le mythe de la lutte de libération nationale de l'Algérie est aujourd'hui bien loin, et la magie des mots ne fait plus recette. L'appellation contrôlée du "socialisme à l'algérienne" n'arrive même plus à masquer la sinistre marchandise frelatée du capitalisme d'Etat, pas plus à l'algérienne qu'à la russe ou à l'américaine mais est la tendance générale du capitalisme décadent, d'autant plus brutale en Algérie ou au Maroc que ce sont des pays sous-développés. Aujourd'hui tout le monde se réclame du socialisme et les pitreries d'Hassan II, appelant à un "socialisme authentiquement marocain" ne peuvent que prêter à sourire, la magie incantatoire sera de moins en moins suffisante pour museler un prolétariat dont on ne peut calmer les tiraillements de la faim avec des "belles paroles".
Les maux dont souffre le "socialisme algérien" : le chômage, avec plus de 1 500 000 sans-emplois (plus de 60% d'inactifs chez les jeunes), des centaines de milliers de travailleurs qui doivent aller travailler dans les métropoles d'Europe (900.000 en France), et l'inflation, qui se traduit par une hausse vertigineuse dans le marché privé et une pénurie dans les magasins d'Etat, n'apparaissent pas très différents des symptômes de la crise du capitalisme dans tous les pays du monde.
Que ce soit en Algérie "socialiste" ou au Maroc "monarchiste", les travailleurs sont confrontés aux mêmes problèmes, à la même attaque de leur niveau de vie et face à cela ne peuvent que réagir de la même manière. Les récentes grèves chez les deux frères ennemis du Maghreb l'ont bien démontré, que ce soit au travers des grèves des travailleurs des transports, du textile et des dockers en Algérie.
En déclenchant une grève sauvage, les travailleurs des docks d'Alger ont vu se dresser devant eux l'ensemble de l'appareil d'Etat. Les exhortations à reprendre le travail au nom de l'intérêt national faites par les bureaucrates des sociétés portuaires étatisées, les manœuvres de Benikous, leader de l'UGTA, le syndicat unique, pour faire cesser la grève, sont restées sans effet, les promesses vagues ne suffisaient plus aux dockers, instruits de l'expérience de grève de 1975 où Boumédienne en personne s'était déplacé pour, à coups de promesses sans lendemain, endormir la méfiance des grévistes. Finalement, c'est en envoyant des jaunes et des flics que la grève a été brisée.
Cette grève est significative par la combativité et la résolution qu'elle a montrées, et du niveau de mécontentement social qui existe en Algérie. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, en Algérie comme au Maroc, la bourgeoisie use et abuse de l'arme mystificatrice des élections et de la démocratie. En Algérie, en l'espace d'un an, quatre fois la bourgeoisie algérienne a amené les travailleurs devant les urnes; au Maroc. C’est dans l'isoloir que la population a été appelée à célébrer l'Union Nationale qui regroupe les soi-disant ennemis d'hier (USFP, Istiqual, et monarchistes). Les bourgeoisies maghrébines prennent des leçons de leurs comparses plus expérimentés d'Europe, mais ne conservent que l'aspect mystificateur : ces élections ne peuvent être que des caricatures de "démocratie à l'occidentale", et leur pouvoir de dévoiement s'use vite.
Le réveil de la classe ouvrière dans ces pays, où le prolétariat subit depuis des décennies le martèlement idéologique du nationalisme le plus putride et la répression étatique la plus féroce, montre bien à quelles difficultés les bourgeoisies nord-africaines se heurtent et vont se heurter de plus en plus dans l'avenir pour faire accepter aux travailleurs des sacrifices croissants au nom de la défense de l'économie nationale.
Les bourgeoisies mauritanienne, algérienne et marocaine qui rêvent d'en découdre pour s'approprier une meilleure part du gâteau saharien, exprimant ainsi le caractère impérialiste de tout capital national, du plus grand au plus petit, voient leur élan belliciste freiné par le resurgissements du prolétariat dans ces pays. Les grèves des dockers à Nouakchott ou à Alger, des travailleurs du chemin de fer en Algérie comme au Maroc sont des coups de semonce dont doivent tenir compte les belligérants.
Les violentes manifestations lors des enterrements des soldats morts dans le conflit larvé contre le Maroc, les mini émeutes qui ont eu lieu dans toute l'Algérie, en prenant prétexte des rassemblements sportifs, les sifflements qui ont salué l'hymne national lors de la finale de la coupe de football et retransmis en direct par la télévision partout en Algérie sont, avec la vague de grèves qui a secoué le pays ces derniers mois, autant de manifestations du mécontentement qui montrent une situation sociale explosive.
Le prolétariat du Maghreb tire sa force et sa combativité non seulement de l'expérience des luttes menées ces dernières années en Afrique du Nord, mais aussi de son lien organique avec le prolétariat européen et sa vieille tradition de lutte, au travers de l'immigration. Obligés aujourd'hui de retourner dans "leur" pays, repoussés par la montée du chômage en Europe qui les touche en premier, ce sont des travailleurs dyrcis au feu des luttes ouvrières en France, en Belgique ou en Allemagne qui retrouvent en Algérie, au Maroc ou ailleurs les mêmes maux contre lesquels ils avaient à lutter en Europe. Aux mêmes maux, les mêmes remèdes : l'arme de la lutte de classe.
Paradoxalement, dans des pays qui ont cultivé le verbe nationaliste depuis la "décolonisation", le poids de cette mystification perd de son importance devant l'expérience des ouvriers marocains, algériens, mauritaniens qui ont lutté ensemble en Europe. Oui pourrait leur faire croire que les frères de classe d'hier, parce qu'ils ont traversé la Méditerranée, doivent s'entre-tuer demain au sacro-saint nom de la défense de l'intérêt national? Oui pourrait leur faire croire que, de retour au "pays", ils doivent cesser leurs luttes alors que ce qu'on leur propose c'est encore plus de chômage, encore plus d'austérité, et une guerre en perspective?
Les bourgeoisies algérienne et chérifienne qui brûlent de se colleter ne peuvent ignorer ce facteur, et le conflit larvé pour le contrôle du Sahara occidental aura d'autant plus de difficulté à exploser que le prolétariat se montrera combatif et résistera aux agressions contre son niveau de vie.
Dans les luttes que mène la classe ouvrière aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient se concrétise, face à la marche de la bourgeoisie vers la guerre, de plus en plus l'alternative prolétarienne face à la crise du capitalisme mondial. Avec l'approfondissement de la crise, les rivalités inter-impérialistes prennent de plus en plus d'acuité. Cependant dans son cheminement de la périphérie du capitalisme vers les centres industriels, la tendance de la bourgeoisie vers une troisième guerre mondiale se trouve de plus en plus freinée (même si ce n'est pas là le seul facteur, c'est celui qui sera historiquement décisif) par la combativité du prolétariat que le chant des sirènes nationalistes arrive de moins en moins à endormir.
Dans sa fuite en avant vers sa "solution" à la crise : la guerre impérialiste, la bourgeoisie retrouve son ennemi héréditaire qui se réveille d'un long étourdissement. Dès aujourd'hui, dans sa lutte contre l'austérité toujours plus grande que lui impose le capitalisme sénile dans sa marche en avant vers l'économie de guerre, le prolétariat apparaît comme le seul obstacle réel face à la généralisation de l'état de guerre quasi-permanent que nous montre le tiers-monde. Dans sa résistance à l'exploitation aujourd'hui, le prolétariat forge déjà les armes dont il aura besoin lors de l'affrontement de classe décisif dont dépendra le sort de l'humanité.
J. J.
Géographique:
- Maghreb [97]
Heritage de la Gauche Communiste:
A PROPOS DES «GROUPES OUVRIERS» (III)
- 24 lectures
Les deux premières parties de cet article étaient constituées par un texte du "groupe ouvrier autonome de Clermont-Ferrand" intitulé "plateforme minimum pour l’autonomie ouvrière" et d'une critique de ce document. Celle-ci s'appliquait, d'une part, à démontrer que, contrairement aux formulations de ce texte, les syndicats et les partis de la gauche du capital (PC, PS, gauchistes) ne peuvent pas être considérés comte "réformistes", et, d'autre part, à relever un certain nombre de confusions sur la fonction des cercles ouvriers qui peuvent apparaître à l'heure actuelle. En particulier, après avoir rappelé que la classe ouvrière se donne deux types d'organisations : son organisation générale (conseils ouvriers) et son organisation politique (parti, minorités révolutionnaires) et qu'il ne peut, à l'heure actuelle, en exister d'autres, notre article faisait apparaître que le GOAC tendait à se définir, malgré ses propres dénégations, comme un troisième type d'organe ayant des caractéristiques à la fois de l'organisation générale de la classe et de ses organisations politiques. Après avoir défini ce que ne peuvent pas être les cercles ouvriers, nous allons essayer maintenant d'établir ce qu’ils sont effectivement.
Signification de l’apparition des cercles ouvriers
De tous temps, depuis que le prolétariat a, avec le capitalisme, commencé à se développer, il a existé parmi les ouvriers la tendance à constituer des cercles de discussion correspondant au besoin de confronter leurs expériences, à en tirer des leçons, à mieux connaître les moyens et les buts de leurs luttes de classe, d'approfondir leur prise de conscience comme classe historique. Pendant toute une période, les organismes de défense économique que la classe s'était donnée, les syndicats, ont joué ce rôle de lieu de développement de sa conscience révolutionnaire. C'est pour cette raison que Marx considérait que ces organes devaient constituer des écoles de communisme". C'est autour des "bourses du travail", des "maisons du peuple", mais également autour des grands partis ouvriers de masse que se rassemblaient les ouvriers qui tentaient de se dégager de l'emprise idéologique du capitalisme, qui étaient animés d'une préoccupation militante et révolutionnaire.
Mais, avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, le prolétariat a perdu ses anciennes organisations syndicales et politiques qui sont devenues des rouages de l'Etat capitaliste. De plus, la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur la classe après la grande vague révolutionnaire du premier après-guerre, a eu raison, d'abord des partis communistes créés pendant cette vague et qui sont devenus de fidèles chiens de garde du capital, ensuite des différents courants et fractions communistes qui s'étaient dégagés de ces partis lors de leur dégénérescence. Certains de ces courants ont finalement rejoint l'ennemi de classe (le trotskysme par exemple), d'autres ont carrément disparu ou ont été réduits à l'état de petites sectes plus ou moins sclérosées. C'est dans une telle situation d'inexistence quasi-totale d'organisations politiques prolétariennes que la classe ouvrière a commencé de rompre, à la fin des années 60, avec le carcan de la contre-révolution. Et c'est le besoin d'une réflexion et d'une prise de conscience suscité par la reprise des luttes qui est à l'origine de l'apparition depuis quelques années et dans beaucoup de pays de toute une série de cercles ouvriers aux dénominateurs et formes multiples, mais qui, pour tous, expriment plus ou moins confusément l'impossibilité de développer une activité et une pensée de classe au sein des organes capitalistes que sont les "organisations ouvrières" officielles (PS, PC, gauchistes, syndicats).
Caractéristiques et dynamique des cercles ouvriers
Quelles que soient les conditions particulières d'apparition des cercles ouvriers, leur dénomination ou leur degré de clarté, leur raison même d'exister leur confère un certain nombre de caractéristiques générales communes.
En premier lieu, ce type d'organes se distingue des organisations politiques de la classe en ce sens qu'ils ne constituent pas de véritables organisations dotées d'un programme politique et de statuts. Première étape dans un processus de prise de conscience des travailleurs qui s'y rencontrent, ils ne sauraient d'emblée se donner une vision élaborée et cohérente basée sur l'ensemble de l'expérience historique de la classe, qui sont les caractéristiques du programme prolétarien. De ce fait, ces organes ne peuvent établir des règles d'appartenance formelles et ne sauraient exiger une discipline de la part de leurs participants. C'est pour ces mêmes raisons que nous préférons les appeler "cercles" au lieu de "groupes" : plutôt que des organisations, ce sont fondamentalement des "lieux" de rencontre et de discussion pour les éléments de la classe en recherche d'une clarification.
Une deuxième caractéristique de ces cercles tient dans leur nature temporaire et éphémère. Etape dans un processus de prise de conscience, manifestation du caractère encore embryonnaire de celui-ci, le mode d'existence des cercles est fondamentalement l'évolution et le dépassement de leurs conditions d'apparition. L'aboutissement logique du processus de prise de conscience dans lequel sont engagés leurs participants est l'adhésion aux positions communistes et donc l'intégration dans une organisation politique. En effet, ceux-ci ne sauraient se maintenir de façon permanente sur des positions minimales telles que, par exemple, "1'anti-syndicalisme et la dénonciation de la "démocratie" politique ou syndicale ; le refus de l'isolement sectoriel ; la recherche de la solidarité avec d'autres secteurs sur ces bases" comme le voudrait le PIC (Jeune Taupe, n°12). Le fait pour des travailleurs d'en rester à des positions élémentaires signifierait que leur prise de conscience s'est arrêtée avant d'atteindre une vision réellement communiste. Et la constitution d'une organisation sur une telle base programmatique aurait plus un effet de blocage que d'activation de la réflexion et de l'approfondissement politique de leurs membres. D'une façon générale, l'adoption par un cercle ouvrier d'une "plateforme», c'est à dire d'une base d'adhésion et par suite de règles organisationnelles, ne constitue pas une étape positive de son développement, mais le conduit à se transformer en secte ou en point de fixation de la confusion[1] (1). C'est en ce sens que nous critiquons le terme de "plateforme" par lequel le GOAC a intitulé son texte.
L'adoption par un cercle ouvrier d'une "plateforme" est d'autant moins souhaitable qu'un tel document serait non seulement nécessairement incomplet et insuffisant pour permettre une réelle activité communiste mais risquerait de plus d'institutionnaliser certaines des faiblesses et des confusions politiques qui pèsent en général sur les cercles ouvriers de par leurs origines mêmes. En effet, dans la mesure où les cercles apparaissent en rupture avec les syndicats et les partis de gauche du capital, ils sont une tendance marquée à rejeter tout ce qui, à leurs yeux, s'apparente de près ou de loin à la "bureaucratie" et à la "manipulation". Aussi, ils sont conduits bien souvent à rejeter tout ce qui est "extérieur" à leur petit cercle et qui risquerait de venir menacer leur "pureté". L'"autonomie" dont ils se réclament, si elle signifie indépendance à l'égard de toute main-mise du capital, acquiert en général un sens localiste (pas de "centralisme", centralisme égalant léninisme) et ouvriériste (pas d'"intellectuels" parmi nous). Traumatisés par la politique des partis bourgeois, les cercles ont souvent tendance à rejeter tout ce qui est "politique". Ils portent ainsi une forte attention à tout ce qui concerne la forme de la lutte (assemblées générales, révocabilité, etc.) au détriment de ce qui concerne leur contenu[2], manifestant de ce fait une forte attirance vers les erreurs conseillistes.
Ainsi, malgré son caractère de grande élaboration, le texte du GOAC constitue une illustration de ce genre d'erreurs: "il est fondamental que le groupe autonome ouvrier répande l'idée de ces formes nouvelles de lutte..." nous regroupons des ouvriers de différentes tendances politiques ou d'aucune tendance... pourvu qu'ils soient d'accord sur la nécessité de développer les formes d'organisation et de lutte autonome des ouvriers".
L’attitude des révolutionnaires à l’égard des cercles ouvriers
Entravés par ces faiblesses constitutives, il est fréquent que les cercles échouent dans leur fonction. La plupart du temps, ils disparaissent comme tels pour devenir la simple "courroie de transmission" de groupes gauchistes ou bien leurs participants se dispersent purement et simplement dans la lassitude et la démoralisation. C'est pour cela qu'il revient aux révolutionnaires une tâche importante à leur égard : celle de les aider à comprendre ce qu'ils sont réellement, le caractère positif de leur existence comme "lieu" de clarification politique mais aussi leurs limites. Contrairement à la vision de "Battaglia comunista", qui veut constituer des "groupes communistes internationalistes d'usine" comme "courroie de transmission", "tête de pont du parti dans l'histoire", ou celle du PIC qui, tout en rejetant une telle vision, préconise, dans sa "stratégie d'intervention" (sic) de "contribuer à la formation de noyaux ouvriers révolutionnaires... germes de constitution de l'organisation autonome de la classe" (Plateforme du PIC), le rôle des révolutionnaires est d'insister sur le caractère embryonnaire et temporellement limité de tels organes ; de combattre en leur sein toute tendance à un repliement ouvriériste et localiste ; de les pousser à s'ouvrir à des participants appartenant à des organisations politiques et éventuellement autres que strictement "ouvriers de pousser la discussion et la clarification au maximum ; de combattre toute tendance à une fixation organisationnelle (plateforme, statuts), ce qui ne veut pas dire que l'élaboration et la diffusion de textes de discussion soit à repousser, au contraire. Une des tâches les plus importantes et certainement les plus difficiles des révolutionnaires sera de combattre -et non de flatter- les préventions contre toute organisation politique (qui peuvent être en contradiction avec la propre évolution organisationnelle du cercle) qui souvent constituent le ciment de tels cercles.
Alors seulement, 1'intervention des révolutionnaires à leur égard sera positive et permettra que l'effort de prise de conscience qui avait présidé â leur naissance ne soit pas stérile et aboutisse réellement à un renforcement de la classe ouvrière dans son ensemble, en vue des luttes de demain.
C.G.
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [23]
Rubrique:
NUCLEAIRE ET ECONOMIE DE GUERRE
- 45 lectures
Après des années de reconstruction, 32 ans après la bombe d'Hiroshima, l'humanité découvre qu’elle a désormais les moyens de sa propre destruction ; les manifestations de Creys-Malville, de Flamanville, et bien d’autres dans d'autres pays -en Allemagne par exemple- témoignent de l'affolement devant de telles possibilités et s’en prennent à ce qui leur semble être l'arme suprême : le nucléaire. Ne s'attaquant qu'à une seule forme d'armement, les "anti-nucléaire" rejoignent en cela Carter, qui, dès le mois de mai, annonçait son intention de ne pas construire d’usine de retraitement, de ne pas produire de plutonium, de ne pas construire de surrégénérateur.
On ne peut pourtant pas prétendre que des Etats puissent, dans le contexte actuel, se tenir en dehors des préparatifs de guerre, et plus particulièrement celui qui est à la tête du bloc impérialiste le plus puissant du monde. En fait, si les Etats-Unis refusent le développement du nucléaire, ce n’est pas par un besoin soudain de réconcilier le genre humain, par-delà les nations et les classes, mais pour des raisons économiques et que le développement du nucléaire ne l'empêche pas de fabriquer des bombes à neutrons...
C'est dire que condamner une forme d'armement comme, par exemple, le nucléaire, ne condamne en rien le développement de l'armement classique ou toute une politique globale d'économie de guerre. Donc, pour les "anti-nucléaire", condamner le nucléaire ne revient-il pas à justifier toutes les autres formes de l’économie de guerre ?
nucléaire ou économie de guerre?
En fait, actuellement, l'économie de guerre ne se limite pas au "nucléaire" à la construction de "Superphénix" à Creys-Malville ou d'autres centrales, mais elle s'étend à toute la production industrielle, à toute la politique générale des grandes puissances. C'est aussi la tendance vers une économie de grands travaux, le renforcement de l'Etat sur des secteurs vitaux de l'économie tels que l'aéronautique, c'est aussi une politique générale d'autarcie sous le contrôle du bloc de tutelle...
Et, ces éléments-là, même s'ils ne sont pas aussi spectaculaires que le "nucléaire" ne participent pas moins du même processus de la marche générale vers la guerre.
Déjà, dans la préparation à la seconde guerre mondiale, la bourgeoisie des pays les plus touchés par la crise avait développé toute une politique de grands travaux et d'armements traditionnels qui ne pouvaient trouver son aboutissement que dans une guerre.
Ainsi, malgré son déficit commercial, l'Italie a construit, entre 1922 et 34, de nombreuses routes -en particulier des routes de montagne- et autoroutes, de nouvelles voies de chemin de fer, aménagé de nouveaux ports.
L'Allemagne, dès le 1er mai 1933, s'est engagée dans la "bataille du travail", a inauguré la construction d'un millier de km d'autoroutes par an pendant sept ans, construit une écluse à ascenseurs entre l'Elbe et l'Oder,...
Les USA ont construit eux aussi de nombreux barrages, et des routes qui, menant aux déserts n'ont pu avoir qu'un intérêt stratégique...
De même, actuellement, comme dans la plupart des pays, la France oriente toute son économie vers la production de guerre. Elle prétend doubler le réseau routier entre 77 et 83, construire de nouvelles voies ferrées, moderniser 1er transports aériens.
Dans tous ces domaines, l'Etat tente d'obtenir au moins la minorité de blocage ou 51% des actions pour pouvoir imposer sa politique : c'est le cas à la SNCF et bientôt à Dassault. Pour sa part, la gauche propose un contrôle de
70 à 85% de la sidérurgie par la simple conversion des dettes de la sidérurgie envers l'Etat en participation de l'Etat, ce que se propose déjà de réaliser Giscard d'Estaing.
L'économie de guerre n'est pas une "autre" forme d'économie capitaliste : elle n'est que la transformation des moyens de production en instruments de la politique de destruction destinés à compléter le rôle de l'armement traditionnel. Et le nucléaire apparaît alors pour ce qu'il est : un moyen de destruction parmi d'autres qui ne doit pas faire oublier la capacité de destruction de l'armement traditionnel et le rôle de la politique économique.
Carter : le contrôle de l’armement au sein du bloc américain
Les Etats-Unis n'ont pas pris leur décision à la légère : ils ne l'ont prise qu'après avoir connu le résultat des travaux d'un groupe d'études de la politique de l'énergie nucléaire : le retraitement n'a aucun intérêt pour les Etats-Unis, il ne pourrait réduire que de 1% le prix final de l'électricité ; d'autre part, ils ont suffisamment d'uranium pour tenir pendant 20 ans et préfèrent garder leurs réacteurs à eau moins coûteux et tout aussi rentables. Quant à l'armement classique, le premier marchand d'armes du monde en a suffisamment et, de plus, l'a expérimenté pendant des années au Vietnam. Forts de cet arsenal, les USA peuvent faire figure de "colombes" disposant d'armes comme instruments de dissuasion et prétendre contrôler des pays de son bloc comme la France et l'Allemagne au nom du respect des accords sur la non- prolifération des armes nucléaires.
En se privant d'usines de retraitement et de surrégénérateurs, les Etats-Unis ont laissé libre un marché pour certains pays européens : ainsi, l'Allemagne a signé un contrat avec le Brésil et la France avec le Pakistan. Si, pour la suite, ces deux pays ont accepté, après l'intervention des USA, de ne plus vendre d'usines de retraitement, ils n’en ont pas moins signé un accord pour la construction de surrégénérateurs.
D'autre part, les USA tentent de "moraliser" la vente des armes : ils n'en vendront désormais qu'aux pays de l'OTAN, au Japon, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande... Pour tous les autres cas, les industriels américains devront obtenir l'appui du gouvernement.
Ainsi, le "pacifisme" de Carter n'est qu'une tentative des Etats-Unis de contrôler la politique des pays du bloc : il va de l'intérêt des Etats-Unis que chaque pays s'oriente vers une économie de guerre, vers une politique autarcique qui ne ferait pas concurrence au bloc, et que chaque pays contrôle à son tour la région dont ils lui ont donné la charge : ainsi, la France contrôle une bonne partie du territoire africain avec l'accord des Etats-Unis.
Carter condamne les constructions d'usines de retraitement et de surrégénérateurs : il n'en construit pas moins des bombes à neutrons, "bombes propres" qui auraient pour rôle la destruction des êtres humains mais non du matériel... Alors, les adeptes du "nucléaire" condamnent à leur tour la bombe à neutrons, ils "en dénoncent le caractère monstrueux" qui "vise délibérément à l'extermination de millions d'êtres humains" (déclaration de 28 PC contre la bombe à neutrons).
Les "anti-nucléaire" en luttant contre l'utilisation d'une arme, même aussi puissante que peut l'être une bombe atomique, justifient en fait l'emploi de toutes les autres armes. Ils ne luttent que contre un aspect secondaire de la préparation de la guerre, de la même façon que les "pacifistes" des deux guerres prétendaient lutter contre la guerre en demandant "la paix".
Mais, pas plus que les exhortations à la paix n'ont fait cesser la guerre en 14-18 comme en 39-45, les réclamations contre le nucléaire ne pourront empêcher une guerre à venir. Dans le passé l'affolement devant l'existence de gaz asphyxiants n'a pas empêché leur emploi au moment de la guerre ; les déclarations de "bonne volonté" de certaines bourgeoisies nationales n'empêcheront pas plus 1'emploi de la bombe à neutrons ou de la bombe atomique.
Seul le prolétariat a les moyens d'empêcher la destruction massive d'une prochaine guerre. Et ce n'est pas en marchandant sur le droit d'utiliser telle ou telle arme : il importe peu aux prolétaires de mourir en masse sous les effets radioactifs d'une bombe atomique, de mourir en petits paquets asphyxié par une bombe à neutrons ou de périr un par un sous les coups d'une baïonnette. Le prolétariat n'a rien à dire sur les armes choisies par la bourgeoisie, il saisit les armes pour détruire la bourgeoisie avant même qu'elle puisse déclencher la guerre : la lutte de classe pour la destruction du capitalisme est la fin de toutes les guerres.
N. M.
Rubrique:
Révolution Internationale - 1978
- 3407 lectures
Révolution Internationale N° 45 - Janvier
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.37 Mo |
- 2879 lectures
Front unique, front anti-prolétarien
- 3490 lectures
« Encore aujourd’hui, le problème du front unique est présenté comme le remède à tous les maux dont souffre la classe ouvrière, incapable de s’opposer à l’offensive du capitalisme. Ceux-là même qui depuis l’après-guerre, n’ont fait que traîner les travailleurs dans la boue des pires compromissions, clairement, pour maintenir coûte que coûte leur influence dans les masses : front unique! Tous ceux qui, à défaut d’une perspective des événements,résultant d’une analyse sérieuse de la situation, veulent agir à tout prix, se tirent d’affaire en criant, eux aussi : front unique! » (Bilan, 1934). C’est ainsi que la gauche communiste italienne en exil jugeait, 12 ans après son adoption par l’Internationale Communiste, la tactique de « front unique ».
Plus de 50 ans après, l’extrême gauche, appendice politique du capital, perpétue une pratique qui a prouvée dans l’expérience, être une des meilleure armes de la défaite du prolétariat : « Selon notre conception du front unique, nous visons à tracer aux travailleurs le chemin du pouvoir politique au mouvement des luttes. Nous l’exprimons par une propagande qui interpelle les partis ouvriers majoritaires, PC et PS, pour les enjoindre, à 1’encontre de leur politique, de prendre le pouvoir en s’engageant à satisfaire les revendications des travailleurs, à rompre avec la bourgeoisie, et à prendre les mesures anti-capitalistes que nécessite la situation... » (thèses du 2ème Congrès de la LCR).
C’est
en s’appuyant sur l’argumentation de l’IC que ces aspirants à
la participation à la gestion du capital jouent leur rôle
de dévoiement. C’est pourquoi il est important d’en
revenir au pourquoi et au comment de cette politique, pour comprendre
comment elle a pu être et est utilisée par les forces de
mystifications bourgeoises, pour que la classe ouvrière en
tire toutes les leçons et ne se laisse pas mener sur le chemin
de la défaite.
La « deuxième période » de l’IC.
C’est essentiellement dans les 3ème et 4ème Congrès de l’I.C. Que les défenseurs actuels du front unique puisent leurs justifications.
Ils peuvent aller jusqu’à se réclamer aussi des « fronts uniques » des bolcheviks avec les mencheviks dans la période qui a précédé la première guerre mondiale. Or, l’ensemble du mouvement ouvrier a toujours caractérisé le front unique comme un front avec des fractions bourgeoises : quand l’I.C. Parlait de « front unique » avec la social-démocratie, c’était d’un front avec des partis bourgeois, irrémédiablement passés dans l’autre camp avec leur participation à la guerre impérialiste. Nous ne pouvons donc comparer les « fronts uniques » avec la politique des bolcheviks avant 14, politique d’alliance avec des mencheviks qui formaient une partie d’une social-démocratie qui n’avait pas encore fait la preuve de sa trahison irréversible et se situait encore à l’intérieur du mouvement ouvrier. Il est vrai que pour les trotskystes, la participation à la guerre impérialiste (dans laquelle ils ont trempé eux-même) n’est plus un critère définissant la nature d’une organisation, les PC étant aujourd’hui qualifiés d’un « opportunisme » mal défini...
Mais voyons plutôt comment ils utilisent le mouvement ouvrier à leurs fins crapuleuses. Il faut d’abord remarquer que les organisations gauchistes n’hésitent pas à se réclamer en bloc de la politique des deux premiers congrès, comme de celle des 3ème et 4ème, sans qu’il leur soit besoin d’expliquer la contradiction fondamentale qui existe entre les deux, autrement que par le fait que les premiers définissaient les principes, et les seconds la tactique. Le résultat en est une confusion plus grande, entravant la réappropriation réelle du passé.
Il nous faut donc revenir au premier Congrès. Se basant sur le changement historique qui mettait définitivement l’humanité devant le dilemme de guerre ou révolution, l’I.C. Mettait en avant comme tâche primordiale la dénonciation de tous les partis « réformistes » qui avaient montré leur nature dans leur participation à la première boucherie impérialiste, et s’avéraient les principaux obstacles à la prise de conscience révolutionnaire du prolétariat : »Ouvrir les yeux à tous les travailleurs sur l’oeuvre de trahison des social-chauvins et mettre PAR LA FORCE DES ARMES CE PARTI CONTRE-REVOLUTIONNAIRE HORS D’ETAT DE NUIRE, voilà une des tâches les plus importantes de la révolution prolétarienne mondiale » (Résolution sur la position envers les courants socialistes, 1er Congrès, 1919)
C’est la même Internationale qui, deux ans après, en 21,mettait en place la tactique du front unique et qui déclarait en 22 : « un gouvernement ouvrier résultant d’une combinaison parlementaire peut aussi fournir l’occasion de réanimer le mouvement révolutionnaire (...) Dans certaines circonstances, les communistes doivent se déclarer disposés à former un gouvernement avec des partis et des organisations ouvrières non communistes ». (Résolution sur la tactique de TIC, 4ème Congrès).
Que s’est-il passé entre les deux positions, dont la seconde a accéléré la précipitation des partis communistes dans le camp bourgeois, amenant 12 ans plus tard de la tactique de front unique aux fronts populaires de partis nationaux préparant la guerre impérialiste, dans lesquels se retrouvaient les mêmes PC, et en fait de « réveil révolutionnaire » à la pire contre-révolution de l’histoire, à l’écrasement non seulement physique mais idéologique de la classe? Entre les deux, s’était produit un reflux de la lutte révolutionnaire. Les défaites subies par la classe ouvrière modifiaient la situation, marquant un coup d’arrêt qui devait par la suite se révéler mortel à la révolution mondiale. Les implications se faisaient déjà sentir au niveau de l’IC : sa politique commençait à prendre le cours de la défense de l’Etat Russe et ses « tactiques » subordonnaient à cet impératif, début d’un processus qui devait mener à la défense nationale de l’URSS, reléguant aux oubliettes les impératifs de la révolution mondiale.
C’est au nom du « reflux », des « conditions devenues défavorables » que les partis révolutionnaires ont été amenés à quitter le programme révolutionnaire pour en revenir à un « programme minimum » terrain d’alliance avec les partis bourgeois, jusqu’à s’investir peu à peu dans le camp bourgeois.
C’est encore au nom de conditions défavorables, où la classe est soumise à la pression de partis bourgeois, que les gauchistes voudraient nous faire croire à 1’inévitabilité de passer des alliances avec l’ennemi. Nous allons voir les principaux arguments de l’Internationale, et comment ils pouvaient contenir en germe les confusions qui devaient permettre à la bourgeoisie de les utiliser.
" ne pas se couper des masses "
L’argumentation de l’I.C. Pour justifier la nécessité de front unique se basait principalement sur le fait que le reflux avait renforcé le poids de la social-démocratie, et que, pour lutter contre elle, il ne fallait pas se couper des travailleurs prisonniers de cette mystification. Pour cela, il fallait travailler à sa dénonciation par des moyens qui allaient de l’alliance pour les partis les plus forts : En Allemagne, le PC s’est prononcé pour l’unité du front prolétarien et a reconnu possible d’appuyer un gouvernement ouvrier unitaire, à l’entrisme pour les partis les plus faibles : « il est maintenant du devoir des communistes d’exiger, par une campagne énergique, leur admission dans le Labour Party » (citations des thèses sur l’unité du front prolétarien du 4ème Congrès, 1922).
L’histoire a donné la réponse à la valeur d’une telle tactique. Les appels à « l’unité à la base » n’ont servi que de paravent à des alliances avec des appareils contre révolutionnaires. En Allemagne, elle a conduit au soutien du gouvernement massacreur d’Ebert, portant un coup mortel au prolétariat allemand et accentuant sa déroute (en 23 », l’alliance s’est même étendue jusqu’aux partis de droite, au parti nazi). Alors que la première nécessité pour le prolétariat était la rupture claire d’avec les partis traîtres, elle a servi partout à ramener les masses dans leur giron, en leur servant de caution. Plus tard, c’est au nom des mêmes arguments que les PC, de compromissions en compromissions devenus à leur tour des agents du capital en milieu ouvrier, vont établir des « fronts populaires » qu’appuieront à leur tour les trotskystes pour : « ne pas se couper des masses », appuyant puisque les masses y étaient, la participation à la guerre impérialiste au nom de 1’antifascisme.
Le coup d’arrêt à la révolution ne pouvait pas ne pas avoir des implications sur l’action de l’organisation révolutionnaire. Mais il ne modifiait en rien, ni la situation du capitalisme, dont le déclin n’allait que s’accentuer, laissant toujours la seule alternative de guerre ou révolution, ni la nature des partis passés dans le camp bourgeois, qui allaient perpétuer leur rôle de dévoiement et d’écrasement de la classe, ni la démocratie bourgeoise qui restait un instrument d’oppression contre la classe ouvrière. Cela ne modifiait en rien les tâches de la classe, dont la seule perspective dans ce système pourrissant ne pouvait être que l’affrontement, et le but premier de s’y préparer. Cela signifiait simplement que la classe ouvrière, affaiblie, écrasée, n’avait plus le rapport de force en sa faveur. Et que l’idéologie dominante reprenait de son poids. Seul un changement, dans ces conditions, aurait pu rétablir l’influence dominante des positions révolutionnaires dans la classe. Suivre les masses sur la pente qu’elles prenaient, c’était les suivre sur le chemin de la défaite, sous la domination bourgeoise, et quitter le terrain révolutionnaire pour se transformer en facteur contre révolutionnaire actif.L’analyse de la situation devait amener les révolutionnaires à s’isoler pour résister au poids immense que reprenait l’idéologie dominante. C’est ce qu’ont fait les différentes fractions de gauche, qui se sont opposées au cours que prenait la politique de 1’IC : gauches allemande, hollandaise, italienne: « si vous prenez le chemin du vieux mouvement ouvrier, alors c’est le chemin qui vous entraînera, et toutes les thèses du monde n’y changeront rien »(intervention du KAPD au 3ème Congrès). En voulant redresser le cours de la situation par une politique volontariste, où le parti devait réveiller les masses au prix de n’importe quelle alliance, l’IC n’a fait qu’ouvrir la porte à l’influence de l’ennemi : le seul résultat fut une accélération de la dégénérescence des partis qui ont suivi cette politique, et une théorisation qui devait laisser s’installer une des plus terribles confusions de l’histoire, entravant le ressurgissement de la prise de conscience par une difficulté à délimiter les ennemis.
Aujourd’hui, le cours n’est plus le même. Depuis la fin des années 60, c’est à un dégagement, même lent, de la classe de l’emprise bourgeoise que l’on assiste. La dangereuse tactique prise par l’IC s’est transformée en outil de la bourgeoisie pour contenir la classe dans ses faiblesses, au nom de l’ »unité à la base », en perpétuant les illusions sur les partis « ouvriers » PC et PS, qui s’apprêtent à jouer une fois de plus le rôle de fossoyeurs qu’ils ont joué tant de fois.
Ennemi n° 1 et n° 2
De même, l’argument de l’I.C. En 22 selon lequel « une des tâches les plus importantes des partis communistes est d’organiser la résistance au fascisme international et d’appliquer énergiquement sur ce terrain aussi la tactique du front unique » est encore fièrement repris par l’extrême-gauche. La sempiternelle « montée du fascisme »,aussi bien que la nécessité de « chasser la droite » sont mises au premier plan des préoccupations prolétariennes, amenant toute une hiérarchie dans les degrés d’antagonismes de la classe ouvrière avec l’une ou l’autre des fractions bourgeoises et une justification de fronts tous azimuts avec l’une contre l’autre.
Ce furent les « fronts antifascistes » qui encore une fois, diluant la classe ouvrière dans la solidarité nationale, l’ont embrigadée dans la boucherie, au seul profit des exploiteurs de tous pays. Pour lutter contre un ennemi n°l fasciste, c’est cette « tactique » qui a jeté le prolétariat sous les griffes d’un ennemi tout aussi redoutable : ce sont ces partis »ouvriers, qui, au nom de la classe ouvrière, ont préparé ou exécuté sa répression en Allemagne, en Espagne 36, comme au Chili...
Ce n’est pas parce que les contradictions de la bourgeoisie donnent naissance à des fractions rivales que cela change d’un iota le caractère réactionnaire et anti-prolétarien qui les unit toutes dans le capitalisme décadent. L’époque des ennemis communs est terminée depuis la 1ère guerre mondiale. Il ne reste en présence que deux ennemis jurés : le prolétariat et la bourgeoisie. Les partis de « gauche » ont révélé dans le sang de la classe qu’ils ne sont pas des partis qui favorisent la lutte du prolétariat, mais des partis du capital dont la fonction essentielle est de réprimer et de mystifier l’antagonisme de classe.
La mise au pied du mur
Argument le plus courant des trotskystes, déjà contenu dans la tactique des 3ème et 4ème congrès d’ »aller aux masses » en appuyant dans un premier temps les partis sociaux-démocrates pour mieux les dénoncer par la suite devant leur refus de mener une politique ouvrière, c’est celui qui consiste à s’appuyer sur leurs références trompeuses au socialisme pour mieux les démasquer et faire éclater au grand jour la tromperie.
Là encore, force est de constater que l’histoire n’a pas confirmé cette position. Aucun mouvement révolutionnaire n’a éclaté par suite de cette tactique. Le seul mouvement victorieux qu’il nous ait été donné de voir après qu’un tel parti aux allures « ouvrières » soit passé au pouvoir, ce fut celui de la révolution russe. Et la « tactique » des bolcheviks, minoritaires à l’époque, ne fut pas celle du front unique, mais : « AUCUN SOUTIEN AU GOUVERNEMENT PROVISOIRE. DEMONTRER LE CARACTERE PROFONDEMENT MENSONGER DE TOUTES SES PROMESSES. LE DEMASQUER AU LIEU « D’EXIGER » (CHOSE INADMISSIBLE ET QUI NE FAIT QUE créer DES ILLUSIONS) QUE CE GOUVERNEMENT DE CAPITALISTES CESSE D’ETRE CAPITALISTE ». (Lénine, Thèses d’Avril). Par contre, nombreuses sont les expériences de ces gouvernements « ouvriers » qui ont précipité la classe ouvrière, incapable de comprendre à temps la véritable nature de ces partis, dans la défaite,l’appui des révolutionnaires ne faisant qu’accroître la confusion.
Pour ceux qui ont pour souci de ne pas voir se répéter les tragédies du passé, de participer dès aujourd’hui à l’essor de la conscience du prolétariat, seule arme qui lui permettra de tirer des leçons de ses expériences futures, l’enseignement que tirait la gauche italienne dès 22 reste valable : « En ce qui concerne le problème d’un gouvernement social-démocrate, il est nécessaire de montrer qu’il ne peut apporter de solutions aux problèmes du prolétariat, et de le montrer AVANT MEME que ce gouvernement ne se constitue pour éviter que le prolétariat ne soit complètement abattu par l’échec de cette expérience.
(...) Lorsque le parti communiste refuse de se ranger parmi les forces qui revendiquent un gouvernement social-démocrate, il ne fait que devenir le protagoniste de cette pression de la partie la plus révolutionnaire des masses ».
La position de la gauche italienne face à la politique de l’I.C. d’appui aux sociaux démocrates, reste pour nous la seule valable, confirmée par une longue expérience, et peut s’appliquer aujourd’hui à tous les partis qui ont ouvertement signifié leur appartenance au camp bourgeois, des PC aux PS en passant par l’extrême-gauche.
Un des paravents les plus grossiers à toute cette politique de défaite a été de faire croire que les partis révolutionnaires pouvaient conserver leur « pureté », l’intégrité de leur programme dans ces alliances contre nature : « Évidemment, nous restons fidèles à notre drapeau, toujours et dans toutes les conditions nous disons qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons. Mais nous ne pouvons imposer mécaniquement notre programme aux masses » (Trotsky, 1933). Et pour ne pas « imposer mécaniquement notre programme aux masses », tous les partis qui ont appliqué cette tactique de front unique, pour suivre la pente que les masses prenaient, de concessions en concessions, ont rogné peu à peu tout le programme révolutionnaire. Aujourd’hui, les organisations trotskystes ne gardent que quelques références trompe-l’oeil : tout leur appareil est entièrement dirigé vers la revendication de la prise en charge du système capitaliste, la revendication du capitalisme d’Etat sous couvert de socialisme.
Le programme révolutionnaire, ensemble des leçons du prolétariat, ne se découpe pas en tranches. Il fait partie intégrante de ce programme, de dénoncer sans compromis possible les partis qui ont trahi la classe et assument depuis plus de 50 ans le rôle de bourreau. Ne pas le faire, c’est renoncer à tout un pan des leçons acquises. Et quand un pan s’en va, une brèche s’ouvre, et sous la force de l’idéologie dominante, le reste part en lambeaux.
D.T.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauchisme [59]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [40]
- La question syndicale [100]
- Le "Front Uni" [36]
Le frontisme honteux du PCI
- 2883 lectures
Une variante de la gangrène frontiste qui sévit aujourd'hui vient de nous être donnée par le Parti Communiste International, organisation qui se réclame de la continuité de la gauche italienne, celle-là même qui dans une des périodes les plus dures du mouvement ouvrier, dénonçait avec clarté le danger de semer des illusions par les politiques de front unique.
Le 19 novembre dernier, en effet, le PCI a signé un tract commun avec différentes organisations d'extrême-gauche, trotskystes et maoïstes, tract d'appel à la manifestation contre les mesures Stoléru qui ont frappé les travailleurs immigrés.
Dans un premier temps, le PCI s'est défendu d'avoir commis là un front unique politique, arguant qu'il ne s'agissait là que d'un accord pour appuyer des revendications immédiates des travailleurs, et donner toute son importance à la mise en avant de l'unité de la classe ouvrière. L'argument n'est guère convainquant. Qu'est ce qu'un front unique politique, en effet si ce n'est associer son organisation politique à d'autres sur la base d'une action, d'une revendication, d'un accord minimum, en étant par ailleurs en désaccord total avec le programme de ces autres organisations politiques? Si ce n'est, comme l'a fait le PCI, noyer dans la confusion la nécessité de clarifier les objectifs des luttes prolétariennes, en faisant miroiter une possibilité d'accord sur des bases minimales? Le PCI a-t-il oublié les leçons tirées par la gauche italienne sur la nécessité de mettre en avant, sous les luttes immédiates, la seule perspective que peuvent préparer ces luttes, celle de l'affrontement? Ou pense-t-il qu'il est possible de le faire en collaboration avec des organisations qui ont fait la preuve de leurs aspirations à la gestion du système bourgeois?
Il est vrai que le PCI considère l'extrême-gauche comme "centriste". On peut se demander ce qui l'arrêterait s'il avait l'occasion de signer un tract avec cet autre "opportunisme" qu'est le PC stalinien!
Il faut dire que, dans un deuxième temps, le PCI, peu fier de son aventure, a juré, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Reprenant la plume pour dénoncer l'extrême-gauche et le "rôle de sabotage qu'ils sont destinés à jouer de plus en plus activement auprès des travailleurs" ("Le Prolétaire" N°255), le PCI affirme : "cet épisode confirme A CONTRARIO le caractère néfaste du frontisme et des cartels hétérogènes d'organisations politiques". Le PCI découvre. Une si grande naïveté n'est pas permise d'un groupe qui se réclame d'une, filiation qui, elle, a tiré cette leçon depuis plus de 50 ans. D'autant que ce n'est pas le premier front que le PCI fait avec des organisations d'extrême-gauche sur d'autres objectifs partiels. Combien de fois réitérera-t-il l'expérience pour mieux faire l'étonné?
Par delà ces tentatives de justification, il faut réaffirmer que si ce qu'on dit est important, ce qu'on fait l'est encore plus. En cédant à la facilité, à la tentation d'une plus grande audience par ce genre de compromis, le PCI s'est engagé sur une pente savonneuse. On ne s'allie pas impunément avec des forces de la bourgeoisie. Le PCI a beau faire de l'équilibre entre les principes et la tactique, ce sont les principes qui seront de plus en plus touchés,et ces principes sont le seul rempart qui protège les organisations révolutionnaires de la force d'aspiration du gouffre de la domination bourgeoise.
DT
Courants politiques:
- Bordiguisme [29]
Rapport sur la situation en France (II)
- 609 lectures
Nous donnons dans le présent journal la suite du rapport sur la situation en France. La première partie (RI 44) montrait comment l'accélération de la crise économique "a précipité non l'effritement mais le renforcement des blocs". Cette dernière partie brosse un tableau des contradictions de plus en plus insolubles des fractions de droite et de gauche de la bourgeoisie ; dans un tel contexte, où en est la lutte de classe en France?
C'est seulement plusieurs années après être entrée dans la crise économique que la France se trouve secouée par la crise politique:
- une scission au sein même de l'appareil d'Etat sur la question brûlante de l'ampleur et du rythme des mesures de capitalisme d'Etat à appliquer -laquelle se répercute au sein des directoires des grandes firmes françaises. Au pouvoir depuis une vingtaine d'années, les forces gaullistes et post-gaullistes ont subi une forte usure politique, une baisse du prestige obtenu à l'apogée de la reconstruction, perdu avec l'approfondissement de la crise. Représentant du grand capital et du capital financier, le pouvoir s'appuie sur une masse électorale composée des couches enfermées dans l'immobilisme social. De la sorte, il n'a pu prendre que quelques timides mesures de lutte contre les secteurs de la petite production;
- une perte d'importants appuis politiques qui déplorent là une gestion au- dessous des moyens à mettre en œuvre pour contrôler la situation. Le besoin d'imposer une austérité plus draconienne et d'intensifier l'offensive contre la classe ouvrière se font jour. Selon le président du CNPF, le patronat doit avoir les mains libres pour sa politique salariale et licencier. Selon l'ex-président Pinay, le plan Barre aurait dû être plus brutal de façon à convaincre que l'heure des sacrifices avait sonné. Sur le marché financier de la Bourse de Paris, la publication du plan Barre a provoqué la déroute du "mardi noir" 12 octobre. Ce n'est donc pas la peur de la gauche, mais bien la propre politique de la droite qui a provoqué la perte de confiance des capitalistes. Aussi, le gouvernement reposant sur une fragile majorité passe-t-il pour n'être qu'une équipe transitoire chargée d'"expédier les affaires courantes" de la bourgeoisie en limitant les dégâts;
- actualité de l'alternative de la gauche plus capable que les giscardiens d'encadrer la classe ouvrière et de faire passer l'austérité. D'ores et déjà, la venue de la gauche au pouvoir constitue Taxe essentiel autour duquel s'articule la vie politique française.
La spectaculaire division intervenue entre les partis signataires du "Programme Commun" ne doit pas faire oublier qu'il s'agit avant tout d'une lutte intestine à la bourgeoisie. Cette querelle symbolise les problèmes qu'un futur gouvernement de crise aura à affronter. Leurs divergences à propos de la renégociation du programme de nationalisations est une expression de la tendance inéluctable du capitalisme d'Etat et, d'autre part, de la difficulté à gouverner à des époques historiques de grands soubresauts. A ce titre, la France a vécu la première crise ministérielle d'un gouvernement de gauche.
Toutefois, il convient de faire remarquer les principales caractéristiques qui distinguent le PS du PC. Alors que le PS est presque entièrement lié, par l'origine sociale de ses dirigeants et de ses militants, par ses traditions politiques et idéologiques, à des fractions de la bourgeoisie traditionnelle, par contre, le PC n'a pratiquement aucun lien direct avec la grande bourgeoisie et ses aspirations politiques. Les liens qu'entretient le PC avec le capital et la bourgeoisie s'effectuent essentiellement à travers sa colossale bureaucratie syndicale et ses municipalités. La seconde différence porte sur la politique étrangère que devrait observer la France. Depuis la "Libération" le PS a toujours défendu la "petite Europe", ses organismes économiques et institutionnels, de même qu'il a choisi, en connaissance de cause, l'Alliance Atlantique. Quant à lui, par ses traditions, par la formation idéologique de ses militants, par ses aspirations, le PC reste plus proche et demeure partisan d'une alliance avec l'URSS. Lors du référendum sur l'Europe, organisé par Pompidou, le PC avait voté contre et le PS s'était abstenu. La troisième différence concerne la question du capitalisme d'Etat. Si, pour le PC, le système doit reposer fondamentalement sur le capitalisme d'Etat sous une forme très poussée, par contre, le PS n'envisage celui-ci que sous une forme plus souple, une prise de participation de l'Etat dans 1'économie, laissant une notable liberté à la petite propriété.
Tous les partis de gauche ont tiré bénéfice de leur Union : le PC en sortant de son ghetto, le PS en réalisant un bond formidable faisant de lui la première force électorale du pays, après le creux de 69 où il ne recueillait plus que 6 % des voix aux présidentielles. L'actuelle désunion, temporaire ou définitive, provient de luttes de tendances rivales à l'intérieur même des deux partis. Dans le PS, les "anciens" regroupés derrière Deferre ont manifesté les plus vives réticences à l'égard de la discipline d'union ainsi que le montrent plusieurs exemples, notamment la question du vote du budget de la ville de Marseille. Dans le PC, la tendance "dure" formée des orthodoxes Leroy et Piquet semble avoir triomphé de l'Eurocommunisme et de la politique d'union de la gauche à tout prix de Marchais. La grande pomme de discorde pourrait bien être la question des nationalisations. Pour les dirigeants socialistes, il y a trop de nationalisations dans le "Programme Commun" que Veulent faire triompher les staliniens. Il est certain que, par le biais des syndicats CGT prédominants, le PC ne ferait que renforcer sa mainmise sur l'appareil d'Etat au détriment des socialistes.
Dans une perspective de défaite de l'actuelle majorité présidentielle, comme formes possibles de gouvernement sont envisageables les hypothèses suivantes:
- un gouvernement d'"union de la Gauche" composé du PS et des radicaux;
- un gouvernement PS/radicaux/giscardiens avec un appui plus ou moins critique du PC;
- un gouvernement PS/radicaux/centristes/giscardiens, avec une opposition ouverte du PC se durcissant;
- une même combinaison gouvernementale sans trop grande opposition du PC.
Parti national, le PC a concentré ses efforts pour se laver de l'accusation infamante d'être une "cinquième colonne" du Kremlin. Depuis qu'il en a été chassé en 1947, le PC continue résolument sa marche vers le pouvoir. Il entend gérer la crise, mais plutôt qu'une mince portion du pouvoir demain, qui ne serait pour lui qu'une situation à la Berlinguer, subissant l'usure rapide de la participation au pouvoir sans pour autant disposer des moyens de mener à bien sa propre politique, le PC est en "réserve de république". Sauf explosion de la lutte de classe, il ne se formera pas, vraisemblablement, de gouvernement avec le PC car, pour l'instant, ne répondant pas aux besoins immédiats du capital. Conscient que ses chances d'occuper une éventuelle place dans un prochain gouvernement se sont amenuisées, le PC se prépare à s'opposer à une politique qu'il aura lui-même inspirée, tout comme au Portugal.
Par rapport au vaste mouvement de 68, les années suivantes laissent l'impression d'un recul, puis d'une stagnation dans la lutte de classe. Au lieu de répondre aux nouvelles attaques de la bourgeoisie par des grèves de plus en plus massives, unifiées et offensives, la lutte de classe a connu un repli notable sur l'usine. Elle porte un caractère défensif. Dans sa forme la plus générale, ce cycle est caractéristique pour l'Europe entière et la France n'y échappe pas dans les conditions d'une crise lente. Les états-majors syndicaux ont pu enfermer les travailleurs dans des luttes sectorielles, provinciales, tournantes afin d'atomiser le front de résistance du prolétariat. Ces actions, étant vouées à l'échec, les syndicats ont été en mesure de déclarer la lutte impossible sur ce terrain. La tactique syndicale a été de saboter systématiquement, scientifiquement les luttes ; de déclarer qu'elles devaient aboutir aux négociations devant le tapis vert patronal. Chaque lutte entreprise contre la menace du chômage a été transformée en "défense de l'outil de travail". Les syndicats ont réussi à faire patienter les travailleurs avec les échéances électorales de 78.
Après un demi-siècle de contre-révolution anéantissant les organisations de classe, ce qui reste prédominant, c'est la pénétration d’illusions parlementaires et syndicales chez les travailleurs. Dans son immense majorité, la classe ouvrière subit passivement l'influence des staliniens et des socio-démocrates. La longue politique d'opposition au gaullisme puis au giscardisme menée par la gauche a encouragé les travailleurs à penser que les diverses composantes de celle-ci sont autant de forces dont ils pourraient disposer pour la satisfaction des revendications les plus urgentes. Mais, d'autre part, le nombre décroissant de grèves montre le refus des travailleurs excédés de se voir sans cesse floués par les syndicats. Consciente que ce calme ne fait que cacher un gigantesque orage social, la bourgeoisie commence à prendre conscience du péril et se prépare à mettre en place les structures d'un syndicalisme "ouvrier" dont la fonction de garde- fous est évidente.
A eux seuls, staliniens, socialistes et droite ne constituent pas la totalité de l'armée ennemie. A leurs forces, s'ajoutent celle du gauchisme dont le rôle va grandissant ainsi que l'ont montré à la fois les élections municipales de ce début d'année et les grands rassemblements écologistes de l'été.
Dans une atmosphère de grand désarroi, le gauchisme a cherché et a trouvé de nouvelles bases de mobilisation pour renforcer son emprise sur toute une partie de la jeunesse, y compris les jeunes apprentis et chômeurs. Mais, insuffisamment forts pour envisager d'entrer dans un quelconque gouvernement -du moins pas pour le moment- les gauchistes doivent remplir le rôle de ramener les travailleurs qui s'en écartent sur le terrain de l'idéologie dominante. Ils servent encore comme "donneurs de conseils" sur la meilleure façon d'encadrer la classe. Leur intervention pour le respect des engagements électoraux pris par les signataires du "Programme Commun" est le soutien qu'apporte une fraction de la bourgeoisie à la mystification des travailleurs. Ainsi, les gauchistes, et avec eux le PSU, posent la question : Non pas combien de nationalisations mais "quelles nationalisations ?" pour conférer au capitalisme d'Etat un caractère plus démocratique.
A partir de la succession d'échecs subis par les luttes sur le terrain de résistance au capital, quelques petits noyaux ouvriers semblent vouloir se dégager de l'étreinte mortelle dans laquelle les étouffent syndicats et gauchistes. A l'évidence, ce phénomène indique l'existence d'une hostilité grandissante à l'égard des promesses contenues dans le "Programme Commun", une angoisse devant la montée régulière du chômage qui, au lieu de se transformer en sentiment de panique, se transforme dialectiquement en volonté de lutter. Derrière l'apparente soumission des travailleurs mûrit lentement une profonde maturation de la conscience de classe. Cependant, du fait de la totale disparition de toute forme de vie politique organisée de la classe durant des dizaines d'années, de l'énorme faiblesse des forces révolutionnaires, ces éléments se débattent dans la confusion et l'obscurité tant en ce qui touche aux principes qu'en ce qui concerne les moyens d'action de la classe.
Pour ces raisons, il serait excessivement dangereux de surestimer les possibilités d'une rapide reprise de la lutte de classe avant les élections de 78. L’actuelle montée historique de la classe est le produit d'une crise économique au lent processus. En ce sens, nous ne sommes pas à la veille d'une explosion ni d'une intense agitation sociale, mais dans une phase de préparatifs électoraux qui freine et dévoie la lutte. Toutefois, cet état d'esprit ne saurait être définitif ; il se modifiera sous l'effet de l'intensification de l'exploitation et des mesures d'économie de guerre développée par la bourgeoisie française.
Exaspéré par une existence de robot, soumis à la pression accrue des lois aveugles du capitalisme, en fin de compte, le prolétariat se trouvera être poussé de l'avant et prêt à engager la lutte politique contre l'Etat. Aux lendemains des élections, l'opium électoral s'évanouissant, une brèche s'ouvrira à travers laquelle s'exprimera avec une force décuplée le mécontentement prolétarien.
Révolution Internationale N° 48 - Avril
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1003.62 Ko |
- 2665 lectures
BREST-LITOVSK : Gagner du temps pour la révolution mondiale
- 766 lectures
Trois mois s'étaient à peine écoulés depuis que le prolétariat russe avait détruit l'appareil d'Etat bourgeois que déjà son parti de classe connaissait une des crises les plus importantes de son histoire. Lénine lui-même, président du premier conseil des commissaires du peuple, fut dans un premier temps mis en minorité, avant de rallier Trotsky à sa position. La question si grave qui, alors, divisa le parti bolchevik, avant-garde du prolétariat mondial, fer de lance de la révolution internationale, n’était rien de moins que la question du rapport de la toute jeune république des soviets avec la guerre impérialiste qui ravageait alors l’Europe.
Jusqu'à la révolution d'Octobre, la Russie avait été partie prenante de 1‘"Entente" (fraction impérialiste qui regroupait aussi l'Angleterre et la France) dans la guerre de rapines qui l'opposait aux Empires Centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Après le mouvement de février qui détrôna le tsar, le nouveau gouvernement de la Russie, avec à sa tête Kerenski, s'appuie sur l'Entente en lui promettant l'exécution des traités. L'armée russe, composée de paysans dans son immense majorité, est de plus en plus sensible à la propagande bolchevique qui réclame la paix. En s’appuyant sur la forteresse ouvrière de Petrograd et sur l'armée démoralisée, vaincue, qui aspire à la fin de la guerre, le parti bolchevik en Russie met en pratique la "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile", selon la vieille formulation de Lénine à Zimmerwald, et contribue par-là à l'apparition du premier pouvoir des Conseils Ouvriers dans le monde, en octobre 1917. Dès le lendemain de l'insurrection, le 2ème Congrès des Soviets rompt catégoriquement avec la politique de guerre des alliés de la vieille Russie.
La question du front contre les Empires Centraux restait à régler. Les alliés, attendant l'aide américaine, faisaient tout pour prolonger les opérations de guerre sur le front russe.
Les Empires Centraux voulaient s'en libérer pour vaincre les alliés avant que n'interviennent les Etats-Unis. La Révolution Russe devait éviter de faire le jeu de l'un ou de l'autre impérialisme, tout en favorisant au mieux l'explosion de la Révolution Internationale.
Les 3 positions bolchéviques
La légende entretenue par les staliniens oppose radicalement Trotsky et Lénine sur la question du traité de Brest-Litovsk. Rien n'est plus faux, car sur les deux principales questions qui sont alors débattues (Io: possibilité d'une guerre révolutionnaire immédiate; 2°: possibilité d'un accord avec les impérialistes) il y a un accord "total et intégral" entre les deux révolutionnaires contre Boukharine, leader des "communistes de gauche", partisans de la guerre révolutionnaire immédiate pour élargir la révolution, et qui considéraient tout traité de paix comme une "flétrissure".
THEORIE DU REPLI
L'opposition entre Lénine et Trotsky se fait sur un point: comment signer la paix. D'accord avec Trotsky, Lénine est partisan d'engager les pourparlers de paix avec les Empires Centraux à Brest-Litovsk, en les faisant traîner en longueur et en les utilisant pour l'agitation. Compte-tenu du fait que l'armée existante est un corps malade de l'ancien Etat, que toute offensive allemande mettrait la République des Soviets dans un état cri tique, il rédige, dès le 21 janvier 18, "21 thèses sur la conclusion immédiate d'une paix séparée et annexionniste" (contribution à l'histoire d'une paix malheureuse) où il met en avant la désagrégation du front et de l'économie, la nécessité d'écraser les classes exploiteuses déjà privées du pouvoir, la nécessité impérieuse, en l'absence de révolution en Allemagne, de créer "la base économique solide d'une puissante Armée Rouge", "afin de préparer la guerre révolutionnaire". La conclusion qu'en tire Lénine, c'est qu'il faut signer la paix dès que l'ultimatum sera présenté, afin d'obtenir le "répit" nécessaire à cette tâche.
NI GUERRE, NI PAIX
Trotsky s'oppose à la signature immédiate de la paix. Il "estimait nécessaire de conduire les pourparlers à une rupture, même en courant le danger d'une nouvelle offensive de l'Allemagne, afin de pouvoir capituler -le cas échéant- devant un emploi évident de la force"
("Ma Vie"). Pour en finir avec les bruits qui couraient d'après lesquels les bolcheviks auraient été de connivence avec le gouvernement allemand, avant de signer une paix séparée, il était indispensable "de donner, coûte que coûte, aux ouvriers d'Europe, une preuve éclatante et incontestable de la haine mortelle qui existait entre nous et les gouvernements de l'Allemagne."
GUERRE REVOLUTIONNAIRE
Les "communistes de gauche" ne croyaient pas à la possibilité de la paix. Pour Boukharine par exemple, les perspectives de paix étaient "inexistantes" et "illusoires", "impossibles" pour Kollontaï.
La foi aveugle en la victoire, grâce aux convictions socialistes des partisans et par la suite à "la nature sociale de la nouvelle armée en voie de mobilisation", rut aussi dans un premier temps la caractéristique de la "gauche". "Si la révolution russe ne fléchit pas elle-même, personne ne la matera ni ne la brisera". "La grande république des soviets... ne peut pas périr" (Radek). "Quand les masses auront vu l'offensive allemande à l'œuvre, ... une vraie guerre sainte commencera " (Boukharine). La guerre révolutionnaire était à l'ordre du jour.
Les partisans de Boukharine virent dans la position de Trotsky un pas fait dans leur direction, et donc, dans un premier temps, fut adoptée la position de "ni guerre, ni paix": laisser traîner en longueur les pourparlers; en cas d'ultimatum, refuser de signer la paix.
La « paix » de Brest-Litovsk
Les pourparlers de paix furent interrompus le 10 février. Trotsky y fit un bref discours, exclusivement destiné à la propagande, qui dénonça la guerre “provoquée par l'esprit de lucre et de domination des classes dirigeantes... Mous ne voulons plus participer à cette guerre purement impérialiste... Nous considérons avec la même intransigeance les impérialismes des deux parties... Nous démobilisons notre armée. Nous refusons de signer une paix d'annexions. Nous déclarons l'état de guerre entre les Empires Centraux et la Russie, terminé."
Le 18 février, l'armée allemande passa à l'offensive sur tout le front.
Les nouvelles conditions de paix étaient catastrophiques: la Russie devait abandonner la Pologne, la Lithuanie l'Estonie, l'Ukraine et la Finlande. La République des Soviets fut forcée de signer, dans les termes qu'utilisa Sokolni- kov le 3 mars à Brest-Litovsk: "Nous sommes ici pour signer une paix qu'on nous impose par la violence. La paix que nous signons nous est dictée les armes à la main... Nous déclinons toute discussion comme inutile."
Le VIIème Congrès, destiné à trancher définitivement la question de la paix de Brest-Litovsk, fut le théâtre de l'affrontement entre Lénine et les "communistes de gauche" qui y devinrent minoritaires. Ceux-ci avaient publié peu auparavant une motion de défiance au Comité Central, accompagnée d'un texte explicatif qui affirmait: "... dans l'intérêt de la révolution internationale, nous estimons opportun de courir le risque de la perte éventuelle du pouvoir des soviets...". Nous sommes là bien loin de l'enthousiasme guerrier qui caractérisa les débuts de la gauche. La défaite possible est admise et même prévue, dans l'intérêt de la révolution mondiale. Les espoirs sur la "guerre sainte" ont disparu à la première offensive allemande. A ce point, la "gauche" défend sa position non plus sur une perspective (la guerre révolutionnaire) mais sur un "principe": si le pouvoir des soviets signe la paix avec un impérialisme, "il devient purement formel".
Dans un article intitulé "chose étrange et monstrueuse", Lénine, après avoir mis ce fait en évidence, remercie la gauche, d'une part d'avoir rompu le silence sur le fond de son argumentation, à savoir "les conditions de la guerre au cas où nous l'accepterions tout de suite", et d'autre part de reconnaître la justesse de l'argument concret: "oui, nous irions à la défaite si nous acceptions aujourd'hui le combat contre l'Allemagne". Il estime que si la révolution avait déjà commencé en Allemagne, "il serait non seulement "opportun", mais absolument obligatoire d'accepter la défaite et la perte éventuelle du pouvoir des soviets", en "détournant une partie des forces de la contre-révolution allemande". Mais la raison de la paix de Brest-Litovsk, c'est que "la révolution européenne a osé se mettre en retard", et "l'impérialisme allemand a osé prendre l'offensive!"
Dans ce contexte, "rien ne peut porter maintenant un coup plus rude à la cause du socialisme que la chute du pouvoir des soviets" affirme le comité central. Lénine ajoute: "nous détournerions du socialisme les grandes masses de prolétaires et semi-prolétaires d'Allemagne (...) que l'anéantissement de la Russie des soviets effraierait, comme celui de la Commune effraya les ouvriers anglais en 1871."
La majorité du Congrès se prononça pour l'orientation de Lénine, signer la paix pour "préparer la guerre révolutionnaire", pour le jour où éclatera la lutte finale; "cette lutte n'éclatera que lorsque la révolution socialiste embrasera les pays impérialistes avancés" (Lénine: "Une leçon dure mais nécessaire"). "S'il est incontestable que toutes les difficultés de notre révolution ne seront surmontées que lorsque viendra à maturité la révolution socialiste mondiale... il est absurde d'affirmer (en escamotant nos difficultés concrètes): je mise sur le mouvement socialiste international, je peux faire n'importe quelle bêtise", déclare Lénine le 7 mars dans son "Rapport sur la guerre et la paix".
"La phrase révolutionnaire est la répétition de mots d'ordre sans rapport avec les circonstances objectives d'un moment. Des mots d'ordre excellents, enivrants, mais dépourvus de base, en voilà l'essence" ("Sur la phrase"). "Il ne faut pas transformer en phrase ce grand mot d'ordre: nous misons sur la victoire du socialisme en Europe". En d'autres termes, il n'était pas question que la "phrase révolutionnaire" en finisse avec la révolution.
L’écho de la phrase
Après la fin de l'été 18, plus personne ne revint sur la question de Brest-Litovsk et ne mit en doute le bien-fondé de l'essentiel de la politique du parti bolchevik. Personne n'en fait plus une question de principe. Il aura fallu attendre soixante ans pour voir Guy Sabatier se faire l'écho de la "gauche". La phrase révolutionnaire, disait Lénine, est tenace comme la gale.
La préoccupation qui est à la base de la brochure de Guy Sabatier ("Traité de Brest-Litovsk 1918, coup d'arrêt à la révolution", éditions Spartacus) est de montrer qu'il y a une rupture de continuité entre les bolcheviks avant et après 17. Il marque cette rupture à la prise du pouvoir. Par là même, il entend démontrer qu'il y a continuité entre les bolcheviks d'Octobre et le stalinisme.
Il bloque l'histoire de toute la vague révolutionnaire qui devient ainsi simplement l'histoire de la contre-révolution, avec à sa tête, le parti bolchevik.
Si nous voyons une rupture, quant à nous, c'est bien entre le bolchevisme et le stalinisme. Mais c'est aussi d'un certain point de vue dans le changement politique fondamental effectué par les bolcheviks entre 1905 et 191/. tn 1905, toute leur analyse est fondée sur le fait que la révolution à venir en Russie sera une "révolution démocratique bourgeoise", que le prolétariat devra pousser jusqu'au bout.
En 1914, avec le déclenchement de la guerre, c'est ce parti qui comprend l'entrée du système dans sa phase de décadence, posant l'alternative de la révolution prolétarienne.
En 1917, c'est cette compréhension quant à la nature de la période et de la révolution russe qui se concrétise dans les thèses d'avril de Lénine, thèses qui dénoncent tout appui et toute alliance avec la bourgeoisie, qui voit dans la révolution russe le point de départ de la révolution mondiale. A partir de ce moment, toutes les questions qui sont débattues en Russie le sont par rapport à comment favoriser le développement de la révolution mondiale?
Par conséquent, Sabatier se trompe. Il déforme, sciemment ou non, ce qu'était le parti bolchevik au lendemain de la prise du pouvoir. Pour ce faire, il prend tous les faits épars qui lui conviennent et procède par amalgame, de façon à appuyer sa thèse: "le parti bolchevik était un parti nationaliste attaché à la défense du capital national".
Ce n'est pas par hasard si ses commentaires sur le KAPD et la création de l'Internationale sont tronqués; s'il fait dire à Rosa Luxembourg que Lénine sacrifie la révolution allemande pour la défense de l'Etat russe. Ce n'est pas par hasard si au passage il signale innocemment que certains -en fait Kerensky et les contre-révolutionnaires- "assuraient que les bolcheviks avaient touché de l'argent de l'Allemagne".
Lorsque Sabatier cite Luxembourg, c'est à la manière des socialistes de gauche.
Il ne cite pas vraiment. Ainsi on ne voit pas l'apport réel de Rosa, on voit une "anti-bolchevik de tous temps". En fait, Rosa commence d'abord par défendre les bolcheviks, à délimiter leur activité dans le camp de la révolution, activité à laquelle elle rend hommage. Elle met en avant le fait que c'est l'absence de réaction du prolétariat international, du prolétariat allemand en particulier, qui est responsable de Brest-Litovsk. Elle parle de la gravité du problème historique posé par Brest-Litovsk, elle ne parle jamais de "ne pas reculer" et ne cache pas l'état de décomposition de l'armée russe. Elle ne prend position contre cette paix que parce qu'il lui semble qu'elle est une erreur: selon elle, cette paix va renforcer le militarisme allemand et dérouter les prolétaires à l'étranger.
Rosa ne cède pas à la "phrase", elle ne fait pas un "principe" de la mort les armes à la main, comme le font les communistes de gauche dans le feu de l'action et Sabatier dans le feu de sa phrase.
Deux mois après avoir exprimé ses craintes, les surgissements révolutionnaires en Allemagne leur enlevaient toute valeur. Brest-Litovsk n'avait pas été un frein. Karl Liebknecht, qui avait partagé en son temps la position de Rosa, avouait: "Il faut avant tout une chose aux soviets de Russie, .... et il ne s'agit pas de manifestations ou de décors, mais d'une force rigide. A cette fin, ... il faut de l'intelligence et du temps, -de l'intelligence pour gagner de ce temps qui est indispensable à la plus grande énergie."
C'est ainsi que les critiques non phraseurs reconnurent la justesse de la politique de Lénine à Brest-Litovsk, qui avant tout visa à gagner du temps, pour mieux pouvoir aider la révolution internationale.
Moro.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [104]
Les "acquis" de 1936
- 6697 lectures
Mars. 78, c’était l’espérance, pour beaucoup, que si la gauche parvenait au pouvoir, enfin « tout allait changer » ! L’espérance était la même, en mai 36, quand les élections législatives donnèrent la majorité à la gauche.
Alors, voyons la suite. Le 4 juin, les partis unis de la gauche forment le gouvernement de Front Populaire. La bourgeoisie n’a pas trouvé d’autre moyen, en effet, pour essayer d’en finir avec le mouvement de grèves qui paralyse le pays. Le président Lebrun supplie Blum de lancer un appel aux ouvriers par radio : « Dites-leur que le parlement va se réunir, que, dès qu’il sera réuni, vous allez lui demander le vote rapide et sans délai des lois (sociales)... ils vous croirons... et alors, peut-être le mouvement s’arrêtera-t-il ? » Car le but est bien là. Le 7, les entretiens entre la Confédération Générale du patronat français et la CGT, en présence de Blum, représentant le gouvernement, aboutissent à la signature des accords Matignon qui sont censés donner des avantages au prolétariat.
Le lendemain, les journaux « de gauche » publient l’accord en criant à la victoire et au triomphe. Quelle est donc cette victoire ? Quels sont ces acquis pour le prolétariat ?... « La délégation patronale admet l’établissement immédiat de contrats collectifs de travail... » « Liberté... d’adhérer librement... à un syndicat professionnel ». « Les salaires réels pratiqués... réajustés... » Promesse de « ...négociations pour la fixation par contrat collectif de salaires minima, par région et par catégorie... » « ...dans chaque établissement employant plus de 10 ouvriers, après accord entre organisations syndicales ou, à défaut, entre les intéressés, il sera institué deux titulaires ou plusieurs délégués ouvriers... » en vue « ...de présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites. » et, en conclusion : « la délégation confédérale ouvrière demandera aux travailleurs en grève de décider la reprise du travail dès que la direction des établissements aura accepté l’accord intervenu et dès que les pourparlers relatifs à son application auront été engagés entre les directions et le personnel des établissements ».
Paris, le 7 juin 36. Les ouvriers, moins impressionnés par ces accords que les journaux « de gauche », tardent à reprendre le travail. C’est alors, le 11 juin, le célèbre discours de Thorez qui deviendra le refrain, dans la bouche des Jouhaux, Cachin, Duclos et consorts pour faire reprendre le travail : »...il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n’ont pas encore été acceptées mais que l’on a obtenu la victoire sur les plus essentielles revendications ». Et, pour hâter la reprise du travail, seront alors ajoutées les fameuses lois sociales du 21 juin 36 :
• les 40 heures : « ...la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l’un et de l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder 40 heures par semaine », et cela, sans réduction de salaire ;
• les congés payés d’une durée de deux semaines pour tous les travailleurs.
Devant ce qui apparaît comme des acquis, la lutte s’effrite puis finit par s’arrêter. Mais, à partir du moment où le prolétariat arrête sa lutte, cela signifie, en période de décadence, que la bourgeoisie entame la reconquête du terrain momentanément concédé.
Voyons plus loin, en effet. Qu’en est-il, de cette soi-disant victoire dont parle Thorez ?
Les conventions collectives .
Non seulement, grâce au syndicat, elles tentent d’enfermer la lutte du prolétariat dans un cadre légal, mais, en plus, sanctionnant le reflux de la lutte, une loi vient s’ajouter, dès décembre 36, aboutissant, au terme de son évolution à la loi du 4 mars 38, rendant « l’arbitrage » obligatoire en cas de conflit, ce qui vaut aux métallos par exemple, l’énorme avantage, désormais, d’être obligés à « un délai d’une semaine franche avant de recourir à la grève ». Le syndicat fera respecter l’esprit d’arbitrage. Avant même qu’il soit rendu obligatoire, le syndicaliste Jouhaux se déclarait « satisfait des résultats des arbitrages » même si « l’arbitrage ne peut apporter 100 % de satisfaction aux travailleurs »! Et si, en 36, notre PC national élevait la voix par rapport à cela... c’est parce que la classe ouvrière n’était pas encore tout à fait battue ; il fallait donc mettre des nuances pour pouvoir arriver en 38 à la déclaration de Croizat -député communiste- à la Chambre : « La classe ouvrière veut l’ordre. La grève n’est pour elle qu’une ultime nécessité qui lui est imposée par l’arbitraire patronal. La classe ouvrière applaudira si nous lui donnons les moyens de suppléer S la grève... » Un acquis ? Oh oui ! mais pour l’Etat qui a enfin compris que le syndicat lui est un précieux auxiliaire qui lui permet de développer sa présence policière jusque dans les usines ! N’est-ce pas le syndicat qui aura sans cesse prêché l’ordre, la sagesse et l’esprit de conciliation aux prolétaires en lutte lorsqu’il répétait par la bouche de la CGT sur tous les airs ce même refrain : que le mouvement doit rester « paisible, ordonné et propre (sic!!)... » et encore quand il invitait « les délégués de toutes les entreprises encore en grève à redoubler d’activité en vue de la conclusion d’accords... et de faire preuve de l’esprit de conciliation... ! » ‘ -
Quand la décadence du capital, dans sa phase de crise mortelle, impose à l’Etat de préparer sa seule issue : la guerre, l’Etat, plus que jamais, se voit contraint de contrôler toute la société pour orienter vers elle toutes ses énergies. C’est le syndicat, dans l’usine (nous le verrons plus loin), qui se chargera de cette besogne. Une victoire alors ? Oh oui ! pour l’Etat, puisqu’il se renforce face à son ennemi, le prolétariat.
Les Salaires.
Autre grande victoire ! Suite aux grèves de mai-juin, les métallos parisiens, par exemple, obtiennent une augmentation de 22 % environ. Pendant les six derniers mois de 36, les salaires restent inchangés, malgré une hausse du coût de la vie de l’ordre de 25 %. En mars 37, suite à deux réajustements, les salaires se trouvent augmentés de 12,84 %. Les salaires ne sont plus modifiés jusqu’à la fin d’octobre 37. Or, à ce moment-là, la hausse du coût de la vie depuis juin 36 atteint : 50 % ! Dans le meilleur des cas, les augmentations de salaire acquises sont réduites à néant : la vérité, c’est qu’il n’y a plus d’augmentation réelle possible ; elle est mangée immédiatement par la hausse des prix. Alors, pour qui la victoire ?
les 40 heures !
Les plus cyniques osent dire : « juridiquement » cela n’a jamais pu être aboli! Laissons le droit et regardons les faits.
-un décret général du 21 décembre 37 stipule la récupération des heures perdues dans les industries souffrant de morte saison. « Cela est valable dans le industries et commerces assujettis à la loi de 40 heures. »
-et encore... autorisation d’heures supplémentaires dans les secteurs essentiels de la vie économique : dès le 29 juillet 37, par arrêté, cela concerne les mines de fer, et, le 21 décembre 37 les mines de charbon. On institue même un Comité d’Enquête sur la productivité du travail, à l’initiative... de la CGT bien sûr! Mais rassurez-vous, c’est uniquement pour démontrer le caractère calomnieux des affirmations patronales sur les baisses de rendement. Le travail de ce comité trouve son heureux aboutissement dans « l’assouplissement » (!) des premiers décrets et instaure des dérogations supplémentaires... pour les industries intéressant la défense nationale. La CGT prépare la guerre.
-Le 21 décembre, une autre dérogation, toujours exceptionnelle, pour les industries souffrant d’une insuffisance de main d’oeuvre qualifiée. Les décrets de novembre et décembre 38 verront l’institution de sanctions contre les refus d’heures supplémentaires! (cela est encore valable). Enfin nous touchons au but : le décret du 21 avril 39 supprime les majorations de salaires pour les heures comprises entre la 40ème et la 45ème heure!
C’est une victoire en effet, un triomphe... mais pour la bourgeoisie de droite et de gauche qui prépare sa guerre.
-Mais il reste les deux semaines de congés payés. Que représentent-elles? Peu de temps après la promulgation des premiers décrets, le patronat réclame la récupération des fêtes de Noël et du 1er de l’An. Le gouvernement, « de gauche » appuie la demande. Les syndicats recommandent à leurs adhérents d’accepter cette récupération qui doit se limiter, paraît-il, à ces deux jours fériés. En fait, la récupération sera étendue à toutes les fêtes légales et même aux fêtes locales. C’est environ 80 heures de travail supplémentaire par an qui sera ainsi récupéré. Faisons le compte, cela fait exactement deux semaines, les deux semaines de congés payés.
Par ailleurs, il est à noter que ces fameux congés payés, sous une forme ou sous une autre, ont été accordés à la même époque dans la plupart des pays développés, sans qu’il y ait eu forcément de luttes ouvrières pour les amener. C’est qu’outre le fait qu’il est possible au capital de les récupérer sous un autre biais, ces congés ne font que prendre en compte la nécessité absolue de repos supplémentaire en vue de la reconstitution de la force de travail de plus en plus exploitée. Nécessité absolue pour chaque capital national s’il veut conserver des ouvriers « rentables » face à l’accentuation des cadences pour produire au plus bas prix et tenter de rester commercial sur un marché international qui a atteint ses limites.
Une victoire ? Qui aura encore le cynisme de parler de victoire ?
Ainsi, la deuxième guerre impérialiste qui se prépare depuis 1930 peut enfin arriver à terme grâce à la gauche et au syndicat qui auront réussi à démoraliser, mystifier, diviser et vaincre la classe ouvrière. La « gauche » sera fière d’avoir réussi, elle le proclamera, les uns vantant la méthode, c’est Blum quand il déclare : « il faut noter qu’au point de vue de l’ordre public, cette forme de grèves a d’incontestables avantages. Les ouvriers occupent l’usine, mais il est vrai que l’usine occupait les ouvriers. Les ouvriers étaient là et pas ailleurs. Ils n’étaient pas dans la rue. Au moment où ils étaient tous groupés dans l’usine, ils ne formaient pas ces cortèges avec des chants, des drapeaux rouges, qui viennent se heurter aux barrages de police... ». Et oui, enfermés dans les usines, quand ils les occupaient, les ouvriers ne menaçaient pas l’Etat. Les autres vantent l’esprit qui les anime et c’est le PC qui conclue : « Les communistes ont manifesté leur volonté inébranlable de défendre le pays en votant les crédits de défense nationale... sur le champ de bataille, des communistes soldats ont déjà versé leur sang ».
Il y a effectivement de quoi être fier d’avoir contribué à l’accomplissement d’une telle oeuvre, la survie du capital : la 2ème boucherie mondiale fera 55 millions de morts...
Les prolétaires doivent en tirer les leçons.
Comme dans les années 30, le capital est mondialement en crise, et une crise de plus en plus aiguë.
Le capital ne survit plus que dans un cycle infernal de crise, guerre, reconstruction, crise...
Comme dans les années 30, l’heure de la gauche au pouvoir se précise avec aussi un programme qui, lui aussi, promet d’accorder les 40 heures,les loisirs, davantage de congés payés, le SMIC à 2400 F et des augmentations de salaires
Plusieurs leçons doivent être tirées, Nous n’en soulignerons qu’une, mais qui est d’importance, capitale pour le prolétariat : étant définitivement entré dans sa phase de décadence, le capital ne peut plus accorder aucun avantage important et durable ! Le prolétariat ne peut plus espérer, comme au 19ème siècle, s’aménager une place moins mauvaise dans le capital. La seule alternative désormais est : guerre ou révolution. La sinistre mascarade de la gauche au pouvoir et des soi-disant avantages acquis sont là pour l’illustrer. Tous ceux, depuis la gauche, les syndicats et les gauchistes de tout poil qui avec un langage qui se veut ouvrier et plus ou moins radical parlent des acquis de 36 sont les ennemis mortels de la classe, aujourd’hui et demain.
En 36, mondialement, la classe ouvrière était faible. Elle se relevait d’une défaite sanglante, celle de la vague révolutionnaire des années 17-23. Mais, demain, quand la lutte se généralisera, à l’inverse des années 30, c’est un prolétariat ayant refait le plein de ses forces physiques et fort des leçons de ses défaites qui se dressera contre toute cette racaille : syndicats, gauche et extrême-gauche, les démasquant pour ce qu’ils sont : les meilleurs défenseurs du capital.
A.B.
Situations territoriales:
- France [55]
- Lutte de classe en France [89]
Courants politiques:
- Gauchisme [59]
Révolution Internationale N° 51 - juillet
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 877.17 Ko |
- 650 lectures
Révolution Internationale N° 53 - septembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 714.86 Ko |
- 648 lectures
Révolution Internationale N° 54 - octobre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 993.3 Ko |
- 685 lectures
Les "droits démocratiques" - [la position des révolutionnaires]
- 728 lectures
LES DROITS DEMOCRATIQUES CONTRE LA LUTTE DE CLASSE
■ Pour les idéologues bourgeois, l'Etat est l'émanation de la souveraineté populaire. La démocratie est la forme suprême de l'Etat, l'achèvement et la perfection de son être. Le marxisme y voit cependant tout autre chose. Dévoilant la division de la société en classes, il démontre qu'il ne saurait y avoir communauté d'intérêts entre exploités et exploiteurs. Par conséquent, l'Etat, loin de gérer un prétendu bien commun, n'est jamais qu'une trique aux mains de la classe exploiteuse. Cela reste vrai même si la démocratie étend son voile hypocrite sur les rapports de classe et ne laisse paraître que les "citoyens égaux et libres". Derrière la liberté et l'égalité formelles, descend l'ombre du bâton dont la classe oppresseuse se sert pour assujettir la classe opprimée.
Pour comprendre la fonction première de la démocratie, on peut méditer ces mots d'Engels : "...au moment de la révolution, elle aura son importance en tant que PARTI BOURGEOIS EXTREME... A ce point, toute la masse des réactionnaires s'aligne dans sa foulée et la renforce, tout ce qui est réactionnaire se donne des allures démocratiques... (ce qui fait que) notre seule ennemi au moment et au lendemain de la crise sera l’ENSEMBLE DE LA REACTION REGROUPEE AUTOUR DE LA DEMOCRATIE PURE" (Engels, 1884, lettre à Bebel).
C'est vrai lorsque la crise révolutionnaire frappe à la porte, mais tend également à se réaliser dès que les affrontements de classe se durcissent. Les luttes prolétariennes trouvent alors sur leur chemin le mirage démocratique et parlementaire, destiné à les égarer, à ramollir ou écarter les assauts qu'elles portent à l'Etat bourgeois, à freiner ou disloquer leur élan, à les emporter sans force loin de leur but. Car si "l'appareil exécutif, militaire et politique de l'Etat bourgeois organise l'action directe contre la révolution prolétarienne, la démocratie représente pour lui un moyen de défense indirecte en répandant dans les masses l'illusion qu'elles peuvent réaliser leur émancipation par un processus pacifique" (thèses de la Gauche italienne, 1920). De ce moyen de défense indirecte, aucun Etat de la classe dominante ne peut durablement se passer sans chauffer à blanc les antagonismes sociaux.
démocratie et état fort sont complémentaires
Nous avons établi que la démocratie servait principalement de tampon entre la machine étatique et la classe ouvrière ; au détriment non de la première, mais de la seconde. Dans le cours au renforcement de l'Etat, la légalité "démocratique" est d'ailleurs la plus avantageuse pour la bourgeoisie. Elle n'a nul besoin de liquider son arsenal démocratique pour augmenter ses capacités de répression brutale. C'est au contraire sous la démocratie que l'Etat bourgeois se renforce LE MIEUX : il gagne en puissance matérielle, sans pour autant rien perdre en puissance idéologique. Il faut apprécier avec réalisme cette tendance de la démocratie â se blinder "contre la subversion", à se doter des capacités de répression les plus modernes pour faire face à la lutte de classe (comme l'indique la campagne anti-terroriste de la bourgeoisie, prétexte au déploiement, béni par la gauche, de ses forces policières). Voir dans le blindage de la démocratie une tendance qui ne peut être inversée, mais que seule la révolution prolétarienne pourra briser par la destruction de l'Etat bourgeois, n'est nullement propager le pessimisme dans la classe ouvrière. A moins de croire réellement que la bourgeoisie ne se préparé pas pour le moment crucial et renoncera à se défendre si les codes démocratiques sont suffisamment exprimés dans un texte de loi. Une fatale illusion qui a creusé la tombe de plus d'une révolution quand la bourgeoisie, acculée, s'est mise à violer tous les chapitres de sa propre légalité.
que signifient aujourd’hui les «droits démocratiques» ?
Au siècle dernier, lorsque le capitalisme était un mode de production progressif, il existait la possibilité pour la classe ouvrière d'obtenir un certain nombre d'améliorations et de garanties au sein du système. A cette époque, malgré les illusions qu'elles pouvaient déjà favoriser, et que les révolutionnaires dénonçaient, les luttes pour certains de ces "droits" avaient un sens. C'est notamment vrai pour le suffrage universel qui permettait, d'une part, l'utilisation du parlement comme tribune de laquelle les partis ouvriers pouvaient mettre en avant ce qui distinguait le prolétariat des autres classes de la société; d'autre part, d'apporter un soutien aux secteurs les plus dynamiques de la classe dominante contre les vestiges de la féodalité afin de hâter le développement du capitalisme et donc des conditions de sa disparition. Mais, aujourd'hui, alors que le capitalisme est un système décadent, qui ne peut accorder de réelles améliorations à la classe ouvrière, au sein duquel tous les secteurs de la classe dominante sont réactionnaires au même titre que le système lui-même, on peut se demander ce que valent ces "droits démocratiques" dont parle l’extrême-gauche. Effectivement, ces droits, quels sont-ils ?
C'est le droit pour le prolétaire, après avoir sué tant et plus pour le capital, de coucher sur papier son mécontentement, de le faire publiquement et même de se rassembler avec d'autres pour en parler... dans la mesure bien sûr où aucune lutte n'en découle, sinon la police intervient et rappelle très vite que la "démocratie a aussi ses devoirs".
C'est le droit, après avoir trimé durement dans les bagnes industriels, de se faire arnaquer par les syndicats pour tenter de récupérer une partie de ce que le capital nous vole, et pour finalement ne pas même récupérer des miettes parce que les syndicats ne sont là que pour protéger les profits du capital.
C'est la liberté de croire que si tel ou tel parti accédait à l'exécutif de l'Etat, la société changerait, de telle sorte que nous devrions nous échiner à élire parti sur parti dans l'espoir de voir leurs promesses se réaliser. Bref, les "libertés démocratiques" sont la consolation offerte par la bourgeoisie à ses esclaves salariés et elles culminent dans la liberté... d'être humble et soumis à l'ordre établi. Qui nous fera croire après ça qu'une autre classe que la bourgeoisie a intérêt à la démocratie politique ?
Dans la propagande des gauchistes, les "libertés constitutionnelles" sont pour le prolétariat la première chose à acquérir. Dans leur vision de la lutte de classe, le prolétariat apparaît comme un ver rampant, la classe opprimée la plus lâche et la plus insensée de l'histoire. Car si les esclaves du passé avaient d'emblée leurs propres révoltes, les serfs les jacqueries, la bourgeoisie les grandes révolutions anti-féodales ; le prolétariat n'a qu'un itinéraire absurde : d'abord lutter avec les méthodes bourgeoises pour des objectifs bourgeois (par exemple, avec les syndicats pour la mystification de "droit de grève"), ensuite seulement envisager la révolution. Comme si après avoir fait siens des buts et des moyens opposés à ses propres buts et moyens, on pouvait songer sérieusement à renverser l'ennemi de classe !
Mais, ici, le gauchisme sursaute et se colore d'indignation. Il crie au scandale, tablant sur le sens commun et l'opinion courante : "Quoi ! Pour ces misérables pourfendeurs de démocratie, la lutte contre l'arbitraire, pour la liberté d'association, d'expression, etc. n'est pas valable en tous temps et de n'importe quelle manière ?" Bien sûr que non, faux dévêts, elle ne Test pas. Les révolutionnaires ne sont nullement favorables aux libertés EN GENERAL qui toujours cachent la dictature bourgeoise. D'abord parce qu'ils sont partisans de la dictature du prolétariat comme transition nécessaire vers le communisme, c'est-à-di- dire d'un pouvoir qui SUPPRIMERA pour les classes exploiteuses ces fameuses libertés politiques dont on parle tant. Ensuite, parce qu'il vaut mieux faire grève pour les intérêts réels de la classe ouvrière, plutôt que pour obtenir... le "droit de grève" accordé par la bourgeoisie, qui ne sera jamais que la garantie verbale de ne pas réprimer la grève, en d'autres termes, du vent. Qui serait assez naïf pour croire que si la grève menaçait véritablement ses intérêts, la bourgeoisie resterait inactive parce qu'elle a promis de le rester ? Seuls ceux qui ont orienté tous leurs espoirs sur l’obtention de cette promesse, en la prenant pour argent comptant, seront surpris lorsque la classe dominante leur cassera l'échine.
L'extrême-gauche, quant à elle, s'affirme partisane de la "liberté de grève": elle montre par-là que la classe ouvrière dont elle rêve, n'est que la classe qui SE SOUMETTRA TOUJOURS ! Tant que les prolétaires feront la grève pour se voir garantir le droit de grève, écriront pour avoir le droit d'écrire, parleront pour avoir le droit de parler, la bourgeoisie ne sera jamais menacée.
Mais quand la classe ouvrière fera grève sans concessions, exprimera ses intérêts généraux antagoniques au capital, écrira et parlera d'insurrection avec la ferme intention de la mettre eri pratique, les fusils de la classe bourgeoise tonneront, quel que soit le "degré de la démocratie". Le gauchisme voudrait établir un "statu quo" entre les deux classes antagoniques. Et pour cela il propose aux prolétaires, ni plus ni moins... de ne pas lutter, de prendre des airs courtisans à l'affût de phrases onctueuses et de caresses empoisonnées. Encore les courtisans savaient-ils s'y prendre. Les prolétaires n'en retireraient qu'une honte sans avantage. En somme, le programme du gauchisme revient à dire que le plus sûr moyen d'empêcher la répression de s'abattre sur la révolution est encore de supprimer la révolution ; et en lieu et place de lutter pour elle, de dévoyer les combats prolétariens en leur donnant comme objectifs des "droits" vides de sens qui ne renforcent que les illusions propagées par la société bourgeoise.
la Position des révolutionnaires sur la démocratie
Toutes ces constatations ne nous empêchent évidemment pas d'affirmer pour le prolétariat le "droit" de combattre la domination bourgeoise. Faut-il beaucoup discuter pour comprendre la différence entre ce "droit" et celui que l'extrême-gauche revendique pour la classe ouvrière ? Le marxisme est partisan de la COALITION des ouvriers pour limiter les empiétements du capital, de l'EXPRESSION par la parole et l'écrit de leurs revendications de classe, et même plus, de leur ORGANISATION comme CLASSE REVOLUTIONNAIRE pour renverser l'Etat bourgeois et le capitalisme.
Jamais la classe dominante ne pourra admettre le "droit", historique du prolétariat à la balayer, elle et toute sa société d'oppression et d'exploitation.
Ce "droit", le prolétariat le tire non d'une constitution stalinienne qui le proclame, ni de principes moraux, mais de sa seule FORCE. Quant à ses possibilités d'association, de réunion, de diffusion d'une presse, etc. -exigences pratiques de sa vie-, il doit les IMPOSER par la lutte contre l'Etat bourgeois, non pour se maintenir dans des positions défensives, mais pour se préparer â l'assaut final.
Rien de commun, on le voit, avec la démocratie bourgeoise et ses prétendues garanties. Mais, au contraire, la plus ferme détermination d'affronter la terreur bourgeoise, démocratie ou fascisme, sur un terrain de classe : par la préparation, l'organisation de la lutte révolutionnaire. Lorsque la classe ouvrière s'émancipera de ses illusions dans la démocratie, elle n'exigera pas un nouveau "droit", un "droit prolétarien" à la révolution ; mais concrétisera son devoir historique de renverser le vieux monde par la destruction de tout l'appareil politique, économique, juridique du capitalisme.
(D'après Internationalisme n°23).
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Les révisions du PCI
- 24 lectures
"Il n'est jamais trop tard pour bien faire" et "tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir", nous dit le "bon sens populaire". En général, les communistes dénoncent ce "bon sens" dans lequel ils voient essentiellement un condensé de tous les préjugés sur lesquels s'appuie l'idéologie de la classe dominante, mais, pour une fois, ces deux proverbes semblent pouvoir s 'appliquer au "Parti Communiste International" dont les analyses publiées dans le n° 77 de "Programme Communiste" et le "Prolétaire" nu 271 traduisent un net redressement par rapport aux aberrations qu'ils a pu produire ces dernières années sur trois points essentiels pour la lutte prolétarienne :
- l’évaluation de la situation internationale et particulièrement la question des préparatifs vers une 3ème guerre mondiale;
- la compréhension de la nature des luttes dites de "libération nationale";
- les tâches actuelles du prolétariat mondial et plus particulièrement dans les pays "sous-développés".
Nous estimons très important ce redressement opéré par le PCI, nous espérons qu'il ne restera pas sans lendemain et permettra en particulier à cette organisation de reconsidérer un certain nombre de positions erronées qui, pour l'heure, lui interdisent une contribution réellement positive au processus de prise de conscience de la classe ouvrière.
Mais nous entendons déjà le militant bordiguiste crier à la "falsification" et déclarer : "Nous, changer de position ? Jamais ! Ne savez-vous pas que nos positions sont invariantes ?"
Bien, puisqu'il le faut, nous allons imposer au lecteur un certain nombre de citations de la presse du PCI pour faire apparaître que ces changements de positions sont bien réels et non le fruit de notre simple imagination torturée.
Une invariance à géométrie variable
Nous avons signalé trois points sur lesquels les positions du PCI ont évolué de façon positive. Le premier concerne l'évaluation de la situation internationale. Voici ce que le PCI écrivait en 1974 concernant les rapports entre les USA et l'URSS : "Nous proclamons depuis longtemps un certain nombre de vérités qui ne sont pas des découvertes de nos cervelles mais découlent d'une application élémentaire du marxisme à l'analyse et à l'appréciation des événements contemporains. Le prétendu "condominium américano-soviétique" sur le monde n'est en réalité qu'une domination du gendarme américain avec participation aux bénéfices du laquais russe. Tout pas en avant dans la détente, dans les "relations commerciales avantageuses", dans la coexistence pacifique... Tout cela signifie le feu vert pour le gendarme impérialiste international siégeant à Washington (mais, bien entendu... la succursale de Moscou, elle aussi en profite : celui qui tient le parapluie de son supérieur hiérarchique a quelque chance d'être à l'abri de la pluie...")...
En 1975, sous le titre "En Indochine, l'axe USA-URSS", on entendait le même son de cloche : "C'est là, dans le stalinisme, qu'est la racine de la capitulation devant l'impérialisme mondial et son pilier: les USA. C'est là aussi qu'est la clé pour comprendre par quel "mystère" la Russie et la Chine peuvent s'accuser réciproquement de révisionnisme et n'aspirer à rien d'autre qu'à de bons rapports et à une "collaboration avantageuse" avec l'empire de la bannière étoilée"...
"C'est en s'appuyant sur les centrales du "socialisme dans un seul pays" que Washington peut se sentir à l'abri aussi bien les jours de tempête que les jours de calme plat". ("Le Prolétaire", n°197 du 31 mai 1975).
Ainsi, à cette époque, le PCI développait la thèse d'un "impérialisme mondial" dirigé par les USA dont l'URSS n'était qu'un simple valet. Il s'agit là d'une position proche de celles des trotskystes pour qui il n'y a pas (comme les révolutionnaires et particulièrement Lénine l'ont toujours affirmé) des blocs impérialistes antagoniques mais une sorte de "super-impérialisme" tentant d'imposer ses conditions léonines à tous les autres pays du monde et contre lequel les "peuples" sont appelés à "s'émanciper". Certes, même à cette époque, il existait une différence fondamentale entre les positions bordiguistes et les positions trotskystes : les premières reconnaissent la nature capitaliste et impérialiste de l'URSS alors que les secondes considèrent ce pays comme un "État ouvrier" qu'il faut défendre. Cependant, cette conception d'un impérialisme mondial, non seulement tournait résolument le dos à la réalité (malgré la prétention de ses auteurs de procéder à "une application élémentaire du marxisme à l'analyse et l'appréciation des événements contemporains") mais, de plus, elle était extrêmement dangereuse et pernicieuse (c'est pour cela que Lénine la combattait très férocement chez Kautsky) : en niant l'existence d'antagonismes irréductibles entre blocs impérialistes, elle tend à accréditer l'idée que la guerre impérialiste mondiale n'est pas la conséquence inéluctable de la crise du capitalisme en l'absence de révolution prolétarienne. C'est, sur le plan théorique, la porte ouverte au pacifisme et à l'abandon des positions fondamentales autour desquelles les révolutionnaires se sont retrouvés pendant la 1ère guerre mondiale et sur lesquelles s'est fondée l'internationale Communiste. Rien de moins.
Progressivement, cette conception absurde a disparu des colonnes de la presse bordiguiste et on a pu voir apparaître des références à l'aggravation des tensions entre les "deux grands blocs" : il est vrai qu'il fallait être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Cependant, même ces derniers mois, la sous-estimation du rôle de l'impérialisme russe dans le monde était de mise : ainsi, lors de l'intervention française au Zaïre, la prise de position du PCI "Impérialisme français hors d'Afrique et du Liban" ("Le Prolétaire", n° 267), ne disait pas un mot de l'existence -combien présente en Afrique !- de l'impérialisme russe. Et si les articles suivants du "Prolétaire" étaient un peu moins discrets sur cette existence (ils insistaient presque exclusivement sur un seul point : les intérêts spécifiques de la France en Afrique), ce n'est que dans "Programme Communiste" n°77 que l'impérialisme russe trouvait sa vraie place dans la tragédie africaine et que la véritable signification des événements était dégagée : "Avec la chute de l'empire colonial portugais, le vrai repartage du continent est désormais ouvert. Mais il démarre en grand précisément au moment où la crise économique mondiale... ramène avec elle le spectre d'une nouvelle guerre mondiale. De plus, la lutte titanesque pour la domination du monde que se livrent les deux super-monstres étatiques du capital, qui masquent leurs faces hideuses de marchands d'esclaves sous les plis des drapeaux d'une hypocrite défense des droits de l'homme d'un côté, d'un faux anti-impérialisme de l'autre, se répercute sur la scène de notre drame... On comprend alors que cette vaste aire géographique... devienne un terrain privilégié de la préparation d'un futur conflit impérialiste".
De même, cet article semblait répondre (est-ce une coïncidence ?) à celui publié dans "Révolution Internationale" n°51 intitulé : "Et si le PCI avait des militants en URSS ?" et dans lequel nous mettions en évidence "l'internationalisme" à usage uniquement occidental de cette organisation. Effectivement, le PCI écrit : "Par rapport à l'Afrique, la position est la même en Belgique contre les agressions belges, aux USA contre les menées américaines, en Russie contre les brigandages russes... car le prolétariat international n'a pas à choisir un camp impérialiste contre un autre".
Très bien ! Voilà qui ressemble plus à une position réellement internationaliste !
Le deuxième point sur lequel on peut noter une évolution de la part du PCI est directement rattaché au premier : la signification des prétendues luttes de "libération nationale". Dans "Le Prolétaire" n°271, le PCI nous en donne partiellement la clé : "Derrière les conflits locaux, rôle de spectre de la guerre mondiale". On peut lire dans l'article : "L'Afrique, en particulier, n'a cessé de prendre feu, dans sa corne orientale, au Sahara Occidental, au Tchad, et, enfin, au Zaïre. Les tensions nationales internes et les explosions sociales dans des pays dont l'indépendance est trop fragile pour ne pas se convertir en dépendance économique, financière, politique et militaire, ont été le prétexte d'interventions soi-disant philanthropiques des uns et des autres, créant une chaîne de heurts, d'antagonismes et de conflits sanglants qui n'est pas près de s'arrêter".
Voilà qui commence à ressembler à une appréciation correcte de ces luttes "nationales" dans lesquelles ce sont les blocs impérialistes qui sont maîtres du jeu, et absolument pas les "peuples". Toute cette théorie bordiguiste sur l'émancipation des "peuples de couleur" et que la simple constatation de la réalité oblige à remettre en cause, repose sur une thèse essentielle : celle de l'existence "d'aires" du capitalisme où les tâches du prolétariat seraient différentes. C'est justement sur ce 3ème point que l'article : "Sur la révolution en Amérique Latine" ("Programme Communiste" n°77) essaie de rétablir une position correcte. C'est explicitement que cet article rejette la thèse énoncée dans le n°75 de "Programme Communiste" et qui affirme : "La classe ouvrière doit lutter pour soulever et entraîner sous sa direction les masses travailleuses paysannes et urbaines dans la révolution agraire et anti-impérialiste, qui n'est pas sa propre révolution de classe, mais une condition nécessaire... sur la voie de son émancipation..."
Il n'a pas peur d'affirmer dans le rectificatif : "Il serait désastreux de s'enfermer dès à présent dans l'horizon soi-disant obligatoire d'une révolution bourgeoise radicale", et aussi: "c'est dans cette perspective, qui renverse le schéma esquissé dans (l'autre article), que nos camarades doivent travailler. Dans cette optique, la future révolution continentale prolétarienne, partie intégrante de la révolution prolétarienne mondiale, est la règle..."
Nous sommes loin des conceptions qui apparaissaient dans l'article dédié à Che Guevara (Le Prolétaire, n°253) qui se lamente que "le prolétariat... alors absent de la scène historique n'ait pas répondu à l'appel que lui lançaient, depuis La Havane, les représentants de la révolution paysanne" et qui prévoit: "L‘ appel, cependant, reste vivant, et la nouvelle vague révolutionnaire devra lui répondre".
C'est donc sur une position bien ancrée dans le PCI que l'article de "Programme Communiste" n°77 appelle à revenir et non sur une simple coquille malencontreusement apparue dans le n°75 de la même revue.
Et maintenant?
Si nous avons mis en évidence l'évolution subie dernièrement par certaines positions du PCI, ce n'est certainement pas pour le lui reprocher. Ces dernières années, ce n'est pas avec indifférence que nous avons constaté et signalé le processus d'involution de cette organisation qui se réclame de la Gauche Communiste, vers des positions de plus en plus proches de celles du trotskysme. Nous avons vu, au contraire, dans ce phénomène une dernière victoire de la contre-révolution qui entraînait de plus en plus à elle une organisation de la classe ouvrière. C'est pour cela que nous saluons les prises de position récentes du PCI. Nous y voyons une réaction contre cette involution et donc la possibilité d'un redressement politique. Cependant, nous estimons que cette réaction n'est pas suffisante et que c'est seulement en remettant explicitement en cause certaines des positions de Lénine et de l'internationale Communiste dont le PCI a fait un dogme, qu'il pourra se donner la capacité de résister efficacement contre la pression de l'idéologie bourgeoise ambiante (et dont sa phraséologie sur les "luttes héroïques" des peuples X ou Y et sur les exploits du "Che" était une des expressions les plus lamentables). Lénine était un grand révolutionnaire, sa contribution au combat de la classe ouvrière est énorme, mais, comme tous les révolutionnaires, il a commis des erreurs. En particulier, dans son débat avec Rosa Luxembourg, l'histoire a donné raison à cette dernière : "Les guerres nationales ne sont plus possibles à l'époque de l'impérialisme effréné. Les intérêts nationaux ne servent que comme instrument de duperie pour mettre les masses ouvrières au service de leur ennemi mortel, l'impérialisme"[1]. Plus d'un demi-siècle de massacres inter-impérialistes a tragiquement confirmé cette thèse. Ici, la fidélité à la lettre des positions de Lénine conduit à une trahison de toute sa démarche comme révolutionnaire et comme marxiste : se mettre à l'école de l'expérience ; critiquer, à la lumière de celle-ci, la moindre erreur programmatique ou d'analyse.
Implicitement, c'est ce qu'a fait le PCI en rejetant certaines de ses positions qui n'ont pas résisté à l'épreuve des faits. Mais, si, réellement, une vie révolutionnaire l'anime, il ne peut en rester là : il doit également tirer les conclusions de ce réalignement et jeter aux orties les dogmes absurdes et dérisoires de "l'invariance" et du "monolithisme". Le PCI n'est ni "invariant", comme on a pu le voir, ni monolithique : sinon, pourquoi le "centre" estime-t-il nécessaire d'indiquer la bonne direction dans laquelle les "camarades doivent travailler". Rien n'est plus étranger au marxisme que l'idée d'une pensée monolithique. Le marxisme est essentiellement critique et même s'il se conçoit comme une vision cohérente du monde, il n'a jamais exclu la possibilité de contradictions au sein de sa démarche, contradictions qui sont l'expression même de la vie.
Chacune des différentes organisations qui se réclament du bordiguisme se considèrent comme "le seul détenteur de la conscience révolutionnaire". Pauvre conscience qui est obligée de courir après l'événement et, incapable de tirer les enseignements d'un demi-siècle d'histoire, d'ajuster le tir au coup par coup. Comme toute pensée, elle aurait grandement gagné à la discussion et à la confrontation avec celle des autres groupes communistes existant à l'heure actuelle. Cela lui aurait peut-être évité certains des errements mencheviks et kautskystes que le PCI -bien que partiellement- vient de rejeter en catastrophe et que d'autres organisations dénonçaient depuis longtemps. Malheureusement, par leur refus récent de participer aux efforts de discussion entrepris avec "Battaglia Comunista" par le CCI, le CWO et autres, le PCI ("Programma"), comme le PCI ("Il Partito Comunista"), se refuse à une telle attitude. Décidément, il reste encore un long chemin à faire pour le bordiguisme !
F.M.
[1] Thèses de la social-démocratie révolutionnaire sur la guerre impérialiste (1915).
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Courants politiques:
- Bordiguisme [29]
- PCI (Le prolétaire) [30]
Rubrique:
Lutte «Populaire» ou lutte de classe ?
- 10 lectures
Iran, Nicaragua, c'est par milliers de morts, que les régimes en place doivent leur maintien au pouvoir. Voilà l'image idyllique que le capitalisme nous donne de lui aujourd'hui. Pour la bourgeoisie "démocratique”, "progressiste” ou "libérale”, tout cela est "de la faute" des régimes "pourris" et "sanguinaires” du Shah ou du dictateur Somoza. Hypocrisie ! Les lamentations actuelles de cette bourgeoisie ne nous feront pas oublier qu'elle partage, avec les secteurs de droite, "fascistes” et autres, l’entière responsabilité des plus grands crimes de ce siècle ; des 20 millions de morts de la 1ère guerre mondiale, des 50 millions de morts de la 2nde, de tous les massacres qui l'ont suivie et surtout qu'elle a toujours été en première ligne quand il s'agit de déchaîner la répression contre la classe ouvrière. Aujourd'hui, dans ces deux pays, ce n'est pas le prolétariat qui occupe le devant de la scène. L'immense mécontentement de presque toutes les couches de la population, violemment heurtées par la crise mondiale du capitalisme, et où domine la petite-bourgeoisie agricole et urbaine, en est d'autant mieux utilisé, soit au service des secteurs les plus anachroniques de la classe dominante comme en Iran, soit au service de la bourgeoisie "démocratique” comme au Nicaragua. De ce fait, la domination bourgeoise n'est nullement remise en cause par ces "mouvements populaires", mais la sauvagerie avec laquelle ils sont réprimés permet de se faire une idée de ce que la classe capitaliste, toutes fractions réunies, est capable de faire quand son système est réellement menacé par la seule classe qui puisse l’abattre : le prolétariat.
----------------------------------------
IRAN
Trois jours avant la répression qui s'est abattue sur les manifestations pacifiques des habitants des taudis en Iran, toute la presse bourgeoise parlait de "libéralisation", s'attardait sur la description idyllique de la foule qui lançait des gerbes de fleurs sur l'armée et la police. Puis, ce fut la tuerie. L'armée tirait à vue. Les soldats qui refusaient d'exécuter, mitraillés aussi. 5000 morts, ce jour-là. Un mouvement qui rassemblait 500 000 personnes dans une même colère s'est fait écraser comme des agneaux dans une boucherie.
C'est ainsi que répond la bourgeoisie lorsque la situation est bloquée, et que les Carter, les Schmidt, les Giscard ou les Hua Kuo Feng ne peuvent admettre que soient mis en péril les milliards investis en Iran, pays clé de la situation stratégique de la guerre entre les blocs.
Mais si les remous actuels en Iran sont certes l'expression de rivalités intestines qui agitent le clan du shah, l'église ou l'opposition pro-russe, alimentées par des rivalités de plus grande ampleur, celles des blocs occidental et russe, la foule mystifiée qui s'est jetée dans la rue, n'était pas avant tout animée de la foi dans Allah ou de la volonté que l'Iran s'islamise. Ce qui l' a jetée là, c'est la misère profonde dans laquelle est maintenue la majorité de la population, pour qui la survie est un problème quotidien, et qui n'a rien à perdre, parce qu'elle ne possède rien, si ce n'est sa vie, et encore si peu.
Cette foule qui s'est fait livrer pieds et poings liés à la répression, endormie par les appels au pacifisme d'une opposition qui craignait d'être débordée par sa masse de manœuvre, ce n'est pas encore la classe ouvrière. Les grands centres industriels, ceux qui se sont soulevés en grève l'année dernière, sont restés muets, à part le simulacre de "grève de solidarité" de 24 heures orchestrée par l'opposition. La classe qui seule porte la possibilité de la véritable libération de l'humanité, celle qui seule a la force de s'organiser et de s'armer contre le capitalisme pourrissant, commence à peine à s'affirmer sur la scène internationale. Aussi longs que soient ses préparatifs, ce n'est que dans un mouvement international de la classe ouvrière que se trouve le bout du tunnel pour le tiers-monde. En l'absence de cette force, les mouvements du lumpen prolétariat sont condamnés à se faire embrigader par des "ayatollahs", des PC ou autres prometteurs de miroirs aux alouettes, et à se faire massacrer.
Si le mouvement auquel s'est heurté l'État iranien n'était pas encore celui de son ennemi mortel, sa réaction fut par contre celle à laquelle TOUTE bourgeoisie a recours face à la colère des exploités, quand les phrases creuses ne suffisent plus.
Pour accréditer la possible mise en place d'une soi-disant libéralisation au nom du camp des droits de l'homme, la bourgeoisie occidentale tente de masquer sous le folklore des grands sorciers ayatollahs les véritables causes de la situation, tentant de justifier la tuerie par le caractère "réactionnaire" du mouvement. Les proclamations américaines du début de l'été ne déclaraient-elles pas que "le shah partage les conceptions occidentales des droits de l'homme"? Nous n'en doutons pas. La bourgeoisie a par-delà ses frontières et ses divisions, la même conception des droits de ceux qu'elle exploite. Et les professions de foi de la gauche en France qui implore une "véritable libéralisation" ne font pas plus illusion que les autres. Depuis le sang des ouvriers allemands sur les mains de la social- démocratie en 1920 jusqu'aux massacres en chaînes dans les pays sous-développés actuellement, la chaîne est longue des forfaits perpétrés par la classe bourgeoise lorsqu'elle se trouve face à l'impasse, à l'opposition de ceux qui n'ont rien à perdre.
La signification de ces derniers massacres est double:
- elle est d'abord un signe que le lumpen prolétariat des pays du tiers monde est prêt à la lutte à mort contre le capital, même s'il se trompe en identifiant aujourd'hui le système qui entretient sa misère à la seule personne du Shah;
- elle est surtout un avertissement de ce qui attend la classe ouvrière si elle se laisse prendre aux prêches pacifistes des fractions bourgeoises qui tentent de l'utiliser, et de ce que sera la réaction des États bourgeois à sa lutte, quelle que soit la fraction, de droite ou de gauche, qui se trouve à la tête de l'État bourgeois.
D.N.
------------------------------------
AMERIQUE LATINE
Au Nicaragua, un régime aux abois déchaîne aujourd'hui une des répressions les plus féroces que l'Amérique Latine ait connu depuis le putsch de Pinochet au Chili en 1973. C'est là une image que le capitalisme, tous secteurs confondus, ne manquera pas de présenter de plus en plus fréquemment à mesure que sa crise mortelle ira en s'aggravant. Mais le dégoût que les atrocités de la soldatesque aux ordres de Somoza ne peut manquer de provoquer, ne doit pas faire oublier au prolétariat où sont ses intérêts véritables, s'il ne veut pas se laisser entraîner dans une lutte qui n'est pas la sienne, où il n'a rien à gagner et tout à perdre.
La "lutte du peuple" n'est pas notre lutte
Pour ceux à qui il suffit qu'une lutte soit violente pour qu'elle soit révolutionnaire, comme "Libération" par exemple, il faut sans doute saluer la "lutte du peuple de Matagalpa" par exemple, où "les étudiants, les lycéens, les commerçants, les paysans, les employés... se sont soulevés comme un seul homme" (journal du 5 août).
Pour nous, pour le prolétariat mondial, cette énumération est avant tout significative que cette lutte n'est pas la nôtre, même si des prolétaires en sont les premières victimes.
En effet, cette lutte, si elle s'appuie sur le mécontentement de toute une série de couches sociales violemment touchées par la crise mondiale du capitalisme, ne peut que servir des intérêts qui n'ont rien à voir, ni avec ceux de la classe ouvrière, ni même avec ceux des autres couches qui sont descendues dans la rue. D'emblée, elle s'est placée sur un terrain parfaitement bourgeois, celui des "droits démocratiques", du "renversement de la dictature fasciste". Et cela d'autant plus facilement que ces différentes couches, autres que le prolétariat, n'ont aucun avenir, ni immédiat, ni encore moins historique. Aucun avenir pour les étudiants et les lycéens destinés à devenir techniciens ou cadres, mais pour quoi faire ? dans un pays où l'industrialisation est à son plus faible degré de développement.
Aucun avenir pour les paysans qui peuvent difficilement vivre de ce qu'il qu'ils produisent : bananes, café, canne à sucre... et plus difficilement encore payer leurs impôts.
Aucun avenir pour les commerçants qui peuvent difficilement vendre quelque chose, à une population dont 80% vit dans les bidonvilles et dont 40% est au chômage.
Aucun avenir pour les quelques milliers d'employés dont la perspective se situe de plus en plus entre l'austérité et le chômage.
Aucun avenir non plus pour les syndicats patronaux de plus en plus écrasés par le poids de la concurrence mondiale.
Et alors, dans ces circonstances, comment la population, le "peuple nicaraguayen", va-t-elle payer les impôts demandés par la famille Somoza ? Et comment la famille Somoza va-t-elle rembourser ses dettes vis-à-vis des USA et négocier le prêt de 40 millions de dollars avec le FMI ?
Il n'y a plus alors aucune difficulté à comprendre pourquoi la population du Nicaragua s'est, en quelque sorte, mise en grève générale, et à quel degré de décomposition de la bourgeoisie cela correspond.
La lutte du "peuple nicaraguayen", c'est donc la lutte de toutes les forces politiques opposées à la famille Somoza : jamais, très certainement, "un front élargi d'opposition" n'a été aussi élargi puisqu'il va des conservateurs aux sandinistes favorables à la guérilla, qu'il comprend à la fois les milieux d'affaires, l'Église, et tous les amateurs de "respect des droits de 1'homme".
Jamais, non plus, une opposition à un gouvernement en place n'a reçu une telle approbation de tous côtés, et bien au-delà du pays concerné lui-même. En effet, derrière le "front élargi d'opposition", et à des degrés divers, il y a bon nombre de pays d'Amérique Latine qui n'ont pas intérêt à voir se développer une zone "d'instabilité sociale" à leurs frontières : c'est le cas du Venezuela notamment, qui a tout récemment prêté son armée au Costa-Rica pour protéger ses frontières, et qui demande de plus en plus fortement l'aide des USA. La réaction des USA semble encore un peu hésitante mais, elle vise avant tout à installer au Nicaragua, comme ailleurs, un régime capable de garantir un minimum de "paix sociale" pour tenter de "rentabiliser" l'aide qu'il peut lui apporter. Le tout, bien sûr, sous la couverture de "respect des droits de 1'homme".
Et toute l'opposition à Somoza se veut respectueuse des "droits démocratiques" du "peuple nicaraguayen" ; il n'est qu'à entendre les syndicats patronaux eux-mêmes : "l'installation d'un régime démocratique susceptible d'introduire des réformes sociales, politiques et économiques visant à l'amélioration des conditions de vie du peuple du Nicaragua". Voilà le contenu de la lutte du "peuple nicaraguayen", exprimé tout crûment par ceux-là mêmes qui exploitent tous les jours des milliers de travailleurs et d'ouvriers agricoles.
La lutte du "peuple nicaraguayen", c'est donc, avant tout, celle de toutes les fractions de la bourgeoisie qui demandent à pouvoir exploiter en paix les travailleurs, et une aide consistante du bloc. Et en suivant l'étendard de la bourgeoisie, cette lutte ne pouvait avoir qu'une issue : le massacre.
Et ce n'est pas parce que des travailleurs ou des chômeurs en ont été les victimes que cette lutte est notre lutte. Toujours les ouvriers ont fait les frais des règlements de compte entre fractions locales ou nationales de la bourgeoisie : les deux guerres mondiales en sont l'expression la plus criante. Et le massacre au Nicaragua n'est donc rien d'autre qu'un moment de la barbarie.
Notre lutte, si ce n'est pas celle d'un "peuple nicaraguayen", c'est celle de tout un prolétariat qui se bat à l'échelle d'un continent entier, et qui tente de lutter en tant que classe autonome. Bien sûr, dans ce cas, les journaux ne signalent les luttes du prolétariat que par quelques entrefilets. C'est bien là l'expression de cette "liberté de presse" qui n'a rien à envier, du point de vue de l'hypocrisie, au "respect des droits de l'homme" de Carter ; et cette politique est bien celle de toutes les fractions de la bourgeoisie qui s'entendent pour saluer la lutte des "peuples d'Amérique Latine" : comprendre, "il n'y a pas de lutte de classe en Amérique Latine". Et pourtant, cette lutte existe, et depuis plusieurs années. Et celle-ci, c'est notre lutte.
La lutte du prolétariat est notre lutte
Notre lutte, c'est celle des mineurs de Chuquicamata, hier contre Allende, aujourd'hui contre Pinochet. C'est celle des travailleurs péruviens dont nous parlions dans le dernier numéro de RI : 40.000 mineurs en grève pendant 31 jours, demandant 25% d'augmentation de salaires et qui ont repris le travail en ayant tout obtenu, du moins pour un temps : la non-application du décret anti-grève, une loi sur la stabilité de l'emploi, la garantie qu'il n'y aurait pas de représailles. La bourgeoisie péruvienne n'a pu, bien sûr, accorder ces revendications qu'en pensant les récupérer le plus tôt possible
Elle n'a, de toutes façons, pas le choix. Mais la classe ouvrière a donné bien des preuves de sa combativité, elle n'a pas hésité à refuser l'accord préalablement signé entre les syndicats et le patronat au cours de la dernière grève. Elle a tout un passé de luttes : les mineurs de Cobiza en 71, les pêcheurs de Chimbote et les mineurs de Cuamone en 73, les mineurs de Centromin Peru en août74, les métallurgistes en septembre74, les mineurs encore en décembre74, les prolétaires de Lima en février75, ceux d'Arequipa en juillet75, les mineurs, les métallurgistes, les employés des banques et de la presse en janvier 76, A tous ceux qui rechercheraient encore une classe ouvrière au Pérou, la voilà, et la liste de son action est suffisamment parlante.
Notre lutte, c'est aussi celle des métallurgistes de Sao Paulo, au Brésil, en mai78. La grève, commencée par les ouvriers de la métallurgie, s'est poursuivie dans la sidérurgie, les constructions mécaniques, les industries textiles. En mai, finalement, 100.000 ouvriers sont en grève illégale pour des augmentations de salaires. Mais, là encore, le patronat est de plus en plus tenté par les méthodes "occidentales": "les dirigeants d'entreprises" estiment qu'une reconnaissance du droit de grève et l'octroi d'un rôle plus important aux syndicats permettraient de circonscrire des conflits sociaux qui, dans les circonstances actuelles, se transforment en autant de "grèves sauvages" ("Le Monde" du 31 mai). Saluons au passage "Le Monde" pour ces quelques lignes qui en disent long sur son objectivité.
En septembre, le mouvement de grève a repris parmi les employés de banque, les métallurgistes du grand complexe de Joao-Montevade, portant à plus de 150.000 le nombre des grévistes. Mais, il faut croire que le vœu du "Monde" n'a pas été satisfait et que les techniques de mystifications syndicales ne sont pas encore au point au Brésil.
Notre lutte, c'est aussi celle des ouvriers de Renault-Argentine en octobre77 : 23 ouvriers sont encore portés "disparus", 140 ont été licenciés.
C'est aussi celle des enseignants de Colombie, des employés de l'aéroport, des banques, des ouvriers du bâtiment il n'y a pas si longtemps, et tous en lutte pour des augmentations de salaires ou des non-versements de primes.
C'est encore celle des mêmes ouvriers de la sucrerie Aztra à Guayaquil, en Equateur, qui, en octobre77, avaient été si violemment réprimés et qui se sont à nouveau remis en grève le 8 août.
Les faits se suffisent à eux-mêmes : la classe ouvrière existe en Amérique Latine et, bien plus, elle se bat, et pas seulement en suivant les syndicats. La bourgeoisie a bien compris qu'il s'agissait des mêmes luttes que dans les pays dits développés , elle qui a commencé par réprimer d'abord violemment toute grève, à interdire le droit de grève, et qui, maintenant, ne se sert plus seulement de la gauche et des gauchistes pour justifier la répression, mais de plus en plus pour demander des "droits démocratiques".
Elle se bat le plus souvent pour des augmentations de salaires, elle se bat contre l'austérité, le chômage, la misère, pas pour obtenir de quelconques "droits démocratiques". Et les préparatifs de la bourgeoisie à un affrontement plus généralisé n'atténuent en rien la force du prolétariat sur tout un continent.
Elle se bat seule, contre la bourgeoisie toute entière. Sa lutte est notre lutte, son ennemi est le même, il est mondial : c'est la bourgeoisie. Là encore plus qu'ailleurs, le prolétariat n’a plus rien à perdre que ses chaînes.
N.M.
Géographique:
Salut à «ALARME»
- 22 lectures
Récemment a été publiée la revue "Alarme", organe du "Ferment Ouvrier Révolutionnaire"[1]. Cette revue continue en français le travail initié par "Alarma" en espagnol depuis plus de 10 ans. Ce groupe, à travers la personne de son inspirateur G. Munis, est issu d'une scission du trotskysme. Réfugiés au Mexique, des membres de l'ex-section espagnole de la IVème Internationale allaient défendre une position internationaliste pendant la guerre en dénonçant le caractère impérialiste dans les deux camps de ce nouvel holocauste. En s'opposant à la "défense de l‘URSS" des trotskystes, concrétisée par leur participation dans les fronts de résistance, le groupe de Munis rompait de fait avec la IVème Internationale, rupture qui fut officialisée par leur scission en 1948.
C'est grâce à cette scission que le groupe du Mexique put se réapproprier les positions de classe les plus fondamentales : affirmation de la décadence du capitalisme, rejet des luttes de libération nationale, caractérisation de l'URSS, de la Chine, etc., comme capitalistes (cf. "Pour un second Manifeste Communiste) ; dénonciation des syndicats comme organes du capitalisme ("Les syndicats contre la révolution" de Munis et B. Péret). Positions aujourd'hui défendues par le FOR.
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir l'intervention des camarades du "Fomento Obrero Revolucionario" s'élargir avec la publication en français de leur numéro 1 d'"Alarme". Cette parution est un signe que la crise, loin de démoraliser le prolétariat et ses éléments d'avant-garde, est au contraire un terrain favorable où la vieille taupe de la révolution vient creuser avec ardeur. L'existence même d'"Alarme" constitue une preuve vivante que la position défendue par "Alarma" il y a quelques années selon laquelle, comme en 29, la crise générale du capitalisme allait plonger dans la résignation et désespoir le prolétariat, ne s'est heureusement pas vérifiée. Le développement de la lutte de classe à l'échelle internationale depuis 68, même si son cours demeure encore hésitant, traduit le cours historique actuel de la tendance générale à la révolution prolétarienne, comme point d'aboutissement de tout un processus d'explosions ouvrières de plus en plus généralisées. Cette alternative prolétarienne, face à l'autre alternative, celle capitaliste de la guerre généralisée, se traduit par un surgissement d'éléments neufs, qui, au prix d'immenses difficultés, se réapproprient peu à peu, les positions révolutionnaires du passé.
Faire face à ses responsabilités de révolutionnaires dans la classe, faire un travail de clarification théorique, mener une confrontation politique dans le milieu révolutionnaire en vue d'un regroupement des forces que le prolétariat sécrète toujours plus est une tâche immense, qui implique une intervention renforcée, un organe d'intervention. Nous saluons dans "Alarme" cette tentative de concrétiser une intervention politique avec des articles vivants d'actualité (Indochine, Italie, grève des mineurs aux USA, etc.) ou de fond (contre les nationalisations) qui viennent actualiser les positions révolutionnaires.
Nous devons faire ici néanmoins quelques remarques d'ordre théorique, qui, bien entendu, n'épuisent pas une discussion plus systématique avec ces camarades. Plusieurs points, dans la présentation du FOR, nous semblent manquer de clarté :
Il est affirmé qu'"il y a 40 ans s'achevait la contre-révolution", et que l'Espagne en 36-37 fut l'ultime point d'aboutissement de la vague révolutionnaire commencée en 17. Parler de "révolution espagnole", alors que le Front Populaire, la mobilisation sur le front de la guerre civile fut un sommet de la contre-révolution, ouvrant le cours à la guerre impérialiste mondiale, c'est ne pas tirer toutes les leçons de la contre-révolution officialisée par l'adoption par l’IC du "socialisme en un seul pays". La Gauche italienne, a travers "Bilan", a été une des seules en mesure, à l'époque, de dénoncer l'écrasement du prolétariat mondial qui se préparait à travers l'embrigadement dans la "lutte anti-fasciste", puis l'écrasement des ouvriers de Barcelone en 1937. "Alarme" qui affirme que "le bordiguisme en arrive à nier la révolution espagnole du fait de l'absence d'organisation révolutionnaire forte" ne comprend donc toujours pas qu'il n'y ait pas une "révolution espagnole" mais bien une contre-révolution espagnole, expression de la contre-révolution mondiale qui réduisit à néant la magnifique combativité du prolétariat espagnol en juillet 36. Et enfin, pourquoi la prétendue révolution espagnole a été une période non d'organisation du prolétariat en conseils, mais d'atomisation dans les tranchées, non de surgissement d'un parti mais de débandade généralisée dans le milieu révolutionnaire. " "Alarme" ne l'explique pas, ne tente pas de soumettre au crible de la critique, -sans préjugés ni idées reçues-cette vieille position erronée du FOR.
Alors que le "Second Manifeste Communiste" définissait le courant trotskyste comme "réformiste", "Alarme" affirme clairement qu'il est contre-révolutionnaire. C'est un pas en avant incontestable. Mieux vaut tard que jamais, après toute une période où le FOR eut quelques "atomes crochus" vers LO pour laquelle il avait plutôt un "préjugé favorable". Il nous semble cependant que cette dénonciation du trotskysme ne va pas jusqu'à la racine du mal. Affirmer que Trotsky considérait ses positions sur l'URSS comme "provisoires", différencier en quelque sorte les "disciples" du "maître", c'est escamoter purement et simplement la responsabilité du créateur de la IVème Internationale dans la trahison de cette dernière lors de la 2ème guerre mondiale : de la "défense de l'URSS" du "programme de transition" au soutien du camp démocratique "contre le fascisme" dans "Défense du marxisme", au salut enthousiaste de l'arrivée de l'armée rouge en Finlande et dans les pays baltes, Trotsky n'a fait que préparer et couvrir le passage progressif du "trotskysme" à la bourgeoisie. Cette réticence à reconnaître la validité de l'analyse de la Gauche italienne par rapport au trotskysme, cette vague nostalgie de la "section espagnole" de la IVème Internationale, autant de confusions du passé que le FOR actuel arrive encore mal à surmonter.
La caractérisation de la période actuelle manque de clarté. Sommes-nous en période de cours vers la révolution? Ou bien alors de cours vers la guerre ? La présentation du FOR garde là-dessus un silence gênant. Le titre d’"Alarme" donné à l’organe du FOR ne contribue pas à dissiper ce silence : s'agit-il de sonner l'alarme face à une prochaine guerre mondiale? "Alarme" est, pour un groupe révolutionnaire Se développant en période de montée de la lutte de classe, un titre bien... alarmiste.
L'ensemble de ces critiques faites rapidement à la jeune publication en français du FOR, ne sont pas bien entendu des critiques pour la critique.
Elles se veulent un encouragement à une discussion de plus en plus profonde et large, sans sectarisme, au sein du milieu révolutionnaire international, à une confrontation publique et résolue de leurs positions avec d'autres groupes politiques, comme ils ont commencé de le faire.
Que cette confrontation, vitale pour le mouvement révolutionnaire, soit possible, les conférences internationales à Oslo ou à Milan l'ont montré.
[1] "Alarme", C/o -"Parallèles", 47, rue St Honoré, 75001 Paris.
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Courants politiques:
Révolution Internationale n° 55 - novembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 957.29 Ko |
- 616 lectures
Les "droits démocratiques" [droit de l'homme]
- 1139 lectures
ce que cachent les "droits de l’homme" et les "libertés" démocratiques
Jamais, en cette époque de guerres, de massacres, de terreur quotidienne de la bourgeoisie, on n'a autant parlé de "droits de l'homme", de "défense des libertés fondamentales", de "démocratie". Une telle logorrhée dans l'utilisation du mot "démocratie", "droits de l’homme", n’est pas fortuite, l'enflure de la phrase suppléant au vide du contenu. Ve réalité au 19ème siècle, Va démocratie bourgeoise est devenue vide de sens mais lourde de mystifications, dans un monde que le capitalisme terrorise quotidiennement A l’heure où la bourgeoisie se gargarise sans pudeur avec le mot "démocratie", qu’elle accole à "liberté", il s’agit de voir pour le prolétariat quelles sont les racines de la démocratie bourgeoise ; quel est le sens aujourd’hui des "droits démocratiques" demandés par les "dissidents" des pays de l'Est; d'opposer enfin à cette "démocratie", la dictature du prolétariat, la vraie liberté, celle de la majorité opprimée sur l’infime minorité exploiteuse.
mensonge du droit et réalité de l’exploitation capitaliste
• Depuis que le capitalisme a définitivement triomphé au 19ème siècle, ses porte-paroles et idéologues patentés se sont toujours efforcés de le présenter comme le porteur des aspirations de l'humanité, comme le sommet de la "civilisation". Les diverses constitutions qui sont nées de la révolution bourgeoise ont été le produit de cette justification par le droit d'une domination s'érigeant par le fer et par le feu, non seulement sur les ruines de l'ancien système féodal, mais sur le corps des exploités supposant au pouvoir de la nouvelle classe exploiteuse. Dernière classe exploiteuse surgie de la société divisée en classes, la bourgeoisie s'est toujours efforcée de dissimuler la nature de son exploitation et de son oppression des masses laborieuses dans la sphère du droit. La "déclaration des droits de l'homme et du citoyen" de 1789 est le monument érigé autant à ses illusions dans les "lumières" qu'elle croyait donner au monde qu'à sa bonne conscience de minorité exploiteuse, mettant deux ans plus tard hors-la-loi les ouvriers en grève qu'elle privait de ce "droit" (loi de 1791).
Face au socialisme petit-bourgeois, croyant dans les vertus du "progrès" et de la "démocratisation" des libertés bourgeoises étendues aux couches exploitées de la société, le communisme s'est toujours dressé dès ses origines contre le mensonge d'un "droit égal" (liberté, égalité, fraternité) pour tous, montrant que les "droits" proclamés par la bourgeoisie éternels "ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté" (Marx, "la question juive", 1843). En instaurant par le principe de la propriété, l'atomisation de la société en cellules concurrentes, en décrétant la guerre de tous contre tous, le capitalisme ne pouvant définir ses propres "libertés démocratiques" dans la sphère politique (libéralisme) et économique (libre-échangisme) que négativement :
- "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" (Déclaration des Droits de l'Homme").
C'est cette pseudo-liberté, celle d'une minorité exploiteuse et non de la communauté humaine, que Marx devait définir comme "la démocratie de la non-liberté, l'aliénation achevée" ("Critique de l'Etat hégélien", 1842). Le prolétariat, dernière classe exploitée de l'histoire, est l'incarnation de l'homme déshumanisé, transformé en marchandise. Sa "liberté" nouvelle, par rapport aux anciennes classes exploitées (esclaves, serfs), c'est de vendre -sous la contrainte économique- sa force de travail qu'il aliène au capital. Sous les "droits de l'homme" se cachent en fait la déshumanisation de l'homme transformé en marchandise, en simple force de travail exploitable à merci.
Si les droits de l'homme, si chers au aujourd'hui à M. Carter et Amnesty International, ont parrainé la révolution bourgeoise, ils sont vite passés du domaine de la "raison pure" chère au monde bourgeois à celui du pur mensonge : les "droits de l'homme", ce furent les babouvistes tombant sous le couperet de la vraie raison bourgeoise : la guillotine ; ce sont les ouvriers anglais pendus dans les années 1830 pour bris de machines ; ce sont les milliers d'ouvriers parisiens massacrés en juin 1848 par les républicains démocrates ; ce sont les charniers de la Commune ouvrant la voie à la république bourgeoise française la plus "démocratique". Tout au long de son histoire, le capitalisme a montré la vérité de ses principes humanistes dans le sang des prolétaires broyés par ses machines, affamés, fusillés, traqués comme des bêtes par la meute déchai née des agents de l'ordre bourgeois.
Si, dans les "Statuts de l'AIT", il est affirmé, dans le préambule, que l'"émancipation de la classe ouvrière n'est pas une lutte pour des privilèges et des monopoles de classe, mais pour l'établissement de droits et de devoirs égaux, et pour l'abolition de tout régime de classe", il faut entendre ces "droits et devoirs égaux" non comme ceux de l'individu abstrait bourgeois, mais ceux de l'homme concret s'affirmant dans la société sans classes ; le communisme, véritable porteur des intérêts de l'humanité, abolit le règne bourgeois du "droit" inégal et fait surgir celui de la liberté humaine où chaque membre de la communauté n'est pl.us "libre et égal devant la loi" mais responsable vis-à-vis de tous. Face à tous les courants petits-bourgeois proudhoniens et trade-unionistes prédominant dans l'Internationale, prisonniers du langage et des illusions bourgeoises des "droits -et des devoirs de l'humanité", le marxisme affirmait avec force qu'il ne pouvait y avoir de principes abstraits de "liberté, égalité, devoir", et que leur réalisation ne se rattachait pas à l'application de la constitution bourgeoise, mais à l'abolition du régime de classe à la base de celle-ci.
“la conquête de la démocratie" au 19ème siècle
Comment expliquer cependant le combat mené par le mouvement ouvrier du siècle dernier pour la "démocratie" ? Marx lui-même n'accepta-t-il pas en 1847 la vice-présidence de l’"Association démocratique" à Bruxelles ? N'appela-t-il pas la "Nouvelle gazette rhénane" en 1848, l'organe de la démocratie" ?
Derrière toutes ces formulations, il n'y a pas, en fait, d'ambiguïtés sur l'essence de la démocratie, comme forme de la démocratie bourgeoise. Cette "démocratie" avec ses libertés pour la classe dominante, le marxisme la rejette. Lorsque le "Manifeste" parle de "conquête de la démocratie" cela doit s'entendre comme le combat du prolétariat sur la voie de son émancipation. Cette émancipation, à l'époque où le capitalisme est encore ascendant, au point que les conditions objectives -pour la révolution prolétarienne sont encore immatures, passe par la conquête non de "libertés en soi"- derrière lesquelles se cache l'hypocrite liberté de la bourgeoisie de commercer et d'asservir les classes laborieuses- mais des libertés du prolétariat pour s'organiser face au capital. C'est pourquoi le prolétariat se battit dès l'origine pour la liberté de se coaliser en partis politiques et en syndicats ; pour la liberté d'avoir sa propre presse ses propres coopératives pour le suffrage universel afin de faire entendre sa voix au parlement bourgeois ; pour la diminution du temps de travail comme condition à l'obtention d'un temps libre pour sa propre existence comme classe. Autant de libertés que le prolétariat exigeait contre la "liberté" de propriété bourgeoise.
Ce n'est pas sur le terrain du droit que le prolétariat livra bataille pour résister et concentrer toutes ses forces face à la machine impitoyable du capitalisme, mais sur son terrain à lui : celui de la lutte de classe.
Ce n'est pas en s'aplatissant devant la bourgeoisie, en lui demandant humblement par des pétitions qu'elle cède, comme le soutinrent les éléments modérés du chartisme et le théorisèrent les courants proudhonien et lassalien, mais par la force que le prolétariat put s'organiser, éditer sa presse, tenir ses propres meetings. Le flot montant des grèves ouvrières dans les années 1860-70, la bourgeoisie ne put le contenir, son appareil juridique en reconnaissant dans la plupart des pays capitalistes le "droit de grève", "le droit d'association" ne faisait qu'entériner une situation de fait. En dépit de ses lois d'exception, comme celle du gouvernement bismarckien en 1878 contre la social-démocratie allemande, la bourgeoisie ne put empêcher la fondation des partis socialistes ; elle dut en valider l'existence dans les pays où le prolétariat était suffisamment développé pour l'imposer.
La bourgeoisie industrielle, fraction la plus avancée du capitalisme, avait d'ailleurs l'illusion qu'elle pourrait utiliser le prolétariat soit contre la bourgeoisie agraire, soit contre la réactionnaire caste nobiliaire. Le suffrage universel qu'elle généralisa, souvent avec réticence, lui permettait d'avoir une base de masse dans les classes petites-bourgeoises, en vue de mieux asseoir et assurer sa domination de l'Etat en y éliminant les derniers vestiges d'archaïsme féodal.
L'alliance électorale de fait entre le parti libéral anglais et les trade-unions allait dans ce sens aussi et menaçait l'indépendance de classe du prolétariat. Ce fut la tâche du socialisme de fonder des partis ouvriers qui maintinrent pendant longtemps une rigoureuse indépendance de classe face aux partis bourgeois. La gangrène s'instaura quand les courants réformistes entraînèrent ces partis dans la voie des compromissions et des alliances avec la bourgeoisie "démocratique", au nom de la défense de la "démocratie pure". Les trotskystes n'ont rien inventé...
Ces "libertés" que le prolétariat obtint par un rapport de forces favorable et surtout parce que la bourgeoisie ne voyait pas pointer à l'horizon. le spectre de la révolution, le marxisme en a toujours montré le caractère formel et non réel sous le capitalisme. La "démocratie", c'est la participation de la bourgeoisie au gouvernement de son Etat, l'exploitation de la majorité par la minorité. Cette minorité dispose des moyens matériels (police, armée, presse, de maintenir sa propre domination. Le marxisme a lutté de toutes ses forces au siècle dernier contre les courants réformistes qui sacralisaient la "démocratie" et en faisaient le but final du prolétariat par la conquête de l'Etat, quand le but véritable est la destruction de l'Etat et donc de la démocratie comme expression de la société divisée en classes. Le marxisme a enfin montré le vrai sens de cette "démocratie" pour la classe dominante :
- "Prenez les lois fondamentales des Etats contemporains, prenez leur administration, prenez la liberté de réunion de presse, prenez "l'égalité des citoyens devant la loi", et vous verrez à chaque pas l'hypocrisie de la démocratie bourgeoise bien connue de tout ouvrier honnête et conscient. Il n'est point d'Etat, même le plus démocratique qui n'ait dans sa constitution des biais aux restrictions permettant à la bourgeoisie de lancer la troupe contre les ouvriers, de proclamer la loi martiale, etc." (Lénine, "Le renégat Kautsky").
les « droits démocratiques » à l'ère de la décadence
Que cette légalité soit le cadet des soucis de la bourgeoisie, quand elle se trouve confrontée au prolétariat, alors que sa propre domination économique est sapée à la base, la période qui a suivi la première guerre mondiale l'a amplement montré.
L'impérialisme comme phase ultime d'un système en décadence s'est traduit :
- 1. par la militarisation de la lutte sociale en vue de la préparation des guerres impérialistes, avec comme corollaire la prépondérance de l'exécutif sur la démocratie parlementaire, reléguée dans le musée des curiosités bourgeoises au rang d'attractions foraines à usage de mystifications.
- 2. par la fusion entre le capital et l'Etat. La tendance qui s'est affirmée avec toujours plus de force, c'est la tendance au parti unique, ou à la fusion des anciens partis bourgeois dans un même appareil étatique. Tendance concrétisée jusqu'à la caricature dans la majorité des nations capitalistes du tiers-monde aux prétendues démocraties populaires. Désormais, la bourgeoisie s'affirme comme un tout, à travers son Etat. La concentration des différentes fractions du capital (basées sur le profit, la rente foncière) a rendu vide de sens la distinction entre fractions agraires réactionnaires et fractions industrielles progressives, valables au siècle dernier.
- 3. par la fragilité d'un système où chaque bourgeoisie nationale est écartelée en différents intérêts opposés (agriculture, industrie), en différentes orientations économiques (protectionnisme," libéralisme"), en différents secteurs (capital privé et d'Etat), en options internationales divergentes (bloc américain, bloc russe). L'Etat capitaliste est le dernier rempart face à l'effondrement et au déchirement de plus en plus aigu de la société.
Le libéralisme qui était au siècle dernier la forme politique de conciliation entre les intérêts divergents au sein de la classe dominante, s'est transformé en terreur de l'Etat, y compris sur les fractions de la bourgeoisie qui s'opposent à l'intérêt général du capital, sous sa forme étatique L'Etat a absorbé toutes les libertés bourgeoises traditionnelles (presse, pluripartisme, élections, etc.) en ne laissant plus qu'une seule "liberté", celle de l’arbitraire de l'Etat. - 4. par le contrôle absolu et permanent du prolétariat, la "liberté syndicale" signifiant l'encadrement totalitaire à tout moment dans l'usine. Le prolétariat a été privé par la terreur ou par la puissance de récupérations bourgeoises de la possibilité de s'affirmer et de résister dans des organismes permanents, dont l'existence menacerait immédiatement la vie du système par leur contenu révolutionnaire (conseils ouvriers). A l'ère de la décadence capitaliste, la liberté du prolétariat de s'organiser comme classe signifie l'anéantissement révolutionnaire du système. L'Etat totalitaire a absorbé la société civile, qu'il domine dans chacune de ses cellules sociales.
Il s'ensuit que la tactique du prolétariat vis-à-vis de la démocratie bourgeoise a changé du tout au tout. Alors qu'au 19e siècle le prolétariat essayait de s'aménager des places fortes au sein de la société, des forteresses permanentes de résistance aux assauts du capital, la décadence l'a privé de ces lieux de résistance permanents, le mettant hors-la-loi, la bourgeoisie n'étant plus en mesure de faire des concessions durables :
- "La bourgeoisie, comme classe dominante, était en mesure avant la guerre de faire des concessions. Le 19e siècle pris comme un tout peut être considéré comme une époque au cours de laquelle la bourgeoisie faisait des concessions à la classe ouvrière et à des couches spécifiques de celle-ci. C'était des concessions constamment inscrites au bilan de la bourgeoisie, pour autant que son pouvoir, sa domination n'étaient pas ébranlées... avec le début d'une nouvelle époque du capitalisme, dont le cadre est devenu trop étroit pour les forces productives, la bourgeoisie a été privée de la possibilité de faire encore des concessions. La guerre a aiguisé cette situation." (Trotski, Discours au 4e congrès de l'Internationale communiste, 14-11-1922)
Le prolétariat ne peut avoir aujourd'hui, et quelle que soit la forme de la dictature bourgeoise ("démocratie occidentale", "démocratie populaire") qu'un seule but : non la "conquête " ou la "reconquête de la démocratie", mais l'anéantissement du système capitaliste. Exiger les "libertés démocratiques" comme le font les "dissidents " intellectuels des pays de l'Est, voire "les droits de l'homme" dans le système capitaliste qui est la négation même de l'humain, n'est pas simplement utopique mais mystificateur en voilant la nature du régime capitaliste, fût-i1 en apparence le plus "démocratique". Les véritables libertés, celles de s'organiser, de penser, d'agir consciemment, le prolétariat ne pourra les conquérir que par la transformation révolutionnaire de la société, par l'élimination de la société de classes. La phase historique qui permettra au prolétariat de passer du "règne de la nécessité" au "règne de la liberté", c'est non la "démocratie pure" mais la dictature du prolétariat, la seule forme de démocratie qui, pour lui et l'ensemble des exploités, soit réelle et non formelle. C'est ce que nous verrons dans un prochain article.
Ch.
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Révolution Internationale n° 56 - décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 892 Ko |
- 682 lectures
Dictature du prolétariat et démocratie ouvrière
- 882 lectures
• Nous avons vu dans une première partie ce que dissimulaient les droits démocratiques et les droits de l'homme dans la société capitaliste dès son origine et comment la "démocratie" bourgeoise avec la décadence était devenue une pure mystification dissimulant le totalitarisme de l’Etat. Au mensonge de cette "démocratie" frelatée, le marxisme, depuis la Commune de Paris, oppose la dictature du prolétariat, comme phase de transition au socialisme. S’agit-il d’une "dictature" dans le sens usuel du terme ? Cette "dictature" ouvre-t-elle la voie à une société fondée sur la liberté et l'égalité réelles, et non abstraites et mensongères de la bourgeoisie ? Le prolétariat, pour parvenir au "royaume de la liberté" (Engels) utilise-t-il et engendre-t-il une démocratie d'un type nouveau ou la supprime-t-il en établissant un pouvoir totalitaire ? Telles sont les questions que se pose et doit se poser tout ouvrier conscient à l'heure où la bourgeoisie mène une offensive idéologique pour discréditer le socialisme, dénigrer la notion de dictature du prolétariat.
Aujourd'hui, plus de soixante années après la plus grande expérience prolétarienne, la révolution russe, la crise générale du capitalisme remet à l'ordre du jour la nécessité de la dictature du prolétariat. Alors que le prolétariat n'a pas été battu, qu'il a ressurgi sur la scène historique par de vastes mouvements de classe, la crise le pousse à des confrontations de plus en plus violentes avec le pouvoir d'Etat partout dans le monde. L'approfondissement de la lutte de classe, pour autant que le capitalisme ne réussit pas à imposer sa solution : la guerre mondiale, va le conduire à des affrontements décisifs avec la bourgeoisie, dont le point le plus haut ne peut être que le renversement mondial du système d'exploitation et l'instauration de sa dictature comme condition nécessaire du passage au socialisme et à la société sans classes.
Il est donc nécessaire de dégager les caractéristiques de la dictature du prolétariat, en montrant qu'elle n'est pas un "mal nécessaire", mais une condition du passage d'une société gangrenée par les crises, les guerres impérialistes, à une société de véritable liberté.
Plus de cinquante années de contrerévolution ont malheureusement déformé le sens du terme "dictature du prolétariat". Celle-ci, dans l'esprit de beaucoup d'ouvriers et en particulier dans les pays de l'Est, est assimilée au capitalisme d'Etat, à l'omniprésence de l'Etat, avec ses camps, le déploiement gigantesque de sa police, sa répression violente des luttes ouvrières comme en 53 en Allemagne de l'Est, 56 en Hongrie et 70 en Pologne. Alors que la prétendue "dictature du prolétariat" dans les pays de l'Est n'est qu'un mensonge monstrueux pour voiler la réalité de l'exploitation de l'Etat capitaliste, les défenseurs zélés du capitalisme n'ont pas manqué pour pré- tendre que la dictature du prolétariat , dans la conception marxiste, ne mènerai qu'à une "dictature sur le prolétariat" Des mencheviks aux actuels "défenseurs des droits de l'homme", les agents acharnés du capitalisme ne manquent pas pour essayer de décourager le prolétariat de renverser la société bourgeoise çt le persuader que la "démocratie occidentale" est préférable, avec ses "libertés".
Cependant, la mystification de la "démocratie" bourgeoise -pour le grand malheur des Carter et autres "nouveaux philosophes"- ne peut que s'effilocher au fil de la crise. Quel ouvrier sensé croira aujourd'hui dans les vertus de la "démocratie" bourgeoise, quand les fameuses "libertés " qui font tant pleur er dans les chaumières signifient : "liberté" d'être au chômage, "liberté " de se faire tuer dans les guerres impérialistes, "liberté " de crever tous les jours à petit feu avec une exploitation toujours plus féroce.
La crise du capitalisme remet donc à ordre du jour la nécessité du socialisme, celle d'en finir avec un système qui n'arrête pas quotidiennement de s'enfoncer dans la barbarie qu'il sécrète.
Pourquoi parler de «dictature» ?
La notion de "dictature", dans le sens non du totalitarisme de l'Etat capitaliste décadent, mais de l'exercice du pouvoir par la classe révolutionnaire historiquement progressiste, dérive des révolutions bourgeoises. Pour établir sa domination économique, la bourgeoisie devrait dominer politiquement le reste de la société à travers l'Etat qu'elle conquérait, par la mise hors la-loi de la classe féodale. Cest par la violence, la terreur généralisée,que les Cromwell, les jacobins, affirmaient la domination de leur classe. Cette terreur s'appliquait sur l'ensemble des couches sociales, aussi bien les classes exploitées (artisans, ouvriers) que sur les fractions indécises de la bourgeoisie prêtes à transiger avec la classe féodale. Mais cette terreur était momentanée pour la bourgeoisie qui n'aspirait qu'à respirer l'air du libéralisme politique, l'air serein de la "démocratie". Cette "démocratie " pour la bourgeoisie ne mettait pas fin néanmoins à la terreur sur la classe exploitée prolétarienne. La dictature est le mode de vie même du capitalisme, fût-il le plus "démocratique", le plus riche en "libertés juridiques" qui soit.
Est-ce à dire que le prolétariat, lorsqu'il prendra le pouvoir, devra établir sa domination de classe sans dictature sur la classe exploiteuse ? L'expérience même montre qu'il est impossible au prolétariat de réaliser son but : le socialisme, sans employer la violence organisée, sans briser la résistance d'une bourgeoisie qui préfère voir le monde s'ensanglanter en entraînant toute l'humanité avec elle, plutôt que d'abandonner le système qui l'a engendré. Contre l'illusion criminelle des anarchistes qui affirment que le prolétariat n'a pas à utiliser la coercition sur les classes exploiteuses, mais doit généreusement garantir la liberté de chacun, de chaque individu, le marxisme affirme que la question de la liberté ne se pose pas en termes d'individus, mais de classes sociales absolument antagoniques.
- "Ces messieurs ont-ils jamais vu une révolution ? Une révolution est à coup sûr la chose la plus autoritaire qui soit. C'est un acte par lequel une part i e de la population impose à l'autre partie sa volonté à coups de fusils, de baïonnettes et de canons -moyens autoritaires s'il est fut. Force en est au parti vainqueur de maintenir sa domination par la crainte que ses armes inspirent aux réactionnaires. Est-ce que la Commune de Paris aurait pu se maintenir plus d'un jour si elle ne s'était servie de l'autorité d'un peuple en armes contre la bourgeoisie ? Ne pouvons-nous pas, au contraire, la blâmer d'avoir fait trop peu usage de cette autorité ?" (Engels, "De l'autorité")
Ainsi la domination du prolétariat n'implique pas la "liberté pour tous", drapeau derrière lequel se cache la bourgeoisie. A la différence de celle - ci qui dissimule toujours hypocritement sa dictature féroce derrière "l'intérêt général", "Tordre social", "les libertés fondamentales", le prolétariat n'a pas peur d'affirmer sans détours la nécessité de la violence pour briser le carcan capitaliste qui enserre la société, de l'appliquer farouchement et ouvertement contre les forces de la contre-révolution.
Dictature du prolétariat=terreur ?
Cependant le prolétariat, tout en employant la violence contre la classe ennemie, n'établit pas son pouvoir de classe en se nourrissant de la chair des vaincus, comme le dieu Moloch de la Bible. Le culte de la "violence en soi", de la violence pour la violence, est une pratique absolument étrangère au prolétariat. Il est de l'essence même du capitalisme de reposer sur des rapports de violence, qui finissent par dominer l'ensemble de la société, pour culminer dans la terreur permanente incarnée par l'Etat. Les soixante dernières années avec leurs sinistre s massacres de millions d'hommes, l'anéantissement de populations entières, la torture institutionnalisée donnent une image exacte de la finalité du capitalisme décadent : l'anéantissement de l'humanité.
Le prolétariat a pour finalité non la conservation, mais la destruction de la barbarie. Classe exploitée, il ne peut avoir pour moteur de son activité révolutionnaire que son but : la suppression de toute exploitation. En détruisant le capitalisme, le prolétariat supprime non seulement son exploitation, mais celle de l'humanité entière. Pour tenter d'opposer le prolétariat au reste des exploités, les idéologues bourgeois et petits-bourgeois ne manquent jamais d'affirmer que "au fond les ouvriers voudraient être patrons", et que "de toutes façons, il faudra toujours des patrons". Pour la bourgeoisie, il est inconcevable qu'il puisse exister un autre système que le sien, fondé non sur l'exploitation, mais sur l’émancipation de toute l'humanité de la société de classes.
Lorsque le prolétariat est amené à utiliser la violence pour enlever toute capacité de résistance à la classe bourgeoise, c'est non pour exercer une terreur sans fin sur cette classe, mais pour mettre fin à la longue nuit de la préhistoire humaine où "l'histoire" des classes exploiteuses s'est transcrit e sur des annales souillées du sang et de la boue de leur système. La dictature du prolétariat n'est pas le renforcement, le développement de la terreur. Cette idée, développée par Staline dans les années 20 que la "dictature du prolétariat" se renforcerai t au fur et à mesure qu'on se rapprocherait du socialisme est la théorisation de la terreur stalinienne dirigée contre le prolétariat. Au contraire, la phase de "dictature" pour briser la contre-révolution bourgeoise est transitoire. Son but n'est pas de se perpétuer, mais de disparaître pour laisser place au socialisme. C'est pourquoi, si la phase de dictature du prolétariat signifie la plus grande fermeté et vigilance vis-à-vis de la bourgeoisie prête à un bain de sang monstrueux, elle n'est pas une "dictature" dans le sens classique du terme que lui a donné la bourgeoisie. Le prolétariat n'est pas une classe assoiffée de sang, le "couteau entre les dents", propre visage de la bourgeoisie que celle-ci projette sur lui pour les besoins de sa propagande vis à vis des Représentant les intérêts de l'humanité sortant du cauchemar de la société de classes, il n'aspire pas à détruire, et se refuse à utilise r les méthodes d'avilissement et d'extermination caractéristiques de la bourgeoisie. Son but, c'est de CONSTRUIRE la société de l'homme, le communisme.
Le communisme, dont le prolétariat porte le germe, est donc aux antipodes du totalitarisme actuel, où Etat et terreur s'identifient. Le marxisme ne peut que rejeter l'assertion selon laquelle la dictature du prolétariat serait "l'instauration de la société mono-classiste, mono-parti et ouvertement totalitaire du prolétariat dirigée par le parti de classe" (Le Prolétaire, N°276). A ces apologistes de la dictature totalitaire d'un parti, on ne peut que répondre, comme le faisait Engels à partir de l'expérience de la Commune : "Regardez donc la Commune de Paris". Regardez donc la révolution russe ! La dictature du prolétariat, c'était au début, non la dictature d'un parti unique, mais celle des conseils ouvriers, "forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" (Lénine). Totalitaire, une révolution qui pendant son existence, fut l'œuvre de millions d’ouvriers qui établirent leur pouvoir non en développant, mais en détruisant l'Etat tzariste totalitaire ? Y avait-il donc un seul parti ouvrier dans les conseils en 1917 ? Dictature d'un parti, le gouvernement des commissaires du peuple, désigné par les conseils ? L'expérience concrète d'octobre 17 est un clair démenti à une telle vision où la fière devise de Marx "l'émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle-même" est remplacée par "la dictature du parti sera l'œuvre totalitaire du mono-classiste mono-parti".
Le contenu véritable de la dictature du prolétariat, de la révolution russe, c'est la démocratie pour les masses ouvrières et travailleuses. C'est ce que nous verrons dans un prochain article.
Ch.
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Réponse au «F.O.R.» (I)
- 6 lectures
Dans le n°54 de notre journal (octobre 78), nous avons salué la parution du 1er numéro d'une nouvelle publication révolutionnaire, "Alarme", organe du "Ferment Ouvrier Révolutionnaire", équivalent français du groupe espagnol "Fomento Obrero Revolucionario". À cette occasion nous avons rappelé les principales critiques que nous faisions aux positions politiques du FOR. À la suite de cet article, nous avons reçu une lettre du FOR répondant à nos critiques et qui annonce : "Nous ne ferons pas paraitre cette présente lettre dans notre journal car, pour le moment, nous ne voulons pas y, faire entrer de polémiques entre groupes".
Nous ne comprenons pas pour quelles raisons les camarades du FOR se refusent à une confrontation publique de nos positions respectives. Pour notre part, nous estimons de peu d'intérêt un débat politique confidentiel entre organisations révolutionnaires : les questions qui y sont agitées n'intéressent pas seulement un petit nombre de spécialistes (c'est là le schéma qui prévaut dans la société bourgeoise) mais bien l'ensemble de la classe ouvrière. C'est pour cela que nous publions ici la première partie de la lettre du FOR et la réponse que nous apportons aux arguments qui y figurent ; la seconde partie de la lettre et la réponse correspondante figureront, pour des raisons de place, dans notre prochain numéro[1].
---------------------------------------
Chers camarades,
Nous voulons tout d'abord vous dire que nous vous savons gré de votre "SALUT A ALARME". Nous avons trouvé cela sympathique et vous êtes les seuls jusqu'à présent à l'avoir fait. Cependant, nous avons tenu à vous adresser une réponse exposant notre propre point de vue sur les divergences entre nos deux groupes que vous avez soulignées dans votre salutation.
SALUT A REVOLUTION INTERNATIONALE
Cela fait maintenant une dizaine d'années naissait le CCI, pur produit de la fameuse "crise de surproduction" qui sévit actuellement dans nos contrées. Nous profitons donc de l'existence de cette "crise" pour correspondre avec le groupe Révolution Internationale qui sans ce "facteur positif" de la révolution se serait retiré tel Mahomet dans la montagne pour y méditer et conserver au plus haut la conscience communiste en attendant de reparaître avec une nouvelle crise.
Vous dites que la parution d'Alarme "est un signe de la crise". Sachez d'abord que lorsque nous nous sommes créés en tant que groupe, nous ne nous sommes pas posé la question de savoir si nous devions agir révolutionnairement parce qu'il y avait crise ou non, ni même parce qu'il y avait agitation sociale ou non. Être révolutionnaire, c'est ressentir profondément le besoin d'agir révolutionnaire- ment quel que soit le moment en tenant compte uniquement des particularités que prend l'activité et l'intervention communiste suivant la situation existante. Être révolutionnaire, c'est initialement une simple question de sentiment : sentir la pourriture et vouloir lutter contre elle. Le FOR s'est créé en 1959, c’est-à-dire en dehors, selon vos propres positions, de toute crise (et il ne s'est pas contenté de conserver au plus haut la conscience communiste). Le FOR, groupe français, aurait très bien pu lui aussi se créer en dehors de toute crise (toujours selon vos propres critères car nous considérons qu’il s'est en effet créé en dehors de toute crise mais ceci est un point de peu d'importance que nous aborderons plus loin) ; pour cela, il eut fallu (et il a fallu) uniquement des individus révolutionnaires, exactement ce que la création du FOR en 59 a requis. Expliquer l’existence ou l'inexistence, la force ou la faiblesse de ou des organisations révolutionnaires par l'état de la lutte de classe et expliquer ce dernier par l'état économique momentané dans lequel se trouve le capitalisme n’est pas notre démarche. Nous n'attachons pas une grande importance à la question de la crise et en général à l'état économique momentané dans lequel se trouve le système capitaliste car notre travail de révolutionnaires doit se faire à n'importe quelle époque, suivant nos possibilités et suivant les caractéristiques des différentes époques. Que les gens soient des marchandises, ils le sont qu’il y ait crise ou pas crise ; mais vous prétendez que, lorsque quelqu'un a le ventre vide, il y a plus de chances qu'il veuille faire la révolution que s'il est gras et replet. Ne pensez-vous pas qu'un individu qui a le ventre vide pense plutôt à le remplir et non pas tant à révolutionner le monde ? Un état de crise économique peut provoquer sans nul doute une certaine agitation sociale. Cependant, ne nous abusons pas sur l'agitation qui peut surgir en réponse à un état de crise, c'est- à-dire en réponse à un état particulier du système capitaliste, et non en opposition directe avec le capitalisme quel que soit l’état économique dans lequel il se trouve momentanément plongé. Nous avons ici parlé d'un état de crise, c'est-à- dire de crise dite de surproduction, mais cela vaut également pour la récession présente. En effet, présentement, il n'y a pas crise de surproduction ce- qui se marquerait par une dépression, par une baisse des prix suivant la loi de l'offre et de la demande et également par un nombre de chômeurs nettement supérieur à celui atteint à ce jour. Avant chaque crise, il y a récession, mais après chaque récession il n'y a pas obligatoirement crise.
Par ailleurs il serait aberrant de nier qu'une révolution peut éclater en pleine croissance capitaliste et ne pourrait aboutir qu'à refuser de reconnaître des perspectives réelles de révolution si elles se présentaient au moment justement où économiquement le capitalisme est en bonne santé. »
--------------------------------------
Chers camarades,
C'est avec beaucoup de clarté que votre lettre exprime ce que nous pensons être une des incompréhensions fondamentales du FOR : le mépris des facteurs objectifs dans l'analyse du développement de la lutte de classe et de l'organisation des révolutionnaires.
Vous écrivez : "lorsque nous nous sommes créés en tant que groupe, nous ne nous sommes pas posé la question de savoir si nous devions agir révolutionnairement parce qu'il y avait crise ou non, ni même parce qu'il y avait agitation sociale ou non". Que vous ne vous soyez pas posé la question vous, individus, nous n'en doutons pas. Et nous vous approuvons. Effectivement, comme le dit la plate-forme de notre organisation : "L'effort de prise de conscience de la classe existe constamment depuis ses origines et existera jusqu'à sa disparition dans la société communiste.
C'est en ce sens qu'il existe, en toutes périodes, des minorités révolutionnaires comme expression de cet effort constant" (Revue Internationale du CCI n°5 p. 22).
Ainsi, et contrairement à ce que vous semblez croire, nous ne défendons pas l'idée qu'il n'y ait de place pour l'activité des révolutionnaires qu'aux moments de crise aiguë ou d'intense lutte de classe.
Tout au contraire, notre courant a toujours dénoncé une telle position. Nous pensons que, même dans les périodes de recul, ou de creux de la lutte de classe, les révolutionnaires ont une fonction. "Leur tâche essentielle consiste alors, en tirant les leçons des expériences antérieures, à préparer le cadre théorique et programmatique du futur parti prolétarien qui devra nécessairement ressurgir dans la prochaine montée de la lutte de classe"(plateforme du CCI). C'est pour cela que, lorsqu'un individu se hisse à une conscience révolutionnaire, il n'attendra pas, pour agir, que la crise ou la révolution soient là.
Vous écrivez encore : "Être révolutionnaire, c'est initialement une simple question de sentiment : sentir la pourriture et vouloir lutter contre elle". Certes, la condition nécessaire pour être un révolutionnaire, c'est d'être un révolté, mais ce n'est nullement une condition suffisante : en effet, peut-on sérieusement dire que les quelques centaines de révolutionnaires (c'est-à-dire membres d'organisations au programme révolutionnaire) existant aujourd'hui dans le monde sont les seuls êtres humains qui soient révoltés contre l'ordre existant ? Certainement pas !
S'il suffit de "sentir la pourriture et vouloir lutter contre elle" pour être révolutionnaire, alors même les fascistes sont révolutionnaires.(ce qu'ils prétendent d'ailleurs quelques fois !)
Être révolutionnaire, c'est participer consciemment et activement à un mouvement qui tend à révolutionner .la société.
Et comme aujourd'hui le seul mouvement qui puisse le faire est la lutte historique de la classe ouvrière contre le capitalisme, "est révolutionnaire celui qui participe à cette lutte en y mettant en avant les buts généraux et finaux du mouvement" (Manifeste Communiste). Contrairement à la conception policière de la bourgeoisie, pour laquelle c'est l'action de "meneurs" qui rend la classe ouvrière révolutionnaire, "il existe des révolutionnaires parce qu'il existe une classe au devenir révolutionnaire" (Plate-forme du CCI). Et cette idée n'est pas une invention du CCI, qu'il aurait mise au point lors de sa "retraite dans la montagne". C’est la même idée qui figure déjà dans le "Manifeste Communiste" dont, à notre connaissance, le FOR se réclame encore : "Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne font qu' exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d'une lutte de classe qui existe, d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux."
En d'autres termes, les communistes ne sont pas le produit d'eux-mêmes, leurs idées ne sont pas le produit de leur révolte. Ils sont fondamentalement une sécrétion de la classe ouvrière dans son processus de prise de conscience d'elle-même, des buts et des moyens de son mouvement historique.
De ce fait, l'apparition, le développement et l'impact des groupes communistes dépendent étroitement des conditions générales de la lutte de classe, de la combativité et du niveau d'ensemble de conscience de celle-ci et donc du rapport de forces entre elle et la bourgeoisie. Est-ce par hasard que le mouvement communiste a dégénéré, s'est disloqué, que les groupes qui ont tenté d'en préserver les principes se sont amenuisés, sclérosés, et ont souvent disparu au cours de la terrible contre- révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière mondiale à partir des années 1920? Est-ce par hasard que depuis 1968, avec la reprise historique des luttes, il soit apparu un nombre important de nouveaux groupes révolutionnaires dans un grand nombre de pays, que ceux qui existaient déjà se soient développés, aient augmenté leur impact, la diffusion et l'importance de leur presse ? Nous ne nions pas que des facteurs autres que la situation d'ensemble de la société et de la lutte de classe puissent jouer dans l'apparition d'un groupe politique. Par exemple, l'action de quelques éléments issus d'un groupe antérieur est souvent décisive dans l'origine ou la constitution formelle d'une organisation communiste. Mais, de la même façon qu'une graine ne donnera jamais une plante si elle est semée sur un sol stérile, un noyau communiste ne peut se développer s'il ne trouve autour de lui des conditions propices à un tel développement. Si, pour fonder un groupe révolutionnaire, il faut "uniquement des individus révolutionnaires, encore faut-il se demander pourquoi de tels individus apparaissent à tel moment et non à tel autre?
Vous écrivez : "Expliquer l'existence ou l'inexistence, la force ou la faiblesse de ou des organisations révolutionnaires par l'état de la lutte de classe et expliquer ce dernier par l'état économique momentané dans lequel se trouve le capitalisme n'est pas notre démarche". Et c'est bien ce que nous critiquons. Nous ne prétendons pas que ce soient les seules déterminations, mais ce sont bien les déterminations essentielles et il nous semble que c'est là la démarche du marxisme dont pourtant vous vous réclamez. De fait, vous attribuez au circonstanciel -votre démarche individuelle- la place fondamentale dans l'apparition et le développement d'un groupe politique comme le vôtre, alors que l'essentiel -les déterminations sociales et économiques, la nécessité historique- est niée purement et simplement. Vous partez de l'idée juste, mais partielle, que pour être révolutionnaire il faut être révolté, pour aboutir à la conclusion apparemment logique mais parfaitement fausse que la cause de l'émergence des organisations politiques de la classe est le produit de la seule volonté d'individus révoltés.
Dans ce dernier passage, non seulement vous exprimez avec clarté votre désaccord avec le marxisme en ce qui concerne les causes de l'apparition des éléments et groupements communistes dans la classe, mais également en ce qui concerne les conditions du développement de la lutte de classe et de la révolution prolétarienne. Sur cette question, il peut être utile de rappeler quelques bases du matérialisme historique :
"l'économie est le squelette de la société" (Marx) ;
"à un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants (...) Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale"[2] (Marx) (2)
"du fait de la prospérité générale, au cours de laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent avec toute la luxuriance possible dans les rapports sociaux bourgeois il ne peut être question de véritable révolution. Celle-ci n'est possible qu'aux périodes où ces deux facteurs, les forces productives modernes et les formes bourgeoises de la production f entrent en conflit l'un avec l'autre... (c'est ainsi que Marx et Engels ont toujours caractérisé la crise). Une nouvelle révolution ne sera possible qu'à la suite d'une nouvelle crise…"[3]. (Marx).
Nous pourrions multiplier les citations des théoriciens du marxisme ; toutes vont dans le même sens : bien que la lutte de classe existe à chaque moment de la vie de la société capitaliste, le développement et l'approfondissement de celle-ci, sa capacité à menacer réellement la classe régnante, n'est possible qu'avec l'aggravation des conditions économiques de la classe exploitée, qu'avec l'existence d'une crise profonde au sein même des institutions du capitalisme, idéologiques, politiques, et en premier lieu, évidemment, dans*la fondation réelle de la société, sur laquelle s'élève l'édifice juridique et politique" (Marx) : l'économie.
Vous appliquez à l'étude des causes de la révolution les mêmes critères qu'à celle des causes du surgissement d'organisations communistes : pour vous, c'est une question "d'individus". Vous posez la question : "Ne pensez-vous pas qu'un individu qui a le ventre vide pense plutôt à le remplir et non pas tant à révolutionner le monde?". Ce que vous semblez oublier, c'est que lorsque cet "individu" est un prolétaire, il appartient à une classe sociale qui a des intérêts collectifs donnés qui ne sont pas la simple somme des intérêts "individuels" des membres qui la composent : c'est pour cela que le marxisme ne pose pas comme l'idéologie bourgeoise que "l'histoire est l'histoire de la lutte des individus" mais bien que "l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes" (Manifeste Communiste).
Comme membre d'une classe que des conditions objectives poussent à agir dans telle ou telle direction, le prolétaire n'agit plus et ne pense plus comme un être individuel et isolé . Quand le prolétariat agit pour lui-même, comme classe, pour "remplir le ventre" de ceux qui le composent, il tend à s'opposer de plus en plus violemment au capitalisme dont l'intérêt est justement de le remplir le moins possible, quels que soient les oripeaux dont il se pare. C'est vrai que dans certaines conditions historiques, notamment lors de la crise de 1929, une aggravation des conditions de vie des ouvriers a finalement débouché sur une plus grande soumission au capitalisme (notamment sous ses formes staliniennes et fascistes), mais il s'agissait là de périodes où le prolétariat était déjà battu, où son unité avait été brisée, où il était justement atomisé, réduit à une simple somme d'individus prolétaires "au ventre vide". Mais l'histoire ne connait pas d'exemple de révolution dans une période de pleine prospérité : 1789 fait suite à une crise économique majeure; la révolution de 1848 est provoquée par la crise commerciale de 1847; c'est parce qu'ils ont “le ventre vide" et qu'ils sont précipités dans le chômage que les ouvriers parisiens se révoltent en juin 1848, ce sont les terribles privations conséquences de la guerre, qui conduisent les ouvriers parisiens à l'insurrection de mars 1871, les ouvriers russes aux révolutions de 1905 et 1917, les ouvriers allemands à la révolution de 1918-19.
Ainsi, qu’elles s'appliquent aux causes des révolutions comme aux causes du surgissement des courants révolutionnaires, les analyses du FOR font preuve d'un égal mépris pour l'expérience historique. Que la Ligue des Communistes et les trois Internationales se soient fondées au moment d'une montée de la lutte de classe, elle-même résultant d'une aggravation des conditions de vie des travailleurs n'est pas fait pour impressionner le FOR : si l'histoire n'entre pas dans ses schémas, ce n'est pas qu'ils sont faux, c'est l'histoire qui s'est trompée! De la même façon, parce qu'il pense que la crise est un obstacle à la révolution et qu'il espère que celle-ci aura quand même lieu bientôt, le FOR décrète qu'aujourd’hui il n'y a pas de crise[4] ce n'est pas plus compliqué, mais malheureusement, une telle démarche ne prépare pas beaucoup cette organisation à comprendre le système qu'elle combat et donc à accomplir sa tâche de contribuer à la prise de conscience de la classe ouvrière.
[1] Les camarades du FOR, dans une lettre ultérieure, nous font part de leur opposition à une publication en plusieurs fois de leur lettre. Si nous n'accédons pas à leur demande, ce n'est nullement que nous voulions envenimer les rapports entre nos deux organisations mais bien pour des raisons techniques et parce que nous pensons qu'une telle séparation entre deux parties qui sont bien distinctes dans la lettre n'est pas de nature à altérer le contenu de l'ensemble de celle-ci.
[2] Avant-propos à la "Critique de l'économie politique".
[3] "Les luttes de classe en France, 1848-1852".
[4] Sur la réalité et l'interprétation de la crise actuelle, nous renvoyons le FOR et les lecteurs aux nombreux articles que nous avons consacrés à ce sujet.
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Courants politiques:
- "Alarma", F.O.R. [113]
Rubrique:
Révolution Internationale - 1979
- 765 lectures
Révolution Internationale N°57 - janvier
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 326.96 Ko |
- 579 lectures
La démocratie ouvrière : pratique du prolétariat
- 22 lectures
Leur démocratie
Avant de définir la "démocratie ouvrière", d'expliquer pourquoi nous utilisons un tel terme, que les trotskystes en particulier ont totalement dénaturé, nous devons montrer quelle forme de démocratie le prolétariat doit rejeter, s'il veut véritablement renverser la société de classes. Pour cela, on doit balayer un certain nombre de confusions qui se sont tissées autour du mot "démocratie". Lorsque nous parlons de "démocratie", nous ne parlons jamais de la "démocratie" en soi, mais d'une forme de pouvoir, de dictature de classe, ou bien de la bourgeoisie, ou bien du prolétariat.
1) Rejet de la "DÉMOCRATIE" Bourgeoise
Le marxisme, même lorsqu'il parle de "conquête de la démocratie", dans le Manifeste Communiste, a précisé ce qu'il entendait par là : certes, conquête de libertés (réformes, droits de grève et de coalition) dans le cadre de la démocratie bourgeoise du 19ème siècle, encore réelle avant sa décadence au 20ème siècle, mais surtout conquête du pouvoir politique par et pour le prolétariat. Il y avait alors un programme minimum (lutte pour des réformes ouvrières, des libertés réelles de presse et de réunion) et un programme maximum (conquête du pouvoir politique, c'est-à-dire dictature du prolétariat). Abandonnant la lutte pour le socialisme, le révisionnisme (Bernstein, Jaurès, social-démocrates de la IIème Internationale) ont fait du rafistolage de la "démocratie" bourgeoise leur drapeau. "Conquête de la démocratie" s'est transformée dans leur bouche en abandon de la dictature du prolétariat. "Améliorer", mais non détruire l' État bourgeois, dont ils fétichisèrent le parlementarisme ! Collaboration de classes, et non lutte de classe, tel était pour eux le sens de cette "conquête de la démocratie".
C'est pourquoi leur drapeau fut la "démocratie en soi "ou la "démocratie du peuple tout entier", "démocratie" où, bien entendu, devaient coexister pacifiquement prolétariat et bourgeoisie.
Cette démocratie-là, avec son parlement, ses prisons, son armée, sa police, ses camps de concentration, sa terreur et la privation de toute véritable liberté politique pour les classes laborieuses, le prolétariat la rejette totalement, et affirme la nécessité de la briser, de la détruire de fond en comble, car elle est la forme même de la dictature bourgeoise.
2) Rejet de la démocratie formelle
La dictature du prolétariat, si elle ne peut se traduire par la terreur -comme nous l'avons vu dans un précédent article- ne signifie pas "démocratie" pour la bourgeoisie. Celle-ci se voit -comme classe- privée de tout droit et de toute liberté politique : la bourgeoisie est privée du "droit" de participer au nouveau pouvoir, privée de sa "liberté" de propriété, sa "liberté" d'exploiter les ouvriers. Il n'y a pas d'égalité entre prolétariat et bourgeoisie. La dictature du prolétariat implique le rejet de la mystification "liberté pour tous".
Si la prise du pouvoir par le prolétariat se manifeste par "l'égalité véritable et la démocratie réelle pour les travailleurs, les ouvriers et les paysans" (Lénine : "Thèses et rapport sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat", 1919), cela n'implique pas l'égalité politique entre les classes, exploitées et la classe ouvrière. Bien que s'appuyant sur celles-là contre la bourgeoisie, elle doit préserver rigoureusement son indépendance de classe ; liberté politique pour tous les exploités (droit de réunion, participation aux soviets) n'implique pas égalité politique absolue. Le prolétariat, à la différence de l'ancienne social-démocratie ou des trotskystes actuels respectueux de la "loi du nombre" (majorité numérique) dénie à toute autre classe la possibilité de s’organiser comme classe, sur le terrain politique[1]. Le pouvoir des conseils ouvriers, en octobre 1917, a affirmé clairement qu'une voix d'ouvrier dans les soviets valait au moins cinq fois plus que celle d'un paysan. Si l'on définit, au sens étymologique, le terme "démocratie" par "pouvoir du peuple", la dictature ouvrière n'est pas "démocratique" : c'est la dictature d'une classe qui monopolise le pouvoir bien que les paysans et les membres des couches exploitées participent aux soviets. Le mécanisme même de la démocratie que la minorité doit se plier à la majorité, abdiquer ses propres intérêts devant la "loi de la majorité numérique", le prolétariat le rejette. Classe minoritaire dans la société à l'échelle du globe (quelques centaines de millions d'ouvriers sur 4 milliards d'hommes), sous peine de voir son pouvoir dégénérer, doit préserver ses intérêts de classe, qui, bien que coïncidant avec ceux de tous les exploités face à la barbarie capitaliste, ne s'identifient pas à ceux des classes exploitées liées à la propriété privée (paysans, artisans, etc.). La condition du socialisme, c'est que le prolétariat reste la classe politiquement dominante. Se lier les mains par le respect fétichiste de la démocratie formelle, ce serait abdiquer son pouvoir de classe.
Pourquoi la “démocratie ouvrière”?
Les bordiguistes, à la suite de la Gauche Communiste, rejetant clairement et la "démocratie" bourgeoise et la démocratie formelle, ont cru en tirer la conclusion que la révolution prolétarienne serait "antidémocratique" ou ne serait pas. Pour cela, ils s'appuient généralement sur Engels qui affirmait que le socialisme se traduit par "la suppression de tout État, et, par conséquent, de la démocratie". Si l'on entend par "démocratie" la FORME que prend le pouvoir prolétarien, une dictature de classe dans une société où l' État subsiste, où les exploités participent à cet État au travers des soviets, qui sont l'organe d'un tel pouvoir, c'est tout-à-fait juste. La disparition des classes, et donc de l' État qui exprime cette division en classes, c'est l'abolition de tout pouvoir de classes, et donc, de la "démocratie". Malheureusement, tel n'est pas le but des croisés de l'"antidémocratisme". Lorsqu'ils définissent la dictature du prolétariat comme totalitaire, renforçant la violence de l' État, ils nient le but du socialisme : l'abolition de tout pouvoir, de tout État.
Il faut en finir avec ces jongleries sur le mot "démocratie" ; laissons aux juristes et aux philosophes le soin de définir l'essence invariante, éternelle du mot "démocratie". Pour nous, marxistes, la "démocratie" que nous voulons, n'est pas un mot, une simple FORME. La "démocratie ouvrière", c'est un CONTENU, une PRATIQUE DE CLASSE, UN BUT : le socialisme, l'émancipation du prolétariat et de l'humanité qui se traduisent par une égalité réelle, une liberté sans précédent pour le prolétariat et les exploités, non limitées mais en développement constant, au fur et à mesure que dépérissent les rapports de production capitalistes.
Il faut en finir aussi avec les conceptions phénoménologiques des anarchistes et des conseil listes, dont la myopie politique ne leur laisse entrevoir de la "démocratie ouvrière" que son mécanisme interne, sa forme, son fonctionnement. Ils ne veulent voir dans la "démocratie ouvrière" que les décisions prises à la majorité, le vote libre de toute contrainte exercée par la bourgeoisie. Ils ne voient pas que l'important, ce n'est pas le mécanisme du vote, mais la pratique réelle du prolétariat : que les positions révolutionnaires de la minorité deviennent celles de la majorité des conseils, emportent l'adhésion de toute la majorité exploitée dans la société.
Inversement, cette pratique du prolétariat qui devient une classe consciente, se libérant de l'idéologie bourgeoise, est un refus de toute contrainte, de toute violence au sein du prolétariat. Le prolétariat ne peut se libérer du joug du capitalisme en se privant de sa propre liberté de mouvement, de discussion, de décision. Le prolétariat progresse à travers ses erreurs, ses hésitations, qu'il tend sans cesse à dépasser. Une minorité révolutionnaire ne saurait suppléer cet indispensable effort du prolétariat de se libérer par ses propres forces. Pour être efficace, emporter l'adhésion de la masse des ouvriers, lui montrer la nécessité de prendre le pouvoir, lui montrer la solution juste quand se multiplient les obstacles, la minorité doit CONVAINCRE la majorité. Inversement, quand une minorité de la classe reste soumise aux préjugés petits-bourgeois, la majorité révolutionnaire n’use pas de sa force numérique pour l'écraser. Elle cherche patiemment à emporter l'adhésion. Pour cela, il faut la liberté de discussion, de délibération la plus totale dans les conseils. La classe ouvrière n'est pas une classe homogène qui décide comme un seul homme la Révolution, marche d'un pas égal vers le communisme. Il y a le poids de l'idéologie bourgeoise, dont le prolétariat se dégage à grand peine ; il y a le poids des éléments arriérés du prolétariat dans les conseils territoriaux ; il y a enfin le poids des paysans et des petits bourgeois avec leurs préjugés de classe. Cette lutte de tous les instants, sans violence ni contrainte, contre les préjugés, par la persuasion, la conviction que donne l'expérience révolutionnaire, c'est la démocratie ouvrière, une liberté nouvelle qui s'impose par la liberté de sa pratique.
S'il était possible d'arriver au socialisme, en l'imposant par la violence au prolétariat, aux couches non exploiteuses, par les actions dictatoriales de minorités résolues, le marxisme n’aurait pas été le marxisme et aurait reconnu la pleine validité du blanquisme. Mais le socialisme ne passe pas par des voies détournées, terrestres ou célestes. Il est possible, parce qu'il est la pratique de millions d'ouvriers, de chaque ouvrier pris non comme individu mais comme l'expression d'une même force collective. Affirmer que la réalisation du communisme, c'est une simple question de "dictature monoparti, totalitaire du prolétariat dirigé par le parti de classe", c'est tout simplement trahir l'essence du socialisme.
Enfin, le prolétariat représente historiquement les intérêts de l'humanité toute entière. Il n'a pas de privilège de classe ou de caste à défendre. Il vise non à se perpétuer comme classe, à devenir une classe exploiteuse totalitaire -ce qui est contraire à son essence- mais à saper les bases mêmes de son existence ; en intégrant en son sein, les classes non exploiteuses et même les membres des classes exploiteuses déchues, le prolétariat fait surgir une véritable communauté humaine, fraternelle et libre. Sa dictature de classe se traduit immédiatement par l'extension, l'élargissement de la démocratie ouvrière, "l'extension sans précédent de la démocratie réelle en faveur des classes laborieuses opprimées par le capitalisme" (Lénine).
- “Seul, le pouvoir des ouvriers non intéressés à la propriété privée des moyens de production et à la lutte pour le partage ou un nouveau partage de ces moyens est en mesure de le faire" (Lénine).
Le prolétariat ne pourra jamais parvenir au socialisme, s'il ne donne à lui-même et à l'ensemble des exploités, à l'humanité tout entière, le goût de la société sans classes fondée sur la liberté matérielle et spirituelle la plus totale. Il en donnera le goût, non par l'étouffement de la société, par de des massacres sans fin, à coup de camps de concentration, mais en brisant les chaînes de l'esclavage qui l'enserrent. Si le prolétariat est amené dans la révolution, à utiliser la violence, il ne fera pas de nécessité vertu. De telles mesures ne sont pas sa pratique spécifique, mais lui sont imposées par la bourgeoisie ; elles sont exceptionnelles et doivent immédiatement laisser place à la démocratie ouvrière, sous peine de dégénérer, de faire perdre au prolétariat son propre but, et, donc, sa propre pratique.
La révolution russe : la démocratie ouvrière impossible?
Et pourtant, diront certains ouvriers rendus méfiants par la contre-révolution stalinienne : "ce que vous dites, vous marxistes, est très beau en théorie, nous ne pouvons qu'y adhérer ; mais donnez-nous des exemples où votre dictature du prolétariat ne s'accompagne pas de restriction de la démocratie ouvrière, et même de violence contre les ouvriers. Regardez donc la révolution russe, ce qu'elle a donné . Il y a un monde entre votre théorie et votre pratique."
Certes oui, la révolution russe nous a montré souvent en négatif la nécessité de la démocratie ouvrière, d'une véritable liberté d'organisation et de critique dans le prolétariat. Certes, il y a eu Kronstadt, l'interdiction des grèves ouvrières pendant la guerre civile, les Tcheka, la militarisation du travail. Mais même négativement, la révolution russe montre la voie du prolétariat dans le futur. Elle montre la validité de la phrase de Marx que "l'émancipation du prolétariat ne saurait être l'œuvre que du prolétariat lui- même". Elle nous montre que le prolétariat ne pourra déléguer son pouvoir ni à l' État, ni à aucun parti censé remplacer sa propre action dans les conseils. Loin d'être un thème de défaitisme, d'abandon de ses propres responsabilités historiques, la révolution russe est un encouragement pour le prolétariat de tirer les leçons de son passé, de comprendre ses propres faiblesses pour ne plus les répéter demain.
De plus cette image de la révolution russe que se sont complus à propager les ennemis du socialisme est à l'opposé de ce qu'elle fut à ses débuts, quand le prolétariat était fort dans ses conseils, quand il n'était pas encore épuisé par la guerre civile. La révolution russe, quand elle fut la dictature des conseils ouvriers et non d'un parti unique, ce fut :
- l'anéantissement de l' État bourgeois avec ses prisons que le prolétariat ouvrit. La destruction de la police et de l'armée bourgeoises. La possibilité pour le prolétariat de dominer la société par la prise du pouvoir.
- une liberté d'organisation et de discussion, de presse illimitée pour le prolétariat. Les conseils ouvriers de 17 ce sont des millions d'ouvriers pouvant enfin avoir leurs locaux, leurs journaux â eux, la liberté enfin de pouvoir décider et imposer des mesures en faveur de leur classe : restriction du temps de travail, augmentation de la consommation ouvrière en s'appropriant les biens de consommation, la gratuité des loisirs, etc.
- même pour les couches non-prolétariennes, les paysans pauvres, la dictature prolétarienne signifia la fin de la dictature des grands propriétaires fonciers, la possibilité de sortir de l'abrutissement de la campagne par la participation aux soviets, par un début d'intégration au prolétariat dans la production, en participant ainsi à la démocratie ouvrière des conseils.
-------------------
Que cette démocratie puisse s'épanouir pleinement, cela dépend du succès de la révolution mondiale, du triomphe de la révolution dans les centres vitaux du capitalisme.
La "démocratie ouvrière" n'est pas un idéal que le prolétariat devrait atteindre, à travers le sang et la terreur, la contrainte et l‘oppression. ELLE SERA LA PRATIQUE MÊME DU PROLÉTARIAT AU COURS DE LA RÉVOLUTION, son élargissement signifiant non le recul du prolétariat, son affaiblissement devant des forces hostiles, mais sa marche en avant vers le socialisme, où s'opère le passage du "règne de la nécessité* dans le règne de la liberté.
Ch.
[1] Les trotskystes montrent leur véritable visage d'agents du capital lorsqu'ils disent que la "démocratie ouvrière" "signifie que la liberté d'organisation politique devrait être accordée à tous ceux, y compris des éléments pro-bourgeois, qui, dans les faits, respectent la constitution de l’État ouvrier" ("Démocratie socialiste et dictature du prolétariat", brochure LCR, mai 1978).
Le "camarade" Brejnev, qui respecte la constitution de l'"État ouvrier" russe, peut dormir sur ses deux oreilles. Le trotskysme a le plus grand respect pour l' État capitaliste russe.
Vie du CCI:
- Débat [21]
Questions théoriques:
- Démocratie [34]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Réponse au «F.O.R.» (II)
- 11 lectures
Suite de la lettre du F.O.R. parue dans le n° précédent.
..."Mais, parlons de notre divergence sur la nature des événements en Espagne de 1936 (et même avant) à 1937. Il est pour le moins étrange que vous ne considériez pas comme révolutionnaire une insurrection qui aboutit à la suppression de fait de l'État bourgeois laissé sans police et sans armée, donc sans pouvoir, au surgissement de comités-gouvernement et de milices ouvrières un peu partout dans l'Espagne non occupée par les troupes franquistes, une insurrection enfin où le prolétariat s'est montré d'une dynamique telle qu'il n’avait jamais eu auparavant. Par ailleurs, vous affirmez que le prolétariat s 'est fait embrigader dans la "lutte anti-fasciste" ; mais cela n'est vrai qu'après l'écrasement de ses éléments les plus radicalisés après mai 37. Enfin, l’insurrection de mai 37 à Barcelone fut sans nul doute le point culminant, la marque de la conscience prolétarienne la plus radicale de la vague révolutionnaire débutée en 1917 car, pour la première fois (et il faut bien le dire, pour la dernière fois) le prolétariat s'affrontait les armes à la main â la fois au stalinisme et aux démocrates bourgeois. Que le prolétariat, fortement influencé par l'anarchisme, ait permis que l'État bourgeois républicain subsiste (même sans aucun pouvoir), ce qui lui a permis de se ressaisir et de, petit à petit, rassembler et organiser ses forces en vue de réprimer le prolétariat ; qu'il n'ait pas centralisé l’appareil d’État qu’il s’était constitué et qui exerçait sa seule autorité jusqu'à ce que l'État bourgeois se redresse, cela, nous ne le nions pas. Mais il est inutile que nous nous étendions plus longtemps sur ce sujet et passons aux implications qu'entraîne votre position sur la nature des événements espagnols de 1936 à 1937 en relation avec d’autres de vos positions.
Vous parlez de "crise révolutionnaire" pour mai. 68, alors que les événements qui sont advenus à cette époque, même s’il ne manque pas d'intérêt de se pencher sur eux, n'ont rien à voir avec un quelconque renversement de pouvoir. Il semblerait donc que la différence de langage au sujet de la révolution espagnole trouve des racines plus profondes qu'une simple méconnaissance par le CCI de l'histoire. Pour le CCI, le prolétariat est écrasé à partir de 1923, et la course à la guerre est inévitable à partir de 1929. Parler de "révolution espagnole" ne serait-il pas bien gênant car ce serait reconnaître que le prolétariat n'était pas écrasé partout et qu’il y avait encore des possibilités de révolution ? Par contre, si mai 68 fut le théâtre d'une "crise révolutionnaire", n’est-ce pas parce que la "crise" doit, selon les principes du CCI, permettre (grâce à lui en dernière instance) la révolution ? À nos yeux, donc, le CCI, loin de baser ses positions sur la réalité, base la réalité sur ses positions -c'est-à-dire la déforme.
Mais revenons sur le fait que vous affirmez que, au moment où ce que nous appelons la révolution espagnole éclatait, le prolétariat mondial était écrasé et le cours vers la guerre inéluctable, reprenant ainsi les positions de la fraction "Bilan" qui se contentait par conséquent ie se croiser les bras, acte, ou plutôt non-acte, considéré par vous corme éminemment révolutionnaire. Plus de révolution possible puisque le prolétariat mondial était écrasé, dites-vous. Tout d’abord, nous ne pensons pas que le prolétariat était écrasé en 1936, et, en général, nous affirmons que l’écrasement du prolétariat, quand il a lieu à un moment donné, peut très bien n'être que momentané et en aucun cas ne préjuge sur ses capacités de lutte et sur les perspectives de révolution dans la période en cours. D'autre part, l'application de vos positions aboutit â transformer la défense de l'internationalisme prolétarien et le défaitisme révolutionnaire en de simples formalités : lorsqu'une guerre est déclarée, le prolétariat est alors écrasé, sans quoi il pourrait immédiatement se lancer contre la guerre dans la révolution... Or, penser qu'il restera écrasé durant toute la période de guerre en agitant le défaitisme révolutionnaire et la défense de l'internationalisme prolétarien, c'est oublier que ces deux principes ont pour objectif de pousser le prolétariat mondial à la révolution... Mais que faire avec un prolétariat écrasé jusqu’à la fin de la période en cours c'est-à-dire de la guerre ? Ce qu'il faut bien retenir en conclusion de ceci, c 'est que la lutte des révolutionnaires ne doit à aucun moment cesser (comme "Bilan" l'a fait) même si le prolétariat est, dans l'immédiat, écrasé . Aussi, ne voir dans les événements en Espagne qu'un des jalons vers la guerre impérialiste (qui, en effet, se préparait) rendue dans le même temps inéluctable, c’est contredire à toute possibilité réelle de renversement par le prolétariat de quelque situation que ce soit.
------------------------------------------------------
L'appréciation des événements en Espagne entre 36 et 39 constitue incontestablement une divergence majeure entre nos deux organisations. Nous profitons donc de votre lettre pour critiquer ce que nous considérons être une analyse complètement erronée de ces événements : celle qui en fait "le point culminant de la vague révolutionnaire débutée en 17."
Dans votre lettre vous ne "niez pas" que le prolétariat "fortement influencé par l'anarchisme, ait permis que l' État bourgeois subsiste... ce qui lui a permis de se ressaisir...et...de réprimer le prolétariat". Mais au lieu de tirer des enseignements de cette constatation, et de la confronter avec votre autre assertion suivant laquelle "ce prolétariat s'est montré d'une dynamique telle qu'il n'avait jamais eue auparavant", vous coupez court et concluez : "mais il est inutile que nous nous étendions plus longtemps sur ce sujet..." On comprend que vous n'ayez pas envie de vous étendre là-dessus, que vous n'ayez pas envie de comprendre comment un prolétariat que vous dites aussi conscient se soit finalement laissé battre de cette façon : cela risquerait d'être un peu douloureux pour vos bonnes certitudes quant à la haute valeur révolutionnaire des événements d'Espagne. Aussi nous nous "étendrons" un peu, à votre place, sur les enseignements à tirer de ces événements.
Avant cela, nous voudrions vous signaler une petite bourde de votre lettre : vous attribuez une note plus élevée aux ouvriers espagnols de 37 qu'aux ouvriers russes ou allemands de 17 ou de 18 parce que "pour la première fois, le prolétariat s'affrontait les armes à la main à la fois au stalinisme et aux démocrates bourgeois". D'une part, on voit mal comment des ouvriers auraient pu affronter le "stalinisme" en 17 ou 18. D'autre part, les ouvriers russes et allemands, s'ils n'avaient pas en face d'eux une alliance entre démocrates et staliniens (et pour cause!) ont dû, par contre, s'affronter à la sainte-alliance entre démocrates et socialistes qui, à leur époque, constituaient déjà le dernier rempart du capitalisme. C'est justement parce qu'ils ont su déjouer les pièges que leur tendaient les partis de gauche et "ouvriers" (mencheviks, socialistes-révolutionnaires, "troudoviks") que les ouvriers russes ont détruit le gouvernement bourgeois et instauré la dictature du prolétariat. Et c'est justement ce que n'ont pas été capables de faire les ouvriers espagnols. Leur réplique du 19 juillet 36 au putsch fasciste, la rapidité et l'ampleur avec lesquelles ils se sont mobilisés, le courage dont ils ont fait preuve pour attaquer, souvent à main nue, les casernes, sont une manifestation incontestable et remarquable de combativité prolétarienne. Mais si on ne peut pas les dissocier, combativité et conscience ne sont pas rattachées par un lien mécanique : à la haute combativité des ouvriers espagnols, et notamment catalans, correspondait un niveau de conscience finalement assez bas. En effet, il serait illusoire de distinguer un prolétariat d'un côté qui aurait été le "plus conscient" de l'histoire de la lutte de classe et de l'autre le fait qu'il était "fortement influencé par l'anarchisme". Le simple fait que l'anarchisme ait eu une telle influence parmi les ouvriers espagnols et non les conceptions communistes (au sens révolutionnaire s'entend, celui des bolcheviks ou des spartakistes et non évidemment au sens stalinien) est une manifestation de l'arriération politique et idéologique de ces ouvriers : à moins de penser que l'anarchisme représente la plus haute expression de la conscience prolétarienne. Mais, à notre connaissance, telle n'est pas votre analyse, puisque vous considérez justement comme une faiblesse du prolétariat l'influence qu'avait sur lui l'anarchisme.
Effectivement, l'anarchisme, sous sa forme anarcho-syndicaliste, avait une grosse influence sur les ouvriers d'Espagne 36. À ce phénomène, on peut attribuer plusieurs causes :
- le niveau d'arriération économique du pays, où le prolétariat, bien qu'as- sez nombreux, travaillait dans une multitude de petites entreprises, et était resté réceptif aux influences petites-bourgeoises (dont Proudhon avait été le grand théoricien) ;
- le fait, qu'épargné par la première guerre mondiale, le capitalisme espagnol n'avait pas eu l'occasion d'intégrer ouvertement les syndicats dans les rouages étatiques comme ce fut le cas par exemple en France en 14 où la CGT "révolutionnaire" et son chef Jouhaux avaient pratiqué la "présence" dans les cabinets ministériels ;
- le discrédit que le réformisme avait fait peser sur le socialisme et que la dégénérescence de la révolution russe avait fait peser sur le "marxisme autoritaire" coupable, d'après les anarchistes, de tous les maux qui accablèrent cette révolution.
Dans ces conditions originales, uniques en Europe, la crise économique mondiale des années 30 avait provoqué de très fortes réactions de la part des ouvriers espagnols, qui se reconnaissaient de plus en plus dans le langage radical de la CNT et dans son refus de participer aux compromissions coutumières des socialistes ou des staliniens. Mais la dure épreuve des faits allait être fatale à l'anarcho-syndicalisme. Incapable de comprendre que la première étape de la révolution prolétarienne réside dans la destruction de l' État capitaliste et dans l'instauration de la dictature du prolétariat, levier politique pour une transformation progressive des rapports économiques, la CNT, toute occupée à "implanter le communisme libertaire" dans chaque commune et dans chaque entreprise, a résolu la question du pouvoir politique de la façon la plus désastreuse qui fut : non en incitant les ouvriers à prendre ce pouvoir mais en les incitant à apporter leur soutien à l' État bourgeois. Et si on veut établir un rapprochement entre la révolution russe de 1917 et les événements d'Espagne en 36-37, on peut dire que la CNT a occupé, sur la scène politique, une position semblable à celle des mencheviks : soutien critique au gouvernement "démocratique", puis participation à ce gouvernement en vue de lui donner une coloration plus "ouvrière" (entrée des anarchistes à la "Generalitat" de Catalogne le 26 septembre 36, au gouvernement central le 4 novembre comparable à l'entrée des mencheviks au gouvernement provisoire en mai 1917). Et, de fait, les arguments mêmes utilisés par la CNT pour justifier sa participation sont du meilleur cru réformiste et social-démocrate : "La CNT a toujours été, par principe et par conviction, anti-étatiste et ennemie de toute forme de gouvernement. Mais les circonstances ont changé la nature du gouvernement et de l' État espagnols... Le gouvernement a cessé d'être une force d'oppression contre la classe ouvrière de même que l' État n'est plus l'organisme qui divise la société en classes. Tous deux cesseront encore plus d'opprimer le peuple avec l'intervention de la CNT dans leurs organes" ("Solidaridad Obrera“ du 13 novembre 1936).
Si on suit la thèse du FOR, on aboutit donc à la conclusion absurde que tout en se laissant mystifier par l'équivalent des mencheviks, tout en leur conservant sa confiance, tout en étant incapable de faire surgir en son sein un véritable parti révolutionnaire, de s'organiser en conseils ouvriers à l'échelle du pays, de prendre le pouvoir politique, le prolétariat espagnol était plus conscient, est allé plus loin que le prolétariat russe de 17, qui a repoussé les bavardages mencheviks, qui s'est donné le parti le plus avancé de l'histoire du mouvement ouvrier, qui s'est donné une auto-organisation et a pris le pouvoir à l'échelle d'un pays immense. On ne voit vraiment pas comment le FOR lui-même peut croire à ce qu'il avance! Peut-être estime-t-il que ces fameux "comités-gouvernements" étaient une forme d'organisation supérieure aux conseils allemands ou aux soviets russes. C'est là une conception défendue par Andres Nin, dirigeant du POUM[1] :
- "En Russie, il n'y avait pas de tradition démocratique, pas de tradition d'organisation et de lutte dans le prolétariat. Nous avons des syndicats, des partis, des publications, un système de démocratie ouvrière. On comprend l'importance qu'eurent les soviets. Le prolétariat n'avait pas ses organisations propres. Les soviets furent une création spontanée qui en 1905 et en 1917, prirent un caractère totalement politique. Notre prolétariat avait déjà ses syndicats, ses partis, ses organisations propres. C'est pour cela que les soviets n'ont pas surgi parmi nous."
Mais ce qui, pour Nin, constituait une force du prolétariat espagnol était, en réalité, une de ses plus grandes faiblesses. Ces fameux comités, en effet, au lieu d'être l'émanation directe des assemblées générales ouvrières, des organismes élus et révocables par elles, étaient la plupart du temps constitués par des délégués nommés par les différentes organisations se réclamant de la classe ouvrière : les syndicats CNT et UGT, les partis socialiste, stalinien et le POUM. Et il en était ainsi à tous les niveaux, les "comités de base" n'ayant pratiquement aucun contrôle sur les comités du "sommet" comme "le comité central des milices anti-fascistes" de Catalogne ou le "comité exécutif populaire" de Valence. À cet égard, le "conseil de défense" d'Aragon faisait figure d'exception puisque résultant de la fédération des divers comités de villes et de villages eux-mêmes nommés par des assemblées générales. Nous ne prétendons pas qu'une forme différente de ces comités aurait changé radicalement le cours des événements en Espagne. Contrairement aux conseil listes, nous ne sommes pas des fétichistes de la forme, nous ne disons pas que l'organisation des ouvriers en conseils les préservent de toute influence bourgeoise, mais nous affirmons, avec l'Internationale Communiste, que dans la période de décadence du capitalisme ouverte par la première guerre mondiale, ceux-ci constituent l'organisation autonome et générale de la classe ouvrière en période révolutionnaire, la "forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" (Lénine)
Et ces fameux "comités" constitués sur la base de la lutte contre le fascisme, purent d'autant mieux devenir des auxiliaires du gouvernement de la République, avant de prononcer leur auto-dissolution, qu'ils étaient directement l'émanation d'organisations ouvertement hostiles aux luttes ouvrières ou incapables de leur indiquer une orientation de classe. Le FOR rejette l'idée qu'avant mai 37 le "prolétariat se soit fait embrigader dans la lutte anti-fasciste en dehors donc de son terrain de classe." C'est faux! Parmi tous les exemples qui illustrent le contraire nous ne donnerons, par manque de place, que cette déclaration de Joaquim Ascaso, président du conseil d'Aragon (pourtant le plus "radical" des différents comités) suite à une entrevue avec Largo Caballero le 31 octobre 1936 :
- "L'objet de notre visite a été de présenter nos respects au chef du gouvernement et de l'assurer de notre attachement au gouvernement du peuple. Nous sommes prêts à accepter toutes les lois qu'il promulguera et, de notre côté, nous demanderons au ministre toute l'aide dont nous avons besoin."
De fait, malgré une poussée initiale très forte dans les rangs ouvriers en faveur d'un renversement immédiat des institutions officielles de la bourgeoisie républicaine, ceux-ci ont finalement capitulé devant l'argument "qu'avant de faire la révolution, il fallait d'abord gagner la guerre" ressassé par les leaders anarchistes. Et cela, en l'espace de quelques semaines.
Dans votre lettre, vous comparez les événements de 1936 à ceux de mai 68 : pour vous, les premiers représentent une expression de la lutte de classe bien plus élevée que les seconds (que le CCI ne qualifie pas de "crise révolutionnaire" comme vous le dites). Certes, sur le plan de l'intensité des affrontements, la comparaison est à peine possible, cependant ce que vous ne voyez pas, c'est que ceux de 36 représentaient un ultime soubresaut rapidement dévoyé d'un prolétariat victime d'une contre- révolution chaque jour plus profonde, alors que ceux de 68 constituaient une première manifestation d'une reprise générale après cette terrible contre-révolution. Et c'est justement parce que les ouvriers d'Espagne luttaient dans un environnement international de silence de la lutte de classe, qu'au lieu de compter sur la solidarité internationale de leurs frères de classe et de faire appel à elle, ils se sont rendus aux arguments des larbins de la bourgeoisie comme Garcia Olives, lequel déclarait :
- "La bourgeoisie internationale refusait de nous fournir les armes dont nous avions besoin... Nous devions donner l'impression que les maîtres étaient non les comités révolutionnaires, mais le gouvernement légal : faute de quoi, nous n'aurions rien du tout. Nous avons dû nous plier aux inexorables circonstances du moment, c'est à dire accepter la collaboration gouvernementale."
C'est bien pour cela que nous considérons que ce qui ressort essentiellement des événements d'Espagne 36, ce n'est pas un quelconque aspect révolutionnaire des luttes de classe qui s'y sont menées, mais bien la façon dont ces luttes ont été dévoyées dans le soutien d'un camp de la bourgeoisie contre un autre, d'un camp impérialiste contre un autre.
[1] Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, petit parti surtout influent en Catalogne qu'on peut situer à l'extrême-gauche de la social-démocratie puisqu'il collaborait avec "l'Indépendant Labour Party" et le PSOP de Marceau Pivert au sein du "Bureau de Londres".
Vie du CCI:
- Polémique [31]
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution Internationale N°58 - fevrier
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 402.67 Ko |
- 567 lectures
Réponse au «F.O.R.» (III)
- 16 lectures
Nous publions ici la 3ème partie de la lettre que nous a adressé le "Ferment Ouvrier Révolutionnaire" (cf. RI n° 56 et RI n° 57) et la réponse qu'elle appelle de notre part.
**********************
... À part cela, le paragraphe de votre article sur Trotsky et les "trotskystes" a retenu également notre attention.
Tout d'abord, jamais le "Pour un second manifeste communiste" n'a défini le courant trotskyste comme "réformiste" mais comme "réformiste vis-à-vis du stalinisme" ce qui est quelque peu différent. Cependant, cette rectification étant faite, aujourd'hui, en effet, une très grande partie d'entre nous ne considère plus cette définition comme valable et préfère souligner que le "trotskysme" se rapproche de plus en plus de la contre-révolution.
Pour ce qui est du "préjugé favorable" pour LO que notre groupe a en effet à un moment montré, nous pensons encore maintenant que le F.O.R. n'a pas eu tort d'espérer que LO donnerait quelque chose d'intéressant puisqu’en 1974, Union Ouvrière scissionnait. Bien entendu, nous savons que, pour vous,U.0. n'a jamais été qu'un ramassis d'"avortons du capital", mais nous jugeons ce qu'a été U.O. différemment de la manière si peu indulgente et si rapide dont vous l'aviez jugée du haut de votre promontoire de "futur parti de la révolution".
Enfin, sur le fait que nous faisons une différence entre Trotsky, le "maître" comme vous dites, et les "trotskystes", les "disciples", une question une seule : faites-vous une différence entre Marx et ceux qui se baptisent "marxistes", entre Lénine et ceux qui se baptisent "léninistes", entre Bordiga et ceux qui se baptisent "bordiguistes" ?
En dernier, vous nous demandiez de nous prononcer sur la caractérisation de la période présente. Bien que nous pensions qu’un adjectif n'a pas un intérêt majeur, nous nous prononçons ici à ce sujet clairement : malgré l'agitation qui s'est déclarée depuis plusieurs années, nous pensons que la période est encore contre-révolutionnaire car rien ne nous indique que la période ait changé dans sa nature.
Voilà, nous pensons avoir épuisé les problèmes que soulevait votre SALUT A "ALARME". Nous ne ferons pas paraître cette présente lettre dans notre journal car, pour le moment, nous ne voulons pas y faire entrer de polémiques entre groupes.
Le 27 octobre 1978, Salutations communistes
F. 0. R
***************************
Cette partie de votre lettre traite principalement de Trostky et du trotskysme mais avant d'aborder cette question, nous voudrions dire quelques mots de votre idée que "malgré l'agitation qui s'est déclarée depuis plusieurs années... la période est encore contre-révolutionnaire car rien ne nous indique que la période ait changé dans sa nature".
En premier lieu, il serait nécessaire que vous précisiez ce que vous entendez par "période contre-révolutionnaire". Si vous désignez de cette façon une période qui n'est pas encore révolutionnaire, nous sommes d'accord avec une telle idée. Effectivement, "rien n'indique" encore que la révolution soit à nos portes. De fait, avec une telle définition, c'est pratiquement toute la vie du capitalisme (à l'exception d'une courte période qui va de 1917 à 1923) qu'on peut qualifier de "période contre-révolutionnaire". Cependant, en mettant dans le même sac toutes les périodes autres que celles où le prolétariat s'affronte les armes à la main et de façon généralisée à l' État capitaliste, on s'interdit de comprendre que dans ces autres périodes, il peut exister des moments où la lutte de classe tend à avancer et se généraliser et d'autres où, au contraire, elle tend à reculer au point de laisser la scène politique entièrement occupée par le jeu interne du capitalisme. Il en est ainsi de la période qui va de 1'épuisement et de la défaite de la vague révolutionnaire du premier après-guerre jusqu'au milieu des années 60. Globalement, pendant toute cette période, c'est le capitalisme qui a l'initiative, qui a les mains libres pour imposer à la société ses propres "solutions" aux problèmes qui sont posés à celle-ci. C'est ainsi qu'à la suite de la crise économique mondiale de 1929, le prolétariat est incapable de résister au cours vers la guerre impérialiste qui constitue justement la réponse capitaliste à cette crise. Plus : le mécontentement ouvrier qui ne manque pas de se manifester contre la misère que la crise inflige aux travailleurs, s'il est incapable de se transformer en combativité contre le capitalisme, est par contre récupéré par divers secteurs de celui-ci pour mieux encadrer les prolétaires dans la participation à la deuxième guerre mondiale : c'est à la gauche du capital et à l’"antifascisme" que revient la palme de cette politique dont le prolétariat espagnol a été, comme on l'a vu, une des premières victimes. Voilà ce qu'on peut appeler une "période contre-révolutionnaire" ou, plutôt, de triomphe de la contre- révolution. Or, telle n'est pas, dans notre analyse, la nature de la période présente. Ce que vous qualifiez de simple "agitation" : mai 68, "l'automne chaud" italien et les émeutes d'Argentine en 69, l'insurrection des ouvriers polonais de 1970, l'explosion de grèves "sauvages" et très combatives qui touche même des pays aussi "calmes" que l'Allemagne et la Suède au tournant des années 60 et 70, la reprise actuelle des luttes de classe aux USA, en Allemagne, en Grande-Bretagne ainsi que dans des pays arriérés comme le Pérou et maintenant l'Iran, tous ces mouvements constituent pour nous (et nous l'avons affirmé depuis 1968) des indices indiscutables du fait que "la période a changé dans sa nature", que le capitalisme n'est plus entièrement maître du jeu et que, de plus en plus, il devra compter avec ce protagoniste dont on avait oublié jusqu'à l'existence pendant des décennies : le prolétariat mondial.
Venons-en à la question du trotskysme : vous affirmez qu'il n'y a pas unanimité dans votre organisation sur cette question : nous pensons qu'il serait très important que vous fassiez connaître publiquement le contenu de vos débats comme les révolutionnaires l'ont toujours fait dans le passé et comme, pour sa part, le CCI le fait chaque fois qu'apparaissent en son sein des divergences politiques importantes. Ceci dit, même celle de vos positions qui se considère la plus critique à l'égard du trotskysme est, de notre point de vue, encore trop timorée. Pour vous, "le trotskysme se rapproche de plus en plus de la contre- révolution". Pour nous, il est dans la contre-révolution. Nous considérons en effet que sa participation au second conflit impérialiste au nom de l'anti- fascisme et de la défense de l'URSS marque son passage irrémédiable dans le camp du capitalisme. Dans ce conflit, il a complètement abandonné ce qui constitue une des positions fondamentales de la classe ouvrière, l'internationalisme, pour passer corps et âme aux côtés d'un des camps impérialistes, pour participer partout à la "résistance" ou appeler les ouvriers russes à défendre la "patrie socialiste". Et votre façon de faire une distinction entre Trotsky et les trotskystes nous paraît, sur ce point, assez spécieuse. Nous n'identifions pas, nous non plus, Trotsky et les courants politiques qui se réclament de lui. Cependant, les aberrations politiques (du point de vue prolétarien) contenues dans le "Programme de Transition" de 1938 n'ont pas été écrites par un quelconque Mandel, Lambert ou Bois[1], c'est Trotsky lui-même qui y préconise la "défense de l' État ouvrier" et la priorité de la lutte "anti-fasciste". Et les contorsions qu'il est obligé de faire entre le début de la guerre mondiale et son assassinat pour, à la fois, encourager les ouvriers anglais à saboter l'effort de guerre de leur capitalisme et leur demander -au cas qu'il considère probable d'une entrée de l'URSS dans la guerre- de favoriser les livraisons d'armes à l'"État ouvrier", ces contorsions illustrent de façon claire la contradiction entre son souci internationaliste et la nature bourgeoise de sa position. Cette contradiction, la plupart de ses compagnons la résolvent en l'alignant ouvertement derrière un des camps. Que, par la suite, certains de ses proches, y compris sa compagne Natalia Sedova, aient rompu avec la "IVe Internationale" et ses positions chauvines comme lui-même l'aurait peut-être fait s'il n'était tombé sous les coups des tueurs de l'"État ouvrier", n'enlève rien à l'énorme responsabilité -d'autant plus grande qu'il avait été auparavant un grand révolutionnaire- que Trotsky a porté dans le passage du "trotskysme" à la contre-révolution et qui n'a rien à voir avec les erreurs que Marx et même Lénine ont pu commettre et derrière lesquelles se réfugient les faussaires de tout acabit.
De fait, le FOR n'a jamais été capable de faire une rupture claire avec le trotskysme et de comprendre la nature exacte de ce courant. De la même façon que Trotsky a été incapable de rompre complètement avec la dégénérescence de la révolution en Russie et de la 3e Internationale, dans la mesure où il avait lui-même participé à cette dégénérescence, l'appartenance au trotskysme jusqu'à la seconde guerre mondiale des fondateurs du FOR leur a interdit jusqu'à présent de comprendre la nature aujourd'hui contre-révolutionnaire de ce courant, elle-même résultat des positions confuses ou carrément bourgeoises qu'il a véhiculées depuis ses origines et malgré sa propre résistance contre la dégénérescence. C'est ce qui apparaît clairement dans “Pour un second Manifeste Communiste" (1961) où on se contente de relever le caractère "plus qu'insuffisant", "propre à favoriser les opportunismes face à la contre-révolution stalinienne" et désormais "caduc" du Programme de Transition alors qu'on affirme en même temps que : "En contraste avec la dégénérescence réactionnaire de l'internationale Communiste, l'Opposition de gauche , qui fut à l'origine de la IVe Internationale, exprimait la continuité idéologique et organique de la Révolution de la même manière que les groupes internationalistes de 1914 face à la corrosion patriotique de la social-démocratie ". Malheureusement, la "défense de l'URSS" n'était pas, en 1938, seulement "propre à favoriser les opportunismes" mais bien une position bourgeoise comme l'avait compris la Gauche communiste (italienne, allemande et hollandaise) qui, bien plus que l'Opposition de gauche , "exprimait la continuité idéologique et organique de la Révolution" et dont le "second Manifeste" ne dit pas un mot.
Cette incapacité du FOR à couper le cordon ombilical avec ses origines trotskystes l'a conduit à commettre des erreurs de taille sur les scissions qui ont pu secouer les groupes trotskystes et dont votre lettre, au lieu d'en tirer les enseignements, au contraire se vante. Ainsi, pour vous, "le FOR n'a pas eu tort d'espérer que LO donnerait quelque chose d'intéressant puisqu'en 1974, "Union Ouvrière" scissionnait". Peut-être considérez-vous que le FOR n'a "pas eu tort" d'écrire à cette occasion ('Alarma’ n°28) que : "la présence d'Union Ouvrière au sein du prolétariat promet de révéler le fait organique le plus positif arrivé en France pour le moins depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui... la constitution d'Union Ouvrière marquera une nouvelle époque dans la régénération du mouvement révolutionnaire en France". Rien que cela ! Quand on connaît la pitoyable trajectoire suivie par "Union Ouvrière" depuis cette époque, ballotée entre le "situationnisme" et l'ouvriérisme pour sombrer dans le néant, on devrait pouvoir se rendre compte de l'absurdité (et du ridicule !) des analyses d'alors du FOR. Pas du tout dites-vous ! "Le FOR n'a pas eu tort".
EN GUISE DE CONCLUSION...
Au risque de nous attirer encore le mécontentement du FOR qui trouvera probablement que nous le "jugeons du haut de notre promontoire", il nous semble nécessaire de mettre en évidence ce qui, de notre point de vue, constitue la base de ses erreurs politiques : l'incapacité de rompre de façon claire et énergique avec la période de contre-révolution que la classe ouvrière a supportée jusqu'au milieu des années 60 et dont elle a commencé depuis à sortir. Cette incapacité se manifeste sur plusieurs plans :
- son incompréhension de la nature réelle du trotskysme et les illusions qu'il conserve sur ce courant politique, sur sa capacité à constituer un terrain fertile pour l'éclosion d'une pensée révolutionnaire, incompréhension et illusions qui résultent de la rupture incomplète du FOR avec ses origines ;
- son idéalisation des événements d'Espagne auxquels la participation de ceux qui plus tard allaient fonder le FOR ne suffit pas à conférer une nature révolutionnaire ; idéalisation qui, par bien des aspects, s'apparente à celle qu'en font les anarchistes auxquels, d'ailleurs, le FOR fait d'autres emprunts comme le rejet moral des déterminations objectives du mouvement prolétarien, le volontarisme et la vision individualiste de la démarche des révolutionnaires et de l'ensemble des membres de la classe ouvrière ;
- le poids d'une vision qu'on pourrait qualifier de "pessimiste" du prolétariat qui ne saurait, face à la crise, avoir d'autre réaction que celle des années 30: une plus grande atomisation et une plus grande soumission à la bourgeoisie, vision qui s'accompagne de l'incompréhension du changement de période historique': ouverture d'un cours vers des affrontements révolutionnaires.
La dernière manifestation du poids des années de contre-révolution sur le FOR, qui n'apparaît pas dans cette lettre mais n'en est pas moins réelle est son sectarisme, sectarisme qui s'est exprimé notamment par son départ spectaculaire de la conférence internationale de novembre 78 et par le refus de ce groupe de poursuivre la discussion et la confrontation politiques avec les autres courants communistes.
Nous pensons que le FOR est incontestablement un groupe communiste animé d'une sincère volonté révolutionnaire. Mais ces qualités ne suffisent pas aux courants révolutionnaires pour être à la hauteur des tâches pour lesquelles ils ont surgi dans la classe. Pour que le FOR puisse contribuer efficacement au processus déjà engagé de prise de conscience de celle-ci vers de nouveaux affrontements révolutionnaires, il faut qu'il soit capable de tirer à fond les enseignements de plus d'un demi-siècle d'expérience prolétarienne, qu'il se dégage de la "tradition de toutes les générations mortes (qui) pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants" (Marx "Le 18 Brumaire...") et en particulier, qu'il comprenne l'impérieuse nécessité de rompre avec l'esprit de secte et d'engager le débat entre révolutionnaires en vue de préparer leur regroupement futur. Sinon, il est condamné à devenir une entrave à ce processus et finalement à disparaître après avoir stérilisé les énergies révolutionnaires de ses militants et de ceux qu’il influence.
Salutations Communistes
[1] Leaders respectifs de la IVème "Internationale", de l'OCI et de "Lutte Ouvrière".
Vie du CCI:
- Polémique [31]